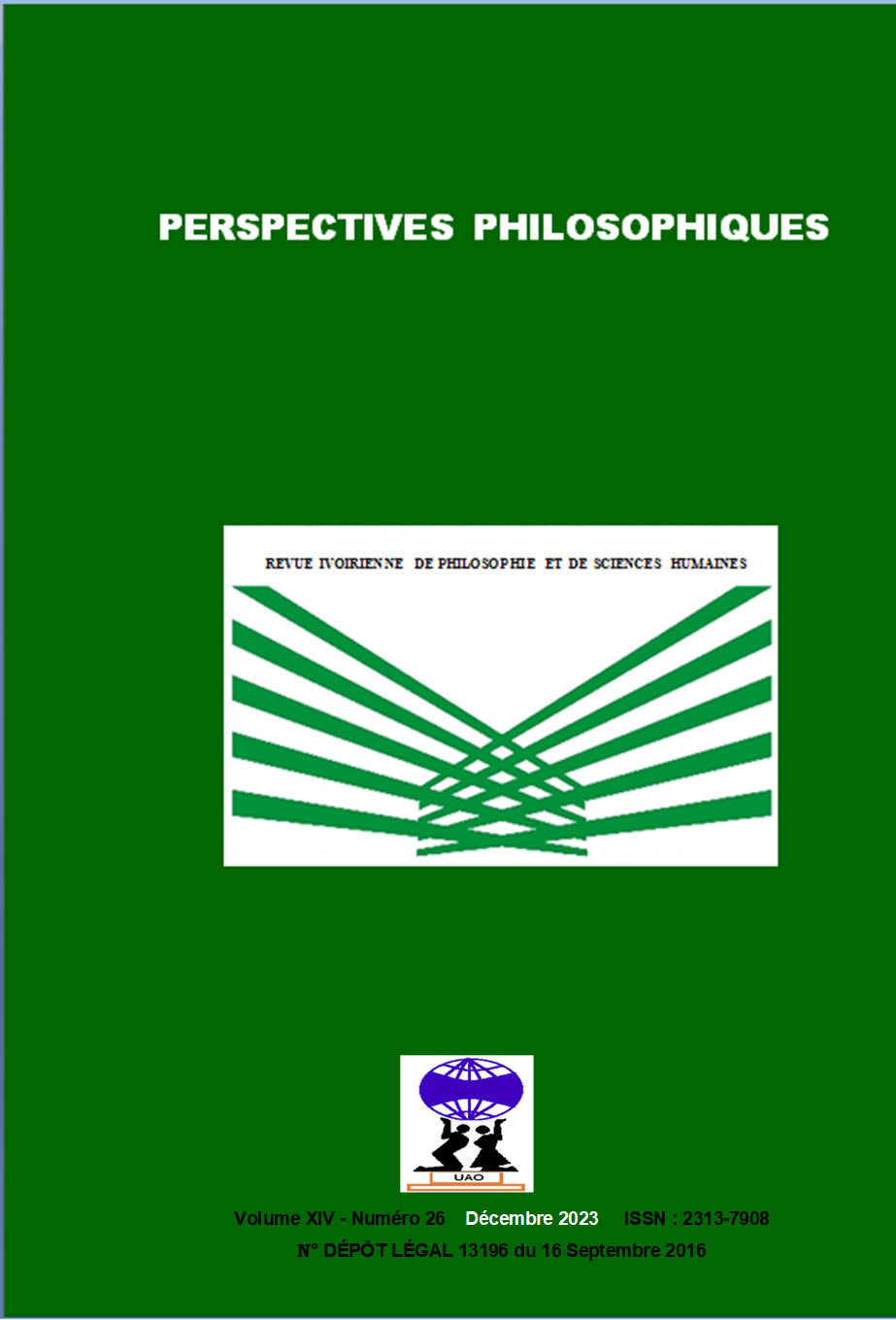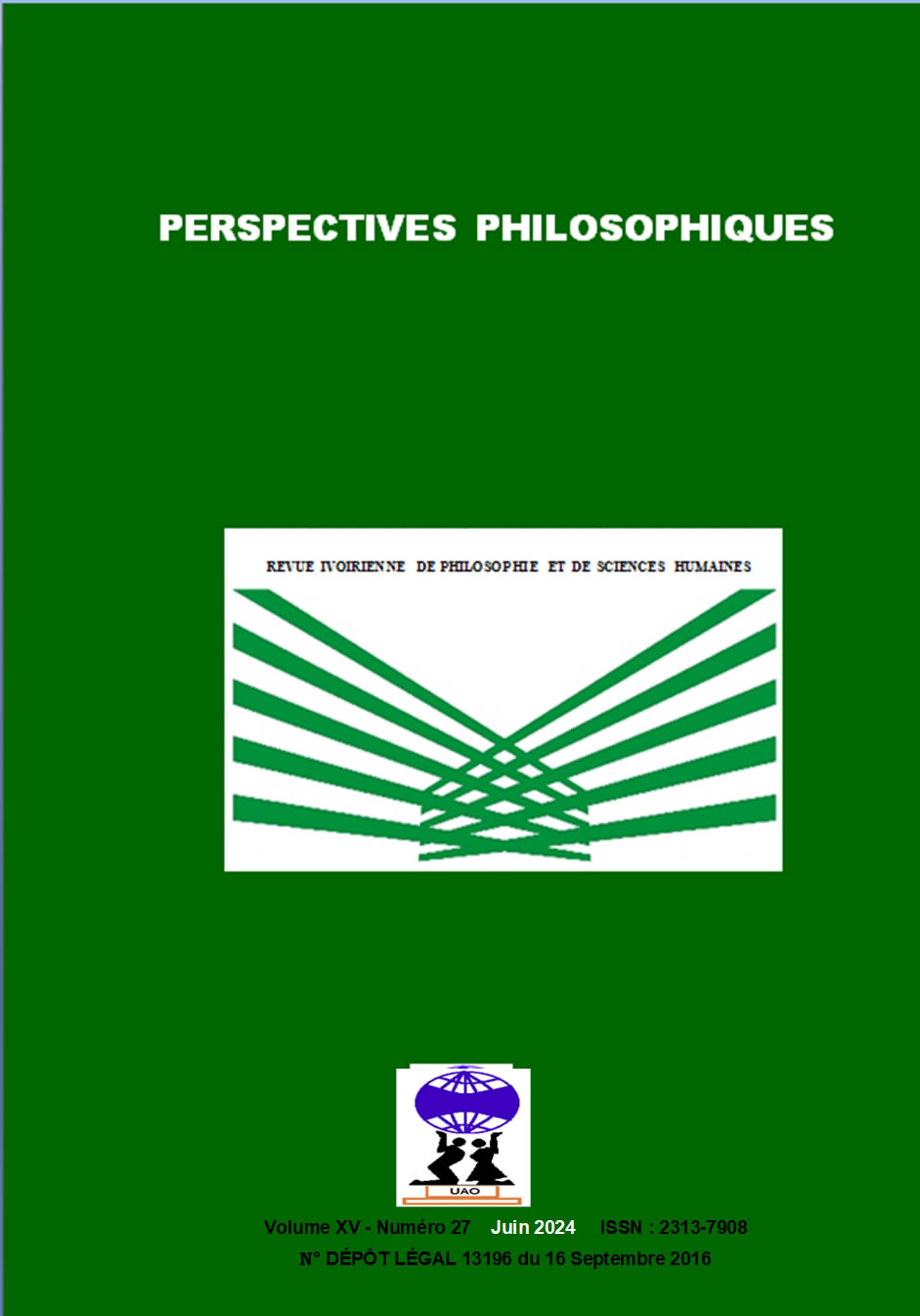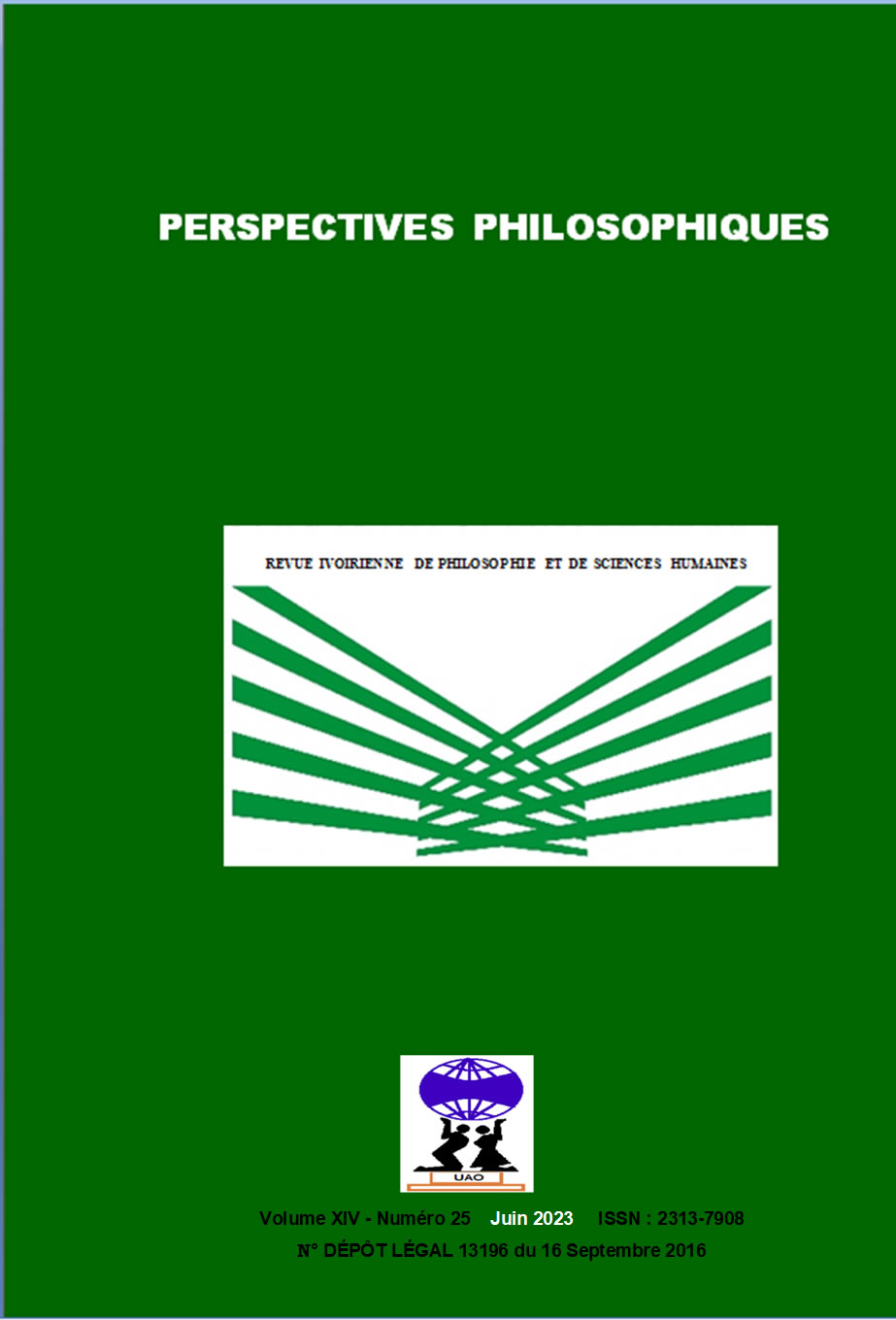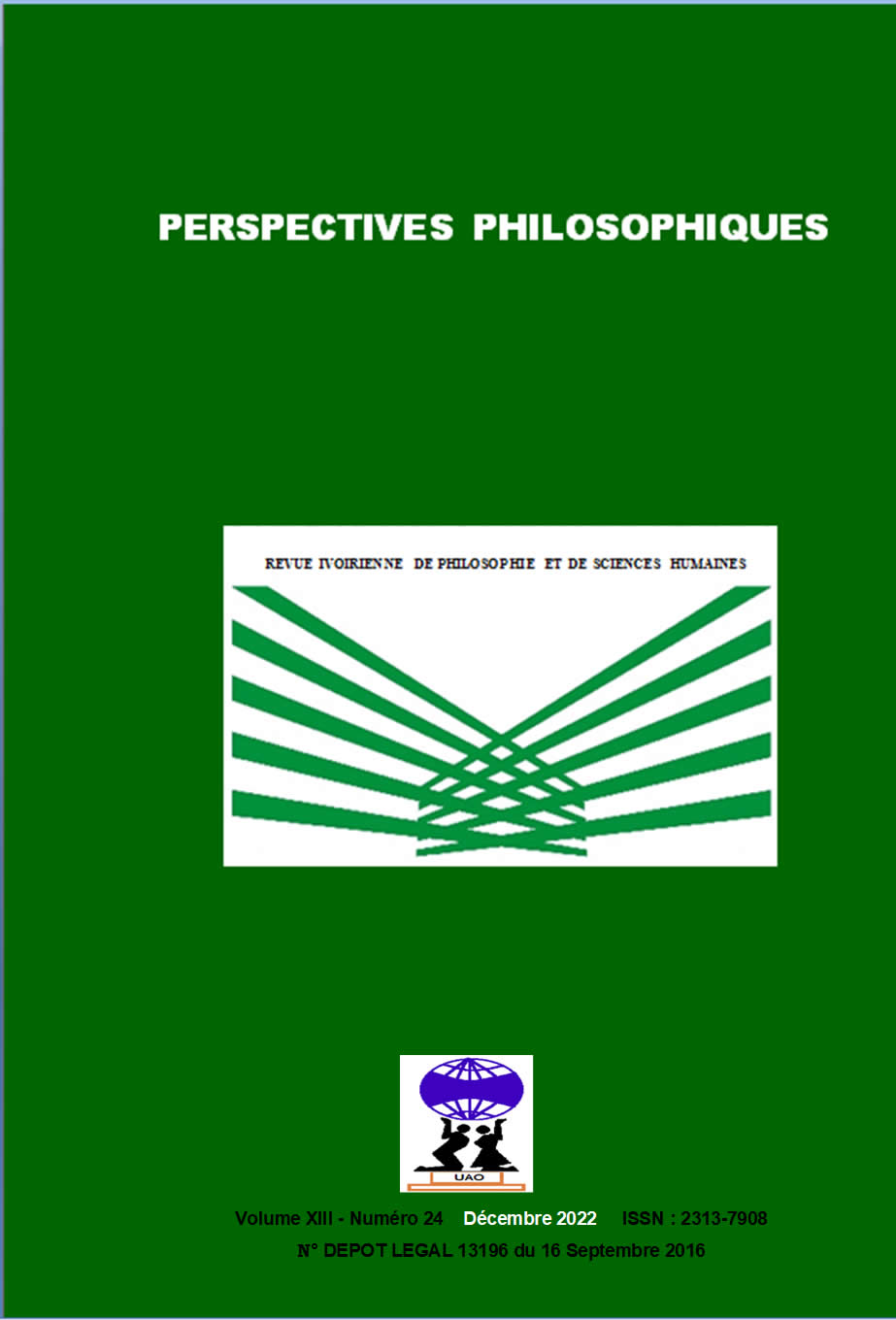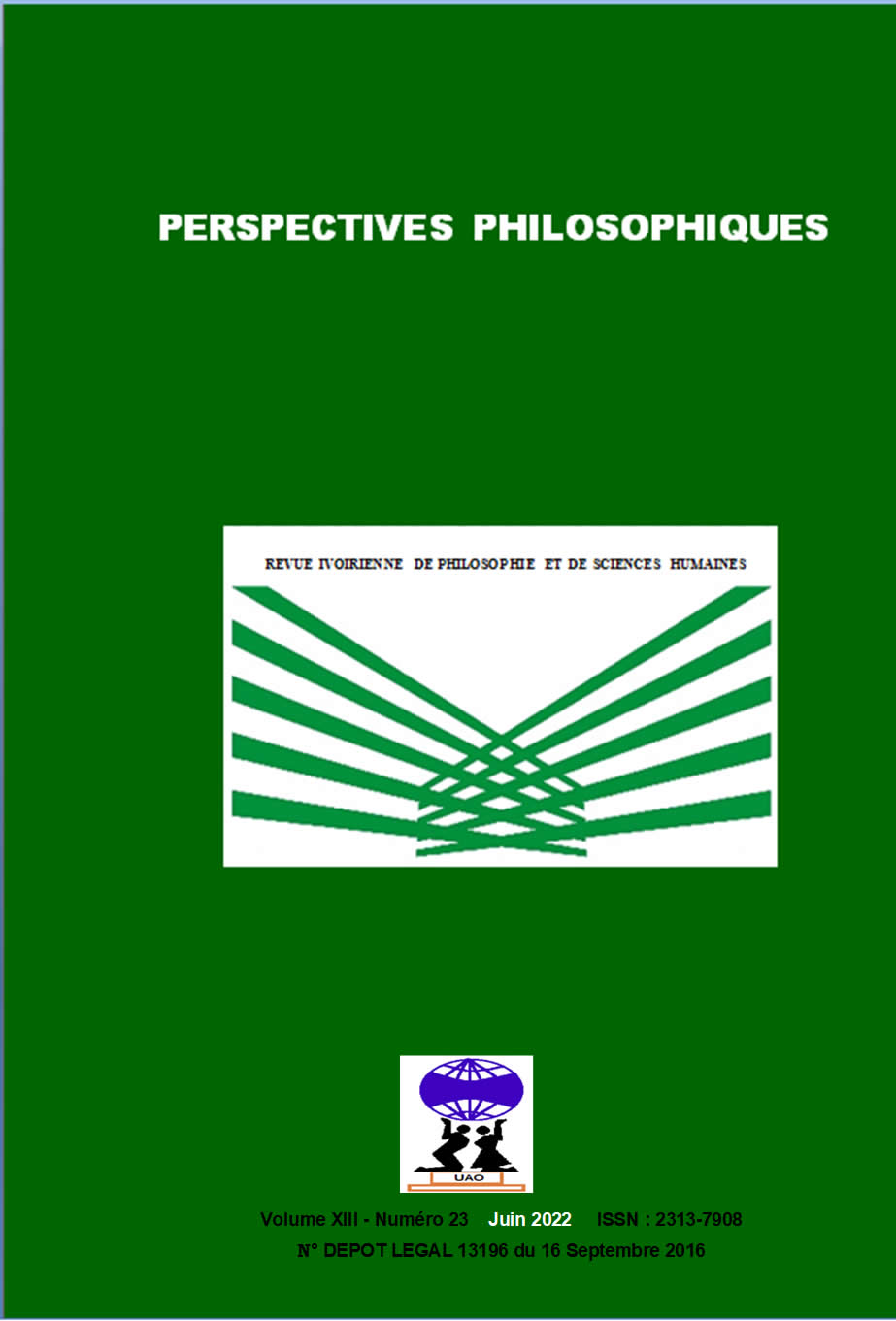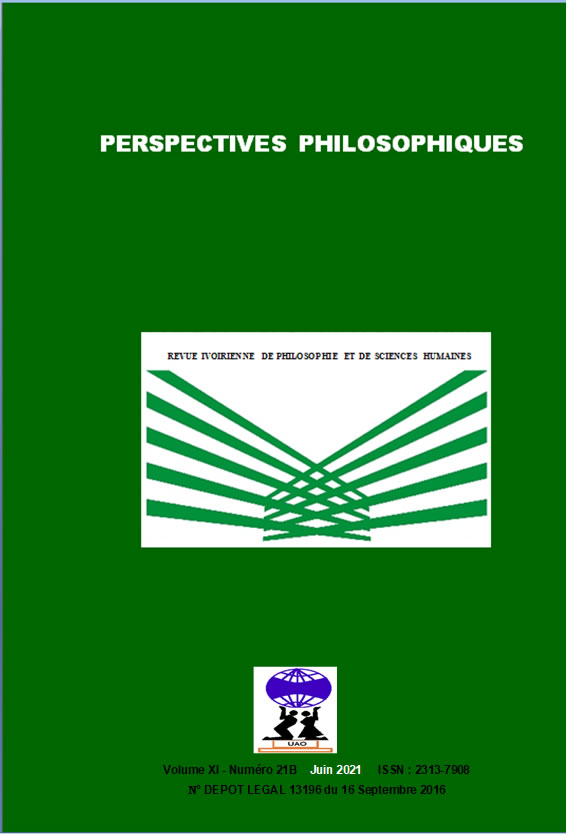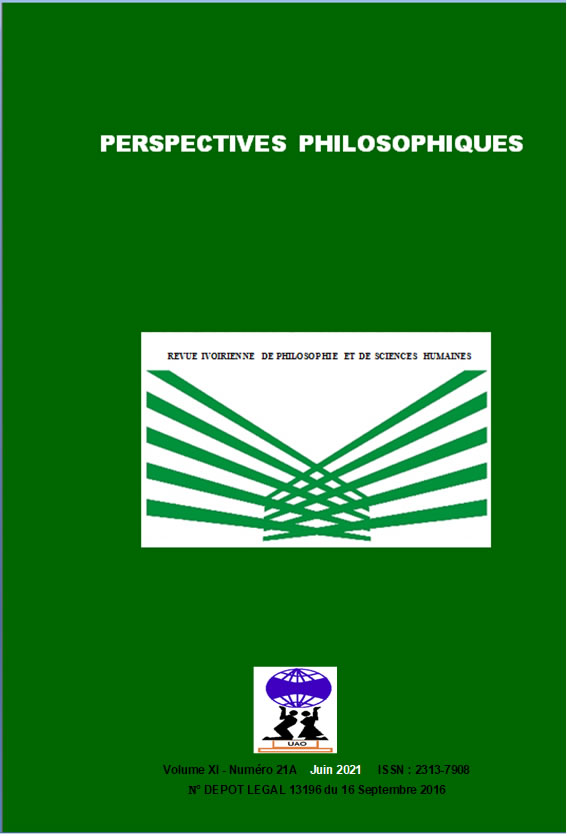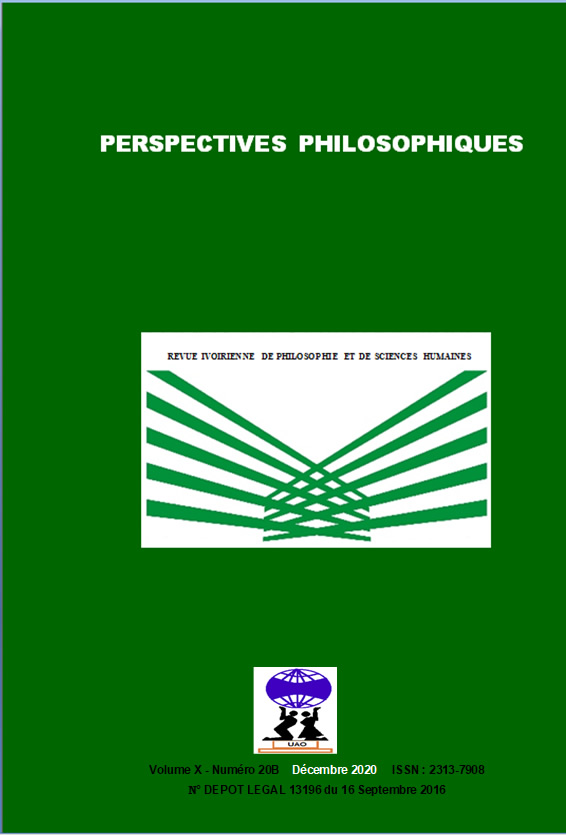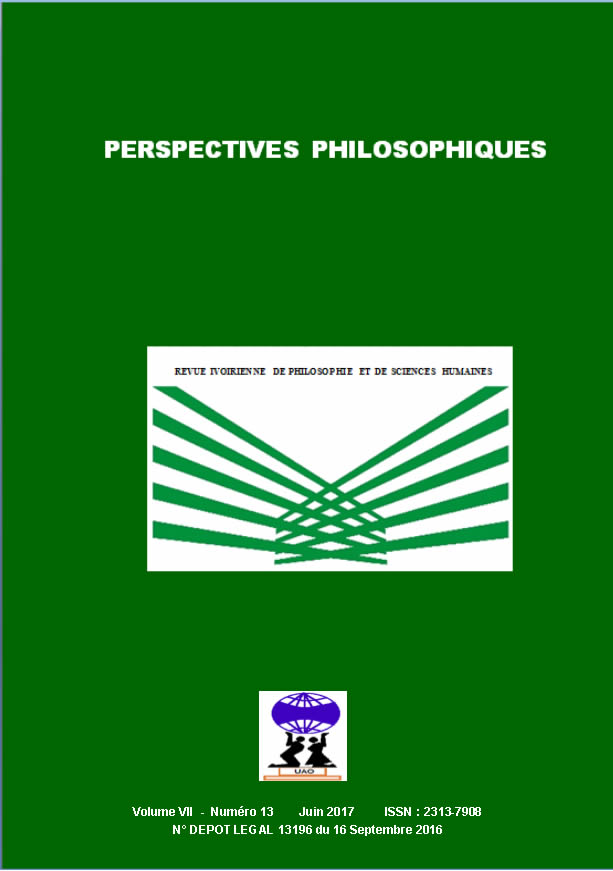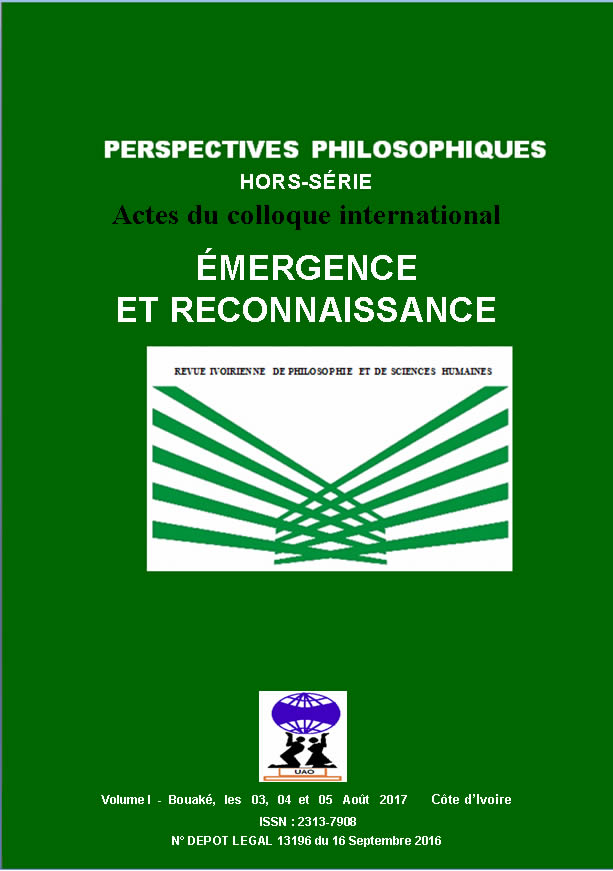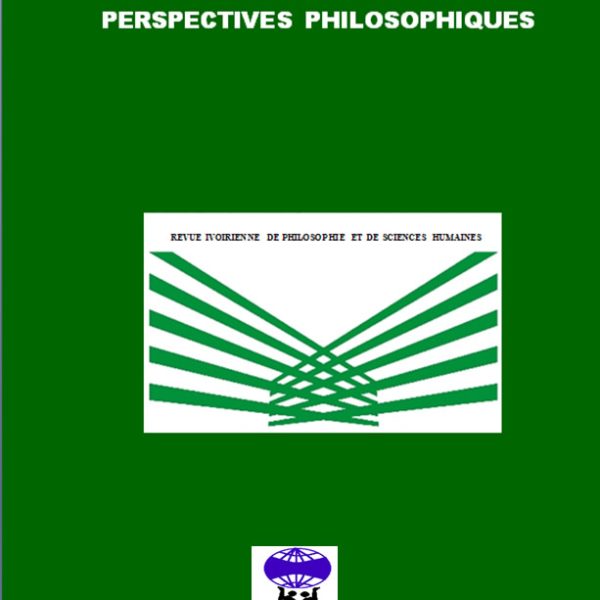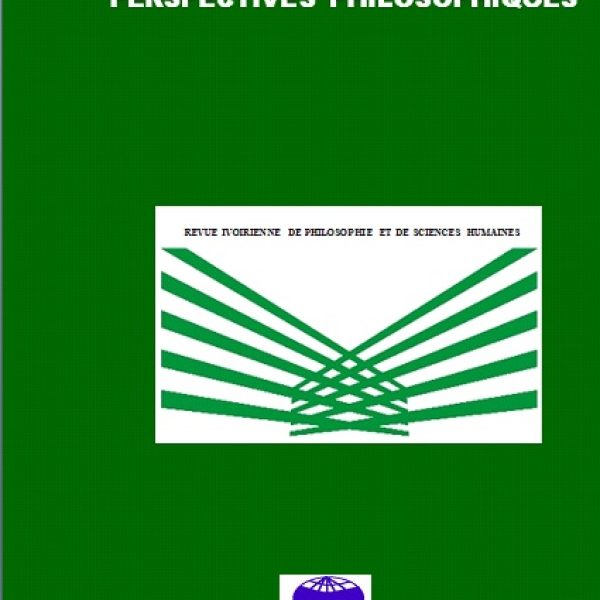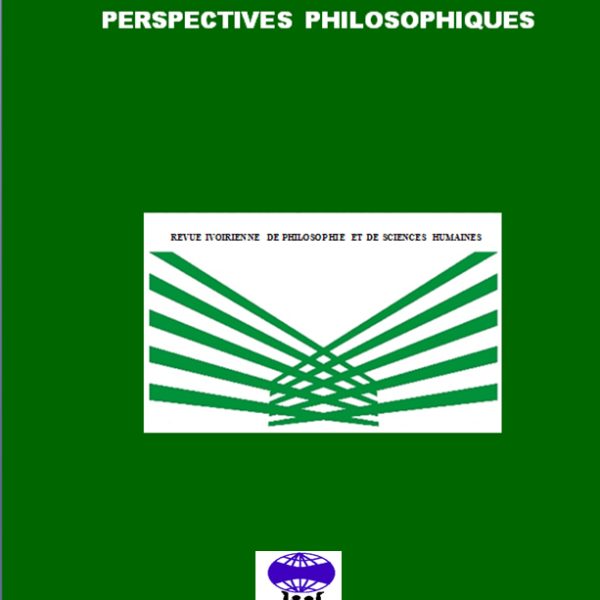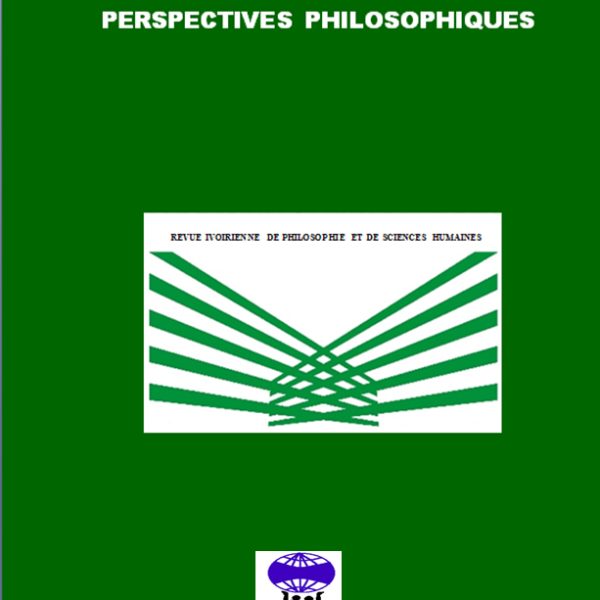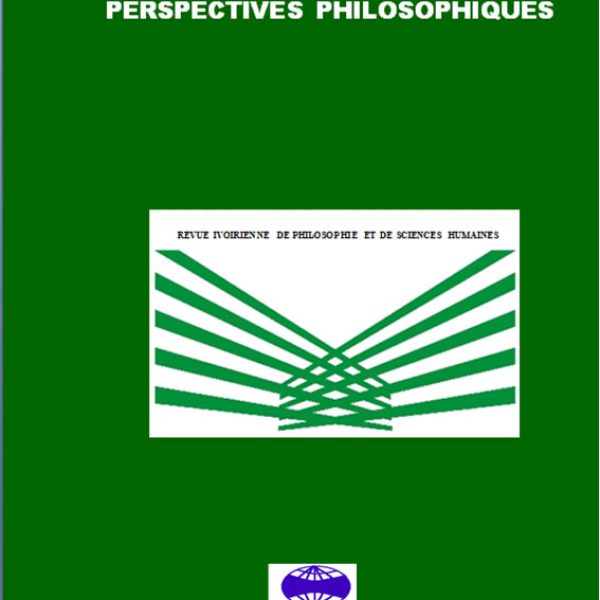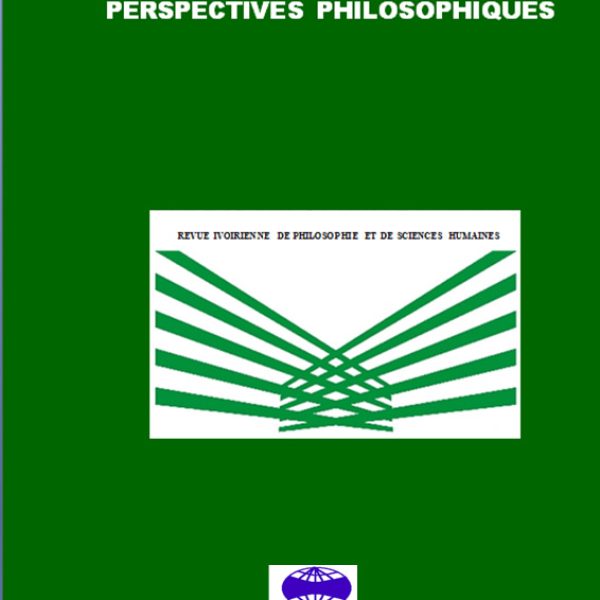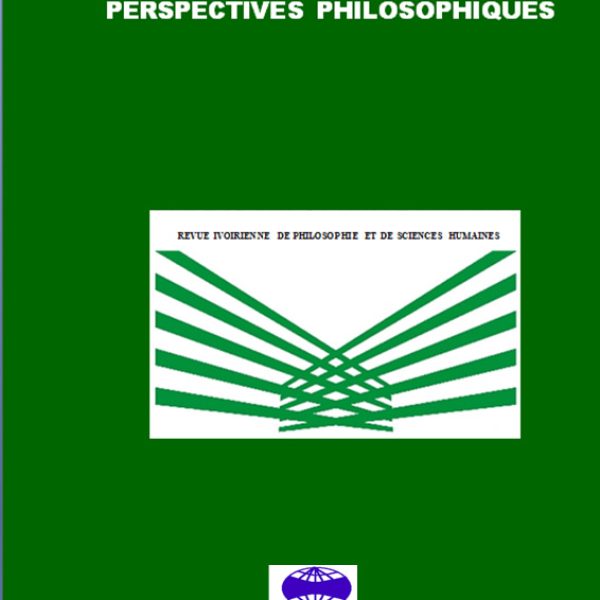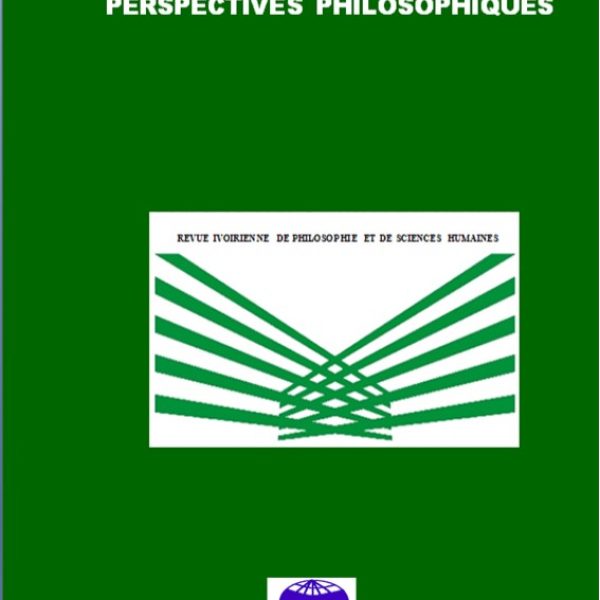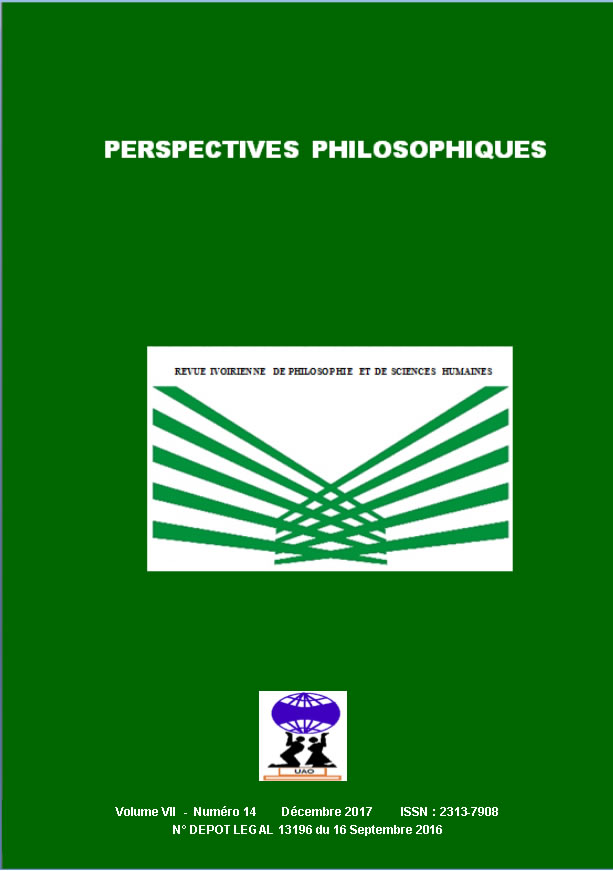
AXE 1 : PRINCIPES DU VIVRE-ENSEMBLE………………….. 1
1. Art et rapprochement des peuples, Jean-Claude Y. GBEGUELE………………………………………………………. 2
3. Vertu kantienne et vivre-ensemble, GUI Désiré………………………………………………………………………..…….29
AXE 2 : MULTIPARTISME ET VIVRE-ENSEMBLE………………….. 98
7. Des enjeux de la diversité culturelle, KOUAMÉ Akissi Danielle………………………………………………………..…. 99
AXE 4 : PAIX, GUERRE ET MONDIALISATION …………………….… 203
15. Tics et vivre ensemble, N’DJA Koffi Blaise……………………………………………………………….…. 238
AXE 5 : LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ……………..…… 267
Présentation et Sommaire N°014 > Résumés des articles N°014
| Volume VII – Numéro 14 Décembre 2017 ISSN : 2313-7908N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : http:// perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Dr. N’dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités
Rédacteur en chef Adjoint : Dr. Assouma BAMBA, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane OUATTARA
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Dr. N’Dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Dr. Abou SANGARÉ, Maître de Conférences
Dr. Donissongui SORO, Maître de Conférences
Dr Alexis KOFFI KOFFI, Maître-Assistant
Dr. Kouma YOUSSOUF, Maître de Conférences
Dr. Lucien BIAGNÉ, Maître de Conférences
Dr. Nicolas Kolotioloma YEO, Maître-Assistant
Dr. Steven BROU, Maître de Conférences
Secrétaire de rédaction : Dr. Blé Sylvère KOUAHO, Maître de Conférences
Trésorier : Dr. Grégoire TRAORÉ, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités
SOMMAIRE
AXE 1 : PRINCIPES DU VIVRE-ENSEMBLE
1. Art et rapprochement des peuples,
Jean-Claude Y. GBEGUELE………………………………………………………….1
2. Le vivre-ensemble à l’épreuve de l’avoir et de l’être dans la pensée de Ebénézer Njoh-Mouelle,
Amenan Edwige KOUAKOU……………………………………………………….136
3. Vertu kantienne et vivre-ensemble,
GUI Désiré………………………………………………………………………..…….81
4. L’unité de la vie chez Claude Bernard : un modèle pour penser le vivre ensemble sociétal,
AGBAVON Tiasvi Yao Raoul……………………………………………………….81
5. De la problématique du vivre-ensemble dans la pensée de Hannah Arendt,
ASSEMIEN Assoumou Joël-Pacôme…………………………………………….81
6. Le concept du visage levinassien comme fondement du vivre-ensemble,
COULIBALY Adama………………………………………………………….…….281
AXE 2 : MULTIPARTISME ET VIVRE-ENSEMBLE
7. Des enjeux de la diversité culturelle,
KOUAMÉ Akissi Danielle………………………………………………………….281
8. Du dévoilement des pièges de la différence : condition de possibilité du vivre-ensemble chez Paulin Hountondji,
DIOMANDÉ Zolou Goman Jackie Élise………………………………………….81
9. Le vivre-ensemble à l’épreuve du multipartisme en contexte africain : la nécessaire éthicisation du politique africain,
COULIBALY Sounan……………………………………………………………….281
AXE 3 : REPLI IDENTITAIRE ET UNITÉ NATIONALE
10. L’interculturalité comme conceptualisation du vivre-ensemble,
VASSY Sylveira Tiburce…………………………………………….…………….281
11. Le Panafricanisme de Nkrumah et les Replis Identitaires,
GNAGNE Akpa Akpro Franck Michaël………………………………………….281
12. Idéologie et identité : vers une esthétique du bien-vivre-ensemble,
TUO Fagaba Moïse………………………………………………………………….281
AXE 4 : PAIX, GUERRE ET MONDIALISATION
13. Sport et dopage : quel rapport au vivre-ensemble ?,
ABOGNY Claude Aurélie………………………………………………………….281
14. Humanisme techno-numérique et la refondation du vivre-ensemble en Afrique,
ABOUDOU Aicha Stéphanie………………………………………………………281
15. Tics et vivre ensemble,
N’DJA Koffi Blaise………………………………………………………………….281
16. Le vivre-ensemble : perspectives du contrat social dans le philosopher lockéen,
KOUMA Kouassi Serge Arnaud……………………………………………….….281
AXE 5 : LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT
17. Le vivre-ensemble et la sauvegarde de l’environnement : l’archétype du développement durable,
COULIBALY Sionfoungon Kassoum…………………………………………….281
18. Les impacts socioéconomiques de la crise écologique sur la vie communautaire,
SORO Torna…………………………………………….……………………………281
19. Une écologie humaniste comme gage de la protection de la vie,
Casimir Konan BOUSSOU……………………………………………………….281
20. L’environnement à l’épreuve de la mondialisation,
KOUA Guéi Simplice……………………………………………………………….281
21. Protection de l’environnement en Afrique : vers une culture de l’écocitoyenneté,
SIALLOU Kouassi Hermann…………………………………………….………281
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
AXE 1 : PRINCIPES DU VIVRE-ENSEMBLE
INFLUENCE DE LA CULTURE HEBRAÏQUE DANS LA THÉORIE FREUDIENNE DE LA RELIGION
ART ET RAPPROCHEMENT DES PEUPLES
Jean-Claude Y. GBEGUELE
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’art est le résultat de toutes les formes de créations que l’homme, dans son vécu quotidien, utilise pour la réalisation du beau. Cette production de l’esprit de l’homme, se confine très souvent dans la réalisation de belles œuvres exclusivement. Ainsi la création artistique devient comme le pense Kant « une théorie de l’art pour l’art ». Car selon lui, l’œuvre d’art doit plaire uniquement. Le présent travail se propose de montrer comment l’art, rapproche les peuples et favorise le vivre ensemble. En effet les créations artistiques de par leurs pouvoirs métamorphiques (transformation) tels que la communication, l’éducation, instaurent la paix et la cohésion dans une société fracturée par les crises politiques, ethniques, etc. L’art est pour ainsi dire une contribution à l’effort de quiétude, d’harmonie et de bonheur dans les sociétés. Qui plus est, il (l’art) permet de surpasser nos querelles, différents, disharmonies dans les nations pour un climat de paix. C’est-à-juste titre que, parler du vivre ensemble, c’est montrer les vertus qui se dégagent dans les productions artistiques, gage d’une vie heureuse et épanouie dans la société.
Mots-clés : Art, Cohésion, Homme, Société, Paix, Vivre-ensemble.
ABSTRACT :
Art is the result of all the forms of creation that man, in his daily life, uses for the realization of the beautiful. This production of the spirit of man, is very often confined in the realization of beautiful works exclusively. Thus art creation becomes, as Kant thinks, “a theory of art for art.” For him, the work of art must please only. The present work aims to show how art brings people closer together and promotes living together. Indeed, artistic creations by their metamorphic powers (transformation) such as communication, education, establish peace and cohesion in a society fractured by political, ethnic, and other crises. Art is, so to speak, a contribution to the effort of tranquility, harmony and happiness in societies. What is more, it (art) allows to surpass our quarrels, different, disharmonies in the nations for a climate of peace. Rightly speaking, to speak of living together is to show the virtues that emerge in artistic productions, the guarantee of a happy and fulfilling life in society.
Key words : Art, Cohesion, Man, Society, Peace, Living together.
INTRODUCTION
Selon Nietzsche, « l’art est l’activité essentiellement métaphysique de cette vie » (2008). Cette pensée nietzschéenne sous-tend que la création artistique dans son expression, est une sublimation des évènements tragiques de l’existence humaine. Autrement dit elle rend possible et supportable la vie terrestre, parsemé de crises et de souffrances. En effet, l’artiste par sa production, ne passe pas outre mesure le principe par lequel les hommes peuvent cohabiter tout en vivant heureux et paisible dans la société. Ainsi, sa créativité joue un rôle prépondérant dans le rapprochement des peuples.
Cependant, Contrairement à Nietzsche, Hegel estime que l’œuvre d’art est dépassée, elle est morte. En effet la création artistique au lieu d’être en rapport avec les réalités terrestres, de sorte à favoriser la cohésion sociale, se borne exclusivement à la satisfaction des besoins spirituels. « De ce fait, elle a perdu sa vérité et sa vitalité authentique » (George Wilhelm Friedrich HEGEL, 1964, p. 30). Alors, ces divergences d’idées posent le problème suivant : Comment l’art peut-il rapprocher les peuples ? En quoi les créations artistiques constituent-elles un facteur de vivre ensemble ? À bien des égards, l’art ne contribue-t-il pas à la promotion des valeurs humanitaires ?
Notre objectif est d’attirer l’attention des hommes sur le rôle que joue l’œuvre d’art dans le développement d’une nation. Car la création artistique est un facteur essentiel dans le développement d’un pays, et ce grâce à sa capacité à promouvoir des valeurs humaines telle que l’amour, le pardon et la paix. Il s’agira, de prime abord de montrer que l’art est facteur de coexistence sociale. Pour ensuite faire ressortir l’idée que les créations artistique participent à l’éducation des citoyens
1. ART ET COHÉSION SOCIALE
Étymologiquement, le mot “Art” découle du grec « technê » qui signifie savoir-faire. Il désigne, dans la conception antique, le savoir-faire de l’artisan, sa maîtrise technique. C’est aussi l’ensemble des activités soumises à certaines règles. Il englobe donc à la fois des savoirs, des savoir-faire, des arts et des métiers. Ainsi, la notion d’art renvoie-t-elle, chez Galien, à un ensemble de procédés servant à produire un certain résultat : « L’art est le système des enseignements universels, vrais, utiles, partagés par tous, tendant vers une seule et même fin» (André LALANDE, 1992, p. 17). Dans cette acception du mot qui a prévalu jusqu’à la fin du Moyen-âge, l’art s’oppose à la fois à la science, conçue comme une pure connaissance, indépendante des applications, et à la nature comme imitation. Jusqu’à la Renaissance, il n’y a pas de différence fondamentale entre l’artiste et l’artisan. D’ailleurs, on appelle « artiste » un ou tout artisan dont la production est d’une qualité exceptionnelle. Mais, le sens actuel de la notion d’art remonte au siècle des Lumières. En effet, au sens moderne et contemporain, l’art se saisit plus par la notion de beaux-arts, dans lesquels le but principal est la production du beau, et spécialement du beau plastique. Peinture, sculpture, gravure, architecture, art décoratif en sont quelques illustrations. Partant de ces conceptions la création artistique se perçoit comme la création de l’artiste, qui utilise son génie pour créer de belles choses. Cette assertion est aussi partagée par Dagnogo Baba quand il dit : « l’art ou du moins les arts, ce sont toutes les formes de créations que l’homme, dans son vécu quotidien, utilise pour réaliser des belles œuvres » (2012, pp. 89-107). L’art est, pour ainsi dire, une production de l’esprit humain qui favorise la réalisation du beau. Nous pouvons aussi ajouter que l’art désigne, de façon générale, un ensemble de procédés susceptibles de produire des effets sensationnels. C’est pourquoi, il apparaît comme la création que n’a pas fournie la nature.
En ce qui concerne la notion de cohésion sociale, elle se définie comme une attitude d’unité dont les hommes utilisent pour une bonne cohabitation dans la société. Elle est l’équivalent même du vivre ensemble. La cohésion dans la société, semble être une réponse aux propos Aristotélicienne qui dit ceci : « l’homme est un animale politique » (ARISTOTE, 1990, p. 57). Cette pensée d’Aristote signifie que l’homme à la différence des animaux est fait pour vivre ensemble. En effet, épris d’une coexistence pacifique l’homme vise toujours une société unie, paisible et équilibrée. C’est ce qui va le pousser à instaurer des balises permettant ainsi d’harmoniser la société humaine. Alors, il ressort de cette évidence que la notion de cohabitation prise de façon naturelle, est partie intégrante de l’homme, car celui-ci, trouve sa véritable réalisation auprès de l’autre, autrement dit la société. Qui (autrui) devient selon les humanistes tels que Roger Garaudy et blaise pascale bénéfique dans la réalisation du bonheur de son prochain. Cependant les diviser serait un mal qu’on inflige à la nature humaine voire à la société. C’est pourquoi si les hommes sont divisés, c’est la société à son tour qui est en péril.
Aujourd’hui et comme partout ailleurs, la notion de vivre ensemble a perdu sa clarté autrement sa valeur extrinsèque. C’est ce qui entraine dans nos différentes sociétés des crises sans précédentes. Ces différentes crises qui parfois divisent des individus, des peuples et des nations, nous amène à comprendre que, apprendre à vivre ensemble, doit être une valeur ou une nécessité que chacun de nous doit cultiver. Alors, comment l’art peut-il favoriser une cohésion sociale ? Mieux en quoi la création artistique est-elle un facteur de rapprochement des peuples ? Par ricochet du vivre ensemble. Ce qui revient à dire que l’art devient indispensable dans une coexistence sociale. Autrement dit, l’œuvre d’art est l’un des principes du vivre ensemble. Mieux l’art est un facteur de coexistence sociale. Parmi les biens qu’il prescrit à l’homme en occurrence la paix, l’amour, etc. L’art dans son expression communique et éduque.
2. ART ET COMMUNICATION
Mathieu Kesler, en subdivisant l’esthétique Nietzschéenne en deux parties : l’une classique et l’autre romantique ou pragmatique entend soutenir que l’art est la véritable expression de la sensibilité. À cet effet, il pense que « le romantisme, loin, de représenter un goût suranné pour des spectacles trop sages ou trop discrets, serait alors l’expression d’une excitabilité et d’une susceptibilité supérieures de la sensibilité » (Mathieu KESLER, 1998, p. 7). Ce qui signifie que, l’art à cette période de son histoire, à cesser de satisfaire les besoins spirituels (sublimation des souffrances par exemple), monde métaphysique au profit des besoins terrestre, sensible. Ici l’art sera désormais en contact direct avec la réalité sociale afin de la comprendre et de la transformer au bénéfice de l’homme. L’art, de ce point de vue, aura une fonction politique qui consiste à être une critique de la société. Et c’est dans cette optique que l’activité artistique va jouer le rôle de cohésion sociale. Lorsqu’on appréhende véritablement l’œuvre d’art, on se rend à l’évidence que la créativité de l’artiste ne se limite pas essentiellement à une théorie de l’art pour l’art, c’est-à-dire à la beauté uniquement. Mais il décrit aussi les réalités sociales pour instaurer un climat de paix dans une société ; d’où sa fonction subversive.
La musique par exemple est un moyen de communication. Elle critique à travers des discographies les velléités qui existent dans la société et montre aux populations la conduite à tenir de sorte à avoir une société équilibrée. C’est ce que semble faire la musique Zouglou. Le Zouglou en réalité est une expression musicale qui s’est laissé entendu par Didier Bilé dans sa discographie intitulée « Gboclo Koffi » dans les années 1991. Cette chanson s’articule comme suit :
Ah ! La vie estudiantine !/ Elle est belle mais il y a encore beaucoup de problèmes. / Lorsqu’on voit un étudiant, on l’envie / Toujours bien sapé, joli garçon sans produit ghanéen. Mais en fait, il faut entrer dans son milieu pour connaitre la misère et la galère d’un étudiant. / Oho ! Bon Dieu, qu’avons-nous fait pour subir un tel sort ?/ Et c’est cette manière/ d’implorer le Seigneur qui a engendré le Zouglou / Danse philosophique qui permet à /L’étudiant de se réjouir et d’oublier un peu ses problèmes. / Dansons donc le Zouglou ! (Ludovic FIE DOH, 2012, p. 195).
Dans cette discographie, l’artiste met en évidence la précarité dans laquelle vivent les étudiants de Côte d’ivoire depuis les années 90. En effet, les bourses et les aides financières sont insuffisantes, les étudiants ne sont pas tous logés par manque ou insuffisance d’infrastructures. Aussi, les rendements des étudiants sont-ils exécrables par manque de bibliothèque. Ce sont toutes ces souffrances qui vont engendrer le ‘’Zouglou’’. Il est donc né dans le but de critiquer les tares de la société d’où son caractère subversif.
La musique reggae milite dans le même sens comme le zouglou. Cela se voit avec la musique de Tiken Jah[1]. En effet, ses textes décrivent les réalités sociales telle que les crises sociopolitiques, les détournements, les confiscations du pouvoir politique, le néocolonialisme, etc. Cela s’atteste dans son premier album Mangercratie. Tiken dans cet album montre le visage indécent de l’actualité socio-politique de son pays, dominé par l’actualité de l’année 96 à savoir le concept de l’« Ivoirité »[2], qui semblerait diviser les ivoiriens en général et les hommes politiques en particulier. Alors pour empêcher une éventuelle crise ; Tiken dans le descendant, rejette indirectement ce concept qui tente à marginaliser certains ivoiriens et appelle à une unité nationale tout en sensibilisant les politiciens à une retenue. Ici, nous voyons clairement que l’art en particulier la musique de Tiken communique des valeurs d’humanismes à l’homme tout en instaurant les fondements d’une cohésion sociale. C’est pourquoi Nietzsche dit que « l’art nous parle, nul n’est indifférent, aucun n’est inutile» (2008, p. 48). Autrement dit une œuvre d’art en lui-même est symbolique.
Aujourd’hui, l’activité artistique, bien qu’elle soit une activité lucrative, « n’a rien perdu de sa valeur initiale, celle de fédérer les hommes dans leur diversité et de contribuer, de ce fait, à l’édification d’une société engagée sur le chemin du développement et de la cohabitation pacifique » (Jean-Baptiste BEHI, p. 54) C’est le cas de la crise militaro-politique qu’a connu la Côte d’Ivoire en 2002. Cette crise, à vrai dire, a divisé le pays en deux parties. L’une, dirigée par les ‘’rebelles’’ et l’autre partie dirigée par le pouvoir d’alors. À l’instar des hommes politiques qui multipliaient les accords afin de permettre une Côte d’Ivoire unifiée, les artistes quant à eux multipliaient des tournées en vue de réconcilier les Ivoiriens par l’art, notamment par la musique. La caravane de paix qui a été organisée, à cet effet, du 21 au 22 avril 2007 par les artistes était, pour guérir les cœurs brisés, panser les plaies béantes que cette ‘’maudite guerre’’ à occasionnée. Pour eux, la paix passe nécessairement par la chanson. Pendant cette caravane toutes les musiques ou chants étaient en faveur de la paix. Les messages qui se dégageaient étaient des messages de paix, de sensibilisation au pardon, à la réconciliation et à la cohésion sociale autrement dit au vivre ensemble.
Les artistes zouglou par ailleurs demandaient aux peuples du nord de s’unir avec les peuples de l’ouest et vice versa. Que des peuples du nord, du sud, de l’est, de l’ouest et du centre, venus des milliers de kilomètres, arborent les couleurs ivoiriennes à cette caravane, et que ceux-ci s’entremêlent et se côtoient sans animosité. Parfois mêmes les participants issus de différents bords politiques s’embrassaient sans le savoir. Voilà des exemples qui montrent bien que l’art reste un puissant facteur de rapprochement des peuples. L’art singulièrement la musique, à travers les messages, véhicule certaines valeurs telles que l’amour, le pardon, la cohabitation qui ont pour finalité d’unifier le pays fracturé. Ces exemples montrent que l’art reste un puissant facteur de rapprochement. Les messages véhiculés lors de leurs escales(les artistes zouglou), sont résolument tournés vers la promotion de la paix. Ils sont dans ce processus de réconciliation neutre, car leurs ambitions est d’emmener surtout les acteurs de la crise au développement de la Côte d’Ivoire. L’art s’il communique, il éduque aussi l’homme.
3. ART ET ÉDUCATION
Parmi les pouvoirs métamorphiques c’est-à-dire de transformation que dispose l’art, nous ne pouvons pas passer sous silence le pouvoir d’éducation. Dans la philosophe de l’art de Platon, l’activité artistique, l’œuvre d’art parce qu’elle ne favorisait pas l’éducation du citoyen était reléguée au second plan. Ainsi, « Si la philosophie de l’art commence avec Platon, elle commence paradoxalement à une condamnation des beaux-arts » (Jean LACOSTE, 1981, p. 5). Cependant, depuis Aristote jusqu’aujourd’hui l’art est devenu un moyen incontournable dans l’éducation du citoyen. Dans nos sociétés actuelles, l’oralité, à travers les contes, sert d’éducation. En effet, les contes, non seulement permettent de rassembler les personnes de bords différents et aussi permettent aux participants de retenir certaines moralités qui constituent les bases d’une éducation forte et durable. Dans kaydara de Amadou Hampaté-Ba, le conte se déroule en trois temps : « Il, amuse les enfants, enseigne et questionne ». C’est dans cette optique que Kouassi Marcel, soutenant cette vérité qui se dégage du conte chez Amadou Hampaté-Ba, affirme que « Hampaté-Ba nous enseigne dans le conte, conté et à conter » (Marcel KOUASSI, 2010, p. 33). Ici, on s’aperçoit bien évidemment que l’art, en particulier le conte, joue un rôle déterminant dans l’éducation du citoyen ou de l’enfant.
Par ailleurs, l’art à travers la comédie favorise aussi à l’éducation du citoyen dans la société. Aristote l’a si bien compris car, pour lui, l’art est, avant tout, imitation. Sur ce point, Platon et lui semble être bien d’accord. Mais, la rupture survient lorsqu’Aristote fait de ce principe de création artistique, la base de l’éducation de l’homme. Elle est, tout d’abord, ce par quoi l’homme apprend dès sa naissance. Dans ce sens, il affirme qu’« imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes et ils se différencient des autres animaux en ce qu’ils sont des êtres fort enclins à imiter et qu’ils commencent à apprendre à travers l’imitation » (ARISTOTE, 1990, 1448a). Cependant chez Platon les artistes n’apporte rien de constructif aux citoyens. Donc, pour lui, les artistes, doivent être chassés de la cité. Dans la pensée aristotélicienne, la comédie à une emprunte éducative, par le biais de l’imitation. Autrement dit, elle reproduit des caractères, des passions, propres à l’homme, pour l’instruire sur leurs impacts dans sa vie. Toutefois, Aristote préfère ce type de représentation à des personnes d’un âge avancé, qui ont la capacité d’en tirer profit. Il écrit à cet effet, qu’« il faut stipuler dans les lois que les plus jeunes ne pourront assister ni aux iambes ni aux comédies, avant qu’ils atteignent l’âge auquel ils auront droit de prendre place dans les activités communes et que l’éducation les aura alors rendus insensibles à l’excès de boisson et au dommage résultant de ces spectacles» (ARISTOTE, 1990, p. 512).
Pour Aristote, si l’éducation ne saurait commencer par l’enseignement des choses basses et mauvaises, et que l’on est toujours sujet à connaître, quel que soit l’âge, l’art comique doit être réservé aux adultes et non aux jeunes. Ceux-ci ayant reçu, au préalable, une éducation leur montrant les valeurs à imiter, pourront, à travers les récits comiques, trouver un équilibre, s’ils ressentaient des envies comme celles imitées par le poète comique. Car, « dans le système éducatif aristotélicien, l’éducation se poursuit après l’école, par une organisation de la vie culturelle qui vient améliorer et conforter le profit que le citoyen peut tirer, toute sa vie, des acquisitions qu’a rendues possibles la formation désintéressée qu’il avait d’abord reçue » (Jean LOMBARD, 1994, p. 130). Nous constatons qu’il y a une hiérarchisation du système éducatif chez Aristote, qui commence par celle qui nous permet de faire un bon choix.
Qui plus est, l’art joue un rôle important dans l’éducation à travers les messages qu’il véhicule aux élèves et aux étudiants. En effet, il contribue à l’éradication de certains phénomènes tels que les grossesses en milieu scolaire, la tricherie, l’école buissonnière et bien d’autres phénomènes, qui minent notre société actuelle. Les créations artistiques notamment les poèmes, les théâtres constituent un puissant moyen de sensibilisation de la jeunesse. Dans nos écoles et universités actuelles lors des activités sociaux-culturelles, l’on présente des théâtres qui, parfois, ne sont pas joué pour une simple satisfaction de plaisir sensoriel, mais, visent à ressasser ou à critiquer un phénomène qui tente à détruire la jeunesse. Du coup, ces activités artistiques en milieu scolaire et universitaire éducative, inculquent des valeurs morales aux apprenants.
Tiken Jah dans ces chansons ne passe pas outre la fonction éducative qui se dégage dans l’art par ricochet la musique. Pour lui, la musique éduque c’est-à-dire, moralise et conscientiser la jeunesse africaine. Il le démontre si bien dans ses morceaux moralisateurs et ceux qui font la promotion de l’école et de la révolution mentale tel que Caméléon, Coup de gueule, l’Africain, Danga, etc. Dans Danga par exemple, l’artiste invite la jeunesse africaine en générale et la jeunesse malinké en particulier, à éviter d’attirer sur elle la malédiction des parents. Selon lui le manque de respect des parents, pourrait nous éloigner de la bénédiction. Dès-lors la faveur des parents est une grande richesse sur cette terre des hommes. En contribuant à l’éducation et à la socialisation des jeunes africains, incontestablement Tiken montre la fonction éducative de l’art à travers la musique. Par conséquent sa musique, ne peut qu’être profitable au futur du continent africain.
Parler de l’impact de l’art dans la quête du vivre-ensemble ou du rapprochement des peuples, il convient de dire que, la production artistique, quand bien même rejeté par certaines personnes, demeure pour ainsi dire, un facteur de cohésion social. En effet, l’œuvre d’art à travers ces pouvoirs de communication et d’éducation, est un outil de rapprochement des peuples. Par conséquent, disons-nous que l’art est aussi un moteur de développement d’une nation. Car, il consolide les relations des citoyens et leurs permet de vivre-ensemble.
CONCLUSION
Selon un dicton : « on ne finit jamais de parler, mais on arrête de parler » Arrêtons-nous alors de parler et retenons l’essentiel car pour nous « l’ineptie est de vouloir conclure » (Diakité SAMBA, p. 233), dit Sidiki Diakité en citant faubert. Aujourd’hui comme partout dans le monde, nos sociétés sont en proie à des fissures. Ainsi, cela hypothèque l’avenir de l’innocent individu de ladite société. À vrai dire, lorsqu’une société est en flamme, ce sont les conditions de réalisation de l’individu qui sont mises en danger. Le manque de quiétude, entraine un déséquilibre social. Du coup il n’y a plus de paix. Alors, on se pose la question suivante : quelles sont les causes de la fracture sociale ? Dans une analyse l’on s’est rendu compte que ces fractures sont souvent causées par les idéologies des hommes politiques qui jouent sur l’identité culturelle des peuples. Aussi, le concept d’assimilation est l’une des causes des brisements dans la société. Alors, parmi les outils permettant de rassembler les uns les autres en vue d’une société réunifiée, s’inscrit inéluctablement l’art. Les artistes, par leurs créativités, participent à la réconciliation des peuples, mieux au vivre ensemble car l’œuvre d’art qu’elle soit picturale, musicale, architecturale, théâtrale, contribue à l’union des peuples, et ce, à travers la communication et l’éducation. C’est pourquoi Akindès relativement aux différents moyens que les hommes de nos jours usent pour leur bien-être dit ceci : « Le monde est fait de paradoxes. Plus le temps passe, plus les hommes s’évertuent à construire plus de murs-tels aussi hauts que les autres-que de pont reliant les cultures et les peuples » (2005, p. 7).Ce qui signifie que, au fur et à mesure que l’homme évolue, l’activité artistique est un mur que les hommes élaborent pour leur bonheur. Dès-lors, les créations artistiques sont aussi un maillon pour le développement durable d’une société.
BIBLIOGRAPHIE
ARISTOTE, Les Politiques, Paris, Flammarion, 1990.
ARISTOTE, Les politiques, traduction de PIERRE Pellegrin, paris, Flammarion, 1990.
ARISTOTE, Poétique, Les Belles Lettres, traduction de Michel Magnien, paris, 1990.
André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Gallimard, 1992.
Diakité SAMBA, Technique et question africaine de développement, rationalité technique et stratégies collectives, collection penser l’Afrique numéro 2.
Descartes RENÉ, Discours de la méthode, Paris, Bordas, 1984.
Friedrich NIETZSCHE, La Naissance de la tragédie, traduction de Jean Marnold et Jacques Morland, Paris, Livre de poche, 2008.
Friedrich NIETZSCHE, Crépuscule des Idoles, trad. de Jean Claude Hémery, Paris Gallimard, 1981.
Friedrich NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, traduction de Georges- Arthur Goldschmidt, Paris, LGF, Livre de poche, 1999.
Francis AKINDÈS, « la chronique d’Akindès », in continental, magazine panafricain d’informations, numero39, juin 2005.
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Introduction à l’esthétique, Paris, Aubier-Montaigne, 1964.
Jean LOMBARD, Aristote, politique et éducation, Paris, L’Harmattan, 1994.
Jean LACOSTE, Philosophie de l’art, Edition Presse Universitaire de France, 1981 Collection « Que Sais-Je? », Numéro 2.
Jean-Paul SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, présentation et notes d’Arlette Elkain-Sartre, Paris, Gallimard.
Ludovic FIÉ DOH, Musiques populaires urbaines et stratégies du refus en Côte d’ivoire, Paris, Édilivre, 2012.
Mathieu KESLER, Esthétique de Nietzsche, Paris, PUF, 1998.
Marcel KOUASSI, Euthanasie et Cultures africaines, collection éthique et Bioéthique, Abidjan, EDUCI, 2010.
Paul-Laurent AKOUN, L’école de Francfort, Paris, PUF, 1987.
Sylvain Matton, Les Dossiers Presse Bac Philosophie, Les Droits de l’Homme et la Philosophie du Droit, Hachette Éducation.
Jean-Baptiste BEHI, New Africain, Le magazine de l’Afrique, le sport outil au service du développement et de la paix, hors-série numéro 1, p. 54.
RÉFÉRENCES WEBOGRAPHIQUES
Dagnogo BABA, « Du pouvoir métamorphique de l’art chez Nietzsche », in Perspectives philosophiques, Revue Ivoirienne de Philosophie et des Sciences Humaines, volume II-numéro 4, décembre 2012.
Ludovic Fié DOH, « Le paradoxe de l’œuvre d’art : contribution francfortoise à la critique de la modernité » in Revue Baobab : Numéro 8 Premier semestre 2011
http://www.slateafrique.com/97407/cote-divoire-la-paix-passe-par-la-chanson-musique, consulté le 20 janvier 2016 à 16h 45 min.
http://le Nazisme d’hitler.blogspot.com/2010/07/une-histoire-philosophique-du-sujet-et.html, consulté le 10 janvier 2016 à 12h30 min.
http://www.slateafrique.com/97407/cote-divoire-la-paix-passe-par-la-chanson-musique, consulté le 15 janvier 2016 à 16 h 45 min.
RÉFÉRENCES DISCOGRAPHIQUES
Tiken Jah FAKOLY, « Mangercratie », in Mangercratie 1996.
Tiken Jah FAKOLY, « Toubabou », in Cours d’histoire, 1999.
Tiken Jah FAKOLY, « Le pays va mal » in Caméléon 2000.
Tiken Jah FAKOLY, « Charnier », in Françafrique 2002.
Tiken Jah FAKOLY, Coup de gueule 2004.
Tiken Jah FAKOLY, « L’Africain », in African 2007.
LE VIVRE-ENSEMBLE À L’ÉPREUVE DE L’AVOIR ET DE L’ÊTRE DANS LA PENSÉE DE EBÉNÉZER NJOH-MOUELLE
Amenan Edwige KOUAKOU
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’avoir et l’être sont des dimensions constitutives de tout être humain. La surdétermination de l’avoir au détriment de l’être est source de désharmonie et de déséquilibre sociaux. Ce déséquilibre marque une rupture entre l’Homme et sa société. Cela, dans la mesure où l’instinct excessif d’appropriation et de chosification que l’Homme développe vis-à-vis de l’avoir le pousse irrésistiblement à être en rupture avec l’ordre social.
De ce fait, à l’examen de la question du vivre-ensemble en rapport avec celle de l’avoir, il nous est apparu nécessaire, non de la rejeter, mais de la reconsidérer en l’accordant avec celle de l’être en tant que la recherche des valeurs universelles et la promotion de la responsabilité des uns vis-à-vis des autres. La possibilité et la consolidation du vivre-ensemble résident de ce point de vue dans l’équilibre dialectique entre l’être et l’avoir. À ce propos, notre point de départ dans le traitement de la question se trouve dans les écrits de Ebénézer Njoh-Mouelle.
Mots clés : Avoir, Déréliction, Être, Intérêt général, Intérêt personnel, Responsabilité, Surdétermination, Vivre-ensemble.
ABSTRACT :
Profit and being are some inherent aspirations of every human being. The over determination of profit to the detriment of being is a source of non-cohesion and social instability. This instability makes a break between human and his society. That, in so for as the excessive instinct of appropriation and non-consideration, irresistibly lead him to be in break with social order.
Therefore, when analyzing the question of common life related to that of profit, as for us, it appears necessary not to reject it. But to reconsider it in accordance with that of human, as the search for universal values and the promotion of responsibility of some towards the others. To this point of view, the possibility and consolidation ok common life reside in dialectical equilibrium between being and profit. In view of that, our starting point, in the revolution of the question, is in a piece of writings from Ebénézer Njoh-Mouelle.
Keywords: Profit, Dereliction, Being, Common interest, Self-interest, Responsibility, over Determination, common Life.
INTRODUCTION
L’avoir et l’être sont des dimensions constitutives de tout être humain. La surdétermination de l’avoir au détriment de l’être peut être source de désharmonie et de déséquilibre sociaux. Cette thématique fait l’objet d’un traitement de pensé dans la pensée de Ebénézer Njoh-Mouelle. Pour le philosophe camerounais la question de l’avoir et de l’être influe sur le vivre-ensemble. Celle-ci peut faire régresser une société ou la faire progresser. C’est d’ailleurs ce qui explique notre intérêt pour ces deux notions dans la mesure où nous avons dans notre analyse pour objectif général de rechercher la bonne marche de la société à travers la promotion du vivre-ensemble.
Pour ce faire, la question centrale qui se dégage est la suivante : Quelle implication l’avoir et l’être ont sur le vivre-ensemble ? Par ailleurs, le déséquilibre entre l’être et l’avoir peut-il défavoriser le vivre-ensemble ? Mieux, comment l’avoir et l’être peuvent-ils contribuer au vivre-ensemble ?
Telles sont les interrogations auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de cette réflexion en nous appuyant essentiellement sur la pensée de Ebénézer Njoh-Mouelle, philosophe du développement. Notre objectif principal est de montrer que c’est par la promotion des valeurs universelles et le sens de la responsabilité des uns des autres qui passent par l’équilibre entre l’être et l’avoir que nous pouvons parvenir à un vivre-ensemble harmonieux.
Pour mieux nous faire comprendre, nous utiliserons les méthodes sociocritique et analytique. De ce fait, nous subdiviserons notre travail en trois grandes parties : Dans la première dont le titre est : autour de la question de l’être et de l’avoir, il sera question d’approfondir notre conception de l’être et de l’avoir pour mieux les analyser. Dans cette partie, nous nous appuierons essentiellement sur le point de vue de Ebénézer Njoh-Mouelle. Quant à la deuxième partie intitulée : dialectique de l’être et de l’avoir et crise du vivre-ensemble, nous aurons à montrer comment la surdétermination de l’avoir au détriment de l’être peut conduire à une crise du vivre-ensemble. Enfin, dans la dernière partie qui a pour titre : le vivre-ensemble comme unité de l’être et de l’avoir, il sera question pour nous de montrer que c’est par l’équilibre entre l’être et l’avoir que nous pourrons consolider le vivre-ensemble.
1. AUTOUR DE LA QUESTION DE L’ÊTRE ET DE L’AVOIR
L’avoir et l’être sont des attributs de tout être humain. Ils permettent d’identifier un individu, de savoir qui il est, ainsi que ses choix de vie. En effet, la conception qu’un individu ou une société a de la question de l’être et de l’avoir peut contribuer à faire progresser sa vie ou à la faire régresser, car la manière dont un individu ou une société aborde ces deux questions favorise ou défavorise ses conditions de vie. En réalité, l’avenir de l’humanité dépend du choix que chacun fera de son mode d’existence porté sur un mode de fonctionnement prédominé soit par l’être, soit par l’avoir.
En fait, l’être renvoie à ce qui est, à ce qui existe. Selon le dictionnaire André Lalande (1926, pp. 307-308), une chose est quand elle est actuellement présente dans l’expérience. L’être est alors une donnée concrète qui s’exprime dans le vécu de l’individu. Il se perçoit par les facultés, les talents ainsi que les potentialités du sujet lui-même, c’est-à-dire de l’individu. C’est pour cette raison que selon Ebénézer Njoh-Mouelle (1980, p. 37), l’être n’est pas une donnée naturelle, il s’acquiert et s’exprime par les actes de l’individu. Ses œuvres doivent viser le bien-être de tous, c’est-à-dire le bien-être de l’individu et celui de ses semblables. Aussi, l’être de chaque Homme doit être guidé par les valeurs positives. Les valeurs sont dites positives lorsqu’elles visent l’intérêt général et non personnel, l’universel et non particulier. L’aspiration à l’être exige à travailler dans le sens des œuvres qui sont bénéfiques pour l’individu et pour les autres.
C’est pourquoi, l’Homme qui aspire à l’être doit transcender les penchants de son ego, c’est-à-dire sa nature égoïste pour poser des actes qui vont dans le sens des valeurs universelles. Cela requiert une aptitude à la liberté : d’où la nécessité pour l’individu de se libérer de sa mauvaise nature pour accéder à une meilleure nature, celle qui recherche le mieux-être de l’individu et celui des autres. En plus, ce dernier doit avoir un sens élevé de la responsabilité. L’être humain qui aspire à l’être doit, pour ce faire, être responsable de lui-même et de ses semblables. L’être requiert alors à l’individu de se libérer de son ego, ensuite de poser des actions qui vont dans le sens des valeurs universelles et enfin de se rendre responsable de lui-même et des autres.
La question de l’être renvoie pour ainsi dire au concret, à la mise en pratique de certaines aptitudes : celles de savoir se libérer de toutes négativités, de poser des actes positifs et de se rendre responsable de soi mais aussi des autres. L’individu qui aspire à l’être a donc pour devoir d’impacter positivement sa société à travers ses œuvres. Au fait sous l’angle de l’être, l’on parvient difficilement à dissocier le sujet de ses œuvres : ici, le sujet et ses œuvres ne font qu’un. C’est d’ailleurs à travers les œuvres et le vécu de l’individu qu’on peut parvenir à l’identifier, à savoir qui il est et où il va.
Parlant de l’Avoir, il est de l’ordre de la possession. Il est le fait de posséder une chose, acquérir une chose, disposer d’une chose qui se distingue de l’acquéreur. Avoir, nous ramène à un sujet qui est le possesseur et un objet qui est la possession. L’avoir fait pour ainsi dire, intervenir deux éléments bien distincts : une possession et un possesseur. À dire vrai, l’avoir permet à l’acquéreur de disposer d’un objet qui lui permet de répondre à certains besoins. Les possessions comme le souligne Ebénézer Njoh-Mouelle (1980) permettent de répondre à deux grands types de besoins : les besoins fondamentaux et les besoins secondaires.
Les besoins fondamentaux répondent aux besoins vitaux, aux besoins nécessaires à la survie[3], lesquels renvoient chez Épicure aux désirs naturels et nécessaires (Émile BREHIER, 2004, p. 323). Ce sont par exemples les besoins tels que le besoin de se nourrir, de se vêtir et de se soigner. Quant aux besoins secondaires, correspondant aussi à l’une des catégories des plaisirs épicuriens : désirs non naturels et non nécessaires (Émile BREHIER, 2004), ils ne sont pas nécessaires pour notre survie. En guise d’illustration, on peut mentionner le luxe, la puissance dominatrice et l’accumulation des biens. Bien que cette dernière vise à garantir à l’individu un mieux-être et une certaine sécurité sociale, elle est loin d’assurer une pleine satisfaction. Ce défaut semble trouver toute sa justification dans la fugacité même des biens matériels. C’est la raison pour laquelle le bonheur que procure l’avoir est passager. C’est pour cette raison que pour notre auteur (Ebénézer NJOH-MOUELLE, 1980, p. 24), il est inutile de vouloir garantir une sécurité sociale par le biais de l’avoir, surtout quand il s’agit de préserver des biens qui répondent à des besoins secondaires. En vérité, l’avoir peut contribuer au bien-être de l’individu. Tout être qui vit possède forcément quelque chose, car vivre sans rien est impossible. Seulement, pour éviter le fourvoiement de l’individu, il s’avère nécessaire pour ce dernier de mesurer son approche de l’avoir. De ce point de vue, Comment peut-on alors comprendre la crise du vivre-ensemble à partir de la question de l’avoir et de l’être ?
2. DIALECTIQUE DE L’ÊTRE ET DE L’AVOIR ET CRISE DU VIVRE-ENSEMBLE
Le vivre-ensemble renvoie à la vie en communauté, à l’équilibre, à la concorde entre les individus d’une même communauté ainsi qu’à l’acceptation de l’autre malgré les différences. Dans une perspective Njoh-Mouelléenne, le vivre-ensemble correspond à « l’être-avec » (Ebénézer NJOH-MOUELLE, 1980, p. 22), c’est-à-dire à la volonté d’être ensemble, non de nous appartenir mais d’affirmer quotidiennement notre volonté de vivre avec autrui, en tant que notre semblable, notre alter ego, l’autre moi-même. En effet, l’être-avec requiert l’agrément de l’autre dans sa différence indépendamment de ses possessions et atouts, ainsi que la prise en compte de sa liberté. À ce titre, la possibilité de l’être-avec nécessite un équilibre entre l’avoir et l’être, dans la mesure où, la surdétermination de l’avoir au détriment de l’être met en mal la cohésion sociale.
En fait, l’instinct excessif d’appropriation et de chosification que l’Homme de l’avoir[4] développe pour posséder ses objets de désirs le pousse à être en rupture avec l’ordre social. C’est en ce sens que pour atteindre ses objectifs, l’Homme de l’avoir est souvent amené à manipuler et à instrumentaliser les autres. C’est d’ailleurs ce qui explique la recrudescence des conflits entre l’individu et sa société. En effet, l’Homme de l’avoir parce qu’obnubilé par sa volonté de posséder et de s’approprier tout, se comporte comme s’il ignorait la liberté de ses semblables. Au fond, comme le dit Ebénézer Njoh-Mouelle (1980, 21), l’individu nie la liberté des autres en faveur de la sienne. Au fait, il n’ignore pas la liberté des autres, mais, il se comporte comme si celle-ci devait être à son service ou du moins se taire et se faire complice de la sienne.
Ainsi, même dans ses relations familiales, l’Homme de l’avoir se comporte parfois comme en propriétaire.
L’homme aveuglé par l’avoir se comporte généralement comme s’il ignorait cette liberté des autres. C’est pourquoi on le verra étendre son instinct d’appropriation chosifiant jusqu’au enfant. Il aura [par exemple,] des enfants tout comme il estime avoir des bateaux, des immeubles et des plantations. Il attendra de ces enfants de la reconnaissance et de la gratitude pour les soins et l’éducation à eux dispensés (Ebénézer NJOH-MOUELLE, 1980, p. 21).
De plus, « Jusque dans l’amour (…), l’homme de l’avoir veut se comporter en propriétaire » (Ebénézer NJOH-MOUELLE, 1980, p. 22). Il agit, selon Ebénézer Njoh-Mouelle, comme si sa femme et les autres membres de sa famille étaient des objets qui sont à sa disposition. Il veut tout s’approprier : les objets comme les êtres humains. Cela entraîne alors la réification de ces derniers. Pour l’Homme de l’avoir, la liberté des autres importe peu. Ce qui le préoccupe plus, c’est de pouvoir disposer d’eux pour atteindre ses objectifs. Du coup, cette situation fait entrevoir chez lui un égocentrisme, un sentiment de supériorité et tout autre caractère analogue. Ses attitudes sont des entraves à la bonne marche de la société, car elles n’œuvrent pas dans le sens de l’être, c’est-à-dire dans le sens du bien-être personnel et de ceux des autres ni dans celui de la responsabilité. Cela dans la mesure où, « nous sommes responsables du devenir humain de l’homme, c’est-à-dire responsable de la liberté des autres et vice-versa » (Ebénézer NJOH-MOUELLE, 1980, p. 44). Tout individu est responsable de lui-même et des autres.
Soulignons que la responsabilité dont nous parlons ici n’est pas synonyme d’une forme d’infantilisation mais de la considération des autres dans notre agir. Au point où comme le dit Emmanuel Levinas l’individu est le « gardien de son frère » (Emmanuel LEVINAS, 1972, p. 10), c’est-à-dire, le gardien de l’autre. Il s’agit, dans les relations interhumaines, de mettre en avant le souci de l’autre dans tout ce que l’individu entreprend afin de faire évoluer l’humanité. C’est d’ailleurs dans la même veine que s’inscrit l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas. Cet auteur, promoteur de l’environnement pour le bien-être de l’homme, fait de la responsabilité de l’homme une nécessité, un impératif. Selon lui, la « responsabilité est la sollicitude, reconnue comme un devoir » (1993, p. 301), un devoir des uns vis-à-vis des autres. La responsabilité est alors comme un sacerdoce que l’individu a vis-à-vis de ses semblables et réciproquement pour sa société en vers lui. Cette responsabilité s’étend aussi bien dans le présent comme dans le futur. À ce propos, la responsabilité ainsi promue doit faire prévaloir le bien-être et la liberté de l’individu ainsi que de ses semblables. Cela passe par l’ascendance de l’être sur l’avoir, seule possibilité du vivre-ensemble durable et harmonieux.
C’est pour cette raison que la surdétermination de l’avoir au détriment de l’être est source de désharmonie et de déséquilibre sociaux. Elle conduit au mal-être de la plupart des sociétés. Elle crée un climat hostile au vivre-ensemble et, par ailleurs, enferme l’individu dans une sorte de prison. En effet, sa volonté de rechercher uniquement son bien-être l’amène à être en rupture avec la société ; d’où son isolement des autres. Une telle situation jette le discrédit sur l’humanité de l’individu, car l’être humain est appelé à vivre en société, c’est-à-dire, avec ses semblables non pas en s’enfermant tout seul dans une sphère qui l’isole des autres (ARISTOTE, 1990, 91). Les êtres humains naissent, certes, libres, mais égaux c’est-à-dire qu’ils naissent libres et égaux en droit. Tel est ce qui se perçoit dans le préambule des déclarations des droits de l’homme de 1948 en ces termes ; tous les hommes « naissent libres et égaux en droit et en dignité »[5]. Chaque être humain a donc pour devoir de respecter les droits des autres. Il doit à ce titre, savoir qu’il a les mêmes droits que les autres indépendamment de ce que chacun a comme avoir. Pour ce faire, il est important pour lui, de respecter le droit des autres et de les aimer comme tels. En fait, son humanité réside dans le fait de pouvoir vivre avec ses semblables, de les aimer malgré leur différence, de les respecter et de reconnaître l’égalité de leur droit avec les siens.
À vrai dire, aucun Homme sur cette terre ne peut pleinement vivre sans les autres, sans le respect et la reconnaissance de l’égalité de ses droits avec ceux des autres. Un Homme a forcément besoin des autres pour se réaliser. Il est donc illusoire de croire qu’un individu peut vivre sans les autres ou sans tenir compte du respect et du droit des autres. Toutefois, lorsqu’il le fait, il s’enferme dans un cercle d’égoïsme et d’individualisme mortel et infernal, qui cependant, nie les droits et le bien-être de la collectivité en faveur des siens. Il refuse ainsi de faire prévaloir l’être en faisant prédominer ses intérêts personnels. C’est d’ailleurs, ce qui entraîne la perte de l’individu et de sa société.
L’amour démesuré de l’avoir au détriment de l’être conduit à ce titre, à la perte de l’individu lui-même et à la désharmonie sociale. La surdétermination de l’avoir au détriment de l’être entraîne la déréliction de l’individu et la crise du vivre-ensemble. En ce sens que, en même temps que le goût prononcé de l’individu pour son intérêt personnel le conduit à sa perte, cela entraîne corollairement le mal-être de la société. En vérité, le rapport qu’un individu entretient avec l’avoir et l’être peut soit le conduire à sa perte ou entraîner la perte de sa société ou soit favoriser son épanouissement et le mieux-être de sa société. Dans la mesure où un être humain falsifié ou aliéné ne peut véritablement contribuer à son épanouissement et à celui de sa société. Cette attitude crée une désharmonie et un déséquilibre sociaux. En fait, cette désharmonie et ce déséquilibre sociaux s’expliquent par la déréliction de l’individu qui est lui-même aliéné. Par conséquent, l’individu aliéné se met en conflit avec sa société en espérant peut-être retrouver cette liberté perdue[6].
Malheureusement, comme nous le constatons, son amour démesuré pour l’avoir le conduit à sa perte et à la perte de sa société : d’où la crise du vivre-ensemble. Une crise suscitée par une surdétermination de l’avoir au détriment de l’être, la prédominance de l’intérêt personnel sur l’intérêt général et le manque du sens de la responsabilité des uns envers les autres. Il se crée une rupture entre l’être et l’avoir, une désharmonie sociale et une crise du vivre-ensemble. C’est dès lors, l’une des causes de certains conflits au sein de la société. Des conflits dus à une démesure de l’avoir au détriment de l’être. La surdétermination de l’avoir au détriment de l’être défavorise donc le vivre-ensemble. La question de l’être et de l’avoir peut pour ce faire, défavoriser ou contribuer au vivre-ensemble. Si tel est le cas, comment peut-on alors, à partir de la question de l’être et de l’avoir favoriser le vivre-ensemble ?
3. LE VIVRE-ENSEMBLE COMME UNITÉ DE L’ÊTRE ET DE L’AVOIR
La possibilité du vivre-ensemble réside dans l’équilibre dialectique entre l’avoir et l’être. À ce propos, les possessions d’un individu, c’est-à-dire son avoir, doivent lui permettre d’œuvrer dans le sens du vivre-ensemble. L’individu doit mettre son avoir au service de l’intérêt général. Du moins, il doit s’efforcer à œuvrer dans le sens du vivre-ensemble par le biais de ce qu’il a et de ce qu’il fait pour les autres et pour lui-même. Non pas qu’il doive mettre tout son avoir à la disposition des autres au point de vivre dans l’ascétisme[7], mais au contraire il doit œuvrer dans le sens de l’intérêt général par le biais de ses possessions et de ses actions. Cela revient à dire que les œuvres et l’avoir d’un individu doivent contribuer à la cohésion sociale et non à le mettre en mal. L’être et l’avoir doivent donc contribuer au vivre-ensemble et non à la déréliction de la société et de l’individu.
Pour Ebénézer Njoh-Mouelle (1980, p. 24), l’avoir doit être un moyen au service d’une fin. Un moyen pour l’Homme de se réaliser et non une finalité en soi. À ce titre, il peut permettre à l’individu de pouvoir vivre avec l’autre sans être un frein à l’être-avec. La recherche de l’avoir ne doit pas amener l’individu à instrumentaliser où à chosifier l’autre, mais à l’accepter comme un individu ayant les mêmes droits que lui, avec lequel il faut être-avec. Être-avec, c’est-à-dire vivre avec l’autre de manière égalitaire, sans vouloir se l’approprier où l’instrumentaliser pour arriver à ses fins. Les rapports entre les Hommes doivent être égalitaires afin de favoriser une coexistence pacifique. Les individus ont donc pour devoir de se respecter, de s’aimer véritablement, de se protéger, de se soutenir ; en un mot, ils ont pour mission de rechercher le bien-être de leur prochain en faisant promouvoir l’être.
Par l’être, nous dit Ebénézer Njoh-Mouelle, « j’entends le mode d’existence où (…) on fait « un » avec le monde » (1980, p. 37). Pour dire qu’avec le mode de fonctionnement fondé sur l’être, on fait un avec ses semblables. Cette unité ontologique est d’ailleurs la seule possibilité du vivre-ensemble harmonieux qui ne pourra que concourir à l’épanouissement réel de tous les individus au sein de la communauté. Dès lors, « pour quiconque ne renverse pas les rapports moyen-fin, l’avoir doit être au service de l’être-homme » (Ebénézer NJOH-MOUELLE, 1980, p. 28) , c’est-à-dire de l’être humain qui vit avec son alter ego et qui ne peut véritablement s’épanouir qu’avec ce dernier.
En effet, la seule chose qui doit guider tout individu dans le vivre-ensemble est un positif principe directeur, c’est-à-dire un principe directeur qui vise les valeurs universelles. Autrement dit, tous les individus ont pour devoir de se laisser guider par des actions positives en ce sens que celles-ci doivent contribuer au bien-être de l’individu et de sa société. Pour ce faire, l’Homme doit nier tout ce qui est négativité en lui, la transcender en faisant appel à son aptitude à la liberté et œuvrer également dans le sens du bien-être de tous y compris du sien. L’individu a pour obligation de se libérer de tous mauvais penchants dans son agir afin d’œuvrer dans le sens d’un meilleur vivre-ensemble. À vrai dire, l’individu doit savoir que son bien-être dépend du bien-être des autres et vice-versa[8]. Il a pour sollicitude d’être responsable de lui-même et des autres, tout ce qu’il a ou tout ce qu’il fait doit contribuer à son bien-être ainsi qu’à celui de ses semblables. Toutes ses actions doivent rompre avec la recherche de tout intérêt égoïste, viser le bien et aller dans le sens des valeurs universelles, c’est-à-dire des valeurs qui font l’approbation de la raison universelle. Lesquelles valeurs, nous le savons, font partie des attributs de l’être. En plus des valeurs universelles qui doivent guider toutes nos actions, il y a aussi la liberté et le sens de la responsabilité des uns à l’égard des autres : d’où l’importance de l’être dans le vivre-ensemble. Le vivre-ensemble réside donc dans la prise en compte effective de l’être.
En fait, la possibilité du vivre-ensemble réside en la capacité d’éviter de se substituer à l’avoir pour aspirer à l’être. Il ne s’agit non plus de nier l’importance de l’avoir, mais de le mettre au servir de l’être afin qu’il ait une possibilité du vivre-ensemble. À ce titre, l’individu doit éviter de se limiter et de s’identifier uniquement à son avoir pour faire prévaloir le vivre-ensemble qui passe par la prédominance de l’être sur l’avoir. Cela requiert que pour une harmonie du vivre-ensemble, l’avoir soit subordonné à l’être. « Il ne s’agit pas pour nous de contester l’importance de l’avoir dans l’entreprise d’épanouissement (…), mais simplement d’inviter à effectuer un déplacement d’accent, un renversement des positions ; ce n’est pas l’être qui doit être subordonné [à] l’avoir mais exactement le contraire » (Ebénézer NJOH-MOUELLE, 2011, p. 169). Non pas que l’existence ou l’importance de l’avoir soit mise en doute, mais que celui-ci soit codifié de sorte à être subordonné à l’être. L’être quant à lui promeut le bien-être de l’individu et de la société. À dire vrai, la possibilité du vivre-ensemble réside dans la complémentarité de l’être et de l’avoir car, l’avoir ne peut contribuer à lui seul au vivre-ensemble. Par conséquent, c’est en subordonnant l’avoir à l’être que le vivre-ensemble est possible. Réciproquement, l’être ne peut à lui seul conduire au vivre-ensemble. De ce fait, il apparaît alors la nécessité de la complémentarité de l’être et de l’avoir pour une possibilité d’un meilleur vivre-ensemble.
Nous avons à ce titre pour devoir de nous auto-éduquer dans le sens du vivre ensemble en rapport avec la question de l’avoir et de l’être. C’est dans cette logique que s’inscrit la pensée de Diakité Samba lorsqu’il affirme qu’un « adulte qui ne s’auto-éduque pas est constamment sous la menace du vivre ensemble» (2016, p. 13). En effet, ce dernier en même temps qu’il met en mal le vivre ensemble s’expose lui-même à de graves conséquences qui ne pourront que contribuer à sa souffrance. L’individu doit donc s’auto-éduquer dans le sens du vivre-ensemble pour son bien-être et celui de sa société. Il doit nécessairement subordonner l’être à l’avoir pour un meilleur équilibre entre ces deux notions et un rapport dialectique entre celles-ci qui ne pourra que contribuer au vivre-ensemble. La prise en compte de l’éducation ou de l’auto-éducation de l’individu peut dès lors, contribuer à l’équilibre et à l’unité entre l’être et l’avoir. Cela est un facteur idéal de la cohésion sociale.
Samba Diakité ne dira jamais assez, l’individu « ne doit pas seulement rechercher ses intérêts, mais aussi ceux des autres. (…) [il] doit comprendre que c’est ensemble, dans une ruche, que les abeilles produisent du miel » (2016, p. 75). C’est en s’agrégeant que les individus contribuent à l’amélioration de leur condition de vie et de celle de la société. Ainsi c’est dans l’équilibre entre l’être et l’avoir que nous pourrons parvenir au vivre-ensemble et contribuer dans le même élan à l’amélioration des conditions de vie de l’individu ainsi que à celle de sa société. Le vivre ensemble réside alors dans l’équilibre et l’unité de l’avoir et de l’être. Il apparait dès lors l’urgence d’éduquer nos populations sur la nécessité de subordonner l’avoir à l’être pour que vive un radieux vivre-ensemble.
CONCLUSION
Pour Ebénézer Njoh-Mouelle, la question l’être et de l’avoir influe sur le vivre-ensemble. Celle-ci peut soit favoriser l’être-avec ou soit la défavoriser. D’une part ; elle défavorise le vivre-ensemble lorsqu’il y a surdétermination de l’avoir au détriment de l’être et peut d’autre part y contribuer lorsqu’il y a une subordination de l’avoir envers l’être. Pour ce faire, la possibilité et la consolidation du vivre-ensemble résident dans l’unité et l’équilibre dialectique entre l’être et l’avoir qui passent par l’éducation ou la rééducation de l’individu sur l’importance de promouvoir les valeurs universelles et d’avoir le sens de la responsabilité des uns à l’égard des autres. La recherche de l’être doit donc être le but ultime de tout être humain en ce sens qu’elle contribue considérablement à un vivre-ensemble harmonieux.
BIBLIOGRAPHIE
André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Presses universitaires de France, 1926, 1323 p.
ARISTOTE, Les Politiques, trad. Pierre PELLEGRIN, Paris, Flammarion, 1990, 567 p.
Ebénézer NJOH-MOUELLE, De la médiocrité à l’excellence : Essai sur la signification humaine du développement, Yaoundé, CLÉ, 2011, 187 p.
Ebénézer NJOH-MOUELLE, Développer la richesse humaine, Yaoundé, CLÉ, 1980, 71 p.
Émile BRÉHIER, Histoire de la philosophie, Paris, Quadrige / PUF, 2004, 1790 p.
Emmanuel LEVINAS, Humanisme de l’Autre Homme, Paris, Fata Morgana, 1972, 123 p.
Hans JONAS, Le principe responsabilité : Vers une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, 340 p.
Samba DIAKITÉ, Identités et reconnaissance : L’Afrique en sursis, Saguenay, Différance pérenne, 2014, 120 p.
Samba DIAKITÉ, Les larmes de l’éducation : Contribution à l’éthique professionnelle en enseignement, Saguenay, Différance Pérenne, 2016, 113 p.
VERTU KANTIENNE ET VIVRE-ENSEMBLE
Désiré GUI
Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La philosophie kantienne notamment la doctrine de la vertu est la cible de kyrielle de controverses. Ces multiples interprétations rendent l’objectivité de la morale kantienne soit inaccessible, soit maladroitement comprise. Cependant, à la lumière d’une appropriation et d’une méditation sérieuse du philosopher kantien, ces controverses semblent superficielles. Cette réflexion se propose pour tâche de démontrer que la moralisation de l’homme est le but de la morale kantienne. En d’autres termes, c’est à partir de l’analyse des concepts fondamentaux de : d’humanisme, de devoir, de sujet moral, de l’impératif catégorique… que la vertu kantienne se perçoit fondamentalement comme une véritable philosophie dont le bien-fondé réside essentiellement dans l’édification du vivre-ensemble.
Mots clés : Discipline, Impératif catégorique, Liberté, Société, Paix, Sujet.
ABSTRACT :
Kant’s philosophie notably the virtue doctrine is the target of long stream controversies. These interpretations make the objectivity of kant’s moral wether inaccessible, or his understanding clumsy. Nevertheless, with a bright appropriation and a serious meditation of kant’s philosopher, these controversies seem superficials. Show that the moralization of man is the aim of kant’s virtue doctine is the task that this thought intend. It means that, it’s according the analysis of basics concepts of : humanismous, done, virtue man, catégorical impérative…that kant’s virtue doctrine, fundamentally become clear as a authentic philosophy that the quintessence reside essentielly in the live together elaboration.
Keywords: Discipline, catégorical Impérative, Liberty, Société, Peace, Subjet.
INTRODUCTION
La réponse kantienne à la question ‘‘Qu’est-ce que les Lumières ?’’ est la mise en exergue de l’exigence du vivre-ensemble et de la recherche de la paix, en tant que des préoccupations de proue de son époque. En effet, en affirmant que : « les Lumières sont « le penser rationnel sur les choses de la vie humaine selon leur importance et influence sur la destination de l’homme » (Emmanuel KANT, 2006, p. 6), Kant montre que les facultés humaines de même que les sciences et les arts doivent concourir à une fin : harmoniser la coexistence. Cette préoccupation n’est-elle pas ce qui est en jeu dans son projet de paix perpétuelle ?
Dans la pensée kantienne, la recherche de la paix est une préoccupation majeure comme en témoigne la problématique de l’antinomie dans les différentes Critiques (dans la première Critique Kant cherche la paix entre les métaphysiciens, dans la deuxième, il traite la question de la liaison entre l’idée du bonheur et le concept de devoir, enfin dans la dernière critique, il traite de l’antinomie du goût). La résolution de l’antinomie de la deuxième Critique est dans la philosophie kantienne la théorisation la plus rigoureuse concernant le vivre-ensemble. En affirmant que les conflits naissent du fait que l’homme s’écarte volontairement de l’impératif catégorique, Kant présente les concepts fondamentaux de la morale comme la clé de voûte pouvant permettre à l’humanité de s’orienter dans la voie sûre de la quête de la coexistence harmonieuse et de la paix perpétuelle. Il dira en ce sens :
La raison, du haut du trône du pouvoir moral législatif suprême, condamne absolument la guerre comme voie de droit, et fait à l’inverse, de l’état de paix, le devoir immédiat, et comme cet état ne peut être institué ni assuré sans un contrat mutuel des peuples, – il faut qu’il y ait une alliance d’une espèce particulière qu’on peut nommer l’alliance de paix (foedus pacificum) et que l’on distinguerait d’un contrat de paix (pactum pacis) en ce sens que ce dernier chercherait à terminer simplement une guerre tandis que la première chercherait à terminer pour toujours toutes les guerres ( 2006, p. 91).
Ce passage de Vers la paix perpétuelle permet de cerner l’évocation aristotélicienne selon laquelle l’homme est un animal politique, pour dire que l’homme n’est authentiquement homme que dans la société, dans l’existence communautaire qui favorise sa réalisation. Cependant, cette vie communautaire ne va pas de soi, elle ne se donne pas hic nunc parfaite et paisible. La vie communautaire est une conquête, une recherche de conditions de possibilité de l’harmonisation de celle-ci, du fait de la nature humaine portée à s’affirmer et à satisfaire certains besoins. C’est bien dans la compréhension de cette double nature de l’homme, en tant qu’être destiné à vivre avec ses semblables et porté à satisfaire des besoins, que la question du vivre-ensemble acquiert toute sa quintessence, dans le kantisme.
Aujourd’hui, la question du vivre-ensemble est d’actualité plus que jamais. En effet, des agressions de personnes, aux victimes du fondamentalisme religieux dans les attentats à la bombe de tous genres, en passant par l’exploitation des plus démunies, les prises d’otage, les crises postélectoraux, les rébellions armées…l’actualité aux quatre coins du monde fonde à repenser rigoureusement l’existence sociale. En clair, l’exigence d’une véritable critique de la condition de l’homme en vue de rendre la vie communautaire conforme aux principes de l’humanité s’impose.
Comprise maladroitement ou partiellement, la doctrine de la vertu kantienne est dans son élaboration une philosophie, qui jette les bases du principe du vivre-ensemble. Porter donc un ‘‘regardsur le vivre-ensemble à la lumière de la doctrine de la vertu kantienne’’ c’est ambitionner de proposer des pistes de solution par des principes rationnels à la dégradation de l’harmonie sociale. Dégradation qui pour le moins qu’on puisse dire réside dans « la question de l’avoir et être constituants essentielles de ce qui est en jeu dans les crises » (Antoine KOUAKOU, 2011, pp. 68-85), dans l’oubli du devoir. N’est-ce pas pour sa rigueur dans l’élaboration des conditions de sociabilité que la vertu kantienne est traitée de morale d’ange ? Comment parvenir au vivre-ensemble à partir de la vertu kantienne ? Quels sont les concepts fondamentaux du vivre-ensemble chez Kant ?
1. L’AMBIGUITÉ DE LA SUBJECTIVITÉ
Il nous semble pouvoir discerner une ambiguïté relative à une polyvalence d’appréhensions de la subjectivité. Comment cerner les contours de cette ambiguïté, si ce n’est pas un questionner fondamental de l’existence. Exister, qu’est-ce donc si ce n’est prendre conscience de son être-là au monde ; c’est-à-dire se saisir comme être dont toute la nature réside dans sa particularité à se soustraire de la présence immédiate parmi les phénomènes ? Exister dès lors ne peut se comprendre que comme se poser. Autrement dit, la vie de l’homme est traversée par le défi et l’exigence de s’exprimer, de s’affirmer. De la sorte, l’homme s’appréhende toujours comme sujet. À cet effet, la primauté du ‘‘Je’’ dans le jeu des rapports interhumains n’est-elle pas révélatrice ? Il est évident que le ‘‘Je’’ en tant que manifestation de la conscience du sujet, du ‘‘Moi’’ est le centre de gravité de la vie. Autrement dit, la subjectivité s’impose comme valeur indomptable, fondatrice des universaux. Or, cette nature du sujet soulève une kyrielle de conceptions. Comment parvenir à saisir l’ambiguïté de la subjectivité ?
Des mythes en passant par les contes africains aux théories et doctrines philosophiques, l’attention accordée au sujet est capitale. Tout se passe comme si tout l’univers et toute la création ne dépendaient que du ‘‘sujet’’. Tout serait donc fait pour et en vue du bien-être du ‘‘sujet’’. Une telle affirmation ne fonde-t-elle pas sa véracité à travers les théories du Géocentrisme[9] ? Plus nettement, on pourrait, en ce qui concerne la philosophie, dire que la valorisation du sujet est pour l’essentiel, ce qui donne tout son sens aux différentes révolutions comme en témoigne la pensée de Platon et de Descartes à travers son cogito. Sinon pourquoi définir les Lumières comme un impératif d’émancipation à l’égard des tutelles ?
«Aie le courage de te servir de ton propre entendement » (Emmanuel KANT, 1976, p. 9), ne veut rien dire d’autre que la valorisation et la mise au premier plan des facultés humaines. Cela dit à quoi renvoie la subjectivité in concreto ? La subjectivité n’est pas un culte des philosophies rejetant la totalité. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un rejet catégorique du tout, de la communauté de l’altérité. Il ne s’agit en aucun cas de soutenir que :
je suis le maître du monde, la ‘‘majesté’’ est à moi. Le monde est devenu prosaïque, car le divin en a disparu : il est ma propriété, et j’en use comme il me plaît (savoir, comme il plaît à l’esprit). Par le fait que le Moi s’était élevé à ce titre de possesseur du monde, l’Égoïsme avait remporté sa première victoire, et une victoire décisive : il avait vaincu le monde et l’avait ‘‘supprimé’’, et il confisqua à son profit l’œuvre d’une longue suite de siècles (Max STIRNER, 2002, p. 88) à l’extrême.
Mais plutôt de la valorisation des facultés de l’homme en vue de parvenir à une société harmonieuse. Ne sommes nous pas fonder à comprendre que la subjectivité dont il s’agit, le sujet à qui s’adresse la question du vivre-ensemble est cet être qui doit rentrer en lui-même, un être dont la vocation réside dans un se questionner soi-même pour faire agir ces facultés naturelles ? De la sorte, ce que renferme la subjectivité c’est la recherche des principes d’une existence digne de l’humain, d’une poursuite de la sagesse qui elle-même « consiste par ailleurs bien davantage dans la conduite que dans le savoir » (Emmanuel KANT, 1994, p. 75). Ce qui ressort du rapport savoir et conduite que fait Kant ne saurait être une évocation poussée à l’extrême de l’égo, de l’individuel mais plutôt d’un comment vivre ?
En clair, la subjectivité est pour Kant une introspection, c’est-à-dire une invitation à rentrer en soi-même, pour rendre notre rapport à l’altérité parfaite. Dès lors, la doctrine de vertu est à entendre toujours comme « connaissance morale, la science de ce qu’il nous faut faire » (Bernard GROETUYSEN, 1966, p. 115). Une telle définition de la morale n’est-elle pas l’affirmation de la liberté comme valeur suprême de l’agir ? Si la subjectivité soulève une ambigüité n’est-ce pas parce que la liberté, principe sous-jacent de cette subjectivité souffre d’une méconnaissance et partant d’un mésusage ?
2. LA LIBERTÉ PRATIQUE COMME PROCÈS DE L’EXISTENCE HUMAINE
« L’homme est libre quand il exerce sa puissance propre qui est le penser, quand ses actes découlent de la nécessité de sa nature humaine ; nécessité certes, mais qui n’est pas contrainte extérieure, impuissance de l’esprit ; nécessité inhérente au réel et non extérieur à lui » (Baruch de SPINOZA, 1954, p. 29) ; que saisir comme substance d’une telle affirmation ? Ce passage met en relief une idée centrale à savoir la définition de l’homme comme être dont toute l’essence réside dans la liberté. De la sorte, il est aisé de comprendre que si l’homme est liberté c’est pour exercer sa pensée. Rappelons de façon synoptique que la liberté pratique revoie toujours à l’exercice de la volonté. Elle est relative à l’action. Sa réalité dépend du devoir. Cette liberté diffère de la liberté dans le domaine de la nature ; qui n’est autre que le déterminisme.
Elle soustrait l’homme du dicta des divinités, en enraciner toute la pensée en l’homme. Le garant des actions humaines c’est l’homme lui-même. Avec la liberté pratique, il s’agit de la mise au pinacle des facultés humaines en vue du rejet de l’anthropomorphisme. Kant bat en brèche les conceptions classiques de l’existence et de l’harmonie sociale. Il n’est plus question de faire comme les Anciens qui :
Dans leur esprit, le monde des dieux et celui des hommes ne faisaient qu’un. Il fallait donc communiquer avec les dieux. Si les hommes les honoraient bien, ils pouvaient éviter les catastrophes (maladies, tremblement de terre…) et même provoquer des naissances ou de bonnes récoltes » (Emilie BEAUMONT, 1949, p. 7).
Désormais l’homme est responsable de son existence car il est libre.
Ce qui est en jeu dans la liberté, ici, c’est qu’en tant qu’elle conduit à une prise de conscience chez l’homme. Cette prise de conscience stipule que l’existence est toujours tournée vers l’autre ; elle n’est pas close mais ouverte pour pasticher Bergson. La liberté est donc essentiellement coexistence. Car : « la conscience de ma propre existence est en même temps une conscience immédiate de l’existence [de mes semblables] » (Emmanuel KANT, 1976, p. 251). La pensée devient, dès lors la mise en œuvre de la liberté. Autrement dit, sans la liberté la pensée serait difforme, vague et sans contenue et l’action ne serait qu’une succession d’accidents. Comment comprendre donc cette corrélation, ce lien indissociable entre la liberté et le penser ? Dans la formule pascalienne selon laquelle l’homme n’est « qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant » (Blaise PASCAL, 1972, p. 78), l’homme est défini comme pensée. Avec Kant, cette pensée n’est rien d’autre que la manifestation de la liberté. Ce qui permet de conclure que travailler à bien penser c’est vivre selon le seul principe de la liberté. Qu’est-ce que la liberté ?
Par liberté, il faut entendre autonomie de la volonté, comme le souligne Kant. Cela revient à dire que l’homme s’autodétermine, il échappe au déterminisme phénoménal pour donner sens à son existence. La liberté renvoie donc au fait d’être la cause de son action ; en ce sens la liberté s’oppose à la liberté transcendantale ou cosmologique : « idée cosmologique d’une absolue spontanéité, résultant de l’élévation à l’inconditionné de la catégorie de causalité » (Jean-Marie VAYSSE, 2007, p. 114). La liberté, ici, est la mise à l’œuvre de la pensée, de la raison en tant que faculté d’où sont tirés les principes de l’action à exécuter. La liberté est donc dite pratique en tant qu’elle est « liberté effective propre à l’homme en tant qu’être raisonnable, doté d’un caractère intelligible et capable de se donner à lui-même la loi inconditionnée de son agir » (Jean-Marie VAYSSE, 2007, p. 115). La liberté, comme on peut s’en apercevoir est le fondement de l’existence humaine. De la sorte, elle est l’élément capital de toute organisation sociale dans la mesure où se sont des êtres libres qui se rencontrent, ce sont des individus libres qui, dans leur rapport les uns avec les autres, participent de la création de la société.
La nécessité de la liberté vient de ce qu’elle permet de comprendre et de prévenir les conséquences de l’insociable-sociabilité ; elle permet de soustraire l’action humaine de la pure contingence, des justifications superflues pour en faire un objet rationnel, un fait de science. Telle que conçue par Kant, la liberté fait de la morale une véritable science. C’est en tant qu’elle fait de la moralité une véritable science, qu’elle est le postulat mis au pinacle dans la philosophie pratique. Par elle, l’homme acquiert toute sa nature d’être pensant capable de devenir meilleur.
Devenir meilleur dans l’entendement de Kant c’est mettre toujours en œuvre sa liberté, c’est-à-dire, comprendre que : « la moralité suppose par conséquent que l’on dépasse son point de vue particulier, son égoïsme et ses intérêts, pour considérer le bien commun » (Emmanuel KANT, 1994, p. 31). La question que soulève cet appel à transcender, par l’exercice de sa liberté, le ‘‘Moi’’ pour le ‘‘Tous’’, c’est-à-dire penser le bien de tous avant le sien, vouloir le bien du groupe et de la communauté avant celui de l’individu ; en clair mettre l’universel avant et au-dessus du particulier est la suivante : la liberté telle que la conçoit Kant est-elle possible dans un contexte des rapports humains où l’homme est un loup pour l’homme selon Hobbes ? En d’autres termes, peut-on accorder crédit à la morale de la liberté kantienne dans une existence dans laquelle celui qui veut être un être de bien parmi tant de mauvais court à sa propre perte ?
La réponse à cette question ritournelle faisant de la morale kantienne un sujet de multiple controverses est bien exposée dans les Fondements lorsque le philosophe de Königsberg écrit : « si la liberté n’avait pas d’effets dans le monde sensible, la morale serait une absurdité : l’impératif catégorique ne pourrait jamais se réaliser, et la soumission à la loi morale, bien qu’impérative, ne serait qu’un mot » (Emmanuel KANT, 1994, p. 18). Autrement dit, c’est en tant que la liberté n’est pas une abstraction que la vie d’un homme devient affaire de tous. Un individu par son action peut à la fois constituer une menace, un danger tout comme le salut de l’humanité. La liberté ; autonomie de la volonté est donc le fait d’obéir à la loi et non d’être soumis à la nécessité. Ici, il est salutaire de rappeler la célèbre formule du Contrat social, (livre I, chap. VIII), l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté.
Qu’est-ce que Rousseau veut mettre en relief à travers ce passage si ce n’est que « l’homme, même le plus nuisible, est peut-être encore le plus utile sous le rapport de la conservation de l’espèce ; car il entretient en lui-même ou par son influence, chez autrui, des impulsions sans lesquelles l’humanité se serait relâchée et aurait pourri depuis longtemps » (Friedrich NIETZSCHE, 1957, pp. 69-70). En analysant ce bout de phrase nietzschéen dans les sillages de Rousseau on en arrive à la conclusion kantienne selon laquelle la liberté est toujours tournée vers l’extérieur, elle n’est pas close.
De cette nature, la liberté s’oppose à toutes sortes d’hétéronomie qui n’est pas :
Seulement l’obéissance à autrui. Même si je me donne ma loi, elle peut encore relever de l’hétéronomie si elle n’est pas formellement déterminée. Le paradoxe est que je n’obéis vraiment à moi-même, ce qui est l’autonomie, que lorsque ma maxime n’a plus rien de singulier : elle est universelle » (Michel COUDARCHER, 2008, p. 130).
Cette distinction entre liberté et hétéronomie ne témoigne-t-elle pas de l’importance de la discipline comme travail de perfectionnement de l’homme en vu d’appliquer l’impératif catégorique ? Comment comprendre la magnificence de l’impératif catégorique et de la discipline comme exigence pour la fondation d’une société authentiquement humaine ?
3. PROLÉGOMÈNES À UNE COEXISTENCE HARMONIEUSE À PARTIR DE L’IMPÉRATIF CATÉGORIQUE ET DE LA DISCIPLINE
L’impératif catégorique est sans ambages dans la morale kantienne ce qui atteste de la recherche de l’humanisme. Par l’impératif catégorique, Kant montre combien l’homme doit transcender sa nature bestiale, son égoïsme ; fondement de toutes les crises et de tous les conflits. Avec l’impératif catégorique, l’existence humaine se conçoit non plus comme une guerre de conscience, une guerre de tous contre tous, mais une exhortation à lutter contre les mauvais penchants. La grandeur de l’impératif catégorique résulte de ce qu’elle permet de comprendre que l’homme possède les principes de bonne conduite dans sa raison, et qu’il s’en écarte volontairement. Et, Pascal n’a pas tord lorsqu’il écrit : « jamais on ne fait le mal si pleinement et si gaîment que quand on le fait par conscience » (Blaise PASCAL, 1972, p. 57). Pour rendre donc compte de son humanité, l’homme ne doit-il pas se faire sien l’impératif catégorique dont la formule suppose : « agis seulement d’après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » ? (Emmanuel KANT, 1994, p. 97).
Cet impératif montre que la volonté libre est une volonté soumise à des lois morales. Dès lors, la volonté est pour elle-même, dans toutes ses actions, une loi, qui renvoie simplement au principe qui veut que toute action soit constamment tournée à la recherche du bien de tous. La conception de l’impératif ne fonde-t-elle pas à saisir l’homme comme être dont tout le sens de l’agir est guidé par la bonne volonté ? Comment comprendre que sans l’ombre d’un doute on s’aperçoit qu’il suffit de jeter un regard par la fenêtre pour voir les misérables et les malheureux ?
Si seuls les hommes libres créent leur propre fortune et que pour Kant la moralité consiste à n’agir toujours qu’en direction du bien de l’universalité, pourquoi arrive-t-il que
C’est le ridicule qui naît de la contradiction entre ce que l’on pense et les faits concrets, les cas indéniables qui se présentent ici et là. C’est l’ironie qu’il y a à parler du meilleur des mondes possibles, devant la misère de la vie ; c’est la vanité de toutes les affirmations d’ordre général sur la vie, lorsqu’on leur oppose la vie elle-même » ? (Bernard GROETUYSEN, 1966, p. 86).
Les principes en vue d’une moralisation de l’homme peuvent-il avoir un sens, autrement dit, l’impératif catégorique n’est-il pas trop intelligible pour les hommes ?
De toute évidence, en ce qui concerne le genre humain, on peut dire que ce qui n’est pas en tout temps et en tout lieu utile aux hommes, n’est utile à personne. Car l’homme dans tout son être est traversé par la vocation de ‘‘persévérance dans l’être’’, c’est-à-dire la recherche du mieux être, la conservation de l’espèce mais surtout le désir d’être heureux. En tant que l’homme est traversé par l’exigence de la quête du bonheur, il doit comprendre que tout ce qui est nuisible au genre, tout ce qui ne contribue au perfectionnement de l’humanité est nuisible à tous, parce que contraire à la conscience collective. Dès lors, ce qu’il y a de plus sûr « au milieu de tous les doutes qu’on tourne depuis quatre mille ans en quatre mille manières… est de jamais rien faire contre sa conscience ‘‘…» (Bernard GROETUYSEN, 1966, p. 66). La conscience est toujours portée vers le bien, ce qui fait dire d’elle qu’elle est instinct divin.
Si l’impératif catégorique est la recherche constante de ce qui est utile au genre, c’est parce que je ne peux pas vouloir ce qui peut nuire à tous dans la mesure où je me détruirais moi-même. Comment mon bien serait-il un bien si en me le procurant je détruis toute possibilité d’en jouir en nuisant au genre humain ? N’est-ce pas là la résolution du rapport du général au particulier ? Tout bien considéré, c’est dans la définition de ‘‘métaphysique’’ que Kant expose les conditions de ce rapport. Il nomme en effet ; « métaphysique le procédé non seulement légitime, mais nécessaire, par lequel nous pensons le rapport de l’universel au particulier. Ce procédé consiste à ajouter à la structure catégoriale formelle un minimum d’empiricité » (Emmanuel KANT, 1994, p. 33).
En clair, Kant n’a jamais exclut le fait que l’homme est d’une nature double et que de lui on peut dire qu’il ne fait pas le mal parce qu’il veut le bien. Au contraire celui-ci veut la stabilité sociale, il recherche la paix, il veut faire le bien à autrui. Or, il recherche sans cesse le profit, le gain, le matériel…au détriment des valeurs cardinales : il cherche l’avoir plutôt que l’être. Comment donc faire prévaloir le bon sens, le bien au détriment des concupiscences ? À cette inquiétude ne peut-on pas a priori dire ceci avec Kant :
Si j’étais simplement membre du monde intelligible, mes actions seraient donc parfaitement conformes au principe de l’autonomie de la volonté pure ; si j’étais simplement un élément du monde sensible, elles devraient être tenues pour totalement conformes à la loi naturelle des désirs et des inclinations, par conséquent à l’hétéronomie de la nature. (Dans la première perspective, elles reposeraient sur le principe suprême de la moralité ; dans la seconde, sur celui du bonheur.) Mais dans la mesure où le monde intelligible contient le fondement du monde sensible, donc aussi de ses lois, et qu’en se sens, eu égard à ma volonté (qui appartient totalement au monde intelligible), il est une source immédiate de législation et doit donc aussi être conçu comme tel, je devrais me reconnaître, bien que d’un autre côté je doive m’envisager comme être appartenant au monde sensible, soumis pourtant à la loi du premier, c’est-à-dire à la raison qui contient la loi dans l’Idée de la liberté, et donc à l’autonomie de la volonté, – par conséquent je devais considérer les lois du monde intelligible comme constituant pour moi des impératifs et les actions conformes à ce principe comme définissant des devoirs (1994, p. 141).
Comme on peut le constater, c’est parce que l’homme doit toute son humanité à sa partie intelligible que l’impératif catégorique n’est aucunement un vœu pieux ; vouloir ce n’est pas un simple vœu, mais le principe déterminant de l’action dans la mesure où il réside dans sujet lui-même. Cela dit, ce qui est sous-jacent dans la formule de l’impératif catégorique c’est la question de la responsabilité mais surtout le sentiment du respect. En effet, c’est parce que dans notre conduite, nous pouvons être tenus pour responsable que toujours la maxime, c’est-à-dire, les déterminations de la volonté, présume que nous agissions volontairement, consciemment et librement. Pour tout dire :
Les maximes, en tant que principes pratiques, font abstraction des circonstances particulières. Elles ne sont pas déterminées par la situation donnée, mais elles peuvent lui être appliquées. Elles sont le principe donateur de critère ou de forme, d’après lequel on répond, en dernière analyse, à une situation donnée » (Otfried OFFE, 1993, 89).
Dès lors, ne peut-on pas affirmer que la philosophie pratique vise un dépassement de tout principe valorisant l’égoïsme ? N’est-ce pas ce caractère universalisable des maximes qui permet de comprendre le problème social et les conflits entre les humains comme relevant d’un oubli du devoir ?
Répondre a priori par l’affirmative à cette question ne poserait aucune polémique, si partout l’homme faisait le bien et qu’il s’excluait allègrement du dicta de ses penchants. Si les évènements de notre époque ne fondaient pas à jeter un discrédit sur l’affirmation antique selon laquelle l’intelligence n’a pas été donnée aux gens pour qu’ils saisissent l’essence des choses, mais pour leur permettre de bien agir. Et que l’on agissait « selon une maxime qui puisse en même tant temps valoir comme loi universelle » (Emmanuel KANT, 1994, p. 178). De la sorte, la recherche du vivre-ensemble doit s’entendre comme une construction. Cette construction invite à comprendre qu’il subsiste un effort considérable à faire en vue de l’harmonisation de la coexistence. Il s’agit de mettre en exergue les mécanismes pouvant permettre à la volonté de toujours respecter les exigences de l’impératif catégorique. Autrement dit, comment l’homme peut-il se plier aux lois de sa raison qui sans contexte rendraient la sociabilité réelle ? En affirmant que :
La question de savoir comment un impératif catégorique est possible ne peut donc être résolue que dans la mesure où l’on parvient à indiquer l’unique supposition à laquelle se trouve soumise sa possibilité, à savoir l’Idée de la liberté, ainsi que dans la mesure où l’on peut apercevoir la nécessité de cette supposition, ce qui est suffisant pour l’usage pratique de la raison, c’est-à-dire pour convaincre de la validité de cet impératif, donc aussi de la loi morale, mais comment cette supposition elle-même est possible, cela ne se laisse jamais apercevoir par aucune raison humaine (Emmanuel KANT, 1994, p. 151,
Kant montre que l’impératif catégorique suppose donc la liberté comme substrat pour son effectuation. C’est pourquoi, l’autonomie de la volonté n’est pas seulement un concept manifestement valable a priori, car ce qui vaut pour le conditionné, la loi morale, vaut à plus forte raison pour ce qui le conditionne ; l’autonomie, en tant que condition de possibilité d’un concept valable a priori, présente avant toute expérience, est elle-même valable a priori. La liberté suppose donc un travail constant de la raison afin de faire de l’impératif catégorique une réalité.
Ainsi, l’homme ne devient véritablement homme que lorsque son action tend à prendre le bien de l’autre, le bien de tous comme valeur suprême. Cela suppose qu’on ne peut être heureux qu’à la condition de se séparer des choses et de se rapprocher de soi. Ou encore, ce qui est recherché en dehors de la liberté ne peut satisfaire l’humain. Il convient dès lors d’exhorter les hommes à tout mettre en œuvre en vue, « de travailler et d’œuvrer dans notre vie, sans trop poser de questions» (Bernard GROETUYSEN, 1966, p. 92). Cette exhortation est dans la philosophie pratique kantienne ce que traduit la discipline. À quoi renvoie ou qu’entendre par discipline ? Quelle importance recouvre le concept de discipline dans une réflexion portant sur l’éduquer au vivre ensemble ?
La discipline est la « contrainte réprimant pour la détruire la tendance à nous écarter de certaines règles. Elle se distingue de la culture, qui nous donne une aptitude et contribue à la formation d’un talent » (Jean-Marie VAYSSE, 2207, p. 52), en ce qui concerne les hommes en tant qu’être doués de raison, ses règles sont l’ensemble des valeurs cardinales ; c’est-à-dire les lois pratiques. Ce faisant, on peut dire que la discipline est un travail introspectif ou intérieur, un effort sur soi pour agir moralement. C’est en tant que l’impératif catégorique ne s’accomplit pas in concreto dans la société que la question de la discipline devient très capitale. En effet, l’homme ne prend pas toujours son prochain comme fin en soi mais plutôt comme moyen. Il est porté à valoriser les fins subjectives (valables seulement pour moi) en lieu et place de celles qui sont objectives (valables pour l’humanité entière en tant qu’espèce raisonnable). La discipline est le gardien qui lui permet de séjourner constamment dans la sphère de la moralité. En d’autres termes, la discipline vise à maintenir l’homme dans le respect des lois pratiques.
Lorsque l’Hermite de Königsberg critique les fondements des morales antiques en soutenant que :
La modération dans les affects et les passions, la maîtrise de soi, la sobriété de réflexion ne sont pas seulement bonnes à bien des égards, mais elles semblent même constituer une dimension de la valeur intrinsèque de la personne ; reste qu’il faut de beaucoup qu’on puisse les déclarer bonnes sans restriction (quand bien même elles ont été valorisées de manières inconditionnée par les Anciens). Car, sans les principes d’une volonté bonne, elles peuvent devenir extrêmement mauvaises, et le sang-froid d’un vaurien le rend, non seulement bien plus dangereux, mais aussi immédiatement, à nos yeux, plus abominable encore que nous ne l’eussions estimé sans cela (Emmanuel KANT, 1994, p. 60).
Il ne dit pas que la bonne volonté s’exprime sans condition en tant que principe transcendantal, c’est-à-dire condition de possibilité de l’expérience pratique. Il ne dit pas que l’homme est capable de faire le bien en toute circonstance. Il montre simplement que c’est en tant que l’homme possède la raison qu’il est capable de se démarquer des actions qui participent de sa petitesse. Kant exhorte à se rapprocher de la raison en mobilisant tous les moyens qui sont en notre pouvoir : objet visé par la discipline. La discipline suppose que l’homme a des dispositions naturelles (tendances animales) qu’il faut purifier. Dans cette perspective, ne peut-on pas dire de la morale kantienne qu’elle a pour fin l’éducation ?
Dire de la morale kantienne qu’elle vise l’éducation ne relève pas d’un éloge sans fondement. Car Kant vise à fonder une morale possible pour tous les êtres raisonnables de l’univers et non d’en inventer. En visant l’universalité sa doctrine de la vertu donne à la liberté toute sa plénitude. Dès lors, ce qui importe c’est l’effort et non le résultat. Si l’effort pour accomplir l’acte moral est supérieur à l’effet, n’est-ce pas justement parce que toute éducation est dite telle que par appropriation de connaissances et de valeurs à même de rendre meilleur ? N’est-ce pas parce qu’éduquer c’est ordonner une certaine conduite ? Tout indique à partir de la discipline que « Kant n’a jamais dit qu’il ne faut pas du tout utiliser un être qui est une personne comme moyen, ce qui rendrait toute vie sociale impossible. Ce qui serait immoral c’est de ne l’utiliser que comme moyen » (Michel COUDARCHER, 2008, p. 137). Cette précision de Coudarcher n’atteste-t-elle que la discipline est un mécanisme d’instruction, d’éducation ?
Tout bien considéré, la discipline est un prédicat de l’éducation en ce sens que l’éducation vise l’idée d’humanité, marche vers laquelle l’existence humaine est tournée. La discipline réprime les penchants en vue de rapprocher l’homme de la moralité. En clair, c’est parce qu’il y a en l’homme des tendances capables de détruire la stabilité, la quiétude et l’harmonie sociale ; c’est parce que l’homme est un être qui porte en lui des germes de la guerre, des conflits que la discipline est incontournable dans la recherche de la sociabilité. Elle est importante en ce sens qu’elle permet de saisir l’homme à la fois comme un ange et une bête.
La discipline permet de contenir la bonne dose d’agressivité qui somnole en l’homme de sorte à faire de lui un ‘‘être pour l’autre’’. In finé, disons que la discipline empêche que l’homme soit détourné de sa destination, qui es celle de l’humanité, c’est ce qui donne à l’impératif catégorique toute sa valeur universelle ; avec pour formule : « agis seulement d’après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (Emmanuel KANT, 1994, p. 97).
CONCLUSION
Bien que tous les penseurs s’accordent à soutenir que l’insertion sociale est la condition du développement des facultés humaines, qu’elle confère l’effectivité de l’humanité, dans la mesure où il est :
Manifeste, à partir de cela que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard (des circonstances), est soit un être dégradé soit un être surhumain, et il est comme celui qui est injurié (en ces termes) par Homère : ‘‘sans lignage, sans loi, sans foyer » (ARISTOTE, 1990, p. 90).
Cependant, cette existence sociale ne va pas de soi. En clair, le vivre ensemble en tant que ce à quoi l’homme est naturellement destiné est une construction. Comment rendre cette coexistence harmonieuse ? Cette question est l’une des plus anciennes et récurrentes en philosophie. Récurrentes dans la mesure où bien que les règles et prescription sont établies les sociétés n’échappent pas aux crises, aux troubles.
Cette résurgence de l’instabilité est ce que Renaut met en exergue à travers ce constat : « tout le renouveau contemporain de la philosophie politique et de la philosophie morale l’atteste : nos sociétés se trouvent, plus que jamais sans doute, confrontées au problème fondamental de savoir de quelle manière et par quels dispositifs des hommes peuvent vivre ensemble » (Alain RENAUT, 2001, pp. 39-56). Ces quelques lignes visent à contribuer à fournir les principes du vivre-ensemble à partir de la philosophie pratique de Kant, notamment sa doctrine de la vertu. En effet, la doctrine de la vertu est un arsenal gigantesque contenant des principes dont les sociétés peuvent user, se prévaloir en vue d’une coexistence authentiquement humaine.
C’est parce qu’elle expose les principes qui font de l’homme une personne que la doctrine de la vertu est à voir comme une philosophie de l’humanisme ; c’est-à-dire une philosophie dont tout le sens réside dans l’ambition d’éduquer à la sociabilité. La doctrine de la vertu kantienne fait du vivre-ensemble une exigence. C’est pourquoi dans l’exposition de ses concepts fondamentaux l’universalité est, chez Kant, le but recherché. L’intention est toujours de penser l’universel à travers la subjectivité. N’est-ce pas là un appel à la recherche perpétuelle de la paix ?
BIBLIOGRAPHIE
BOURGEOIS (Bernard), Philosophie et droit de l’Homme de Kant à Marx, Paris, PUF, 1990.
COUDARCHER (Michel), Kant pas à pas, Paris, Ellipse Édition Marketing, 2008.
KANT (Emmanuel), Anthropologie du point de vue pragmatique, traduction, présentation, bibliographie et chronologie par Alain Renaut, Paris, Flammarion, 1993.
KANT (Emmanuel), Critique de la raison pure, trad de Jules Barni revue par P. Archambault, Paris, Flammarion, 1976.
KANT (Emmanuel), Critique de la raison pratique, trad. F. PICAVET, Paris, PUF, 1943.
KANT (Emmanuel), La Religion dans les limites de simple raison, Traduction de Monique NAAR, Paris, VRIN, 2004.
KANT (Emmanuel), Métaphysique des Mœurs I (FONDATION/ INTRODUCTION), traduction et présentation bibliographie et chronologie par Alain RENAUT, paris, GF- Flammarion, 1994.
KANT (Emmanuel), Vers la paix perpétuelle, Que signifie s’orienter dans la Pensé ? Qu’est-ce que les Lumières ? Introduction, notes, bibliographie et chronologie par Françoise PROUST, Traduction Jean-François POIRIER et Françoise PROUST, Paris, Flammarion, 2006.
LÉVINAS (Emmanuel), Entre nous, essais sur le penser-à-l’autre, Paris, Édition Grasset & Fasquelle, 1991.
NIETZSCHE (Friedrich), Le gai savoir, Introduction et traduction de Pierre Klossowski, Paris, Club Français du Livre, 1957.
RENAUT (Alain), Kant aujourd’hui, Paris, AUBIER, 1999.
VAYSSE (Jean-Marie), Dictionnaire Kant, Paris, Ellipse édition Marketing, 2007.
1.2. Critique des programmes : cas de la lecture et des langues
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
4. L’unité de la vie chez Claude Bernard : un modèle pour penser le vivre ensemble sociétal,
AGBAVON Tiasvi Yao Raoul……………………………………………………….81
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
AGBAVON Tiasvi Yao Raoul
Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)
Courriel : r_roulio@hotmail.com
L’UNITÉ DE LA VIE CHEZ CLAUDE BERNARD : UN MODÈLE POUR PENSER LE VIVRE ENSEMBLE SOCIÉTAL
Résumé : L’unité de la vie bénéficie d’une réflexion particulière dans la philosophie bernardienne. Si tous les êtres vivants semblent différents, par leur constitution et leur fonction, ils possèdent tous un élément commun : la vie. Les phénomènes de la vie sont communs aux êtres vivants, et les manifestations vitales chez les animaux comme chez les végétaux ne diffèrent pas foncièrement. Ainsi, la vie apparaît en sa dimension unitaire, chez les vivants malgré leur diversité. Penser le vivre ensemble, à partir de cette conception de Claude Bernard, c’est penser la diversité au sein d’une même société. L’objet de cet article est de montrer, en s’appuyant sur la pensée bernardienne, que la diversité n’entame pas l’unité dans la société qui appelle au vivre ensemble.
Mots-clés : unité, vivant, vivre ensemble, vie, société, diversité, phénomène, animal, végétal
Abstract : The unity of the life profits from a particular thought in philosophy of Claude Bernard. ¶ If all living things seem different, their constitution and their function, they all have a common element: life. ¶ The phenomena of life are common to all living beings and vital manifestations in animals as in plants do not differ fundamentally. ¶Thus, life appears in its unitary dimension in living despite their diversity. Think living together, from this Claude Bernard’s way of looking, is think diversity within the same society. The purpose of this article is to show, based on the Bernard’s thought, which diversity does not undermine societie’s unity that calls living together.¶
Keywords : unity, living, living together, life, society, diversity, phenomenon, animal, plant ¶
Introduction
Le monde veut s’appréhender comme un village planétaire. « Certes d’un bout à l’autre de la planète, les différences culturelles paraissent aller en s’affaiblissant, et effectivement, des cultures singulières disparaissent (…) » (Paul RASSE et Al, 2001, p. 13). La mondialisation est un fait et les frontières culturelles semblent ne plus être rigidement tracées. Pourtant, toutes les sociétés ne sont pas mues par les mêmes valeurs. De fait, au sein même de chaque société, se trouve une mosaïque de valeurs. La société présente alors des couches diverses susceptibles d’être conflictuelles, parfois même en conflit. Dans une telle approche, que vaut la société en situation de conflit ou de stabilité ? N’est-ce pas un oxymoron que de parler de société conflictuelle ? À en croire l’étymologie de société, du latin « societas » qui signifie « association » et de « socius » qui signifie « compagnon, associé, allié », la société ne tient que parce qu’il y a harmonie entre les maillons qui la constituent.
Mener une réflexion sur la société ne saurait évacuer la question de l’identité. Éristique qu’il soit, « le concept d’identité tient du paradoxe, ce qui en fait l’intérêt, car il conduit à poser des questions pertinentes sur l’évolution des cultures qu’il permet de saisir dans leur dynamique et leur diversité » (Paul RASSE et Al, 2001, pp. 14-15). Or, l’identité dont il s’agit dans l’élaboration de cet article relève de la diversité culturelle au sein d’une société fragmentée, disloquée. Qui plus est, ces fragmentations et dislocations sociétales semblent fondées sur les différences de valeurs identitaires. « Dans son sens le plus fort, l’identité est une notion existentielle » (Stéphane FERRET, 1998, p. 11), et tout ce qui se rapporte à l’existence comme la société ne peut s’en départir. Ainsi, la problématique du vivre ensemble en société s’inscrit dans une dynamique existentielle. Vivre ensemble suppose vivre en société, et partager les mêmes valeurs. Mais sur quel modèle repose fondamentalement le vivre ensemble, lorsque la société se présente comme un agrégat multiculturel ? Au-delà des théoriciens du contrat comme Hobbes, Rousseau, etc., ne pouvons-nous pas percevoir dans le philosopher bernardien, un modèle de pensée applicable à la société ? Le vivre ensemble sociétal ne peut-il pas être pensé à partir de l’unité de la vie chez Claude Bernard ?
Cette contribution, dans une démarche analytique et analogique, vise à, premièrement, revisiter la conception bernardienne de l’unité de la vie pour en saisir la quintessence. Deuxièmement, montrer que la biologie peut apporter des contributions importantes aux réflexions sociétales. Troisièmement, montrer que l’unité de la vie, telle que conceptualisée par Claude Bernard, pourrait s’appréhender comme une réflexion fondamentale sur le vivre ensemble.
- L’unité de la vie chez Claude Bernard
L’unité de la vie, chez Claude Bernard, est une réflexion sur l’identité de la vie chez tous les êtres vivants. De la plante, donc des végétaux aux animaux, la vie est la même. À vrai dire, cette conception fait partie de ses réflexions tardives que nous pouvons considérer de philosophie de maturité. De facto, « la question de l’unité de la vie fut – avec celle de la nature des ferments – un des problèmes auxquels Claude Bernard, vers la fin de sa vie, consacra la plus grande attention »[10] . Toutefois, comment appréhender une telle philosophie face à la diversité biologique ? À partir de quel ordre (macroscopique ou microscopique) Claude Bernard nous amène-t-il à percevoir l’unité de la vie ?
Selon Claude Bernard, « la vie, rapportée à l’échelle du protoplasma, est identique chez les animaux et les végétaux »[11]. En effet, à cette échelle, pour lui, la vie est la même chez tous les êtres vivants, aussi bien chez le végétal que chez l’animal. Toutefois, si Bernard soutient cette idée, il faut reconnaître que celui-ci s’inscrit dans une dynamique de reconsidération de la physiologie de son temps. Dans les Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, il souligne ceci :
« On a accordé de tout temps les attributs généraux de la vie aux animaux et aux végétaux. Cependant, dès les premiers moments où ces études attirèrent les méditations des naturalistes, la science de la vie se divisa en deux branches : l’une comprit les plantes, l’autre les animaux. Devenues ainsi distinctes, la physiologie végétale et la physiologie animale se développèrent séparément. » (Claude Bernard, 1879, p. 1).
L’on peut percevoir, dans les dires de Claude Bernard, l’attention que celui-ci accordait aux réflexions sur la vie. Il est à remarquer que les animaux et les végétaux ont bien été comptés parmi les êtres doués de vie. Mais, de quelle manière envisageait-on la vie chez les animaux et chez les végétaux ? Était-ce dans un même moule que l’on appréhendait la vie animale et la vie végétale ? Cela ne pouvait naguère être le cas.
Déjà avec Aristote, il se constate une nette classification entre les animaux. Une telle distinction entre les animaux ne tient qu’aux données livrées par les apparences. Ainsi, Aristote souligne dans son premier Tome de l’Histoire des animaux qu’« il y a des animaux qui se ressemblent pour toutes leurs parties, d’autres qui diffèrent. (…) La ressemblance porte alors non seulement sur l’ensemble du corps, mais encore sur chacune des parties » (1964, p. 1). Aristote établit, dès lors, une typologie entre les animaux, vu que ceux-ci présentent des différences notables. Dans l’Histoire des animaux, il mène sa réflexion en montrant les fondements de la distinction entre les animaux. Il affirme en ces termes : « les différences entre les animaux concernent leur genre de vie, leurs actes, leur caractère, leurs organes » (1864, p. 3). De la sorte, la distinction entre les animaux se situe à plusieurs niveaux et l’on peut remarquer avec Aristote que leur manière de vivre différemment est fondamentale. Aussi est-il que, dans son ouvrage De l’âme, Aristote fait encore une distinction entre les êtres vivants à partir des différents types d’âmes. De la plante à l’animal, puis de l’animal à l’homme, il distingue trois types d’âmes que sont l’âme végétative (plantes), l’âme sensitive (animaux) et l’âme rationnelle (homme)[12]. Malgré ces distinctions, il fait remarquer la présence de plusieurs facultés chez les animaux (âme végétative et sensitive) et chez l’homme (âme végétative, sensitive et rationnelle). Les analyses aristotéliciennes sont claires, il y a une distinction entre tous les êtres vivants, et sa philosophie semble faire l’apologie de ces différences plutôt que leurs points de convergences.
La réflexion aristotélicienne sur les êtres vivants est certes originale, mais elle se fonde sur les données apparentes. C’est une taxinomie centrée sur les animaux et l’être humain considéré comme le sommet de la chaîne. L’échelle d’observation relève du macroscopique. L’on pourrait même soutenir l’idée selon laquelle la biologie aristotélicienne est une biologie macroscopique. Toutefois, la biologie ne s’est pas astreinte aux observations macroscopiques. En effet, « l’œil armé du microscope voit le vivant macroscopique composé de cellules comme l’œil nu voit le vivant macroscopique composant de la biosphère » (George CANGUILHEM, 1975, pp. 47-48). C’est dire qu’une autre échelle d’observation intervient lorsque l’on veut appréhender le vivant. À la vérité, les échelles semblent différentes et l’on pourrait se poser la question de savoir si c’est la même entité qui est observée. Ainsi, la controverse sur la théorie cellulaire ne saurait passer sous silence. De Hooke[13], Malpighi[14] et Grew[15], l’utilisation du microscope ne se présente pas comme un obstacle dans l’étude du vivant. Ils « constatent que dans le vivant il y a ce que nous appelons maintenant des cellules » (George CANGUILHEM, 1975, p. 49), même s’ils ne conçoivent pas le vivant comme n’étant que cellules. Or, Bichat et Comte ont manifesté leur aversion pour le microscope. Canguilhem le souligne bien lorsqu’il dit ceci : « Bichat n’aimait pas le microscope (…). Comte manifeste son hostilité à l’emploi du microscope et à la théorie cellulaire… » (1975, p. 64). Cela ne pouvait leur permettre d’adhérer à la théorie cellulaire, même si ces deux auteurs n’ont pas les mêmes approches du vivant, c’est-à-dire l’un vitaliste et l’autre positiviste. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, c’est le même être qui est observé sous d’autres angles.
C’est à Virchow[16] qu’il faut reconnaître le mérite d’avoir affûté la théorie cellulaire pour aboutir à une science qui a pour objet, la cellule. À preuve, « c’est à partir de Virchow et de Kölliker que l’étude de la cellule devient une science spéciale, la cytologie… » (George CANGUILHEM, 1975, p. 68). À y voir de près, la théorie cellulaire propose une connaissance du vivant en ses parties élémentaires. Il est vrai que cette théorie a été promue par plusieurs auteurs, dont nous nous sommes abstenus de faire une liste exhaustive dans ce travail, mais l’essentiel est la caractéristique d’une telle approche du vivant. Celui-ci n’est plus perçu, comme avec Aristote en sa dimension macroscopique, mais dans une perspective microscopique. L’on n’est plus en face d’une théorie animiste où les types d’âme distinguent les êtres vivants et les “unifient”[17]. L’âme n’est plus l’élément vital, le tissu n’en est plus, mais la cellule devient cet élément. « La cellule c’est, selon Claude Bernard, l’ « atome vital » » (George CANGUILHEM, 1975, p. 69). Or, la cellule se trouve en tout être vivant (plante, animal, homme). Toutefois, la cellule ne se présente pas identiquement chez tous les êtres vivants. Si elle est, comme le dit Claude Bernard, l’ « atome vital », elle n’est pas la même chez tous les vivants. Dès lors, la question d’identité se soulève, car si la cellule végétale diffère de la cellule animale, comment pourrait-on aboutir à l’unité de la vie ?
Le choix du protoplasme, chez Claude Bernard, ne semble pas être fortuit pour la démonstration de l’unité vitale. En effet, chez lui, l’on ne peut parvenir à cette thèse qu’ « à condition, bien entendu, de regarder la vie dans son expression la plus simple et la plus générale, telle qu’elle se manifeste à l’échelle du protoplasme » (Ignace Ayénon YAPI, 2015, p. 96). « En biologie, le terme de protoplasma désigne un constituant de la cellule considérée comme élément atomique de composition de l’organisme (…) » (George CANGUILHEM, 1975, p. 49). Le protoplasme se trouve inclus dans la cellule et devient par conséquent une entité élémentaire dans l’organisme vivant. Les mécanismes biochimiques, à cet effet, dans le protoplasme se trouvent être les mêmes dans tous les organismes vivants. Aller jusqu’au protoplasme de la cellule vivante, c’est appréhender le vivant dans une perspective élémentaire qui outrepasse les dissemblances physiologiques entre les êtres vivants. C’est une manière d’appréhender tous les vivants sous un même angle.
Depuis Aristote, et Claude Bernard n’en dit pas le contraire[18], l’identité de la vie animale et végétale ne tenait qu’au phénomène de la nutrition, ce qu’Aristote attribuait à l’âme végétative. Une telle identité ne pouvait rendre compte de cette unité que dans une sorte de dualité, même si le concept d’âme utilisé par Aristote pouvait être pris en un sens où les vivants auraient tous une âme commune. De plus, en contradiction avec la thèse de Linné[19], « en repoussant l’horizon de la perspective physiologique jusque dans les mécanismes les plus élémentaires de la vitalité, à savoir ses facteurs physico-chimiques, Claude Bernard veut montrer comment toute forme de vie repose en définitive sur des principes identiques » (Ignace Ayénon YAPI, 2015, p. 97). Bernard abhorrait l’idée d’une physiologie animale et végétale séparée, il optait pour une seule physiologie générale prenant en compte animaux et végétaux à la fois. Certes, son objectif épistémologique n’est pas moindre, mais sa démonstration de l’unité vitale est une philosophie biologique considérable pour sa « tautologie de la vie : toute vie est vie » (Ignace Ayénon YAPI, 2015, p. 103). Une telle philosophie biologique ne pourrait-elle servir de base à des réflexions autres que celles biologiques ? Si tel est le cas, la réflexion biologique ne peut-elle pas être un modèle pour penser la société ? Bien avant de tirer des leçons de la thèse de l’unité vitale chez Claude Bernard pour la société, il nous faut saisir en quel sens la biologie peut être un modèle pour la société.
- La biologie : un modèle pour la société ?
L’histoire de l’évolution de la biologie nous livre plusieurs conceptions du vivant. De ces conceptions, l’on peut remarquer que la connaissance de l’être vivant, support matériel de la vie, s’est approfondie. À dire vrai, les controverses, suscitées par les différentes conceptions sur le vivant, ont été fécondes pour la connaissance de celui-ci. L’on ne saurait passer sous silence la vive controverse entre mécanisme et vitalisme. D’un côté, les tenants du vitalisme défendent la thèse selon laquelle, le vivant est mû par une force vitale qui échappe aux lois de la physique et de la chimie. De l’autre bord, les tenants du mécanisme et du positivisme ont vite fait de rejeter le vitalisme pour le qualifier d’une obsolète métaphysique dans la connaissance du vivant. Ces derniers ont fondé la connaissance du vivant sur les mécanismes du vivant, le considérant comme une machine vivante soumise aux lois physico-chimiques. Si de Stahl[20] à Xavier Bichat[21] en passant par Paul Joseph Barthez[22], le vitalisme était vivace jusque « dans les premières décennies du XIXe siècle » (Pierre VIGNAIS, 2006, p. 238), « VON HELMHOLTZ en Allemagne et Claude BERNARD en France avaient pris leur distance aussi bien avec un vitalisme spéculatif qu’avec un matérialisme mécaniste qui réduisait l’être vivant à un système physico-chimique (…) » (Pierre VIGNAIS, 2006, p. 240). En effet, Claude Bernard, bien qu’étant en accord avec l’idée du rejet des considérations métaphysiques dans la connaissance du vivant, ne voulait guère astreindre le vivant aux lois physico-chimiques. Pour lui, la physique et la chimie ont leur mode opératoire, les sciences du vivant, à l’instar de la physiologie, doivent s’inspirer de leurs méthodes, mais leur objet est bien plus spécifique et ne saurait être considéré au même titre que la matière inerte.
Cette brève esquisse de la controverse entre vitalisme et mécanisme dans la biologie montre la complexité de la connaissance du vivant. La complexité se révèle parfois dans la complète opposition entre vitalisme et mécanisme ou dans la conciliation restrictive entre ces deux doctrines. Quand l’on adopte une position vitaliste, ce n’est pas moins le vivant qui est l’objet d’étude. Il en est de même lorsque l’on adopte la position mécaniste. Pourtant, ces deux positions doctrinales appréhendent, à leur manière, le vivant. Elles rendent compte, d’une manière ou d’une autre, des caractéristiques du vivant. Même, lorsqu’elles sont conciliées, cela n’a qu’un seul et même objectif, celui de mieux connaître l’être vivant. Appréhender le vivant revient à prendre appui sur certains modèles doctrinaux ou conceptuels. Il n’est pas faux de souligner que le vitalisme et le mécanisme ne sont pas les seules doctrines fondamentales en biologie, mais elles ne sont pas des moindres, et elles semblent les mieux indiquées dans ce travail. S’il existe diverses manières de percevoir le vivant rationnellement, la biologie peut-elle servir comme modèle pour une réflexion quelconque ?
À première vue, la complexité de l’organisme vivant n’est que spécifique. Même si les sciences physico-chimiques ont servi de modèle aux sciences du vivant. Leurs objets d’études se révèlent différemment et les approches diffèrent. Claude Bernard, pour illustrer la distinction entre science physico-chimique et science du vivant (physiologie) souligne ceci : « la physique et la chimie, qui sont les sciences expérimentales dans le règne des corps bruts, ont conquis la nature inerte ou minérale, et chaque jour nous voyons cette conquête s’étendre davantage. La physiologie, qui est la science des corps organisés, doit conquérir la nature vivante ; c’est là son problème, ce sera là sa puissance » (Claude BERNARD, 1878, p. 102). De la matière inorganique à la matière organique, il n’y a, apparemment, pas de lien. Il serait incongru de penser un corps organisé à partir d’un corps inorganique. À preuve les différences sont visibles et l’on ne saurait autoriser, même une analogie, entre ces deux ordres différents. Or, le problème n’est que du ressort des apparences. Toutefois, s’il en est ainsi, comment surmonter cette difficulté qui voudrait une asymétrie entre corps organiques et corps inorganiques, pour se prolonger dans une distinction fondamentale entre sciences physico-chimiques et sciences du vivant ?
Dans la quarantième leçon du Cours de philosophie positive, Auguste Comte ne manquait pas de voir dans la chimie un modèle cognitif idéal pour les autres sciences, surtout pour les sciences du vivant. De facto, il soutient « qu’il ne peut exister de matière organique radicalement hétérogène à la matière inorganique, et que les transformations vitales sont subordonnées, comme toutes les autres, aux lois universelles des phénomènes chimiques » (Auguste COMTE, 1869, p. 49). Les lois des phénomènes chimiques sont toutes aussi bien valables pour la matière inorganique que pour la matière organique. L’on se rend à l’évidence de la considération de lois universelles opérant dans le vivant comme dans l’inerte. Partant, Auguste Comte estompait les frontières entre organique et inorganique. En considérant que les lois de la chimie des corps inorganiques sont valables pour les corps vivants, il peut bien être remarqué avec Comte que le modèle cognitif des corps bruts ne saurait être différent de celui de la matière vivante. De la sorte, les sciences physico-chimiques peuvent, sans ambages, servir de base, de modèle aux sciences du vivant. Dans cette perspective, Claude Bernard entrevoit dans la méthode des sciences physico-chimiques, une méthode féconde pour les sciences du vivant. Il souligne qu’ « Il n’y a donc en réalité qu’une physique, qu’une chimie et qu’une mécanique générales, dans lesquelles rentrent toutes les manifestations phénoménales de la nature, aussi bien celles des corps vivants que celles des corps bruts » (Claude BERNARD, 1878, p. 116). Avec lui aussi, les frontières distinctives entre le vivant et l’inerte ne sont que des apparences. Cela dit, si malgré leurs apparentes distinctions et la divergence de leurs objets d’études, les sciences physico-chimiques servent de modèle aux sciences du vivant, ne pourrait-on pas voir dans ces sciences un modèle pour la société ? Dans un tel cas, serait-ce invalider les réflexions fondamentales sur la société ?
Les réflexions sur la société ne sont pas toutes unanimes sur la représentation de celle-ci. Les crises, les conflits sont autant de problèmes qui sous-tendent les réflexions sociétales. Comment parvenir à une société digne de ce nom, où chaque individu se réalise pleinement ? Comment la comprendre ? Ces questions n’ont pas moins retenu l’attention des auteurs comme Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, etc. En effet, ces philosophes du contrat ont pensé la société selon un modèle juridique.
Malgré leur diversité, les doctrines du contrat social se proposent de trouver dans l’individu le fondement de la société, de l’État ou de l’autorité politique. Et leur postulat fondamental est que la société, ou tout au moins l’État, n’est pas un phénomène naturel, mais une création artificielle et donc volontaire. Plus précisément encore, les théories du contrat social développent une conception juridique du monde (Dominique WEBER, 2000, p. 28).
Selon cette analyse de Dominique Weber, c’est dans l’individu même que se trouve le fondement de toute société. Il ne saurait être pensé la société sans humain qui la compose. La société, comme elle l’a si bien souligné avec les philosophes du contrat, est une création et une émanation de la volonté. Pourtant leurs théories, même si elles appréhendent l’individu comme fondement de la société, elles ne se fondent pas sur une approche biologique de l’individu qu’est l’homme. L’homme est le “créateur” de la société. De ce fait, une réflexion sur celle-ci, ne doit-elle pas prendre en compte sa dimension biologique ? Mieux les théories biologiques, ne peuvent-elles pas servir de modèle aux théories qui s’affairent à la société ?
Pour Comte, « comme tous les phénomènes, les phénomènes sociaux sont soumis à des lois » (Auguste COMTE, 2007, p. 117). Il considère ainsi la société comme un organisme où tout est régi par des lois. Certes l’homme ne peut pas les gouverner, mais il peut agir sur ces lois, les modifier. Ainsi Auguste Comte soutient que la réflexion biologique puisse servir à celles qui sont d’ordre social. Le rapport qu’il établit entre biologie et société est tel que l’on peut voir en la société une sorte d’interprétation de la biologie. Car, l’organisme vivant est régi par des lois et la société essaie de se réguler par des lois comme un organisme. Toutefois, la critique canguilhémienne à cette conception de la société fondée sur le modèle biologique n’est pas à tenir à l’écart. « Il faut cependant souligner que Canguilhem n’admet pas la métaphore réciproque, celle qui consiste à prendre l’organisme comme modèles des sociétés humaines » (Jean GAYON, 2000, p. 34). Canguilhem soutient l’idée selon laquelle les lois de l’organisme sont données par lui-même, alors que celles des sociétés sont créées. Certes les normes de la société sont inventées, mais il y a tout de même normes. La critique de Canguilhem faite au positivisme social comtien est légitime. Pourtant, bien que la société ne soit pas une entité biologique, elle est au moins composée d’entités biologiques. Les hommes sont au fondement de la société et ils sont des êtres biologiques. À preuve, « les hommes sont des objets biologiques, et il n’y a aucune raison d’imaginer qu’il puisse en être autrement » Stéphane FERRET, 1998, p. 42). Dès lors, ne peut-on pas se servir des théories qui les étudient comme modèles pour penser la société dans laquelle ils se réalisent ?
La distinction entre un organisme et une société est apparente. Nonobstant cet état de fait, il faut reconnaître que la société pourrait s’inspirer des réflexions de la biologie pour penser sa constitution. Si tous les philosophes du contrat ont pu voir dans l’individu le fondement même de la société, l’on peut à bon droit trouver dans la biologie des fondements aux réflexions sur la société. Les crises, les déchirements dans la société ne peuvent aussi exclurent, dans les réflexions sur eux, le modèle biologique. La biologie peut être un modèle pour la société compte tenu du fait que ses constituants sont des objets biologiques. C’est dans cette perspective que l’on puisse se référer à des théories biologiques pour penser la société.
- Penser le vivre ensemble sociétal à partir de l’unité de la vie bernardienne
L’unité de la vie bernardienne est une réflexion biologique. C’est une philosophie biologique qui, au-delà de toutes les critiques que l’on pourrait lui faire, est fondamentale. Elle ne voit que dans tous les êtres vivants une seule et même chose : la vie. Du végétal à l’animal, il n’y a aucune frontière distinctive à l’échelle du protoplasme. Cette dimension élémentaire des êtres vivants les unit et donne lieu à une unité vitale. Le fait de voir en tous les êtres vivants la même identité vitale est considérable. C’est une thèse que l’on ne saurait ignorer chez Claude Bernard. Ainsi, comment, à partir d’une telle thèse, mener une réflexion sur le vivre ensemble ?
Le vivre ensemble n’est pas un simple groupe de mots. Qui plus est, les sociétés, après certaines fractures, essaient de parvenir à une stabilité. Les recours aux mots tels qu’unité, paix, fraternité deviennent habituels. L’on s’attend à des résultats probants par le changement de vocabulaire. Pourtant, « derrière des mots apaisants, une réalité plus dure se fait jour, celle d’une inimitié entre citoyens que l’on peut revendiquer » (Patrice BRUN, 2012, p. 16). Soulever la question du vivre ensemble, c’est penser les problèmes de liens qui structurent la société. Pourquoi devons-nous vivre ensemble ? Une telle question pourrait être entrevue comme le fil d’Ariane du cheminement présent de notre réflexion. Plusieurs pistes réflexives de réponses peuvent se frayer sans grandes difficultés. Mais le modèle biologique semble plus naturel. Ce n’est pas affirmer la primauté du modèle biologique sur les autres, c’est surtout voir dans un tel modèle des arguments nécessaires et tautologiques pour aboutir à l’idée du vivre ensemble sociétal.
La plupart des crises au sein des sociétés sont attisées par des problèmes identitaires. « Effectivement, chaque communauté regroupe et spécifie des entités sociales plus petites dans un processus laborieux d’unification interne ; à partir de quoi, elle-même dégage sa propre identité qui la différencie des autres entités de mêmes niveaux » (Paul RASSE et al, 2001, p. 16). Produire de la différence n’est pas ce qui se fait le moins dans la société. Jusqu’aux plus petites couches sociales, il y a la prégnance de la différence, aussi bien interne (à l’intérieur de ses couches) qu’externe (entre les couches elles-mêmes). En effet, chaque couche sociale se présente comme unique et distincte des autres. Les hommes qui sont aussi les acteurs de la société ne sont pas tous identiques. C’est là que réside le problème nodal. Comment peut-il avoir harmonie entre plusieurs entités distinctes ? Il est important de remarquer que, « depuis que les humains sont humains, ils se font des idées les uns sur les autres » (Michel DESPLAND, 2009, p. XV). Ces idées s’expriment sur plusieurs plans et ne convergent pas. Surtout après des crises, le climat de méfiance s’enracine dans un rapport sournois à l’altérité. La société n’est plus celle du vivre ensemble, mais celle d’un contexte du vivre avec méfiance, en considérant l’autre différemment. Cependant, pour qu’une vie « de société soit agréable, chacun doit manifester une attitude déférente envers autrui » Arthur MARSOLAIS, 2000, p. 3).
À la vérité, l’attitude déférente envers l’autre pourrait conduire à outrepasser les rets de la différence. Mais sur quoi une telle attitude pourrait-elle se fonder ? Une société agréable, c’est une société où les relations entre les constituants de celle-ci sont stables. Une telle stabilité ne peut trouver son sens que dans le vivre ensemble, si nous nous en tenons à l’étymologie même de société qui veut dire association. Dans une association, il se trouve qu’il y a une sorte de ciment qui permet les jonctions. Cela n’efface guère les différences, mais les différences sont laissées au compte des apparences. Les apparences ne sont pas au fondement de la société. Elles ne peuvent, non plus, pas être le socle du vivre ensemble. D’une certaine manière, vivre ensemble c’est accepter la différence. En effet, vivre ensemble, « ce n’est pas la recherche du consensus, mais l’acceptation, par les parties en présence, des différences de l’autre » (Patrice BRUN, 2012, p. 20), différences qui ne sont que du ressort des apparences. À cet effet, la philosophie biologique de Claude Bernard est d’un grand intérêt pour mieux comprendre l’au-delà des formes apparentes.
Lorsque Claude Bernard entrevoit le vivant dans ses réflexions tardives, l’on se rend compte que celui-ci veut faire disparaître les frontières entre tous les êtres vivants au niveau vital. Il ne fait aucune distinction entre vie animale et vie végétale. À l’échelle du protoplasme, selon ses analyses, tous les êtres vivants ont les mêmes bases vitales. Il faut reconnaître que « la thèse bernardienne tire ainsi sa vérité d’abord de son caractère analytique et tautologique, à telle enseigne que l’insuffisance éventuelle de certaines preuves scientifiques qui la soutiennent, ne saurait en rien entamer sa crédibilité philosophique » (Ignace Ayenon YAPI, 2015, p. 103). La portée philosophique de cette thèse bernardienne révèle son habilité à servir de fondement à la réflexion sur le vivre ensemble.
Si « la vieille question de ce que nous faisons, de ce que nous voudrions faire, de ce que nous pourrions faire et de ce que nous devrions faire, pour « bien-vivre ensemble » » (Mathieu BERGER et AL, 2011, p. 598), nous est adressée, nous pouvons, avec la thèse bernardienne répondre que la société ne doit pas s’astreindre aux apparences. De facto, l’animal ne pourra jamais être un végétal et vice versa. Pourtant, leurs vies sont identiques. Malgré toutes leurs dissemblances, l’animal et le végétal sont tenus par les mêmes manifestations vitales. Cette réflexion biologique vaut pour la société. Des êtres qui se présentent différemment, mais qui sont sous-tendus par une unité vitale appellent à reconsidérer les valeurs sociétales. Quand des animaux sont sous le même règne vital que les végétaux, comment ne pas tirer leçons d’une telle philosophie ? Les hommes, en tant qu’êtres biologiques et au cœur de toute idée de société, sont mus par la même vie. Or, si tel est le cas, il y a unité vitale, en quelque sorte, chez tous les hommes. Ici, la différence ne se présente pas comme celle de l’animal et du végétal. Elle s’entend surtout au niveau des divergences d’opinions, de bords, de culture, etc.
Cependant, au-delà de tous ces clivages, le fait considérable est que les hommes ne dérogent pas aux lois biologiques. Il est vrai que chaque être humain est un individu unique, mais un être unique en qui la vie se manifeste de la même manière que chez tous les êtres humains. Cela dit, vivre ensemble repose sur le fait que, malgré les différences apparentes, au fond c’est la même vie qui se déploie sous plusieurs formes matérielles. Ces supports matériels peuvent ne pas être les mêmes apparemment, mais ils ne diffèrent en rien fondamentalement. Au fond, la thèse de l’unité de la vie bernardienne appréhende l’identité de la vie par-delà les différences. Ainsi, une philosophie du vivre ensemble peut être entrevue en elle. Et penser le vivre ensemble sociétal à partir de ce philosopher bernardien est d’un intérêt non moins important pour la société. À la vérité, l’unité vitale est un fait avéré, car « malgré leur extrême variété de taille ou de forme, tous les êtres vivants, de la bactérie à la baleine, sont apparentés dans leur composition chimique, leur plan et leurs fonctions » (Gérard KLEIN, Michel SATRE, 2003, p. 13). La même vie qui se manifeste en tout être vivant est déjà un argument valide pour ne pas s’attarder sur les divergences, mais plutôt se focaliser sur ce qu’il y a d’identique en tous : la vie.
Pour que la société soit, il faut des hommes. Pour que les hommes soient actifs en société, il leur faut la vie. Or, la vie qu’il leur faut est une, elle se trouve en tous bien que chacun en fasse usage à sa guise. Au fond, elle est vécue de la même manière, car il n’y a qu’une seule manière de vivre selon Claude Bernard (Ignace Auenon YAPI, 2015, p. 103). Vivre ensemble, à partir de la thèse de l’unité vitale, c’est accepter la différence, non comme différence, mais comme une même expression de la vie différemment. Il n’y a pas, en effet, plusieurs hommes foncièrement distincts. Il n’y a que plusieurs supports matériels de la même vie. C’est là l’importance de la thèse bernardienne pour penser le vivre ensemble à partir de réflexions biologiques.
Conclusion
La société est composée d’êtres humains qui sont en réalité ses acteurs. Ce sont les hommes qui font la société. Dès lors, en tant qu’êtres biologiques, leur vivre ensemble peut faire recours à des analyses biologiques. Ainsi, en considérations finales, l’on peut retenir que la thèse de l’unité vitale chez Claude Bernard peut être d’une grande envergure pour penser le vivre ensemble sociétal. En tout état de cause, cette thèse bernardienne ne vient aucunement rendre obsolètes les théories des philosophes du contrat. Elle vient simplement apporter une contribution sur la constitution de la société, en s’appuyant sur la dimension biologique. Le philosopher de Claude Bernard n’est certes pas le premier à être pris pour modèle de la société. Auguste Comte avait, avant lui, ouvert la voie. Mais, la thèse de l’unité vitale est, à n’en point douter, l’une des thèses les plus convaincantes comme modèles pour penser la société.
Les différences qui sont au cœur des difficultés du vivre ensemble ne peuvent résister fortement à la thèse de l’unité vitale. « Toute vie est vie. Il n’y a donc pas, par exemple, une vie animale différente de la vie végétale, et la vie humaine, du point de vue de sa structure physico-chimique, n’a aucune spécificité qui la différencierait de celle qui anime les autres êtres » (Ignace Auenon YAPI, 2015, p. 17). Cela est encore plus patent quand il ne s’agit que des humains. L’unité vitale estompe toutes les différences apparentes pour ne considérer que ce qui est fondamental. Aussi est-il qu’elle amène à comprendre que « toutes les vies se valent et toutes peuvent donner lieu, sans changer, à la béatitude » (David RABOUIN, 2010, p. 178).
Bibliographie
« Auguste Comte », in Archives de Philosophie, Tome 70, 2007, pp. 115-121.
ARISTOTE, De l’âme, Traduction et notes d’Edmond Barbotin, Paris, Les Belles Lettres, 1966.
ARISTOTE, Histoire des animaux, Tome I, Traduction de Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1964.
Arthur MARSOLAIS et Luce BROSSARD (dir.), Non-violence et citoyenneté : un « vivre ensemble » qui s’apprend, Québec, Les Éditions Multimondes, 2000.
Auguste COMTE, Cours de Philosophie Positive, Tome troisième, Paris, J. B. BAILLIÈRE et FILS, 1869.
Claude BERNARD, La science expérimentale, Paris, J-B Baillières et Fils, 1878.
Claude BERNARD, Leçons sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux, Tome II, Paris, J.-B. Baillière et Fils, 1879.
David RABOUIN, Vivre ici. Spinoza, éthique locale, Paris, P.U.F., 2010.
Dominique WEBER, Du contrat social, Jean Jacques Rousseau : avec le texte intégral du livre 1, Paris, Bréal, 2000.
Georges CANGUILHEM, La connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1975.
Gérard KLEIN, Michel SATRE, « Compartimentation cellulaire », in Philippe TRACQUI, Jacques DEMONGEOT (dir.), Éléments de biologie à l’usage d’autres disciplines. De la structure aux fonctions, Paris, EDP Sciences, 2003.
Ignace Ayénon YAPI, « L’unité de la vie selon Claude Bernard », in http://www2.univ-mlv.fr/revuethique/pdf/yapi.pdf, consulté le 10 novembre 2012.
Ignace Ayénon YAPI, Approches du vivant. Études d’épistémologie biologique, Paris, L’Harmattan, 2015.
Jean GAYON, « Le concept d’individualité dans la philosophie biologique de Georges Canguilhem », in Guillaume LEBLANC, Lectures de Canguilhem : Le normal et le pathologique, Paris, ENS Éditions, 2000.
Mathieu BERGER, Daniel CEFAÏ, Carole GAYET-VIAUD (dir.), Du civil au politique. Ethnographies du vivre-ensemble, Bruxelles, Peter Lang, 2011.
Michel DESPLAND, Vivre ensemble : croyances et sciences en terre laïque, Québec, Les Presses de l’Université de Laval, 2009.
Patrice BRUN, « Conflits et réconciliations dans la Grèce Antique. Tensions Sociales et guerre civiles (staseis) dans les cités grecques », in Stephan MARTENS, Michel De WAELE, Vivre ensemble, vivre avec les autres : Conflits et résolution de conflits à travers les âges, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012.
Paul RASSE et al. (dir.), Unité-diversité : les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2001.
Pierre VIGNAIS, Science expérimentale et connaissance du vivant : la méthode et les concepts, Grenoble, EDP Science, 2006.
Stéphane FERRET, L’identité, Textes choisis, Paris, Flammarion, 1998.
INFLUENCE DE LA CULTURE HEBRAÏQUE DANS LA THÉORIE FREUDIENNE DE LA RELIGION
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
5. De la problématique du vivre-ensemble dans la pensée de Hannah Arendt,
ASSEMIEN Assoumou Joël-Pacôme…………………………………………….81
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
ASSEMIEN ASSOUMOU JOEL-PACÔME
De la problématique du vivre-ensemble dans la pensée de Hannah Arendt
Résumé
Le vivre-ensemble est une notion qui renvoie à l’idée de cohabitation pacifique, de cohésion sociale et de vie harmonieuse entre des individus sur un espace donné. Au demeurant, l’homme est naturellement porté à vivre avec les autres, ce qui fait de lui un animal social. Cette propension de l’homme à vivre avec les autres dépasse les frontières étatiques. Cependant, cet élan du vivre-ensemble se heurte au sein des États à des pesanteurs d’ordre politique, religieux et socioéconomique. Ce qui a pour conséquences des soubresauts qui rendent les États ingouvernables. Dans un tel contexte, le vivre-ensemble devient problématique. Dès lors, il importe de revisiter la pensée de Hannah Arendt pour explorer les tenants et les aboutissants du vivre-ensemble.
Mots clés : Vivre-ensemble, politique, cohésion, État, pesanteurs, tradition
Summarized
The living together is a notion which sends back at the idea of peaceful cohabitation, at the idea of social cohesion and at the idea of harmonious life between individuals on a given space. However, the man is naturally carried to live with the others, which makes of him a social animal. This propensity of the man to live with the others exceeds the state borders. However, this moose(run-up) of the living together collides within States with gravities of political, religious and socioeconomic order. What has for consequences of the jolts(starts) which return ungovernable States. In such a context, the living together becomes problematic. From then on, it is important to revisit the thought of Hannah Arendt to explore the ins and outs of the living together.
Keywords: living together, politics, cohesion, State, gravities
Introduction
Depuis Aristote, on sait que l’homme ne peut vivre hors du groupe. Certes, « l’homme est un loup pour l’homme » à l’état de nature comme le démontre bien le philosophe anglais Thomas Hobbes, et son altérité représente pour lui un « enfer » dans la société, selon l’entendement de Jean-Paul Sartre. Mais l’éducation et les lois façonnent l’homme pour l’amener à devenir sociable et à s’accommoder au Mitsein de Martin Heidegger. Cela est le rôle auquel s’assignent les États modernes, comme le souhaite ardemment Jean-Jacques Rousseau.
D’ailleurs, toutes les philosophies politiques et sociales, de l’Antiquité grecque à nos jours, s’évertuent à mettre l’accent sur la nature sociale de l’homme. Apparemment, le vivre-ensemble s’impose au citoyen au sein de l’État. Il ne peut plus s’écarter de la communauté avec laquelle il partage le même territoire, les mêmes lois et les mêmes idéaux. Seulement que, dans le cas des États de l’Afrique, où les peuples ont hérité de frontières artificielles au gré des intérêts des colons, ajoutées aux différences socioculturelles et religieuses, le vivre-ensemble apparaît hypothétique.
Du coup, ces clivages vont avoir des répercussions sur la vie sociale, économique et politique. Partout, les citoyens vont cultiver leur appartenance ethnique ou religieuse au détriment de leur appartenance nationale. Dans son imaginaire, l’individu réduit la communauté juste à l’ensemble de ceux qui partagent avec lui les mêmes faits culturels, la même langue ou les mêmes croyances. C’est contre cette vision réductionniste du vivre-ensemble que s’insurge Hannah Arendt dans ses théories politiques. Dès lors, comment les citoyens d’un même État peuvent-ils réaliser le vivre-ensemble ? Telle est la préoccupation qui est la nôtre et qui traverse toute l’œuvre de Hannah Arendt.
La résolution de ce problème passera par trois axes majeurs : d’abord, nous évoquerons les fondements du vivre-ensemble. Ensuite, il s’agira de montrer la dimension du vivre-ensemble dans le contexte africain. Enfin, il faudra proposer des pistes de solution pour la consolidation du vivre-ensemble.
1. LES FONDEMENTS DU VIVRE-ENSEMBLE
1.1. Fondement historique
Le vivre-ensemble est un état social qui est le produit d’un long processus. Cela se manifeste par l’acceptation mutuelle des membres d’une communauté humaine ou d’un État. La saisie des fondements du vivre-ensemble implique une analyse des théories contractualistes, notamment celles de Thomas Hobbes. En effet, pour le philosophe anglais, « l’homme est un loup pour l’homme » à l’état de nature. Dès lors il devient impérieux les hommes sortent de cette situation de guerre de tous contre tous pour asseoir l’État civil, en se dépouillant de leurs droits individuels au profit du Léviathan qui sera le garant du respect des lois. Dès cet instant, le vivre-ensemble dérive d’un fondement historique. Selon Ernest Renan, la volonté de vivre ensemble est le produit d’une histoire commune à des personnes ayant traversé aussi bien des douleurs que des joies.
1.2. Fondement politique
Aujourd’hui où la démocratie en tant que système de gouvernement transmet des principes plus ou moins universels, dont les élections, le vivre-ensemble doit se consolider. En effet, plus le choix des dirigeants sera libre, plus les citoyens nourriront le sentiment de vivre ensemble. Les peuples européens sont à un stade de démocratisation très avancé au point où ils ont pu créer des États-nations. Ces citoyens choisissent leurs dirigeants par des élections libres et transparentes.
1.3. Fondement social
De plus, il faut, à travers l’éducation, façonner les citoyens à la tolérance, notion qui parcourt l’œuvre de Hannah Arendt. Bien avant elle, John Locke (1632-1704) s’est appesanti sur la notion de tolérance, surtout dans le domaine de la foi religieuse. Le vivre-ensemble pourrait s’appréhender comme le sentiment d’appartenance. C’est la propension qu’ont les hommes à nouer des relations, à échanger, à s’accepter dans leurs différences. C’est ce que Martin Heidegger traduit par le terme allemand de mitsein, qui signifie être avec. Jean-Luc Nancy, lui, parlera de l’être en-commun. Ces différents concepts rejoignent l’être-ensemble dans un monde commun dont parle Hannah Arendt. À partir de ces différents contenus, nous appréhendons que le vivre-ensemble soit une condition fondamentale de l’existence de la politique.
Le vivre-ensemble rassemble et unit les hommes autour d’une même vision, une même idéologie et un même idéal. Avec le vivre-ensemble, les hommes sont plus épanouis, ils prennent activement part à la vie publique en exploitant toute leur énergie et intelligence. Mieux, le vivre-ensemble, s’il est inclus dans les projets politiques, contribue à la construction d’un monde plus paisible où les hommes cohabitent et entretiennent de saines relations. C’est ainsi que l’humanité se mettra à l’abri des conflits violents tels que les deux guerres mondiales. Pendant ces événements douloureux, nous avons assisté à la déshumanisation de l’espèce humaine, l’anéantissement des valeurs humanistes, à la négation de la pluralité humaine et à la ruine d’un monde ayant perdu le sens des relations humaines. « Ce que la guerre nucléaire anéantirait, c’est la pluralité, le monde des relations humaines qui s’instaurent partout où des hommes vivent ensemble, la possibilité de parler, d’agir de concert » (Hannah ARENDT, 1965, p. 18).
Hannah Arendt définit l’appartenance comme une relation de soi avec l’altérité autour de soi et en soi. La relation avec l’altérité permet à chaque individu de faire advenir quelque chose de neuf. Dans la Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt disait : « Au fait d’être né, nous répondons en commençant du nouveau de notre propre initiative » (Hannah ARENDT, p. 230). Initiative, voilà le mot clef au plan phénoménologique et anthropologique : à quoi correspond le consentement au vivre-ensemble, au plan politique? (Paul RICOEUR, 1991, p. 215). En ce sens, la fondation peut être interprétée à la manière d’une naissance collective. Puisqu’il ne s’agit pas simplement de fonder un nouveau monde politique, mais il s’agit surtout de maintenir la capacité d’innover.
La capacité d’innover, ainsi garantie, demeurera liée à la fondation de la même façon que la capacité humaine d’agir et d’innover est enracinée dans la condition humaine de natalité. On reconnaîtra, ici, une autre façon de décrire l’autorité et son processus d’augmentation. Pour Arendt, ce processus d’augmentation et l’autorité émergent avec l’acte de fondation, donc avec la naissance du politique. L’autorité et le processus d’augmentation assurent la continuité de la possibilité d’innover. Innover, c’est apporter quelque chose de nouveau, c’est un système de recyclage. En politique, l’innovation serait la possibilité donnée à chaque régime d’inventer un nouveau système de gouvernement. Mais quelle est la dimension du vivre-ensemble dans le contexte africain ?
2. LE VIVRE-ENSEMBLE DANS LE CONTEXTE AFRICAIN
2.1. Un contexte politique difficile
Malgré l’instauration du multipartisme et les efforts de démocratisation, nous assistons à des tensions, à des conflits dus à l’existence de régimes dictatoriaux. Certes, nous nous défendons d’alléguer que tout est sinistre en Afrique et nous sommes très loin d’être animés d’un pessimisme absolu. Mais le constat est clair, la politique africaine n’innove pas, elle est figée et statique. Mieux, elle a toujours reconduit les mêmes personnalités, doctrines et idéologies. Cette politique repliée sur elle-même a poussé certains peuples à lancer des slogans tels que : « On veut du changement, du vrai changement, ce régime a tué la démocratie, ce régime est sanguinaire, etc. »[23]. De quel changement parlons-nous ? Pourquoi ce changement?« Un changement, c’est le passage d’un état x, défini à un temps t, vers un état xı à un temps tı, où x et x1 peuvent représenter un être humain ou un milieu social qui, après changement, devient à la fois autre chose et le même »[24].
On peut s’inspirer des philosophes présocratiques tels qu’Héraclite pour qui le changement est l’essence de l’Être. Pour lui l’Être est toujours en mouvement et en conflits entre les figures de l’élément matériel tel que le feu. Quant à Parménide, il soutient que l’Être est en permanence sous l’apparence des changements. Cette opposition radicale entre les deux philosophes présocratiques traverse toutes les théories du changement. Elle est au cœur du changement dialectique de la pensée allemande du XIXème siècle : de Hegel à Marx. Cette opposition pourrait se retrouver dans la dialectique existentialiste et phénoménologique avec respectivement Jean-Paul Sartre et Merleau Ponty. Après avoir analysé et commenté les différentes définitions et aspects du changement, il importe de répondre à cette interrogation : le changement dans nos régimes africains est-il pour maintenant ?
C’est en ce sens que la pensée de Hannah Arendt trouve tout son intérêt. Lire Arendt, permettra de sortir de notre mutisme, de notre solitude intellectuelle. Avec Arendt, la politique est une existence, c’est-à-dire qu’elle se résume à l’espace public, à la parole, à la communication et à la discussion. Ce sont là les clés, les seuls moyens pour retrouver les conditions de notre humanité. Cette attitude est la manifestation la plus authentique de notre liberté. Une politique qui s’assigne pour objectifs de favoriser la communication et d’asseoir la cohésion sociale, pourrait sauver l’Afrique, notre Afrique, de ses propres turpitudes. Elle permettra aux chefs d’État, dans l’exercice de leurs fonctions, d’éviter les mandats illimités, de prôner une politique libre, c’est-à-dire sans exclusion et dépouillée des considérations religieuses, culturelles et tribales. En Afrique, en effet, la conquête du pouvoir politique, sa conservation et sa dévolution demeurent toujours problématiques.
On observe de façon récurrente à des élections truquées, à des manipulations de textes constitutionnels et à des formes de dynasties moyenâgeuses au grand dam des aspirations du peuple. Au Togo, le fils de Gnassingbé Eyadema est aux affaires, au Gabon, le fils d’Omar Bongo a remplacé son père et en R.D.C, Kabila fils a succédé à son père. On pourrait objecter que ces descendants de présidents sont arrivés au pouvoir à l’issue d’élections libres. Mais force est de reconnaître que ces nouveaux princes ont bénéficié de certaines conditions dues à l’influence de leurs prédécesseurs. Encore, les élections sont le plus souvent des mascarades, et elles sont gagnées au forceps, par des hold-up électoraux.
Or le vivre-ensemble que souhaite ardemment Arendt s’accommode difficilement avec ces travers politiques. L’Afrique a besoin donc de sortir de sa sclérose et s’adapter à l’évolution des mentalités des nouvelles générations. C’est ainsi qu’elle pourra échapper aux récurrents soubresauts engendrés par la mauvaise gouvernance, à l’immobilisme idéologique et économique. Il faut noter que les dirigeants africains sont, pour la plupart, réfractaires à des réformes qui sont susceptibles d’opérer des transformations adéquates pour le bien-être des citoyens.
Au regard de ce qui précède, il appert que le vivre-ensemble doit être conditionné par un environnement politique d’ouverture et de tolérance. Partant de là, la politique africaine ne sera plus aux antipodes de celle voulue par Arendt. Appliquer pleinement la politique telle qu’élaborée dans les théories arendtiennes, c’est reconnaître donc la valeur et l’importance de la démocratie athénienne. Cette démocratie devrait être adaptée aux réalités africaines. Accorder une importance à la démocratie athénienne, c’est donner la possibilité à chaque Africain de surmonter, transcender les tensions politiques. Transcender les tensions politiques, c’est rapprocher les couches sociales en menant des actions fortes et visibles. Qu’est-ce que donc les actions fortes et visibles ?
2.2. Manque d’action d’intérêt général
Les actions fortes et visibles constituent les piliers d’une bonne gouvernance. Elles seraient au cœur même de la politique. L’action forte est appréhendée comme l’ensemble des œuvres humaines mises en place par un gouvernement ou un régime en vue de créer un monde meilleur, un environnement favorable au bien-être et au vivre-ensemble, dans lequel tous les citoyens participent librement aux débats sur les questions qui engagent l’avenir de la nation.
L’action, comme le souligne Arendt, « c’est la catégorie centrale de la pensée politique » (1958, p. 39). Cette affirmation d’Arendt doit être comprise comme une leçon, une leçon pour l’Afrique, notre Afrique et le politicien africain, car l’action est la seule activité qui mette directement en rapport les Hommes. À vrai dire, la nécessité et la visée de l’action sont la pluralité humaine. L’action définit l’homme en tant qu’être social et politique, capable de gérer les affaires publiques. En gérant les affaires sociales, l’action politique se donne pour finalité de promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble. L’homme politique ne peut réussir ce projet qu’à partir du strict respect des principes suivants : l’éducation, l’autorité, la tradition et la culture. Respecter ces principes, c’est pratiquer la politique du vivre-ensemble, la pluralité politique.
En clair, le respect de ces principes accorderait à la politique une reconnaissance, elle serait ainsi marquée du sceau de la politique authentique, la politique véritable. Cette reconnaissance de la politique passe nécessairement par le respect de l’altérité. Le respect de l’altérité, c’est la reconnaissance de l’autre dans sa différence. Cette définition de l’altérité vient éclairer la thèse d’Arendt selon laquelle, ce sont les Hommes qui font la politique. Arendt sera soutenue dans son analyse par Emmanuel Levinas dont la vision consiste à comprendre le sens et l’importance de la relation à autrui. Cette relation doit être comprise comme originelle et fondatrice de toute autre relation à l’être. L’essentiel est de se rendre capable de respecter l’altérité, et non plus de tenter de la résorber dans l’identité du même, c’est-à-dire du concept et du système de catégories par lequel le philosophe croit pouvoir comprendre le monde dans la totalité de ses aspects. C’est dans cette logique qu’Emmanuel Levinas précise :
En quoi consiste l’acuité de la solitude ? Il est banal de dire que nous n’existons jamais au singulier. Nous sommes entourés d’êtres et de choses avec lesquels nous entretenons des relations. Par la vue, par le toucher, par la sympathie, par le travail en commun, nous sommes avec les autres. Toutes ces relations sont transitives : je touche un objet, je vois l’Autre. Je suis tout seul. C’est donc l’être en moi, le fait que j’existe, mon exister qui constitue l’élément absolument intransitif, quelque chose sans intentionnalité, sans rapport. On peut tout échanger entre êtres sauf l’exister. (Emmanuel LEVINAS, 1983, p. 21).
Justement, c’est le sens de la relation à Autrui qui a permis à Arendt d’asseoir ses travaux de théorie politique sur les concepts fondamentaux tels que : le pluralisme politique, le vivre-ensemble, la liberté, l’action. Une fois que la politique se détourne de ces assises, elle développe le cannibalisme et on assiste à des politiques totalitaires, identitaires et nationalistes. Dès lors quelles voies peuvent conduire à un vivre-ensemble durable ?
3. LES VOIES POUR UN VIVRE-ENSEMBLE DURABLE
3.1. Des acteurs politiques responsables
Il importe donc pour les acteurs politiques de s’inspirer de la théorie politique élaborée par Hannah Arendt, qui prend appui sur la démocratie et la tolérance. Hannah Arendt défend les concepts fondamentaux tels que : l’action politique, la pluralité politique, le vivre-ensemble, domaine public. Ces concepts, de par leur définition, impliquent une vie politique vertueuse qui garantit le bien-être et le vivre-ensemble pour toute la communauté. « Tous ces termes s’interpénètrent : domaine public, espace d’apparence, réseau de relations humaines, révélation du qui. Prises ensemble, elles constituent la condition d’une vie politique » (Hannah ARENDT, 1958, p. 23).
Arendt nous donne la voie à suivre pour aborder autrement la politique. Elle affiche dans ses théories son souci le plus ardent qui est de construire une vie politique idéale. En effet, Arendt élabore des thèses qui concernent l’existence politique, à savoir : la pensée politique et son histoire, mais aussi les systèmes politiques et leurs dérives identitaires : le totalitarisme, l’antisémitisme, la révolution, la nature de la liberté et tout particulièrement l’usage des facultés de la pensée et du jugement. Pour mieux se faire suivre, elle nous propose de penser ce que nous faisons, en traitant des facultés humaines générales qui naissent de la condition humaine.
Ces facultés humaines sont permanentes à travers l’histoire des idées, clairement et distinctement inspectée par une analyse qui reste essentiellement phénoménologique. En clair, cette analyse ne peut se détourner de l’action politique. Avec Hannah Arendt, l’homme d’action n’est pas une personne, mais un personnage. Ces propos d’Arendt doivent interpeller les acteurs de la vie politique pour ce domaine se pratiquer dans les règles de l’art. Cela voudrait dire la politique doit être une méthodologie, une science et une technique avec ses règles à respecter. C’est aussi avoir le courage de lire entre les lignes de la démarche méthodologique de la théorie politique de l’élève de Martin Heidegger.
Chez Arendt, le vivre-ensemble est conditionné par la politique qui est synonyme de liberté et de pluralisme. C’est pourquoi, elle doit se pratiquer dans un espace public, un libre échange d’idées et d’opinions. Mais le vivre-ensemble est détruit par la manipulation, les discours de propagande et démagogiques d’une élite obnubilée par la conquête du pouvoir d’État. Le champ politique est devenu une foire où les larrons de tous acabits viennent ruser avec le peuple. Ici n’y entre que des gens corrompus qui se livrent un combat sans merci. C’est pourquoi, il est temps de mener des réflexions plus profondes sur la politique de l’époque contemporaine.
Autant l’État est la manifestation de la Raison chez Hegel, autant la politique est la raison en action. L’acteur politique doit, de ce fait, se dépouiller de ses passions et désirs égoïstes pour agir au profit de l’universel. Si « le plus haut devoir des individus est d’être membre de l’Etat », l’homme politique doit s’assigner la noble fonction de travailler pour le bien-être de la communauté. En d’autres termes, la politique devient ainsi le lieu privilégié où les intérêts particuliers et égocentriques doivent s’effacer au profit de l’intérêt général.
C’est pourquoi, l’attitude de Nelson Mandela face à la communauté blanche est louable. En effet, l’opinion internationale nourrissait des craintes quant à un éventuel désir de vengeance des Noirs avec l’arrivée de Mandela au pouvoir. Mais tout le monde fut étonné de découvrir un homme politique certes noble de par son origine, mais surtout de par son esprit. Il a rassuré toutes les communautés raciales de son pays et il a pris des mesures qui favorisaient la cohésion sociale. Mandela a ainsi hissé l’action politique à un niveau très élevé. Mandela a éclipsé ses passions, ses intérêts personnels, en donnant une importance particulière aux actes qui pouvaient consolider la coexistence pacifique entre les différentes races qui vivent sur le territoire de l’Afrique du Sud.
3.2. L’action
L’exemple sud-africain montre bien que le vivre-ensemble ne se décrète pas, mais il doit être sous-tendu par des actions et des initiatives individuelles des leaders politiques. Ceux-ci, en effet, ont un rôle de premier plan à jouer dans la construction d’une société assise sur le vivre-ensemble. C’est en cela que la pensée arendtienne prend toute sa signification. En effet l’action est bien une notion chère à Arendt dans le fil de ses réflexions sur la politique. L’action, saisie comme ce qui contribue à consolider le vivre-ensemble, est un concept placé au cœur de la politique d’Arendt. Elle est même incontournable dans la pensée politique de celle-ci. L’action fait partie des principes de l’existence de la politique authentique chez Arendt. En effet, l’action politique, pour Arendt, correspond à la condition humaine de la pluralité. L’action politique résume toute la philosophie politique de l’auteure de La crise de la culture. Elle est à la fois distincte de la connaissance objective fondée sur les concepts et de l’évaluation morale fondée sur des valeurs. Hannah Arendt nous permet de comprendre l’action lorsqu’elle écrit : « Action veut dire pluralité, et inversement. Action veut dire individus et inversement » (Hannah ARENDT, 1958, p. 187).
L’action est communément considérée comme ce que fait une personne qui réalise une volonté, une pulsion. C’est aussi un acte de courage, de dévouement qui distingue un individu et fait de lui un homme d’action. Les hommes d’action sont légion dans tous les domaines d’activités humaines : dans l’armée, dans le cinéma et surtout en politique. Mais la politique particulièrement recommande des actions nobles, celles qui rassemblent les citoyens autour d’un idéal. L’homme d’action en politique est différent de l’homme d’action militaire. Il doit être guidé par la morale et le bon sens dans tout ce qu’il entreprend, parce que la politique au sens grecque est un art de gestion des affaires publiques au profit de tous les membres de la société. Ainsi que se construit un vivre-ensemble durable. C’est à cette fin que Hannah Arendt assigne l’action politique ; elle qui souhaite bien ressusciter les valeurs de la Grèce antique dont s’inspire la démocratie.
Cette position de Hannah Arendt met en valeur la promotion d’une vie politique qui soit étroitement liée à un comportement dépouillé d’agressivité, qui œuvre en faveur de la tolérance et l’égalité. En un mot, il s’agit, pour, Arendt, de la capacité à s’élever au-dessus des conditions subjectives et particulières du jugement, et de réfléchir sur ce qui est objectif et positif pour le bien-être de la communauté.
3.3. L’éducation
Au regard de ce qui précède, il semble incontournable que le vivre-ensemble peut être favorisé par une politique éducative plus démocratique. C’est par l’éducation que l’Afrique pourra sortir des miasmes du tribalisme, de l’intolérance religieuse, de l’exclusion et toutes autres formes de marginalisation. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau accordait une importance capitale à l’éducation. Les sociétés les plus avancées sont celles qui ont vulgarisé l’enseignement des valeurs universelles d’humanisme. Si la France se trouve parmi les nations les mieux policées, c’est sûrement grâce à la politique d’éducation initiée par Jules Ferry au XIXe siècle, avec comme slogan : école gratuite, laïque et populaire.
En Côte d’Ivoire, le gouvernement vient d’adopter une loi sur l’école obligatoire, cela est salutaire, même si les parents peuvent brandir l’argument de la cherté de la vie. Alors, il faut aussi proposer une école gratuite pour tous. Certes, l’éducation n’a pas de prix, c’est-à-dire qu’aucun sacrifice n’est au-dessus de ses retombées non seulement pour l’individu, mais aussi pour la nation tout entière.
Le respect des principes démocratiques peut favoriser un vivre-ensemble en ce sens que chaque citoyen n’aura pour référence que la loi, rien que la loi. Si la loi est appliquée à tous de façon impersonnelle, alors il y aura moins de frustration et, partant, moins de violence.
Conclusion
« De la problématique du vivre-ensemble dans la pensée de Hannah Arendt » a fait l’objet de notre étude. Il s’agissait de montrer que le vivre-ensemble ne surgit pas du néant ; il est plutôt un processus ayant un fondement historique, politique et social. Cela nous a amené à l’examen critique du vivre-ensemble dans le contexte africain, ce qui a révélé un tableau peu reluisant en ce sens que le continent noir est encore enlisé dans tensions politiques, ethniques et religieuses. Cette situation rend davantage impérieux le besoin de revisiter la théorie politique d’Hannah Arendt qui ébauche des solutions pouvant consolider le vivre-ensemble. Elle recommande la tolérance et une revalorisation des principes démocratiques. Elle s’accorde avec Samba Diakité que la différence ne peut être source de différend, mais plutôt un enrichissement collectif, dans la construction de la civilisation de l’universel.
Références bibliographiques
ARISTOTE.-La politique, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1929, 18x11cm, 595p.
Anne-Marie Roviello, Sens commun et modernité chez Hannah Arendt, Bruxelles, OUSIA, 1987, 13x14cm, 198p.
Emmanuel Levinas, Humanité de l’autre homme, Montpelier, Fata Morgana, 1972, 10x 10cm, 122p.
Hannah Arendt, La vie de l’esprit : I- La pensée, II- Le vouloir, trad. L. Lotringer, Paris, PUF, 1981, 25x14cm, 570p.
Hannah Arendt-Martin Heidegger, Lettres et autres documents, trad. Hélène Frappât, Paris, Gallimard, 2001, 13x10cm, 266p.
Tradition cachée, trad. S. Courtine-Denamy, Christian-Bourgeois, Paris, U.G.E. 10/18, 1996, 12×11, 5cm, 178p.
Édifier un monde, Fritervention, 1971-1975, trad. E-kauFholz-Messmer, Paris, Seuil, 2007, 12x10cm, 153p.
Responsabilité et jugement, trad. Jean Luc Fidel, Paris, Payot, 1960, 12×11, 5cm, 160p.
Samba Diakité, Philosophie et Contestation en Afrique. Quand la différence devient un différend, Paris, Publibook, 2011, 22,5cmx17, 5cm, 512p.
Éthique et infini, Paris, Fayard, 1982, 16x 15cm, 120p.
Jean Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Tel Gallimard, 1977, 20x15cm, 722p.
Jean-Rodrigue-Elisée Eyene Mba, Démocratie et Développement en Afrique face au libéralisme. Essai sur la refondation politique, Harmattan, 2003, 11x 12cm, 142p.
WEBOGRAPHIE
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/…/changement_rheaume.pdf, consulté le 3 juillet 2011.
https://interventionseconomiques.revues.org/966, consulté le 27 avril 2012
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
6. Le concept du visage levinassien comme fondement du vivre-ensemble,
COULIBALY Adama………………………………………………………….…….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
COULIBALY Adama
Université Alassane Ouattara
LE CONCEPT DU VISAGE LEVINASSIEN COMME FONDEMENT DU VIVRE-ENSEMBLE
Résumé :
Poser la question du vivre-ensemble, c’est la poser dans un monde en crise relationnelle comme le nôtre. Au fond, toute crise, qu’elle soit profonde ou peu profonde, a pour origine première, le rapport à autrui. Partant, il est pertinent d’envisager le vivre-ensemble dans une perspective de crise du rapport à l’autre. Le concept levinassien du visage trouve là son assise essentielle. Étant parvenu à s’arracher au séjour familier et quotidien, le visage se révèle comme la réalité d’autrui dans sa pure humanité, là où se lit l’homme pour l’homme. L’enjeu de cette conception éthique est l’humain se saisissant comme le visage universel où se disent les valeurs substantielles, qui régissent l’harmonie sociale et politique. En ce sens, l’éthique du visage s’inscrit dans une perspective de la valorisation de l’homme, de la préservation de sa dignité et du respect de ses droits. Les principes afférents au visage sont donc des principes du vivre-ensemble.
Mots-Clés : Autrui, Épiphanie, Humain, Justice sociale, Nudité, Responsabilité, Visage, Vivre-ensemble.
Subtract:
Asking the question of living together, is questioning it in a world in relational crisis like ours. Basically any crisis either acute or less acute has its first cause in the relationship with others. Consequently, it is important to consider the live together in a crisis perspective of the relationship to others. The levinassian concept of face has here an important place to substantially think this problematic. Having been able to step away from the informal and daily stay, the face reveals itself as a reality of others in his pure mankind, where man is read for man. The issue of this ethical conception is humanity understanding as the universal face, where substantial values that govern social and political harmony are told. The ethics of the face fall, consequently, within the scope of mankind valorisation, his dignity preservation and respect of his rights. So, the principles pertaining to the face are live together principles.
Key words: Epiphany, Face, Mankind, Nudity, Others, Responsibility, Social justice, Live together
Introduction
La thèse du philosophe grec Aristote selon laquelle « l’homme est par nature un animal politique » (ARISTOTE, 1990, p. 91) trouve toute sa signification dans l’idée que l’existence humaine est une coexistence. C’est dire qu’il n’y a pas de vie authentiquement humaine qui soit isolée. La cohabitation de l’homme avec son semblable en vue d’un rapport harmonieux donc d’un vivre-ensemble paisible devient essentiellement une exigence fondamentale de l’exister humain.
Pourtant, l’existence humaine est menée aujourd’hui de telle sorte que toute idée de paix, d’harmonie et de fraternité semble être compromise. À la vérité, lorsqu’on scrute nos sociétés actuelles, on constate qu’elles sont profondément marquées par une crise relationnelle. Constatable par l’accroissement des inégalités et des injustices sociales, de l’émergence de nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion, de la confiscation des droits les plus fondamentaux (le droit à la vie, le droit à la liberté) de l’autre homme ou de l’homme tout court par l’exercice du pouvoir politique, devenu de plus en plus violent. Aussi, sans oublier de souligner d’une part, la résurgence de certains phénomènes devenus globaux tels que le terrorisme, les fondamentalismes religieux, le racisme, les dérives identitaires liées à l’exaltation et à l’exacerbation des nationalismes, et d’autre part, l’ère des mutations technologiques et de la mondialisation où on assiste à la réification de l’homme au moyen de la technique et à un oubli total de l’humain au nom du profit ou de l’avoir.
Toute chose atteste évidemment que la crise du vivre-ensemble est avant tout une crise relationnelle ; l’expression de la perte du sens de soi, de la perversion des valeurs éthiques exprimée dans la perte du sens de l’autre. N’est-ce pas vrai que toute crise a pour origine fondamentale, le rapport à autrui ? Le refus de la proximité n’est-il pas le produit de la haine pour l’autre, et donc source de violences et de guerres ? La crise du vivre-ensemble apparaît-là, sans conteste, comme une crise du rapport à l’autre.
C’est partant de ce fait que la réflexion éthique levinassienne de la relation à autrui s’avère nécessaire pour penser substantiellement la question du vivre-ensemble.
Née du traumatisme de l’expérience propre au XXe siècle, de la négation absolue de l’autre qui est celle des camps, l’éthique levinassienne est fondée sur la conception du rapport à autrui. Elle enseigne la reconnaissance de l’humanisme de l’autre homme, interdit de nuire à autrui et ordonne de lui porter secours, fut-il meurtrier, ennemi, ou persécuteur. Et ce noyau, il l’a trouvé dans le visage d’autrui. En effet, « la présence personnelle de l’Autre à travers son visage signifie, pour Levinas, l’ordre au Moi de renoncer à la violence et l’engage à se “mettre en société avec lui” » (Emmanuel LEVINAS, 1994, p. 14). Il laisse entendre, à travers le visage, la nécessité de cohabiter avec l’autre, de le reconnaître comme un frère humain dont je suis responsable. Une telle éthique est, selon Zielinski, « un garde-fou contre les risques d’une éthique pensée à partir de soi, qui ferait de l’égoïsme la mesure de toute action » (Agata ZIELINSKI, 2004, p. 115).
L’enjeu de cette conception éthique est l’humain, surtout parce que le problème philosophique est toujours entendu comme celui du sens de l’humain, de la recherche du fameux « sens de la vie ». Le visage de l’autre est, selon Levinas, le lieu où peut se garantir cette valeur substantielle et universelle.
De là, il apparaît que le concept fondamental de l’éthique levinassienne, le visage, a un rapport essentiel avec le concept du vivre-ensemble. C’est d’ailleurs cette question qui est à l’origine même des aspects les plus radicaux de sa proposition éthique du visage (Agata ZIELINSKI, 2004, p. 7).
L’objectif principal du présent article est de montrer que le visage levinassien est capable de nous offrir des opportunités indéniables, des principes pouvant nous permettre de construire un vivre-ensemble harmonieux.
Dès lors, comment articuler la notion du visage levinassien avec le concept du vivre-ensemble ? En d’autres termes, en quoi la conception du visage levinassien se donnerait-elle à comprendre comme fondement du vivre-ensemble ? Dans une époque, comme la nôtre, encline à la violence, aux guerres et aux déchirements fratricides, comment penser le visage comme facteur de restauration du rapprochement entre les hommes ? Soucieuse de relever le défi d’une paix durable, l’exigence éthique du visage ne se saisirait-elle pas comme socle de la promotion de la dignité humaine ?
Le présent article s’articulera autour de trois principaux axes qui s’énoncent comme suit :
- Approche phénoménologique du visage : Pour une saisie substantielle du concept
- L’épiphanie du visage comme facteur de restauration des relations humaines
- L’exigence éthique du visage : socle de la promotion de la dignité humaine
1. Approche phénoménologique du visage : Pour une saisie substantielle du concept
Parler du visage dans le champ strictement levinassien, est-ce faire référence à la conception de l’imagerie populaire où celui-ci est réduit à sa pure empiricité ? Répondre par l’affirmative serait loin de faire justice à la pensée levinassienne du visage, c’est la pervertir ou la méconnaître absolument. En fait, il est à saisir que le « visage » levinassien, même s’il part d’un principe phénoménologique, ne se rapporte pas au visage physique. Sa phénoménalité a valeur d’exception. C’est ce que Levinas met en valeur par l’expression « épiphanie du visage ». En tant qu’il est essentiellement une désensibilisation, une dématérialisation de la donnée sensible, le visage n’est pas réductible à un ensemble de qualités sensibles que sont le nez, les yeux, le front, le menton. Ce n’est donc pas un simple étant (Emmanuel LEVINAS, 1982, p. 89) placé devant nous. Pourtant, généralement quand on aborde la question du visage, on a tendance à l’appréhender comme telle. C’est d’ailleurs pourquoi, l’on entend souvent dire, qu’un tel a un visage rond, allongé, chiffonné, ridé, mignon ou agréable.
De ce point de vue, le visage devient une référence à partir de laquelle on est capable d’apprécier ou de déprécier telle ou telle personne. Cette conception est de nature à vouloir identifier l’homme à partir de la couleur de sa peau, de la forme de son nez, de la couleur de ses yeux. En fustigeant une telle pensée, Levinas écrit : « Quand on observe la couleur des yeux, on n’est pas en relation sociale avec autrui » (Emmanuel LEVINAS, 1982, p. 90), surtout qu’elle apparaît, à ses yeux, comme source de conflit ou de discrimination entre les hommes. Les propos divisionnistes, discriminatoires, négationnistes, racistes trouvent, ici, toute leur justification. Pourtant, comme on le dit communément, “voir le visage de quelqu’un, ce n’est pas le connaître”. Vouloir déterminer l’homme à partir des catégories générales, raciale, ethnique, religieuse, politique c’est le dénaturer, le dévisager (Michel DUPUIS, 1994, p. 109).
Le visage ne se résume pas, pour ainsi dire, à la fonction sociale dans laquelle on tente parfois de l’enfermer. C’est dire avec Salomon Malka que « le visage pour Levinas est exilé de son contexte physique et social et signifie par lui-même et en lui-même » (Salomon MALKA, 1989, p. 22). On remarquera, chez Levinas, une certaine réciprocité du visage à l’être heideggérien, qui en tant que phénomène ne se donne pas comme ce qui se montre en personne dans les limites d’une intuition donatrice originaire, mais ce qui de lui-même donne sens et fondement à ce qui se montre (Martin HEIDEGGER, 1986, p. 57). Si le visage, tout comme l’être, ne se rapporte pas à l’immédiateté d’un étant, sa spécificité réside en ce qu’il n’est rien d’anonyme, d’impersonnel, de formel mais se rapporte toujours à un individu.
Le visage est chez Levinas un trait caractéristique de l’autre, il signifie une radicale transcendance d’autrui (Emmanuel LEVINAS, 2001, p. 239). Il se révèle irréductible à toute structure intentionnelle ou gnoséologique, pour autant qu’il échappe à toute prise donc non-totalisable. Comme on le voit, le visage apparaît-là comme une dimension fondamentale de l’homme, figure de « la vraie essence de l’homme » (Emmanuel LEVINAS, 1965, p. 266). Il signifie plus que le corps. Il signifie toute la personne humaine. Il ne saurait nullement être comparable, de ce fait, aux choses de la nature qui sont convertibles, comestibles qui ont un prix. Le visage ne se présente pas sous la modalité d’une chose du monde. Il ne saurait, par conséquent, être réduit à aucune tentative d’objectivation.
Malheureusement, l’homme de la postmodernité est en déphasage dans son rapport au visage. Il est devenu un moyen d’attraction, de plaisir ou de concupiscence justifiant certaines pratiques telles que la dépigmentation de la peau, la chirurgie esthétique, les maquillages, etc. C’est l’expression d’une tendance réductionniste du corps ou du visage à la pure matérialité.
De plus, avec la mondialisation et l’apport des nouvelles technologies de l’image et de l’information, le ʺbeau visageʺ devient un produit de grande consommation que la culture publicitaire insinue dans les consciences individuelle et collectives. Dans cette logique du marché, le visage se trouve évacué au profit de la banalité du “on”, de la publicité et de la visée utilitaire. Quand le visage est défiguré en son essence, il y a absolument risque de perte du sens de l’humain.
Avec Levinas, l’accès à l’expérience du visage ou à sa vérité substantielle n’est pas dans l’attirance des choses ou dans l’avoir, mais surgit de sa nudité. Celle-ci n’est pas à confondre avec l’état d’un corps sans vêtements : on peut être nu tout en étant paré. Au sens levinassien, il y a nudité lorsqu’il y a révélation de vulnérabilité, de dénuement. C’est dire qu’au cœur de la nudité du visage se trouve transparaître la vulnérabilité de toute personne humaine inscrite dans l’expression des yeux, fut-il maître ou esclave, riche ou pauvre, puissant ou faible (Emmanuel LEVINAS, 1984, pp. 162-163). Cette vulnérabilité de la condition humaine que Levinas qualifie de « pauvreté essentielle » (Emmanuel LEVINAS, 1982, p. 90), se donne à saisir comme une pauvreté qui ne s’apparente nullement à une misère existentielle ni à une condition de vie matérielle démunie. Il s’agit bien plutôt de l’expression d’un visage dépouillé de toutes ses qualités, autant culturelles que naturelles. La vérité du visage s’affirme, dès lors, avec Levinas, dans un arrachement au séjour familier et quotidien (Emmanuel LEVINAS, 1972, p. 21).
La particularité du philosophe, c’est d’avoir révélé, à travers le visage, autrui dans sa pure humanité. Cette lecture qui se veut substantielle de l’autre, ne se révèle-t-elle pas comme lieu d’un rapport éthique fondamental ? Au fond, le concept du visage levinassien ne revêt-il pas des principes fondateurs et régulateurs du vivre-ensemble ?
2. L’épiphanie du visage comme facteur de restauration des relations humaines
Le visage levinassien est essentiellement porteur d’une relation éthique fondamentale marquée par le sceau de l’asymétrie. Celle-ci ne se situe pas sur le plan de la réciprocité symétrique du rapport « je-tu » (Martin EUBER, 1938 p. 13), telle qu’on le trouve chez Martin Buber ou Gabriel Marcel, où l’intersubjectivité se lit en terme de marchandage, de troc, du donant-donant. Dans cette logique relationnelle, l’autre serait destiné à rendre au moi, au sujet le bien que celui-ci lui aurait fait. Ce rapport inégalitaire ne doit pas non plus s’entendre comme un rapport de domination où l’autre dans une logique de servitude se doit de se soumettre à la tyrannie d’un maître. Elle est cette relation où l’obligation à l’égard d’autrui prime sur tout ce que je pourrais attendre de lui.
Dans cette relation, le sujet se préoccupe d’abord de l’autre avant de se soucier de sa propre personne. La primauté est toujours accordée à autrui. C’est ce que Levinas a appelé, en langage grec, la dissymétrie de la relation interpersonnelle (1982, p. 145). C’est d’ailleurs l’un des traits majeurs auquel le philosophe tient comme à la prunelle de ses yeux. Ainsi, il écrit : « aucune ligne de ce que j’ai écrit ne tient, s’il n’y a pas cela » (Emmanuel LEVINAS, 1982, p. 145).
Or, il se trouve que cette intersubjectivité originelle et première dite éthique, ne saurait à vrai dire constituer la structure de la relation sociale puisque « deux hommes face à face ne constituent pas le noyau d’une société » (Salomon MALKA, 1989, p. 95). En effet, dans l’ordre social autrui n’existe pas seul, il y a aussi le tiers, le « troisième homme ». « S’il était mon seul interlocuteur je n’aurais eu que des obligations ! Mais je ne vis pas dans un monde où il n’y a qu’un seul « premier venu » ; il y a toujours dans le monde un tiers : il est aussi mon autre, mon prochain » (Emmanuel LEVINAS, 1991, p. 113). Pour lui, la relation singulière au visage d’autrui ne saurait se fermer sur elle-même, ne saurait exister sans la prise en compte du tiers, le pluriel des autres : l’entrée du tiers ouvre la relation du face- à- face à l’universalité où le sujet devient responsable de tous. Il y a donc là co-existence, rassemblement.
Dès lors, le lien social naît véritablement avec la prise en compte du tiers dans les relations interhumaines. Cette prise en compte du tiers dans le philosopher levinassien est tout entière une préoccupation du vivre-ensemble. C’est d’ailleurs pourquoi, la pensée de Levinas s’inscrit pleinement dans une dimension politique et sociale. Dès lors, comment Levinas aborde-t-il la question de la relation sociale ? En d’autres termes, comment entend-il garantir cette nouvelle approche relationnelle ?
Pour garantir la sécurité ou la protection des relations sociales, Levinas évoque la nécessité de l’instauration d’une justice entre les incomparables pour autant que chaque être est unique (Emmanuel LEVINAS, 1991, p. 114). Il s’agit de modérer le privilège accordé à autrui, de situer une responsabilité mesurée et d’établir l’égalité entre les unicités qui ne deviennent des citoyens qu’à cette condition. On voit là, qu’avec le tiers s’ouvre la nécessité de l’État et des lois. C’est donc à partir de la notion de justice, réclamée par le tiers, que le philosophe envisage la possibilité de la réalisation « d’une société juste » (Emmanuel LEVINAS, 1963, p. 37). Pour parvenir à cette fin, « il faut des institutions qui arbitrent et une autorité politique qui la soutienne. La justice exige et fonde l’État » (Emmanuel LEVINAS, 1991, p. 202). Dans cette nécessité de s’occuper de la justice apparaît l’idée d’équité, voire d’impartialité sur laquelle se fonde l’idée d’objectivité.
Cependant, cette seconde forme de socialité ne se limite pas au strict respect des lois, mais sur le visage qui fait appel à la responsabilité personnelle de chacun, dans laquelle il se sent élu et irremplaçable. Ainsi, il préconise une politique d’un État libéral où, de droit, la justice se donne d’être toujours meilleure. « L’État libéral, dit Levinas, n’est pas une notion purement empirique ― il est une catégorie de l’éthique où, placés sous la généralité des lois, les hommes conservent le sens de leur responsabilité, c’est-à-dire leur unicité d’élus à répondre » (Jacques ROLLAND, 1988, p. 62). Dans la réflexion politique levinassienne, il apparaît clairement que le tiers, loin d’introduire la rupture dans la pensée de Levinas, introduit plutôt la responsabilité éthique dans la dimension d’une responsabilité juridique et politique. En ce sens, la justice sociale ne devient possible que sur une ouverture inconditionnelle au visage, entendu, ici, non comme la forme singulière d’un seul homme, mais l’expression métaphysique de l’humanité qui englobe, et autrui, et le tiers.
Partant, il convient de souligner que la dimension politique apparaît comme étant aussi bien dérivée que dépendante de la relation inégalitaire, car la visée éthique est toujours au-delà des lois. Cette subordination de la politique à l’éthique vise à débarrasser celle-ci de toute forme de despotisme et de dictature qui sont de véritables sources des malheurs publics. Aux yeux de Levinas, il semblerait que tout État soit totalitaire en puissance. Et sa critique morale de la totalité englobe le totalitarisme politique (Agata ZIELINSKI, 2004, p. 144). Aussi, précise-t-il que dans « un État où la relation interpersonnelle est impossible, où elle est d’avance dirigée par le déterminisme propre de l’État, est un État totalitaire » (Emmanuel LEVINAS, 1991, p. 115). Au sein d’un tel État, les droits de l’homme sont constamment violés, les relations entre les individus deviennent de véritables cauchemars puisqu’elles entretiennent la haine, la méfiance des uns à l’égard des autres. C’est dire que quand il y a une scission qui s’opère entre la politique et les normes éthiques du visage, il y a forcément une crise du vivre-ensemble.
Contrairement à cette vision totalitaire, Levinas opte pour une politique de la fraternité, de la proximité humaine où chacun se doit d’être responsable de son prochain, de son frère humain. C’est cette responsabilité que Levinas a appelé « l’amour du prochain » (Emmanuel LEVINAS, 1991, p. 113) en tant qu’elle est la prise sur soi du destin d’autrui. C’est là véritablement où la multiplicité humaine (Emmanuel LEVINAS, 1984, p. 345) de la structure de l’État est soumise aux exigences de la rencontre du visage et du dialogue qu’il prône. Pour le philosophe qui fait la promotion de l’autre, il est indispensable de toujours lier l’État et la responsabilité envers les autres hommes, afin que la paix ne soit pas la suite d’une contrainte, de la force exercée par l’État ou de la suspension provisoire de la guerre, mais la paix grâce au visage. Ce n’est donc pas l’État qui vient offrir le cadre immuable d’un vivre-ensemble, mais l’incessant appel du visage de l’autre et du tiers.
Dans le visage de l’autre et du tiers se loge déjà la paix et la fraternité. En tant que tel, le visage exige droiture et honnêteté et exige, par conséquent, une gestion transparente des ressources de l’État. Là où ces exigences sont prises en compte, là règne l’intérêt des autres, l’intérêt public. Les actes de prévarications, le vol des deniers publics sont l’expression du manque du souci du visage qui dicte de ne pas tuer. Le « tu ne tueras point » (Emmanuel LEVINAS, 1991, p. 114), le discours dont il est porteur, est l’interdit fondateur de toute société politique. Il enseigne de ne pas porter atteinte à l’humain : visage universel où se disent les valeurs substantielles qui régissent l’harmonie sociale et politique. C’est là que le visage apparaît comme cette transcendance à partir de laquelle la fraternité humaine devient possible et la justice sociale se consolide.
En abordant la question politique dans son rapport au visage, Levinas veut répondre à une préoccupation existentielle, celle du vivre-ensemble harmonieux qui semble avoir perdu son sens dans un monde constamment en crise relationnelle. L’objectif fondamental de cette conception du visage, est de garantir ou de renforcer au cœur des relations humaines, la fraternité, l’amour et la justice afin d’instaurer un cum-vivre, un vivre-ensemble. En ce sens, ce concept du visage en appel à la reconnaissance des droits de l’autre homme.
Avec Levinas, le droit de l’homme devient originairement le droit de l’autre. L’originalité de ces droits se manifeste dans l’idée que seul autrui a des droits, le sujet n’a que des devoirs (Emmanuel LEVINAS, 1987, p. 119). La loi qui engage la relation éthique et qui vise le respect des droits de l’autre est non écrite, mais elle est pourtant ce qui incarne en premier lieu le visage d’autrui. C’est dans le sens de la responsabilité-pour-autrui que les droits de l’autre homme ont une signification chez Levinas. Ainsi, il précise que « la responsabilité de l’un-pour-l’autre, à travers laquelle, dans le concret, les droits de l’homme se manifestent à la conscience comme droit d’autrui et dont je dois répondre. » (Emmanuel LEVINAS, 1997, p. 169) Cette responsabilité est une exposition aux autres, aux tiers-homme et au quart-homme et à tous les autres.
Le privilège accordé à la loi de l’autre dans cette responsabilité vise la reconnaissance et le respect des droits des opprimés, des faibles (veuve, orphelin, étranger), des non-apparentés, des sans-secours, des minorités. Lesquels sont quotidiennement mis à prix par les droits des plus forts, dans un monde où les droits de l’homme sont des droits de certains genres, des plus forts (Bernard FORTHOMME, 1979, p. 52). Il y a là une sorte d’impérialisme dominateur, l’expression des suppôts du Même qui est de nature à masquer l’absolution du visage à servir, parce que réduisant tout, les droits de l’homme, les valeurs au Moi. Un Moi que Blaise Pascal trouvait déjà haïssable, usurpateur. Il s’agit de dénoncer ce qu’il y a d’inhumain dans cette expression des droits et surtout de l’égoïsme qu’elle incarne. Partant, la reconnaissance et le respect des droits d’autrui apparaissent pour Levinas comme totalement asymétriques et non réciproques.
La philosophie du droit de l’autre homme en appel, ainsi, à une responsabilité qui est rupture de la subjectivité autosuffisante du moi jouissant. Elle est porteuse du sens d’une identité humaine qui ne se lit pas dans un enfermement à soi, dans les particularités culturelles, raciales, sociales, religieuses et politiques, mais dans une ouverture, une présence aux autres au prix d’un renoncement à soi. Pour Emmanuel Levinas, le vivre-ensemble exige essentiellement un prix. C’est au prix d’un acte de déposition, de la déposition de la souveraineté par le Moi que la relation sociale avec autrui voire le vivre-ensemble devient possible.
En ce sens, une lecture substantielle de soi ne devient réellement saisissable qu’à travers une révélation dépendante du visage de l’autre. L’auteur de l’Humanisme de l’autre homme entend lutter efficacement contre le mal qui se manifeste d’une certaine manière par des attitudes de conflits entretenues par une certaine recherche de la suprématie, aussi de certaines conceptions idéologiques de l’existence d’autrui (Robert MISRAHI, 1997, p. 253). Sa pensée du visage se présente comme un effort de la préservation de l’intégrité absolue de l’autre, de l’humain puisque, « la présence personnelle de l’Autre à travers son visage signifie l’ordre au Moi de renoncer à la violence et l’engage à se “mettre en société avec lui” » (Emmanuel LEVINAS, 1994, p. 14). Dès lors, la coexistence pacifique dans des sociétés multiculturelles, la concorde, la diversité, la tolérance, le dialogue ainsi que la prévention des discours haineux et conflictuels apparaissent comme des principes qu’incarnent le visage et fait qu’il apparaît comme une véritable parade contre l’exclusion sociale.
Par ailleurs, cette approche levinassienne du visage, en tant qu’elle vise l’humain, est en correspondance essentielle avec l’idée de la religion. Penser donc la religion avec Levinas c’est penser le visage. « Le visage de l’homme ― c’est ce par quoi l’invisible en lui est visible et est en commerce avec nous » (Emmanuel LEVINAS, 1976, pp. 187-188). On le voit avec Levinas que le visage humain (Emmanuel LEVINAS, 1965, p. 50) se donne comme le lieu de la manifestation de l’infini et lieu de la possibilité d’une relation avec la transcendance. Cette approche phénoménologique indique essentiellement que Dieu est à penser dans la merveille de la rencontre avec l’autre. Connaître Dieu, c’est être en harmonie avec autrui.
Cette orientation éthique de la question de Dieu à partir du visage constitue un appel à l’humanité entière à se rendre plus respectueuse à l’égard de l’autre. En philosophie, la question de Dieu renvoie plus particulièrement à la vie humaine selon les normes morales et éthiques : « quand on aborde la question de la théologie à l’œuvre dans la philosophie, il ne faut pas oublier que le site originaire de Dieu est l’éthique » (François-David SEBBAH, 2000, p. 54). La crise spirituelle de notre temps, crise de la religion s’explique par le fait que celle-ci a été vidée de sa substance, de sa dimension éthique. C’est dire que les comportements déviationnistes religieux sont la conséquence de la perversion de l’idée de Dieu, de la déchéance de l’humanité de l’Autre. Ainsi, « dire que Dieu peut ordonner aux hommes des actes d’injustices et de cruautés, c’est la plus grande erreur qu’on puisse commettre à son égard » (Emmanuel LEVINAS, 1976, p. 184), c’est même la base de toutes les dépravations morales.
Au total, il y a lieu de constater que la question de la relation sociale et politique, ainsi que les questions des droits de l’homme et de la religion, dans leur rapport au visage, telles qu’abordées par Levinas, dégagent non seulement une signification profonde, mais énoncent aussi des principes que sont la justice, l’amour, la fraternité, la tolérance, l’ouverture à l’autre et le respect de la personne humaine. Ces principes afférents au visage permettent de restaurer les relations interhumaines en vue de l’instauration d’une paix durable. Une telle éthique, en tant qu’elle obéit aux exigences de l’humanité de l’homme, ne se dévoile-t-elle pas comme socle de la promotion de la dignité humaine ?
.
3. L’exigence éthique du visage : socle de la promotion de la dignité humaine
Ce qui est mis en avant par l’exigence de l’éthique du visage, c’est la dignité humaine. C’est elle qui est promue. Avec Emmanuel Levinas, il ne s’agit pas d’une dignité scolaire, intellectuelle ou d’une construction idéelle, mais d’une dignité qui prend sens à partir d’une réalité relationnelle qu’exige le visage de l’autre qui fait naître le sentiment de respect de la personne humaine. Il faut entendre par là que la dignité qui transparaît dans le visage est consubstantielle au respect : il s’agit fondamentalement du respect de la vie humaine. Cette idée est celle qui est mise en valeur ici par cette expression : « le visage est un Sinaï qui interdit le meurtre » (Paul RICOEUR, 1990, p. 388). Il s’agit de veiller à ce que la vie ne soit pas relativisée ; il n’est pas de vie humaine qui soit plus digne que l’autre, elle est égale pour tous. Par voie de conséquence, tous les êtres humains méritent respect, sans exception de personne, de groupe et de race. Pourtant, il est malheureux de constater que l’œuvre d’Hitler, celle qui a tant causé du tort à l’humanité, demeure encore de nos jours. Elle s’exerce très souvent dans les instances sportives et culturelles. En effet, il est tout à fait regrettable de voir des hommes injuriés, rejetés, stigmatisés à cause de la couleur de leur peau. Ces actes racistes ou de prosopolepsie, en tant que pure négation de l’humanité de l’autre, manifeste l’intérêt qu’a l’homme du XXIe siècle de recourir à la conception levinassienne du visage qui s’impose comme une véritable parade contre cette désolation, cette inhumanité.
Par ailleurs, la dignité que confère le visage n’est pas fonction d’un pouvoir ou d’une possession, mais s’inscrit dans une signifiance propre du visage que Levinas nomme épiphanie qui échappe à tout pouvoir, à toute prise en tant qu’elle est la révélation de la saisie de l’invisible dans le visible (Yvon PAILLE, 2004, p. 202): le visage. Cette manifestation de la splendeur de l’infini (Emmanuel LEVINAS, 1965, p. 50) dans le visage indique que la dignité humaine ou le respect dû à une personne ne se perd pas parce qu’elle aurait perdu sa possession, son pouvoir, sa raison. Non ! Cette dernière n’est aussi en aucune manière une détermination de la dignité humaine. Finalement, la dignité est ce qui « ne se divise pas, ne se multiplie pas, ne s’évalue pas sur une échelle graduée. Elle est » (Jacques DUQUESNE, 1998, p. 97). Chez Emmanuel Levinas, la dignité s’aperçoit à travers le visage comme ce qu’il y a de plus universelle, « c’est celle de toute humanité qui me regarde dans le visage d’autrui et dont je suis responsable, l’universalité de chair et de sang, présente dans le lointain comme dans le prochain » (Olivier, DEKENS, 2003, p. 82). La conception éthique qui se dégage est celle de comprendre que toute violation des règles de l’humanité de l’autre, de sa dignité est une atteinte à l’humain donc à soi-même.
À la vérité, nous nous sommes éloignés du visage et notre existence s’est racornie, desséchée : les guerres, les violences ainsi que les actes terroristes qui sévissent partout dans le monde ont, au fond, pour origine première le rapport à autrui. Le visage semble avoir été vidé de sa substance. Il s’agit avec Levinas de redonner, à partir du visage, de la valeur à ce qui est désormais devenue obsolète : la dignité. C’est pour mettre en exergue cette valeur hautement humaine que l’éthique du visage trouve son assise essentielle. La signification de cette éthique tient à la possibilité que dans le visage il y a d’humain en l’homme. C’est pour cette raison que l’éthique s’avère un humanisme de l’autre homme, une reconnaissance de l’autre. Cette reconnaissance, comme l’énonce si bien, Charles Taylor, « n’est pas simplement une politesse que l’on fait aux gens : c’est un besoin humain vital » (Charles TAYLOR, 1994, pp. 41-42).
Dans cette perspective, la reconnaissance de l’humanisme de l’autre devient une exigence fondamentale pour l’accomplissement de l’humanité de l’homme puisque, par principe, elle exclut l’intolérance, l’inégalité, le mépris des autres ainsi que les discours réductionnistes, négationnistes et exclusionnistes. Ces discours sont l’expression de la perte du sens de soi, de la perversion des valeurs éthiques exprimée dans la perte du sens de l’autre. Cette exigence du visage peut être profitable dans le cadre de la recherche de la paix dans le monde, surtout comme on le constate aujourd’hui, la reconnaissance de l’humanisme de l’autre continue de poser un problème crucial aussi bien en Occident qu’en Afrique.
L’exigence d’une éthique du visage se présente comme une exigence de la Kénose où le sujet perd ses avidités égocentriques pour se mettre en relation éthique avec l’autre. » (Henri BAH, 2009, p. 89). L’éthique devient, de ce fait, « ce lieu, cette conception des relations humaines, du lien social où la primauté est accordée à l’Autre » (Agata ZIELINSKI, 2004, p. 93). C’est ce que soutient aussi René Henrion en ces mots : « Le seul moyen d’assurer son bonheur, c’est de ne songer qu’à celui d’autrui » (Rene HENRION, 1970, p. 7). Dans un monde tourné constamment vers l’idéal d’un bonheur matériel, n’est-il pas anachronique de croire qu’il est possible de s’intéresser davantage à l’autre qu’à soi ? Il nous faut sortir de cet enchainement à soi, compris dans l’exaltation du narcissisme pour une ouverture inconditionnelle au visage d’autrui. L’essence éthique c’est cela, celle qui exige le respect absolu de l’humanité de l’autre (Fred POCHE, 1998, p. 81), car sans autrui, il ne saurait y avoir d’éthique.
Avec Emmanuel Levinas, la dignité, consubstantielle au respect de la personne humaine donc de la vie, ne trouve sa signification que dans le visage d’autrui. Ce visage, dans son épaisseur métaphysique, est l’immédiateté d’un appel qui vise l’humain en nous (Fabio, CIARAMELLI, 1989, 28). Ainsi, l’exigence éthique qu’il prône, et qui s’entrevoit à travers l’exigence de la sortie de soi vers autrui, de sa reconnaissance, de sa primauté, de la mise en avant de ses intérêts dans les relations interhumaines, milite entièrement pour la promotion de la dignité humaine.
Conclusion
La problématique du vivre-ensemble se joue dans un cadre existentiel, cadre social et politique où s’entretiennent des rapports conflictuels entre les hommes. En abordant, dans cette sphère, sa théorie éthique du visage, Levinas entend répondre aux crises relationnelles par l’instauration d’une justice nouvelle fondée sur la fraternité, la proximité, l’amour, c’est-à-dire sur la responsabilité-pour-autrui. C’est, donc, en ce sens que la question du tiers devient essentielle dans la pensée politique du philosophe. L’espace institutionnel qu’elle justifie n’est plus commandé par la logique d’homogénéisation, pour autant que dans l’anonymat des rapports institutionnels, toute différence s’abolit au nom du caractère universel des lois qui est, par principe, structurellement oublieux de la singularité, de l’autre homme. C’est dire que tout État serait foncièrement violent, totalitaire en puissance.
Penser le vivre-ensemble dans le cadre de la conception du visage chez Levinas, implique que nous nous appuyions sur l’approche levinassienne de la politique considérée comme devant être le lieu où s’incarne le droit de l’autre. Le visage de l’autre est l’expression métaphysique de l’humanité qui n’est pas réductible à la totalité. Il échappe pour ainsi dire à toutes les catégories sociales. Une telle pensée est déjà une résistance de l’individu à la société, aux effets d’homogénéisation de la vie commune. Aux yeux de Levinas, la légitimité de l’État dépend tout entière de sa capacité à respecter et à rendre possible la relation à la singularité d’autrui. Ainsi, l’exigence d’une subordination radicale de la politique à l’éthique s’avère nécessaire au maintien de l’ordre public, de la paix et de la fraternité. En mettant en avant le souci de l’autre, du tiers, cette subordination exige droiture et honnêteté, voire une gestion transparente des ressources de l’État. René Simon en déduit que dire qu’une telle pensée n’a pas de répercussion pratique sur l’existence singulière et collective, c’est se méprendre du tout au tout sur la signification de son discours. La dimension la plus concrète, la plus existentielle, la plus sensible, la plus corporelle, de cette pensée, c’est bien cette immédiate relation avec le visage de l’autre, cette proximité constitutive de la subjectivité (Simonne PLOURDE, 1996, p. 142). Cette dernière obéit à l’exigence de la Kénose où le sujet perd ses avidités égocentriques pour se mettre en relation éthique avec l’autre.
L’éthique du visage, en tant qu’elle milite pour la reconnaissance de l’autre, de la préservation de sa dignité et du respect de ses droits, s’impose comme une véritable parade contre le mal en formes d’exclusion sociale, de crises identitaires, religieuses et politiques. Le concept du visage levinassien, de ce fait, est capable de favoriser l’instauration d’un vivre-ensemble fraternel, pacifique où la vie de chacun est préservée et promue.
BIBLIOGRAPHIE
Agata ZIELINSKI, Levinas : la responsabilité est sans pourquoi, Paris, PUF, 2004, 159 p.
ARISTOTE, Les Politiques, trad. Pierre PELLEGRIN, Paris, Flammarion, 1990, 576 p
Bernard FORTHOMME, Une philosophie de la transcendance, la métaphysique de Levinas, Paris, Vrin, 1979, 437 p.
Charles TAYLOR, Multiculturalisme, Paris, Aubier, 1994, 142 p.
Emmanuel LEVINAS, De Dieu qui vient à l’idée, Paris, Vrin, 1982, 270 p.
Emmanuel Levinas, Difficile Liberté, Paris, Albin Michel, 1976, 411 p.
Emmanuel LEVINAS, Entre Nous, Paris, Grasset, 1991, 252 p. .
Emmanuel LEVINAS, Hors sujet, Paris, Le livre de poche, 1997, 220 p.
Emmanuel LEVINAS, Liberté et commandement, Montpellier, Fata Morgana, 1994, 104 p.
Emmanuel LEVINAS, « Paix et proximité », in Les cahiers de la nuit surveillée, n°3, Lagrasse, Verdier, 1984, pp. 345-346.
Emmanuel LEVINAS, De l’existence à l’existant, Paris, J. Vrin, 1984, 174 p.
Emmanuel LEVINAS, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Jean Vrin, 2001 330 p.
Emmanuel LEVINAS, Éthique et Infini, Paris, Fayard, 1982,144 p.
Emmanuel LEVINAS, Humanisme de l’autre homme, Paris, Fata Morgana, 1972,123 p.
François-David SEBBAH, Levinas. Ambiguïtés de l’altérité, Paris, Les belles Lettres, 2000, 222 p.
Fabio CIARAMELLI, Transcendance et éthique, essai sur Levinas, Bruxelles, Ousia, 1989, 220 p.
Fred POCHE, Penser avec Arendt et Levinas. Du mal politique au respect de l’autre, Lyon, chronique sociale, 1998, 147 p.
Henri BAH, « Penser la reconstruction post-conflit en Côte d’Ivoire », in Revue scientifique de l’Université de Bouaké, n°2, Paris, MENAIBUC, 2009, pp.81-92.
Jacques DUQUESNE, Le bonheur en 36 vertus, Paris, Albin Michel, 1998, 312 p.
Jacques ROLLAND, Autrement que savoir, Emmanuel Levinas, Paris, Osiris, 1988, 95 p.
Martin BUBER, Je et tu, préface de Gaston Bachelard, trad. Geneviève Bianquis, Paris, Aubier/ Montagne, 1938, 173 p.
Martin HEIDEGGER, Être et Temps, trad., François Vezin, Paris, Gallimard, 1986, 590 p
Michel DUPUIS, Levinas en contrastes, Bruxelles, Le point, 1994, 202 p.
Olivier DEKENS, Politique de l’autre homme : Levinas et la fonction politique de la philosophie, Paris, Ellipses, 2003, 96 p.
Paul RICŒUR, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, 430 p.
René HENRION, Le livre d’amour, Paris, Flammarion, 1970, 268 p.
Robert MISRAHI, Qu’est-ce que l’éthique ? Paris, Armand COLIN, 1997, 285 p.
Salomon MALKA, Lire Levinas, Paris, Cerf, 1989,116 p.
Yvon PAILLÉ, Philosophie, éthique et politique, Québec, Beauchemin, 2004, 284 p.
AXE 2 : MULTIPARTISME ET VIVRE-ENSEMBLE
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
7. Des enjeux de la diversité culturelle,
KOUAMÉ Akissi Danielle………………………………………………………….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
KOUAMÉ Akissi Danielle
Université Alassane Ouattara
Email : issikakouame@yahoo.fr
Des enjeux de la diversité culturelle
RÉSUMÉ
Le repli identitaire semble être l’une des gangrènes qui mettent à mal l’unité des nations. Pourtant, l’homme est un animal politique qui est contraint d’être sociable pour sa pleine réalisation et son épanouissement. Il urge en ce sens de repenser voir rééduquer l’homme pour possibiliser ce dessein commun et primordial qu’est le vivre – ensemble. La diversité culturelle qui en découle se trouve, en effet, à la rencontre de l’altérité. Du jeu des échanges doit naître une culture renouvelée et inédite, capable d’offrir à l’humanité ses plus belles pages dans un univers mondialisé.
MOTS CLÉS : Altérité – Art – cohésion-sociale- Culture- Diversité- Mondialisation.
INTRODUCTION
Bien que conscient de la nécessité de l’autre pour la réalisation de soi, Jean Paul Sartre soutien que le malheur, c’est la présence de l’altérité. Une telle thèse n’est pas sans fondement parce qu’elle se justifie à la relecture de l’histoire de l’humanité. L’extrémisme, l’idée d’une race pure, l’égoïsme et le culte de la personnalité gagne du terrain faisant reculer la tolérance, l’acceptation de l’autre, le respect de la dignité humaine. Ce qui donne le prétexte du développement du terrorisme, des attentats, des guériras urbaines, des conflits inter-ethniques, interreligieux.
Même la mondialisation des cultures qui se donne pour mission de rompre avec toutes ses considérations pour créer un village globale conduisant à l’uniformisation, l’universalisation des cultures semble être un échec. Au « rendezvous du donner et du recevoir, les peuples sont restés opaque comme des monades sans porte ni fenêtre. Où, lorsqu’elles tentent de « s’embrasser », il y a toujours une culture, (celle qui a une idée poussée de son identité) qui finit par dévorer l’autre. Et elle crie victoire !»(Henri BAH, 2004) Soum Bill, artiste zouglou justifie cette méfiance par le simple fait qu’ « à cause de la mondialisation, les pays pauvres deviennent de plus en plus pauvres. À cause de la mondialisation, les pays riches deviennent de plus en plus riches »[25]. Au lieu du tout diversifié et harmonieux souhaité, l’humanité se déchire. L’individualisme est la nouvelle valeur promue. Les attaques terroristes au mali, les exterminations inter-religieuses au Nigéria, les attentats à la bombe en France, la fusillade au journal Charlie hebdo, parmi eux figure les récentes tueries au Burkina-Faso sans oublier la guerre en Syrie, en centre Afrique, à la plage de grand-Bassam en Côte d’Ivoire en sont la manifestation.
Par ailleurs, même si l’autre est différent de moi, il constitue le moteur de la réalisation de mon bonheur et de l’enrichissement de ma culture. L’être humain ne saurait vivre en autarcie car, hors de la société il est inachevé et éclopé vu que l’autre est une partie de nous-mêmes (Joseph KI-ZERBO, 2010, p. 10).
Le paradoxe de la diversité culturelle induit la question: Comment la diversité culturelle peut-elle être un facteur d’unité entre les peuples? Autrement dit, une coexistence pacifique dans la différence est- elle possible ? Le dénouement d’une telle interrogation se fera autour de deux questions secondaires qui constitueront le fil d’Ariane de notre exposé. Qu’est-ce que la culture ? En réalité la culture ne serait-elle pas tension perpétuelle vers l’autre ? Ensuite, l’art ne seraitil pas le moyen par excellence du dépassement du moi égoïste et de la cohésion sociale?
L’intention fondatrice de notre réflexion porte sur le sens de la culture dans la cohésion sociale. En nous appuyant sur la méthode critique et analytique, notre exercice consistera à montrer en deux moments que, la culture implique nécessairement l’autre et que la contemplation artistique rend possible le dépassement de soi.
I- DE LA CULTURE COMME OUVERTURE À L’ALTERITE
L’altérité c’est l’autre. Il semble être à première vu un obstacle à la vie harmonieuse. En fait, il est le moyen même de la réalisation de l’idée d’humain. Ce visage de l’inconnu qui semble m’obliger à me constituer, à me construire et à me redéfinir est la condition de ma réalisation en tant que sujet. Tendre vers l’autre et sa culture est la clef de ma réussite. Or, la manière unilatérale d’appréhender l’altérité a conduit au chao dans lequel se trouve le monde de nos jours. Des hommes au nom de la culture se donnent la mort en sacrifiant les autres. Il y a ainsi une perversion du sens de la culture dont la vocation première est la socialisation et l’humanisation tout en rendant l’homme heureux. La culture s’est détournée de sa finalité première. Au lieu d’être facteur d’unité, elle est devenue source de désunion. C’est ce qu’Hannah Arendt perçoit comme la crise de la culture. Le mode de fonctionnement de la société est en déréliction. On assiste à la chute du système politique, également à la perte de l’autorité qui est la conséquence de la crise de l’éducation. L’idéal éducatif, valeur fondatrice qui a vu naître la culture est mise à mal. Les parents ne sont plus des repères pour leurs enfants et la pensée se dissocie de l’agir. Cet équivoque suscite en nous la nécessité de questionner en direction de la culture depuis sa racine à partir de la pensée de Hannah Arendt.
La culture n’est pas stagnante, statique mais, elle vie, évolue, avance. Elle est dynamique. Elle est semblable à une plante, qui a besoin de sol, d’eau, d’engrais, de soleil, d’aire, de sels minéraux pour grandir, vivre et survivre. Le bien – être de la plante prend donc en compte plusieurs éléments endogènes et exogènes. En effet, « la culture, mot et concept, est d’origine romaine. Le mot culture dérive de colère, cultiver, demeurer, prendre soi, entretenir, préserver et renvoie primitivement au commerce de l’homme avec la nature, au sens de culture et entretient de la nature en vue de la rendre propre à l’habitation humaine » (Hannah ARENDT, 1972, p. 271). La culture présente un caractère interactionnel et on en déduit qu’elle ne peut et ne doit subsister sans les autres. Pour dire qu’aucune culture n’est achevée, statique, parfaite à la base. Elle se construit, se bonifie et se parfait au contact des autres.
Disons que la culture doit toujours et sans cesse s’actualiser pour s’adapter aux besoins et aux attentes de la société vue qu’elle vise la construction de l’idée d’homme et de façon perpétuelle. Loin d’être le lieu du repli sur soi, de l’enfermement, du rejet de l’autre, du culte de la différence, la culture est, au contraire, ouverture, tention perpétuel vers l’autre. Cet autre n’est sans doute pas l’étranger, l’étrange, le bizarre, l’ennemi, l’inferieur, celui à qui il faut tourner le dos parce que représentant un obstacle à ma réalisation et en perpétuel conflit avec moi-même. L’autre et sa culture sont déterminants dans la réalisation de mon identité et de mon accomplissement entant qu’humain. Par conséquent, accueillir, accepter, et cohabiter avec autrui, se dessine comme une nécessité pour toute culture qui aspire au progrès et pour tout être humain enclin à l’épanouissement.
Aussi, la culture ne satisfait-elle pas un intérêt égoïste. Bien au contraire, elle intime la reconnaissance de l’autre et de son identité. Elle est, en effet, « l’ensemble des techniques, des mœurs, des institutions et des symboles qui permettent aux hommes de survivre, vivre ensemble, mais aussi de vivre aussi bien que possible » (Joël GAUBERT, 2000, p. 7). La culture s’apparente ainsi à un ensemble de pratiques, de systèmes de pensée, ou d’action qui permet à un individu ou un groupe social, de se situer par rapport aux autres. Ceci dans la singularité qui autorise à la fois son identification. La culture serait donc un ensemble de signes, de symbole qui permet à un peuple de construire son identité, de se distinguer et exprimer sa spécificité quant aux autres cultures.
Selon le mot de Marcuse, la culture apparaît comme un processus d’ « humanisation » (Herbert MARCUSE, 1970, p. 312). Elle est caractérisée par les efforts collectifs pour perpétuer la vie humaine et pour apaiser la lutte pour l’existence ou du moins la confiner dans les limites contrôlables. Ce qui voudrait dire que, la culture nous recommande une certaine humanité dans notre agir, nous évitant au maximum de nuire. Par conséquent, consolider une organisation productive de la société, développer les facultés intellectuelles des hommes, diminuer et sublimer les agressions, les violences et la misère constituent le sens même de toute culture. Il va s’en dire que les crimes, les exactions, les guerres et les conflits que vie l’humanité démontrent que la culture semble mésinterprètée ou incomprise de l’humanité Ce qui pose la culture comme un préalable à toutes les crises. Or, le but que vise toute culture est le développement, le bien-être de l’homme.
Les valeurs prônées et partagées par un peuple ne devraient pas être des foyers intarissables de conflit, de destruction massive des biens communs et de régression de l’humanité. « Le vrai développement est celui de nos cultures » (Joseph KI-ZERBO, 2010, p. 9). La culture ne peut se développer qu’en s’ouvrant aux autres pour apprendre des autres et donner d’elle. En somme, aucune culture ne peut exister singulièrement car en réalité, le repli identitaire est synonyme d’enferment, du culte de la personnalité, et de la différence. Se fermer aux autres en clamant la supériorité de sa race, de sa religion, de son savoir, c’est, s’arrêter de penser, de vivre. C’est donc mettre un frein au développement ou du moins à son propre développement. En sus, cela pourrai faire accuser un retard quant à la marche historique de l’humanité. On peut même dire que c’est aussi refuser d’adapter le code culturel au changement. Or, précise ONANA :
La culture n’est pas une réalité figée et immuable. Elle est dynamique et sujette à des changements, fonctionnels et structurels, qui, le plus souvent, sont une adaptation à l’évolution sociale et économique du pays considéré. Vu sous cet angle, un facteur culturel perçu aujourd’hui comme un avantage est susceptible de devenir un handicap à terme, et vice versa. »[26]
La diversité permet de découvrir, se découvrir et mieux, au contact de l’autre qui n’est pas moi, mais sans qui je ne suis pas.
L’aboutissement de la tentative de définition de la culture débouche inéluctablement sur l’idée selon laquelle, l’autre serait une nécessité absolue pour toute culture. « Autrui me regarde et comme tel, il détient le secret de mon être » (Jean-Paul SARTRE, 1943, p. 403) pour parvenir à la pleine réalisation de soi, l’homme doit être en présence sinon en contact avec autrui, qui n’est pas lui, mais qui valide son identité. En un mot, l’autre possibilise mon accomplissement. Cependant, l’autre me plonge dans une certaine gêne limitant mes actions. Par son regard, l’autre m’empêche de jouir pleinement de ma liberté. Ma liberté pourrai m’indiquer de sortir dénuder de ma maison et de me promener dans la rue pour prendre l’air par exemple. Or que cette liberté est subjective. Conscient de la présence de cet autre qui n’est pas moi et qui est capable de me juger et de me blâmer, il m’intimide par son simple visage. Il devient impossible voire difficile pour moi d’exprimer cette liberté. Mon malaise, ma souffrance, c’est l’autre avec ses valeurs, son identité différente de la mienne et qui tend à m’aliéner et mettre un frein à ma liberté. Par ailleurs, même si ma relation avec cet autre qui n’est pas moi est souvent conflictuelle, mon épanouissement dépend et est réalisable qu’en sa présence. Autrui ne se contente donc pas d’être dans une présence passive mais, il prend une part privilégié dans mon projet de connaissance de soi, de découverte de soi et de construction de ma personnalité.
En effet, l’objectivité de l’image de soi dépend du regard de l’autre car, si
la culture s’entend comme ensemencement, ouverture, partage, échange, communication, alors elle ne peut évoluée ni connaitre le progrès en étant enclavée. À ce sujet, se pose la question essentielle qui conduit cet exposé: « l’altérité et le jeu des échanges ne peuvent-ils pas être une opportunité d’enrichissement de nos cultures ? » (Ludivic Doh FIE, 2007, pp. 35-53). L’autre favorise l’innovation, et l’actualisation de ma culture. Il est source de construction, d’enrichissement, d’amélioration et de développement durable. Mais, la perversion de la culture semble être une entrave à ce projet.
N’empêche qu’ « il faut que chaque culture accepte de se vendre à l’autre pour s’acheter qualitativement »(Samba DIAKITE, 2012, pp. 182-201). L’ouverture semble être un impératif. La culture est dynamique, mouvement et doit être entretenu, la seule condition pour elle de se bonifier est de se soumettre au regard d’autrui. C’est ce que Ludovic Doh FIÉ affirme en ces termes : C’est dans l’ouverture à l’autre que se trouve la chance des cultures africaines (Ludovic Doh FIE, 2007, pp. 35-53).
Ainsi, loin d’être la recherche de la singularité, de la satisfaction des intérêts égoïstes, la culture prône en soi la quête de l’autre, la diversité et l’ouverture gage de richesse et de coexistence. Aussi, entant que manifestation véritable de la culture, l’art ne serai-t-il pas un canal d’affirmation de soi et dépassement de la subjectivité pour une relation de sympathie dans la diversité ?
II- L’ART FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE
L’art est l’élément qui représente le mieux la culture parce qu’il est éternel et demeure le témoin de l’histoire. Quand tout semble perdu, l’art est comme une archive à travers laquelle, il est possible de redécouvrir l’histoire. L’artiste serait alors le témoin authentique et privilégier de l’histoire. Par conséquent, il est le garant de la mémoire collective. Il est « le producteur authentique des objets que chaque civilisation laisse derrière elle comme la quintessence et le témoignage durable de l’esprit qui l’anime » (Hannah ARENDT, 1972, 257). Notons que l’art, entant qu’activité de l’esprit, constitue un puissant canal de communication en vue de formuler les opinions, les réalités existentielles d’un peuple ou une collectivité. L’œuvre d’art permet de pérenniser la connaissance, le savoir et l’histoire pour l’enseigner aux générations avenir. Ainsi, l’art permet d’affirmer l’identité en étant témoin de son contexte socio-historique.
Admettre que la création artistique est inhérente à toute société humaine, c’est reconnaître la valeur essentielle de l’art en tant que mode d’expression achevée des idées humaines. En ce sens, la production artistique est tributaire du mode de vie de l’artiste qui les produits. L’artiste vie dans la société, il est donc influencé par celle-ci. Ses œuvres en sont les fruits. Disons que, les différentes expressions de l’art retracent non seulement la civilisation et l’activité à laquelle s’adonnaient les peuples durant l’histoire de l’humanité. Plus exactement une compréhension véritable du sens de l’art est à saisir à partir du contexte sociohistorique d’où il émerge. Ainsi, « l’art est pour soi et ne l’est pas ; il manque son autonomie sans ce qui lui est hétérogène » (Théodor Wisengrund ADORNO, 1995, p. 22) Adorno dont la philosophie de l’art garde une distance raisonnable entre fait social et autonomie de l’art soutien que l’art ne doit pas rester prisonnière de la société. L’art est certes autonome mais également fait social pour l’essentiel. L’œuvre d’art ne se soustrait aucunement de la réalité. Elle prend tout simplement du recul vis-à-vis d’elle pour mieux la critiquer et proposer des pistes de solution aux problèmes que vie la société. Par conséquent, le mystère de l’art n’est pas à saisir hors du champ de la réalité concrète.
L’art dans son déploiement doit être un vecteur de réalité concrète qui engage l’existence pratique de l’homme et concourt par-là à son épanouissement. Tout ceci revient au fait que l’art ne nait pas ex nihilo. Toute œuvre d’art est une traduction sociale donc est tributaire des réalités existentielles de la société d’où elle s’origine. L’art est lié à la société quelle se contente de dépeindre en exprimant les valeurs, la condition des peuples, les tares, les aspirations en proposant même des solutions aux crises quelle traverse. En côte d’ivoire, le zouglou est « une danse et un rythme dans lesquelles les jeunes se reconnaissent. On peut le dire, cette danse informe sur l’état des jeunes au début des années 1990. Et elle informe sur l’état global du corps social de cette époque » (Yacouba KONATE, 2001, p. 129) Né au campus, le zouzlou sert de cadre d’expression aux étudiants qu’elle réunit autour d’une même cause. Aujourd’hui elle est devenue un mode de vie, un esprit qui informe, renseigne, enseigne et prend son ancrage dans la société. Ses textes se chargent de décrire la vie des peuples de la Côte d’Ivoire, de la condition de la jeunesse, de son économie et même de son histoire. Sans oublier qu’il se mue en éveilleur de conscience par moment. La musique se pose alors comme une contre-culture, un moyen d’expression, de contestation et de révolution sociale. Cette musique populaire (Ludovic Doh FIE, 2012, p. 7) est une forme de stratégie du refus. Elle permet non seulement d’engager le débat mais de prendre part au jeu politique en vue d’une condition améliorée des populations également. Aussi, garanti-t-elle une lutte pacifique excluant toute violence. En sus, la musique est « révélatrice des valeurs et du sens de leur mutation dans une société. Elle est l’expression et le facteur de reproduction des habitudes et pensée de cellesci. Si elle est enracinée dans la société, elle ne peut que l’exprimer » (Ludovic Doh FIE, 2012, p. 13). C’est en cela que se référer à l’art pratiqué par un peuple peut instruire sur l’histoire, la religion, le modèle politique et économique, les habitudes culinaires, les valeurs d’une société.
Qui plus est, les nouvelles techniques de productions et de reproduction de l’art permettent la démocratisation de l’œuvre d’art. Ces nouveaux moyens technologiques rompent dans un certain sens d’avec la tradition qui était placée sous le signe du cultuel. Sous ce jour, l’art connait une redéfinition. L’art acquiert la possibilité de briser les barrières spatiotemporelles, de sortir du cultuel, de quitter le repli sur soi pour être diffuser à une grande échelle. L’art technologique permet alors, de véhiculer, d’exposer les informations relatives à un peuple au-delà des frontières nationales car, la connaissance, la découverte de l’inconnu et l’étrange autorise l’acceptation de celui-ci dans le respect. L’art technologique permet de rapprocher (Benjamin WALTER, 2009, p. 15), l’information et les peuples. Ce qui permet d’affirmer son identité et aussi d’apprendre de l’autre. Avec cette révolution, le savoir voyage sans quitter son origine. Les technologies permettent, à cet effet, de posséder l’information pour connaître et accepter l’autre à travers sa culture. Au-delà de l’art perçu comme traduction de l’expérience vécue et les nouvelles technologies perçues comme le véhicule de la culture pour s’ouvrir et accepter l’autre, notre regard est porté sur la dimension métaphysique de l’art.
S’il y a souvent conflit au sein d’une même société, c’est parce qu’en réalité elle n’a pas une culture mais des cultures. Le conflit naît de la moindre différence entre ces cultures (Henri BAH, 2014). En effet, il y a conflits parce que les peuples ont des cultures qui diffèrent les unes des autres, aussi parce que chaque peuple croit et veut sa culture supérieure aux autres et parce que la présence d’une autre culture au lieu d’être source de pluralité, de richesse, de métissage est vécu comme une adversité. En ce sens, la diversité devient une source de différent, conflit perpétuel visant à anéantir, pour exister et dominer en maître suprême et ultime. Or, la question de l’identité est fluctuante, elle oscille d’une situation géographique à une autre, d’une couleur de peau à une autre et même d’une civilisation à une autre. Les crises identitaires sont dues à la volonté des peuples à vouloir dominer et brandir la supériorité de leurs valeurs culturelles.
Cependant, il serait possible de parvenir à une harmonie des contraires. Il faut donc privilégier les choses de l’esprit car, elles sont à même de nous conduire à la vérité des choses et de nous rapprocher. La saisie de cette valeur est rendu possible par l’art car, comme le dit Platon, l’œuvre d’art est le véhicule de l’idée.
C’est l’apparition sous forme sensible de la vérité qui n’est autre que l’Idée. Celleci constitue la valeur de l’homme qui n’est qu’un roseau pensant, le plus faible de la nature, c’est la raison qui lui garantit sa grandeur et sa supériorité sur les autres êtres. C’est donc dans l’idée que peut se résoudre le conflit d’intérêt qui oppose les hommes. Le beau comme finalité sans fin de l’art semble être le recours ultime dans la résolution du mal qui ronge l’humanité. À travers lui, l’homme peut un moment renoncer à sa subjectivité pour se faire sujet pensant et capable de connaître les choses en soi. Disons que :
Dans le beau nous saisissons toujours les formes essentielles et primordiales de la nature tant animé qu’inanimée, en d’autres termes, les idées de Platon à son sujet, et que cette prise de possession a pour condition sa corrélation essentielle, le sujet connaissant affranchi de la volonté, c’est-à-dire une pure intelligence sans desseins ni fins (Arthur SCHOPENHAUER, 1999, p. 164).
L’œuvre d’art, selon Schopenhauer, intime la méditation, le recueillement dans un détachement avec tout affect et toute subjectivité. Au contact d’une œuvre d’art, il est possible de s’élever au-dessus de la différence et des différents pour côtoyer la vérité de l’être qui est le dénominateur commun en tous les hommes ; chose qui fait prendre conscience du fait qu’au-delà des considérations culturelles, demeure en chaque être une valeur identique, inchangée malgré le temps et l’espace et qui les uni les uns aux autres : l’Etre
« Se détacher de soi-même » (Arthur SCHOPENHAUER, 1999, p. 165), telle est l’attitude qui permet de rentrer en possession de la connaissance purement objective des choses. L’art pris dans sa dimension métaphysique justifie le fait que l’artiste noir américain Michel Jackson, l’ivoirien, Alpha Blondy pour ne citer que ceux-là, réunissent dans un même stade, des hommes de couleur noire, jaune, blanche. Cela traduit le fait que, c’est lors de la contemplation d’une œuvre d’art que l’homme est capable de s’élever, de se détacher et faire abstraction de son individualité, sa tendance égoïste pour saisir la vérité. La vérité de l’être est la valeur qui est éternelle et subsiste à travers le temps et l’espace. À travers cette idée, nous pouvons déduire aussi qu’il est nécessaire de laisser le beau orienter notre regard parce que «le beau excite manifestement, comme tel, notre satisfaction et notre joie, sans avoir aucun rapport avec nos fins personnelles, c’est-à-dire notre volonté » (Arthur SCHOPENHAUER, 1999, p. 164). Il est possible de parvenir à la vérité premier facteur d’unité ontologique et de cohésion social en étant en contacte intime avec l’œuvre car, le beau transcende toutes les considérations sociales, la diversité culturelle, raciale et ethnique.
Nous référant à la contemplation esthétique, notre démonstration nous conduit à la conclusion que, devant une œuvre artistique, le beau est universel et sans concept pour pasticher Emmanuel KANT. Pour dire que, les pagnes tissés, les sculptures, les parures, les productions théâtrales, discographiques et cinématographiques, tout ce qui relève de l’art brise les barrières spatio-temporelles et permet la connaissance d’autrui en repoussant la haine, la méfiance, la violence pour créer un cadre de dialogue culturelle sans susciter des conflits inter-ethnique.
CONCLUSION
L’idée d’une universalisation ou uniformisation du savoir dans un contexte de mondialisation des cultures semble être un échec vu les nombreux bouleversements et conflits que vit l’humanité. Et, le prétexte de ses nombreuses crises est la diversité culturelle. La différence est devenu un diffèrent, la diversité un motif de génocide inscrivant toute la terre dans une interminable et perpétuelle guerre où les peuples entretiennent les uns envers les autres une relation de méfiance et de déchirement.
Or, ce constat montre que la culture pervertie et mal comprise dans sa totalité. En nous appuyant donc sur l’étymologie même du mot et concept de culture, nous avons pu démontrer que la culture est mouvement, ouverture et tentions perpétuel vers d’autres identités culturelles pour son évolution et le développement durable. Et, dans cette logique, nous avons pû déduire aussi que, l’autre malgré sa présence qui pourrai constituer un frein à mon épanouissement se trouve être la clef de la pleine réalisation de mon existence et non ce culte qui tue.
Aussi, l’art entant que reflet de la réalité et de l’expérience humaine permetil l’affirmation de la culture et la connaissance de l’autre sans oublier la contemplation esthétique qui permet de conclure que tous les hommes appartiennent à la même race, qui est la race humaine. À cet effet, on peut dire que la différence entre les hommes et par ricochet entre les cultures n’est qu’apparente.
Ainsi, l’achèvement de notre vision nouvelle de la mondialisation des cultures se pose comme cette religion sociale qui, unit tous sans en exclure aucun car, elle permet aux majorités d’y adhérer sans défiance et aux minorités d’y participer sans méfiance. Toute chose qui rend donc possible le véritable rendez-vous universel. En somme, elle est un précipité culturel qui découle d’un continuum de valeurs normatives et inclusives de tous les particularismes culturels. C’est là, la marque d’une culture enrichie au prix d’un dialogue interculturel. Ce qui est le garant d’un monde nouveau où l’uniformisation ne sous-entend plus cette réalité semblable à un guet-apens mais, qui, plutôt encense une culture inclusive.
BIBLIOGRAPHIE
Jean-Paul SARTRE, l’être et le néant, essai d’ontologie phénoménologique, paris, Gallimard, 1943.
Hannah ARENDT, la crise de la culture, trad. Patrick Levy, Paris, Gallimard, 1972.
Marcuse HERBERT, Culture et société, traduit par les Éditions Minuit, 1970.
Jean-Claude CHIROLLET, esthétique et technoscience : pour la culture tecnoesthétique, Mardaga, Liège, 1994.
Joël GAUBERT, Quelle crise de la culture ? Éditions Pleins Feux, Nante, 2000.
Jean-Pierre WARNIER, La mondialisation de la culture, Paris la découverte, 2003.
Théodor ADORNO, Théorie esthétique, Paris, klincksieck, 2004, traduit de l’allemand par marc Jiménez.
Henri BAH, « mondialisation de la culture et figures de l’altérité », in, éthiopique n74, littérature, philosophie et art, premier semestre 2005. Consulte en octobre 2015.
Ludovic Doh FIÉ, « mondialisation des cultures : éclipse ou reviviscence des cultures africaines » in, Lettres d’ivoire numéro 003, deuxième semestre 2007.
Benjamin WALTER, l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, traduit de l’allemand par Maurice de gandillac, Paris, Allia, 2009.
Samba DIAKITÉ, « pour une éthique de la diversité en Afrique : de l’aporie identitaire à l’autoconscience culturelle », in, Revue baobab, numéro10, premier semestre 2012.
Jean-Baptiste ONANA, culture et développement, De la relation entre culture et développement : Leçons asiatiques pour l‘Afrique, disponible sur, www.politiqueafricaine.com/numeros/pdf/068096.pdf consulté le 17/12/2015.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
8. Du dévoilement des pièges de la différence : condition de possibilité du vivre-ensemble chez Paulin Hountondji,
DIOMANDÉ Zolou Goman Jackie Élise………………………………………….81
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
DIOMANDÉ Zolou Goman Jackie Élise
Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire
Contacts : +225 78966348/ 06908763
DU DÉVOILEMENT DES PIÈGES DE LA DIFFÉRENCE : CONDITION DE POSSIBILITÉ DU VIVRE-ENSEMBLE CHEZ PAULIN HOUNTONDJI
Résumé :
Le vivre-ensemble est une tendance irréversible, non seulement entre les individus, mais aussi entre les pays et les continents, en dépit des velléités particularistes. C’est pourquoi, Hountondji s’érige contre l’attitude des intellectuels africains qui se targuent encore des oripeaux de la Négritude en demeurant réfractaires à toute valeur venant de l’extérieur, notamment de l’Occident. Certes, ce comportement est un réflexe de peuples complexés au regard des tribulations historiques subies. Mais, selon Hountondji, c’est bien là le piège qui entrave l’élan de développement de l’Afrique. Car dans la mondialisation contemporaine, les différents continents, les différents pays s’enrichissent dans une interpénétration. Aujourd’hui, l’Afrique qui fait partie du Tiers-Monde a plus que besoin de s’ouvrir au reste du monde, et cela passe nécessairement par un changement de mentalités de ses citoyens. Notre intervention consistera à montrer comment, au-delà des différences de tous ordres, les pays, les continents et les individus au sein des nations, peuvent se départir « des pièges de la différence » et favoriser ainsi le vivre-ensemble pour une humanité plus paisible, et surtout pour une Afrique à l’abri des guerres fratricides.
Mots clés : Vivre-ensemble, mondialisation, culte de la différence, coexistence, Afrique, reconnaissance, identité, ré-conciliation de l’unité nationale.
Introduction
L’existence humaine se conjugue sous le mode de « l’être-avec », du Mitsein heideggérien. D’ailleurs, toutes les philosophies politiques et sociales, de l’Antiquité grecque à nos jours, s’évertuent à mettre l’accent sur la nature sociale de l’homme. Ce qui vaut pour l’homme, en particulier, vaut aussi pour toutes les communautés humaines, en général.
En effet, autant l’individu ne pourrait vivre à réclusion, autant aucune société humaine ne saurait vivre en autarcie, c’est-à-dire repliée sur elle-même. S’impose alors la nécessité d’une cohabitation, d’une collaboration, d’une mise en contact. Seulement que, dans le cas de l’Afrique, victime pendant des siècles de toutes les formes d’humiliation et d’assujettissement, à savoir la traite négrière, l’esclavage et la colonisation, l’affirmation de sa présence au monde rime bien souvent avec l’affirmation d’une identité particulière, d’une originalité qui ne soit engluée dans quelque manière d’être au monde. Du coup, être, dans l’imaginaire collectif africain, c’est être différent, c’est ne pas être l’autre ou ne pas être comme l’autre. C’est contre cette vision réductionniste et exclusionniste de l’affirmation de son être-au-monde que s’insurge Paulin Hountondji. Certes, nous ne sommes pas l’autre, d’autant plus que nous avons à affirmer notre identité.
Mais cette affirmation de l’identité ne doit pas consister à ériger une muraille particularisante autour de nous. Dès lors, comment l’Afrique peut-elle réaliser le vivre-ensemble d’une part, au sein des peuples et des pays qui la composent et d’autre part, avec les autres parties du monde ? Telle est la préoccupation qui traverse cette contribution. Au-delà de cette question principale, une série d’interrogation s’impose : en quoi l’exigence de l’affirmation de l’identité africaine constituerait un obstacle dans la réalisation du vivre-ensemble ? La pluralité d’identités dans le monde ne favoriserait-elle pas l’effectuation du vivre-ensemble ? Qu’en est-il du vivre-ensemble dans l’univers socio-politique africain ? À travers la méthode analytico-critique, nous montrons les limites du culte de la différence et nous indiquons la nécessité et la possibilité, en tant que différents de s’ouvrir les uns les autres pour vivre réellement ensemble.
- De l’exigence de l’affirmation de l’identité africaine au culte de la différence
Après des siècles d’humiliation, à travers la traite négrière, l’esclavage et la colonisation, l’Afrique a à se redéfinir une identité. C’est le sens de l’émergence du mouvement de la négritude, de l’ethnophilosophie et de l’anti-colonialisme.
En effet, la négritude est l’un des mouvements de revendication des peuples noirs, et par ricochet, un courant de la pensée africaine. Elle apparaît aussi comme un viatique pour la libération du Nègre. Elle puise sa source de l’action des panafricanistes tels que Williams Du Bois, Price-Mars et Marcus Garvey.
Le premier fit de la théorie de la vie intellectuelle active, un instrument de combat pour l’égalité raciale, pour la dignité de l’homme Noir. Le second, quant à lui, se contenta de faire la promotion de la culture nègre et l’écho lointain qu’elle pourrait avoir sur la prise de conscience de la personnalité culturelle du Noir. Le troisième, en l’occurrence Marcus Garvey, s’est engagé dans sa lutteen faveur des masses noires. En somme, ces trois grandes figures luttèrent pour l’unité de la race, c’est-à-dire de l’Afrique, en vue de lui assurer plus de dignité, de liberté et d’autonomie. Le combat de ces trois grands a été noble à une époque donnée. Cependant, à travers les mutations qui se font dans tous les domaines de l’existence humaine et dans le monde entier, il s’impose, alors, aux Africains de revoir l’essence contractuelle à la base, les dimensions idéologiques dans l’idée de mondialisation, les contraintes de la pensée abstraite, calculatrice, en un mot, l’insertion et l’intégration obligées de l’Afrique au système dominant d’une société industrielle.
Après les humiliations qu’elle a subies et qui l’ont déstructurée et affaiblie, il fallait détruire cette idée de l’Afrique endormie et agonisante, qui a besoin de l’aide de l’Occident. Cependant, refuser que l’Occident continue d’infantiliser et de marginaliser l’Afrique, n’était pas, en réalité, une fin en soi. Mais une voie pour parvenir à la reconstitution d’une Afrique adulte, responsable, qui prend son destin entre ses mains, refusant de demeurer dans cette posture de marginalisé et d’éternel assisté.
Les idéologies africaines qui ont été créées, telle que la négritude, ont joué un double jeu. Le premier était de montrer à l’Occident les valeurs culturelles africaines, en prétendant préserver leur authenticité culturelle. Le second a été de conduire les Africains à ce qu’on pourrait appeler le repli nationaliste sur eux-mêmes à travers une promotion interminable de leurs valeurs culturelles. Pourtant, ce qui importe dans ce monde contemporain, c’est de réapprendre à penser et à agir. Car à vouloir, coûte que coûte, affirmer ou à continuer d’affirmer son identité culturelle à l’autre qui doit le reconnaître obligatoirement, c’est, sans le vouloir, faire le jeu de l’adversaire. Car, comme le dit Hountondji, il est « dangereux pour l’homme d’attendre d’un autre homme qu’il lui délivre un certificat d’humanité ». (1985, p. 52) Ce qui sous-entend que la dignité ne se quémande pas, mais s’acquiert au prix de nombreux sacrifices. C’est à travers nos œuvres que nous serons jugés et justifiés, alors mettons-nous au travail et arrêtons de perdre notre temps à exhumer notre passé et nous enfermer dans la contemplation des prouesses de nos ancêtres. Tirons-en des leçons, pour nous mettre en état pour participer à l’évolution de l’humanité.
Ainsi la négritude apparaît-elle comme un mouvement de révolte et de lutte pour la libération et la réhabilitation de l’homme Noir. Elle est donc une réalité historique et psychologique. D’ailleurs, Yves-Emmanuel Dogbe n’en dit pas le contraire :
La négritude s’était donc fixée pour but, dans un premier mouvement, la libération du Nègre par le dépassement du complexe d’infériorité (qui vise essentiellement la couleur de sa peau) et du sentiment de la fatalité de la servitude ; puis dans un second mouvement, sa réhabilitation, par la conquête, la restauration de sa dignité d’homme et de contribution à la grande œuvre de l’humanité, à la civilisation de l’universel (1980, p. 103).
Dans l’entendement de Paulin Hountondji, la négritude fait partie des littératures philosophiques africaines, entre autres l’ethnophilosophie qu’il définit comme une « recherche imaginaire d’une philosophie collective, immuable, commune à tous les Africains, quoique sous une forme inconsciente. » (1980, p. 21). Elle fait partie des idéologies africaines qui cherchaient à fonder un système de savoir propre aux Africains. La préoccupation de toutes ces idéologies africaines se résume, pour ainsi dire, en « la quête passionnée d’une identité niée par le colonisateur. » (Paulin Jidenu HOUNTONDJI, 1980, p. 60).
Cette quête passionnée des Africains de leur identité est aussi entretenue par la catégorisation faite par des auteurs occidentaux dont Hegel. En effet, ce dernier caractérise le Noir comme une entité close, incapable de raisonner et dont la culture est asexuée. La réplique des Africains à ces allégations sera virulente. Cependant le combat sera mal orienté car la base a été faussée par les auteurs de la philosophie bantu, que sont Placide Tempels et Alexis Kagamé. Leur objectif était de réhabiliter l’Africain dans le domaine de la pensée, précisément la pensée philosophique. Cependant, la méthode utilisée a été un opium pour la conscience des Africains, en ce sens que ces auteurs sublimaient tout ce qui était en rapport avec l’être et la pensée des Africains sans qu’une recherche scientifique approfondie ne soit faite en profondeur. Le résultat des recherches de ces deux auteurs a été de montrer que les Africains sont incapables de produire une pensée philosophique par eux-mêmes. Dès lors, Tempels, en particulier, s’érige comme le porte-parole des Africains dans les débats entre les Occidentaux et les Africains. Par ailleurs, pour Kagamé, le Bantu est capable de philosopher. Il part de la démonstration que le kinyarwandais qui est la langue des Bantu-rwandais renferme des concepts philosophiques qui, bien exploités, permettront aux Africains de participer au banquet de la réflexion au plan international. Mais, il fait remarquer que les Bantu sont des métaphysiciens intuitifs, mais ignorant leur propre capacité de conceptualisation. Nous restons dans le même schéma qui montre que le Blanc est un être rationnel et le Noir un être émotif, intuitif. Kagamé est donc resté victime des pièges de Tempels.
La pensée de ces derniers va conduire les Africains au repli nationaliste ou au repli continental. Pourtant tout pays, tout peuple, qui aspire au développement, ne peut atteindre cet objectif en vivant en vase clos. Cette attitude constitue un véritable handicap qui empêche l’Afrique de faire un bond en avant. Car, les peuples africains ont une propension à sublimer leur passé dont ils font une fascination béate. Il faut rompre avec cette idée de contemplation et passer à une nouvelle étape, c’est-à-dire avoir un esprit d’ouverture et d’universalité qui marque la pensée contemporaine.
Il s’agira pour nous, Africains, de réorienter nos actions en nous intéressant aux révolutions scientifiques, technologiques qui s’opèrent ici et ailleurs. Le défi qui nous attend, c’est de nous imposer dans tous les domaines d’activité.
Ce que Hountondji attend plutôt de la négritude est que, en tant qu’affirmation de soi et surtout de réhabilitation de soi, elle ne soit pas un culte de la différence ou ne tende pas au narcissisme. Selon Hountondji, pour qu’une société évolue, devienne émergente et se développe, il faudrait des contradictions, des confrontations de pensées individuelles et responsables. Or, le constat est que dans les sociétés africaines, la contradiction semble être un obstacle au progrès. Elle engendre plutôt un retour en arrière, vers le passé ancestral. Pour Paulin Hountondji, si l’Occident nous infantilise, c’est parce qu’il ne voit pas nos œuvres présentes. Il continue pour dire : « il s’agit pour les philosophes africains de se définir, eux-mêmes et leur peuple, face à l’Europe, sans laisser à d’autres le soin de le faire à leur place, sans laisser à personne le loisir de les fixer, de les pétrifier. » (1980, pp. 21-22)
Dans cette avancée du monde, le Noir ne peut présenter un démenti de son infériorité que par ses actions et non par les slogans creux qui ne convainquent personne. Le problème n’est pas de battre les Européens, mais de pouvoir réussir dans les domaines où ils excellent. En philosophie, en technologie, par exemple, les Africains ne devraient pas se croire génériquement handicapés.
Cette quête de l’affirmation de soi s’est transformée en culte de la différence, ce combat qui aurait pu être une richesse pour l’Afrique. Toute vie normale est faite de compétitions, d’adversités, de conflits et de brassage culturel. C’est la compréhension et l’appréciation de la différence qui peut conduire au véritable sens du vivre-ensemble.
II. De la différence à la réalisation du vivre-ensemble
La quête de la différence ne doit pas consister en une hiérarchisation des cultures ou en l’affirmation d’une originalité propre à l’Afrique. C’est dans cette condition qu’intervient la critique de l’ethnophilosophie par Paulin Hountondji et Marcien Towa. Ces penseurs prennent appui sur le livre de Placide Tempels, intitulé La Philosophie bantoue, publié en 1945. Ce livre évoque d’emblée les concepts qui dominaient le discours philosophique africain, à savoir la quête de soi et le souci de réhabilitation de l’identité négro-africaine. Il s’agit pour l’Africain de montrer sa capacité à penser. Il se donne pour tâche de démontrer, par tous les moyens, qu’il est capable d’être un bon et grand philosophe, au vu et au su de l’Européen. Alors, il est urgent, pour eux, de refonder les différents types de philosophies qui avaient été inventées par les ethnophilosophes. On peut citer entre autres, les “philosophies” bantu, rwandaise, dogon, yoruba, wolof, que Hountondji définit comme une vision collective et spontanée du monde qui est comparée à la philosophie européenne, qui, quant à elle, est une discipline réflexive et rationnelle.
Ce culte de la différence, cette hargne de prouver à tout prix notre humanité, de nous définir et essayer de codifier une sagesse en une philosophie, a fait perdre aux Africains l’essentiel qui est d’apporter de nouvelles idées pour le développement de l’humanité dans d’autres domaines d’activité. Le souci de toujours répondre aux allégations des Européens, fait des Africains des marionnettes de ceux-ci. En effet, le respect ne se force pas ou ne se quémande pas, mais s’acquiert, se gagne dans la dignité. Il n’est pas question de continuer à perdre le temps à brandir nos pratiques culturelles, dans l’intention de les justifier aux yeux des Européens ; ce qui importe, c’est de les analyser de manière critique et de les transformer. Cela permettra aux Africains de s’imposer dans le monde. Autrement, les Africains risquent de figer leurs savoirs tant valorisés. C’est ce qui amène Hountondji à affirmer que « À vouloir coûte que coûte défendre nos civilisations, nous avons fini par les figer, par les momifier. Nous avons trahi nos cultures d’origine en voulant à tout prix les donner en spectacle, en en faisant des objets de consommation externe, des objets de discours, des mythes. » (1980, pp. 43-44).
Pourtant, le faisant, nous jouons aux jeux des Européens, contre qui nous nous insurgeons. Les Africains ont perdu leur temps à ressasser leur passé et à chercher à plaire à l’Occident, en oubliant l’essentiel qui est le développement de l’Afrique.
D’ailleurs, la philosophie développée par le Révérend Tempels est d’emblée qualifiée par Hountondji d’ethnophilosophie. Pour le philosophe béninois, l’ethnophilosophie repose sur un mythe, celui de l’unanimité primitive, sur une illusion, celle d’une philosophie close et non comme une discipline réflexive, dans laquelle l’on assiste à des débats contradictoires et constructifs. Le type de philosophie développée par les ethnophilosophes, écarte les Africains dans le discours les concernant. Pourtant, qui dit philosophie dit discours, débat et confrontation de différentes opinions. Comme le dit Hountondji, la philosophie est « un débat sans cesse rebondissant. Hors de ce débat, il n’y a pas de philosophie. La philosophie n’est pas un système clos, mais une histoire, un débat qui se transmet de génération en génération, et dans lequel chaque auteur, chaque penseur, intervient en toute responsabilité. » (1980, p. 82). Lorsque l’un des acteurs d’un débat est absent ou exclu, il ne peut y avoir d’échanges objectifs. En effet, la méthode et le projet du missionnaire belge étaient de rendre service aux Bantu, de rechercher, de classifier et de systématiser les éléments de leur système de pensée, en vue d’édifier à leur place un système ontologique. Il l’affirme clairement en ces termes :
Nous ne prétendons certes pas que les Bantous soient à même de nous présenter un traité de philosophie, exposé dans un vocabulaire adéquat. Notre formation intellectuelle nous permet d’en faire le développement systématique. C’est nous qui pourront le dire, d’une façon précise, quel est le contenu de leur conception des êtres, de telle façon qu’ils se reconnaissent dans nos paroles et acquiescent en disant : « tu nous as compris complètement, tu “sais” à la manière dont nous “savons” » (Paulin Jidenu HOUNTONDJI, 1980, p. 54).
À bien observer la philosophie développée par Tempels, elle est fondée sur le vécu des Bantu. Dans sa démarche, il dénie au Noir la capacité de faire un exposé systématique, cohérent sur son système ontologique, ce qui fait la spécificité de l’intelligence et de la pensée occidentales. Son ambition était d’instaurer une pensée logique et consciente. Car, la pensée fondamentale de l’ontologie est chez le Bantou une pensée directe et collective. Cette lecture de Tempels enlève à l’Africain toute auto-détermination, toute auto-réflexion. Cette marginalisation de la pensée des Africains met à mal l’esprit de cohésion sociale, voire du vivre-ensemble.
À travers les écrits de Tempels sur les Bantu, les Occidentaux prétendent que le niveau de leur pensée a atteint l’étape supérieure de la raison qui correspond à l’état scientifique chez Auguste Comte. Quant à celle des Africains, selon les Occidentaux, elle est encore à l’étape de l’enfance qui correspond à l’état théologique chez Auguste Comte. Cette attitude nous éloigne de l’idée du vivre-ensemble. En fait, la quête du vivre-ensemble suppose le respect et la participation, sans chaîne, sans exploitation, sans domination, et aussi, sans oppresseur ni opprimé. Lorsque Tempels s’érige en porte-parole des Africains pour s’adresser à ses compatriotes Occidentaux sans la caution des Africains, cela montre bien que les Africains sont situés à la périphérie des réflexions scientifiques internationales. Cette sous-estimation du Noir et cette sublimation du Blanc nous éloignent de l’unité internationale qui aurait pu profiter à tous, c’est-à-dire aux Africains et aux Autres.
Les Africains vont alors se replier sur eux-mêmes. Ils vont chercher à s’enraciner dans leur propre culture qui « représente un supplément de valeurs assurant au développement une histoire propre et un visage particulier et, à certains égards, servant d’alternative ou de pôle de résistance à une pensée unique, dogmatique, voire anthropophage » (Albert Kasanda LUMEMBU, 2004, p. 13). Cela fait, les Africains auront du mal à se départir de leur tradition et de l’héritage colonial, ce qui a un impact négatif sur l’esprit de compétition et de la promotion de la raison.
Ainsi, les Africains vont-ils passer leur temps à se justifier auprès du Blanc, précisément devant les idéologues de l’impérialisme européen. Ces penseurs européens ont formulé le syllogisme du racisme, qui est le fondement idéologique de l’impérialisme européen, et qui se formule comme suit :
L’homme est un être essentiellement pensant, raisonnable.
Or le Nègre est incapable de pensée et de raisonnement.
Il n’a pas de philosophie, il a une mentalité prélogique, etc…
Donc le Nègre n’est pas vraiment un homme et peut être, à bon droit, asservi, traité comme un animal.
La philosophie étant, aux yeux du philosophe européen, la manifestation la plus éclatante et la plus haute de la raison humaine, la refuser aux Nègres n’est qu’une précision apportée à la mineure du syllogisme raciste et impérialiste (Marcien TOWA, 1979, pp. 17-18).
À lire ce raisonnement formel, l’on observe une désacralisation de l’être africain, une dépersonnalisation de l’Africain de la part des Occidentaux. Pourtant, il ne peut avoir échange entre deux êtres, deux peuples que lorsqu’ils se considèrent et se respectent réciproquement.
Aucune culture ou civilisation n’est supérieure à l’autre, dans la mesure où chacune joue sa partition pour le progrès de l’humanité. C’est pourquoi, les Africains chercheront à se réhabiliter aux yeux de l’Occident, en brandissant leur originalité, leur authenticité. Pourtant, selon Hountondji, cette idée d’originalité, de l’authenticité prônée par les Africains est à la base du retard de l’Afrique. Alors, pour lui, il faut libérer le discours, c’est-à-dire sortir du repli identitaire et s’ouvrir aux autres. Car, comme il l’affirme,
La recherche de l’originalité est toujours solidaire d’un désir de paraître. Elle n’a de sens que dans le rapport à l’Autre, dont on veut à tout prix se distinguer. Rapport ambigu dans la mesure où on affirme sa différence, mais où, en l’affirmant, on n’a de cesse que l’Autre ne l’ait effectivement reconnue. Cette reconnaissance se faisant malheureusement attendre, le désir du sujet, pris à son propre piège, se creuse toujours davantage jusqu’à s’aliéner complètement dans une attention inquiète aux moindres gestes de l’Autre, aux moindres mouvements de son regard. (1980, p. 34).
Il est clair que, la théorie de l’auto-satisfaction et de conservation d’identité, ne garantira pas la liberté psychologique des Africains. Notre liberté, c’est-à-dire l’affirmation de notre humanité dans le monde actuel ou l’affirmation de notre originalité, dépend de notre manière d’être au monde. Ce qui importe, ici, c’est d’imposer le respect. Et cela ne se réalisera que lorsque nous sortirons de la passivité, tout en cessant de passer notre vie à reconstituer la pensée de nos ancêtres. Il importe de passer à la mise en mouvement de notre être, de notre savoir-faire, dans la mesure où, « Ce n’est pas en nous accrochant à notre essence et à notre passé que nous pourrons jamais recouvrer [notre liberté]. Ce serait plutôt maintenir le statu quo ou plus exactement confirmer et accélérer l’évolution actuelle vers la dépendance et l’impuissance. Le chemin de [la libération] passe obligatoirement par une révolution, et donc par une auto-révolution ». (Paulin Jidenu HOUNTONDJI, 1980, p. 67).
Le souci de Hountondji et de Towa est que les Africains refusent de renoncer à l’exercice de l’esprit, c’est-à-dire la pensée au profit d’un miroitement obsessionnel du legs de leurs ancêtres. Les deux philosophes refusent l’unanimisme absolu prôné par les ethnophilosophes et les négritudiens. Pour eux, il importe de prôner le pluralisme, la contradiction, la contestation dans notre vie intellectuelle et politique d’aujourd’hui. Il s’agit alors de promouvoir la contradiction interne et aller au-delà de la pensée des ancêtres. Il convient de relire l’ethnophilosophie pour l’approfondir et la dépasser. C’est pourquoi, Marcien Towa continue dans cette perspective, en prônant la mise en crise du contenu de la négritude. Pour lui, la négritude, surtout celle de Senghor, a participé au retard de l’Afrique. Son seul but était d’amener les Africains à se souvenir de leur passé, avec une pensée passive, c’est-à-dire faire une rétrospective passive du passé africain. Elle aurait dû permettre un dépassement, mais elle a gaspillé assez d’énergie en ne faisant que la promotion des cultures africaines. La négritude a failli à sa mission qui était de sortir l’Afrique de la domination coloniale.
Il s’agit de nous départir de l’exhumation d’un passé idyllique et des « revendications d’un nationalisme culturel dépassé » (Paulin Jidenu HOUNTONDJI, 2008, p. 360). Il convient donc de changer de regard. Ce type de changement est explicité par Njoh-Mouelle en ces termes : « Notre regard a davantage intérêt à se tourner vers nous-mêmes désormais qu’à continuer à se promener à l’extérieur, en quête d’approbation et d’applaudissement » (1975, p. 21). Il n’est pas, en effet, interdit de se référer à son passé pour revendiquer sa reconnaissance, mais il conviendrait de questionner ce passé dans tous ses aspects et tirer une conclusion rationnelle, pour éviter de se tromper. C’est ce qui a manqué dans la démarche des Négritudiens et des ethnophilosophes africains. La simple préoccupation de recourir au passé a éloigné les Africains de leur véritable cible, le développement africain, par les Africains eux-mêmes. Cette soif d’obtenir la reconnaissance de l’Occident a endormi la conscience créatrice des Africains, plus encore “l’angoisse” créatrice africaine. C’est pourquoi, Samba Diakité affirme que l’ethnophilosophie, à l’instar de « la négritude serait l’opium de la conscience africaine. » (2011, p. 364).
L’époque de la contemplation de notre passé est révolue. Cette page doit être tournée au profit d’une autre, celle des actes. Ce sont par nos initiatives, nos inventions et innovations qui nous permettront de nous imposer et favoriseront la reconnaissance de notre humanité, et la maintiendra en respect. Aujourd’hui, la majorité des pays africains possèdent des usines de transformation de leurs matières premières, des Universités, des élites qui ont fait et font encore leur preuve sur le plan international. Il conviendrait d’exploiter ces ressources pour se faire une place de pays leader sur l’échiquier international. Qui plus est, cette volonté de brandir notre originalité et notre authenticité ne doit pas nous éloigner de ce qui est nécessaire, un développement autocentré : le développement qui viendra du greffage rationnel de nos propres ressources endogènes et celles exogènes. Ce n’est pas en nous agrippant à notre essence et à notre legs ancestral que nous obtiendrons le respect venant de l’autre. Au contraire, nous perdrons tout, car le monde évolue et l’homme aussi. Les cultures, aussi, sont appelées à évoluer. Alors l’Afrique se doit de marcher au rythme du monde, sinon, elle s’égarera. C’est dans ce sens que Towa interpelle les Africains. Selon lui, les peuples, « qui ont voulu préserver leur originalité, leur être profond sont en train de les perdre en se perdant (…) [car] incapables de riposter adéquatement au défi du temps, succombent sous le poids du passé, s’éloignent de la scène de l’histoire et deviennent un champ d’action et d’extension de l’autre. » (1979, p. 46)
Pour éviter d’être à la traine des autres ou de rester à la périphérie de l’évolution du monde, la vie autarcique n’est pas la bonne voie, surtout pas pour notre développement. L’ouverture aux autres civilisations nous sera profitable. Au-delà de l’affirmation de notre originalité, de notre authenticité, il y a des tâches plus importantes et plus urgentes sur lesquelles nous devons nous concentrer. Il s’agit de participer à l’évolution et à la recherche technologique et scientifique. L’Afrique a besoin d’Africains nouveaux, c’est-à-dire les Africains qui soient débarrassés de tout complexe, et qui puisent dans leur conscience historique l’énergie nécessaire qui fait d’eux des innovateurs cherchant à s’assumer dans tous les domaines du connaissable. En fait, cette quête aveugle de notre liberté risque de figer toutes les sources de notre créativité. Pour l’éluder, il conviendrait de tenir compte des réalités actuelles et de nous en conformer, pour construire une Afrique moderne et digne. Pour y parvenir, il faut sortir de notre état de minorité et mettre en marche notre créativité. Cela fait, nous obtiendrons notre liberté tant espérée. En fait, comme le soutient Njoh-Mouelle, « Effectuer notre liberté c’est la traduire en actes qui parleront d’eux-mêmes au lieu que nous préférions la solution de facilité qui consiste à clamer une liberté verbale, impuissante et folklorique, tandis que nos gouvernails de direction demeurent importés. » (1975, p. 23).
Il convient alors, de changer de stratégie, en nous adaptant aux réalités du temps, tout en étant ouvert à la critique, à la contradiction et surtout à la compétition. Ne perdons plus le temps à admirer nos sources et nos ressources en les laissant intactes. Il ne s’agit pas non plus, selon Hountondji, de « raconter des histoires ou [de] répéter des choses entendues, mais [de] contester, expliquer, interpréter en vue de transformer » (2007, p. 102). Alors, pour rendre possible ce désir, il sera question de chercher à créer des usines de transformation de nos produits locaux et à créer aussi des plates-formes d’échanges entre les intellectuels africains. Pour ce faire, il faut une volonté politique plus rationnelle et plus responsable. Si en 2015, en Europe, la Cop 21, La 21ème Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est un accord planétaire, c’est-à-dire mondial, a pu réunir plus de 190 pays autour des travaux sur les changements climatiques, cela montre que le monde a réellement évolué. Quand une partie du monde est menacée, toute la planète doit se mobiliser. Dès lors, la question de la différence ne doit plus être perçue comme un obstacle à la réalisation du vivre-ensemble, mais elle participe à un enrichissement mutuel.
III. Le vivre-ensemble dans l’univers socio-politique africain : de la ré-conciliation à l’union nationale
Pour parvenir à l’union nationale à travers l’instauration d’une vraie harmonie entre les pays africain, les ethnies, selon Hountondji, il faut appliquer les principes sus-mentionnés, c’est-à-dire sortir du culte de la différence, l’enfermement culturel. Le souci de Hountondji est de rendre possible la communication et le dialogue, d’une culture à une autre. Le dialogue est un élément fondamental pour l’unité nationale et aussi pour la problématique de la mondialisation. Car,
Les hommes se parlent d’une culture à une autre. (…) la discussion est une pratique quotidienne, non seulement à l’intérieur de chaque groupe humain constitué, mais de plus en plus aujourd’hui à l’échelle planétaire. Il faut donc bien admettre qu’au-delà de leurs différences individuelles et collectives, les êtres humains présupposent au minimum, dans leurs rapports entre eux, quelques règles et quelques principes sans lesquels ne pourrait se constituer aucun discours. (2007, p. 2).
Ces règles qui permettent la communication, rejettent les éléments tels que l’ethnocentrisme, le repli autarcique. Alors, pour rendre possible le discours, il convient de sortir de l’ethnocentrisme, qui est une tendance à privilégier le groupe social auquel on appartient et à en faire le seul modèle de référence, en vue d’accepter la différence. Car la différence ne doit pas être source de différends, mais une richesse. Il est clair que, d’un individu à l’autre, d’une race à l’autre, nous sommes tous différents les uns des autres. Il faut rechercher le lien commun sur lequel nous nous accordons tous, car par exemple, sur le plan ontologique et juridique, nous sommes tous égaux. C’est ce lien commun qui nous permettra de nous reconnaître en l’autre et de dialoguer avec lui. Ainsi, nos différences, au lieu de générer des conflits, constitueront une force vitale pour l’humanité. Cela montre clairement, que nous nous trouvons dans un monde de complémentarité. Amadou Hampâté Bâ ne dit pas le contraire, quand il écrit ceci : « La beauté d’un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde »[27]. Ainsi, la diversité ne devait pas inhiber l’éveil africain, mais plutôt en être la source vivifiante. Un monde sans contraire, sans contradiction, est un monde stagnant. Pourtant, l’Afrique est un continent qui se veut évolutif dynamique, alors il existera toujours des chocs d’idées, c’est ce qui rend le monde meilleur. Tout développement n’est possible qu’à partir de la diversité des opinions. Hountondji peut alors noter ceci: « La diversité des opinions n’est pas un mal, mais au contraire, la condition de tout progrès » (1973, p. 40).
La rencontre des civilisations permet de détruire des mentalités, en général et celles des Africains, en particulier, l’idée des frontières dont ils ont été victimes. Les frontières actuelles en Afrique, en effet, ont été héritées de la colonisation. L’histoire contemporaine de l’Afrique noire, depuis la Conférence de Berlin, de novembre 1884 à février 1885, est marquée par le découpage du continent. Il y a une part qui appartient aux Français, une part aux Britanniques et une autre aux Portugais. Hountondji le montre en ces termes :
Comme toutes les ex-colonies d’Afrique noire, le Bénin a hérité de frontières arbitraires tracées par le colonisateur. Brisant l’unité des ethnies, dont les morceaux séparés évoluent désormais sur des territoires différents, ce tracé a, inversement regroupé sur un même territoire et sous une même autorité politique des ethnies différentes. (2000, p. 204).
Cela a causé des ruptures au sein des peuples, d’autant plus que l’harmonie est brisée. Les mêmes ethnies se trouvent de part et d’autre des frontières nationales. Joseph Ki-Zerbo fait la remarque en ces mots : « Je suis persuadé que si l’on permettait la libre circulation des peuples, on désamorcerait l’essentiel des affrontements ethniques. Beaucoup d’ethnies ne se retrouvent qu’en dépassant les frontières prétendument nationales.» (Joseph KI-ZERBO, 2003, p. 59). Au-delà, les Africains finissent, somme toute, par se reconnaître les uns dans les autres, transcendant les barrières, les frontières factices héritées de la colonisation. Ce geste est en soi la manifestation du désir naturel, inhérent à l’Africain, de vivre avec l’autre, au sens du Mitsein heideggerien. C’est ce qu’on constate d’ailleurs à travers l’hospitalité légendaire des Africains. Même si l’on voit des rapatriements de part et d’autre des frontières des pays africains, tels que les deux étapes de rapatriement en 2015, des ressortissants ivoiriens du Togo, cela est très négligeable ; et en toutes relations interétatiques, il y a des normes à respecter.
À l’échelle nationale, ce désir d’être avec l’autre s’est traduit, dès les indépendances, par la mise en avant du parti unique, censé fédérer toutes les populations, toutes les intelligences, au-delà de la multiplicité des ethnies. Cela se perçoit dans cette pensée de Christian Potholm :
Dans le contexte de l’Afrique indépendante, nombreux sont les leaders politiques qui entendent donner de la société africaine traditionnelle l’image d’une société homogène. On a fréquemment prétendu que ces sociétés partageaient des conceptions identiques quant à la nature des collectivités humaines, ce principe s’appliquant évidemment aux nouvelles nations. » (Christian POTHOLM, 1981, p. 6).
Le parti unique vise, en fait, la construction de la nation. C’est pourquoi, Cheikh Hamidou Kane fait dire à l’un de ses personnages, à propos des indépendances, ceci : « L’important n’est pas de dire oui ou non, mais de dire oui ou non d’une seule et même voix dans l’unité » (Cheikh HMIDOU, 1997, p. 107). L’avènement du multipartisme, par contre, est apparu, dans bien des cas, comme une remise en cause de l’unité nationale. Les partis politiques se sont constitués, dans la plupart des cas, sur des bases ethniques, entraînant ainsi un repli sur soi, conduisant à des attitudes comme le tribalisme, source de bien de conflits comme la tragédie rwandaise. Cela est élucidé par Paul Bohannan et Phillip Curtin dans cette phrase : « Les Africains identifient effectivement leurs intérêts avec ceux des personnes qui parlent la même langue, viennent des mêmes communautés rurales, ont une culture commune et ils se sentent souvent unis par des liens de parenté réels ou fictifs. » (Paul BOHANNAN et Phillip CURTIN, 1973, pp. 428-429).
Mais, passé l’euphorie, finis les conflits, place au réalisme : l’Africain retourne dans son être originel, pour laisser prévaloir ce qui l’a toujours guidé : le désir d’être, de vivre avec l’autre. C’est le moment de la ré-conciliation qui consiste en un retour à l’unité originelle, à l’harmonie primitive. Le cas du Rwanda en est un exemple édifiant. Pour panser les plaies de la tragédie de 1994, les autorités ont banni du discours officiel comme populaire les termes de « Tutsi » ou de « Hutu ». Le Rwanda apparaît désormais comme une entité unique, au sein de laquelle les clivages ethniques ont disparu. C’est une interpénétration des peuples : les bourreaux d’hier fument le calumet de la paix avec leurs victimes. Dans le contexte socio-politique africain, le vivre-ensemble n’est que le retour aux sources, à la nature originelle de l’Africain. L’objectif visé est la construction de la nation. Nous avons l’exemple de la Côte d’Ivoire qui fait des efforts pour la réconciliation entre les Ivoiriens. Ce sentiment se matérialise à travers la création des structures telles que la CDVR (Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation) et la CONARIV (Commission Nationale de Reconciliation et d’Indemnisation des Victimes), et bien d’autres structures de prise en charge des victimes de guerre. Ces structures ont participé à l’intégration des victimes des différentes crises ivoiriennes et leur ont permis de surmonter leur douleur causée par les crises. Ce qui est recherché ici, c’est l’unité nationale, le vivre-ensemble.
Conclusion
Au sortir cette analyse, nous notons que la différence ne doit pas constituer un frein à la réalisation du vivre-ensemble. La différence n’est pas source de différend, mais une richesse pour chaque civilisation, car nous nous trouvons dans un monde de complémentarité. Dès lors, les Africains ne doivent pas craindre la diversité, et chercher à vivre en autarcie. La pluralité ne devait pas inhiber l’éveil africain, mais plutôt en être la source vivifiante. Un monde sans choc, sans contraire, est stagnant et sans saveur. L’Afrique est un continent qui se veut dynamique, alors elle sera toujours confrontée à la diversité d’opinions, aux contradictions interne et externe. Ce qui conduit absolument au développement, à l’émergence. Tout développement n’est réalisable qu’à partir de la pluralité des opinions.
Il convient de retenir que le vivre-ensemble ne sera une réalité que lorsque les Africains, en particulier, et le monde, en général, s’accepteront réciproquement, car le monde est un patrimoine commun. Alors, chacun doit y apporter sa pierre à l’édifice. Il s’agit, en effet, de détruire le complexe de supériorité du Blanc et le complexe d’infériorité du Noir. En fait, le vivre-ensemble est l’autre nom de l’humanité. Alors pour que la notion d’humanité ne soit pas une légende, il faut que dans le monde règnent la considération et le respect mutuel.
Bibliographie
I. Les ouvrages consultés
- Aimé CÉSAIRE, Lettre à Maurice Thorez, Paris, Présence Africaine, 1956.
- Cheikh Hamidou KANE, Les gardiens du temple, Paris, Éditions Stock, 1997.
- Christian POTHOLM, La politique Africaine : “Théories et pratiques“, Paris, Nouveaux Horizons, 1981.
- Ébénézer NJOH-MOUELLE, Jalon II : L’africanisme aujourd’hui, Yaoundé, CLÉ, 1975.
- Joseph KI-ZERBO, À quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein, Paris, Éditions de l’Aube/Éditions d’en bas, 2003.
- Marcien TOWA, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique, Yaoundé, CLÉ, 1979.
- Marcien TOWA, L’idée d’une philosophie négro-africaine, Yaoundé, CLÉ, 1979.
- Paul BOHANNAN et Phillip CURTIN, L’Afrique et les Africains, Paris, les Éditions Inter-Nationales, 1973.
- Paulin Jidenu Hountondji, Économie et société : Le Bénin d’hier à demain, Paris, L’Harmattan, 2000.
- Paulin Jidenu HOUNTONDJI, Sur la «philosophie africaine» : critique de l’ethnophilosophie, Yaoundé, CLÉ, 1980.
- Samba DIAKITÉ, Philosophie et contestation en Afrique : Quand la différence devient un différend, Paris, Éditions Publibook, 2011.
- Yves-Emmanuel DOGBE, Négritude, culture et civilisation, Paris, Akpagnon, 1980.
II. Les Articles consultés
- Albert Kasanda LUMEMBU, « Leurres et lueurs de la philosophie africaine », in Pour une pensée africaine émancipatrice, point de vue du Sud -Vol. X (2003), n°4, Paris, L’Harmattan, 2004.
- Paulin Jidenu HOUNTONDJI, « Pièges de la différence » in Diogène, n°131, Juillet-Septembre 1985.
III. Webographie
- Amadou HAMPATÉ BÂ, « Lettre d’Amadou Hampaté Bâ adressée à la jeunesse africaine », in http://yasserassoweh.over-blog.fr/pages/Lettre_dAmadou_Hampate_Ba_adressee_a_la_jeunesse_africaine-5632172.html, consulté le 18/12/15.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
9. Le vivre-ensemble à l’épreuve du multipartisme en contexte africain : la nécessaire éthicisation du politique africain,
COULIBALY Sounan……………………………………………………………….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
COULIBALY Sounan
Université Alassane Ouattara
LE VIVRE-ENSEMBLE À L’ÉPREUVE DU MULTIPARTISME EN CONTEXTE AFRICAIN : LA NÉCESSAIRE ÉTHICISATION DU POLITIQUE AFRICAIN
Résumé
Le présent article est une réflexion sur le vivre-ensemble en rapport avec le multipartisme en contexte africain. La question de savoir si nous devons ou pouvons vivre ensemble semble être un non-sens. En tant que des frères en Humanité, nous n’avons pas le choix. Au-delà de nos différences ” apparentes “, nous y sommes contraints absolument. Conscients de cela, la question qui se pose est donc la suivante : En quoi est-il possible de positiver, à partir des principes qui nous sont communs, le vivre-ensemble ? Ce questionnement revêt une particularité singulière dans le contexte africain où la pluralité de partis politiques, réel levier de l’expression démocratique sous d’autres cieux, rime le plus souvent avec crispation, instabilité, fragilisation, voire destruction du tissu social. Le vivre-ensemble nécessite une éthicisation du politique et du citoyen africains. Une éthicisation qui aboutit à l’émergence d’un citoyen africain nouveau : des politiques responsables et respectueux du peuple, et des sociétés civiles fortes, actives et engagées. D’un citoyen nouveau et d’une classe politique nouvelle épris des valeurs promotrices de la cohésion sociale.
Mots-clés : Citoyen nouveau – Démocratie – Éthicisation – Monopartisme – Multipartisme- Politique africain – Sociétés civiles – Vivre-ensemble
INTRODUCTION
L’histoire du multipartisme en Afrique se décline, aux dires des historiens, en deux moments majeurs : le premier remonte à la triste et douloureuse période de la colonisation européenne. « Les partis politiques africains, écrit Loucou, sont nés sous l’effet de la colonisation» (Jean-Noël LOUCOU, 1992, p. 6). Le second est, quant à lui, sa restauration dans les années 1990, où plusieurs ex-colonies françaises mettent, en effet, fin au multipartisme et instaurent des systèmes de parti unique[28].
Mais, vingt-cinq ans après sa restauration, le constat est loin d’être reluisant. Pire, le pluralisme politique, réel levier de l’expression démocratique sous d’autres cieux, rime, en Afrique, le plus souvent, avec violence et instabilité socio-politiques, avec accentuation de la fracture sociale, avec discours xénophobes et haineux[29]. D’où l’intérêt du sujet-ci : ” Le vivre-ensemble à l’épreuve du multipartisme en contexte africain : la nécessaire éthicisation du politique africain″.
L’une des meilleures façons d’aborder un tel sujet est de poser des questions simples : qu’est-ce que le vivre-ensemble ? Quels en sont ses principes fondateurs ? Qu’est-ce que le multipartisme ? Quelle est la nécessité de son instauration en Afrique ? La pluralité de partis politiques est-elle incompatible avec l’idée de vivre-ensemble ? Comment le multipartisme, censé favoriser la cohésion sociale, peut-il se transformer en un moyen de fragilisation, de division et de destruction sociale ? Est-ce parce ses normes sont-elles mal articulées pour que les Africains ne s’y reconnaissent pas ? Ou est-ce plutôt parce que ces derniers appliquent mal ses principes ? Sur quelles valeurs éthiques doit-on refonder la pratique politique africaine ? Autrement, quels référents éthiques pour le nouvel homme politique africain ?
- La perversion de l’idéal du parti unique comme fondement du multipartisme
La société est « l’état particulier à certains êtres qui vivent en groupes plus ou moins nombreux et organisés[30] ». De cette approche, il est permis de parler de société animale et de société humaine, la première étant moins organisée que la seconde. Cette dernière qui se distingue nettement de la première, est spécifiquement saisie comme « l’ensemble des individus entre lesquels existent des rapports durables et organisés le plus souvent établis en institutions et garantis par des sanctions [31]». Ainsi, à la différence de la société animale basée sur l’instinct, la spontanéité, la société humaine a, à ses fondements, des principes établis et connus de tous qu’il convient de connaitre et respecter pour une coexistence harmonieuse. Dès lors, quels sont les fondements du vivre-ensemble ?
- Droit et Justice
Le droit est un principe fondamental du vivre-ensemble. Son respect strict assure et garantit la paix sociale. Par conséquent, son inobservance compromet fortement l’unité nationale. D’ailleurs, la plupart des problèmes époquaux, la multitude de conflits qu’on observe avec écœurement dans le monde, sont, en partie, le fait de la méconnaissance et/ou du non-respect des droits humains. La multiplication des ligues de droits de l’homme, des facultés de droit, des Déclarations universelles des droits de l’homme illustre, avec pertinence, l’importance du droit dans les activités humaines. Mais, qu’est-ce que le droit ? On définit le droit, dans son acception générale, comme ce qui est permis dans une communauté, une collectivité humaine et qui ne nuirait pas ou ne porterait pas atteinte à autrui. Autrement dit, le droit est ce qui est permis à un homme de faire dans les limites du strict respect des droits d’autrui.
Subséquemment, bien compris et effectif, le droit est, en ses deux composantes majeures, ce qui possibilise réellement le vivre ensemble. En effet, le respect du droit naturel considéré comme « celui qui résulte de la nature des hommes et de leurs rapports indépendamment de toute convention ou législation» (André LALANDE, 2010) et du droit positif défini comme « celui qui résulte des lois écrites ou des coutumes passées en force de lois » (André LALANDE, 2010) concourt efficacement à la cohésion sociale. La différence entre les deux étant que le premier est vécu de façon spontanée parce qu’inné, c’est-à-dire faisant partir de la nature même de l’homme tandis que le second fait objet d’apprentissage parce que relevant de convention.
Le droit, qu’il soit naturel ou positif, pour être respecté, a besoin d’un élément régulateur qu’est la justice. Celle-ci peut être saisie comme un outil qui permet à l’homme d’appliquer des sanctions à tous ceux qui vont à l’encontre du respect des lois sociétales. C’est un « principe moral de conformité aux droits positifs ou naturels[32] ». La justice est donc en quelque sorte ce qui veille au bon fonctionnement du droit. C’est pourquoi, on peut qualifier la justice de « juste appréciation, juste reconnaissance et respect du droit et du mérite de chacun[33]». Ainsi appréhendée, la justice est essentielle dans la quête et la consolidation du vivre ensemble en ce sens qu’elle sert d’arbitre dans les rapports, notamment conflictuels entre citoyens. En ces trois formes majeures[34], la justice régule la vie sociétale : veille à l’affirmation et à l’effectivité de l’égalité en droits des citoyens, sanctionne le contrevenant aux règles en vigueur, veille et favorise l’application du principe d’équité en matière d’accès aux services sociaux de base. Boileau n’a-t-il pas dit que « Dans le monde il n’est rien de beau que l’équité : sans elle, la valeur, la force, la bonté, et toutes les vertus dont s’éblouit la terre, ne sont que faux brillants et que morceaux de verre» (Nicolas BOILEAU, Satires XI). Par conséquent, tout pays où la justice n’est pas indépendante, est un État paralysé, un pays à l’avenir incertain.
Le droit et la justice ainsi définis et placés au fondement de toute existence sociale harmonieuse ne pourront être réellement utiles à l’homme que s’ils sont vécus au sein d’une organisation plus élaborée avec des règles de fonctionnement plus rigoureuses : l’État.
2- État et Nation
Au-delà de toute critique qu’on pourrait lui adresser, l’État joue un rôle fondamental dans la construction et la consolidation de la paix sociale. En tant qu’organisme juridico-politique qui dirige, de façon souveraine, un ensemble d’hommes à l’intérieur d’une frontière reconnue, l’État veille au bon fonctionnement administratif, politique et juridique de la société. Il structure et dirige, en toute souveraineté, les rapports et les échanges entre les individus. À ce titre, Lalande le définit comme « une société organisée dans sa structure politique, administrative, juridique et jouant le rôle d’une personne morale» (André LALANDE, 2010). L’État favorise le vivre ensemble par la sécurité des personnes et de leurs biens qu’il garantit, par le développement qu’il apporte et promeut, et surtout par ses multiples interventions en faveur d’un meilleur rayonnement de l’appareil judiciaire. Toutes ces actions permettent d’atténuer, sinon d’éviter les tensions entre individus et intercommunautaires susceptibles à leur tour d’ébranler le tissu social.
Eriger la nation en un fondement du vivre-ensemble est à inscrire dans la stricte définition de celle-ci comme communauté naturelle et historique. En effet, appréhendée comme l’ensemble des règles, des individus d’une société constituant une unité morale autour d’aspirations et de valeurs communes, la nation constitue le lieu par excellence de la coexistence pacifique. Ayant en partage la nation et conscients du fait que l’intérêt superieur de celle-ci prime sur tout autre, les citoyens peuvent, dans un réel élan patriotique, dépasser leurs divergences de vue, leurs antagonismes existentiels. De ce fait, la nation fait appel à un ensemble homogène, à une diversité intégrée. C’est de cette force extraordinaire d’intégration des particularismes dans un projet fédérateur, dans le cadre d’une nation, qu’il s’agit quand nous faisons de la nation l’un des piliers centraux du vivre ensemble qu’il est nécessaire de ne pas confondre avec unanimisme.
Présenter l’État et la Nation comme deux piliers distincts du vivre-ensemble ne signifie aucunement une séparation, une opposition radicale entre ces deux entités. En réalité, il existe, au contraire, une intimité, un lien indéniable entre elles. La nation n’est que la conscience spontanée d’appartenir à un même territoire, d’avoir les mêmes aspirations, les mêmes pratiques (religieuses, linguistiques, etc.). Or, ce sont ces mêmes aspirations qui, traduites sous forme écrites et rendues universelles (la constitution), sinon universables qui forment l’État. Celui-ci est même présenté comme «l’ensemble des individus qui constituent un État » (André LALANDE, 2010). Dès lors, on peut dire que l’État n’est rien d’autre que l’ensemble des services généraux de la nation.
Les valeurs d’égalité, d’équité et de droit n’ont réellement de sens que dans un État où l’état de droit est effectif. Le respect de ces éléments constitue un réel gage de rapprochement, de cohabitation et d’unité entre concitoyens.
En somme, « l’Afrique Noire, après avoir construit ses institutions autour du parti unique, s’est aperçue que ce système ne garantissait pas la stabilité politique[35] ». Mieux, avec le monopartisme qui « n’a pas résolu tous [les] problèmes[36] », les inégalités sociales se sont accentuées et l’unité nationale s’est considérablement fragilisée. Dès lors, le système du parti unique a, dans son déploiement, engendré des pratiques largement contraires à ses idéaux initiaux. Lesquelles pratiques déviationnistes ont, à leur tour, incité les bailleurs de fond à imposer le pluralisme politique aux pays africains. La restauration du multipartisme dans les années 1990 est donc la conséquence directe de la perversion des idéaux du parti unique. En clair, la nécessité du multipartisme s’est imposée lorsque les partis uniques sont devenus des partis iniques, totalement déconnectés ou / et ignorant les réalités et les besoins primaires des populations.
3- Du parti unique au parti inique : la nécessité du multipartisme
La perversion du parti unique qui a nécessité l’instauration du multipartisme dans la quasi-totalité des ex-colonies françaises s’observe à deux niveaux. Le culte ou la vénération de la personne des « chefs d’État » en est le premier. Les partis-États se sont transformés, identifiés et confondus, au cours de leur évolution, à la personne de leur chef et/ ou de son clan. Les discours louangeurs à son égard prenant le pas sur les débats de fond, sur les idéaux du parti. Loucou le dit bien : « toute la superstructure juridique et institutionnelle du parti unique est souvent un trompe-l’œil qui permet en fait d’asseoir l’autorité d’un homme et d’un clan et qui sert de paravent à une pratique autocratique et totalitaire » (Jean-Noël LOUCOU, 1992, p. 125). Ainsi, à l’instar de la mission fondamentale de faire cohabiter, de façon harmonieuse, les vivre-ensembles tribaux, sectaires, la majeure partie des nobles et authentiques objectifs du monopartisme sont tus, du moins négligés en faveur de la “publicité″ du ” père de la nation″. Le folklore autour de la personne d’Houphouët- Boigny ou de Sékou Touré l’illustre bien.
La seconde illustration de pratiques déviationnistes des partis uniques, devenus des partis iniques, est la relative “institutionnalisation″ et l’accentuation des discriminations et des inégalités sociales. En effet, les barons des partis uniques se sont adonnés aux abus de toute sorte. Droit de cuissage, népotisme (favoritisme) généralisé en passant par le développement inégalitaire, la gabegie financière, la mauvaise gestion et le détournement des deniers publics et bien d’autres dérives ont permis d’accentuer les inégalités sociales et leur lot de désolations, de frustrations et de tensions militaro-socio-politiques. La prostitution de l’idéal du parti unique, voulue et entretenue sous le silence complice et coupable des peuples, nécessita la restauration du multipartisme avec son panier d’idéaux qu’il convient d’interroger et d’analyser afin de savoir s’il échappe, à son tour, à la critique c’est-à-dire si les énormes espoirs suscités ont été ou non satisfaits.
La longévité – trois décennies environ- des partis uniques s’explique par quelques facteurs. Le monopole du pouvoir, la maturité politique et la personnalité de leur leader en constituent le premier. Les pères fondateurs de nos jeunes nations, n’ont pas gouverné seulement par la terreur, par le musellement des opposants. Leur long règne s’explique aussi par leur remarquable habilité politique. Le dialogue comme voie de règlement des différends politiques adopté par Houphouët Boigny, en Côte d’Ivoire, en est une preuve tangible. Aussi, la cohérence et la constance de l’action, des choix et des programmes de gouvernement, caractérisés par les progrès socio-économiques réalisés ont-ils milité en leur faveur. Certes, le bilan varie largement d’un pays à l’autre et que ces partis-États pouvaient, lors de leur gouvernance, faire plus, cependant, il faut avoir la lucidité et l’honnêteté intellectuelle de reconnaitre qu’ils ont fait beaucoup.
Également, la part active des dits partis dans les luttes émancipatrices a longtemps permis de rallier l’adhésion de la majeure partie des peuples de l’époque à la cause des partis uniques. Les populations se sont toujours, en effet, senties redevables à ces partis, ne serait-ce que pour la liberté et l’égalité retrouvées. L’exemple de l’African National Congress, en Afrique du sud, a, ici, droit de cité même si les contextes semblent différents. Par ailleurs, dans certains pays où le multipartisme n’était pas légalement interdit, la désorganisation et la misère de l’opposition, surtout l’obsessionnelle soif du pouvoir et d’argent, ont favorisé la longévité des partis uniques. Du Ghana à la Côte d’Ivoire en passant par la Guinée de Sékou Touré, les oppositions n’existaient que de nom. Enfin, le contexte international de guerre froide, à cette époque a aussi contribué à la pérennité des systèmes uniques. Par exemple, Le PDCI a « survécu aux vicissitudes du temps grâce notamment au soutien infatigable de la France au nom de la solidarité idéologique, mais aussi pour des considérations géostratégiques et économiques ». (Issaka SOUARE, 2010, p. 105)
Toutefois, ces facteurs ne doivent pas être l’arbre qui cacherait la forêt de dérives dictatoriales des partis uniques. Le monopole du pouvoir, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée et “institutionnalisée[37]″, le musèlement, l’emprisonnement l’oppression voire l’assassinat d’opposants ont été utilisés, de façon massive, par les pouvoirs monnaie courante les insuffisances du monopartisme.
Cela dit, quel bilan peut-on faire du multipartisme en Afrique noire, environ trois décennies après sa restauration ? Le pluralisme politique a-t-il répondu aux attentes qui ont motivé sa revendication et sa restauration ? A-t-elle fait mieux que les partis uniques ? Ou au contraire, a-t-elle ruiné les acquis du monopartisme ? La possibilisation de l’expression plurielle, à travers l’ouverture démocratique, ne s’est-elle pas transformée en un vaste champ d’instrumentalisation des questions sociales et des masses populaires avec ses corollaires de tensions ethniques ou claniques, de crises militaro-socio-politiques, voire de drames humains ? Le mésusage de la politique par les acteurs politiques africains n’a-t-il pas remis en cause les acquis du monopartisme ?
L’instabilité socio-politique[38] dans bon nombre de nos pays et la méconnaissance des réels rôles dévolus à un parti politique, notamment à une opposition, dans la construction d’un État moderne et démocratique, ajoutées à la mauvaise foi de beaucoup d’entre nos politiques, ont conduit, dans la plupart de nos pays, à un bilan catastrophique, du moins mitigé du système pluraliste. Lequel bilan triste et amer appelle nécessairement à un renouveau du politique africain. Un renouveau basé sur l’éthicisation, la conscientisation des acteurs politiques africains, c’est-à-dire, une appropriation[39] de la noblesse politique par ceux-ci.
- Pour un renouveau du politique africain : l’appropriation des valeurs fondamentales de l’éthique politique
- Multipartisme et recrudescence de la violence : de l’idéal de la Cité juste à la réalité de l’oppression du peuple
L’analyse critique de la situation socio-politique actuelle des pays d’Afrique noire révèle que l’exercice du multipartisme semble avoir remis en cause les relatifs acquis des partis uniques. En effet, le pluralisme politique en contexte africain semble s’être mué en un climat de méfiance totale et de guerre farouche entre les différents acteurs, du moins en une “animosité” à peine voilée entre eux. D’où la recrudescence de la violence de tous genres. Les nombreuses crises pré et post-electorales avec leur cortège d’enlèvement, de meurtre et de fracture sociale en sont l’exemple palpable. Le rappel des effets néfastes de la pratique perverse du multipartisme par le politique africain ne vise aucunement, tenons-nous à le préciser, à remettre en cause la noblesse du dit système qui ne se réduit pas au seul[40] modèle démocratique. Au Cuba, en Chine ou en Russie, trois pays qualifiés de non démocratiques, on y observe pourtant une relative coexistence pacifique. Nous visons donc seulement à décrier la mésutilisation du pluralisme dans nos pays. Autrement, si le multipartisme est en lui-même noble, son application par le politique africain – gouvernants comme opposants- parait problématique, ou du moins suscite interrogations et débats. La manipulation est devenue une monnaie courante L’instrumentalisation par les partis politiques des questions sociales le prouve à suffisance.
La restauration du pluralisme visait, entre autres objectifs, à plus de justice sociale, d’équité et d’égalité. Ce qui, pour l’heure, reste une pure illusion tant la situation semble s’être empirée avec le multipartisme. De l’idéal d’une Cité juste et égalitaire, l’on fait face à la réalité implacable de la manipulation et de l’oppression des masses populaires. Les intérêts du peuple passent après ceux des politiciens qui contribuent efficacement à la recrudescence de la violence, à la fracture sociale. La politisation, dans les années 90, des questions scolaires par l’opposition ivoirienne, particulièrement le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et, plus tard, par le RDR[41] et le PDCI[42] est encore fraiche dans les mémoires. Ce qui fait dire à Loucou que « L’école est devenue l’enjeu et le champ clos du combat politique du fait de la confusion des motivations corporatistes et des options idéologiques » (Jean-Noël LOUCOU, 1992, p. 174).
La partialité de la presse est la seconde traduction de l’action manipulatrice des partis politiques. La presse, qu’elle soit audiovisuelle ou écrite éprouve des difficultés réelles à se professionnaliser. Tirant parti du retour au multipartisme avec la naissance en une année de quatre-vingts titres de journaux, celle-ci parait sous influence et à la solde des partis politiques. « Elle n’a pas su, à quelques exceptions près, nous dit Loucou, éviter les maladies infantiles de la diffamation, de la désinformation et de l’irresponsabilité» (Jean-Noël LOUCOU, 1992, p. 175). Dès lors, les hebdomadaires sont devenus, au mépris des règles déontologiques, de véritables relayeurs des idéologies des partis politiques. Par exemple, en Côte d’Ivoire, chaque hebdomadaire[43] ou presque, est affilé à une formation politique.
Le domaine judiciaire constitue « le dernier pôle des crises de l’ère du multipartisme » (Jean-Noël LOUCOU, 1992, p. 176) en Afrique noire. Il faut dire que la place de la justice est loin d’être reluisante tant elle est perpétuellement « décriée, [particulièrement par l’opposition] à cor et à cri, pour son manque d’indépendance et sa soumission au pouvoir politique » (Jean-Noël LOUCOU, 1992, p. 175). Les tapages juridico-médiatiques sur la nature même du procès sur les évènements du 18 février 1992[44] en disent long sur la perception de la justice dans nos pays. Si pour le gouvernement ce procès est celui de droit commun- du fait de la destruction de biens publics et privés-, pour l’opposition, c’en est plutôt un procès politique. Sans prendre position dans ces considérations qui n’honorent pas nos jeunes États, nous disons que « la justice en définitive s’incline devant le pouvoir politique». (Jean-Noël LOUCOU, 1992, p. 178).
Toutes ces crises sociales instrumentalisées et amplifiées par les politiques, notamment par l’opposition, certes déjà existantes, dénaturent et discréditent nos politiques et par ricochet la noblesse politique. Pour restaurer celle-ci et éviter que la politique divise plutôt que d’unir, un retour aux valeurs fondatrices de l’éthique en politique s’avère plus que nécessaire.
- Pour un retour à la noblesse politique
Le renouveau du politique africain – gouvernants et opposants- tant souhaité, passe nécessairement par l’appropriation d’un certain nombre de valeurs non seulement par les acteurs politiques mais aussi et surtout par l’ensemble des citoyens. Car, la pratique cauchemardesque du pluralisme à laquelle nous assistons en Afrique engage une responsabilité multiple. Bien que principaux acteurs de ce désastre, les hommes politiques n’en sont pas pour autant les seuls responsables. L’indifférence et la passivité des citoyens par rapport à la pratique politique ne sont pas à négliger.
En effet, pour que le pluralisme politique soit ce puissant levier de démocratisation et de vivre-ensemble, il faut des citoyens consciencieux et engagés dans la défense de leurs droits. La relative droiture des politiques occidentaux est due en partie à l’extrême vigilance de leurs concitoyens, notamment des sociétés civiles. Un citoyen africain nouveau est donc ce qu’il faut pour une meilleure pratique politique en Afrique. Mais, quel sens faut-il donner à la notion de citoyen africain nouveau ? Consiste-t-il en un remplacement pur et simple des classes politiques existantes ? Le renouveau ici est à comprendre sous l’angle de la refonte des mentalités africaines. L’éthicisation du politique africain, qui appelle à une nouvelle pratique politicienne, consiste donc en l’implication et l’engagement actif de tous à faire reposer la pratique de ce noble art de gestion des peuples sur les vraies valeurs de l’éthique en politique.
L’éducation et la responsabilisation des acteurs politiques africains constituent le premier point de cette réforme des mentalités. La politique comme “art de gestion de la cité″ requiert, contrairement à l’opinion dominante, une formation, une éducation à ses règles. Car, il ne suffit pas seulement d’être instruit et d’être banquier, juriste ou enseignant pour être un bon politique. Prétendre aux destinées d’un peuple requiert du futur dirigeant une éducation et une formation préalables. Phase d’apprentissage et d’acquisition des aptitudes à diriger, l’éducation aux valeurs fondatrices de l’éthique politique doit inculquer l’idée que la politique demeure, pour pasticher Amadou Koné (1980), un jeu. Pour ce qui est de la responsabilisation, il faut l’envisager sous l’angle du Principe-Responsabilité de Jonas (1993) qui appelle au sens de responsabilité des hommes politiques. Elle vise à amener les politiques africains à prendre la pleine mesure de chacun de leurs actes et d’en assumer les conséquences. Ricœur n’a-t-il pas dit, dans Le juste (1995), qu’il n’y a pas d’humanité sans responsabilité. Gaumont abonde dans le même sens pour dire « […] qu’assumer [ses actes], ça aide à grandir. Dire la vérité aussi » (2014, p. 27).
Ainsi, avant tout agir, ils doivent plus ou moins mesurer non seulement les conséquences immédiates de leurs actes mais aussi celles lointaines. L’exigence du sens de la responsabilité qui doit caractériser tout homme, est toute particulière chez l’homme politique pour la simple raison que ses propos et actes vont au-delà de sa seule personne. C’est pourquoi, il doit éviter tout propos et tout acte incendiaire ou susceptible de mettre en mal la paix sociale. Il doit éviter, par exemple, de faire sortir dans la rue ses militants pour une marche non autorisée, voire interdite par l’autorité compétente. Bref, il est temps que nos politiques soient responsables tant dans le discours qu’en actes.
La responsabilité fait appel, ici, à une autre valeur essentielle qui est celle de l’esprit républicain. Le citoyen africain n’est pas suffisamment républicain, c’est-à-dire respectueux des lois et valeurs fondatrices de la République. Le nombre pléthorique de coups d’État, de rebellions armées, de tentatives de modification ou de tripatouillage des constitutions dans de nombreux de nos États en dit long sur notre conscience républicaine. Par esprit républicain, nous entendons aussi le patriotisme vrai à distinguer du patriotisme archaïque et haineux. Le patriotisme vrai est celui prôné par le poète et homme politique français Lamartine et qui se compose « de toutes les vérités, de toutes les facultés, de tous les droits que les peuples ont en commun, et qui, chérissant avant tout sa propre patrie, laisse déborder ses sympathies au-delà des races, des langues, des frontières » (Alphonse de LAMARTINE, 1842). Ramené à notre sujet, nous pouvons dire que le vrai patriotisme consiste à faire prévaloir l’intérêt superieur de sa patrie, de son peuple sur les siens et avant ceux de son appartenance idéologique.
Deux voies s’offrent pour y parvenir. D’une part, promouvoir et intégrer l’enseignement du civisme et des valeurs républicaines dans nos programmes éducatifs et scolaires de base. D’autre part, il faut donner force à la loi, de façon rigoureuse, afin de contraindre les uns et les autres au respect strict des lois. Par exemple, récriminer par des mesures dissuasives, comme c’est le cas au Rwanda[45], tout propos haineux, tout discours tendancieux et incendiaire.
Aussi, les acteurs politiques doivent-ils être éduqués au respect mutuel. Il faut leur rappeler le caractère inconditionnel du respect. En effet, si aimer ou éprouver de l’estime pour ses adversaires politiques peut relever de la réciprocité, le respect est, quant à lui, inconditionnel. Dans cette logique, le combat politique doit, dans un cadre de dialogue réel et constructif, demeurer seulement une confrontation d’idées, d’arguments et de programmes politiques. Chacun ne fait qu’exploiter les failles de ses adversaires en sa faveur, mais sainement et dans le strict respect de l’autre. Ce qui sous-entend qu’il faille distinguer la critique constructive de l’injure pure et simple. L’inconditionnalité du respect parait une règle simple mais fondamentale, en ce sens qu’elle permettra aux politiques de même qu’aux autres citoyens de comprendre que nos différences et divergences, loin d’être un frein, sont une richesse inestimable, un atout essentiel dans la construction et la consolidation de l’harmonie sociale. Celle-ci dépend, rappelons-le, en grande partie d’une justice sociale effective, c’est-à-dire une meilleure distribution équitable des retombées du développement socio-économique. Par ailleurs, si le respect inconditionnel doit être de mise entre acteurs politiques, il doit en être de même à l’égard de leurs concitoyens dont ils revendiquent la défense des intérêts.
Toutefois, l’éducation, aussi importante soit-elle, suffit-elle à rendre exemplaire la pratique politicienne en Afrique ? N’a-t-elle pas besoin de l’appui de sociétés civiles conscientes, extrêmement vigilantes, fortes, engagées et mieux structurées ? Le renouveau du politique africain, qui appelle à une refonte des mentalités tant des acteurs politiques que de l’ensemble des citoyens africains, a besoin de l’implication et de l’engagement actif, mais pacifique et républicain, des associations de sociétés civiles. Sans quoi, il parait utopique de croire que les hommes politiques changeront, de manière qualitative, du jour au lendemain, par pur élan éthique. Il faut qu’ils y soient accompagnés, voire contraints d’une manière ou d’une autre. C’est en cela que le rôle des populations civiles s’avère capital.
Comme cela s’observe ailleurs, notamment en Occident, les sociétés civiles constituent un réel levier de contrôle et de régulation de l’action des politiques. En effet, si le politique occidental est plus ou moins exemplaire, ce n’est sans doute pas de son plein gré, c’est aussi dû à l’existence de sociétés civiles, extrêmement vigilantes et actives dans la défense de la cause publique. L’action décisive d’investigation et de dénonciation des médias, notamment des journalistes d’investigation en France ou aux États-Unis, s’avère capitale dans l’ancrage de la culture démocratique qui caractérise ces nations.
CONCLUSION
Au terme de notre analyse, le multipartisme a, en Afrique, une histoire qui est celle d’un réel contraste. Dans sa première phase expérimentale, le multipartisme s’est remarquablement illustré dans les luttes émancipatrices des instincts inhumains de l’impérialisme européen. Toutefois, il s’assimile, depuis sa restauration dans les années 90, à un puissant facteur d’instabilisation et de destruction des acquis du monopartisme, notamment de l’unité sociale, du vivre ensemble. Mais, si la responsabilité des acteurs politiques est clairement établie, il n’en demeure pas moins pour l’immense majorité des autres citoyens, notamment des sociétés civiles.
La passivité et l’affiliation de celles-ci aux partis politiques, leur amateurisme et leur désorganisation ont favorisé, hier, la longévité des partis uniques, et assurent, aujourd’hui, la mésutilisation criminelle et incendiaire de la politique. Le renouveau du politique africain (gouvernants et oppositions) afin que la pluralité politique soit au service du vivre-ensemble, nécessite, dans un premier temps, une éducation aux règles et valeurs basiques du jeu politique qui sont celles « de respect [mutuel], d’Empathie, de Responsabilité, de Réconciliation[46] », d’esprit républicain et de patriotisme vrai. Cette éthicisation des politiques passe, dans un second temps, par l’éveil, l’engagement effectif et coordonné de sociétés civiles autonomes, intègres respectueuses des lois républicaines.
C’est à ce prix que nous parviendrons à « restituer à la pratique [politicienne] sa pleine dimension humaine » (Françoise SIRI, 2002, p. 59), et éviter ainsi que l’Afrique continue d’être le « continent en déperdition », le « continent foutu » ou le « continent maudit » dont le passé ne passe pas» (Jean PING, 2009, p. 9). Toute chose qui fera que la démocratie vraie[47] – le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple (Abraham Lincoln) – et non de façade qu’est celle des puissances occidentales, se possibilisera en Afrique même si l’avenir de ce système de gouvernance semble obscur. En d’autres termes, l’avenir appartient-il à la démocratie dans un contexte international miné par le terrorisme multiforme ?
Références bibliographiques
BECKER (Paula) et RAVELOSON (Jean-Aimé A.), Qu’est-ce que la démocratie, traduction de Rabary-Andriamanday Voahanitriniaina, Antananarivo, 2008
BOILEAU (Nicolas), Satires XI.
DEBBASCH (Charles), Le Parti unique à l’épreuve du pouvoir : les expériences maghrébines et africaines. Pdf disponible sur le net. Consulté le samedi le 12 décembre 2015 à 13h21
Dictionnaire Le Petit Robert
GAUMONT (Philippe), Prisonnier du dopage, Paris, Grasset, 2014
JONAS (Hans), Le Principe-Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, traduction de Jean Greish, Paris, Cerf, 1990.
LALANDE (André), Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, Quadrige/P.U.F, 2010
LAMARTINE (Alphonse de), Discours du 10 mars 1842, au banquet pour l’abolition de l’esclavage.
LOUCOU (Jean-Noël), Le multipartisme en Côte d’Ivoire, Abidjan, Editions Neter, 1992, 213 pages
KONÉ (Amadou), Les frasques d’Ébinto, Abidjan, CEDA-HATIER, 1980
PING (Jean), Et l’Afrique brillera de mille feux, Paris, Harmattan, 2009
RICOEUR (Paul), Le juste, Paris, Esprit, 1995
SOUARÉ (Issaka), Thèse de Doctorat soutenue à l’Université de Montréal en Juin 2010
SIRI (Françoise), Dopés : victimes ou coupables ? Dijon, Le Pommier, 2002
UNESCO et UNICEF, « Apprendre à vivre ensemble, Un programme interculturel et interreligieux pour l’enseignement de l’éthique». In http://www.ethicseducationforchildren.org. Consulté le vendredi 20 novembre 2015 à 21h17.
AXE 3 : REPLI IDENTITAIRE ET UNITÉ NATIONALE
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
10. L’interculturalité comme conceptualisation du vivre-ensemble,
VASSY Sylveira Tiburce…………………………………………….…………….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
VASSY Sylveira Tiburce
Philosophie politique et sociale.
+225 08725601/46476755
L’INTERCULTURALITÉ COMME CONCEPTUALISATION DU VIVRE-ENSEMBLE
RÉSUMÉ : La fin de la guerre froide avec la chute du Mur de Berlin marque la fin de la période des antagonismes idéologiques. Ce vent du changement a instauré un nouvel ordre des choses en ce qui concerne les relations entre États, entre peuples et entre cultures. Les nouveaux conflits sont identitaires car les oppositions se font sur fond du manque et du besoin d’affirmation. Cette nouvelle donne favorise la réflexion philosophique sur les problématiques culturelles conceptualisées par l’interculturalité. Qu’est-ce que l’interculturalité ? En quoi les compétences interculturelles favorisent-elles le vivre-ensemble ? C’est le lieu de montrer que l’acquisition de compétences interculturelles œuvre à la consolidation du vivre-ensemble dans un espace de diversité ethnique, culturelle, religieuse et politique.
Mots-clés : Culture, différencialisme, identité, interculturalité, vivre-ensemble,
INTRODUCTION
Il existe des mots dont la notoriété repose plus sur les valeurs qu’ils véhiculent que sur la signification claire et précise que l’on peut en avoir. Dès lors que la question de leur véritable sens se pose à nous, que nous nous rendons compte que ce que nous supposons véritablement connu n’est pas tout à fait connu. Cette méconnaissance se manifeste par des attitudes ambiguës et paradoxales face aux enjeux de ces mots. C’est pour cela, qu’il nous paraît absolument nécessaire de nous interroger sur les significations profondes des termes vivre-ensemble et interculturalité dans le cadre de notre étude afin de garantir, en plus des valeurs qu’ils représentent, une connaissance critique conséquente nous permettant d’être en phase avec leurs enjeux. Alors, en quoi consiste le vivre-ensemble dans une démarche interculturelle ? C’est le lieu de signifier ou de relever la nécessité d’acquérir des compétences interculturelles pour œuvrer à la consolidation du vivre-ensemble dans un espace de diversité identitaire. Il s’agit pour nous, d’orienter la réflexion philosophique vers « la diversité culturelle » pour enfin approfondir les arguments afin de combattre les préjugés qui font obstacles à la construction d’une nation de diversités participatives au vivre-ensemble en emmenant à une prise de conscience interculturelle pour une « citoyenneté multiculturelle » et démocratique, telle que propose Will Kymlicka (2001).
I-APPROCHE DÉFINITIONNELLE DE L’INTERCULTURALITÉ
On ne peut entreprendre aucun discours sérieux sur le concept d’interculturalité sans au préalable définir sa radicale culture. C’est à partir du terme culture que nous pourrons saisir l’orientation à donner à celui d’interculturalité.
Le terme culture est un substantif du verbe latin Colere (culture, embellir) qui donne le nom cultura en référence à la culture agricole. La culture n’aurait jamais quitté son sens premier de culture comme travail de la terre sans l’intervention de Cicéron qui l’associa à un autre terme : animus. Ainsi cultura animi, c’est-à-dire la formation morale et intellectuelle de l’individu, est devenu le jardin de l’âme, la culture de l’esprit. Cette belle métaphore donnera naissance au sens moderne du terme « culture », associant ainsi la connaissance au savoir, à la science, à l’éducation et à l’exercice des arts.
Cette nouvelle signification ouvre la voie à diverses interprétations selon les sciences et les théories scientifiques. Elle regorge différentes orientations parmi lesquelles nous retiendrons deux principalement. Une première, celle donnée par la sociologue Margaret Mead, et transcrite dans Le Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines. Elle définit la culture comme étant un ensemble historiquement et géographiquement défini des institutions caractéristiques d’une société donnée, qui désigne « non seulement les traditions artistiques, scientifiques, religieuses et philosophiques d’une société, mais encore ses techniques propres, ses coutumes politiques et les milles usages qui caractérisent la vie quotidienne » (Louis-Marie MORFAUX, 1980, p. 71). Cette approche fait une part belle à la conception sociologique de la culture ; une conception alors restrictive en ce qu’elle n’embrasse pratiquement pas les autres domaines de connaissances. Ce qui nécessite à notre niveau de nous tourner vers l’organisation mère en charge de la culture, l’UNESCO, pour en savoir plus.
À sa Conférence mondiale sur les politiques culturelles de Mexico en 1982, l’UNESCO a donné une définition qui fédère toutes les autres. Dans son sens le plus inclusif, la culture peut être définie aujourd’hui comme un :
Ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances » (1982).
Ainsi, la culture se définit comme étant le ressort permettant à l’homme de réfléchir sur lui-même. Elle fait de l’homme un être spécifiquement humain, rationnel, critique et éthiquement engagé. Par elle, nos valeurs et nos choix reçoivent du sens. C’est par elle que l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet inachevé et remet en question ses propres réalisations. La culture est partagée par les membres d’un groupe et permet à quiconque de les définir comme tel.
C’est donc à travers la culture que les hommes se distinguent entre eux car elle est l’élément fondamental dans la constitution de l’identité. De ce fait, la culture est devenue incontournable dans l’analyse de tous les phénomènes humains, qu’ils soient sociaux, politiques ou économiques. On peut dire sans se tromper qu’il est le phénomène principal du XXIeme siècle, autour duquel se définissent des épiphénomènes d’identité économique, politique et sociale dans une société. C’est en cela que Boris Buden pense que nous sommes à un tournant culturel aujourd’hui. Tout se définit à partir de la culture désormais parce que chaque société et, par voie de conséquence, chaque perception de la réalité politique, est bornée par une culture. Ce tournant culturel constitue le phénomène principal caractéristique de la condition ‘‘post-moderne’’. Les sociétés postmodernes font de la culture la fin de leur existence. Pour lui,
La culture est passée au premier plan comme condition même de la possibilité d’une société et de la réalité politique telle que nous la concevons aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle la démocratie, c’est-à-dire la quête de la liberté et l’égalité, de même la poursuite de la justice sociale, du bien-être etc. apparaissent aujourd’hui comme culturellement déterminées. (Boris BUDEN, 2006)
Toute chose qui emmène à comprendre l’enjeu de la culture et de la recherche interculturelle actuelle. La prédominance de la culture comme élément premier dans la constitution de l’identité favorise la mise en avant de la différence. Mais, une mise en avant qui rythme plutôt avec le rejet, l’opposition et une affirmation conflictuelle entre les identités. On dira que les cultures se posent en s’opposant. Jean-Paul Sartre avait déjà soupçonné cette recognition identitaire conflictuelle. À l’attention de ses compatriotes qui ont un comportement de méprise à l’égard des autres peuples et des autres cultures, il faisait cette analyse :
Mais il sera toujours temps de parler des différences. Ce qui sépare doit s’apprendre ; ce qui rejoint se voit en un clin d’œil. Cet homme qui vient vers nous, vous devez savoir sur l’heure si vous verrez en lui ‘‘d’abord’’ un Allemand, un Chinois, un Juif ou d’abord un homme. Et vous déciderez de ce que vous êtes en décidant de ce qu’il est (Jean-Paul SARTRE, 1954, p 12).
Cette attitude coloniale française est généralisée aujourd’hui. Lorsqu’un homme voit un autre, automatiquement il veut savoir si c’est un Allemand, un Chinois, un Juif ou un Noir. Pire, il se soucie de savoir si c’est un chrétien ou un musulman, s’il est de la gauche ou de la droite, etc., avant même de considérer que c’est un homme. Alors, comment définir l’homme de sorte que cette diversité ne se perçoive plus comme un obstacle à la préservation de l’espèce humaine, c’est-à-dire à sa liberté mais plutôt le fondement d’un vivre-ensemble pacifique ? C’est à cette problématique que la philosophie interculturelle tend à répondre.
À partir de cette approche de la notion de culture, de son importance et surtout des enjeux de son orientation actuelle, il est aisé de comprendre le concept d’interculturalité, sa problématique et ses enjeux. L’interculturalisme part d’un fait, afin de le dépasser en corrigeant ses effets fâcheux : le multiculturalisme. Le multiculturalisme ou le pluriculturalisme est au regard de la culture un fait sociétal. Aucune société n’est possible sans la diversité culturelle. Aucune société ne repose sur une culture unique, c’est-à-dire n’est monoculturelle. Toutes les sociétés sont multiculturelles. La multiculturalité se vérifie dans la rue, au travail, pendant les loisirs, à l’école, à la télévision, etc. Cette présence de différents groupes qui vivent plus ou moins paisiblement les uns à côté des autres, est une avancée positive vers une société plurielle et pluriculturelle. Mais elle n’est pas encore de l’interculturalité, mais plutôt du multiculturalisme. Alors, qu’est-ce que le multiculturalisme ?
Dans le multiculturalisme, le préfixe « multi » rappelle l’existence dans un même espace de plusieurs identités culturelles. « Le multiculturel est un concept opératoire propre à décrire et définir une situation sociale réunissant au sein d’une entité urbaine, régionale, nationale ou supranationale, plusieurs groupes communautaires » (Alexis NOUSS, 2005, p. 24). Peu importe que ces groupes communautaires soient « égaux en nombre et importance ou non, hiérarchisés ou non » (Alexis NOUSS, 2005, p. 24). Alors, faire cas du multiculturalisme, c’est en effet, constater et admettre simplement l’existence de différences, par ricochet, l’existence de différends dans une société. « Le multiculturalisme additionne des différences, juxtapose des groupes et débouche ainsi sur une conception mosaïque de la société. Ce modèle additif de la différence privilégie les structures, les caractéristiques et les catégories » (Martine ABDALLAH-PRETCEILLE, 2004, pp. 21-22), nous dit Abdallah-Pretceille. Elle nous montre ainsi le caractère passif et catégoriel du multiculturalisme.
Le multiculturalisme, dans certaines sociétés, use du concept de différence en le réduisant au différencialisme. Ainsi, la recherche d’une culture commune s’érige en maintien d’une situation hégémonique d’une culture sur les autres cultures que l’on juge moins conformes à la promotion des valeurs que l’on veut nationales. Ainsi par exemple, les étrangers doivent rester étrangers car les origines font la différence et leurs origines les condamnent à une condition permanente d’étranger. Le multiculturalisme admet la différence culturelle pour s’en servir comme motif pour ériger une d’entre elles en absolue. Les autres cultures ont inévitablement deux perspectives : s’assimiler ou disparaître. Ce qui revient au même, c’est-à-dire disparaître. Les différentes culturelles sont hiérarchisées et juxtaposées dans l’optique du maintien de l’ordre existant des choses. Ce différencialisme a pour conséquence l’exclusion, la xénophobie qui sont plus pratiquées et présentes dans plusieurs pays. Ce différencialisme culturelle et identitaire a connu des formes plus avancées dans l’histoire de l’humanité comme le nazisme allemand, la ségrégation aux États-Unis et l’apartheid en Afrique du Sud. Au nom d’une identité culturelle blanche les Noirs ont subi toutes les pires formes d’aliénation. Les juifs allemands sont emmenés dans les camps de concentration parce que ne respectant pas la pureté aryenne. Sommes-nous en marge et à l’abri d’un tel différencialisme dans nos différents pays? Ce serait prétentieux à notre niveau d’y répondre avec conviction. Mais, nous pouvons considérer que l’on n’est jamais assez sûr d’être à l’abri : d’où l’importance de l’interculturalisme pour construire et consolider le vivre-ensemble.
Le terme « interculturel » est apparu dans le vocabulaire et attesté que vers la fin du siècle passé. Il se compose, comme on le mentionne dans le Petit Robert du préfixe inter et du substantif à base adjectival culturel. Il concerne, les rapports et les échanges entre des cultures et entre des civilisations différentes. L’expression « dialogue des cultures » a fini à son tour par coexister avec le substantif interculturel sur lequel a été forgé depuis quelques décennies le néologisme interculturalité en usage dans différents domaines y compris celui de la philosophie.
Dans l’interculturel, on suggère que le préfixe « inter » indique que les identités acceptent de se rapprocher mais que chacune reste ce qu’elle est. Il indique une mise en relation et une prise en considération des interactions entre des groupes, des individus, des identités. L’interculturel est une notion qui sert à cerner les dynamiques de rencontre, d’échange entre deux ou plusieurs cultures ou communautés en contact. L’interculturel est une manière d’analyser la diversité culturelle à travers son contenu et ses pratiques. C’est donc avant tout une démarche, une analyse, un regard et un mode d’interrogation sur les interactions culturelles. Et c’est son caractère dynamique qui en constitue la spécificité. L’interculturel peut être compris comme une construction ouvrant à la compréhension des problèmes sociaux et éducatifs dans leur rapport avec la diversité culturelle. Il présente alors une visée éducative, ce qui est à distinguer de plusieurs autres concepts tels que le multiculturalisme et le pluriculturalisme. Il ne propose pas néanmoins des voies toutes tracées pour gérer la diversité culturelle dans toutes les circonstances, mais outille tout individu et toute société à faire face positivement aux différences identitaires.
L’avantage de l’interculturel est que les cultures non seulement cohabitent, mais interagissent. À cet effet, Carmel Camilleri explicite cette différence en disant que le multiculturel émerge quand des rencontres entre porteurs de systèmes culturels différents produisent des effets spontanés dans lesquels on n’intervient pas. On parlera par contre, d’interculturel lorsqu’apparaît la préoccupation de réguler les relations entre ces porteurs, au minimum pour réduire les effets fâcheux de la rencontre, mieux, pour les faire profiter de ses avantages supposés.[48]
De ce fait, célébrer la multiculturalité est devenu banal aujourd’hui parce que la simple présence de plusieurs cultures ne constitue en rien un avantage. Elle est même parfois source de conflits fratricides. Celle-ci se contente généralement de reconnaître la pluralité des groupes avec pour objectif d’éviter l’éclatement de l’unité collective. La multiculturalité ne remet pas en question les droits inégaux, les pouvoirs des uns sur les autres, la segmentation et les inégalités sociales. Pour que cet état de fait soit bénéfique il faut des relations dites interculturelles entre ces différentes cultures. L’interculturalité met en route une dynamique à l’issue incertaine certes, mais qui constitue un équilibrage des rapports de force dans une optique de démocratie et du vivre-ensemble.
La démarche interculturelle impose aux différents acteurs de se décentrer, de se mettre à la place des autres et de coopérer en toutes circonstances. Se décentrer consiste à jeter sur soi et sur son groupe un regard extérieur. L’objectif est d’apprendre à objectiver son propre système de référence, à s’en distancier, sans pour autant le récuser, et donc à admettre l’existence d’autres systèmes de référence. Ainsi l’on est capable de se mettre à la place des autres. Se mettre à la place des autres, c’est développer des capacités empathiques, c’est-à-dire des capacités d’identification et de projection de soi dans la culturelle de l’autre. Cela ne peut se faire qu’à la suite du deuil du caractère absolu de notre culture selon Paul Ricoeur. Ainsi, « nous avons à faire le deuil du fondamental et de l’absolu de la fondation historique : nous laisser raconter par les autres dans leur propre culture, c’est faire le deuil du caractère absolu de notre propre tradition » (2004, p. 19). Mais cela n’arrive pas de soi, sinon que, « la capacité à faire deuil doit être sans cesse apprise et réapprise » (Paul RICŒUR, 2004, p. 19). Ainsi, pour Paul Ricœur, toute démarche interculturelle commence avec la mise entre parenthèse du caractère absolu de toute culture.
Dans la même veine d’idée, Fornet-Betancourt définit le champ de la philosophie interculturelle. Il explique que l’anti‐centrisme de la philosophie interculturelle ne renvoie nullement à une négation ou à une déconsidération de l’environnement culturel propre et respectif. Bien au contraire, il insiste sur l’esprit critique qu’il convient d’avoir à l’égard de notre propre culture, sur le fait de ne pas sacraliser celle‐ci ni céder à ses tendances ethnocentriques. Il faut partir de sa propre tradition culturelle, en la considérant toutefois non pas comme une institution absolue, mais comme un lieu de passage vers l’intercommunication. (Raùl FORNET‐BETANCOURT, 2011, p. 43).
Pour cela, il est nécessaire de connaître un certain nombre de données quant à la grille de comportement à adopter. La diversité des cultures, avec son insaisissable croissance, son dynamisme et son pouvoir de transformation des individus et des sociétés, implique pour les individus comme pour les sociétés eux-mêmes, des compétences et des capacités spécifiques à désapprendre, à apprendre et à réapprendre pour parvenir à l’épanouissement personnel et à l’émergence d’un vivre-ensemble sincère.
II- COMPÉTENCES INTERCULTURELLES POUR UN VIVRE-ENSEMBLE VÉRITABLE
Le développement de compétences interculturelles répond au constat préoccupant de la prise en compte de la diversité culturelle. Mialy Henriette Rakotomena pose cette problématique en ces termes : « Si on considère que la diversité constituera le nouveau cadre dans lequel les organisations seront amenées à évoluer désormais, comment assumer cette diversité ? » (2005, p. 669). Ainsi, elle pose en termes clairs la nécessité du changement de paradigme par rapport à la gouvernance nouvelle de la société. En effet, pour elle, « La gestion des ressources humaines semble devoir suivre actuellement la succession rapide des évènements mondiaux au travers la considération progressive d’une compétence spécifique liée à la différence culturelle. Cette compétence est dite ‘‘compétence interculturelle’’» (Mialy Henriette RAKOTOMENA , 2005, p. 669).
L’aptitude à la compréhension d’autres cultures demande au préalable une meilleure conscience de sa propre identité culturelle, un esprit ouvert et pluraliste. Une culture qui mesure sans indulgence ses points forts et ses limites est à même d’élargir ses horizons et d’enrichir ses ressources intellectuelles et spirituelles en tirant des enseignements de conceptions épistémologiques, éthiques et esthétiques et de vision du monde autres que les siennes. Et cependant se pose toujours la question de la démarche à adopter pour parvenir à l’unité dans la diversité ou du moins, à vivre-ensemble par-delà la diversité, à travers une entière mise à contribution de la richesse culturelle. Le dialogue interculturel rencontre de ce fait de nombreux obstacles. Que faire ? La philosophie interculturelle envisage s’imposer dans ce XXIeme siècle comme le lieu d’une étude culturelle scientifique.
Ainsi, les compétences interculturelles peuvent être comprises comme des ressources auxquelles il est fait appel dans le cadre du dialogue interculturel. L’éclaircissement du sens de quelques concepts clés de la compétence interculturelle est quasi nécessaire dans notre démarche pour frayer le chemin nous menant à l’acquisition de ces compétences.
Ainsi, nous avons entre autres l’identité culturelle. Elle désigne les aspects de l’identité communs aux personnes appartenant à une certaine culture, qui, envisagés globalement, les distinguent des membres d’autres cultures. On remarque que l’identité culturelle ou simplement la culture est une construction. Elle n’est jamais fixe et immuable. Elle évolue dans le temps et dans l’espace. Ainsi, on peut en déduire qu’une culture n’est pas un fétiche à usage personnel et aux pouvoirs arrêtés et connus. C’est en cela que Sartre considère la culture et son contenu comme la responsabilité de ces porteurs passés, actuels et futurs. Il dit : « la culture c’est, à mon sens, la conscience en perpétuelle évolution que l’homme prend de lui-même et du monde dans lequel il vit, travaille et lutte » (1971, p. 152). Par conséquent, les significations passées, présentes et futures de chaque culture dépendent des hommes qui l’ont portée hier, ceux qui la portent aujourd’hui et ceux qui la porteront demain ; de ce qu’ils veulent en faire aujourd’hui et demain.
Alors ce processus d’auto-identification doit constituer un mécanisme d’humanisation de l’individu et du groupe, et non pas des usines de fabrication d’essences immuables (Raùl FORNET-BETANCOURT , 2006, p. 159). Elle doit permettre la meilleure socialisation de ces porteurs et éviter de constituer un moyen de différencialisme absolu. Elle doit évoluer et changer en se perfectionnant. Pour Xavier ALBO,
Les cultures sont vivantes, comme les hommes. Et, comme eux, leur continuité n’est pas statique mais dynamique. Bien que nous soyons toujours loyaux envers notre identité culturelle, personne d’entre nous ne vit encore sa culture comme nos grands-parents (2003, p. 29).
Pour dire que toute identité culturelle est un présent dépassé vers le futur. Sinon, toute identité culturelle statique est condamnée à sa mort, puisque « Les seules cultures statiques sont celles qui ont disparues ou celles qui sont dans les musées » (Raùl FORNET-BETANCOURT , 2003, p. 29). Ainsi, l’on comprend qu’une culture naît, grandit et meurt comme tout être vivant. Ajoutons à cela que l’identité individuelle comme collective est toujours multiple et mouvante. Cela veut dire qu’une personne appartient dans le même temps à plusieurs sphères culturelles. Christian Godin dira qu’« une personne est toujours plurielle », (2011, p. 19) et qu’en matière d’identité, « nous avons toujours affaire à une multiplicité » (2011, p.19). Ce qui conditionne et facilite tout individu ou toute culture au dialogue interculturel.
Le dialogue interculturel est à distinguer d’un simple processus de négociation qui en général à pour enjeux des intérêts politique, économique et géopolitique. Il s’agit ici d’un processus incluant l’échange ouvert et respectueux d’opinions entre des individus et des groupes différents par l’appartenance et le patrimoine ethniques, culturels, religieux et linguistiques, sur la base de la compréhension et du respect mutuels. Le dialogue interculturel contient l’aptitude à remettre en cause les certitudes bien établies fondées sur des valeurs et des croyances en mettant en jeu la raison, l’émotion et la créativité afin de parvenir à une nouvelle compréhension commune. Il y a dialogue interculturel chaque fois que des personnes de différentes identités culturelles se rencontrent. Il peut prendre un aspect solennel lors des rencontrent entre des personnes appartenant à des entités culturelles différentes pour des négociations. « Le dialogue interculturel est donc un outil essentiel pour résoudre les conflits interculturels de manière pacifique et la condition préalable du développement d’une culture de la paix » (UNESCO, 2003, p. 15), et du vivre-ensemble lorsqu’il participe à l’émergence d’une citoyenneté interculturelle.
La citoyenneté interculturelle désigne le nouveau type de citoyen dont le nouveau village mondial a besoin. Traditionnellement, un citoyen est celui qui remplit des devoirs et qui a des droits vis-à-vis d’un État ou un pays. Mais aujourd’hui, où le monde se rétrécit et où la compréhension de l’universalité progresse, une citoyenneté interculturelle est nécessaire. De même qu’un bon citoyen contribue à la grandeur de son pays en participant à sa construction et à sa protection, un citoyen interculturel compétent doit prendre en considération et respecter dans ses paroles, ses actes et ses convictions un contexte géopolitique et socioculturel toujours plus large. Tenir compte de l’impact de ses paroles, de ses actes et de ses convictions sur les personnes vivant dans sa propre sphère culturelle mais aussi et surtout sur celles des autres sphères culturelles et identitaires. Être un citoyen interculturel c’est s’engager à une responsabilité accrue à travers toutes nos interactions culturelles, qu’elle soit dans notre communication avec les autres ou dans nos actes quotidiens. Cela implique un véritable changement de paradigme nécessitant un nouvel alphabétisme.
L’alphabétisme interculturel; l’intérêt de cette formule est qu’elle suggère que, comme pour d’autres formes d’alphabétisme, un certain degré d’enseignement actif ou d’apprentissage par l’exemple est requis, mais pas nécessairement dans le cadre de l’éducation formelle. L’échange d’expériences, la conversation et la pratique font partie des moyens grâce auxquels les personnes appartenant à des groupes divers parviennent à se comprendre mutuellement. Un changement de paradigme est incontournable dans le processus d’acquisition de compétences interculturelles étant donné que chaque culture est consciemment et/ou inconsciemment considérée par ses porteurs comme le meilleur réservoir de valeurs. Il est naturel que chaque culture enseigne à ses membres que sa manière de faire les choses est la meilleure. En effet, qui voudrait appartenir à une culture reconnaissant comme supérieures d’autres manières de faire que la sienne propre ? Cependant, selon De Carlo, « la finalité à atteindre par un processus éducatif, consiste à sauvegarder sa propre identité culturelle et en même temps être prêt à se faire transformer graduellement par la rencontre et la fréquentation des autres » (1998, p. 119). Alors il est primordial de s’éduquer à l’interculturel afin d’éviter les effets fâcheux des rencontres interculturelles comme le rejet de soi dû à la perte de confiance à sa propre identité culturelle ; c’est le signe de l’aliénation culturelle et de déculturation profonde.
L’éducation à l’interculturel et le changement de paradigme qui s’en suit réconcilie l’individu avec sa propre culture, qu’il apprend à mieux connaître, et celle des autres qu’il est curieux de connaître dans un esprit de convivialité. De même, les relations interculturelles ne peuvent être toujours rationnellement compréhensibles. Il faut admettre le mystère qu’elles constituent et faire le deuil du fondamentalisme, nous dit Paul Ricœur. « Il faut accepter dans nos échanges culturels qu’il y ait de l’indéchiffrable dans nos histoires de vie, de l’irréconciliable dans nos différends, de l’irréparable dans les dommages subis et infligés » (2004, p. 19). Car l’histoire de l’humanité n’a toujours pas été parsemée de justice et d’égalité. C’est en admettant cette évolution avec ses injustices et en assumant notre responsabilité que nous pouvons envisager l’avenir dans de meilleures conditions : « Quand on a admis cette part de deuil, on peut se confier à une mémoire apaisée, au feu croisé entre foyers de cultures dispersés, et à la réinterprétation mutuelle de nos histoires et au travail à jamais inachevé de traduction d’une culture dans une autre » (Paul RICŒUR, 2004, p. 19). Pour dire que, le but de l’interculturalité consiste désormais à la prise de conscience de cette longue histoire de vie. Ainsi, la convivialité doit être établie comme un but recherché dans nos échanges interculturels car elle valorise le relationnel et l’harmonie. Elle place par conséquent l’interconnexion et l’interdépendance au-dessus de l’individualité et la rationalité. Elle devient le levier du pardon et de la réconciliation entre peuples.
Afin que cette réconciliation soit effective, il faille que les responsabilités respectives des parties prenantes soient assumées. Mais comprendre surtout que seul le mot pardon peut vraiment présider à cette réconciliation car aucune compensation, aucun autre mot ne peut réparer l’irréparable déjà accompli. L’humble pardon du bourreau et l’inépuisable devoir d’acceptation du pardon de la victime. Le pardon doit être réciproque lorsque tous sont à la fois bourreaux et victimes ; telle démarche favorise le vivre-ensemble dans la différence. Les personnes qui nous ressemblent le plus sont toujours les plus faciles à comprendre, mais c’est avec celles qui différent de nous que nous avons les échanges les plus fructueux, quoique parfois conflictuels. Antoine de Saint-Exupéry ne disait-il pas dans La Citadelle que si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser tu m’enrichis ? La nature humaine incite à explorer les différences et à apprendre de nouvelles choses. Demorgon Jacques trouve dans la multiplicité la cause de la créativité. Chez lui, s’il y a multiplicité de situations, « c’est parce que les humains sont semblables, à partir de leur liberté adaptative ; qu’ils sont différents puisqu’ils adaptent leurs réponses à leurs situations changeantes » (2009, pp. 49-57).Alors, l’interculturalité vient comme un moyen pour mettre à disposition du genre humain un plus grand éventail de solution pour faire face aux multiples défis de son existence, en coalisant ses ressources culturelles, pour un vivre-ensemble harmonieux.
CONCLUSION
La diversité culturelle et politique et le pluralisme religieux font désormais partie des réalités de notre monde contemporain. Les flux migratoires, accentués ces dernières années font de notre société, une société de plus en plus hétérogène. Cela pose, sous un nouveau jour, le défi de la cohésion sociale et des relations interculturelles harmonieuses. En ce sens, la connaissance de l’autre et le développement des compétences interculturelles citoyennes utiles à la vie en société sont définitivement des moyens à privilégier pour construire la cohésion sociale gage d’un vivre-ensemble pacifique.
BIBLIOGRAPHIE
CHEBEL, Malek et GODIN, Christian, Vivre ensemble. Éloge de la différence, Paris, Editions First-Gründ, 2011.
FORNET‐BETANCOURT, Raùl, La Philosophie interculturelle. Penser autrement le monde, Paris, trad. A. Kasanda, Les éditions de l’Atelier, 2011.
GOMEZ-MULLER, D’Alfredo (dir.), Sartre et la culture de l’Autre, Paris, L’Harmattan, 2006.
NOUSS, Alexis, Plaidoyer pour un monde métis, Paris, Textuel, 2005.
ABDALLAH-PRETCEILLE, Martine, L’Education interculturelle, Paris, PUF, 2004.
KYMLICKA, Will, La Citoyenneté multiculturelle : une théorie libérale du droit des minorités, Trad. P. Savidan, Paris, La Découverte, 2001.
DE CARLO, Maddalena, L’interculturel, Paris, CLE International, col. Didactique des Langues étrangères, 1998.
MORFAUX, Louis-Marie, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Paris, Armand Colin, 1980.
SARTRE, Jean-Paul, Situations, IX, Paris, Gallimard, 1971.
SARTRE, Jean-Paul, Situations, V, Colonialisme et néo-colonialisme, Paris, Gallimard, 1954.
ALBO, Xavier S.J., Culture-Interculturalité-Enculturalité, trad. Maite Vaquero&Elise Fleury, Caracas, Edition et Distribution Fédération Internationale de la Foi et Joie, 2003.
ALBO, Xavier S.J., Compétences interculturelles : cadre conceptuel et opératoire, Paris, UNESCO, 2013.
DEMORGON, Jacques « Complexités des relations culturelles dans l’histoire des pays et des pédagogies », in Synergies des pays Riverains baltique, numéro6, 2009.
Carmel CAMILLERI et Cohen-Emerique MARGALIT, Choc des cultures: concepts et enjeux de l’interculturel, Paris, L’Harmattan, 1989.
RAKOTOMENA, Mialy Henriette, « Les ressources individuelles pour la compétence interculturelle individuelle » in Revue internationale sur le travail et la société, Octobre 2005.
RICŒUR, Paul, « Cultures, du deuil à la traduction », in le monde, 25 Mai 2004.
Rapport de L’UNESCO, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles à l’issue de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles du 26 Juillet au 06 Août 1982.
BUDEN, Boris, « La Traduction culturelle : Pourquoi elle est importante et par où commencer. » Transversal/EIPCP multilangual webjournal. Under translation, 06/2006, Vienne, European institute for progressive cultural policies. Trad. Fr. de Lise Pomier. (En ligne : http ://eipcp.net/transversal/0606/buden/fr ;10/02/2016.
CAMILLERI, Carmel, cité par Rinetta Kiyitsioglou-Vlachou, in « culture et interculture : réflexions d’ordre didactique »,
www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/fr/kiyitsioglou_vlachou, consulté le 26/09/2013.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
11. Le Panafricanisme de Nkrumah et les Replis Identitaires,
GNAGNE Akpa Akpro Franck Michaël………………………………………….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
GNAGNE AKPA AKPRO Franck Michaël
Université Alassane Ouattara (Côte d’ivoire)
Email : fmgnagne@yahoo.fr
Le Panafricanisme de Nkrumah et les Replis Identitaires
RÉSUMÉ :
Comment peut-on vivre ensemble et bâtir des Nations, des peuples, et un continent africain forts, capables de relever les défis contemporains et ceux à venir dans un monde capitaliste où les intérêts économiques guident l’agir des uns et des autres, où les identités individuelles et souvent collectives sont de plus en plus brandies ; où chaque Nation prône sa souveraineté et où l’on assiste à des patriotismes exacerbés ? Nkrumah propose à l’Afrique une voie appropriée avec le panafricanisme. Il y a donc lieu, pour chaque individu et nation, de se surpasser pour se dépasser, en tant que particularité limitée, vers l’ensemble ouvert pour constituer l’Afrique afin de lui donner les ressources d’un développement autocentré. C’est la condition de « la survivance de l’Afrique libre, les progrès de son indépendance et l’avance vers l’avenir radieux auquel tendent nos espoirs et nos efforts,… » (Kwame NKRUMAH, 1994, p. 254).
Mots clés : Développement- Éducation à la Démocratie- Intégration africaine- Liberté- Nation- Panafricanisme- Unité- Repli identitaire-Vivre ensemble.
ABSTRACT : How can we live together and build nations, peoples, and a powerful african continent, able to take up contemporary challenges and those to come in the capatalist world where economic interests guide the behaviour of one and the other, where individual and sometimes collective identities are more and more brandished, where each nation laud its sovereignty and where people witness exaggerated patriotism ? Nkrumah suggests to Africa an appropriated way with Panafricanism. There is therefore a need, for each individual and nation, to excel themselves go out of their depth, as a limited particular nature, towards the opened cohesion in order to set up Africa to give to it resources of a autocentered development. It is the condition of « The surveillance of the free Africa, the progresses of its independence and the progress to the glorious futur to which our hopes and efforts are drawing tigh » (Kwame NKRUMAH, 1994, p. 254).
Keywords: Education for Development- democracy- Integration africaine- freedom- Nation- Panafricanisme- Unité- identity Repli-Living together.
INTRODUCTION
«Le monde dominé par les valeurs occidentales en général et par les valeurs américaines en particulier est confronté à un repli identitaire et culturel intranational, transnational et supranational dans une grande partie du monde, aux conséquences parfois catastrophiques»[49]. Cette situation est bien visible en Afrique.
En effet, lorsqu’on vient à porter un regard sur le continent africain, le constat est alarmant et bien triste. Notre Continent est violenté du dedans et du dehors par des crises de tout genre, des guerres ethniques, religieuses et tribales, des rebellions armées, des coups d’États militaires, des guerres territoriaux, des épidémies tel que (Ebola, Paludisme, Sida etc.). Il sert aussi de dépotoir aux Occidentaux qui y déversent des déchets toxiques pour contribuer à tuer ce qui y reste d’environnement naturel et social.
Cette situation dramatique est consolidée par les replis identitaires qui ne permettent pas au continent de se retrouver en lui-même dans une plénitude pouvant l’aider à se constituer pour pouvoir être. Ainsi, nous voulons interroger, dans la patience et la pertinence du concept, l’être et le devenir de l’Afrique qui est sur le point de s’échapper à elle-même. Nous le faisons avec la médiation du panafricanisme de Kwame Nkrumah dont nous nous reconnaissons dans l’idéal du Vivre ensemble et de développement de l’Afrique. C’est pourquoi, pour notre contribution à ce colloque, nous avons choisi de nous y intéresser à travers le sujet suivant : LE PANAFRICANISME DE KWAME NKRUMAH ET LES REPLIS IDENTITAIRES.
Quel est l’impact des replis identitaires sur le panafricanisme ? À partir d’une approche conceptuelle des notions de Panafricanisme et de repli identitaire, nous voulons montrer que les replis identitaires sont d’abord un obstacle au Panafricanisme. Ensuite, voir comment ces obstacles peuvent être surmontés afin que se réalise le Panafricanisme de Nkrumah. Enfin, montrer que le panafricanisme de Nkrumah peut contribuer efficacement au Vivre ensemble et garantir à l’Afrique un avenir satisfaisant.
La réflexion sur ces objectifs s’articulera autour des interrogations suivantes :
Peut-on réaliser le Vivre ensemble dans un continent en proie aux replis identitaires ? Existe-t-il une voie plus appropriée que celle du panafricanisme proposée par Nkrumah dès l’aube des indépendances ?
Pour notre part, le panafricanisme de Nkrumah est l’outil le mieux indiqué pour mettre fin aux replis identitaires, réaliser le Vivre ensemble et pour garantir le développement de l’Afrique. C’est bien dans ce canevas que s’inscrira notre argumentaire autour de cette réflexion.
Pour ce fait, nous utiliserons les méthodes historiques, analytiques et sociocritiques (qui nous permettrons de passer en revue l’histoire du panafricanisme, à analyser notre problème et nous qui de porter un regard critique sur notre sujet.
- LES CONCEPTS DE PANAFRICANISME ET REEPLI IDENTITAIRE
Il s’agira ici pour nous à partir d’une approche conceptuelle de tenter de comprendre le sens et la portée des notions de Panafricanisme et de Repli identitaire, soumises à notre réflexion.
- LE CONCEPT DE PANAFRICANISME
Une analyse du terme Panafricanisme révèle les mots Pan, Afrique et Isme à partir desquels on peut fixer son sens avec rigueur. Le préfixe Pan est un terme savant qui exprime à la fois l’idée de partie, de morceau, mais aussi d’un tout, d’un ensemble organisé. L’Afrique, de façon schématique, désigne un continent habité par des peuples divers ayant une histoire assez colorée. Quant au suffixe Isme, il évoque le caractère d’idéologie de ce à quoi il se rapporte. Par idéologie, on convient avec l’économiste français François Partant pour entendre un « ensemble d’idées, de doctrines, de valeurs, de croyances, qui explique en particulier l’organisation d’une société, qui justifie cette organisation et la fait accepter par tout le monde (ou par le plus grand nombre), parce qu’elle semble, sinon parfaite, du moins logique et dès lors inéluctable » (François, PARTANT, 1982, p. 115).
Ainsi, le panafricanisme est perçu comme «… l’idéolgie de la démocratie et des droits de l’homme dans un cadre fédéral africain» (Hubert KAMPANG, 2000, pp. 159-252) visant «…à réaliser le gouvernement des Africains par des Africains, en respectant les minorités raciales et religieuses qui désirent vivre en Afrique avec la majorité noire» (George PADMORE, 1961, pp. 27-471), il s’apparente au pangermanisme ou au panaméricanisme avec pour vocation de regrouper en un État unique toutes les populations de la même origine (noire). Selon Bwemba BONG, «L’œcoumène panafricain se définit comme étant l’espace géographique, mais surtout sociologique, constitué par l’Afrique et les nations nègres – ou d’ascendance négro-africaine – dispersées au monde par «yovodah» (2010, p. 18): un espace profondément imprégné de pratiques et institutions culturelles d’origine africaine » ( Bwemba BONG, 2010, p. 18). Le panafricanisme est de ce fait un mouvement de solidarité entre peuples noirs visant leur émancipation.
Le mot «panafricain» est apparu à la fin du XIXe siècle lors de la préparation de la Conférence panafricaine de 1900 (Kwame NKRUMAH, 1994, p. 160). Historiquement, l’idée se développe en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l’esclavage en Amérique. L’expansion du panafricanisme se retrouve dans les écrits et discours de quelques figures fondatrices, parmi lesquelles Edward Wilmot Blyden et Anténor Firmin (Kwame NKRUMAH, 1994, p. 160). Au début du XXe siècle, d’autres figures telles que Benito Sylvain ou William Edgar Burghart Du Bois contribuent à l’affirmation politique du projet panafricain. Avec la décolonisation, celui-ci prend une ampleur nouvelle et se retrouve incarné par des dirigeants africains tel que Kwame Nkrumah qui va le marquer de son empreinte ; d’où l’idée d’un panafricanisme politique de Kwame Nkrumah. Encore aujourd’hui, le panafricanisme s’exprime en Afrique, comme dans les anciennes puissances coloniales, dans les domaines politiques, économiques, littéraires ou encore culturels.
Selon le dictionnaire Larousse, le panafricanismeest une idée politique et un mouvement qui promeut et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains où qu’ils soient dans le monde[50]. Il vise à unifier les Africains du continent et de la Diaspora africaine en une communauté africaine globale. Il est à la fois une vision sociale, culturelle et politique d’émancipation des Africains. Le cœur de son principe est la croyance que les peuples d’Afrique et de la Diaspora partagent une histoire et une destinée commune et que leur progrès social, économique et politique est lié à leur unité. Son objectif ultime est la réalisation d’une organisation politique intégrée de toutes les nations et peuples d’Afrique (Kwame NKRUMAH, 1994, p. 162).
Le panafricanisme est l’unité d’une diversité de conceptions se rapportant à l’être des Africains et au devenir de l’Afrique. C’est bien ce que fait remarqué Bwemba Bong lorsqu’il affirme que :
Le terme « panafricanisme » recouvre des courants divers : Garveyiste, Négritude, afrocentricité, Consciencisme philosophique, Panafricanisme révolutionnaire, etc. ce sont autant de composants qui enrichissent l’idéal panafricaniste à différents moments de son histoire, loin d’être un problème, ces divergences de vue sont le fondement même de l’historiographie panafricaine en tant que discipline d’étude. Aussi, toutes ces composantes ont-elles un dénominateur commun qui se résume en deux idées majeures, à savoir : la question de l’unité, la question de la libération ; avec son subtratum, la désaliénation (2012, p. 4).
La désaliénation, c’est tout ce que vise le panafricanisme. Redonner à l’homme noir son droit d’eksister et son droit à l’existence et lui permettre d’en jouir. Par le panafricanisme en effet, le noir ou l’Africain retrouvera sa dignité ontologique (ce que le Lodjoukrou appel «Lewi», 1980), qui fait de lui l’égale des hommes d’autres races. Le noir redevient à partir du panafricanisme un Lewi. Égal à lui-même et aux autres, jouissant de toutes ces facultés spirituelles, morales, psychologiques et intellectuelles et répondant à ces droits et devoirs. Il redevient l’homme dans sa totalité, jouissant de la plénitude de son être. «Le panafricanisme s’analyse comme un mouvement révolutionnaire essentiellement politique ; il vise à détruire les bases de la domination impérialiste en Afrique et à réaliser l’unité du continent.» (Babacar SINE, 1983, p. 101).
- LE CONCEPT DE REPLI IDENTITAIRE
Le repli identitaire est un mot composé de repli et de identitaire à partir des quels on peut saisir son sens. Repli est un nom masculin qui désigne l’action de se replier, s’isoler, une retraite volontaire, sur des positions prévues ; une défense, un recul etc. On parle de repli des valeurs, replis des frontières etc.… c’est d‘ailleurs cette dernière qui nous intéressera le plus dans le cadre de notre analyse.
En effet, le repli des frontières est un fait réel qui suscite plusieurs interrogations. Pendant que l’humanité se constitue en de grand groupe, doit-on parler encore de repli de frontière ? Avec la mondialisation qui veut fait de la terre un village planétaire (Jean-Pierre WARNIER, 2003, p. 128), on assiste de plus en plus à la suppression des frontières. Cette idée même de village planétaire n’est-elle pas la représentation archétypale du vivre-ensemble ? Si le monde devient un village planétaire, cela ne signifie-t-il pas que tous les êtres humains forment déjà une communauté ? De ce fait, l’humanité ne suit t’elle pas la trajectoire d’une intégration florissante, gage de tout développement humain d’abord ?
Certes avec la mondialisation, nous sommes tentés d’affirmé que l’humanité tend vers un vivre ensemble harmonieux mais, dans les faits, mous sommes confrontés à toute une autre ralité. Réné Toko Ngalani pense avec Nkrumah que nous sommes dans un système impérialiste qui donne aux Occidentaux et leurs alliés notamment les États-Unis, la primauté, la supériorité, voir le monopôle sur le reste du monde. Plus tôt que de conduire l’humanité à des valeurs cosmopolites, la mondialisation est une véritable machine d’exploitation des plus faibles par les plus forts. C’est un véritable mécanisme de croissance d »inégalité et de violation des droits des personnes et des États. Le village planétaire qui met fin aux frontières, pose aussi le problème de la souveraineté des États.
Or, les États africains ne veulent pas céder leur souveraineté au profit d’un quelconque village planétaire, de surcroit d’une unité continentale. Ils conservent jalousement cette souveraineté à partir de laquelle, les dirigeants se permettent tout à leur profit sauf dans les intérêts de leur peuple souverain. Une souveraineté acquise à de grand prix, souvent suite à des luttes acharnées. Tel, le cas des indépendances. C’est bien ce que fait remarquer Sangaré Abou. Pour lui en effet, L’indépendance est :
Le plus souvent acquise des suites de hautes luttes. Le drame, c’est que la plupart des mouvements révolutionnaires et des régimes politiques qui ont combattu pour acquérir l’indépendance, perdent leur prestige dans la gestion des affaires publiques de leur pays, tant ils se retournent contre les idéaux, les principes et les valeurs pour la promotion desquels ils ont combattu. Ils se comportent comme s’ils avaient un rapport ontologique à la souveraineté absolue. Ils n’arrivent pas à l’adapter aux réalités mondiales. [51]
Les États africains en refusant de céder leur souveraineté, se livrent à la merci de leurs dirigeants qui abusent d’eux. Ils se ferment au monde en se renfermant sur eux. De ce fait, ils sont coupés de toute réalité de ce monde et de toute voie de progrès et de développement. En refusant de s’ouvrir, les États africains signent leur arrêt de mort. Jean-Claude Barreau le fait remarquer bien. Il écrit à cet effet que, «lutter contre la mort, c’est d’abord s’ouvrir…. Lutter contre la mort, c’est faire l’expérience de l’autre.» (Jean-Claude, 1969, p. 75) Il n’en (est pas le cas chez pour les États africains. Ils refusent de s’ouvrir aux autres États africains et aux restent du monde. Ce qui justifie la misère de l’Afrique et son retard sur le reste du monde. Comme on peut le voir, le repli en général et particulièrement celui des frontières est catastrophiques et ne peut être salutaire à l’Afrique et au restent du monde.
Quant à identitaire, c’est ce qui est relatif à l’identité (d’une personne, d’un groupe). Identitaire vient de identité et se rapporte au caractère de ce qui est identique, similaire, qui est en accord, qui coïncide et incarne l’idée de communauté.[52] C’est aussi ce qui marque la différence entre les hommes, individus et les sociétés. La différence est essentiellement ce qui fait la particularité d’une chose, d’un être et qui le distingue des autres. Identitaire, s’apparente à l’identité or, l’identité c’est la différence, le caractère intrinsèque, ontologique d’une chose, d’une personne, individu, d’une communauté, d’une société.
Dans la dynamique des cultures et des sociétés, la différence peut être qualitative, c’est-à-dire qu’elle peut avoir affaire au genre et aux nuances physiques ; ou elle peut être quantitative, c’est-à-dire qu’elle a affaire au nombre et à l’influence des peuples les uns sur les autres. Dans l’un ou dans l’autre de ces cas, elle peut être source de crise et de conflit, mais aussi, d’enrichissement et de complétude, pourvu que les individus et les peuples puissent en faire bon usage. Comment cette question est abordée en Afrique ?
L’Afrique est une entité dynamique au sein de laquelle se meuvent de multiples et diverses sociétés, États et cultures. En tant qu’une diversité unifiée, elle se construit sur la base de la confrontation de ces diverses cultures et des États dans leur différence. Si la vie humaine est marquée par la différence, il n’en est pas moins en Afrique. L’Afrique à l’image de ces États a cette particularité d’être encrée dans ses traditions et dans sa façon d’être, et cela de manière à s’isoler et à rester cloitrée dans sa zone de confort sans envisager d’en sortir. « L’Afrique est d’une façon générale le pays replié sur lui-même et qui persiste dans ce caractère principal de concentration sur soi » (HEGEL, 1965, p. 158). Cette affirmation de Hegel, consignée dans la Raison dans l’histoire, traduit à la fois l’enfermement ainsi que le refus de sortir de soi du continent. L’enfermement et le refus d’ouverture sont les bâtons qui l’empêcheraient de se déployer, de se développer et de s’affirmer. Ce constat est sans doute le reproche le plus fréquent et le plus évident qui puisse être adressé à l’Afrique. En effet, après le soleil des indépendances, une lueur d’espoir est survenue sur le continent. Malheureusement, pendant que l’on s’attendait à une manifestation plus noble de la part des États qui consisterait à sortir de soi pour atteindre l’idéal d’unité gage de la survie du continent, ceux-ci ont opté pour leur souveraineté aux dépends de celle du continent.
La singularité et la spécificité de l’Afrique dans ce monde jouent un rôle déterminant dans l’élaboration et la construction de son identité et dans l’amorce d’un développement harmonieux du continent. Le rôle qu’elles y jouent dépend essentiellement de la façon d’être des individus et des peuples africains ainsi que leur façon d’appréhender leur différence vis-à-vis des autres. Cette différence peut avoir des conséquences constructives ou destructives selon que les peuples et les cultures qui s’en servent. Mais, en Afrique, cette différence est au fondement de presque toutes les crises. Voyons comment elle peut être source de conflit ? Et en quoi est-elle un obstacle au panafricanisme ?
- LES REPLIS IDENTITAIRES COMME OBSTACLE AU PANAFRICANISME
Lorsque la nécessité de s’unir gagna l’ensemble du continent ; au moins par idéal, il sembla que les Africains se soient attachés au panafricanisme. Mais au moment de passer à la concrétisation du rêve et d’organiser des unions entre États, des dissensions idéologiques apparurent. Les États n’étaient pas tous d’accord sur la forme et la nature de l’union à adopter parce qu’ils voyaient en celles-ci la voie par lesquelles ils perdraient leur souveraineté nouvellement acquise.
Un clivage se dessina, manifeste dans l’ensemble des rassemblements sous régionaux créés entre 1958 et 1963 et dans les bases de l’Organisation de l’Unité Africaine. À cet égard, l’unité gouvernementale proposée par Nkrumah fut loin d’emporter la majorité, son projet tomba peu à peu en désuétude.
Cependant, relativement à la forme du panafricanisme, deux conceptions s’affrontaient, sans toutefois être en complète opposition : le continentalisme et le régionalisme. Au sujet la nature du panafricanisme, certains et notamment Nkrumah, prônaient le supranationalisme ; d’autres se contentaient d’une simple coopération, moyen par lequel ils garderont toujours leur souveraineté[53].
Pour ce qui concerne la forme, nous aurons d’une part, Nkrumah qui fonde sa pensée politique sur le continentalisme. Et cela s’aperçoit à travers cette pensée :
Néanmoins, je suis persuadé que les forces qui nous unissent font plus que contrebalancer celles qui nous divisent. Quand je rencontre d’autres Africains, je suis toujours impressionné par tout ce que nous avons en commun. Ce n’est pas seulement notre passé colonial, ou les buts que nous partageons : cela va beaucoup plus profond. Le mieux est de dire que j’ai le sentiment de notre unité en tant qu’Africains. ( Kwame NKRUMAH, 1994, p. 159).
Cette pensée de Nkrumah laisse voir sa conviction politique ainsi que sa conception du panafricanisme. En effet, Kwame NKrumah envisageait certes l’union des États africains comme un moyen de libération du continent, mais également comme un moyen de parvenir au développement économique. Raison pourquoi, il opte pour une union à l’échelle continentale.
Nkrumah considérait que les forces qui unissaient les Africains dépassaient les obstacles que constituaient pour certains les diversités culturelles et linguistiques.
Par ailleurs, Cheikh Anta Diop pensait au contraire l’évidence de l’unité culturelle de l’Afrique. L’organisation de la famille, l’organisation de l’État, les conceptions philosophiques et morales étaient communes à l’ensemble des africains «(…) découlant d’une adaptation similaire aux mêmes conditions matérielles d’existence.» (Cheikh Anta DIOP, 1974, p. 40). C’est cette communauté culturelle que Senghor qualifiait d’ «africanité»;elle justifiait une organisation commune à l’échelle du continent et notamment la création d’un Marché Commun africain qui permettrait de regrouper les ressources et de définir une politique commerciale commune à l’égard des étrangers.
D’une manière générale, les Africains étaient attachés à l’idéal d’un continent uni. Plusieurs Constitutions en témoignaient et notamment celle de la Guinée, de la Tunisie, du Mali, prêtes à sacrifier leur souveraineté individuelle au profit de l’unification générale de l’Afrique. (Cheikh Anta DIOP, 1974, p. 176). Toutefois, le continentalisme heurtait de front le courant régionaliste.
Toutefois, régionalisme et continentalisme n’étaient pas en opposition absolue. Nkrumah notamment, malgré son attachement au continentalisme, considérait que le régionalisme était une première étape, voire un moyen de réaliser l’union à l’échelle du continent. (Cheikh Anta DIOP, 1974, p. 175).
Comme on peut bien le voir, Nkrumah envisageait l’unité de l’Afrique sur le plan continental c’est-à-dire avec un marché commun extérieur, une diplomatie commune, une taxe douanière, une force africaine, une économie commune, une monnaie commune, un représentant commun à l’O.N.U, un parlement commun etc… Il envisageait une unité selon le modèle américain, c’est-à-dire le fédéralisme, dans lequel chaque État est souverain. Mais, ce modèle sur le plan diplomatique aurait une voie commune. Il serait à cet égard contrait au régionalisme qui perpétue le système Balkan des impérialistes, en mettant en retard le contient sur le plan de l’intégration économique et politique et, par contrecoup, affaiblit le continent sur le plan diplomatique. (Cheikh Anta DIOP, 1974, pp. 236-245).
Cependant, la politique de sous régionalisation qui sera rappelée dans plusieurs des actes de l’OUA avait essentiellement pour but ultime l’intégration du continent dans une vaste communauté africaine à travers un processus progressif. Cette intégration qui est multisectorielle était divisée en quatre secteurs : intégration économique, intégration politique, intégration sociale et intégration culturelle (Kwame NKRUMAH, 1994, pp. 177-200).
Dans cet ordre d’idée, par sa résolution CM/464 (XXVI) l’OUA divise l’Afrique en cinq (5) grandes sous régions : Afrique du Nord, de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Sud et chacune de ces régions doit s’intégrer dans une seule organisation sous régionale. Les dissensions se sont manifestées de manière plus forte au sujet de la nature de l’union.
Cependant, le fédéralisme de Nkrumah devait posséder des pouvoirs supranationaux. En effet, il faut préciser qu’une organisation «super étatique» ou «supranationale» est : «une organisation pourvue de pouvoirs réels de décision non seulement à l’égard des États membres mais aussi à l’égard des ressortissants de ces Etats.» (Guillien. R et Vincent. J, 1995, pp. 391-583) Cela signifiait que les États devaient opérer un transfert de pouvoirs et de compétences souveraines au profit de l’union. Les populations et les ressources devaient être mises en commun pour se protéger du colonialisme qui, selon le leader ghanéen, revenait sous forme déguisée.
L’union continentale était indispensable pour construire un système économique et social fort comparable à celui des pays les plus avancés. Cela passait par la création d’un Marché commun à l’échelle de toute l’Afrique, nécessaire au développement de l’économie et des moyens de transport ainsi qu’à l’exploitation des richesses agricoles et minérales. Ceci, dans le cadre d’un gouvernement unifié des Etats africains qui aurait besoin d’une monnaie unique, d’une zone monétaire et d’une banque centrale d’émission. (Kwame NKRUMAH, 1994, pp. 248-254).
En outre, les stratégies militaires et de défense devaient être unifiées afin de protéger le continent en contre toute attaque d’un État particulier. Un fondement politique commun était ainsi nécessaire, selon Nkrumah pour l’unification des politiques de planification économique, de défense et de relations diplomatiques avec l’étranger. (Kwame NKRUMAH, 1994, pp. 248-254).
La majorité des chefs d’État africains se sont opposés au projet de Nkrumah au nom de la prudence et du réalisme. Ils considéraient que les solidarités qui les unissaient n’étaient pas assez fortes pour créer une organisation supranationale. D’une manière générale, la supranationalité et l’idée de fédération (même au niveau régional), emporta peu de succès. Les chefs d’États ont préféré majoritairement s’entendre sur une simple coopération, laissant intactes les souverainetés.
L’euphorie des indépendances avait détourné les nouveaux dirigeants post coloniaux de toute vision prospective d’une Afrique unie, solidaire et plus forte pouvant s affirmer dans les relations internationales. Dans le contexte de la guerre froide, marqué par des enjeux de puissance et de domination, Les Chefs d’Etats ont préféré majoritairement œuvrer pour le développement de la coopération entre une époque où la plupart des Etats africains venaient d’accéder à l’indépendance, la force du nationalisme naissant constituait un obstacle insurmontable pour tout projet à vocation supranationale. C’est ce qui amène Yves Person à dire que « Les indépendances africaines ont consacré la fin du panafricanisme» (Jérome SANOU, 1977, p. 22) et Vladimir Diodioa fait remarquer que « Chaque État essaie de balayer devant sa propre porte avant de balayer devant celle des autres » (Vladimir DIODIO, 1976, p. 73).
Chaque État s’engageait donc dans l’entreprise de construction nationale en suivant le modèle de l’État Nation hérité de la période coloniale. L’expérience a prouvé que ce choix n’était ni judicieux ni réfléchi En effet, la construction de l’État- Nation sur un espace flou et exigu, au détriment d’un minimum d’unité à l’intérieur d’aires géographiques et culturelles semblables, s’était avéré lourd de conséquences, non seulement pour cet État lui-même, mais pour l’ensemble du continent ( Ahmed Mahamed GHADI, 2009, p. 23). L’État-Nation africain est aujourd’hui, face à lui-même et face à la communauté internationale un échec. Les unions sont donc restées pour la plupart au stade d’une coopération politique, économique, sociale ou culturelle, souvent technique autour des transports ou de l’éducation. C’est ce que fait remarquer Yacouba Zerbo lorsqu’il affirme:
En refusant d’accomplir l’acte qui consacre l’indépendance véritable, les nouveaux responsables africains ont ouvert la voie au néo-colonialisme, c’est-à-dire la coopération. C’est pourquoi, déclarait le général de Gaulle : “Nous avons changé la colonisation en coopération parce que l’objet de la colonisation qui était de créer pour la métropole des zones d’influences politico-économiques et d’assurer le rayonnement de la civilisation métropolitaine était sauvegardé par la coopération” (2003, p. 117).
Ainsi, la supranationalité a été rejetée en raison de solidarités que les chefs d’Etats africains ne considéraient pas assez fortes pour créer une organisation super étatique. Contrairement à Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop qui envisageaient l’unité du contient à partir de ses différentes cultures, les leaders africains considéraient que les disparités, tant culturelles que démographiques et économiques, étaient trop imposantes.
Enfin, il ne faut pas nier l’influence de la politique des anciennes puissances coloniales, qui fit obstacle, selon Lansiné Kaba et Philippe Decraene, à la réalisation de l’unité de l’Afrique.
Les anciennes métropoles n’auraient pas eu intérêt à l’unification des États africains dans la mesure où il était plus facile de traiter avec des États pris individuellement plutôt qu’avec un ensemble unifié. À cet égard, la Grande Bretagne et la France du général De Gaulle furent accusées d’opposition respective à l’institutionnalisation de la fédération Est-africaine ainsi qu’à l’idée de constitution des fédérations de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F) et de l’Afrique Equatoriale Française (A.E.F.) ( Kwame NKRUMAH, 1994, p. 170) ; l’ancienne administration coloniale (Française et Anglaise) étant réticente, selon Lansiné Kaba, aux fédérations africaines qui, plus fortes que les États individuels, pouvaient lui échapper.
Au regard de ces différentes raisons, les États devenus souverains, ont résisté à toute politique d’intégration ; les différents rassemblements sous régionaux et régionaux tenues dans les années soixante l’illustrèrent ce fait. Malgré tout, la voie vers la réalisation de l’unité africaine s’est ouverte et tout semble indiquer que l’idéal panafricain se réalisera.
En effet, le nombre d’organisations sous régionales dans les années soixante révélait le désir des États africains de s’unir. Mais les obstacles étaient trop nombreux. Ces unions furent souvent inefficaces et parfois échouèrent.
Ces obstacles étaient les mêmes à la veille du sommet d’Addis-Abeba instituant l’Organisation de l’Unité Africaine. Les clivages idéologiques quant à la forme et la nature de l’unité continentale s’exprimèrent à haute voix, mais l’urgence et la gravité de la situation politique africaine permirent d’aboutir au consensus.
- L’INTÉGRATION AFRICAINE ET LA RÉALISATION DU PANAFRICANISME
Le panafricanisme est une idée noble qui peut se réaliser et contribuer efficacement au devenir du continent africain. Mais comment ? Et à partir de quoi ?
Conscient du fait qu’une théorie sans pratique est vaine, et que le panafricanisme est un projet théorique, Nkrumah propose le consciencisme comme démarche pratique dans la réalisation du panafricanisme. Pour mieux saisir sa méthode, interrogeons nous sur ce que c’est que le consciencisme. Qu’est ce que le consciencisme ? Comment se présente t-il ? En quoi peut-il permettre la réalisation effective du panafricanisme en Afrique ?
Le Consciencisme se définit comme «l’ensemble, en termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettront à la société africaine d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu’ils s’insèrent dans la personnalité africaine. Celle-ci se définit elle-même par l’ensemble des principes humanistes sur quoi repose la société africaine.» (Kwame NKRUMAH, 2009, p. 98).
Comme on peut bien le voir à partir de cette définition, le Consciencisme est cette doctrine philosophique conçu par Kwame Nkrumah, d’abord comme preuve de l’existence d’une pensée africaine, ensuite comme contribution à l’émergence de cette pensée ou philosophie africaine, enfin comme moyen d’un vivre ensemble harmonieux à partir d’une intégration florissante qui puise ses sources et ressources dans nos valeurs culturelles africaine, gage de tout développement. Il est «la prise de conscience de l’homme colonisé, dans une situation d’oppressé, d’où la nécessité de s’en défaire» (Jean Gobert TANOH, 2015, p. 85).
En effet, à partir du consciencisme, Nkrumah met l’accent sur la pensée comme fondement, comme base de tout cheminement et de l’organisation de toute société humaine qui veut se fait une place dans le concert des Nations. «…Le consciencisme philosophique, soutient philosophiquement un projet culturel : la réalisation de l’unité africaine, une nouvelle entreprise de la repersonnalisation africaine.» (Babacar SINE, 1983, p. 101).
À partir de cette idée, Nkrumah veut aussi interpeller la société africaine sur l’importance de l’éducation. L’éducation, en tant que « Mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain, avec pour objet non seulement le développement intellectuel c’est-à-direl’instruction, mais encore la formation physique et morale, l’adaptation sociale… à partir de Système ou de traité d’éducation. » L’éducation est, donc pour Nkruamh, le socle de tout développement. C’est à travers lui que Nkrumah compte intégrer les États africains. Pour lui, l’éducation est le vecteur de la prise de conscience. Seule l’éducation peut éclairer sur l’enjeu de l’assimilation des éléments Occidentaux, musulmans, eurochrétiens dans la construction de la personnalité africaine.
C’est bien à cela que répond le consciencisme, c’est pourquoi Nkrumah le définit comme « …l’ensemble, en termes intellectuels… » ; Or, l’intellectuel, c’est celui qui a été à l’école, a suivi une formation et a été inséré dans la société pour faire² valoir ce qu’il a appris. C’est celui qui possède l’instruction et est amené à le diffuser par l’enseignement. Nous dirons avec Platon que c’est celui qui a vu la lumière et qui est appelé à le faire découvrir aux autres. De ce fait, en fondant le consciencisme sur l’agir « intellectuel », Nkrumah veut montrer que le développement de l’Afrique passe nécessairement par l’éducation en tant que système et l’intellectuel devient donc acteur de ce système qu’il maîtrise et qui doit être le porte flambeau de ce développement. C’est lui qui doit sensibiliser la masse sur les principes qui fonderont un vivre ensemble profitable à l’ensemble de la société africaine et du continent tout court, mais aussi les sensibilisés sur l’importance de s’ouvrir aux autres et au monde. Mais, surtout de s’ouvrir à soi. Car, s’ouvrir à soi permettra de mieux s’ouvrir aux autres.
Comme nous pouvons le constater, le consciencisme se veut une pyramide à trois échelles : éducation/formation, ouverture et intégration (assimilation). En se présentant ainsi, le consciencisme se pose comme base ou fondement pratique de l’unité du continent c’est-à-dire du panafricanisme. Il est en termes pratique, l’organigramme qui structurera la société africaine dans son mode et son fonctionnement. Et, c’est de cette organisation que découlera la stabilité même de l’Afrique. En effet, le panafricanisme en tant que projet politique et purement théorique, ne peut voir le jour sans l’éducation de la masse, la sensibilisation des Hommes politiques, l’éducation à la bonne gouvernance et à la démocratie et à l’éthique, aussi sans une ouverture des États et des citoyens au sein du continent et à l’égard des autres peuples vivants sur le continent et ailleurs et enfin sans une véritable intégration. C’est bien ce que se propose le consciencisme. En plus d’être une arme d’intégration, le Consciencisme est aussi et surtout chez Nkruamh le moyen de la réalisation des États-Unis d’Afrique. C’est surtout cela, l’enjeu du consciencisme.
Par ailleurs, Cheikh Anta Diop dans son ouvrage Les fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique Noire, insiste sur la construction d’un État fédéral d’Afrique. Pour arriver à cet État, Diop pose l’Intégration africaine comme la condition sine qua non de l’Unité politique, culturelle et économique de l’Afrique. À partir cette intégration africaine, les nombreux problèmes de migrations en Afrique subsaharien auront gain de cause.
En effet, l’intégration favorise «…une valorisation de la perception de l’étranger du migrant dans l’espace principal des mouvement des populations » (Pierre, KIPRE, 2010, p. 105). Ainsi donc pour une meilleur stratégie d’intégration régionale telle que prôné par Ckeihk Anta Diop, Pierre Kipré pense que :
La politique des migrations doit être une politique régionale fondée sur les actions régionales de proximité (par exemple l’aménagement concerné et conjoint des hommes de frontière) et visant à fixer les populations migrantes fragilisées par l’inadaptation de leur espace de vie et de leur méthode de production. Cela suppose avec des compétences supranationales, d’abord la crédibilité des institutions chargées de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. (Pierre KIPRE, 2010, 106).
Seule à ce prix que l’intégration africaine sera une réalité et contribuera efficacement à résoudre les problèmes africains de développement.
CONCLUSION
L’enjeu fondamental du panafricanisme ou des États-Unis d’Afrique est l’intégration économique, culturelle, sociale et enfin politique de l’Afrique. À l’heure de la mondialisation, au moment où le monde parle en termes de grands ensembles et même de «grand village planétaire», et où la notion d’État est complètement précarisée par rapport aux grands ensembles, l’Afrique ne peut plus s’offrir le luxe de prétendre au développement dans les micros entités, exiguës que sont nos États. L’Afrique doit penser à un grand ensemble qui, comme l’a dit Nkrumah, pèsera véritablement sur le plan international.
En effet, le but ultime du panafricanisme ou des États-Unis d’Afrique est de lutter contre la balkanisation de l’Afrique avec une suppression des frontières issues de la colonisation afin d’arriver à une unité du continent, berceau de l’humanité. Pour ce fait, il faut mettre fin aux replis identitaires qui entraves la réalisation de ce merveilleux projet, par l’expérience de l’altérité, qui consiste à s’ouvrir. C’est à ce prix que l’Afrique réussira le pari de sa survie et répondre aux exigences du développement durable.
BIBLIOGRAPHIE
Anta Cheikh DIOP, Civilisation ou Barbarie, Paris, Présence Africaine, 1981. 472 pages.
Anta Cheikh DIOP, Les fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique Noire, Paris, Éditions. Présence Africaine, 1974, 124 pages.
Bamba ASSOUMAN, Thèse Unique de Doctorat, soutenue publiquement le 30 Janvier 2007, à l’Université de Cocody, Abidjan, p. 19.
Babacar SINE, LE MARXISME , devant les sociétés africaines contemporaines, Paris, Présence africaine, 1983, 210 pages.
Bwemba BONG, quand l’Afrique était l’or noir de l’Europe, Paris, Édition Anibwé, 2010. pages 242.
David Musa SORO, L’intégration, condition de la paix et du développement en Afrique, Abidjan, Les Éditions Balafons, 2011, 118 pages.
François PARTANT, La fin du développement, naissance d’une alternative ? Paris, François Maspero, 1982.
George PAMDORE, Panafricanisme ou communisme ? La prochaine lutte pour l’Afrique, Paris, Présence africaine, 1961, 471 pages.
G. W. F. HEGEL, La Raison dans l’Histoire, traduction nouvelle, introduction et notes par KOSTAS PAPAIOANNOUA, Paris, Union générale d’édition, 1965, 312 pages.
Hubert KAMPANG, Au-delà de la Conférence nationale pour les Etats-Unis d’Afrique, Paris, l’Harmattan, collection Afrique, 2000, p159, pages 252.
Jean-Claude BARREAU, Où est le mal ? Paris, Seuil, 1969. Pages 111.
Jean Gobert TANOH, LA FRANÇAFRIQUE COMME PERVERSION D’UNE INTUITION, Réflexion sur la colonisation positive, Paris, les Éditions du Panthéon, 2015, 202 pages.
Kwame NKRUMAH, l’Afrique doit S’Unir, Paris, Présence Africaine, première édition 1964, dernière édition «Collection Panafricanisme», 1994, 266 pages.
Kwame NKRUMAH, Le Consciencisme, Paris, Présence africaine, première édition 1976, dernière édition «Collection Panafricanisme», 1976, 146 pages.
Ligue Panafricaine UMOJA, le Panafricanisme en quelques questions, livret n°3, collection LPU, Yaoundé, septembre 2012.
Pierre KIPRÉ, MIGRATIONS EN AFRIQUE NOIRE, la construction des identités nationales et la question des étrangers, Les Éditions du CERAP, Abidjan, 2010, 162 pages.
Sous la Direction de David Musa SORO, Propos d’intégration, Abidjan, Les Éditions Balafons, 2011, 180 pages.
WEBOGRAPHIE
Abou SANGARE, « La ruse de la raison dans les relations internationales », in Implications philosophiques, Revue internationale de philosophie, (en ligne), consultée en Juin 2015 sur www.implications-philosophiques.org.
Francis AKINDÈS «Le lien social en question dans une Afrique en mutation», Article publié dans l’ouvrage sous la direction de Josiane Boulad- Ayoub et Luc Bonneville, Souverainetés en cri se, pp. 379- 403. Collection: Mercure du Nord. Québec: L’Harmattan et Les Presses de l ‘Université Lava l, 2003, 569 pp.
Lucien AYISSI «Le problème du vivre-ensemble entre le même et l’autre dans l’État postcolonial d’Afrique noire», in QUEST: An African Journal of Philosophy / Revue Africaine de Philosophie XXII: 121-140.
Yacouba ZERBO, «La problématique de l’unité africaine » (1958-1963), Guerres mondiales et conflits contemporains, 2003/4, n°212, p.113-127. DOI: 10.3917/ gmcc. 212. 0113.
«Défis identitaires et culturels en ce début du 21ème siècle», in RÉSEAU MULTIDISCIPLINAIRE D’ETUDES STRATÉGIQUES 21 janvier 2008, RMES/NA/2008/03, p. 3.
DICTIONNAIRES, REVUE ET MÉMOIRE
Dictionnaire Larousse, définition de Panafricanisme: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/panafricanisme/57545 [archive].
«Défis identitaires et culturels en ce début du 21ème siècle», in RÉSEAU MULTIDISCIPLINAIRE D’ETUDES STRATÉGIQUES 21 janvier 2008, RMES/NA/2008/03, p. 3.
Le lexique de Guillien R. et Vincent J., Termes juridiques, Paris, Dalloz, 1995.
Le Grand Robert de la Langue française, version électronique, deuxième édition dirigée par Alain REY du Dictionnaire Analogique et Alphabétique de la Langue française de Paul ROBERT.
Jérôme SANOU, Les résolutions de l’OUA, Mémoire de Maitrise, Université du Bénin, Lomé, 1977.
Vladimir DIODIO, Revue française d’étude africaine, no37, Paris, Janvier 1976.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
12. Idéologie et identité : vers une esthétique du bien-vivre-ensemble,
TUO Fagaba Moïse………………………………………………………………….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
TUO Fagaba Moïse
IDÉOLOGIE ET IDENTITÉ : VERS UNE ESTHÉTIQUE DU BIEN-VIVRE-ENSEMBLE
Résumé : L’identité désigne l’ensemble des processus, des traits, et manières qui permettent de connaitre et reconnaitre un individu ou un groupe d’individus parmi d’autres. Cependant, il est paradoxal de constater que la question identitaire, surtout politiquement, a toujours alimenté des foyers de tensions et conduit inéluctablement à un repli identitaire. L’humanité se trouve en face d’un autre défi énorme que forger l’identité elle-même, celui de l’unité des Nations. Cet article se propose de relever ce défi en s’inspirant de la conception adornienne de l’identité qui fait de l’individu un être de liberté. Cette réflexion tente de montrer que l’identité dans le langage adornien s’oppose au repli identitaire et se positionne en ferment pour l’unité des Nations, car Adorno critique vigoureusement les langues imprégnées de vestiges totalitaires, du radicalisme, de la xénophobie et de l’idéologie haineuse.
Mots clés : Esthétique, idéologie, identité, bien-vivre-ensemble.
Summary: The identity indicates the whole of the processes, the features, and manners which make it possible to know and to recognize a person or a group of persons among others. However, it is paradoxical to note that the identity matter, especially in politics, has always been the cause of tensions and ineluctably leads to identity withdrawal. Thus, humanity faces another enormous challenge than forging the identity itself, that of the unitity of the Nations. This article proposes to take up this challenge by getting ispired by the Adornian conception of identity , which is an individual identity and that makes each person a Man of freedom. Throughout this article, it is a matter of showing that the identity in theAdornian language is opposed to the identity withdrawal and positions as the way for the unit of the Nations, because Adorno vigorously criticizes the impregnated languages of totalitarian vestiges, radicalism, xenophobia and ideology full with hatred.
Keys words: Esthetics, ideology, identity, well-live-together.
INTRODUCTION
L’identité désigne l’ensemble des processus, des traits, et des manières qui permettent de connaître et reconnaître un individu ou un groupe d’individus parmi d’autres. Cependant, il est paradoxal de constater que la question identitaire, surtout politiquement, a toujours alimenté des foyers de tensions et conduit inéluctablement à un repli identitaire. C’est pour cette raison que cette réflexion s’enracine sur le plan doctrinal dans la pensée d’Adorno qui constitue une alternative. Celle-ci permet de diagnostiquer le rapport négatif qui existe entre l’idéologie et l’identité. Il semble que ce couple ʻidéologie et identité̕ ne produit que de vestiges totalitaires, du radicalisme, de la xénophobie et de l’idéologie haineuse. Ainsi, l’humanité se trouve en face d’un autre défi plus énorme que forger l’identité elle-même, celui de l’unité des Nations ou du bien-vivre-ensemble. Ce triste constat peut susciter de telles interrogations : quel est l’impact de l’idéologie sur l’identité ? S’il est vérifié que l’idéologie a une influence négative sur l’identité, le couple idéologie et identité conduit-il au repli identitaire ? Cela viendrait à affirmer que l’idéologie dominante se réclame dépositaire d’une fausse authenticité qu’elle est prête à conserver par tous les moyens. À cet effet, une question pertinente mérite d’être posée : y’a-t-il encore une possibilité d’unité des Nations ou du bien-vivre-ensemble face à la menace pesante de l’idéologie du repli identitaire ? Il semble que l’esthétique adornienne peut conduire, malgré les écueils à surmonter, à l’unité des Nations et au bien-vivre-ensemble. Mais, comment l’esthétique peut-elle servir de facteur d’unité des Nations et du bien-vivre-ensemble ?
Cette réflexion permet de comprendre que l’identité dans le langage adornien s’oppose au repli identitaire et se positionne en ferment pour l’unité des Nations, car Adorno critique vigoureusement le langage imprégné des concepts de nature à favoriser le repli identitaire. Autrement dit, la philosophie d’Adorno en général, de laquelle s’inspire cette réflexion, s’efforce de questionner les réalités existentielles dans le but de les comprendre (saisir leur essence, les causes et les origines qui les déterminent) et de procéder à leur interprétation (leur donner un sens nouveau). Les hypothèses qui orientent cette réflexion sont les suivantes : en premier lieu, nous pensons que le repli identitaire appauvrirait l’identité. En second lieu, nous pensons que l’esthétique, en tant que manifestation dialectique de l’art entre l’individuel et l’universel, conduirait à une véritable unité des Nations, voire une mondialisation ou encore une totalisation consolidée et non fragile.
De même, cette analyse va s’efforcer d’un premier temps, à travers la méthode critique, de dénoncer l’idéologie de l’authenticité qui constitue le nœud essentiel de tout repli identitaire. Le second moment, à partir de la méthode analytique, consistera de proposer l’esthétique comme facteur de construction de l’unité des Nations et du bien-vivre-ensemble.
I/ L’IDÉOLOGIE DE L’AUTHENTICITÉ COMME SOURCE DE REPLI IDENTITAIRE
Le repli identitaire est un comportement qui consiste à rester attacher à ses propres valeurs ou aux valeurs communautaires, mais aussi et surtout à croire que celles-ci sont nettement meilleures et plus supérieures que celles des autres. Mais on pourrait s’interroger ainsi : comment l’idéologie de l’authenticité conduit au repli identitaire ?
Il est fondamental, avant toute réflexion sur cette question, d’analyser d’entrée de jeu la notion d’idéologie, car ce concept peut être polysémique, afin de mieux définir le contexte dans lequel nous l’utiliserons. Alors, qu’est-ce que l’idéologie ?
L’idéologie, selon André Lalande dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie, est la : « science ayant pour objet l’étude des idées, de leurs lois, de leurs origines. » On constate qu’à ce niveau, la notion d’idéologie est neutre et ne comporte aucun germe de danger qui pourrait conduire au repli identitaire. Cela nous donne droit de l’analyser dans la conception adornienne. Selon la pensée d’Adorno, l’idéologie est un jeu verbal, une sorte de langage caractérisé par « les mots purs, mots en soi, mots sursignifiés et surinvestis, mots voulant exprimer l’inexprimable, mots codés. » (Bourahima OUATTARA, 1999, p. 184) L’idéologie, pour Adorno est « le jargon ». Or, « le jargon est un maniement de la langue qui comprend d’abord par le charme magique qu’il entend exercer. Cette sacralisation va de pair avec une mythologie de l’Être et du pathos de l’authenticité. » (Théodor ADORNO, 1989). Cette définition de l’idéologie par Adorno nous permet de comprendre qu’elle est la source du repli identitaire, puisque caractérisée par un esprit nationaliste aveugle, par le mépris de la différence ou de l’altérité, en un mot, par le repli sur soi.
De prime abord, l’idéologie identitaire, en tant qu’ensemble d’idées qui incite à l’action dans l’unique but de triompher de son identité, conduit à la sacralisation de celle-ci. Autrement dit, l’idéologie permet de construire une sorte de doctrine qui prône la supériorité ou l’excellence de sa culture et de ses valeurs, en un mot de son identité que celles des autres. L’idéologie identitaire poussée à son excès ne tarde pas à s’opposer, voire à nier la différence identitaire. Ses partisans se considèrent plus authentiques que les autres. Mieux, ceux qui ne partagent pas ou qui ne sont pas de la même identité sont considérés comme inférieurs. Adorno nous cite le cas des Allemands en exemple. Pour lui, « en Allemagne, on parle d’un jargon de l’authenticité, mieux encore : on écrit, en tant qu’une marque distinctive d’une élite sociale – noble et intime, parfois ; langue de base en tant que langue supérieure. » (1989, p. 43) L’auteur du Jargon de l’authenticité veut simplement souligner que l’idéologie identitaire est une véritable source de concepts frustrants, haineux et divisionnistes.
En fait, l’idéologie identitaire tombe sous la critique adornienne, car pour lui, elle alimente les foyers de tensions et de répressions des systèmes totalitaires. Cette liaison de l’identité d’avec la répression politique conduit à une logique de la manipulation la langue en mettant en place des mots qui modélisent son identité et excluent la différence, car l’altérité est considérée comme inauthentique. Même si l’idéologie identitaire peut devenir un moyen de reconnaissance et d’affirmation de soi, Adorno garde la raison, car l’idéologie joue une fonction démagogique. Le jargon interdit toute analyse et pervertie la réflexion. Adorno précise, à cet effet, qu’être : « Authentique » veut dire : il appartient au cœur de l’affaire que l’homme tout entier parle. Ce faisant, il advient ce que le jargon lui-même stylise dans le « se produire ». La communication se renferme sur elle-même et fait de la propagande pour une vérité qui devrait bien plutôt être suspecte en raison de la promptitude de l’accord collectif. » (Théodor ADORNO, 1989, p. 45). Cette pensée d’Adorno traduit les raisons secrètes d’une idéologie identitaire qui porte le flambeau de l’authenticité. En toute évidence, toute idéologie identitaire qui ne poursuit que son authenticité porte les germes de la domination, car elle parvient à ce que Samba DIAKITÉ appelle « le monoculturalisme. » À ce sujet, il affirme que : « le monoculturalisme s’apparente à la recherche de l’originalité d’une culture, la pureté d’une culture, l’exaltation de son authenticité et de son originalité intrinsèque. De ce fait, le monoculturalisme semble montrer la domination d’une culture sur les autres ; elle semble, de façon subtile, nier l’existence des autres cultures. » (2012) En effet, la volonté manifeste de conserver l’authenticité de son identité, de se référer à ses racines, à ses sources crée la nostalgie de l’origine, l’illusion de la pureté et de l’incorruptible de son identité. Une telle idéologie conduit nécessairement à une identité close, c’est-à-dire à une identité renfermée sur elle-même refusant ainsi l’intégration de toute identité étrangère. Adorno et Horkheimer affirment à juste titre que de tels idéologistes sont des : « ennemis de tout ce qui est différent ; [ils sont caractérisés par] la haine féroce pour tout ce qui est différent. » (1974, p. 215) Pour eux, ces idéologistes manifestent une haine, voire une xénophobie qui est téléologiquement inhérente à leurs mentalités. Cela les poussent à se replier sur eux afin de préserver leur identité pure. Mais, le pire est que la réalisation de cette identité authentique fait recours le plus souvent à la violence comme moyen pour réprimander toute différence identitaire. Par conséquent, la quête effrénée de l’authenticité implique une défiance et méfiance, tout en aboutissant au fanatisme identitaire pour ne dire tout simplement qu’au culte de l’identité.
C’est pourquoi, on peut dire que l’idéologie identitaire a une valeur puérile, à cause de la mentalité inférieure qu’elle inculque à l’individu en le soumettant dans la mimésis et dans la pression de la masse. En réalité, une telle attitude traduit clairement l’incapacité d’un tel sujet à assumer son identité. La peur de perdre son identité authentique entraine la xénophobie et le racisme, voire l’introduction des concepts antisociaux. Elle est le plus souvent accompagnée de comportement barbare et déshumanisant. En s’intéressant au cas particulier de l’Afrique dans ses analyses, FIÉ Doh Ludovic ne manque pas de mentionner cette dimension de conservation de son identité authentique par un repli sur soi. Puisque, selon lui,
Parler de mondialisation des cultures, on se heurte, chez les intellectuels Africains, à au moins deux attitudes. L’une extatique et l’autre méfiante, et parfois assimilable à un repli identitaire. La seconde, et la plus répandue, consiste à voir dans la mondialisation des cultures un processus au travers duquel, tel un python qui avale un lièvre, la culture la plus forte ingurgite celle qui l’est moins. (Ludovic Doh FIE, 2012, p. 156).
Ce qui convient de retenir à travers cette pensée, est que l’idéologie de la fidélité absolue à son identité authentique s’oppose, et même, rejette l’esprit d’ouverture aux autres.
En toute évidence, le jargon de l’authenticité identitaire conduit aux actions aveugles qui déshumanisent l’homme en détruisant son espace social. Il est une source de mensonge qui favorise la distorsion ou la dislocation du mot. Il pousse les individus à agir aveuglement dans l’irrationnel. C’est le cas de l’antisémitisme qui « se fonde sur une fausse projection, qui est l’opposé de la vraie mimésis, très proche de celle qui fut réprimée ; en fait elle est peut-être l’expression morbide de la mimésis réprimée. » (ADORNO et HORKHEIMER, 1974, p. 195). Cette dangereuse conception de l’identité amène l’individu à se détourner des valeurs éthiques, d’intégration en mettant en amont et en aval l’exaltation de la différence. Or, l’exaltation de la différence conduit à une négation de l’autre. Pourtant, la volonté de nier l’autre est source de violence, car la qualification de la différence accompagnée d’une certaine considération d’infériorité et quelques prétentions de dominer l’autre conduisent aux crises identitaires. On assiste donc par là à une domination de l’homme par l’homme, car Trent Schroyer affirme que : « la domination, ou contrôle coercitif de la conduite humaine, résulte du refus de reconnaître aux gens la souveraineté culturelle et la liberté d’interpréter leurs propres besoins. » (1980, p. 18). Et si les hommes politiques « ne sont pas arrivées à créer un espace publique pouvant servir de ferment à la concertation au sens d’une discussion publique sans limitation et sans domination sur le caractère approprié et souhaitable des principes qui orientent l’action » (Ludovic Doh FIE, 2011, p. 90), alors s’installe la violence. Mais, le constat est que les politiques utilisent le jargon de l’authenticité comme moyen pour endoctriner et manipuler les masses. Les masses soumises ainsi à l’idéologie propagandiste se replient sur elles-mêmes et se montrent très hostiles à toute étrangéité et créent des obstacles autour de leurs identités. C’est dans cette logique que se perçoit l’incapacité des dirigeants africains à construire une Afrique ouverte au reste du monde. Ainsi, on a le sentiment qu’: « aujourd’hui à l’ère des ouvertures au monde, à l’ère de la mondialisation, l’Afrique semble se re-trouver dans un vase clos, détachée du monde dans une chaos-cratie délirante, sous-tendue par un système répétitif d’une gestion opaque du trésor commun. » (Samba DIAKITE, 2014, p. 13). C’est dans cette optique que nous sommes d’avis avec Adorno quand il souligne l’urgence de penser, c’est-à-dire d’examiner, de discuter et de critiquer sans complaisance dans les détails les idéologies haineuses qui produisent et alimentent les crises identitaires qui à leur tour, déchirent et fragilisent l’humanité.
Ces crises identitaires deviennent de en plus fréquentes dans le monde entier et de plus en chaotique qu’Adorno affirme : « la vie se change en idéologie de la réification, à vrai dire en masque mortuaire. » (1986, p. 19). Sa préoccupation est celle de l’artiste, c’est-à-dire d’un héros qui ose critiquer, malgré les nombreux risques que comporte cette tâche. Pour Adorno, il est nécessaire d’oser critiquer car la civilisation devient de plus en plus une civilisation des crises, voire de la violence. L’idéologie identitaire qui devrait garantir un monde de liberté et de coexistence pacifique, devient une source de violence et de danger permanent pour l’humanité.
Qui plus est, l’idéologie confère une infaillibilité au langage, le rendant souverain. Ainsi, sa combinaison avec l’identité donne corps et vie à une crise de la communication ou encore mieux à une communication répressive. À travers l’expérience quotidienne, nous constatons que l’idéologie identitaire poussée à son comble se sert des concepts d’accusations vaines, de médiocrité et d’impostures et échappe à la maîtrise des hommes. Cette pensée s’illustre bien avec le concept de « bouc émissaire » de René Girard, qui traduit le fait qu’une personne porte injustement les erreurs des autres, certainement des plus dominants. En réalité, le bouc émissaire est l’incarnation de la conscience dominée, qui constitue la poubelle des consciences dominantes. Elle est toujours accusée sans avoir aucune possibilité d’accuser. Pour cela, les consciences dominantes se servent de l’idéologie en tant que moyen d’expression et de pression. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Adorno, en faisant allusion à l’idéologie qu’il qualifie d’une soit disant philosophie, affirme que :
Ce que la philosophie veut (…) [ est qu’elle] exige que tous ces mots disent plus que ce que chacun dit. C’est ce qu’exploite la technique du jargon. La transcendance de la vérité sur la signification des mots et des jugements isolés est attribuée aux mots par le jargon comme leur propriété immuable. (1989, p. 47).
Ce qui sous-entend que l’idéologie identitaire possède une autonomie absolue, qui à notre sens, conduit à une dissymétrie entre le langage et l’action, autrement dit une rupture entre le dire et le faire. Cette dissymétrie alimente le plus souvent des foyers de violence, car elle prétend convertir de force la fausseté en vérité. En ce qui concerne la violence du langage, Adorno critique la philosophie heideggérienne en la considérant comme le nerf sciatique de tout langage totalitaire et répressif. Selon lui, en analysant la question de l’Être, Heidegger a employé un langage comportant les principes du jargon de l’authenticité. Son ontologie traduit un caractère conservateur et réactionnaire. Il le souligne en ces termes : « la violence est inhérente au noyau de la philosophie heideggérienne, comme à la forme de sa langue : elle est inhérente à la constellation dans laquelle cette philosophie pousse la conservation de soi et la mort. » (ADORNO, 1989, p. 134) Ce qui veut dire qu’à force de vouloir garder l’authenticité, voire l’ipséité de la question ontologie sans aucune référence empirique, Heidegger se perd dans une contrainte de répétition qui s’apparente avec l’échec et la violence. Une violence donc de la mort qui semble prendre appui sur l’instrumentalisation de l’identité.
Il est manifeste que l’instrumentalisation de l’identité et la nostalgie de sa source est une source de repli identitaire. Elles sont caractérisées par le mépris de l’autre. Cette instrumentalisation de l’identité consiste à faire de celle-ci un objet de culte ou le plus souvent une simple marchandise. À vrai dire, l’instrumentalisation de l’identité est une sorte de fétichisme ou charlatanisme qui vise à aveugler l’individu. Nous pouvons illustrer cette pensée avec ces lignes de Heidegger qui s’accorde finalement avec Adorno. Il souligne que : « le langage tombe au service de la fonction médiatrice des moyens d’échange, grâce auxquels l’objectivation, en tant que ce qui rend uniformément accessible tout à tous, peut s’étendre au mépris de toute frontière. Le langage tombe ainsi sous la dictature de la publicité. » (1957, p. 36). En clair, l’instrumentalisation de l’identité est, pour ainsi dire, une perversion de celle-ci. Elle la détourne de toute valeur morale et éthique. Cette identité instrumentalisée relève des émotions. En cela, l’émotion introduit une déconnexion, voire une rupture entre la théorie et la pratique. C’est pourquoi, les attitudes divisionnistes, tribalisme, chauvinisme, et l’exaltation de l’esprit nationaliste sont des rejetons de l’identité instrumentalisée. Puisque la course à l’originalité et à l’authenticité n’est rien d’autre que des germes de la passion, voir de l’émotion en tant que raison instrumentale.
De ce qui précède, on peut retenir que l’idéologie identitaire de l’authenticité, à travers les concepts tels que : la sacralisation de l’identité, la nostalgie de l’origine, la quête effrénée de la pureté et de l’incorruptibilité de l’identité, l’instrumentalisation de l’identité et autres concepts similaires, est à l’origine du repli identitaire. Mais, comment parvenir à l’unité des Nations, mieux au bien-vivre-ensemble malgré les potentielles menaces qui conduisent au repli identitaire?
II – L’ESTHÉTIQUE COMME FACTEUR DU BIEN-VIVRE-ENSEMBLE :VERS UNE ÉTHIQUE DE LA DIFFÉRENCE
Il nous semble bien indiqué que l’esthétique, en tant qu’œuvre d’art, peut être une alternative, voire un facteur de cohésion sociale et du bien-vivre-ensemble. Mais, qu’est-ce qu’une œuvre esthétique ou du moins qu’est-ce que l’esthétique et comment peut – elle parvenir à cette fin?
L’esthétique, à notre sens, est la philosophie de l’art. Or, l’art est une représentation critique et harmonieuse du monde. Selon Adorno, l’art est fondamentalement politique. Politique en ce sens qu’il participe à l’harmonie sociale et au bien-vivre-ensemble, parce que l’œuvre d’art possède une puissance critique, une force de protestation qu’aucun pouvoir politique ne peut empêcher. L’art se doit donc de critiquer les dérives de la culture humaine en général, et de l’idéologie identitaire en particulier. L’homme, a généralement une nostalgie aveugle de son identité. Il aurait tendance à se replier sur lui-même en refusant au nom de l’originalité et de l’authenticité de s’ouvrir à l’autre en situation de conflit, de déni ou de frustration. Ce repli sous-entend qu’il a peur de perdre sa culture au contact de celle de l’autre ou de la voir tomber sous les coups de la critique de l’autre. Pourtant, l’œuvre esthétique est la conséquence ou le résultat d’une critique, c’est-à-dire de la séparation de ce qui est éthique et de ce qui ne l’est pas, de ce qui humanise et de ce qui déshumanise, de ce qui forme et de ce qui déforme.
L’art, selon Adorno étant un moyen de transformation sociale, peut permettre à l’identité d’être un indice permettant l’identification d’un individu parmi tant d’autres sans être une source de violence et de division. C’est pourquoi, la culture étant son expression, Marcuse a pu soutenir qu’elle apparaît comme la finalité des actions morales, esthétiques et des valeurs intellectuelles d’une société. En réalité, la culture humanise l’individu et au-delà de lui la société. Mais, pour que la culture réussisse cette tâche d’humanisation, il faut la neutraliser. La neutraliser, c’est tenter de la libérer de toute forme de violence, de barbarie et de prétention à l’exaltation de la différence ; en un mot, c’est l’esthétiser. En cela, l’esthétique vise l’harmonie et l’épanouissement des individus dans la société, voire leur émancipation en favorisant un espace exempt de souffrance et de laideur. Dans ces conditions, il convient de retenir que l’éthique de la culture s’impose à nous pour éviter la répression culturelle. D’où la nécessité de ré-éduquer notre culture, concevoir des identités ouvertes à celles des autres et laisser tomber tous les concepts nuisibles au nom d’une cohésion des Nations et du bien-vivre-ensemble. Pour ce faire, l’on ne doit pas se méfier de la mondialisation ou de l’universalisation des cultures ni y entrer aveuglement. Par conséquent, il est fondamental que la mondialisation s’inspire de cette pensée de FIÉ Doh Ludovic qui souligne que : « la culture d’un peuple est une figure particulière de l’histoire de l’humanité, à coté d’autres cultures. Il n’y a pas de culture qui soit supérieure à une autre. » (2012, p. 159). Pour parvenir donc à une véritable unité des Nations et à des principes fiables du bien-vivre-ensemble, nous croyons qu’il est nécessaire de prendre en considération certaines valeurs esthétiques à savoir la reconnaissance de l’altérité, une éthique du langage et une éthique de la réciprocité.
En réalité, on décèle une éthique de la différence chez Adorno, c’est-à-dire la capacité d’accepter l’autre malgré sa différence identitaire, qui peut servir d’alternance. La pensée adornienne est fondamentalement caractérisée par ce grand souci : réalisation ou la mise en pratique de l’altruisme. En un mot, le philosopher adornien s’identifie à l’humanisme. Durant toute sa vie, notre théoricien n’a fait que lutter en faveur de la diversité culturelle. Pour ce faire, on perçoit dans sa pensée, un art de vivre et mieux de bien-vivre-ensemble, à travers ses penchants à promouvoir la liberté individuelle. En fait, l’esthétique adornienne est une œuvre subversive qui déconstruit les formes de dominations et est porteuse d’un changement qualitatif de la société.
La philosophie adornienne milite pour un espace social caractérisé et défini par des relations inter-individus, des relations inter-culturelles, en un mot, des relations inter-identitaires. Cela dit, cette éthique de la différence que l’on retrouve dans le philosopher adornien permet de construire une société consolidée où les différentes cultures peuvent co-exister dans une parfaite harmonie. Cette éthique de la différence permet de créer un autre monde, celui de la tolérance et de l’acceptation de l’autre avec sa culture. Ainsi, l’éthique, étant la science des valeurs humaines universelles, peut aider l’humanité à construire un véritable monde de libertés individuelles caractérisé par l’esprit d’ouverture. Puisqu’en réalité, l’éthique de la différence consiste à promouvoir l’acceptation des différences. De cette manière, une telle recommandation nous permet d’éviter le triomphe identitaire, qui selon Yacouba Konaté, est la conséquence de l’esprit nationaliste, nationalitaire et la catégorisation fixe des individus. Ce qui veut clairement dire qu’une éthique de la différence peut nous aider à éviter les concepts divisionnistes (authenticité, originalité) et des propos xénophobes. C’est dans cette même perspective que s’inscrit Hannah ARENDT. Pour elle, la politique étant un élément essentiel de la culture, doit reposer : « sur un fait : la pluralité humaine. » (2015, p. 39). En effet, l’éthique de la différence peut servir de panacée pour les crises inter-ethniques et identitaires, car elle préconise l’acceptation, l’ouverture à l’autre et à sa culture sans vouloir qu’il soit identique à lui. L’éthique de la différence nous permettra de penser et panser les plaies béantes de nos cultures d’impostures, repliées sur elles-mêmes, conduisant à une effective cohésion sociale qui réponde aux valeurs humaines.
Dans la pensée d’Adorno, il existe une éthique du langage qui nous semble bien indiquer, comme moyen de lutte contre les dérives culturelles et le repli identitaire. En réalité, la pensée adornienne est caractérisée par un langage anti-totalitaire. C’est d’ailleurs pour cela qu’il interdit formellement à l’œuvre d’art de communiquer, vu que « la communication des œuvres d’art (…) se produit par la non communication » (ADORNO, 1995, p. 20). En fait, cette pensée dialectique d’Adorno est une manière d’interpeler tout communicateur[54] sur les limites naturelles du langage à rendre compte des essences des choses. Cela dit, tout langage doit être fragmentaire[55], c’est-à-dire moins totalitaire et qui n’est pas caractérisé par la domination répressive. Pour ce faire, Adorno souligne aussi que : « la dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. » (1995, p. 13). Ce qui sous-entend qu’une pensée dialectique est moins totalitaire, car elle accepte la contradiction. En effet, le modèle de langage dialectique que propose Adorno permet de montrer les limites de toute communication. Ce modèle de langage dialectique repose sur les principes de la vérité, de la justice et surtout de la tolérance. Cette éthique du langage peut permettre aux individus de proscrire les concepts divisionnistes et haineux de leur langage. Ce qui favorise implicitement la coexistence pacifique.
Ainsi, si tout communicateur accepte ses limites, tel qu’Adorno le pense, la réalisation du bien-vivre-ensemble cesse d’appartenir à la fiction pour devenir une réalité. La raison est qu’une communication consciente de ses possibles limites est moins autoritaire. Et, par ailleurs, elle valorise l’altérité, voire la diversité culturelle pour s’enrichir et tendre à la vérité, qui doit-être ; selon Adorno, le contenu de tout langage. À vrai dire, ce modèle de langage adornien vise à lutter contre la perversion de la vérité, contre les mensonges outranciers et les manipulations idéologiques qui ne produisent que la violence destructrice. Puisque, la déréliction du langage résulte de l’abus des concepts, voire de leur manipulation idéologique. Ainsi, l’éthique du langage peut créer un espace public, qui prende en compte la diversité culturelle, et à partir duquel un vivre-ensemble peut être construit à travers une éthique de la discussion qui rendra la parole plus compréhensible, accessible et valable pour tout le monde. L’éthique du langage, à notre sens, peut aider à éviter les discours répressifs, divisionnistes et guerriers. Il est évident que c’est à partir du langage que nous partons à la rencontre de l’autre et de sa culture. Pour éviter donc toute forme de vexation, de frustration ou même de négation de l’autre, il faut une stratégie de communication fondée sur la considération de l’autre en évitant toutes sortes de frustrations et de mépris. Cette stratégie permettra de rentrer dans le monde de l’autre, quoique différent du nôtre, sans le nuire et se nuire soi-même. Celle-ci facilitera une éthique de la diversité culturelle.
On retrouve aussi une éthique de la réciprocité dans la philosophie adornienne qui peut-être une voie de sortie de l’impasse du repli identitaire pour une vraie cohésion sociale. En effet, elle exige la considération de l’autre et de sa culture. Or, considérer l’autre c’est lui reconnaître les mêmes droits et la même dignité que soi, quoique différent de nous. Ainsi, la reconnaissance et l’acceptation de cette différence conduit à l’harmonie sociale. Si selon DIAKITÉ Samba la différence est le plus souvent source de différend, alors l’éthique de la réciprocité peut remédier à cette négation de la différence. Pour une meilleure application de cette éthique de la réciprocité, il faut une ré-éducation de nos cultures. C’est dans cette perspective qu’Adorno affirme que : « exiger qu’Auschwitz [en tant que mal absolu] ne se reproduise plus est l’exigence première de toute éducation. » (2003, p. 235). Nous remarquons chez Adorno, l’éducation vise à lutter contre cet aveuglement de la civilisation moderne, qui n’a produit que des barbaries et des désolations au nom du triomphe identitaire. Dans ce même élan, Arendt souligne que l’éducation est un art qui participe à la construction du monde. Elle introduit une nouveauté dans le monde. Ainsi, une éducation réussie conduit à un idéal culturel, un idéal identitaire : celui de l’unité des Nations et du bien-vivre-ensemble.
Eu égard à tout ce qui précède, on peut dire que l’esthétique culturelle est une voie de sortie de l’impasse des crises identitaires, de la dissymétrie entre langage et action, entre le dire et le faire artistique.
CONCLUSION
Pour terminer, retenons que la dissymétrie entre le langage et l’action, entre le dire et le faire artistique est la conséquence du fourvoiement de la culture. Ce fourvoiement de la culture découle de l’instrumentalisation de la culture, de la déréliction du langage, de l’exaltation de la différence, de l’authenticité et de l’originalité. Telles sont autant d’attitudes qui donnent naissance non seulement aux crises identitaires, aux concepts divisionnistes, aux différentes formes de barbaries dans les sociétés, mais aussi et surtout au repli identitaire. Mais, l’esthétique culturelle à travers l’éthique de la culture peut servir de panacée, de moyen de libération et d’émancipation et de facteur du bien-vivre-ensemble. Celle-ci conduit à l’instauration d’un idéal culturel qui participe à l’harmonie des cultures et de sociétés. Par conséquent, l’esthétique culturelle est la « Grandeur de l’âme, Grandeur de l’Homme pour négocier une culture du Vivre-Ensemble. » (Samba DIAKITE, 2014, p. 66). En vérité, l’esthétique est le dépassement de l’égocentrisme de l’homme. Par conséquent, elle est donc la condition de la cohésion pacifique et sociale dans le monde des humains.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ADORNO (T.W.), Autour de la théorie esthétique, paralipomena, introduction première, traduit de l’allemand par MARC JIMENEZ &ELIANE KAUFHOLZ, (Paris, Klincksieck, 1976).
ADORNO (T.W.), Jargon de l’authenticité, De l’idéologie allemande, traduction de l’allemand et préface d’Éliane Escoubas, (Paris, payot, 1989).
ADORNO (T.W.), Théorie esthétique, traduit de l’allemand par Marc Jimenez, (Paris, Klincksieck, 1995).
ADORNO (T.W.), Modèles critiques, critique de la politique, traduit de l’allemand par Marc Jimenez et Éliane Kaufholz, (Paris, Payot, 2003).
Minima Moralia, Réflexions sur la vie mutilée, traduction de Éliane et Jean-René Ladmiral, (Paris, Payot, 2003).
PRISMES, critique de la culture et de la société, traduction de Geneviève et Rochlitz, (Paris, Payot, 1986).
ARENDT (H.).- Qu’est-ce que la politique?, traduit de l’allemand par SYLVIE COURTINE-DENAMY, (Paris, Éditions du Seuil, 1995).
ARENDT (H.).- La crise de la culture, trad. Jacques Bontemps et Patrick Lévy, (Paris, Gallimard, 1999).
BIDIMA (J-G.).-La philosophie négro-africaine, (Paris, PUF, 1995).
FIÉ Doh ( L.),- Musiques populaires urbaines et stratégies du refus en Côte d’Ivoire, (Paris, Éditions EDILIVRE APARIS, 2012).
HEGEL (G.W.F).- Introduction à l’esthétique, (Paris, Aubier-Montagne, 1964).
JIMENEZ (M.).-Qu’est-ce que l’esthétique ?, (Paris, Gallimard, 1999).
Articles:
FIÉ Doh ( L.),- « Marcuse et la critique de l’identité », in cahier philosophique d’Afrique, Ouagadougou, PUO, 2008, n°006, pp 133- 148.
La critique de l’identité chez Adorno, Revue ivoirienne de philosophie et de culture, korè, PUCI, Abidjan, 2007.
«Jeunesse et violence: contribution de Yacouba Konaté à la critique de la culture contemporaine.» in Autour de l’oeuvre de Yacouba Konaté, sous la direction de David Musa SORO, (Abidjan, Balafons, 2011).
DIAKITÉ Samba, « Yacouba Konaté et l’Afrique : la cure de soi ou de l’éternel retour du Kilikan-sosso » In Autour de l’œuvre de Yacouba Konaté, sous la direction de David Musa SORO, (Abidjan, Balafons, 2011).
AXE 4 : PAIX, GUERRE ET MONDIALISATION
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
13. Sport et dopage : quel rapport au vivre-ensemble ?,
ABOGNY Claude Aurélie………………………………………………………….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
ABOGNY Claude Aurelie
Université Alassane Ouattara de Bouaké
SPORT ET DOPAGE : QUEL RAPPORT AU VIVRE-ENSEMBLE ?
Résumé
Vu de l’extérieur, le sport moderne se présente comme une activité à caractère rassembleur, dont le fondement incontesté serait la consolidation du vivre-ensemble. Cependant, en y jetant un regard critique l’évidence montre que tous ces aprioris ne sont qu’un leurre. L’athlète est utilisé comme un moyen et non comme une fin, pour des intérêts particuliers. La soif exacerbée et inétanchable de victoire et le souci faramineux du gain matériel, prête le flanc à l’individualisme au détriment du communautarisme. L’athlète manipulé à souhait, en vue de satisfaire l’appétit financier de ses employeurs en dépeint la triste réalité. La solidarité constitutive de l’humanité, dans le sport moderne se trouve pour ainsi dire reléguée au second plan, tout en compromettant le vivre-ensemble.
Mots clés : Agressivité, compétition, dopage, humanité, société, sport, sport-business, vivre-ensemble.
Abstract :
Modern sport appears in a general way as an activity with a gathered characteristic, that the real fondement would be enforcement of the live together. However by having a critical view, evidence show us obviously that those a priorism opinions are just a lure. The athlet is used as mean for particular interests. Exacerbated and unquenched force of victory, and staggered worring of material gain favorise the individualism to the detriment of communautarism. Athlet, manipulated in order to satisfy the financial wants of his employers, is the typical sad example. The humane question in the modern sport is so that, throw on the second point and compromise so the live together, base of social life.
Key work: Aggressiveness, business sport, competition, drug taking, humanity, society, sport, live together.
INTRODUCTION
Le sport est de nos jours semblable à un sacré phénomène de foire. L’on adule les athlètes comme s’ils étaient des surhommes, tout en oubliant que « le sport est capable du meilleur comme du pire » (Bénédicte HALBA, 1999, p. 3). L’effervescence de la victoire nous transpose dans un univers presqu’inimaginable, au point que l’on en oublie tout, ne serait-ce qu’en une fraction de minute. Cependant, derrière toute cette euphorie se cache bien de choses, telles que le dopage et le culte de l’individualisme qui constituent des gangrènes phares du milieu qui corrompent l’esprit du sport. Le tour de France de 1998 avec l’explosion de l’affaire Festina ainsi que bien d’autres jusqu’à ce jour en disent long. Les tout derniers jeux olympiques de Sotchi n’ont point été exemptés par la question. Le sport d’élite devient alors l’une des problématiques du siècle à résoudre sans trop tarder.
Si la société est le milieu de prédilection par excellence de l’homme et que le sport est aussi un phénomène de société, nous pouvons penser un rapprochement entre les deux concepts. Pour mieux comprendre leur relation, nous allons instruire la question suivante : comment doit-on pratiquer le sport pour qu’il soit compatible avec les exigences du vivre-ensemble ?
- DES ORIGINES DU SPORT
- Sport : querelle des anciens et des modernes
L’expression sport a été inspirée de l’ancien français « desport » (XIIe siècle). Le concept dans son évolution à travers le temps, les époques et les civilisations passe par l’Angleterre et devient au XIVe siècle « disport » renvoyant à « divertissement » « passe-temps » qui incluait tous les jeux de société anciennement pratiqués en France. Lorsqu’on étudie l’histoire du sport, elle s’articule autour d’un débat opposant deux thèses majeures. Selon la première thèse, celle des « anciens » ; le sport est un phénomène universel qui, depuis toujours, a existé sous des formes diverses au sein des sociétés. Il fut l’une des pierres angulaires de l’éducation humaniste du XVIe siècle. À ce propos, Wolfgang et Thuillier affirme :
Contrairement à ce que l’on estime souvent le sport n’est pas né à Olympie, pas plus qu’il ne s’est éteint dans l’Attique ou le Péloponnèse. L’Égypte nous offre de nombreuses scènes sportives entre autre la lutte dès le 3ème millénaire avant notre ère, et les romains, héritiers d’Étrusque sur bien des points et en particulier dans ce domaine ont peut-être créé le sport moderne avec ses clubs puissants et ses enjeux financiers colossaux. (2004)
Le sport ne remonte pas seulement à deux siècles, mais remonte à plus de trois milles ans avant Jésus-Christ. Cette affirmation pourrait trouver une justification dans le fait, que déjà 1200 ans avant notre ère, existait la «pelota » (Microsoft Encarta, 2009), jeu regroupé en deux catégories : jeux directs, où les joueurs sont face à face et se relancent la balle comme au tennis, et jeux indirects, où les joueurs sont face à un mur contre lequel ils lancent la balle, directement ou après l’avoir fait rebondir sur un autre mur comme au squash.
Cette thèse démontre que la pratique sportive aurait toujours existée. En ce sens, dit Michel Caillat : « le capitalisme réorganise de manière originale et neuve les données antérieurs de la culture. » (2008, p. 17). Juste pour dire que le capitalisme n’a en rien enfanté le sport, mais qu’il aurait plutôt seulement modelé, en faisant en sorte de l’améliorer rien qu’en le soumettant aux normes et exigences du moment.
Pour la seconde thèse, celle des « modernes », le sport n’est apparu de façon plus précise dans l’histoire qu’à la fin du XIXe dans un contexte d’amateurisme aristo-universitaire, presque exclusivement masculin, et dans les pays industriellement développés d’Europe et d’Amérique. Pour ces derniers, « le sport est l’enfant de la révolution industrielle et de la société capitaliste » (Michel CAILLAT, 2008, p. 15) et « il est erroné de regarder le passé avec nos modes de pensées actuelles et d’imaginer que les pratiques qui ressemblent à celles que nous connaissons peuvent se rapporter à cette appellation “sport” » (Philippe LYCTARD, 1999-2000). C’est donc une illusion pour ceux-ci de croire, que la pratique sportive ait pu exister bien avant le XIXe siècle, puisque de leur point de vu, en ce qui concerne le sport, tout commence dès le XIXe siècle et ni avant ni après cette époque-là.
Mais, peu importe, que le sport soit considéré comme un « invariant culturel », ou qu’il n’ait pris ses marques qu’au XIXe siècle, le principal est que de par sa définition basic, le sport se saisi comme un ensemble « d’activités physiques exercée dans le sens du jeu, de la lutte et de l’effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et respect de certaines règles et disciplines » (Alain REY, 2016), qui par extension est devenu objet de compétition. Le sport de compétition dont l’objectif est la réalisation d’une performance par rapport à un obstacle, une distance, un temps, un adversaire, ou soi-même, l’évidence montre que la pratique équilibrée d’un sport aide au maintien de la bonne santé et en favorisant un meilleur entretient du corps. Il faut tout de même mentionner que toute pratique exagérée d’un sport, quel qu’il soit, pourrait nuire au bien-être physiologique et psychologique du pratiquant.
Au-delà des divergences sur l’histoire du sport, il y a un consensus sur le fait qu’il est une activité qu’on ne peut pratiquer en dehors de la société, d’où tout ce qui rime avec sport rimerait également avec la société. Le besoin se fait sentir de faire, alors, un tour d’honneur sur la notion de société, mais plus précisément sur le sport et ses premiers pas dans la société moderne.
- Sport et lutte des classes
Le sport tel que connu au XIXe siècle se présentait comme une activité sectaire sans précédent. Le sport d’alors était strictement réservé aux Hommes de la haute sphère. Celui-ci fut pendant « très longtemps interdit aux indigènes » (Michel CAILLAT, 1996, p. 30). Les esclaves et les peu fortunés n’en étaient pas seulement écartés, mais (les classes inférieures) souffraient également de l’égoïsme de la bourgeoisie aristocrate. À cet effet, Caillat a pu dire « le prolétariat souffre pendant que l’aristocratie dépense de coquettes sommes sur les champs de courses et s’adonne aux jeux populaires en les modifiant » (1996, p.18) dans leur seul intérêt. L’aristocratie obnubilée par sa soif de pouvoir ne prêtait guère attention à l’agonie du prolétaire qui ne pouvait que subir les affres déraisonnés de la première dans l’incapacité de dire ou de faire quoi que ce soit.
Il faut compter les équitations, l’escrime, le billard, les jeux d’échecs etc.; comme sports réservés aux classes privilégiées. Tout ce dont profite le prolétariat, c’est juste des petits moments d’euphories qui, à peine passés, les abandonnent à leur tristes réalités pendant que l’aristocratie en profite longuement et largement. Lorsque Pierre de Coubertin affirme avec une certaine fierté « Tout est aplani, l’ouvrier est à la hauteur du patron, le manœuvre au niveau de l’intellectuel, la lutte des classes s’efface. Des êtres que tout sépare se retrouvent dans la joie et bonne humeur à pratiquer, à encourager, à se parler sans gêne et sans réserve d’une passion commune » (Michel CAILLAT, 2008, p. 72), il en ressort d’une manière un peu plus claire que nul n’était étranger à ce phénomène où la bourgeoisie l’emportait toujours sur le prolétariat. L’individualisme avait atteint un sommet presqu’insaisissable, du moment où il l’emportait sur la communauté.
Il serait pour nous un peu prétentieux d’affirmer que ces barrières n’existent vraiment plus, car les paris existent toujours et les tenants du sport de haut niveau ne cessent point d’accroître leurs chiffres d’affaires et de grossir leurs comptes en faisant de plus en plus fortune au détriment des autres. Ce sont en effet, les mêmes qui appuient ce système et si le sport de masse existe encore aujourd’hui, c’est juste parce que le profit leur revient. Sinon à quoi bon investir dans une affaire à très faible rendement ? Si, certains affirment avec une particulière certitude que « les barrières sont tombées », nous, nous dirons que ce n’est qu’une simple vue de l’esprit, une utopie. Il est clair que, même si des fils de famille modeste deviennent des athlètes de haut niveau, juste par les bonnes grâces de mère nature (allusion fait à leurs capacités naturelles), cela ne leur est en rien un avantage. Sont-ils toujours sous l’emprise de la bourgeoisie qui leur fait goûter au fruit interdit « l’argent » car une fois consommé, on en veut toujours un peu plus, au point de se laisser aller à des pratiques mesquines, qui on ne se lasserait de le dire empoisonnent l’esprit du sport moderne.
À partir de ce qui précède que pouvons-nous dire du sport et de son sens du vivre-ensemble ?
- SPORT ET SENS DU VIVRE-ENSEMBLE
- Qu’est-ce que le vivre-ensemble ?
À l’état de nature, « l’Homme est un loup pour l’Homme » (thomas HOBBES, 2013). C’est l’état de guerre de chacun contre chacun, de barbarie et de sauvagerie. La seule solution pour sortir de cet état c’est le contrat duquel naît l’État qui résulte de la session du pouvoir et de la force. Tout pouvoir, toute force est donnée à un seul homme ou à une assemblé sensée décider et diriger sans parti pris. Faut-il que, l’homme délaisse sa barbarie d’alors, afin d’épouser la citoyenneté qui lui donnerait d’avoir droit de cité et l’astreindrait aux devoirs correspondants. Le passage d’un état de nature à l’état de paix traduit l’acceptation de l’autre, celui qui n’est pas moi, mais qui est semblable à moi, cet autre sans qui je ne saurai réellement être moi.
Vivre-ensemble, traduit la reconnaissance de l’autre et l’acceptation de cohabiter avec lui sans le souci de différenciation quelconque (sociale, raciale, etc.). Le vivre-ensemble va bien au-delà des frontières que nous lui avons subjectivement délimitées, il tient dans le don de soi et dans le respect de l’autre en mettant en avant l’égalité des Hommes, (grands ou petits, hommes ou femmes, valides ou invalides).
Fort de ce constat, le besoin se fait sentir de soulever la préoccupation suivante : Quelle place confère-t-on au vivre-ensemble dans une société où l’esprit de compétition est à tous les carrefours ?
- De l’esprit de compétition
À entendre parler de compétition de nos jours, la première idée qui effleure l’esprit est celle du sport. Il y a cependant, bien de domaines où l’esprit de compétition rentre en ligne de compte. En effet, la compétition semble être l’âme même de l’existence humaine, car les Hommes vivent comme s’ils étaient tout le temps en compétition et sous les regards intransigeants d’un arbitre incorruptible. Même la simple montée dans le bus constitue pour nous un objet de compétition soit contre nous-même, soit contre une tierce personne ou soit simplement contre le temps. Pour revenir au sport, notons que l’esprit de compétition en est le moteur premier. Par l’esprit de compétition, le sport valorise la sociabilité rien qu’en favorisant les rassemblements interhumains. Il prête le flan au vivre-ensemble car en me frottant à l’autre, j’apprends à mieux me connaître et à le connaître aussi, ce qui facilite mon intégration à son monde, sinon à la société et vice-versa. Les compétitions interhumaines favorisent l’engouement à l’apprentissage, la complémentarité des hommes par l’utilité du groupe, la solidarité. C’est justement en face de l’autre que je perçois plus facilement mes défauts, que je prends conscience de mes lacunes et je me sens plus en proie à l’effort.
Si l’expression compétition semble rimer avec opposition, il convient de noter qu’il n’en est évidemment rien. Venu du latin « cum petere » qui signifie « recherche ensemble », compétition renvoi à ; recherche simultanée avec une, deux ou plusieurs personnes. Faut-il entendre par là qu’être en compétition, c’est juste faire en complémentarité avec l’autre, ce qu’il me serait difficile de faire à moi tout seul. Dès lors l’adversité n’existe plus. L’adversaire est avant tout un partenaire indispensable sans qui le sport n’aurait de sens réel.
Car «la compétition est une rencontre, une intrigue, une communication entre deux joueurs ou deux équipes. Et cette rencontre est possible entre tous car le sport possède un langage universel, accessible à tous. On n’a pas besoin de la parole en sport, tout passe par le corps, les gestes et les règles. L’universalité du sport est d’ailleurs souvent source d’inspiration pour un autre domaine lui aussi accessible au-delà des mots l’art. La littérature, la peinture, la sculpture, la musique et les arts plastiques s’inspirent ainsi souvent du sport pour leur création. »[56]
Il va sans dire qu’à l’origine, la compétition dans le sport n’était vraiment rien de semblable à ce qu’on pourrait constater sur le terrain aujourd’hui. Elle était plus considérée comme objet de réunion que de dislocation interhumaine, car favorisant le rassemblement, la courtoisie, l’épanouissement social et bien des fois l’effacement des barrières litigières entre personnes interposées et/ou entre peuples, communauté etc. Soutient Caillat l’esprit de compétition dans le sport est « « un meilleur moyen de créer des liens en gommant les différences », le sport apparait comme le parfait antidote aux fléaux sociaux » (2008, p. 71) ce qui traduit aisément que l’idée de compétition telle que connue à l’origine est en faveur des relations humaines et donc du vivre-ensemble.
Bien que la compétition de par sa définition originaire soit favorable au vivre-ensemble comment se manifeste de nos jours avec l’explosion du sport moderne ?
- LES ANTICHAMBRES DU SPORT, UNE ENTRAVE AU VIVRE-ENSEMBLE
- Le dopage sportif comme source de compromission du vivre-ensemble
Le problème qui se pose aujourd’hui, est que l’esprit de compétition dans le sport moderne a changé sa ligne de mire en se pervertissant. La course à la victoire est devenue plus qu’obsessionnelle. L’adversaire n’est plus considéré comme l’ami qui pourrait m’aider dans ma quête d’harmonie, de paix, de joie, d’un bel instant de bonheur. Il est plutôt considéré comme un potentiel ennemi qu’il faut vaincre par tous moyens.
Le sport, c’est une guerre en miniature qu’il faut gagner par tous les moyens. La violence n’est pas seulement visible dans les gradins du stade du Heysel ou de Sheffield ; elle est inscrite dans la logique de l’affrontement ; elle se donne à voir. « Le vrai sport disait George Orwell (1903-1950) n’a rien à voir avec le fair-play. C’est plein de jalousie, de vantardise, de non-respect des règles et d’un plaisir sadique à regarder la violence. En d’autres mots, c’est la guerre sans les coups de feu. (Michel CAILLAT, 2013, p. 70).
Ce qui est déterminable par l’obsession de l’Homme à outrepasser ses limites naturelles en compromettant sa propre santé voir sa vie. Les athlètes poussés par leurs équipes de mise en forme, appuyées par les clubs, les sponsors, les médias etc. se trouvent pris comme entre deux eaux, contrains de faire plus qu’ils ne peuvent. L’esprit de compétition y aurait largement contribué car n’ayant plus la particularité de recherche commune mais valorise un individualisme sans précédent qui s’oppose inexorablement au vivre-ensemble. Les faits ne sont point anodins : ces blessés graves, ces accidents cardiovasculaire et ces morts lors des compétitions en dépeignent la triste réalité. Les morts dans le sport, il n’en manque point. « Les morts se comptent par dizaines sur les rings, sur les circuits automobiles, sur les parcours de triathlon et sur les pistes de ski. » (Michel CAILLAT, 2013, p. 70). Pas seulement là, mais aussi sur les terrains de football, de basketball, même sur les patinoires pour les pratiquants de patinage artistique. L’on paie à prix d’argent pour aller voir des athlètes en compétition dont l’espérance de vie est pour la plupart réduite soit de moitié, soit un peu plus encore à force d’acharnement et d’ingurgitations de potions aux effets dits miraculeux, ou d’injections de produits prohibés. Le plus triste est que « le cirque de formule 1 poursuit sa route ; les rivalités entre les monstres sacrés se sont fortement accru, le spectacle de vitesse et de la mort garde son fidèle publique.» (Michel CAILLAT, 2013, p. 71). L’on côtoie la mort à tous les niveaux du sport qu’il soit de haut niveau ou pas.
Aller toujours plus loin, repousser encore plus loin ses limites, en vue de finir parmi les meilleurs ou pourquoi pas figurer sur les plus hautes marches de l’estrade, tel devient le crédo de l’athlète. Car pensent-ils (les athlètes) qu’ils ne sont ne seraient en mesure de réaliser des records jamais battu ou d’atteindre la victoire avec de simples performances naturelles. La quête de performance et le souci interminable de battre des records, représente dans le sport un sacré dilemme. Ainsi, le sport traditionnelle laisse petit à petit place à un sport que nous qualifierons de « sport de la démesure », dans le sens où il dépasse les limites de l’attendu.
En effet, même si l’on peut sentir un instant, un semblant de solidarité favorable au vivre-ensemble, alors, celui-ci est intéressé. L’ambition liée au désir de vouloir toujours plus, sans jamais accepter de marquer une pause réflexive, est à l’origine de la disparition de l’« idéal romantico-naturaliste du sport, celui de l’athlète qui gagne une course à l’eau pure en cultivant son talent naturel par le travail, la volonté et le courage » (Jean-Noël MISSA, 2011, p. 84). De plus en plus, sinon « peu à peu la philosophie artificialiste du “ dépassement des limites ” (…) s’impose dans la société au détriment d’une philosophie naturaliste du “ respect des limitesˮ» » ( Jean-Noël MISSA, 2011, p. 90) ce qui met en péril l’esprit de compétition originel dans son rapport au vivre-ensemble, où la compétition est abordée sous l’angle d’un jeu, car joue-t-on seulement en vue d’un divertissement quelconque et non point en vue d’un gain financier ou matériel. Le sport moderne tel qu’il se présente à nous n’a semble-t-il rien d’un jeu. La simple observation des enjeux qui le déterminent en dit long.
Le sport, autrefois reconnu pour ses capacités incontestable à taire les différents de tout ordre, ses valeurs éducatives et morales prend un tout autre sens avec la biomédicalisation et la technologisation dont il fait l’objet. L’aspect naturaliste disparaît à grand pas, pour céder la place à la pharmaco-assistance, qui qu’on le veuille ou non dans quelques années, sera légalisée à un degré inédit, qui dérangerait à coups sûr la morale et l’éthique. Si, petit à petit les OGM (organismes génétiquement modifiés) ont gagnés le monde, et que le body building prend de l’ampleur en occident et partout dans le monde, attendons-nous à ce fait : le sport biomédicalisé regagnera la liste. Si, les hommes se sont fait eux-mêmes « maîtres et possesseur de » (René DESCARTES, 1951, p. 91) leur propre nature et de celles des autres espèces qui les entourent, quel sort réservent-ils à ces athlètes et à l’humanité ? Vu que tout se trame dans le temps et dans l’espace.
Les athlètes en quête d’accroissement de rendement, dans l’espoir d’améliorer leurs performances ont recours au dopage et trouvent cette immixtion correct, car selon eux, c’est le seul moyen de se mettre au niveau des plus “forts”. Trouvent-ils discriminatoire l’idée de savoir l’autre naturellement plus fort. Telle est l’idée qui pousse pour la plupart les athlètes d’un certain niveau à se laisser entraîner dans cette forme d’abattoir qui sait bien taire son nom par la loi du silence. Elle les amène à s’adonner à l’absorption de produits illicites et/ou à l’utilisation de pratiques interdites qui représentent un taux de risque élevé pour le bien-être de l’athlète. Il n’est effectivement guère étonnant de constater la facile accessibilité aux produits dopants, car ils sont à portée de main.
Il convient de noter que, « seul les athlètes les plus aisés financièrement peuvent se payer le luxe de prendre les conseils d’un médecin privé pour leur préparation biomédicale » (Jean-Noël MISSA, p. 106). Les moins nantis prennent plutôt le chemin du risque et du danger, car être un sportif de haut niveau « par exemple n’est pas sans danger » (Jean-Noël MISSA, 2011, p. 106).
- Sport business : ouverture au dopage et éclipse du vivre-ensemble
L’activité sportive est l’un des milieux les plus attrayants qui soit. Pour qu’un club gagne en crédibilité et en popularité aux yeux du monde des spectateurs, faudrait-il, qu’il soit capable de présenter sur la scène sportive nationale et internationale des athlètes qualifiés et performants capables de défendre les couleurs de leur drapeau. Pour relever ce challenge, notons que plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte. Il faut certes des entraîneurs rigoureux qui ont la maîtrise de leur art, pour des entraînements appropriés, mais surtout des athlètes déterminés et des conditions adéquates d’entraînements, sans compter des médecins du sport spécialisés. Une fois ce pari gagné, c’est alors qu’entrent en scène, le sponsoring, les partenariats, les financements etc. ; en vue d’accompagner les clubs et les athlètes dans une spirale de gloire qu’ils espèrent sans fin. Alors des partenariats et des contrats de sponsoring sont signés entre clubs, athlètes et structures ou boîtes financièrement influentes. Les choses sont ainsi faites, pour qu’en bénéficient les signataires. En vue d’honorer ces contrats, les athlètes se voient contraints par leurs supérieurs de mettre en danger leur propre vie, en se livrant à des pratiques peu recommandables et reconnu pour être risquées, en utilisant des produits illicites et/ou des techniques interdites par l’AMA (Agence mondiale antidopage).
Autant d’apport financier, de sponsoring et de partenariat viennent dégarnir la chose sportive en la dépouillant de son sens de l’humanité et du vivre-ensemble. Car là où le matériel et l’idée du gain abonde les relations humaines s’estompent. Plus le sponsoring est lourd et les partenariats sont importants, plus les exigences de performances sont au rendez-vous. Il est donc exigé aux athlètes de redoubler d’effort. Peu importe les moyens que ceux-ci utiliseraient, il leurs faudra remporter à tout prix la victoire. On s’aperçoit dès lors que :
L’âge du « sport business » s’est imposé. Et avec lui l’inflation salariale galopante, les transferts faramineux, le parrainage planifié, l’expansion inquiétante du nombre des agents de joueurs, le poids grandissant des multinationales et la recherche continue des retours sur investissement pour des présidents patrons. (Michel CAILLAT, 2008, p. 88).
L’athlète devient à ce moment précis tel une marionnette manipulable à souhait. Le plus aberrant à ce propos, est que, pour appuyer ses malversations, des laboratoires peu scrupuleux ont la manie de perfectionner de plus en plus les produits dopants et même d’en fabriquer sur mesure, afin de satisfaire de façon particulière les clubs, les athlètes en fonction de leurs exigences. Le vivre-ensemble serait-il en faveur de pareilles mesquinerie ? Oserions-nous y répondre par un «non» car en tout temps vivre-ensemble c’est principalement penser le bien être de l’autre et ce peu importe les situations. Henri Desgrange écrit à ce propos ; « quand tout le corps médical réuni viendrait te dire qu’ils produisent des résultats extraordinaires, tu n’en feras jamais usage. Tu gagneras des courses avec une belle santé et pas autrement. » (1894).
Dans bien des cas, les sportifs ne font pas recours à de pareilles pratiques dans le simple but de satisfaire les regards égoïstes des sponsors, des partenaires et d’éventuels parrains etc., mais principalement dans l’intention de garder leur poste dans leur club d’accueil. Ou tout simplement en vue de faire qu’à la longue le contrat qui les lie audits club soit renouvelé, ou même pour qu’un club plus offrant leur fasse la cour, de sorte à leur éviter de rester au chômage après un temps de gloire. Les débuts en tant qu’athlète dans la course aux médailles sont certes difficiles, mais paraissent un peu moins lourds que lorsque l’athlète devient un athlète planétaire, donc professionnel parmi les professionnels. Les charges augmentent et les erreurs deviennent presqu’intolérables. Aucun droit à l’erreur n’est permis. Puisque dans business, il n’y a point de sentiment ni de pitié dirait-on que vivre-ensemble et business s’opposent frontalement.
Alors, l’organisme de l’athlète fort sous le coup de la charge, de la pression, et avec les années perd son agilité et n’est plus aussi productif qu’à ces premières heures. À un moment donné de leur carrière, il est évident que «tous les coureurs avaient connu cette spirale implacable. Certains résistaient plus longtemps que d’autres, mais tous, ou presque, finissaient par céder, pour conserver leurs boulot de cycliste professionnel et par amour du vélo » (Jean-Noël MISSA, 2011, p. 98). C’est alors que le dopage fait son entrée à pas de fourmi dans ledit sport de haut niveau et en prend les rênes. La promotion du sport y contribue largement. Les médiats, les TICs y jouent un rôle faramineux, avec la globalisation des chaînes télévisées, radiographique, la presse écrite, sans oublier la percée du génie informatique. Juste en vue d’attirer l’attentions des téléspectateurs et des lecteurs dans le souci du profit et du gain, ceux-ci font le point des compétitions et aussi les éloges des tenants des titres, par la diffusion d’images audiblement commentées ou en élaborant des textes souvent un peu trop osés. Et lorsqu’un cas de dopage éclate, le sujet « fait le plus souvent la une des journaux » (François SIRI, 2002, p. 5), tous les renards de l’information, la presse écrite et audiovisuelle ne font aucune preuve de compassion pas même d’humanisme, mais se donnent les moyens de disséquer l’individu ou la structures en question, de sorte qu’il n’en reste pas un seul morceau de récupérable. Que peut-il y avoir de plus déshumanisant ?
- RÉSULTATS ET PROPOSITION DE SOLUTIONS
- Les résultats obtenus lors de notre étude se déclinent comme suit :
- Le sport à l’origine favorable au rassemblement a perdu cette particularité et constitue plutôt une barrière à la faisabilité réelle du vivre-ensemble ;
- L’attitude de rassembleur que semble avoir le sport moderne n’est qu’une vue de l’esprit une illusion ;
- Le dopage est une pratique dangereuse qui dénature le sport ;
- Vivre-ensemble, c’est la reconnaissance de l’autre et l’acceptation de cohabiter avec lui sans distinction sociale, raciale, économique et de sexe etc. ;
- Là où la soif de pouvoir et de victoire domine là s’arrête le vivre-ensemble.
- Quelques propositions de solutions :
- Prôner le vivre-ensemble en toute chose dans le sport ;
- Prôner un sport naturaliste afin d’éradiquer le dopage en milieu sportif ;
- Atténuer les sponsorings, les partenariats, les financements en vue de redonner au sport ses valeurs perdu ;
- Reconsidérer l’esprit de compétitions originel afin de favoriser à nouveau l’engouement à l’apprentissage, la complémentarité des hommes par l’utilité du groupe, la solidarité.
Conclusion
Le sport est à l’origine tout ce qu’il y a de plus favorable au vivre-ensemble. Mais de nos jours, pourrait-on avec certitude affirmer cela sans émettre de réserves ?
L’évolution biomédicale et la biotechnologie de ces dernières décennies est à l’origine d’un revirement non moins négligeable du sport dit moderne. Le souci qu’a l’homme pour le gain matériel outrepasse les limites de l’attendu. Les structures sportives sont semblables à des agences commerciales où le business est tout ce qu’il y a d’important. En un mot, le sport moderne semble être toute une machine industrielle où l’intérêt pour l’Homme n’occupe qu’une infirme partie. Les athlètes sont utilisés comme moyen en vue d’une fin très intéressée.
Dans le milieu sportif en effet, la valeur humaine s’effrite. Plus passe le temps et plus les sciences relatives au sport évoluent (biotechnologie, biomédecine, etc.). Si la question d’humanisme y est très négligeable, combien encore plus le concept du vivre-ensemble ? Car humanisme et vivre-ensemble sont des concepts frères. Aussi prétentieux que cela puisse paraître, nous dirons que, oui le sport originel fut en faveur du vivre-ensemble, mais pas celui que nous concevons aujourd’hui comme sport moderne accompagné de tous ses accessoires ornementaux.
En un mot, disons que dans la conception moderne du sport il n’y a pas de place fait à l’humanisme et même pas au vivre-ensemble.
Bibliographie
Bénédicte HALBA, Dopage et sport, Ligugé, les essentiels Milan, 1999.
François SIRI, Dopés victimes ou coupables, Dijon-Quetigny, Édition Juliette Thomas, 2002.
Henri DESGRANGE, La Tête et les Jambes, Paris, L. pochy, 1894.
Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, in livre I chapitre VIII, UGE/10 :18, Paris, 1973.
Dominique LECOURT, Claude Olivier DORON, Pascal NOUVEL, Jean-Noël MISSA ; Gérard DINE, Bengt KAYSER, Alexandre MAURON, Christophe BRISSONEAU, Patrick LAURE, Jean Paul THOMAS, Philosophie du dopage, Paris, PUF, 2011.
Michel CAILLAT, Le Sport, Edition le Cavalier bleu, Paris, 2008.
Michel CAILLAT, Sport et civilisation, L’Harmattan, Paris, 1996.
Philippe LYCTARD, « Cours d’histoire du sport » in chapitre 1, b, Université de Montpellier, de 1999-2000.
René DESCARTES, Le discours de la méthode, Paris, UGE/10 :18, 1951.
Thomas HOBBES, Le citoyen (de cive), Édition électronique (ePub, PDF) v.: 1,0 : Les Échos du Maquis, novembre 2013.
Wolfgang DECKER et Jean Paul THUILLIER, Le sport dans l’antiquité, Égypte, Grèce, Rome, Éd A&J Picard, 2004.
Webographie
Alain REY, Le grand robert de la langue française, in http://www.lerobert.com, consulté le 5 février 2016.
L’EPS : Un moyen d’apprendre à vivre ensemble, https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/…/04_03STA00126.pdf
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
14. Humanisme techno-numérique et la refondation du vivre-ensemble en Afrique,
ABOUDOU Aicha Stéphanie………………………………………………………281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
ABOUDOU AICHA STÉPHANIE
Université Alassane Ouattara
Humanisme techno-numérique et la refondation du vivre-ensemble en Afrique
Résumé
L’homme, animal politique éprouve sans cesse le besoin de garantir sa sécurité et celle de ses biens par des lois républicaines, expressions de la volonté générale. Ce désir de sécurité a pour but ultime le bien-être individuel et collectif, qui est constamment remis en cause par la guerre des intérêts au sein des États africains. La persistance de ce conflit conduit à une situation dans laquelle la corruption, le communautarisme et le mépris de l’autre sont érigés en principes de gouvernance, tant et si bien que les efforts de réconciliation butent sur les murailles des intérêts personnels. D’où l’urgence d’un nouvel humanisme.
Partant de la thèse que les cultures techniques et numériques sont les vrais gages d’une gestion transparente des affaires publiques et de la bonne gouvernance, ce texte démontre la nécessité de recourir à l’humanisme techno-numérique dans le processus de refondation postmoderne du vivre-ensemble en Afrique.
Mots clés : Humanisme, culture techno-numérique, vivre-ensemble, refondation.
Abstract:
Man, a political animal, constantly feels the need to guarantee its security and that of its possessions by republican laws, expressions of the general will. The ultimate goal of this desire for security is individual and collective well-being, which is constantly challenged by the war of interests within African states. The persistence of this conflict leads to a situation in which corruption, communitarianism and contempt for others are set up as principles of governance, so much so that reconciliation efforts stumble over the walls of personal interests.Hence the urgency of a new humanism.
Starting from the thesis that technical and digital cultures are the true guarantee of a transparent management of public affairs and good governance, this text demonstrates the need to resort to techno-digital humanism in the process of postmodern refounding of life together in Africa.
Keywords: Humanism, techno-digital culture, living together, refounding.
INTRODUCTION
Regroupés au sein d’une société et avec une pluralité de langues et de cultures, nous sommes amenés à vivre ensemble, ce qui voudrait dire vivre en harmonie. Mieux, nos différences ne doivent pas nous conduire à des actions conflictuelles, mais plutôt à penser l’avenir ensemble, en élaborant des règles pour l’harmonie et le développement de la société.
Le vivre-ensemble ne peut subsister que sur la base de principes consensuels. L’élaboration de ces principes s’oppose aux penchants agressifs de l’homme qui est capable d’attenter à la vie de son prochain. Cette triste réalité humaine, Thomas Hobbes l’exprimait en ces termes : « l’homme est un loup pour l’homme » (1982, p. 83). Ainsi, sans des lois qui limitent les actions des uns sur les autres et des autres sur les uns, la société vivrait dans une crainte perpétuelle. C’est donc par souci de sécurité et de bien-être que des principes vont être conçus. Cependant, il faut constater de nos jours que l’élaboration et le respect de ces principes alimentent des conflits dans les sociétés africaines qui aspirent à la démocratie.
La dégradation du tissu social est s’accrue, notamment avec l’avènement de la technologie du numérique avec laquelle la société toute entière connaît, un bouleversement. Et cela se perçoit dans l’utilisation que l’on fait des ensembles techno-numériques. Ce qui suscite le changement d’ordre social est l’inaccessibilité au contenu techno-numérique. L’utilisation des technologique à des fins nuisibles, a prend une certaine proportion au point où les relations sociales se détériorent. L’utilisation des techniques numériques, particulièrement l’informatique et l’internet occasionne la déchéance du vivre-ensemble en Afrique, notamment en côte d’ivoire, en ce sens qu’ils ont été facteur de propagande. ‘’Les armes numériques’’ tel que les réseaux sociaux conduisent à des affrontements. Le cas des affrontements postélectoraux en Côte d’Ivoire. À vrai dire, l’internet est utilisé pour s’informer mutuellement, organiser son milieu de vie et pour exprimer le vécu, mais des groupes terroristes s’en servent pour organiser des attentats et inciter à la haine. En effet, la révolution numérique a considérablement donné de nouvelles formes de communication dans les relations humaines. Au vu du bouleversement que connaît notre société actuelle et au regard de la culture numérique, notre objectif est de faire comprendre le vrai sens de l’humanisme techno-numérique. Pour atteindre cet objectif, nous analyserons le problème suivant : la culture numérique peut-elle contribuer à la refondation du vivre-ensemble ? Répondre à cette question reviendrait de prime abord à énumérer les principes du vivre ensemble, puis à identifier la culture numérique et son impact au sein de notre société. Pour montrer enfin comment une bonne culture techno-numérique peut sauvegarder les valeurs et contribuer à la refondation du vivre-ensemble.
- LES PRINCIPES ESSENTIELS DU VIVRE-ENSEMBLE
Dans une société pluraliste, multiculturelle et pluriethnique, il est impératif de favoriser le vivre-ensemble, résultante d’une bonne cohabitation sociale, gage de paix et de stabilité. Le vivre-ensemble est possible à condition de respecter les principes de bases formulés par la société, tel que la justice, l’égalité entre les personnes et la tolérance.
La justice, « est un principe moral de la vie sociale fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres qui peut être le droit naturel (l’équité) ou le droit positif (la loi). »[57] Elle est donc équité, impartialité et respect des lois de l’autorité. C’est pourquoi un gouvernant doit faire respecter les droits des individus au sein d’une société. Dans ce sens, toutes les personnes agissent et posent des actions par devoir et non par contrainte. La justice devient dès lors, un principe en vertu duquel tout agir humain doit être approuvé ou apprécié en fonction de la loi ou du droit naturel. Pour une meilleure vie en société, il est nécessaire d’avoir une justice capable de régler les différends entre les citoyens afin de garantir la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Cela doit se faire en sanctionnant les attitudes nuisibles à la société pour que celles-ci ne prospèrent pas, par la même occasion la société doit protéger les personnes vulnérables en limitant le pouvoir des plus forts. Toutes ces actions servent la justice sociale en contribuant à l’harmonie sociale. C’est dans ce sens que Rousseau affirme que « le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme pas sa force en droit et l’obéissance en devoir » (Jean Jacques ROUSSEAU, 2001, p. 49). Pour que la justice règne, il faut qu’elle s’étende à toutes les personnes d’une société, non à une partie qui favorise un certain type d’individus, ce qui voudrait dire une justice globale qui requiert la participation de tout citoyen au respect et à la soumission à la loi. Ce qui fera d’elle un principe universel.
Ce principe de justice doit à cet effet reposer sur une culture de la gestion transparente des biens de la société. Le bon fonctionnement des biens publics, tels que les hôpitaux et les universités relève de la participation de tous les individus de la société. À cet effet, chaque personne doit prendre part au développement de sa société ou de son pays en vue de son bien-être social, en améliorant la qualité des services et responsabiliser chaque individu à faire de la gestion transparente son crédo. Il faut que les personnes en charge de ces biens publics remplissent correctement la fonction qui leur est assignée et que ce bien puisse être accessible et profitable à tous. La gestion du bien public doit être à l’avantage de la société et non à l’avantage d’un individu. Chaque individu doit décider pour lui de ce qui le concerne, il doit participer de ce fait au débat citoyen, et pour donner sens à la démocratie qui lui permet d’exprimer sa liberté. Le vivre-ensemble nécessite l’apport de tous et l’intégration de la diversité culturelle dans le processus de développement. Les différences culturelles ne doivent pas être un frein à la construction collective de notre pays.
La reconnaissance de la diversité culturelle implique que la loi soit la même pour tous, d’où le principe d’égalité qui découle du principe de justice et énonçant que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse »[58]. La loi doit être égale pour tous et non liée à une catégorie sociale. Le principe d’égalité doit être posé comme point de départ pour une société dont la prétention est de consolider les liens sociaux sur la base des principes universels. Car, ce principe a pour but de lutter contre les formes de discriminations et les rapports de dominations qu’ils soient sociales, racistes ou autres. En raison du principe d’égalité, l’accès à un bien public doit être garanti à tous les citoyens quelques soit leur appartenance culturelle et ne doit souffrir d’aucune forme de distinction d’origine et de condition sociale. Toutes les personnes doivent de ce fait être traitées de la même manière parce que nul ne doit bénéficier des privilèges au détriment de l’autre. Il est vrai que nous ne sommes pas constitué en tant qu’être humain de la même manière du point de vue physique, mentale ou génétique, mais nous restons tous égaux en dignité et en droit.
La cohésion sociale revient à accepter toutes les personnes au sein d’une société comme ayant les mêmes droits. Reconnaître que chaque individu a le même droit que l’autre au sein d’une société, c’est favoriser le vivre-ensemble. Les droits communs à tous exigent les mêmes possibilités de vie, d’expression et de pensée autant qu’ils sont dans leur diversité. Ce qui implique le respect de la dignité humaine, le respect de soi et de l’autre, car nous sommes tous plus ou moins dépendant les uns des autres. Cette dépendance doit nous amener à agir ensemble pour améliorer nos conditions de vie, par la reconnaissance du pluralisme culturel, aboutissant au principe de tolérance.
Tolérer, c’est accepter avec indulgence une chose ou une action que l’on pourrait empêcher. La tolérance est donc une attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d’agir qui soit différente de celle qu’on adopte soi-même. Cette attitude a pour objectif la compréhension de l’autre dans le respect, l’égalité en vue d’une relation pacifiée. Ainsi la paix devient possible grâce à l’ouverture d’esprit dans la différence. Le respect mutuel permet à l’autre de s’exprimer car, celui-ci ne se sent pas exclu ni humilié par une certaine forme de supériorité de l’autre sur lui. Il apprend à communiquer sur ses réalités cachées. C’est pourquoi, lorsque l’on accepte la démarche d’être tolérant, il n’y a plus de méfiance vis-à-vis de l’autre, la pratique de la tolérance participe à l’expression de toutes les composantes de la société. La mise en pratique de la tolérance, c’est accepter que celui qui diffère de moi profite de la même liberté et laisser chacun vivre ses choix religieux, politiques et d’expression.
La tolérance nécessite que chacun jouisse des mêmes chances sociales d’un pays sans que cela ne soit teinté d’aucune forme de discrimination. Car, l’exclusion conduit à frustrer l’autre et favorise la déchéance du vivre-ensemble. Selon Aristote, dans La Grande Morale (Arléa, 1992) tolérer, c’est connaître l’autre sans pour autant perdre son identité, à travers un dialogue avec « un autre-moi » pour me comprendre et comprendre l’autre. L’objectif de la tolérance est de comprendre la complexité des relations humaines pour un vivre-ensemble harmonieux.
Malheureusement, dans toutes nos sociétés africaines qui aspirent à la paix et à la démocratie, nous faisons le constat d’un retour accentué des formes d’exclusions sociales, des nationalistes radicaux, de discriminations et bien d’autres maux. Toutes ces difficultés que vivent les membres de nos sociétés africaines sont une occasion d’alerter le plus grand nombre possible de personnes sur la nécessité de créer une société harmonieuse et juste afin de relever le défi du vivre-ensemble. C’est pourquoi il sera question pour nous d’identifier les nouveaux instruments de propagations de ses maux.
- LA CULTURE NUMÉRIQUE ET SON IMPACT DANS LA SOCIÉTÉ
Notre société a connu des changements positifs au XXIe siècle. Dans les domaines tels que la communication, l’éducation et l’économie. Ceux-ci ont occasionné de nouvelles formes de vies. Ces changements sont le fruit de la révolution des technologies numériques qui forment la culture numérique.
La culture numérique est « une expression qui fait référence aux changements culturels produits par les développements et la diffusion des technologies numériques et en particulier d’internet et du web »[59]. La culture numérique serait donc un ensemble de productions culturelles qui à partir des technologies, de l’information et de la communication (TIC) sont transmises en données, dans l’ordre de la perception sensible. Ces productions numérisées sont entre autres les documents, les images, les sons. La technique est au cœur de toutes les activités exercées par l’homme, car elle répond à la nécessité de parfaire et d’organiser nos sociétés, afin de les rendre plus productifs et efficaces. Elle obéit dans la mesure du possible aux soucis sociaux, celle de l’automatisation des activités humaines réalisées à la main, entre autres le calcul où l’on utilisait les cailloux ou bâtonnets pour compter. Aujourd’hui, avec les machines à calculer la capacité de réflexion et de mémorisation se trouve affectée parce que transférée à des degrés divers, vers des artefacts. L’ordinateur est pratiquement capable de tout faire, c’est-à-dire permet de traiter des textes, de gérer des bases de données de façon rapide à travers un réseau informatique qui relie des ordinateurs du monde entier entre eux dans l’échange d’information.
Grâce au progrès technique, l’information est à la portée de tous, « mais encore, la possibilité est offerte à chacun d’étendre sa culture, son éducation grâce à la présence des objets techniques » (Marcel KOUASSI, 2011) par un processus d’échanges d’information. Cependant, la technique dans son essence réelle a été pervertie. L’utilisation première de la technique qui était de faciliter les activités et rapports humains est corrompue à des fins plus personnelles. Cette utilisation de la technique était dite artisanale parce qu’elle répondait aux besoins du moment tel qu’abattre un arbre avec la hache ou faire cuire de l’argile au feu de bois et n’avait pas de portée industrielle et économique à grande échelle. La volonté de domination de l’homme se trouve couplée à la puissance technique et contribue au délitement des liens sociaux comme ce fut le cas de la Côte d’Ivoire.
Loin de nous de faire des polémiques, il est de notre devoir d’identifier la place des technologies numériques dans la décadence du vivre-ensemble ivoirien. L’un des éléments déclencheur de la crise ivoirienne est la télévision. C’est à la suite des images que présente la télévision lors de la proclamation des résultats définitifs en 2010 que survint la crise. Étant donné que le numérique est le chiffrage des valeurs physiques, traité par des matériels informatiques tels que l’ordinateur, les tablettes et la télévision, il est un système technologique qui permet de donner et d’échanger des informations. Dans cette perspective, toute personne qui sait se servir d’un élément du numérique a accès à l’information et la propage. Le numérique a favorisé ainsi le délitement du vivre-ensemble. L’exemple des révoltes qui ont eu lieu dans les pays arabo-musulmans entres autres la Tunisie et l’Égypte pendant la période 2010-2014. La cohésion sociale a pris un coup. Notons que les réseaux sociaux tels que Facebook, twitter et des géants du Net ont favorisé les incitations à la haine. En ce sens, l’usage de ses réseaux sont des facteurs importants dans la propagation des informations.
Les médias sociaux ont été des moyens d’obtentions et de divulgations d’informations concernant les évènements dans les pays cités plus haut. Ces informations sont pour la plupart diffusées par des blogueurs témoins d’une situation. En effet, « en 2007, le blogueur Wael Abbas a posté une vidéo montrant un homme, Emad el Kabir, victime de torture et d’abus sexuel commis par des policiers. Cette vidéo a causé un tel scandale que les autorités ont été contraintes d’arrêter et de juger les coupables » (David FARIS. M, 2012, pp. 99-109). Les réseaux sociaux sont des instruments de mobilisation et de propagation car étant des puissants relais d’informations, ils amplifient et répercutent les frustrations et revendications des populations.
La technique numérique a été conçue pour faciliter les actions humaines. Elle est née du développement des techniques soutenues par l’humanisme, doctrine philosophique qui valorise l’humain avant tout. D’où, la notion d’humanisme technique. Humaniser la technique, c’est donner à l’homme les moyens d’expressions de ses formes de vies renouvelées en permanence. La technique numérique telle qu’internet et le smart phone modifient de manière inédite la réalité sociale. Cette modification symbolise le passage de la société physique à la société numérique par le remplacement des relations humaines, comme lien d’interaction, par la société virtuelle. En effet, loin des liens physiques, nous communiquons sur la toile, caché derrière nos téléphones, nos ordinateurs, en ayant une impression réelle de partager quelque chose. Une information parvient à nos parents et amis en un laps de temps. La rapidité de partage, d’expression et d’activité qu’offre le numérique crée ainsi de nouvelles habitudes sociales.
Malheureusement elle a laissé place à toutes formes de perversions. C’est pourquoi, nous abordons le thème humanisme techno-numérique dans la consolidation du vivre-ensemble. Notre objectif est de faire comprendre le vrai sens de l’humanisme technique. La certitude placée en la technique peut être qualifié d’humaniste, car elle a pour objectif premier de répondre à la volonté des sociétés en compensant un manque. En exemple, le téléphone portable a été inventé juste pour répondre au souci de communication à distance, il permet à toute personne qui en possède, de communiquer avec n’importe qui et n’importe où. Pour plus de rapidité et pour gagner en temps, il est aussi utilisé à des fins professionnelles, entre amis ou collègues se donner des rendez-vous et faire des transactions monétaires. Le développement technologique en soi n’est pas mauvais, seulement l’objet technique peut avoir plusieurs fonctions, celui qui s’en sert à la possibilité d’en faire un mauvais usage. Le téléphone sert à communiquer, cependant il peut servir à déclencher une bombe. Dans cette perspective, il est nécessaire d’intégrer la culture technique numérique aux modes de vies de la société en vue de faciliter l’insertion harmonieuse du numérique dans le tissu social. Celle-ci consiste à s’initier aux pratiques et aux modes d’utilisations des techniques numériques, d’où l’éducation au fonctionnement du numérique.
L’intégration de la culture numérique vise une incorporation des savoirs ou connaissances techniques aux modes de vie de la société. En effet, face au progrès technique et de ses applications dans les différents domaines d’activités humaines, une éducation numérique s’impose. Avec les techniques numériques qui rationnalisent les relations humaines et nos sociétés, il implique d’avoir un minimum de connaissances de l’univers techno-numérique. Nos sociétés actuelles, pour la plupart attachées aux techniques traditionnelles connaissent un retard face à la dynamique évolutive des techniques modernes. Elles ne peuvent cependant pas jouer leur « rôle régulateur et intégrateur entre les hommes et le monde en évolution dans lequel ils vivent » (Gilbert SIMONDON, 1993, p. 52). Étant donné que les sociétés sont en déphasage avec la réalité technique en évolution, elles ne facilitent pas l’accès de la technique à la culture universelle. D’où, l’urgence de l’effort d’un minimum de connaissance des différents schèmes techniques. De plus, avec la technique numérique, comme porteuse de valeur par laquelle l’homme acquiert « la force, la rapidité et la précision de ses gestes » (Gilbert SIMONDON, 1989, p. 116), pour faire face non seulement aux obstacles environnementaux et culturels, mais aussi elle est porteuse d’opportunités économiques. L’intégration de la culture technique doit être appréhendée comme un travail symbolique à travers la connaissance effective des schèmes de la technique depuis sa genèse, sa concrétisation et sa phase contemporaine. La culture technique est donc la prise de conscience véritable de la nature des objets techniques pris dans leur fonctionnalité.
À partir du présupposé selon lequel de nos jours la technique numérique est un acteur inévitable dans la gestion du devenir de l’homme, de la société et dans la mesure ou communiquer à des milliers de kilomètres et avec des milliers d’interlocuteurs est possible sans délai, l’utilisation du numérique doit être pour nous un moyen de réconcilier nos populations, de leurs donner un motif valable pour participer à l’effort de reconquête de la cohésion sociale. Le numérique peut nous aider dans le processus de bonne gouvernance, en ce sens que le politique doit établir des initiatives qui favorisent le bon déroulement des relations sociales. En effet, « la prépondérance de l’information et la connaissance est devenue la caractéristique essentielle des pays africains […]. Parmi les TIC, internet se trouve en haut de l’échelle. Cette technologie a créé dans les pays d’Afrique, de nouvelles exigences au niveau des choix politiques nationaux » (Imen Khanchel EL MEHDI, 2011, p. 63-84). C’est pourquoi, le politique a pour devoir de mettre en œuvre des procédures transparentes à travers l’information et la discussion, pour améliorer les processus de décisions ayant une incidence sur le vivre-ensemble. Il devient dès lors, le régulateur des conflits. En ce sens, nous pensons que les TICS jouent un rôle précieux parce qu’indispensables de nos jours. Son utilisation régulière, à travers les réseaux sociaux comme facebook, twitter permet de communiquer avec la population à travers des programmes de sensibilisation sur la paix durable et ses enjeux pour la société. Elles sont un moyen de discussion entre les citoyens qui donnent leurs avis sur les décisions ou projets les concernant.
L’insertion des objets techniques dans la société a influencé positivement nos actions. En effet, non seulement elle est à portée de tous, mais aussi elle renchérit efficacement l’humanisme traditionnel. Les technologies de l’information et de la communication permettent aujourd’hui à tous d’avoir les mêmes informations au même moment et de pouvoir les partager. Le cas de la télévision à travers laquelle nous recevons une information même dans la contrée la plus reculée. Le téléphone, aussi permet de prendre des nouvelles de l’autre sans avoir à parcourir des kilomètres d’un village à un autre, en seulement quelques minutes nous sommes satisfaits. Nous bénéficions au quotidien des bienfaits des technologies sur le corps social, l’univers de la technique sert de médiation entre la nature et nous, à ce propos « le rapport entre la technique et le social n’est pas uniquement une action du premier sur le dernier. L’infiltration technique devient ‘’une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles’’ » (Marcel KOUASSI, 2001). Il existe un caractère fonctionnel de l’objet technique dans ce rôle de médiation qui est souvent méconnu par l’homme et la culture. Cette méconnaissance entraine parfois une relation conflictuelle qui devient aliénation du sujet porteur d’objet technique, dans cette mesure « il faut que le sujet qui le reçoit possède en lui des formes techniques » (Gilbert SIMONDON, 1989, p. 227), c’est-à-dire une connaissance des schèmes de fonctionnement de l’objet technique.
L’effet bénéfique des techniques numériques fait que « Simondon a confiance dans le progrès des techniques qu’il juge émancipateur non seulement par rapport aux servitudes de la nature et de la matière, mais aussi par rapport aux asservissements politiques et idéologiques des communautés particulières »[60]. En matière de politique, les réseaux sociaux permettent de respecter les principes cardinaux de la bonne gouvernance telle que la transparence ou l’obligation de rendre compte aux citoyens.
L’humanisme techno-numérique exige une parfaite connaissance de la réalité technique. Celle-ci consiste à ne pas rester en marge de la réalité technique afin d’éviter « le danger principal d’aliénation » (Gilbert SIMONDON, 1989, p. 102), celui de faire de l’outil technique un passe-temps qui nous déconnecte du monde réel et nous emprisonne au point où nous ne faisons plus qu’un avec lui. Sur ce plan elle nous empêche de réfléchir par nous-même. Il est donc nécessaire que les sociétés inculquent la culture technique à leur manière de vivre. À ce propos, Simondon propose que l’on soit éduqué, formé à la connaissance de la nature réelle des objets techniques. La méconnaissance de la nature réelle de l’objet crée un défaut de savoir et nourrit des préjugés sur celui-ci. C’est pourquoi il affirme que « cette ignorance est l’une des causes du faux rapport entre la culture et la technique » (Marcel KOUASSI, 2013, p. 122). La connaissance de la nature des objets techniques doit être une priorité. Avec elle nous obtiendrons des valeurs liées à leurs modes de fonctionnement structurels. À travers les lois d’interconnexions structurelles et fonctionnelles du technocosme harmonieuses, nous pourrons contribuer à la refondation du vivre-ensemble.
- VALEURS TECHNO-NUMÉRIQUES, COMME MODÈLE DE REFONDATION DU VIVRE-ENSEMBLE.
La culture numérique est l’ensemble des valeurs de connaissances et des pratiques qui impliquent l’usage des techniques numériques. En tant que telle, elle nous offre des valeurs qui peuvent contribuer à reformer le tissu social, le vivre-ensemble harmonieux. Certes, pour parvenir à une émergence réelle de l’Afrique, notamment celle de la Côte d’Ivoire, il nous faut pratiquer le modèle de vie des lois du système des techniques numériques.
Pour un vivre-ensemble harmonieux, la valeur qu’il convient de pratiquer est celle de la transparence. En effet, la bonne gestion des affaires publiques nécessite de nos jours que tout le monde se plie à cette nouvelle injonction qu’est la transparence. Au risque de passer pour suspect, le citoyen a le droit à une information fiable et accessible en matière de décisions. La citoyenneté est en crise parce que la population elle-même est exclue dans sa majorité, lors des prises de décisions. La transparence devient donc une obligation de rendre compte de tout ce qui pourrait impacter la vie des populations sur des questions de santé, d’emploi, d’environnement etc. Elle a pour objectif de montrer que les décideurs agissent de façon responsable pour le bien-être social des gouvernés. Les TICS participent au renforcement du tissu social en ce sens que chacun prend part aux débats, en donnant son avis ou son opinion à propos d’une décision en toute liberté. En vue de l’intérêt commun, internet a réalisé le rêve des sociétés plus libres et permet à tout le monde de participer au changement politique et social, marquée par le monopole de la prise de parole via internet en favorisant la connaissance et le sens critique des gouvernés. À ce sujet, plusieurs personnes « ont réussi à employer Internet pour coordonner leurs revendications en vue d’une meilleure représentation de leurs intérêts » (Andrew FEENBERG, 2014, p. 128), c’est cas le printemps arabe. Dans le processus de renforcement du tissu social, le citoyen exige la transparence de la part des acteurs politiques. L’exigence de la notion de transparence dans nos milieux de vie procède de la rigueur pratique. Se servir de la culture numérique comme modèle du vivre-ensemble répond au souci d’imitation du système numérique.
La rigueur pratique de la culture numérique est la soumission aux lois qui régissent tout le système technique. Cette soumission revient à adapter les règles du système numérique tel que la patience. L’exemple de l’ordinateur en est une illustration. Lorsque nous mettons en marche un ordinateur, nous patientons jusqu’à ce que tout le système informatique s’installe avant son utilisation. Si tel n’est pas le cas, il pourrait se planter ou ne pas fonctionner de manière correcte. Le système nous impose son rythme de travail, d’où la valeur de la patience de tout système informatique. La notion de rigueur numérique nous présente un monde des techniques qui conditionne les utilisateurs. En effet, dans le système fonctionnel de la technique, il existe une harmonie structurelle de sorte à ce que chaque élément fonctionne dans l’intérêt de tout le système. Ce modèle harmonieux du système numérique doit nous servir d’exemple afin de favoriser le vivre-ensemble. Chaque citoyen doit à son niveau participer au développement de son pays. La solidarité des uns et des autres doit primer sur les différences culturelles et sociales pour donner une meilleure image de la nation. L’unité et le dynamisme des individus d’une société composée favorise la cohésion sociale et donne un intérêt commun en vue de s’ouvrir au monde.
Aujourd’hui en Afrique nul, ne peut concevoir une activité en dehors de la technique numérique, à chaque activité ou domaine d’activité l’on a recourt à un objet numérique, ordinateur, smart phone, tablette androïde etc. La présence des objets numériques partout dans le monde est la preuve de leur caractère indispensable. À cet effet, nous disons que la technique est du côté de la vie parce qu’elle est un facteur d’évolution pour l’humanité. Cependant, la valeur d’universalité de la technique numérique produit un changement de mentalité et de comportement chez l’africain. Elle modifie nos rapports sociaux, nos modes de travail et l’organisation de la société tant et si bien qu’il doit y avoir des principes éthiques pour gouverner le numérique. L’éthique ici, prend sens dans l’accompagnement de l’usage du numérique qu’en font les acteurs des différentes sociétés. Certes, les lois du système techno-numérique n’ont pas besoin d’une norme sociale particulière, mais elles ont occasionné une fracture culturelle qui demande une culture numérique. C’est pourquoi, il ne faut pas nier les principes essentiels du vivre-ensemble telles que la justice, la tolérance et l’égalité, mais les refonder au regard de la culture numérique.
Le développement des sociétés repose sur l’harmonie sociale et non sur la construction des foyers de haines et de tensions qui fragilisent le tissu social. En tant que discipline visant à réguler le comportement humain au sein d’une société plurielle, l’éthique vise à accompagner les actions humaines afin de faire un bon usage du numérique et éviter la propagande d’informations qui constituent un danger pour lien social. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer la propagation de rumeurs et de fausses explications à ternir l’image d’une personne, ce qui demande une vérification des données et informations numérisées. L’usurpation de l’identité d’autrui pour planifier des arnaques. Au regard de ce qui suit, une étique de la technique s’impose. Il est vrai que « les normes techniques sont entièrement accessibles à l’individu sans qu’il doive avoir recours à une normativité sociale » (Gilbert SIMONDON, 2005, p. 264). Cependant, il est essentiel dans cette perspective de respecter l’autre dans ses actions. Bref, dans sa différence.
Les valeurs de transparence, de rigueur pratique et d’universalité du contenu numérique offert à l’Afrique qui s’ouvre à l’évolution technoscientifique, sont des moyens pour renforcer le tissu de la cohésion sociale. Nous avons pour obligation de nous inspirer des lois du technocosme numérisé en vue de favoriser un vivre-ensemble véritable.
CONCLUSION
L’homme, animal politique recherche toujours le vivre-ensemble paisible et émancipateur. Au XXIe siècle, la construction de ce vivre-ensemble ne peut se concevoir sans un recours positif, c’est-à-dire un bon usage des connaissances technologiques, informatiques ou numériques. Pour cela, il faut « redonner à la culture le caractère véritablement général qu’elle a perdu, il faut pouvoir réintroduire en elle la conscience de la nature des machines, de leurs relations avec l’homme et des valeurs impliquées dans ces relations » (Gilbert SIMONDON, 1989, p. 13). Cette tâche est essentielle dans la mesure où dans nos sociétés, le vivre-ensemble et la cohésion sociale sont conflictuelles à cause de la guerre des intérêts. Celle-ci a eu pour conséquence l’usage des outils numériques qui a impacté nos vies et celle de toute la société.
La refondation du vivre-ensemble à l’ère des technologies de l’information et de la communication doit insister sur la culture technique comme projet d’insertion harmonieux du numérique au sein des sociétés africaines. Car, le choc entre le vivre-ensemble et le numérique s’est opéré parce qu’indépendamment de toute volonté, l’usage que l’on a fait des outils numériques a impacté négativement le tissu social. Derrière ce monde d’artéfacts tellement sophistiqué et complexe qui domine nos domaines d’activités, il nous faut prendre conscience de la « réalité humaine »[61] contenue dans tout objet technique numérisé.
En promouvant les valeurs de transparence, de rigueur pratique et d’universalité ou d’interconnexions et fonctionnelles harmonieuses, l’humanisme techno-numérique offre un modèle du vivre-ensemble à l’Afrique. Pour refonder le vivre-ensemble en Afrique, nous avons l’obligation de nous inspirer des lois d’interconnexions structurelles et fonctionnelles du technocosme numérisé.
BIBLIOGRAPHIE
- Andrew FEENBERG, Pour une théorie critique de la technique, Québec, LUX Éditeur, 2014.
- Andrew FEENBERG, (Re)penser la technique, vers une technologie démocratique, La découverte, Paris, 2004.
- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
- Gilbert HOTTOIS, Gilbert Simondon et la philosophie de la « culture technique », Bruxelles, de Boeck, 1993.
- Gilbert SIMONDON, Du Mode d’existence des objets techniques, Paris Aubier, 1989.
- Gilbert Simondon, L’individuation psychique et collective à la lumière des notions de forme, et d’information, Éditions Jérôme Million, 2005.
- Jean Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, livre I, chapitre .3, Garnier-Flammarion, 2001.
- Marcel KOUASSI, Heidegger et la question du transfert des technologies en Afrique, Abidjan, CRESTE Éditions, 2013.
- Thomas HOBBES, Le citoyen, « épître dédicatoire », Garnier Flammarion, 1982.
Webographie
- Culture numérique in Https://fr.wikipedia.org/wiki/num0/009rique.
- David FARIS M, « La révolte en réseau : Le « printemps arabe » et les médias sociaux » Politique étrangère 2012/1 (Printemps), p.99-109. in www.cairn.info/revue-politique-etrangère-2012-1-page-99.htm
- Gilbert HOTTOIS, « La technoscience : entre technophobie et technophilie », in www.download2.cerimes.fr/canalu/documents/utls/download/pdf/190100.pdf, consulté le 04/06/2014.
- Imen Khanchel EL MEHDI, « Gouvernance et TIC : cas des pays d’Afrique », Recherches en Sciences de Gestion 2011/5 (N° 86), pp. 63-84, in http://www.cairn.info/revue-recherche-en-sciences-de-gestion-2011-5-page-63.htm.
- La Toupie, in www.toupie.org/dictionnaire/justice.htm.
- Marcel KOUASSI N’dri, Gilbert Simondon : « Un optimisme technique sans illusion », in www.contrepointphilosophique.ch, Rubrique Philosophique, 20 janvier 2011, consulté le 10 mars 2014.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
15. Tics et vivre ensemble,
N’DJA Koffi Blaise………………………………………………………………….281
RÉSUMÉ :
Réagissant contre le système éducatif centré sur l’instruction, Nietzsche prône une pédagogie active qui concilie l’instruction et l’éducation. Ce nouveau paradigme pédagogique vise à former des élites à travers une éducation supérieure. La pédagogie créative peut s’appliquer au contexte du Licence- Master- Doctorat où la créativité et les talents importent tant pour sa formation que son auto-emploi.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
Reacting against the educational system centered on instruction, Nietzsche advocated on active pedagogy that balances educations. This new educational paradigm aim at the making of elites through a superior education. The creative pedagogy can be used in the perspective of the Licence- Master-Doctorat system; where creativity and talents are required for one’s training and self-employment.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
N’DJA Koffi Blaise
Mail : koffiblaisendja@yahoo.fr
Contacts : 09818647/06709323
TICS ET VIVRE ENSEMBLE
Résumé :
Aujourd’hui, la technique est devenue non seulement un système mais aussi une médiation entre l’homme et son environnement naturel. Les techniques modernes, en l’occurrence, les Technologies de l’Information et de la communication (TICs) sont un moyen par excellence de formation et d’information de l’homme moderne. Ainsi, favorisent-elles le rapprochement, la socialisation des peuples. Malheureusement, nous assistons, dans nos sociétés hautement techniciennes, à l’excès d’information qui envahissent et inhibent l’esprit de l’homme moderne et qui, parfois, finit par l’intoxiquer. Or, l’intoxication crée, dans nos sociétés modernes, des psychoses, des tensions qui fragilisent parfois le tissu social. D’où la remise en cause du vivre ensemble des peuples et la dégradation de l’environnement social. La présente contribution vise à démontrer que même si les Tics permettent le rapprochement, la socialisation des peuples, elles peuvent aussi être source de tensions et de détérioration de notre environnement social.
Mots clés : environnement social, intoxication, médiation, Tics, tensions, tissu social, vivre ensemble.
INTRODUCTION
L’homme moderne vit, aujourd’hui, dans une société hautement technicienne où la technique a acquis et accroît son pouvoir de manipulation de la nature humaine. Celle-ci est même devenue un système et une médiation entre l’homme et son environnement naturel. Ainsi, les techniques modernes, en l’occurrence, les Technologies de l’Information et de la Communication (TICs) sont un moyen par excellence de formation, de rapprochement des peuples.
Toutefois, les informations véhiculées, diffusées par celles-ci ne favorisent pas toujours la cohésion sociale. Elles créent parfois des psychoses, des tensions qui tendent fragiliser le tissu social et à installer le désordre dans la société. Face au caractère ambivalent des TICs, nous sommes tentés de nous interroger : les TICs favorisent-elles véritablement le vivre ensemble ? Autrement dit, les TCIs sont-elles toujours facteur de rapprochement des peuples ? Ne seraient-elles pas parfois source d’intoxication, de haine, de dénigrement, de stigmatisation ? Ou encore, les TICs ne seraient-elles pas un moyen de manipulation psychologique ? La présente contribution se propose de montrer que les TICs ne favorisent pas toujours le vivre ensemble. Elles peuvent fragiliser, déchirer le tissu social. Dans cette perspective nous analyserons d’abord les TICs comme facteur de révolution de la communication sociale ; ensuite comme un obstacle au vivre ensemble et enfin nous soulignerons la nécessité d’une éthique des TICs pour une paix durable.
I – TICs ET RÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION SOCIALE
La communication est aussi vieille que l’humanité. Il n’y a pas une existence humaine sans communication. L’homme, dans son rapport avec ses semblables, a toujours besoin des moyens de communication. En effet, pour communiquer, hier, avec ses correspondants, il usait des moyens de communication tels que les chevaux, des courriers, des tam-tams, des lettres, etc. Ces médias anciens n’étant plus efficaces, persuasives face aux défis nouveaux de notre société hautement technicienne, l’homme moderne s’est orienté vers un nouveau, puissant et formidable moyen de communication : les TICs.
L’homme moderne recherchait l’efficacité, la précision dans la société. Aujourd’hui nous y sommes. D’autant plus les TICs de par leur puissance extraordinaire, persuasive et obsessionnelle ont révolutionné l’univers de la communication. L’homme semble ainsi gagner le pari de la communication rapide et opératoire. Grâce aux TICs le monde est devenu un village planétaire. Les progrès apportés par les TICs, en matière de communication, a modifié profondément les relations sociales et la médiation de l’homme moderne à son naturel et artificiel. Ainsi, l’homme peut actuellement s’adresser de façon instantanée, directe au monde entier et, réciproquement, ces correspondants à travers le monde entier peuvent s’adresser à lui. Il s’informe en temps réel sur tout ce qui se passe autour de lui et dans le monde. À dire vrai, on sonné glas aux médias anciens. Elles ont aucun doute démocratisé la parole et information. La démocratisation de la parole est l’une des particularités des TICs. On pourrait, à cet égard, dire avec Jacques Ellul qu’ « il n’y a plus de sacré, il n’y a plus de mystère, il n’y a plus de tabou, (il n’y a plus de secret) » (2008, p. 130). Tout cela provient de l’autonomie des TICs.
En somme, l’univers de la communication est drastiquement révolutionné grâce aux TICs. Les conséquences des nouveaux médias que sont les TICs, notamment Internet sont réelles et lourdes dans la société nouvelle ; la société numérique. À cet effet, on pourrait dire que les nouveaux médias ont un pouvoir incontestable et indubitable. Actuellement, grâce à Internet chacun est devenu son propre journaliste. Nous pouvons nous informer et même diffuser les informations directement par le biais de notre téléphone, Ipad, Smartphone, ordinateur. Cela revient à dire que l’on peut librement diffuser ses propres informations et faires ses propres commentaires sur la Toile. Michael Schudson, à cet effet, souligne dans son ouvrage Pouvoir des médias journalisme et démocratie que le journalisme serait provisoirement aboli et chacun serait son propre journaliste. Pour lui, les enfants, les jeunes, les indigents, les ermites retranchés dans la solitude et même les criminels du fond de leur prison et les personnes âgées dans leur maison de retraite peuvent emmètrent et recevoir des messages. Désormais, dans la société nouvelle,
Les gouvernants, hommes d’affaires, groupes de pression, candidats aux élections, chefs religieux et responsables syndicaux informent directement le citoyen directement par le canal de son ordinateur personnel. (…) Le citoyen se branche sur la source d’information de son choix parmi toutes celles que lui offre le réseau informatique. (…) Il est tout aussi bien producteur que consommateur de l’information (Michael SCHUDSON, 2001, p. 1).
À vrai dire, le paradigme a changé. L’on est à la fois producteur et consommateur de l’information. Ce changement de paradigme montre clairement que les TICs ont, de façon extraordinaire, révolutionné la communication. Car, la révolution de la communication s’est soldée par la démocratisation de la parole. Toutefois, il convient de noter que les TICs ne progressent pas sans régression, sans ombre. Quelles sont alors les implications des TICs sur la cohésion sociale ?
II. LES TICs, UN OBSTACLE AU VIVRE ENSEMBLE
Les TICs en tant que supports techniques de la propagande[62] et de la manipulation psychologique sont un moyen par excellence de la fragilisation du tissu social. Aujourd’hui, les moyens techniques sont entrés dans le monde politique. Le politique, le propagandiste use de la propagande pour manipuler psychologiquement l’homme. Michael Schudson conscient de la manipulation psychologique de la masse du politique par le canal des TICs s’interroge en ces termes :
La politique (…) est-elle totalement soumise à la télévision ? La manipulation cynique des images et des sons a-t-elle réussi à mettre le public sous hypnose ? Les politiciens ont-ils court-circuité le mécanisme qui confie au citoyen le pouvoir de décision ? Ont-ils anesthésié les parties de son cerveau qui lui permettent de juger de la substance des choses, de sorte qu’il ne soit plus sensible qu’aux seules apparences ? La politique (…) est-elle aujourd’hui soumise au règne de l’image ? (2001, p. 157)
Aux yeux de Schudson, les politiciens usent des images et des sons produits par les TICs pour manipuler à outrance le public. Ces images envoûtantes deviennent comme une drogue pour celui-ci. En réalité, la publicité politique consiste à convaincre un grand nombre d’individus. En effet, la publicité et la propagande, en agissant sur le subconscient de l’individu formate l’esprit de celui-ci. La propagande, à la vérité, fixe l’état d’esprit des hommes. Elle manipule les hommes. « Lorsqu’elle proclame la liberté, elle se contredit elle-même. Le mensonge est sa seconde nature. (…) La propagande est anti-humaine » (Max HORKHEIMER, 1974, p. 278). Ces moyens techniques obsessionnelles amenuisent la liberté de l’individu et suppriment son esprit critique. À toutes occasions et partout, le propagandiste fait passer les images et les messages envoûtants sous les yeux des hommes modernes. Ces images et ces informations accompagnées de bruits détournent l’attention, l’esprit critique de l’être humain. Par conséquent, il est totalement absorbé et devient lui-même un objet de propagande. Comme le souligne Ellul dans La Technique ou l’Enjeu du siècle :
Dans la rue, affiches, haut-parleurs, cérémonies, meetings. Dans son travail : prospectus, mobilisation des entreprises ; dans ses distractions : cinéma, music-hall. Chez lui : presse et radio. Tout converge vers le même point, tout a la même action sur l’individu. Les moyens employés deviennent tellement énormes qu’il ne s’en aperçoit plus (2008, p. 331).
Aux yeux d’Ellul, la propagande est un attentat psychologique. L’on prend ici le subconscient de l’individu en otage. Il est submergé d’images, d’informations. On procède par la répétition incessante, voire indéfinie des mêmes expressions, des mêmes faits et des mêmes images. Cette attitude conduit à la désinformation, sinon à l’intoxication. L’intoxication, pour ainsi dire, ne rapproche pas les peuples. Bien plus, elle fragilise, déchire le tissu social dans la mesure où elle crée la psychose et installe parfois la méfiance, la tension entre les hommes.
De plus, les TICs sont un espace de liberté d’expression. Elles démocratisent la parole. Actuellement tout le monde s’exprime librement grâce à elles. En effet, nous nous exprimons sans cesse sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cette nouvelle opportunité que les TICs nous offrent au niveau de la communication n’est souvent pas utilisée à bon escient. Certaines praticiens et usagers des TICs surtout d’Internet véhiculent, diffusent parfois des rumeurs, des messages de haine sur les réseaux sociaux qui favorisent des soulèvements populaires. Avec les internautes, en effet, nous assistons à la propagandation des rumeurs sur Internet, à la surveillance informatisée et à l’harcèlement numérique. Les internautes diffusent les messages qui installent des psychoses dans l’esprit des populations. Ces psychoses, troubles psychiques créent souvent des méfiances entre les citoyens. Cela se solde par des tensions qui amenuisent les relations humaines. En ce sens, l’environnement social se dégrade, s’effrite. Les tensions ont des implications sur le vivre ensemble puisqu’elles affectent directement ou indirectement les hommes et marquent leur conscience. Autrement dit, les tensions causées par les intoxications ont des conséquences désastreuses ; elles ont pour conséquence parfois des pertes en vie humaine. La révolution numérique ouvre une nouvelle ère de communication. Tout le monde est presque devenu professionnel de communication. On communique à outrance sans répit. On peut dire que chacun est devenu journaliste à l’ère du numérique. Nous utilisons parfois des facteurs internes de l’homme, à savoir le ressentiment ou la haine pour détourner la conscience collective ou individuelle. Dans le monde politique, nous assistons, en effet, à la stigmatisation de tel ou tel adversaire politique. On diffuse journellement des messages, des images de haine, d’humiliation, de frustration sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. Cette attitude est une sorte de machination que l’on met en place pour stigmatiser, mépriser, étiqueter l’autre. Dans le domaine politique, l’on procède à la fixation collective de haine, de dénigrement, d’humiliation, de stigmatisation sur tel ou tel adversaire politique. L’on diffuse des messages de dénigrement, de haine, frustration, de calomnie sur les chaines de télévision, sur les réseaux sociaux. C’est ce que semble expliquer cette indication lumineuse d’Ellul dans La Technique où l’Enjeu du siècle : « L’on désigne l’adversaire comme l’auteur de tous les maux, de toutes souffrances. Tel le juif dans le système nazi, tel le bourgeois dans le système communiste. » (2008, p. 332). Ici, l’on manipule le subconscient de l’homme moderne. L’on, à vrai dire, manipule le ressentiment en trouvant toujours un bouc émissaire. La propagande, à cet effet, nous offre un bouc émissaire, sur lequel chacun, sinon le peuple reporte tout le mal de la société, tout son péché. L’ennemi est tout près ; il n’est plus loin. Il est désigné par la propagande. En réalité, les TICs sont parfois une porte d’entrée du désordre, des conflits dans les sociétés nouvelles.
Nous cherchons toujours à authentifier, justifier nos actes. Ainsi, nous sommes absolument bons et l’adversaire est complètement mauvais. On ne trouve aucune valeur et aucune qualité en lui. Une telle technique de manipulation ne peut que conduit à la « mort social » de l’autre, à une « pathologie sociale » au sens honnethien du terme. Cette attitude fragilise le tissu social et se termine parfois par des conflits. Aux, yeux de Axel Honneth, l’adversaire est moralement, psychologiquement, socialement tué par la propagande. L’adversaire est perçu comme le mal, la gangrène de la société dans la mesure où il est « la cause du malheur, de l’incarnation du mal » (Jacques ELLUL, 2008, 332). Cette manière d’étiqueter, de stigmatiser l’autre met en cause le vivre ensemble, la cohésion sociale. Nous tombons donc dans la «société du mépris » (Axel HONNETH, 2000, p. 32) où la haine, la violence, l’intolérance s’installent dans nos cœurs. Par conséquent, survient l’état de guerre de tous contre tous au sens hobbesien du terme. L’environnement social se détériore, se dégrade profondément dans ces conditions. En un sens, nous assistons à la dissolution des relations humaines. Sans nul doute, nous avons gagné en matière de communication, mais nous perdons au niveau social.
Il s’ensuit qu’à l’ère des TICs, nous savons plus communiquer. Nous communiquons mal. Nous constatons un déficit de communication. Nous communiquons partout et à toutes occasions avec nos amis sur Facebook, au téléphone et même nous transposons, délocalisons notre bureau dans nos domiciles familiales. Ainsi, nous sommes toujours occupés en telle enseigne que nous coupons tout lien, contact physique autour de nous. Nous sommes parfois insensibles, réfractaire à tout ce qui relève de notre environnement ambiant. Nous sommes toujours connectés à Internet, mais déconnectés des réalités sociales. Nous pouvons dire que nous passons plus de temps devant les « tabernacles modernes », la télévision, l’ordinateur, le téléphone, etc. Nous ne sommes plus en communion parfaite avec les autres autour de nous. L’environnement social est mis en mal. La proximité et la sociabilité tendent à disparaître. Les contacts physiques tendent à s’éteindre comme la flamme du feu de paille. La communion vraie n’est plus. Elle s’est éclipsée. Cette éclipse de la communion met en mal le vivre ensemble. Nous créons chaque jour un fossé, un mur d’insensibilité entre nous. Internet est devenu notre nouvel ami. Il est la médiation entre les hommes de notre temps. Nous subissons donc un nouvel ordre social. Les réalités sociales sont pour ainsi dire reléguées au second plan. Nous ne discutons plus puisque nous n’arrivons plus à écouter l’autre. Chacun est retranché, isolé dans son bureau, dans laboratoire. Les réalités sociales sont devenues virtuelles, pourrait-on dire.
Horkheimer et Adorno ont raison de dire dans La dialectique de la raison que les moyens de communications modernes isolent les hommes : « Le progrès sépare littéralement les hommes. (…) Les moyens de communication isolent les hommes physiquement. (…) Les communications établissent l’uniformité parmi les hommes en les isolant » (1974, pp. 236-237) Pour Adorno et Horkheimer, des moyens de communication tels que le speaker, la publicité, le cinéma, la voiture sont une source d’isolement des hommes. Ces anciens moyens de communication sont amplifiés aujourd’hui par les TICs. En matière d’isolement des individus, par exemple, le discours du speaker s’imprime dans le cerveau des hommes et les empêche de se parler, de communiquer.
Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que les TICs ne garantissent pas toujours la cohésion sociale. Elles sont parfois synonymes de tensions, de conflits. Cependant, ne serait-il pas impératif de les réguler, de les accompagner éthiquement afin qu’elles redeviennent davantage un facteur de cohésion sociale ?
III UNE ÉTHIQUE DES TICs POUR UNE PAIX DURABLE
Les TICs de par leur pouvoir de persuasion et leur caractère ambivalent, font sombrer parfois l’humanité dans les calamités triomphant partout (Max HORKHEIMER et Théodor ADORNO, 1974, p. 21). Ainsi, nous jugeons nécessaire de les réguler, les encadrer éthiquement afin qu’elles soient véritablement un facteur de paix et de rapprochement des peuples. Mais comment cela pourrait-il se faire de façon lucide quand on sait que les effets du progrès technique sont imprévisibles ? Pour Ellul, la responsabilité et la prévoyance doivent être au cœur de nos actions. La prévisibilité étant impossible, nous devons manifester désormais la prévoyance. La prévoyance chez Ellul consiste à prendre conscience qu’il peut toujours avoir de possibles accidents de grande étendue dans nos actions techniciennes. Comme le souligne partrick Lagadec, la prévoyance commence lorsque nous acceptons que nous sommes tous dans une civilisation de risque.
La question de la responsabilité ici n’est pas seulement individuelle ; elle est à la fois individuelle et collective. Aux yeux d’Ellul, la responsabilité individuelle est fondamentale. Il faut désormais poser le problème au sommet, c’est-à-dire au pouvoir public là où la décision est prise : « Il faut commencer par rendre responsable les dirigeants. C’est par la tête que pourrit le poisson » (1988, p. 337). On remarque que pour ce penseur, la responsabilité incombe en premier lieu les pouvoirs publics.
Hans Jonas aborde également la question de la responsabilité. L’éthique de la responsabilité chez Jonas repose sur l’heuristique de la peur. Elle permet d’anticiper les risques, les dangers qui accompagnent le progrès technique. Quant à Hottois, l’éthique de la responsabilité doit être ouverte et évolutive. Il nous invite à recourir à la prudence. Car, c’est avec prudence et responsabilité que nous pouvons créer dans notre société actuelle un cadre social et gérer l’avenir de l’humanité. Gilbert Hottois nous propose dans Le paradigme bioéthique les voies de l’éthique technicienne.
Pour Hottois, la voie de l’éthique est l’ultime moyen pour contrôler éthiquement l’essor de la technique. Cette voie de l’éthique favorise le dialogue entre la technique et le symbole. Le dialogue permettra ici de canaliser le progrès technique afin que la technique co-évolue avec les valeurs. Sous cet angle, Hottois utilise la voie moyenne comme la médiane entre les technophobes et les technophiles. La voie moyenne, en effet, est le lieu de la discussion. La discussion nous conduit à un consensus. Et le consensus nous permettra de trouver le juste milieu afin de ne pas nuire à autrui. Ce qu’il importe de souligner est que dans la discussion tous les acteurs doivent être pris en compte : la minorité, le singulier et la majorité. Cependant, comment par la voie moyenne articuler le symbole et la technique ?
La voie moyenne, dans le philosopher de Hottois, s’intéresse, d’abord à la conservation de l’homme-nature. Cela s’explique par l’imprudence des hommes dans la société technicienne. D’autant plus l’imprudence nous a conduit dans la situation où le symbole tend à disparaître. À vrai dire, le pouvoir de la technique a altéré notre environnement naturel et social. Nous payons, à cet effet, cher notre imprudence aujourd’hui. C’est pourquoi la deuxième voie de l’éthique, la conservation de l’homme-nature nous appelle à la responsabilité de sorte nous gérions de façon raisonnée et éclairée le vivant (humain et non-humain). Cette gestion raisonnée du vivant s’explique par le fait qu’il existe fondamentalement une coopération soit de proie soit de prédation entre les êtres vivants. Il est alors important, urgent d’interpeller les hommes afin de sauver l’essentiel. Comme le souligne Hottois, aujourd’hui « il s’agit d’appels éclairés qui témoignent seulement du sens de la responsabilité collective des hommes l’égard des menaces qui pèsent sur l’environnement et qui les mettent en danger la qualité de vie des générations futures, voire la survie même de l’humanité » (Gilbert HOTTOIS, 1990, p. 133).
Concrètement, face aux problèmes éthiques qui affectent l’environnement social, nous proposons la mise en place d’un comité d’éveil et d’éthique national, sinon international des TICs. Ce comité aura pour mission de veiller à assurer non seulement une réflexion éthique sur le progrès hallucinant et fulgurant des TICs, mais aussi de proposer des recherches permettant de faire face aux éventuelles dérives et risques possibles.
Aussi, ce comité d’éthique aurait-il la charge de réguler, filtrer, traiter les informations en respectant les valeurs éthiques et la charte de la rédaction afin de censurer les informations qui ne respecteraient pas les règles de l’art. Le comité d’éthique doit être de nature pluridisciplinaire, c’est-à-dire constitué des chercheurs du domaine des TICs, mais aussi des philosophes, des juristes, des économistes, des sociologues, des anthropologues, des industriels, etc. Nous jugeons aussi nécessaire de bien former, éduquer et instruire la population en général et en particulier les apprenants et la jeunesse. Cette formation devrait être prise en compte dans les programmes d’enseignement des apprenants du primaire en passant le secondaire jusqu’à l’Université. Par ailleurs, nous proposons des Masters d’éthique des TICs.
De plus, il faut sensibiliser les chercheurs et les apprenants sur les enjeux éthiques des TICs. Il s’agira de les sensibiliser sur les questions éthiques liées à celles-ci. Ici, nous proposons d’organiser des colloques nationaux et internationaux pour sensibiliser les citoyens sur ces questions. Les conclusions de ces colloques pourraient être mises au service du politique. Il faut aussi renforcer l’identification des utilisateurs d’Internet afin de faire la lumière sur la traçabilité des informations en remontant jusqu’à l’origine de celles-ci. Il serait important de créer des lois nationales et internationales sur les TICs, le site et la chaine des enfants. Nous veillerons à l’encadrement des enfants afin qu’ils ne s’exposent pas sur Internet et la télévision.
QUE CONCLURE !
Comme on le voit, les TICs ont modifié, transformé profondément la vie des hommes et la communication sociale. Mais elles ont engendré de nombreux problèmes dans notre société actuelle. Car, elles ne favorisent pas toujours la cohésion sociale, l’intégration des peuples. Elles sont parfois source de tension, de violence. À cet effet, il est, nécessaire de nous pencher infailliblement sur l’éthique des TICs afin de réguler celles-ci pour ne pas que le bébé soit noyé avec l’eau de bain, voire « tuer la poule aux œufs d’or ». C’est à ce prix que les TICs redeviendront davantage un facteur de cohésion sociale, de rapprochement des peuples. Il est donc urgent de former, de sensibiliser, d’éduquer les acteurs des TICs et les populations sur les problèmes éthiques liés au progrès fulgurant des TICs.
BIBLIOGRAPHIE
– André LALANDE, Vocabulaire critique et technique de la philosophie, Paris, 2e édition Quadrige 2006, 1323p.
-Hans JONAS, Le principe responsabilité, traduit par Jean Greisch, Paris, Cerf, 1991, 336p.
– Hans JONAS, Pour une éthique du futur, traduit par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Paris, Desclée De Brouwer, 1998, 159.
– Jacques ELLUL, La Technique ou l’enjeu du siècle, Économica, 1954, 423p.
– Jacques ELLUL, Le bluff technologique, Paris, Hachette, 1988, 486p.
– Jacques ELLUL, Sans feu ni lieu, Paris, Table Ronde, 2003, 369p.
– Jacques ELLUL, La parole humiliée, Paris, La table ronde, 2OI4, 426p.
– Lionel POTON, philosophie des droits de l’homme, Paris, Vrin, 1990, 207p.
-Max HORKHEIMER et Théodor ADORNO, La dialectique de la raison, Paris, Traduit par Eliane Kaufholz, Gallimard, 1974, 281p.
– Michael SCHUDSON, Pouvoir des médias journalisme et démocratie, Paris, trad. de l’américain par Monique Berry, Nouveaux Horizons, 2001.
– Sylivie FAUCHEUX et al. TIC et développement durable, Bruxelles, De Boeck, 2010, 222p.
– Gilbert HOTTOIS, Le paradigme bioéthique, une éthique pour la technoscience, Bruxelles, De Boeck, 1990, 216p.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
16. Le vivre-ensemble : perspectives du contrat social dans le philosopher lockéen,
KOUMA Kouassi Serge Arnaud……………………………………………….….281
RÉSUMÉ :
Réagissant contre le système éducatif centré sur l’instruction, Nietzsche prône une pédagogie active qui concilie l’instruction et l’éducation. Ce nouveau paradigme pédagogique vise à former des élites à travers une éducation supérieure. La pédagogie créative peut s’appliquer au contexte du Licence- Master- Doctorat où la créativité et les talents importent tant pour sa formation que son auto-emploi.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
Reacting against the educational system centered on instruction, Nietzsche advocated on active pedagogy that balances educations. This new educational paradigm aim at the making of elites through a superior education. The creative pedagogy can be used in the perspective of the Licence- Master-Doctorat system; where creativity and talents are required for one’s training and self-employment.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
KOUMA Kouassi Serge Arnaud
Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)
Courriel : koumarnoh@yahoo.fr
Contacts : 07 990 352 / 05 156 110
LE VIVRE-ENSEMBLE : PERSPECTIVES DU CONTRAT SOCIAL DANS LE PHILOSOPHER LOCKÉEN
Résumé : Le contrat social est la cheville ouvrière de la pensée politique de Locke. Si l’homme est par essence sociable, il n’est pas toujours donné que sa vie en société soit paisible. Le contrat social vise donc à former une société civile garante de la vie, de la liberté et des biens d’autrui qui, du reste, demeure précaire à l’état de nature. Ainsi, le contrat social apparaît comme une panacée aux crises de la vie en société. Penser le vivre-ensemble, partant de cette conception de Locke, c’est penser les conditionnalités de la vie en société. L’objet de cet article est de montrer, en s’appuyant sur la pensée de Locke, que le contrat social appelle au vivre-ensemble par-delà son libéralisme qui coïncide avec l’individualisme.
Mots-clés : Contrat social ; État de nature; individualisme; Libéralisme; Société civile; Vivre-ensemble.
Abstract : The social contract is the linchpin of the political thought of Locke. If the man is by essence sociable, it is not always given that its life in society is peaceful. The social contract thus aims at forming an civil society guarantor of the life, freedom and goods of others which, remainder, remain precarious with the state of nature. Therefore, the social contract seems a panacea with the crises of the life in society. To think the living together, on the basis of this design of Locke, it is to think the conditionalities of the life in society. The object of this article is to show, relying on the thought of Locke, which the social contract calls with the living-together beyond his liberalism.
Keyswords : Civil society; individualism; Liberalism; Living together; Social contract; State of nature.
Introduction
Parler du Vivre-ensemble dans une atmosphère de mondialisation où aucune frontière ne résiste à la volonté d’aller vers la république des différences ( Guerard de LATOUR, 2009) paraît fortuit. Tous les pays sont interdépendants et (ré) liés les uns aux autres par divers moyens. La notion de village planétaire est exaltée pour nous dire que nous vivons une communauté de destins au-delà de l’hétérogénéité de nos cultures et de nos différences raciales. Pourtant, ces mêmes différences sont utilisées à d’autres desseins pour semer des conflits de tout genre qui peuvent remettre en cause les fondations de nos sociétés. Or, Vivre-ensemble suppose vivre en société et partager des valeurs communes. Quelle société peut-elle alors être le terreau du vivre-ensemble dans ce cas ?
Pour John Locke, c’est la société civile issue d’un contrat social qui est la condition sine qua non du vivre-ensemble véritable. En fait, la société civile est, chez lui, le résultat d’une convention passée entre les hommes pour sortir d’un état pré-politique précaire. Mener une réflexion sur la société civile ne saurait se faire sans épuiser la question du contrat social car « le contrat [social] marque le premier stade dans [le] développement de la société politique » (Alexi TADIE, 2003, p. 12). Du latin « contractus » qui veut dire « resserrer », le contrat social sous-entend que pour qu’il existe, il faut qu’il y ait deux volontés individuelles au minimum. Il servira de maillage de leurs intentions communes pour établir une société civile consentie et paisible. Qui plus est, le contrat social invite à une co-habitation harmonieuse parce qu’il ne vise que la sauvegarde de la liberté, de la vie et des biens de ceux qui auront consentis à le contracter. Le contrat social lockéen est conçu non pas par des groupes constitués, mais par des individus autonomes. Cela met en évidence son libéralisme, selon lequel, la finalité du contrat est « de permettre à l’individu de réaliser les fins qui lui sont propres » ( Alain POLICAR, 2012, p. 32). A priori, la pensée de Locke est paradoxale parce qu’il soutient l’entrée dans la société civile en même temps qu’il revendique des droits individuels. Cet « volte-face » a valu au libéralisme d’être taxé d’égoïsme par les communautaristes et les républicanistes. Tout ce qui se rapporte au libéralisme se réduirait à ce que Macpherson a appelé individualisme possessif. Une tendance qui vise « à considérer que l’individu n’est nullement redevable à la société de sa propre personne ou de ses capacités, dont il est, au contraire, par essence, le propriétaire exclusif » (Crawford Brough MACPHERSON, 2004, p. 18). Le souci premier de Locke, dans sa démarche, n’est pas de construire une société civile sur la base d’une déliaison individualiste. Il fait la promotion d’une société civile faisant de l’individu une entité autonome. L’individu de Locke est « naturellement sociable sans être pour autant naturellement politique » (Philippe RAYNAUD, 2010, pp. 21-33). Son essence est réductible au vivre avec autrui. Cependant, pour éviter les abus et persécutions, cette vie commune ne saurait se faire sans encadrements et sans lois.
Ainsi dit, la problématique du vivre-ensemble s’inscrit dans une dynamique contractualiste d’ascension libérale. Dès lors, comment à partir du contrat lockéen, penser le vivre-ensemble quand nous savons que Locke est un penseur qui prône le libéralisme ? Pour y répondre, nous allons examiner les questions subsidiaires suivantes : Sur quel doctrine s’appuie fondamentalement le vivre-ensemble, quand la société se présente comme gagnée à la ferveur individualiste ? Le libéralisme est-il un obstacle au contrat social ? Le vivre-ensemble ne peut-il pas se penser à partir du contrat social lockéen ?
Cette contribution, dans une démarche analytique et herméneutique, recherche, premièrement, à revisiter la conception lockéenne du contrat social pour saisir la quintessence de celle-ci. Deuxièmement, à montrer que le libéralisme, au-delà des critiques, peut apporter sa pierre à l’édifice du vivre-ensemble. Troisièmement, à montrer que le contrat social, telle que pensé par John Locke, pourrait se saisir comme une réflexion fondamentale sur le vivre-ensemble.
- Le contrat social chez John Locke
L’idée de contrat social, chez Locke, est la fondation de sa pensée politique. Le contrat social est une convention, « celle par laquelle tous s’obligent ensemble et mutuellement à former une société et à constituer un seul corps politique » (John LOCKE, 1977, p. 82). C’est dire que le contrat social est le fruit de la volonté des hommes de s’unir dans un cadre commun de vie. Si le contrat est à l’origine de la société civile, c’est qu’il a existé une période pré-contractuelle : c’est l’état de nature. Ainsi, la société civile n’est pas une société née ex abrupto. Elle remédie aux défauts de l’état de nature dans la gestion des hommes. L’existence du contrat détermine et entérine le passage de l’état de nature à la société civile. Qu’est-ce que l’état de nature ? Pourquoi l’homme l’abandonne-t-il au profit de la société civile ?
Partout dans le monde, à quelques très rares exceptions près, les hommes vivent dans des sociétés politiques. Le phénomène de politisation des sociétés humaines a donné aux philosophes de tous les temps matière à penser. En effet, pour retracer une « généalogie réflexive et critique » (Simone GOYARD-FABRE, 1996, p. 11) de la politique[63], Hobbes, Locke et Rousseau, ont élaboré des conjectures en vue de retrouver les conditions dans lesquelles serait née la politique. Pour eux, tout est parti de l’état de nature, un état pré-politique. À la différence de Hobbes, qui voyait en cet état, un état de violence et de sacrifice de la liberté, Locke le considérait comme un état paisible et libre. C’est un « état où[les hommes] sont parfaitement libres d’ordonner leurs actions, de disposer de leurs biens et de leurs personnes comme ils l’entendent(…) sans demander l’autorisation d’aucun autre homme ni dépendre de sa volonté » (1977, p. 6). L’état de nature est donc un état de liberté absolue, d’égalité puis qu’il n’y existe pas de subordination entre les hommes.
Toutefois, l’état de nature ne saurait être un état de licence où toute action, parce qu’elle est voulue par quelqu’un, peut être exécutée sans limite. Cette liberté est encadrée par ce que Locke appelle loi naturelle, qui, évite à « tous les hommes de violer les droits d’autrui et de se faire du mal entre eux » (1977, p. 78). Elle entretient un minimum de lien entre les hommes pour leur éviter de sombrer dans un état de guerre qui, « est un état d’inimitié et de destruction » (John LOCKE, 1977, p. 83). Alors, la loi naturelle est une entente tacite dans l’état de nature qui oblige
Les hommes de façon absolue, parce qu’ils sont hommes, même en l’absence de relations établies, d’accord solennel entre eux sur ce qu’ils feront ou ne feront pas, mais notre inaptitude à nous procurer nous-mêmes, en quantité suffisante, les objets nécessaires au genre de vie que notre nature désire, une vie à la mesure de la dignité humaine. (John LOCKE, 1977, p. 83)
À en croire la version lockéenne de l’état de nature, les conditions pour y rester sont réunies a priori. D’où vient-il, dans ce cas, que les hommes (se) décident à quitter une condition si heureuse pour entrer dans la société civile ? Locke est conscient du fait, qu’à l’état de nature, la possibilité que l’on viole la loi naturelle existe parce que tout le monde a le droit d’« empêcher de nuire, obtenir réparation des dommages » ( Philippe NEMO, 2002, p. 309) par ses propres moyens. Dans ce cas, comment (se) rendre justice sans créer d’injustice quand nous savons que l’amour propre rend l’homme partial en sa faveur ou en faveur de ses amis ? C’est bien cela qui incite à sortir de l’état de nature pour entrer dans la société civile parce qu’il n’y existe pas « par nature aucune supériorité ni aucune juridiction d’un homme sur un autre »( John LOCKE, 1994, p. 7).
Donc, à l’état de nature, la loi naturelle, pour réparer une injustice est fondée sur quoi ? La loi naturelle se fonde sur la raison. Loin d’un rationalisme triomphant, il est conscient que la raison humaine est faillible. C’est pourquoi, pour lui, seule « la raison éclairée et prudente qui, respectueuse, des desseins de Dieu qui porte en elle la « la loi de nature », est apte à sortir l’homme de la misère dont l’affligent les assauts de la passion » (Simone GOYARD-FABRE, 1986, p. 47). En cette raison, fondamentalement raisonnable, il voit le reflet de l’image de Dieu, qui oblige l’homme et le soutient pour le mettre à l’abri des dérives passionnelles. De facto, l’on ne devrait pas assister à des conflits qui mettent l’avenir de l’humanité en jeu. Dans les faits, les hommes ne consultent pas toujours leur raison, et se laissent, parfois, guider par leur passion. Le risque de bafouer mutuellement leurs droits et d’entrer en conflit est grand.
Pour l’éviter, la raison prescrit de rentrer dans une nouvelle forme de société, la société civile. Cette dernière a « pour caractéristique d’être placée sous l’autorité d’un État, dont la fonction est de pacifier les rapports humains en imposant, par la force si besoin est, l’obéissance à la loi naturelle et le respect mutuel des droits naturels » (Michel BIZOU, 2010, pp. 35-56). La loi naturelle et les droits naturels sortent ainsi de la précarité pour être sécurisés. La société civile rompt totalement d’avec l’état de nature dans la mesure où elle règle les problèmes de l’état de nature. Les lois sont écrites et acceptées par tous, car le consentement est un préalable pour entrer dans la société civile. Un juge impartial est établit et c’est l’État. En instaurant donc l’État, à qui le rôle de juge impartial est attribué, les hommes se mettent au-dessus des partialités individuelles :
« Ce qui fait que les hommes sortent de l’état de nature et entrent dans une république, c’est donc l’instauration, ici-bas, d’un juge investi de l’autorité de trancher toutes les controverses et de réparer les torts susceptibles d’être faits à tous les membres de la communauté » (John LOCKE, 1977, p. 64).
Le passage de l’état de nature à la société politique consiste alors à confier à l’État, c’est-à-dire à la communauté, son droit de juger de l’application de la loi naturelle aux cas particuliers. C’est un transfert de droit et c’est exactement ce que Locke nomme le contrat social. Ce transfert de droit de juger à la communauté règle le problème théorique de l’impartialité du jugement. Il laisse en suspens le problème pratique de l’organisation du lien social sous l’autorité d’un juge impartial.
En effet, la communauté est encore une instance sans autorité et sans structure, dépourvue d’institutions qui lui permettraient de prononcer des jugements et d’en assurer l’application. C’est pourquoi il faut que la communauté arrive à la formation d’un gouvernement, en se choisissant des chefs qui feront fonctionner l’État. Or, en instituant l’État comme structure du gouvernement, l’on assiste à son passage de contrat à celui de mandat ou de trust[64]. En ce sens, l’État est le mandataire de la communauté et il lui est subordonné. Cette subordination annonce le libéralisme de Locke car, « le pouvoir de l’État doit être limité parce que, justement, au-delà d’un certain point, il menace les droits des individus » (Michel BIZOU, 2008, pp. 28-57). En fin de compte, obligation est faite à l’État de rester fidèle au fondement originel de la communauté sur lequel et pour lequel il a été conçu. Dès lors, on peut comprendre la liberté d’où le libéralisme tire substance.
Si à l’état de nature, la liberté naturelle est « d’être exempt de toute sujétion » (John LOCKE, 1977, p. 19) à un quelconque pouvoir, cette liberté est conditionnée par le respect scrupuleux des droits naturels des hommes. Quand l’État est institué, la liberté civile est de n’être « soumis à aucun pouvoir législatif que celui qui a été établi dans la République par consentement » (John LOCKE, 1977, p. 19). Toujours en respectant les droits naturels tels que la vie, la liberté et la propriété, l’État en devient le mandataire. Le libéralisme de Locke place en l’individu le fondement de la société. Ce faisant, ces droits, pour lesquels il a abandonné sa liberté à l’état de nature, doivent être protégés dans la société civile. Si le libéralisme ne nie donc pas l’existence d’une vie en communauté, d’où vient-il qu’il soit confondu à un individualisme intégral ? C’est vrai que le libéralisme fait de la préservation des droits individuels la fin de toute société, toutefois, n’est-ce pas un moyen pour construire une société juste, où pourront vivre ensemble tous les citoyens ? Bien avant de tirer les leçons du contrat social chez John Locke, il nous faut saisir comment le libéralisme, bien qu’étant individualiste, n’est pas en porte-à-faux avec le contrat.
- Le libéralisme : une doctrine individualiste à l’épreuve du contrat social
Le libéralisme est victime de sa célébrité. « Tout le monde parle du libéralisme. Tout le monde a un avis bien arrêté sur lui (…) Pour qui a pris le recul et le temps suffisants pour outrepasser les caricatures, le libéralisme apparaît sous son vrai visage » (Mathieu LAINE, 2012, p. 11). En attendant, qu’est-ce que le libéralisme ?
C’est « une doctrine qui place la volonté individuelle à l’origine des relations sociales et préconise une limitation des compétences de l’État » (Noëlla BARAQUIN et AL, 2007, p. 201). C’est dire que le libéralisme est une doctrine qui place l’individu (de par sa volonté) à l’origine de tout lien social. Partant de là, le libéralisme veille à ce que l’entrée en société de l’individu ne soit pas un frein à l’expression de sa volonté propre, de sa liberté. En fait, le libéralisme est une réflexion sur les conditions de la paix civile et du vivre-ensemble. Pour y arriver, il fait de la liberté individuelle le moyen. La proclamation de la liberté individuelle a donné lieu à un reproche récurrent, celui d’être fossoyeur du lien social parce qu’individualiste. De quel individualisme s’agit-il ici ? N’est-il pas plutôt une forme sociale structurante ?
Alain Laurent, dans son ouvrage intitulé histoire de l’individualisme, part du principe que « l’individualisme repose avant tout sur la conviction que l’humanité est composée non pas d’abord d’ensembles sociaux, mais d’individus : d’êtres vivants indivisibles et irréductibles les uns aux autres, seuls à ressentir, agir et penser réellement » (Alain LAURENT, 1993, p. 4). Par sa définition, il en ressort qu’avant de devenir des acteurs sociaux, les individus jouissent d’une souveraineté unique et irréductible à quelque autre entité. C’est un processus socialisant qui pose l’individu comme un atome social. La philosophie du contrat de Locke expose cette volonté de vivre en société de l’individu tout en gardant ses prérogatives individuelles. Il n’en pouvait être autrement car, « la société sans les individus et l’individu sans société sont des choses qui n’existent pas » (Norbert ELIAS, 1999, p. 117).
En effet, le libéralisme a pour objectif de revendiquer les droits des individus. Cette revendication ne peut se faire à l’encontre des autres individus que dans la société. Il s’ensuit que l’individu et la société sont indissociablement liés. L’individu du libéralisme n’est donc ni a-social, ni anti-social. Il veut juste échapper à la dictature d’autrui dans ce qui engage sa vie, son avenir. Ainsi, l’individualisme n’est pas une fin, mais un moyen pour construire un lien social solide, respectueux des valeurs individuelles dans le strict respect des droits des autres.
Puisque le lien social est « comme ce qui maintient, entretient une solidarité entre les membres d’une même communauté, comme ce qui permet la vie en commun, comme ce qui lutte en permanence contre les forces de dissolution toujours à l’œuvre dans une communauté humaine » (Francis FARRUGIA, 1997, pp. 29-57), il va s’en dire qu’a priori, l’ingénierie sociale de l’individualisme est irréalisable. C’est une méprise de l’esprit de l’individualisme dans son acception libérale, parce que :
Pour [l’individualisme libéral], le soi ne s’arrête pas à la substance corporelle et [que] la division du soi et d’autrui est intérieure à l’individualité ; elle est sans cesse renégociée par l’individu lui-même dans ses interactions émotionnelles, sociales et morales, tout en étant indépassable » (Catherine AUDARD, 2009, p. 79).
Chaque individu représente une entité propre qui interagit avec les autres individus pour former une « unité totalisante ». L’individu s’inscrit dans une dialectique qui fait qu’il est à la fois indépendant et interdépendant vis-à-vis des autres. Cela est dû au fait qu’il ne peut « exister de société sans solidarité » (Serge PAUGAM, 2008, p. 5). La solidarité responsabilise mutuellement les individus, crée de l’empathie entre eux et soude davantage le lien social existant. Le lien social renforcé rend le paysage social comme le produit d’une étoffe caractéristique appelée « N’zassa »[65]. On retrouve cette étoffe en Côte d’Ivoire précisément chez le peuple Akan.
Pour arriver à cette société « N’zassa », où l’intégration communautaire est effective, la tâche sera des plus hardies tant le culte de la différence est exalté, utilisé à des fins conflictuelles. Cet écho est repris par Serge Paugam dans son ouvrage Vivre ensemble dans un monde incertain, où il expose la problématique du vivre ensemble dans la crise du lien social actuelle. Ainsi, il met au goût du jour une équivocité quant au débat qui a lieu :
En réalité nous oscillons sans cesse entre une attitude qui consiste à constater de façon pessimiste toutes les formes de déclin du lien social et une autre qui nous conduit, au contraire, à nous projeter dans une société en mutation où émergent en même temps des formes nouvelles de vie en société où les liens sociaux se réinventent sous des formes parfois inattendues ( 2014, p. 6).
Il faut réadapter les rapports interindividuels dans une société où les clivages sociaux gagnent du terrain. L’individualisme est mis en cause dans le délitement du lien social. Face aux nouveaux défis, aux nouvelles formes de violence, quelle(s) réponse(s) ? Dans Malaise de la modernité, Charles Taylor parlant de l’individualisme, le considère comme la plus belle conquête de la Modernité. Cette conquête nous a donné droit à « un monde où les gens peuvent choisir leur mode vie, agir conformément à leurs convictions, en somme, maîtriser leur existence d’une foule de façons dont nos ancêtres n’avaient aucune idée » (Charles TAYLOR, 2008, p. 10).
Néanmoins, il critique l’extrémisme individualiste. C’est moins l’existence que la mise en pratique de l’individualisme qu’il met en cause. Il met en garde contre le risque de dogmatisation. Face au « désenchantement du monde » dont parlaient Nietzsche et Weber, il en fait ressortir une variante, fruit de la Modernité : c’est la raison instrumentale. C’est par la médiation de celle-ci que nous évaluons les moyens qui concourent à satisfaire nos désirs. Que faire face à ce risque ? Taylor pose le diagnostic en faisant une critique généalogique de la Modernité dans son ouvrage Les sources du moi. Il y dévoile deux facettes de l’individualisme, qui sont à l’origine des conflits affectant la société : « L’idéal d’indépendance et d’autonomie ʺdésengagéeʺ à l’égard du monde et d’autrui d’une part, la reconnaissance de la particularité et la valorisation expressiviste de la différence de l’autre »[66]. L’homme a besoin d’une vie sociale pour son épanouissement sans pour autant s’aliéner : c’est une philosophie de la relation.
C’est un truisme de dire que le libéralisme est un individualisme, mais « ce serait une idée erronée que de concevoir l’individualisme comme une atomisation du lien social » (Michel BIZOU, 2010, pp. 35-56). Au contraire, chez Locke les individus, même à l’état de nature, sont profondément reliés par la loi naturelle. Les individus ont naturellement quelque chose qui les relie avant qu’ils ne contractent ou marchandent. L’individualisme veut en fait dire que le pouvoir politique doit toujours respecter les droits des individus quelle que soit la situation car l’État ne possède aucun droit qui ne soit octroyé avant son institution. L’État n’est pas générateur de la loi naturelle. Or, la loi naturelle vise le respect de la liberté, de la vie et des biens des individus. Donc l’État ne pourrait pas vouloir abusivement imposer aux hommes pour limiter leurs droits.
- Le contrat social comme fondement du vivre-ensemble lockéen
Le problème fondamental auquel le contrat social apporte solution est de « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1996, p. 53). Le contrat vise à protéger les biens de chaque contractant qui, abandonnant une partie de sa liberté naturelle, obtient une liberté civile juridiquement reconnue et protégée. Nonobstant le fait que le contrat social détermine l’existence de la société civile, quelle est sa véritable fin ? Les crises de succession au trône dans l’Angleterre lockéenne lui ont rappelé que son contrat avait un goût d’inachevé. Ces crises le pousseront à préférer la monarchie constitutionnelle à la monarchie héréditaire. Le constitutionnalisme de Locke part de là. Celui-ci va se forger à travers le rule of law qui est l’occasion de « chercher les moyens à préserver l’idée que le règne de la loi est la seule voie de la liberté » (Jean-Fabien SPITZ, 2001, p. 13). C’est l’ultime condition pour garantir et protéger les droits individuels en quittant l’état de nature.
Mais, Elle n’est pas sans risque même si sa mission est noble. Elle cherche à établir et conserver :
Une norme de justice indépendante de la volonté dans un contexte où, cependant, l’individualisme semble nous orienter vers la toute puissance de la passionnalité humaine et nous indiquer que l’accord sur le droit ne peut être qu’un artifice s’imposant par les voies de la puissance et de la volonté (Jean-Fabien SPITZ, 2001, p. 13).
Spitz met en évidence le risque encouru dans un monde individualiste et animé par la volonté de puissance. La loi pourrait être manipulée au profit de certaines personnes ou groupes de personnes. Locke en est conscient. C’est pourquoi, il enjoint à toute la communauté au processus d’élaboration des lois. C’est moins les lois existantes que le principe de ce qu’est une loi que Locke analyse en fait. Dans l’optimisme anthropologique qu’on lui connaît, il le dit promptement :
Si les hommes qui s’associent abandonnent l’égalité, la liberté et le pouvoir exécutif, qu’ils avaient dans l’état de nature, aux mains de la société pour que le pouvoir législatif en dispose selon que le bien social l’exigera, chacun agit de la sorte à seule fin de mieux protéger sa liberté et sa propriété, car on ne saurait prêter à une créature raisonnable l’intention de changer d’état pour être plus mal ; il ne faut donc jamais présumer que le pouvoir de la société, ou pouvoir législatif, qu’ils ont institué, s’étende au-delà du bien commun (1977, pp. 148-149).
Le but ultime de la société civile est le bien commun. Son obtention passe nécessairement par la protection de la liberté et de la propriété de celui qui entre dans la société civile. La liberté, ici, ne consiste pas à pouvoir tout faire, elle consiste plutôt à ne pas être soumis au pouvoir arbitraire d’autrui. Or, le risque d’être sous le joug d’autrui est bien réel avec les éventuels conflits qui surviendront dans la société civile. Locke pense alors que c’est en fixant de façon rigoureuse et incontestable les limites du domaine propre à chacun que nous avons plus de chance d’éviter ces conflits. C’est la tâche de la loi, et c’est pourquoi elle est essentielle à la liberté. En conséquence, la loi juste est l’instrument d’une vie communautaire harmonieuse et paisible. Elle prévient les querelles, règle les conflits et condamne les éventuels coupables. Elle est, comme Hobbes l’entendait, le moyen pour les hommes de vivre en paix car, elle est « semblable à ces haies qui empêchent de s’égarer dans le champ du voisin, non de marcher sur le chemin » (Pierre MANENT, 1987, p. 77). La loi est, au premier chef, la connaissance et la distinction de ce que nous devons faire et ne pas faire au risque d’empiéter sur la propriété d’autrui. Elle nous donne le moyen cognitif d’éviter tout conflit avec autrui et lui, avec nous.
Néanmoins, à l’état de nature, l’homme est à la fois juge et partie. Ce qui pouvait mettre en mal l’équilibre de cet état pré-social. D’où l’importance du magistrat civil dans le dispositif juridico-social de Locke dans la société civile. Pour entrer dans la société civile, il faudra passer nécessairement par le contrat social. Le faisant, les hommes optent pour la sécurité juridique car, à l’état de nature, les lois sont établies, mais pas écrites. Les hommes n’y bénéficient pas d’un juge impartial et d’un pouvoir capable d’exécuter ses sentences. Le contrat social consiste, dans ce cas précis,
À passer une convention avec d’autres hommes, aux termes de laquelle les parties doivent s’assembler et s’unir en une même communauté, de manière à vivre ensemble dans le confort, la sécurité et la paix, jouissant en sûreté de leurs biens et mieux protéger contre ceux qui ne sont pas des leurs » (John LOCKE, 1977, p. 129).
Cela prouve bien qu’il y a une philosophie du vivre-ensemble chez Locke. Celle-ci a pour but d’instaurer un climat de paix entre les hommes d’une même communauté et de favoriser la conservation de leurs biens. C’est en quelque sorte un état de droit qui doit prévaloir dans la société civile si tant est que celle-ci est régie par le droit. La liberté, une des conditions de l’opérationnalité du vivre-ensemble, est conditionnée par la loi. La loi rend donc possible la liberté. On ne peut se rendre coupable de violence sur autrui sans subir, en principe, la rigueur de la loi. La liberté sous la loi revient à « suivre ma propre volonté toute les fois que cette règle garde le silence et de ne pas me trouver soumis à la volonté inconstante, incertaine, secrète, arbitraire d’un autre homme » (John LOCKE, 1977, p. 88).
Allant du principe que « là où le droit finit, la tyrannie commence » (John LOCKE, 1977, p. 193), Locke condamne tout décret intempestif, toute loi de circonstance, toutes lois votées par une majorité qui ne concerneraient qu’une minorité. Dans cette logique, le vivre-ensemble est compromis. Face à cela, il y’a un impératif : c’est le retour aux principes du vivre-ensemble. Ce faisant, « le vivre ensemble, voire la vie en société, a des exigences qui engagent chacun par rapport à d’autres. Dans cette perspective, l’épanouissement de soi et le vivre ensemble sont possibles grâce à l’ouverture, le respect, la considération de l’autre et le dialogue » (Emmanuel MBOUA, 2012, p. 19).
Vivre- ensemble est un appel vers l’autre dans un élan de respect et de dialogue. Le vivre-ensemble n’exclut pas les rapports conflictuels entre les hommes. Il met en place des canevas pour le règlement des conflits car le consensus est partagé sur un certain nombre de droits inaliénables. Si nous sommes d’accord sur le minimum vital, il n’y a pas de raison que nous ne surmontions pas les crises entre nous. Vivre-ensemble dans un monde incertain pose un problème d’intégration de notre système associatif. Il nous faut revenir aux valeurs de protection et de reconnaissance pour construire une société mosaïque :
En apaisant les angoisses de l’insécurité dans toutes les sphères de la vie sociale, en s’efforçant de valoriser réciproquement tous les individus dans leur quête de reconnaissance, les politiques publiques pourront ainsi œuvrer pour le lien social(…) [Elles] sauront rechercher ensemble, dans l’intérêt de chacun, les conditions optimales du plaisir de vivre ensemble dans une société démocratique, apaisée et ouverte à tous (Serge PAUGAM, 2014, p. 86).
En concluant son livre par cet appel, Paugam donne une piste en vue de régler la crise du modèle d’intégration de la société. Les obstacles auxquels sont confrontés les individus sont bien réels. Pour y mettre fin, il faut revenir aux valeurs du lien social : la protection et la reconnaissance. Le contrat social joue ce rôle dans la mesure où il a pour dessein premier de protéger l’individu des abus. Étant donné qu’il est mandant de la société civile et que les mécanismes qui y sont en vigueur, sont le fruit de sa collaboration, il ne souffrira pas de rejet.
Conclusion
Avec le contrat social, le vivre-ensemble n’est pas un simple slogan. Il est théoriquement établi à l’état de nature et juridiquement protégé dans la société civile. Si ma vie, ma liberté et ma propriété sont protégées par la loi dans la société civile, le vivre-ensemble qui se résume en ces trois principes, s’en trouvera exalté. La fin du contrat lockéen est la judiciarisation des principes du vivre-ensemble comme panacée aux maux sociétaux. Le vivre-ensemble lockéen se manifeste à travers sa volonté de préserver la liberté des citoyens et éviter la tyrannie. Dans la construction de l’État, l’épanouissement de l’individu est l’objet et le but. Le vivre-ensemble est le fruit d’un contrat social passé pour sortir de la précarité de l’état de nature. Pour ne pas qu’il reste un vœu pieux, un simple acte de foi, il faut que dans le dispositif étatique, la loi soit la pièce maîtresse. Se faisant, l’individu a l’obligation de la respecter parce qu’elle est le fruit de sa collaboration avec les autres. Ce sont les règles de réciprocité et de régulation des lois qui feront que, si les principes du vivre-ensemble sont reconnus, il y aura moins de turpitudes dans la société civile.
À vrai dire, la philosophie lockéenne du contrat n’a pas l’intention de minimiser les autres philosophies du contrat, elle apporte juste sa pierre à la construction d’une société, en se basant sur la dimension libérale. Dans cette logique, l’individu libéral, au centre de toutes les controverses liées à sa nature ʺégoïsteʺ, ne peut donc pas être décrit comme antisocial. Il est un individu qui « accueille l’autre au sein même de son intériorité » (Catherine AUDARD, 2009, p. 79).
Bibliographie
Alain LAURENT, Histoire de l’individualisme, Paris, P.U.F, 1993.
Alain POLICAR, Le libéralisme politique et son avenir, Paris, CNRS Éditions, 2012.
Alexis TADIÉ, Locke, Paris, Hachette, 2003.
Catherine AUDARD, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société, Paris, Gallimard, 2009.
Charles TAYLOR, Malaise de la modernité, Paris, Cerf, 2008, Trad. Charlotte Melançon, p. 10.
Crawford Brough MACPHERSON, La théorie politique de l’individualisme possessif. De Hobbes à Locke, Trad. Michel Fuchs et Postface de Patrick Savidan, Paris, Gallimard, 2004.
Emmanuel MBOUA, Principe éthique du vivre ensemble, Paris, Harmattan, 2012.
Francis FARRUGIA, « Exclusion, mode d’emploi » in Cahiers internationaux de sociologie, 102/Janvier-juillet, 1997.
Jean-Fabien SPITZ, John locke et les fondements de la liberté moderne, Paris, P.U.F, 2001.
Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, Paris, L.G.F, 1996.
John Locke, Second traité du gouvernement civil, Traduction de Bernard Gilson, Paris, Vrin, 1977.
John LOCKE, Second traité du gouvernement civil, Traduction J-F. Spitz et C. Lazzeri, Paris, P.U.F, 1994.
Mathieu LAINE, Dictionnaire du libéralisme, Paris, Larousse, 2012.
Michäel BIZIOU, « À l’articulation du libéralisme politique et du libéralisme économique : le jugement individuel face à l’État chez Locke et Smith » in Gilles KÉVORKIAN, dir., La pensée libérale. Histoire et controverses, Paris, Ellipses, 2010.
Michaël BIZIOU, « Le libéralisme de Locke : des déductions de la raison à la politique de jugement » in Blaise BACHOFEN, Dir., Le libéralisme au miroir du droit. L’Etat, la personne, la propriété, Lyon, ENS Éditions, 2008.
Noëlla BARAQUIN et al, Dictionnaire de philosophie, Paris, Armand Colin, 2007.
Norbert ELIAS, La société des individus, Paris, Fayard, 1999.
Philippe NEMO, Histoire des idées politiques aux temps modernes et contemporains, Paris, P.U.F, 2002.
Philippe RAYNAUD « John Locke, fondateur du libéralisme ? » in KÉVORKIAN Gilles, dir., La pensée libérale. Histoire et controverses, Paris, Ellipses, 2010.
Pierre MANENT, Histoire intellectuelle du libéralisme, Paris, Hachette, 1987.
Serge PAUGAM, Le lien social, Paris, P.U.F, 2008.
Serge PAUGAM, Vivre ensemble dans un monde incertain, Paris, Éditions de l’aube, 2014
Simone GOYARD-FABRE, Éléments de philosophie politique, Paris, Armand colin, 1996.
Simone GOYARD-FABRE, John locke et la raison raisonnable, Paris, Vrin, 1986.
Sophie Guérard de LATOUR, Vers la république des différences, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009.
Stephan MARTENS, Michel de WAELE, Vivre ensemble, vivre avec les autres. Conflits et résolution de conflits à travers les âges, Lille, Presses Universitaires Septentrion, 2012.
AXE 5 : LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
17. Le vivre-ensemble et la sauvegarde de l’environnement : l’archétype du développement durable,
COULIBALY Sionfoungon Kassoum…………………………………………….281
RÉSUMÉ :
Réagissant contre le système éducatif centré sur l’instruction, Nietzsche prône une pédagogie active qui concilie l’instruction et l’éducation. Ce nouveau paradigme pédagogique vise à former des élites à travers une éducation supérieure. La pédagogie créative peut s’appliquer au contexte du Licence- Master- Doctorat où la créativité et les talents importent tant pour sa formation que son auto-emploi.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
Reacting against the educational system centered on instruction, Nietzsche advocated on active pedagogy that balances educations. This new educational paradigm aim at the making of elites through a superior education. The creative pedagogy can be used in the perspective of the Licence- Master-Doctorat system; where creativity and talents are required for one’s training and self-employment.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
COULIBALY Sionfoungon Kassoum
Université Alassane Ouattara
Courriel : sionfoungon@yahoo.fr / kascoulibaly@gmail.com
Le vivre-ensemble et la sauvegarde de l’environnement : l’archétype du développement durable.
Résumé :
Est-il possible de construire le monde actuel et futur sans le souci environnemental ? Est-il possible de vivre-ensemble, en harmonie, sans la garantie d’une “santé” environnementale ? La sauvegarde de l’environnement est nécessaire pour assurer l’existence de l’humanité. Ce faisant, elle doit être réalisée de manière commune. Mais, comment réussir cette entreprise sans nuire au vivre-ensemble ? Cette réflexion invite à voir dans le développement durable, un modèle qui permet la co-construction du vivre-ensemble structurée par la sauvegarde de l’environnement. Il s’agit de conjuguer le vivre-ensemble avec la sauvegarde de l’environnement.
Mots clés : Dégradation environnementale – Développement durable – Diversité culturelle – Individualisme – vivre ensemble.
INTRODUCTION
La montée du niveau de la mer, le réchauffement climatique, le trou dans la couche d’ozone, les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, la difficile gestion des déchets ménagers, les pollutions atmosphériques sont autant de facteurs qui indiquent une inquiétude grandissante face à la dégradation, à l’échelle mondiale, de l’environnement. Cela illustre que la dégradation de l’environnement menace toute l’humanité et que, de ce point de vue, elle ne peut être mise à l’écart des mutations sociales.
Le fait est que, le rapport social de l’homme à la nature est au fondement de la dégradation de l’environnement qui, à son tour, influe sur le rapport social des hommes entre eux. Mais, au fond, le rapport de l’homme à la nature est un rapport complexe de l’homme avec lui-même dont le fil d’Ariane est l’individualisme, devenu une valeur suprême.
Dans l’individualisme, l’accaparement des ressources de la terre se fait au détriment des autres, mais encore, il a lieu dans un contexte de rareté progressive desdites ressources. René Barbier, dans un « élément pour une philosophie du vivre ensemble »[67], a sans doute raison de faire de cette valeur le défi principal pour la construction du vivre ensemble et de la cohésion sociale. En outre, la rareté des ressources, l’un des grands paramètres du XXIe siècle fait remarquer Nicolas Hulot, précède l’étape de la pénurie qui conduit toujours à « la guerre » (Nicolas HULOT, 2015). La rareté combinée à l’accaparement conduit à la dégradation de l’environnement qui, par ce fait, devient une menace pour la paix et la cohésion sociale. Du coup, sauvegarder l’environnement, c’est aussi penser la paix et la stabilité mondiale, c’est penser le vivre ensemble.
Depuis 1972, dans la déclaration des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm qui aboutira plus tard sur l’idée de développement durable, il a été question de « la nécessité d’adopter une conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d’améliorer l’environnement »[68]. Cela signifie qu’il faut unir les forces et fonder au-delà des différences, une véritable conscience environnementale.
Cependant, comment parvient-on à le réaliser dans un monde ultra individualiste ? La dégradation de l’environnement n’étant plus irréelle, quelles conséquences peut-elle avoir sur le vivre-ensemble ? Quel moyen s’offre à nous pour pouvoir réaliser l’implication de la sauvegarde de l’environnement et du vivre ensemble ?
Cet article ambitionne de penser le vivre-ensemble et la sauvegarde de l’environnement comme un tout. Il présente en cela, le développement durable comme un modèle de ce tout unificateur. Alors, nous aborderons, premièrement la question de la dégradation environnementale et le vivre-ensemble, deuxièmement, la coévolution vivre-ensemble et sauvegarde de l’environnement dans la pensée éthique, troisièmement, exposer le modèle du développement durable.
- La question de la dégradation de l’environnement et le vivre ensemble
Les changements climatiques, un des phénomènes de notre monde actuel, constituent un facteur d’instabilité sociale constante et multiaggravante. Ils accentuent les inégalités, les misères, les injustices et peuvent être source de conflits intercommunautaires menaçant la cohésion sociale ou le vivre-ensemble. Mais, avant d’aborder, avec plus de profondeur, la question des impacts de la dégradation environnementale sur le vivre-ensemble, il nous paraît important d’analyser ce qu’est le vivre-ensemble.
- Éléments pour une appréhension du vivre-ensemble
La notion de vivre-ensemble intervient dans un monde où l’individualisme devenu forcené semble nuire à la construction d’une cohésion sociale. Les Grecs entendaient par la notion de « pléonexie », cette attitude individualiste consistant, selon Dany-Robert Dufour à « vouloir plus que sa part » (Dany-Robert DUFOUR, 2015, p. 15). La « pléonexie » était considérée dans les mêmes strates que l’inceste par exemple, et constituait une attitude déviante. Elle trouve dans la cupidité une représentation archétypale et peut faire planer sur la société des risques de conflits, d’entrechoquements d’intérêts. Selon Dufour, cette norme a longtemps été restreinte dans la morale jusqu’à Bernard de Mandeville. Mandeville, par sa pensée, prône tout le contraire d’une restriction de la « pléonexie ». Il trouve même dans cette attitude qu’il nommait « selfish systems of morals » (Hervé MAUROY, 2015, p. 87) (systèmes égoïstes de la morale), le fondement de l’évolution sociale. Dans l’esprit de Mandeville, il n’y a que de bienfaits pour une société qui vit dans l’avidité, l’égoïsme et « la pléonexie ».
Ce système qui fait de l’égoïsme une valeur suprême, peut générer des risques écologiques et sociaux d’envergure. Platon, dans La République, présentait déjà la « pléonexie » comme un facteur de destruction des liens sociaux. En effet, si chacun se laissait aller à son égoïsme, la cité ne serait que ruine et désolation. Elle croupirait sous le poids des divisions et tensions sociales et ne serait pas une mais, « double, celle des pauvres et celle des riches, qui habitent le même sol et conspirent sans cesse les uns contre les autres » (PLATON, 1950, 295). Une telle cité ne serait donc pas un havre de paix et de cohésion sociale.
La question de l’individualisme, de l’égoïsme et de la « pléonexie », montre que le vivre ensemble n’est pas spontané. Il est une construction sociale qui doit rassembler et unir les différences. Il doit trouver, par-delà tout différend, dans le principe aristotélicien de l’homme comme « animal politique », les éléments nécessaires pour la constitution d’une société harmonieuse. Il doit pouvoir se nourrir de cette spontanéité naturelle à l’entraide, à la solidarité, comme si nous étions tous liés par des fils secrets.
Cette tension naturelle au souci de l’autre peut en effet, constituer les fondements d’une harmonie sociale. Roger-Pol Droit, dans sa sympathique analyse sur “ce qui nous unit”, voit cela dans la concrétisation du « nous » (Roger-Pol DROIT, 2015, p. 11) véritable qui se trouve dans notre affect. C’est dans ce « nous » de la soudaineté et de l’imprévisibilité surgissant dans l’urgence du danger qu’est mise en exergue cette disposition affective pouvant nous conduire vers « ce qui nous unit ». C’est ce « nous » qui fait cohabiter plusieurs cultures sur un même territoire. Il révèle, entre autre, les aspects culturels du vivre ensemble.
Arthur Schopenhauer voyait ce « nous » provenir du concept de « pitié » qui nous permet de ressentir l’autre en nous, de lui venir en aide et de ne pas le nuire par des actes antagonistes. Il en a fait même le fondement de la morale. La « pitié » est ce sentiment de compassion envers l’autre et qui nous permet, originairement, d’être unit à lui.
Cette compassion révèle selon Schopenhauer l’existence d’une union originaire de tous les vivants, antérieure à leur séparation. Dans l’émotion partagée, on éprouverait comment les barrières entre nous peuvent sauter. Les cloisons qui nous séparent en autant d’individus isolés, clos sur eux-mêmes, viendraient voler en éclats. En fait, cette émotion directement partagée révélerait combien la clôture de nos individualités n’est qu’un artifice, une illusion, une forme de notre exil hors du grand Tout (Roger-Pol DROIT, 2015, p. 17).
Ce grand Tout, c’est le monde de Platon dans le Timée perçu comme un tout vivant ; c’est le cosmos des Stoïciens régi par le principe d’harmonie fondée sur la relation pacifiée qui devrait exister entre les hommes eux-mêmes et entre les hommes et la nature. Ce grand Tout sera, plus tard, repris dans les thèses environnementalistes sous le concept d’« équilibre symbiotique », corrélatif, notamment aux différents déséquilibres occasionnés par l’action anthropique dans la nature et qui, aujourd’hui, s’avèrent avoir un impact sur l’humanité et la cohésion sociale.
- L’impact de la dégradation de l’environnement sur le vivre ensemble
Les perturbations environnementales ne peuvent plus être comprises comme un auto-déchaînement de la nature. Elles sont maintenant le fruit des actions massives et concentrées de l’homme dans la nature et dans la durée qui menacent de rupture, les cycles naturels tout en conduisant l’homme vers l’irréversible. Cette irréversibilité qu’Elizabeth Kolbert, dans son œuvre La 6e extinction (Elizabeth KOLBERT, 2015), a qualifiée d’extinction de masse, se trouve être une menace pour l’existence, aussi bien des êtres vivants non-humain que des humains. Dans le cas des humains, ces perturbations influent sur nos rapports sociaux.
En effet, certains cas de figures nous portent à croire que les effets des dégradations de l’environnement ont un impact considérable sur les rapports sociaux. Même si cela n’est pas encore perceptible à l’échelle globale, il se manifeste déjà par les effets dévastateurs du changement climatique. Ces effets sont au fondement de conflits intercommunautaires dans certaines contrées. Selon Nicolas Hulot, le conflit en Syrie et celui du Darfour apparaissent comme deux exemples probants qui justifient l’ampleur conflictuelle des dégradations de l’environnement.
Les changements climatiques aggravant la désertification en Syrie, ont eu pour conséquence un mauvais rendement agricole, soit une chute de plus de 80% et une perte de 60% des troupeaux. « Cela a contraint plus d’un million de personnes à passer du Nord de la Syrie au Sud-Est de la Syrie et c’est du Sud-Est de la Syrie qu’est partie la rébellion syrienne. [Certes], ce n’est pas le changement climatique qui est à l’origine de la rébellion syrienne, mais il a été un catalyseur » (Nicolas HULOT, 2015, p. 19). En tant que catalyseur de la rébellion syrienne, le changement climatique a donc eu un effet provocateur.
Au Darfour, on retrouve un cas similaire. Un changement climatique a exterminé des milliers de personnes et « contraint des éleveurs nomades au déplacement, parce qu’un degré d’élévation de la température a tendu encore davantage le partage des pâturages. Ces éleveurs sont alors entrés en conflit territorial avec des pasteurs sédentaires. C’est ce qui a mis le feu aux poudres » (Nicolas HULOT, 2015, p. 19). Dans ces deux exemples, tout part donc d’un problème environnemental et, avec la guerre, finit par fragiliser les liens sociaux.
Dans ces deux cas mentionnés par Nicolas Hulot, le plus remarquable est le déplacement massif des populations vers des lieux plus accueillants climatiquement. On estime qu’en moyenne 23 millions de personnes se déplacent chaque année, dans le monde, sous l’effet du changement climatique. C’est environ six fois supérieur aux déplacements de populations générées par les conflits politiques. Mais, lorsqu’on ajoute, à ce phénomène de migration climatique, la question des inégalités sociales dues aux dérèglements environnementaux, nous remarquons une accentuation des menaces sur le maintien de la cohésion sociale.
C’est dans le prisme de la raréfaction des ressources naturelles et dans les effets de la destruction des écosystèmes que l’on relève le plus, les inégalités sociales liées à l’environnement. Il existe, en l’occurrence, des différences sociales dans l’accès aux ressources naturelles, également dans la répartition des dégâts provoqués par les dégradations environnementales, comme c’est le cas du réchauffement climatique qui affecte le plus, les plus démunis. Les populations riches, qui constituent la minorité, sont toujours favorisées au détriment des populations pauvres. Cette injustice est un fait constaté au niveau planétaire :
Une minorité s’est approprié les ressources et les aménités communes du milieu (ou de l’environnement) tout en exposant la majorité aux effets de la dégradation de l’écosystème terrestre. Ce sont ainsi ceux qui ont le moins participé au changement climatique qui en souffriront le plus et qui disposent des moyens les plus faibles pour s’y adapter. De même, ce n’est pas dans les beaux quartiers que sont installés les établissements polluants ou dangereux (Catherine LARRÈRE et AL, 2013, p. 50).
Il est à remarquer, d’ailleurs, que la question des inégalités sociales n’est plus si étrangère à la montée du terrorisme, de la violence et de la haine qui secouent et menacent la cohésion sociale dans notre monde actuel. Mais, étant donné que ces inégalités peuvent avoir des fondements environnementaux, les actions de sauvegarde de l’environnement devraient pouvoir offrir les moyens d’y remédier. Dans cette optique, nous trouvons nécessaire de penser le vivre-ensemble en coévolution avec la protection de l’environnement.
- La coévolution vivre-ensemble et sauvegarde de l’environnement : la perspective éthique
La crise environnementale transforme nos manières traditionnelles de voir la nature comme une vaste étendue de matières au service de l’homme. Elle a fait que l’on intègre, progressivement, le souci environnemental dans nos constructions sociales. Michel Serres fait remarquer qu’avec cette crise, « l’histoire globale entre dans la nature ; la nature globale entre dans l’histoire » (Michel SERRE, 1992, p. 18). Cette intégration, inédite en philosophie, a donné les outils pour repenser le rapport de l’homme à la nature aussi bien par la politique, la métaphysique que par l’éthique. Elle a, à cet effet, fait naître au début des années 1970, le besoin d’une éthique environnementale. Pour mieux cerner l’idée de la coévolution du vivre-ensemble et de la sauvegarde de l’environnement, il nous semble juste de voir, dans l’éthique environnementale la question du vivre ensemble.
- Le vivre ensemble dans la pensée environnementaliste
La question du vivre ensemble n’a pas été abordée, de manière frontale, dans les écrits des environnementalistes. Cependant, on peut la rencontrer, de manière indirecte, dans les réflexions sur les diversités culturelles. En effet, si la protection de l’environnement social, siège des diversités culturelles, doit maintenant tenir compte de la protection de environnement naturel, nous pensons qu’il n’y a pas une incompatibilité entre la pensée environnementaliste et l’idée du vivre-ensemble. L’environnementalisme est favorable aussi bien à la sauvegarde de l’environnement qu’à la promotion du pluralisme culturel. Une telle pensée est d’ailleurs partagée par Arne Naess pour qui : « les attitudes qui s’inspirent de l’écologie privilégient la diversité des modes de vie humains, des cultures, des activités, des économies » (Arne NAESS, 2007, pp. 51-60). Elles sont, en ce sens, favorables à la mise en valeur des modes de vie communautaires et donc compatibles avec l’idéal de vie communautariste prôné par le vivre-ensemble.
Il y a, en outre, dans l’idée d’ « égalitarisme biosphérique » de Arne Naess des éléments justificatifs d’une construction environnementaliste du vivre ensemble. Cet égalitarisme s’inspire d’une indistinction opérée entre diversité culturelle et diversité du vivant. Il engendre une norme de diversité et de symbiose qui, à son tour, « augmente les potentialités de survie, les chances de développement de nouveaux modes de vie, la richesse des formes de vie » (Arne NAESS, 2007, p. 53). Dans une telle démarche, « la lutte pour l’existence et la survie des plus adaptés, devrait être interprété dans le sens d’une capacité à coexister et à coopérer en nouant des relations complexes, plutôt que comme capacité à tuer, à exploiter et à supprimer » (Arne NAESS, 2007, p. 53). C’est dire que le principe d’ « égalitarisme biosphérique » permet de prendre en compte les plus vulnérables, à les intégrer dans la lutte pour l’existence et non à les exterminer. En réalisant ce principe que prône Arne Naess, on arrive à produire un mode de vie symbiotique qui verra vivre ensemble les humains, et le monde non-humain.
Mais l’« égalitarisme biosphérique » fait partie des sept principes composant la Deep Ecology, à savoir : l’image relationnelle du champ de vue total, égalitarisme biosphérique, principe de diversité et de symbiose, position anti-classe ; lutte contre la pollution et l’épuisement des ressources, complexité, et non pas complication, autonomie locale et décentralisation (Arne NAESS, 2007, p. 53). De ces sept points, on peut dire que c’est à partir du rejet de l’image anthropocentrique au profit de l’image relationnelle que s’établit un égalitarisme biosphérique garantissant la défense du principe de diversité et de symbiose. Ce principe engendre une position anti-classe favorable à la lutte contre la pollution et l’épuisement des ressources. Cet ensemble cohérent montre la satisfaction et le « plaisir profonds que nous éprouvons à vivre en association étroite avec les autres formes de vie» Arne NAESS, 2007, p. 52). Elle explicite pour ainsi dire cette nécessité qu’il y a de sauvegarder l’environnement et de réaliser une cohésion véritable avec l’idée du vivre ensemble.
2- La coévolution du vivre ensemble et de la sauvegarde de l’environnement
Notre civilisation technique, en transformant le réel, a longtemps fait miroiter l’illusion d’un progrès illimité qui apporterait à l’homme les bienfaits de la nature. Elle fait que l’on proclame volontiers, dans la recherche de ce progrès, que « plus de technologie vaut toujours mieux que moins de technologie » (Wolfgang SACHS, 2003, p. 41). Mais cette affirmation n’est pas fortuite, car elle « tire son caractère péremptoire d’une conception matérialiste du monde, mais elle doit sa popularité à un malentendu tragique, à savoir que les technologies modernes ont l’innocence de l’outil » (Wolfgang SACHS, 2003, p. 41). En adoptant donc définitivement ce principe de l’innocence de l’outil, l’humanité a privilégié le recourt constant à sa rationalité technique pour la réalisation de ce progrès.
Cependant, le constat c’est que la rationalité technique apparaît, désormais, envahissante et dévastatrice. Elle est envahissante, car elle s’étend pratiquement à toutes les activités humaines. Elle est dévastatrice, en ce sens qu’elle engendre des bouleversements considérables dans la nature humaine et dans la nature entendue comme environnement. Le projet initial de transformation de la nature s’amplifiant, engendre des déséquilibres environnementaux considérables qui, interpellent l’humanité sur la nécessité de protéger l’environnement.
Ce principe de protection de l’environnement semble ne pas être un choix mais une obligation, du moment où selon Jean Jacques Rousseau, « l’homme tient à tout ce qui l’environne » (Jean Jacques ROUSSEAU, 2009, p. 167). Dans l’esprit de Catherine et de Raphaël Larrère, cela signifie « qu’il en dépend, mais aussi qu’il s’y attache et s’en soucie : on est toujours, d’une façon ou d’une autre, préoccupé par le milieu dans lequel on vivait » (Catherine et Raphael LARRÈRE, 2009, p. 167). En effet, cette pensée de Rousseau institue une interdépendance entre l’homme et la nature, et évoque, fondamentalement, deux réalités : premièrement, que l’homme a nécessairement besoin de « ce qui l’environne », son existence en dépend. Deuxièmement, « ce qui environne » l’homme a besoin d’exister de façon autonome et hétéronome. La nature doit exister de façon autonome, car elle est le socle de toute existence. De façon hétéronome, la nature doit recevoir son principe de protection de la volonté humaine.
Cette volonté de protection qui devait aller de soi, a commencé, certes tardivement de manière délibérée dans la moitié du XIXe siècle, mais elle montre un désir manifeste à prendre soin de notre bien commun. C’est dire que le souci pour la sauvegarde de l’environnement est contemporain, d’une part et, d’autre part, il est un nouveau paramètre avec lequel nous devrons construire une existence humainement acceptable. Sans doute, cette réalité qui nous rattrape, provient de l’idée que « nous devons bien supposer qu’une nature existe, pour continuer d’exister » (Catherine et Raphael LARRÈRE, 2009, pp. 102-103), mais encore, « c’est une nature que nous aimons, et dont nous n’avons jamais complètement cessé de faire partie » (Catherine et Raphael LARRÈRE, 2009, p. 103). Autrement dit, nous sommes le fruit de la nature et nous y demeurons jusqu’à la fin de notre existence. C’est pourquoi, la dégradation de la nature représente une menace réelle pour la survie de l’humanité. Partant de ce fait, il devient important d’œuvrer pour la sauvegarde de l’environnement afin de préserver l’humanité de toute catastrophe. Cependant, comment parvenir à une telle sauvegarde sans nuire au vivre-ensemble ?
Arne Naess disait que, « les organismes sont des nœuds au sein du réseau ou du champ de la biosphère, où chaque être soutient avec l’autre des relations intrinsèques » (2007, p. 52). Il présente ainsi l’existence d’une relation naturelle entre les êtres vivants. Cette relation devrait pouvoir permettre d’aller au-delà de l’anthropocentrisme, pour établir une véritable existence symbiotique entre l’homme et la nature. Sauvegarder l’environnement dans un tel cadre, revient alors à réorganiser nos modes de vie de sorte à y inclure le monde extrahumain. La réorganisation véritable de nos modes de vie allant dans le sens de la protection de la nature ne peut se faire sans une réelle réflexion sur la diversité culturelle.
En effet, certaines pratiques[69] culturelles peuvent être nuisibles à l’environnement. Elles puisent en cela, leur justification dans la défense de toutes cultures comme naturelles et présentées comme identité humaine. En dépit de ce fait, il est à remarquer qu’au regard de l’analyse d’Arne Naess, la diversité culturelle n’est pas incompatible avec la sauvegarde de l’environnement. Les aspects culturels de nos rapports à l’environnement révèlent une interdépendance, une relation intrinsèque entre l’homme et la nature. Ainsi, « si la diversité culturelle est favorable à la diversité biologique, la préservation de celle-ci doit favoriser celle-là » (Catherine et Raphael LARRÈRE, 2009, p. 188). L’une et l’autre nous intiment à penser, de manière coévolutive, leur préservation. Dans un tel cas, le plus difficile devient le choix que nous devons opérer entre sauvegarde de l’environnement et respect de la culture. Or, il suffit d’envisager les possibilités d’une coévolution homme-nature qui se trouve promue dans les sept points de la Deep ecology d’Arne Naess.
Toutefois, les cultures ne sont pas immuables. Elles sont dynamiques et relèvent, avant tout, du conventionnel. Le fixisme apparent de l’identité culturelle qui, lui donne l’aspect de naturel provient, surement, de son caractère transmissible intergénérationnel. De la sorte, la culture peut être perçue comme le conventionnel qui acquiert le statut de naturel par la tradition. C’est de cette idée de transmission intergénérationnelle que la culture apparait comme un fait de nature figé dont, toute tentative de changement réveille les instincts guerriers et des positions extrémistes. Mais si la nature (environnement) qui n’est pas le fait de l’homme a pu être modifiée par lui, alors il est possible de modifier ce qui relève de son faire, c’est-à-dire la culture.
L’homme doit, dans ce sens, adapter sa culture aux réalités de la menace de la dégradation environnementale sur l’existence de toute forme de vie sur terre. Catherine Larrère note à ce sujet, que « réfléchir sur la dimension environnementale des revendications culturelles conduit alors à remettre en question une vision statique et figée de l’identité culturelle, pour en admettre la fluidité et la recomposition dynamique » (Catherine et Raphael LARRÈRE, p. 19). N’est-ce pas, une manière de dire que nos cultures doivent s’adapter aux réalités environnementales actuelles ? N’est-ce pas, une autre manière de dire qu’il nous faut un autre modèle de construction sociale ?
- Le développement durable comme modèle du vivre ensemble et de la sauvegarde de l’environnement
Le développement durable ambitionne de produire un modèle global de développement économique et social fondé sur la prise en compte de la fragilité de notre environnement naturel. Il apparait comme un modèle pour un programme d’action globale afin de garantir les besoins de l’humanité présente et future. Sur ce, il invite à penser nos actions dans une démarche universelle, pour deux raisons fondamentales : la globalisation de la dégradation environnementale et l’obligation d’uniformisation des actions. Toutefois, ces deux raisons ne sont pas distinctes, elles sont interdépendantes.
L’effet global de la crise de l’environnement n’est plus une chimère. Plusieurs faits attestent, aujourd’hui, de la globalité de ce phénomène. Les exemples de la déchirure de la couche d’ozone, de l’amplification des gaz à effet de serre, les pollutions atmosphériques, etc., montrent cette triste réalité. Les pollutions atmosphériques et les gaz à effet de serre, par exemple, ne se limitent pas aux territoires de leur production. Ils s’éparpillent comme une trainée de poudre dans le ciel et produisent des conséquences bien loin de leur lieu d’origine. Les pays africains, en l’occurrence, qui ont un degré de pollution moindre que les pays développés sont, malheureusement, les plus exposés aux dégâts de cette dégradation de l’environnement. La crise environnementale fait naître une responsabilité de l’homme envers la nature mais encore de l’homme envers son semblable. Cette responsabilité nous pousse à penser dans un cadre global, nos actions particulières.
Le principe d’obligation d’uniformiser nos actions trouve, ainsi, son fondement dans cette crise. Le sommet de la Terre qui s’est déroulé à Rio en 1992 a consacré la reconnaissance définitive de la globalité de la crise environnementale. Peu importe les résultats qui ont, sans aucun doute, été décevants, « le fait même que le sommet se soit tenu prouve que la crise environnementale est devenue l’objet d’une préoccupation commune et de débat public » (Catherine et Raphael LARRÈRE, 2009, p. 7). Il a constitué un moment décisif pour la vulgarisation du développement durable au niveau des peuples et de la prise de conscience véritable des dangers qu’encourt la biosphère. Ce sommet a par ailleurs, plaidé pour une mise en œuvre rapide, à l’échelle mondiale, des principes de ce modèle de développement. Ce caractère universel s’appuie sur la nécessité d’une vision commune de penser le bien-être de l’humanité. Ainsi, par ce critère universel, le développement durable devient la représentation archétypale du vivre-ensemble et de la sauvegarde de l’environnement.
Cette représentation intime aussi, une démarche convergente qui consistera à faire de ce type de développement un objectif commun. Comme le dit Sylvie Brunel, le développement durable « incarne aujourd’hui l’une des faces positives de la mondialisation, la prise de conscience qu’il existe des problèmes communs à l’ensemble de l’humanité, qui transcendent les frontières et doivent être traités à la fois globalement et localement » (Sylvie BRUNEL, 2015, p. 5). Ces problèmes communs incitent à fédérer nos actions, à penser le monde comme unité. Dans un tel cas, la durabilité du développement consacre véritablement la conjugaison du vivre-ensemble et la sauvegarde de l’environnement. Elle permet de fédérer, en une sorte de religion de masse, les différentes cultures afin de penser le futur de l’humanité.
Ce modèle de développement économique et social, permet de penser l’économie, l’environnement et du social comme un tout. En intégrant dans les objectifs économiques l’aspect social et environnemental, le concept de développement durable aboutit à une lecture systémique du développement. En tant que système, il consistera à promouvoir une économie viable dans un environnement vivable sous la houlette d’une société équitable, dans un monde qui se fragilise progressivement. Comme le relève Franck Burbage, « il semble acquis que le développement durable est désormais sinon le seul, en tout cas l’un des principaux défis pour une humanité qui a pris ou repris conscience de sa fragilité, qui sait, même de manière mutilée et confuse, que les conditions terrestres de sa suivie collective, a fortiori de la vie heureuse, sont loin d’être assurés » (Sylvie BRUNEL, 2015, p. 8), si bien évidemment, elle continue de penser uniquement son développement sous l’angle unique de l’économie. Elle doit maintenant penser en termes de globalité.
En définitive, dans la mesure où « les problèmes de développement durable qui se posent désormais au monde sont des problèmes mondiaux, nécessitant une approche globale » (Sylvie BRUNEL, 2015, p. 119), parvenir à sa réalisation, c’est mettre en place des instruments qui permettraient de « transcender les égoïsmes nationaux pour imposer une vision planétaire de l’intérêt général » (Sylvie BRUNEL, 2015, p. 119). Dans cette vision planétaire, l’humanité pense l’humanité en harmonie avec la nature. En d’autres termes, dans le développement durable, l’humanité se trouve interprétée comme un tout.
CONCLUSION
La question du vivre-ensemble est à mille lieux d’être pensée sous l’angle exclusif de la pensée politique ou sociale. Elle relève aussi de la pensée environnementaliste. Et ce, pour une raison fondamentale : la crise environnementale qui menace l’humanité actuelle est un facteur aggravant les inégalités sociales et génère des conflits et divisions sociales. Dans cette optique, construire un vivre-ensemble, c’est désormais tenir compte de l’environnement. Dans notre réflexion, l’objet recherché était de voir dans le développement durable, un modèle pour réaliser le vivre-ensemble.
Il fut donc question d’appréhender l’idée de vivre ensemble et la question de la dégradation de l’environnement. L’appréhension de cette idée n’est possible que par le canal de l’individualisme devenu une valeur dans notre monde. Cet individualisme que les Grecs appelaient pléonexie, par le principe d’accaparement des ressources de la nature par les uns au détriment des autres accentue, les problèmes environnementaux. Ces problèmes, à leur tour, menacent la survie de l’humanité et la cohésion sociale.
Ainsi, sauvegarder l’environnement revient à la penser dans une démarche coévolutive d’avec la construction du vivre-ensemble. Cette coévolution permet de reconnaitre une valeur intrinsèque à l’environnement qui « nous commande de respecter son intégrité par-delà l’aspect utilitaire » (Hans JONAS, 1990, p. 263). Mais la globalisation de la crise environnementale ne nous laisse pas d’autres choix que d’arpenter ce chemin à l’échelle mondiale.
En ce sens, le développement durable se dévoile comme un modèle qui garantit la possibilité de réaliser le vivre-ensemble et la sauvegarde l’environnement. Il faudrait, pour ce faire, que l’humanité fasse du développement durable une réalité.
BIBLIOGRAPHIE
AFEISSA Hicham-Stéphane, Éthique de l’environnement. Nature, valeur, respect, Paris, J-Vrin, 2007.
AFEISSA Hicham-Stéphane, Qu’est-ce que l’écologie ?, Paris, Éditions J. Vrin, 2009.
BRUNEL Sylvie, Le développement durable, 5e Édition, Paris, PUF, 2015.
BURBAGE Franck, Philosophie du développement durable, Paris, PUF, 2013.
DROIT Roger-Pol, Qu’est-ce qui nous unit ?, Paris, Plon, 2015.
DUFOUR Dany-Robert, Pléonexie. [dict. : « Vouloir posséder toujours plus »], Lormont, Le Bord de l’eau, coll. « La bibliothèque du MAUSS », 2015.
HULOT Nicolas, « Le climat est un facteur d’injustice sociale » : 15-33, in Floran AUGAGNEUR et Jeanne FAGNANI (dir.), Environnement et inégalités sociales, Paris, La documentation Française, 2015.
JONAS Hans, Le principe responsabilité, Trad. Jean Greisch, Paris, Les éditions du Cerf, 1990.
KOLBERT Elizabeth, La 6e extinction. Comment l’homme détruit la vie, Trad. Marcel Blanc, Québec, Guy Saint-Jean, 2015.
LARRÈRE Catherine et Raphaël, Du bon usage de la nature : Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Éditions Flammarion, 2009.
LARRÈRE Catherine, SCHMID Lucile et FRESSARD Olivier, L’écologie est politique, Paris, éd. Les petits matins, 2013.
PLATON, La république, in Œuvres complètes, trad. Robert Baccou, Paris, Garnier, 1950.
SACHS Wolfgang et ESTEVA Gustavo, Des ruines du développement, trad. Valentin Duranthon et Christine Balta, Paris, Ed. Le serpent à plumes, 2003.
SERRES Michel, Le contrat naturel, Paris, Flammarion, coll. « champs », 1992.
BARBIER René, « élément pour une philosophie du vivre ensemble », in http://www.barbier-rd.nom.fr/elements-philosophie-vivre-ensembleRB.pdf
LARRÈRE Catherine, « Multiculturalisme et environnementalisme » in http://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Larrere.Multic.pdf
MAUROY Hervé, « La Fable des abeilles de Bernard Mandeville », in Revue européenne des sciences sociales [En ligne], 49-1 | 2011, mis en ligne le 01 janvier 2015, consulté le 02 novembre 2016. URL : http://ress.revues.org/843
PNUE, Déclaration de Stockholm, in http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
18. Les impacts socioéconomiques de la crise écologique sur la vie communautaire,
SORO Torna…………………………………………….……………………………281
RÉSUMÉ :
Réagissant contre le système éducatif centré sur l’instruction, Nietzsche prône une pédagogie active qui concilie l’instruction et l’éducation. Ce nouveau paradigme pédagogique vise à former des élites à travers une éducation supérieure. La pédagogie créative peut s’appliquer au contexte du Licence- Master- Doctorat où la créativité et les talents importent tant pour sa formation que son auto-emploi.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
Reacting against the educational system centered on instruction, Nietzsche advocated on active pedagogy that balances educations. This new educational paradigm aim at the making of elites through a superior education. The creative pedagogy can be used in the perspective of the Licence- Master-Doctorat system; where creativity and talents are required for one’s training and self-employment.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
SORO Torna
Doctorant au Département de Philosophie
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d’Ivoire)
(+225) 09 528 131 / (+225) 05 979 559
LES IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE SUR LA VIE COMMUNAUTAIRE
Résumé :
Cette réflexion porte sur les impacts socioéconomiques de la crise écologique sur la vie communautaire. Aujourd’hui irréfutable, la crise de l’environnement a une forte incidence sur les relations intersubjectives et est susceptible de désintégrer les fondements de la vie communautaire et l’harmonie sociale. Cette crise est responsable des phénomènes de désertification, de pollutions diverses et de raréfaction des sols cultivables et habitables qui provoquent d’importants flux migratoires. Ces déplacements massifs sont à la base des chocs de cultures et d’intérêts et engendrent surtout des conflits civils (guerres climatiques), à travers le monde. Trouver une solution à la crise environnementale est incontestablement un gage de consolidation de la cohésion sociale. Mais, cela exige que les hommes apprennent à vivre ensemble et en harmonie avec la biosphère.
Mots-clés : Adaptation, Crise environnementale, Guerres climatiques, Nature, Paix, Réchauffement climatique, Réfugiés climatiques, Vivre-ensemble.
Subtract:
This essay is about socioeconomic impacts of ecologic crisis on community life. Nowadays irrefutably, environment crisis has strong incidences on intersubjective relations and community life foundations are likely to be shattered by ecologic factors. This crisis is the cause of desertification, various pollutions and cultivable and living lands immersion phenomena that cause some important migratory influx of peoples. These massive movements of populations are at the root of cultural and interests’ clashes and cause today civil conflicts or climatic wars through the world. Find a solution to the environmental crisis is a gage for social cohesion consolidation. But, that requires from man learning to live together and in harmony with the biosphere.
Key-words: Adaptation, Climatic refugees, Climatic swarming up, Climatic wars, Environmental crisis, Nature, Peace, Together-live.
Introduction
Aujourd’hui, les problèmes écologiques sont susceptibles de désintégrer les fondements de la vie communautaire. La désertification, la raréfaction des sols cultivables, la pollution des eaux et l’immersion des terres habitées provoquent d’importants flux migratoires (réfugiés ou déplacés environnementaux) qui ont sur l’équilibre social. Cette situation met en évidence le lien nécessaire entre le milieu naturel et la cohésion de la vie communautaire.
La cohésion sociale ne dépend plus uniquement des facteurs culturels, économiques, existentiels ou politiques (Ninon GRANGE, 2009, pp. 523-524). La qualité de l’environnement devient désormais une composante prépondérante dans la détermination des conditions du vivre-ensemble. Les relations intersubjectives ne constituent plus le viatique exclusif pour garantir une vie paisible et harmonieuse entre les membres d’une communauté humaine ou entre différents groupes sociaux. La désharmonie entre l’homme et la biosphère se présente davantage comme un frein à la stabilité sociale et économique.
Cette analyse se propose de réfléchir sur les impacts socioéconomiques de la crise écologique sur le vivre-ensemble. En d’autres termes, elle entend répondre à la question suivante : Quels sont les impacts de la crise de l’environnement sur la vie communautaire ? La vie humaine étant étroitement liée à la nature, sa détérioration influe sur les activités économiques de la vie individuelle et communautaire. Ce qui pourrait effriter la paix sociale et remettre en cause le vivre-ensemble. Il convient, alors, de s’interroger sur les alternatives pouvant conduire à une résolution de la crise environnementale afin de contenir ses conséquences sur la vie sociale. Mieux, comment peut-on pallier les impacts climatiques sur la vie communautaire ? Étant donné que la dégradation de l’environnement naturel et le phénomène des déplacés et réfugiés environnementaux peut être à la base de la désintégration de la cohésion sociale, un engagement à la fois collectif et individuel dans la protection de la nature et une gestion rationnelle de ses ressources pourraient favoriser une consolidation du vivre-ensemble.
Cette investigation sera faite au moyen des méthodes phénoménologique et analytique. Celles-ci serviront, d’une part, à examiner ces hypothèses et, d’autre part, à apporter des réponses aux interrogations ci-dessus soulevées. La réflexion sera menée autour de trois (3) axes majeurs : L’irréfutabilité de l’existence de la crise écologique (I), La crise de l’environnement comme dislocation du vivre-ensemble (II) et La protection et la gestion rationnelle de l’environnement comme ciment du vivre-ensemble (III).
L’irréfutabilité de l’existence de la crise écologique
Il faut relever que la crise de l’environnement avec ses corolaires, dont le réchauffement climatique, ne sont pas admis par tous, en dépit de toutes les mobilisations en faveur de la protection de la biosphère. Certains théoriciens y voient une imposture, une manipulation de l’opinion et une pure idéologie ne correspondant pas à la réalité des faits. Au nombre de ces climato-septiques, fait partie Claude Allègre. Pour ce dernier, les mouvements de dénonciation des conditions climatiques catastrophiques, en perspective avec la dégradation de la planète, et les défenseurs de la nature sont porteurs d’un alarmisme écologique infondé. Car, ce qu’ils décrivent ne pourrait être fondé par une réalité phénoménologique. Au contraire, ce catastrophisme serait fondé sur des conjectures qui ne reflètent pas la réalité vécue par l’homme.
Pour Allègre, le réchauffement du globe annoncé est contraire à ce que présentent les températures atmosphériques et les phénomènes climatiques observés. À ce propos, il souligne que depuis « dix ans […] le climat ne donne guère raison aux prévisions alarmistes des experts du GIEC. […] La température moyenne de l’océan n’augmente pas depuis 2003. Depuis dix ans, la température moyenne du globe a désormais tendance à décroitre » (2010, pp. 17-18). En d’autres termes, il n’y a pas de réchauffement climatique. Ce dont il est question à ce sujet, il s’agit d’une opinion majoritaire transformée en une évidence planétaire et en une vérité scientifiquement démontrée.
Cette thèse négationniste du réchauffement climatique est soutenue par d’autres scientifiques. Parmi ceux-ci figure Mojiv Latif (du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC)). Il estime que, d’après son nouveau modèle d’évaluation des conditions climatiques, « le globe va se refroidir pendant vingt ou trente ans » (Claude, ALLEGRE, 2010, p. 19). Ce qui signifie que les inquiétudes soulevées à propos du réchauffement de la planète sont infondées. Autrement dit, les activités humaines, telles qu’elles se développent actuellement ne seraient pas aussi nocives que le prétendent les environnementalistes.
C’est justement pour cette raison que la protection de la nature semble peu nécessaire à certains égards. La protection de la biosphère s’identifie même, par moment, à un antihumanisme, surtout lorsqu’elle fait appel à d’importants sacrifices de la part de l’homme. Car, d’un côté, exiger de l’être humain de tels sacrifices se présente comme une action contre son épanouissement. D’un autre côté, imputer la responsabilité de la dégradation de l’environnement naturel au genre humain s’apparente à sa diabolisation. Ainsi semble-t-il non-humain de relever le rôle de l’homme dans la destruction des équilibres naturels. Et, c’est là la dernière thèse d’une bonne partie des climato-sceptiques. Après, en effet, avoir nié la crise écologique, certains soutiennent, aujourd’hui, la thèse selon laquelle les changements climatiques que vit le monde ne sont pas imputables à l’activité humaine.
En référence à cette thèse, toute implication de la responsabilité humaine ou de l’activité anthropique dans la crise environnementale est rangée du côté des ennemis de l’humanité. C’est d’ailleurs pour cette raison que Luc Ferry perçoit l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas comme opposée aux valeurs de l’humanisme. Dans Le nouvel ordre écologique, il décrit l’éthique de Jonas comme « une critique de l’humanisme et une reconnaissance des droits de la nature » (192, p. 152). Ce qui signifie que l’éthique jonassienne, l’une des pensées pionnières de l’éthique environnementale, est assimilée à une négation de l’humanité pour ses thèses non-anthropocentriques et sa dénonciation de la nature destructrice des activités humaines pour le milieu naturel. Pour Ferry, l’incrimination du comportement dominateur et exploiteur de l’homme dans l’éthique jonassienne ne saurait correspondre à une pensée pro-humaniste. Elle est plutôt, pour lui, une remise en cause de l’humanisme et de ses valeurs fondamentales basées sur l’anthropocentrisme. Ainsi, les principaux facteurs de la dégradation de l’environnement et ses conséquences sont niés de même que la crise elle-même.
En dépit de cette négation du réchauffement climatique, les phénomènes environnementaux ne cessent de mettre en évidence la gravité de l’état de crise dans lequel se trouve la nature. La crise écologique se manifeste davantage par de multiples facteurs assez perceptibles. Elle est aujourd’hui une réalité phénoménologique irréfutables. Cette irréfutabilité se fonde sur le fait que l’essentiel des activités humaines ont un rapport direct avec l’exploitation de la biosphère. Cet usage, devenu excessif, entraine une destruction systématique des couverts végétaux. Et, cela a pour effet, d’une part, de libérer le dioxyde de carbone (CO2) emprisonné par les plantes et, d’autre part, d’empêcher l’absorption de celui produit par les activités humaines. L’accumulation de ce gaz dans l’atmosphère, et de ceux provenant de la combustion de matières fossiles, crée un effet de serre qui entraîne un réchauffement global de la planète. Ainsi, au-delà de la pollution engendrée par les combustibles végétaux et miniers, la déforestation est responsable d’une vague de chaleur qui bouleverse le climat. C’est pourquoi, Jonas souligne que « la combustion des matières fossiles, par-delà la pollution locale de l’air, pose encore un problème de réchauffement global » (1993, p. 253). Ce qui montre que les activités humaines ne laissent pas inchangée l’atmosphère générale. Au contraire, la température du globe ne cesse de s’élever (GIEC, 2013, p. 3).
Les différents rapports du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), créé par le PNUE en 1988 (Jacques EXBALIN, 2009, p. 16), attestent cette hausse inédite de la température globale. Son rapport de 2013, notamment, relève que « chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850 […]. Les années 1983 à 2012 constituent probablement la période de 30 ans la plus chaude qu’ait connue l’hémisphère Nord depuis 1400 ans » (GIEC, 2013, p. 3). La Terre est alors face à un problème climatique inédit : la hausse continue de sa température.
Cette élévation de la température mondiale, davantage inquiétante, renferme des répercussions graves pour la vie des terriens. Car, elle met l’environnement existentiel de tous les êtres vivants, l’homme y compris, en mauvais état. Pour Romain Felli, « jamais l’environnement n’a été plus mal en point : réchauffement climatique, réfugiés environnementaux, catastrophes naturelles, pollutions, désertifications, urbanisme incontrôlé, destruction des réserves naturelles, épuisement des ressources, […], etc. » (2008, p. 9) sont autant de maux dont il souffre. En d’autres termes, l’état de l’environnement naturel a été profondément dégradé. Il est en état de crise.
Cette crise écologique ne peut être niée aujourd’hui. La crise écologique et le réchauffement climatique sont manifestes et s’accentuent très vite. C’est pourquoi, Christian Gerondeau affirme qu’il « faudrait donc être de bien mauvaise foi pour nier que nous vivons un épisode de réchauffement climatique très rapide » (2008, p. 17). Ce qui signifie que l’acceptation de la crise écologique s’impose à tous, avec une évidence incontestable, indépendamment des tendances idéologiques de chacun et de son vouloir. Sa réalité phénoménologique s’oppose à toute thèse négationniste du malaise dans lequel est plongé le milieu naturel et du réchauffement climatique. Cette réalité est reconnue dans les Sommets internationaux sur le climat, l’environnement ou le développement depuis Stockholm en 1972 et a été confirmée à la Conférence mondiale sur le Climat à Paris en fin 2015, la COP 21. Dans l’accord adopté (Article 2) au cours de cette conférence, l’objectif principal que se fixent les Parties, est :
Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques (Nations Unies, 2015, p.24/39).
Cela montre qu’il y a un accord sur la réalité de la crise environnementale. Il apparait alors que la crise de l’environnement n’est nullement un fait d’imagination. Son existence est irréfutablement fondée par ses conséquences et les démonstrations scientifiques du GIEC et d’autres chercheurs. Mais, bien plus, la crise environnementale a d’importantes répercussions sur la vie communautaire des peuples et la cohésion sociale. À cet effet, la Déclaration finale de la COP 21 relève « que les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète » (Nations Unies, 2015, p.24/39). Cette menace porte aussi bien sur le niveau économique de ces sociétés que sur leur vie communautaire.
La crise de l’environnement comme amenuisement des revenus économiques et dislocation du vivre-ensemble
Les sociétés ou communautés humaines, se constituent à par des personnes regroupées principalement autour d’intérêts communs (PLATON, 462b). C’est ce qui explique le fait qu’il existe des communautés de pêcheurs, de chasseurs, d’agriculteurs, etc. L’exploitation des ressources naturelles, leur distribution et répartition participent à la vie des membres et à la cohésion des communautés. La vie communautaire est alors conditionnée par celle des personnes y prenant part. Or, l’existence de l’homme est intrinsèquement liée à l’environnement naturel. Car, il n’y a pas de menace contre la biosphère qui n’ait de répercussions sur la vie de l’être humain (Hans JONAS, 1993, p. 188).
Au regard de leur communauté de destin « à travers le danger » (Hans JONAS, 1993, p. 188), la biosphère constitue la principale condition d’existence de l’homme. La vie d’une communauté est, de ce fait, liée aux ressources que renferme le territoire sur lequel elle s’installe. La dégradation des paysages naturels de ce territoire réduit sources de revenus des populations. Dans ce contexte, la recherche de moyens de subsistance peut effriter le tissu social, car chaque membre protège les espaces acquis ou conquis (PLATON, 462c). Ainsi, la destruction de la nature est une menace contre la continuation de toute possibilité de vie communautaire.
De plus, la crise écologique est un facteur de paupérisation. Elle met à mal les moyens de production de richesses de certaines régions et peuples. Elle entraine la détérioration des terres arables. De ce fait, celles-ci deviennent moins productives. Les communautés qui exploitent ces terres sont rendues économiquement vulnérables. Leurs moyens de subsistances se réduisent progressivement du fait des aléas climatiques.
Le rapport 2014 du GIEC relève, à cet effet, des :
risques de perte des moyens de subsistance et de revenus dans les régions rurales en raison d’un accès insuffisant à l’eau potable et à l’eau d’irrigation, ainsi qu’à la diminution de la productivité agricole, en particulier pour les agriculteurs et les éleveurs disposant de moyens limités dans les régions semi-arides » (2014, p. 14).
. En d’autres termes, les populations dont les moyens de subsistance et les revenus reposent sur les exploitations agro-pastorales sont fortement menacées par les conséquences liées à la dégradation de la nature. Car, les impacts environnementaux sur leurs revenus économiques peuvent rendre quasi impossible la satisfaction de leurs besoins élémentaires de survie.
Étant dans l’incapacité d’assurer leurs moyens existentiels avec les terres qu’ils occupent, ces populations n’ont nulle autre alternative que de migrer vers d’autres zones plus propices à la vie. Ce phénomène de migration ou de réfugiés climatiques constitue, aujourd’hui, l’un des problèmes socio-environnementaux les plus importants et inquiétants. Les flux de déplacés environnementaux deviennent davantage importants avec « la fonte des calottes polaires, […] l’élévation du niveau océanique, […] l’immersion de grandes surfaces de basses » (Hans JONAS, 1993, p. 253) et la désertification. Pour les problèmes d’immersion ou de désertification, l’unique solution semble être le refuge. La survie devient pratiquement inenvisageable dans de telles situations. De nombreux peuples se trouvent déjà confrontés à cette difficile réalité de réfugiés climatiques. À ce propos, Christel Cournil précise :
plusieurs territoires et manifestations sont d’ores et déjà identifiés : avancée du désert de Gobi en Chine, inondations au Bangladesh et dans le delta du Nil, submersion d’archipels comme les îles Tuvalu, Kiribati, fonte du permafrost des terres des Inuits d’Amérique du Nord, du Canada et du Groenland, sécheresse de la bande sahélienne en Afrique de l’Ouest, etc. (2012, p. 26).
Toutes les populations de ces régions sont en phase de perdre une partie de leurs sources de revenus et de subsistance ou la totalité de leurs territoires à cause du réchauffement climatique. L’existence des États insulaires est même en jeu (Marilyn TREMBLAY, 2015, p. 98) devant l’importance et la récurrence des répercussions climatiques.
Ainsi la crise environnementale est-elle aujourd’hui un facteur responsable de la migration de nombreuses personnes ou populations. Car, l’« influence des changements climatiques sur les humains […] stimule la migration, détruit des moyens d’existence, perturbe les économies, sape le développement » (UNFPA, 2001). En d’autres termes, le réchauffement de la planète a une incidence directe sur les revenus des populations et sur les mouvements migratoires de notre époque. Si le développement et les économies sont compromis et les moyens de subsistances inexistants, il est évident que le seul recours des peuples en détresses n’est que la migration. Les mouvements de migrants environnementaux peuvent être internes ou étrangères. Norman Myers estime que le nombre de déplacés climatiques, d’ici 2050, atteindra au moins les 200 millions (Oli BROWN, 2008, p. 11).
Mais, un autre problème est lié aux impacts de la crise écologique et au phénomène de déplacés climatiques. Il s’agit de la naissance de nouveaux conflits multiformes entre les personnes, les peuples ou les États et l’exacerbation des anciens conflits. Les migrations humaines du fait de la rareté des ressources naturelles peuvent être sources de tensions sociales et engendrer des guerres civiles. Car, souvent les communautés, dans la défense de leurs intérêts, sont hostiles à toutes invasion extérieure. Elles estiment que les ressources qu’elles disposent, sont des biens communs dont elles ne peuvent être spoliées.
Selon le rapport 2014 du GIEC, « le changement climatique peut accroître indirectement les risques de conflits violents – guerre civile, violences interethniques – en exacerbant les sources connues de conflits que sont la pauvreté et les chocs économiques […] » (GIEC, 20014, p. 20). Les terres habitables et cultivables devenant rares ainsi que les ressources de subsistance, des conflits peuvent naître de leur occupation et exploitation. Harald Welzer a raison de soutenir, à ce propos, que les violences du XXIème seront essentiellement liées aux changements climatiques, la détérioration de l’environnement et la raréfaction des ressources naturelles (Harald WELZER, 2009, p. 189). Ces guerres climatiques existent bien déjà dans certaines régions du monde. Walzer souligne d’ailleurs que la « première guerre climatique » (Harald WELZER, 2009, p. 97) est celle du Darfour. Ce qui montre que la crise de l’environnement est un important facteur de désintégration de la cohésion sociale.
Il est donc évident que la crise écologique réduit les ressources économiques et de subsistance des populations. La raréfaction des ressources naturelles et les migrations environnementales qui en résultent, sont des sources de dégradation de l’harmonie sociale et du vivre-ensemble. Un bon état de l’environnement est déterminant pour une vie communautaire harmonieuse. Une gestion rationnelle et durable de l’environnement est, de ce fait, nécessaire à l’édification d’une vie communautaire paisible.
La protection et une gestion rationnelle de l’environnement comme ciment du vivre-ensemble
Les incidences de la crise écologique sur les populations humaines et la vie communautaire sont devenues beaucoup importantes. Elles exigent des alternatives susceptibles de les contenir. Les populations et les politiques, pour faire face aux répercussions environnementales sur la vie humaine, ont recours à divers moyens ou attitudes. Parmi ceux-ci, l’adaptation aux changements climatiques constitue l’une des principales voies de recours. Elle consiste à fournir, aux populations concernées, les moyens de pouvoir développer de nouvelles capacités leur permettant de vivre dans leurs territoires habituels, en dépit des changements climatiques qui y sont intervenus. Ainsi de nouvelles habitudes culturales, alimentaires, vestimentaires, culturelles, économiques, peuvent-elles être adoptées en vue de surmonter les obstacles climatiques et d’assurer de meilleures conditions d’existence.
Dans cette optique, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), dans son rapport de 2014, relève des possibilités d’adaptation aux changements climatiques, selon les réalités vécues sur les continents (2014, pp. 21-25). Mais, on remarque dans ce rapport que certaines propositions de possibilités d’adaptation aux risques climatiques sont estimées à de très faibles degrés de réussite. Bien plus, le GIEC ne fait pas de proposition d’adaptation pour tous les risques environnementaux. L’adaptation ne concerne, alors, que quelques problèmes environnementaux. Les autres exigent une autre attitude, en l’occurrence la migration.
Les États insulaires, étant les plus concernés par cette situation, sont appelés à intégrer dans leur politique générale de protection de leurs habitants, l’alternative de la migration. Car, la fonte des glaciers polaires, si elle n’est pas stoppée, engloutira les îles constitutives de ces pays. C’est d’ailleurs pourquoi, conscients de cette réalité, certains de ces États ne manquent pas d’envisager des voies migratoires plus préventives et diplomatiques pour leurs populations. C’est le cas du Kiribati. Cet État insulaire, menacé de disparition avec la montée du niveau des océans, a acquis un territoire de refuge de 20 Km2 aux Fidji (Laurence CARMEL, 2014).
Cette solution est adéquate pour prévenir et contenir les problèmes règlementaires des migrants. Mais, elle serait peu envisageable si le phénomène des réfugiés environnementaux devrait se généraliser dans le monde ou toucher une partie importante des régions habitées du globe. Dans un tel scénario, le risque de chocs de cultures et d’intérêts, ainsi que celui de guerres climatiques, restent très élevés. Les problèmes environnementaux sont alors d’importants facteurs de dislocation du vivre-ensemble.
Il importe alors que la crise environnementale soit traitée à sa racine. Ce qui veut dire qu’au-delà des tentatives d’adaptation ou des perspectives de migration, il faut juguler la dégradation de la nature et restaurer les parties endommagées de la biosphère. Il s’agit de protéger la nature et d’assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Pour cela, il est indispensable que l’être humain apprenne à vivre en harmonie avec la nature.
Cette culture du vivre-ensemble avec la biosphère s’assimile à une dévotion ou un comportement citoyen envers l’environnement naturel. Il est impératif pour l’homme d’adopter cette attitude éco-citoyenne, afin de le protéger. C’est la condition principale de garantir la continuation de son existence. Car, le genre humain partage un destin commun avec la nature. Ainsi que l’affirment Edgar Morin et Anne Brigitte Kern, « nous sommes solidaires de cette planète, notre vie est liée à sa vie. Nous devons l’aménager ou mourir » (1993, p. 213). La biosphère est une réalité à laquelle l’existence humaine se trouve intrinsèquement rattachée.
Le comportement de l’homme envers l’environnement naturel déterminera à long terme la permanence de la vie humaine sur Terre. La prise de conscience de cette réalité est essentielle pour parvenir à faire de la nature le partenaire de l’homme. En d’autres termes, l’idéologie de la domination de la nature doit être substituée par la volonté de ne pas l’endommager, bien qu’en continuant jouir de ses ressources. Ce qui requiert une forte conscience écologique de la part des populations. Cette conscience seule est susceptible d’induire un changement significatif dans les rapports de l’homme avec la nature et donner naissance à un mode de vie éco-citoyen.
Pour aboutir à cette écocitoyenneté, il est important que les individus intègrent le souci de la biosphère, non seulement dans leurs conception et perception de la vie, mais aussi dans leurs comportements. Car, c’est seulement une « vision du milieu naturel favorisant des rapports harmonieux entre une société et son environnement » (Teresa KWIATKOWSKA, 2007, p. 182) qui peut permettre d’opérer une réforme profonde de notre mode de gestion et d’exploitation des ressources naturelles et de contenir la crise écologique. En effet, pour rompre d’avec le mode de vie basé sur le gaspillage et le consumérisme et adopter une gestion durable et un usage de nécessité des ressources naturelles, il faut nécessairement un changement de mentalité à l’égard de la biosphère.
Ce changement requiert une éducation de base des populations. Celle-ci doit substantiellement prendre en compte les questions environnementales et les conséquences liées aux problèmes écologiques. Cette éducation est une nécessité pour permettre l’émergence d’une nouvelle forme de citoyens, conscients de la communauté de destin entre l’être humain et le milieu naturel. Cette conscience que la dégradation de la biosphère constitue un danger pour, d’une part, leur survie et, d’autre part, leur équilibre social, peut inciter les populations à développer une relation harmonieuse avec l’environnement naturel. Elles peuvent alors se constituer en agents de protection de la biosphère et de gestion durable des ressources naturelles.
Une attitude éco-citoyenne peut alors permettre de réduire de façon significative la pression anthropique et de limiter les impacts nocifs sur le milieu naturel. En plus de la baisse de l’empreinte écologique à laquelle l’on peut parvenir, l’engagement collectif et individuel des populations dans une relation non conflictuelle avec leur environnement, peut également permettre d’assurer une restauration des couverts végétaux, des sols et des cours d’eau détruits. Cette restauration de la nature pourrait favoriser la relocalisation des populations contraintes à se déplacer, d’une part, et procurer plus de moyens existentiels et économiques aux peuples, d’autre part. Ce qui aura indubitablement pour effet de réduire significativement les tensions communautaires et (r)affermir le vivre-ensemble.
Ainsi, la protection de la nature et une meilleure gestion de ses ressources contribueront à endiguer la crise environnementale. En trouvant donc une solution à la crise écologique, cela pourrait constituer un facteur important de consolidation de la cohésion sociale et de la vie communautaire.
Conclusion
En définitive, l’on constate que la crise de l’environnement constitue une menace contre l’existence de l’être humain et est à prendre en considération. Elle est, aujourd’hui, caractérisée par la destruction des sources de revenus des populations et de leurs milieux de vie. Cette situation provoque, à travers le monde, le déplacement de nombreux peuples. Ces flux migratoires constituent, aujourd’hui, un facteur majeur de conflits civils ou militaires. Ces guerres climatiques qui procèdent des chocs de cultures et d’intérêts provoqués par le phénomène des déplacés et réfugiés environnementaux, sont un facteur important de désharmonie de la vie communautaire.
Trouver une solution durable à la crise environnementale est, se révèle alors essentiel à la résolution de ces conflits climatiques ou environnementaux. Car, la protection de l’environnement naturel et une gestion rationnelle, équitable et durable des ressources naturelles sont des leviers importants pour garantir aux hommes des sources de revenus suffisants pour leur vie. Cela est également un canal déterminant pour la reconstitution de la cohésion sociale dans certaines régions du monde et un moyen de prévention de conflits civils à venir. Apprendre à vivre ensemble et en harmonie avec la nature constitue donc un gage de consolidation du vivre-ensemble.
Bibliographie
- Christel COURNIL, « Les déplacés environnementaux », in Les réfugiés. TDC, n° 1028 – 15 janvier 2012, Paris, CNDP – CHASSENEUIL- DU-POITOU, 2012.
- Christian GERONDEAU, Écologie, la grande arnaque, Paris, Albin Michel, 2008.
- Claude ALLÈGRE, L’imposture climatique ou la fausse écologie, Paris, Plon, 2010.
- Edgar MORIN, Anne Brigitte KERN, Terre-Patrie, Paris, Éditions du Seuil, 1993.
- GIEC, Changements climatiques 2013 : Les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Thomas F. Stocker et al.], Cambridge et New York, Cambridge University Press, 2013.
- GIEC, Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité – Résumé à l’intention des décideurs. Contribution du Groupe de travail II au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Christopher B.Field et al (dir.)], Genève (Suisse), Organisation météorologique mondiale, 2014.
- Hans JONAS, Le principe responsabilité. Vers une éthique pour la civilisation technologique, trad. Jean Greish, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993.
- Harald WELZER, Les guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009.
- Jacques EXBALIN, Le réchauffement climatique à la portée de tous : Les causes, les réalités et les conséquences, Paris, L’Harmattan, 2009.
- Laurence CARAMEL, « Face à l’élévation du Pacifique, Kiribati achète 20 km2 de terre refuge aux Fidji », in Le Monde (14 juin 2014) en ligne : Le Monde.fr, http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/14/face-a-l-elevation-du-pacifique-kiribati-achete-20km2-de-terre-refuge-aux-fidji_4438266_3244.html?xtmc=tuvalu&xtcr=1> (Consulté le 12/10/2015, en ligne).
- Luc FERRY, Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1992.
- Marilyn TREMBLAY, « Les déplacés environnementaux dans le contexte de la disparition graduelle d’États insulaires : Une protection partielle par le droit international », Mémoire de Maîtrise en droit à l’Université de Laval, Québec, Canada, 2015.
- NATIONS UNIES, « Adoption de l’Accord de Paris », FCCC/CP/2015/L.9, in http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf (Consulté le 13/12/2015, en ligne).
- Ninon GRANGÉ, De la guerre civile, Paris, Armand Colin, 2009.
- Oli BROWN, Migrations et changements Climatiques, trad. Marc Tessier et Pierre Nicolas, Éditions de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Genève, 2008.
- PLATON, La République, http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/philosophie/ressources/œuvres.htm (Consulté le 19 janvier 2015, en ligne).
- Romain FELLI, Les deux âmes de l’écologie. Une critique du développement durable, Paris, L’Harmattan, 2008.
- Teresa KWIATKOWSKA, « Éthique de l’environnement : une pratique pour la suivie de la planète », in Henk Hendrikus Antonius Maria Juhanne TEN HAVE, Éthique de l’environnement et politique internationale, Paris, Éditions UNESCO, 2007.
- UNFPA, L’état de la population mondiale 2011. 7 milliards de personnes : leur monde, leurs possibilités, New York, UNFPA, 2011.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
19. Une écologie humaniste comme gage de la protection de la vie,
Casimir Konan BOUSSOU……………………………………………………….281
RÉSUMÉ :
Réagissant contre le système éducatif centré sur l’instruction, Nietzsche prône une pédagogie active qui concilie l’instruction et l’éducation. Ce nouveau paradigme pédagogique vise à former des élites à travers une éducation supérieure. La pédagogie créative peut s’appliquer au contexte du Licence- Master- Doctorat où la créativité et les talents importent tant pour sa formation que son auto-emploi.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
Reacting against the educational system centered on instruction, Nietzsche advocated on active pedagogy that balances educations. This new educational paradigm aim at the making of elites through a superior education. The creative pedagogy can be used in the perspective of the Licence- Master-Doctorat system; where creativity and talents are required for one’s training and self-employment.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
Casimir Konan BOUSSOU
Université Alassane Ouattara
(Bouaké-Côte d’Ivoire)
Une écologie humaniste comme gage de la protection de la vie
Résumé
La question de la responsabilité humaine à l’égard de l’environnement devient de plus en plus importante, dans la mesure où plusieurs facteurs existentiels indiquent que le rythme de la dégradation de la nature s’accroît de façon exponentielle. Ainsi, pour éviter que l’humanité ne sombre dans une catastrophe écologique globale et irréversible, la définition d’une éducation axée sur le développement durable s’impose. L’éthique de la responsabilité apparaît en ce sens comme la clé pour réapprendre à vivre avec notre environnement. La nature étant le creuset de la vie, sa disparition va de pair avec la disparition de la vie elle-même. Il devient alors impératif de déterminer les conditions d’une bonne gestion de la nature. La question du vivre-ensemble doit donc être un atout majeur de solidarité, d’unité et de collectivité pour, non seulement défendre nos valeurs, mais aussi, pour réfléchir sur la question de la protection de l’environnement
Mots-clés : environnement, éthique, protection, responsabilité, vie.
INTRODUCTION
La crise écologique actuelle met à l’épreuve les conditions propices à l’épanouissement d’une vie authentiquement humaine sur terre. Elle menace la condition de notre existence qu’est la nature. Plusieurs facteurs environnementaux indiquent que le rythme de la dégradation de la nature s’accroît de façon exponentielle, au point qu’elle met en péril notre existence. En effet, la nature étant le creuset de la vie, sa disparition signifie celle de tous les vivants. Il devient alors impératif de déterminer les conditions d’une bonne gestion de la nature afin de préserver la possibilité de la continuation de la vie sur terre.
La précarité dans laquelle se trouve notre environnement, eu égard à la destruction de la nature, mérite une réflexion philosophique que nous osons engager dans les sillons de la pensée jonassienne. Selon Hans Jonas, il existe une intimité profonde transversale entre l’homme et la nature. Mais que devons-nous faire pour résoudre le problème de la dégradation de la nature, qui constitue un véritable fléau pour l’humanité tout entière ? Quelle évaluation peut-on en faire dans un contexte où la crise environnementale invite à une réflexion profonde, multiforme et collective ? Comment assoir les conditions d’un vivre-ensemble dans un monde qui vacille ? De telles interrogations impliquent une reconsidération des rapports entre l’homme et son environnement. Notre thèse suppose que la résolution des crises écologiques actuelles passe nécessairement par le vivre-ensemble. Cela signifie, que si l’éthique environnementale ignore la pertinence des apports culturels différenciés, elle peut être handicapée dans la lutte pour la protection de l’environnement. C’est donc une responsabilité à la fois individuelle et collective qui peut venir à bout de la crise écologique mondiale. Cela se justifie à travers l’impératif catégorique de Hans Jonas qui stipule : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre » (1993, p. 30).
L’objectif qui sous-tend cette analyse est que la méconnaissance des réalités biologiques de la vie peut faire croire que la nature peut se reconstituer d’elle-même en dépit des interventions dangereuses qu’on y mène. Il faut donc amener les hommes à comprendre, qu’il y a un seuil à ne pas franchir dans l’exploitation de ce cadre de vie. Notre objectif est de montrer, dans un premier temps, que la destruction de la nature va de pair avec la destruction de la vie. Ensuite, nous montrerons qu’établir une harmonie entre l’homme et la nature est naissante aujourd’hui. Nous dégagerons des stratégies et des mécanismes de protection efficace de la nature, afin de susciter une attitude éco-citoyenne.
- Liberté technoscientifique et condition existentielle de l’homme
Au XXIe siècle, il est évident que la liberté est l’un des fondements des recherches scientifiques et technologiques. Seulement, la mise en pratique des résultats de la recherche reste problématique. Les dangers des découvertes et des inventions scientifiques s’accentuent avec l’introduction des biotechnologies dans toutes les politiques de développement. En d’autres termes, la nature, tout entière, est soumise aux exigences marchandes et aux désirs des scientifiques. C’est dans ce sens que le commandant Jacques-Yves Cousteau affirme : « Plus de 40% des espèces océaniques ont été anéanties en un laps de temps très court. Il apparait délirant, ajoute le célèbre océanographe, de présenter comme espoir du monde ce qu’on assassine » (L’Encyclopédie Glorier, 1980, p. 25). Pour lui, il est temps que l’on cesse de considérer l’océan comme un dépotoir, car, c’est le plancton végétal marin qui produit l’oxygène terrestre et ce sont les mers qui pourront un jour apporter une solution au problème de la malnutrition, selon la théorie de Cousteau.
Mais pour que cela soit possible, il faut que l’homme devienne le responsable de la terre, or tel n’est pas le cas ; dans la mesure où, aujourd’hui, avec la puissance de la technique, l’homme a tout le pouvoir d’exploiter la terre à sa guise. Par le pouvoir de la technique :
Il tend à vouloir dominer le territoire, bâtir des villes, des murs, des citadelles, creuser des puis, pratique l’irrigation. Il ne s’agit plus d’un échange symbolique dans un cycle de vie cosmique. L’être humain contrôle et gère la vie, notamment celle des plantes et des animaux. On pourrait dire en somme qu’il arrache à Dieu une partie de son pouvoir. Il devient un rival de Dieu. (André BEAUCHAMP, 2013, p. 5).
Nourrit par l’utopie technologique, l’homme devient ainsi un demi dieu, dans la mesure où, il cherche à percer tous les mystères de la vie. Que l’homme soit heureux un jour, que le contenu rêvé de l’âme humaine se réalise, ne concerne pas seulement le possible, c’est absolument nécessaire.
Cependant, ce processus d’objectivation scientifique du monde engendre à la fois la rupture de la solidarité anthropocosmique, l’équilibre éco-systémique et une crise environnementale majeure. Visiblement, la liberté de la recherche scientifique et celle des inventions technologiques déconstruisent et arraisonnent la nature et l’environnement. La technique moderne constitue, quelque fois, un danger qui réside précisément dans le fait que nous ne pouvons pas prévoir les conséquences de l’application de ses nouvelles connaissances. « Peut-être pourraient-elles être appliquées à bon escient et profiter à l’humanité. Mais cela ne suffit pas, parce que l’histoire nous a montré combien l’homme est plus enclin à mésuser qu’à bien user de sa puissance » (Gordon Rattray TAYLOR, 1971, p. 291). D’où les projets du développement durable qui invitent à un sens de responsabilité éthique plus grand.
L’éthique de la responsabilité a pour but de canaliser, de réorganiser, de réorienter le pouvoir et l’action des technosciences. En effet, l’homme doit se percevoir comme un être faisant partie intégrante de la nature. L’éthique jonassienne représente ainsi le moyen par lequel l’on peut relativement canaliser ou, du moins éclairer, accompagner éthiquement l’opération technoscientifique. À l’image de sa philosophie de la biologie, Jonas tente de fonder un impératif existentiel global et bipolaire.
Le respect de la vie devient une obligation morale, dans la mesure où toutes les espèces vivantes aspirent à la vie. Nous devons veiller à ce que la vie proprement humaine ne soit pas mise en péril. Il faut, par conséquent, la préserver quel qu’en soit le prix. La vie est une fin en soi, un bien absolu, une valeur non mesurable et non quantifiable. Sa pleine réalisation exige la liberté de la recherche, le progrès des connaissances et la valorisation des découvertes.
La nature exprime une vie qui est l’une des conditions de l’équilibre cosmique. Sans cet équilibre, la vie humaine, notamment celle des générations présentes et futures, ne peut prospérer. C’est pour cette raison que Hans Jonas formule son impératif existentiel de la manière suivante : « inclus dans ton choix actuel l’intégrité future de l’homme comme objet secondaire de ton vouloir » (1993, p. 31). Comme l’homme-technicien détient le pouvoir de s’autodétruire, Jonas nous invite à agir en conséquence afin de réduire ces risques. Or, la technique, avec ses prouesses indiscutables, nous montre qu’elle est un pouvoir capable de répondre à tous les fantasmes et désirs de l’humanité. Tout cela vise à réaliser le vœu cartésien qui consiste à rendre l’homme « comme maître et possesseur de la nature » (René DESCARTES, 1951, p. 91). La technique s’est lancée dans un projet de transformation radicale de l’essence du monde. Elle a rendu « l’homme […] plus puissant, plus fin ou tout simplement nouveau » (Gilbert HOTTOIS, 1984, p. 96).
Le progrès technoscientifique actuel entraîne des conséquences inédites qui menacent l’avenir de l’humanité. « Intervenant ainsi au cœur de toute réalité, la technique moderne finit par pénétrer, non seulement les entrailles de la nature, mais aussi et surtout les séquences de notre propre être » (Marcel KOUASSI, 2013, p. 28). La survie future de l’homme sur terre est fortement compromise par les effets néfastes et excessifs de la technique moderne. En effet, la relation de l’homme avec la technique est devenue préoccupante, voir inquiétante. Selon Heidegger, la technique moderne est devenue « un danger suprême » (Martin HEIDEGGER, 1958, p. 36).
Cependant, les conséquences néfastes et incontrôlables de ce projet montrent qu’il met considérablement la nature en danger, parce que ces attentes, notamment le bonheur de l’humanité, semble difficilement réalisables. Ce qui est préoccupant, c’est le fait que ce projet et les forces mises en œuvre pour l’atteindre sont quelques fois excessives et dangereuses pour l’avenir et le devenir de l’humanité. Ainsi, selon Jacques Ellul, « la technique conditionne et provoque les changements sociaux, politiques et économiques » (Jacques ELLUL, 1954, p. 189) de tout type de développement. Or, le danger viendrait de « l’effet cumulatif apparemment inéluctable de la technique telle qu’elle s’exerce quotidiennement dans ses formes les plus pacifiques » (Hans JONAS, 1988, pp. 29-30). C’est donc l’ensemble de nos technologies, du fait de leur effet cumulatif, qui mettrait en danger l’existence des générations présentes et futures par la destruction de l’environnement. Nous devons donc être plus prudents et responsables dans l’utilisation des objets techniques, pour éviter qu’elles transforment négativement notre structure organique et biologique ou encore la nature.
L’humanité a, de ce fait, la lourde tâche de faire en sorte que son existence authentique et son entéléchie ne soient pas sacrifiées sur l’autel du progrès technique. Cela implique aussi que, compte tenu du pouvoir outrancier de la technologie qui est à l’œuvre dans le monde, nous soyons, par notre responsabilité, le principal garant d’une vie globale et authentique. La préoccupation essentielle de Hans Jonas est le respect de l’humanité dans ses relations avec les générations futures et à la nature : en un mot au vivre ensemble. Nous devons, avant toute chose, permettre que, par la préservation de la nature ; les êtres humains et non humains puissent non seulement survivre, mais aussi vivre en harmonie. La responsabilité de garantir l’existence de l’humanité trouve son sens dans ces propos de Hans Jonas : « Jamais l’existence ou l’essence de l’homme dans son intégralité ne doit être mis en enjeu dans les paris de l’agir » (1993, p. 62). Cette restriction de l’agir technoscientifique sur l’homme est applicable dans l’exploitation de la nature qui suit sa propre finalité.
En entretenant des fins ou en ayant des buts, comme nous le supposerons maintenant, la nature pose également des valeurs ; car devant une fin donnée de quelque manière que ce soit et recherchée de facto, son obtention dans chaque cas devient un bien et son empêchement un mal, et avec cette différence commence l’imputabilité de la valeur (Hans JONAS, 1993, pp. 115-116).
Fondamentalement, tous les êtres vivants poursuivent une fin, un but qui est intimement rattaché à l’être. Le fait d’atteindre ce but, peut être défini comme un bonheur pour eux. Ce bonheur se traduit par la parfaite réalisation de leur être. Tous les êtres vivants, sans exception, déploient leur existence vers la quête de cette finalité. Mais, l’acharnement avec lequel ils désirent atteindre ce but est la preuve de sa valorisation ou de sa valeur.
Pour autant donc que les buts sont effectivement prédisposés dans la nature, y compris dans la nôtre, ils ne semblent pas jouir d’une dignité que celle de leur avoir lieu effectif et ils devraient simplement mesurés d’après leur force motivante et peut-être d’après la prime de plaisir liée à leur obtention (ou de la douleur qui résulte de leur refus (Hans JONAS, 1993, p. 116).
Cependant, il faut souligner que deux valeurs, préalablement inscrites dans leur être, déterminent ou orientent leur mouvement : le bien et le mal. Empêcher l’être vivant d’atteindre cet objectif, peut être considéré comme un mal. « Dans la faculté comme celle d’avoir des fins, nous pouvons voir un bien-en-soi, dont il est intuitivement certain qu’il dépasse infiniment toute absence de fin de l’être » (Hans JONAS, 1993, p. 116). En manifestant le besoin ardent de réaliser son être, le vivant le pose « comme étant meilleur que le non-être » (Hans JONAS, 1993, p. 117). L’être vivant préfère, dans ce cas, l’être au non-être ; c’est-à-dire la continuité de son existence à son anéantissement ou son extinction, son dépérissement.
Cela veut dire que le simple fait que l’être ne soit pas indifférent à l’égard de lui-même fait avec le non-être la valeur de base de toutes les valeurs, et le même premier « oui » comme tel […]. En ce sens tout être sentant et même par une tendance est non seulement une fin de la nature, mais également une fin en soi, à savoir sa propre fin. Et c’est précisément ici, par la lutte de la vie contre la mort que devient « emphatique » l’auto-affirmation de l’être. La vie c’est la confrontation explicite de l’être au non-être, car dans sa soumission constitutionnelle aux besoins qui est donné avec la nécessité du métabolisme, auquel la satisfaction peut être refusée, elle porte en elle la possibilité du non-être comme son antithèse qui lui est toujours présente, à savoir en tant que menace (Hans JONAS, 1993, pp. 117-118).
Chaque phénomène vivant lutte perpétuellement contre son propre dépérissement, sa disparition. En un mot, contre la mort. Mais celle-ci est inscrite dans les germes des phénomènes vivants, et elle se présente comme sa négation. En s’opposant à son dépérissement, à la mort, l’être vivant pose la vie comme une valeur absolue. Ainsi, la « vie en tant que telle est l’expression de choix face au risque du non-être qui fait partie de son essence » (Hans JONAS, 1993, p. 119).
On peut dire que, ce que visent et recherchent les êtres vivants, c’est la vie elle-même. La protection de la vie comme valeur absolue est donc placée sous la responsabilité de l’homme (d’un point de vue ontologique), parce qu’il « peut également devenir son destructeur grâce au pouvoir que procure le savoir » (Hans JONAS, 1993, p. 119). La protection de la nature devient ainsi une obligation, voire un devoir moral pour l’homme. Mais, dans quelles mesures les pays du Sud, qui veulent sortir de la pauvreté, en adoptant une économie des matières premières, peuvent-ils contribuer à la protection de l’environnement et à une vie en harmonie avec la nature ?
- Responsabilité et protection de l’environnement
La pauvreté, dans les sociétés du tiers-monde, est un obstacle au développement durable. Les populations tentent de concilier pauvreté et protection de la nature. Mais, comment peut-on protéger la nature, pendant que des êtres humains meurent de faim par le fait de la pauvreté ? Autrement dit, « comment protéger l’environnement dans l’extrême pauvreté, sans remettre en cause le droit à la vie des misérables »? (Marcel KOUASSI, 2014, p. 2).
Nous pensons que devant la souffrance des plus pauvres, le dilemme éthique est réel :
Par exemple, au nom de la protection de la biodiversité et des espèces rares, on peut demander à une population misérable et vulnérable qui tire sa pitance de la chasse d’arrêter cette activité hautement vitale. Pour cette population misérable et vulnérable, accepter une telle demande, fut-elle gouvernementale ou internationale, c’est signer son arrêt de mort et renoncer à son droit inaliénable : le droit à la vie. Comme les morts ne peuvent pas protéger l’environnement, il faut en convenir que la misère rend la protection de l’environnement problématique, voire illusoire (Marcel KOUASSI, 2014, p. 4).
Pour que le développement durable ait un avenir, la protection de la nature doit pouvoir tenir compte des modes de survie des plus démunis. Ils ne peuvent survivre qu’en exploitant la terre, les eaux, etc. Protéger la nature contre l’agression de ces derniers, sans toutefois trouver des solutions adéquates pour leur venir en aide, c’est porter une atteinte à leur droit vital. Nous pensons que « dans une société où toutes les formes de misères sont manifestes, la protection de l’environnement devient un simple slogan » (Marcel KOUASSI, 2014, p. 10). On conçoit que, dans les pays pauvres, nous assistons à l’enfermement dans le cercle vicieux de la misère ou de la pauvreté des plus démunis. « La misère, sous toutes ses formes, est un obstacle à la protection de l’environnement national et international » (Marcel KOUASSI, 2014, p. 3). La protection de l’environnement, en Afrique comme dans le reste du tiers-monde, est un leurre, un idéal qui reste idéel.
Les forêts classées, les parcs et réserves, qui permettent de préserver le peu de forêt et de faune dont nous disposons, subissent l’exploitation continue des paysans qui ne cherchent qu’à trouver leur pitance. « Face aux inégalités croissantes, les populations africaines, en quête de moyens pour assurer leur survie quotidienne, ne font plus de la protection de l’environnement une préoccupation majeure » (Marcel KOUASSI, 2014, p. 8). Pour surmonter cette attitude pragmatique, il faut mettre en place des structures qui protègent la nature en améliorant les conditions d’existence des plus démunis. Il faut une politique de développement durable, consciente de la solidarité anthropocosmique. Dès cet instant, il faut « trouver une solution à la misère de l’environnement qui est aussi celle de l’homme » (Marcel KOUASSI, 2014, p. 13).
Dans la tradition africaine, la protection de l’environnement participe à la préservation de la cohésion sociale. Quotidiennement, « la nature se présente à l’homme africain comme un réservoir de signifiant, de signe porteur de message cosmique » (Grégoire TRAORE, 2014, p. 12). D’ailleurs, les gardiens de la tradition, à travers les cultes, les contes, les interdits et les légendes, montrent que « la nature est bienveillante, elle est salvatrice et l’on se doit de la respecter. Respecter la nature, c’est respecter le legs des ancêtres […], c’est respecter l’espèce humaine » (Diakité SAMBA, 2014, p. 10).
En Afrique, la culture et les tabous résultent des rapports que les hommes entretiennent avec leur environnement. Cela veut dire qu’il existe un lien intime entre ceux-ci et le monde. C’est pour cette raison que l’environnement est considéré par les Africains comme une valeur, une source de vie, digne de respect. La destruction de la nature en Afrique n’est pas forcément liée au brassage des civilisations africaines et occidentales. La culture sur brûlis et les feux de brousse pour chasser le gibier ne sont pas des habitudes occidentales. En outre, si le bois sacré permet la préservation de la nature en Afrique, le système de forêts classées et de réserves est un moyen de préservation de la faune et de la flore en Occident. En Afrique également, il existe des méthodes et mécanismes de gestion de l’environnement qui sont mis en place par les paysans. Ces méthodes sont efficaces pour la fertilité du sol et la protection de la nature. Ces pratiques culturales que sont la jachère et l’assolement participent à la sauvegarde de la diversité biologique.
Par ailleurs, on assiste à la promotion de savoirs locaux dans la gestion de ce cadre de vie commun à tous. Dans la recherche de moyens de protection de l’environnement, les savoirs locaux ont un rôle à jouer. En effet, les sociétés traditionnelles ont toujours eu un respect pour la nature. Elles contribuent à la protection de la nature en développant les forêts sacrées, véritables cadres écologiques. La dégradation rapide des forets africaines et surtout celles de la Côte d’Ivoire, qui est passée de six million dans les années soixante à moins de deux millions aujourd’hui, s’est faite malgré la mise en place des lois et la présence des agents des eaux et forêts. En effet, la recherche de l’économie ayant pris le pas sur la sagesse, l’on a assisté impuissamment à la destruction de la flore et de la faune. Cependant, pour lutter contre la déforestation, les pouvoirs publics ont pris conscience de l’importance des pratiques des populations locales dans la gestion de leur environnement.
D’ailleurs, les différents interdits, les cultes, les contes et les légendes ont consolidé la crainte et le respect des forêts sacrées. Il en est de même pour les cérémonies initiatiques, les rites par lesquels les sociétés africaines traditionnelles développent une volonté de préservation des richesses naturelles, culturelles et spirituelles que sont les forêts sacrées. Parler de nature en Afrique, c’est aussi parler de la vie. « Il est temps que les intellectuels africains cessent de considérer les savoirs et savoir-faire locaux comme des doctrines nébuleuses inaptes au développement » (Konaté MAHAMOUDOU, 2014, p. 23). Dès lors, devant l’incapacité des États à trouver des solutions communes et durables en matière de gestion de la nature, il devient nécessaire d’encourager les initiatives des sociétés locales et traditionnelles à mettre sur pied des mécanismes de protection de la nature. Il est donc évident que :
Les actions de protection de la biodiversité ne peuvent être menées par les seuls biologistes, mais doivent être menées en coopération avec les populations locales. C’est aussi prendre en compte la diversité des savoirs, et admettre les savoirs vernaculaires en même temps que les savoirs savants[70].
La question de la place des générations futures dans la conscience africaine n’est pas fortuite. C’est une préoccupation qui est née des récentes crises écologiques qu’a connues l’humanité. Il est vrai que tout être humain est responsable de sa progéniture parce qu’il a le souci de son avenir. Mais, un tel souci prend généralement tout son sens dans le fait que ce sont des êtres, avec qui nous partageons déjà notre existence. Concernant les générations futures, les réalités se présentent autrement. Ce sont des êtres humains potentiels, c’est-à-dire dont l’existence n’est pas encore effective et par conséquent, leur bonheur semble incertain. Les techniques traditionnelles de protection de la nature en Afrique sont déjà, la preuve que ce continent se soucie, non seulement de la qualité de son environnement, mais aussi du sort des générations futures. « Pour la conscience collective africaine, la protection de la nature ne se pose pas comme une exigence purement pratique. Elle est un devoir ontologique » (Grégoire TRAORE, 2014, p. 13), tant et si bien qu’elle développe « une relation qui accorderait la même valeur à l’homme et à la nature » (Hans JONAS, 1993, p. 18).
Dans l’imaginaire des sociétés traditionnelles, il est impossible de concevoir l’homme en dehors de la nature, puisque les deux entités cohabitent et entretiennent des relations de complémentarité. L’Africain conçoit la nature comme un corps dont il est lui-même membre. Autrement dit, la nature est considérée comme la condition de l’existence humaine. En effet, c’est en sauvant la nature que l’homme arrive à se sauver lui-même. La protection et le respect de la nature sont les piliers de l’éducation en Afrique. Conditionner par le principe du vivre-ensemble, « il revient donc aux intellectuels africains, chacun selon sa compétence, d’œuvrer pour l’élaboration d’une stratégie globale » (Konaté MAHAMOUDOU, 2014, p. 20) et optimiste pour la sauvegarde de la nature.
Dans Une éthique pour la nature, Hans Jonas montre que « la puissance technique est collective et non individuelle. Par conséquent, seule la puissance collective, c’est-à-dire en définitive, la puissance politique, peut également maitriser cette liberté » (1993, p. 149). Les puissances qui pèsent sur la nature ne relèvent pas d’un seul individu, mais plutôt d’une collectivité. Dans ces conditions, la protection de la nature ne saurait venir d’une responsabilité individuelle, mais plutôt d’une responsabilité à la fois individuelle et collective. Il est donc impératif que les hommes se mettent ensemble ou se mobilisent tous pour la cause de l’environnement. C’est donc « le temps de mettre pied à terre pour réfléchir et pour souffler, si nous voulons assurer à nos enfants un avenir vivable. » (Jean-Marie PELT, 2008, p. 276). Cela consiste à faire preuve de modestie, de maturité morale et de responsabilité dans notre relation avec la nature.
Par ailleurs, il importe de souligner que la société actuelle impose à l’individu des besoins qui sont collectifs. Les puissances qui suscitent ces besoins sont aussi collectives. Dans ces conditions, il est nécessaire de penser à une action collective afin de préserver l’environnement qui tend à disparaitre.
Conclusion
Si la nature est le creuset de la vie, force est de reconnaître que celle-ci est diversement appréciée. Elle est tantôt magnifiée et vantée par les poètes pour sa beauté. Tantôt exploitée et détruite pour des besoins vitaux et surtout économiques de l’homme. Elle est ainsi au cœur d’une véritable controverse et de sentiments contradictoires. En un mot, la nature connaît une aventure ambiguë. Mais une seule vérité semble surgir de ce paradoxe : la nature connaît une dégradation accélérée. La destruction de la nature devient implacable et effroyable.
Hans Jonas propose que, la question de la protection de l’environnement doit être une action collective. En effet, « le savoir, le vouloir et la puissance sont collectives, leur contrôle doit donc l’être également » (1998, p. 105). C’est pour dire qu’il est impossible actuellement de gérer individuellement la crise écologique. C’est donc l’unité, la collectivité et le vivre ensemble, par les associations, les ONG, qu’on peut venir à bout de cette tâche. Mais cela ne peut être possible que par l’intervention des pouvoirs politiques. Ceux-ci peuvent déterminer des règles de conduite, mobiliser des individus et groupe d’individus pour la cause de l’environnement.
C’est donc le moment d’instaurer des systèmes politiques, capables de gérer de « façon responsable et rationnelle les ressources naturelles sur lesquelles repose la survie de l’humanité. [Il faut donc] encourager les systèmes politiques à conformer leurs normes ou principes d’action au respect de l’intégrité physique de la nature » (Grégoire TRAORE, 2014). La question du vivre ensemble doit être un atout majeur de solidarité et d’unité, pour non seulement défendre nos valeurs, mais aussi, de réfléchir sur la question de la protection de l’environnement.
BIBLIOGRAPHIE
- Hans JONAS, Le principe responsabilité, Paris, CERF, 1993.
- Hans JONAS, Pour une éthique du futur, Pavot et Rivages, Paris,1998.
- Hans JONAS, Une éthique pour la nature, Desclée de Brouwer, Paris, 1993.
- Jacques ELLUL, La technique où l’enjeu du siècle, Paris, Armand Colin, 1954.
- Martin HEIDEGGER, Essais et conférences, trad. André Préau, Paris, Gallimard, 1958.
- L’Encyclopédie Glorier, Le livre des connaissances, volume 10 sur la nature, Montréal, Glorier Limitée, 1980.
- Jean-Marie PELT, Nature et spiritualité, Paris, Fayard, 2008.
- Gilbert HOTTOIS, Le signe et la technique, Paris, Aubier, 1984.
- Gordon Rattray TAYLOR, La révolution biologique, Paris, Marabout université, 1971.
- Marcel N’dri KOUASSI, Heidegger et la question du transfert des technologies en Afrique, Abidjan, CRESTE Édition, 2013.
- René DESCARTES, Discours de la méthode suivi des méditations, Paris, Collection Union Générale d’Edition 10.18, 1951.
- Hans JONAS, « La science comme vécu personnel », in Études phénoménologiques, n°8, 1988.
- André BEAUCHAMP, Gérer la terre? https://www.biblisociety.ca/Summer2013AB/feature_3099.html, in Actualités Bibliques, Juillet-Décembre 2013, Volume 38 n°2, Consulté le 26-11-2015.
- Diakité SAMBA, « De la crise du savoir en Afrique: du soupçon au développement», in Les cahiers de IRDA, n°001, Janvier 2014, http://www.institutirda.org/matieres/Prof.%20SAMBA%20DIAKIT%C3%89.pdf . Consulté le 12-09-2016.
- Marcel N’dri KOUASSI, « Protection de l’environnement dans la misère et la misère de l’environnement en Afrique », in Revue baobab, n°7, Deuxième semestre 2010.
- Catherine LARRÈRE, Multiculturalisme et environnement, in http://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Larrere.Multic.pdf, consulté le 08/07/2016.
- Grégoire TRAORÉ, « Mythes et protection de l’environnement en Afrique », http://www.institutirda.org/matieres/Dr.%20TRAORE%20Gr%C3%A9goire.pdf , in Les cahiers de IRDA, N°001, 2014, consulté le 30-06-2014.
- Grégoire TRAORÉ, « Démocratie et gestion de l’environnement à la lumière de l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas », http://www.implicationsphilosophiques.org/actualite/une/democratieetgestiondelenvironnement/ , in Implication Philosophique, publié le 20 Juin 2014, consulté le 5-10- 2015.
- Mahamoudou KONATÉ, « Pour une épistémologie des transferts de technologie chez Sidiki Diakité », http://www.institutirda.org/matieres/Dr%20KONAT%C3%89%20Mahamoudou.pdf , in Les cahiers de IRDA, n°001, Janvier 2014. Consulté le 12-09-2016.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
20. L’environnement à l’épreuve de la mondialisation,
KOUA Guéi Simplice……………………………………………………………….281
RÉSUMÉ :
.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
KOUA Guéi Simplice
Université Alassane Ouattara
Cel : 87001834 / 45921592
L’environnement à l’épreuve de la mondialisation
Résumé
Les dégradations de l’environnement s’accentuent avec les processus de mondialisation en cours. La réalité de notre monde mondialisé est faite de changement climatique et de désertification. Nous assistons au triomphe de l’économie capitaliste fondée sur la logique du profit, l’ouverture du monde aux échanges de capitaux et de marchandises. L’extension des lois du marché entraîne une marchandisation de l’environnement naturel puisqu’elle accentue l’exploitation mercantiliste de la terre et du vivant. Aujourd’hui, tous les biens et services environnementaux sont l’objet d’une évaluation économique et monétaire. Devenue une simple marchandise, la nature est surexploitée à tel point qu’elle tend à disparaître avec toutes les espèces vivantes qui la composent. Dans la mesure où ce type d’économie accentue la destruction de la nature, il nous faut renoncer à ce qui semble être son souffle vital, c’est-à-dire la logique du profit, pour tendre vers une économie de besoins susceptible de préserver les ressources naturelles.
Mots-clés : capitalisme – économie – économie de besoins – marchandise – mondialisation – nature – profit
Abstract
The process of globalization arouses the increase of environment degradation. The reality of our globalized world is made of climatic change and of desertification. We are assisting to the triumph of the capitalist economy based of the principle of profit, the accessibility of the world to capital exchanges and to goods. The extension of the law of market brought about the marketing of the natural environment, for it enhances the mercantilist exploitation of the land and of all the livings. Today, all the goods and environmental services are subjected to an economic and monetary evaluation. As merchandise, the nature is over-exploited to such a point that it’s on the way to disappear with all the living species which make it up. Insofar as this kind of economy enhances the destruction of the nature, we have to renounce what seems to be its vital breath, that is to say, the logic of profit in order to tend toward an economy of needs likely to preserve the natural resources.
Keywords: capitalism – economy – economy of needs – globalization – merchandise – nature – profit
Introduction
La mondialisation en cours porte des atteintes épouvantables à l’environnement naturel. Le monde globalisé soumet la terre à une logique qui n’est pas la sienne. De plus en plus les déserts progressent, les sécheresses s’intensifient, les changements climatiques s’amplifient, les pollutions se multiplient, la biodiversité se raréfie. La société entièrement globalisée entraîne des émissions et des extractions de tout genre, soumettant ainsi l’humanité à de nouvelles angoisses aussi qu’à de nouvelles misères. Or, août 1991 avait suscité un immense espoir chez tous les habitants de la planète. Cette date qui marque la fin de la bipolarisation du monde devrait donner un souffle nouveau à l’humanité. À cette époque, l’humanité se croyait entrée dans une nouvelle ère de paix et de liberté. Comme le témoigne Jean Ziegler, « des millions d’hommes et de femmes à travers la planète crurent sincèrement que la liberté triomphait, que l’aube d’un monde civilisé, démocratique, ordonné selon le droit et la raison, s’annonçait » (Jean ZIEGLER, 2002, p. 39). La fin de la guerre froide devrait favoriser un projet collectif de l’humanité, c’est-à-dire un monde dans lequel les hommes, les femmes et les enfants se sentiraient bienveillants sur une terre épanouissante.
Mais, contre toute attente, l’unification du monde a abouti à la marchandisation de la terre et du vivant. Plutôt que de s’engager dans des conditions vraiment respectueuses de la nature, la société entièrement globalisée sombre dans une nouvelle forme de gaspillage, de surexploitation et de destruction des ressources environnementales. Consacrant le triomphe de l’économie capitaliste, elle-même renfermée dans la logique marchande, la mondialisation a transformé la planète tout entière en un vaste marché où tout, ou presque tout, devient valeur vénale. Devenue simple marchandise évaluable à un prix économique et monétaire, la nature tend à disparaître avec toutes les espèces qui la composent.
C’est sur ce moment de régression que nous tentons de porter notre réflexion critique. L’une de nos tâches dans ce travail est de comprendre le phénomène de mondialisation. La mondialisation en tant que support du capitalisme conduirait-elle vers l’apocalypse ? La mondialisation serait-elle une supercherie en vue d’une surexploitation des ressources naturelles qui favorisent la survie de l’humanité ? Si tel est le cas, comment pourrait-on s’en sortir ?
Notre analyse se propose de montrer que la mondialisation n’est rien d’autre qu’un capitalisme mondialisé qui se soucie peu des préoccupations écologiques. C’est pourquoi il faut sortir de sa logique destructrice au profit d’une économie de besoins susceptible de préserver la planète. Pour défendre cette idée, nous avons divisé notre travail en trois parties. La première partie consiste à montrer que la mondialisation est une colonisation du monde par l’économie capitaliste. Pour mettre en évidence la légitimité de cette thèse, nous nous sommes appuyés sur le livre de Michel Beaud intitulé Le basculement du monde dans lequel, à travers les trois phases de la mondialisation, à savoir l’internationalisation, la multinationalisation et la globalisation, il montre que ces trois termes renvoient essentiellement à des réalités économiques.
La deuxième partie nous permet de montrer que la mondialisation a réduit la terre et le vivant à de simples valeurs vénales. Elle a transformé la planète tout entière en un vaste marché où tout a valeur de marchandise. Par ailleurs, elle crée de nouveaux besoins, de nouvelles dépendances qui entraînent la surexploitation des ressources naturelles. Pour pallier cette situation susceptible de conduire à une catastrophe humanitaire, nous proposons, dans la troisième partie, comme alternative, une économie de besoins capable de préserver l’environnement naturel. Cette économie de besoins est à redécouvrir aujourd’hui, car elle correspond mieux à notre situation de crise écologique.
I/ La mondialisation : une idéologie capitaliste
La mondialisation sous-entend l’idée d’uniformisation, voire d’unification du monde. Pour René Passet, il s’agit d’un phénomène très ancien, mais profondément renouvelé, par « l’apparition de l’ordinateur et de l’immatériel » (René PASSET, 2003, p. 27). En effet, la mondialisation en cours s’est traduite par les mutations technologiques dans les domaines du transport et de la communication. L’avènement des technologies de l’information et de la communication a ouvert d’immenses possibilités aux hommes et aux femmes, à travers le monde, d’entrer en contact sans se rencontrer. Désormais, le monde devient un “village planétaire” grâce au foisonnement des communications, des informations, des événements culturels, des opérations monétaires et financières, mais aussi grâce à la télédiffusion et au multimédia.
Pour Michel Beaud, la mondialisation n’est pas un phénomène neutre. « Derrière les mutations technologiques, comme les promesses et les mirages, il y a des motivations et des logiques sociales. Derrière les satellites, les nouveaux câblages planétaires (autoroutes de l’information), l’explosion du culturel, les gentils organisateurs d’internet, il y a d’énormes enjeux » (p. 111). Ces enjeux sont l’extension des relations commerciales et la quête du profit maximum, la recherche de nouveaux marchés et de nouvelles marchandises. En un mot, il s’agit de la domination du monde par l’idéologie capitaliste. Dès lors, c’est à partir d’une analyse des dynamiques capitalistes qu’il faut partir pour comprendre la mondialisation en cours. C’est à juste titre que Beaud soutient que la prise en compte du capitalisme « est indispensable pour comprendre évolution, problèmes et enjeux de la terre et des sociétés » (1999, p.259).
Le capitalisme joue un rôle important dans les mutations en cours dans la société contemporaine. Notre société de production d’énormes savoirs, de l’information et des technologies est une société capitaliste mondialisée. Les informations, les savoirs et les technologies, plutôt que de favoriser le dépérissement du capitalisme, font accroître ses dynamismes et élargissent son champ de production. Car le capitalisme mondialisé est éperdument consommateur de technologies. Comme le souligne Beaud, aujourd’hui, les grandes firmes capitalistes mobilisent la science et la technique pour la recherche du profit, l’innovation, l’accumulation des richesses et la création de nouvelles marchandises. L’économiste français qualifie le capitalisme mondialisé de « capitalisme technologique » pour mettre en exergue le privilège que les firmes accordent à la technoscience pour la production des marchandises. La technoscience n’est plus « la technoscience considérée comme force exerçant d’une manière autonome ses effets dans les transformations économiques et sociales et l’évolution de la civilisation (…) ; mais une technoscience de plus en plus systématiquement mobilisée par les grandes firmes » (, p. 265).
Il n’est point aisé aujourd’hui de parler d’une autonomie de la technoscience. La science et la technique sont soumises à l’économie. Elles sont contrôlées par les très grandes firmes capitalistes capables de financer les recherches, les équipements et la formation des hommes. Ainsi, du matériel médical aux services informatiques en passant par le secteur des ordinateurs, de l’alimentation et celui du textile, un petit nombre de firmes capables de gros investissements contrôle les marchés. Ces firmes capitalistes ont la possibilité de mobiliser la technoscience, de la maîtriser et de l’orienter dans la conception et la production des biens et services qu’elles désirent, mais aussi de façonner nos vies et la structure de nos sociétés. « Ces firmes, écrit Beaud, ne pèsent pas seulement sur les productions et les marchés : elles orientent les recherches, conçoivent les produits, structurent les systèmes, suscitent les demandes, et finalement prédéterminent les modes de vie et les formes des sociétés à venir » (1999, p. 268).
Fondées sur la mobilisation des sciences et des techniques, avec la mainmise sur les institutions internationales et soutenues par les États nantis, les grandes firmes transcontinentales se déploient partout dans le monde, s’implantent en tout lieu, s’approprient la terre et le vivant et monopolisent le capital financier. Produisant de nouvelles marchandises et suscitant de nouveaux besoins, elles créent de nouvelles nécessités, de nouveaux manques auxquels les individus et les sociétés se trouvent astreints. Elles soumettent la société et les individus à leur propre logique. Désormais, c’est à partir de la logique capitaliste qu’il faut tâcher de comprendre notre monde, son évolution et la place des individus dans la société. L’avenir de la planète, les aspirations des hommes, leurs besoins sont déterminés par les firmes transnationales capitalistes.
Comme nous le constatons, la mondialisation n’est rien d’autre que la colonisation du monde par l’idéologie capitaliste. Elle signifie l’invasion du monde par les firmes occidentales. Il s’agit, selon Jacques Luzi, de « l’intronisation d’un seul capitalisme transcendant les nations » (1996, p. 10), à savoir le capitalisme occidental. En effet, pendant des années, plusieurs capitalismes se sont partagé le monde. Le capitalisme italien, hollandais, français, britannique ou américain; le capitalisme européen, asiatique ou anglo-saxon ; ou encore le capitalisme agricole, manufacturier, commercial, industriel ou financier. Toute cette variante montre que le capitalisme renvoie à une réalité nationale, régionale ou sectorielle, c’est-à-dire concernant un secteur d’activité humaine. Mais aujourd’hui, toute cette réalité à la fois multiple et multiforme a laissé la place à l’action d’un petit nombre de firmes occidentales. Beaud décrit le processus :
L’essentiel de ce que l’on nomme mondialisation recouvre de multiples manifestations de l’expansion à l’échelle du monde des capitalismes nationaux les plus puissants – expansion qui s’opère à travers trois grands types de processus qui ont fait l’objet de nombreuses analyses : l’internationalisation (des échanges, du crédit, des paiement), la multinationalisation (d’entreprises, de banques, d’organismes financiers) et la globalisation (monétaire, financière, culturelle). (1999, p. 175).
La mondialisation renvoie, chez l’économiste français, à la propagation des grandes firmes occidentales de dimension globale. Il en donne les différentes phases. Pour lui, la mondialisation en cours a débuté par l’internationalisation à partir du XVIe siècle à la seconde guerre mondiale. Cette phase constitue la période d’expansion des capitalismes nationaux. Elle est marquée par les échanges, les crédits, les investissements internationaux.
Après cette étape vient celle de la multinationalisation. Elle a commencé après la seconde guerre mondiale et se caractérise par le développement de la multinationalisation des produits et des banques. Elle est dominée par l’activité des grandes firmes, des organismes financiers, des entreprises. Ces deux premières périodes marquent l’interdépendance des entreprises de plusieurs nations, soit par les échanges, soit par la concurrence, soit par les associations.
La globalisation constitue la troisième dimension de la mondialisation. Elle est principalement monétaire et financière. Elle a connu son essor lorsque la sphère financière s’est détournée du système monétaire international fondé sur des changes fixes, pour adopter les nouvelles mesures de déréglementations, la multiplication des opérations de change et des activités financières et boursières, mais aussi et surtout avec l’intensification des nouvelles technologies de télécommunication et de traitement de données (Jacques LUZI, 1996, p. 113). Il s’agit de favoriser la performance financière par les nouvelles technologies. Ces trois phases ne s’excluent pas, elles sont complémentaires et caractérisent la mondialisation actuelle.
À y voir de près, la mondialisation n’est qu’un phénomène économique. Jean Ziegler en fait l’historique. Pour lui, la notion de mondialisation est un néologisme ancien dans la langue française. Jusqu’en 1992, elle était perceptible dans les expressions comme “multinationales”, “transnationales”, “mondialisation des marchés”. Mais c’est au lendemain de la guerre du Golf, en 1991, où on annonce à Washington la naissance d’un “nouvel ordre mondial”, que la notion de mondialisation commence à s’employer sans complément de nom. Désormais, elle désigne l’organisation des affaires internationales. Tout comme Beaud, Ziegler assimile la mondialisation à une réalité purement économique, une idéologie des puissances capitalistes, qui plutôt que d’unifier le monde l’a disloqué. « La mondialisation n’a pas mondialisé le monde, elle l’a fractionné » (Jean ZIEGLER, 2002, p. 77), nous dit-il. Elle accentue les inégalités entre les peuples et consacre la marchandisation de la nature.
Aujourd’hui, plusieurs pays mettent en place des stratégies pour limiter la migration des pays pauvres vers les pays riches. De plus en plus les frontières se renforcent, des barrières se dressent. À l’intérieur des frontières, la situation des migrants n’est pas du tout reluisante. Ils sont victimes de racket, de vols et même de prostitution forcée, de surtravail, intégration dans des réseaux délinquants et criminel. D’un autre côté, les trafics de femmes et d’enfants remettent en cause la question du respect des droits de l’homme. « Les estimations les plus fréquents (ONU) parlent de quatre millions de femmes et de jeunes filles achetées ou échangées dans le monde chaque année » (Stéphane de TAPIA, 2003, p. 26). Tout cela montre que la mondialisation est porteuse d’énormes contradictions qui se manifestent également dans ses rapports à l’environnement naturel.
II/ Mondialisation ou omnimarchandisation de la nature
La mondialisation entraîne la marchandisation de la nature. En quête de profit toujours croissant, elle réduit tout à la marchandise. Jacques Luzi fait la remarque suivante :
Au XIXe siècle, les capitalismes industriels, en transformant la terre, le travail et la monnaie en marchandise, ont condamné le monde à l’omnimarchandisation. Au XXIe siècle, le capitalisme généralisé et mondialisé consacrera cette omnimarchandisation en globalisant les marchés de la terre, du travail et de la monnaie. (1996, p. 11)
L’économie capitaliste ne connaît que le langage de la rentabilité, de la marchandise et de l’argent. Renfermée dans la logique du gain et du profit, elle soumet tout à la rationalité calculatrice. Devenue une réalité mondiale, elle étend les lois du marché à tous les domaines de la vie, soumettant ainsi la terre et le vivant à la logique concurrentielle d’un marché autorégulateur.
Placée sous le signe du libéralisme, la mondialisation entraîne la diversification des concurrences, la revendication de nouvelles mesures de déréglementation, la suppression des limites imposées par la réglementation dans chaque pays. Ce qui affaiblit les mesures de protection des écosystèmes. En conséquence, l’eau, l’air et la terre sont devenus des valeurs vénales. Les caractères de cette généralisation de la marchandise sont omniprésents et si connus que l’énumération semble superflue. On assiste de nos jours à la marchandisation de l’homme, qui se traduit par le commerce du sang et des organes. Il existe également la marchandisation des fonctions sociales et des activités humaines supérieures à travers les domaines de l’éducation, les loisirs et l’information, les recherches scientifiques, les œuvres intellectuelles et artistiques.
En plus, les activités de protection de l’environnement sont devenues des activités lucratives. On parle aujourd’hui des marchés du carbone, pour dire que la résolution des crises écologiques passe par le marché. C’est à bon droit que Beaud fait remarquer que « dans le mouvement de généralisation des marchés et d’extension du capitalisme à tous les domaines, la dégradation de l’environnement (…) est devenue une occasion d’affaire » (Michel BEAUD, 1999, p. 160). En effet, la réparation des catastrophes écologiques constitue maintenant un marché rentable pour des firmes. Du traitement de l’eau au recyclage et à la valorisation des déchets en passant par la dépollution des sols et celui des anciens sites industriels, plus rien n’échappe aux appétits marchands. Dans la mesure où la réparation des dégradations de l’environnement est devenue une activité rémunératrice, il va sans dire que désormais, les intérêts des firmes polluantes et ceux des firmes dépolluantes coïncident, ce qui ne peut laisser assez de chance à la protection de l’environnement.
Enfin, l’économie mondialisée crée de nouveaux besoins qui ne cessent de s’intensifier et de se diversifier. Ces besoins nous conduisent vers une nouvelle forme de dépendance : « La dépendance de nouveaux matériels, de nouveaux logiciels, de nouveaux besoins d’information, de nouvelles attentes, de nouveaux espoirs, qui nous enserrent dans des rets innombrables : nouvelles dépendances, nouvelles aliénations » (Michel BEAUD, 1999, p. 175). L’économie capitaliste mondialisée crée de nouveaux besoins dont la satisfaction augmente la demande de nouveaux biens, de nouvelles richesses. Ce qui conduit à l’exploitation de toutes les ressources et les propriétés de la nature, à l’appropriation privée des biens environnementaux et des écosystèmes, mais aussi à la production de nouvelles technologies sur le marché. En d’autres termes, les nouvelles dépendances créent de nouveaux risques, de nouveaux dangers et de nouveaux dommages pour l’environnement.
Comme on le constate, la mondialisation, avec sa logique marchande et concurrentielle, menace de faire voler la nature physique en éclats. Tout cela constitue un véritable danger pour le monde et suscite des inquiétudes. Jacques Luzi prévient : « Né du compromis et de la compromission, le capitalisme mondialisé ne peut être réformé. Si nul ne le détruit, il le fera lui-même en détruisant le monde » (1996, p. 12).
Devons-nous assister passivement à la destruction de notre monde avec toutes les richesses qui le composent ? Ce serait faire preuve d’imprévoyance et d’irresponsabilité. Dans la mesure où la destruction de la nature se profile à l’horizon, s’armer pour l’éviter est un devoir éthique et moral. Comme le pense Hans Jonas, nous devons aujourd’hui protéger la nature contre nous-mêmes, car nous sommes devenus un danger pour celle-ci. Nous devons la protéger parce qu’elle a en elle une valeur propre qu’il importe de préserver. Dans cette logique, il écrit en substance la chose suivante : « Dans une optique véritablement humaine la nature conserve sa dignité propre qui s’oppose à l’arbitraire de notre pouvoir » (Hans JONAS, 1993, p. 188).
Pour le philosophe allemand, la nature renferme des valeurs qui ne relèvent pas de la subjectivité humaine. Il existe des valeurs objectives qui sont attachées à la nature et qui ne sauraient faire l’objet d’une évaluation économique et monétaire. C’est d’ailleurs pourquoi l’économie capitaliste, qui ramène toute valeur à la valeur économique et marchande, échoue à préserver la nature. Renfermant tout dans la logique du marché, du profit et de l’accumulation, elle détruit la terre et les sociétés qui la composent. Comment sortir de ce total désarroi ? Pour venir à bout de la situation actuelle, il faut renoncer à la logique du profit qui caractérise le capitalisme mondialisé. Il faut militer pour une économie de besoins. L’importance de cette économie de besoins dans un contexte de crise écologique trouve tout son sens dans la philosophie de Hans Jonas qui écrit à ce sujet ce qui suit : « en soi le critère de besoins offre une meilleure présupposition de rationalité (…) que le critère du profit » (1993, p. 199). Pour Jonas, la logique du profit est facteur de gaspillage des ressources naturelles, elle est incapable de préserver la nature. C’est pourquoi, le philosophe allemand milite pour une économie de besoin au détriment de l’économie de profit.
III/ Pour une écocitoyenneté : sortir de la logique du profit
La mondialisation en cours a déjà fait trop de mal à la terre et à l’humanité. Pour Ziegler, « la réalité du monde mondialisé consiste en une succession d’îlots de prospérité et de richesse, flottant dans un océan de peuple à l’agonie » (Jean ZIEGLER, 2002, p. 38). C’est dire que la réalité de notre monde devenu “un village planétaire”, la réalité de notre société d’opulence ne correspond pas à un véritable développement économique mondial, mais plutôt, le développement des centres d’affaires où les grandes firmes et les banques, les assurances et les marchés financiers, les services marketing et de commerce foisonnent. Pendant ce temps, autour des centres économiques, un nombre sans cesse croissant de la population demeure dans la misère ; sur la surface du globe les déserts avancent, le niveau des océans augmente, le changement climatique devient une réalité affectant un nombre infini d’individus.
La mondialisation, ou mieux, « le capital financier globalisé » (Jean ZIEGLER, 2002, p. 28) génère d’énormes angoisses. Plutôt que de favoriser la fraternité, la complémentarité entre les hommes, la liberté et la justice sociale, elle accentue les disparités entre les individus, les classes sociales, les pays et les continents. La consolidation des liens universels entre les hommes, le bien public sont devenus des notions creuses. Le renforcement de la solidarité, la pacification du monde demeurent des illusions. Au contraire, on assiste à une concurrence outrancière entre les êtres humains, débouchant sur l’épuisement sans cesse croissant des ressources naturelles. L’air est pollué, l’eau se raréfie, les forêts sont dévastées, les sols sont érodés, le nombre des réfugiés écologiques ne cesse de s’amplifier, l’avenir de l’humanité est hypothéqué.
Tout cela doit inciter à une conception nouvelle de notre monde et de sa structure économique. Il ne s’agit pas forcement d’inventer de nouveaux modes de vie ou de conduite. Il peut s’agir de redécouvrir, de réinventer des anciennes manières de vivre susceptibles de préserver l’environnement. C’est dans ce sens que nous trouvons l’intérêt de l’économie de besoins. Mais que renferme la notion de besoin et qu’est-ce qui caractérise cette économie de besoins ?
Dans L’homme unidimensionnel, Herbert Marcuse écrit: « Au niveau atteint par la civilisation, les seuls besoins qui doivent être satisfaits absolument sont les besoins vitaux, la nourriture, le logement, l’habillement. Satisfaire ces besoins est la première condition pour réaliser tous les besoins, qu’ils soient sublimés ou non » (Herbert MARCUSE, 1968, p. 31). Si Marcuse soulève la problématique des besoins, c’est justement parce qu’il est témoin des travers d’une société globalisante et totalitaire qui impose aux individus de “faux besoins”. La société industrielle avancée que le philosophe germano-américain dépeint dans son livre assimile les hommes aux objets, au point où les gens se reconnaissent dans leurs marchandises, ils trouvent leur âme dans leur automobile, leur chaîne de télévision de haute-fidélité, leur maison, leur équipement de cuisine.
La société industrielle avancée, bien assimilable à notre société globalisée, crée sans cesse des besoins qui maintiennent l’individu dans la minorité de l’existence, de ténèbres, de l’emprise des forces aliénantes et dominantes. Par les innombrables besoins qu’elle suscite et impose aux hommes, la société globalisée entraîne la corruption de nos âmes, la perte de la dignité humaine, la violence à l’égard de l’homme et de la nature, les inégalités sociales, sources de misère les plus insupportables. C’est pourquoi Marcuse pense qu’il faut recourir à la satisfaction des vrais besoins, des besoins vitaux afin de libérer l’homme. Mais les besoins vitaux ne sauraient se réduire à la simple satisfaction matérielle. Voilà pourquoi, il y inclut les besoins intellectuels. Pour lui, les vrais besoins sont les besoins historiques, les besoins qui ne sont pas déterminés par les forces extérieures, ni imposés par la publicité.
Tout comme Marcuse, Hugues Puel accorde un intérêt particulier à la question des besoins. Pour l’économiste français, le concept de besoin paraît essentiel parce qu’il se rattache à la nature de l’homme. Toutefois, étant donné une pluralité de besoins, comment distinguer les vrais besoins de ceux qui ne le sont pas ? Pour répondre à cette question, l’économiste français va envisager une typologie des besoins qui consiste en une classification entre besoins primaires, secondaires et tertiaires.
Les besoins primaires sont appelés les besoins essentiels. Leur absence entraîne la mort ou l’atrophie de l’individu. Il s’agit de la nourriture, les vêtements, l’habitat, mais aussi le réconfort moral, la possibilité de faire des enfants et de les éduquer, la paix et la confiance entre les hommes. Pour Puel, la satisfaction des besoins primaires est facteur d’harmonie sociale. Les besoins secondaires sont ceux dont on peut se passer. Ils facilitent cependant la vie parce qu’ils sont utiles. Les biens qui concourent à la satisfaction de ces besoins sont ceux qui permettent à une société de devenir prospère. Enfin quant aux besoins tertiaires, ils renferment les biens qui ne sont pas essentiels, mais qui sont utiles et agréables. Ils procurent à l’homme certains charmes de la vie. Il s’agit par exemple des œuvres d’art, de la beauté d’un cadre de vie. En un mot, les besoins tertiaires renferment les biens dont la création donne lieu à une société civilisée.
Puel pense que derrière cette typologie des besoins, se profile une conception de l’homme comme un être ouvert au progrès, à l’accomplissement, au dépassement. Il ajoute que dans la production des biens ce qui doit être premier, c’est la production des biens primaires. La production des biens secondaires et tertiaires doit être limitée quand celle des biens primaires n’est pas suffisante pour tous. Car, pense-t-il, c’est en cela qu’il peut avoir une économie humaine, une croissance économique qui va de pair avec le développement de tous les hommes (Hugues PUEL, 1989, pp. 83-93).
Au regard de ce qui précède, on peut définir l’économie de besoins comme une économie qui vise « le développement de tout l’homme et de tous les hommes » (François PERROUX, 1981, p. 32). L’économie de besoins ne cherche pas la satisfaction des besoins solvables, laissant les innombrables besoins non solvables. Elle ne se met pas du côté de ceux qui disposent d’un pouvoir d’achat. Cette économie que Serge Latouche appelle “l’économie de l’autre Afrique”, cette économie appelée encore l’économie populaire ou l’économie sociale est faite de dons, d’entraides, de mutuelles et de coopératives. Elle s’enracine dans le champ des relations sociales. Elle ne se nourrit pas de profit et d’accumulation de la richesse. Elle ne crée pas de disparités entre les hommes. Elle ne vit pas de surtravail et de bas salaires. Elle se déploie dans l’intérêt de tous.
Il s’agit de cette économie dans laquelle l’exploitation de la nature ne se mue pas en une surexploitation ; mais où les hommes se montrent économes en gérant parcimonieusement les ressources de la terre. Cette économie peut favoriser la protection de l’environnement dans la mesure où elle est avant tout endogène. Faite de coopératives, de mutuelles, des associations, celles-ci peuvent définir des règles communautaires susceptibles de préserver l’environnement.
Aussi, récusant la logique du profit maximum et ayant pour souci la satisfaction des besoins humains, qui renferment les besoins écologiques, l’économie sociale peut encourager les comportements respectueux de l’environnement, mais aussi développer les activités moins consommatrices des ressources naturelles non renouvelables. Déjà, l’économie sociale a commencé une transformation écologique de l’économie :
Mentionnons par exemple qu’un certain nombre de coopératives ont fait naître des filières d’activités économiques d’avant-garde dans des secteurs comme la bioénergie, l’éolien, l’agroalimentaire biologique, le solaire… ; que des syndicats travaillent des projets de conversion écologique de leur entreprise ; que des communautés locales au Sud ont passé au solaire pour s’alimenter en électricité. (Louis FAVREAU, 2003, p. 68)
Cette idée montre qu’à travers les mouvements sociaux, la protection de l’environnement peut devenir une réalité. Cela répond d’ailleurs à une idée très chère à Hans Jonas, à savoir confier la protection de l’environnement aux pouvoirs publics. Dans Pour une éthique du future, Jonas écrit: « le savoir, le vouloir et la puissance sont collectifs, leur contrôle doit l’être également : seuls les pouvoirs publics peuvent l’exercer » (Hans JONAS, 1998, p. 105). Pour le philosophe allemand, les dangers qui pèsent sur l’environnement ne relèvent pas uniquement des comportements individuels, mais plutôt collectifs. Dans ces conditions, leur gestion relève plus de la collectivité. On peut donc penser dans cette même veine d’idée qu’un système ou un mode de vie individualiste ne saurait aujourd’hui favoriser la protection de l’environnement. À l’opposé, les collectivités, les mutuelles, les coopératives peuvent servir de modèle.
Eu égard à ce qui précède, on peut considérer l’économie populaire comme un paradigme écologique. Elle pose la protection de l’environnement comme son premier souci. Cela peut s’illustrer à travers des exemples multiples comme celui de la fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF). Celle-ci a développé de nouvelles activités, dont la production de la biomasse. La biomasse est une source d’énergie ne contenant pas de carbone, pouvant remplacer les énergies fossiles et dont l’utilisation réduit les émissions de gaz à effet de serre. L’invention de cette source d’énergie a favorisé la création de nombreux emplois ainsi que l’indépendance énergétique des communautés locales et la lutte contre la déforestation au Québec.
Les mutuelles de solidarité sénégalaises, dans la région de Thiès, ont développé l’électricité photovoltaïque dont bénéficie une multitude de paysans. Il s’agit là, pour Louis Favreau, d’une innovation majeure réalisée dans cette région du monde. Car, au Sénégal, seulement 16 pour cent de la population rurale ont accès à l’électricité. Dans ces conditions, le solaire apparaît comme une alternative aux énergies fossiles pour de nombreux pays du monde. Si on y ajoute la production de l’énergie éolienne en Belgique, la construction au Brésil de logements sociaux, « Ma maison, ma vie », équipés de chauffe-eau solaire pour répondre au besoin d’énergie des pauvres, le programme de modernisation des bâtiments en Allemagne pour faire face à la crise économique dans le secteur des bâtiments, on ne peut constater que la liste des efforts fournis par l’économie sociale pour la sauvegarde de l’environnement est longue.
Comme nous le constatons, l’économie populaire crée des activités non polluantes, mais aussi génératrices d’emplois verts. C’est pourquoi, elle paraît efficiente en matière de protection de l’environnement. Face aux dynamismes d’une économie capitaliste qui génère misère et angoisse, nous avons beaucoup à apprendre des leçons de cette économie. En tant qu’économie de besoins, elle est susceptible de répondre à nos besoins de préservation de l’environnement.
Conclusion
Au terme de cette analyse, il ressort que la mondialisation, plutôt que de favoriser un monde vraiment fraternel, a plongé les relations humaines dans les « eaux glacées du calcul égoïste » (Karl MARX, 1962, p. 22). Elle accentue les disparités entre les hommes et génère la misère et l’angoisse. Réduisant tout à la rationalité calculatrice et au rapport d’argent, elle a consacré le monde à l’omnimarchandisation. Tout cela montre que la sauvegarde de l’environnement se révèle comme un mythe dans notre société entièrement globalisée. Dans un monde fractionné et disloqué, la protection de l’environnement est mise à rude épreuve puisque les forces qui pèsent aujourd’hui sur la nature sont non seulement multiples et multiformes, mais aussi individuelles et collectives. C’est surtout une responsabilité aussi bien individuelle que collective qui peut servir de parade à la crise écologique actuelle. Or, le capitalisme mondialisé est renfermé dans l’accumulation individuelle pour le profit et le profit individuel pour l’accumulation. Il se révèle impuissant pour venir à bout de la situation de crise qui est la nôtre aujourd’hui.
Dès lors, la nécessité d’une alternative s’impose. Il nous faut aujourd’hui une économie de “tous les hommes”, c’est-à-dire une économie qui n’établit pas une ligne de démarcation entre les nantis et les démunis ; mais où tout le monde peut avoir sa place. Cette économie doit être aussi une économie de “tout l’homme”, c’est-à-dire une économie qui répond aux besoins solvables, mais aussi à ceux qui ne sont pas solvables. Elle cherche à satisfaire tous les besoins de l’homme en vue de son épanouissement. Il s’agit de cette économie qui sait que, l’homme, en dehors de ses intérêts économiques, est un être social. Il entretient des rapports qui sont imprégnés de sentiments et de valeurs non quantifiables en termes économiques, à savoir les sentiments d’amitié et de solidarité, mais aussi des valeurs éthiques et morales.
Fort de ce constat, il importe aujourd’hui de développer une économie qui se situe dans le champ du social. Une économie faite d’entraide, de don, de mutuelles, d’associations. Cette économie peut favoriser un monde encore plus fraternel, mais aussi en phase avec l’écologie, dans la mesure où elle se souci du besoin économique, social et écologique des hommes. Cette économie de besoins peut servir de paradigme écologique en ces temps de globalisation économique et de dégradation écologique. Toutefois, nous devons constamment veiller à l’enracinement éthique de cette économie.
BIBLIOGRAPHIE
Carol MCAUSLAND, «Mondialisation : Effets directs et indirects sur l’environnement », in OCDE, Mondialisation, transport et environnement, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/97892640729306fr,2011, consulté le 04 novembre 2015, à 22h 36, pp.35-61.
François PERROUX, Pour une philosophie du nouveau développement, Paris, Aubier/ Les Presses de l’Unesco, 1981, 279p.
Hans JONAS, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, traduit de l’allemand par Jean Greisch, Paris, Cerf, 1993, 338p.
Hans JONAS, pour une éthique du futur, traduit de l’allemand par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Paris, Payot & Rivages, 1998, 120p.
Herbert MARCUSE, L’homme unidimensionnel, traduit de l’anglais par Monique Wittig et l’auteur, paris, Les Éditions de Minuit, 1968, 288p.
Hugues PUEL, L’économie au défi de l’éthique, Paris, Cujas/ Cerf, 1989, 154p.
Jacques LUZI, « Mondialisation de la misère », in AGON, n°16, 1996, pp.9-12.
Jean ZIEGLER, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Paris, Fayard, 2002, 367p.
Karl MARX et Friedrich ENGELS, Le manifeste du parti communiste, Paris, Union Générale d’Éditions, 1962, 190p.
Louis FAVREAU, « L’urgence écologique, le principal défi de l’économie sociale et solidaire », in Thierry JEANTET (dir.), L’économie sociale et solidaire, une réponse aux enjeux internationaux, disponible sur http://www.economiasolidaria.org/files/Libro_FIDESS_EMB_2012.pdf
pp.65-79, consulté le 14 juin 2015 à 17h 35.
Louis FAVREAU, « L’économie sociale et solidaire : pôle éthique de la mondialisation ? », (Économie Éthique n°4, SHS-2003/WS/33), disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/ulis/index.html, consulté le 20 septembre 2014, 90p.
Michel BEAUD, Le basculement du monde. De la terre, des hommes et du capitalisme, version numérique, disponible sur http://classiques.uqac.ca/contemporains/beaud_michel/balculement_du_monde/beaud_basculement_monde_1.pdf, consulté le 20 septembre 2014, 246p.
Michel BEAUD, « Capitalisme, logiques sociales et dynamiques transformatrices », in Bernard CHAVANCE et al, Capitalisme et socialisme en perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, Paris, La Découverte, 1999, pp.249-274.
René PASSET, l’émergence contemporaine de l’interrogation éthique en économie, 2003, (Économie Éthique n°2, SHS-2003/WS/22) disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/ulis/index.html consulté le 20 septembre 2014, 42p.
ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
21. Protection de l’environnement en Afrique : vers une culture de l’écocitoyenneté,
SIALLOU Kouassi Hermann…………………………………………….………281
RÉSUMÉ :
Réagissant contre le système éducatif centré sur l’instruction, Nietzsche prône une pédagogie active qui concilie l’instruction et l’éducation. Ce nouveau paradigme pédagogique vise à former des élites à travers une éducation supérieure. La pédagogie créative peut s’appliquer au contexte du Licence- Master- Doctorat où la créativité et les talents importent tant pour sa formation que son auto-emploi.
Mots clés : Biophilosophie, compétence, créativité, employabilité, éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.
ABSTRACT :
Reacting against the educational system centered on instruction, Nietzsche advocated on active pedagogy that balances educations. This new educational paradigm aim at the making of elites through a superior education. The creative pedagogy can be used in the perspective of the Licence- Master-Doctorat system; where creativity and talents are required for one’s training and self-employment.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability, education, eliteness,pedagogy, superman.
INTRODUCTION
SIALLOU Kouassi Hermann / Doctorant
Université Alassane Ouattara
Bouaké – Côte d’Ivoire
Tel : +22508240599
Email : siallouhk@gmail.com
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE : VERS UNE CULTURE DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
Résumé
La crise écologique est une réalité incontestablement alarmante en Afrique. Elle prend une proportion de plus en plus critique qui met ce continent dans une situation d’urgence. À l’instar des autres continents, l’Afrique lutte pour la sauvegarde de son environnement. Cependant, l’accentuation de la déforestation, de la pollution, de la sécheresse, de la dégradation des ressources naturelles et la présence des déchets qui infestent nos villes achèvent de convaincre quant à la sempiternelle pathologie environnementale dont souffre une Afrique qui s’accommode difficilement des rudiments et avatars de la modernité. En dehors des facteurs politiques, sociaux, économiques, idéologiques, scientifiques et techniques qui exacerbent cette crise, la conscience écologique individuelle, faiblement constituée en Afrique, peut en être considérée comme l’une des causes fondamentales. La sauvegarde de l’environnement en appelle nécessairement à l’action collective et individuelle des citoyens africains et invite, pour ce faire, à une réforme des mentalités qui milite en faveur d’un comportement écocitoyen.
Mots-clés : développement durable, écocitoyenneté, environnement, identité, justice environnementale, responsabilité, solidarité.
Abstract
The ecological crisis is an undeniably alarming reality in Africa. It is taking an increasingly critical proportion, which puts this continent in an emergency situation. Like other continents, Africa is struggling to safeguard its environment. However, the increase in deforestation, pollution, drought, degradation of natural resources and the presence of the waste that infest our cities is proving to convince us of the perennial environmental pathology of an Africa that finds it difficult to accommodate rudiments and avatars of modernity. Apart from the political, social, economic, ideological, scientific and technical factors that exacerbate this crisis, individual ecological consciousness, weakly constituted in Africa, can be considered as one of the fundamental causes. Safeguarding the environment necessarily calls for the collective and individual action of African citizens and calls, in order to do so, for a reform of mentalities which militates in favor of eco-citizen behavior.
Keywords: sustainable development, eco-citizenship, environment, identity, environmental justice, responsibility, solidarity.
INTRODUCTION
La crise écologique est aujourd’hui un fait irrécusable. Elle est globale et nous menace de ses dommages irréversibles. Cette affirmation que nous empruntons à Jean-Marie Pelt en donne la pleine mesure :
La menace écologique qui déjà se dessinait à l’époque a pris, avec la réalité aisément perceptible par tous du réchauffement climatique, une place inquiétante parmi nos préoccupations. Redoutée pour les générations futures, elle s’est brusquement rapprochée et menace directement nos propres enfants, si ce n’est nous-mêmes. Elle nous atteint avec le cortège d’inquiétudes qu’elle suscite : grave perturbation du climat, aux effets imprévisibles ; érosion accélérée de la biodiversité ; déforestation, déboisement, aridification et désertification des sols ; aggravation des pollutions de l’air et de l’eau (2008, pp. 11-12).
La maison dans laquelle nous habitons brûle[71] effectivement, pour reprendre les mots de l’ex-président français, Jacques Chirac. D’importantes rencontres internationales (la conférence de Stockholm, le rapport Brundtland du CMED[72], la conférence de Rio de Janeiro, le Sommet de Copenhague et celui de Bonn, la convention sur la diversité biologique, la COP 21 à Paris et la COP 22 à Marrakech) sont la reconnaissance avérée et la confirmation de la globalité, de l’ampleur et de la complexité de cette crise. Face à cette réalité qui prend des proportions de plus en plus critiques, la responsabilité de l’homme, en vue de la protection de l’environnement, ne peut être éludée ; elle est un impératif majeur qui nécessite, de la part des humains, une prise de conscience et une mise en œuvre de mesures urgentes et efficaces. À l’instar des autres continents, l’Afrique s’engage dans une lutte acharnée pour sauvegarder l’environnement mondial. En effet, de remarquables efforts sont à saluer en matière de protection de l’environnement en Afrique. Cependant, en dépit de ces efforts, les problèmes environnementaux perdurent et même s’accentuent. Et, dans l’avenir, la crise écologique pourrait faire basculer de nombreux Africains dans une extrême pauvreté.
Les motivations du présent article se fondent d’abord sur le constat d’échec des stratégies et des politiques de protection de l’environnement en Afrique perpétuant, de fait, la crise écologique sur le continent. Aussi, le choix de cette réflexion tient au fait que la sauvegarde de l’environnement naturel répond à un souci de préservation de la vie dans sa totalité. Car, la nature, en tant que biodiversité de l’environnement ou baromètre de l’existence, est le cadre du monde sensible, reflet du monde métaphysique selon la conception platonique. En gros, il faut comprendre tout simplement que la menace contre la nature est un péril, non seulement contre la vie physiologique, mais aussi contre l’humanité métaphysique qui constitue le fondement intrinsèque de l’être humain. On peut simplement en comprendre que c’est la nature, cadre du monde sensible qui oxygène l’existence physiologique. Pour s’adonner aisément à la réflexion et à la pensée, il faut être dans un corps saint. La nature, en tant que creuset de la vie est ce qui soutient toute vie communautaire, la cohésion sociale et le bien-être des individus. S’il n’y a pas de nature, la question même de la vie et, par-delà, du vivre-ensemble, perd son sens. Cette idée est aussi perceptible dans cette affirmation de Lucie Sauvé : « l’environnement est le creuset où se forgent notre identité, nos relations d’altérité, notre être-au-monde» (Lucie SAUVE, 2002). Il apparait de plus en plus impérieux de placer au centre des activités humaines le sort du naturel sans lequel les artifices de culture et de vie sociale, en général ne seraient que pure chimère ou grossière élucubration.
Nous ambitionnons, à travers cet article, contribuer au tissage d’un faisceau de solutions multiples proposées par la kyrielle d’analystes sur la question. Car, le continent africain, foncièrement espace du bruit, n’a que son environnement comme gage de survie certaine. Plus spécifiquement, il s’agit d’amener les consciences individuelles, en particulier celles des Africains à s’approprier les valeurs et modes de vie respectueux de l’environnement en vue d’une vie sociale plus équitable et plus épanouie.
La dégradation de l’environnement sur le continent africain s’accélère à un rythme sans précédent, tendant à rendre fallacieux les efforts entrepris pour sa résorption. Les paramètres socioéconomiques, politiques et sociologiques en devraient être examinés. Les difficultés liées à la gestion de l’environnement sur le continent africain inspireraient les questions suivantes : quelles sont les causes de la dégradation de l’environnement en Afrique ? Quelles sont les causes de l’indifférence des populations africaines face aux problèmes environnementaux ? Comment les amener à s’approprier les valeurs et les modes de vie respectueux de l’environnement ? Et, comment initier une formule du vivre-ensemble autour de la culture de l’écocitoyenneté ?
Pour répondre à cette problématique, nous aborderons dans cet article trois points essentiels. D’abord, nous présenterons l’état désastreux de l’environnement sur le continent africain. En effet, la dégradation de l’environnement dans les pays africains perdure et s’accélère à un rythme sans précédent, montrant que les efforts entrepris sont vains. Ensuite, nous aborderons les raisons qui justifient cette persistance du problème écologique sur le continent et la complexité de la gestion efficace de l’environnement. Les raisons sont à la fois socioéconomiques et politiques. Aussi, les questions relatives à la protection de l’environnement semblent ne pas être prioritaires pour les populations africaines qui ignorent que leur propre épanouissement dépend en partie de celle de la nature. Cette réalité nous amène, dans la troisième partie, à proposer l’écocitoyenneté comme une alternative pour une protection durable de l’environnement. Il s’agit de faire de l’écocitoyenneté une culture fondamentale reconnaissant l’appartenance de l’homme à l’environnement naturel.
I- Crise écologique en Afrique : état des lieux
Le problème de l’environnement est l’un des défis majeurs en ce début du XXIe siècle. Les équilibres écosystémiques connaissent une déstabilisation avancée, et ce, sans limite géographique. Le réchauffement climatique, la déforestation, la régression de la biodiversité, l’amenuisement des ressources en eau, la dégradation des sols, les pollutions atmosphériques et aquatiques, les sécheresses, etc. sont autant d’indices qui attestent la manifestation visible de la crise écologique. Le constat de cette nature en crise conduit Anne Dalsuet à l’affirmation suivante: « l’éventualité d’un bouleversement global du climat devient réalité(…). Nul doute que la nature est en crise » (2010, p. 7). Les conséquences de ces bouleversements sont profondes. Autrement dit, ces problèmes ont un impact significatif : non seulement, ils affectent la santé humaine, mais, ils handicapent également le développement économique et social. Si l’humanité ne s’engage pas résolument dans la recherche de solutions durables, la terre risque même d’être inhabitable à brève échéance. Pour l’heure, il n’est pas impossible d’améliorer la qualité de l’environnement et de donner la possibilité à tous les citoyens de la terre, en particulier aux africains, de bénéficier équitablement des mêmes chances d’une vie heureuse. Mais, pour y arriver, il faut, au niveau de chaque pays, continent et peuple, consentir des sacrifices, car la sauvegarde de l’environnement s’assimile, presque, à la survie de l’humanité.
En Afrique, l’on est conscient de l’ampleur du problème et des efforts sont entrepris pour préserver les données naturelles de base. Cependant, force est de constater que l’amélioration de la situation est peu perceptible. Au contraire, l’on constate que le problème demeure et tend même à s’accentuer. L’environnement urbain en Afrique renseigne sur l’ampleur de la dégradation de l’environnement. En effet, les déchets infestent la majeure partie des villes africaines. L’environnement naturel est menacé de perturbations irréversibles par l’action anthropique. La forêt, pourvoyeuse de services écologiques cruciaux pour la survie de sa population disparait à un rythme accéléré, causant ainsi une forte perte en biodiversité. Selon la FAO, « la superficie forestière estimable en Afrique est passée de 750 millions d’hectares en 1990 contre 675 millions d’hectares en 2010 » (FAO, 2001, p. 3), soit une perte de 75 millions d’hectares de forêt en l’espace de deux décennies. Le cas de la Côte d’Ivoire, par exemple, est très inquiétant. En effet, la forêt ivoirienne recule fortement à cause d’une exploitation outrancière. De 16 millions d’hectares au début du siècle, elle est à moins de 3.5 millions d’hectares aujourd’hui.
Pour l’essentiel, les facteurs de dégradation de l’environnement naturel sont directement liés au mode de vie et aux activités des pays africains. Le dynamisme de l’agriculture et la quête d’espace vital, y sont pour quelque chose dans ce phénomène de dégradation écologique. En effet, le souci du minimum vital crée une sorte de « quête de survie contre la vie ». On peut y associer le facteur économique pour lequel l’exploitation du bois constitue une activité principale, mais qui ne bénéficie pas de mesures d’accompagnement appropriées.
La croissance démographique, la pauvreté, les conflits armés, le libéralisme économique et l’absence de suivi dans le processus de gestion environnementale, le plus souvent, pour des questions d’intérêts, sont à l’origine du délitement de l’environnement en Afrique. Ces réalités suggèrent que la politique de gestion de l’environnement est fondamentalement handicapée.
II- Handicaps à la politique de gestion environnementale en Afrique
La protection de l’environnement en Afrique est confrontée à de multiples difficultés qui favorisent la persistance de la menace contre l’environnement. « Les États africains sont conscients de la menace qui plane sur leur continent. Mais, la mise en place de mesures coordonnées par les États africains en matière de protection de l’environnement naturel se trouve parfois confrontée à des problèmes d’instabilité politique due à une mauvaise maîtrise des principes démocratiques » (Grégoire TRAORE, 2014). Les prises de décision sont aussi difficiles que leur exécution pour plusieurs raisons. Cependant, des actions sont entreprises en faveur de la sauvegarde de l’environnement, quoiqu’elles ne donnent pas les résultats escomptés, la situation ne s’améliore pas de façon notable. Les blocages sont liés, d’une part à certaines exigences politiques et socioéconomiques et, d’autre part, à des pesanteurs psychologiques et à l’absence d’une conscience écologique solide.
1- Causes socio-politiques et économiques
Des politiques de gestion de l’environnement existent en Afrique afin de faire face à la menace mondiale dont les effets sont multiples et perceptibles à toutes les échelles de la vie. Toutefois, ces politiques sont bien souvent inefficaces. La persistance et l’accentuation de cette crise sur le continent laisse penser que les politiques de gestion environnementale ne sont pas en phase avec les réalités socioéconomiques du présent. La pression démographique, la pauvreté, l’accélération vertigineuse de l’urbanisation et la mauvaise gestion sont autant de facteurs interdépendants qui jouent en défaveur de la sauvegarde de l’environnement. La baisse du niveau de vie, qui impose une lutte acharnée de survie, développe chez les populations africaines un type de comportement qui favorise la dégradation de leur milieu de vie. Par exemple, l’on constate qu’en milieu urbain, les communes les plus pauvres sont beaucoup plus insalubres, car les préoccupations des populations de ces communes sont autres que l’entretien de leur cadre de vie. La municipalité, en raison de ses maigres ressources, ne dispose pas de moyens matériels nécessaires à l’entretien de l’environnement de ces localités. À l’opposé, dans certaines communes où les populations sont plus fortunées l’on s’offre les services de particuliers ou d’entreprises pour l’assainissement.
La persistance des problèmes environnementaux est la conséquence de deux facteurs concomitants. Il y a, d’une part le manque d’implication des populations africaines dans les projets et programmes liés à l’exigence de protection de l’environnement et, d’autre part, la faiblesse et l’irresponsabilité des politiques étatiques qui n’accordent pas de priorité à la gestion de l’environnement. La mauvaise gouvernance qui se manifeste dans la quête de satisfaction des intérêts personnels, la corruption, l’absence de suivi des projets et des programmes élaborés, le libéralisme économique, les conflits armés, favorisent l’exploitation abusive des ressources naturelles et constituent de véritables freins aux efforts de sauvegarde de l’environnement. Cet ensemble de facteurs repose sur une réalité négative fondamentale : la faiblesse de la conscience écologique.
2- Cause psychologique : faible conscience écologique
L’impassibilité de l’africain face aux problèmes écologiques est liée à son ignorance des implications économique, sociale, sanitaire et même existentielle de ces problèmes. Autrement dit, la crise écologique est réelle ; mais, l’homme africain en a une faible conscience en raison du défaut d’information et de formation sur les questions cruciales qu’elle dévoile. C’est ce que semble dire Grégoire Traoré dans ce qui suit :
dans le cadre africain, le manque de maîtrise du jeu démocratique et d’impassibilité des populations face aux problèmes écologiques accentue le péril déjà imminent auquel ce continent devra faire face (…) le caractère trouble du jeu démocratique africain fait qu’il est difficile d’établir des normes éthiques, politiques et juridiques susceptibles de conduire les hommes à des initiatives efficientes à même de préserver leur habitat naturel. (2014).
Pire, en Afrique, les populations pensent, à tort, que la gestion de l’environnement relève de la responsabilité de l’État. Elles ne se sentent pas concernées par la protection de l’environnement et, par conséquent, ne s’y impliquent pas. Face aux mesures prises en faveur de la sauvegarde de l’environnement, elles demeurent quelque peu réservées, rendant ainsi ces mesures non opératoires. Depuis les périodes ancestrales jusqu’aujourd’hui, l’entretien de la nature n’est pas une culture pour nos peuples. Ce que l’Afrique intègre dans l’environnement, c’est d’exploiter la nature pour vivre.
Certes le culte de l’environnement peut échapper à l’Africain, mais en réalité, il est incrusté dans son surconscient ; les forêts sacrées qu’on retrouve dans nos contrées rurales ne sont que des formes traditionnelles de forêts classées. Le totémisme aussi en participe. C’est donc à point nommé que les marxistes pensent que le mythe prospère sur un terrain que la science n’a pas encore conquis. C’est dire, qu’à la base d’un mythe se trouve une vérité scientifique, d’utilité vitale, non encore démontrée, en raison du niveau de développement encore bas.
Un État fort prend des mesures fortes qui sont respectées et suivies. La responsabilité et la garantie d’un développement durable incombent à l’État qui à travers les actions gouvernementales doit assurer un suivi transparent (…). En l’absence d’une implication forte de l’état, toutes les actions menées par les différents acteurs auront un impact peu perceptible. Toutefois, au-delà de ces mesures, c’est l’ensemble des actions individuelles et collectives qui peuvent assurer une durabilité à notre environnement (Moise MOUPOU, 2009, p. 11).
Certes, en tant que l’élite intellectuelle, l’État a sa part de responsabilité dans l’éducation des populations à la bonne gestion de l’environnement. Toutefois, il ne peut y avoir d’efficacité dans cette lutte pour la préservation de l’environnement que si les décisions étatiques trouvent un champ d’application. Si cela revient en premier lieu, à élaborer un programme fiable et équilibré entre les intérêts socioéconomiques et l’exigence de protection de l’environnement, il s’agit aussi et surtout de se donner une population à même de respecter les décisions et de les mettre en œuvre. La formation écocitoyenne est ici un impératif.
III- Exigence d’une culture écocitoyenne pour un développement durable
Le développement durable n’est plus une question de choix, mais plutôt une nécessité. La durabilité du développement nécessite, de la part des africains, une nouvelle vision et un changement de leur schéma de développement et de croissance qui nuit à l’intégrité sociale, économique et environnementale. Le concept de développement durable vient surtout du rejet du modèle de développement basé sur l’idéologie du « toujours plus » et la quête illimitée du lucre. Ce modèle de développement fondé uniquement sur la logique capitaliste, se souciant peu de l’avenir de l’humanité, a été l’erreur fatale de notre civilisation. Sauvage, destructeur et irresponsable, ce système mis en place a entrainé la surexploitation de l’environnement, et engendré d’énormes injustices et inégalités sociales. Avec l’espoir de corriger ce mode de civilisation, le rapport de Brundtland soutient que le développement durable « est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »[73]. La durabilité du développement consiste donc à concilier le développement social, le développement économique et une bonne gestion de l’environnement.
Pour que le développement de l’Afrique s’inscrive dans cette logique, il faut s’engager résolument, de façon individuelle et collective, dans la gestion de l’environnement. Autrement dit, le bien-être des populations africaines et de la tranquillité sociale passe absolument par une intégration de la dimension environnementale dans les politiques de gouvernance. Si l’Afrique veut se sauver du désastre écologique, elle doit impérativement envisager un modèle de développement qui certes, intègrerait la logique capitaliste mais qui la raisonne substantiellement, c’est-à-dire qu’elle doit construire un nouveau modèle de société qui place l’être humain et la nature au cœur des priorités. « En tout premier lieu, cette société pérenne se doit de nourrir sainement sa population, de préserver et régénérer le milieu naturel et de recréer du lien entre les humains et la nature, avec le souci qu’impose à notre conscience, de la manière la plus rigoureuse, le sort des générations futures » (Pierre RABHI, 2013, p. 164). Mais, cela exige au préalable une éducation fondée sur des valeurs qui appellent à des sentiments respectueux de l’environnement et de l’être humain. C’est en raison de cette réalité que notre article recommande, au-delà de toutes les mesures de protection de l’environnement, la culture à l’écocitoyenneté comme une nécessité fondamentale. L’avenir de l’Afrique repose sur l’éducation qu’elle aura donnée à la génération présente.
1– L’écocitoyenneté ou la priorité de l’intérêt commun
Le souci d’un avenir plus radieux exige la préservation de la nature. Pour qu’il y ait une cohésion sociale, il faut d’abord la vie, et pour qu’il y ait la vie, il faut nécessairement et naturellement des ressources pour son alimentation. De vieilles civilisations ont été victimes d’écocide faute d’une exploitation outrancière et démesurée de leur ressource naturelle. Par exemple,
Les Mayas, suite à une croissance démographique très importante, se répandirent en grand nombre sur les versants bordant les vallées qu’ils occupaient, déboisant massivement, ce qui aurait provoqué à la fois une importante érosion et un assèchement général du climat,(…). Selon beaucoup d’historiens, à partir du IXe siècle, (…) entre 90 et 99% de la population disparut » (Yves SCIAMA, 2008, p. 62).
Pour éviter de subir le sort qu’a connu cette civilisation, il est aujourd’hui important que les populations du monde prennent la pleine mesure du danger pour s’orienter vers des actions écocitoyennes concrètes. Autrement dit, il est avantageux pour les Africains de s’engager résolument sur la voie d’une protection efficace de leur cadre de vie. Cet engagement requiert à l’endroit des individus, la nécessité d’une reconnaissance de leur appartenance à la communauté biotique et exige, pour ce faire, d’adopter des comportements écocitoyens. Du point de vue définitionnel, l’écocitoyenneté est une expression littéralement formée de deux mots. Le préfixe éco renvoie à l’étymologie grecque oikos qui signifie habitat, maison, milieu de vie. La notion de citoyenneté quant à elle, renvoie à une reconnaissance identitaire d’appartenance à une entité où chaque personne a pour responsabilité, en tant que citoyen, d’œuvrer en faveur de l’intérêt général. Cette appréhension du mot met en évidence l’idée d’une responsabilité réciproque de chacun envers son prochain et envers la nature. Elle est définie par Martinez et Poydenot comme « une participation politique à la cité, ciment du lien social en démocratie, qui renvoie à la transcendance laïque d’un intérêt général et d’une chose publique à protéger ensemble » (2009, p. 62).
Ainsi, l’écocitoyenneté est un sentiment, sinon, une psychologie, celle selon laquelle notre existence dépend de la nature. De ce fait, elle amène le citoyen à poser des actes réfléchis qui intègrent le culte environnemental dans ses comportements de tous les jours. À la lumière de la crise écologique, l’écocitoyenneté se veut une reconnaissance intégrationniste de l’homme dans la nature. Cette reconnaissance de citoyenneté à un environnement implique, de la part du citoyen, des droits et des responsabilités envers l’environnement naturel et toutes les espèces vivantes qui s’y trouvent. C’est dans cette logique que, l’impératif catégorique revisité par Hans Jonas, « agis de telle façon que les effets de ton action soient compatibles avec la Permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre » (1990, p. 40), invite à une vie de sobriété et de responsabilité, c’est-à-dire qui prend en considération les réalités environnementales afin d’assurer la perpétuation de la vie sur terre. Plus précisément, l’écocitoyenneté est un ensemble de visions et de pratiques comportementales qui fondent l’engagement d’un individu à l’égard du bien commun, notamment, de l’environnement. Elle se construit dans l’action collective et partagée qui permet d’analyser, de manière critique, les dynamismes sociales et socio-écologiques, les politiques publiques, les pratiques des autres et les siennes et de les examiner au regard de la justice afin d’œuvrer pour l’avènement d’une justice environnementale et d’un monde meilleur. C’est-à-dire que l’environnement doit bénéficier de toute une légifération.
2- Politique de développement en Afrique : pour une incitation à l’écocitoyenneté
Dans le contexte actuel des crises écologiques, les préoccupations environnementales ne doivent pas échapper aux politiques des États africains. Pour notre part, il est fondamental d’inclure la dimension environnementale dans tous les domaines et secteurs de la société. Si le respect des principes écologiques ne guide pas les programmes de gouvernement des pays africains, la crise écologique ira de mal en pis et il ne serait pas, par conséquent, étonnant de voir les projets de développement échouer. La préservation de l’environnement, agrémentant le cadre de vie, peut attirer des populations dont des investisseurs qui pour leur réalisation, ont besoin d’un cadre de vie favorable. La nécessité d’un changement de cap s’impose avec acuité. Il s’agit en effet d’intégrer les contraintes environnementales dans l’analyse des projets de développement économique et social de l’Afrique. La gestion politique de la société ne doit pas uniquement se circonscrire autour des relations interhumaines. Mais, elle doit tenir compte des réalités écologiques, gages d’une vie sociale plus épanouie. C’est fondamentalement l’une des conditions pour atteindre l’émergence de l’Afrique. Selon Dominique Bourg et Kerry Whiteside,
Le bon gouvernement doit rompre avec cette conception de l’indépendance qui dresse l’individu contre la nature. Les démocrates écologiques proposent au contraire que la mesure du bon gouvernement soit sa tendance à se préoccuper de la protection de la nature, dans tous les sens du terme » (2010, p. 100).
Car, la nature joue un rôle capital dans le processus de développement.
Toutefois, en dehors des efforts politiques, il appartient aussi à chaque individu, à chaque africain d’apporter volontairement sa contribution. Comme cette légende amérindienne du colibri qui milite en faveur de la valeur contributive individuelle de chaque personne face à une menace, nous encourageons, à travers cet article, les individus africains à une plus grande responsabilité environnementale. Selon cette légende pleine de leçon,
Un jour il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s’active, allant chercher quelques gouttes d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ?» « Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. (Pierre RABHI, 2009, p. 10).
Comme morale, cette légende appelle chaque être humain à une responsabilité individuelle vis-à-vis de la nature. « Tel est notre responsabilité, dit Pierre Rabhi, à l’égard du monde car nous ne sommes pas totalement impuissants si nous le décidons » (2009, p. 10). Si chaque citoyen posait quotidiennement des écogestes, de façon volontaire, sans une pression quelconque, et si ce geste est à la fois répété par toute la population africaine, l’on pourrait à l’avenir, observer une nette amélioration de la situation du monde, particulièrement, en Afrique. En clair, « la crise environnementale commande des changements de comportements et de valeurs non seulement de la part des États, des organisations internationales, des firmes privées et des industries, mais aussi de chaque individu » (Nicolas MILOT et Stéphane LA BRANCHE, 2010, p. 10). Nous devons conjuguer l’action collective et individuelle. Chaque habitant de la terre peut être une source de solution pour (ré)construire un monde habitable et durable. Cela exige l’implication de tous dans la gestion de l’environnement.
CONCLUSION
L’existence, l’épanouissement et le développement des populations africaines ne sauraient être séparés de ce dont elles dépendent, c’est-à-dire la nature.
La Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d’un immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit. (Pierre RABHI, 2013, p. 141).
Malheureusement, cette nature est mise en péril par la démesure des ambitions et du pouvoir de l’homme. En effet, le monde est sous la menace d’une crise écologique qui s’accentue. Les équilibres symbiotiques de la nature ou, par extension, l’équilibre de la vie dans tous ses aspects est rompu. En raison de cette pénible réalité qui bouleverse l’organisation et le fonctionnement du monde, des dispositions en faveur de la sauvegarde de l’environnement sont prises. Cependant, force est de constater que, malgré les déterminations et les politiques de protection environnementale, les problèmes demeurent, surtout, en Afrique. En d’autres termes, la gestion de l’environnement en Afrique connait de réelles difficultés, en sorte que la crise écologique perdure et s’accentue. Les raisons qui justifient un tel échec des stratégies de protection de l’environnement sur le continent sont multiples. Toutefois, il convient de dire que la conscience écologique faiblement constituée en Afrique en est la principale cause. Pour Traoré, les « prises de décisions motivées par des intérêts politiques égoïstes et l’ignorance des citoyens des enjeux de protection de l’environnement» (2014) entravent la gestion durable de la nature. Cette attitude d’ignorance à penser que la gestion de l’environnement est une affaire de l’État laisse les populations africaines indifférentes à la cause écologique quand bien même elles sont conscientes des menaces.
La protection de l’environnement doit être considérée comme le premier souci des populations africaines en ce sens qu’elle conditionne leur jouissance sociale et leur développement socioéconomique. Cela nécessite donc l’implication et l’engagement de tout le monde. Il faut, pour cela, une éducation d’un citoyen éclairé, solidaire et engagé, qui milite en faveur de la responsabilité écologique. C’est en cela que notre article se propose de galvaniser les africains à une culture écocitoyenne, gage d’une protection durable de l’environnement et, par ricochet, de la cohésion sociale. À la lumière de la crise écologique, l’enjeu de l’éducation environnementale est d’une nécessité vitale. Cette éducation « œuvre à responsabiliser les individus dans la gestion de leur environnement, à faire émerger la notion d’écocitoyen pour assurer le développement soutenable de notre planète »[74]. Et Lucie Sauvé de préciser que, «l’objet de l’éducation relative à l’environnement (ERE) est en effet fondamentalement notre relation à l’environnement » (2002). Cette relation recommande une harmonie entre l’homme et la nature, car c’est l’avenir de l’humanité qui est en jeu.
La nature fait d’emblée partie des délibérations sur la meilleure organisation possible de la cité, de la vie en société et de la vie tout court. (…) L’engagement de la communauté à comprendre et à préserver ses caractéristiques irréductibles apparaît comme une composante essentielle d’une vie bonne pour tous les êtres vivants » (Dominique BOURG, 2010, p. 102).
L’humanité se doit donc de changer de paradigme, en passant de la logique du toujours plus à celle d’un développement qui fait de la vie une préoccupation centrale. Nous devons cultiver l’écocitoyenneté comme un art de vivre et travailler au maintien de l’équilibre symbiotique de la nature car notre survie en dépend. L’avenir de l’environnement en Afrique dépend des choix économiques et politiques actuels de nos sociétés. Il dépend en quelque sorte de l’attitude de chaque citoyen.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- Claude VILLENEUVE (Dir), Forêts et humains : une communauté de destins, Canada, Institut de l’énergie et de l’environnement et de la francophonie, 2012.
- Dominique BOURG et Kerry WHITESIDE, Vers une démocratie écologique, Paris, Seuil, 2010.
- Henk. A. M. J. TEN HAVE (Dir.), Éthique de l’environnement et politique internationale, Paris, Unesco, 2007.
- FAO, Situation des forêts du monde, Rome, 2011.
- Francine PELLAUD, Pour une éducation au développement durable, Paris, Quae, 2011.
- Guy PONTIÉ et Michel GAUD (Dir.), « Afrique contemporaine » n°161, L’environnement en Afrique, Paris, La documentation française, 1992.
- Grégoire TRAORÉ, Démocratie et gestion de l’environnement à la lumière de l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas, in implications philosophiques, Juin 2014, http://www.implications-philosophiques.org/ ?
- Hans JONAS, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, trad. Jean Greisch, Paris, les Éditions du Cerf, 1990.
- Jean-Marie PELT, Nature et spiritualité, Paris, Fayard, 2008.
- Journal Francophone de l’Écocitoyenneté, La pollution en Afrique francophone, Aout 2009, jfe no 002.
- La commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir à tous, Montréal, Québec, Les Éditions du Fleuve, 1988.
- Nicolas HULOT, Robert BARBAULT, Dominique BOURG, Pour que la terre reste humaine, Paris, Seuil, 1999.
- Nicolas MILOT et Stéphane LA BRANCHE (éds), Enseigner les sciences sociales de l’environnement, Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 2010.
- Pierre RABHI, La part du colibri. L’espèce humaine face à son devenir, Paris, l’Aube, 2009.
- Pierre RABHI, Vers la sobriété heureuse, Paris, Actes sud, 2010.
- Rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Les liens entre santé et biodiversité, no 008095-01, Avril 2013.
- PNUE, L’avenir de l’environnement en Afrique. Notre environnement, notre richesse, 2006.
[1] Tiken Jah Fakoly, de son vrai nom Doumbia Moussa, est un artiste ivoirien, chanteur, musicien et auteur compositeur. Il rentre sur la scène dans les années 1996 et fait le reggae.
[2] L’Ivoirité, est un concept politique ivoirien. Il est apparu en 1970, avec plus de précision, en 1974, par Pierre Niava parlant de l’œuvre et du projet du jeune intellectuel, Niangoranh Porquet.
[3] Les besoins vitaux permettent de contribuer à la survie des Hommes ainsi que de celle des animaux, alors que les besoins secondaires concernent uniquement les êtres humains.
[4] L’Homme chez qui prédomine le désir de posséder.
[5] Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.
[6] L’individu aliéné perd tous repères du fait de son attitude qui le met en conflit avec ses semblables et avec lui-même, car sa volonté de s’approprier, à tout prix, tous ses objets de désirs, favorise sa déréliction et un climat hostile au vivre ensemble au sein de sa communauté : d’où la perte de sa liberté. Ce dernier espère donc retrouver cette liberté en s’opposant de plus belle aux autres dans la mesure où, son manque d’autocritique l’amène à penser que son aliénation est due en grande partie aux autres. De ce fait, il se met une fois de plus en conflit avec ses semblables en espérant retrouver sa liberté perdue. En réalité, pour l’Homme de l’avoir son véritable épanouissement ne dépend pas forcement du bien-être des autres, au fond, le bien-être des autres lui importe peu. Ce qui lui importe le plus, c’est la recherche effrénée de l’avoir, qui, dans son entendement va contribuer à son véritable épanouissement et sa sécurité sociale.
[7] Vivre au maximum dans la réduction de tout ce qui est bien matériel, c’est-à-dire la privation presque totale de tout ce qui est bien matériel. Il est d’ailleurs illusoire de vouloir vivre sans rien, car tout être humain a forcément quelque chose. En effet, à défaut d’avoir des biens matériels, un être humain a au moins un corps qui lui sert de possession, voire même un habit qui recouvre son corps.
[8] De même que l’individu doit tenir compte du bien-être de la collectivité, de cette même manière, la collectivité doit aussi tenir compte du bien-être des individualités. La collectivité n’est-elle pas en ce sens un ensemble d’individualité. Pour ce faire, la collectivité doit tenir compte de l’épanouissement de toutes les individualités et ne doit pas les nier.
[9] Les doctrines du géocentrisme s’articulent autour de l’idée selon laquelle l’homme étant la créature la plus parfaite, et habitant la terre ; le centre de l’univers ne saurait être que la terre. Cf. de la révolution des orbes célestes. Nicolas COPERNIC.
[10] Ignace Ayénon YAPI, « L’unité de la vie selon Claude Bernard », in http://www2.univ-mlv.fr/revuethique/pdf/yapi.pdf, consulté le 10 novembre 2012.
[11] Idem
[12] La distinction entre les différentes âmes, selon Aristote, permet d’établir les différences entre les êtres vivants. Certes, tous les êtres ont en commun un type d’âme qu’est l’âme végétative, mais ils sont bien différenciés. Cf. ARISTOTE, De l’âme, Traduction et notes d’Edmond Barbotin, Paris, Les Belles Lettres, 1966, pp. 35-36.
[13] Robert Hooke (1635-1703), savant anglais, fabriqua un microscope qui lui permit de de découvrir la structure cellulaire des plantes. Il serait le premier à employer le mot « cellule » pour désigner les sortes d’alvéoles qu’il avait discerné en regardant les coupes de liège au microscope.
[14] Marcello Malpighi (1628-1694), médecin et biologiste italien, a décrit les composants microscopiques de nombreux organes, notamment les reins. Il est l’un des précurseurs de l’histologie et le père de l’anatomie microscopique.
[15] Nehemiah Grew (1641-1712), médecin et botaniste anglais, est considéré, avec Marcello Malpighi, comme le fondateur de l’anatomie et de la physiologie végétale.
[16] Rudolf Virchow (1821-1902), médecin allemand, est le fondateur de la pathologie cellulaire. Il démontra que la théorie cellulaire s’applique aux tissus malades aussi bien qu’aux tissus sains.
[17] Parler d’”unification” des êtres vivants, c’est faire référence à leurs points communs. Lorsque Aristote distingue les différentes âmes, il en ressort que tous les êtres vivants ont en commun la nutrition, donc l’âme végétative. L’Histoire des animaux et le traité De l’âme sont les ouvrages qui illustrent mieux cela.
[18] Avec Aristote, l’âme végétative appartient à tous les êtres de la nature, de la plante à l’homme en passant par les animaux. Cependant, pour Claude Bernard, s’il faut établir l’identité du règne végétal et animal à partir de la nutrition, il faut aller jusque dans les mécanismes qui la sous-tend, car il n’y a qu’un seul processus nutritif pour les deux règnes, voire tous les règnes. Cf. Claude BERNARD, Leçons sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux, Tome II, op. cit., pp. 46-47.
[19] Carl Von Linné (1707-1778), naturaliste et médecin suédois, soutenait la fixité des espèces, aboutissant à une distinction, de fond en comble, entre animaux et végétaux par leurs classifications.
[20] Georg Ernst Stahl (1660-1734), chimiste et médecin allemand, maintenait une stricte séparation entre la chimie et la médecine.
[21] Xavier Bichat (1771-1802), médecin français, fut un défenseur du vitalisme. Pour lui, il existe des propriétés vitales qui sont sans cesse variables et opposées aux propriétés physiques fixes et invariables.
[22] Paul Joseph Barthez (1734-1806), médecin français et chef de l’école de Montpellier, fut l’un des fondateurs de la théorie vitaliste, dont Xavier Bichat fut un admirateur.
[23]À ces propos le lecteur doit se référer aux pays Africains qui ont traversé des graves crises de leur histoire : La Côte d’Ivoire, La Lybie, Le Mali pour ne citer que ceux -là.
[24]www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/…/changement_rheaume.pdf, consulté le 3 juillet 2011.
[25] Production discographique de Soum Bill, extrait de l’album Terre des hommes, paru en 2006.
[26] Jean-Baptiste ONANA, culture et développement, De la relation entre culture et développement : Leçons asiatiques pour l‘Afrique, disponible sur, www.politiqueafricaine.com/numeros/pdf/068096.pdf consulté le 30/01/2017.
[27] Amadou HAMPATÉ BÂ, « Lettre d’Amadou Hampaté Bâ adressée à la jeunesse africaine », in http://yasserassoweh.over-blog.fr/pages/Lettre_dAmadou_Hampate_Ba_adressee_a_la_jeunesse_africaine-5632172.html, consulté le 18/12/15.
[28] Le Parti Démocratique de Guinée et le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire en sont une parfaite illustration.
[29] À l’égard de certains compatriotes, mais surtout à l’égard de ressortissants de pays voisins-frères. Les pires formes d’humiliation subies par les communautés nigérienne, malienne et notamment burkinabé, de la part de certains politiques ivoiriens, ne peuvent être tolérées.
[30] Dictionnaire le Petit Robert
[31]Dictionnaire le Petit Robert
[32] Dictionnaire le Petit Robert
[33] Dictionnaire le Petit Robert
[34] Depuis Aristote, il existe plusieurs sortes de justice qu’on peut résumer en ces trois majeures :
– la justice commutative : appliquée au niveau des échanges, elle veille à l’équité dans les transactions, c’est-à-dire qu’aucun des échangeurs ne soit lésé.
– la justice distributive : rémunérer chacun en fonction de ses efforts personnels
– la justice répressive : rendre proportionnelle la gravité des peines au dommage commis. Elle n’est pas forcément une application à la lettre de la loi du talion « dent pour dent, œil pour œil ».
[35]Charles DEBBASCH, Le Parti unique à l’épreuve du pouvoir : les expériences maghrébines et africaines, p.1. Pdf disponible sur le net. Consulté le samedi le 12 décembre 2015 à 13h21
[36] Idem
[37] Houphouët-Boigny ne disait-il pas qu’on ne fouille pas dans la bouche de celui qui grille les arachides.
[38] La majorité des ex-colonies voire l’ensemble des pays africains connaissent ou ont connu, à part le Sénégal, des situations socio-politiques difficiles, des coups d’État, des rebellions, des crises pré et/ou post-electorales, des crises nées de tripatouillages constitutionnels, etc.
[39] Nous utilisons ce mot et non celui de retour parce que nous pensons, vu la pratique politicienne, que nos hommes politiques, dans leur quasi majorité, connaissent peu, lorsqu’ils ne l’ignorent pas complètement, les règles qui régissent le jeu politique. Ils sont, nous l’estimons ainsi, arrivés en politique de façon accidentelle, c’est-à-dire sans aucune formation en la matière. Or, à l’instar des autres domaines d’activités humaines, la politique est un art qui nécessite au préalable un apprentissage, une initiation. Sans quoi, on ne peut qu’aboutir au désastre que nous constatons avec amertume.
[40] Le Cuba, le Venezuela, la Chine etc. qu’on présente comme des régimes autoritaires parviennent cependant à faire cohabiter leurs concitoyens.
[41] Rassemblement Démocratique des Républicains
[42] Parti Démocratique de Côte d’Ivoire
[43] Au point qu’on a en Côte d’Ivoire, des journaux bleus (ceux de l’opposition) et des journaux orange, dédiés au pouvoir.
[44] Le 18 février 1992, l’opposition organise une marche non autorisée. Il s’ensuit des violences et des destructions de biens publics. Plusieurs cadres du parti frontiste dont le couple Gbagbo sont arrêtés et jugés.
[45] La constitution rwandaise interdit tout propos susceptible de réveiller les vieux démons du génocide. L’État, en dépit des déviations que dénoncent certaines organisations non gouvernementales, y veille rigoureusement.
[46] UNESCO et UNICEF, « Apprendre à vivre ensemble, Un programme interculturel et interreligieux pour l’enseignement de l’éthique ». In http://www.ethicseducationforchildren.org. Consulté le vendredi 20 novembre 2015 à 21h17
[47] Démocratie vraie, se distinguant nettement de celles de façade des puissances occidentales qui se disent démocrates chez eux pendant qu’ils encouragent et installent des dictatures, des pouvoirs totalitaires chez les autres. Ils légitiment, pour des intérêts économiques et géopolitiques, l’oppression des masses populaires africaines, bien sûr avec la complicité de nos dirigeants et le silence coupable des peuples africains. Ces derniers oublient très souvent que le rôle d’un citoyen ne consiste pas seulement à aller voter et respecter la loi, celle-ci ne disant pas toujours le juste. Or, c’est au juste de dicter la loi. C’est à ce titre que le peuple, en tant que légitime détenteur de la justice, est dans l’obligation de s’engager dans la lutte pour la défense de ce juste, même en violation de la loi, si nécessaire.
[48] Carmel CAMILLERI, cité par Rinetta Kiyitsioglou-Vlachou, in « culture et interculture : réflexions d’ordre didactique » www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/fr/kiyitsioglou_vlachou, consulté le 26/09/2013.
[49] «Défis identitaires et culturels en ce début du 21ème siècle», in RÉSEAU MULTIDISCIPLINAIRE D’ETUDES STRATÉGIQUES 21 janvier 2008, RMES/NA/2008/03, p. 3.
[50]Dictionnaire Larousse, définition de Panafricanisme :http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/panafricanisme/57545 [archive]
[51]Abou SANGARÉ, « La ruse de la raison dans les relations internationales », in Implications philosophiques, Revue internationale de philosophie, (en ligne), consultée en Juin 2015 sur www.implications-philosophiques.org
[52] Le Grand Robert de la Langue française, version électronique, deuxième édition dirigée par Alain REY du Dictionnaire Analogique et Alphabétique de la Langue française de Paul ROBERT.
[53] La souveraineté, c’est la capacité dont dispose les États d’agir sans autorisation ni contrôle extérieurs. Elle est, au regard du principe d’égalité des États, affirmée comme valeur fondatrice du droit international. Cette conception, donne libre cours aux États de faire ce qu’ils veulent chez eux, sans avoir à rendre compte à l’extérieur, et elle tiendra bien aussi longtemps que l’État restera replié sur lui-même comme une entité close et opaque.
[54] Nous ne faisons pas allusion seulement aux conférenciers et hommes de médias mais à tout individu qui fait usage du langage en tant que moyen de communication.
[55] Fragmentaire ici signifie pour nous tolérance, souplesse.
[56] L’EPS : Un moyen d’apprendre à vivre ensemble, https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/…/04_03STA00126.pdf.
[57]Dictionnaire la toupie in www.toupie.org/dictionnaire/justice.htm
[58] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Article 6.
[59] Culture numérique, Https://fr.wikipedia.org/wiki/culture_numérique, consulté le 07/12/2015.
[60]Gilbert HOTTOIS, « La technoscience : entre technophobie et technophilie », in www.download2.cerimes.fr/canalu/documents/utls/download/pdf/190100.pdf, consulté le 04/06/2014.
[61] Expression de Simondon selon laquelle tout objet technique inventé contient en lui les valeurs humaines cristallisées
[62] Cette expression désigne le fait d’user de la parole, l’écriture et surtout des images pour vanter les mérites d’une théorie, d’une idée, d’un homme en vue de recueillir l’adhésion, le soutien du public. En un sens, c’est une sorte de publicité politique qui consiste à véhiculer des messages ou informations erronées destinées à manipuler l’opinion. Elle se rapproche de la publicité ; elle se distingue de la publicité en ce qu’elle vise un but politique et non commercial. Elle influence l’attitude fondamentale de l’homme puisqu’elle crée en lui des réflexes conditionnés.
[63] C’est dans le sens grec du mot politique que nous nous inscrivons, c’est-à-dire l’art de gouverner la cité. Cela ne peut se faire sans une autorité, à qui, le pouvoir de gouverner la cité est donné. Le pouvoir repose, ici, sur le consentement.
[64] Locke entend par trust toute mission conférée par la communauté à un pouvoir d’agir dans son intérêt. Elle est basée sur la confiance.
[65] Cette étoffe est un agrégat de tissus d’origines aussi diverses que variées qui, pour faire une pièce unique, sont cousus les uns à côté des autres pour donner une étoffe unique aux couleurs harmonieuses.
[66]Céline SPECTOR « Charles Taylor, philosophe de la culture » in http://www.laviedesidees.fr/Charles-Taylor-philosophe-de-la.html, consulté le 25/11/2015.
[67] René BARBIER, « élément pour une philosophie du vivre ensemble », in http://www.barbier-rd.nom.fr/elements-philosophie-vivre-ensembleRB.pdf, consulté le 03 Juin 2016.
[68] PNUE, Déclaration de Stockholm, in http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf, consulté le 08/11/2015.
[69] Les Makahs, population aborigène de la côte ouest des États-Unis, dans l’État de Washington, en affirmant leur droit à chasser les baleines, ne défendent pas seulement un droit d’accès à des ressources alimentaires. La pêche à baleine tient à l’ossature même de leur société. Leur interdire de continuer à la chasser serait mettre en danger leurs traditions, leur identité, la communauté qu’ils forment. Chasser la baleine aide les Makas à se souvenir de « qui ils sont » : ils se targuent de consommer de la chair de baleine depuis 2200 ans. Exemple, cité par Catherine LARRÈRE, « Multiculturalisme et environnementalisme », in http://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Larrere.Multic.pdf, consulté le 10/09/2015.
[70]Catherine LARRÈRE, Multiculturalisme et environnement, in http://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Larrere.Multic.pdf , p.18. Consulté le 08/07/2016.
[71] – Expression empruntée à l’ex-président Français Jacques Chirac lors de son intervention au nom de la France au quatrième sommet de la Terre à Johannesbourg le 2 septembre 2002. www.lefigaro.fr/…/25001-20140327ARTFIG00120-ecologie-le-discours…/E. Consulté le 30/12/2014.
[72] – Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement
[73] – La Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, Notre avenir à tous, Montréal, Québec, Les Éditions du Fleuve, 1988, p. 51.
[74] – Réseau École et Nature, Guide pratique d’éducation à l’environnement, édition revue et augmentée, Lyon, Chronique sociale, 2001. www.reseauecoleetnature.org/system/files/guide-pratique-07-2.pdf. Consulté le 23/02/2016.