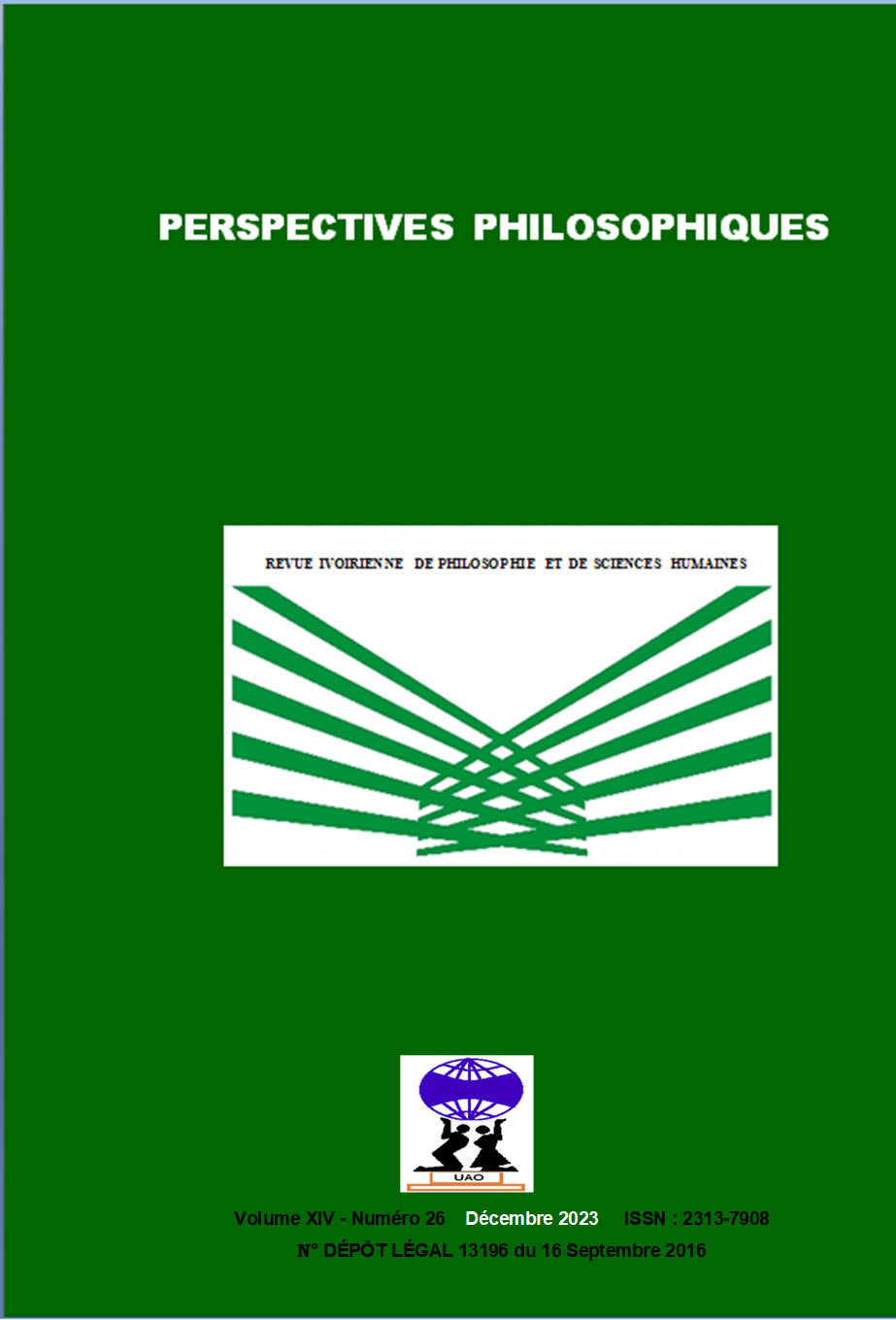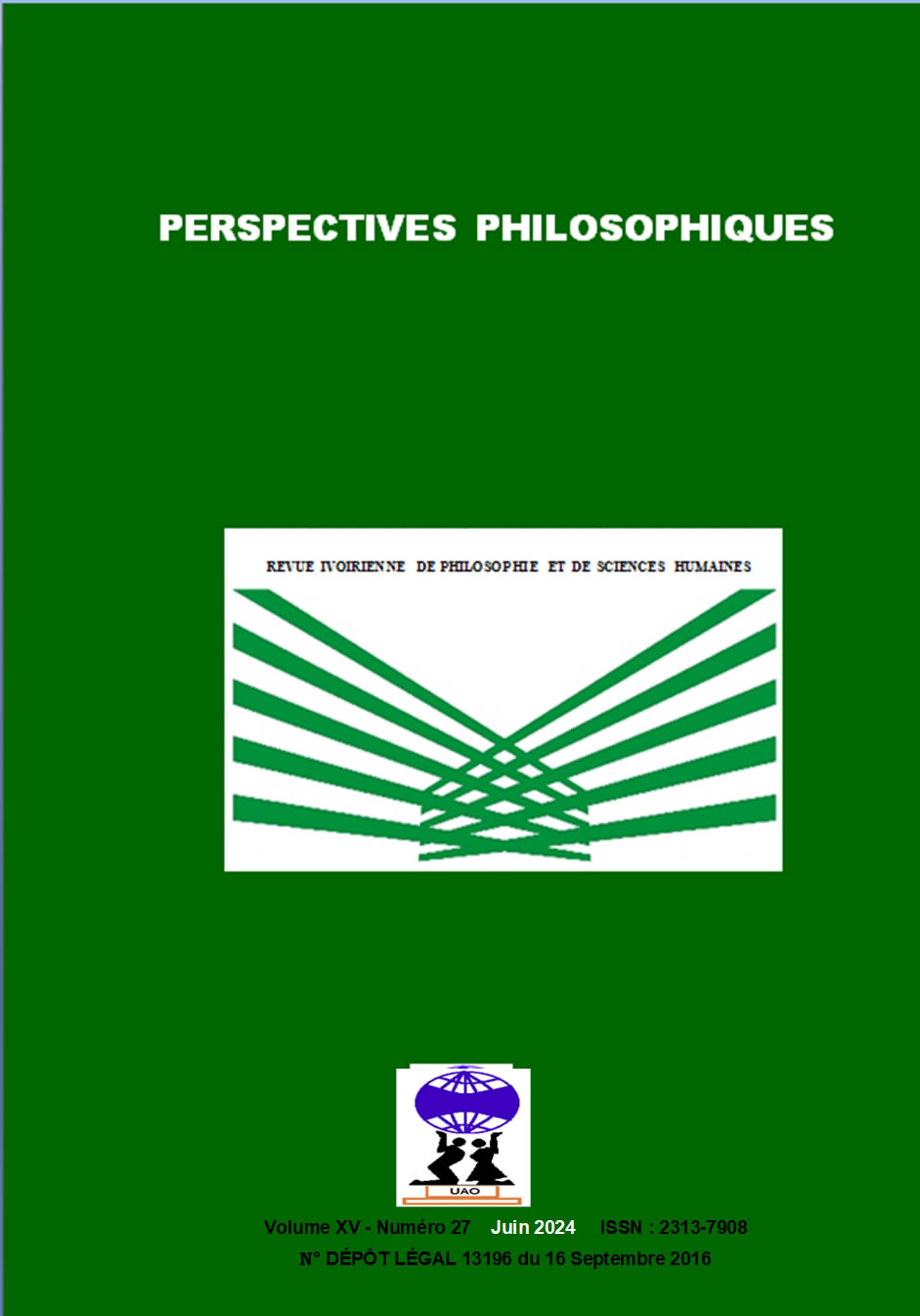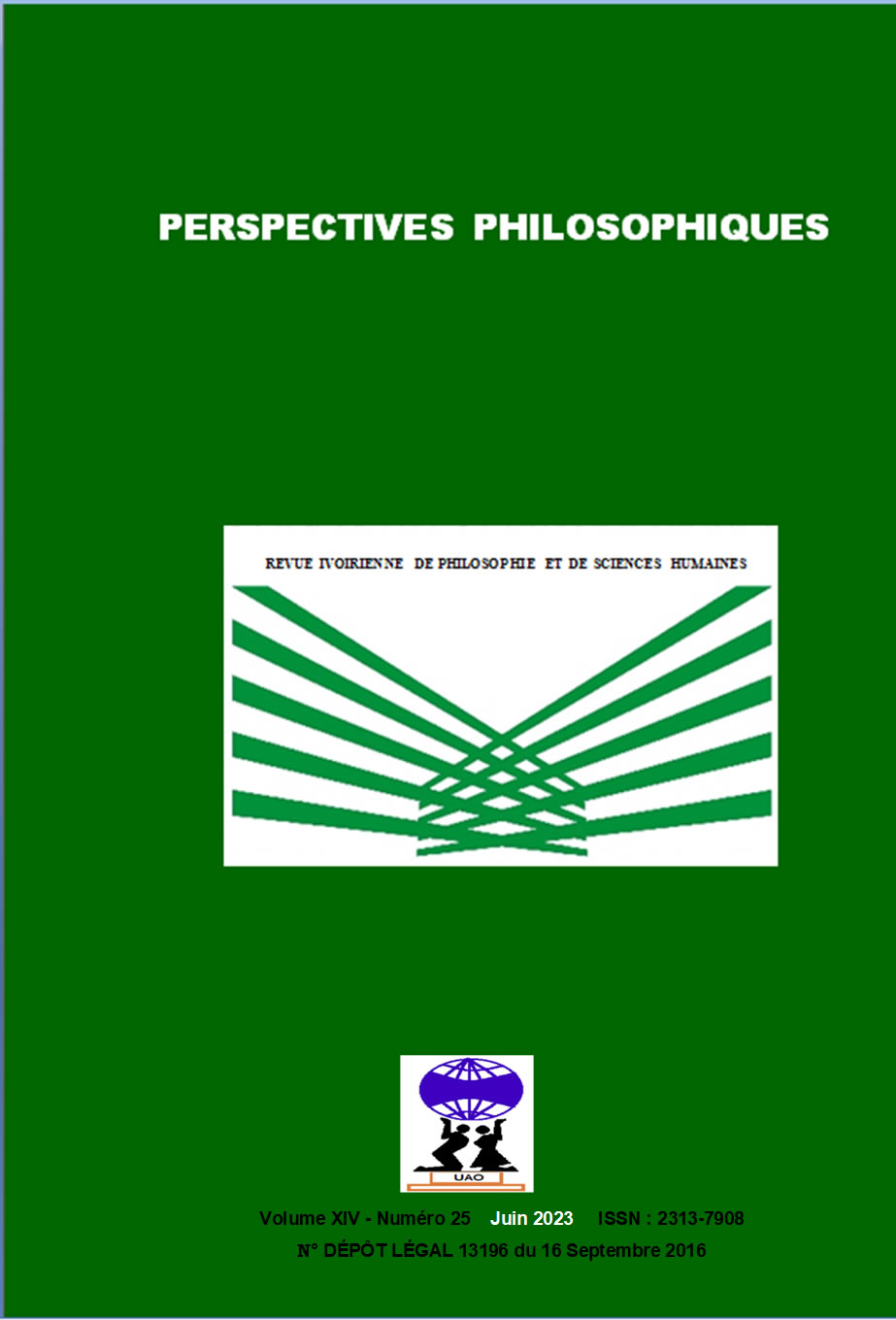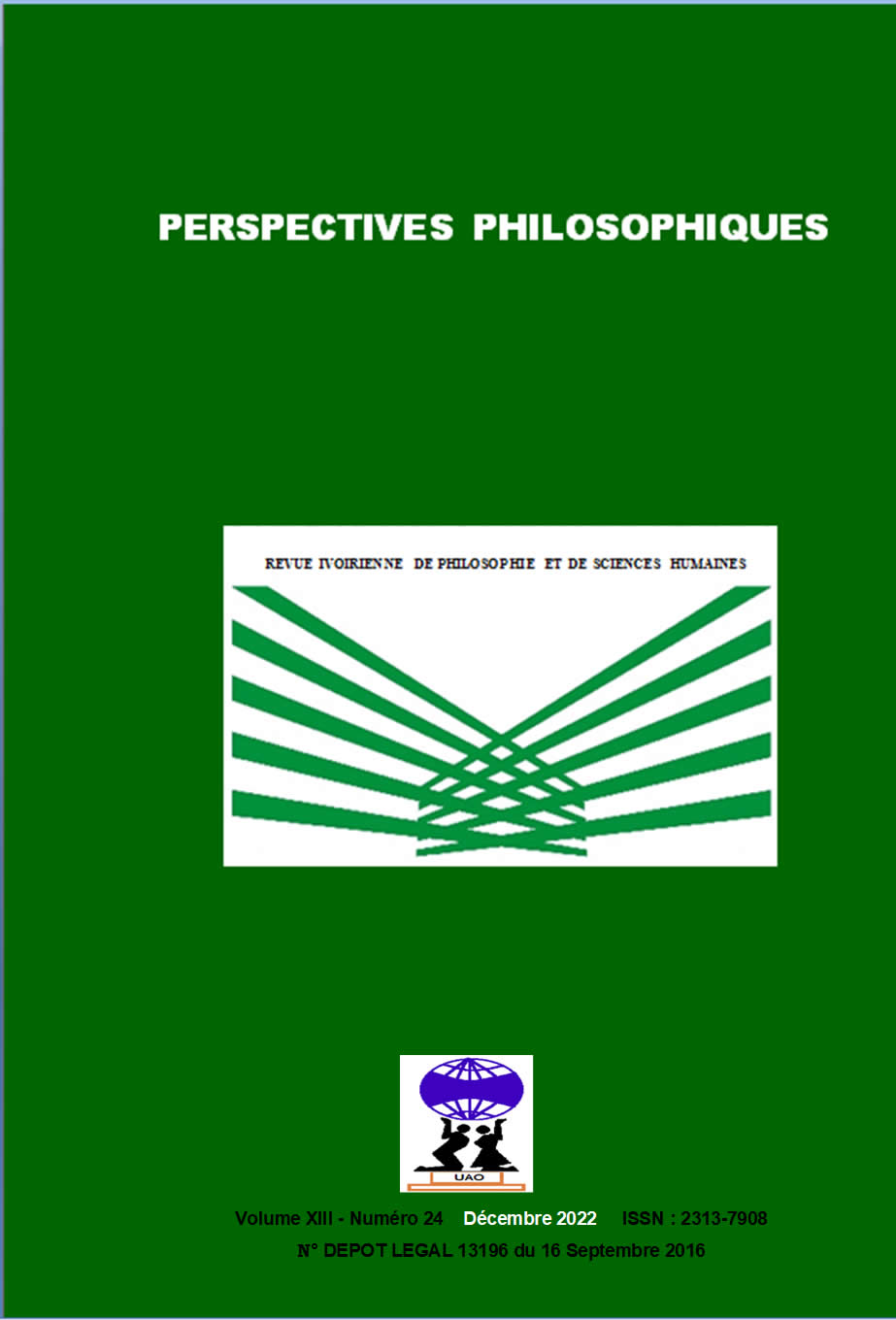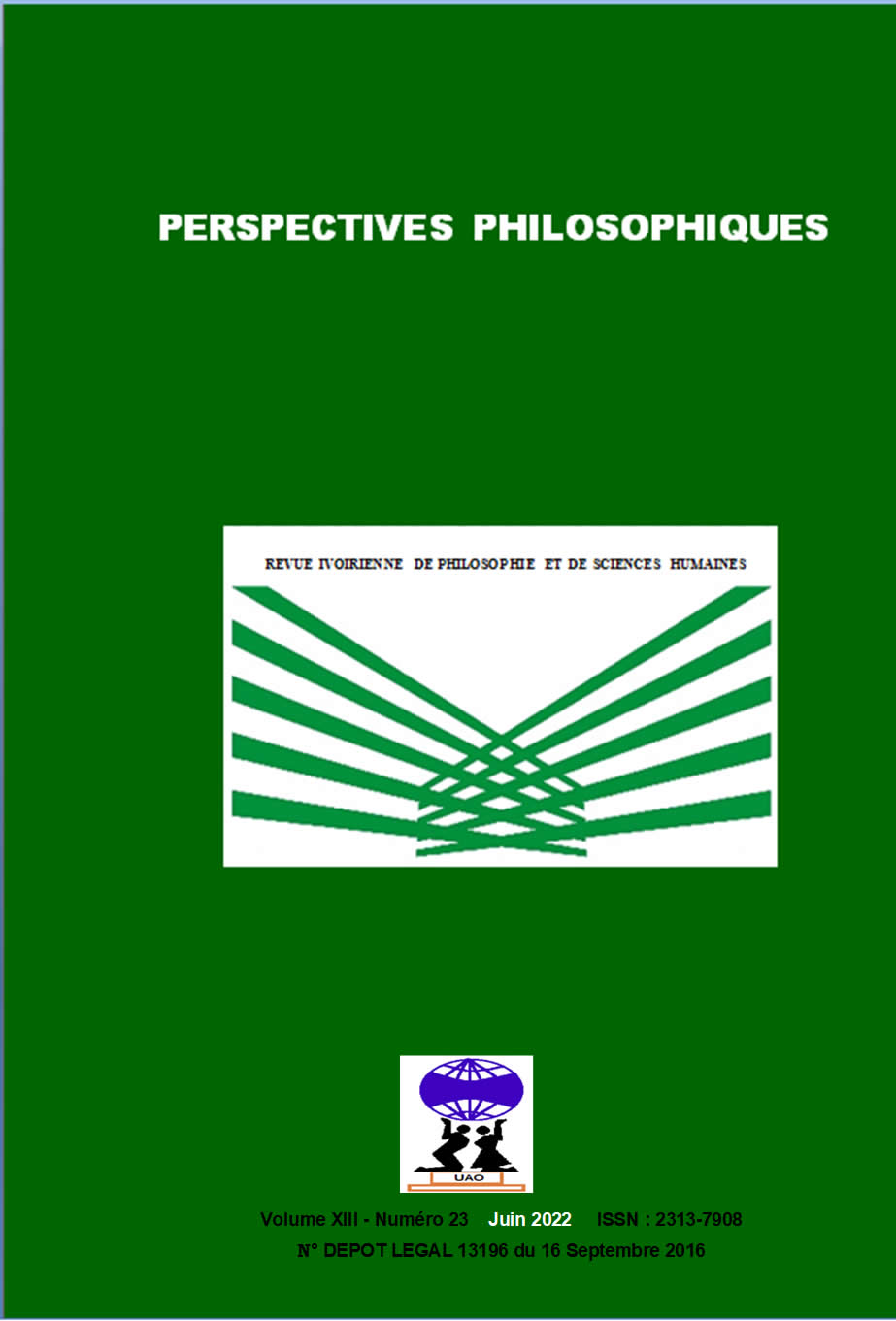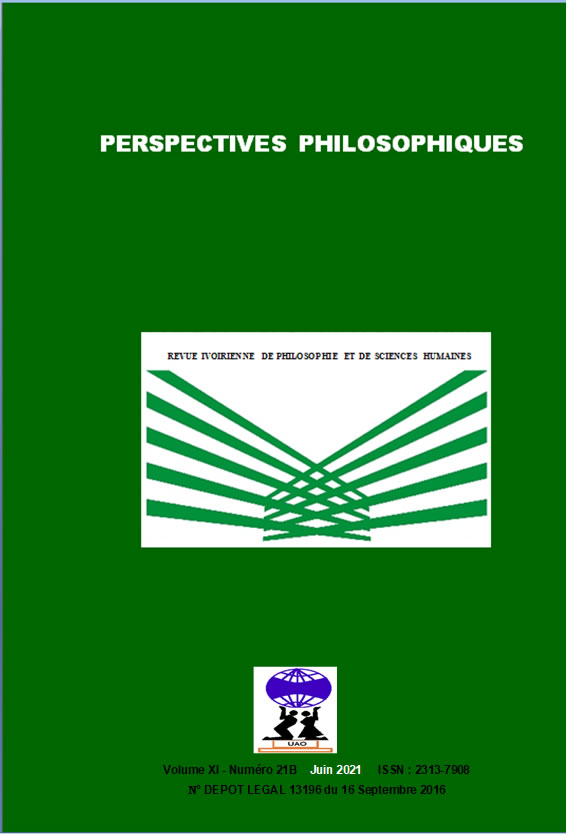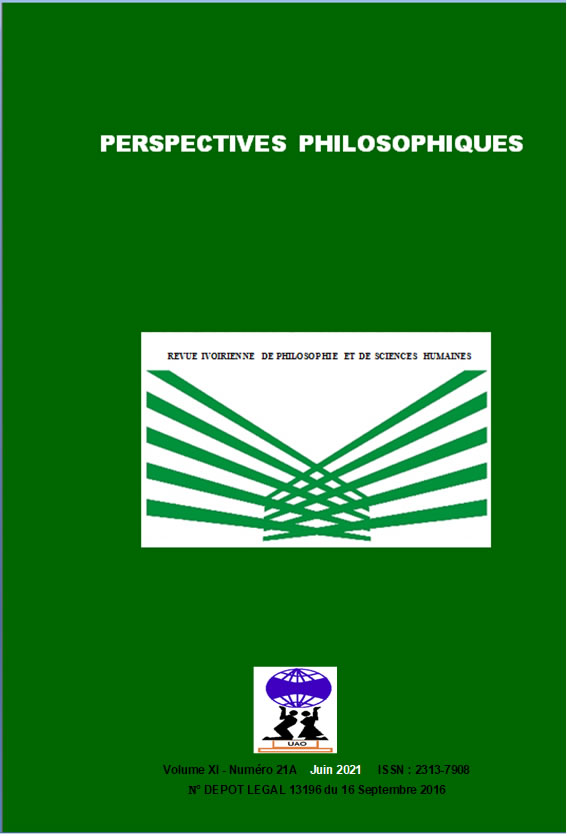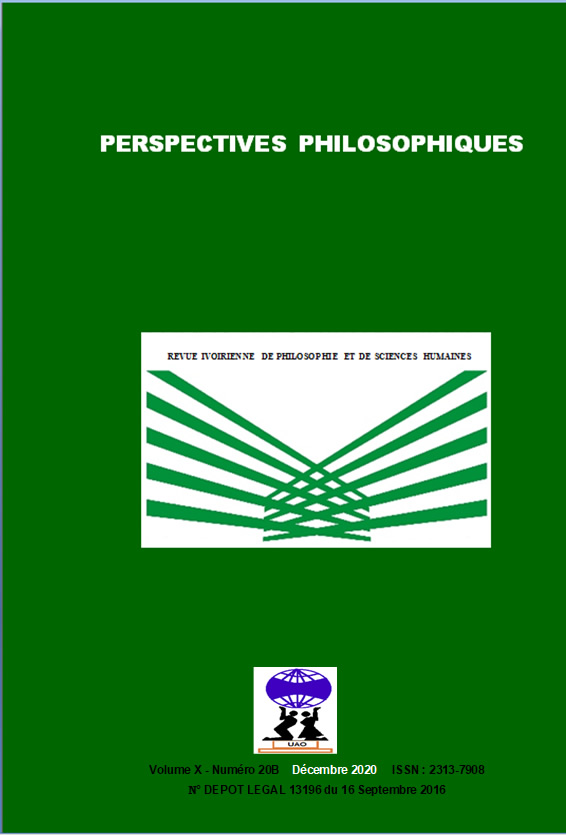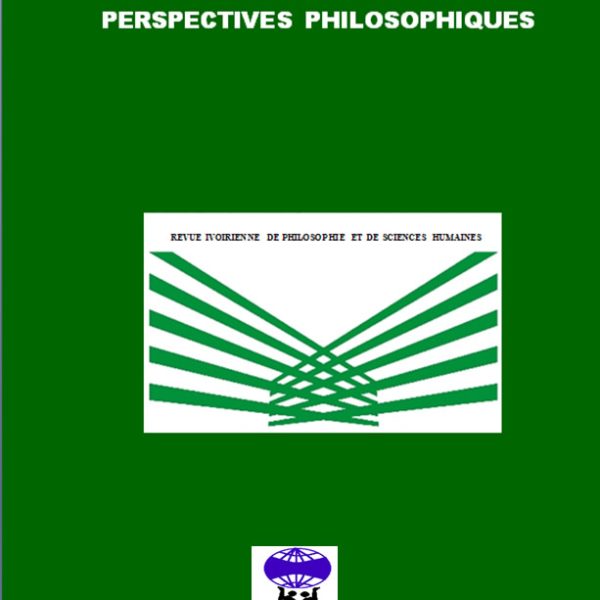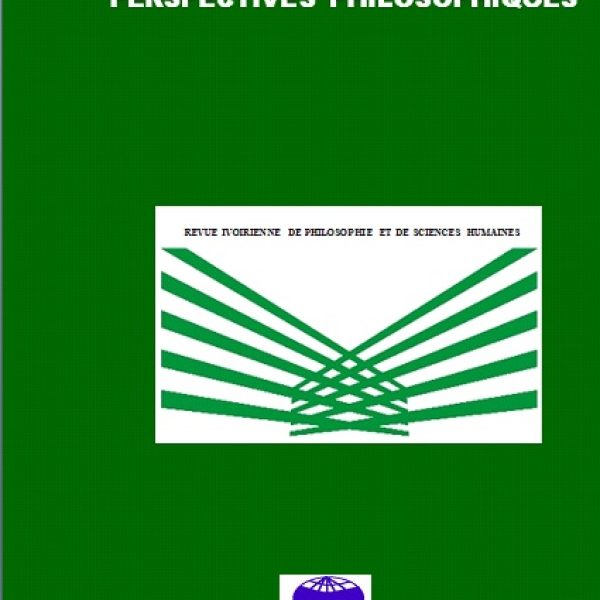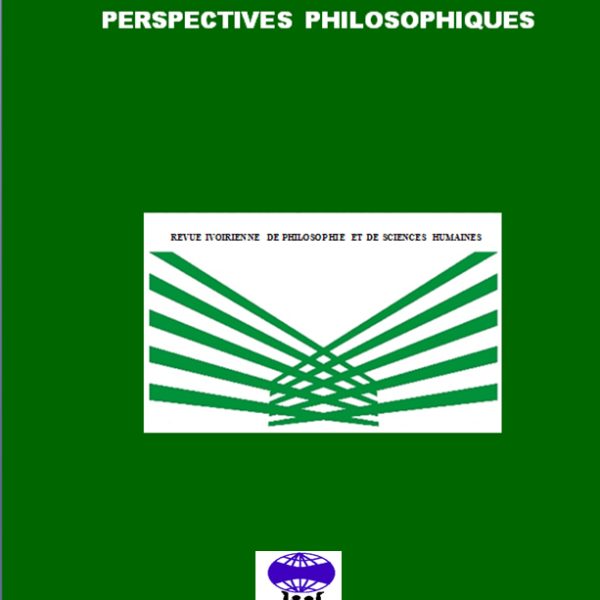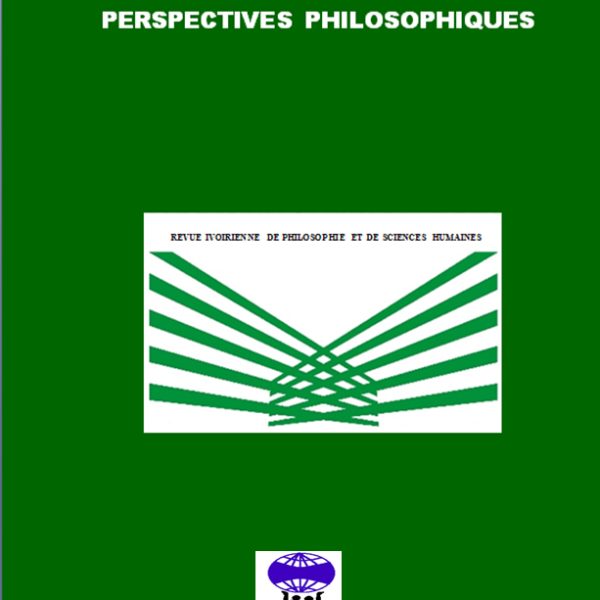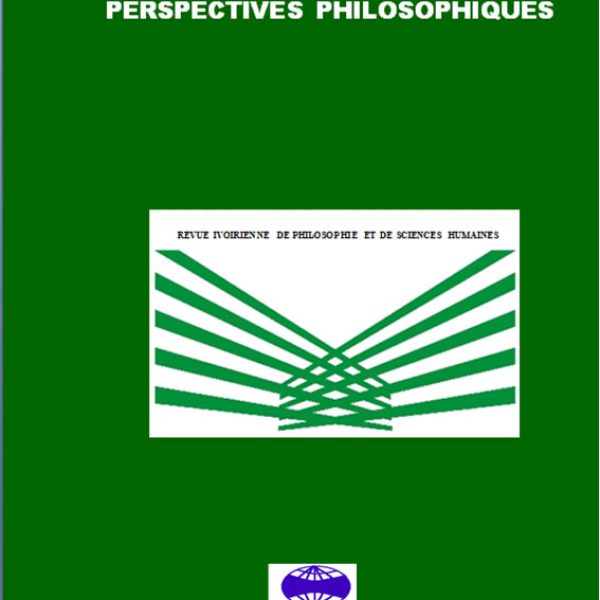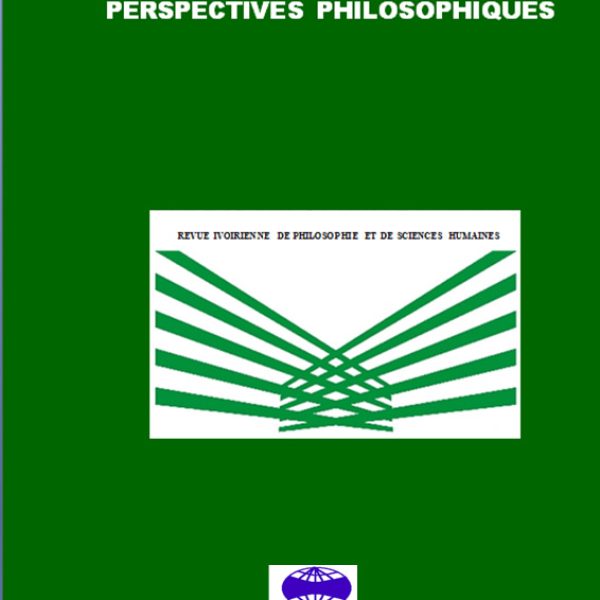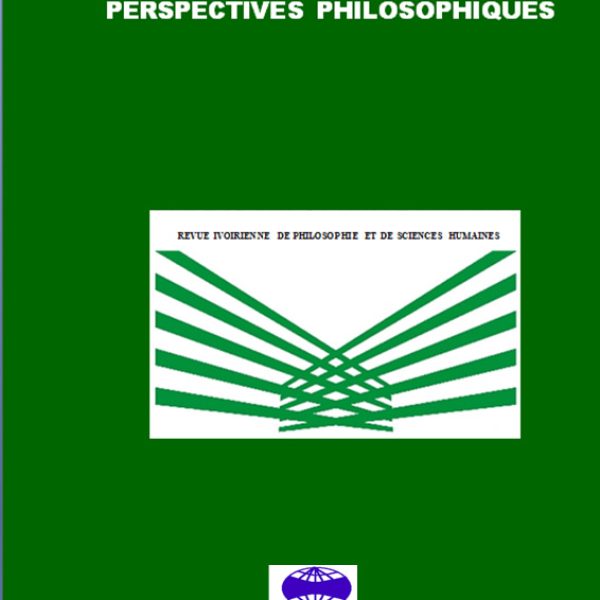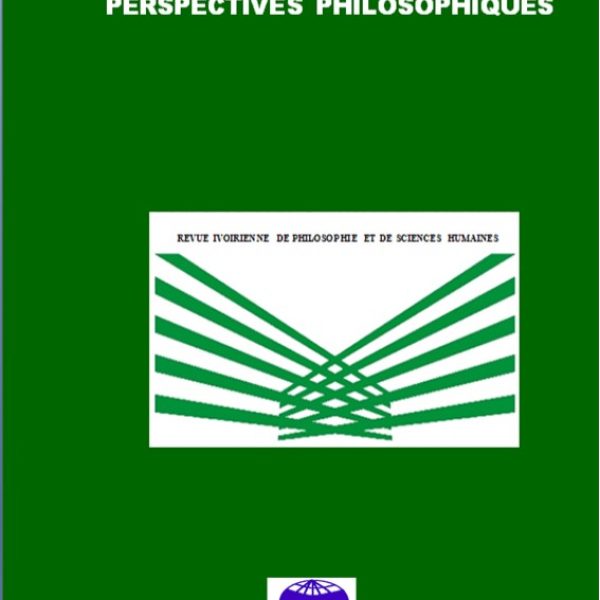| Actes du colloque international pluridisciplinaire LA CRISE DE L’UNIVERSITÉ EN AFRIQUE : DIAGNOSTIC ET ÉLÉMENTS DE STRATÉGIES TRANSVERSALES |
| PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES |
| Volume XII – Numéro 22 – Bouaké, les 09, 10 et 11 Juin 2022 Côte d’Ivoire ISSN : 2313-7908 N° DÉPÔT LÉGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Grégoire TRAORÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 01 03 01 08 85
(+225) 01 03 47 11 75
(+225) 01 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : https://www.perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DÉPÔT LÉGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Grégoire TRAORÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Prof. N’dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités
Rédacteur en chef Adjoint : Dr Éric Inespéré KOFFI, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. N’Dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Donissongui SORO, Professeur des Universités, Philosophie antique, Philosophie de l’éducation Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Nicolas Kolotioloma YEO, Professeur des Universités, Philosophie antique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Secrétaire de rédaction : Dr Kouassi Honoré ELLA, Maître de Conférences
Trésorier : Dr Kouadio Victorien EKPO, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Dr Faloukou DOSSO, Maître de Conférences
Dr. Kouassi Marcelin AGBRA, Maître de Conférences
Dr Alexis Koffi KOFFI, Maître de Conférences
Dr Chantal PALÉ-KOUTOUAN, Maître-assistant
Dr Amed Karamoko SANOGO,Maître de Conférences
PREMIÈRE PARTIE : ALLOCUTIONS ET COMMUNICATIONS EN PLÉNIÈRE………………………….…………………………………………………1
I. ALLOCUTIONS…………………………………………….…………….…………….…1
Allocution du Président du comité d’organisation………………………….……….2
Allocution du Directeur du Département de Philosophie………………………….6
Allocution du Directeur de l’UFR-CMS…………………………………..…………….9
Allocution du Président de l’Université Alassane OUATTARA………..………….12
Allocution du Maire de Bouaké………………………………………………………….15
Allocution du Ministre de la Promotion de la bonne Gouvernance et de la lutte contre la Corruption, Parrain du Colloque………………………………..………….17
Allocution du Président du Conseil Économique Social Environnemental et Culturel, Patron du colloque……………………………………………..….………….19
Allocution de clôture du Président émérite de l’Université Alassane Ouattara, Président de la Chaire UNESCO de Bioéthique de l’UAO………………..……….21
Rapport de synthèse……………………………………………………………..…….….24
Recommandations……………………………………………………………..…………..31
II. COMMUNICATIONS EN PLÉNIÈRE………………..…………………………….33
« Vrai et faux pluralisme ». Les universités dans l’ordre mondial contemporain,
Ernst Wolff………………………………………………………………………….……….35
Notre devoir et notre foi au caractère universel de l’Université,
Thiémélé L. Ramsès BOA………………………………….………………………….….51
DEUXIÈME PARTIE : AXES DE RÉFLEXION ET ATELIERS……..….63
PREMIER AXE : GOUVERNANCE ET FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS…65
Mauvaise gouvernance endémique des États africains : approche synoptique des universités en déconstruction,
Kobenan Maxime KOUMAN……………………………………………………….…….67
L’essence de l’université chez Heidegger : la Lehrerschaft face aux défis de la Führerschaft, cas de l’Afrique,
Pascal Dieudonné ROY-EMA……………………………………..…………………….85
La gouvernance universitaire à l’épreuve de la discipline sur le campus au Cameroun,
Saidou ABOUBAKAR…………………………………………………………………….101
Gouvernance et financement des universités de la zone UEMOA,
Kadiatou SANOGO N’DOURE ………………………………………………………….119
Fondements et typologie caractéristique de la crise de l’université en Afrique : cas de l’université gabonaise,
Georges MOUSSAVOU………………………………………………………….……….135
Projets d’école et l’autonomie des universités au Togo,
Ati-Mola TCHASSAMA…………………………………………….…………………….149
La communication interne de l’UFR/LAC de l’université Joseph KI-ZERBO au Burkina Faso,
1. Marcel BAGARE 2. Dognon Lucien BATCHO 3. Salif ZONGO………………165
DEUXIÈME AXE : UNIVERSITÉ ET QUESTION DU GENRE…….…………..185
Femmes et carrières à l’épreuve de la disparité fondée sur le sexe au sein de l’université de N’Djamena,
1. Dieudonné VAÏDJIKÉ 2. Alexis NGARMBATEDJIMAL 3. François NDILBÉ MBAÏNGUEM………………………………………………………………….…….…….187
Genre et harcèlement sexuel en milieu universitaire : le cas des étudiantes des universités de Côte d’Ivoire,
Lou Gobou Bien-aimée GOHI………………………………………………..…….….203
TROISIÈME AXE : FORMATION ET EMPLOYABILITÉ DES ÉTUDIANTS……………………………………………………………………………….217
La dialectique de la formation et de l’emploi : l’université à l’épreuve du devenir,
Akpolê Koffi Daniel YAO…………………………………………………..…………….219
Penser la crise des universités africaines comme une crise de la langue de la formation scientifique,
Tohotanga COULIBALY………………………………………………………………….233
La philosophie de l’entrepreneuriat : une implication socio-économique de l’allégorie de la caverne chez Platon,
Bi Zaouli Sylvain ZAMBLÉ………………………………………………….………….247
Formation et employabilité des étudiants africains, quelle approche philosophique ?,
Aikpa Benjamin DIOMAND…………………………………………………………….263
La question de la réforme et la révolution dans l’université en Afrique à la lumiėre de la pensée de Paul RICŒUR,
Oi Kacou Vincent Davy KACOU……………………………………..……………….283
L’employabilité des diplômés en SHS au Mali : des dynamiques contradictoires aux origines de la crise de l’université,
Sambou DIABY……………………………………………………………….………….299
Les universités africaines : entre professionnalisation manquée des enseignements et prolifération des instituts privés d’enseignement supérieur douteux,
Théodore TEMWA……………………………………………………………….……….315
Crise de l’université camerounaise comme crise des sciences sociales : entre théorisation et professionnalisation des enseignements,
Lydie Christiane AZAB à BOTO……………………………………………………….333
De la mission nouvelle des universités africaines : pour une politique d’employabilité des jeunes,
Miesso ABALO…………………………………………………………………………….351
Formations et risques de chômage des étudiants au Gabon : quelle représentation sociale ?,
Parfait MIHINDOUBOUSSOUGOU…………………………..……………………….365
QUATRIÈME AXE : UNIVERSITÉ ET CULTURE DE L’EXCELLENCE…….383
De la promotion de l’éducation positive pour une université plus créative,
Hyacinthe Aboa ACHI…………………………………………………………..……….385
La refondation de l’université africaine comme institution méritocratique : un impératif catégorique dans la quête de l’excellence,
Franck KOUADIO……………………………………………………………..………….399
Culture organisationnelle et excellence à l’Institut Supérieur du Génie Électrique du Burkina Faso (ISGE-BF)
Marcel ZERBO……………………………………………………..……………………..419
Le finalisme aristotélicien : une invitation à l’excellence pour nos universités africaines,
Arnaud-Olivier GNAHOUA………………………………………….………………….435
De la culture de l’excellence dans l’espace universitaire africain : réflexion à partir de la pensée de Njoh-Mouelle Ébénézer,
Zolou Goman Jackie Élise DIOMANDÉ…………………………………………..…447
Une auratisation de l’environnement académique peut-elle sauver l’université de la grisaille ?,
Masséké OPONOU………………………………………………..……………….…..…463
Conditions pour un excellent enseignement à l’université,
Niali Armand-Privat PILLAH……………………………………….………………..…477
CINQUIÈME AXE : SYNDICALISME, POLITIQUE ET VIOLENCE À L’UNIVERSITÉ……………………………………………………………………………497
La fin et les moyens : conséquences de l’auto-justification de la violence politique et syndicale dans les universités ivoiriennes,
Youldé Stéphane DAHÉ…………………………………………………………………499
La démocratisation des libertés chez Marx : une propédeutique à la pacification de l’espace universitaire ivoirien,
Jean-Joel BAHI……………………………………………………………………………515
Les universités ivoiriennes à l’épreuve de la violence des syndicats estudiantins,
1. Koffi Décaird KOUADIO 2. Alice KOUAKOU…………………………………….531
Le paradigme esthético-éducatif aristotélicien et schillérien face à la problématique de la violence dans l’espace universitaire ivoirien,
Koudou François OZOUKOU…………………………………………………….……545
La FESCI, ce boulet que porte l’université ivoirienne dans un élan de servitude volontaire,
Bledé SAKALOU……………………………………………………….…………………557
Violences en milieux universitaires : déterminisme et normativité d’un phénomène pernicieux en Côte d’Ivoire,
Tiasvi Yao Raoul AGBAVON………………………………………….……………….575
Les enjeux de l’art technologique dans les crises universitaires ivoiriennes à partir de la pensée de Walter BENJAMIN,
Barthelemy Brou KOFFI……………………………………………………………….589
Violences estudiantines syndicales en Côte d’Ivoire : entre revendications légitimes et délinquance,
Kouassi Marcelin AGBRA………………………………………..…………………….605
Les relations conflictuelles entre les syndicats et l’administration gabonaise. Cas du SNEC de 1991 à 2020,
1. Lucien MANOKOU 2. Nathalie EBANETH…………………………..……………621
SIXIÈME AXE : RESPONSABILITÉS ÉTHIQUES, PÉDAGOGIQUES ET ACADÉMIQUES DES UNIVERSITAIRES………………………………………….637
Décolonisation de la pensée : exigence de qualité académique,
Mafa Georges ASSEU…………………………………………………………………….639
Du modèle anthropologique canguilheméen : une thérapie à la crise de l’université en Afrique
Florence BOTTI………………………………………………………………..………….655
Le savoir ou la politique : la mission des universitaires africains en question,
Dotsè Charles-Grégoire ALOSSE………………………………..…………………….667
L’enseignement philosophique : un modèle d’étude exégétique pour une université en crise,
Chantal PALÉ-KOUTOUAN…………………………………………………………….683
L’enseignement dialectique platonicien : un guide d’éducation pour l’excellence universitaire,
Ange Allassane KONÉ…………………………………………………..……………….699
Autodétermination des peuples et censure : la fonction de l’université selon Kant,
Amidou KONÉ…………………………………………………………………………….715
Éthique de la discussion et crise de l’université en Afrique,
Cyrille SEMDE…………………………………………………………………………….731
SEPTIÈME AXE : INFRASTRUCTURES, TICE ET INNOVATION PÉDAGOGIQUE……………………………………………………………………………..745
TICE, déconstruction ou reconstruction technoscientifique de la crise des universités en Afrique subsaharienne ?,
Kouadio Victorien EKPO………………………………….…………………………….747
Le rôle de l’insuffisance des infrastructures dans la crise universitaire au Niger,
Abdou KAILOU DJIBO…………………………………………………….…………….761
Problèmes de logements d’étudiants et crises académiques à l’université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo,
1. Djibril KONATÉ 2. Foussata DAGNOGO…………………………………………783
HUITIÈME AXE : LIBERTÉS ET FRANCHISES UNIVERSITAIRES…797
Ontologie augustinienne et résolution des crises universitaires,
N’gouan Yah Pauline ANGORA épse ASSAMOI……………………………………799
NEUVIÈME AXE : UNIVERSITÉ ET DYNAMIQUE DES SOCIÉTÉS…811
La vocation de l’université en Afrique à la lumière du Conflit des facultés d’Emmanuel Kant,
Éric Inespéré KOFFI…………………………………………………………….……….813
De la décadence éthico-religieuse à la déconfiture institutionnelle des universités en Afrique : une analyse prospective,
Kouassi Honoré ELLA……………………………………………..…………………….829
Communication de crise et crises de fonctionnement dans les universités subsahariennes,
Faloukou DOSSO………………………………………………..……………………….847
Sociétés en crise et crise de l’université en Afrique : la culture comme recours dans la perspective de Paulin HOUNTONDJI,
Kouamé Hyacinthe KOUAKOU………………….…………………………………….863
La crise des universités africaines : le péril de l’éducation parentale,
Aya Anne-Marie KOUAKOU…………………………………………………………….879
Fondements et enjeux de la crise de l’université publique en Afrique noire : quels repères pour en sortir ?,
Bilakani TONYEME……………………………………………………………..……….895
Université et culture des valeurs morales chez les étudiants au Burkina Faso,
Bawala Léopold BADOLO………………………………………..…………………….911
Universités, enseignants-chercheurs : objectifs et implications socio-politiques en Afrique,
Cyrille MICKALA……………………………………………………..……………………927
Les universités dans le développement des sociétés africaines,
Adjoua Marie Jeanne KONAN……………………..……………………………………949
Le conservatisme platonicien, un possible remède à la crise de l’université,
Amed Karamoko SANOGO………………………………………………………………963
Crise des universités africaines comme crise de la rationalité,
Roland TECHOU………………………………………………………..…………………979
L’engagement des universitaires face aux réalités sociales chez Marcuse,
Amara SALIFOU………………………………………..……………………………..….995
Crise universitaire et défis éducationnels à partir de la pensée de Hobbes,
Amenan Madeleine Épouse Ekra KOUASSI…………..……………………………1011
Crise universitaire : impératif éthique bergsonien de libération de l’intellect,
Amani Albert NIANGUI………………………………………………….………….….1025
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
PREMIÈRE PARTIE : ALLOCUTIONS ET COMMUNICATIONS EN PLÉNIÈRE
I. ALLOCUTIONS
Allocution d’ouverture prononcée par Professeur Nicolas YÉO, Président du Comité d’organisation,
Monsieur le Président du Conseil Économique Social Environnemental et Culturel, Dr Eugène Aka Aouélé, Patron du colloque, représenté par Madame Kanaté ;
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Prof. Adama Diawara, Président du colloque ;
Monsieur le Ministre de la Promotion de la bonne Gouvernance et de la lutte contre la Corruption, Monsieur Épiphane Zoro Bi Ballo, Parrain du colloque ;
Monsieur le Maire de la Commune de Bouaké, M. Nicolas Djibo ;
Monsieur le Président de l’Université Alassane Ouattara, Prof. Kouakou Koffi ;
Madame la Directrice du Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU-Bouaké), Madame Brou N’goran ;
Madame et Monsieur les Vice-Présidents de l’Université Alassane Ouattara, Prof. Kodo Michel et Prof. Théoua Pelagie Epouse N’dri ;
Monsieur le Secrétaire général, Dr Berté Siaka, Maître de Conférences ;
Monsieur le Directeur de la Scolarité de l’Université Alassane Ouattara, Prof. Soro Donissongui ;
Messieurs le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société, Prof. Bamba Assouman, représenté par Monsieur le Vice-Doyen, Prof. Troh Deho Roger ;
Mesdames et Messieurs les Chefs de service ;
Messieurs les Chefs de département ;
Madame et Messieurs les experts nationaux et internationaux ;
Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs ;
Chers collaborateurs du Personnel Administratif et Technique de l’Université Alassane Ouattara ;
Mesdames et messieurs de la presse ;
Chers étudiants ;
Mesdames et Messieurs,
Le Colloque international pluridisciplinaire qui nous réunira pendant ces trois jours est particulier. En effet, c’est l’une des rares fois où, à l’image du serpent qui se mord la queue, non pas pour s’autodétruire, mais dans le sens d’une interprétation égyptienne, pour renaître et pour se régénérer, le Département de Philosophie de l’Université Alassane Ouattara a jugé nécessaire de rompre le silence. Dans cette perspective, il nous invite à réfléchir sur la thématique : « La crise de l’Université en Afrique : diagnostic et éléments de stratégies transversales ». C’est Professeur Boa Thiémélé qui, dans la revue Lettres d’Ivoire, invitait les Africains à apprendre à jeter un regard objectif sur eux-mêmes, dans le sens de la maxime socratique du « Connais-toi, toi-même ». Il écrivait : « En refusant de jeter un regard objectif sur nous-mêmes, nous courons le risque de maintenir des pratiques avilissantes ». En organisant ce colloque, le Comité d’Organisation espère des experts et participants, des analyses objectives et des propositions précises qui permettront de rehausser l’image de l’Université en Afrique. Les résultats et recommandations seront consignés, d’abord dans un bréviaire que nous remettrons aux autorités compétentes, puis dans un ouvrage collectif qui sera publié par la Revue du Département Perspectives philosophiques.
Mesdames et messieurs, le titre de ce Colloque est évocateur. En effet, en l’écoutant attentivement, plusieurs questions légitimes peuvent tarauder les esprits : Pourquoi les universités africaines n’occupent pas de rangs honorables dans le classement des universités ? Quelle solution doit-on mettre en œuvre pour faire face à la massification galopante des étudiants dans nos structures de formations académiques ? À quoi former les étudiants : formation académique ou formation professionnelle ? Formation courte pour le Master ou formation longue pour le Doctorat ? Comment résorber le problème de la violence dans nos espaces universitaires ? En tout état de cause, le faible niveau des étudiants (eux-mêmes éprouvés par les conditions d’études difficiles), la ruine de la mysticité et de l’autorité du maître, la violence dans l’espace académique, le caractère inhomogène des politiques publiques d’une université à une autre (parfois dans le même pays), l’insuffisance des ressources allouées à la recherche, sont autant de problème auxquelles le Comité d’Organisation attend des propositions de solution.
De toute évidence, ce colloque nous permettra d’éviter l’attitude peu planificatrice d’Épiméthée, ce titan non-prévoyant, qui, comme le souligne Arnaud Sorosina, ne réfléchit qu’après coup. Epiméthée, nous rapporte la mythologie, a accepté de Zeus la main de la belle Pandore, sans réfléchir, quoique son frère Prométhée lui ait conseillé de faire attention à la supposée générosité du roi des dieux. La fin de l’histoire est peu joyeuse. Du reste, à l’aube des temps mythiques, sans aucune analyse approfondie, Epiméthée dépensa, de manière inconsidérée, toutes les qualités, aux dépens de la race humaine. Aujourd’hui, participant à ce colloque, nous voulons nous garder de reproduire ces erreurs d’Epiméthée. Nous n’avons le droit d’être coupables de manque d’anticipation et, par ricochet, de misanthropie, en faisant l’impasse sur les insuffisances de nos systèmes académiques.
Cela dit, il ne s’agit pas, pour nous, d’ouvrir ici la boîte de Pandore. L’on sait, en effet, d’Hésiode que, Pandore, la première femme humaine façonnée par Zeus, ne fut qu’un moyen de vengeance contre l’humanité. Pour atteindre cette fin, Zeus conçut la belle Pandore et lui offrit une boîte chargée de tous les maux, et lui donna l’instruction de ne jamais l’ouvrir. Cédant à la curiosité, Pandore ouvrit malheureusement la boîte, laissant les maux se répandre dans le monde, à l’exception de l’espérance. Le Colloque n’est pas le moment espéré du déclenchement des foudres de la colère envers et contre tous. Il n’est pas l’occasion toute trouvée de fustiger et de se venger contre maîtres, responsables académiques et autorités politiques. Loin s’en faut.
Au contraire, celui qui doit nous inspirer, c’est bien Prométhée, le clairvoyant. Ceux qui ont lu le Protagoras de Platon se souviennent que, par humanisme, Prométhée subtilisa le feu de la forge d’Héphaïstos qu’il mit à la disposition de l’homme. Ce seul élément dérobé aux dieux changea, du tout au tout, la place de l’homme dans la nature. Il s’agit, concrètement, pour nous, au moyen de la métis grecque, de faire un diagnostic clair et objectif de la crise de notre institution commune et de proposer des solutions de sortie de crise, afin de changer qualitativement la place de l’Université africaine et de ses animateurs.
Je ne ferai pas le colloque avant le colloque. Qu’il me soit alors permis, à ce stade de mon propos, d’adresser mon infinie reconnaissance au chef du Département, le professeur Traoré Grégoire. En effet, désigné à ce poste par l’ancien chef de Département, Professeur Fié Doh Ludovic, à qui je rends un vibrant hommage, Professeur Traoré a accepté de m’offrir l’opportunité de conduire les travaux de l’organisation de cette activité scientifique jusqu’à son terme. Je lui dois plus qu’une simple reconnaissance. Merci Professeur.
Je manquerai à un devoir si je ne salue pas l’immense travail abattu par toute l’équipe d’organisation. Que chacun des membres de ce dynamique et fraternel groupe, trouve ici l’expression de ma profonde gratitude. Aux autorités, tout protocole respecté, à nos maîtres et experts d’ici et d’ailleurs, à tous les collègues, à tous les contributeurs, aux syndicats d’enseignants et d’étudiants, à nos étudiants, en un mot, à tous les participants, je dis merci d’avoir accepté, aujourd’hui, de prendre part aux assises de cette activité scientifique. L’œuvre humaine est frappée du sceau de l’imperfection, nous en sommes bien conscients. Aussi, le comité d’organisation voudrait-il humblement s’excuser auprès de tous pour les insuffisances constatées et subies. Nous nous engageons, avec détermination, à corriger ce qui peut l’être pour une meilleure tenue de ce colloque.
Mesdames et Messieurs, nous devons la tenue effective de cet évènement scientifique aux appuis multiformes du Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation (FONSTI), à la facilitation des autorités de notre institution dont le premier responsable est le Prof. Kouakou Koffi, au soutien de notre ministère de tutelle dirigé par le Professeur Adama Diawara, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à l’accompagnement de notre Parrain, Monsieur le Ministre Epiphane Zoro Bi Ballo et, par-dessus tout, à l’appui institutionnel du Président du Conseil Economique, social, Environnemental et culturel. En attendant que des voix plus autorisées que la mienne ne viennent leur exprimer notre reconnaissance, permettez-moi de leur merci du fond du cœur.
Tel est mon dernier propos.
Je vous remercie !
Allocution d’ouverture prononcée
par le chef du Département de Philosophie, Professeur TRAORÉ Grégoire
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Monsieur le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel ;
Monsieur le Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption ;
Monsieur le Maire de la commune de Bouaké ;
Monsieur le Président de l’Université Alassane Ouattara ;
Monsieur le Doyen de l’UFR – Communication, Milieu et Société ;
Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de services ;
Chers étudiants ;
Chers amis de la presse ;
Mesdames et Messieurs, Honorables invités en vos rangs, grades et qualités,
Au nom du Département de philosophie, je voudrais vous dire, au-delà de ce que je saurai exprimer, mes sincères remerciements pour votre présence effective, massive et distinguée qui montre tout l’intérêt que vous avez bien voulu accorder à ces assises qui s’ouvrent, aujourd’hui, à l’Université Alassane Ouattara. La « crise de l’Université » fait partie des problématiques des temps modernes qui exigent des solutions immédiates tant elle touche au fondement même des Institutions qui donnent sens à la dynamique sociale.
C’est peu dire que l’air du temps est à l’inquiétude. Les crises sont légion et ont la particularité d’être la plupart du temps mondiales en raison de l’interdépendance des États, mais plus encore de l’interconnexion des espaces et des écosystèmes vivants. Edward Lorenz, pouvait éloquemment dire à propos qu’un battement d’ailes d’un papillon au Brésil provoque une tornade au Texas ou que le conflit en Ukraine peut avoir des conséquences en Côte d’Ivoire. Si ce constat est révélateur d’une logique implacable qui gouverne les choses, il est surtout représentationnel de la remise en cause du fond déterministe sur lequel repose la connaissance rationnelle. Le fait est que, les crises ne sont plus extérieures au processus de socialisation si bien que l’on ne peut plus les imputer uniquement aux phénomènes naturels. Elles font même corps avec ce processus de sorte que toute action peut bien déboucher sur une crise inattendue. Nous vivons ainsi dans une époque où les crises ne viennent pas de l’extérieur troubler la quiétude de la société. De nature endogène, en général, elles sont fabriquées par la société elle-même. Nos sociétés, en effet, sont de véritables fabriques crisogènes.
Si la crise est, cependant, ce moment de rupture, de malaise, parfois un tournant périlleux qui peut aussi introduire un changement de vision, une orientation nouvelle avant que d’aboutir tout de même à une issue heureuse, une réelle démarche votive à la recherche de solutions idoines doit s’imposer. C’est donc à juste titre que l’alma mater, que dis-je, l’Université, en tant qu’Institution qui contribue à l’autoréflexion de la société, mobilise, en ce jour, ses acteurs afin qu’ils fassent l’anamnèse des maux ainsi que leurs métastases qui sapent ses propres fondements et valeurs. Mesdames et Messieurs, ces acteurs rompus à la bonne réflexion, ces philosophes de qualité et bon goût ne sont-ils pas comme pouvait le dire Émile Zola « ces actifs ouvriers qui sondent l’édifice sociale, en indique les poutres pourries, les crevasses intérieures, les pierres descellées, tous ces dégâts que l’homme lambda ne voit pas du dehors et qui pourtant peuvent entraîner la ruine du monument social entier ?
L’Université, depuis quelques décennies, est appelée à répondre à de nouveaux et grands défis en termes d’éducation, de recherche et de gouvernance liés souvent à la massification du nombre d’apprenants et à leur dissémination à travers le monde, à la mutation rapide des sociétés, à l’évolution de l’état d’esprit de la jeunesse et à l’inadaptation du système d’enseignement aux exigences modernes. Caractéristique des temps modernes, la crise de l’Université, peu importe l’espace où elle prend forme, doit nécessairement faire l’objet d’une analyse critique de la part des universitaires et particulièrement des universitaires africains, car en Afrique, elle semble prendre l’aspect d’une nébuleuse. Ce colloque vient donc à propos pour faire un état des lieux des crises répétées qui secouent nos sociétés, qui ralentissent leur développement. Ce colloque a pour ambition de mettre en évidence les défis et trouver les solutions susceptibles de conduire les États sur la voie d’une gestion durable, dynamique et responsable des Universités africaines. Il proposera, je l’espère pour ma part, une réflexion constructive sur de nouvelles perspectives heuristiques de qualité universitaire ; sur l’implication de nos Universités africaines dans la construction à court, moyen et long terme de nos Institutions gouvernantes et dirigeantes.
Mesdames et Messieurs, la centralité thématique de ce colloque qui nous réunit, porte au total sur « La crise de l’Université en Afrique ». Nous sommes tous, panélistes et partenaires extérieurs, appelés à trouver à partir de ce colloque des solutions pour sauver la situation de léthargie inquiétante de l’Université source de crises qu’elle traverse dans les pays africains. Poser un diagnostic sur la situation de l’Université en Afrique impose de pouvoir déceler les maux qui la rongent, mais surtout de situer les responsabilités. Un tel acte est d’une grande portée puisque l’Université, en tant que cadre d’élaboration et de partage des connaissances, est également le lieu de préparation de la société de demain. En envisageant la recherche de solutions sous l’angle de la transversalité ou du moins de l’interdisciplinarité, nous pensons que cet acte est solidaire d’une vision globale caractérisée par l’implication mutuelle des œuvres que l’on peut qualifier de l’esprit d’avec celles de la société. Une telle globalité est déjà à l’œuvre dans le réinvestissement social des recherches et réflexions issues des Universités, de sorte que l’on arrive à la logique suivante : l’évolution des sociétés impacte la marche de l’Université et la marche de l’Université impacte la société. En d’autres termes, la crise de l’Université a des impacts sur la société et les crises sociales ont des répercussions sur l’Université. Par conséquent, penser la crise de l’Université revient à panser la société. Je suis donc convaincu que nous aurons des résultats satisfaisants au regard de la qualité des différents contributeurs qui ont bien voulu apporter leurs idées pour panser la crise de l’Université en Afrique.
Je voudrais très chaleureusement, en ma qualité de Directeur de Département, d’une part, en tant que coordonnateur général des activités de ce colloque, d’autre part, exprimer ma gratitude à nos invités de marque ainsi qu’à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Je voudrais aussi remercier avec encore beaucoup d’enthousiasme et de chaleur le Président du Comité d’Organisation (PCO) de ce rassemblement scientifique pour avoir œuvré généreusement et efficacement au bénéfice de cet évènement, ô combien utile à nos Institutions, à toutes les Universités africaines ainsi qu’à nos décideurs socio-politiques africains. Nos remerciements vont aussi à tous nos partenaires, à tous nos collègues, nos maîtres, venus ici pour échanger sur un sujet aussi important.
Je vous remercie et souhaite, à tous, un très bon séjour scientifique.
Allocution d’ouverture prononcée par
le représentant du Professeur BAMBA Assouman,
Directeur de l’UFR – CMS
Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil Economique, Social, Environnement et culturel, Haut patron de la cérémonie ;
Monsieur le représentant de Monsieur le Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, parrain de la cérémonie ;
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de la région de Gbêkê ;
Madame la représentante de Madame le Député ;
Madame la représentante de Monsieur le Maire de la Commune de Bouaké ;
Mesdames, Messieurs les Présidents d’Université ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs et chefs de service ;
Monsieur le Chef du Département de Philosophie ;
Mesdames, Messieurs les communicants et panélistes ;
Mesdames Messieurs Enseignants-Chercheurs et Chercheurs ;
Mesdames, Messieurs les membres du Personnel Administratif et Technique ;
Mesdames, Messieurs, étudiantes et étudiants ;
Mesdames, Messieurs, amis de la presse ;
Honorables invités ;
En vos rangs, grades et qualités tout protocole respecté ;
Mesdames, Messieurs,
Le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société, Professeur BAMBA Assouman, lui-même enseignant-chercheur au département de philosophie, aurait voulu être des nôtres, à l’entame de ce colloque. Mais en mission à Abidjan, il nous rejoindra avant la fin des travaux. Etant donné qu’il m’a chargé de m’adresser à vous, en son nom, il se fait présent, autrement, car, en réalité, « celui qui parle est sans absence ». En sa qualité de premier responsable de l’UFR dont les locaux abritent le présent colloque, il voudrait, avant toute chose, féliciter le Département de Philosophie avec, à sa tête, Professeur TRAORE Grégoire, pour avoir pris l’initiative d’organiser un colloque sur l’Université et dire sa joie d’accueillir l’évènement.
Vous l’aurez sans doute compris, il n’y a pas d’Université, d’UFR, de Département et, partant, d’enseignants-chercheurs dignes de ces noms sans activités de recherche de l’envergure des colloques et autres rencontres de ce type. Les autorités de l’Université Alassane Ouattara, en général, et celles de l’UFR, en particulier, se réjouissent donc de la tenue du présent Colloque international et pluridisciplinaire qui interroge la « crise de l’Université en Afrique ». L’UFR Communication, Milieu et Société est d’autant plus heureuse qu’organiser un colloque sur « la crise de l’université » qui se nourrit souvent de « crises à l’université », relève du courage.
L’Université est, selon une périphrase bien connue, « le temple du savoir ». Elle est donc destinée à penser le monde, non pas de façon hédonique, mais aux fins d’en panser les lésions et autres meurtrissures. C’est au nom de cette mission de l’Université que les différents spécialistes qui l’animent, chacun suivant sa science, tentent d’apporter leur part de solution aux nombreux défis qui assaillent notre monde d’aujourd’hui et qui, entre autres, ont pour noms : réchauffement climatique, terrorisme, crise économique, immigration clandestine, développement durable, pression foncière, conflits intercommunautaires, chômage, etc.
Ce faisant, l’Université, en général, et les universités africaines, en particulier, sont dans leur rôle dans le sens où les nombreux colloques que nous avons vu passer ici, à l’Université Alassane Ouattara et ailleurs nous semblaient relever de l’évidence, à tout le moins, des préoccupations habituelles des universitaires. Le courage des organisateurs du présent colloque est d’autant plus réel qu’il s’agit, cette fois-ci, pour les penseurs du monde, de se faire objet de leurs propres discours, de diagnostiquer leurs propres maux et d’en proposer les remèdes. J’ai lu ceci dans l’argumentaire du colloque : « Malgré les réformes institutionnelles entreprises par le politique, malgré les études d’institutions techniques et autres experts, la crise de l’Université africaine persiste. D’où la nécessité de repenser, à nouveaux frais, cette crise. Tel est l’objet de ce colloque sur la crise de l’Université africaine. »
S’il est conseillé au chercheur de se tenir à distance de son objet d’étude pour le cerner, avec plus d’objectivité, un Colloque sur l’Université par des universitaires peut être objet de suspicion légitime. À l’image d’un blessé qui soigne ses propres blessures, les contributeurs pourraient s’appliquer les remèdes avec une telle délicatesse que leur guérison en pourrait être différée. Mais conscients de ce que pareille attitude pourrait mettre en péril la survie du penseur et celle de la pensée elle-même, les universitaires venus d’horizon divers, c’est-à-dire aussi bien des universités ivoiriennes que des universités du Niger, du Burkina Faso, du Congo Brazzaville, du Mali, du Bénin, du Cameroun, du Tchad, de la Belgique vont, nous en sommes convaincu, dire la science, poser le vrai diagnostic et proposer des « éléments de stratégies transversales » pour que les universités africaines puissent pleinement impulser le développement.
Les enjeux de ce Colloque sont aussi les nôtres en tant qu’UFR, mais aussi et surtout en tant qu’université. En effet, notre Université, l’Université Alassane Ouattara, qui entend porter et habiter son nom, met progressivement en place les outils nécessaires pour son positionnement dans le concert des universités. Le Plan d’Orientation Stratégique, la Cellule qualité, le Manuel de procédure sont, entre autres, des marches de l’échelle qui nous conduira, assurément, au sommet.
Avant de me réduire au silence, je voudrais dire aux organisateurs du présent colloque que leur belle initiative sonne, pour eux, comme un défi. On entend souvent dire, plus à tort qu’à raison, que nos recherches ne servent à rien, qu’elles tournent en circuit fermé entre nous, sans réel impact sur la société qui pensait pourtant que l’Université était son laboratoire à solution. Mais ce Colloque à ceci de particulier, comme je l’ai mentionné plus haut, que l’Université se pense elle-même, par elle-même et pour elle-même. Autrement dit, on ne comprendrait pas que les « stratégies transversales » proposées par les contributeurs ne soient pas appliquées par nous et pour nous, les universitaires. Le rapport dit « de synthèse » du présent Colloque et les Actes qui suivront seront, c’est notre souhait, aussi bien pour les acteurs que pour les décideurs, des documents précieux à consulter et à exploiter.
Je vous remercie !
Allocution d’ouverture prononcée par Madame TEHOUA Pélagie, Vice-présidente de l’Université Alassane OUATTARA, Représentant Monsieur Kouakou KOFFI, Professeur des Universités, Président de l’Université Alassane OUATTARA
Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et culturel, Haut patron de la cérémonie ;
Monsieur le représentant de Monsieur le Ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, parrain de la cérémonie ;
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de la région de Gbèkè ;
Madame la représentante de madame le Député ;
Madame la représentante de Monsieur le Maire de la Commune de Bouaké ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs et chefs de service ;
Monsieur le Chef du département de philosophie ;
Madame, Monsieur les communicants et panélistes ;
Mesdames et Messieurs les Enseignants-chercheurs et Chercheurs ;
Mesdames et Messieurs les membres du Personnel administratif et technique ;
Mesdames et Messieurs étudiantes et étudiants ;
Mesdames et Messieurs de la presse ;
Honorables invités ;
En vos rangs, grades et qualités tout protocole respecté ;
Mesdames et messieurs,
J’ai l’insigne honneur de prendre la parole au nom du Président de l’UAO, le professeur Koffi KOUAKOU, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue dans notre université, dans le cadre de ce rendez-vous intellectuel organisé par le département de philosophie de l’UFR/CMS de l’UAO.
Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et culturel, haut patron de cette cérémonie, toujours au nom du président de l’UAO, j’exprime toute la reconnaissance de notre communauté universitaire pour l’honneur que nous fait, à travers vous, Monsieur le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et culturel, de rehausser l’image de ce rendez-vous scientifique. Votre présence remarquable et remarquée témoigne de l’accompagnement sans faille de nos autorités à la communauté universitaire.
C’est le lieu pour moi de vous exprimer, Madame, Madame et Monsieur les représentants du Préfet de région, du maire de la commune de Bouaké, honorables invités, les profonds regrets du Président de l’UAO qui n’a pas pu être présent, étant en déplacement.
Je puis néanmoins vous assurer de sa déférence à votre égard et de l’intérêt qu’il porte à cette importante rencontre scientifique.
Honorables invités, mettre en place un enseignement supérieur de qualité a toujours été, depuis les indépendances, au cœur des préoccupations du Gouvernement ivoirien.
La Côte d’Ivoire bénéficie en cela d’un système d’enseignement supérieur en perpétuelle mutation et croissance. Grâce aux efforts constants du Gouvernement, l’écosystème de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire s’est enrichi de plusieurs plans interministériels de développement ayant conduit, entre autres, à l’élaboration d’une Politique nationale de l’enseignement supérieur, à la création de plusieurs universités, à la rénovation et l’équipement des universités existantes, nonobstant la décennie de crise ayant fragilisé les universités et le système d’enseignement supérieur. L’institutionnalisation des contrats d’objectifs pour améliorer le fonctionnement de nos universités prend de plus en plus forme. Notre pays fait également partie de ceux qui, dans la sous-région, investissent le plus dans le secteur Éducation/Formation.
C’est donc le lieu de saluer tous les efforts du gouvernement avec à sa tête SEM le Président de la République, pour rendre nos universités compétitives et innovantes.
Cet élan de satisfaction n’empêche pas, cependant, la réalité des difficultés, des pressions, des tensions de toutes sortes, des grèves, constituant à la fois les manifestations de dysfonctionnements et des menaces permanentes à l’instauration d’un système d’enseignement supérieur de qualité.
Remobiliser les forces vives de l’enseignement supérieur, maintenir dans la pérennité le dialogue social en recentrant, avec réalisme, tous les acteurs sur les enjeux collectifs, avec un objectif d’efficacité collective, faire des espaces universitaires des espaces pacifiés offrant des formations en adéquation avec les offres d’emploi, tels demeurent quelques défis à relever.
Un regard vers les universités sœurs dans d’autres États africains, notamment ceux du système CAMES, permet de se rendre compte que nous partageons presque les mêmes difficultés et défis.
Point donc besoin de souligner l’intérêt du présent colloque initié par le département de philosophie avec pour thème : « La crise de l’Université en Afrique : diagnostic et éléments de stratégies transversales ».
Certainement oui, il y a des thématiques qui sont importantes à plus d’un titre parce qu’elles touchent l’essence de notre vécu, et la manière dont nous les traitons conditionnent notre présent et notre devenir. Je pense que celle autour de laquelle nous réunit le département de philosophie en fait partie. Elle nous invite, en effet, dans une démarche participative, à faire sans complexe un état des lieux de la situation dans nos universités, ayant vocation à former les élites de demain, et de proposer des pistes de solutions.
C’est pourquoi, votre présence, Madame la Vice-présidente du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, Président de cette illustre institution assurant la représentation des principales activités économiques et sociales et contribuant à l’élaboration de la politique économique et sociale de notre pays. Votre présence nous honore autant qu’elle nous rassure que les conclusions de ce colloque seront portées au plus haut niveau de l’État. Nous vous en remercions.
Monsieur le représentant de Monsieur le Ministre de la promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, l’UAO vous remercier d’avoir associé votre image à ce rendez-vous scientifique. Votre présence est une confirmation de l’engagement du Gouvernement, portée de manière spécifique par monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui préside cette cérémonie, de hisser notre système d’enseignement supérieure aux hauteurs de l’excellence.
Nous nous réjouissons également d’avoir, avec nous, nos autorités politiques et administratives locales, Monsieur le préfet région, Monsieur le maire, nous ne vous remercierons jamais assez pour votre appui constant aux activités scientifiques de l’UAO.
À vous, chers Professeurs, Enseignants-chercheurs et Chercheurs, chers communicants et participants, venus de l’extérieur du pays ou des autres contrées ivoiriennes, l’UAO vous remercie de vos inestimables contributions tant attendues.
Tous, le Président de l’UAO me charge de vous dire que vous êtes chez vous à l’UAO. Il est d’autant plus réjoui de votre présence que vos communications et travaux viendront non seulement enrichir le grenier de connaissance de notre communauté universitaire, mais plus encore ils permettront aussi de présenter à nos gouvernements respectifs des réflexions qui pourront servir de référence à la prise de décisions.
À présent, qu’il me soit permis de féliciter les organisateurs (le département de philosophie) pour cette belle initiative, de saluer la mobilisation de nos étudiantes et étudiants venus marquer leur intérêt à la présente rencontre.
Sur ces mots, au nom du Président de l’UAO, je souhaite à toutes et à tous un très bon colloque.
Je vous remercie !
Allocution d’ouverture de Madame la représentante de Monsieur DJIBO Youssouf Nicolas, Maire de Bouaké
Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, Haut patron de la cérémonie ;
Monsieur le représentant de Monsieur le Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Parrain de la cérémonie ;
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de la région de Gbèkè ;
Madame la représentante de Madame la Députée de Bouaké ;
Messieurs les Présidents Honoraires d’universités ;
Madame et Messieurs les Présidents d’universités ;
Messieurs les Directeurs et Chefs de service ;
Monsieur le Chef du Département de philosophie ;
Mesdames, Messieurs les communicants et panélistes ;
Mesdames, Messieurs les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs ;
Mesdames, Messieurs les membres du Personnel administratif et technique ;
Mesdames, Messieurs les Étudiantes et Étudiants ;
Mesdames, Messieurs les amis de la presse ;
Honorables invités ;
En vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté ;
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, à cette entame de mon propos, vous traduire ma joie d’être encore aujourd’hui à l’université Alassane Ouattara, lieu d’où l’on ressort toujours enrichi.
À tout un chacun, je voudrais transmettre les chaleureuses salutations du Maire DJIBO Youssouf Nicolas et, par ricochet, souhaiter la cordiale bienvenue à tous les éminents Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des pays amis et frères qui ont effectué le déplacement à Bouaké à l’occasion de ce colloque international pluridisciplinaire. Quoi de plus normal que la ville du brassage ethnique et culturel par excellence dont la devise est : « De nombreux peuples, une cité », abrite un colloque international pluridisciplinaire ? Nous sommes très heureux de vous recevoir chers frères et sœurs. AKWABA, Bienvenue à tous !
N’hésitez surtout pas de profiter de notre gastronomie à la fois délicieuse et variée ainsi que de nos sites de loisirs paradisiaques naissants, en marge de ce banquet scientifique.
« Quand l’on ramasse les fruits du grand arbre par terre, il faut remercier le vent qui en est la cause », dit une sagesse de chez nous. Je voudrais donc, au nom du Maire DJIBO Youssouf Nicolas, saluer les organisateurs de ce colloque international pluridisciplinaire, notamment, le Département de philosophie de l’Université Alassane Ouattara, ainsi que toutes les personnes de bonnes volontés qui y ont contribué.
Nous sommes convaincus que la mise en pièces du thème de ce colloque, « La crise de l’université en Afrique : diagnostic et éléments de stratégies transversales », fournira des résultats probants afin de contribuer au mieux-être des Universités africaines, en général, et de celle de Bouaké, en particulier.
C’est sur cette note d’espérance que je voudrais clore mon propos, tout en souhaitant un excellent colloque à l’ensemble des participants.
Je vous remercie de votre aimable écoute !
Allocution d’ouverture prononcée par Monsieur BOTI Bi Zoua, représentant Monsieur ZORO Bi Ballo Épiphane, Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Parrain de la cérémonie
Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, Haut patron de la cérémonie ;
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de la région de Gbèkè ;
Madame la représentante du Maire de Bouaké ;
Madame la représentante de Madame la Député de Bouaké ;
Messieurs les Présidents Honoraires d’universités ;
Madame et Messieurs les Présidents d’universités ;
Messieurs les Directeurs et Chefs de service ;
Monsieur le Chef du Département de philosophie ;
Mesdames, Messieurs les communicants et panélistes ;
Mesdames, Messieurs les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs ;
Mesdames, Messieurs les membres du Personnel administratif et technique ;
Mesdames, Messieurs les Étudiantes et Étudiants ;
Mesdames, Messieurs les amis de la presse ;
Honorables invités ;
En vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté ;
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, avant toute chose, vous demander de bien vouloir excuser Monsieur le Parrain, le Ministre ZORO Bi Ballo Épiphane qui n’a pu effectuer le déplacement jusqu’à Bouaké pour des contraintes majeures. Il m’a chargé de le représenter à ce forum scientifique.
Je voudrais vous exprimer ma joie de parrainer cette activité hautement scientifique qui réunit aussi bien des hommes du monde scientifique africain que ceux de l’international. Cela démontre qu’il y a, et qu’il y aura toujours des personnes dignes qui œuvrent pour le développement des sciences de façon générale et en particulier par celles dites sociales ou humaines pour le développement de notre continent.
Ce colloque, qui a pour thème « La crise de l’université en Afrique : diagnostic et éléments de stratégies transversales », interpelle le monde entier à plus d’un titre. Cette thématique est l’une des préoccupations les plus mouvantes à l’échelle mondiale. Nous en attentons, à l’issue de ce colloque, les Actes et, soyez rassurés qu’il en sera fait bon usage.
Je tiens à féliciter les organisateurs de ce colloque qui arrive à point nommé dans une ère où l’on constate de nombreux dérapages dans nos structures universitaires. Encore une fois, félicitations à nos hommes qui croient en la science ! Félicitations pour votre courage à dénoncer ces insuffisances ! Félicitations à l’ensemble des étudiants ici présents !
Si vous êtes là, nous pensons que c’est pour une bonne cause, car l’ambition première de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire, c’est de contribuer au développement de notre chère patrie. C’est pour cela que j’invite tous les étudiants de l’Université qui porte le nom de notre Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à être des « modèles » afin que leur formation intellectuelle puisse véritablement leur offrir de grandes portes de sortie, et que l’excellence, à l’image de notre Président de la République, se retrouve, ici, à l’UAO.
Suivant la dénomination du département ministériel de Monsieur le Parrain, à savoir le Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, je vous rassure, au nom de Monsieur le Ministre, que les jeunes étudiants ivoiriens ont de l’avenir et cela ne peut se concrétiser qu’en apprenant dans un esprit harmonieux et solidaire les uns des autres. Sachez, ici et maintenant, chers étudiants que le gouvernement de Côte d’Ivoire travaille pour qu’à partir de vos acquis, le rêve de l’émergence soit une réalité.
Avant de terminer, j’adresse les remerciements du Ministre à toutes les bonnes volontés qui ont apporté leurs aides pour l’organisation de ce colloque, notamment ;
- Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, représenté par la première Vice-présidente Mme KANATÉ
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- La Présidence de l’Université Alassane Ouattara
- Le FONSTI et tous les autres partenaires.
Tout en vous remerciant pour votre présence et votre implication dans les différentes activités académiques, je tiens à vous encourager pour que règne un véritable climat de paix et d’entente sur nos campus universitaires.
Vive l’Enseignement supérieur ivoirien pour que vive le savoir en Côte d’Ivoire.
Je vous remercie !
Allocution d’ouverture prononcée par Madame KANATÉ, représentant Dr Eugène AKA AOUÉLÉ, Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC)
Avant tout propos, je voudrais souligner que le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, aurait bien voulu marquer de sa présence, la cérémonie d’ouverture de ce Colloque international, auquel il accorde un grand intérêt. Pour des contraintes majeures, il m’a chargé d’un message, que je m’en vais, maintenant, vous délivrer.
Mesdames et messieurs, c’est un agréable plaisir, pour moi, de prendre part à la cérémonie d’ouverture de ce Colloque international organisé, ici, à Bouaké, par le Département de Philosophie de l’Université Alassane Ouattara. Je me réjouis d’être dans cette coquette cité : Bouaké, ville chargée de symboles dont l’un des plus remarquables est le stade de la paix, qui vient d’être majestueusement réhabilité.
Un autre symbole, et non des moindres, est cette illustre institution qui m’accueille et dont le nom à lui tout seul, est assez évocateur : je veux parler de l’Université Alassane Ouattara, ce haut lieu académique dont le dynamisme, à l’instar de l’auguste personnalité dont il porte le nom, n’est plus à démontrer.
C’est au compte de ce dynamisme qu’il y a lieu de mettre l’organisation du présent colloque qui rassemble, ce jour, de hautes expertises venues de partout. Je voudrais saluer toutes les éminentes et distinguées personnalités politiques, administratives et universitaires qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre.
Je salue les responsables du Département de Philosophie, pour la part qu’ils ont décidé de prendre dans la réflexion sur les crises qui secouent le monde universitaire et les solutions qui sont susceptibles d’être apportées, à l’effet de les juguler.
Cela dit, peut-on dire que ce colloque est de trop ? Cette question nous semble mal à propos, car considérée d’un point de vue formel et in abstracto, il n’y a jamais un colloque de trop pour les universitaires, pour qui, les colloques devraient être ce que le sang est à l’organisme.
Par ailleurs, en considérant la question d’un point de vue matériel, in concreto, ce colloque dont le thème est : « La crise de l’Université en Afrique : Diagnostic et éléments de stratégies transversales », nous semble de la plus haute importance et de la plus haute pertinence. Mais en quel sens ?
Cette rencontre nous semble de la plus haute importance, dans la mesure où l’enseignement supérieur, à travers l’institution universitaire qui l’incarne, est conçu pour être au service du développement des États et des sociétés. En effet, l’université, tel un miroir, place les États en interface direct avec leurs avenirs, par leurs capacités à assurer à leurs jeunesses, une formation adéquate, leur permettant de se hisser à la pointe de l’innovation techno-scientifique et, ainsi faire face aux défis d’un environnement globalisé et rudement concurrentiel.
Mesdames et messieurs, ainsi que vous pouvez le constater, la bonne santé de l’enseignement supérieur et, partant, de l’Université, apparait comme un indicateur de performance, comme le baromètre qui permet de suivre, en temps réel, les aspirations légitimes au développement, de nos États.
De toute évidence, les persistants soubresauts et les dysfonctionnements, enregistrés durant ces dernières décennies au sein de nos différentes universités du continent africain, semblent véhiculer un message sans ambages, à savoir que l’Université ne va pas bien.
Prendre conscience de cet état de fait et mener des réflexions sur la crise de l’Université en Afrique, nous paraît indiqué. Le thème, donc, qui nous réunit ce matin, par le rôle capital que l’institution universitaire est appelé à jouer dans les États africains, parait de la plus haute importance.
Aussi, est-ce volontiers, que j’ai accepté d’accorder mon patronage à ces assises, qui, comme on pourrait s’en douter, ont tout d’une catharsis impliquant un processus salutaire de remontée de la pente et de la restauration de l’Université.
Mesdames et messieurs, face à ce qui passe pour être un véritable problème de société, c’est ensemble, dans une synergie d’actions impliquant toutes les parties prenantes, allant des pouvoirs publics aux différentes composantes de nos sociétés civiles sur le continent, que nous parviendrons à relever ce défi.
C’est pourquoi, je voudrais saluer la clairvoyance et la justesse de vue des organisateurs de ces assises. L’adage ne dit-il pas qu’un mal diagnostiqué est à moitié soulagé ? Je ne doute pas, un seul instant, que les différentes contributions visant à cerner et à circonscrire le Colloque, fruits de réflexions affutées à la hauteur des enjeux, produiront les résultats escomptés. Les résultats de vos travaux sont donc attendus pour une meilleure performance de l’Université en Afrique. C’est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et déclarer, ouvert, le Colloque international sur la crise de l’Université en Afrique.
Tel est le message que m’a demandé de vous transmettre, monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène AKA AOUÉLÉ.
Je vous remercie !
Allocution de clôture prononcée par
Monsieur Lazare POAMÉ, Professeur des Universités,
Président honoraire de l’Université Alassane Ouattara
Honorables invités,
Chers collègues Enseignants-chercheurs,
Mesdames et Messieurs,
Ce colloque a été l’occasion de faire entendre de façon polyphonique et symphonique les voix des universitaires, préoccupés à la fois par le devenir des universités, par les transformations du savoir lui-même et le poids de la parole universitaire, alliage du scientifique et du déontologique, du logos et de l’éthos.
L’évocation de la parole universitaire, au terme de ce colloque initié par des philosophes, est l’occasion de rappeler la spécificité du dire philosophant, caractérisé par l’esprit critique qu’il faut s’empresser de distinguer de l’esprit de critique, réputé pour son étroitesse déconcertante. L’esprit critique, en portant la marque de l’autocritique, de l’autoréflexion et de la co-construction quasi-socratique, est l’un des phares secourables nécessaires pour diagnostiquer et surmonter rationnellement la crise de l’université. C’est cet esprit qui a fécondé, entre autres, la crisologie d’Edgar Morin dont on retiendra, pour le sujet qui nous réunit, la méthode d’observation critique et quasi clinique doublée d’une déontologie.
Cette rencontre scientifique a le mérite d’avoir amené les uns et les autres à échapper aux condamnations de leur conscience en adoptant une posture humaniste en direction de notre maison commune, l’université dans laquelle nous sommes appelés à passer la majeure partie de notre existence.
Penser à l’université en pensant l’université, c’est lui appliquer le pansement ontique et ontologique produit par les catégories héritées de la pensée pensante à l’effet d’assurer sa survie dans un monde enclin à la condamner à la simple survivance.
En effet, l’université doit vivre et non s’accommoder d’une morne survivance. Elle doit vivre conformément à son essence et à ses nécessaires transformations existentielles qu’impose la mondialisation et que l’humanité, plus spécifiquement l’Afrique, ne parvient pas à colliger adéquatement.
La crise des universités africaines, selon notre perception, est la manifestation d’une colligation ratée de l’essence de l’université et des besoins existentiels qui trouvent leur apothéose dans le socio-économiquement désiré et le scientifiquement performant.
L’essence de l’université peut être cherchée dans le principe de raison auquel nul ne peut se soustraire, dans le savoir qui récuse sans excuse ni accusation, dans le savoir savant et l’ignorance savante de Socrate. L’université comme lieu de production de ce type de savoir n’est donc pas à confondre avec un établissement postsecondaire.
La pensée de la crise de l’université doit donc, avant tout, s’enraciner dans l’essence de celle-ci sans donner dans un essentialisme obtus.
Mais cette crise ne peut être surmontée sans une conscience généralisée de l’excellence tridimensionnelle qu’il faut considérer comme une totalité insécable :
- L’excellence académique qui repose sur la qualité de la formation et de la recherche ainsi que la qualité des infrastructures universitaires à caractère scientifique et social ;
- L’excellence irénologique qui doit permettre de congédier scientifiquement, au sens large de Wissenschaft, le pathos activiste au profit de la recherche coopérative de l’idéal pacifiste et pacificateur de l’espace universitaire ;
- L’excellence managériale qui implique :
- une gestion rationnelle des ressources financières et des ressources humaines de l’université ;
- une maximisation graduelle des ressources propres par la valorisation des expertises des Enseignants-chercheurs et chercheurs, gage d’une véritable autonomisation de l’université ;
- une collaboration exemplaire entre l’administration et les groupes légalement constitués ;
- une anticipation rationnelle sur le devenir des futurs diplômés.
En s’engageant résolument dans la voie de cette triple excellence, les universités en Afrique gagneront le double pari des meilleurs classements dans les rankings internationaux et de la meilleure visibilité dans les stratégies d’implémentation du développement durable.
Chers collègues, par vos voix, cette voie de l’excellence tridimensionnelle a été magistralement explorée et c’est pourquoi, le Pr Abou KARAMOKO ici présent et moi-même, qui avons tenu pendant plusieurs années les rênes d’une université, nous vous en félicitons.
C’est le lieu pour nous d’adresser des remerciements très sincères à tous les collègues qui ont effectué le déplacement à Bouaké, depuis les grandes régions du continent africain et les grandes villes de la Côte d’Ivoire pour prendre part à ce colloque. Nous pensons aux Professeurs Stève Gaston BOBONGAUD, Célestin Kalombo MBUYU, Ignace BIAKA, Ramsès Thiémélé BOA et à la Présidente de l’université de Daloa, Madame le Professeur Abiba TIDOU SANOGO Épse KONÉ, représentée ici par le Professeur Issiaka KONÉ, Doyen de l’UFR des Sciences sociales et humaines.
Nous remercions tout particulièrement le Ministre Nicoué BROOHM, Professeur titulaire de Philosophie à l’université de Lomé, le Professeur Mahamadé SAVADOGO, anciennement Président du CTS LSH du CAMES, qui ont toujours su se libérer pour notre Institution à l’occasion des séminaires doctoraux, des soutenances de Thèse et cela, depuis plus d’une dizaine d’années.
Comment ne pas remercier également les autorités administratives et académiques de l’Université Alassane Ouattara qui se sont véritablement impliquées dans l’organisation de ce colloque ? Nous pensons au Président Koffi KOUAKOU, au Doyen de l’UFR CMS, le Pr Assouma BAMBA, au Vice-Doyen chargé de la pédagogie, le Pr Tro DEHO, au Chef du Département de Philosophie, le Professeur Grégoire TRAORÉ qui tient entre ses mains le flambeau hérité du Professeur Ludovic Fié DOH, un flambeau dont la flamme originelle est liée à un nom : Ignace Ayénon YAPI, Premier chef du département de Philosophie de l’université de Bouaké.
Nous n’oublions pas le Comité d’organisation, avec à sa tête, le Professeur Kolotioloma Nicolas YÉO que nous tenons à féliciter très chaleureusement pour son expertise organisationnelle.
Somme toute, ma conviction, aujourd’hui, est que le plus grand défi que doivent relever les universités en Afrique pourrait se traduire par l’appropriation mentale de la culture de l’universellement souhaitable que nous inspire la maxime d’Emmanuel Kant : « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature ».
Je vous remercie
RAPPORT DE SYNTHÈSE
Les 9, 10 et 11 juin 2022 s’est déroulé, à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, un Colloque International Pluridisciplinaire portant sur la thématique: La crise de l’Université en Afrique : diagnostic et éléments de stratégies transversales. Ce forum scientifique a réuni les universitaires, venus de tous les horizons, autour de 09 axes de réflexion animés par 126 panélistes.
Au titre de la Gouvernance et du financement des universités, les communications ont toutes révélé que l’enseignement supérieur est et demeure le moteur de la recherche scientifique, voire du développement des États. Cependant, ce secteur du système éducatif est confronté à un véritable problème de gouvernance dû non seulement au manque d’infrastructures, mais aussi au faible financement des structures de recherche par l’État dont le rôle régalien n’est pas toujours exercé comme il faut. L’analyse-diagnostic de cette contre-performance des universités africaines en déconstruction nécessite, de la part des gouvernants, des reformes institutionnelles et académiques en matière de « gouvernance managériale et d’assurance qualité ». Ce mode de gouvernance, gage d’une véritable autonomisation des universités, tient à l’environnement économique mondial qui recommande une gestion rationnelle, plus transparente, efficace et collégiale des universités. À ce niveau, les panélistes ont défendu l’idée que les responsables administratifs des universités soient issus des élections étant entendu que les nominations posent trop souvent le problème de l’efficacité dans la gouvernance de ces structures.
Aussi, a-t-il été proposé que le financement des universités s’opère par la possibilité donnée à ces institutions académiques, de faire valoir leur leadership, en concluant des accords de partenariat avec des entreprises privées dont les expertises et les compétences sont avérées dans le domaine de la recherche technologique, informatique. Dans cette optique, la valorisation des expertises ou résultats de la recherche (création de brevets, inventions) des Enseignants-chercheurs pourraient permettre une maximisation graduelle des ressources financières allouées aux universités. Faire de la recherche une source d’économie, un moteur de création d’entreprises pour l’émergence des champions nationaux, est cette nouvelle vision qui devrait désormais animée les gouvernants en vue de rendre nos universités plus compétitives à l’échelle mondiale.
Au titre de l’université et des questions du genre, les communications se sont cristallisées autour de la nécessité d’une déconstruction des stéréotypes féminins dans l’espace universitaire où les étudiantes, en état de vulnérabilité, sont, la plupart du temps, victimes de toute sorte d’abus, de violences (harcèlement, intimidations). Au sujet des stéréotypes, les communications ont montré que l’idée de la masculinité du métier d’enseignant-chercheur ou chercheur, l’incapacité ressentie par les femmes à s’imposer dans le troisième cycle ainsi que les inégalités homme/femme en termes de carrière universitaire, persistent, et ce, malgré tous les efforts engagés par les décideurs politiques et les organisations non gouvernementales qui militent en faveur des droits de l’homme et de la femme. Les conséquences de cette vision réductrice de la condition féminine se traduisent en termes de manque de confiance, de sous-estimation de soi, autant d’écueils qui entravent non seulement la progression des étudiantes au grand dam des familles enclines au désespoir, mais aussi enlaidissent l’image de l’institution universitaire.
Pour ce faire, les universitaires encouragent les États à faire de l’égalité des chances, l’un des Objectifs de Développement Durable à atteindre en 2030, une arme contre les discriminations basées sur le genre et lutter contre la précarité féminine.
Au titre de la formation et de l’employabilité des étudiants, les communicateurs ont cherché à savoir si nos universités sont à même d’offrir de nouvelles opportunités, des perspectives heureuses aux étudiants ou si celles-ci, calquées sur les modèles d’héritages coloniaux, pouvaient encore répondre aux besoins et aux défis de développement de notre temps au moment où l’émergence des technosciences tend à remettre en cause la pertinence de certaines filières considérées à tort ou à raison comme des usines de fabrique de chômeurs. Il a été convenu que les universités africaines, outre leur mission de transmission du savoir, de formation des ressources humaines, doivent y adjoindre une nouvelle mission : celle qui consiste à assurer la qualité du contenu des programmes des enseignements dispensés et leur adéquation au marché de l’emploi, au monde socioprofessionnel. Ce qui est en jeu, dans la problématique de l’employabilité, c’est la crédibilité des universitaires auprès des décideurs politiques.
Au titre de l’université et de la culture de l’excellence, les communications ont insisté sur la promotion de la culture de l’excellence au sein de l’université dont la vocation est de contribuer au développement de la société par la production des connaissances et des compétences. Toutefois, la promotion de la culture de l’excellence a été nécessitée par un diagnostic peu reluisant de la situation de nos universités en perte de valeurs. La marchandisation du savoir avec la vente de fascicules par les enseignants-chercheurs, les frais exorbitants de scolarité, la transformation des campus universitaires en des espaces commerciaux contribuent à la baisse de la qualité des enseignements, au faible rendement des apprenants et à l’exclusion massive de ceux-ci du système éducatif.
L’image que nous donne à voir nos universités semble être, pour le moins, aux antipodes du concept fort mobilisé de la Démarche Qualité qui est l’autre nom de l’excellence. L’excellence académique repose sur la qualité de la formation et de la recherche ainsi que sur la qualité des infrastructures universitaires à caractère scientifique et social. De ce fait, la création d’un prix d’excellence pour célébrer les étudiants et étudiantes qui se seraient distingués dans leur domaine respectif est à encourager.
Au titre du Syndicalisme, de la politique et de la violence à l’université, les communications ont porté sur les rapports entre les organisations syndicales qui défendent les intérêts de leurs membres et la persistance des actes de violences qui, malheureusement, rythment la vie des universités africaines. Si, généralement, les violences sont orchestrées par la non prise en compte de certaines revendications estudiantines et des enseignants-chercheurs, il est à observer, cependant, que l’affiliation de certains mouvements syndicaux aux partis politiques et les problèmes de leadership au sein de ceux-ci sont, pour une bonne part, à l’origine des crises à répétition. Les violences physiques et verbales qu’exercent les mouvements syndicaux ne vont pas sans la destruction de biens publics et privés, l’atteinte à la liberté d’expression et mettent à mal le bon fonctionnement des activités académiques. En outre, les récurrentes interventions des forces de l’ordre au sein des universités posent, avec acuité, la question des franchises universitaires. Il y a lieu, pour sortir de cette impasse, que les autorités universitaires et les décideurs politiques entreprennent des actions innovantes en vue de pacifier ces espaces-sanctuaires. Dans cette optique, l’institution d’une gouvernance participative et inclusive constitue une piste prometteuse à explorer. Cette gouvernance induit la promotion d’une éthique de la discussion ou de la communication.
Au titre des Responsabilités éthiques, pédagogiques et académiques des universitaires
Il est de notoriété que les universités africaines ont toujours occupé un rang peu honorable au classement mondial depuis des années. Ce positionnement, qui tire sa source de plusieurs facteurs, est l’expression d’un malaise profond qui mérite une auto-évaluation objective de la communauté savante. Ainsi, la responsabilité pédagogique, académique et éthique des universitaires a été passée, par les panélistes, au scanner en vue d’offrir une meilleure visibilité aux universités. Dans le contexte africain actuel, les maquettes pédagogiques ou contenus de connaissance mobilisés dans les projets universitaires, les principaux modèles d’enseignement et de formation convoqués dans la constitution des programmes académiques ne s’accommodent pas toujours avec les réalités sociologiques, voire le potentiel endogène des peuples. Les universitaires versent dans l’extraversion scientifique, parce qu’ils sont consommateurs des savoirs et pensées en rupture d’avec les critères de vérité de leurs espaces socioculturels.
L’implémentation du système LMD, depuis quelques années, semble ne pas donner les résultats escomptés au sens où elle ne s’est pas opérée de manière effective. L’impasse dans laquelle se trouve ce système a suscité l’idée d’une décolonisation des universités africaines qui ont besoin d’avoir une identité propre à elles. La crise des docteurs, en quête d’emploi en Côte d’Ivoire, interpelle les universitaires sur l’urgence qu’il y a à contraindre non seulement les gouvernants à créer des écoles doctorales, mais aussi à se projeter sur l’avenir, voire à anticiper rationnellement sur le devenir des futurs diplômés.
Les universitaires sont ceux qui portent tous les espoirs du développement et du monde comme l’exprime si bien le logo de l’université Alassane Ouattara. Leur responsabilité pédagogique et académique induit celle éthique qui exige d’eux qu’ils soient non seulement des modèles pour les apprenants, ceux qui forment et forgent leur esprit, mais aussi ceux qui véhiculent des valeurs telles que la rigueur, le respect de la chose publique, l’altérité et le mérite. La responsabilité intellectuelle ou morale des universitaires, quant à leur fonction première d’éveilleurs et d’éclaireurs des consciences, n’est pas toujours assumée. De plus en plus, les enseignants-chercheurs se gardent d’oser et les activités extra-universitaires qu’ils exercent, par moments, tendent à supplanter celle enseignante, et ce, au désavantage des apprenants dans leur cheminement académique.
Au titre des Infrastructures, TICE et innovation pédagogique
La crise traditionnelle des universités qui s’exprime, entre autres, par la massification des effectifs due à une insuffisance d’infrastructures, a connu une accentuation avec la pandémie du Covid-19. Si certaines universités ont totalement fermé leurs portes, d’autres, en revanche, ont tenté de maintenir des cours à distance grâce aux applications numériques WhatsApp, Zoom ou encore Teams, en réunissant des conditions stratégiques favorisant les usages de ces plateformes. Ces innovations pédagogiques, s’accommodant d’une série de ruptures relatives au temps et à l’espace de l’organisation de l’enseignement, déconstruisent et reconstruisent les cadres et les modes d’appropriation traditionnels du savoir. C’est aussi dans ce cadre qu’il faut saisir la pertinence de la création d’un service de pédagogie universitaire à l’UAO dont la vocation est d’instruire les enseignants-chercheurs sur la nouvelle façon de transmettre le savoir aux apprenants, voire d’encourager les recherches et d’améliorer la qualité de l’enseignement. Il urge, pour nos institutions universitaires, d’amorcer le processus de renouvellement de l’enseignement conforme à la révolution technoscientifique. Les communications ont donc, pour une bonne part, montré la nécessité d’une implémentation, mieux d’une appropriation du modèle de la gouvernance numérique centré sur les usages des acteurs comme nouvelle architecture de la relation au savoir.
Au titre des Libertés et franchises universitaires, les communications ont mis l’accent sur les menaces et pressions que subissent les enseignants-chercheurs, toutes choses qui ébranlent l’un des principes de base de la fonction de l’universitaire, en l’occurrence la liberté académique ou l’autonomie professionnelle. Ce droit professionnel, acquis par le degré d’engagement de l’enseignant au sein de la communauté universitaire, est menacé à l’ère de la mondialisation qui promeut les valeurs de transparence et de liberté. Cette menace demeure indissociable des décisions académiques, politiques et religieuses qui contraignent bon nombre d’universitaires à se résigner ou à s’exiler aux fins d’échapper aux persécutions. L’ingérence du politique ou du religieux dans l’espace universitaire remet en cause les franchises universitaires au nom desquelles l’enseignant-chercheur ne doit être défavorisé ni soumis à un traitement moins favorable de la part de l’université ou de l’autorité publique. C’est pourquoi, il a été suggéré aux décideurs politiques, à l’effet de prévenir certaines crises et pacifier durablement l’espace universitaire, l’élaboration de textes juridiques portant sur la liberté et les franchises universitaires.
Au titre de l’université et de la dynamique des sociétés, les communications ont mis en exergue la nécessité d’une forte contribution des enseignants-chercheurs au développement de la société. Si l’université est vue comme le moteur de la dynamique sociale enclenchée par la recherche scientifique, c’est dire qu’elle est, en principe, censée répondre, dans la mesure du possible, aux préoccupations sociétales. Son utilité et son importance devraient susciter un profond intérêt de la part des gouvernants et de tous les acteurs du monde académique. Or, tel n’est malheureusement pas le cas sous nos tropiques.
L’insuffisance de moyens financiers et matériels alloués aux universités, dans le cadre de la recherche scientifique, ne permet pas de répondre aux nombreuses sollicitations des populations dans quasiment tous les secteurs d’activités. L’impression qui se dégage, aujourd’hui, c’est que l’université semble fonctionner en vase clos, voire si éloignée des besoins exprimés par les populations. Celles-ci, dans leur grande majorité, ne perçoivent pas très bien l’impact que les études et recherches universitaires pourraient avoir sur leurs conditions socio-économiques. C’est donc cette approche du rapport entre nos universités et la société qu’il faudra travailler à inverser. Ne pas le faire, ce serait s’auto-mutiler.
En s’engageant résolument dans toutes ces voies de solutions suggérées, portant la marque de l’autocritique et de la co-construction, les universités en Afrique gagneront le double pari des meilleurs classements dans les rankings internationaux et la meilleure visibilité dans les stratégies d’implémentation du développement durable.
Fait à Bouaké, le 11 juin 2022
Le Comité Scientifique
RECOMMANDATIONS
Au Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel
Le Colloque recommande au Conseil de bien vouloir associer les universitaires aux réflexions sur les questions d’ordre Economique (Les sciences économiques), Environnemental (Chaire l’Unesco de Bioéthique) et Social (Les sciences socio-anthropologiques, la philosophie)
Au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Le Colloque recommande la prise en compte des conclusions des travaux.
Au Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption
Le Colloque recommande au Ministère d’associer les universitaires à l’exécution de sa stratégie de lutte contre la corruption.
À l’Université Alassane Ouattara
Le Colloque recommande l’accompagnement soutenu des activités telles que les colloques, les séminaires, les ateliers etc.
II recommande aussi la diffusion des accords de partenariats entre l’Université Alassane Ouattara et les structures de recherche en vue d’optimiser le financement des projets de recherche.
Au FONSTI
Le Colloque recommande aux responsables d’accentuer la promotion de cet outil indispensable de Financement des programmes et projets de recherche scientifique et d’innovation technologique.
À la Mairie de Bouaké
Le Colloque recommande d’associer les universitaires aux activités sociales et culturelles qu’elle organise dans sa mission de satisfaire aux besoins de la population locale.
Fait à Bouaké, le 11 juin 2022
II. COMMUNICATIONS EN PLÉNIÈRE
« VRAI ET FAUX PLURALISME ». LES UNIVERSITÉS DANS L’ORDRE MONDIAL CONTEMPORAIN
Ernst WOLFF
Institut supérieur de philosophie, KU Leuven (Belgique)
1. Sur les « universités » et les « crises » : une vision de contre-bas
L’intitulé du colloque utilise le mot « université » au singulier, se référant à l’institution sociale dans sa généralité. Néanmoins, il est primordial de rappeler que le terme « université » désigne une pluralité d’entités, présentant des traits communs, mais aussi une remarquable variété, chaque université ayant sa propre forme institutionnelle, mais aussi les personnes qui y travaillent : administrateurs, comptables, informaticiens, étudiants, direction, bibliothécaires, enseignants-chercheurs, agents d’entretien, etc. Chacun a sa propre série d’intérêts et d’objectifs, qui s’imbriquent parfois parfaitement pour soutenir le fonctionnement de l’université, mais qui sont parfois si opposés qu’ils paralysent des parties plus ou moins importantes de l’université. Les relations entre l’université et son personnel peuvent être complémentaires ou exploitantes dans les deux sens. En outre, chaque université interagit également avec les institutions du même État et d’autres États dans des réseaux globaux d’interaction institutionnelle en bénéfice mutuel parfaitement accordées ou d’antagonisme agressif. Appelons cela la perspective descriptive des universités. Cette perspective est la spécialité des historiens, des sociologues, des économistes.
Cependant, qui parle de différence peut aussi vouloir s’engager sur le plan normatif : certains traits sont nécessaires pour qualifier un établissement de vraiment universitaire, tandis que d’autres sont accidentels. Pour avancer dans cette voie, il faut se faire une idée de ce que sont idéalement les universités. On peut être réticent à s’engager de manière normative avec les universités. Qu’est-ce qui doit être considéré comme un modèle dans ce domaine ? Les plus anciennes, les américaines, les plus riches, sont-elles des modèles pour les autres ? C’est à cela que se résument en pratique les systèmes de classement des universités. Ou, si l’on veut toujours aborder les universités de manière normative, mais que l’on rejette l’approche par les modèles, à partir de quelle hauteur théorique pourrait-on évaluer les universités ? L’idéal allemand humboldien de l’université comme institution d’éducation intégrale ou le modèle plus américain d’une institution qui fournit des individus qualifiés pour le marché du travail, ou encore un autre modèle (mais comment le trouver) ? Mais dès lors que l’on pressent que quelque chose est en jeu dans les universités, la question d’une vision normative devient incontournable.
Ajoutons un dernier élément de complexité. Lorsque l’on parle des crises des universités, on a le plus souvent en tête le type de difficultés dans lesquelles ces institutions se retrouvent et au milieu desquelles elles doivent maintenir le bateau à flot. Je voudrais simplement rappeler que les crises ne sont pas seulement subies, elles sont aussi créées de l’intérieur du monde universitaire. En réfléchissant au « cœur de métier » (core business) idéal de l’université, nous ne devrions pas seulement considérer la science comme un moyen de résoudre des problèmes, mais aussi comme la source ou le révélateur de crises[1].
Il était important d’esquisser une vue d’ensemble qui rende compte de la complexité du sujet. Tout en gardant à l’esprit les trois points abordés, je procéderai d’une manière beaucoup plus conforme à mon implication dans la vie, à savoir dans le feu de l’action. Cela m’oblige à reconnaître immédiatement la perspective très contingente et limitée que j’adopte, clairement marquée par les expériences de vie que j’ai vécues et par les tâches que j’ai dû accomplir quotidiennement en tant que professeur de philosophie, dans différents endroits du monde[2].
2. Partager des notes : revisiter Hountondji
Le fait d’être situé et d’avoir une perspective personnelle permet toutefois d’élargir le champ de vision, notamment en échangeant des notes avec d’autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. C’est l’objectif que je me suis fixé en revisitant l’essai « Vrai et faux pluralisme »[3] du philosophe béninois Paulin Hountondji, qui doit vous être familier.
Cet essai a été prononcé au colloque de l’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française à Louvain-la-Neuve en Belgique du 21 au 25 mai 1973, sous le thème « L’Université et la pluralité des cultures ». Je crois qu’en revisitant quelques points de cette communication à presque 50 ans de distance et en y comparant ma propre expérience, le petit ver que je suis pourra lever la tête juste assez pour avoir un peu plus de visibilité sur la question qui nous occupe. Pour échanger des notes, je dois l’écouter sous l’angle du thème de notre conférence, « La crise de l’université en Afrique ». Certes, la communication de Hountondji ne porte pas directement sur la crise de l’université, mais elle comporte assez de matière pour nourrir notre réflexion sur ce thème. En retour, j’introduirai son souci du pluralisme dans le thème de notre conférence, comme j’ai déjà commencé à le faire ci-dessus, en pensant aux universités au pluriel, aux crises au pluriel, et en ajoutant à l’avance les Afrique et les Europe au pluriel[4].
L’idée maîtresse de l’article de Hountondji consiste à explorer le potentiel et les pièges du discours sur le pluralisme culturel. Ainsi, son article commence comme suit :
Par pluralisme culturel, on entend généralement trois choses : (1) le fait de la pluralité culturelle, entendue comme coexistence de cultures appartenant, au moins en principe, à des aires géographiques différentes ; (2) la reconnaissance du fait de cette pluralité ; (3) l’affirmation que cette pluralité est une bonne chose et le volonté d’en tirer parti d’une manière ou d’une autre […] (219)
Si les crises ne sont pas le thème majeur de Hountondji, sa réflexion sur le pluralisme n’a vraiment de sens que si l’on considère qu’elle est pensée à partir d’une situation perçue comme critique. Ainsi, on ne peut apprécier la portée de l’analyse terminologique liminaire de l’article que si l’on se rend compte que le problème lui-même est rendu chaque fois où il évoque le contexte sociopolitique à partir duquel il pense.
a. Ce contexte est celui de la politique des premières années de l’après indépendance. Hountondji évoque les difficultés (a) de trouver une articulation appropriée pour le destin des citoyens (comme l’ont tenté les nationalismes et les socialismes de l’époque) et (b) de situer les nouveaux États africains dans le monde géopolitique, les uns par rapport aux autres et par rapport aux plus grandes puissances internationales. Ce complexe de questions sociopolitiques implique également (c) les difficultés de trouver des politiques appropriées pour les institutions, y compris les universités.
b. La mise en évidence de ce contexte de crises sociopolitiques aide à apprécier le fait que Hountondji est peu concerné par une métaphysique de la pluralité et de l’unité, mais principalement par des difficultés de nature pratique. L’aspect compréhensif et véridique de son argumentation est au service de la question : que faut-il faire ? Pour savoir ce qu’il faut faire – pour trouver des stratégies appropriées pour répondre à cette donne sociopolitique – il faut surmonter l’obstacle d’une saisie débilitante du complexe problématique. Ce dépassement ne consiste pas seulement à revenir au terme « pluralisme », mais à remplacer la mauvaise compréhension du pluralisme par une bonne. Dès lors, que faut-il entendre correctement par pluralisme ?
c. Bien sûr, les questions sociopolitiques ci-dessus ont tout à voir avec des points de vue différents, des histoires différentes, des modèles différents, des valeurs différentes, etc. Mais la reconnaissance et la valorisation de ce pluralisme local et international deviennent un problème lorsqu’elles se font au moyen d’un particularisme « culturaliste ». Pour nos besoins, le résumé de cette dernière approche par Hountondji à la page 74 suffit :
Étrange paradoxe : dans les conditions qui prévalent actuellement, le dialogue avec l’Occident ne peut qu’encourager le folklorisme, sorte d’exhibitionnisme culturel collectif, parce qu’il oblige l’intellectuel du ‘tiers monde’ à ‘défendre et illustrer’, à l’intention du public occidental, les particularités de sa civilisation d’origine. Ce dialogue apparemment universel revient donc en fait à développer la pire espèce de particularisme culturel – la pire espèce, parce que ces particularités prétendues sont dans la plupart des cas purement imaginaires et parce que l’intellectuel qui les défend prétend parler au nom de son peuple tout entier, lequel non seulement ne le lui a jamais demandé, mais ignore le plus souvent jusqu’à l’existence d’un tel dialogue.[5]
d. Cette attitude sur la spécificité et la pluralité culturelles – le « faux pluralisme » -, Hountondji l’identifiait à l’époque surtout à deux partisans : l’« Européen nostalgique » et le « nationaliste révolté ». Tous deux font de la culture le principal point de discorde dans les échanges entre groupes (au détriment de l’économie et/ou la politique[6]). Par conséquent, ce qui est repris de l’Occident dans la culture africaine relève de l’« acculturation » ou de l’« occidentalisation » – toutes deux comprises comme une « aliénation culturelle », à laquelle seul le « nationalisme culturel » peut remédier (234). En bref, Hountondji s’oppose à ces deux partis pour leur essentialisme et leur pensée anhistorique qui se résument à une doctrine de l’unanimisme.[7]
e. Quel est donc le « vrai pluralisme » que Hountondji leur oppose ? C’est le pluralisme qui oppose terme à terme les trois défauts précédents : c’est le pluralisme de la nature (de chaque culture intérieurement), le pluralisme de l’histoire et le pluralisme de l’opinion. Ce pluralisme est fondé sur la « compénétration progressive des cultures ». (231-2). Anticipant en quelque sorte Olufemi Taiwo[8] ou Mahmood Mamdani[9], Hountondji met plutôt sur le compte de la colonisation qu’elle a appauvri les cultures africaines en freinant les « mutations », en niant le « pluralisme interne » (233) et en imposant des polarisations artificielles (234). Ainsi, son propre point de vue n’est en aucun cas une apologie de la violence colonisatrice ou néocolonisatrice. En outre, si Hountondji rétorque en soulignant la pluralité interne à l’œuvre dans les cultures africaines, cette pluralité est aussi interne à l’humanité à l’échelle du monde entier (235). Ce qui fait de la différence quelque chose de beaucoup plus flou et incertain que ne le voudraient les culturalistes. En fait, le point de vue de Hountondji sur la pluralité implique trois éléments significatifs : la capacité d’agir[10], les discordances (234) et l’ouverture aux autres et au monde (234).
f. Ces trois éléments sont des biens ambigus, leur résultat exact ne peut être prévu de manière simple. Mais ils ne relèvent pas pour autant d’un défaitisme ou d’une indifférence. Au contraire, pour Hountondji ce sont les composantes essentielles d’une nouvelle résistance à l’injustice. Une fois l’essentialisme et l’unanimisme déconstruits, le pluralisme permet aussi la formation « des solidarités nouvelles entre des hommes ou des groupes d’hommes » (236). On peut appeler cela la condition de possibilité de nouvelles « stratégies transversales ».
g. Enfin, les crises sociopolitiques provoquées par une revendication excessivement simplifiée de l’identité culturelle ont selon Hountondji des répercussions sur l’université. D’abord, parce que dans leur effort pour se démarquer de l’héritage colonial, les universités s’emparent d’une des possibilités de l’Europe, à savoir la fascination pour l’identité simplifiée – et promeut celle-ci, comme en politique, avec des noms comme « négritude », « authenticité », « repersonnalisation de l’homme africain »[11] (229). Hountondji ne récuse pas ces termes, qui constituent une réponse partiellement correcte à la situation, dans la mesure où ils placent la question de l’africanisation des universités au centre des préoccupations (236) et, ce faisant, reconnaissent la nécessité de contrer l’imitation ou l’assimilation du présumé universalisme occidental (236). Pourtant, en acceptant un culturalisme essentialisé, cette réponse succombe encore à l’extraversion que Hountondji ne cesse de critiquer. Cette ambiguïté, en tant que figure majeure de la crise de l’université, se révèle quand Hountondji la situe dans son contexte sociopolitique.
J’arrête ici ma lecture de « Vrai et faux pluralisme ». Écouter attentivement Hountondji ne signifie pas approuver sans critique tous ses points de vue. Une acceptation inconditionnelle de ses vues serait plutôt étrange, étant donné la perspective très différente à partir de laquelle nous regardons un monde en mutation aujourd’hui. Mais surtout, cette absence de dissensus reviendrait à saper sa leçon même, à laquelle je veux m’accrocher. Je souscris à sa vision du pluralisme, d’abord en pratiquant ce pluralisme des points de vue dans le débat avec lui. Permettez-moi donc de commencer par exprimer nos points de divergence :
– Si je suis d’accord pour dire qu’il y a une « compénétration progressive des cultures », j’insisterais davantage sur les rapports de force impliqués dans ce processus et sur la dissymétrie des flux.
– Hountondji reproche aux deux camps culturalistes de négliger les enjeux politiques et économiques de la pluralité (notamment l’effet de la (néo-) colonisation) (226, 230). Cependant, je ne pense pas que des positions culturalistes fortes d’aujourd’hui commettent nécessairement cette négligence – mon expérience sud-africaine révèle plutôt la tendance à amalgamer politique, économie et culture.
– Et pour cette raison, je ne crois pas du tout que l’insistance sur la pluralité culturelle, en ce qui concerne l’Afrique, soit toujours au service d’un programme politique conservateur (231). Bien que, en toute équité, cette affirmation de Hountondji s’applique à la vision culturaliste de la pluralité culturel.
– Enfin, je ne pense pas que la réduction des oppositions politiques à celle de la domination de classe que défendait Hountondji tienne encore, ni à l’échelle nationale, ni à l’échelle internationale (235-6). Cependant, mon propos doit être atténué, sur la base de l’analogie qu’il établit entre les luttes culturelles et politiques.
Jusqu’ici le dissensus. Mais je trouve en Hountondji un partenaire important et je souhaite élaborer dans mes propres termes les points d’accord :
– On ne peut espérer comprendre la crise de toute institution, et en particulier des universités, en faisant abstraction du contexte sociopolitique local, national et mondial. Et je maintiens ce point, même si je reconnais les limites de ma propre capacité à m’y engager.
– Étant donné le fait de la pluralité, et en la considérant dans toute sa complexité, on n’a pas d’autre choix que d’historiciser et de désessentialiser les phénomènes culturels[12]. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut restaurer la capacité d’agir (agency). Ce n’est qu’ainsi que l’on peut se l’approprier pleinement, de manière « responsable ».
– Mais le pluralisme a pour prix la discorde et l’incertitude. Ce n’est pas une vision réconfortante face aux crises. Néanmoins, il convient de noter que les mêmes facteurs génèrent également la créativité. De même, si le dissensus peut être vécu comme paralysant parce que relativisant, l’interaction recadre partiellement le sens de notre coexistence. En d’autres termes, le dissensus entraîne une sorte de relativisme, mais qui se situe entre l’invention et la coordination.
– On pourrait donc dire que le pluralisme est en soi un problème, mais aussi une ressource – une étape possible dans la direction d’une réflexion commune et séparée sur la manière d’avancer. Le propos de Hountondji sur les nouvelles alliances me convainc.
En soulignant toujours le même point sous un autre angle, je conclurai que l’interaction des peuples, colonisation et décolonisation comprises, sont à considérer comme des phénomènes de pluralité humaine. Selon la reconstruction de Ricœur, la mondialisation a conduit à la découverte d’une pluralité humaine encore insoupçonnée – une première crise, involontairement créée – à laquelle la colonisation a été appliquée comme une panacée. De même, tout en assumant pleinement la nécessité de la décolonisation, Ricœur signale la crise de la pluralité sans arbitrage qu’elle a ouverte[13]. Ils témoignent du fait que les crises sont parfois subies par les hommes, mais parfois aussi créées par eux. En réfléchissant aux implications de ces événements – mais aussi à nos crises actuelles – les sciences humaines et sociales apportent un éclairage sur ces crises, et ce faisant, ne les atténuent pas immédiatement, mais tendent plutôt à les intensifier d’abord.
3. De Hountondji à nous
Le pluralisme en tant que complexe problématique est un sujet dans lequel je suis impliqué depuis bien avant de lire Hountondji. Comme le montrent deux textes, dont la première version date de 1999 : Ernst Wolff, « Anatomie van ‘n teologiese ideologie : die Hervormde Kerk se steun aan die apartheid ideologie », in Historia: the Journal of the Historical Association of South Africa, 51 (1), (2006, pp. 141-162) et Ernst Wolff, « Sanctus Marthinus laudator philosophicus. Or, sitting at the guru’s feet », in Martin Versfeld, 2021, « A South African philosopher » in dark times, Leuven: Leuven University Press, pp. 175-190)[14].
Mes années de formation et le début de ma carrière se sont déroulés en Afrique du Sud pendant les années de la transition démocratique post-apartheid et ses suites, lorsque le débat sur la nature et les conséquences du pluralisme était notre pain quotidien national. Depuis lors, j’ai été confronté à des formes de faux pluralisme dans mon milieu professionnel de la philosophie, tant en Afrique du Sud qu’en Europe. Dans des études que j’ai consacrées à chaque cas, j’ai démontré comment les courants de pensée essentialiste et anhistorique sont impossibles à soutenir. Ainsi, alors que l’opposition du programme puriste – Hountondji dirait « culturaliste » – à l’eurocentrisme dans les universités sud-africaines est parfaitement justifiée, sa tentative de poursuivre ce programme par une opération de balayage, sans qualification, court le risque d’infliger plus de mal que de bien[15]. De même une poursuite rigoureuse de l’étude de la philosophie européenne elle-même confirmerait sa pluralité, derrière laquelle la reconnaissance institutionnalisée est encore en retard[16]. Bien que je reconnaisse des exceptions, la philosophie européenne, à grande échelle, se trouve toujours dans une situation de crise refoulée – la crise d’une négligence auto-imposée par rapport au pluralisme[17]. C’est la crise de la discordance avec sa propre pluralité et avec la pluralité du monde à partir duquel et pour lequel elle essaie de philosopher. Comment continuer à travailler quotidiennement à la poursuite d’un véritable pluralisme ?
3.1. Ethos d’engagement envers une véritable pluralité
Le type d’éthos académique que notre époque réclame correspond à la poursuite des vertus intellectuelles identifiées par Hountondji : opposition à l’essentialisme, sensibilité à la construction historique des phénomènes et des problèmes, et refus de l’unanimisme. Dans le même ordre d’idées, j’ai préconisé ailleurs la pratique philosophique « intercontinentale », entendue comme une éthique visant à « philosopher en pleine conscience de la mondialisation contemporaine et de la pluralité sans arbitre impartial des désaccords »[18]. Le point de synthèse est la prise en charge de la responsabilité d’un véritable pluralisme interne et externe, un point qui vaut pour la pratique académique et universitaire en général. De manière générale, une telle poursuite se réalisera par :
– Un travail de comparaison[19] – comme je tente de le faire ici en réfléchissant avec Hountondji ; mais aussi en vous parlant, à Bouaké, de Pretoria et de Louvain.
– Un travail de traduction – littéral (parce que c’est un moyen clef de s’opposer à la quasi-disparition de contributions importantes à la république des lettres[20]), mais aussi dans le sens métaphorique plus large d’une explication réciproque incessante. Dans les deux cas, nous avons besoin de personnes « polyglottes ».
Un travail de désessentialisation de la philosophie. Je ne vois aucune raison pour laquelle on ne devrait pas continuer à étudier les traditions philosophiques nationales de l’Allemagne, de la France ou de tout autre pays. Au contraire, chaque fois que je parle à des collègues africains, je les implore de faire progresser l’historiographie de la pensée de leur propre pays, ce que j’ai également fait pour le mien.[21] Mais il y a également un grand besoin de raconter à nouveau l’histoire de la philosophie. Mais nous avons tout autant besoin d’explorations systématiques de domaines problématiques où les contributions de différents angles sont valorisées.
Une véritable pluralité appelle une quête correspondante de nouvelles alliances intellectuelles. Ailleurs, j’ai caractérisé cela comme une quête de communalité, basée sur un universalisme latéral (un principe, d’ailleurs, auquel souscrivent des auteurs africains comme européens)[22]. Bien sûr, la communalité n’émerge que de la pluralité ; lorsque la pluralité n’est pas suffisamment reconnue, elle étouffe l’émergence de la communalité.
3.2. L’enchevêtrement des crises et des solutions
De peur de donner l’impression d’un bon pluralisme qui dissiperait les crises, je voudrais insister sur le fait que les solutions et les crises restent à jamais enchevêtrées.
1. Un exposé plus complet de la question actuelle devrait intégrer plus complètement les dimensions socio-économiques et politiques de la pluralité – avec une complexification supplémentaire de la question.
2. Il est évident que le type de plaidoyer en faveur du pluralisme que je fais ici souscrit à quelque chose comme un esprit démocratique, largement conçu. Pourtant, les gens ne sont pas simplement démocratiques et tout le monde ne veut pas poursuivre le travail des universités de manière démocratique. Si l’existence de ces autres points de vue concerne la pensée pluraliste, elle fixe également une sorte de limite : on ne peut s’accommoder de ceux qui se rebellent contre la « parité de participation »[23] que jusqu’à un certain point. En outre, ceux qui sont d’accord avec la pratique démocratique se tromperaient sérieusement en pensant qu’en dernière analyse, c’est eux qui mènent le jeu.
3. La pratique de nombreuses disciplines en vue d’un véritable pluralisme exige de travailler avec un héritage ambigu. Malgré toute leur magnificence constructive et critique, les savoirs européens sont issus de traditions qui ont été complices du racisme et de la violence impériale[24]. En même temps, non seulement il n’est pas souhaitable de se débarrasser de ces traditions européennes en Afrique, mais ce n’est même pas possible. Le seul moyen d’aller de l’avant semble donc être de reconnaître l’ambiguïté de l’héritage et de le visiter avec une attention acharnée. Si l’ambiguïté signifie à la fois problème et potentiel, alors le test pour nous consiste à séparer l’un de l’autre, à faire fructifier le potentiel positif et à le retourner contre le bagage négatif. On peut s’attendre à ce que cela ouvre tout un domaine de nouvelles disputes, d’incertitudes et potentiellement de crises.
4. J’ai insisté plus haut sur le fait que la question du pluralisme véritable est motivée par la question : que faut-il faire ? Elle témoigne de l’ambition des sciences d’être pertinentes pour les questions ambiantes. Mais comment comprendre la pertinence ? Compte tenu de l’ambiguïté que nous venons d’évoquer, il convient d’hésiter avant de considérer le patrimoine de telle ou telle tradition a priori comme pertinent pour la société. Seule l’adhésion totale au pluralisme interne et externe peut nous aider à résister à la domination de la tradition, tout en nous offrant la possibilité d’apprendre d’elle. Et, comme nous l’avons vu avec Hountondji, cette acceptation est pratiquée par la reconnaissance de la capacité d’agir, des discordances et de l’ouverture. Pourtant, mon point de vue sur la pertinence ne couvre jusqu’à présent que la recherche de l’excellence dans l’écriture et l’enseignement. Mais ce n’est là que la moitié du problème, car il est tout à fait concevable que des travaux remarquablement pertinents sur le plan social soient réalisés par des universitaires, sans bénéficier d’aucune réception et restant ainsi sans impact réel sur les crises sociales auxquelles ils se proposent de répondre. Cela se produit régulièrement en Afrique et en Europe. Ce n’est pas le lieu de déballer ce problème particulièrement difficile. Il suffit de rappeler que dans mon introduction, j’ai insisté sur une perspective descriptive des universités, qui nous aide à les considérer comme faisant partie de la fibre complexe des relations sociales locales, nationales et internationales, informelles et institutionnelles. La crise de la philosophie et de beaucoup d’autres sciences humaines et sociales est qu’elles se battent tellement pour l’indépendance et la liberté de pensée, qu’elles n’accordent pas l’attention nécessaire pour resituer leurs résultats dans cette fibre sociale. Ce n’est qu’en s’engageant dans les réseaux sociaux et les technologies de diffusion des idées, et en s’engageant dans un travail interdisciplinaire et des alliances entre l’université et d’autres acteurs sociaux, que l’on peut espérer traduire une recherche pertinente en réception et en impact social. Cependant, il ne s’agit pas non plus d’une fin heureuse, car qui parle des relations qui tissent la fibre sociale, parle d’influence, de pouvoir et d’intérêts et cela ouvre le problème tout à fait difficile des compromis au nom de l’efficacité. À défaut, les universitaires pourraient rechercher la pureté, mais au prix de l’insignifiance sociale. Je répète qu’il s’agit d’une crise du monde universitaire en Afrique, mais pas moins en Europe.
5. Situer le monde universitaire dans le contexte des acteurs sociaux accentue la question du droit à la parole et de la capacité à être entendu. Cette question s’inscrit dans la crise actuelle de deux manières.
5.a. L’intégration/exclusion horizontale. Les arguments concernant la participation légitime au débat public peuvent se disqualifier en mobilisant des arguments similaires à ceux de leurs adversaires les plus évidents à l’autre bout du monde et du champ politique. Le point pourrait également être abordé sous un autre angle. La prétention répandue d’accéder à l’universalisme dans la pensée européenne reflète un principe de non-discrimination, que je soutiens de tout cœur. Cependant, le manque d’attention à l’écart entre la prétention à l’universalité et son instanciation particulière de facto, continue de marquer la pratique intellectuelle en Occident[25]. Comment prendre en compte la diversité, sans perdre l’idéal d’universalisme qui s’oppose à la discrimination ?
5.b. Intégration/exclusion verticale. Dans toutes les universités, les universitaires jouissent d’une position de privilège relatif quant à la manière dont leurs propos sont pris au sérieux. Cela ouvre le risque d’abus sous forme de paternalisme et d’élitisme. L’enjeu est de savoir dans quelle mesure nous pouvons intégrer ou faire valoir les points de vue des plus démunis dans notre pensée. C’est toute une boîte de Pandore, abordée en Europe dans la théorie critique ou le pragmatisme sociologique, et en Afrique depuis des décennies dans les débats sur le statut de l’« ethnophilosophie ». S’il semble donc souhaitable d’intégrer nos recherches non seulement à la vie de nos étudiants et aux acteurs puissants de la société, mais aussi aux précaires de chaque société – voire de la société mondiale dans son ensemble – il n’existe pas de recette claire pour y parvenir[26].
Ces cinq points nous ramènent à la pratique du pluralisme, dont la forme mondialisée que j’appelle la philosophie intercontinentale, mais avec un regard incertain sur l’avenir.
Références bibliographiques
CÉSAIRE Aimé, 1955, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine.
EBOUSSI-BOULAGA Fabien, 1977, La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie, Paris, Présence Africaine, p. 136.
EZE Emmanuel, 2010, Race and the Enlightenment. A reader, Cambridge, Blackwell.
FRASER Nancy, 2008, Scales of justice. Reimagining political space in a globalizing world. Cambridge, Polity Press.
HOUNTONDJI Paulin, 1977, Sur la « philosophie africaine ». Critique de l’ethnophilosophie, Paris, Maspero, pp. 219-238.
JULLIEN François, 2008, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Paris, Fayard.
MAMDANI Mahmood, 2016, « Between the public intellectual and the scholar: decolonization and some post-independence initiatives in African higher education », in Inter-Asia Cultural Studies, N°17/1, 2016, pp. 68-83.
MAMDANI Mahmood, 2012, Define and rule. Native as political identity, Cambridge & Londres, Harvard, U.P.
MERLE Marcel, « L’anticolonialisme », in Marc Ferro (ed.) Le livre noir du colonialisme. XVIe – XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, Pariis, Arthème Fayard/Pluriel, pp. 815-862.
OKONDA Okolo, 1986, Pour une philosophie de la culture et du développement. Recherches d’herméneutique et de praxis africaines, Kinshasa, Presses universitaires du Zaïre.
TAIWO Olufémmi, 2010, How colonialism pre-empted modernity in Africa, Bloomington: Indiana University, Press.
WOLFF Ernst, 2006, « Anatomie van ‘n teologiese ideologie : die Hervormde Kerk se steun aan die apartheid ideologie », in Historia: the Journal of the Historical Association of South Africa 51 (1), 2006, pp. 141-162
WOLFF Ernst, 2016, « Décoloniser la philosophie. Autour des contestations universitaires en Afrique du Sud », in La Vie des Idées 2016 (https://laviedesidees.fr/Decoloniser-la-philosophie.html) et Ernst Wolff, « Four questions on curriculum development in contemporary South Africa », South African Journal of Philosophy, 35 (4), 2016, pp. 444-459.
WOLFF Ernst, 2021, Lire Ricoeur depuis la périphérie. Décolonisation, modernité, herméneutique. Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, pp. 93-116 (accès libre : https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/48482).
WOLFF Ernst, 2013, « Reform and crises. Reflexions and questions on the condition of the Human and Social Sciences in South Africa and beyond », in Theoria: A Journal of Social and Political Theory 60 (135), 2013, pp. 62-82.
WOLFF Ernst, 2012, « Sanctus Marthinus laudator philosophicus. Or, sitting at the guru’s feet », in Martin Versfeld. A South African philosopher in dark times, Leuven: Leuven University Press, 2021, pp. 175-190 (accès libre: https://lup.be/collections/category-philosophy/products/172317).
NOTRE DEVOIR ET NOTRE FOI AU CARACTERE UNIVERSEL DE L’UNIVERSITÉ
Thiémélé L. Ramsès BOA
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La démocratie cognitive, la démocratie participative, la laïcité et l’éducation à l’altérité sont nécessaires à l’accomplissement de la mission universelle de l’université. Notre rêve d’assumer ces valeurs fait de nous les acteurs principaux de la crise de l’université.
Mots clés : Averroès, pluralisme.
Abstract:
Cognitive democracy, participatory democracy, secularism and education in otherness are necessary for the fulfillment of the universal mission of the university. Our dream of assuming these values makes us the main actors in the crisis of the university.
Keywords : Averroès, pluralism.
Introduction
Madame et Monsieur,
En vos grades et qualités,
L’espace cognitif de mon intervention partira de l’expérience vécue en tant qu’enseignant-chercheur et aussi en tant que chef du département de philosophie de l’UFHB. Je vais partir de l’expérience vécue à ces deux niveaux de responsabilité pour bâtir l’architecture de ma réflexion.
Mais, je pars d’un principe que ma vocation d’enseignant-chercheur a traduit dans la rédaction d’un livre[27]. Le principe analytique se fonde sur l’inexistence de la sorcellerie. La conséquence de ce principe, c’est que si la sorcellerie n’existe pas, l’attribution de la causalité revient au sujet agissant. Autrement dit, parce que la sorcellerie n’existe pas, le sujet est responsable de ce qui lui arrive comme négativité car, justement, la croyance en la sorcellerie fonctionne sur le principe du rejet de la cause du mal sur une entité extérieure au sujet agissant. Ramené au thème de ce colloque et au sens de mon intervention, je veux dire ceci : nous sommes, enseignants-chercheurs, personnels administratifs, étudiants, en somme membres du système de l’enseignement supérieur, les premiers responsables de ce qu’on peut considérer comme crise de l’université en Afrique. Le principe de la sorcellerie aurait fonctionné si nous avions accusé en priorité et de façon unique, l’autre, en sa nature multiple en tant que parents d’élèves, l’État, la Société globale, les politiciens, etc. le lieu premier d’expression de notre responsabilité se situe dans le refus d’une dimension de l’université : l’ouverture à la critique, au pluralisme des idées.
1. Valeur du désaccord, valeur du pluralisme
Je pars d’une question issue d’une inquiétude : avons-nous suffisamment intégré l’idée de l’université comme lieu d’échanges de pensées contradictoires, expressions du pluralisme, confrontation des doctrines ou pour le dire autrement le lieu où la liberté transcendantale devient pratique ? Là où existe la liberté, des sujets se retrouvent pour lui donner forme. Si des sujets se retrouvent dans des lieux dédiés à la pensée c’est parce que la liberté a été conquise sur les pouvoirs. Il faut le rappeler, l’université dont nous héritons, s’est émancipée en instituant sa liberté intérieure à l’égard de la religion et des pouvoirs politiques. A partir de la Renaissance, elle décide d’interroger le monde, la nature, Dieu. Elle le fait dans la diversité de pensée contre le dogmatisme clérical de l’époque, contre la pensée unique instituée en dogme et tradition irréfragable.
Cet héritage n’a pas été suffisamment recueilli ici, en Afrique. J’en ai fait l’amère expérience en 2007, à Abidjan à la réunion du département de Philosophie. Permettez-moi de lire le témoignage que j’en fait dans mon livre, aux pages 58 et 59.
Je me souviens comme si c’était hier. En effet, le mardi 12 juin 2007, en tant que chef du département de philosophie, j’avais convoqué le Conseil du département pour une réunion ordinaire. Avant l’adoption de l’ordre du jour par le Conseil, prof Dibi demande la parole pour un préalable, motivé, d’après lui pour des raisons d’éthique. Très en colère, et avec des propos inamicaux et peu fraternels, il s’est demandé si je méritais de diriger notre institution de base, le département de philosophie. Il a estimé, avoir été injurié dans mon ouvrage, Recherches philosophiques, Tome 1 : quelle philosophie pour l’Afrique, Abidjan, Educi, 2007, ouvrage qu’il a lui-même préfacé. En des termes très durs, il a rappelé avoir été mon professeur, avoir dirigé ma thèse d’État et que, à ce titre, je lui devais respect. Après cela, il m’a jeté à la figure le livre en question. Il a refusé d’assister à la réunion puis a quitté la salle non sans avoir promis de ne plus jamais assister aux réunions tant que je serai à la tête du département. Du reste, il a tenu parole durant les trois années de mon mandat de chef de département. (Thiémélé L. R. Boa, 2020, p. 58-59.)
Pour moi, l’université est le lieu de la liberté de pensée et de la pluralité. Nous devons vivre la confrontation des idées comme l’essence de notre présence en ce lieu. La polémique doit être essentielle en ce régime universitaire. La conflictualité théorique y est centrale. Une université compétitive fabrique une société démocratique qui est à la fois une société qui assume ses divisions mais cherche à étendre le champ de désaccord. C’est à ce prix qu’elle produit doctrines et écoles de pensées, anime les instituts de recherche et irrigue la société de l’intelligence.
Nous y voyons, hélas, les ainés brimer les cadets, les enseignants interdire aux étudiants la critique de leurs idées. Comment créer une émulation intellectuelle dans un univers de brimade, d’uniformité intellectuelle, de monolithisme gnoséologique ? J’ai appris à mes dépens que le monde de l’université et de la recherche est bien un champ de bataille où s’affrontent tout autant, les sentiments, les affects les idées et la raison. Mais bien souvent, nous prenons le parti des sentiments et des affects contre la raison. Certes, la relation avec le maître, dans tous les milieux, est une relation d’affection, de confiance mutuelle et d’échange, mais elle ne peut se faire dans une perpétuelle soumission de l’élève. Était-ce une façon pour le maître Dibi Kouadio de maintenir l’esprit du mandarinat qui fait que, quel que soit le degré de profondeur de ses idées, le maître est toujours, en comparaison avec son disciple, dans une position supérieure ? Comme le reconnaît F. Waquet, le champ universitaire contient l’une des configurations élémentaires d’exercice du pouvoir : la relation maître-disciple, relation hiérarchique entre un supérieur et un inférieur, un dominant et un dominé, un patron et un client (F. Waquet, 2008, p. 90). Le mandarinat, fondé sur les jeux de pouvoir sous le signe de la domination, de la sujétion et de la rivalité côtoie dans le milieu universitaire l’enthousiasme intellectuel, l’affection partagée et le plaisir de travailler à la construction des idées. La place dévolue aux relations interpersonnelles devrait être minime à une période où le savoir est largement institutionnalisé. La relation magistrale, parce qu’elle est une relation interpersonnelle, combine à la fois la subjectivité des émotions et l’objectivité des cadres théoriques. Elle devient du reste de plus en plus problématique à notre époque d’interdisciplinarité où la parcellisation du savoir pose la question de l’unicité du maître. Le disciple recompose une figure magistrale divisée dans une pluralité intellectuelle de formation.
Ainsi, la crise de l’université pourrait avoir pour cause la perpétuation d’une vision unitaire du savoir, une approche monolithique de la vérité détenue par une classe de savants. La notion contemporaine d’interdisciplinarité rend caduque la figure du maître censé tout savoir. Elle offre à notre regard un horizon global de la connaissance universelle. Son programme est, selon Georges Gusdorf, « le rassemblement des approches de l’intelligibilité selon la multiplicité des vocations individuelles et la diversité des perspectives de la culture mondiale » (G. Gusdorf, 1977, p. 647). Pour que ce programme de multiplicité et de diversité puisse aboutir, G. Gusdorf recommande « une sorte de polythéisme épistémologique, respectueux des discordances et discontinuité, des intervalles » (Idem). L’université serait ainsi en crise à cause de son attachement viscérale à la formulation de l’unicité des savoirs détenue par une catégorie de sachants. La crise est d’autant plus fréquente que cette catégorie refuse la discussion théorique, la confrontation des doctrines. Or, c’est la pluralité des perspectives, la pluralité des points de vue et des positions qui fait émerger le monde commun de la connaissance.
2. L’université comme espace de sublimation de la conflictualité dangereuse
Ce même schéma de refus de la confrontation avait été vécu deux années auparavant, en 2005. A l’époque chef de département, j’avais chargé mon adjoint, de superviser l’élection du président de la promotion des étudiants de niveau Licence, aujourd’hui, on dirait de la L3. La période de campagne avait été lancée ; 6 candidats, avaient déposé leurs dossiers. La veille du scrutin, à ma grande surprise, le responsable me trouve au bureau et tente de me convaincre de l’idée d’un consensus entre les 6 candidats. Il voulait éviter les élections qui pourraient, selon lui, déboucher sur des conflits et la violence en milieu universitaire. Je n’étais pas d’accord avec ce procédé ; il a insisté. Finalement, l’élection au suffrage universel n’a pas eu lieu ; un des candidats, a été présenté comme celui que les 5 autres avaient désigné. Quand le résultat fut proclamé, un des candidats malheureux est venu contester à la fois la décision du choix consensuel et le mode de désignation qu’il a jugé antidémocratique et autoritaire. J’ai estimé qu’il avait raison. Mais compte tenu de la période (période d’examen, fin d’année proche, etc.), j’ai dû convaincre ce candidat de laisser tomber sa requête.
Au fond de moi-même, je savais, en réalité que cet étudiant avait raison car justement l’université est le lieu d’apprentissage de l’attitude citoyenne. Elle est le lieu de l’engagement des étudiants qui, sortant de leur particularisme religieux et communautaire, abandonnent la tendance à utiliser la force, apprennent à parler, à argumenter, à convaincre par la puissance du verbe et à vaincre la timidité. S’ils ne peuvent le faire en ce lieu dédié à la pluralité, où et quand vont-ils en faire l’expérience ? On le sait tous aujourd’hui : c’est parce que des individus sont privés du droit à la parole que l’usage de la force brute, de la violence devient le recours premier et principal dans la vie ordinaire. Pour moi, les élections du délégué de Licence était un champ d’expérimentation de l’action politique et de la liberté démocratique. L’espace universitaire doit être pensé comme lieu de sublimation de la conflictualité. En permettant le débat électoral, on encourageait ainsi la réflexion sur l’intérêt général. Ce faisant, on parvient à purifier cet espace de la conflictualité dangereuse.
Là où règne la parole, les hommes ont la possibilité de discuter et de s’accorder sur le bien commun. Mais là où la parole fait défaut, les hommes deviennent des ennemis et leur monde devient un monde de violence. L’incapacité à argumenter, la peur de prendre la parole en public, l’impossibilité de pouvoir agir ensemble, de façon concertée, poussent les individus à la ruse, la manipulation et la violence. Lorsque l’université n’offre pas aux étudiants la possibilité d’exprimer leur capacité de dialogue, d’écoute et de respect de l’autre à travers des élections libres, transparentes et inclusives, ils grandissent avec l’idée que les adversaires politiques sont des ennemis à abattre. Ils font ainsi du jeu politique une conception étroitement liée à l’usage de la violence. Ils peinent à abandonner la violence au profit du dialogue.
Dans ce deuxième exemple, il nous faut, ici aussi, reconnaître notre responsabilité dans le refus de former des citoyens capables de privilégier la confrontation verbale ou la juridiction de la palabre. Ce faisant, nous accélérons le dépérissement démocratique.
3. L’interdisciplinarité et la pluralité des formes de savoirs
Le troisième et dernier groupe de fait est intervenu, d’abord quand j’étais le chef de département ensuite quand j’ai été nommé responsable du Comité scientifique de notre département. Des étudiants sont venus me voir. Ils estimaient que des enseignants transformaient leurs cours en moment de recrutement des militants de leurs partis politiques. Le cours se transformait à la fois en campagne électorale et en institut de formation idéologique. Le second groupe était venu pour des raisons religieuses. Ils estimaient que l’islam était souvent vilipendé et le christianisme présenté comme essence de la religion. Le professeur transformait les cours en campagne d’évangélisation et de délivrance des âmes. Dans le deuxième cas, la nature laïque de notre institution et de l’Etat était foulée aux pieds ; dans le premier cas, la politique partisane faisait son nid au cœur d’une institution qui par essence, doit se mettre au-dessus de la mêlée.
Aujourd’hui, ces deux dangers continuent d’exister. Ils sont même aidés par l’enfermement communautaire ou, pour le dire trivialement, le tribalisme. Dans les trois cas, l’université souffre de deux genres de pensées closes : d’abord, la pensée parcellaire de l’idéologie partisane qui prend la partie pour le tout de l’Etat, l’autre, la pensée de la propagande religieuse et la dernière, la pensée fermée, repliée sur l’ethnie ou la communauté. Ces trois cas trahissent le caractère universel de l’université car, il faut le rappeler, l’université vise l’universel, elle se pose sur fonds de l’universalité. Or la politique partisane, l’endoctrinement religieux et le repli communautaire concilient difficilement l’ouverture à l’altérité et l’universalité. Ils piétinent le principe de la laïcité que je défends de toute ma force. Ils la foulent aux pieds en voulant, de manière exclusive s’accaparer l’Etat et ses institutions. Seule cette laïcité de mise à distance peut permettre de réaliser une des missions de l’enseignement que Edgar Morin exprime ainsi :
Enseigner la citoyenneté terrestre, en enseignant l’humanité dans son unité anthropologique et ses diversités individuelles et culturelles, ainsi que dans sa communauté de destin propre à l’ère planétaire, où tous les humains sont confrontés aux mêmes problèmes vitaux et mortels (E. Morin, 1999, p. 114).
Pour résoudre les risques de stigmatisation de l’islam, il m’a semblé important d’étudier la philosophe d’Averroès (1126-1198), penseur de l’ère almohade. L’étude de ce philosophe du reste tombait à pic. Elle permettait de donner solution à deux problèmes : d’abord ouvrir nos offres de formation à la pensée arabo-musulmane, ensuite, elle intervenait comme solution aux risques d’obscurantisme véhiculés par le fondamentalisme musulman.
En effet, j’ai ramené la justification du cours sur la philosophie d’Averroès (Ibn Rushd) à 5 principales raisons
Raison 1. Sortir de la philosophie classique des auteurs dits célèbres en portant notre attention sur la philosophie du Moyen Age.
Raison 2. Recenser dans la construction de cette philosophie classique, ce qu’elle doit aux auteurs oubliés, peu étudiés dans le cursus universitaire de notre université.
Raison 3. Montrer comment la philosophie dite classique a été influencée par des auteurs et des problématiques à la fois lointaines mais proches, non-occidentales.
Raison 4. Montrer l’influence de la civilisation et de la culture arabo-musulmane sur la philosophie occidentale dite classique en espérant combattre les préjugés ethnocentriques dont nous héritons et qui veulent effacer les sources non grecques de la civilisation européenne. Cet espoir s’appuie sur les dires d’Alain de Libera : « Que les « Arabes » aient joué un rôle déterminant dans la formation de l’identité culturelle de l’Europe [est une chose] qu’il n’est pas possible de « discuter », à moins de nier l’évidence » (A. de Libera, 1991, p. 104). L’Occident avait presque oublié l’héritage antique. Aux XIe et XIIe siècle seront traduites de l’arabe au latin, en Espagne et en Sicile, les œuvres d’Avicenne, Averroès, Idrisi. Elles portent sur la médecine, la philosophie, le Droit, la géographie, etc. Cette influence sera culturelle au double sens d’influence à la fois intellectuelle qu’agricole puisque par la même voie seront cultivés en Occident l’abricot, la courgette, la pastèque, le riz, l’orange, le blé dur, le coton et la fauconnerie. L’existence d’articles d’usage courant sera révélée aux Occidentaux par les Arabes : sucre, limonade, divan, le jeu d’échec (qui vient du mot shah), la mousseline, le mohair, etc. (S. Hunke, 1984, p. 14).
Raison 5. Au moment où, à travers l’actualité politique de certaines régions la cohabitation difficile entre religion/politique/science est en arrière-plan des conflits sanglants, il s’agit de voir comment leur voisinage a été pensé par les ancêtres intellectuels ou humains de ceux qui se battent aujourd’hui. Ils oublient, ces combattants actuels que pour Averroès la foi et la raison sont les deux méthodes pour arriver à une seule vérité. La science et la foi ne s’excluent pas l’une l’autre. Elles aident à rechercher une seule vérité.
Raison 6. Voir comment la religion musulmane a rayonné sur la pensée mondiale alors qu’aujourd’hui une tendance obscurantiste interne à l’islam même privilégie la mise en sommeil de la raison en refusant les débats contradictoires. Averroès nous montre au contraire que la philosophie a toujours fait partie de l’identité musulmane. La philosophie n’est pas une activité étrangère ; elle est aussi bien occidentale qu’orientale. En tant que faisant partie de l’histoire humaine, elle appartient aussi à l’histoire musulmane. Dès lors, tout penseur peut puiser dans ce patrimoine universel d’avant l’islam :
Mais si d’autres que nous ont déjà procédé à quelque recherche en cette matière, il est évident que nous avons l’obligation, pour ce vers quoi nous nous acheminons, de recourir à ce qu’en ont dit ceux qui nous ont précédés. Il importe que ceux-ci soient ou non de notre religion… Par ceux qui ne sont pas de nos coreligionnaires, j’entends les Anciens qui ont étudié ces questions avant l’apparition de l’islam (Averroès, 1996, p. 109-111).
En quoi ce penseur pouvait constituer un rempart contre l’étouffement de la raison ? Averroès répond à sa manière à la question du statut et de la place de la philosophie dans une société musulmane. Son expérience du rapport islam et philosophie aboutit à l’affirmation de rapports nécessaires et licites. Il est licite pour un individu de faire de la philosophie s’il est un musulman. Pour celui qui en a le talent, c’est vivement recommandé et même obligatoire. Etant donné que nos talents, d’une certaine manière, nous sont gracieusement octroyés par Dieu, ne pas y répondre, c’est en quelque sorte ne pas répondre à la volonté divine. Un musulman qui ne se sert pas de la raison donnée par Dieu commet un sacrilège.
Les philosophes ne sont ni meilleurs ni pires que la masse. Ils doivent respecter leur propre nature et répondre à un appel qui est dans le Coran et qui les encourage de manière explicite à l’examen rationnel de tous les étants. Dieu, ayant voulu s’adresser à l’ensemble de l’Humanité s’est ainsi adressé à chacun de ses membres. Il appartient aux philosophes de s’engager dans l’effort personnel d’interprétation des versets dont certains sont obscurs, avec un sens littéral et un sens caché. Cet effort personnel est la condition d’un progrès intérieur, spirituel et scientifique. En approfondissant le sens de l’écrit, le philosophe fait progresser la raison ; et tout progrès de la raison se reflète dans un enrichissement du sens de l’écriture. Comme le dit Alain de Libera commentant ce double mouvement :
Le philosophe est au fond engagé dans un double mouvement : un travail philosophique tout court et une multiplication du sens de l’écriture qui fait que celle-ci apparaît pour ce qu’elle est : d’une richesse infinie. Donc le philosophe n’est pas l’ennemi du sens. La métaphore pour lui n’est pas stérile ou vaine (A. de Libera, 1998-1999, p. 19).
Témoin d’une époque qui voit la prolifération d’un nombre de sectes philosophiques et théologique en luttes les unes contre les autres, Averroès va y percevoir un grand danger. Elles donnent, selon lui, le spectacle d’une victoire de l’irrationalité où sont absentes l’intelligence et le questionnement critique. Il lutte contre les théologiens, les Mu’tazilites (ou figure du sophiste dans l’islam). Fustigeant l’attitude des Ash’arites, un groupe de théologiens il les accuse d’avoir substitué des interprétations imaginaires à son examen rationnel :
Leurs penseurs spéculatifs sont devenus des oppresseurs pour les Musulmans, en ce sens qu’une fraction des Ash’arites a déclaré que quiconque ne reconnaitrait pas l’existence du Créateur – louangé soit-il- d’après les méthodes qu’eux-mêmes ont instituées dans leurs livres pour Le connaître était infidèle alors que les infidèles, les égarés, ce sont eux en vérité ! (Averroès, 1996, p. 165).
La philosophie et la théologie étant menacées, il fallait les sauvegarder afin de préserver les droits et la liberté de la spéculation philosophique. Les théologiens également s’en inquiétaient car la discussion des textes du Coran se répandaient dans tous les milieux. Il attribue le mal à ce qu’on autorise l’accès de la philosophie à des esprits incapables de la comprendre. Quel est le remède qu’il propose ? Pour lui, ce remède est dans une exacte définition des divers degrés possibles de l’intelligence des textes coraniques et dans l’interdiction signifiée à chaque esprit de dépasser le degré qui lui convient.
Les hommes se répartissent donc du point de vue de la Loi révélée en trois classes :
Ceux qui ne sont absolument pas hommes à connaître l’interprétation, […] c’est la grande masse des humains, … Ceux qui sont hommes à connaître l’interprétation dialecticienne, [.] Ceux qui sont hommes à connaître l’interprétation certaine, et qui sont [aussi] les hommes assentant par démonstration, […] Exposer quelqu’une de ces interprétations à quelqu’un qui n’est pas homme à les appréhender [- …] conduit tant celui à qui elle est exposée que celui qui les expose à l’infidélité (Ibidem, p. 157).
Averroès défend la philosophie. Non seulement il la défend par nécessité rationnelle, mais par nécessité divine. La loi divine elle-même invite à une étude rationnelle de l’univers pour qui sait lire clairement les recommandations du Coran :
Que la Révélation nous appelle à réfléchir sur les étants en faisant usage de la raison, et exige de nous que nous les connaissions par ce moyen, voilà qui appert à l’évidence de maints versets du Livre de Dieu – béni et exalté soit-IL. En témoigne, par exemple, l’énoncé divin : « Réfléchissez donc, Ô vous qui êtes doués de clairvoyance », qui est une énonciation univoque du caractère obligatoire de l’usage du syllogisme rationnel… (Ibidem, p. 105).
Averroès, veut concilier philosophie et religion. Ou encore, il montre la nécessité d’un rapprochement et la nécessité d’une distinction entre sagesse (raison) et religion (foi). Sans définir une primauté de la philosophie sur la religion ou de la religion sur la philosophie, il estime que la vérité du Coran peut être démontrée grâce à la raison. Si l’usage de la raison est rendu obligatoire par le Coran, c’est parce que celui-ci est un texte de nature rationnelle, constitué de propositions démontrables. Le Coran est un discours sur Dieu. Il y démontre son existence.
Averroès ne combat pas la religion ; son objectif est de raffermir la foi. Il demeure, malgré tout, un philosophe croyant, un musulman qui s’interroge sur la forme d’intelligibilité à introduire dans le monde à partir de sa croyance :
Son but n’est pas de délivrer du croire ou de la croyance, c’est de délivrer des faux croyants, nous délivrer de ceux qui donnent toujours le choix entre savoir et croire. Et qui prétendent tout régler et disposer de ce choix en disant : nous, nous savons ce que croire et nous savons tout… Et c’est cette figure du théologien sectaire qui noie la masse des croyants dans de fausses interprétations, les entraine sur les chemins de l’infidélité, du fanatisme et de l’intolérance et ce sont ces mêmes théologiens qui prétendent rivaliser avec les hommes de science et imposer leurs interprétations allégoriques là où le philosophe essaie de donner une exégèse rationnelle (A. de Libera, 1998-1999, p. 19-20).
Pour lui, la connaissance intellectuelle forme l’essentiel de la sagesse humaine. Elle est l’unique fin de la vie humaine et la source de la suprême félicité. Des théologiens sectaires l’accusèrent injustement de se consacrer au culte de la philosophie aux dépens de son devoir religieux. On peut dire qu’il professa un islam des Lumières dont l’université et notre époque peuvent s’inspirer.
Conclusion
Je voudrais m’arrêter ici, dans la relation de ces faits d’expérience. Mon fin mot, est un encouragement à tous : j’ai foi en l’université. Elle traverse certes des moments difficiles, mais elle saura les résoudre parce qu’elle en a les ressources. Nous sommes tous habités par cette « condition indispensable à tout enseignement : l’éros, qui est à la fois désir, plaisir et amour, désir et plaisir de transmettre, amour pour la connaissance et amour pour les enseignés » (E. Morin, 1999, p. 113). En somme, nous avons tous foi dans les possibilités de l’esprit humain. Et c’est pourquoi nous sommes venus nombreux ici aujourd’hui en ce lieu. Nous y sommes parce que conscients de cette mission : l’université doit établir l’homme dans sa dignité et sa responsabilité en en faisant un citoyen du monde qui recueille dans tout le passé culturel de l’humanité ce qu’elle a donné de meilleur et de noble. Chacun est invité, malgré les turbulences propres à une œuvre grandiose, à croire cela possible. Merci de votre aimable attention.
Références bibliographiques
AVERROES, 1996, Discours décisif, traduction inédite de Marc Geoffroy. Introduction d’Alain de Libera, G-F Flammarion.
BOA Thiémélé Ramsès, 2010, La sorcellerie n’existe pas, Abidjan, Les Editions du Cerap.
BOA Thiémélé L. Ramsès, 2020, Reconstituer le corps glorieux d’Osiris. Abidjan, Les Editions Kamit, p. 58-59.
GUSDORF Georges, 1997, « Passé, présent, avenir de la recherche interdisciplinaire », in Revue internationale des sciences sociales, Vol. XXIX (1977), N°4, p. 627-648.
HUNKE Sigrid, 1984, Le soleil d’Allah brille sur l’Occident : notre héritage arabe, traduit de l’allemand par Solange et Georges de Lalène, Albin Michel.
LIBERA Alain de, « Extraordinaire et douloureuse modernité d’Averroès » Entretien avec Alain de Libéra, in Confluences Méditerranée, N°28, Hiver 1998-1999.
LIBERA Alain de, 1991, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil.
MORIN Edgar La tête bien faite. Repenser la réforme. Réformer la pensée. COLLECTION « L’HISTOIRE IMMÉDIATE » Éditions du Seuil, 1999.
WAQUET Françoise, Les enfants de Socrate. Filiation intellectuelle et transmission du savoir XVIIe-XXIe siècle. Paris, Albin Michel, 2008, p. 90.
DEUXIÈME PARTIE : AXES DE RÉFLEXION ET ATELIERS
PREMIER AXE : GOUVERNANCE ET FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS
Kobenan Maxime KOUMAN
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Cet article met en exergue les moments de prestige des universités africaines et leur déconstruction progressive due à la mal gouvernance de nos États. Si au moment des indépendances, l’université faisait rêver et les universitaires étaient enviés, force est de constater qu’aujourd’hui, c’est une désillusion généralisée. L’université est devenue l’ombre d’elle-même. Le sujet cherche donc à diagnostiquer les causes de cette déconfiture et partant proposer des solutions pour une revalorisation de nos temples du savoir. Le désintérêt dont elles font l’objet de la part des gouvernants est à l’aune des crises répétitives que sont les grèves interminables, les effectifs pléthoriques dans les amphithéâtres et dans les cités dortoirs, la fuite des cerveaux…C’est le début d’une liste de problèmes qui peut s’étaler à l’infini. Il est donc temps d’entreprendre des reformes structurelles et institutionnelles en repositionnant les universités au centre des projets de développement des États. Il s’agit de façon concrète de procéder à une décentralisation des universités et d’œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie et de travail de ses principaux acteurs.
Mots clés : Crisologie, Décentralisation, Déconstruction, Mauvaise gouvernance, Réformes.
Abstract:
This article highlights the moments of prestige of African universities and their progressive deconstruction due to the poor governance of our States. If at the time of independence, the university was a dream and academics were envied, it is clear that today there is widespread disillusionment. The university has become a shadow of itself. The subject therefore seeks to diagnose the causes of this discomfiture and therefore propose solutions for a revaluation of our temples of knowledge. The disinterest they are the object of on the part of the rulers is in the light of the repetitive crises that are the interminable strikes, the overstaffing in the amphitheatres and in the dormitory towns, the brain drain… This is the beginning of a list of problems that can go on forever. It is therefore time to undertake structural and institutional reforms by repositioning universities at the center of state development projects. This is a concrete way of decentralizing universities and working to improve the quality of life and work of its main actors.
Keywords : Crisology, Decentralization, Deconstruction, Bad Governance, Reforms.
Introduction
Est-il nécessaire d’être un expert en crisologie pour constater que les universités d’Afrique subsaharienne présentent un visage hideux, sinistre et pâle en comparaison à celles d’ailleurs ? Cette question aux accents pessimistes peut paraître hâtive, brutale et même choquante. Malheureusement, l’analyse factuelle du fonctionnement de nos institutions universitaires montre que celles-ci, depuis les années 1980, ont connu des fortunes diverses épousant les convulsions et la météo politico-économique des États en devenir. Au-delà des discours populistes et démagogiques, des déclarations cosmétiques et chatoyantes des décideurs politiques, la plupart des gouvernants d’Afrique subsaharienne semblent porter très peu d’intérêt à la recherche universitaire. Les universités font figure de parent pauvre dans le flot des programmes de développement des États. Ces lieux, qui jadis étaient appelés « Temple de savoir » sont devenus des sortes de dépotoirs où les États déversent le flux de leur jeunesse devenue trop embarrassante et encombrante. Ce constat est au fondement de ce sujet de réflexion intitulé « Mauvaise gouvernance endémique des États africains : Approche synoptique des universités en déconstruction ». Pourquoi les universités africaines sont-elles en proie à des crises interminables qui les défigurent et les déstructurent ? Quelles stratégies faut-il adopter afin de réformer et réhabiliter ces institutions de savoir ? Le sujet se propose de comprendre les causes profondes de cette crise. L’article part de l’hypothèse selon laquelle nos universités sont en déconfiture parce que nos États ont démissionné et accorde très peu d’intérêt à la recherche. Il s’ensuit qu’une telle étude ne saurait se passer d’une plaidoirie en faveur d’une réappropriation ou d’une renaissance du système universitaire africain. Ainsi, cette étude, à travers une méthode analytico-critique, s’articule autour de trois axes majeurs : le premier axe permet de montrer la mission historique qu’ont accomplie les universités dans le développement du continent africain. Le deuxième axe fait une analyse crisologique des universités africaines. La dernière partie met en exergue les défis et des esquisses de solutions qui sont, entre autres, des pistes pour une redynamisation des universités africaines.
1. Approche historique des universités africaines : un défi pour le développement du continent
1.1. La mission historique des universités africaines
Au lendemain de la vague des indépendances, chaque État africain se devait d’emprunter le chemin du développement qu’avait tracé le colonisateur. La construction des universités était l’un des éléments catalyseurs de ce chantier. Cette institution était considérée, à juste titre d’ailleurs, comme le laboratoire qui donnerait à la société africaine les intelligences capables de booster ou d’orienter le développement d’un continent qui a commencé à panser ses plaies issues d’une longue période coloniale et impériale. L’université qui est ce lieu de « démocratisation de la connaissance universelle » (D. Bailly, 2001, p. 6), est au cœur de ce projet herculéen qui n’est autre que celui de suivre le modèle de développement administratif, social et économique du colonisateur. Ainsi, grâce à l’enseignement universitaire, chaque citoyen, selon D. Bailly (2001, p. 7) pouvait « voler, à l’instar de Prométhée, le feu de la connaissance », qui est le gage d’un succès social. L’université est pour ainsi dire une institution où l’égalité de chance était une réalité. Tout le monde y avait accès et « constituait pour les oubliés du destin et de l’histoire, l’unique espoir de se faire une place au soleil » (D. Bailly, 2001, p. 7). Cette égalité de chance pour tous, dans l’acquisition du savoir, était une aubaine pour ceux qui, par leurs origines (pauvres) étaient astreints à la pauvreté et la misère. À travers donc la possession de ce feu prométhéen, n’importe quel jeune africain pouvait devenir un « Titan » dans la société. L’une des premières missions, et non des moindres, assignées à l’université après les indépendances, était de former des leaders éthiques susceptibles d’animer une administration compétente, exemplaire, dans un environnement favorable pour tous. Pour P. Gueye (2003, p. 21) « la mission principale de l’université était de fournir des cadres aux autres ordres d’enseignement et à l’État. »
L’Afrique post-coloniale était appelée à s’assumer et à s’affirmer afin de rentrer dans le concert des continents respectés. La construction des universités participait à cette indépendance politico-administrative. “La fierté” de tout État nouvellement indépendant, c’est d’affirmer sa souveraineté, c’est-à-dire la capacité qu’a un État de s’auto-déterminer. En effet, « la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une république » (J. Bodin, 1951, p. 122). L’auteur montre que la souveraineté possède ce caractère à elle propre de ne se déterminer que par elle-même. Elle est un attribut essentiel de l’État. La souveraineté marque l’absoluité du pouvoir d’État. (J. Bodin, 1951, p. 135). Pour s’affranchir d’une longue période d’emprise coloniale, l’enseignement supérieur avait donc pour rôle de créer les conditions nécessaires d’une souveraineté effective des États africains, en formant d’une part des cadres compétents et compétitifs et d’autre part, en développant une main d’œuvre productive pour les industries naissantes. Ainsi des universités d’enseignement général et des universités de formation technique et professionnelle ont vu le jour dans presque toutes les capitales d’Afrique. Le rôle éminemment important que jouaient les universités dans cette vision ambitieuse conférait à cette structure toutes ses lettres de noblesses.
1.2. Réputation et prestige des universités / universitaires
Les premières universités des années 60, période d’indépendance de la plupart des États africains subsahariens, ont acquis une réputation, un prestige sans précédent. Ces institutions d’enseignement supérieur étaient considérées comme des pôles d’excellence. Du coup, les rares jeunes qui ont la chance d’être appelés étudiants recevaient les honneurs familiaux et de toute la société. C’était une fierté et un honneur pour les familles et l’étudiant lui-même d’être appelé universitaire. L’étudiant faisait l’objet d’admiration de tous. Selon le rapport de la BAD (Banque Africaine de Développement), Département du développement humain (OSHD) de juillet 2007, « Au cours des années 50 et 60 (…) la qualité des installations répondait aux besoins des étudiants et des enseignants, tout en reflétant le prestige dont jouissaient les intéressés dans les différents pays ». (Rapport de la BAD, 2007, p. 1). Pour atteindre ces objectifs de façon efficace et efficiente, l’enseignement supérieur bénéficiait de ressources adéquates de qualité qui lui permettaient de maintenir des normes académiques élevées.
Les orientations à l’université se faisaient en fonction des principaux postes de responsabilité au sein de l’administration et des entreprises. Le prestige de l’étudiant venait, d’une part, du fait qu’il était vu comme un substitut du « Blanc », homme intellectuel au savoir immense et parlant parfaitement la langue du colon, et d’autre part, l’étudiant ignorait le concept de chômage, car le nombre de postes disponibles dans les administrations était largement supérieur au nombre d’étudiants diplômés. Les offres d’emplois étaient supérieures aux demandes. C’était la chasse aux fonctionnaires, aux enseignants des lycées et collèges, aux universitaires, aux ingénieurs, aux médecins … Les propos d’E. Dernintseva (2014, p. 21) sur le sujet sont très édifiants : « Après les indépendances, les nouveaux États africains furent confrontés à la pénurie de cadres en mesure de travailler dans les organes du pouvoir et d’occuper les postes administratifs autrefois réservés aux Européens ». Les universitaires étaient considérés comme des “messies” terrestres qui, une fois sortis des Temples du savoir, devaient apporter le salut d’un développement holistique aux sociétés africaines encore très jeunes et très fragiles. Ce salut se matérialisait par une diffusion des connaissances reçues du colonisateur qui ne sont autres que la formation et le perfectionnement de la main d’œuvre, le progrès social et la modernisation de l’économie par sa formation et sa codification, conformément aux normes internationales.
Malheureusement, ce prestige dont jouissaient ces structures dispensatrices de connaissance, a commencé à péricliter à partir des années 1980. La machine productrice de savoir a commencé à se gripper. Les causes de cette décadence sont à rechercher non seulement dans la gouvernance endogène des États par les décideurs africains, mais aussi dans le diktat des services financiers internationaux. C’est le début de la crise des universités, définie comme crise politique, économique et sociale.
2. Analyse crisologique des universités africaines
Aujourd’hui, force est de constater que le prestige et l’honneur dont jouissaient nos institutions universitaires et le personnel enseignant ainsi que leurs étudiants sont en perpétuel déclin. Une approche crisologique de cette situation peut permettre de saisir ses tenants et ses aboutissants. Cependant, avant toute analyse, il convient d’éclaircir le concept de « crise ». Du grec « krisis », le terme crise désigne une période d’incertitude, un changement brutal qui désorganise l’ordre initial. C’est un « moment où (…) surgissent des incertitudes ». (E. Morin, 2016, p. 75). Toute crise est par essence désorganisatrice, désagrégation d’une organisation ou d’une structure de référence. Provoquée par un évènement majeur, selon E. Morin (2016, p. 36), la crise constitue une rupture soudaine d’un équilibre, c’est la remise en cause de la survie ou le bon fonctionnement d’un système.
C’est donc conformément à l’acception du concept de crise qu’il faut projeter une analyse profonde de la crise universitaire dans les États d’Afrique. Cette crisologie permet de penser afin de panser les plaies béantes qui gangrènent ces Temples du savoir. En effet, toute crise donne à penser, elle stimule l’intelligence et nourrit l’esprit critique. L’objectif téléologique de cette re-flexion est de trouver des solutions pour relancer la machine puisque dans la pratique « toute crise crée des conditions nouvelles pour l’action » (E. Morin, 2016, p. 41).
2.1. L’impact économique et structurel de la crise
La crise actuelle des universités africaines est le fruit de plusieurs années d’errance et de tâtonnement économique des ressources financières de la part des pouvoirs publics qui avaient le destin des jeunes États en mains. L’histoire récente du continent montre que de 1960 à 1970, l’on a constaté une acceptable croissance économique pour les États africains. L’espoir était grand et permis quant à l’avenir du continent. Toutefois, à partir de 1970, les économies africaines ont commencé à s’essouffler. Ce qui aura pour conséquence l’imposition d’un programme d’ajustement structurel (PAS) qui remettait en cause le modèle de développement qui prévalait jusque-là. Les multinationales tels que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International obligent leurs débiteurs à mettre leurs économies sous contrôle et donc sous « perfusion ». Cela implique également que les États concernés ne soient plus maîtres des décisions de leur programme de développement.
Ainsi les programmes d’ajustement structurel se présentent comme une « aide ou le financement d’un programme accompagné de conditions portant sur l’économie dans sa totalité » (B. N’Gom, 1984, p. 81). Ces programmes ont ceci de particulier qu’ils pétrifient l’activité social (R. Vaneigem, 2004, p. 45). C’est dire que le pouvoir politique n’est plus ce messie dont la mission était de conduire son peuple vers la terre promise. Les économies étant désormais sous tutelle et surtout soumises aux exigences de la rationalité et de l’efficacité, les États ne choisissent plus leur modèle de développement, « l’ère des choix est close » selon les mots de G. Burdeau (1974, p. 224). Cette nouvelle donne signifie que le centre du pouvoir de décision n’est plus endogène, mais plutôt exogène. Il est tenu par des forces centrifuges et abstraites, très peu soucieuses du volet social de la vie des populations. Comme le fait remarquer l’ancien Directeur du FMI, M. Candessus (1999, p. 3) « le programme d’ajustement structurel instaure une nouvelle forme de domination qu’on peut appeler colonialisme du marché au profit des clubs de Paris et de Londres et du G7. » Il est donc clair qu’avec l’avènement brutal de la crise économique et de la recherche des solutions avec les PAS, Les États africains ne tiennent plus la clef de répartition de l’assiette budgétaire de leurs ressources financières. Cela aura nécessairement un impact considérable sur les secteurs prioritaires comme la santé et surtout l’enseignement supérieur.
Dans presque tous les États d’Afrique, en effet, les lignes budgétaires allouées à l’enseignement supérieur ont drastiquement diminué à cause du désengagement des bailleurs de fonds entraînant ainsi une détérioration de la performance des institutions universitaires. Ainsi la crise économique est devenue, en grande partie, la source de la crise universitaire. La mise sous contrôle de la gestion économique des États impacte inexorablement le fonctionnement et la structuration originelle des universités. A. Abdelkader (2002, p. 20) constatait qu’« obnubilés par les instructions de « bonne gouvernance» données par les institutions financières internationales, les nouveaux dirigeants ont ignoré l’enseignement supérieur, considéré comme improductif. »
L’enseignement supérieur, à partir des années 1980, est donc tombé en disgrâce à cause de la mauvaise gouvernance des ressources publiques entrainant ainsi une crise économique aiguë sans compter la faible aide des bailleurs de fonds et des pays bénéficiaires de l’aide qui, confrontés aux effets drastiques de la crise, ont considéré que l’enseignement supérieur est un service public coûteux et inefficace. L’université ne s’inscrit pas dans une production immédiate de gain financier comme les entreprises de biens de consommations. L’université forme les ressources humaines susceptibles de servir les entreprises et les administrations publiques. Or les services financiers internationaux, devant l’ampleur de la crise économique, ont tout de suite opté pour l’investissement dans les secteurs producteurs de revenus immédiats au détriment des secteurs de formation. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur le bon fonctionnement de ces structures d’accueil.
2.2. Des grèves répétitives et de la violence estudiantine
La crise économique survenue dans les années 1980 a affecté considérablement le fonctionnement et la stabilité des universités dont le point culminant fut l’année 1990 avec l’avènement du multipartisme, élément inspirateur de la création de plusieurs « syndicats avec toutes les tendances : radicales, inconditionnelles et modérées » (S. Klotioma, 2001, p. 8). En effet, l’une des caractéristiques de toute crise est qu’elle génère le doute, la suspicion quant à la réalité du devenir du danger. Toute crise est d’abord une rupture avec l’ordre ancien et est révélatrice d’un avenir incertain. C’est donc cette incertitude du lendemain, cette situation économique chaotique, avec une jeunesse déboussolée et désemparée, qui va déterminer leur comportement et orienter la lutte syndicale. Quand « l’horizon est bouché » (S. Klotioma, p. 8) et que l’étudiant est « voué à un perpétuel questionnement » (S. Klotioma, p. 8) sans une réponse concrète de la part des décideurs, il ne reste que la violence comme mode d’expression pour ces syndicats estudiantins naissant et qui rêvent d’un changement de vie et d’étude ici et maintenant. Les nombreuses crises sociales telles que les grèves des étudiants et des enseignants témoignent du malaise profond que les acteurs des institutions universitaires ressentent. Cette situation s’empire d’année en année avec des effectifs qui ne cessent d’être pléthoriques et encastrés dans des infrastructures devenues trop exiguës. P. Gueye (2004, p. 42.) résume ici le visage sombre et sinistre des universités africaines : « les images récurrentes, dans nos universités et institutions de formation, d’amphithéâtres et de salles bondées, avec des apprenants assis à même le sol ou accrochés aux fenêtres sont saisissantes pour tout enseignant ou visiteur. » C’est le cas par exemple de l’université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire) qui, construite dans les années 1963 pour 6000 étudiants, accueille aujourd’hui environ 70 000 étudiants avec des infrastructures presqu’à l’identique. Cette insuffisante des infrastructures d’accueil impacte considérablement la qualité de la formation et donc des diplômes. En effet, l’on assiste à une élasticité des années académiques qui s’étalent sur presque toute une année, voire deux années. Les maquettes pédagogiques sont souvent exécutées à moitié ou survolées en raison de l’insuffisance criarde des salles de TD (Travaux Dirigés) ou d’amphithéâtres pour les CM (Cours Magistraux).
Il faut relever également une insuffisance remarquable des cités dortoirs des étudiants. À Abidjan, on compte par exemple 12 000 lits pour presque 100 000 étudiants que comptent les deux universités de ladite ville (Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY et l’université Nangui Abrogoua). La conséquence de cet état de fait est que certains étudiants qui, n’ayant pas de tuteur dans la capitale ivoirienne, sont obligés d’élire domicile, une fois la nuit tombée, dans les amphithéâtres où étudiantes/étudiants passent la nuit, couchés sur des nattes ou des matelas de fortunes (cartons ou des morceaux de pagnes). Quant à la bourse d’étude, elle ne couvre que 5% des étudiants. Cela s’avère très insignifiant pour des étudiants issus en grande majorité des couches sociales très défavorisées. Nombreux sont les étudiants qui, ne possédant pas d’outils informatiques (ordinateurs) se voient dans l’impossibilité d’accéder à internet, et donc ignorent toute idée de « bibliothèque virtuelle » ou encore toute idée de « prise des cours à distance ».
Ces conditions de vie et d’étude archaïques amènent les étudiants et leurs mouvements syndicaux à trouver comme moyen d’expression des grèves à répétition avec leur corollaire de violences. La violence est devenue une forme de refuge pour des apprenants dont le seul espoir repose sur la magnanimité de la providence. Le cas de la FESCI (Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire) crée en 1990, est édifiant à ce sujet. Pour cette mythique organisation qui a eu comme leaders charismatiques Soro Guillaume (1992-1994) et Blé Goudé (1994-1996), entre autres, la violence est devenue une méthode d’action et de revendication, avec son cortège de démesures, de dérapages et de défiance de l’autorité compétente. S. Klotioma synthétise cette violence caractéristique de la FESCI en ces lignes :
Cette barbarie s’opère par l’annexion des territoires dont l’ex-cité de Yopougon nommée le « Kwa Zulu Natal » où les étudiants régnaient en maître absolu et semaient la teneur. Quand ils voulaient, ils délogeaient, ils pillaient, ils brûlaient (…) À cette époque c’était l’usage du pétiole, des boîtes d’allumettes et des bâtons comme moyen d’affrontement. Le cas de la mort de Thierry Zébié est encore frais dans les mémoires.
Avec le temps, on a pu constater que les machettes et les gourdins se sont substitués aux stylos. Ces actes barbares sont nourris par l’accumulation des sentiments de frustrations, d’aigreur, de colère (E. Neveu, 2002, p. 26). L’abandon brutal et précipité de la politique sociale qui préexistait au bénéfice des étudiants, est, en grande partie à l’origine de ce comportement anti-social qui frise l’état de nature hobbesien. L’accumulation d’une bonne somme de frustrations a ceci de particulier qu’elle produit, selon E. Neveu (2002, p. 26) « le potentiel nécessaire à l’engagement dans des actes violents. » Le cas de la Côte d’ivoire n’est qu’une représentation générale de ce qui se passe dans la plupart des universités africaines. J. F. Kobiané et M. Filon (2017, p. 351) ont donné le cas du Burkina Faso où les universités font face à d’énormes défis en termes de capacités d’accueil et de qualité d’enseignement. C’est le même constat au Cameroun, au Congo-Brazza, au Niger, etc. Le 20 janvier 2020, les enseignants-chercheurs du Niger, par exemple, ont entamé leur deuxième mois de grève pour revendiquer une augmentation de salaire et une amélioration substantielle de leur condition de travail. Lors de ces arrêts de travail, Nabala Adaré, le Secrétaire Général du Syndicat des Enseignants-chercheurs du Supérieur (SNECS) a déclaré devant la presse nationale et internationale qu’il n’y a rien qui avance en termes de solutions entre la corporation et les autorités étatiques. Ces exemples peuvent se multiplier à l’infini dans tous les États d’Afrique subsaharienne. En somme, il convient de souligner que c’est l’incapacité des États à donner aux institutions universitaires, les conditions nécessaires d’étude qui est au fondement de la cristallisation de la crise dans ces temples du savoir.
2.3. De la démotivation des « maîtres à penser »
La gestion laxiste des ressources financières, greffée au poids de la dette caractéristique de la mauvaise gouvernance entachent fortement la qualité de l’enseignement supérieur. La dégradation de cette performance se constate à l’aune de la condition peu envieuse du corps enseignant. Il est à noter que le « doctorat » en tant que diplôme suprême dans le cursus universitaire, ne fait plus rêver tant est que les mesures pécuniaires qui devraient subséquemment le soutenir font défauts. Comparés à d’autres agents similaires ou inférieurs en grade, on note que les enseignants du supérieur sont constamment animés par un sentiment de frustration (P. Gueye, 2004, p. 24). Prolétarisés par des salaires de misère, les titulaires de la chaire ou des travaux dirigés sont devenus peu enthousiastes et sont tentés d’aller vendre leur expertise ou leur « cerveau » ailleurs. L’eldorado pour les enseignants d’Afrique, c’est « là-bas », le lointain devenu proche grâce à une mondialisation qui, en effaçant les frontières, transforme les intellectuels des États du Sud en proies trop faciles pour les puissants, c’est-à-dire les États du Nord. La fuite des cerveaux est une réalité en Afrique. Les pays pauvres, qui peinent à rémunérer les intellectuels à la hauteur de leur diplôme, deviennent impuissants au départ de ceux-ci vers les pays riches qui les reçoivent gratuitement puisque n’ayant pas participé à leur formation. Ce sont donc des cerveaux bien pleins, « une expertise de pointe et souvent expérimentée » (I. Diène, 2003, p. 8), que l’Afrique donne gratuitement sans contrepartie, aux États déjà développés.
On a pu constater également que la recherche de revenues complémentaires amène les gardiens du peuple à se muer en homme d’affaires, à être les suppôts des hommes politiques (Directeur de cabinet, chef de cabinet, attaché de mission, conseiller …). Ces emplois secondaires ou emplois de fortune appelés “gombos” en Côte d’ivoire, permettent d’avoir des revenus additionnels afin de compenser les trous financiers laissés par le salaire de base trop insuffisant pour combler les dépenses du mois. L’enseignant-chercheur se voit donc partout en train de « prostituer » son savoir moyennant quelques revenus complémentaires.
À ces facteurs démotivants, s’ajoutent le cloisonnement et l’immobilisme des enseignants qui deviennent peu compétitifs et très peu efficaces scientifiquement car étant coupés des schèmes de connaissances de leurs collègues des autres universités. Ce manque d’enthousiasme s’approfondit avec un accès très limité à internet qui est cette forme virtuelle de mobilité. Internet est devenu un outil sine qua non dans l’acquisition et la dispensation de la connaissance. Comment consulter les bibliothèques numériques si les universités continuent d’œuvrer avec des méthodes moyenâgeuses ? Comment dispenser des cours à distance si les institutions universitaires n’ont pas accès aux NTIC ? Ce fut le cas de l’université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody qui s’est trouvée dans l’incapacité d’organiser des cours à distance durant la période décisive de la pandémie de la COVID-19, faute d’infrastructures adaptées pour les besoins de la cause. Le risque était trop grand d’entasser enseignants et enseignés dans des amphithéâtres devenus trop petits à cause des effectifs pléthoriques. Au Gabon, pour les mêmes motifs, les portes des universités sont restées fermées durant deux années avant de s’ouvrir timidement pour cause de COVID-19. Ces facteurs caractéristiques des universités qui s’étiolent à mesure que le temps passe, ne favorisent pas la passion et l’ardeur au travail des dispensateurs du savoir. Cela suppose qu’il faut les repenser pour panser les maux qui minent les universités africaines.
3. Défis et stratégies pour une re-construction des universités en Afrique
Le diagnostic de la crise ayant montré que la mauvaise gouvernance des biens publics par l’autorité compétente étant à l’origine de la décadence précipitée des universités africaines, et les conséquences supra mentionnées étant évoquées, il faut maintenant s’orienter vers de nouvelles perspectives en proposant des pistes pour une (re)-forme ou une (re)-construction de la société du savoir en Afrique. La (re)-construction doit être pensée comme ce qui prend en compte les infrastructures, les acteurs, l’économie et le leadership avec une gouvernance démocratique institutionnelle des universités.
3.1. Décentralisation géo-infrastructurelle des universités
L’une des clefs, et non des moindres, de la résolution des crises universitaires, passe nécessairement par la mise en œuvre d’une bonne politique sociale qui prenne en compte le développement des structures d’accueil afin de désengorger celles déjà existantes. Autrement dit, il faut une réorientation de la politique de construction des universités, à travers une politique de décentralisation des espaces d’accueil. L’erreur commise au lendemain des indépendances, c’est d’avoir concentré la construction des édifices universitaires dans les capitales politico-économiques, sans avoir une vision de projection et d’anticipation sur le futur. Il est donc temps de décentraliser les espaces géographiques d’enseignement en prenant en compte la cartographie des États.
Pour y arriver, les États d’Afrique noire doivent investir massivement dans le social et l’éducation. Il faut sortir du diktat des institutions financières internationales qui nourrissent l’idée selon laquelle l’enseignement universitaire est improductif. J. Y. Moisson (1999, p. 15) incrimine, à sa juste valeur, la stratégie d’endettement pratiquée par la haute finance internationale en la rendant responsable du retard de développement de l’Afrique. Si donc « l’échec social des stratégies d’ajustement structurel » (K. Mustapha, 1999, p. 7) étant constaté, il faut revenir sur les investissements des structures de formation de l’élite de demain qui est la clé de voûte de tout développement. Tout processus de développement n’est réussi que lorsque les décideurs nationaux ciblent, en toute indépendance, les secteurs vitaux capables de booster la croissance et le progrès de manière durable. Et l’un des secteurs vitaux et dynamiques qui soutient le développement et qui nécessite un investissement sérieux, c’est l’enseignement supérieur. C’est dire que l’échec des PAS doit amener les décideurs africains à ne plus suivre aveuglement ceux que K. Mbaya (2000, p. 2) appelle « les marabouts et les marchands du développement » qui sont ces soi-disant experts et qui proposent des stratégies et méthodes de développement extraverties et donc inadaptées aux réalités endogènes.
Investir donc en décentralisant les structures d’accueil, c’est rapprocher l’université des populations des provinces, c’est créer des pôles de formation de proximité afin de maintenir, d’une part, les étudiants dans leurs régions d’origine et donc non loin de leurs familles, et d’autre part, éviter leur entassement dans une seule université susceptible de créer des crises. Aussi faut-il noter que la décongestion des facultés ne peut se faire aujourd’hui de manière efficace sans prendre en compte la révolution numérique. Il s’agit d’équiper les universités d’Afrique en exploitant les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies. Avec l’enseignement digitalisé ou enseignement numérique, on peut décentraliser virtuellement les espaces de formations en permettant d’une part aux enseignants de donner des cours à distance, et d’autre part en permettant aux étudiants de se former en étant chez eux. L’université de demain est celle de la mobilité virtuelle qui supprime les cloisonnements. Désormais, il est possible de démystifier l’apprentissage dans les amphithéâtres en se formant chez soi ou à partir de son lieu de travail. Cette nouvelle forme d’enseignement basée sur une culture technologique doit être un défi prioritaire des États africains, s’ils veulent être au rendez-vous du donner et du recevoir du savoir au cours du 21e siècle naissant.
La plupart des universités africaines avaient du mal à trouver des solutions à l’engorgement des amphithéâtres durant la crise de la COVID-19. Les cours à distance n’ont pu être assurés faute d’une connexion efficace à internet ou d’un accès ouvert à tous. C’est donc sous un stress et une peur permanents que les différents acteurs du système universitaires ont pu sauver ces institutions de formation. Un grand effort d’investissement est donc à faire dans ce domaine. Outre cette nouvelle forme d’enseignement, le digital permettra à ces nombreux étudiants démunis financièrement d’avoir accès aux bibliothèques numériques et une ouverture vers de nouvelles formations et de nouvelles compétences, donc un accès au savoir universel.
3.2. Valorisation des maîtres et gouvernance institutionnelle : De la prise de conscience à l’urgence
L’université africaine de demain doit résorber la crise actuelle en faisant de la condition enseignante une priorité. Le mal étant diagnostiqué, il faut penser maintenant à le guérir. Il urge d’aller au chevet de ces malades que sont les sociétés du savoir en Afrique. Au-delà de la construction des infrastructures supra-mentionnées, il faut que les dispensateurs de la connaissance soient revalorisés à la hauteur de leur qualification. Cela sous-entend que les États africains doivent donner un traitement salarial spécial aux universitaires afin que ceux-ci ne soient pas tentés d’aller monnayer leur savoir-faire vers d’autres secteurs ou hors du continent. L’exode des cerveaux africains est dû en grande partie au traitement insuffisant et aux conditions archaïques de travail. L’amélioration de leurs conditions de vie et de travail est l’une des conditions pour les rendre peu envieux des autres fonctionnaires. Cela permettra de mieux les stimuler et les motiver. En faisant le diagnostic de la crise actuelle de l’enseignement supérieur, P. Gueye (2004, p. 24) relevait que « la différence de traitement avec d’autres agents similaires ou inférieurs en grade est à l’origine de la fuite interne de compétences, c’est-à-dire du départ des universitaires vers d’autres secteurs ». La frustration due à une prolétarisation de l’enseignant-chercheur le rend vulnérable et l’expose à toute sorte d’offre jugée plus alléchante et attrayante. Ainsi à défaut d’aller monnayer son savoir en Occident, l’enseignant africain est plus séduit et happé par la politique où des voitures de service, des primes colossales et des voyages de mission lui sont réservés.
Aussi faut-il résoudre l’épineux problème du cloisonnement des acteurs en Afrique afin d’éviter la routine, la démotivation et l’inefficacité du chercheur. « Le confinement intellectuel » a pour conséquence le retard scientifique. L’enseignant universitaire est un citoyen du monde à travers ses voyages d’études, sa participation aux différents colloques internationaux qui sont des cadres d’échanges, de contacts et d’ouverture d’esprit. Le savoir scientifique doit être dynamique et universel. La mobilité fait partie des conditions de compétence et d’efficacité des maîtres du Temple. Il est donc du devoir des institutions universitaires de rechercher, pour les acteurs, des ressources matérielles et financières nécessaires au bon fonctionnement des universités. Cela pourrait être sous la forme d’un partenariat public / privé ou par une budgétisation spéciale de la part des États.
Il faut donc revoir le mode de gouvernance universitaire par une démocratisation de cet espace. Cela implique qu’il faut y associer tous les acteurs tels que le corps enseignant et les mouvements estudiantins. Cette méthode pourrait permettre d’obtenir un cadre de paix et de stabilité, condition d’une formation et d’apprentissage optimal en milieu universitaire. L’absence de cogestion des instances universitaires est souvent l’une des causes des crises qui plombent le bon fonctionnement de ce secteur. L’implication de tous les acteurs dans les prises de décision est une manière de responsabiliser tout le monde afin de prévenir ou de résoudre les conflits. Imposer des décisions de façon unilatérale à partir du sommet ne peut que créer les germes d’une future crise. A contrario la concertation et le dialogue sont des armes efficaces contre les mécontentements et les grèves.
Conclusion
Au terme de notre réflexion sur les récurrentes crises universitaires d’Afrique subsaharienne, il ressort qu’il est temps de tirer la sonnette d’alarme afin de réveiller les consciences sur les causes et les conséquences qui les sous-tendent. L’approche diagnostic de cette déconstruction/déclinaison, nous conduit à l’idée selon laquelle les crises universitaires sont avant tout une crise de gouvernance et une mauvaise appréciation ou une sous-estimation du rôle éminemment important que les universités jouent dans le développement holistique des États. Sans toutefois prétendre écrire pour prouver un quelconque génie, nous pensons tout de même qu’il faut (ré) habiliter l’Enseignement supérieur à travers un investissement conséquent et une (ré) vision du fonctionnement administratif en privilégiant une gestion démocratique, participative de tous les acteurs de ce secteur. Ce sont là, des propositions parmi tant d’autres, propositions pouvant permettre de stabiliser et redorer l’image de ces Temples du savoir de l’Afrique.
Références bibliographiques
ABDELKADER Aghadi, 2002, « En Afrique l’Enseignement supérieur sacrifié », in le Monde diplomatique, Paris.
BAILLY Diegou, 2001, « Encore l’école », in le Jour, Abidjan, n°1270.
BODIN Jean, 1951, Les six livres de la République, Paris, PUF.
BURDEAU Georges, 1974, La démocratie et les contraintes du nouvel âge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence.
CAMDESSUS Michel, 1999, « La mondialisation doit s’accompagner d’un volet social », Paris, Développement et coopération, N°6.
DERMINTSEVA Ekaterina, 2014, « Faire des études pour rester : parcours d’étudiants en France », in Migrations société, Paris, N°156.
GUEYE Papa, 2004, « Enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : des pistes pour une réforme », in UNESCO-BREDA, Dakar.
DIÈNE Ibra, 2003, « La fuite des cerveaux dans l’enseignement supérieur : impacts et solutions. » in, International de l’éducation, Dakar.
KANKWENDA Mbaya, 2000, Les marabouts et marchands du développement en Afrique, Paris, L’Harmattan.
KLOTIOMA Soro, 2001, « École ivoirienne », in L’Agora, Abidjan, N° 1050.
KOBIANÉ Jean-François et al., 2017, « Les défis de l’enseignement supérieur au Burkina Faso », in Dynamiques éducatives au Burkina Faso : bilan et perspectives, Ouagadougou, L’Harmattan Burkina.
MUSTAPHA Kassé, 1999, L’Afrique endettée, Dakar, NEAS-CREA.
MUSTAPHA Kassé, 2011, « L’université africaine. De la crise aux réformes », in Actes du colloque « Repositionner les universités dans le développement de l’Afrique », Lomé, Nicolae Railean.
MOISSERON Jean-Yves, 1999, Dette et pauvreté, Paris, Economica.
NEVEU Eric, 2002, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte.
N’GOM Benoît, 1984, Les droits de l’homme et l’Afrique, Paris, Silex.
Rapport de la BAD, 2007.
VANEIGEN Raoul, 2004, Pour l’abolition de la société marchande, pour une société vivante, Paris, Rivages.
Pascal Dieudonné ROY-EMA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
roypascal2007@yahoo.fr / royema@me.com
Résumé :
Durant sa riche carrière professorale, Heidegger va à la quête d’une forme d’idéal universitaire classique. C’est que, pour lui, l’Université n’était pas ou n’était plus conforme à son essence. Elle avait failli à ses missions fondamentales ; ce qui, du même coup, l’avait amputée de sa Selbstbehauptung, sa capacité à affirmer elle-même son autonomie. Dans sa vision, la concordance de l’université avec son essence exige une détermination du corps enseignant à « l’auto-affirmation auto-définissante [qui] autorise l’auto-méditation résolue en vue d’une autonomie authentique ». Si « nous » voulons demeurer dans l’essence de l’Université, explique Heidegger, il faut que la Lehrerschaft – c’est-à-dire le corps enseignant – fasse de « l’autonomie authentique » son principe fondamental. Précisément, il faut qu’elle « devienne forte pour la Führerschaft », la disposition à être chef. C’est alors la capacité de la Lehrerschaft à s’élever à la Selbständigkeit authentiqueaux fins d’être disposée à la Führerschaft qui permettra à l’Université africaine de retrouver son essence.
Mots clés : Auto-affirmation, Auto-définissante, Autonomie authentique, Dasein, Essence,Führerschaft, Lehrerschaft, Université, Wissenschaft.
Abstract:
During her rich teaching career, Heidegger sought a form of classical academic ideal. For him, the university was not or was no longer consistent with its essence. It had failed in its fundamental missions, which, at the same time, had deprived it of its Selbstbehauptung, its ability to assert its autonomy itself. In his vision, the university’s concordance with its essence requires a determination on the part of the teaching body to “self-definition [which] allows resolute self-meditation for authentic autonomy.” If “we” want to remain in the essence of the University, Heidegger says, the Lehrerschaft – the teaching body – must make “authentic autonomy” its fundamental principle. Precisely, it must become «strong for the Führerschaft», the willingness to be leader. It is then the ability of the Lehrerschaft to rise to the authentic Selbständigkeit for the purpose of being disposed to the Führerschaft that will allow the African University to regain its essence.
Keywords : Self-definition, Authentic autonomy, Dasein, Essence, Führerschaft, Lehrerschaft, University, Wissenschaft.
Introduction
Les contributions aux travaux de Heidegger tentent, diversement, d’éclairer la nature et les limites de sa pensée que S.-J. Arrien et C. Sommer (2021, p. 317) qualifient de « legs philosophique majeur du XXe siècle », tout en envisageant la question de sa postérité et surtout de son actualité, pour nous, aujourd’hui, en jetant, ici, un regard synoptique sur le fonctionnement de nos universités africaines.
« Le terme d’université, qui provient du poussiéreux Moyen-Âge, laisserait accroire que l’enseignement prend en vue l’universel dans le savoir » (B. Rappin, 2015, p. 353). Dans le monde, les premières universités se seraient formées dans les douzième et treizième siècles. Celles de Paris en France et de Bologne en Italie, prétendent être les premières qui aient été établies en Europe. L’université serait alors fille de l’Occident ; elle serait fondamentalement une création occidentale avant de se répandre dans les autres parties du monde. Toutefois, il faut préciser que, « si les historiens s’accordent à dire que les premiers embryons de notre université moderne virent le jour au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, leur processus d’apparition est encore l’objet d’âpres débats » (R. Müller, 2003, p. 43).Une filiation continue relierait les institutions d’enseignement arabo-orientales, byzantines et monastiques d’une part, et les universités des XIIe et XIIIe siècles, d’autre part.
En Afrique post-coloniale de façon générale et principalement dans les anciennes colonies françaises, l’université est née au lendemain des indépendances. La première université ivoirienne a vu le jour le 1er octobre 1963, suite à la transformation du Centre d’Enseignement Supérieur d’Abidjan (créé le 3 juillet 1959 par l’arrêté du 11 septembre 1959) en Université d’Abidjan, officialisée par le décret n°64-42 du 9 janvier 1964.
Du latin universitas (« corps, compagnie, corporation, collège, association ») comme abréviation de l’expression médiévale universitas magistrorum et scolarum (association/corps des professeurs et des élèves), l’université est passée, historiquement, comme le disent C. Charle et J. Verger (2012, p. 112-115), d’une institution ecclésiastique jouissant de privilèges royaux et pontificaux, qui était chargée de l’enseignement secondaire et supérieur, à une institution d’enseignement supérieur et de recherche constituée par divers établissements (collèges, facultés, etc.) et formant un ensemble administratif dont le fonctionnement et la gouvernance posent problème aujourd’hui encore, dans plusieurs pays africains.
Actuellement, cela n’échappe à aucun esprit averti que l’Éducation nationale, l’Université et le Savoir sont en crise en Afrique et notamment en Côte d’Ivoire. Dès qu’on débat de l’université aujourd’hui, « les mêmes idées reçues et mots dépréciatifs reviennent : “échec” en premier cycle, “fac parking”, “usine à chômeurs”, etc. » (S. Beaud et M. Millet, 2021, p. 98). Pourtant, les universités jouent un rôle décisif en cette période de consolidation de la construction de nos États en voie de développement.
Pour alimenter le débat de la recherche de solutions aux crises des universités africaines, une lecture serrée du mythique Discours que Martin Heidegger a prononcé le 27 mai 1933 pour sa nomination à la tête de l’Université de Fribourg-en-Brisgau peut s’avérer précieuse. Ce que Martin Heidegger avait dénoncé hier, est encore valable aujourd’hui. Pour lui, l’université comme ensemble administratif n’était pas ou n’était plus conforme à son essence. Elle avait failli à ses missions fondamentales ; d’où son incapacité à affirmer son autonomie. Sous sa plume, le savoir ne doit pas être un simple objet inféodé « au dressage extérieur en vue d’un métier » (O. Jouanjan, 2010, p. 211), à l’espace économique, pour employer des mots d’aujourd’hui. Heidegger opte assez clairement pour une autonomie absolue du champ de la pensée par rapport à ce qui menace de l’absorber, la mise en marchandise et la dérive mondiale des biens de consommation courante, dirait-on aujourd’hui. Ce qui implique que la Lehrerschaft – c’est-à-dire le corps enseignant – se détermine pour faire de la quête de son autonomie authentique, un principe fondamental de sorte qu’elle « devienne forte pour la Führerschaft », la disposition à être chef.
Comment acquérir une forme d’idéal universitaire classique en Afrique ? Comment conformer l’université à son essence et à ses missions fondamentales ? Comment les universités africaines peuvent-elles retrouver leur capacité à affirmer leur autonomie dans une gouvernance authentique ? Pour répondre à ces questions, nous irons, d’une part, à la découverte du contexte historique et du sens du Discours de Rectorat (1) ; et d’autre part, nous exposerons le faisceau de l’idéal universitaire heideggérien, à partir du décryptage des notions de Lehrerschaft et de Führerschaft, qui présente « l’auto-affirmation auto-définissante » du corps enseignant comme postulat (2).
1. Le discours du rectorat
1.1. Contexte historique
Héritière critique de la phénoménologie husserlienne, l’œuvre de Martin Heidegger la plus connue, Être et temps (1927), est fondatrice aussi bien pour l’existentialisme que pour la pensée de la déconstruction. Son projet d’analytique du Dasein propose d’interroger l’existence humaine comprise comme être-au-monde ouvert à la question de l’être. Le Dasein (l’être-là) est cet étant (existant concret) pour lequel il y va en son être de cet être même. La philosophie est comprise ainsi comme ontologie. Heidegger en appelle à la reprise de la question de l’être, en référence à la philosophie grecque antique, celle d’Aristote, de « l’être en tant qu’être », et celle des présocratiques. L’histoire de la métaphysique, parvenue à sa fin, est celle de l’oubli de cette question. « Heidegger en propose la reprise et la déconstruction, au sens où il faut au penseur défaire les scories au cours de l’histoire de la philosophie pour en retrouver le sens originel, le sens existentiel » (C. Sommer, 2010, p. 157).
C’est au moment de la consolidation de l’influence de cette pensée que Heidegger est élu Recteur de l’Université de Fribourg-en-Brisgau le 21 avril 1933. À cet effet, il prononce son discours rectoral, le discours d’intronisation, intitulé « L’auto-affirmation de l’Université allemande » (Die Selbstbehauptung der deutschen Universität), le 27 mai 1933. « Le 1er mai 1933, le philosophe avait adhéré au parti nazi (NSDAP), arrivé au pouvoir le 30 janvier de la même année ; adhésion le 3 mai, antidatée au 1er mai 1933. Heidegger vote pour le NSDAP dès avant 1932 » (C. Sommer, 2010, p. 159). La question de l’engagement national-socialiste de Heidegger a suscité de très vives controverses dans l’histoire de la philosophie.
Malgré la liaison « compromettante » que le Discours peut nous contraindre à faire entre la « philosophie » de Heidegger et son engagement politique, nous souhaitons afficher sur ce point une sorte de neutralité afin de nous soustraire à ce débat toujours vif sur la portée et les conséquences à tirer de l’engagement de Heidegger dans le national-socialisme en renvoyant dos à dos ceux qui « réduisent l’œuvre à une forme sublimée d’un national-socialisme vulgaire » et ceux qui « la détachent de l’engagement politique ». Car comme l’indique C. Sommer (2013, note 7, p. 9), les deux approches « contournent la complexité réelle des liens entre philosophie et politique tels qu’ils se nouent chez Heidegger à partir de 1933 ». L’éclairage platonicien pourrait, peut-être, nous aider à mieux comprendre le lien qui est censé unir gouvernement politique et philosophie dans l’Université du IIIème Reich, et à introduire ainsi dans cette complexité une certaine clarté ; « mais sans pouvoir pour autant permettre d’estimer le degré réel de compromission avec l’idéologie nazie qui ne cesse de faire débat depuis qu’il existe « une affaire » Heidegger » (C. Sommer, 2013, p. 32). Finalement, comme le note le préfacier et traducteur Jean Kessler, « même la parenté platonicienne et tous ces commentaires sur ce point, nous laissent livrés à nous-mêmes, à nos doutes et à nos questions sur l’insondable énigme de cet engagement » (C. Sommer, 2013, p. 2).
Le contexte du Discours de Rectorat fait qu’on peut y reconnaître l’air du temps idéologique national-socialiste, mais nous choisissons ici volontairement de ne pas en chercher les traces. Heidegger démissionnera de son poste de Recteur le 23 avril 1934. Pendant cette période, il exerce diverses activités liées à sa fonction officielle, tout en continuant de dispenser son enseignement universitaire.
La réflexion que nous développons en ces pages entend s’inspirer de celle tracée par un Nicolas Tertulian (« Histoire de l’être et révolution politique. Réflexions sur un ouvrage posthume de Heidegger », in Les temps modernes, vol. 45, N°523, 1990) ou un Jean-Michel Palmier (Les écrits politiques de Heidegger, Paris, L’Herne, 1968) qui cherchent à rendre compte de la dimension sémantique de l’œuvre de Heidegger en la restituant dans le champ qui l’a vue naître. C’est la filiation philosophique de la dimension politique de la pensée heideggerienne qui nous intéresse. Précisons, par ailleurs, que la filiation philosophique du rapport du philosophe au politique chez Heidegger est double, remontant d’une part à Jünger et d’autre part à Nietzsche. Dans son texte de 1945 sur le Rectorat, il souligne l’importance qu’a eue sa lecture de Jünger, avec qui il entretient une relation épistolaire dès les années 1930, pour le développement de sa pensée.
Une telle analyse ne signe pas le rejet de la pensée de Heidegger : elle souhaite plutôt situer les limites à l’intérieur desquelles cette philosophie peut aider à penser la modernité politique et à panser les crises répétitives qui paralysent la gouvernance authentique des universités africaines, point d’intérêt éminent de notre étude.
1.2. Le sens du Discours
Remplaçant à la tête de l’université de Fribourg le social-démocrate von Möllendorf, qui n’exerça sa charge que quelques jours, Heidegger entend rénover l’Université allemande, et par là l’Allemagne tout entière ainsi que la civilisation européenne. Il s’inscrit dans le mouvement de mise au pas (Gleichschaltung) de la société allemande qui vise, au-delà, à poursuivre la « révolution » nationale-socialiste. Le Discours de Rectorat a aussi bien un aspect philosophique qu’un aspect politique.
Le philosophe nouvellement Recteur livre une exhortation aux étudiants et aux professeurs afin de les mobiliser en temps de crise politique. Si l’université a un rôle capital à jouer dans cette crise, « c’est que les événements politiques témoignent selon Heidegger d’un profond oubli quant à ce en quoi consistent essentiellement la connaissance et toute pensée comme telle » (M. Béland, 2006, p. 99).
Heidegger affirme que la connaissance ne serait maintenant comprise que de façon purement instrumentale, technique ; voilà pourquoi selon lui, l’essence de la science est « « vidée et usée ». La pensée et la connaissance, malmenées par la théologie chrétienne aussi bien qu’après (par) la pensée mathématiquement technique des Temps modernes, errent loin de leur origine et de leur grandeur destinale » (M. Béland, 2006, p. 99). Heidegger croit fermement qu’une mission salvatrice pour la pensée occidentale est inscrite dans le destin du peuple allemand et c’est pour cette raison qu’il affirme « avoir accepté le Rectorat de l’Université de Fribourg, afin de prendre part au renouveau spirituel de l’Allemagne et de l’Occident au moyen d’une rénovation interne de l’Université allemande » (M. Béland, 2006, p. 99).
Le Discours en appelle à l’extension du « Führerprinzip » au savoir. Le « Führerprinzip » implique l’idée d’obéissance au chef, de soumission à ses instructions en tant que guide. C’est un principe essentiel du fonctionnement de tout Système, de toute Administration et de toute Gouvernance en tant qu’organisation hiérarchique. Ce principe directeur qu’est le « Führerprinzip », qui se reflète également dans le principe de l’expression comme principe de l’autorité de leadership inconditionnel, était un concept politique et une formule de propagande dans le socialisme national allemand.
Heidegger propose de réorganiser le travail des étudiants en trois « services », du travail, de la défense et du savoir.
La première obligation est celle qui les conduit à la communauté populaire. Elle leur fait un devoir de prendre part à la peine, aux aspirations, aux capacités de tous les membres du peuple, quel que soit leur état, en partageant le fardeau et en mettant la main à la pâte. Cette obligation est désormais fixée et enracinée dans l’existence étudiante par le service du travail. La troisième obligation de la communauté étudiante est celle qui la lie à la mission spirituelle du peuple allemand. Ce peuple travaille à son destin dans la mesure où il place son histoire dans une certaine possibilité : celle de manifester la surpuissance de toutes les puissances formatrices de monde de l’existence humaine, et où il conquiert toujours à nouveau son monde spirituel. (…) Une jeunesse étudiante qui se risque tôt dans l’âge adulte et qui étend son vouloir jusqu’au destin à venir de la nation, s’oblige de fond en comble au service de ce savoir. (…) Mais ce savoir n’est pas pour nous la tranquille prise de connaissance d’essentialités et de valeurs-en-soi, il est la plus tranchante mise en péril de l’existence au milieu de la surpuissance de l’étant. (…) Les trois liens – lien par le peuple au destin de l’Etat dans une mission spirituelle – sont pour l’essence allemande également originels. Les trois services qui sortent de là – le service du travail, le service militaire, le service du savoir – sont également nécessaires et de rang égal. (V. Farias, 1992, p. 126-141).
Le Discours de Rectorat affirme que l’essence de la science est l’unité de trois savoirs : la connaissance du peuple, la connaissance du destin de l’État et la connaissance de la mission spirituelle du peuple. « Heidegger assure que l’unité de ces trois savoirs forme « l’essence originale et pleine de la science dont la mise en œuvre est (la) tâche » des professeurs et des étudiants » (M. Béland, 2006, p. 100).
Mais abstraction faite du contexte, ce qui caractérise la philosophie, on pourrait considérer qu’il s’agit seulement d’une exaltation de la science. La particularité de Heidegger étant une focalisation sur l’origine, « le commencement est encore, il ne gît pas derrière nous […] mais il se dresse devant nous » (M. Heidegger, 2003, p. 19). Et on pourrait y voir une incitation à suivre l’exemple grec : « si nous nous conformons à la lointaine injonction du commencement, alors la science doit devenir l’événement fondamental de notre existence spirituelle-populaire » (M. Heidegger, 2003, p. 21). C’est une forme d’idéal universitaire classique qui ambitionne de réorganiser le savoir et la science, c’est-à-dire tresser un nouveau lien entre l’action et la pensée au sein de l’Université et sous le leadership (Führerschaft) du corps des enseignants (Lehrerschaft).
2. L’idéal universitaire heideggérien
2.1. L’essence de l’Université
Les efforts principaux de Heidegger, considéré comme l’un des philosophes les plus influents du XXe siècle, portent sur la métaphysique traditionnelle, qu’il interprète et critique d’un point de vue phénoménologique, herméneutique et ontologique. Cette posture scientifique et intellectuelle, Heidegger la transporte dans ses ouvrages et dans sa carrière enseignante durant laquelle il va à la quête d’une forme d’idéal universitaire classique.
Mais la conception heideggérienne de l’université est particulière puisque le philosophe argumente que « la tant chantée « liberté académique » se voit chassée de l’université allemande, car cette liberté était inauthentique parce que seulement négatrice » (M. Heidegger, 2003, p. 29). Elle signifiait principalement l’insouciance, l’arbitraire des projets et des inclinations, la licence dans tout ce qu’on faisait ou ne faisait pas.
C’est pourquoi, lors de sa prise en charge solennelle du Rectorat de l’Université de Fribourg-en-Brisgau le 27 mai 1933, Heidegger prône l’auto-affirmation de l’Université allemande et, partant, celle de l’Université tout court. On peut simplement voir dans ce petit texte une apologie un peu particulière de la science (Wissenschaft), renvoyée à son origine plutôt qu’à ses développements.
« Notre réalité humaine (Dasein) – dans notre communauté de chercheurs, de professeurs et d’étudiants – est déterminée par la connaissance (Wissenschaft) » (M. Heidegger, 1995, p. 2). C’est donc la Wissenschaft (science) qui est le principe unificateur de cette « communauté de chercheurs, de professeurs et d’étudiants » que constitue l’université. « La Wissenschaft (…) c’est la condition pour que l’idée d’universitas, d’où l’université tire son nom, accède à la plénitude de sa portée, en tant que communauté de savoir, qui tire de l’idée même du savoir la condition de sa cohésion » (P. Macherey, 2012, p. 19).
Dans son état actuel, l’université africaine est amputée de sa Selbstbehauptung, sa capacité à affirmer elle-même son autonomie, pour reprendre la formule dont Heidegger s’est servi, en 1933 pour intituler son Discours de Rectorat, « die Selbstbehauptung der deutschen Universität » (M. Heidegger, 2003, p. 21).
L’idée même de Selbstbehauptung comporte une référence primordiale au principe du vouloir : « si l’université est en déréliction, en décomposition, comme un organisme dont l’unité se défait, c’est parce qu’elle s’est coupée de ce principe vital » (M. Heidegger, 2003, p. 13) ; en l’absence d’une volonté de savoir authentique, c’est-à-dire une volonté tournée vers l’essence de la science et non vers tel ou tel but particulier, la connaissance n’est plus qu’une tâche technique, dont les résultats se mesurent en termes de réussite ou d’échec matériels. Or la volonté de laquelle le savoir tire sa substance doit être avant tout une volonté spirituelle, faute de quoi elle trahit sa mission, et sombre dans l’inessentiel. Il faut donc opérer « un retour radical à l’origine, reprendre les choses à leur source » (M. Heidegger, 2003, p. 8).
Dans ce discours de prise de la charge de Recteur, Heidegger indique se situer au niveau des essences, qu’il interprète de manière nationaliste : « maîtres et élève ne doivent leur existence et leur force qu’à un enracinement véritable et communautaire dans l’espace de l’université allemande » (M. Heidegger, 2003, p. 7). Cette option volontariste lui fait dire que « l’auto-affirmation de l’université allemande, c’est la volonté originelle, commune, de son essence » (M. Heidegger, 2003, p. 11). On peut voir là se mêler l’essence de l’université et celle de l’Allemagne. Comme quoi, pour Heidegger, l’université doit être « tout entière au service de l’État » (M. Heidegger, 2003, p. 33).
Dans sa vision de l’essence de l’Université, Heidegger invite le corps enseignant à « l’auto-affirmation auto-définissante [qui] autorise l’auto-méditation résolue en vue d’une autonomie authentique » (M. Heidegger, 2003, p. 43). Dans le discours de Rectorat de Heidegger, cet objectif grandiloquent, nous le limitons au cadre universitaire, pour les besoins de notre article.
Si « nous » voulons l’essence de l’Université, explique Heidegger, il faut que la Lehrerschaft – c’est-à-dire le corps enseignant – « devienne forte pour la Führerschaft », la disposition à être chef. Pour ce faire, il faut que le corps enseignant de l’université puisse s’exposer jusqu’aux « postes extrêmes du danger de la constante incertitude du monde », du moins si « nous voulons l’essence de la science ». Il faut que ce corps tienne les positions et que, de là, lui vienne « le questionner commun et le dire communautairement accordé (gemeinschaftlich gestimmte Sagen) ». À cette condition, il sera assez « fort pour la Führerschaft ». C’est donc la capacité de la Lehrerschaft à s’élever ou à correspondre à la Selbständigkeit authentique aux fins d’être disposée à la Führerschaft qui permettra aux universités africaines de retrouver leur essence.
Être chef, c’est moins marcher en tête, qu’avoir « la force de pouvoir aller seul ». Une telle force « relie à l’essentiel », permet la « sélection des meilleurs » et « éveille la Gefolgschaft authentique de ceux qui sont d’un courage nouveau » (François Fédier traduit par « disposition à suivre » (mais : « décision d’accepter de suivre » à la deuxième phrase du Discours), Gérard Granel par « allégeance »). Cette Gefolgschaft n’a nul besoin d’être « éveillée » chez les étudiants, puisque la Studentenschaft – le corps étudiant – « ist auf dem Marsch », est « en marche ». Elle est manifestement mieux préparée, au printemps 1933, à la Gefolgschaft, que le corps enseignant ne l’est à la Führerschaft. Allons scruter davantage les contenus des concepts de La Lehrerschaft et la Führerschaft.
2.2. La Lehrerschaft et la Führerschaft
Dans les travaux de Heidegger, la réflexion sur la Führerschaft est mise en relation avec la Gefolgschaft. Le mot Gefolgschaf se rencontre à deux reprises dans le Discours de rectorat. Dès la deuxième phrase, on lit : « La Gefolgschaft des enseignants et des élèves ne s’éveille et ne se renforce qu’à partir de l’enracinement véritable et commun dans l’essence de l’Université allemande. » (GA 16, p. 107). Puis il est articulé à son partenaire sémantique, la Führerschaft (GA 16, pp. 112-113).
La Führerschaft désigne la direction et la « conduction » (commandement) de l’ensemble des dirigeants (Führer), la Gefolgschaft (comitatus) l’ensemble de ceux qui suivent les dirigeants, « un couple de notions transposé à partir de Tacite, Germania, chap. 13 et 14. En 1933, ces termes, on le sait, sont des termes courants de la LTI (Lingua Tertii Imperii), la langue du troisième Reich » (O. Jouanjan, 2017, p. 317). Or, en voulant imposer la Führerschaft et son principe complémentaire qu’est la Gefolgschaft dans l’institution universitaire, Heidegger semble en effet transposer le Führerprinzip (le principe général de l’organisation sociale) national-socialiste comme principe de commandement et principe de la Gemeinschaft référé en dernière instance à un Auftrag destiné par un Schicksal. Mais, en 1933/1934, il en propose une version hyperbolique si fortement conceptualisée, selon un geste fondamentalement métapolitique, que cette version ne peut que paraître irréaliste ou inintelligible aux yeux des instances précisément dirigeantes du régime. Notons que Heidegger sera officiellement élu Führer-Rektor le 1er octobre 1933, en vertu de la nouvelle constitution badoise des Universités à laquelle il a contribué.
La Gefolgschaft ne peut se diriger elle-même, mais a besoin du Führer (chef, leader) qui marche en tête. Dans le Discours de Rectorat, Heidegger dit qu’être Führer, c’est moins « marcher en tête » que « pouvoir aller seul ». L’idéologue ordinaire n’imagine pas un Führer qui pourrait aller « seul » puisque la Gefolgschaft est toujours vue comme collant à ses basques.
Chez Heidegger, la Lehrerschaft– c’est-à-dire le corps enseignant – se détermine pour faire de la quête de son autonomie authentique, un principe fondamental de sorte qu’elle « devienne forte pour la Führerschaft ». La Lehrerschaft, c’est l’ensemble de ceux qui enseignent et savent enseigner ; c’est la communauté des enseignants. « Le véritable enseignant ne se distingue de l’élève qu’en ce qu’il peut mieux apprendre et a plus authentiquement la volonté d’apprendre. Dans tout enseigner, c’est l’enseignant qui apprend le plus », notait M. Heidegger (1988, p. 85).
Conclusion
La pensée de Heidegger est très opérante pour réfléchir au monde d’aujourd’hui. Heidegger lui-même semblait l’annoncer de façon prémonitoire en écrivant ceci : « Penser, c’est se limiter à une unique idée, qui un jour demeurera comme une étoile au ciel du monde » (M. Heidegger, 1990, p. 21 ». Et c’est à cette tâche que ce texte s’est attelé, modestement, en cherchant dans les regards, les voix et les styles de Heidegger, des mots pour nos universités africaines aujourd’hui.
Le retard et les crises ne résident pas dans l’inadaptation de l’Université à son époque ; ils se logent essentiellement dans le peu d’engagement authentique des universitaires dans sa gouvernance. Mieux, c’est parce que les universités africaines ont des difficultés à correspondre à l’essence de l’Université, parce qu’elles fonctionnent dans l’oubli presque total de l’essence de l’Université, qu’elles connaissent des crises et du retard.
Pour que les universités africaines retrouvent leur essence de paix et de terre fertile à la semence intellectuelle, il faut que les enseignants, en bonne intelligence avec les étudiants et les personnels administratif et technique, se déterminent pour piloter authentiquement le fonctionnement et la gouvernance des universités. Ce qui implique de savoir susciter un leadership avéré, la Führerschaft (disposition à être chef), du corps enseignant (Lehrerschaft) qui permet la sélection des meilleurs et éveille l’adhésion naturelle, c’est-à-dire la Gefolgschaft (disposition à suivre) authentique de ce grand ensemble administratif qu’est l’institution universitaire ; un ensemble de maîtres (le corps des enseignants) et d’élèves (le corps des étudiants), de ceux qui savent et de ceux qui apprennent à savoir, sans oublier les personnels qui assurent la continuité administrative et technique.
Références bibliographiques
ARRIEN Sophie-Jan et SOMMER Christian, 2021, Heidegger aujourd’hui : Actualité et postérité de sa pensée de l’événement, Paris, Éditions Hermann, 540 p.
BEAUD Stéphane et MILLET Mathias, 2021, L’université, pour quoi faire ?, Paris, PUF, 110 p.
BELAND Martine, 2006, « Heidegger, le philosophe et la cité : sur la filiation philosophique d’un engagement politique » in Horizons philosophiques, vol. 16, n° 2, pp. 97–118.
BELLOQ Céline, 2019, Être soi avec Heidegger, Paris, Eyrolles, 184 p.
BERLIOZ Dominique et LOTH François (Dir.), 2022, Métaphysique et Ontologie Autour de Frédéric Nef. Objections et réponses, Paris, Vrin, 378 p.
BLANCHET Vincent, 2021, « Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV-101, Winke I und Winke II (Hefte 1957-1959), éd. et postface de Peter Trawny, Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 2020, 220 p. », Revue philosophique de la France et de l’étranger, vol. 146, N°4, pp. 553-554.
CHARLE Christophe et VERGER Jacques, 2012, Histoire des universités : XIIe-XXIe siècle, Paris, PUF, 384 p.
FARIAS Victor, 1992, Heidegger et le nazisme, Paris, Editions Verdier, 381 p.
GADAMER Hans-Georg, 2018, Vérité et Méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Edition intégrale, Paris, Points, 816p.
GRONDIN Jean, 2019, Comprendre Heidegger : l’espoir d’une autre conception de l’être, Paris, Hermann, 282 p.
HEIDEGGER Martin, 2013, Apports à la philosophie : De l’avenance, trad. François Fédier, Paris, Gallimard, 624 p.
HEIDEGGER Martin, 1995, Écrits politiques : 1934-1966, trad. François Fédier, Paris, Gallimard, 336 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et Temps, traduit de l’allemand au français par François Vézin, Paris, Gallimard, 581 p.
HEIDEGGER Martin, 2020, Gesamtausgabe, IV-101, Winke I und Winke II (Hefte 1957-1959), éd. et postface de Peter Trawny, Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 220 p.
HEIDEGGER Martin, 2003, L’Auto-Affirmation de l’Université Allemande, Edition bilingue, Trad. Gérard Granel, Mauvezin, Trans-Europ-Repress (T.E.R.), 46 p.
HEIDEGGER Martin, 2019, Méditation, trad. Alain Boutot, Paris, Gallimard, 448 p.
HEIDEGGER Martin, 2019, Pensées directrices : Sur la genèse de la métaphysique, de la science et de la technique modernes, Trad. Jean-François Courtine et Françoise Dastur, Paris, Le Seuil, 464 p.
HEIDEGGER Martin, 1988, Qu’est-ce qu’une chose ?, trad. Jean Reboul et Jacques Taminiaux, Paris, Gallimard, 272 p.
HEIDEGGER Martin, 1990, Questions III et IV, trad. Jean Beaufret, Paris, Gallimard, 504 p.
HEIDEGGER Martin, 2021, Réflexions XII-XV : Cahiers noirs 1939-1941, Trad. Guillaume Badoual, Paris, Gallimard, 320 p.
HEIDEGGER Martin, 2010, « Trois lettres à Karl Löwith », Archives de Philosophie, 2010/2 (Tome 73), pp. 321-332.
HEIDEGGER Martin, 2017, Vers une définition de la philosophie, trad. S. Jan-Arrien et S. Camilleri, Paris, Seuil, 290 p.
HEISENBERG Werner, 2006, Physique et philosophie : La science moderne en révolution, Trad. Jacqueline Hadamard, Paris, Albin Michel, 285 p.
JOUANJAN Olivier, 2010, « Gefolgschaft et Studentenrecht : deux gloses en marge du Discours de rectorat », Les Études philosophiques, 2010/2 (n° 93), pp. 211-233.
JOUANJAN Olivier, 2017, « Justifier l’injustifiable : l’ordre du discours juridique nazi » in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2017 :2 (Volume 79), pp. 313-319.
LAYET Clément, 2020, Hölderlin : La démesure et le vivant, Paris, J. Vrin, 400 p.
MACHEREY Pierre, 2012, La parole universitaire. Kant, Hegel, Heidegger, Lacan, Bourdieu et Passeron, Rabelais, Hesse, Hardy, Nabokov, Paris, Editions La Fabrique, 100 p.
MENGUAL Zhong Estelle, 2021, Apprendre à voir : Le point de vue du vivant, Paris, Actes Sud, 256 p.
MÜLLER Rainer, 2003, « La naissance de l’université » in Les sciences au Moyen Âge, Dossier Pour la Science N°37, 120 p.
RAPPIN Baptiste, 2015, Heidegger et la question du management, Nice, Les éditions Ovadia, 366 p.
SOMMER Christian, 2013, Heidegger 1933 : Le programme platonicien du Discours du rectorat, Paris, Éditions Hermann, 64 p.
SOMMER Christian, 2010, « Présentation Autour de Heidegger, Discours de rectorat (1933) : contextes, problèmes, débats », in Les Études philosophiques, vol. 93, no. 2, 2010, pp. 155-162.
SPENGLER OSWALD, 2016, L’Homme et la Technique, Traduit par Christophe Lucchese, Paris, R&N Éditions, 116 p.
LA GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE À L’ÉPREUVE DE LA DISCIPLINE SUR LE CAMPUS AU CAMEROUN
Saidou ABOUBAKAR
Université de Ngaoundéré (Cameroun)
Résumé :
Au Cameroun, depuis la création des premières institutions universitaires en 1961, le paysage de l’enseignement supérieur s’est progressivement enrichi de près de 360 nouvelles institutions universitaires dont 11 universités d’État. Fruits de plusieurs réformes à l’instar de celle de 1993, ces nouvelles institutions ; au-delà du rapprochement de l’université des populations par une meilleure répartition géographique, visent principalement à régler l’épineux problème de la surpopulation estudiantine sur les campus. Des campus où la coexistence obligatoire de trois types d’acteurs à savoir, les étudiants, les enseignants-chercheurs et les personnels d’appui pose un véritable problème de gouvernance universitaire. L’on s’interroge dès lors sur la place de cette dernière dans la disciplinarisation du campus au Cameroun. La réponse à cette interrogation permet de se rendre compte qu’il est clairement prévu des règles qui guident et limitent la conduite des acteurs suscités. Cet encadrement normatif des comportements sur les campus est un important instrument de prévention et de résolution des crises à l’université. Il s’agit donc dans cette étude, de montrer que la discipline est un élément fondamental de la gouvernance universitaire. Nous allons utiliser la méthode analytique, traditionnelle pour le juriste car, s’appuyant sur la technique documentaire, qui va nous permettre de confronter les textes juridiques, la jurisprudence et la doctrine. C’est donc par cette approche que nous nous proposons de faire la présentation de la gouvernance universitaire comme étant le socle tant de la discipline des étudiants que des personnels enseignants et d’appui.
Mots clés : Discipline, Enseignants-chercheurs, Étudiants, Gouvernance universitaire et Personnel d’appui.
Abstract:
Keywords : Discipline, Teacher-Researchers, Students, University Governance and Support Staff.
Introduction
La carte universitaire camerounaise répond aux besoins précis de développement du pays (J. F. Ndongo, 2018, p. 7) et une vue d’ensemble de son architecture se résume à : onze universités d’État[28], sept institutions transnationales d’enseignement supérieur dont deux universités virtuelles de l’Union Africaine, une université panafricaine, une zone franche universitaire, quatre Institutions à Statut Particulier et 349 Instituts Privés de l’Enseignement Supérieur (IPES) dont le statut fut défini par la loi d’orientation de l’Enseignement Supérieur du 16 avril 2001 (A. E. Bella, 2010, p. 332). Ces IPES sont, conformément à l’article 22 alinéa 1 de la loi d’orientation de 2001, créées « à l’initiative des personnes physiques ou morales privées ou par les organisations internationales dans les conditions fixées par des textes particuliers » et « fonctionnent sous le régime de l’autorisation, de l’agrément ou de l’homologation selon les modalités fixées par des textes réglementaires spécifiques »[29].
L’autonomie de l’ensemble de ces institutions est la manifestation tangible d’une gouvernance universitaire réussie au Cameroun. Selon M. Carrier (2010, p. 9), la gouvernance est généralement définie comme « un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions, pour atteindre des buts propres discutés et définis collectivement dans des environnements fragmentés et incertains ». Dans l’enseignement supérieur, on parle de gouvernance universitaire. Structurée autour de trois types d’acteurs à savoir, les étudiants, les enseignants- chercheurs et le personnel d’appui, elle se concrétise grâce à ses organes de délibération et d’exécution. L’ensemble de ces organes se déploie sur un campus couvert par les franchises universitaires, socles de l’autonomie des universités[30]. Elles garantissent d’une part, l’exercice des libertés indispensables au développement de l’enseignement et de la recherche et d’autre part, le bénéfice par les enseignants, d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leur fonction. Mais, les franchises universitaires ne mettent pas l’université à l’abri des crises ou mouvements des membres de la communauté comme en 1972, 1973, 1975, 1978, 1980, 1981, 1991 à l’université de Yaoundé ; 2002 à l’Université de Ngaoundéré ; 2005 et 2013 à l’université de Buea avec mort d’homme en 2005 ; 2010 à l’université de Yaoundé 2. Certaines de ces crises se sont soldées par des actions répressives de l’armée déployée sur les campus afin d’enrayer les manifestations concernant des revendications corporatistes[31]. D’autres ont nécessité l’intervention du Président de la République (A. E. Bella, 2015, p. 301) alors que d’autres encore ont alors que d’autres encore ont été à l’origine des réformes universitaires. On se souvient que la grève de 1975 a été à l’origine du décret n°75/805 du 26 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions du décret n°67/DF/ du 28/12/1967 portant statut de l’université de Yaoundé complété par le décret n°81-536 du 23 décembre 1981. Celles de 1980 et 1981 ont conduit le Président de la République à prendre le décret n° 82/083 du 19 février 1982 fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des associations d’étudiants des Facultés et des Grandes Écoles des Institutions Universitaires. Celle de 1991 a été à l’origine, de la grande réforme de 1993 avec l’éclatement de l’Université de Yaoundé en 6 nouvelles universités d’État par une série de décret du 19 janvier 1993.
La présente réflexion interroge la place de la gouvernance universitaire dans la disciplinarisation du campus au Cameroun. En utilisant la méthode analytique, traditionnelle pour le juriste car, s’appuyant sur la technique documentaire, qui va nous permettre de confronter les textes juridiques, la jurisprudence et la doctrine, nous nous proposons de présenter la gouvernance universitaire comme étant le socle de la discipline des étudiants d’une part, et du personnel universitaire, d’autre part.
1. Gouvernance universitaire, socle de la discipline des étudiants sur le campus
La discipline des étudiants sur le campus universitaire au Cameroun est garantie grâce à une série de règles prévues par divers textes législatifs et règlementaires. Avant de lever un pan de voile sur la sanction disciplinaire en cas de violation desdites règles, il est important de revisiter la procédure y relative.
1.1. La procédure disciplinaire mettant en cause un étudiant
L’analyse des manquements à la discipline estudiantine et la composition du conseil chargé de statuer sur ces manquements permettra de bien comprendre la procédure disciplinaire proprement dite.
1.1.1. Les manquements à la discipline estudiantine
Pour avoir une idée précise de la liste des cas d’infractions disciplinaires dans les institutions universitaires camerounaises, l’on se réfère de prime abord au décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités. Ledit décret dispose en effet que
Tout manquement par un étudiant à la discipline, aux règlements régissant le régime des études, aux règles de la bienséance universitaire, toute participation directe ou indirecte aux actes susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’Institution Universitaire, tout comportement contraire à la dignité universitaire, constituent une infraction disciplinaire[32].
À l’Université de Ngaoundéré par exemple, le cas de la fraude aux examens qui est la principale infraction disciplinaire se décline exactement en : « a. la substitution de personne lors d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ; b. l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ; c. l’obtention par vol, manœuvre ou corruption, de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document matériel non autorisé, ou encore d’une évaluation non méritée ; d. la possession ou l’utilisation avant ou pendant un examen de tout document ou matériel non autorisé ; e. l’utilisation pendant un examen de la copie d’un autre candidat ; f. l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle et g. la falsification d’un document à l’occasion d’une évaluation »[33]. En outre, le fait de signer la copie ou de la marquer d’un signe distinctif peuvent également faire l’objet de sanctions disciplinaires.
1.1.2. La composition du conseil disciplinaire
Les manquements disciplinaires estudiantins sont portés devant le conseil de discipline composé outre du Chef de l’établissement qui en est le Président, du Directeur-Adjoint ou le Vice-Doyen, Vice-président ; d’un Enseignant de l’Établissement désigné par le Chef d’Établissement ; d’un Enseignant de l’Institution-Universitaire désigné par le Chef de ladite Institution ; d’un Représentant de l’Association des étudiants de l’Établissement, tous membres[34].
1.1.3. La procédure disciplinaire proprement dite
La procédure disciplinaire commence au niveau de l’établissement concerné puisque l’exercice de l’action disciplinaire revient, en cas de fraude aux examens par exemple, aux Chefs d’établissements qui saisissent à cet effet le jury d’examen qui n’est autre que le conseil de discipline[35].
Dans le cas de fraude aux examens, l’étudiant suspect est immédiatement exclu de la salle d’examen, puis, en application de l’article 65 du décret n°93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités, un rapport circonstancié signé de deux surveillants est soumis au Chef de l’Établissement. Pour autant ses notes ne sont pas publiées jusqu’à l’aboutissement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, il ne saurait être invité à comparaître aux heures où une matière dans laquelle il compose est programmée. Dès réception du rapport des surveillants donc, le Chef d’établissement réunit sans délai le jury de fraude où l’étudiant mis en cause est convoqué et où les griefs qui lui sont reprochés lui sont lus de même que la sanction encourue, puis il est invité à décliner sa défense. La procédure disciplinaire étant contradictoire, ledit étudiant peut se faire défendre lui-même ou par un avocat de son choix. Si convoqué, il ne se présente pas, une nouvelle convocation lui est adressée par toute voie laissant trace écrite. En cas d’absence à la seconde session du jury de fraude, le conseil statue par défaut et émet un avis sur l’une des sanctions visées à l’article 62 du décret portant dispositions communes aux universités repris par les autres textes réglementaires à l’instar du statut commun des étudiants des Institutions Universitaires Publiques du Cameroun.
1.2. Les sanctions disciplinaires contre les étudiants
Les textes régissant l’enseignement supérieur au Cameroun prévoient clairement des sanctions disciplinaires estudiantines de même que les autorités habilitées à les prononcer.
1.2.1. La typologie des sanctions disciplinaires estudiantines
Intégralement reprises par les autres textes règlementaires, notamment le Statut des étudiants et les décrets portant organisation administrative et académique de chacune des 11 universités d’Etat, les différentes sanctions disciplinaires contre un étudiant sont prévues à l’article 62 du décret portant dispositions communes aux Universités qui précise que « suivant la gravité de la faute commise, les étudiants peuvent être l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : l’avertissement ; le blâme qui peut être assorti d’une suspension partielle ou totale de toute forme d’aide ou d’assistance universitaire ; l’interdiction de se présenter aux examens sanctionnant l’année académique en cours avec suppression de toute aide universitaire ; l’exclusion temporaire d’une à deux années académiques et l’exclusion définitive des Établissements des Institutions Universitaires Nationales ».
Ces sanctions ne sont pas des innovations des décrets issus de la grande réforme de 1993. Elles sont une adaptation (par le retrait de « la suppression de la bourse ») des dispositions du décret n°75/805 du 26 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions du décret n°67/DF/ du 28/12/1967 portant statut de l’université de Yaoundé[36]. De toute manière, une fois constituées et au bout de la procédure disciplinaire, elles sont prononcées par des autorités bien précises.
1.2.2. Les autorités compétentes pour sanctionner les étudiants
Conformément aux dispositions applicables, seul le Chef de l’institution universitaire est compétent pour prononcer la majorité des sanctions contre les étudiants. Il s’agit des sanctions d’avertissement ; de blâme qui peut être assorti d’une suspension partielle ou totale de toute forme d’aide ou d’assistance universitaire et d’interdiction de se présenter aux examens sanctionnant l’année académique en cours avec suppression de toute aide universitaire. Cependant, aux termes de l’article 64 du décret portant dispositions Communes aux Universités, le Chef de l’Institution Universitaire peut déléguer à l’autorité académique et aux Chefs d’Établissements une partie du pouvoir disciplinaire relevant de sa compétence. Une délégation qui ne peut porter que sur l’application des sanctions d’avertissement et de blâme qui peut être assortie d’une suspension partielle ou totale de toute forme d’aide ou d’assistance universitaire.
Les sanctions d’exclusion temporaire d’une à deux années académiques et d’exclusion définitive des établissements des institutions universitaires nationales relèvent de la compétence exclusive du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur après avis du Chef de l’Institution Universitaire. On se souvient de l’affaire des étudiants de l’université de Ngaoundéré qui ont été exclus définitivement des institutions universitaires nationales pour faux baccalauréat tchadien. Dame MAMA BILOA Sandrine a même par la suite saisi le juge administratif en contestation de ladite décision (J.-C. Aba’a Oyono, 2002, p. 23). Aucune sanction ne saurait être prise à l’encontre d’un étudiant à titre conservatoire. Par ailleurs, et en dehors de toute action disciplinaire, les Chefs des Institutions Universitaires et les Chefs d’établissement disposent du pouvoir d’admonestation contre tout étudiant. Ce pouvoir peut emporter incapacité d’être délégué des étudiants pendant une année académique, ou la suppression de toute forme d’aide accordée à l’étudiant pour une durée n’excédant pas trois mois[37].
De tout ce qui précède, l’on comprend parfaitement que c’est grâce à la gouvernance universitaire que les étudiants observent une discipline permettant au campus de jouer pleinement le rôle que lui assigne le gouvernement de la République. Le même constat peut être fait relativement aux personnels universitaires.
2. Gouvernance universitaire socle de la discipline du personnel
La gouvernance universitaire sur le plan managérial ne se limite pas à prévoir la procédure disciplinaire impliquant un personnel. Elle s’assure également que les manquements disciplinaires sont effectivement sanctionnés.
2.1. La procédure disciplinaire impliquant un personnel universitaire
L’enseignement supérieur distingue clairement le personnel enseignant du personnel d’appui. Il est évident que la procédure disciplinaire impliquant le premier soit présentée avant celle du second.
2.1.1. La procédure disciplinaire impliquant un personnel enseignant
Relativement aux infractions disciplinaires, l’article 49 du décret portant dispositions communes aux Universités cite : « tout manquement aux obligations professionnelles que sont notamment l’assiduité aux enseignements, la présence effective dans le lieu de recherche, l’encadrement des enseignants et des chercheurs, l’encadrement des étudiants, la préparation et la surveillance des examens, la correction des copies, les évaluations diverses, la participation aux jurys, la participation aux jurys d’examen, le secret des sujets d’examen et des délibérations des jurys, la participation aux activités d’appui ;
– tout acte portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la déontologie universitaires ; ou de
– tout acte partisan, isolé ou concerté de nature à empêcher le fonctionnement normal et régulier de l’Institution Universitaire ou des Établissements ». Des éléments intégralement repris par les différents décrets portant organisation administrative et académique des universités d’État au-delà de l’article 51 alinéa 3 du décret n° 93/035 du 19 janvier 1993 portant Statut Spécial des Personnels de l’Enseignement Supérieur qui parle aussi de « la participation à la fraude aux examens ou à la complicité ou tentative de complicité à la fraude aux examens ».
S’agissant de la composition[38] du conseil de discipline impliquant un enseignant, il s’agit de :
– le Chef de l’institution Universitaire, Président ;
– le Représentant du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, Membre ;
– le Représentant du Ministre de la Fonction Publique, Membre ;
– le Chef d’Établissement auquel appartient l’Enseignant concerné, Membre ;
– deux enseignants de rang magistral, ou à défaut, deux Chargés de Cours désignés par le Chef de l’Institution Universitaire, Membres ;
– le Représentant au Conseil d’Administration du grade de l’Enseignant concerné, Membre et
– Le Secrétaire Général de l’Université, Greffier.
La présence des 2/3 des membres est nécessaire pour la validité de l’avis émis et le président du conseil a le droit de convoquer toute personne dont le témoignage est susceptible de concourir à la manifestation de la vérité.
Quant à la procédure proprement dite, le Conseil de discipline est directement saisi soit par le Chef de l’Institution Universitaire, soit par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur[39] et instruit les affaires par tous les moyens légaux propres à éclairer la situation sur la base d’un rapport circonstancié. Cependant, il revient préalablement au greffier d’instruire l’affaire. À cet effet, il entend obligatoirement le mis en cause sur procès-verbal, peut convoquer tout témoin en vue de son audition et a accès à tout document ou dossier lui permettant de mener à bien sa mission. À l’issue de l’instruction, un rapport circonstancié est transmis au Président du Conseil de Discipline, à l’effet de provoquer la tenue du Conseil de Discipline, à travers une convocation adressée aux membres dudit Conseil précisant le jour, l’heure et le lieu de la séance.
Le mis en cause est informé par les mêmes voies que les pièces du dossier sont tenues à sa disposition auprès du Greffier, pour consultation sur place et à titre confidentiel, soit par lui- même soit par son défendeur.
La procédure disciplinaire d’un enseignant étant essentiellement contradictoire, le mis en cause doit être convoqué par écrit, au moins cinq (05) jours avant la tenue du conseil. S’il ne se présente pas, l’affaire est renvoyée et il est à nouveau convoqué par voie d’huissier. S’il ne répond pas à la seconde convocation, le conseil de discipline statue par défaut. Le rapport et les pièces du dossier d’instruction sont confidentiels.
L’enseignant traduit devant un conseil de discipline a le droit de se défendre, soit de vive voix, soit par mémoire écrit. Il peut également se faire assister par un de ses pairs ou par tout autre défenseur de son choix par devant le Conseil de Discipline où, selon l’article 58 du décret portant dispositions communes aux Universités, la présence des 2/3 des membres est nécessaire à la validité des avis émis. Des avis rendus à la majorité simple des membres présents régulièrement convoqués, cinq jours au moins avant la séance, mais en cas de partage de voix, l’opinion favorable à l’Enseignant mis en cause prévaut.
2.1.2. La procédure disciplinaire impliquant un personnel d’appui
Le décret portant dispositions communes aux Universités et les différents décrets portant organisation administrative et académique des Universités d’État n’avait pas prévu des dispositions relatives à la discipline de cette catégorie de personnel. Il a fallu attendre l’année 2011 pour qu’un texte règlementaire, notamment le décret n° 2011/119 du 18 mai 2011, soit pris pour fixer les dispositions communes applicables aux personnels d’appui des institutions universitaires du Cameroun. Conformément à l’article 41 du texte susvisé, un Conseil de Discipline des Personnels d’Appui des Institutions Universitaires Publiques du Cameroun est créé au sein de chaque institution universitaire dont le fonctionnement est régi par l’arrêté n°13/0645 /MINESUP du 30 décembre 2013. Ledit conseil se compose du Directeur des Affaires administratives de l’institution universitaire concernée, Président ; d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ; d’un représentant du Ministère en charge du travail ; d’un représentant du chef de la structure ou de l’établissement dont relève le personnel mis en cause et d’un délégué du personnel.
En outre, la décision du Chef de l’institution Universitaire concernée portant traduction du personnel d’appui devant le conseil de discipline, désigne également le Rapporteur et le Secrétaire de séance. Ceux-ci assistent aux travaux du Conseil sans voix délibérative et aucune autre personne n’est habilitée à prendre part aux travaux. La procédure disciplinaire étant contradictoire, tout personnel d’appui doit assister au Conseil et peut se faire défendre par l’intermédiaire d’un avocat désigné par ses soins.
Mais, selon l’article 37 du décret n°2011/119 du 18 mai 2011 portant dispositions communes applicables aux personnels d’appui des institutions universitaires du Cameroun, la procédure disciplinaire commence par une demande d’explications écrite adressée au mis en cause dès la constatation de la faute. Sur son initiative, ou à la demande d’une des autorités investies du pouvoir disciplinaire, le Chef de l’institution Universitaire saisit le Conseil par une décision de traduction du mis en cause, avec copie au Ministre de l’Enseignement Supérieur. Ladite décision indique clairement les faits qui lui sont reprochés, les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, ainsi que les sanctions envisagées à son encontre.
Dès réception de ladite décision, le Président la transmet au Rapporteur, contre décharge, ainsi que l’ensemble du dossier disciplinaire qui doit comprendre tous les documents relatifs aux faits reprochés au mis en cause, notamment ses explications écrites sur ces faits ; toutes les décisions de sanctions antérieures et autres mesures conservatoires, ainsi que les avis et recommandations des différents Conseils de Discipline et toutes pièces relatives à son évaluation.
Il revient au Rapporteur d’instruire le dossier du personnel d’appui mis en cause qui est invité à en prendre connaissance. La communication du dossier disciplinaire au mis en cause doit être intégrale et la lecture est faite sur place.
Le Rapporteur doit faire preuve d’impartialité absolue dans l’instruction du dossier. À cet effet, il procède aux investigations, enquêtes et recherches utiles à la manifestation de la vérité. Après l’enquête au cours de laquelle est entendu sur procès-verbal le mis en cause, un rapport est produit et transmis au Président avec l’ensemble du dossier disciplinaire contre décharge.
Dès réception du dossier de l’instruction, le Président convoque individuellement les membres du Conseil. Ce dernier donne ses avis préalables sur toute proposition de sanction de retard à l’avancement, d’abaissement d’échelon et de licenciement. Les avis qui ne lient pas le chef de l’institution universitaire concernée sont pris à la majorité simple des membres présents, et en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Dès que la procédure disciplinaire est conduite à son terme dans tous les cas susvisés, les sanctions appropriées peuvent dès lors être prises par les autorités compétentes.
2.2. Les sanctions disciplinaires du personnel universitaire
La présentation des sanctions à l’égard du personnel enseignant précèdera celle du personnel d’appui.
2.2.1. Les sanctions du personnel enseignant
L’article 50 du décret portant dispositions communes aux Universités repris par l’article 51 du décret n° 93/035 du 19 janvier 1993 portant Statut Spécial des Personnels de l’Enseignement Supérieur prévoit les sanctions disciplinaires ci-après classées par ordre de gravité croissante :
1) l’avertissement écrit,
2) le blâme avec inscription au dossier,
3) la réprimande qui emporte incapacité d’être membre du Conseil d’Administration pendant une année,
4) la censure qui emporte incapacité d’être membre du conseil d’Administration pendant deux années et qui est incompatible avec toute fonction de responsabilité au sein des Institutions Universitaires,
5) le déplacement d’office pour un emploi équivalent des cadres de l’Enseignement Supérieur,
6) l’ajournement à un an de l’avancement d’échelon à l’ancienneté,
7) la radiation de la liste d’aptitude au grade supérieur pour une période à préciser sur l’acte de sanction,
8) l’abaissement d’échelon,
9) la suspension temporaire de fonctions,
10) la rétrogradation,
11) l’interdiction d’enseigner,
12) la révocation sans suspension des droits à pension, avec suspension des droits à pension, ou avec déchéance des droits à pension.
Quant à l’autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire contre un enseignant après avis du conseil de discipline, elle varie en fonction de la gravité. Ainsi donc, le Chef de l’Institution Universitaire est compétent pour infliger l’une des sanctions relatives à l’avertissement écrit ; au blâme avec inscription au dossier; à la réprimande qui emporte incapacité d’être membre du Conseil d’Administration pendant une année, à la censure qui emporte incapacité d’être membre du Conseil d’Administration pendant deux années et qui est incompatible avec toute fonction de responsabilité au sein des Institutions universitaires et au déplacement d’office pour un emploi équivalent des cadres de l’Enseignement Supérieur.
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur de son côté est compétent pour infliger l’une des sanctions portant sur l’ajournement à un an de l’avancement d’échelon à l’ancienneté, la radiation de la liste d’aptitude au grade supérieur pour une période à préciser sur l’acte de sanction, l’abaissement d’échelon et la suspension temporaire des fonctions.
Le Président de la République est compétent pour infliger l’une des sanctions relatives à la rétrogradation, l’interdiction d’enseigner et la révocation sans suspension des droits à pension, avec suspension des droits à pension, ou avec déchéance des droits à pension.
En cas d’urgence et conformément à l’article 62 du décret n°93/035 suscité portant Statut Spécial des Personnels de l’Enseignement Supérieur, l’enseignant mis en cause peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le chef de l’Institution Universitaire, en attendant la mise en mouvement de la procédure disciplinaire. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois (03) mois. L’acte portant suspension dudit enseignant doit en préciser la durée et indiquer si l’intéressé conserve le bénéfice de la totalité de son traitement, et dans le cas contraire, déterminer le montant de la retenue, qui ne peut être ni supérieure à la moitié du traitement, ni porter sur les prestations familiales. À l’issue de la période de suspension, le Chef de l’institution universitaire réintègre d’office l’enseignant concerné dans ses fonctions si aucune sanction n’a été prononcée contre lui pendant la période de suspension.
2.2.2. Les sanctions à l’égard du personnel d’appui
Pour le personnel d’appui indiscipliné, l’une des sanctions disciplinaires suivantes selon la gravité de la faute peut lui être infligée. Il s’agit, selon l’article 36 dudécret n°2011/119 du 18 mai 2011 Portant dispositions communes applicables aux personnels d’appui des institutions universitaires du Cameroun, de l’avertissement ; du blâme ; de la mise à pied d’un (01) à huit (08) jours ; du retard à l’avancement pour une durée d’un (01) à deux (02) ans ; de l’abaissement d’échelon et du licenciement.
L’autorité compétente pour prononcer la sanction à l’endroit d’un personnel d’appui est d’une part le Chef d’établissement, lorsqu’il est question d’infliger l’une des sanctions relatives à l’avertissement ; au blâme et à la mise à pied d’un (01) à huit (08) jours. D’autre part, il s’agit du Chef de l’institution Universitaire, pour infliger l’une des sanctions portant sur le retard à l’avancement pour une durée d’un (01) à deux (02) ans ; l’abaissement d’échelon et le licenciement.
Conclusion
Au terme de notre analyse, il y a lieu d’admettre que l’influence de la gouvernance universitaire sur la discipline sur le campus camerounais est une réalité indubitable. Ce défi national a ainsi suscité des réactions d’une telle envergure. Les textes accordant des pouvoirs au Ministre de l’Enseignement supérieur et au Président de la République, en leur reconnaissant explicitement la compétence de sanctionner certains membres de la communauté universitaire, relève de ce type de réaction au niveau national. C’est ainsi que l’anthropologie du corps social camerounais dans sa globalité et plus spécifiquement universitaire laisse entrevoir la manifestation du pouvoir dans sa capacité à contrôler et à enrégimenter la corporation universitaire, entendu au sens classique du terme, c’est-à-dire l’ensemble constitué des maîtres et de leurs disciples. Ses modes de figuration et ses représentations, ainsi que note A. E. Bella (2015, p. 325), rendent manifestes sa réalité dans le campus Le défi de la discipline universitaire est aussi perçu ou relevé par les responsables des institutions universitaires pris sur un plan individuel. Les dispositions reconnaissant et instituant le principe des franchises universitaires leur accordant d’importants pouvoirs disciplinaires en sont une illustration. Toute chose qui met en relief le souci du gouvernement d’assurer la paix dans le milieu universitaire afin de lui permettre d’assurer pleinement ses missions. Cependant, force est d’admettre que les normes encadrant la discipline dans la communauté universitaire se révèlent utiles mais insuffisantes. Il faudrait, une audace révolutionnaire pour aller vers une gouvernance universitaire dans laquelle chaque maillon de la chaîne concernée pourrait voir son dossier disciplinaire traité dans un délai bien précis. Dans le cas contraire, pour le cas des étudiants par exemple, de préjudices énormes sont inévitables à l’instar de ceux dont les sanctions d’exclusion des universités nationales interviennent après l’obtention de leur diplôme. Et, à ce propos, les tergiversations ne sont plus permises : le temps est venu de franchir le Rubicon en renforçant le dispositif actuel pour un campus calme et discipliné.
Références bibliographiques
ABA’A OYONO J. C., note sous CS/CA, ordonnance du 7 décembre 2000, Mama Biloa Sandrine c/ Université de Ngaoundéré, Juridis Périodique, N°51, juillet-août-septembre 2002, 117 p.
BELLA Achille Elvire, 2010, L’institution universitaire au Cameroun : dynamiques, ruptures et permanences d’une réalité plurielle ; des origines à 2001, thèse Yaoundé I, 332 p.
BELLA Achille Elvire, 2015, « Les mouvements étudiants et l’ordre politique au Cameroun postindépendance : entre enrégimentement et résilience », Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), pp. 291 – 328.
CARRIER Mario et collab., 2000, « La reconstruction de la légitimité des collectivités rurales. Entre gouvernement et gouvernance », in Carrier, Mario et Serge Côté (dir.), Gouvernance et territoires ruraux, Québec, PUQ, p. 41-63.
CHARLIER Jean-Emile, CROCHE Sarah et NDOYE Abdou Karim, 2009, Les universités africaines francophones face au LMD. Les effets du processus de Bologne sur l’enseignement supérieur au-delà des frontières de l’Europe, Louvain-la-Neuve, Academia, 334 p.
DENEF Jean-François, MVE-ONDO Bonaventure, 2016, Introduction à la gouvernance des universités : guide de gouvernance et d’évaluation à l’usage des recteurs et présidents d’universités ou d’institutions d’enseignement supérieur, Paris, Edition des archives contemporaines, 317 p.
MARTIN Eric, OUELLET Maxime,2010, La gouvernance universitaire dans l’économie du savoir, Rapport de recherche, IRIS, novembre 2010, 9 p.
FAME NDONGO Jacques,2018, « Préface » in Recueil des textes du Ministère de l’enseignement supérieur, Yaoundé, 7 p.
HOTYAT F., 1968, « Les examens, quelques considérations générales », in Revue française de pédagogie, volume 2, pp. 9-18.
SALL Abdou Salam, 2017, La gouvernance universitaire. Une expérience africaine, DAKAR, CODESRIA, 218 p.
SALL Abdou Salam, 2012, Les mutations de l’enseignement supérieur en Afrique : le cas de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Paris, L’Harmattan, 202 p.
SALMI Jamil, 2009, Le défi d’établir des universités de rang mondial, Banque mondiale, Washington DC.
GOUVERNANCE ET FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS DE LA ZONE UEMOA
École Normale d’Enseignement Technique et Professionnel (Mali)
Résumé :
La massification de l’enseignement, la multiplication des classements, la transformation des modes de financement et plus généralement, l’internalisation constituent quelques-uns des bouleversements profonds auxquels est confronté l’enseignement supérieur dans la plupart des pays de l’UEMOA. Ces bouleversements se sont traduits par des reformes importantes des universités dans les années récentes, notamment au Mali. Dans ce contexte, la gouvernance universitaire et, plus généralement les liens entre les Etats et les institutions d’enseignement supérieur ont généré de nombreux débats. En la matière plusieurs rapports ont été publiés au niveau mondial tel que (Fieldenn, 2008). Cependant, la plupart d’entre eux se limite à caractériser la gouvernance à un niveau institutionnel, sans interroger les acteurs sur leurs perceptions et leurs pratiques.
La présente étude vise à donner un panorama des pratiques de gouvernance des universités de l’Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) et particulièrement celles du Mali. Nos résultats sont issus d’un premier traitement des données obtenues par la passation d’un questionnaire en ligne et par courrier auprès des universités de l’UEMOA et particulièrement les universités et les grandes écoles du Mali. Tout en validant un diagnostic maintes fois formulé par les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce processus doit conduire à la formulation d’un vaste programme de réformes institutionnelles et académiques. On se pose la question centrale de recherche suivante : quel est le mode de gouvernance et de financement adapté aux universités de l’UEMOA et particulièrement aux Universités maliennes ?
Mots clés : BAD, Financement, Gouvernance, UEMOA-Mali, Université.
Abstract:
The massification of education, the proliferation of rankings, the transformation of funding methods and more generally, internalization are some of the profound upheavals facing higher education in most WAEMU countries. These upheavals have resulted in major reforms of universities in recent years, particularly in Mali. In this context, university governance and, more generally, the links between States and higher education institutions have generated many debates. In this regard, several reports have been published worldwide, such as (Fieldenn, 2008). However, most of them limit themselves to characterizing governance at an institutional level, without questioning the actors about their perceptions and practices.
This study aims to provide an overview of the governance practices of the universities of the West African Economic Monetary Union (UEMOA) and particularly those of Mali. Our results come from a first processing of the data obtained by the passing of an online questionnaire and by mail with the universities of the UEMOA and particularly the universities and the grandes écoles of Mali. While validating a diagnosis repeatedly formulated by the actors of higher education and scientific research, this process must lead to the formulation of a vast program of institutional and academic reforms. We ask ourselves the following central research question: what is the mode of governance and financing adapted to UEMOA universities and particularly to Malian universities?
Keywords : BAD, Financing, Governance, UEMOA-Mali, University.
Introduction
À l’époque de l’indépendance, les dirigeants africains ont reconnu clairement le rôle important que l’enseignement supérieur allait jouer dans la construction des nouvelles nations. En effet, l’une des premières conférences sous régionales organisées après l’indépendance a traité du développement de l’enseignement supérieur (Tananarive, 1962). Par ailleurs, comme l’a noté le premier document de politiques publié par la Banque mondiale sur l’Enseignement en Afrique subsaharienne (1988), « …les universités africaines ont relevé le défi de façon impressionnante » (p. 5). Cependant, cette étude a aussi recommandé la prudence, étant donné que dans la seconde moitié des années 80, les pays de l’ASS (Afrique Subsaharienne) avaient déjà pourvu à leurs besoins en personnel dans les administrations nouvelles, et que les économies étaient en stagnation. Elle a en effet constaté que « La contribution au développement faite par l’enseignement supérieur est menacée… par quatre points faibles étroitement liés. D’abord, l’enseignement supérieur produit relativement trop de diplômés issus de programmes de qualité et de pertinence douteuses, et trop peu de savoir et de soutien direct pour le développement. Ensuite, on constate des signes indubitables de détérioration de la qualité des résultats dans de nombreux pays, au point où l’efficacité de base des établissements est aussi en doute. Enfin, le coût de l’enseignement supérieur est trop élevé. Pour terminer, le mode de financement de l’enseignement supérieur est socialement inéquitable et économiquement inefficace » (p. 5). Pour faire face à ces problèmes, l’étude recommandait des politiques destinées à (a) améliorer la qualité, (b) accroître l’efficacité, (c) augmenter la diversité à la sortie, et (d) augmenter la participation financière des bénéficiaires et de leurs familles. Pour finir, l’étude prévenait que l’amélioration de la qualité coûte cher, et que la mise en œuvre des politiques pour atteindre les objectifs (b), (c) et (d) « sera, pratiquement partout en Afrique (en particulier dans l’espace UEMOA), une condition préalable en vue de libérer les ressources nécessaires pour atteindre l’amélioration de la qualité » (p. 6).
Dans le contexte des économies en stagnation et le besoin de réformes structurelles indispensables, l’économie politique pour introduire le genre de réformes de l’enseignement supérieur recommandées dans l’étude de la Banque s’est révélée très difficile dans la plupart des pays de l’ASS pendant les années 90. En conséquence, l’augmentation des inscriptions, ajoutée à des contraintes sévères sur les budgets publics, a davantage accentué la crise dans l’enseignement supérieur africain. En même temps, cependant, on constatait en Afrique une conscience accrue du besoin de réformes de l’enseignement supérieur et de la connaissance de ce qu’il fallait faire (selon la conférence sur l’enseignement supérieur en Afrique à Accra). De nombreux changements courageux de politiques de l’enseignement supérieur et des structures de gestion et de gouvernance ont pris naissance partout en ASS (en particulier dans l’espace UEMOA) pendant les années 90.
Ces efforts de réforme se sont accélérés au cours des dernières années, et méritent d’être vigoureusement soutenus par les partenaires au développement. Comme indiqué ci-dessous, la Banque mondiale a soutenu un bon nombre de ces efforts de réforme de différentes façons. Plutôt que de s’opposer à l’enseignement supérieur, les politiques d’intervention de la Banque, en règle générale, étaient plutôt guidées par les principes suivants : le soutien de l’enseignement à tout niveau doit être intégré dans une démarche holistique qui englobe l’ensemble du secteur éducatif; dans cette démarche holistique, compte tenu de la stagnation de l’enseignement primaire entre 1980 et le milieu des années 90 au point où seulement la moitié des enfants en ASS ont commencé et terminé l’enseignement primaire, et où, par ailleurs, près de la moitié des femmes adultes étaient analphabètes, il fallait donner la priorité à l’enseignement primaire dans le soutien que la Banque apporte à la plupart des pays, en vue de promouvoir la réduction de la pauvreté, une plus grande équité et des sociétés plus démocratiques. Ceci était particulièrement le cas dans les pays où de faibles inscriptions au primaire coexistaient avec le chômage notoire des diplômés de l’enseignement supérieur (un pays sur trois en ASS avait moins de 60% d’inscriptions à l’école primaire vers 1995) ; et le développement de l’enseignement supérieur est important mais, pour le faire de façon efficace, les investissements publics dans ce secteur doivent être faits dans un cadre de politiques qui encouragent une meilleure qualité de la formation et de la recherche, adaptent les programmes de formation aux besoins de développement du pays, et encouragent une plus grande équité dans les bénéfices que les différentes tranches de revenus de la population tirent des dépenses publiques pour l’éducation. Partant de ce contexte nous nous posons la question centrale de recherche suivante : quel est le mode de gouvernance et de financement adapté aux universités de l’UEMOA ?
1. Cadre conceptuel de l’étude
Le cadre conceptuel de la présente étude repose sur une analyse systémique. L’enseignement supérieur est défini comme le système qui doit répondre à tous les besoins de formation postsecondaire du pays et s’adresser aux étudiants dont les études secondaires ont été sanctionnées par un diplôme formellement reconnu. Il s’agit d’un sous-système de l’éducation nationale. Dans l’espace UEMOA, la mission très largement reconnue du système d’enseignement supérieur est de former des ressources humaines compétentes et capables de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté et au développement intégral du pays sur les plans culturel, économique et social. Ainsi conçu, l’enseignement supérieur s’impose comme un levier du développement socioéconomique. Il contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens en luttant contre la pauvreté et ses causes (analphabétisme, sous scolarisation, etc.). Il permet le développement adéquat des ressources humaines. Le but de l’enseignement supérieur se définit par son triple rapport au savoir, c’est-à-dire de : (i) contribuer à la production du savoir (recherche) ; (ii) optimiser l’appropriation critique du savoir (enseignement) (iii) valoriser la maîtrise du savoir (capitalisation et mise en valeur). Au cours des deux dernières décennies, le travail de l’enseignant chercheur universitaire s’est considérablement modifié. Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la généralisation des échanges de toutes natures ont transformé le savoir en un bien public planétaire. Par conséquent, l’enseignant chercheur doit apprendre à enseigner en tenant compte de l’accès qu’ont ses étudiants audit savoir par l’intermédiaire des banques de données mondiales, générales et spécialisées. Il doit aussi contribuer à l’évolution de ce savoir à partir de la recherche de solutions aux problèmes prioritaires de sa collectivité et des initiatives particulières.
Les institutions d’enseignement supérieur qui marquent l’histoire sont celles qui réussissent à s’intégrer au milieu qui les porte. Le transfert des résultats de la recherche dans le milieu socio-économique doit devenir une préoccupation constante du système d’enseignement supérieur de chaque pays. La société civile et ses principaux acteurs doivent être associés de façon permanente à la définition des programmes de formation et des priorités de la recherche. Pour une nouvelle vision de l’enseignement supérieur : Rapport intermédiaire de la phase intégration, Pertinence et qualité synthèse et options d’appui Étude sur l’enseignement supérieur (p. 7) dans les pays de l’UEMOA Novembre 2004. La participation structurée de tous les partenaires à la gouvernance est nécessaire pour s’assurer que les orientations du système permettent de répondre aux besoins prioritaires de la société et que les ressources investies sont utilisées efficacement. Elle a besoin pour s’exercer d’un système d’information permettant de fournir les informations nécessaires à la définition des problèmes et au suivi des solutions proposées. Elle suppose des mécanismes et des outils d’évaluation et de sanction de la performance des professeurs et des chercheurs, des programmes et des divers organes des institutions.
La démarche de réflexion sur l’enseignement supérieur dans l’Espace UEMOA ne saurait faire abstraction des grands défis et des transformations au plan mondial, régional, national et individuel qui se répercutent sur les composantes et l’environnement des systèmes éducatifs. Ces éléments déterminent les choix prioritaires que doit faire l’enseignement supérieur pour engager son avenir. Trois grands défis ont été retenus en raison de leur influence particulière sur l’efficacité de l’enseignement supérieur : la mondialisation et l’intégration sous régionale ; les progrès de la démocratie sociale et politique ; la pauvreté et le marché du travail. La mondialisation. Au cours des dix ou quinze prochaines années, sous l’effet de la mondialisation, la plupart des sociétés ouest africaines devront relever le défi de l’accession à la société du savoir et de l’intégration à la nouvelle économie planétaire grâce à la maîtrise des technologies de l’information et de la communication. Dans le contexte d’une économie politique mondiale, un pays isolé aura peu de chance de se développer durablement, d’où l’intérêt d’une intégration sous régionale des institutions de l’enseignement supérieur.
Quatre principes, déjà consacrés dans l’Espace UEMOA, peuvent guider cette intégration de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique. Le premier principe, celui de la subsidiarité, veut qu’on ne traite au niveau régional que ce que les pays, pris individuellement, ne sauraient traiter avec autant d’efficience. Ce principe supporte la nécessité pour les pays de répondre aux besoins nationaux de formation. Le principe de différentiation permet à chaque État de définir ses priorités et son rythme. Le principe de coopération permet à l’instance régionale d’appuyer l’action des pays dans des domaines où il existe des convergences d’intérêt et des interdépendances. Enfin, le principe de cohérence consiste à articuler les appuis bilatéraux et multilatéraux en fonction des initiatives nationales et régionales. La démocratie sociale et politique, la capacité d’autonomie d’un système d’enseignement supérieur est nécessaire au maintien de sa cohérence et de son dynamisme. Elle repose largement sur la participation structurée de tous les partenaires de l’enseignement supérieur à la gouvernance, sur un système d’information crédible et sur des mécanismes d’évaluation fiables.
Dans l’Espace UEMOA, la démocratie Pour une nouvelle vision de l’enseignement supérieur : Rapport intermédiaire de la phase Intégration, Pertinence et Qualité Synthèse et options d’appui Étude sur l’enseignement supérieur (p. 8), dans les pays de l’UEMOA Novembre 2004 universitaire est en pleine évolution; c’est donc l’occasion pour les acteurs de l’enseignement supérieur de rester attentifs et de mettre en avant certains principes démocratiques tels que la participation, la concertation et la transparence pour considérer les nouvelles formes de transactions et d’interactions avec les étudiants, les enseignants et les personnels techniques, d’une part, et entre enseignants et étudiants dans le cadre des enseignements, d’autre part. La pauvreté et le marché du travail. La pauvreté s’exprime à tous les niveaux dans les pays de l’UEMOA, principalement dans le manque de moyens et de bien-être. Dans le contexte économique des pays de l’UEMOA, les leviers du développement économique manquent dramatiquement, comme en fait foi l’état du marché du travail qui se caractérise par un manque d’opportunités du fait de l’incapacité des économies nationales à absorber les diplômés de l’enseignement supérieur et, en même temps, de créer de nouveaux emplois dans les secteurs publics et privés.
L’enseignant-chercheur est à la fois le premier acteur et le pivot central du système d’enseignement supérieur. De transmetteur des connaissances dont il était auparavant le seul détenteur, il est appelé à devenir l’intellectuel chercheur qui, par son lien privilégié avec le système global du savoir, peut optimiser la démarche d’appropriation critique du savoir par l’étudiant. La valorisation du savoir passe par une revalorisation du rôle de l’enseignant chercheur. Un corps professoral revalorisé devra être invité à renouveler sa pédagogie et à considérer que l’étudiant est en relation de partenariat avec ses enseignants. C’est ce partenariat dans la formation qui permettra à l’étudiant d’apprendre un savoir utile et de pouvoir, par la suite, s’insérer sur le marché du travail. La performance de l’enseignement supérieur sera fonction de la qualité et de la pérennité de la coopération qui se développera entre les enseignants et les étudiants. Les étudiantes et les étudiants sont les principaux responsables de leur formation et de leur éducation. À ce titre, ils doivent être invités à participer aux décisions qui les concernent directement. Leur participation apparaît comme la seule stratégie susceptible de stimuler en leur sein, et dans l’ensemble de la société, une réflexion sur l’avenir des universités et des établissements d’enseignement supérieur. Les étudiants doivent accepter de mieux jouer leur rôle dans le développement social de leur pays respectif.
2. Méthodologie de recherche
La Banque Africaine de Développement (BAD) faisait de la lutte contre la pauvreté l’objectif central de ses opérations de développement et retenait comme l’un de ses thèmes majeurs la valorisation des ressources humaines. En 2000, elle informait les États membres qu’elle définissait l’éducation, surtout au niveau professionnel et universitaire, comme un instrument clé de la lutte contre la pauvreté. À l’issue d’une mission exploratoire effectuée en juin et juillet 2001 visant à opérationnaliser cette orientation, deux grands objectifs généraux ont été retenus : (1) entreprendre une vaste étude sur l’enseignement supérieur et (2) envisager la création d’un fonds régional d’appui à cet ordre d’enseignement afin de contribuer au développement des ressources humaines. L’étude marque une volonté politique de renouveau de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les pays de l’Espace UEMOA. Dans l’exercice de ses fonctions économiques et monétaires, l’UEMOA a retenu au rang de ses priorités le développement des ressources humaines.
La Commission de l’UEMOA (Département du développement social/Direction de l’enseignement supérieur) a été retenue par la BAD pour agir comme agence d’exécution de l’étude. Celle-ci est supervisée par un comité de pilotage, structure regroupant les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des pays membres ou leurs représentants, les trois principaux bailleurs de fonds actuels dans le secteur de l’enseignement supérieur (Groupe de la Banque, Banque Mondiale, Coopération française), l’ADEA (Groupe de travail sur l’enseignement supérieur) /Association des universités africaines (AUA) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Les ministres ont désigné huit correspondants nationaux pour assurer la liaison entre les systèmes d’enseignement supérieur de leur pays respectif et l’UEMOA. Comme suite à un appel d’offres international, la firme SOFEG, en partenariat avec l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC), a été retenue comme Consultant responsable de l’étude. La première étape a été consacrée à la définition du cadre conceptuel et méthodologique de l’étude, élaboré essentiellement à partir d’une recherche documentaire. En juillet 2004, le rapport de premier établissement, qui définit ce cadre conceptuel et méthodologique a été approuvé par l’UEMOA. La méthodologie de l’étude privilégie trois instruments : la recherche documentaire, le questionnaire et l’entretien semi-dirigé ainsi que la consultation du milieu par le biais d’un atelier national à caractère participatif. 1 Protocole additionnel No II relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA, janvier 1994. Pour une nouvelle vision de l’enseignement supérieur : Rapport intermédiaire de la phase 1 Intégration, Pertinence et Qualité Synthèse et options d’appui Étude sur l’enseignement supérieur (Page 2) dans les pays de l’UEMOA Novembre 2004.
La seconde étape a été consacrée à la réalisation des diagnostics participatifs dans les 8 pays. À cet effet, l’équipe du Consultant, composée d’experts burkinabè, canadiens, français, ivoiriens, nigériens et sénégalais, a visité chacun des pays et pris part aux ateliers nationaux portant, dans chaque pays, sur les mêmes quatre thèmes relatifs à l’enseignement supérieur : l’efficacité interne (qualité), l’efficacité externe (pertinence), le financement et l’intégration régionale. D’une durée de trois jours, ces ateliers regroupaient quelque 70 participants, issus principalement du milieu de l’enseignement supérieur. À l’occasion des ateliers, les experts ont procédé à la collecte des données et informations spécialisées et ils ont réalisé plus de trois cents entretiens avec des acteurs ou groupes d’acteurs de premier plan. Les missions de diagnostic se sont tenues entre les mois de mars et juin 2004. Comme suite à ces missions, huit rapports diagnostiques, un par pays, ont été rédigés à l’intention de l’UEMOA, entre août et septembre 2004. La troisième étape, réalisée parallèlement avec la seconde, a consisté à effectuer une analyse de l’économie de l’enseignement supérieur des pays de l’UEMOA dans le contexte de la lutte contre la pauvreté.
L’étude prend en compte les informations recueillies par les experts et les données disponibles dans les rapports et documents de la Banque Mondiale, du PNUD, de l’UNESCO et de plusieurs autres agences internationales. L’étude a été déposée à l’UEMOA en septembre 2004. La quatrième étape conclut la phase 1 de l’étude. Elle a consisté en la rédaction d’une synthèse des travaux de la première phase et en la formulation des propositions d’options d’appui à l’amélioration de l’enseignement supérieur dans l’Espace UEMOA. C’est l’objet de la présente étude. Tout au long de cette première phase, l’équipe du Consultant a été confrontée à la difficulté de recueillir une information récente, valide, complète et comparable d’un pays à l’autre. Le problème généralisé de la déficience des systèmes d’information de gestion dans l’ensemble des systèmes d’enseignement supérieur des pays concernés fragilise la validité des données quantitatives recueillies. L’information financière adéquate fut très difficile à obtenir, parfois impossible, si bien qu’on n’a pas pu aller aussi loin que voulu dans les analyses des capacités et des modes financement de l’enseignement supérieur. Le Consultant a compensé ce défaut en recourant aux bases de données internationales, mais celles-ci ne permettent pas d’atteindre un degré élevé de finesse. La complémentarité des données quantitatives disponibles et des propos recueillis auprès des décideurs et des acteurs rencontrés permet néanmoins de brosser un portrait valide de la situation de l’enseignement supérieur.
3. Analyse de la gouvernance et du financement des universités de l’espace UEMOA
Le soutien que la Banque mondiale a apporté à la réforme et à la revitalisation de l’enseignement supérieur en ASS pendant les dix dernières années a pris la forme de travail analytique, de partage des connaissances et de prêts. En ce qui concerne le travail analytique, la politique de la Banque est influencée par une appréciation accrue des contributions au développement que les établissements d’enseignement supérieur peuvent apporter à leur pays au XXIème siècle, une époque reconnue comme étant celle de la « société du savoir », de l’ère de « l’information », et de « l’économie concurrentielle globale. » Le rôle-clé joué par le savoir et l’information a été étudié dans le rapport de la Banque sur le développement mondial, Savoir pour le développement, publié en1998/99, qui soulignait les contributions que l’information et le savoir apportent à la croissance économique. Ce rapport a mis l’accent sur la nécessité d’un « système national d’innovation » dans lequel les universités jouent un rôle-clé. Par la suite, un Travail Indépendant sur l’Enseignement Supérieur et la Société, financé conjointement par la Banque et l’UNESCO, a étoffé ce rôle dans son rapport de l’an 2000 intitulé L’Enseignement Supérieur dans les Pays en Voie de Développement : Péril et Promesse. La justification complète des nouvelles politiques de la Banque se trouve dans la publication, datée de 2002, Construire les Sociétés du Savoir : Nouveaux Défis pour l’Enseignement Supérieur.
En ce qui concerne le partage des connaissances, les programmes d’aide aux pays ont permis à la Banque de soutenir un certain nombre d’efforts visant à aider les pays à développer des stratégies pour l’enseignement supérieur, stratégies enracinées dans leur contexte national mais enrichies par le savoir international. D’une manière plus générale, la Banque a dirigé pendant une douzaine d’années les activités du Groupe de Travail sur l’Enseignement Supérieur, organisé dans le cadre de l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA). C’était le seul des dix Groupes de Travail de l’ADEA qui était dirigé et financé par la Banque ; en 1992, la direction de ce Groupe de Travail passa à l’Association des Universités africaines, sans perdre le soutien financier de la Banque. Sous la direction de William Saint, Spécialiste Principal de l’Éducation, ce Groupe de Travail a mis sur pied un nombre de manifestations et d’études pour le partage des connaissances y compris « Revitaliser les Universités en Afrique : Stratégies et Directives », publié en 1997. Elle cherche à stimuler le développement de l’enseignement supérieur en Afrique en assurant la large dissémination des leçons tirées de certaines des innovations les plus réussies dans l’enseignement supérieur en Afrique pendant les dernières années. Enfin, les prêts à l’éducation constituent le troisième instrument utilisé par la Banque mondiale pour soutenir l’enseignement supérieur en Afrique.
Dans la période de cinq ans, de 1985-89, environ 17% de tous les prêts à l’éducation en ASS étaient consacrés à l’enseignement supérieur, comparés à 29% à l’enseignement primaire. De 1995-99, les chiffres correspondants étaient de 7% pour l’enseignement supérieur et 46% pour l’enseignement primaire. Ainsi, conformément au programme de la Conférence sur l’Éducation dans le Monde de 1990 à Jomtien, qui réclamait l’enseignement primaire universel pour l’an 2000, le programme de prêts de la Banque a reflété ce renouvellement de la priorité à l’enseignement primaire. Néanmoins, bien que le volume des prêts à l’enseignement supérieur ait diminué, à la fin des années 90 la Banque continuait de financer certains éléments relatifs à l’enseignement supérieur dans les programmes éducatifs d’environ 20 pays, c’est-à-dire dans plus de la moitié des pays dans lesquels la Banque apportait un soutien financier direct à l’enseignement. Comme indiqué ci-dessus, une bonne partie de ces fonds a soutenu l’élaboration de stratégies pour le développement de l’enseignement supérieur. Pour conclure, la Banque mondiale est encouragée par la présence actuelle de nombreuses tendances positives dans l’enseignement supérieur africain et est prête à augmenter son aide aux pays africains en vue de la consolidation de leurs systèmes d’enseignement supérieur.
Ce faisant, la Banque cherche à promouvoir des stratégies de planification institutionnelle, une plus grande autonomie des institutions vis-à-vis des gouvernements, des chances égales pour l’enseignement supérieur privé, et le partage des connaissances liées aux innovations réussies entre les institutions africaines. La Banque soutient également l’assurance qualité et la responsabilité institutionnelle dans l’utilisation efficace des fonds publics, et les efforts pour garantir que l’enseignement supérieur puisse répondre de façon plus efficace et plus souple aux demandes du marché de travail d’une main-d’œuvre qualifiée. Essentielle à cette approche a été l’aide financière que la Banque apporte à des “fonds d’innovation” sensibles à la demande et qui cherchent à favoriser des changements positifs dans la culture institutionnelle entourant les approches traditionnelles d’enseignement et d’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Cette approche nouvelle se manifeste déjà dans des projets de la Banque au bénéfice de l’enseignement au Mali, au Sénégal en Côte d’Ivoire, et au Bénin.
Parler d’une nouvelle vision de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pointe la nécessité d’un changement en profondeur dans les systèmes d’enseignement supérieur des huit pays membres de l’UEMOA qui sont interpellés par leur grave dysfonctionnement. Ces systèmes fonctionnent dans un cadre organisationnel inadapté et dans une pénurie de ressources telle qu’ils sont devenus incapables d’accomplir leur mission de formation des ressources humaines nécessaires pour pouvoir s’inscrire adéquatement dans la nouvelle société du savoir. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent plus contribuer au développement global de leur société ni de leur sous-région. C’est avec ce sentiment d’urgence que la Banque Africaine de Développement (BAD), principal partenaire financier de cette étude, et l’UEMOA, l’agence d’exécution, ont convenu d’un processus qui doit permettre de mesurer l’ampleur du défi posé aux différents pays membres de l’Union. Tout en validant un diagnostic maintes fois formulé par les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce processus doit conduire à la formulation d’un vaste programme de réformes institutionnelles et académiques.
Ce sentiment d’urgence est partagé par les acteurs de l’enseignement supérieur eux-mêmes qui, depuis près de deux décennies, ont produit de nombreux rapports circonstanciés et sont intervenus dans différents forums, sur le continent africain et à l’extérieur, pour sonner l’alarme et souligner avec force que le système global d’enseignement supérieur africain francophone se détériore depuis le début des années 80. Les acteurs s’entendent pour dire que la détérioration du système s’est accélérée à partir de 1986, suite à l’application des premiers plans d’ajustement structurel (PAS) mis en avant par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM). En janvier 1994, la dévaluation de 50 % du franc CFA est venue aggraver une situation déjà précaire. L’équipe SOFEG considère que le temps et les circonstances sont moins propices à constater l’état des lieux qu’à actualiser et rendre utile un diagnostic déjà largement connu de la plupart des parties prenantes du système. Il semble exister un consensus qu’il est temps de passer à l’action en proposant des options d’appui permettant de mettre un terme à la détérioration du système.
4. Recommandations
– On doit bien choisir les responsables des Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) de la zone UEMOA pour éviter des problèmes de mauvaise gouvernance.
– On doit mener des réflexions sur la question d’autonomisation des universités de la zone UEMOA pour avoir des universités d’excellences.
– On doit chercher à instaurer d’autres visions concernant les universités de la zone UEMOA tel que le modèle d’université entrepreneuriale ; on doit enfin reconfigurer l’offre de formation.
Conclusion
Cet article porte sur la crise la gouvernance et le financement des universités de la zone UEMOA et en particulier les universités maliennes. Cette étude est réalisée comme un guide qui permettrait de comprendre les enjeux de la gouvernance et du financement des universités de la zone UEMOA afin de partager les leçons tirées de certaines des innovations les plus réussies lancées au niveau de l’enseignement supérieur au cours des dernières années. Le but de cette étude est d’améliorer la gouvernance et le financement des universités africaines et particulièrement celles de la zone UEMOA. Cette étude est axée sur les problèmes auxquels nos universités sont confrontées, et cherche à munir les établissements d’enseignement supérieur des outils dont ils ont besoin pour accroître leurs résultats.
Cet article compte également montrer qu’alors que certains des systèmes africains de l’enseignement supérieur faisaient face à une crise sérieuse, d’autres développaient des solutions locales porteuses d’espoir pour un avenir meilleur. En se fondant sur ces orientations positives, les établissements africains d’enseignement supérieur pourront former un plus grand nombre d’étudiants ; ils les formeront à des niveaux plus élevés de qualité et de pertinence, leur permettant d’engendrer le savoir par une recherche améliorée ; ils pourront ainsi former des diplômés qui seront des dirigeants compétents, des gestionnaires capables, des professionnels qualifiés, et des citoyens productifs. Il est important que les partenaires au développement en Afrique soutiennent ce processus de renouveau de l’enseignement supérieur africain. L’enseignement supérieur joue un rôle-clé dans le développement économique et social de toute nation. Ceci est encore plus vrai dans l’économie globalisée actuelle, fondée sur l’information et le savoir. Aucun pays ne peut espérer s’intégrer avec succès dans cette économie du XXIème siècle, et en bénéficier, sans une main-d’œuvre éduquée et qualifiée. L’enjeu est considérable pour l’Afrique sub-saharienne (ASS) et particulièrement les pays de l’UEMOA, étant donné le faible niveau d’éducation de la main-d’œuvre dans la plupart des pays, et le besoin urgent de croissance soutenue à un haut niveau pour réduire la pauvreté. Par ailleurs, bien que les universités soient faibles dans de nombreux pays de l’UEMOA, il n’en reste pas moins qu’elles représentent les seuls établissements nationaux qui possèdent les compétences, l’équipement et le mandat pour créer un savoir nouveau et adapter au contexte local et le savoir créé ailleurs.
Références bibliographiques
BOURGEOIS Isabelle, LASSERRE René, 2008, « Vers un nouveau mode de financement des universités (2/2) », in Regards sur l’économie allemande, 88 | 2008, p. 15-24, 10 p.
CALVIAC Stéphane, 2019, « Le financement des universités : évolutions et enjeux » in, Revue française d’Administration publique, CERA, ENA, n° 169, 2019, pp. 51-68.
CRUCIS Henry Michel, 2012, « Quelles ressources humaines et financières pour les universités ? Innover au-delà de la LRU », Paris, Presses universitaires de France, « Cités », 2012/2 n° 50, p. 117 à 125, 9 p.
CYTERMAN Jean-Richard, 2014, « Le financement du système éducatif français et l’enjeu de la performance », in Revue internationale d’éducation, N°65, p. 121- 131.
Eastman, Julia Antonia, 2006, « Recettes et réformes organisationnelles dans l’enseignement supérieur : quelques aperçus du Canada », Université de Victoria, Canada, Édition de l’OCDE « Politiques et gestion de l’enseignement supérieur », 2006/3 n° 18, p. 63 à 94, 32 p.
FOREST Frédéric, PIOZIN Éric, 2015, « Les évolutions du financement public des établissements d’enseignement supérieur : leviers de transformation et de renforcement de leur autonomie », in Gestion & Finances publiques, N°11-12, p. 42-48.
LEPORI Benedetto, 2008, « Options et tendances dans le financement des universités en Europe », Presses de Sciences Po, « Critique internationale », 2008/2 n° 39, p. 25 à 46, 22 p.
MACHADO Cerdeira, MARIA Luisa, 2014, « Enjeux présents et futurs du financement de l’enseignement supérieur. Un aperçu des tendances mondiales », in Revue internationale d’éducation, N°65, p. 45-56.
MBENGUE Seydina Ababacar, 2018, L’enseignement supérieur public au Sénégal et le défi de la gestion par la performance, PRE ENA 2018-02, 46 p.
Rapport de l’étude sur l’enseignement supérieur dans les pays de l’UEMOA PHASE 1 SYNTHÈSE ET OPTIONS D’APPUI Pour une nouvelle vision de l’enseignement supérieur.
FONDEMENTS ET TYPOLOGIE CARACTÉRISTIQUE DE LA CRISE DE L’UNIVERSITÉ EN AFRIQUE : CAS DE L’UNIVERSITÉ GABONAISE
Georges MOUSSAVOU
Institut de Recherche en Sciences Humaines / Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (Gabon)
Résumé :
L’objectif de cet article est d’appréhender la crise de l’université en Afrique en lien avec la construction de l’État et l’exercice du pouvoir politique. Notre hypothèse est que « la crise de l’université gabonaise est liée aux processus et mécanismes sociaux et politiques de construction et de fonctionnement de l’État ». À partir de la théorie de l’action organisée qui postule que le système, « produit social et culturel », est une construction des acteurs impliqués à travers leurs actions et stratégies, nous expliquons que la crise de l’université gabonaise, caractérisée par les violences politiques, policières, universitaires, symboliques et psychologiques, est une co-construction des acteurs internes que sont les étudiants et les enseignants-chercheurs, et des acteurs externes (les gouvernants).
Mots clés : Acteurs, Crise universitaire, Organisation, Pouvoir d’État, Système.
Abstract:
The objective of this article is to understand the crisis of the university in Africa in connection with the construction of the State and the exercise of political power. Our hypothesis is that « the crisis of the Gabonese university is linked to social and political processes and mechanisms of construction and functioning of the State ». From the theory of organized action which postulates that the system, « social and cultural product », is a construction of the actors involved through their actions and strategies, we explain that the crisis of the Gabonese university, characterized by the political, police, academic, symbolic and psychological violence, is a co-construction of internal actors that are the students and the teacher-researchers, and the external actors (the rulers).
Keywords : Actors, University crisis, Organization, State power, System.
Introduction
L’intérêt d’analyser et d’expliquer la crise de l’université gabonaise se fonde sur une observation : « la permanence et la récurrence des mouvements de revendications étudiantes et enseignantes corrélativement aux types de réponses du gouvernement, dès l’année académique (1971-1972) suivant la création de l’Université Nationale du Gabon (UNG) en 1970 » (G. Moussavou, 2022, p. 184-194). De façon générale, en sociologie, « le terme crise s’entend à plusieurs niveaux, économique, politique ou social, et il peut désigner des phénomènes d’intensité variée » (A. Akoun et P. Ansart, 1999). En ce sens, la crise désigne une tension, un désordre social ou une rupture imprévisible et spectaculaire. Pour M.-C. Smouts et al. (2003, p. 91), la crise désigne « le trouble et le déséquilibre ». Quant à la crise de l’université gabonaise, elle se traduit par des relations conflictuelles entre les acteurs internes (les étudiants et les enseignants-chercheurs) et les acteurs externes (les gouvernants), autour de la définition, de la conception et de l’organisation de l’université. Par ce biais, ces acteurs participent à la « co-construction » (M. Crozier et E. Friedberg, 1977) du système universitaire, dans un contexte « de violences politique, symbolique, policière et universitaire » (G. Moussavou, 2022, p. 175-194).
Nous formulons l’hypothèse selon laquelle, la crise de l’université gabonaise est liée aux processus et mécanismes sociaux et politiques de construction et de fonctionnement de l’État.
Elle en est l’indicateur principal de la crise même de l’État.
L’objectif ici est donc de dévoiler la réalité de ce qui se passe au niveau de la gouvernance universitaire et politique. Notre perspective d’analyse est celle de la théorie de l’action organisée des acteurs impliqués dans l’organisation et le fonctionnement de l’université.
1. Université Nationale du Gabon, une contingence sociopolitique : le facteur originel de la crise
La mise en place d’une institution de formation supérieure au Gabon commence dès 1959 avec l’implantation d’un embryon d’établissement polytechnique à Libreville, appartenant à la Fondation pour l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (FESAC). La création de l’Université Nationale du Gabon (UNG) en août 1970 et son ouverture effective sur le site de la FESAC, dès le mois d’octobre de la même année, a été une surprise inattendue pour les nouveaux bacheliers. L’ordonnance n°30/71 du 19 avril 1971 portant création de l’UNG a été prise et promulguée huit mois après cette ouverture. Cet écart temporel montre que l’université ainsi créée, sans infrastructures à elle et sans vision stratégique claire, a fonctionné pendant plusieurs décennies dans une certaine « illégalité » (G. Moussavou, 2020, p. 26). Ce processus précipité et inattendu pour les étudiants nous est apparu être en lien avec l’arrivée du nouveau président de la République succédant à Léon Mba en 1967, qui avait hâte, d’une part, de rassembler les acteurs politiques et les populations dans le cadre d’un parti-unique d’État, le PDG (Parti Démocratique Gabonais), aux fins de taire les divergences politiques relatives au multipartisme existant ; et, d’autre part, de couper tout ravitaillement de la contestation politique des étudiants Gabonais en France, à travers l’Association Générale des Etudiants du Gabon (AGEG) membre de la FEANF[40]. Cette perspective dont le corollaire a été le contrôle social des acteurs sociaux notamment ceux affectés à l’accomplissement des tâches dans l’administration et autres institutions scolaires et universitaires, s’est appuyée sur des recrutements des personnels à partir des critères ethno-politiques désignés par le vocable de la « géopolitique » (G. Moussavou, 2022, p. 21-22) et « d’autres liens » (A. E. Augé, 2005), constitutifs de la clientèle politique du pouvoir d’État.
2. Facteurs secondaires de la crise de l’université gabonaise
2.1. Pouvoir d’État et université
L’université constitue une organisation sociale, institutionnelle, structurelle et rationnelle dont la mission fondamentale est la production des savoirs et des élites pour le développement économique et social. L’État, acteur majeur de l’action publique, pourvoit aux besoins de l’université dont il est le créateur et où se développent des activités spécifiques d’éducation et de recherche scientifique.
Au regard des enjeux de formation des élites que l’État souhaite avoir, la création d’une université devait alors s’inscrire dans un projet stratégique de construction sociale, politique et culturelle préalablement élaboré. C’est ainsi que la nature du pouvoir politique d’État et donc de la puissance publique influe sur la gouvernance universitaire et la qualité de la formation. Autrement dit, l’université, composante du système social et politique, ne peut connaître un réel épanouissement que si le pouvoir d’État qui l’institut veuille lui donner sens et vie ; en lui fournissant notamment dans un cadre démocratique et stratégique, des dispositifs nécessaires à la pleine éclosion des intelligences et des savoirs qui s’y construisent. Or, on observe qu’en dehors des énoncés contenus dans les textes organiques et réglementaires, l’État n’a pas encore présenté et mis en œuvre un quelconque plan de cadrage des établissements et de formation supérieure en rapport avec le développement économique et social recherché.
De fait, au Gabon comme ailleurs en Afrique, l’État est un produit importé de l’administration coloniale. C’est un outil de régulation sociale et politique exogène, qui a assimilé des logiques et mécanismes de gouvernance coloniale et qui s’est greffé à des organisations sociales autres que celle dont il s’origine. Sa construction dans un contexte de déficit généralisé de personnels formés et instruits, d’absence de stratégies sociopolitiques de développement autonome et efficace, a laissé naître une « pâle copie » d’un système politique exogène à l’Afrique. C’est à cette typologie supra institutionnelle, marquée par des pratiques sociales « patrimonialisées », qu’on a assigné des missions d’organisation et de développement. J-F. Médard (1990 : 25) affirme à ce propos : « On attendait de l’État qu’il ne fut pas uniquement l’État gendarme, ni même le walfare state, mais aussi le démiurge du développement ».
De plus, l’omniprésence symbolique, manifeste et personnifiée du pouvoir d’État dans la quasi-totalité des secteurs d’activités ; l’hyper centralisation de l’administration et la personnalisation des actions publiques, caractérisent la nature sociopolitique du pouvoir exécutif en œuvre au Gabon. Ce dernier revendique l’exclusivité et le monopole de la gestion des affaires publiques et de l’action étatique. En dépit de l’existence formelle de la séparation des pouvoirs, (exécutif, législatif, judiciaire), le pouvoir exécutif et, notamment, le président de la République, n’a en réalité pas de compte à rendre aux autres composantes de la société, et encore moins, aux autres pouvoirs dits constitutionnels. Ce verrouillage sociopolitique, culturel, économique et financier par le truchement d’un « parti hégémonique », a généré la pensée unique : celle au service du président de la République ; qu’elle soit rationnelle ou irrationnelle. Il a également induit la dépendance systémique des moyens publics et des autres institutions, y compris les institutions universitaires. C’est donc dans un contexte de consolidation du régime politique que le président Albert Bernard Bongo décida de la création « impromptue » (G. Moussavou, Idem, p. 25-26) de l’Université Nationale du Gabon, d’une part, et qu’évolue l’ensemble des institutions universitaires, d’autre part.
2.2. Système universitaire et entrecroisement du système des acteurs
L’observation du fonctionnement de l’université gabonaise montre une implication polarisée d’acteurs socio-institutionnels divers dans les processus de sa gouvernance. Ces processus mettent en œuvre les actions, les actes et non actes des acteurs internes que sont les étudiants et les enseignants-chercheurs, d’une part, et des acteurs externes, hormis le ministère de tutelle, d’autre part. Les acteurs externes ce sont notamment les principaux responsables des institutions et administrations suivantes :
– la présidence de la République ;
– le ministère chargé du budget et des finances publiques ;
– le ministère chargé de la planification, ordonnateur des investissements ;
– le ministère de la fonction publique, chargé de la gestion des carrières administratives ;
– l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG), chargée d’attribuer et de gérer les allocations d’études des étudiants.
Les opérations et actions de ces institutions et administrations externes participent à l’articulation et à la complexification organique et systémique du système universitaire. Elles ont hissé le président et la présidence de la République au rang de pôle central de résolution directe des problèmes de tous ordres affectant le fonctionnement quotidien de l’université. Aussi, du fait de l’hyper centralisation administrative et au nom de l’unicité des caisses de l’État, les ministères en charge des finances publiques et de la planification des investissements occupent, avec le président de la République, une position dominante, voire hégémonique, dans la gouvernance universitaire. Cette position consiste, entres autres, en la détermination du nombre de postes budgétaires des personnels, des moyens financiers et matériels alloués à l’université. En plus de cette position, ces ministères et la présidence de la République ont leurs agendas et calendriers d’opérations qui ne sont pas nécessairement en cohérence avec l’agenda universitaire. Les besoins cruciaux et vitaux s’inscrivant dans le fonctionnement harmonieux et normal de l’université et ses centres de recherche ne sont pas non plus en adéquation avec les besoins inconnus, les vues et préoccupations des principaux dirigeants de ces institutions et administrations.
Les votes de budgets par le parlement n’induisent pas non plus la mise à disposition et l’exécution obligatoire et rigoureuse de ceux-ci pour faire face, en temps réel, aux besoins spécifiques de l’université, d’autant que toute administration qui ne bénéficie d’aucun « blanc-seing » du président de la République ou des ministres en charge des finances publiques et de la planification peut voir ses dotations diminuées progressivement ou carrément supprimées au cours d’une année budgétaire. De même, si les budgets alloués n’ont pas été entièrement consommés par les établissements destinataires du fait de leur déblocage tardif, les dotations restantes ne sont pas non plus reconduites en supplément au cours de l’année budgétaire suivante. Elles sont purement et simplement sucrées par les services des finances et du trésor public, étant entendu que tout budget ordonnancé est supposé être disponible. Or, du fait des procédures bureaucratiques laborieuses, de la gabegie et de la corruption qui caractérisent la chaîne de la dépense, toutes les dotations ne sont malheureusement pas utilisées entièrement par les administrations destinataires dont l’université.
L’autre cas le plus patent est celui du phénomène des queues de budgets dont les principaux bénéficiaires ne sont autres que les agents et responsables des ministères en charge des finances publiques. De l’autre côté, l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) dépendante politiquement de la présidence de la République et du ministère des finances, influe d’une certaine manière dans la gouvernance universitaire. En effet, bien que cette agence soit placée sous la tutelle technique du ministère de l’enseignement supérieur, son fonctionnement révèle une ambiguïté la plus totale. Le ministère de tutelle technique n’a en réalité aucune maîtrise de ce qui s’y fait. Cette agence, comme les autres institutions et administrations extérieures, participe à l’entrecroisement inefficient et inefficace des services étatiques dans le champ universitaire. La représentation de la diversité des ministères au sein de sa commission d’attribution, de renouvellement et/ou de suppression des allocations d’études n’est, en effet, en rien synonyme de travail collectif d’identification et de détermination préalables des secteurs de formations stratégiques. Lesquels devaient fonder, selon les textes qui régissent sa commission, les orientations des étudiants boursiers en vue du développement économique et social du pays.
Par ailleurs, en dehors des inscriptions en 3ème cycle, recherchées par les étudiants eux-mêmes dans les universités étrangères, c’est l’ANBG ou certains parents qui choisissent les établissements de formation à l’étranger, dans lesquels les étudiants boursiers sont envoyés pour une formation à l’extérieur du pays. Cependant, il se trouve que certains établissements à l’étranger ne soient pas agréés ou reconnus par l’État dans leurs pays, voire ne sont pas appropriés pour des formations de qualité. Surtout, les retards de paiement de bourses souvent accusés par cette agence sont également l’une des causes majeures de plusieurs mouvements de manifestations/protestations étudiantes parfois violentes, se traduisant par les fermetures de portail et autres perturbations.
Ainsi, le ministère de l’enseignement supérieur est quasi déconnecté de plusieurs pans du pilotage des universités placées sous sa tutelle officielle. Par conséquent, cette forme de tutelle ne peut être que notoirement approximative, relative et atrophiée : elle est sous subordination prononcée d’autres acteurs au sein du pouvoir exécutif. In fine, se pose la question du statut et de l’identité de ce ministère.
3. Typologie et caractérisation de la crise de l’université gabonaise
L’analyse chronologique et descriptive des manifestations/protestations étudiantes et enseignantes, expression visible de la crise universitaire, nous a permis de mettre en relief les problèmes fondamentaux expliquant la complexité de l’organisation universitaire et du système de décisions structurant sa gouvernance. Car, autant l’Université Nationale Gabon devenue Université Omar Bongo (UOB) en 1978 que les universités qu’elle a générées, suite à ses crises de croissance, connaissent une permanence des problèmes d’organisation et de fonctionnement les plus élémentaires dont quasiment tout le monde s’est accommodé. À la suite d’une première phase de recueil d’informations dans le quotidien progouvernemental l’Union et « l’hebdomadaire de l’USTM »[41] (2002 – 2005), nous avons observé que de 1970 (année de création de l’UNG) à 2005, soit 35 années de fonctionnement académique, l’Université Omar Bongo a officiellement connu 17 mouvements de revendications et de protestations étudiantes et enseignantes. De 1985 (année d’ouverture de l’USTM) à 2005, soit 20 années de fonctionnement académique, l’Université des Sciences et Techniques de Masuku a connu 10 mouvements de revendications et de protestations étudiantes et enseignantes. Soit une moyenne chacune d’une instabilité universitaire majeure tous les deux ans. Quant à l’Université des Sciences de la Santé (USS), résultat de la séparation de ses établissements d’avec l’UOB depuis janvier 2002, elle a connu son premier mouvement de revendications et de protestations au cours de l’année académique 2004 – 2005. Ces informations cumulées à celles tirées de la seconde phase de recueil d’informations menée en 2018 nous amènent au constat suivant : sur 48 années de fonctionnement académique (1970 – 2018), l’université gabonaise dans son ensemble a connu officiellement 32 années (au minimum) de perturbations majeures d’activités, soit 67%[42] de temps académique affecté par des manifestations/protestations des acteurs internes du système universitaire. Les tableaux qui suivent indiquent comment nous sommes parvenu à produire les statistiques relatives à ces manifestations/protestations des acteurs internes et celles relatives aux réponses des responsables gouvernementaux.
Dans le tableau n°1 ci-dessous, chaque citation est considérée de manière autonome. Elle est rapportée à 48 années de fonctionnement universitaire constituant la référence de base de calcul de la moyenne fonctionnelle. Ainsi, à l’observation des termes de citations qui y sont contenus, l’agrégation des doléances et manifestations contre l’administration universitaire (43,75%) et de celles contre les mesures et décisions du gouvernement (33,33%) est de l’ordre de 77,08%. Ces situations qui résultent des pratiques et formes de gouvernance des autorités universitaires et gouvernementales, sont caractérisées, d’une part, par l’unilatéralisme dans la gestion et les prises de décisions ; et, d’autre part, par l’ignorance ou la non-prise en compte de l’intérêt, pour les autres catégories d’acteurs internes de l’université, de participer activement à la vie de leur institution.
Tableau n°1 : Doléances à l’origine des revendications des étudiants et enseignants-chercheurs de 1970 à 2018
| Termes de citations | Nbre de citations | % |
| Manifestations et protestations contre l’inaction, les mesures et décisions de l’administration universitaire. | 21 | 43,75% |
| Manifestations et protestations contre l’inaction, les mesures et décisions du gouvernement. | 16 | 33,33% |
| Revendications de bourses et/ou allocations d’étude. | 15 | 31,25% |
| Revendications de meilleures conditions de vie et d’études par les étudiants. | 10 | 20,83% |
| Revendications liées au restaurant universitaire. | 9 | 18,75% |
| Revendications liées à la bibliothèque. | 7 | 14,58% |
| Revendications de la prime d’incitation à la recherche, du paiement des vacations et des heures supplémentaires par les enseignants-chercheur et chercheurs. | 7 | 14,58% |
| Revendications de meilleures conditions de travail par les enseignants-chercheur et chercheurs. | 6 | 12,50% |
| Revendication d’une meilleure qualité de la couverture des enseignements et de compléments des effectifs d’enseignants. | 5 | 10% |
| Agressions d’enseignants, d’étudiants et assassinats. | 4 | 8,54% |
| Revendications de bonnes structures d’accueil et des équipements des salles de cours. | 3 | 6,25% |
| Demandes de régularisation des situations administratives. | 3 | 6,25% |
| Insatisfaction des étudiants face aux activités pédagogiques des enseignants. | 2 | 4,16% |
| Revendications de meilleures conditions de logement étudiant. | 2 | 4,16% |
| Manifestations contre la situation salariale des chercheurs et enseignants-chercheurs. | 1 | 2% |
| Revendications de budget et/ou de crédits suffisants pour les établissements | 1 | 2% |
| Total | 112 | 233% |
Source : Georges Moussavou
À l’instar du tableau n°1 ci-dessus, chaque citation du tableau n°2 ci-après est également considérée de manière autonome.
Tableau n°2 : Réponses des autorités universitaires et gouvernementales aux revendications des étudiants et des enseignants-chercheurs, de 1970 à 2018
| Termes de citations | Nbre de citations | % |
| Interventions de forces de l’ordre. | 17 | 35,40% |
| Décisions d’organisation et de réorganisation structurelles. | 13 | 27% |
| Décisions d’arrêts d’activités, invalidation des années académiques et/ou fermeture des universités. | 7 | 14,58% |
| Promesses. | 7 | 14,58% |
| Solutions matérielles, travaux de voiries, réfection et construction. | 6 | 12,50% |
| Réception des acteurs internes par le président de la République. | 6 | 12,50% |
| Réception des acteurs internes par le ministre de tutelle ou le gouvernement. | 5 | 10% |
| Menaces et intimidations. | 4 | 8,54% |
| Emprisonnements et décisions d’autorité. | 3 | 6,25% |
| Non-réponses du gouvernement et absence de solutions visant l’amélioration des conditions de vie, d’études et de travail. | 1 | 2% |
| Total | 69 | 130,85% |
Source : Georges Moussavou
Il ressort du tableau n°2 ci-dessus que les réponses et actions gouvernementales se répartissent comme suit :
– force, actions de violences physiques et politiques (interventions des forces de l’ordre, emprisonnements et décisions d’autorité) : 41,65% ;
– décisions d’organisation et de réorganisation structurelles : 27% ;
– décisions d’arrêts d’activités, d’invalidations des années académiques et/ou de fermetures des universités, lesquelles s’inscrivent dans le cadre des actions de violences universitaire, politique et symbolique, sont à égalité de 14,58% avec les promesses formulées par le gouvernement et l’administration universitaire ;
– quant aux solutions matérielles, aux travaux de voiries, de réfection et de construction, elles sont à égalité de 12,50% avec le taux de réception des acteurs internes des universités par le président de la République, El Hadj Omar Bongo Ondimba. En effet, nombre de solutions aux revendications en milieu universitaire n’ont été trouvées directement que par le président de la République, alors que la réception des acteurs internes par le ministre et/ou le gouvernement visant l’amélioration des conditions de vie, d’études et de travail, sont de l’ordre de 12%. Autrement dit, solutions et non-solutions de l’État se neutralisent ;
– enfin, les menaces et intimidations, les actions de violences psychologiques, symboliques et politiques sont de l’ordre de 8,54%.
En agrégeant l’ensemble des violences caractéristiques des réponses gouvernementales face aux problèmes formulées par les acteurs internes, nous avons un taux d’actions gouvernementales violentes de l’ordre de 64,77%.
Conclusion
Dans le cadre de notre article, il s’agissait d’expliquer, sur la base de la théorie de l’action organisée des acteurs impliqués, que la crise de l’université gabonaise est liée aux processus et mécanismes sociaux et politiques de construction et de fonctionnement de l’État. En ce sens, cette crise est, avant tout, l’indicateur de la crise même de l’État. Des données d’investigation recueillies, il ressort que les processus de création de la première université, l’université nationale, la nature du pouvoir politique d’État et donc de la puissance publique et l’organisation du système universitaire sont au fondement de la crise de l’université gabonaise. Cette crise est exacerbée par l’hyper centralisation du pouvoir exécutif et les actions hégémoniques des acteurs institutionnels externes n’ayant aucun lien direct avec la tutelle officielle. Ce qui place le ministère de l’enseignement supérieur dans une tutelle approximative et relativement atrophiée ; et l’institution universitaire dans une mainmise des acteurs dont les agendas n’ont aucune relation objective avec ses missions. Des contradictions de définition et de conception de ce que doit être l’université, entre les acteurs internes (étudiants et enseignants) et les acteurs externes (les gouvernants), il découle des manifestations de mécontentements et des violences à la fois politiques, policières, universitaires, symboliques et psychologiques.
De là, nous pensons que pour résoudre cette forme relationnelle improductive, il est plus que nécessaire de rendre la gouvernance publique véritablement et sincèrement démocratique et, d’inscrire l’université dans un véritable projet de construction noble de la société, pour le développement économique et social du pays.
Références bibliographiques
AKOUN André, ANSART Pierre, 1999, (Sous la dir.), Dictionnaire de Sociologie, Paris, Le Robert et Seuil.
AUGE Axel Eric, 2005, Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne. Une sociologie du pouvoir au Gabon. Coll. Etudes africaines, Paris, L’Harmattan.
BAYART Jean-François, 1996, « L’historicité de l’État importé », in Les Cahiers du CERI, n°15, Paris, Sciences Po, 1996, pp. 7-44.
BAYART Jean-François (Sous la dir.), 1996, La greffe de l’État, Paris, Kartala.
BERNAULT Florence, 1996, Démocraties ambiguës en Afrique centrale, Congo-Brazzaville, Gabon : 1940-1965, Paris Karthala.
BADIE Bertrand, 1992, L’État importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Fayard.
CROZIER Michel, FRIEDBERG Erhard, 1977, L’acteur et le système, Paris, Seuil.
DARBON Dominique, 2010, Le comparatisme à la croisée des chemins. Autour de l’œuvre de Jean-François Médard, Paris, Karthala.
FOCART Jacques, 1997, Le journal de l’Elysée, tous les soirs avec de Gaulle : 1965-1967, tome 1, Paris, Fayard/Jeune Afrique.
MAGANGA Théophile, MOUSSAVOU Georges, 2013, Gouvernance des universités gabonaises. Quels défis à relever pour leur performance ?, Paris, Publibook.
MBACH Jean Ferdinand, 2015, La construction de l’État au Gabon (1957-2009), Paris, L’Harmattan.
MEDARD Jean-François, 1990, « L’État patrimonialisé », Politique Africaine, N°39, Paris, Kartala, pp. 25-36.
MOUSSAVOU Georges, 2020, Organisation et système universitaire au Gabon. Sociologie des processus et systèmes institutionnels, Paris, L’Harmattan.
MOUSSAVOU Georges, 2022, Pouvoir d’État, système d’enseignement supérieur et de recherche au Gabon. Sociologie historique de l’action publique, Paris, L’Harmattan.
PAMBOU Tchivounda Guillaume, 1982, Essai sur l’État africain postcolonial, Paris, LGDJ.
ROSSANTANGA-RIGNAULT Guy, 2000, L’État au Gabon, Histoire et Institutions, Libreville, Ed. Raponda-Walker.
SMOUTS Marie-Claude, BATTISTELLA Vennesson Pascal, 2003, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz.
ZUE-NGUEMA Gilbert, 2009, La philosophie par temps de mondialisation économique, Paris, Dianoïa.
PROJETS D’ÉCOLE ET L’AUTONOMIE DES UNIVERSITÉS AU TOGO
Ati-Mola TCHASSAMA
École Normale Supérieure (Togo)
Résumé :
L’une des nouvelles visions des Institutions Universitaires est l’autonomie et le fonctionnement démocratique. Le projet d’école répond d’un cadre fédérateur qui résulte d’un processus de mobilisation des acteurs : enseignants, élèves, parents d’élèves, les spécialistes de l’éducation autour de l’école pour la bonification de la qualité de l’éducation (J. Ehrhard, R. Toraille, G. Villars, 1982). De ce cadre fédérateur, nous pensons que les projets d’école peuvent favoriser l’autonomie des Universités. Pour vérifier cette hypothèse, des enquêtes à partir d’un questionnaire et d’un guide d’entretien auprès des enseignants-chercheurs consentants desdites Institutions et une étude documentaire ont été faites. L’analyse, à la fois quantitative et qualitative, montre que les projets d’école sont dans leur étape embryonnaire. Par des formations et sensibilisations, une priorité doit être accordée à ceux-ci afin de contribuer à l’autonomie financière et à l’assurance qualité des Institutions universitaires.
Mots clés : Autonomie, Projet d’école, Université.
Abstract:
One of the new visions of University Institutions is autonomy and democratic functioning. The school project responds to a unifying framework which results from a process of mobilizing actors: teachers, students, parents of students, education specialists around the school for the improvement of the quality of the education (J. Ehrhard, R. Toraille, G. Villars, 1982). From this unifying framework, we believe that school projects can promote the autonomy of universities. To verify this hypothesis, surveys based on a questionnaire and an interview guide with consenting teacher-researchers from the said Institutions and a documentary study were carried out. The analysis, both quantitative and qualitative, shows that the school projects are in their embryonic stage. Through training and awareness, priority must be given to these in order to contribute to the financial autonomy and quality assurance of university institutions.
Keywords : Autonomy, School project, University.
Introduction
Les besoins des États Africains en matière de développement culturel et social ont conduit les pays l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) à réfléchir sur le rôle et les caractéristiques de leur système éducatifs et en particulier les Universités. Cela va dans le même sens que E. Albert et I. Calin (1993) qui pensent que tout système éducatif doit s’ouvrir à son milieu, donc répondre au besoin de sa société en mutation. Pour ces auteurs, l’éducation est de plus en plus une perspective, c’est-à-dire, la recherche de formules nouvelles. La recherche du savoir est devenue l’enjeu du premier plan. Dans leur rôle de moteur du développement, les Universités africaines ont entrepris de vastes réformes en vue de transformer leur système d’enseignement pour qu’il contribue davantage au développement économique et social. Les Universités sont devenues des guides dans le but de faire avancer les sociétés. Par exemple, ces impératifs donnèrent naissance à l’Université, de la recherche moderne grâce à laquelle les « sociétés agricoles sont devenues des sociétés industrielles, ce qui a rendu possible un vaste commerce mondial » (E. P. Cubberley, 1948, p. 799). Cet état a transformé les « formations universitaires, à finalité non professionnelle, suivies par une petite élite homogène en un vaste système d’enseignement supérieur professionnalisé, proposant des filières diversifiées à des effectifs issus des classes moyennes » (H. K. Jarausch, 1983, p. 10). Avec la réforme de l’enseignement supérieur dans les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), l’une des nouvelles visions des Universités est l’autonomie et le fonctionnement démocratique. Au Togo, la nouvelle Loi d’Orientation de l’Enseignement Supérieur l’a réitéré en son article 53 : « les établissements publics d’enseignement supérieur jouissent d’une autonomie administrative et financière ». Pour une efficacité d’un système éducatif, il faut des établissements qui ont des moyens de leur autonomie et savent rendre compte de l’usage qu’ils en font ; ils ont des professionnels compétents, autonomes et réflexifs (Ph. Perrenoud, 2002). Cette étude prend en compte le lien entre les projets d’école et l’autonomie des Universités. Une analyse de situation et l’énoncé du problème seront faits à travers la suite.
1. Problématique
Les Universités deviennent le principal lieu où les biens symboliques sont, sinon produits, du moins conçus et élaborés » (B. Scott, 1998, p.127). Au moment où l’octroi de subventions publiques aux Universités est en recul dans de nombreux États, ces établissements risquent plus en plus de recourir aux stratégies du secteur privé afin d’augmenter leurs ressources financières, soit en tentant d’attirer un noyau d’étudiants payant leur scolarité, soit en donnant la priorité à des créneaux de production de savoirs financièrement rentables. Si l’Université s’assimile de plus en plus à une entreprise, et donc à l’équivalent d’une entité du secteur privé, il est à craindre qu’elle cherche essentiellement le profit, et ne devienne de ce fait une « enclave sans aucune responsabilité sociale » (E. Hazelkorn, 1999, p. 107). Sa gestion va s’apparenter à celle d’une entreprise qui cherche à attirer une clientèle dont les étudiants de toute nationalité, les entreprises, les Universités sœurs pour le transfert de connaissances. Elle obéit désormais aux lois de la concurrence par les produits de la recherche. Cela nécessiterait la transformation des découvertes scientifiques en produits brevetés, commercialisables et des échanges altruistes d’idées, de savoir-faire et de connaissances entre organisations axées sur la recherche et leurs utilisateurs respectifs (G. Harman, K. Harman, 2004).
La majorité des pays africains est focalisée sur l’enseignement de base délaissant l’enseignement supérieur et la recherche qui manque énormément de financement. Afin de disposer de ressources suffisantes pour l’enseignement supérieur et la recherche, les pays de l’UEMOA ont souhaité :
– trouver un équilibre dans l’allocation des ressources entre les différents niveaux d’enseignement ;
– renforcer la collaboration avec le secteur privé et encourager la sponsorisation de la formation universitaire et de la recherche par les entreprises ;
– responsabiliser et autonomiser davantage les Universités et les centres de recherche et
– prendre des mesures permettant aux Universités et centres de recherche d’avoir plus d’activités génératrices de revenus (PMC, 2009). Il s’agit d’une application idéologique des mécanismes issus de l’entreprise privée à l’éducation supérieure et qui fait intervenir la notion d’assurance qualité. Cela met en compétition les Universités qui sont évaluées à partir de critères dits rationnels mais en fonction d’un modèle marchand de l’éducation. Il ne s’agit pas de mesurer la qualité de ce qui est produit, à savoir l’enseignement et le savoir, mais plutôt de produire un système de notation permettant de mesurer la valeur réputationnelle des établissements (ASSE, 2012). Dans ce sens, la plupart des pays tendent à accorder aux établissements scolaires une certaine autonomie dans l’usage des ressources et l’organisation du travail, parfois dans les choix curriculaires. On demande aussi aux établissements de construire un projet, entendu comme une déclinaison locale de la politique régionale ou nationale, un ensemble d’objectifs et de priorités adaptés au contexte spécifique (M. Broch et F. Cros, 1990 ; G. Thurler, 2001 ; Ph. Perrenoud, 2001). Il s’agit de faire de chaque établissement une entité indépendante, un « Etat dans l’État ». L’autonomie est une stratégie de gestion décentralisée du système éducatif. Cette autonomie plus forte, peut rendre certains d’entre eux plus efficaces encore, en les libérant de certaines contraintes, en les laissant donner libre cours à leur créativité et à leur dynamisme. C’est un levier de changement, à condition d’apprendre à s’en servir dans ce sens (Ph. Perrenoud, 2002). J. Barroso et C. Menitra (2009) précisent qu’en ce qui concerne les écoles, l’autonomie se traduit non pas seulement par la possibilité qui leur est accordée de choisir leurs dirigeants, mais aussi par la possibilité de définir leur projet éducatif et leur règlement interne dans les limites fixées par la loi générale ; d’avoir l’existence d’une marge relative de choix au niveau de leur organisation interne en termes de composition de leurs organes de gestion supérieure et intermédiaire ; un assouplissement relatif du budget, notamment au niveau de la gestion des ressources humaines et financières ; la possibilité de disposer de recettes propres provenant du loyer de locaux, de la vente de services et du versement de certaines taxes, etc.
Le projet d’école est un processus de mobilisation des acteurs (enseignants, élèves, parents d’élèves, les spécialistes de l’éducation) autour de l’école pour l’améliorer la qualité de l’éducation ou contribuer au changement de comportement (J. Ehrhard, R. Toraille & G. Villars, 1982). Par exemple, le projet d’école « Education à l’environnement » ou autre consiste à initier les apprenants à la vie politique, économique et sociale de son pays. Ils font l’expérience de la vie pratique, de la connaissance de la vie collective afin qu’ils puissent intérioriser les règles de conduite orientée vers le respect de l’autre et la solidarité (R. Lafon, 1969). Il peut concerner un groupe d’élèves ou tout l’établissement. Il existe trois (3) sortes de projets d’école :
– ceux qui visent à améliorer les performances scolaires et compétences sociales des élèves et à diversifier les pratiques pédagogiques des enseignants (théâtre, poésie, formation pédagogique des enseignants, fabrication des outils pédagogiques et d’autres produits enseignés à l’école) ;
– ceux qui visent à ouvrir l’école sur son milieu (sorties pédagogiques, solliciter un spécialiste pour concrétiser un enseignement) et
– ceux qui visent à améliorer les conditions de vie de l’établissement (construction des bâtiments scolaires, laboratoires, cantines, toilettes, bibliothèque, etc.).
L’organisation des apprenants n’est plus fondée sur la discipline coercitive par laquelle l’enseignant détient les trois pouvoirs à savoir : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif (Lapie cité par J. Ehrhard, R. Toraille & G. Villars, 1982). Il s’agit de la méthode active qui constitue, d’après R. Mucchielli (1974, p. 69) « un apprentissage de la vie sociale, de la participation coopération et d’un savoir-être, en même temps qu’un acquis ». Cette pédagogie active fait de chaque enfant, un homme et un citoyen en développant chez celui-ci le sens du devoir et de responsabilité. Ainsi, l’école, par les pratiques pédagogiques des enseignants, peut influencer le choix professionnel des élèves (A.-M. Tchassama, 2014). Dans le cas du choix professionnel, cela consiste à rendre autonome l’apprenant. Autrement dit, celui-ci, de par son expérience, sa responsabilité, jouit d’une autonomie dans son choix professionnel qui n’engage que sa vie. Par conséquent, l’acte qu’il pose est un acte d’un Homme responsable qui doit œuvrer pour son bien-être, celui de sa famille et de son Etat. Avec la mutation du monde professionnel qui a exigé la création de nouveaux emplois, l’individu, au cours de la vie, doit se confronter à des situations nouvelles et accomplir des tâches inhabituelles. Il apparaît que l’on peut nommer maturité, la capacité à affronter ces situations et accomplir ces tâches. Cette maturité s’acquiert au cours d’un processus de développement. Lorsque ces situations ont trait au choix d’une formation, d’un secteur d’activités, d’un métier ou à l’adaptation professionnelle, on parle de maturité vocationnelle (Y. Forner, 1991). Cette maturité désigne donc un état de préparation aux prises de décision en matière de formation et d’emploi.
Le Rapport de la conférence des Ministres à Abidjan 2014 sur la Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique, a montré que le taux de chômage a considérablement augmenté. Le chômage des jeunes est devenu ces dernières années l’enjeu principal de chaque société. J.-F. Marquet et F. Schmitt (2001) ont pensé aux modules de construction de projet personnel de l’étudiant. Cela favoriserait la réussite des étudiants et limiter les abandons sans réorientation. Le projet d’école prendrait en compte le projet personnel de l’étudiant et permet de construire son projet d’études en connaissant mieux le cursus dans lequel il est inscrit, de découvrir les métiers liés à ce cursus, de construire son projet professionnel. Dans l’autonomie et la gestion des établissements qui autorisent l’élaboration des projets d’école, J. Barroso (2006) met en évidence la qualification des chefs d’établissements, la professionnalisation des enseignants et des agents éducatifs, ainsi que le renforcement de la participation des parents et des élèves. L’une des principales caractéristiques de la gestion des établissements scolaires se fonde sur le principe d’éligibilité de ses dirigeants. Dans ce type de régulation, le chef d’établissement agit à la fois comme un représentant de l’État sur lequel il fondait son autorité et comme un représentant du corps enseignant sur lequel reposait sa légitimité. L’action du chef d’établissement reposait donc sur une double logique :
– une logique étatique de type bureaucratique et administratif, où l’école est perçue comme un service de l’État, assujettie à un réseau complexe de normes qui renforcent l’intervention directe de l’administration centrale (à travers son corps de fonctionnaires et d’inspecteurs) ou son intervention indirecte, relayée par le chef d’établissement, dont la fonction essentielle est de veiller au respect des normes et des règlements et
– une logique corporatiste de type professionnel et pédagogique, où l’école est perçue comme une organisation professionnelle dont la gestion de type collégial jouit d’une relative autonomie pédagogique et financière, et dans laquelle le chef d’établissement exerce ses fonctions plutôt comme un leader pédagogique que comme un administrateur-délégué du pouvoir central.
J. Barroso (2007) a identifié quatre conceptions différentes du chef d’établissement :
– une conception bureaucratique, étatique et administrative, où le chef d’établissementest considéré avant tout comme un représentant de l’État à l’école, exécutant et surveillant le respect des normes émanant du pouvoir central et faisant le lien / exerçant un contrôle entre le ministère, son administration centrale ou régionale d’une part, l’ensemble des enseignants et des élèves qui fréquentent l’école d’autre part ;
– une conception corporatiste, professionnelle et pédagogique, où le chef d’établissement est considéré comme un intermédiaire entre l’école (en particulier entre les enseignants) et les services centraux ou régionaux du ministère, en assurant la défense des intérêts pédagogiques et professionnels des professeurs face aux contraintes bureaucratiques et financières imposées par l’administration ;
– une conception managériale, où le chef d’établissement est considéré comme le gestionnaire d’une entreprise, qui se soucie surtout de l’administration des ressources, de la formation et des compétences techniques spécifiques, et dont l’objectif majeur est d’assurer l’efficience et l’efficacité et
– une conception politico-sociale, où le chef d’établissement est considéré comme un négociateur, un médiateur entre logiques et intérêts différents (parents, enseignants, élèves, groupes sociaux, intérêts économiques, etc.), en vue de parvenir à un accord ou à un engagement local par rapport à la nature et à l’organisation du bien commun éducatif que l’école doit garantir à ses élèves.
En conformité avec cette législation, la direction des établissements scolaires est assurée par un organe collégial (le conseil exécutif) ou par un organe unipersonnel (le directeur exécutif), selon le désir exprimé par l’assemblée qui est chargée d’élaborer le règlement interne de l’école. Dans les deux cas, la direction doit être assurée par des enseignants chevronnés ou par des enseignants ayant suivi une formation en gestion des établissements. Les membres du conseil exécutif ou le directeur sont élus par l’assemblée électorale mise en place à cet effet, qui comprend le personnel enseignant et non-enseignant dans l’exercice effectif de fonctions dans l’établissement scolaire, par des représentants des élèves (dans le cas de l’enseignement secondaire), ainsi que par des représentants des parents.
Ce conseil exerce des fonctions de direction stratégique et est responsable de la définition des lignes d’orientation des activités de l’école, en y assurant la participation et la représentation de la communauté éducative (corps enseignant et personnel non-enseignant, parents et tuteurs, élèves (au niveau de l’école secondaire), municipalité et communauté locale. Simultanément, sont élargis les dispositifs de reddition de comptes à travers l’évaluation interne et externe, en tant que condition indispensable à la réalisation du principe de la contractualisation. Pour Ph. Perrenoud (2002), un bon établissement autonome est celui qui est peuplé d’enseignants professionnels. Un projet d’établissement n’a guère de sens s’il n’émane pas d’une véritable communauté de professionnels. L’efficacité de l’école reste dans une large mesure dépendante de l’efficacité personnelle de chaque enseignant et les autres acteurs de l’établissement. Les élèves apprendront moins qu’ils ne le pourraient si leurs enseignants ne se montrent pas présents, disponibles, inventifs, rigoureux, observateurs, chaleureux, empathiques, justes, adéquats, mobilisateurs, cohérents et collaborateurs. Un bon professeur doit évidemment maîtriser sa discipline, pour planifier correctement ses cours, concevoir et animer toutes sortes d’activités d’apprentissage, notamment des recherches, des situations-problèmes, des projets. Dans le registre classique de la maîtrise des savoirs à enseigner, certains enseignants sont en défaut, parce que leur formation disciplinaire n’est pas assez poussée, ou parce qu’elle est trop dogmatique. Ils éprouvent des difficultés dans la gestion de l’hétérogénéité et de la diversité culturelle des étudiants, le contrôle des absences et des conduites, les relations avec les parents, la médiation des conflits, la pédagogie coopérative, la gestion de la classe, l’organisation du travail à l’échelle de plusieurs classes ou d’un cycle d’apprentissage pluriannuel, la collaboration avec des spécialistes des difficultés d’apprentissage, des troubles médico-pédagogiques, de la prévention, du travail social. De ce qui précède, nous pensons que seuls les projets d’école peuvent permettre aux Universités de jouir d’une autonomie et assurer l’assurance qualité de celles-ci. Cette étude vise à répertorier les projets d’école dans les Universités publiques au Togo. Elle permet de fournir aux Autorités Universitaires et aux enseignants-chercheurs des stratégies permettant aux Universités publiques de jouir d’une autonomie financière. La méthodologie suivante a permis de vérifier cette hypothèse.
2. Méthode
Pour nous rendre compte de l’organisation des deux Universités publiques du Togo, nous nous sommes intéressé aux universitaires parmi lesquels un échantillon constitué de 43 enseignants-chercheurs consentants ont été choisis. Le choix de ces institutions s’explique par le fait qu’il n’existe que, pour le moment, les deux universités publiques au Togo. Cette enquête permettrait de comprendre l’autonomie dans ces institutions, conformément à la loi d’orientation de l’enseignement supérieur dans notre pays.
Des enquêtes à partir de d’un questionnaire, un guide d’entretien et une étude documentaire ont été faites. Un questionnaire et un guide d’entretien ont été administrés aux enquêtés afin d’avoir leurs connaissances sur les projets d’école et leurs opinions par rapport au fonctionnement autonome des Universités au Togo. L’enquête a eu lieu en août 2021. L’analyse documentaire a permis d’avoir des informations sur les textes régissant le fonctionnement des Universités au Togo et dans le monde. Les données recueillies ont été traitées manuellement pour catégoriser les différentes réponses des enquêtés. Ainsi, L’analyse à la fois quantitative et qualitative, a été faite. Nous avons procédé au calcul de fréquences des réponses aux questions fermées et à l’analyse du contenu des réponses issues du guide d’entretien. Il s’agit d’une analyse logico-sémantique qui, d’après R. Mucchielli (1984), s’intéresse directement au contenu manifeste.
3. Résultats
Cette étude vise à étudier le lien entre le projet d’école et l’autonomie des Universités publique du Togo. Or, l’autonomie d’une Institution Universitaire se traduit par la possibilité des acteurs de choisir eux-mêmes leurs dirigeants, de disposer de recettes propres (J. Barroso et C. Menitra, 2009). Les résultats nous situent par rapport aux institutions de notre enquête.
3.1. Autonomie des Universités publiques du Togo, choix des dirigeants et l’existence de projets d’école
Les résultats montrent qu’au Togo, outres les doyens, certains Directeurs d’Institutions et Chefs de Département, les deux Dirigeants des deux Universités publiques ne sont pas élus. Ces Universités dépendent plus financièrement de l’État.
On peut répertorier les trois formes de projets d’école dans les Universités publiques au Togo.
Il s’agit des projets d’école qui visent à différencier les pratiques pédagogiques et à améliorer l’apprentissage des apprenants (la formation des enseignants universitaires), les projets qui servent à ouvrir l’école sur son milieu et ceux destinés à améliorer le cadre de vie de l’Institution (Jardin d’expérimental à l’École de l’Agronomie, élevage d’expérimental à l’École d’Agronomie, la préparation du gel hydroalcoolique à l’école de pharmacie de l’Université de Lomé). Les projets d’école qui visent à améliorer le cadre de vie de l’Institution (dans les deux Universités, il y a l’aménagement du restaurant, construction des amphithéâtres, des laboratoires, des routes). Les résultats des recherches ne sont pas valorisés et restent dans les tiroirs, d’après les propos des enquêtés. Aucune découverte n’est brevetée et commercialisée. Ces projets répertoriés ne sont développés dans le but de contribuer à l’autonomie financière des Universités. Les enquêtés ont de différentes opinions par rapport à cette autonomie des Universités.
3.2. Opinion des enquêtés par rapport à l’autonomie des Universités publiques
Lorsque nous avons cherché à savoir si les Universités Africaines peuvent jouir d’une autonomie, le tableau suivant nous situe par rapport aux réactions de nos enquêtés.
Tableau : Répartition des enquêtés selon que les Universités jouissent d’une autonomie ou non
| Variables | Effectifs et pourcentages de réponses des enquêtés | ||
| Oui | Non | Total | |
| Autonomie administrative seulement | 18 41,9% | 25 58,1% | 43 100% |
| Autonomie financière seulement | 0 0% | 43 100% | 43 100% |
| Autonomie administrative et financière | 25 58,1% | 18 41,9% | 43 100% |
Si tous les enquêtés pensent que les Universités africaines ne doivent pas jouir de l’autonomie financière, le tableau ci-dessus montre que 41,9% d’entre eux pensent que cesUniversités ne doivent jouir que de l’autonomie administrative à cause de la pauvreté, la mauvaise gouvernance dans ces Universités et la paresse des acteurs. Par contre, ils sont plus nombreux (58,1%) à vouloir que celles-ci jouissent à la fois d’une autonomie administrative et financière pour éviter l’influence du politique. Dans ce sens, les propositions des stratégies suivantes ont été faites par les enquêtés permettant de contribuer à l’autonomie financière des Universités. Il s’agit de la recherche du partenariat, s’engager et respecter la bonne gouvernance, la majoration des frais d’inscription des étudiants, la professionnalisation des offres de formation, le montage des sociétés internes aux universités pour participer aux appels d’offre, la transformation des produits locaux, etc. La suite nous permet de mieux l’expliciter.
4. Discussion
Les données recueillies montrent que l’autonomie des Universités prévue par la loi est très limitée. Cette autonomie se situe au niveau du choix des dirigeants et dans la gestion de ces institutions.
4.1. Autonomie des Universités publiques du Togo, choix des dirigeants et l’existence de projets d’école
Si l’autonomie des Universités se traduit par la possibilité qui leur est accordée de choisir leurs dirigeants et de définir leur projet, ce qui n’est le cas dans les Universités publiques du Togo surtout par rapport au choix des dirigeants. L’analyse montre aussi que les projets qui existent sont à l’étape embryonnaire et ne permettent pas d’assurer l’autonomie financière des Universités. Ce qui est contraire à la Loi d’Orientation de l’Enseignement Supérieur au Togo et aux recommandations de l’UEMOA. Parmi les propositions de stratégies permettant aux Université de jouir à l’autonomie financière, figurent les projets d’école. Mais, il n’y a pas encore des stratégies permettant aux Universités d’avoir plus d’activités génératrices de revenus et de valoriser les résultats de recherche pour une autonomie financière. La proposition liée à l’augmentation des frais d’inscription limiterait l’optimum éducatif des apprenants qui consiste à créer les conditions pour que chaque apprenant puisse évoluer dans ses études jusqu’au plus haut sommet selon que ses compétences et aptitudes le lui permettent (J. Beauté, 2008). Les Institutions éducatives qui se veulent démocratiques ne peuvent évoluer que dans ce sens. Mais, la majorité des acteurs enquêtés ne pensent pas de la même manière l’autonomie de ces institutions, conformément à ce que prône la loi d’orientation des Universités du Togo.
4.2. Opinion des enquêtés par rapport à l’autonomie des Universités publiques
La majorité des enquêtés pensent que les Universités africaines ne peuvent jouir que de l’autonomie administrative à cause de la mauvaise gouvernance, la paresse des acteurs, etc. Cela s’explique par l’appréhension que ceux-ci ont de la réforme de l’enseignement supérieur. Ph. Perrenoud (2002) explique que les établissements du supérieur sont actuellement en train d’apprendre à assumer cette autonomie, avec des régressions et des dérapages, mais aussi des aventures collectives extraordinaires. Cela ne va pas sans ambivalences, résistances, difficultés et conflits. L’autonomie administrative suppose un dirigeant éligible et managérial, considéré comme le gestionnaire d’une entreprise, qui se soucie surtout de l’administration des ressources, de la formation et des compétences techniques spécifiques, et dont l’objectif majeur est d’assurer l’efficience et l’efficacité (J. Barroso, 2007). Cela peut induire l’autonomie financière. Cette appréhension de la réforme s’explique par le fait que ceux qui pense que les Universités africaines peuvent jouir à la fois de l’autonomie administrative et financière, trouvent que cela permettrait d’éviter l’influence du politique. Pourtant, l’autonomie est une stratégie de gestion décentralisée du système éducatif. Il s’agit de faire de chaque institution une entité indépendante, un « État dans l’État » Ph. (Perrenoud, 2002). Cette autonomie existe dans les textes, mais sur le terrain, on n’innove pas assez. L’équation la plus courante reste un professeur, une matière, un programme. La classe fonctionne à l’ancienne pédagogie, l’adulte délivre son cours, et les élèves notent. Il faut reconnaître que les dirigeants des Universités publiques ont, dans leur politique, entamé la construction des amphithéâtres, les laboratoires et arrangent les rues à l’intérieur des universités. Cela peut être considéré comme des projets d’école qui visent à améliorer le cadre de vie scolaire. Il n’existe pas d’autres formes de projets d’école dans ces Universités qui contribueraient à s’auto-prendre en charge et permettre aux étudiants d’être entrepreneurs et plus rentables. Les Universitaires ne sont pas formés par rapport aux projets d’école. Il s’agit d’un enseignement pratique interdisciplinaire qui devrait les outiller à élaborer, ensemble ces projets.
Conclusion
Dans le préambule de la Loi d’Orientation de l’Enseignement Supérieur (Loi No 2017-005) au Togo, l’enseignement supérieur constitue l’une des priorités du développement national. Il s’enracine dans les valeurs fondamentales de la culture nationale et universelle. De cette affirmation, nos Universités ne peuvent que s’orienter vers la recherche de l’innovation pédagogique qui prennent en compte les projets d’école. Ce qui assurerait leur autonomie. Mais, les données recueillies montrent que cette autonomie des Universités prévue par la loi est très limitée. Il existe encore des pratiques bureaucratiques et d’une culture de la dépendance de l’État au niveau des Universités publiques. Est-ce que la formation pédagogique et interdisciplinaire des enseignants-chercheurs ne serait pas un facteur de l’autonomie des Universités et de la valeur réputationnelle de celles-ci ?
Références bibliographiques
ALBERT Emile et CALIN Izabelle, 1993, Guide Pratique du maître, IPAM.
ASSE, 2012, La qualité de l’enseignement supérieur, sommet sur l’Education supérieure-rencontre 1, Bologne.
BARROSSO Joâo, 2006, « La régulation de l’éducation comme processus composite : le cas du Portugal », in École, régulation et marché. Une comparaison de six espaces scolaires locaux en Europe, Paris, PUF, pp. 281-314.
BARROSSO Joâo, 2007, « L’autonomie et la gestion de l’école publique : entre le marché, le managerialisme et la démocratie », in Derouet J.-L. et Normand R., dir., L’Europe de l’éducation : entre management et politique, Lyon, Institut national de la recherche pédagogique, pp. 85-100.
BARROSSO Joâo, MENITRA Caen, 2009, Knowledge and public action. School autonomy and management. Knowandpol project. Consultable en ligne sur : http://knowandpol.eu/IMG/pdf/o21.portugaleducation.pdf, (consulté le 27 mai 2012).
BEAUTE Jean, 2008, Courant de la pédagogie, Lyon, Chronoque sociale.
BROCH Marcel et CROS Françoise, 1990, un projet d’établissement. Stratégies et methods, Paris, INRP.
EHRHARD Jean, TORAILLE Raymond, VILLARS Guy, 1982, Psychopédagogie pratique, l’Education scolaire et ses problèmes, Paris, Librairie.
GATHER THURLER Martine, 2001, « Le projet d’établissement : quelques éléments pour construire un cadre conceptuel », in Pelletier, G. (dir.) Autonomie et décentralisation en éducation : entre projet et évaluation, Montréal, Université de Montréal/AFIDES, pp. 81-93.
HARMAN Grant et HARMAN Kay, 2004, « Governments and Universities as the Main Drivers of Enhanced Australian University Research Commercialization Capability », in Journal of Higher Education Policy and Management, 26, 2, pp. 153-169.
JARAUSCH Konrad, 1983, « Higher Education and Social Change: Some Comparative Perspectives », in K.H. Jarausch (éd.), « The Transformation of Higher Learning 1860-1930 », Chicago: University of Chicago Press, pp. 9-36.
LAFON Robert, 1969, Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant, Paris, PUF.
MARQUET Jean-François et SCHMITT François, 2001, Introductions de la démarche qualité dans l’enseignement supérieur, Partage d’expériences, Recueil des interventions et documents utilisés, Séminaire de l’équipe Kalis, Université Pierre Mendès France, Grenoble 2.
MUCCHIELLI Roger, 1974, L’Observation psychologique et psychosociologique, Paris, ESF.
PERRENOUD Phillipe, 2001, L’établissement scolaire entre mandat et projet : vers une autonomie relative, in Pelletier, G. (dir.) Autonomie et décentralisation en éducation : entre projet et évaluation, Montréal, Université de Montréal/AFIDES, pp. 39-66.
PERRENOUD Phillipe, 2002, Dix principes pour rendre un système éducatif efficace, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducatio, Université de Genève, Editions de l’aube.
TCHASSAMA Ati-Mola, 2014, « Pratiques pédagogiques des enseignants et projet professionnel chez les adolescents : cas des élèves de la classe de 3eme des collèges d’enseignement Général de la Préfecture de l’Ogou », in Ingénierie Culturelle, N°003, Presse de l’IRES-RDEC, Lomé, pp. 37-57.
Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) (2004), Etude sur l’enseignement supérieur dans les pays de l’UEMOA, Phase 1, Rapport final : http://www.uemoa.int/Publication/2005/RapportEnsSupPI.pd
PERFORMANCE MANAGEMENT CONSULTING (PMC), 2009, L’enseignement dans l’UEMOA, Enjeux, Défi et Perspectives. résumé de la note sectorielle sur le secteur de l’enseignement dans l’UEMOA, in www.performancesconsulting.com.
RAPPORT CONFÉRENCE DES MINISTRES À ABIDJAN, 2014, sur la « Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique », in Pole Qualité Inter Pays dans le domaine du Développement des Compétences Techniques et Professionnelles « PQIP/ DCTP ».
LA COMMUNICATION INTERNE DE L’UFR/LAC DE L’UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO AU BURKINA FASO
1. Marcel BAGARE
École Normale Supérieure Koudougou (Burkina Faso)
2. Dognon Lucien BATCHO
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
3. Salif ZONGO
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
Résumé :
L’Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication (UFR/LAC), la plus peuplée de l’Université Joseph KI-ZERBO, connait des crises régulières depuis des décennies. Ces crises sont souvent imputables à une absence de communication interne. Ce travail de recherche s’inscrit dans une perspective de compréhension des sources de ces conflits, à travers une dynamique d’analyse afin de jeter des bases d’une communication interne répondant aux besoins de l’ensemble des parties prenantes. Pour mener à bien cette étude, nous avons opté pour une méthode mixte (quantitative et qualitative). Cette étude invite les responsables de l’UFR/LAC à utiliser un mode de communication mieux adapté à leur personnel en ce sens qu’une bonne communication interne et de qualité est un instrument privilégié pour créer et entretenir un climat de travail apaisé.
Mots clés : Burkina Faso, Communication interne, Conflit, Gouvernance, Management, Université Joseph KI ZERBO.
Abstract:
The Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication (UFR/LAC), the most populated of University Joseph KI-ZERBO has been facing since 2017, 2018 and 2019 recurring crises. These crises are often attributable to a lack of effective internal communication. This research work aims at evaluating the internal communications in UFR/LAC, through an analysis of the effectiveness of the internal communication regarding the strikes observed in recent years, in order to lay the foundations for an internal communication that meets the needs of the whole staff. To carry out this study, we adopted a mixed methodology, both quantitative and qualitative. This study invites UFR/LAC managers to use a mode of communication better suited to their staff inasmuch as a good internal and quality communication is a privileged instrument for creating and maintaining a good working atmosphere.
Keywords: Burkina Faso, intern communication, conflit, governance, management, Université Joseph KI ZERBO.
Introduction
La communication est au cœur de toutes les controverses, de tous les débats. Dans les organisations, elle est très souvent vue, à la fois, comme la cause de tous les maux, et le remède susceptible d’apporter une solution à tout problème. De nos jours, tout dysfonctionnement organisationnel est ramené à un « problème de communication ».Dans les Universités, au même titre que dans les entreprises, la communication joue un rôle primordial. Qu’elle soit externe ou interne, elle demeure la vitrine et la carte santé de toutes organisations. Les nouveaux modes de communication tels qu’Internet, les réseaux sociaux numériques et bien d’autres requièrent une place entière dans la gestion des organisations. Ainsi, N. d’Almeida et T. Libaert (2014, p. 10) soutiennent que « La communication d’une organisation (entreprise, administration, association) recouvre un ensemble de structures et de procédures… ».
À l’Université Joseph KI-ZERBO, la communication bénéficie d’une attention particulière depuis plusieurs années. L’élaboration et la validation d’une stratégie de communication en 2020 est un témoignage de la reconnaissance de l’importance de la communication par l’institution. Dans sa structuration, l’Université compte plusieurs unités de formation dont l’Unité de Formation en Lettres, Arts et Communication (UFR/LAC). Elle est l’une des plus importantes en matière d’effectif. À elle seule, l’UFR/LAC comptait au cours de l’année académique 2020-2021, 15 114étudiants répartis dans huit (08) départements d’enseignement avec 75 enseignants permanents. De ce fait, des mouvements de contestations (2017 et 2019) sont enregistrés. Ils opposent souvent les étudiants entre eux et parfois ces derniers à l’administration ou aux enseignants. Les origines de ces crises sont liées à une insuffisance de communication au sein de l’organisation. En effet, « les nombreuses difficultés liées à la gestion du personnel dans le monde des organisations sont souvent liées à l’absence d’une communication interne appropriée » (UNICEF, 2018, p. 56) La recrudescence de ces moments de crises suscite notre intérêt. Pour conduire cette recherche, nous avons voulu comprendre les modes de communication de l’UFR/LAC et évaluer les moyens d’adaptation de la gouvernance et du management au regard de ses spécificités.
1. Problématique
L’enseignement supérieur public au Burkina Faso comme dans de nombreux pays d’Afrique francophone est caractérisé par la surpopulation estudiantine, le manque de personnel adéquat, l’état de détérioration avancée des infrastructures physiques, le manque d’équipements, le retard académique et la baisse du soutien gouvernemental du point de vue budgétaire et politique. A l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), les effectifs des étudiants sont passés de 35 000 étudiants en 2007 à 50 836 en 2020 pour 619 enseignants permanents (UJKZ-DPS[43]-2020)
Déjà handicapée par le manque d’infrastructures et les retards académiques, l’UJKZ fait face à la montée des revendications due à la libéralisation d’internet. Cette situation a été favorisée par le climat social généré par l’insurrection populaire de 2014 où la liberté d’opinion par les usagers a connu une ascendance. Dès lors, les autorités sont, au quotidien, confrontées à la gestion des plaintes. En 2017, une sanction infligée à un étudiant du département des études anglophones par le conseil de discipline de l’UFR/LAC, s’était transformée en mouvement de grève généralisée des étudiants contre l’administration. Des incidents similaires vont se multiplier dans d’autres filières et se caractérisent par des grèves contre l’instauration d’un nouveau régime d’étude, le boycott des évaluations, la prise en otage des responsables académiques. Ces situations alimentent les tensions entre étudiants, enseignants et administration. Pourtant, une communication aurait pu éviter ces situations. Car, « les conflits qui naissent sur les campus portent en filigrane l’absence de communication et de dialogue entre les acteurs de la communauté universitaire. C’est pourquoi, la mise en place d’un cadre de dialogue social est perçue comme un moyen pour améliorer la gouvernance et instaurer un climat plus propice à l’acquisition du savoir » (Premier ministère, 2011, p. 20) ».
Pour B. Miège, (1996, p. 4), « la communication est devenue une préoccupation première des dirigeants des organisations. Elle prend place désormais au rang des orientations stratégiques ». Celle interne est la pierre angulaire du management des ressources humaines au sein d’une organisation. Grâce à elle, la cohésion des travailleurs et leurs motivations sont améliorées. On assiste alors à un renforcement de la culture d’entreprise, du sentiment d’appartenance et à l’amélioration de la circulation de l’information interne. C’est dans cette même dynamique, que nous nous posons la question selon laquelle : comment la communication influence-t-elle l’approche managériale des responsables de l’UFR/LAC en termes de gestion des ressources humaines ?
Cette principale question de recherche interroge l’efficacité de la communication interne de l’UFR/LAC. De cette préoccupation principale, découlent ces questions secondaires : quels sont les modes de circulation de l’information à l’UFR/LAC ? Quels sont les supports utilisés et la pertinence de leur choix ? Quelle appréciation peut-on faire de la gouvernance et du management de l’UFR/LAC ? En termesd’objectifs, général et secondaires, il s’agit en premier d’analyser l’efficacité de la communication interne de l’UFR /LAC dans la stratégie managériale des responsables en charge de l’UFR/LAC. Ensuite, connaitre l’organisation, le mode de fonctionnement et la pertinence de la communication interne de l’UFR/LAC, identifier ses supports de communication et apprécier la gouvernance voire le management au sein de l’UFR/LAC. Notre hypothèse principale est que la communication interne de l’UFR/LAC manque d’efficacité. Les secondaires sont l’UFR/LAC ne dispose pas d’un mode de communication répondant aux besoins de ses parties prenantes ; les supports de communication de l’UFR/LAC ne sont pas adaptés et manquent de pertinence ; la gouvernance et le management de l’UFR/LAC sont plus autoritaires que participatifs.
Dans la conduite de cette étude, nous avons convoqué deux théories. Celle des parties prenantes ou stakeholder et celle de Harold Dwight Lasswell. La première s’intéresse àl’ensemble des individus qui peuvent être affectés par la réalisation des objectifs organisationnels de l’entreprise. Elle considère que la responsabilité de l’organisation est de concilier les intérêts contradictoires des groupes qui sont en relation directe avec elle. C’est donc une approche participative dans la gestion des hommes au sein des organisations. Cette théorie prône l’intégration de l’ensemble des partenaires à la démarche, car l’organisation n’est pas une entité abstraite qui vit en vase clos. De ce fait, elle partage des intérêts avec un ensemble d’acteurs qui défendent aussi chacun leurs propres intérêts spécifiques.
La seconde théorie, celle de LASSWELL, nous amène à nous interroger sur les modes de communication de l’UFR/LAC. Elle cherche à comprendre les modes de production et de circulation de l’information au sein de l’UFR. L’UFR/LAC ne disposant pas de service de communication à proprement dit, c’est le secrétariat du directeur, celui principal, la scolarité et parfois les délégués de promotions qui en sont les provenances. Cette situation créé un flux d’information souvent mal interprété par les acteurs internes. Or pour Lasswell, n’importe quelle information peut atteindre son destinataire, à condition qu’il n’y ait pas d’interférence. Cette théorie repose sur les cinq (05) questions que sont Qui ? Dit quoi ? À qui ? Par quel moyen ? Avec quels effets ? Nous avons retenu cette théorie car les acteurs s’influencent mutuellement. Cette théorie est compatible à la troisième théorie retenue dans le cadre de cette réflexion notamment celle de la dissonance cognitive de Festinger (1957) et Bateson (1980). Cette théorie permet d’appréhender le comportement des acteurs impliqués dans une dynamique communicationnelle. Ainsi, pour ces auteurs, une personne qui se trouve confrontée simultanément à des informations, opinions, comportements ou croyances qui la concernent directement et qui sontincompatibles entre elles, ressent un état de tension désagréable. Le concept de dissonance cognitive est lié au fait qu’il est plus difficile pour un individu de corriger des idées acquises depuis longtemps que d’apprendre des idées nouvelles pour lesquelles il ne dispose pas encore d’un modèle ou d’un système de représentation.
2. Méthodologie et présentation de l’UFR/LAC
2.1. Méthodologie de travail
Une démarche à la fois quantitative et qualitative a été adoptée pour conduire cette étude. Outre la recherche documentaire et l’observation participante, nous avons collecté des informations auprès des acteurs à travers un questionnaire et un guide d’entretien. La recherche documentaire a porté sur des documents traitant de la communication interne, de la gouvernance universitaire et du management des ressources humaines. En ce qui concerne l’observation directe, elle permet, d’après Jean-Louis J-L Bayle, (2000, p. 67), l’accès à des sources d’informations qui seraient inaccessibles à un observateur étranger. Cette méthode a permis de connaître le phénomène étudié de l’intérieur, avec tous les avantages que cela comporte pour une meilleure compréhension des faits observés. Ce procédé nous a permis d’appréhender d’autres aspects de la communication interne et du management en étant en contact avec les faits. S. T. Balima et M. S. Frère (2003, p. 50) soulignent que « le but de la démarche est de voir, de sentir, d’éprouver soi-même ce que les autres voient, sentent, éprouvent. Il s’agit de vivre de l’intérieur la culture, le milieu que l’on cherche à connaître ». Ainsi, selon le statut des acteurs concernés ici, notamment les étudiants ou anciens étudiants-enseignants actuellement dans cette UFR, nous vivons au quotidien les réalités.
Pour les enquêtes, nous avons adopté l’entretien et le questionnaire. L’entretien semi-directif a été retenu. Il a permis de mieux cadrer les enquêtés afin de concentrer l’entretien sur les objectifs chaque fois que le sujet s’en écarte. Enfin, l’administration du questionnaire. C’estune série de questions relatives à une situation, à des opinions, à des attentes, à des niveaux de connaissance ou de conscience d’un phénomène. Cet outil nous a aidés à récolter les informations à caractère quantitatif auprès de 146 acteurs. Dans l’élaboration du questionnaire, les questions à réponses fermées et semi fermées ont été utilisés.
2.2. Présentation de l’UFR/LAC et échantillon
L’UFR/LAC est composé de huit (08) filières. Mais sept (07) sont opérationnelles actuellement. La huitième, celle des études arabophones et langues orientales est en création. Les sept fonctionnelles comportent quatre (04) formations classiques et trois (03) formations professionnalisantes. Dans le cadre de cette recherche, nous avons retenu les filières classiques car celles professionnelles ont été effectifs maitrisés et sont moins sujettes aux crises. Notre travail porte de ce fait sur les filières Lettres modernes (LM), Études germaniques et Études anglophones. Ce sont les filières où les crises sont récurrentes.
La détermination de la taille de l’échantillon dépend aussi en grande partie du plan d’étude[44]. Ainsi, les enquêtés sont composés de l’ensemble des étudiants des trois filières retenues, du personnel Administratif, Techniques, Ouvriers et de Service (ATOS), des enseignants des trois (03) filières et des syndicats d’étudiants et d’enseignants. Au niveau des enseignants, l’UFR compte au total 75 enseignants permanents de tout rang. Ceux des filières concernées par l’étude sont au nombre 51 dont 07 femmes.
Au niveau du personnel ATOS, les personnes ayant plus de deux (02) ans de service au sein de l’UFR/LAC sont les cibles retenues. Certains d’entre eux exerçaient déjà dans d’autres unités de formation avant d’être affectés à l’UFR/LAC. L’UFR/LAC compte au total 22 ATOS repartis donne 14 hommes et 08 femmes. Pour les besoins de l’étude, nous avons retenu 05 hommes et 03 femmes.
Quant aux étudiants, l’échantillon choisi est l’ensemble des étudiants ayant plus de deux (02) ans soit plus d’une année d’inscription sur le campus. Ce choix parce que deux (2) ans de présence sur le campus, sont suffisants pour mieux connaitre les difficultés auxquelles leur UFR est confrontée. Ainsi, pour l’étude, nous avons retenu les gros effectifs par ordre croissant. L’UFR/LAC compte 15 114 étudiants. Ils sont composés de 9 050 hommes et 6 064 femmes. Ces trois filières comptent à elles seules 14 142 dont 5 547 femmes. Nous avons retenu 142 étudiants en tenant compte des spécificités de chaque filière.
En somme, nous avons travaillé sur un échantillon composé de 173 individus. Dans l’échantillonnage, le genre a été pris en compte. Le pourcentage par catégorie de 173 individus donne 10% des enseignants de tous grades, 40% des ATOS, 1% des étudiants et 02 membres de syndicat composés d’enseignants et d’étudiants. Un manque d’information et l’absence d’une liste exhaustive des syndicats nous ont conduits à prendre les deux syndicats les plus actifs à l’issue de nos observations internes.
La méthode d’échantillonnage aléatoire simple a aidé à la sélection des enquêtés. Elle a permis de donner une chance égale à chaque unité de notre population. La procédure a permis de dresser la liste de toutes les unités de la population observée. Les filières qui ont un effectif compris entre 1000 et 6000 étudiants ont été préférées. Pour les étudiants, nous nous sommes intéressés aux délégués d’UFR, de promotion et 1% de l’effectif global des étudiants des trois filières avec possibilité d’extension. Car, la plupart des aspects communicationnels se déroulent entre les représentants d’étudiants (délégués d’UFR et de promotion), enseignant et administration. Les tableaux suivants précisent les échantillons par catégorie d’acteurs.
Tableau 1 : Échantillon de l’enquête par entretien
| Chef de départements | Enseignants | Personnel administratif | Syndicats | |
| Lettres modernes | PT :1, ; MC :2 ; MA :2 A :3 ; EPT :1 | |||
| Allemand | MA :1 ; A :1 | |||
| Anglais | Mc :1 ; MA :1 | |||
| Total | 03 | 14 | 08 | 02 |
| Total général | 27 | |||
Source : Enquête terrain, UFR/LAC (UJKZ), 2021
Tableau 2 : Échantillon de l’enquête par questionnaire
| Délégués de promotion | Étudiants | Délégués d’UFR | |
| Lettres modernes | 1 | 64 | 1 |
| Allemand | 1 | 18 | |
| Anglais | 1 | 60 | |
| Total | 03 | 142 | 01 |
| Total général | 146 | ||
Source : Enquête terrain, UFR/LAC (UJKZ), 2021
À partir des observations faites, des réponses obtenues des questionnaires et des entretiens avec les différents acteurs de l’UFR/LAC, nous avons dégagé les facteurs qui mettent à mal la communication interne de l’unité. Pour chaque composante de la population cible, les données collectées ont fait l’objet d’une analyse par thématique des discours. L’anonymat a été requis pour les personnes enquêtées. Pour les enseignants et le personnel ATOS, nous n’avons pas précisé le poste occupé au sein de l’UFR/LAC. Pour le traitement des données, nous avons utilisé une méthode manuelle et une méthode automatique notamment l’utilisation du logiciel Excel pour la construction des graphiques.
3. Présentation des résultats des entretiens et discussion
3.1. Présentation des résultats des observations et des entretiens
Les observations internes faites au sein de l’UFR/LAC ont porté sur les outils, les modes et la perception des acteurs sur la diffusion et la circulation de l’information à l’UFR/LAC. Il en ressort qu’il y a des réunions, des concertations au niveau des étudiants, des syndicats d’étudiants et entre les étudiants par promotion. Cependant, aucune mention des assemblées d’enseignants et de personnels. Néanmoins, il se tient parfois des instances comme le conseil de gestion, des rencontres d’enseignants et de la direction dont la régularité n’est pas fixe. Ce constat laisse penser qu’au sein de l’UFR, ces deux acteurs n’ont pas une organisation structurée. En revanche, ils appartiennent à des structures organisées au sein de l’université. Sur les informations concernant les étudiants, elles sont, pour la plupart, affichées sur les tableaux dédiés à cet effet ou livrées aux différents délégués ou responsables de promotion par divers canaux qui peuvent être des appels ou des notes circulaires. Ces derniers sont chargés de les relayer auprès de leurs camarades. Ces informations viennent souvent de l’administration, de la scolarité ou des enseignants. Elles concernent, pour la plupart du temps, la programmation des cours et devoirs. Quant aux enseignants, ils reçoivent leurs informations via des courriers, des notes de service à travers les boites à lettres dans les départements où lors de leur passage au secrétariat. Lorsqu’il y a une urgence, certains reçoivent des appels téléphoniques.
Sur les données de l’enquête qualitative, notre objectif était de comprendre ce que représente la communication interne pour nos enquêtés. Sur les outils, les appréciations du niveau de la communication interne par le personnel ATOS ne sont pas bonnes. Il la juge insuffisante et peu organisée. « La communication interne n’est pas suffisamment prise en compte au sein de l’UFR/LAC », estime une secrétaire. Cette impression est également partagée du côté des enseignants.Que ce soit d’administration à enseignants ou d’enseignants à enseignants ou encore d’enseignants à étudiants et vice-versa, plusieurs pensent que la communication interne n’est pas adaptée à leurs besoins. Outre l’accès à l’information, les retards dans leur diffusion, certains pointent du doigt la gouvernance et le management. « Ici, c’est la jungle, il y a des clans et des parrains vous savez », nous explique un. « Il y a de réels problèmes de communication. Il n’y pas de vie universitaire. Chacun vient faire ses cours et s’en va. En dehors de ça, tu te débrouilles et fais tes obligations. L’UFR est à l’image du pays », estime un autre.
Pour les syndicats, leurs opinions sur la communication interne globale de l’UFR/LAC ne sont pas différentes. « Il n’y a pas de communication » lâche d’emblée un. « On vous donne des informations quand ça les prend. Rarement les instances se tiennent » avoue-t-il. Des entretiens avec les chefs des départements, responsables des trois filières où nous avons mené nos enquêtes, ils reconnaissent de réels problèmes de communication mais s’en défendent. « Nous sommes à la tête des départements à gros effectifs. C’est un héritage. Les problèmes sont certes réels. Mais que pouvons-nous quand vous avez des acteurs pas faciles qui ont tout le temps raison et qui refusent de voir la réalité en face notamment les étudiants. Quant à nos collègues, il faut faire avec. Pour avancer, nous sommes obligés de nous concentrer sur l’essentiel en mettant la communication en second plan par l’absence de moyens ». Et un autre de renchérir. « La hiérarchie vous presse de rattraper les retards. À l’interne, les étudiants sont là, à vouloir vous voir faire comme ailleurs oubliant que les réalités sont différentes. Ce n’est pas facile. Mais on a accepté et on fera ce qu’on peut », lance -t-il.
3.2. Présentation des résultats des questionnaires
Ces résultats exposent la compréhension de la communication interne, les besoins, les canaux, les attentes et l’appréciation des étudiants par rapport à la communication et au management de l’UFR / LAC.
Graphique 1 : Compréhension de la communication interne par les étudiants
Source : Enquête terrain, UFR/LAC (UJKZ), 2021
La notion de communication interne revêt plusieurs compréhensions chez les étudiants. Aussi diverses que variées, elles témoignent de la richesse et de la complexité de la notion. Dans le graphique 1, il ressort que la communication interne, c’est se renseigner, échanger avec les autres, être informé et interagir avec les autres. Cela se justifie par les taux de 34% des enquêtés qui estiment qu’elle consiste à se renseigner alors que 33% soutiennent qu’elle vise à interagir tandis que pour 28%, elle consiste à informer. Ces divergences de points de vue autour de la notion de communication rassurent sur leurs attentes.
Graphique 2 : Attentes des étudiants concernant la communication interne de l’UFR/LAC
Source : Enquête AC (UJKZ), 2021
Le graphique 2 fait état de l’influence des étudiants dans la dynamique de la communication interne de l’UFR/LAC. Dans leur majorité, ils souhaitent que la communication interne facilite les interactions au sein de l’UFR/LAC. En somme, la communication interne doit permettre de fédérer tous les acteurs autour d’un objectif commun. Ainsi, elle deviendra un facteur de cohésion et d’harmonie. C’est l’attente de 76% de nos enquêtés. Cette attente se ressent à travers l’expression des besoins en information exprimés par les étudiants de l’UFR/LAC.
Graphique 3 : Besoins d’informations des étudiants de l’UFR/LAC
Source : Enquête terrain, UFR /LAC (UJKZ), 2021
Les besoins en informations des étudiants sont identifiés. Ils sont 40% à vouloir que l’UFR/LAC communique sur ses différents services. 36% veulent qu’elle diffuse davantage des informations sur les calendriers des devoirs et évaluations. En revanche, 34% attendent d’elle, qu’elle communique sur ses activités et 29% souhaitent avoir des informations sur les programmations des cours. Les données de ce graphique prouvent que les besoins en termes d’informations des étudiants sont énormes. Pour ce faire, ils ont proposé les canaux qu’ils préfèrent.
Graphique 4-a : Canaux par lesquels les étudiants reçoivent et souhaitent recevoir les informations
Source : Enquête terrain, UFR /LAC (UJKZ), 2021
Graphique 4-b : Les canaux de communication privilégiés par des étudiants
Source : Enquête terrain, UFR /LAC (UJKZ), 2021
À travers le graphique 4-a, l’affichage est le support privilégié actuellement pour diffuser les informations au sein de l’UFR/LAC. Ce canal d’information n’est pas priorisé par les étudiants. Les tableaux d’affichages sont, non seulement, en nombre insuffisants, mais aussi manquent de coordination et sont parfois surchargés et non actualisés. Au niveau du graphique 4-b, les réseaux sociaux viennent en tête des canaux privilégiés par les étudiants pour s’informer. Le fait qu’il n’existe pas de point focal d’information, en dehors des délégués des promotions et de la scolarité, les étudiants sont parfois obligés d’aller sur les réseaux sociaux numériques comme infos de l’UFR/LAC[45], UO I24[46] et Oreille du campus pour s’informer[47]. Ces plateformes d’information sont des stratégies développées par des étudiants eux-mêmes pour faciliter l’accès à l’information. Certains étudiants passent par les appels et d’autres, par des demandes d’audience pour obtenir des informations. Au regard des données des graphiques 4-a et b, nos enquêtés ont évoqué leurs canaux de préférence pour recevoir les informations.
Graphique 5 : Appréciation de la communication interne de l’UFR/LAC par les étudiants
Source : Enquête terrain, UFR/LAC (UJKZ), 2021
Le graphique 5 montre que 98 étudiants sur 158 estiment que la communication est mauvaise. Cependant, ils sont 50 à trouver qu’elle est bonne. Ces chiffres interpellent les autorités sur les besoins en information et communication des étudiants.
3.3. Discussions
3.3.1. Sources, besoins et modes de circulation de l’information entre les acteurs internes de l’UFR/LAC
Les sources des situations conflictuelles au sein de l’UFR/LAC proviennent du faible niveau de communication interne, notamment la non-adaptation des canaux de diffusion des informations, déplorent certains acteurs. En effet, la communication interne ne se résume pas à faire circuler des notes de service. Elle doit prendre en compte les aspects sociaux.
En plus de constituer un facteur d’échanges, la communication interne doit aussi être un facteur de cohésion dans une organisation. Car, au sein d’une organisation, le personnel a besoin de se tisser de nouveaux liens de fraternité pour se sentir en sécurité. Ainsi, J.-M. Decaudin et J. Egalens (2009, p. 14) affirment que « rares sont les personnes qui peuvent travailler ensemble sans tisser des liens par la communication interne ».
La difficulté première de la communication interne de l’UFR/LAC demeure la circulation de l’information. L’ensemble des acteurs trouvent que les canaux de communication utilisés ne sont pas adaptés. La communication interne est une composante essentielle des organisations. Sa réussite assure une cohésion et prévient les conflits. Elle découle, en principe, de la stratégie globale l’Université (institution). En plus de veiller à une bonne circulation de l’information, elle est aussi un outil de management. Or, l’UFR/LAC n’en dispose pas et ne possède non plus un service en charge de la communication. Pour D. Bougnoux (2001), donner l’information fait partie de la stratégie globale de communication d’une organisation. Cependant, la communication interne ne s’arrête pas uniquement à la diffusion de l’information. Selon l’auteur, l’information est un contenu chargé de signification, par contre la communication interne est chargée de tisser des relations afin d’apporter du sens. C’est l’ensemble des flux d’information et des échanges visant un équilibre informationnel et relationnel (N. D’Almeida et T. Libaert, 2014). La particularité de la communication interne est qu’elle est destinée à l’ensemble des acteurs de l’organisation sans exception. Nos enquêtes révèlent que les instances statutaires que sont les conseils d’établissement et scientifiques et les réunions se tiennent souvent, mais les comptes rendus ne sont pas envoyés à tous les participants. Ce qui fait que les informations et décisions ne sont pas connues de tous. Outre ces constats, il y a la lenteur et la rétention d’information à certains niveaux. La classification des outils de communication notamment les courriers montrent une importante communication hiérarchique, descendante, où le message émane de la direction via les secrétariats ou la scolarité. D’après les entretiens, la communication descendante est jugée plus importante qu’auparavant. Mais les informations diffusées sont parfois jugées insuffisantes ou arrivent souvent avec un retard du fait du manque de suivi. Ainsi, c’est la lourdeur des circuits d’information officielle qui est pointée du doigt par le personnel. Toujours selon D. Bougnoux (2001), la diffusion de l’information au sein d’une organisation permet au personnel d’être au courant des modalités de fonctionnement du service par contre celle-ci ignore souvent l’individu au sein de l’organisation. En revanche, la communication interne permet de cerner la dimension humaine grâce à l’obligation de ménagement au sein de l’organisation.
3.3.2. Management et gouvernance au sein de l’UFR/LAC
À ce niveau, certains acteurs perçoivent l’UFR/LAC comme un instrument de contrainte. Il en résulte un faible degré d’appartenance et un manque de confiance. La non tenue régulière des conseils d’établissement pour échanger sur la vie au sein de l’UFR/LAC montre que les responsables ne se soucient pas de la cohésion sociale et l’amélioration des rendements de l’institution. Ainsi, sans connaître les aspirations de son personnel, il est difficile d’anticiper et désamorcer les éventuels conflits ou tensions. Facteur de bon climat social, la communication interne est aussi un moyen d’améliorer les performances de l’organisation ; d’où son importance. À l’UFR/LAC, les avis sont multiples sur la communication ascendante. La déception d’une partie du personnel est liée aux limites du management. En dépit de l’évolution des outils et les dynamiques actuelles, les responsables continuent de vouloir diriger à l’ancienne. Ceci s’explique par le caractère dépassé des textes. Les effectifs ne sont plus adaptés à l’esprit qui a prévalu à l’élaboration des textes. « Pour des organisations à fortes tailles humaines, le mode de gestion participatif pourrait faciliter la consultation et la concertation. En lieu et place, les responsables prennent des décisions dont l’application se révèle inopérante » avoue un enseignant. Une telle situation a conduit des étudiants à refuser des compositions. De plus, il n’y a pas de pratique unifiée des outils de communication déjà existants (affichage). Cet état des lieux corrobore notre hypothèse initiale qui affirme que l’UFR/LAC manque d’une communication interne efficace. Intégrer donc la dimension ressources humaines dans la stratégie des organisations est une nécessité reconnue. Les organisations doivent avoir une stratégie de développement humain et social en harmonie avec leur stratégie économique et leur responsabilité´ sociale (J.-M. Peretti, 2013, p. 1). Mais pour y arriver, l’UFR/LAC peut mettre en place un point focal de communication au sein de l’UFR/LAC, adapter les canaux de communication aux besoins des cibles et réduire les délais de transmission des informations. En outre, elle peut prévoir une ligne budgétaire pour les actions de communication et impliquer davantage les acteurs clés (Etudiants, ATOS, syndicats et enseignants) dans les prises de décisions à travers un management participatif. Ainsi, il est nécessaire de communiquer sur les performances réalisées par l’UFR/LAC en termes d’amélioration des résultats et évaluer la portée des informations diffusées afin de savoir si les cibles sont touchées à travers les feedbacks. C’est pourquoi, en se référant aux six dimensions de la communication interne de C. Michon (1994) qui sont : information, convivialité, participation, fédération, implication, identification, les institutions, qu’elles soient publiques ou privées doivent intégrer la communication interne dans leur stratégie de management afin d’apporter des réponses adéquates aux problèmes de communication tout en minimisant les incompréhensions. Selon C. Michon, le responsable de communication interne est chargé de gérer les projets de communication interne liés à l’activité de l’organisation notamment l’adhésion aux valeurs, au changement stratégique et au projet d’amélioration de la qualité de service de l’organisation.
Conclusion
La communication interne semble être négligée, mais elle est l’un des éléments les plus importants dans une institution. Elle est plus liée à la gestion du personnel qu’à de simples diffusions d’informations et ne peut être soustraite de la stratégie globale de l’organisation. Elle est de ce fait, toute la communication mise en place au sein d’une institution et à destination de tout son personnel. Ses actions interviennent pour rassembler l’ensemble du personnel autour de l’image de l’organisation. C‘est un outil de management indispensable qui facilite, non seulement, le fonctionnement des services mais permet aussi à chacun de comprendre la vision de l’organisation. Sa conduite et son succès nécessitent des moyens humains et financiers, P. Detrie et C. M. Broyez, (1995, p. 47 ). La communication interne efficace repose plus sur des comportements que sur des supports, et donc plus sur le management que sur des techniques.
Notre étude avait pour objectif d’analyser la communication interne de l’UFR/LAC afin d’apporter des suggestions. L’enquête menée au sein de l’UFR/LAC a permis de confirmer le fait que l’institution ne dispose pas d’un mode de communication efficace. Aussi, les canaux et les modes de communication de l’UFR/LAC sont inappropriés. La place de la communication interne actuelle au sien de l’UFR/LAC doit être revisitée et rehaussée. Chaque responsable d’organisation doit comprendre le rôle déterminant que la communication joue dans toute gestion efficace.
Références bibliographiques
BALIMA Serge Théophile, DUCHENNE Véronique, 2005, Méthodologie de la recherche en science de l’information et de la communication : L’élaboration du mémoire de maitrise, Ouagadougou, Ed. Sankofa.
BOUGNOUX Daniel, 2001, Introduction aux sciences de la communication, Paris, Ed. La Découverte.
DECAUDIN Jean-Marc, EGALENS Jacques avec la collaboration de WALLER Stéphane, 2009, La communication interne, stratégie et techniques, Paris, DUNOD 2e Edition.
DETRIE Phillipe, MESLIN-BROYEZ Catherine, 1995, La communication interne au service du management, Dijon-Quetigny.
FESTINGER Léon, 1957, A theory of cognitive dissonance, Stanford University Press.
https://books.openedition.org/pum/14800?lang=fr, consulté le 06/11/2021.
https://web.facebook.com/groups/1784029735193699, consulté le 14/07/2021.
https://web.facebook.com/groups/449137742668729, consulté le 21/06/2021.
https://web.facebook.com/Oreilleducampus-143066116168546, consulté le 21/08/2021.
LOUBET Jean-Louis DEL BAYLE, 2000, Initiation aux méthodes des sciences sociales, Paris, L’Harmattan.
MEIER Olivier, 2001, Déco de manager, Paris, Dunod.
MICHON Christian, 1994, « Communication et organisation », in Revue scientifique francophone en Communication organisationnelle.
MIEGE Bernard, 1996, La société conquise par la communication,Tome 1, logiques sociales, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
Premier Ministère, 2011, Comité ad hoc de réflexion sur l’université du Burkina Faso, L’enseignement supérieur au Burkina Faso : Diagnostic, défis et normalisation De ses institutions. DEPS : Direction des Etudes, de la Planification et Statistiques 2019-2020.
QUIV Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc, 1988, Manuel de recherche en science sociales, Paris, Dunod.
THEATART Raymond Alain, 1980, Le management, Paris, Presse universitaire de Paris.
DEUXIÈME AXE : UNIVERSITÉ ET QUESTION DU GENRE
FEMMES ET CARRIÈRES À L’ÉPREUVE DE LA DISPARITÉ FONDÉE SUR LE SEXE AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ DE N’DJAMENA
1. Dieudonné VAÏDJIKÉ
Université de N’Djamena (Tchad)
2. Alexis NGARMBATEDJIMAL
Université de N’Djamena (Tchad)
3. François NDILBÉ MBAÏNGUEM
Université de N’Gaoundéré (Cameroun)
Résumé :
Les carrières des femmes à l’Université de N’Djamena (doctorat, post-doctorat, premier poste, postes à responsabilité…), comme dans d’autres universités du pays et d’ailleurs, restent largement en retrait par rapport à celles des hommes. Les femmes semblent s’intégrer difficilement et sont sous-représentées à tous les niveaux : pédagogique, administratif et décisionnel. Une démarche qualitative, intégrant la revue documentaire, l’observation directe et les entrevues individuelles menées auprès de quelques acteurs de l’enseignement supérieur, montre que la féminisation progresse dans l’espace universitaire n’djamenois. Cependant, les instances de recrutement de l’enseignement supérieur et le fonctionnement de l’Université de N’Djamena ne sont pas exonérés des risques de discrimination (indirecte) ou de marginalisation.
Mots-clés : carrière universitaire, discrimination, enseignante-chercheure, femme, genre, N’Djamena.
Abstract :
The careers of women at the University of N’Djamena (doctorate, post-doctorate, first position, positions of responsibility, etc.), as in other universities in the country and elsewhere, remain largely behind those of men. Women seem to have difficulty integrating and are under-represented at all levels: educational, administrative and decision-making. A qualitative approach, integrating the documentary review, direct observation and individual interviews conducted with a few higher education actors, shows that feminization is progressing in the N’Djamenian university space. However, the higher education recruitment bodies and the functioning of the University of N’Djamena are not exempt from the risks of (indirect) discrimination or marginalization.
Keywords : university career, discrimination, teacher-researcher, woman, gender, N’Djamena.
Introduction
Les recherches sur les femmes, dans le milieu universitaire, ne sont pas un fait nouveau. Plusieurs études se sont inscrites dans la suite logique des interprétations et explications consacrées à la place, à la responsabilisation, à la condition de la femme et/ou aux conditions de travail des femmes, dans les universités comme dans d’autres institutions, au regard de la société sur leur vie professionnelle. En dépit de nombreuses étapes franchies à l’échelle mondiale, qui tendent vers l’égalité entre l’homme et la femme, les femmes universitaires, dont celles du Tchad, subissent, dans leur carrière, des inégalités sexuelles liées au genre[48]. Elles sont, très souvent, discriminées, écartées de certaines responsabilités, mais aussi de certains avantages professionnels à cause de leur statut de femme. Cela ne signifie-t-il pas que les politiques du genre demeurent encore des nouvelles problématiques qui préoccupent, si nous voulons comprendre et expliquer les barrières auxquelles les femmes font face dans l’exercice de leur métier, dans la valorisation de leur surinvestissement ?
En effet, les femmes, en particulier les enseignantes-chercheures de l’Université de N’Djamena comme celles d’autres universités du Tchad et d’ailleurs, sont victimes des inégalités sexuelles qui se justifient par leur faible représentation dans les instances décisionnelles, administratives et pédagogiques. Considérées comme des individualités particulières du « sexe faible », puis supposées être insuffisamment représentées dans les activités de promotion et dans l’analyse de leurs évolutions contrairement aux hommes (S. Louvel et A. Valette, 2014), les enseignantes-chercheures de l’Université de N’Djamena, à l’instar d’autres femmes universitaires, sont quelquefois retardées ou exclues des activités scientifiques. De ce fait, les femmes ne construisent-elles pas difficilement leur projet de carriériste à l’Université de N’Djamena ? Les compétences professionnelles constatées chez les hommes et les femmes en milieu universitaire ne doivent-ils pas permettre aux femmes d’y exercer les mêmes fonctions que les hommes ? Comment rétablir l’égalité de sexes dans la promotion académique universitaire ?
Pour traiter ces questions, qui découlent de notre préoccupation sur la répartition inégale des tâches entre hommes et femmes au sein de l’Université de N’Djamena, nous proposons une approche méthodologique consistant à recourir à des données empiriques afin de confronter les éléments de réponse obtenus à partir de la méthode qualitative.
1. Approche méthodologique
Comme nous l’avons mentionné, cette étude s’inscrit exclusivement dans la démarche qualitative. Compte tenu de la qualité des informations recherchées, nous proposons cette méthode pour aborder les acteurs sur les situations qu’ils ont vécues ou expérimentées en matière de discriminations liées aux inégalités de sexe. Ainsi, certaines questions ont été animées par des entretiens pour éclairer les résultats par des motivations de personnes et la carrière dans l’enseignement supérieur. Sans doute, les femmes et les hommes universitaires ont constitué la population cible de cette étude lors de la collecte des données sur le terrain.
La taille de l’échantillon est constituée de 25 personnes, dont 10 hommes et 15 femmes de l’Université de N’Djamena. Si le nombre des femmes dépasse celui des hommes, c’est parce que nous leur avons donné l’opportunité d’exprimer ce qu’elles ressentent effectivement en tant qu’enseignantes-chercheures ou travailleuses dans l’enseignement supérieur. Cependant, il faut relever que certaines occasions de rencontre ont facilité la tâche dans la collecte des informations recherchées. D’abord, notre collaboration avec les collègues de l’Université de N’Djamena, qui se sont rendus disponibles à décrire ce qu’ils savent des conditions de travail de leurs collègues femmes. Enfin, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’Institution du 04 au 09 mai 2022, qui a mobilisé tout le personnel enseignant, administratif et partenaire, nous avons pu mettre à profit le temps pour échanger avec quelques autorités universitaires et enseignants-chercheurs (hommes et femmes) des quatre sites universitaires de N’Djamena (Ardepdjoumal, Farcha, Gardolé et Toukra).
Les critères de sélection de nos informateurs tiennent compte, entre autres, de la profession et du rôle des enseignants-chercheurs dans l’enseignement supérieur. Cela nous a permis de bien identifier nos interlocuteurs avec qui nous avons partagé de riches connaissances sur les conditions de travail des enseignantes-chercheures ou chercheures à l’Université de N’Djamena. Les résultats obtenus se présentent sous la formule de discussion avec la confrontation des éléments des réponses de différents types. Les axes d’information sont relatifs aux perceptions de la carrière des femmes dans l’enseignement supérieur, mais aussi aux difficultés qu’elles y rencontrent.
2. Résultats et discussion
La collecte des données sur le terrain a permis d’obtenir les résultats. Ces résultats sont présentés ici sous forme de discussion et d’analyse reposant sur la confrontation des idées ou de différents points de vue des acteurs interrogés.
2.1. Organes de gouvernance et politique du genre dans l’espace universitaire tchadien
Dans les institutions publiques et privées, en général, la politique de l’égalité entre hommes et femmes inspire une gestion inclusive des ressources humaines dans le processus de développement et les politiques publiques (A. Moukaddem et A.-F. Bender, 2021). Le droit de la femme séduit, par conséquent, un nombre important de textes sur le genre dans ces institutions, parce que l’émancipation et/ou l’épanouissement des femmes, voire leur participation aux décisions politiques au même titre que les hommes, sont à la base des objectifs mondiaux de développement (ONU, 2015). À partir de ces objectifs, les femmes figurent dans de nombreux programmes de développement, et doivent faire partie des instances importantes de décision pour le progrès sur tous les plans. Cela sous-tend que les femmes occupent une place prioritaire dans les programmes politiques qui promeuvent leur épanouissement et autonomie, dans les grandes institutions telles que les Universités. C’est ce que F. Fassa et al. (2019, p. 1) ont fait comprendre dans leur analyse lorsqu’ils affirmaient : « Depuis la fin du XXe siècle, les interventions des gouvernements en faveur de l’égalité se sont multipliées, tout au moins dans les discours, pour qu’une place de plus en plus grande soit faite à de telles politiques et contribue à la lutte contre les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes ».
Au Tchad, notamment, l’intégration des femmes à l’enseignement supérieur s’accompagne de l’élaboration de textes légaux pour la reconnaissance de leurs droits. Des organes tels que le Conseil d’Administration (CA), la Présidence de l’Université (PU) et le Conseil d’Enseignement et de la Vie Universitaire (CEVU) sont chargés d’appliquer les textes et de promouvoir la politique du genre au sein de l’Université, dans le but d’aider les femmes à y exercer leur métier, sans discrimination, sans harcèlement, etc., dans l’égalité des chances. Mais, il s’avère que la politique du genre est banalisée, réduite à des jeux de l’impression laissant toujours les femmes dans les conditions accablantes de travail. Elle tient lieu du choix que ces dernières devraient opérer entre l’abandon et la survie pour échapper aux inégalités socioprofessionnelles. Cette politique est loin de prendre en compte les obstacles auxquels les femmes font face à différents niveaux de formation et de vie professionnelle. Par conséquent, l’exécution de la politique du genre se pose avec acuité ; et les règles d’égalité et de promotion des femmes dans l’espace universitaire s’engloutissent dans les politiques discriminatoires entravant leur progression dans la carrière universitaire. Il faut comprendre que, malgré l’existence des organes d’exécution de la politique du genre, les femmes rencontrent des difficultés dans la carrière de l’enseignante-chercheure, parfois à cause du poids des pesanteurs socioculturelles[49].
Il est vrai que les règles de promotion et d’égalité entre les sexes profitent généralement aux hommes qui se considèrent comme le sexe supérieur. Du coup, la gestion et le fonctionnement de l’espace universitaire reposent sur l’inégalité des droits, des responsabilités et des opportunités dont devraient jouir à la fois les hommes et les femmes. Les hommes sont davantage privilégiés dans leurs carrières. Or, le but de la politique du genre consiste à prendre en compte la répartition des rôles et des activités des femmes et des hommes dans la société ; cela pour tendre vers un équilibre des rapports des pouvoirs entre les sexes (Rapport de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes en Chine, 1996) et vers un partenariat effectif entre les deux sexes (S. de Beauvoir, 1949), dans le système valorisé des chercheurs. Un système qui consiste à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de l’enseignement et de la recherche scientifique.
2.2. Responsabilisation des femmes à l’Université de N’Djamena
Dans le monde du travail, en général, et en particulier, dans l’espace universitaire, la disparité entre les sexes reste profonde : les possibilités d’emploi et de responsabilité sont moindres pour les femmes. Aussi, pour réussir professionnellement, celles-ci doivent s’adapter au modèle masculin et en adopter les valeurs de compétitivité et d’agressivité. Les femmes carriéristes de l’Université de N’Djamena ne sont pas moins concernées, comme celles d’autres universités du Tchad et d’ailleurs, du fait de leur présence moins significative dans l’investissement pédagogique, mais surtout administratif. Elles sont peu associées aux postes de responsabilité. Les hommes sont visibles à des postes stratégiques et valorisés à plusieurs titres (Ministère de l’éducation nationale, 2000), tandis que les femmes, actives à l’intérieur de l’université, s’occupent rarement des postes stratégiques comme « présidente d’université ». Il en résulte que leur place est moins considérée dans les instances de prise des décisions qui marquent la vie politique et scientifique de l’université. Dès lors, la culture de différence devient une norme ou une règle normale de nomination dans les tâches administratives, comme l’avouent Lhenry (2005) et Fassa et al. (2019).
Nombre de penseurs, tels que Platon, reconnaissent aussi que la nature de la femme est différente de la nature de l’homme. Cependant, ils affirment que des natures distinctes doivent se consacrer aux mêmes occupations. Toutefois, il faut « confier aux femmes une part plus légère qu’aux hommes, compte tenu de la faiblesse de leur genre » (Platon, 2002, 457a). En clair, aux yeux de Platon, la femme et l’homme ont les mêmes aptitudes, cependant, il faut réserver à la femme les tâches plus légères, et par suite, choisir les femmes qui sont physiquement et intellectuellement aptes comme l’homme pour les mêmes fonctions.
En effet, à cause des inégalités sexuelles, l’on s’imagine que les femmes ne sont pas bien positionnées pour commander les hommes, ou instruire, dans un milieu où on retrouve les hommes majoritairement, et plus aisément à des postes plus stratégiques. La discrimination fondée sur le sexe est illégale. Mais même après l’égalité des sexes établie dans la loi ou la constitution, il reste souvent des us et coutumes conférant des droits ou des privilèges aux hommes. C’est ainsi que les hauts postes de commandement, ou les postes clés, sont fortement concentrés entre les mains des hommes qui se partagent les premiers rôles, les responsabilités et les opportunités scientifiques de grandes importances. Ces propos l’illustrent succinctement : « Les femmes ont accès seulement aux postes des secrétaires, mais aussi certains postes techniques ou de ressources financières. Rares, elles n’accèdent aux postes du haut sommet de l’Université »[50]. Cela montre bien évidemment que les femmes sont peu impliquées dans les instances de prise de décisions importantes pour la vie universitaire. Elles s’étaient nourries de l’espoir de renverser la donne avec la nomination d’une femme à la tête du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation pendant la période de transition. Malheureusement, cet espoir s’est effondré très rapidement parce que la ministre, peu ou mal comprise, n’avait pas eu le temps de faire aboutir toutes ses reformes, car elle a été relevée de ses fonctions au bout de six mois. Il semble que certains cadres de l’enseignement supérieur ont contesté sa nomination à cause, entre autres, de son statut de femme. Cela signifie que ce sont toujours les hommes qui veulent être à la tête des institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans ce pays, comme dans les organes décisionnels.
De toute évidence, la « gabarie » ou la « domination masculine » au sens de P. Bourdieu (1998) soumet les enseignantes-chercheures ou chercheures au travail peu valorisé qui ne leur permet pas d’imposer des décisions aux hommes. Il en résulte que celles-ci font l’objet de nombreuses inégalités dans l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles sont sous-représentées dans les tâches administratives qui se rapprochent de la position du commandement, puisqu’elles sont victimes des considérations discriminatoires négatives, entretenues par les hommes pour favoriser leur suprématie dans le monde scientifique. En fait, comme le souligne S. de Beauvoir (1949, p. 155) là où il se trouve des hommes et des femmes, « nous voyons que les hommes règnent et que les femmes sont régnées ». Cela, en dépit de la politique en matière d’égalité entre l’homme et la femme à travers de nombreuses conventions de droits de l’homme à l’échelle internationale.
2.3. Faible participation des enseignantes-chercheures qualifiées aux tâches universitaires
L’on pense généralement que les femmes ne sont pas en mesure de faire le travail universitaire, parce qu’elles ne sont pas douées comme les hommes ou n’ont pas les mêmes aptitudes intellectuelles que ces derniers. Les obstacles sont soit directs (nomination critiquée, faible participation aux compétitions scientifiques, etc.), soit liés à la division sexuelle du travail qui fait peser sur les femmes certaines tâches exogènes, entre autres ménagère, qui les poussent à privilégier le devoir conjugal (S. Lhenry, 2005). C’est dans cet ordre d’idées que A. Moukaddem et A.-F. Bender (2021) notifient que la responsabilité de la famille est à la charge de la femme. Celle-ci se trouve obligée de délaisser sa carrière pour un certain moment qui affecte sa trajectoire professionnelle au sein de l’université.
Il est à noter que les femmes semblent être celles qui font moins le travail de l’enseignant-chercheur à cause de leur situation conjugale, difficilement conciliable avec leur vie professionnelle. C’est pour cela qu’elles restent en retrait de l’ascension académique et à tous les niveaux de la formation universitaire. Du coup, elles sont sous-représentées et accusent un retard dans la promotion académique ou carriériste. Par exemple, sur 216 Maîtres-Assistants de l’Université de N’Djamena, il n’y a seulement que 5 femmes, sur 57 Maîtres de Conférences, on n’en compte qu’une seule (Maître de Conférences en 2022) et aucune femme parmi les 12 Professeurs Titulaires. Cela prouve effectivement que les femmes ne font pas, jusqu’aujourd’hui, parties des rangs des professeurs, parce que c’est un domaine qui demande des sacrifices constants pour parvenir à l’excellence[51], si l’on en croit Fassa et al. (2019). Les informations recueillies auprès d’un enseignant-chercheur renchérissent ces propos : « Nous pensons que c’est un travail difficile. Et les femmes ne travaillent pas assez comme les hommes. Pour certaines, nous pourrions dire qu’elles ne sont pas à la hauteur de leurs tâches universitaires »[52]. À travers ces affirmations, on verse les femmes dans la fainéantise, la médiocrité ou la paresse au regard de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; bien qu’il y ait quelques-unes qui s’investissent activement dans leur carrière pour la reconnaissance de leurs efforts.
Par ailleurs, on soutient que les femmes publient rarement des articles, et sont parfois absentes des débats scientifiques qui réunissent les chercheurs à l’échelle internationale et nationale. Et pourtant, pour accéder aux grades, il faut prouver sa capacité scientifique par des encadrements de travaux de recherche et des publications de documents qui sont scientifiquement avérés. Mais ce n’est pas le cas chez la plupart des enseignantes-chercheures de l’Université de N’Djamena, comme celles d’autres Universités du Tchad. Dans cette posture, elles sont jugées incompétentes. En revanche, certains responsables, moins sévères dans leurs jugements, estiment que ces dernières ne sont pas véritablement encouragées dans leurs tâches. Elles ne sont pas prioritaires dans les bourses ou les financements de recherche qui devraient les motiver à exceller comme les hommes. C’est ce que fait voir cet informateur qui exprime sa désolation : « Les femmes n’évoluent pas au même titre que les hommes. Les conditions de travail et le manque de discrimination positive en leur faveur, dans l’accès aux fonds de recherche, les empêchent d’évoluer dans leur projet de promotion au même titre que les hommes »[53]. Autrement dit, les femmes ont un accès limité aux fonds de recherche et de formation par rapport aux hommes[54]. Cela, malgré de nombreux efforts fournis par le gouvernement pour le respect des droits égaux dans le milieu professionnel. À cela, s’ajoute, comme nous l’avons évoqué, leur statut d’épouse ou de mère qui rend l’exercice de leur carrière difficile au milieu des hommes.
Tout porte donc à croire que le manque d’accès égal aux opportunités et responsabilités académiques est l’un des corollaires des disparités fondées sur le sexe, empreintes souvent de harcèlements de toutes sortes, dans l’espace universitaire. Ces obstacles relèguent les femmes au second rang en matière de promotion dans leur carrière.
2.4. Harcèlement et discrimination de l’enseignante-chercheure dans l’espace universitaire
D’après les données collectées et analysées, les femmes sont bel et bien harcelées et discriminées dans le monde universitaire. Elles subissent parfois des comportements violents et agressifs et, par voie de conséquence, ne travaillent pas aisément comme les hommes.
En effet, la faible considération des enseignantes-chercheures ou chercheures dans leurs tâches administratives et pédagogiques émaille la vie universitaire dans certaines villes africaines, où l’on pense, à la manière de B. Spinoza (1966) que la femme n’est pas l’égal de l’homme. Le harcèlement et la discrimination sont des formes d’injustice infligées régulièrement aux femmes dans leur vocation et ambition de faire carrière dans l’enseignement supérieur. Les expressions suivantes traduisent les difficultés qu’elles rencontrent : « Les femmes sont au quotidien harcelées, dénigrées, calomniées, rabaissées ; elles ne sont pas considérées à la hauteur de leurs tâches. Les rares qui accèdent aux postes de responsabilité de bas étage doivent se donner dix fois plus pour récolter des miettes de reconnaissances »[55].
En tout état de cause, il convient de comprendre que les femmes sont harcelées sexuellement, physiquement et moralement au sein des facultés, des services et des départements ; ce qui les amène quelquefois à quitter l’enseignement supérieur contre leur gré pour intégrer d’autres départements ministériels. Ce sont des faits indubitables, mais qui ne sont pas punis par la hiérarchie ; puisque la hiérarchie, elle-même, se prête parfois à ce jeu pervers, relèvent certaines enseignantes-chercheures. Elles déclarent avoir été harcelées, violentées et/ou insultées dans leurs tâches administratives et pédagogiques. Leurs propos sont assez clairs là-dessus lorsqu’elles soulignent que ce n’est pas facile de travailler avec les hommes sans recevoir des coups de différence ; puisque les hommes montrent qu’ils sont toujours différents et supérieurs aux femmes. Cela donne à voir que les femmes sont moins valorisées dans les services qu’elles rendent pour le développement des activités scientifiques. Dans ce cas de figure, que faut-il entreprendre pour rétablir l’équilibre entre les sexes en milieu universitaire ?
Notons que les inégalités de sexe nécessitent de nouvelles approches pour réduire les différences de traitement entre les hommes et les femmes à l’Université de N’Djamena, dans la perspective d’amener les deux sexes à coopérer et collaborer ; surtout qu’il n’est pas contre-nature d’accorder aux femmes les mêmes privilèges dans l’administration des institutions, voire de la cité.
2.5. Plaidoyer pour rétablir l’égalité entre hommes et femmes à l’Université de N’Djamena
Face à la disparité fondée sur le sexe, à l’Université de N’Djamena, la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’application de la politique du genre s’avère nécessaire pour garantir l’égalité entre hommes et femmes, ou mieux l’égalité des chances et de promotion à de hauts postes de responsabilité. Cela, dans la perspective de veiller au respect des droits de tous, particulièrement des femmes considérées comme des carriéristes incapables d’exercer les mêmes fonctions que les hommes.
Pour mieux appréhender la participation de tous, hommes et femmes, à toutes les tâches au sein de l’espace universitaire, il est judicieux de créer des conditions favorables de travail, susceptibles de rétablir l’égalité des sexes dans le travail et la promotion, en priorisant naturellement une compétitivité équitable. Cette politique peut permettre d’identifier les problèmes et besoins cruciaux afin de contribuer à l’épanouissement des universitaires, sans distinction de sexe, en prenant en compte les aspirations de promotion et de valorisation des femmes à toutes les instances de prises de décisions et d’accès à tous les postes de responsabilité.
Plus concrètement, les recommandations du terrain se conjuguent vers la mise en place d’un fonds de recherche pour motiver et encourager les femmes à progresser en grade comme les hommes ; ce qui veut dire qu’il faut booster les recherches des femmes pour qu’elles parviennent aux résultats innovants dans le monde scientifique. Cela doit passer par leur implication dans les activités académiques, une démarche qui peut constituer une source de motivation pour attirer un nombre important de femmes dans l’enseignement supérieur. Avec leur vision ou leur manière de diriger, elles veilleront à ce que l’égalité entre l’homme et la femme soit respectée dans ce domaine.
Aussi convient-il de souligner que l’absence d’un réseau professionnel entre les femmes de l’Université de N’Djamena ne leur permet pas de prévaloir leurs droits d’exercer les mêmes fonctions que les hommes. Les femmes n’occultent pas d’ailleurs le fait qu’elles n’aient pas d’association de solidarité entre elles au sein de l’université, rend difficiles leurs revendications. C’est ce qui apparaît dans les propos qui suivent : « Vous voyez que les femmes n’ont pas une association, donc c’est difficile pour elles de défendre leurs intérêts et de dénoncer les violences qui leur sont infligées ; un obstacle majeur pour les travailleuses de l’université »[56].
Pour tout dire, l’existence d’un mécanisme de suivi et d’application de la politique du genre ou d’une plateforme féminine dans les universités du Tchad en général, peut être un atout pour les enseignantes-chercheures qui s’évertuent à revendiquer leur place dans le but d’y jouer efficacement leur rôle. Aussi, à travers ce réseau féminin, celles-ci parviendront à dénoncer les harcèlements et les injustices dont elles font souvent l’objet dans les facultés, les services et les départements. Cela peut les aider à comprendre Platon (2002) qui souligne que les femmes et les hommes ont les mêmes aptitudes à participer à la gestion des affaires publiques et des biens communs. « La femme participe naturellement à toutes les occupations, l’homme de son côté participe à toutes également », affirme Platon (2002, 455e). Selon l’auteur, il n’y a pas d’occupations relatives à l’administration de la cité qui appartiennent à une femme parce qu’elle est une femme et à un homme parce qu’il est un homme. Cependant, il rappelle que, dans toutes ces activités, la femme est un être faible que l’homme.
Conclusion
Nous pouvons dire que le constat sur la considération et les conditions de travail des femmes dans l’enseignement supérieur tchadien est alarmant. À l’Université de N’Djamena, en particulier, les femmes sont quasiment absentes des postes clés de responsabilité, et leurs droits sont parfois peu reconnus malgré la sensibilisation constante sur l’égalité entre l’homme et la femme dans le monde professionnel. Elles ont non seulement un accès inégal aux instances de décision de l’Université et aux fonds alloués aux recherches, mais elles font également l’objet du harcèlement et de la discrimination à cause des inégalités de sexe dans leurs droits à la recherche.
Ces violences basées sur le genre (VBG) apparaissent régulièrement dans les rapports de pouvoir entre les acteurs de l’enseignement supérieur. Les harcèlements sexuels et moraux, par exemple, sont des scènes auxquelles les femmes sont sujettes au quotidien. C’est pourquoi la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’application de la politique du genre, ou d’une plateforme féminine, serait un atout pour permettre à ces dernières de mettre en valeur leurs investissements, notamment pédagogique, scientifique et administratif, et de dénoncer les cas de violence auxquels elles font face en milieu universitaire. Ainsi, grâce aux entretiens réalisés et animés avec les acteurs de l’Université de N’Djamena, nous avons opté pour une approche de féminisation et de partenariat dans l’optique de rétablir l’égalité entre hommes et femmes dans l’enseignement supérieur ; puisque que c’est la même aptitude naturelle à l’administration des affaires publiques qui existe chez la femme autant que chez l’homme, sauf que, comme l’affirme Platon avec application, dans le premier cas, cette aptitude est plus faible, et dans le second, plus fort.
Références bibliographiques
BENNINGHOFF Martin, GOASTELLEC Gaële et LERESCHE Jean-Philippe, 2009, Les inégalités dans l’enseignement supérieur et la recherche, 2ème Conférence internationale du RESUP, Université deLausanne.
BEAUVOIR Simone De, 1949, Le Deuxième sexe : l’expérience vécue, Paris, Gallimard.
BOURDIEU Pierre, 1998, Domination masculine, Paris, Seuil.
ÉTIENNE Gérard, 2011, « L’égalité des sexes par le savoir ? Une approche par les trajectoires universitaires d’hommes et de femmes de l’élite scientifique mexicaine », in Autrepart (59), pp. 75-90.
FASSA Farinaz, BENNINGHOFF Martin et KRADOLFER Sabine, 2019, « Universités : les politiques d’égalité entre femmes et hommes à l’heure de l’excellence », in Dossiers Sociologies.
LHENRY Sophie, 2005, Les enseignantes-chercheures à l’université et la norme masculine de réussite, Paris, Diderot.
LOUVEL Séverine et VALETTE Annick, 2014, « Les carrières à l’université. Une approche par les modes d’engagement dans la promotion », in Revue d’anthropologie des connaissances, Vol. 8, n° 3, pp. 523-54.
Ministère de l’éducation nationale, 2000, « Les enseignants-chercheurs à l’université. La place des femmes », (En ligne), consulté le 20 juillet 2022, https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/014000283.pdf.
MOUKADDEM Abir, BENDER Anne-Françoise, 2021, « Carrière des femmes universitaires au Liban : vers une gestion plus inclusive ? », (En ligne),
in https://agrh2020.sciencesconf.org/data/pages/MOUKADDEM.pdf, consulté le 4 juin 2022.
ONU, 2015, « Progression lente des femmes en politique, un obstacle au développement », (En ligne), in
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2015/3/press-release-sluggish-progress-on-women-in-politics-will-hamper-development, consulté le 09 juin 2022.
PLATON, 2002, La République, Livre V, trad. Georges Leroux, Paris, Flammarion.
Rapport de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes en Chine, 1996, Beijing, 4-15 septembre 1995, Nations Unies, New York, (En ligne), in
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20F.pdf, consulté le 10 juin 2022.
RICAHRD Madelaine, 1977, Traditions et coutumes matrimoniales chez les Mada et les Mouyeng, Anthropos Institut, Haus Volker und Kulturen.
SABATIER Mareva, MUSSELIN Christine et PIGEYRE Frédérique, 2015, « Devenir professeur des Universités », in Revue économique, 66 (1), pp. 37-63.
SPINOZA Baruch, 1966, Traité politique, Lettres, trad. Charles Appuhn, Paris, Flammarion.
GENRE ET HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU UNIVERSITAIRE : LE CAS DES ÉTUDIANTES DES UNIVERSITÉS DE CÔTE D’IVOIRE
Lou Gobou Bien-aimée GOHI
Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La question du harcèlement sexuel en milieu universitaire, ces dernières années, fait débat à cause de son ampleur et ses conséquences sur les résultats des étudiantes qui en sont victimes. Dans le cadre de l’enseignement supérieur, les victimes sont en général les étudiantes qui subissent diverses pressions de la part de certains enseignants. Aussi est-il que cette situation influe tout à la fois sur les résultats ou rendements des étudiantes, que sur le fonctionnement de la structure universitaire. Il se pose ainsi, de toute nécessité, la question suivante : Que faire pour surmonter cette situation déplorable ? En d’autres termes, quelles stratégies engager pour offrir plus de chances aux étudiantes ? Cette communication a pour objectif d’analyser les relations enseignants/étudiantes à l’Université, de décrire le phénomène du harcèlement des étudiantes par les enseignants et de faire des recommandations pour limiter cette pratique dans les Universités de Côte d’Ivoire.
Mots clés : Côte d’Ivoire, Étudiante, Genre, Harcèlement, Université.
Abstract:
The question of sexual harassment in the university environment, in recent years, has been debated because of its extent and its consequences on the results of the students who are victims of it. In the context of higher education, the victims are generally female students who are subject to various pressures from certain teachers. Also, is it that this situation influences both the results or yields of the students, and the functioning of the university structure. The following question therefore arises, of all necessity: What can be done to overcome this deplorable situation? In other words, what strategies should be adopted to offer more opportunities to female students? This communication aims to analyze teacher/student relations at the University, to describe the phenomenon of teacher harassment of female students and to make recommendations to limit this practice in the Universities of Ivory Coast.
Keywords : Côte d’Ivoire, Student, Gender, Harassment, University.
Introduction
Les inégalités du genre constituent un problème majeur pour la majorité de nos pays Africains. Les violences basées sur le genre subies par les femmes sont considérées comme une conséquence des inégalités structurelles et comme un instrument permettant de les maintenir (Hammel 2011). Elles englobent le Harcèlement sexuel qui est le fait d’abuser de l’autorité que confère une fonction pour tenter d’obtenir une faveur sexuelle de quelqu’un (e) par contrainte. Le harcèlement sexuel en milieu universitaire est le fait d’user de façon répétée, d’ordres, de menaces, de contraintes, de paroles, de gestes, d’écrits, d’appels ou messages téléphoniques ou tout autre moyen dans le but d’obtenir d’un (e) apprenant (e) ou d’un (e) éducateur (trice), contre son gré, des relations de nature sexuelle pouvant porter atteinte à sa dignité. Le harcèlement sexuel peut prendre plusieurs formes. Nous avons d’abord la forme verbale qui se caractérise par des surnoms sexuels, des commentaires sur la taille et la forme de la personne harcelée ainsi que des demandes incessantes de la part de l’harceleur. Nous avons ensuite la forme auditive qui comprend les bruits et sifflements venant de la personne qui harcèle et enfin nous avons la forme physique et visuelle qui est le fait de mimer l’acte sexuel avec les mains ou avec la bouche, de s’agripper à la personne harcelée, de pincer ses parties sensibles et intimes et lui envoyer des entremetteurs ou des messages écrits, téléphoniques, de proférer des menaces, des promesses d’argent ou de services à rendre sans que l’autre ne les sollicite, etc. L’approche de genre aide à comprendre le phénomène du harcèlement sexuel. Cette approche qui peut se définir comme l’acquisition d’un droit à la reconnaissance sociale peut être considérée comme un processus vers l’égalité entre les hommes et les femmes et comme le renforcement du pouvoir de la femme. La prédominance des hommes dans le corps enseignant renforce le pouvoir masculin et le recours au harcèlement sexuel des enseignants en vue de contraindre les étudiantes. Le harcèlement sexuel est favorisé par le type de relations entre l’homme et la femme. L’adoption de l’approche de la sociologie interactionniste a permis aussi de comprendre le harcèlement sexuel. Selon Guy Rocher (1969): « une action sociale est une réalité totale, globale qui engage et influence la personnalité individuelle et qui forme en même temps un tissu social ». Brookfield (2004 : p 240), lui soutient que le pouvoir est présent dans les plus petites interactions humaines, Pour Bourdieu (1990), c’est une construction de relations dissymétriques entre individus et groupes comme domination des hommes sur les femmes. Pour revenir à notre sujet d’étude, le harcèlement sexuel dans les milieux universitaires se manifeste par des regards, des insinuations, des propos malsains, des propositions de rencontre, des familiarités indésirables, de plaisanteries déshonorantes, des blagues, voire des agressions sexuelles. Cet état de choses est souvent favorisé par la sphère géographique qui crée des contacts, qui a leur tour favorise des sentiments qui finissent par perturber la vie intime des étudiantes. Notre problématique s’articule autour des trois questions suivantes :
1) Comment se caractérise le harcèlement sexuel et quelle est son ampleur à l’Université ?
2) Quels sont les facteurs qui sont à la base du harcèlement sexuel ?
3) Quelles dispositions faut-il prendre pour y remédier ?
Cette étude s’inscrit dans une perspective de recherche-action entre les milieux communautaires et universitaires ; ses visées ultimes permettront d’approfondir la compréhension du phénomène des violences sexuelles en milieu universitaire, et de formuler des recommandations pour la mise en place d’interventions auprès de l’ensemble de la communauté universitaire. À la lumière des résultats, il s’agira de proposer des recommandations mobilisant les instances gouvernementales, institutionnelles et communautaires afin d’interpeller toute la communauté universitaire. Ces recommandations visent la communication en matière de prévention de la violence sexuelle en milieu universitaire en Côte d’Ivoire.
1. Matériels et méthodes
La Côte d’Ivoire dispose de plusieurs universités publiques, mais pour le besoin de notre étude, l’enquête s’est déroulée dans quatre universités publiques qui sont : l’Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan), Nangui Abrogoua à Abidjan, Alassane Ouattara (Bouaké) et l’Université Jean-Lorougnon-Guédé (Daloa). Étant donné que la présente étude n’est pas exhaustive, nous avons travaillé sur un échantillon de 400 personnes. Notre cible concerne 400 étudiantes. Nous avons fait de la recherche documentaire et notre enquête s’est faite à travers des entretiens et des questionnaires auprès de notre cible pendant deux mois (début juin 2021 à fin août 2021). Nous avons mené des investigations sur le terrain dans la ville d’Abidjan. Pour les villes de l’intérieur citées, nous avons compte tenu de la distance, utilisé les réseaux sociaux et internet pour envoyer les questionnaires par mail. Les étudiantes ont été sollicitées par un message électronique les invitant à remplir le questionnaire et nous avons reçu les réponses par ce même canal. Notre démarche a été tant quantitative que qualitative et pour le traitement des données, nous avons fait des statistiques grâce au logiciel Excel pour rendre les résultats de notre travail.
2. Résultats
Figure 1
| Victime ou Témoin d’harcèlement | Ni Victime ni Témoin d’harcèlement | |
| Total | 400 | 0 |
| % | 100 | 0 |
Source : notre enquête 2021
Les résultats donnent 100% de oui au niveau des 400 personnes. Elles avouent avoir été victime ou témoin de harcèlement dans leur établissement Universitaire.
Figure 2
| Harcèlement verbal | Harcèlement moral ou psychologique | Harcèlement sexuel | Cyber harcèlement | Harcèlement physique | Dégradation de bien | Harcèlement de groupe | |
| Total | 20 | 115 | 210 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| % | 5 | 28,75 | 52,5 | 1,25 | 12,5 | 0 | 0 |
Source : notre enquête 2021
Au niveau du type de harcèlement, nous remarquons un pourcentage élevé au niveau du harcèlement sexuel avec un taux de 52,5%, le harcèlement moral ou psychologique avec 28,75%. Le harcèlement verbal se fait moins sentir en milieu universitaire avec un pourcentage de 5% ainsi que le cyberharcèlement qui ne représente que 1,25%.
| Auteur de cet harcèlement | |||
| Un professeur | Un membre du personnel universitaire | Un étudiant | |
| Total | 350 | 35 | 15 |
| % | 87,5 | 8,75 | 3,75 |
Au niveau de l’auteur du harcèlement en milieu universitaire, selon les enquêtes, nous avons un pourcentage élevé de 87,5% provenant du corps enseignant, 8,75% en ce qui concerne les membres du personnel universitaire et 3,75% pour les étudiants.
Figure 3
Source : notre enquête 2021
Figure 4
| Lieu du déroulé du harcèlement | |||
| Établissement (salles de cours, resto u) | Résidences universitaire | Autres espaces universitaires | D’une sortie universitaire |
| 260 | 100 | 25 | 15 |
| 65 | 25 | 6,25 | 3,75 |
Source : notre enquête 2021
Au niveau de la demande d’aide des victimes, nous remarquons que 50% des étudiantes ne dénoncent pas le harcèlement dont elles sont victimes, car elles ne demandent pratiquement pas d’aide. 35% en parlent à leurs amis étudiants. 7,25 % en parlent à des membres de leur famille. 5% parfois à un enseignant de l’université et seulement 2,5% portent plainte.
Figure 5
| Oui, une fois | Oui, plusieurs fois | Non, jamais | Non, je ne souhaite pas répondre | |
| Total | 50 | 320 | 0 | 30 |
| % | 12,5 | 80 | 7,5 |
Source : notre enquête 2021
Au niveau des fréquences, 80% des étudiantes avouent qu’elles ont été harcelées à plusieurs reprises. 12,5 répondent qu’elles en ont été victimes au moins une fois et 7,5% n’ont pas répondu à la question.
Figure 6
| Oui, à unenseignant | Oui à un étudiant | Oui, à un membre de ma famille | Oui, à un professionnel de la santé | Oui, en portant plainte | Non, mais j’en avais besoin | Non j’en avais pas besoin | |
| Total | 20 | 140 | 30 | 10 | 200 | 0 | |
| % | 5 | 35 | 7,5 | 0 | 2,5 | 50 | 0 |
Source : Notre enquête 2021
Au niveau de la demande d’aide des victimes, nous remarquons que 50% des étudiantes ne dénoncent pas le harcèlement dont elles sont victimes car elles ne demandent pratiquement pas d’aide.35% en parlent à leurs amis étudiants, 7,25% en parlent à des membres de leur famille ,5% parfois à un enseignant de l’université et seulement 2,5% portent plainte.
3. Analyse des résultats et discussion
Les formes de harcèlement dans l’enseignement supérieur sont diverses. On peut citer les remarques sexistes ou discriminantes durant un examen avec un jury ou durant une entrevue dans le bureau d’un membre du personnel ; les situations de pouvoir sur les étudiants, par exemple, pendant l’encadrement d’un stage, d’un mémoire ou d’un doctorat ; les discriminations entre étudiants ; ou encore les abus liés à l’apparence et au physique, lorsque l’on commence à s’interroger sur le sujet, ce ne sont pas les témoignages qui manquent. Ces comportements peuvent viser le genre de la victime, son origine, son statut social, son orientation sexuelle, son apparence physique, sa religion, etc. Les déclarations de violences paraissent relativement élevées dans les Universités en Côte d’Ivoire, car environ un tiers des femmes ont déclaré avoir subi une violence sexuelle.
Deux grands types de violences sont dénoncés : les violences psychologiques d’une part et les violences à caractère sexuel d’autre part, qu’elles soient sans contact, sans pénétration ou avec pénétration. Qu’elles soient psychologiques ou sexuelles, les violences ont des effets néfastes sur les parcours universitaires. Certaines étudiantes que nous avons pu enquêter, ont notamment changé de filière ou d’établissement. Les étudiantes touchées par les violences en parlent peu à leurs amis ou proches. Elles refusent d’engager des procédures au sein des établissements quand bien même les faits déclarés sont jugés graves. Les faits le plus souvent, déclarés par les étudiantes touchent à la sexualité. Le fait le plus fréquemment relevé porte sur les propos et attitudes à caractère sexuel, déclarés par 52,5% des étudiantes selon les universités (Tableau 2). Puis viennent les moqueries et les insultes. Les propositions sexuelles insistantes malgré le refus sont fréquemment déclarées dans certaines universités et touchent 5 % des étudiantes. Toutefois, si ces formes de violences sont les plus fréquentes pour les étudiantes, elles le sont dans des proportions nettement moindres : les propos et attitudes à caractère sexuel sont déclarés par la plupart des étudiantes ainsi que le fait de faire l’objet de propositions sexuelles insistantes. Les violences psychologiques incluent les insultes, les moqueries, les intimidations ainsi que les atteintes au travail.
Pour une meilleure compréhension du phénomène des violences sexuelles, une typologie de violences prenant en compte l’ensemble des faits subis, leur fréquence et leur gravité doit être créée en recourant à une classification ascendante hiérarchique. Pour autant, le caractère particulier de certaines situations de violence, notamment celles d’étudiantes, peu nombreuses, ayant déclaré des violences très graves de types différents, ne permet pas de créer des groupes homogènes de taille suffisante… Ces personnes, en ayant déclaré un nombre important de faits de nature différente et des fréquences élevées se distinguent fortement des autres étudiantes au point de composer une classe propre. D’une manière générale, les classes dégagées sont proches d’une Université à l’autre et du volet Virage réalisé en population générale. Cette classification permet de distinguer trois situations de violences sexuelles (violences sexuelles sans contact, violences sexuelles avec contact sans pénétration, violences sexuelles avec pénétration) et trois situations différenciées de violences psychologiques et physiques (violences psychologiques déclarées pas ou peu graves par les étudiantes, violences physiques pas ou peu graves et enfin, violences physiques et/ou psychologiques très graves).
Les situations de violences ainsi déterminées présentent une forme de gradient, conforme à la notion de continuum des violences. Les étudiantes de la catégorie « violences psychologiques pas ou peu graves » n’ont pas déclaré de faits d’une autre nature (physique ou sexuelle). Par contre, des étudiantes ayant déclaré des violences psychologiques se retrouvent dans d’autres catégories, si elles ont déclaré également d’autres types de faits. Les étudiantes de la catégorie « violences sexuelles avec contact sans pénétration » ont déclaré des formes de violences psychologiques ou de violences sexuelles sans contact. De même, les étudiantes qui déclarent des violences sexuelles avec pénétration rapportent aussi des violences psychologiques et des formes d’agressions sexuelles sans ou avec contact. On remarque au sein des universités que les lieux des violences sont variés. L’enquête identifiait à la fois des lieux internes aux universités (salle de cours, bureaux, etc.) et des lieux publics extérieurs à l’université (espaces collectifs, terrains sportifs, etc.).
La difficulté du harcèlement en milieu universitaire, c’est qu’il peut se développer dans des lieux et des contextes très divers et parfois difficiles à contrôler : au moment d’un cours dans une classe ou un amphithéâtre, sur le forum en ligne de l’établissement, lors d’une fête estudiantine sur le campus, lors d’un rendez-vous entre un professeur et une étudiante, etc. À cela s’ajoutent le manque actuel de suivi des signalements et parfois l’inexistence de mesures pour y faire face. Le manque de données statistiques dont nous disposons en Côte d’Ivoire contribue à invisibiliser le problème. Pourtant, il semble qu’une grande majorité de personnes ayant fréquenté l’enseignement supérieur a au moins une fois été témoin, voire victime, d’une de ces catégories de harcèlement.
4. Recommandations en cas de harcèlement sexuel en milieu universitaire
Il est urgent de réformer le fonctionnement des sections disciplinaires pour que le harcèlement sexuel et d’autres formes de discriminations, quel qu’en soit le motif, fassent l’objet d’un traitement efficace dans l’enseignement supérieur et dans le milieu universitaire. Aujourd’hui, aucune de ces formes de violence sociale, génératrice d’inégalités, n’est correctement traitée. Pour ce faire, nous recommandons de :
– Créer une section disciplinaire en cas de harcèlement sexuel en milieu universitaire.
– Assurer l’information et la prévention en milieu universitaire en condamnant le harcèlement sexuel, et les autres formes de violences et de discriminations.
– Convoquer automatiquement la section disciplinaire en cas de harcèlement sexuel. Cette section disciplinaire doit pouvoir être directement saisie par les victimes et elle doit pouvoir décider des mesures conservatoires d’urgence, si nécessaire.
– Créer un comité indépendant chargé de l’instruction des plaintes. Ses membres ne doivent pas faire partie de la section disciplinaire. Ce comité doit comprendre des personnalités extérieures.
– Garantir l’indépendance de la section disciplinaire et la rendre paritaire quel que soit le statut de la personne jugée. Ses membres doivent être des personnes extérieures à l’établissement où les faits se sont produits pour éviter le favoritisme.
– Donner le droit aux plaignantes de faire appel des décisions auprès d’une cour de seconde instance, en cas de désaccord sur la décision.
– Créer un observatoire des discriminations et des violences sexuelles dans l’enseignement supérieur pour évaluer et faire un suivi du phénomène. Cet observatoire pourrait mesurer également les autres formes de discrimination.
Conclusion
En définitive, l’on peut affirmer que le milieu Universitaire n’est pas épargné par le harcèlement. Nous dégageons plusieurs pistes de solutions qui devront être mise en place pour prévenir et lutter contre le harcèlement des étudiantes. Il s’agit de :
– Faciliter le dépôt des signalements dans chaque établissement Universitaire et dans d’autres structures.
– Imposer à chaque établissement Universitaire de créer, quand ce n’est pas déjà fait, un dispositif de référence ;
– Offrir une voie de recours externe pour que les étudiantes victimes soient accueillies, conseillées et accompagnées ;
-Informer et sensibiliser les établissements Universitaires, le personnel et les étudiantes sur le sujet du harcèlement, afin d’identifier les comportements problématiques et réagir de manière efficace.
– Agir pour informer les victimes, sensibiliser les témoins et dissuader les auteurs.
– Adopter un cadre légal spécifique pour mieux protéger les étudiantes.
– Répertorier les initiatives existantes permettant de lutter contre le phénomène du harcèlement,
– Dresser la liste des profils des principales victimes et les circonstances qui favorisent les abus pour aboutir à des solutions probantes.
Il est urgent de réagir, tant pour le bien-être de nos étudiantes que pour la qualité de notre enseignement. Il est donc fondamental, malgré le caractère complexe du harcèlement de mettre tout en œuvre pour l’éradiquer dans le milieu universitaire.
Références bibliographiques
BOUDON Raymond, 1979, La logique du social. Introduction à l’analyse sociologique, Paris, EditionHachette.
FERRÉOL Gilles, 1995, Dictionnaire de sociologie, Paris, Armand Colin.
BOUCHARD Pierrette, 2007, Consentantes? Hyper sexualisation et violences sexuelles, RimouskiQuebec, Edition CALACS de Rimouski.
BOURDIEU Pierre, 1998, La Domination masculine, Paris, Edition Seuil
BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude, 1970, La reproduction. Éléments pour une théorie du Système d’enseignements, Paris, Éditions de Minuit
GUIDERE Mathieu, 2014, Méthodologie de recherche, France, Edition-Ellipses.
HAMEL Christelle, 2011, Violences et rapports de genre : Contextes et Conséquences des violences subies par les femmes et les hommes, Descriptif du projet d’enquête, Paris, INED, Enquête VIRAGE.
LOUIS Marie-Victoire, 1860-1930, 1994, Le Droit de cuissage, Paris, Éditions de l’Atelier.
PNUD, 2002, « Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté », in Rapport mondial sur le développement humain.
ROCHER Guy, 1969, Introduction à la sociologie générale, Tome I : L’action sociale, Paris, Le Point.
SIRONI Françoise, 1999, Bourreaux et victimes. Psychologie de la torture, Paris, éditions Odile Jacob.
TROISIÈME AXE : FORMATION ET EMPLOYABILITÉ DES ÉTUDIANTS
LA DIALECTIQUE DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI : L’UNIVERSITÉ À L’ÉPREUVE DU DEVENIR
Akpolê Koffi Daniel YAO
Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d’Ivoire)
yaoakdaniel@yahoo.fr / yaoakdaniel@upgc.edu.ci
Résumé :
La crise de l’emploi désigne une des pathologies de la société qui met en cause la formation lorsque nous considérons son déphasage avec les exigences des emplois modernes. La compréhension de cette crise, préalable à toute entreprise de résolution, autorise l’entrée dans le système de l’emploi qui se déploie selon la dynamique de la dialectique, au sens de Hegel, et dont les moments sont l’employabilité, la formation et l’emploi. L’attention portée à la formation adossée à l’université est ce qui met au centre des débats cette institution appelée à être soumise à un repositionnement structurel et fondamental en s’inscrivant dans la dynamique du devenir qui constitue l’essence de la société comprise comme système des besoins. En réalité, c’est une université tournée vers la prospective et l’esprit d’entreprise qui constitue l’effectivité d’une dynamique du devenir adéquatement assumée.
Mots clés : Devenir, Dialectique, Emploi, Formation, Société.
Abstract:
The employment crisis designates one of the pathologies of society that calls the question of training when we consider its out of step with the demands of modern jobs. The understanding of this crisis, prior to any resolution enterprise, authorizes entry into the employment system which unfolds according to the dynamics of the dialectic, in the sense of Hegel, and whose moments are employability, training and employment. The attention paid to training backed by the university is what puts this institution at the center of the debate, which is called upon to undergo a structural and fundamental repositioning by becoming part of the dynamics of becoming which constitutes the essence of society understood as a system of needs, itself synonymous with employability. In reality, it is a university turned towards foresight and the spirit of enterprise which constitutes the effectiveness of a dynamic of becoming adequately assumed.
Keywords : Becoming, Dialectic, Employment, Society, Training.
Introduction
Hegel a défini l’homme dans la société comme « une totalité de besoin et un mélange de nécessité naturelle » (Hegel, 2013, p. 349). Cette approche réapparait chez Marx, certainement influencé par Hegel, avec l’idée selon laquelle la réalisation sociale de l’individu est intimement liée aux conditions matérielles de son existence. De cette façon, l’impossibilité même de cette satisfaction est la manifestation de l’état de minorité eu égard aux conditions matérielles : c’est la pauvreté. Et il y a dans les sociétés modernes, comme cause principale de la pauvreté, la difficile insertion professionnelle des individus qui conduit à une crise de l’emploi. Dès lors, comment ne pas prêter attention à la crise de l’emploi ? Cette attention est renforcée par la capacité qu’elle a à plonger le corps social dans un déchirement dont les conséquences sont à saisir en plusieurs points. En effet, ailleurs, la crise de l’emploi a favorisé le développement d’activités jugées, selon la conscience des peuples, immorales ; mais aussi, comme le pense Jakkie Cilliers (2004, p. 81-100), la constitution ou le renforcement de fractions terroristes. Ces orientations peuvent s’expliquer par le fait que dans les conditions précaires d’existence, l’homme défait des considérations morales semble être contraint d’emprunter les chemins qui s’offrent à lui.
L’exigence qu’il y a à sortir de cette situation donne à la question en direction de la crise de l’emploi tout son sens ici et maintenant. Ainsi, la question assez concrète, simple en son énonciation, mais non moins fondamentale, s’offre de la manière suivante : comment venir à bout de cette crise ? Mais cette question ne peut être envisageable que si la crise elle-même est adéquatement comprise. Sa compréhension exige qu’elle soit saisie dans le système de sa manifestation qui appelle nécessairement la formation ; car il ne peut avoir d’emploi sans formation. Dans la mesure où l’un s’incline pour laisser surgir l’autre, il existerait donc une relation entre emploi et formation qui doit être appréhendée à partir d’une approche conceptuelle ; c’est là le premier moment de cette réflexion. Sur cette base, le deuxième moment consistera à se saisir du normativisme de cette relation, en ce qui la caractérise fondamentalement, pour avoir une lecture plus adéquate de cette crise de l’emploi afin de proposer, dans un ultime moment, des réponses concrètes gravitant autour du fonctionnement de l’université sensée assumer la formation en vue de l’emploi.
1. L’endroit de la relation formation-emploi : enjeu d’une analyse conceptuelle
L’exigence qu’il y a à établir la relation vraie entre la formation et l’emploi participe, d’abord, de la constitution de l’idéal type de leur manifestation ; elle permet ensuite de décrypter la condition crisique de cette relation pour penser un rétablissement. Dans les faits, montrer l’insuffisance d’une certaine disposition, c’est avant tout, comme dans un préalable, avoir en idée la disposition qui peut constituer la base normative à partir de laquelle tout jugement peut être opéré. En effet, l’envers est en réalité « envers » d’un « endroit » su comme tel. En s’offrant dans une telle analyse, la relation qui peut exister entre la formation et l’emploi, avant de se prêter à tout jugement qualitatif, suggère une mise en avant de ce qu’elle est fondamentalement. Fondamentalement, il faut entrer dans la vie même des concepts de « formation » et d’« emploi ». Les élever au rang de concept revient à signifier qu’ils sont des expressions pensées de réalités vivantes et dynamiques.
L’appréhension des concepts de « formation » et d’« emploi » dans une simple perspective historique laisse immédiatement apparaître une antériorité de la formation et désigne ce par quoi il faut commencer. Former, comme le mot l’indique, c’est prendre forme ou donner une forme. Dans l’univers social en général, et relativement aux individus, la formation consiste dans la constitution d’un profil en vue d’une finalité. En cela, formation et éducation semble aller de pair. Si la formation fait référence à des individus dans un système universitaire, l’éducation, elle, fait plutôt appel à la condition de l’individu enfant. Mais, éduquer, du latin educare, c’est conduire ou guider vers une certaine destination qui n’est pas à retrouver dans l’espace mais dans la constitution d’un type d’homme. Formation et éducation constituent donc, au fond ou à des moments différents, des étapes d’un même processus qui doit être lu à partir du moment initial qu’est l’éducation elle-même.
L’éducation trouve tout son sens dans le mouvement qui consiste à intégrer les individus dans l’architecture sociale en les initiant aux modes, idéaux et pratiques. Et les choses ne peuvent être autrement quand on sait, comme l’affirme Kant, que
l’homme est la seule créature qui soit susceptible d’éducation. Par éducation l’on entend les soins (le traitement, l’entretien) que réclame son enfance, la discipline qui le fait homme, enfin l’instruction avec la culture. Sous ce triple rapport, il est enfant, – élève – et écolier (Kant, 2004, p. 7).
Il y a dans cette pensée une référence au devenir de l’homme comme homme à travers sa discipline qui faire dire de l’éducation qu’elle est un en-vue-de. Les choses se précisent lorsque Kant insiste, parlant de l’homme,
[qu’] il ne lui sert de rien d’être ménagé pendant sa jeunesse par une tendresse maternelle exagérée, car plus tard il n’en rencontrera que plus d’obstacles de toutes parts, et il recevra partout des échecs lorsqu’il s’engagera dans les affaires du monde (Kant, 2004, p. 13).
L’évocation « des échecs lorsqu’il s’engagera dans les affaires du monde » montre que la destination de l’homme est de se préoccuper des affaires du monde ; et c’est en vue de cette finalité qu’il est éduqué. Hegel s’inscrira dans cette perspective en percevant, devant le sérieux de la vie adulte contre l’éducation ludique, « la nécessité d’être éduqué (…) chez les enfants comme le sentiment propre consistant à être insatisfaits d’être au-dedans de soi tels qu’ils sont » (Hegel, 2013, p. 339). Ainsi, le sérieux que constitue les affaires du monde constitue le ce-en-vue-de-quoi de l’éducation, donc de la formation. Par ailleurs, le sens de la formation se trouve clarifié et la réalité à laquelle elle fait référence se trouve manifeste dans les milieux de type universitaire. Par-là, le sens de la formation universitaire s’accomplit dans le but de la formation qui est la consécration aux affaires du monde. Mais que signifie s’occuper des affaires du monde, n’est-ce pas là le sens de l’emploi ?
L’appréhension du concept d’« emploi » ne va pas, dans un souci de précision, sans celui de « travail » pour lequel Marx offre la considération qui suit :
Le travail est d’abord un procès qui se passe entre l’homme et la nature, un procès dans lequel l’homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action. Il se présente face à la matière naturelle comme une puissance naturelle. Il met en mouvement les forces naturelles de sa personne physique. Ses bras et ses jambes, sa tête et ses mains pour s’approprier la matière naturelle sous une forme utile à sa propre vie » (Marx, 1993, p. 199).
Il en ressort clairement que le travail, au sens strict, fait allusion à toutes activités humaines visant à produire des biens matériels ou des prestations de service utiles à l’existence humaine en général. La question de la rémunération n’apparait pas dans ce contexte. Et c’est ce qui marque la différence entre le travail et l’emploi. Relativement à cela, l’emploi doit être perçu comme l’exercice du travail qui est rémunéré par un salaire ou des émoluments. À cela, il faut nécessairement ajouter la question de la qualité ou de la décence de l’emploi dans une endurance quasi radicale ; car il n’y a, en effet, d’emploi que d’emploi décent. Cette affirmation semble aller à l’encontre de la définition classique de l’emploi qui intègre la rémunération sans condition. Mais, l’emploi qui ne peut se perpétuer par la pratique du travailleur, certainement parce qu’il ne peut, en s’y consacrant se maintenir socialement, ne saurait, au sens propre, être un emploi. Sur la qualité de l’emploi, l’Organisation Internationale du Travail apporte cette clarification :
La qualité de l’emploi est un concept multidimensionnel et l’une des dimensions les plus importantes d’un travail décent. La qualité générale ou globale d’un emploi est la somme des multiples aspects affectant la relation professionnelle et le travail lui-même. La nature dimensionnelle de la qualité de l’emploi rend pratiquement impossible l’élaboration d’un seul indicateur ou d’un système d’indicateurs. Dans cette section, nous présentons la qualité de l’emploi comme étant les aspects des relations de travail pouvant avoir un impact sur le bien-être des travailleurs : tous ces aspects sont liés au contrat de travail, à la rémunération aux heures de travail, à la protection sociale et au dialogue social (Organisation Internationale du Travail, 2019, p. 10).
À partir de ces considérations qui rappellent les critiques marxiennes du capitalisme, on peut se départir de l’appellation d’emploi décent pour celle d’emploi, et considérer les emplois en deçà de ces exigences comme des sous-emplois ou des pseudo-emplois. On retrouve, dans l’approche hégélienne du travail ce lien qu’il entretient avec la satisfaction sociale en général et qui donne du sens à l’élan, ici, privilégié. Le philosophe écrit à cet effet : « la société civile contient [parmi ces trois moments, d’abord,] la médiation du besoin et la satisfaction de l’individu-singulier par son travail et par le travail et la satisfaction des besoins de tous les autres » (Hegel, 2013, p. 356). L’ouverture du travail et par ricochet de l’emploi, dans sa pratique, sur les besoins des autres le place dans le système social comme la réponse à la satisfaction, certes des besoins du travailleur en particulier, mais des besoins du corps social en général.
La société en général, comprise comme système des besoins, a son équilibre dans la capacité qu’a ses acteurs à s’auto-suffire. En ce sens, les affaires générales des sociétés ou des communautés consistent dans le maintien d’un tel état d’autosuffisance. Or, c’est bien là que la question de la formation a trouvé, en tant que cela constitue son but, son sens vrai. En effet, la formation est en vue des affaires de la société. Et l’emploi consiste dans l’activité même assumant les affaires de la société. Formation et emploi se tiennent donc ; et la formation en vue des affaires du monde devient la formation en vue d’un emploi. Cette relation opère un renversement qui est manifeste en ceci : si immédiatement, selon un ordre historique, considérant les déterminations d’un individu, la formation précède l’emploi, il ne peut avoir de formation en-vue-de que si le ce-qui-est-visé est préalablement établi. Ainsi, l’emploi précède la formation. Mais, il y a là un paradoxe, car, non encore assumé, il n’est qu’un possible emploi, d’où l’employabilité. Le système qui s’établit semble coïncider avec le schéma dont les figures, s’effaçant progressivement, les unes après les autres, sont : employabilité, formation et emploi. Ce schéma qui ressemble à la dialectique de Hegel appelle le traitement des choses, notamment de la crise liée à l’emploi, sur ce terrain.
2. La crise de l’emploi ou crise de sa dynamique dialectique
La ressemblance entre le schéma de la manifestation de l’emploi avec celui de la détermination dialectique, au sens qui est celui de Hegel, a été vite faite quand on se contente d’apprécier le mouvement ternaire qui se profile ici ; c’est-à-dire sous la forme « employabilité », « formation » et « emploi ». Mais, la ressemblance n’est pas l’identification, et la lecture de la condition de l’emploi sur le terrain dialectique ne peut être possible que par identification et non par ressemblance. Ainsi, seule l’exposition du sens et des déterminations dialectiques peuvent, par analyses, faire émerger la considération vraie. Il s’agit en fait de montrer que la dialectique est à l’œuvre dans cette sphère. Passons outre l’approche de la Science de la logique (Hegel, 1994, p. 189) qui est sans conteste éloquente à ce sujet pour privilégier un exemple de récupération ou d’application. Le chemin à suivre est indirectement suggéré par Catherine Malabou. Dans L’avenir de Hegel, plasticité, temporalité, dialectique, la philosophe a fondé son entreprise sur une approche plastique de la dialectique. Elle a, dans ce sens, préciser comme préalable le principe de la dialectique comme suit :
Le mouvement de l’auto-détermination est en effet le principe du processus dialectique. Son énergie naît de la tension contradictoire entre le maintien de la déterminité particulière et sa dissolution dans l’universel. Dans la Science de la logique, Hegel montre que cette tension est celle par laquelle un « terme premier », « considéré en soi et pour soi’’ et qui a l’apparence du « subsister autonome », se montre comme « l’autre de soi-même » en dissolvant la fixité de sa position (C. Malabou, 1996, p. 26).
Elle pose à partir de là la plasticité de la dialectique quand elle écrit :
Le procès dialectique est plastique dans la mesure où il articule en son cours l’immobilité pleine (la fixité), la vacuité (la dissolution) et la vitalité du tout comme réconciliation de ces deux extrêmes, conjugaison de la résistance et de ta fluidité. Le procès de la plasticité est dialectique en ce que les opérations qui le constituent, prise de forme et anéantissement de toute forme, émergence et explosion, sont contradictoires (C. Malabou, 1996, p. 26).
Il ressort de son analyse deux dispositions essentielles à noter, comme pour entériner l’existence d’un procès dialectique : d’abord, le mouvement d’auto-détermination, en soi rationnel, qui commande, ensuite, le passage de termes s’appelant mutuellement afin de produire, dans un mouvement qui est celui du devenir nécessaire, la réconciliation et la vitalité du tout.
À la lumière de ces dispositions, le schéma de l’emploi présente bien, dans la dynamique ternaire, des termes qui s’appellent mutuellement. En effet, employabilité, formation et emploi constituent des moments nécessaires d’une trilogie qui trouvent tout son sens dans sa capacité à favoriser la survivance de la société. Ces moments ont cette relation d’effacement nécessaire qui se perçoit entre la possibilité de l’emploi ou l’employabilité (ce qui équivaut aux besoins en bien et services) et le processus de formation consistant à apprêter les individus pour les voir répondre aux besoins ; et aussi dans le passage plus fluide de la formation à l’emploi. Ce moment de l’emploi se donne comme celui de la réconciliation et exprime la vitalité du tout. Cela se prouve par le fait que l’emploi constitue la fin dernière des moments précédents. Depuis ce dernier point, le mouvement d’auto-détermination qui constitue le principe de la dialectique se perçoit en ce que la raison d’être de l’emploi ou le processus par lequel il advient à sa manifestation traverse la série des figures qui ne sont en réalité que les moments de sa vie interne, et avec lesquelles il forme un tout vivant. Ainsi, le schéma de l’emploi ou, pour dire adéquatement, le système de l’emploi se déploie sur un fond dialectique. La crise du système de l’emploi revient donc à une crise de la dynamique dialectique sur laquelle il repose. En appréhendant les choses dans ce sens, ce qu’on appelle crise de l’emploi ne peut nous révéler son point crisique qu’en examinant, comme dans le cas d’un système électrique devant sa panne au dysfonctionnement de l’une de ses composantes, la susceptibilité de la défaillance de ces moments.
Le premier des moments du système de l’emploi est l’employabilité (la possibilité de l’emploi) qui doit être saisi dans sa relation intime aux besoins sociaux. Le concept d’utilité qui apparaissait dans la définition du travail chez Marx et l’attention à la satisfaction des besoins chez Hegel font de l’employabilité le synonyme du fonctionnement de la société. L’essence de la société, pour dire ce qui la caractérise fondamentalement, c’est d’être le système des besoins. Cette condition ontologique ne saurait être travestie par une volonté particulière car les hommes qui composent la société sont, biologiquement et par habitudes sociales, des êtres de consommation. Sur un ton quasi ironique et de désespoir, pour montrer la nature insatiable de l’homme, Dostoïevski disait : « Donnez-lui une suffisance économique telle qu’il ne lui reste absolument plus rien à faire, sinon dormir, manger de la brioche et s’agiter, l’histoire du monde ne s’arrête pas » (Dostoïevski, 1992, p. 27). Le progrès de l’histoire expose le renouvellement des besoins, mais aussi la création de nouveaux. La marche de l’histoire est la démarche des sociétés de consommation.
Le mode d’être du moment de l’employabilité constitue une réponse directe à la question de la rareté de l’emploi. Fondamentalement, la question ne saurait se poser tant que les hommes et les sociétés manifestent principalement des besoins. Suivant, l’existence des désirs non-naturels et non-nécessaires, selon le mot d’Épicure, élargit la sphère des besoins. Ainsi, « l’exaltation de l’abondance et la grande lamentation sur les “besoins artificiels’’ ou “aliénés’’ alimentent ensemble la même culture de masse, et même l’idéologie savante sur la question » (J. Baudrillard, 1970, p. 97). Ces éléments soulignent donc la possibilité de l’emploi et, pour répondre à la question de la rareté, l’impossibilité même de la rareté de l’emploi. Dans cette perspective, eu égard au tandem employabilité et emploi, la question de la crise de l’emploi semble avoir sa source dans la condition de la formation ; ce moyen terme entre employabilité et emploi.
Mettre l’accent sur la formation, cela amène à approcher un phénomène qui a un spectre assez large par un point de prise inadéquat si l’on considère déterminations économiques dont les impacts sont manifestes sur la santé sociale. Dans son analyse sur la condition du chômage en France, analyse qui peut servir dans les études sur le cas africain qui est aussi traversé par cette même réalité, B. Martinot s’attarde sur les causes économiques du chômage en indexant les rigidités économiques.
Les rigidités dénoncées par la littérature économique sont de nature très diverses : assurance chômage trop généreuse, taxation du travail excessive, réglementations diverses décourageant l’embauche, insuffisante concurrence sur le marché des biens et services, mauvaises conditions de la négociation salariale. En outre, bien évidemment, la qualité des relations sociales et la plus ou moins grande efficacité des politiques de l’emploi jouent un rôle non négligeable. On le voit, ces facteurs sont nombreux et leurs poids relatifs sans doute très variables d’un pays à un autre (B. Martinot, 2013, p. 97).
Toutefois, il poursuit en ajoutant ceci : « le second apport des analyses économiques contemporaines consiste à ne pas séparer les considérations économiques et les aspects sociaux de la question du chômage » (B. Martinot, 2013, p. 97). Et c’est bien ce qui doit retentir dans les politiques africaines de l’emploi beaucoup adossées aux déterminations économiques. Dans ce sens, l’attention à la condition de la formation a tout son sens. Sa position médiane entre l’employabilité et l’emploi, eux-mêmes réfléchissant les déterminations sociales, lui rend ici de l’intérêt. Si le système de l’emploi, dialectique en son fond, flanche dans le moment de l’emploi, c’est certainement parce que la cristallisation qui constitue la crise de la dialectique y est manifeste. Mais sous quelle forme ? Face au devenir perpétuel des besoins et réalités sociales, une formation sclérosée ne peut constituer, en termes de productions de ressources humaines et de solutions, une réponse adaptée. De cette façon, la formation qui repose sur cette institution qu’est l’université constitue le défi à confronter.
3. L’institution universitaire à l’épreuve de la dynamique du devenir
L’évocation du devenir s’inscrit dans le sens où l’emploi ne désigne pas seulement une simple fonction, mais une sphère dont l’appréhension exige une coïncidence avec la vie des peuples qui l’accueillent. Or, ce qui caractérise la vie des peuples et constitue la trame de fond de leur histoire, c’est le devenir qui détermine par corolaire l’arrière fond de la sphère professionnelle. De cette manière, cette dernière ne saurait être en phase avec ce qui demeure dans une cristallisation radicale ; pourtant, telle semble être la condition de la formation assurée par l’institution universitaire. En effet, sous les apparences d’une mutation des systèmes pour épouser des formes dites internationales, le fond des choses semble dire la répétition de dynamiques traditionnelles. Elles produisent des individus avec les exigences d’un temps dépassé et qui se trouvent, en leur temps, comme face à une réalité inconnue. Et la réponse que les instances dirigeantes de l’institution de la formation donnent à la crise de l’emploi en est une preuve. Comme le relève Marc-Laurent Hazoumê,
c’est à l’appel à s’investir dans l’agriculture que doivent répondre tous les jeunes diplômés comme c’est la mode partout en Afrique en ce moment. La raison d’une telle vision est simple. Faute de débouchés nouveaux créés, les pouvoirs publics, dans la plupart des pays africains, ne découvrent d’autre solution que celle-là (Hazoumê, 2012, p. 20).
Cette solution, qui réduit à néant les politiques et le sens des parcours universitaires, apparait comme un aveu d’impuissance face à une réalité dont la compréhension et la gestion échappent aux politiques. Si dès l’entame, l’insuffisance de la formation a été relevée pour exiger une sorte de mise à jour, il ressort, chez Hazoumê, l’idée de création d’emploi. De l’actualisation de la formation à la création de l’emploi tout semble reposer sur l’idée d’une formation liée aux exigences du devenir. E. Quenson note
[qu’] actuellement, la formation parait ainsi occuper une place centrale dans la société. Qu’elle concerne l’accès des jeunes à l’emploi ou le maintien ou l’adaptation et le maintien des salariés dans l’entreprise, elle est systématiquement arrimée de manière normative à la problématique de l’emploi (Quenson, 2012, p. 12).
Abordant les choses dans son sens, la question du contenu même de la formation et de la redéfinition de l’université se pose. Si la formation entraine l’université dans son élan, c’est bien parce qu’elle en constitue le cœur. Et la place centrale que Quenson accorde à la formation, dans la société, devient celle de l’université. Comme la société est par essence, parce que perpétuellement en mouvement, dynamique, il ne saurait en être autrement de l’université. Pour elle, se livrer au dynamisme, c’est dans un premier sens coïncider avec le mouvement de la société en vue du dénouement de la problématique de l’emploi. L’effectivité de cette orientation et de sa vie demande un repositionnement de l’institution universitaire, du point de vue de sa forme, et une re-visitation des contenus et offres de formation ; ce qui passe pour une réforme fondamentale de l’université.
Le repositionnement de l’institution universitaire va avec son ouverture aux réalités et dynamiques sociales. Cette ouverture pourrait s’entendre dans le sens d’un intérêt des scientifiques et des chercheurs pour les besoins sociaux, mais une telle orientation, non institutionnalisée, est déjà en vigueur et influence peu les programmes de formation. Par contre, récupérer les choses sous l’angle institutionnel reviendra à assoir, dans l’architecture organisationnelle des universités, des pôles scientifiques académiques d’études sociales et d’analyse des offres de formation. Une telle entreprise constitue une dimension de la prospective des métiers et des qualifications. Par exemple, en France, « les autorités éducatives ne souhaitaient pas conduire leur politique sans une anticipation des grandes évolutions en termes d’emploi et de professions (…) ont, dès la moitié des années 1980, chargé la société BIPE conseil, de remettre en œuvre les] exercices de prévisions » (J.-J. Paul, J. Rose, 2008, p. 25).
De quoi s’agit-il concrètement ? « Il s’agit tout d’abord de partir d’hypothèses macroéconomiques relatives à la croissance et à l’évolution de la durée et de la productivité du travail pour déterminer les besoins totaux de main-d’œuvre et les créations nettes d’emploi » (J.-J. Paul et J. Rose, 2008, p. 26). Cette prospective est pratique pour l’orientation des formations existantes en fonction des emplois tout aussi existants, mais est limitée face à la nécessité de création des emplois. La grande préoccupation à ce niveau est : comment former ou apprêter les esprits à faire advenir à l’existence ce qui n’est pas encore ? Il ne suffit en effet pas de lever la carte entrepreneuriale pour résoudre la question ; car là encore, au-delà de celles relative aux moyens et conditions, la question par quoi commencer demeure. Mais, Heidegger offre une piste de réflexion lorsqu’il affirme que « du néant rien ne nait ». L’idée qui en ressort est que ce qui doit advenir a ici et maintenant ses germes. Dans le sens des analyses causales, on pourrait affirmer que ce qui devra se produire comme effet, ne pourra l’être qu’en vertu de l’existence préalable de sa cause. Or, tout ce qui advient comme étant posé par l’homme a, bien avant tout matériaux, sa cause première en l’homme même.
Se focaliser sur l’homme dans une entreprise de formation en vue de la création d’emploi, c’est mettre à sa disposition le matériel cognitif nécessaire à cet effet. Même si nous ne voulons pas nous attarder sur le phénomène (courant et parfois vulgaire) des motivations, notons que la réaffirmation des possibilités de l’individu n’est pas un pan négligeable quand elle s’attarde sur la considération de l’homme comme esprit. Suivant Albert Antonioli, c’est à l’esprit qu’il faut s’intéresser pour imprimer, en l’homme, la dynamique de la création d’emploi. Pour lui, et la chose se confirme par les réclamations d’emploi qui se sont transmuées en mouvement sociaux,
C’est l’ensemble de la population [académique] qu’il est nécessaire de « reformater », et procéder à une véritable révolution des mentalités. Concrètement au lieu de produire des « demandeurs d’emplois », [les institutions de formation doivent] se résoudre à produire massivement des « donneurs d’emplois » ; en un mot des entrepreneurs (A. Antonioli, 2017, p. 115-116).
Aussi, il importe d’assoir non la pensée, mais l’esprit de l’entreprise. « L’esprit d’entreprise est un état d’esprit. C’est une attitude, produit d’un système de valeurs, de normes » (A. Antonioli, 2017, p. 121). Tout le mécanisme à mettre en place pour décrisper la question de l’emploi reposerait donc, en fonction de la visée, sur un processus d’acculturation dont les normes doivent être adaptées aux réalités de nos espaces.
Conclusion
Il est évident qu’en abordant la question de la problématique de l’emploi dans le cadre du fonctionnement des universités, et relativement aux contenus des formations que l’idée de l’inutilité de certaines disciplines scientifiques ou même de leur orientation puisse ressortir. Cela est renforcé par l’accent mis sur l’esprit de l’entreprise. Toutefois, cette attention ne dit en rien l’abandon des sciences et des orientations classiques des recherches scientifiques. La recherche fondamentale et la recherche historique, en général et propre à chaque science, ont tous leurs sens pour la perpétuation des savoirs, et pour le potentiel intelligible qu’elles déploient.
Le sens dans lequel la culture de l’esprit de l’entreprise doit être prise, c’est celui qui consiste à rétablir un équilibre porté par la dialectique dont les termes sont : employabilité, formation et emploi. L’institution à laquelle ce système s’adosse, comme son moment total et médiateur, l’université, trouverait son sens dont un repositionnement structurel et fondamental pour remplir sa vocation d’instance centrale de la société. C’est là tout le sens de son inscription dans la dynamique du devenir originairement propre au système des besoins de la société. Concrètement, l’attention au devenir pourrait reposer sur la création, au sein des universités, d’un pôle de recherche et de réflexion travaillant à faire correspondre les programmes de formation aux besoins sociaux et aux défis des entreprises.
Références bibliographiques
ANTONIOLI Albert, 2017, Développer l’esprit d’entreprise, du droit d’apprendre au devoir d’entreprendre, Paris, L’Harmattan.
BAUDRILLARD Jean, 1970, La Société de consommation, ses mythes, ses structures, Paris, Denoël.
CILLIERS Jakkie, 2004, « L’Afrique et le terrorisme », in Afrique contemporaine, De Boeck Supérieur, n° 209, pp. 81-100.
DOSTOÏEVSKI Fiodor, 1992, Les carnets du sous-sol, trad. A. Markowicz, Paris, BABEL.
HAZOUMÊ Marc-Laurent, 2012, Réinventer l’Université, Approche de solutions pour l’emploi des jeunes au Bénin, Paris, L’Harmattan.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 2013, Principes de la philosophie du droit, traduction de J.-F. Kervégan, Paris, PUF.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1994, Encyclopédie des sciences philosophiques, T I, La science de la logique, Traduction de Bernard Bourgeois, Paris, Vrin.
KANT Emmanuel, 2004, Réflexions sur l’éducation, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin.
MALABOU Cathérine, 1996, L’avenir de Hegel, plasticité, temporalité, dialectique, Paris, Vrin.
MARTINOT Bertrand, 2013, Chômage : inverser la courbe, Paris, Les Belles Lettres.
MARX Karl, 1993, Le Capital, Livre 1, trad. E. Balibar et al, Paris, PUF.
QUENSON Emmanuel, 2012, Une socio-histoire des relations formation-emploi, Paris, L’Harmattan.
ROSE Jean-Jacques Paul et José, 2008, Les relations Formation Emploi en 55 question, Paris, Dunod.
Organisation International du Travail, 2019, Mesurer l’emploi décent des jeunes, Un guide sur le suivi, l’évaluation et les leçons des programmes du marché du travail, Turin, OIT.
PENSER LA CRISE DES UNIVERSITÉS AFRICAINES COMME UNE CRISE DE LA LANGUE DE LA FORMATION SCIENTIFIQUE
Tohotanga COULIBALY
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Depuis que les Africains ont hérité du système d’enseignement issu de la colonisation, ils y ont maintenu les langues européennes, encouragés en cela par certains penseurs qui ont admis que les langues africaines ne sont pas aptes aux discours scientifiques. La langue est le creuset de la vision du monde d’un peuple dans lequel se noue son pouvoir créatif. Or, il n’existe pas une langue spécifique pour véhiculer le savoir scientifique. C’est pourquoi nous pensons qu’une formation universitaire en Afrique qui intègre les langues locales peut résorber la crise de l’emploi qui peut être interprétée comme la résultante d’une inadéquation entre le contexte culturel de la formation marqué par les langues européennes et le milieu de vie des étudiants, en l’occurrence le continent africain. C’est cette disjonction entre le canal de la formation et le milieu de la formation qui limite le pouvoir innovant des étudiants africains en les rendant myopes aux opportunités qu’ils peuvent se créer en réinvestissant leur formation dans le tissu social.
Mots clés : Africain, Contexte culturel, Développement, Langue, Science, Université.
Abstract:
Since the Africans inherited the educational system resulting from colonization, they maintained there the European languages, encouraged in that by some thinkers who admitted that the African languages are not suited to the scientific speeches. The language is the crucible of the vision of the world of people in whom his creative capacity is tied. However, there is not a specific language to convey the scientific knowledge. This is why we think that a university formation in Africa which integrates the local languages can reabsorb the employment crisis which can be interpreted like the resultant of an inadequacy between the cultural context of the formation marked by the European languages and the medium of life of the students, in fact the African continent. It is this disjunction between the channel of the formation and the medium of the formation limits the innovating capacity of the African students while making them short-sighted to opportunities which they can create by reinvesting their formation in social fabric.
Keywords : African, cultural Context, Development, Language, Science, University.
Introduction
Depuis que les Africains ont hérité du système d’enseignement issu de la colonisation, ils y ont maintenu les langues européennes comme canal privilégié de transmission du savoir scientifique. Pourtant, dans cette première moitié du XXIe siècle, les universités africaines sont de plus en plus contestées. Le sujet de cette contestation qui déborde souvent le champ académique pour troubler l’ordre social n’est pourtant pas, une remise en cause des missions traditionnelles dévolues à ces universités. Au-delà de ce que l’on peut penser, les universités africaines continuent d’assurer à la jeunesse africaine, un savoir-faire pouvant permettre à cette dernière de rehausser qualitativement son niveau de formation et de développer sa personnalité civique ou citoyenne. On ne peut remettre cela en cause, si l’on consulte régulièrement les catalogues des universités Cheik Anta Diop de Dakar, de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et celle d’Abdou Moumouni de Niamey, pour se rendre compte des nombreuses thèses de doctorat régulièrement soutenues dans plusieurs disciplines scientifiques. Ce fait, à lui seul, témoigne de la vivacité de l’esprit scientifique qui règne dans ces lieux de production du savoir.
Et pourtant, lorsqu’on aborde le dernier maillon des missions de ces universités, c’est -à -dire, l’insertion socio professionnelle des étudiants formés en leur sein, on sent une gêne, un malaise qui souvent, tourne à la déception. Les observateurs sont unanimes : l’université africaine a presque échoué, ou du moins, ne remplit plus convenablement sa mission qui devait lui permettre d’assurer au jeune qui franchit ses portes, une insertion adéquate dans la vie et le tissu social. Les jeunes se sentent floués par l’ère postcoloniale africaine qui proclame à tout vent, qu’elle s’est départie de la féodalité en coupant tout lien avec l’économie agraire, pour se bâtir essentiellement à partir de l’économie du savoir.
On peut dès lors, légitimement s’interroger : pourquoi les jeunes qui sortent des universités africaines avec parfois les plus hautes distinctions de ces institutions ont de plus en plus du mal à s’insérer dans le tissu social dans lequel ces universités sont implantées ? Ne faudrait-on pas enrichir la maquette pédagogique de ces institutions en introduisant les langues locales dans la formation de ces étudiants pour favoriser l’élargissement de l’assiette d’emploi qu’ils peuvent se créer dans leur milieu culturel et social ? Puisqu’il est admis, comme le pense A. Mbembe (2017, p. 393), « que la langue en tant que telle permet des perspectives nouvelles », nous montrons, à partir d’une analyse critique, que l’introduction des langues locales dans l’enseignement universitaire permettrait d’ouvrir de nouvelles perspectives en adaptant l’enseignement aux réalités socio-économiques afin d’élargir l’espace d’employabilité des étudiants africains.
Notre analyse s’inscrit dans le champ épistémologique, même si elle a un pendant sociolinguistique. C’est pour cela qu’elle déconstruit, dans un premier point, l’idée que les langues africaines sont inaptes à l’expression du discours scientifique. Ensuite dans un second point, nous montrons que les langues européennes, elles-mêmes, éprouvent des difficultés dans l’élaboration du savoir scientifique. Et enfin dans le dernier point, nous recommandons l’introduction des langues africaines dans la formation universitaire afin de promouvoir l’intégration sociale et économique des étudiants.
1. Les langues européennes, canal de formation dans les universités africaines, une nécessité de la science ?
Cette question ne devrait même pas se poser pour des penseurs eurocentristes et leurs partisans africains. Pour eux, il est normal que les disciplines scientifiques qui sont enseignées jusqu’à présent dans les universités africaines, le soient en langue occidentale. La raison fondamentale est qu’elles sont pour la plupart, d’origine occidentale. Aussi, pour les enseigner, aux jeunes africains, afin d’éviter que leurs essences, l’intelligence des concepts qui les caractérisent, ne soient édulcorées et que leurs sens ne se perdent dans des traductions mal adaptées, il est bienséant de conserver, pour leur transmission, la langue maternelle à partir de laquelle elles se sont rendues accessibles à l’homme.
Cet argument peut être évoqué, en un sens, en ce qui concerne les sciences dites « dures » telles que la mathématique et la physique qui ont, toutes deux, acquis leurs lettres de noblesse avant la période coloniale. Et même – il faut le rappeler -, la physique moderne, telle qu’elle nous est enseignée dans les états francophones, en langue française, n’a pas été inventée pour ce qui concerne ces théories essentielles de la physique classique et la physique contemporaine, dans cette langue. D’origine, les propositions de la physique étaient formulées en italien, en anglais ou en allemand. Pourtant, on nous objectera que ceci n’est pas essentiel puisque toutes les langues européennes, que ce soit l’anglais, l’italien, l’espagnol ou le français, ont des racines communes, latines ou grecques. C’est cela qui fait que ces langues ont la même manière d’appréhender le monde. De ce fait, au moyen de l’une ou de l’autre, on peut conceptualiser, à travers elles, indifféremment le réel. Ils objecteront, pourtant, qu’une telle possibilité est exclue en ce qui concerne les langues africaines. Les sciences ont une racine propre qui tire sa substance dans la culture d’une race bien déterminée, la race européenne. Même si, la culture européenne peut avoir en partage certains éléments qui ont leurs corollaires dans d’autres civilisations, la science quant à elle, est une réalité typiquement européenne. Lévy Brühl (1951, p. 11) explique en disant qu’« à défaut de littérature et de sciences, les primitifs ont des mythes des contes, des proverbes (…) qui parfois forcent notre admiration ». Ceux que Brühl appelle primitifs, sont la classe des peuples autres que les Européens parmi lesquels ils comptent les Africains. Ces peuples émotifs, guidés par la passion ne peuvent exercer leur raison pour saisir des principes intangibles qui gouvernent les phénomènes naturels.
La science ne fait pas partie du monde des Africains. Néanmoins, la condition nécessaire que doit remplir un Africain pour capter son intelligence réside, dans sa capacité à comprendre les langues européennes. Gobineau (1967, p. 182) insiste sur le fait en ces termes : « le fait du langage se trouve intimement reliée à la forme de l’intelligence de la race ». Dans cette perspective, l’enseignement de la science dans les langues européennes aux jeunes africains, aurait un double bénéfice. En un sens, elle permettrait d’élever la conscience de ces jeunes, à un degré de rationalité qui manque à leurs langues maternelles, incapables qu’elles sont, de formuler des lois générales capables d’embrasser la réalité concrète. Et, en un autre sens, cet enseignement aurait l’avantage de les extraire de leurs univers irrationnels, dépourvus de principe explicatif du réel et marqués par le miracle, le lyrisme et l’émerveillement.
Pourtant, des travaux de certains intellectuels africains ont prouvé que ce discours qui tend à mettre les langues africaines à l’index quant à la production scientifique pour ensuite les présenter, pour ainsi dire comme des obstacles épistémologiques à toute création scientifique, relève plutôt d’une condescendance, d’un mythe au service d’intérêts éloignés de la pratique scientifique réelle. En réalité, les langues africaines ne sont pas contre-productives d’un point de vue épistémologique pour ainsi dire au regard du savoir scientifique. Surtout, qu’en 1975, Cheikh Anta DIOP a pu traduire la théorie des ensembles de Georg Cantor en langue wolof, et montrer par là qu’à partir d’une langue africaine, on peut transcrire avec cohérence, les raisonnements mathématiques et les équations de la physique. Ce travail a été, en 2002, poursuivi par Dafon Aimé SEGLA lorsqu’il a traduit en langue yoruba des extraits des Éléments d’Euclide.
Ces tentatives des Africains pour montrer la fécondité scientifique des langues africaines sont encore classées parmi les recherches épistolaires qu’on dit menées par certains penseurs pour distraire leur temps et surtout, satisfaire leur curiosité scientifique. La science a-t-elle vocation à se greffer seulement sur les langues européennes au point que ces langues soient les seules langues capables d’exprimer l’objectivité scientifique ?
2. Les langues européennes et la difficulté d’expression du savoir scientifique
Pour les adeptes des anthropologues comme Lévy Brühl ou même Gobineau, les langues africaines, si riches pour flatter l’esprit lorsqu’il s’exerce au divertissement, sont très pauvres lorsqu’on les emploie pour découvrir les lois générales et les principes de la nature. Mais, lorsqu’on investit l’histoire des idées, les langues européennes utilisées dans les universités africaines, comme des canaux idoines pour transmettre la connaissance scientifique a connu elle-même des fortunes diverses. Il y a eu une mutation dans ces langues au point où certaines d’entre elles qui avaient l’exclusivité de l’expression du savoir scientifique, ont été abandonnées au profit d’autres langues qui, à l’époque étaient objet des mêmes reproches faites actuellement aux langues africaines.
En effet, au XVIIe siècle, Francis Bacon le promoteur de la science occidentale soutenait que la langue peut être un frein au savoir. Il distingue ainsi, quatre espèces d’idoles qui sont autant de sources d’erreur lorsque l’homme est en quête de vérité sur la nature. Ainsi dans la recherche scientifique, l’esprit humain peut être victime des idoles de la tribu. Ce sont des erreurs communes à tous les hommes. Il en est ainsi des idoles de la Caverne qui sont des erreurs particulières à chaque individu, des idoles du théâtre, qui sont inculquées à l’homme par les faux systèmes philosophiques, et les idoles du forum, qui proviennent spécifiquement de l’emploi du langage. Le langage est, pour Bacon, la source d’erreurs les plus pernicieuses et les plus répandues qui mènent l’esprit humain dans l’obscurité en dépit des précautions qu’il prend pour cultiver et transmettre la science. Francis Bacon (1857, p. 19) affirme que,
les plus dangereuses de toutes les idoles sont celles du forum, qui viennent à l’esprit de son alliance avec le langage. (…) Lorsqu’un esprit plus pénétrant ou une observation plus attentive veut transporter ces lignes pour les mettre mieux en harmonie avec la réalité, le langage y fait obstacle.
En d’autres termes, le langage étant une création des communautés humaines, les hommes de science l’emploient communément avec confiance en oubliant que le sens des mots n’a pas été fixé par les esprits les plus avertis afin qu’il serve à informer le réel. À l’époque de Bacon, le philosophe français René Descartes fait le même constat lorsqu’il soutient que le langage n’est jamais totalement transparent pour servir de médiation entre l’homme et la nature. Descartes (1906, p. 79) justifie cet état de fait en ces termes :
Les paroles toutefois m’arrêtent, et je suis presque déçu par les termes du langage ordinaire (…) Un homme qui tâche d’élever sa connaissance au-delà du commun doit avoir honte de tirer des occasions de douter des formes de parler que le vulgaire a inventées.
En d’autres termes, pour Descartes, le langage est l’élément principal qui annihile les efforts de l’homme dans son entreprise de rendre intelligible la nature. En réalité, les critiques du langage de Francis Bacon et René Descartes ne s’adressent pas a priori aux langues africaines. On peut le deviner lorsqu’on considère la période historique qui a vu éclore leurs écrits. Le langage qu’ils mettent en cause est soit le latin, soit le grec qui occupaient et détenaient, jusqu’au XVII siècle, en Europe, le monopole de l’expression du savoir scientifique. Ces langues, dans ces contrées européennes, avaient la même hégémonie de canal de transmission de la science comme le sont aujourd’hui les langues dans les États et institutions universitaires africaines. D’ailleurs, à cette époque, en Europe, tout écrit savant devait être obligatoirement rédigé en latin ou en grec. Ces deux langues constituaient, à elles seules, le circuit officiel et institutionnel de diffusion de la science.
Pourtant, les langues européennes, langue de prédilection de la formation universitaire en Afrique aujourd’hui, étaient qualifiées de « vulgaires », c’est-à-dire, de langues réservées à l’expression des besoins du bas peuple, des hommes du Tiers-État qui sont eux-mêmes incapables d’élever leur intellect pour avoir accès au latin et épouser son intelligence pour prétendre le lire et l’écrire. La langue française qui, aujourd’hui, se trouve dans une situation de monopole en ce qui concerne l’élaboration et la transmission du savoir dans les ex-colonies françaises a été, à un moment donné de l’histoire, contestée quant à sa capacité à pouvoir être un canal pour la transmission du savoir scientifique. Et même, l’ordonnance du Roi de France, François 1er de 1539, n’y fit rien puisqu’il instituait seulement le français comme langue de l’administration et de la justice. Il a fallu des penseurs audacieux comme Descartes, pour faire la promotion de cette langue dans le domaine de la science et de la culture. Descartes (1987, p. 77) se justifie dans son ouvrage Discours de la méthode :
Si j’écris en français, qui est la langue de mon pays, plutôt qu’en latin, qui est celle de mes précepteurs, c’est à cause que j’espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu’aux livres anciens. Et pour ceux qui joignent le bon sens avec l’étude, ils ne seront point, je m’assure, si partiaux pour le latin, qu’ils refusent d’entendre mes raisons, parce que je les explique en langue vulgaire.
Depuis Descartes, il est admis que la science demeure l’apanage de toutes les langues naturelles. Car la « langue vulgaire » pour ne pas dire, la langue vernaculaire, comme on qualifie aujourd’hui la plupart des langues africaines, utilisées seulement par la basse classe de l’État français, qui n’avaient pas les facultés nécessaires de se cultiver et d’accéder au monde de la science qui circulait à travers le latin, n’est pas rétif à la transmission du savoir. Cette considération peut être mise en parallèle avec le choix de Descartes. En effet, avant que celui-ci n’opère cette révolution linguistique, en France et en Europe, l’on n’imaginait pas que le latin pouvait être relégué au rang des langues mortes utiles seulement aux archéologues, et le français, « la langue vulgaire ». Or, elle a traversé les frontières de la France et s’imposerait comme une langue internationale par laquelle l’on enseigne des générations d’individus. C’est par le français que des générations et des générations de sachants ont fait progresser la science dans les directions que leurs devanciers n’avaient pas entrevues.
Dès lors, il appert qu’il n’y a pas de langue plus apte que d’autres pour servir de canal de découverte ou de transmission du savoir scientifique. Il n’y a qu’un usage scientifique de la langue. Et, les langues africaines ne sont pas rétives au discours scientifique. C’est pourquoi, parlant des langues africaines, Adama Ouane (2010, p. 6) affirme qu’« il n’est pas vrai qu’apprendre ces langues ou apprendre dans ces langues retarde l’accès aux sciences, aux technologies ou aux autres savoirs mondiaux et universels, et leur maîtrise. »
En réalité, les premiers missionnaires venus d’Occident avaient bien compris que les langues locales africaines sont des puissants marqueurs sociaux. C’est pour cette raison que pour répandre l’Évangile et implanter leurs missions d’évangélisation dans le monde rural africain, ils ont utilisé des langues locales africaines comme langue de l’enseignement du catéchisme. Omasombo Tshonda et Paluku Sikuhimbire (1984, p. 105) rappellent que les missionnaires européens, sont les initiateurs de l’idée que pour être efficace et tenir ses promesses d’innovation sociale, l’enseignement doit se faire dans les langues locales.
L’enseignement scolaire a commencé à être assuré dans la langue africaine à l’époque des missions chrétiennes qui désiraient propager leur foi avec le maximum d’efficacité. Cette contribution missionnaire a doté un grand nombre de langues africaines de textes écrits et d’une orthographe.
En effet, d’une part, le message originaire de la foi chrétienne en Afrique a pu prendre racine dans les langues locales. Et d’autre part, on voit l’implication sociale aujourd’hui de la religion dans les sociétés africaines. De ce point de vue, on ne peut que souhaiter que la science se serve de ce même canal pour élargir son horizon dans les sociétés africaines. D’ailleurs, lorsqu’on passe d’une langue à une autre, la science se bonifie. À ce propos Jean-Marc Lévy-Leblond (2013, p. 23) fait observer en ces mots :
Il est tout à fait remarquable que la révolution scientifique du début du XVIIe siècle, la coupure galiléenne, ce moment où s’inaugure la science telle que nous la connaissons aujourd’hui, coïncide précisément avec l’affaiblissement du latin, et le début de sa disparition comme langue de culture commune. Les grands fondateurs de la science moderne, au début du XVIIe siècle, écrivent très largement dans leur langue nationale, et le revendiquent ! Ce fait est bien connu dans le cas de Galilée qui a écrit certes quelques textes en latin, mais dont les grandes œuvres sont écrites en italien.
Il est ainsi évident que le passage d’une langue à une autre favorise la révolution scientifique en étant même le moteur de la découverte scientifique. On peut le dire, la domination factuelle des langues occidentales dans l’enseignement des universités africaines, parait injustifiée. Ladite domination a des conséquences négatives quant à l’approfondissement, à la rénovation et au partage du savoir scientifique. Et d’ailleurs cette domination factuelle des langues européennes constitue un frein qui rétrécit l’employabilité des étudiants africains, comme nous allons le montrer dans la section suivante.
3. Promotion des langues africaines dans les universités africaines, un moyen d’intégration sociale et économique
Mamadou Ndoye (2005, p. 1) donne un diagnostic éclairant du mal qui mine les universités africaines : « les taux d’inscription des étudiants en Afrique restent relativement faibles par rapport à ceux du reste du monde en développement, la fuite des cerveaux et le chômage des diplômés restés sur place semblent au contraire témoigner d’un trop plein ». Pourtant, ce diagnostic si réaliste s’attarde seulement à décrire les effets de la crise des universités, car il omet de mettre en exergue sa racine. L’université qui, sous d’autres cieux, est le fleuron de la société, en tant que lieu intellectuel d’incubation des solutions innovantes impulsant le développement, est en Afrique, le talon d’Achille du développement.
En réalité, il n’y a pas que le nombre élevé de diplômés universitaires dans les pays africains qui expliquerait leur chômage. La formation de ces diplômés ayant été faite dans les langues européennes, la conceptualisation, l’élaboration et l’émission du savoir-faire, appris dans ces universités, se font par le biais de ces langues. Or, aucune langue n’est neutre. Elle véhicule toujours une conception du monde qui reflète la manière dont les hommes rendent compte de leur existence prenant en compte, leur milieu de vie ou environnement. De ce fait, des étudiants africains formés dans les langues européennes, adoptent des représentations du monde à travers lesquels ils perçoivent une réalité. Il s’agit de la réalité européenne que leur impose leur langue d’apprentissage, différente de leur réalité existentielle, de leur vécu, c’est-à-dire, celle qui les environne, la réalité africaine. La dissonance de ces deux réalités est vécue par les étudiants africains comme la juxtaposition de deux espaces de résonance linguistique distincts.
En fait, ces espaces linguistiques concurrentiels qui maintiennent les étudiants africains entre deux mondes dans lesquels ils sont en transition, ont un inconvénient certain sur leur insertion socioprofessionnelle. Selon Joseph KI-ZERBO (1990, p. 11) : « le système éducatif africain d’aujourd’hui alimente la crise en produisant des inadaptés économiques et sociaux ». En d’autres termes, il y a comme un hiatus entre leur lieu de formation et le milieu de vie quotidienne des étudiants africains. Ce qui fait qu’ils sont des « inadaptés économiques » pour ceux, d’entre eux, qui n’ont pas eu la chance de se retrouver dans un environnement où la valeur culturelle se mesure à l’aune de la langue et du savoir occidental. À défaut de se retrouver dans un tel milieu social, les étudiants africains sont exclus du tissu social et économique. En effet, de tels étudiants ne peuvent pas interpréter par eux-mêmes, le monde de leur existence, en fonction de leurs préoccupations. Ils ne peuvent alors, pour produire une substance intellectuelle qui puisse être élever au rang de valeur marchande dans les échanges culturels avec les autres.
Il n’est pas vrai que ces étudiants ne peuvent rien produire. Ce qui est vrai, c’est que ce qu’ils produisent ne peut prendre racine dans leur société au point de leur conférer un droit de propriété dans leur environnement culturel. Par conséquent, ils ont du mal à investir le milieu culturel local pour en faire un lieu de résonance scientifique dans lequel leur production pourra s’enraciner et prend son envol. Par exemple, un étudiant qui a étudié les sciences sociales dans les universités africaines, à défaut de trouver un emploi dans le cadre institutionnel hérité de la colonisation, à savoir l’administration, les institutions scolaires, et certaines entreprises qui fonctionnent sur le modèle européen, aura des difficultés à s’insérer dans le tissu social économique du pays africain dans lequel il a été formé. En réalité, cet étudiant ignore le patrimoine culturel de son peuple, le répertoire central de sa communauté linguistique. Il ne peut donc pas faire la publicité des sciences au sein de sa communauté au point de susciter en eux, un intérêt pour qu’ils puissent accorder à ces sciences du crédit pour ensuite les valoriser et en promouvoir socialement le porteur.
Le problème de la formation des jeunes africains dans les langues européennes est la source de l’indifférence et de la méconnaissance des sciences sociales par les populations africaines. En fait, « elles ne voient pas toujours à quoi elles ne servent ni ce à quoi elles peuvent correspondre » (Boubakar LY, 1990, p. 186). En réalité, les populations africaines ne comprennent pas l’utilité des sciences sociales parce qu’elles ne s’enseignent pas dans les langues africaines. Elle parle de la société, mais elles ont en vue la société et la culture occidentale, car comme le montre G. Sawadogo (2004, p. 252), « enseigner une langue, c’est enseigner la culture qu’elle véhicule. » Les jeunes africains formés dans les universités africaines sont, pour ainsi dire formatés dans la culture occidentale. Ce qui fait que, du point de vue de la culture, il n’y a pratiquement pas de différence entre un étudiant ivoirien formé à l’université de Korhogo et un étudiant français, formé à l’université de Montpellier, en France. Il apparait donc que les universités africaines, en maintenant les langues occidentales à partir desquelles elles ont été créées sur le sol africain, continuent d’être des universités annexes et même des universités européennes délocalisées. Et, cela a un inconvénient énorme pour les sociétés africaines, comme le rappelle Joseph Ki Zerbo (1990, p. 50) en ces propos-ci :
Le fait que l’école n’ait pas fondamentalement changé en Afrique depuis la fin de la période coloniale, est ainsi un indice que de vraies mutations sociales ne sont pas produites. La société globale coloniale s’est retirée en laissant derrière elle son école comme une bombe à retardement qui n’a pas été désamorcée.
Et c’est lorsque les étudiants africains finissent leur formation qu’ils se rendent compte que le parchemin qu’ils ont acquis peut devenir une arme de destruction pour eux-mêmes, s’ils n’arrivent pas à intégrer une structure occidentale. Pour maximiser leur chance, en effet, les diplômés des universités africaines émigrent, non pas parce qu’ils n’ont pas été bien formés, mais parce qu’ils ont du mal à intégrer le marché du travail local. Ils quittent l’Afrique pour l’Europe parce que leur formation s’étant faite en langue européenne, le contexte culturel de leur formation, la société et les langues européennes dans lesquelles ils ont été formés leur offre plus d’opportunités d’emplois que le contexte linguistique et culturel de leur formation.
On peut y voir un avantage considérable à l’ère de la mondialisation où le monde est, dit-on, devenu un village planétaire. Ainsi, que les étudiants en fin de cycle dans les universités africaines, qui n’arrivent pas à s’insérer dans le tissu social et économique africain, peuvent trouver des débouchés dans les pays occidentaux. Cependant, vu le nombre d’africains diplômés formés en langues européennes émigrer et s’adapter à la société européenne, on se rend compte de ceci : les États africains investissent de l’argent dans les universités pour les former et qui, finalement sont aptes à faire valoir leurs compétences sous d’autres cieux, autres qu’africains. D’après, le Professeur d’économie de l’université d’Ibadan au Nigéria, S. Ibi Ajayi(2001, p. 7) « on estime à plus de 30.000 le nombre d’africains titulaires de doctorats qui travaillent en Europe occidentale et en Amérique du Nord ». L’enseignement tous azimuts des langues européennes dans les universités africaines crée des diplômés sans interlocuteur social, car ces derniers ne s’épanouissent que dans les systèmes économiques des langues dans lesquelles ils ont été formés.
Conclusion
Si nous recommandons l’enseignement des langues locales dans les universités africaines, c’est parce que nous sommes parvenus à établir que toutes les langues humaines ont des tares qu’une observation attentive peut mettre en relief. Pourtant, sans elles, aucune connaissance du réel ne peut être possible au point de prétendre se communiquer. Pas plus que les langues d’autres peuples, les langues africaines sont aussi riches que complètes et peuvent servir de canal de formation à toutes les disciplines enseignées dans les universités. Cependant, en excluant les langues africaines dans la formation universitaire, on exclut de fait, la réalité africaine immanente aux langues locales et qui s’y manifeste substantiellement. Ladite réalité linguistique en question, ne parle plus aux étudiants. C’est qu’ils qui ne sont pas formés, mais transformés sur le sol africain, mais à partir des langues occidentales dans lesquelles ils sont formés et qui, malheureusement les coupent de leur énergie existentielle et leur âme culturelle créatrice. Toute création étant fille d’un contexte culturel et des attitudes y afférentes, un étudiant africain qui est formé dans une langue occidentale, est déconnecté de son environnement socio-culturel. Sa créativité intellectuelle et linguistique s’amenuise strictement en raison du fait qu’il a les pieds dans un monde et la tête dans un autre.
Toutefois, des étudiants africains formés à partir des langues locales sont immédiatement intégrés dans leur milieu culturel. Cela génère un bénéfice énorme en termes de développement endogène et de création d’emploi. Ils peuvent s’offrir en s’inspirant d’abord de leurs cultures sans être inaptes à conquérir d’autres types d’emplois plus compétitifs. Il s’agit, en réalité, pour ces étudiants, d’avoir les ressorts nécessaires pour se projeter dans un marché du travail plus élastique en ajustant aussi les diplômes à tous les éventails d’emplois disponibles dans la société. C’est un ajustement structurel de la formation en fonction de l’environnement socioculturel que nous recommandons. Cela, afin de sortir de l’éducation mimétique qui se base seulement sur l’extérieur.
Pourtant, en le disant ainsi, nous n’avons dans notre démarche nullement l’intention de promouvoir une proscription des langues européennes dans la formation du capital humain africain. Il ne s’agit non plus, pour nous de penser à les remplacer exclusivement par des langues locales africaines. Aujourd’hui, la mondialisation est une réalité. Et même, la marche du monde nous montre qu’elle s’inscrit dans un processus irréversible dans lequel le multilinguisme est une nécessité qu’il faut prendre en compte dans la formation des ressources humaines de qualité. C’est à ce prix que les universités africaines rempliront leur vocation première, de moteur de promotion sociale.
Références bibliographiques
AJAYI S. I b i, 2001, « Comment l’Afrique peut bénéficier de la mondialisation », in Finances & Développement, Washington, International Monetary Fund.
BACON Francis, 1857, Novum organum, trad. en français avec une introd. et des notes par Lorquet, Paris, Hachette.
BRÜHL Lévy, 1951, La mentalité primitive, Oxford, Clarendon Press.
BOUBAKAR Ly, 1990, « Les sciences sociales en Afrique : Problèmes de recherche et de formation », in Afrique et Développement, Actes de la Sixième Assemblée générale du CODESRIA, Vol. 15, N°3/4.
DESCARTES René, 1987, Discours de la méthode, Paris, J. Vrin.
GOBINEAU Arthur De, 1967, Essai sur l’inégalité des races humaines, Paris, Éditions Pierre Belfond.
KI ZERBO Joseph, 1990, Éduquer ou périr, Paris, L’harmattan.
LÉVY-LEBLOND Jean-Marc, 2013, « La science au défi de la langue », in Synergies Europe, N°8.
MBEMBE Achille, 2017, « Penser le monde à partir de l’Afrique », in Écrirel’Afrique-Monde, Paris, Phillipe Rey.
NDOYE Mamadou, 2005, « Quel enseignement supérieur pour l’Afrique ? », in La lettre de l’ADEA, volume 17, N°3/4.
ORIVEL François, 1991, « La crise des universités francophones en Afrique subsaharienne », in Perspectives, Revue trimestrielle de l’éducation, Vol. XXI, N°3, pp. 377-385.
OUANE Adama, 2010, Pourquoi et comment l’Afrique doit investir dans les langues africaines et ’enseignement multilingue, Hambourg, ADEA.
PRAH Kwesi Kwaa, 2002, Les langues africaines pour l’éducation des masses en Afrique, Trad. Brigitte Angays, Casas Book série, N°29.
SAWADOGO Georges, 2004, « Les langues nationales à l’école burkinabé : enjeux d’une innovation pédagogique majeure », In REPÈRES, recherches en didactique du français langue maternelle N° 29/2004.
TSHONDA Omasombo, Paluku Sikuhimbire, 1984, « L’Afrique et ses problèmes de langues », in Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 39, N°1.
Bi Zaouli Sylvain ZAMBLÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Si la philosophie est en crise dans le monde contemporain, au point d’être taxée de filière inutile de laquelle les universités devraient se débarrasser, c’est parce qu’elle n’a pas encore été exploitée dans toutes ses dimensions. Au-delà de sa dimension théorique, largement exploitée, elle comporte une dimension active, qui reste quasiment inexplorée. Celle-ci prend sa source dans la pensée de Platon et consiste à mettre en action la connaissance philosophique au service de la communauté. Un tel service se rapporte à l’entrepreneuriat dont le lien avec l’allégorie de la caverne chez Platon constitue l’objet de la présente étude. Elle montre que la philosophie politique de Platon est une ressource utile à la création et à la gestion d’entreprise. C’est une exigence éthique pour le prisonnier, libéré de la caverne ombreuse et admis à contempler le Vrai en soi dans le monde Intelligible, de revenir parmi ses anciens compagnons pour les servir en appliquant sa connaissance à la création des valeurs et de la richesse. Il s’agit de partir d’une approche analytique du mythe de la caverne pour redéfinir la mission sociale et éducative du philosophe, désormais invité à former les étudiants à la gestion entrepreneuriale en vue d’aider les universités à mieux lutter contre le chômage.
Mots-clés : Caverne, Crise, Emploi, Entrepreneuriat, Philosophie, Universités, Vrai.
Abstract :
If philosophy is in crisis in the contemporary world, to the point of being taxed as a useless sector which universities should get rid of, it is because it has not yet been exploited in all its dimensions. Beyond its theoretical dimension, widely exploited, it includes an active dimension, which remains almost unexplored. This has its source in the thought of Plato and consists in putting philosophical knowledge into action in the service of the community. Such a service relates to entrepreneurship, whose link with the allegory of the cave in Plato constitutes the subject of the present study. It shows that Plato’s political philosophy is a useful resource for creating and managing a business. It is an ethical requirement for the prisoner, released from the shadowy cave and allowed to contemplate the True in itself in the intelligible world, to return among his former companions to serve them by applying his knowledge to the creation of values and wealth. It is a question of starting from an analytical approach of the myth of the cave to redefine the social and educational mission of the philosopher, now invited to train students in entrepreneurial management in order to help universities to better fight against unemployment.
Keywords : Cave, Crisis, Employment, Entrepreneurship, Philosophy, True, Universities.
Introduction
Les difficultés liées à l’employabilité des étudiants en général, et singulièrement ceux de la philosophie, est l’un des aspects notables de la crise des universités contemporaines. En effet, « une grande majorité de philosophes se retrouve encore contrainte, pour trouver un emploi, de se tourner vers une autre branche que la sienne. Autrement dit, pour ce qui est de leur propre discipline, il y a beaucoup de philosophes au chômage» (M. Mongin, 2007, p. 1). C’est comme si la philosophie était incompatible au marché de l’emploi. Pourtant, il est possible de trouver une âme philosophique au fondement de tous les emplois, étant donné qu’ils reposent sur des principes rationnels justifiant leur existence ainsi que leur finalité (c’est-à-dire le service qu’ils doivent rendre à la société). Cela signifie que tous les emplois ont une dimension philosophique au point qu’ils peuvent être adaptés à la philosophie. Une telle adaptation suppose une philosophie de l’entrepreneuriat qui, au-delà de la description du rapport entre l’entrepreneuriat et la philosophie envisagée par certaines études, interroge la place de l’entrepreneuriat dans la mission du philosophe. En témoigne la position de R. Borchgrave (2006, p. 191) qui considère que la philosophie procure au manager, c’est-à-dire au chef d’entreprise, une sérénité intérieure et une hauteur de vue, de sorte à l’aider « à communiquer, à motiver et à donner du sens au travail collectif ». Il en est de même des auteurs comme Gislain Deslandes et Salvatore Maugeri qui prônent l’importance de la philosophie et de l’éthique dans la mission du manager, en tant que chef d’entreprise.
Au fond, l’idée d’entrepreneuriat, en tant qu’activité d’initiation et de gestion d’unité économique chargée de la production des valeurs, réside dans la philosophie politique dont la mission fondamentale se traduit par l’exigence de service rendu à la communauté. Cette exigence peut se lire dans le mythe de la caverne qui révèle, selon les termes de J. Russ (1999, p. 96), que « le philosophe, qui a dompté les caprices du corps et s’est tourné vers le ciel des essences, va maintenant redescendre dans la caverne et gouverner en philosophe-roi ». Outre la dimension politique de cette gouvernance, il existe une dimension sociale dans la mesure où la cité peut contenir des pauvres dont la misère matérielle demande des réponses au philosophe-roi. Celui-ci est ainsi tenu de transformer sa connaissance en une ressource capable de créer des emplois et de la richesse afin de libérer son peuple de la misère. Dès lors, la question fondamentale qu’on est en droit de se poser s’énonce comme suit : le philosophe peut-il transformer la connaissance acquise dans le monde supérieur en une ressource entrepreneuriale ? En fait, en quoi l’entrepreneuriat est-il une mission du philosophe ? Comment peut-il transformer la connaissance théorique en une source de richesse matérielle ? Cette mission entrepreneuriale du philosophe peut-elle garantir l’employabilité des diplômés de philosophie ?
L’analyse du mythe de la caverne chez Platon permet de supposer que la tâche de gestion de la cité, confiée au philosophe, comporte une dimension sociale qui l’invite à créer et à gérer des entreprises afin de sauver les populations de la misère morale et matérielle. Une telle position philosophique vise à approfondir et à prolonger la pensée politique de Platon en mettant en exergue son implication socio-économique. Il s’agit, plus spécifiquement, de mettre en évidence la nécessité de l’entrepreneuriat dans la mission du philosophe et de montrer que la philosophie de l’entrepreneuriat peut contribuer à l’employabilité des étudiants. Pour atteindre cet objectif, la méthode analytique s’avère nécessaire, car il s’agit de partir de l’allégorie de la caverne dans la perspective platonicienne pour en dégager les implications sur l’entrepreneuriat. Ainsi, de l’analyse de la place de l’entrepreneuriat dans la mission du philosophe, il sera question d’examiner la possibilité de transformer la connaissance en une source de richesse. Cela permettra de discuter de la portée de la philosophie de l’entrepreneuriat sur l’employabilité des étudiants.
1. La place de l’entrepreneuriat dans la mission du philosophe politique
Une mission est une attribution reconnue à un individu ou à une entité pour accomplir une tâche précise afin d’atteindre un but défini. Pour le philosophe politique, voué à la quête de la vérité relative à l’homme et à son rapport avec la société, il est question de servir l’humanité en interrogeant les conditions de réalisation de son bonheur. Ce rôle est éclairé par Socrate, considéré comme le fondateur de la philosophie politique compte tenu de son injonction à centrer le regard du philosophe sur la connaissance de l’homme et de son rapport avec les autres. Dans le mythe de la caverne soumis au principe dialectique, mouvement ascendant et descendant, il décrit la condition humaine, « selon qu’elle est ou qu’elle n’est pas éclairée par l’éducation » (Platon, 2008, 514a). Cette condition est d’abord caractérisée par la misère humaine. À ce niveau, les hommes sont enchainés à l’intérieur d’une caverne et ne voient point la réalité des essences, mais l’ombre des images de la réalité. C’est la copie des copies qui constitue la réalité de ce monde physique. L’un d’eux est détaché et envoyé dans le monde supérieur. Il s’agit du second mouvement de la dialectique, où le prisonnier accède à la vérité, au beau en soi, et donc à la connaissance vraie. Ayant ainsi acquis la connaissance supérieure faisant de lui un philosophe, il doit redescendre sur la terre pour sauver ses anciens compagnons de fortune qui sont restés dans la prison. Cette descente du philosophe dans la foule renvoie à la troisième étape de la dialectique qui suppose une exigence de partage de connaissance. Étant éduqué par la communauté, il a, selon E. Gendron (1985, p. 332), « la responsabilité d’y retourner pour la gouverner ». Cette gouvernance n’est pas une domination, mais une expression de service à la communauté.
Un tel service se subdivise, pour le philosophe, en trois missions fondamentales. Elles sont d’ordre pédagogique, politique et social. La première est la mission éducative. Étant donné que les hommes qui sont dans le monde sensible, celui de la caverne, sont caractérisés par l’ignorance, le philosophe a le devoir de les éduquer, c’est-à-dire de leur annoncer la bonne nouvelle, la vérité. Ce n’est pas une mission facile, car les prisonniers sont bien accoutumés à leur condition de vie, ils y sont si attachés qu’ils la prennent pour la réalité absolue. Ainsi, Platon prévient que le philosophe pourra être objet d’incompréhension et même de raillerie, tant qu’il ne s’est pas encore familiarisé avec la réalité du monde sensible.
Cette mission risquée d’éducation de la foule est accompagnée d’une autre, la mission politique. En fait, la misère humaine est aussi caractérisée par la domination des plus forts sur les plus faibles. Pour sauver le peuple de cette injustice, le recours au philosophe, attaché à la quête du savoir et de la vérité, est nécessaire. Selon Platon (1987, 326b), « les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n’arrive au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement ». Le disciple de Socrate pose ainsi le savoir comme la condition de la gouvernance. À ce titre, affirme M. Kakogianni (2010, p. 13), « seul doit gouverner celui qui sait ». Cette mission de gestion reposant sur le savoir, est accompagnée d’une troisième qui reste quasi-inexplorée : la satisfaction des besoins existentiels de la population.
La misère humaine, qui ne se limite ni à l’ignorance ni à la domination des forts sur les faibles, se traduit également par la pauvreté. Parmi les prisonniers de la caverne, c’est-à-dire les habitants du monde sensible, il existe des riches, mais aussi des pauvres. Ces derniers ont plus besoin de l’amélioration de leur condition sociale que de la contemplation philosophique. Cela requiert des actions concrètes et capables de les aider à travailler et à obtenir des moyens matériels. Au fond, Platon fonde la société sur le besoin, notamment la complémentarité des besoins qui pousse les uns vers les autres. Chacun a besoin des services de l’autre pour se réaliser. Une telle complémentarité renvoie à la justice sociale consistant à mettre chacun à sa place afin de n’accomplir que les tâches relatives à sa compétence. Ainsi, la société se forme par la satisfaction des besoins. Le philosophe doit alors répondre à ces besoins, en créant des entreprises. C’est en ce sens que la philosophie de l’entrepreneuriat devient indispensable à l’accomplissement de la mission du philosophe.
Elle peut se définir comme l’étude des principes et des fondements de la gestion commerciale en vue de transformer la connaissance philosophique en une source de valeur et de richesse. Une telle philosophie comporte une double dimension. Elle est d’abord théorique. En ce sens, elle interroge les fondements, les conditions de réalisation et la finalité de l’entrepreneuriat. Cela répond à une visée éthique consistant à encadrer l’action entrepreneuriale de sorte à maintenir son lien avec le service à la communauté, le fondement philosophique de l’entrepreneuriat. Celui-ci cohabite avec le fondement économique, la recherche du profit. Son caractère pratique et actif s’entrevoit, en outre, dans l’action entrepreneuriale. Le philosophe est tenu de fournir l’exemple de création et de gestion d’entreprise. La réalisation de cet acte répond à une exigence à la fois pédagogique et éthique. Sur le plan pédagogique, il est question de montrer la voie à la population, en leur indiquant comment une entreprise se crée et se gouverne. C’est la pédagogie par action et par exemplarité dont les leçons sont plus faciles à assimiler que toutes les grandes théories. Du point de vue éthique, sa gestion humaniste d’entreprise doit permettre aux autres entrepreneurs de comprendre que l’entrepreneuriat n’est pas seulement un instrument de recherche de profit, mais beaucoup plus une œuvre de don de soi et de service à l’humanité. Créer une entreprise répond à un besoin de la société. Cela requiert la transformation de la connaissance en une source de valeur dont les conditions de réalisation méritent une analyse détaillée.
2. La philosophie de l’entrepreneuriat et la transformation de la connaissance
L’entrepreneur, comme le dit J.-M. Say (1996, p. 348), « est l’intermédiaire entre le savant qui produit la connaissance et l’ouvrier qui l’applique à l’industrie ». Cela signifie que le rôle fondamental de l’entrepreneur est de transformer la connaissance en une source d’action qui s’applique dans les usines et dans les entreprises. Ainsi, selon J.-M. Besnier (2006, p. 82), « le nerf de la production et de la richesse consiste dans l’information, la science, les savoirs, l’imagination ». La philosophie qui préside à cette transformation de la connaissance est la philosophie de l’entrepreneuriat. Il s’agit d’une nouvelle manière de philosopher qui ne se borne plus à l’acquisition du savoir, mais cherche à transformer le savoir acquis. Cela signifie que le savoir n’est pas sa propre finalité, il est un moyen visant une fin. Il se pose comme une matière première dont la simple possession demeure insuffisante, sa finalité résidant dans la production des valeurs et de la richesse. À la suite de Marx qui voulait transformer le monde par la connaissance, cette forme de philosopher vise la transformation de la connaissance elle-même dans le but de libérer le monde de la misère.
Ce caractère transformateur de la connaissance, bien qu’ignoré, est présent dans toute l’histoire de la philosophie. Ses premières traces se trouvent chez Thalès, dont on dit qu’il devint riche grâce à sa connaissance astronomique. À ce titre, Aristote (2015, p. 40)écrit :
Alors que les gens le blâmaient, à cause de sa pauvreté, lui disant que la philosophie n’était d’aucune utilité, on raconte qu’il prévit une abondante récolte d’olives grâce à l’astronomie. Alors qu’on était encore en hiver, il fit bon usage du peu de richesses qu’il avait, en versant des arrhes pour louer tous les pressoirs à huile de Milet et de Chios. Il n’engagea que peu d’argent, dans la mesure où personne ne surenchérit. Le moment opportun arriva où, en même temps, et tout d’un coup, on cherchait de nombreux pressoirs, qu’il sous-loua selon ses propres conditions. En récoltant une grande fortune, il démontra qu’il serait facile aux philosophes de s’enrichir s’ils le voulaient, mais que ce n’est pas ce à quoi ils consacrent leurs efforts.
Thalès, considéré par Aristote comme le premier philosophe, montre ainsi qu’il est capable d’user de sa connaissance pour créer de la richesse. Il considère toutefois que ce n’est pas à ce but que la philosophie est destinée, son objet fondamental étant la connaissance des principes de l’univers. Préoccupé par l’observation des astres en vue de la connaissance de l’univers, Thalès ignore ce qui se passe sous ses pieds au point de tomber dans un puits. C’est pour éviter cette ignorance des choses du monde sensible que Socrate fonde la philosophie politique qui exige une descente du philosophe dans la foule de sorte à contribuer à la réalisation de bonheur de la société. Ce dernier parcourait les rues d’Athènes pour interroger ses concitoyens et leur demander de changer d’habitudes. Il était convaincu que son savoir pouvait aider à la transformation des hommes de la cité d’Athènes.
C’est aussi ce caractère transformateur de la connaissance qui convainc Platon de la possibilité d’une cité idéale dans le monde politique. Ainsi, il tenta à trois reprises de mettre en pratique la cité idéale en Sicile. Bien que ces tentatives se soient soldées par des échecs, le souci de transformer la société par le savoir y est affirmé par le disciple de Socrate. Il peut être considéré comme l’un des initiateurs de l’entrepreneuriat au sens où il fut le premier à formaliser un établissement scientifique nommée l’Académie. Ce fut un établissement autonome d’initiative privée qui traduisait la vision de son inventeur et qui était rigoureusement organisé avec un règlement intérieur et un budget. Il rendait un énorme service à la communauté dans la mesure où il offrait la formation à ses auditeurs autant qu’il produisait de la connaissance. Cet établissement forma de grands experts tels qu’Aristote et Xénocrate qui figurent parmi les bâtisseurs de la civilisation occidentale. C’est également grâce à lui que Platon arrivait à répondre aux sollicitations des gouvernants qui avaient besoin de son expertise pour la rédaction de leurs constitutions. Selon P.-M. Schuhl (1946, p. 50), il envoya « Pyrrha Ménédème, à Élis Phormion, qui y établit une constitution d’un conservatisme modéré » et Aristonymos chez les Arcadiens pour rédiger leur constitution. Ainsi, « de toutes parts on s’adressait à Platon lorsqu’on avait besoin de rédiger une constitution ». Grâce à l’entreprise académique, Platon répondait avec expertise et management aux besoins de la société. Cela traduit la dimension philosophique et sociale de l’entrepreneuriat qui s’exprime dans le service à la communauté.
Mais, sa dimension économique, la recherche du profit, n’était pas une préoccupation pour lui. À la différence de la version moderne de l’entrepreneuriat, l’entreprise académique de Platon ne se souciait pas de la richesse matérielle. Il semblait s’opposer à la marchandisation. À ce titre, Platon (2006, 743d) écrit : « Il ne doit y avoir dans la cité ni or ni argent, ni gains importants procurés par les métiers manuels, le prêt à intérêt ou le proxénétisme. On ne doit gagner d’argent que ce que rapporte l’agriculture ». Cela signifie qu’aucun métier manuel, hormis l’agriculture, ne doit procurer de gain matériel. Ce n’est, en réalité, pas l’idée de commerce qui dérange tant le disciple de Socrate, mais la possibilité de soumettre plusieurs hommes à la servitude d’un seul : l’entrepreneur. Il admet que l’économie, définie par J.-F. Pradeau (2000, p. 25) comme « l’ensemble des propositions relatives à la production, à l’échange et à la propriété des biens », peut être considérée comme une science royale, c’est-à-dire une science du commandement au même titre que la politique. Platon (1969, 81c) l’exprime en ces termes : « Il n’y a pour tout cela qu’une seule science ; maintenant, qu’on l’appelle royale, politique, économique, nous ne disputerons pas sur le mot ». Bien que considérée dans La République comme une activité de classe inférieure, l’économie se trouve dans Le Politique au rang de la science de la gouvernance. Elle rentre, selon les termes de A. Espinas (1914, p. 111), « dans la sphère de l’activité gouvernementale ». Sa dignité politique se voit rétablie, même si Platon reste opposé à toutes les activités axées essentiellement sur la recherche du profit, compte tenu des dangers moraux du commerce, c’est-à-dire du risque d’exploitation des artisans par « un seul propriétaire » (S. S. Meyer, 2002, p. 392).
Cette méfiance de Platon, à l’égard de la recherche du profit et de l’argent, est difficilement défendable de nos jours. En fait, l’argent est désormais nécessaire à tout entreprise humaine, car non seulement il possède la qualité de tout acheter, mais il est également l’objet dont la « possession est la plus éminente » de tous les biens selon K. Marx (1972, p. 107). Au fond, il n’est pas seulement un bien, il est une source de biens, vu sa capacité d’acquérir les autres biens et de transformer le mal en bien. Il peut rendre « blanc le noir, beau le laid, juste l’injuste, noble l’infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche » (W. Shakespeare, 1941, p. 1035). A priori son possesseur est bon, ses défauts pouvant être transformées en des qualités. Ce prestige de l’argent s’explique par le fait que le monde est devenu pleinement marchand au point où seuls les produits soumis à l’échange ont de la valeur. Et cela n’épargne pas le savoir qui, selon les termes de M. Kakogianni (2010, p. 16), « doit être absolument marchandisé ». En réalité, il ne s’agit pas de vendre la connaissance, car vendre un objet, c’est le perdre. C’est, en terme lockéen, la force de travail qui est à vendre et non le savoir. Cette force du travail renvoie ici à l’énergie déployée pour mobiliser la connaissance. Ainsi, le savoir produit des objets matériels ou des prestations de service.
Il est question d’objectiver la connaissance à travers un produit destiné à répondre aux besoins de la société. Cette objectivation de la connaissance dans des produits matériels concerne a priori les spécialistes des sciences de la matière et de la technologie. Ce sont eux qui doivent produire ou trouver des formules permettant la production des matières. Mais, le philosophe y a une double tâche à accomplir. D’un côté, il peut encadrer cette production de la matière à l’aide de l’éthique en la conciliant avec les exigences humaines. Il peut être question d’une éthique de la technologie ou de l’environnement dont le respect est un impératif sociétal pour toutes les unités de production. De l’autre côté, il peut être l’organisateur de ces productions. La chose la plus délicate dans le fonctionnement d’une entreprise, ce n’est pas la connaissance des matières, mais celle des hommes, car ce sont eux qui font fonctionner l’appareil entrepreneurial. C’est pourquoi, A. Swaton et S. Lapied (2013, p. 191) estiment que les entrepreneurs « sont des chefs, susceptibles de mobiliser des hommes et des moyens autour d’un projet ». La réussite d’une telle tâche requiert une bonne connaissance de la nature humaine. Ainsi, le philosophe, voué à la connaissance de l’homme et des conditions de son bonheur, devrait être la personne indiquée pour l’accomplir. S’il est déjà aisé de savoir que le philosophe doit diriger des organisations politiques, cette tâche de gestion peut être mise en œuvre dans une entreprise destinée à la production de la richesse. Il peut utiliser sa connaissance des hommes pour créer des entreprises dans tous les domaines et conduire les hommes qui y travaillent. Cette réorientation de la philosophie vers la création des entreprises pourrait renforcer l’employabilité des diplômés.
3. La philosophie de l’entrepreneuriat et la question de l’employabilité
L’analyse de la capacité de la philosophie de l’entrepreneuriat à garantir l’employabilité des étudiants requiert de préciser que le philosophe est un roi, et non un valet. Platon (2008, 500c) parle du « philosophe-roi », qui mérite la notoriété et le prestige. Ce caractère royal du philosophe est liée à sa connaissance de l’homme et des principes de l’univers qui fait de lui une source de lumière de sorte à éclairer le sentier des autres et de les conduire vers la béatitude. Cette royauté du philosophe le prédispose à la gouvernance qui ne saurait se borner à des tâches techniques d’employé, mais à celles qui consistent à créer et à concevoir les conditions d’un monde meilleur. Une telle science ne saurait se limiter à former des étudiants en vue d’occuper des emplois salariaux et subalternes ; elle forme plus à la gouvernance, ce qui revient à la création et à la gestion d’entreprise. Il est vrai que l’étude philosophique peut conférer de multiples qualités recherchées par les employeurs. Ces qualités sont surtout l’esprit critique et analytique, le sens de la concision, la facilité de rédaction et la capacité d’adaptation aux situations nouvelles ou difficiles. C’est ce qui amène M. Mongin (2007, p. 2) à considérer que « le travail du philosophe correspond aujourd’hui à celui d’un expert consultant qui possède des compétences pointues sur des sujets précis et que les décideurs viennent recruter pour des missions requérant une expertise très technique ». Si cela traduit une certaine importance du rôle social du philosophe ainsi que la nécessité de son intervention dans la résolution des problèmes précis, il est plus indiqué pour lui de s’installer à son propre compte, au regard de son attachement à la liberté et à la gouvernance.
De là, il peut utiliser ses qualités pour créer sa propre entreprise ou pour secourir les autres entreprises qui ont besoin de son expertise. Il doit saisir des opportunités insoupçonnées ou non exploitées et mobiliser des expertises diverses autour de son projet. Cela va nécessiter des moyens matériels qu’il peut être difficile de disposer. Dans ce cas, le philosophe-entrepreneur peut recourir au crédit qui est un canal essentiel de mobilisation de ressources. Il peut, selon A. Swaton et S. Lapied (2013, p. 192), « faire appel aux capitalistes, que Schumpeter range en deux catégories : les propriétaires d’entreprises ayant des capitaux qui ne sont pas mobilisés pour la production courante et les banquiers spécialisés dans le financement ». Le soutien des banques ou des anciennes entreprises s’avère alors très important dans la création d’entreprise. Elles peuvent aider les étudiants de philosophie à s’installer à leur propre compte. Il peut être question de créer des cabinets de consultance, d’éthique, de pédagogie, de rédaction, de formation ou de toute autre forme de société commerciale ou de prestation de service. C’est bien en ce sens que la philosophie pourra atteindre, selon John Dewey, sa vraie nature en traitant les problèmes que rencontrent tous les hommes. Elle doit sortir des limites dogmatiques de la réflexion théorique pour penser les problèmes de la société et les résoudre.
Cela suggère enfin une réforme de l’enseignement de la philosophie dans les universités. C’est le lieu de redéfinir les objectifs de la formation philosophique. Est-ce pour pérenniser la pensée des auteurs passés ou pour servir la société ? Quelle est la responsabilité éthique et sociétale de l’enseignant à l’égard des étudiants qu’il forme ? S’agit-il de former des têtes pleines ou des citoyens-acteurs du développement de leur pays ? En un mot, écrit P. Hiligsmann (2014, p. 21), « devons-nous mettre l’étudiant au centre de nos formations ? ». Ce questionnement suppose la prise en compte de l’intérêt des étudiants. Cela requiert la cessation de l’enseignement des savoirs inopérants et moins utiles à la société. C’est en ce sens que S. Auroux (1993, p. 22) affirme qu’un « apprentissage de la philosophie centré sur l’histoire de cette discipline, enfermé d’abord dans des problèmes formulés avec tous les raffinements techniques produits par une maturation millénaire, n’est pas souhaitable ».
Bien que ce type d’enseignement permette d’instruire les étudiants, il ne s’agit « plus seulement de fabriquer des têtes bien pleines », encore faut-il « qu’elles puissent trouver leur place dans la société en complétant les stocks de ressources humaines des entreprises » (M. Mongin, 2007, p. 6). Il n’est pas non plus question d’une simple sensibilisation à l’entrepreneuriat telle qu’enseignée dans certains départements de philosophie, mais d’un apprentissage à la transformation de la connaissance. Le rôle de l’enseignant, en la matière, est d’aider l’étudiant à transformer sa connaissance philosophique en une ressource capable de créer de la valeur utile à la société. Cela pose l’exigence d’un savoir opérationnel ainsi que la prise en compte de nouvelles questions telles que celles liées à l’urbanisme, à la santé publique, aux fonciers, aux affaires et à bien d’autres questions qui se posent à la société contemporaine. Elle permettra aux diplômés de philosophie de participer pleinement au développement de leur pays et de contribuer à y « rendre la vie agréable » (M. D. Soro, 2010, p. 62). Ce qui revient à dire avec S. Auroux (1993, p. 22) que « la philosophie ne survivra qu’à condition qu’on refuse de séparer la pratique philosophique et l’acquisition du savoir, la réflexion et l’aventure de la vie ». Cette conciliation de la théorie et de la pratique, voire de l’action, permettra de mettre fin à la crise de la philosophie.
Conclusion
Cette étude révèle une dimension insoupçonnée de la philosophie, celle de l’entrepreneuriat, qui traduit la nécessité de transformer la connaissance en une source de valeur, entendue comme l’emploi, la richesse, le bien et la vertu. C’est une exigence éthique qui oblige le philosophe au partage de connaissance et au service de la communauté. Ce service vise à sauver les autres de la misère humaine. Celle-ci doit être affrontée dans tous ses aspects, y compris sa dimension matérielle traduite par la pauvreté. Cette dernière ne peut être combattue que par l’entrepreneuriat, un instrument de création de valeurs et de richesse destiné à répondre aux besoins de la communauté. Le partage de la connaissance relative à un tel instrument ne peut que faciliter la mission sociale du philosophe.
La philosophie de l’entrepreneuriat se pose alors comme un passage obligé pour le philosophe politique. Elle permet l’encadrement éthique des activités commerciales et surtout la réalisation de la vision du philosophe à travers l’entreprise. Celle-ci se pose comme un instrument d’expérimentation des idées philosophiques. Elle adapte ainsi la philosophie aux besoins du marché de l’emploi, en transformant la connaissance philosophique en une source de valeur et de richesse. Une telle adaptation n’est pas une rupture radicale avec la source, mais un retour « à son essence originelle » (K. Harries, 2010, p. 193) dans laquelle réside une exigence de l’action, comme mode de vie philosophique. Il est certain que la valorisation de l’action entrepreneuriale dans la pratique philosophique ne saurait prétendre répondre à toutes les questions théoriques qu’elle suscite, n’étant encore qu’une ébauche de construction d’une nouvelle branche de la philosophie politique et sociale. Mais, elle offre déjà l’espoir de sortir la philosophie de la crise de l’employabilité et de contribuer à la résolution des crises universitaires dans le monde contemporain.
Références bibliographiques
ARISTOTE, Les Politiques, 2015, trad. Pierre Pellegrin, Paris, Garnier Flammarion.
AUROUX Sylvain, 1993, « Formation et Généralité : Le rôle social de la philosophie », in Scepticisme et exégèse. Hommage à Camille Pernot, https://www.persee.fr/doc/cafon_0984-9912_1993_mel_13_1_1002, consulté le 21 février 2022.
BESNIER Jean-Michel, 2006, « Chapitre 4. La connaissance : une source de richesses ? », in Le philosophe et le manager. Penser autrement le management, in https://doi.org/10.3917/dbu.borch.2006.01, De Boeck Supérieur, pp. 81-88.
BORCHGRAVE Rodolphe de, 2006, « Chapitre 12. Philosopher en entreprise ? », in Le philosophe et le manager. Penser autrement le management, https://doi.org/10.3917/dbu.borch.2006.01, De Boeck Supérieur, pp. 191-196.
ESPINAS Alfred, 1914, « L’art économique dans Platon », Revue des Études Grecques, tome 27, fascicule 122. pp. 105-129, in https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1914_num_27_122_6780, consulté le 11 février 2022.
GENDRON Edmond, 1985, « « L’allégorie de la caverne », in République en petit », Théologique et philosophique, Laval, vol. 41, n° 3, p. 329-343.
HARRIES Karsten, 2010, « Le discours de rectorat et le « national-socialisme privé », de Heidegger », in Les Études philosophiques, Presses Universitaires de France, vol. 2, N°93, p. 189-210.
HILIGSMANN Philippe, 2014, « Les Facultés de lettres doivent-elles assurer l’employabilité de leurs diplômés ? ». in La professionnalisation des études universitaires, Liège, Université Catholique de Louvain, consulté le 29 mai 2022 sur http://hdl.handle.net/2078.1/151908.
KAKOGIANNI Maria, 2010, « le savoir-marchandise et les chemins de l’éducation : balade platonicienne », Presses universitaires de Caen, « Le Télémaque », vol. 2 n° 38, p. 11-18.
MARX Karl, 1972, Manuscrits de 1844 (Économie politique et philosophie), trad. Émile Bottigelli, Paris, Éditions sociales.
MEYER Susan Sauvé, 2002, « Les dangers moraux du travail et du commerce dans Les Lois de Platon », Picard, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 2, N°16, p. 387-397.
MONGIN Martin, 2007, « Réflexions sur le métier de philosophe », Le Portique [En ligne], Recherches, http://journals.openedition.org/leportique/1393, consulté le 25 mars 2018.
PLATON, 2008, La République, in Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, Paris, Flammarion.
PLATON, 2006, Les Lois, trad. Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion.
PLATON, 1969, Le Politique, trad. Émile Chambry, Paris, Garnier-Flammarion.
PLATON, 1987, Lettre VII, trad. Luc Brisson, Paris, GF Flammarion.
PRADEAU Jean-François, 2000, « L’économie politique des Lois. Remarques sur l’institution des Κληροι », Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 11, pp. 25-36, in https://www.persee.fr/doc/ccgg_1016-9008_2000_num_11_1_1516, consulté le 19 juin 2021.
RUSS Jacqueline, 1999, Les chemins de la pensée, Paris, Bordas.
SAY Jean-Baptiste, 1996, Cours d’économie politique et autres essais, Paris, GF-Flammarion.
SCHUHL Pierre-Maxime, 1946, « Platon et l’activité politique de l’Académie », Revue des Études Grecques, tome 59-60, fascicule 279- 283. pp. 46-53 https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1946_num_59_279_3082, in consulté le 21 janvier 2019.
SHAKESPEARE Williams, 1941, « La vie de Timon d’Athènes », in Les Tragédies, trad. Pierre Messiaen, Paris, Albin Michel.
SORO Musa David, 2010, Deux philosophes de l’action pratique : Platon et Descartes, Abidjan, Les Éditions Balafons.
SWATON André ; LAPIED Sophie, 2013, « L’entrepreneur schumpétérien est-il surhumain ? », L’Harmattan, « Cahiers d’économie Politique », vol. 2, n° 65, p. 183-202in https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2013-2-page-183.htm, consulté le 12 janvier 2020.
FORMATION ET EMPLOYABILITÉ DES ÉTUDIANTS AFRICAINS, QUELLE APPROCHE PHILOSOPHIQUE ?
Aikpa Benjamin DIOMAND
Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’épaisse inquiétude que soulève l’avenir professionnel des étudiants contraint désormais, les universités africaines à déployer de multiples dispositifs pour les accompagner dans leur insertion professionnelle. Cette nécessaire mutation ne laisse pas indifférente la philosophie qui, en sa qualité de science des crises, peut contribuer à la réflexion sur la question par de nouvelles offres en termes de paradigmes de formation universitaire. L’objectif principal de cette communication est de faire contribuer la philosophie à améliorer le rapport des universités africaines à l’employabilité. À cela, s’ajoutent deux objectifs spécifiques. Le premier est de repenser le système de formation de l’université en Afrique. Le second est de faciliter l’intégration des étudiants au marché du travail et à la production de la richesse.
Mots clés : Crise universitaire, Employabilité, Étudiants, Formation, Philosophie.
Abstract:
The deep concern raised by the professional future of students now forces African universities to deploy multiple measures to support them in their professional integration. This necessary mutation does not leave philosophy indifferent which, in its capacity as a science of crises, can to contribute to reflection on the question through new offers in terms of university traning paradigms. The main objective of this communication is to make philosophy contribute to improving the relationship of African universities to employability. In addition, there are two specific objectives. The first is to rethink the university training system in Africa. The second is to facilitate the integration of students into the labor market and the production of wealth.
Keywords : Employability, Philosophy, Students, Training, University crisis.
Introduction
La recherche d’adéquation entre formation et employabilité est de nos jours, un des axes clés de la stratégie de lutte contre les crises répétitives des universités africaines. Selon le Centre africain pour la transformation économique, basé à Accra, près de 50% des diplômés universitaires ne trouvent pas d’emploi en raison de l’inadéquation entre leur formation et le monde du travail. (Raphaël Obonyo, 2019). Dès lors, repenser le contenu des enseignements et le rôle de la recherche universitaire dans le sens de l’employabilité des étudiants, est devenu un impératif catégorique opposable aux universités du continent qui, du reste, sont aussi à l’écoute des reformes universitaires dans le monde, notamment dans l’espace européen, telles qu’annoncées par le processus de Bologne. Ce processus qui se décline en trois déclarations principales (déclaration de Lisbonne, déclaration de la Sorbonne et enfin déclaration de Bologne), a inscrit le couple formation-employabilité au cœur de son dispositif de réforme de l’enseignement supérieur. Cette nécessaire mutation ne laisse pas indifférente la philosophie qui, en tant que science des crises, s’invite au débat sur la formation et l’employabilité des étudiants pour contribuer à réinventer les universités africaines. D’où le titre de notre communication : Formation et employabilité des étudiants, quelle approche philosophique ? L’objectif général de cette communication est de faire contribuer la philosophie à la résolution des crises universitaires récurrentes en Afrique, à cela s’ajoutent deux objectifs spécifiques : le premier est de repenser la formation en termes de nouvelles philosophies de la pédagogie universitaire et de l’orientation des étudiants ; le second est la facilitation des étudiants à l’intégration au marché du travail et à la production de richesses. Ces objectifs se tiennent dans cette interrogation : comment réinventer, d’un point de vue philosophique, l’université en Afrique pour, à la fois, faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et rompre avec les crises répétitives ? Les méthodes analytique et critique nous aideront à répondre à cette problématique autour de trois axes essentiels.
Le premier est une analyse des concepts de formation et d’employabilité, et le deuxième se résume à questionnement de l’économie et du marché du travail africains comme préalable à une meilleure réflexion sur le rapport entre formation et employabilité des étudiants, et le troisième est l’occasion de dresser le rapport entre formation et employabilité en réinventant une la philosophie de la pédagogie et de l’orientation.
1. Analyse des concepts de formation et d’employabilité
Une analyse conceptuelle de la formation et de l’employabilité est nécessaire pour mener à bien la réflexion sur la formation et l’employabilité. C’est à cette tâche que nous nous consacrons dans la première partie de notre travail. Il s’agit alors, d’examiner les concepts de formation et d’employabilité.
1.1. Le concept de formation
Le concept de « formation » désigne, à la fois, « le processus naturel ou culturel par lequel les choses prennent formes, ainsi que les résultats de ce processus ». (M. Fabre, 1992, p. 120). Le concept de formation est une notion transversale. À cet égard, on peut la retrouver, en théologie, en biologie, en géologie, en science de l’éducation, notamment en pédagogie, etc. Le caractère transversal de la notion en fait une notion polysémique. Ainsi, en théologie, le mot « formation » désigne le processus entraînant l’apparition de quelque chose qui n’existait pas auparavant. Il renvoie alors à l’action de créer, de donner l’être et la forme à quelqu’un ou à quelque chose. Ce verset de la Bible : « L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre » (Genèse 2v7a) traduit bien cette définition. En biologie, le concept signifie développement et modification de l’organisme qui rend l’individu ou la chose capable d’exercer des fonctions reproductives. En géologie, le terme formation renvoie à un ensemble de couches ou portions de terrains ou de substances minérales présentant des caractères géologiques et paléontologiques semblables qui paraissent dater de la même époque. Enfin en pédagogie, le concept de formation désigne, entre autres, le cursus, la qualification et le processus. De ce point de vue, la formation est un ensemble d’actions, de méthodes et de techniques dont la finalité est de faciliter la transmission des connaissances, des compétences, l’apprentissage de savoir-faire, le développement personnel et l’évolution des comportements en lien avec le monde du travail. La formation, sous le registre pédagogique, présente aussi plusieurs visages : la formation professionnelle qui est un programme bien planifié visant à développer des compétences et des connaissances spécifiques à l’exercice d’un emploi, d’une carrière professionnelle bien déterminée ; la formation générale (culture générale, langue, discipline intellectuelle spécifique, notamment les mathématiques, la philosophie, la sociologie, le droit, l’économie, l’histoire, la géographie), et, enfin, la formation technique.
La formation, à première vue, se distingue de l’éducation qui est un système d’apprentissage visant à transmettre aux apprenants des connaissances sur les valeurs, les faits, les évènements, les croyances, les institutions, les principes et les concepts généraux. En ce sens, force est de savoir que l’éducation aide à développer les compétences fondamentales (acquisition de la lecture, l’écriture et du calcul), les facultés morales, le sens du raisonnement, du jugement et de la compréhension du monde. Cependant, cette distinction n’est pas étanche, en ce sens qu’il ne peut y avoir de formation sans éducation à la base. De ce fait, l’éducation, peut être considérée dans une certaine mesure, comme la matrice de la formation tandis que celle-ci peut être analysée comme le processus de transformation des compétences de l’éducation en compétences professionnelles. La formation, en effet, transforme les compétences acquises de l’éducation en savoir-faire et en compétences professionnelles. A l’image des systèmes industriels qui transforment les produits d’autres industries en produits finis pour le marché de consommation, la formation transforme les produits de l’éducation en produits finis pour le marché du travail.
Dans la perspective du développement de l’économie africaine et du marché de l’emploi en faveur des étudiants du continent, la formation reste un outil essentiel de création de richesse et d’insertion professionnelle, car elle a vocation non seulement de permettre aux personnes formées de faire face à l’évolution rapide de l’économie, du marché du travail, des pratiques professionnelles et des nouveaux besoins des entreprises mais aussi et surtout d’anticiper les changements dans le sens d’offrir des outils cognitifs et pratiques pour une meilleure réactivité des personnes formées. C’est pourquoi, de nos jours, la notion de formation est de plus en plus mise en lien avec la notion d’employabilité.
1.2. La notion d’employabilité
L’analyse de l’évolution du marché du travail et des politiques de formation a bénéficié du concept d’employabilité développé dans les années 90. Face à la montée du chômage, beaucoup de questions ont émergé concernant les capacités des individus à répondre aux sollicitations de l’entreprise et/ou du marché ; et ce compte tenu de ce que le système éducatif peut leur apporter en amont. En 2001, les Nation-Unis ont intégré la problématique de l’employabilité parmi les priorités en faveur de l’emploi des jeunes au même titre que l’entrepreneuriat, la question du genre et la création d’emploi (C. Ratsimbazafy, 2015, p. 2).
Mais que désigne ce concept d’employabilité ? L’employabilité peut s’analyser sous deux angles : le premier est celui de l’employeur et le second, celui du demandeur d’emploi. Du point de vue de l’employeur, l’employabilité désigne « la capacité à disposer de personnes capables d’assumer le travail dans les normes attendues » (C. Ratsimbazafy, 2015, p. 2). Dans la perspective du demandeur d’emploi, l’employabilité traduit le fait qu’une personne puisse se réaliser en transformant ses compétences en emploi. Pour le dire autrement, l’employabilité définit la capacité d’une personne à faire coïncider ses qualités et ses compétences acquises à l’issue de sa formation, avec les besoins évolutifs du marché du travail de sorte à se réaliser en transformant ses compétences en emploi. « L’employabilité caractérise, dès lors, la capacité d’un individu à occuper un emploi qui conjugue les circonstances personnelles avec les offres du marché. Cela signifie que l’individu peut gérer sa situation sur le marché du travail en exploitant son potentiel dans un emploi durable. » (C. Ratsimbazafy, 2015, p. 2).
L’employabilité a donc partie liée avec l’évolution structurelle du marché de l’emploi. De ce fait, la construction d’une meilleure employabilité exige qu’on observe la structure et l’évolution du système de production. Donc l’articulation de la formation et de l’employabilité impose, non seulement la connaissance de l’ordre économique en vigueur et son évolution, mais aussi et surtout l’évolution du marché du travail en tant qu’il constitue le miroir des besoins en travail de la société. D’où, il convient de faire du questionnement de l’économie et du marché du travail africains comme préalable à une meilleure réflexion sur le rapport entre formation et employabilité des étudiants en Afrique. C’est à cette tâche que nous nous employons à montrer dans la deuxième partie de de notre travail.
2. Questionnement de l’économie et du marché du travail africains comme préalable à une meilleure réflexion sur le rapport entre formation et employabilité des étudiants en Afrique
On ne peut penser le couple formation-employabilité notamment, en Afrique, sans interroger l’univers économique et le marché de l’emploi. Mais, questionner l’économie et le marché du travail africains pose avant tout, l’exigence d’une enquête sur le processus de leur naissance. Freud, dans ses travaux sur l’étude de la personnalité, nous a appris que « l’enfant est le père de l’adulte ». De même, les conditions de naissance des institutions influencent l’esprit, l’organisation et le fonctionnement desdites institutions. Ce parallèle, entre la personnalité et les institutions, nous conduit à faire de l’enquête sur l’extrait de naissance de l’économie et du marché du travail africains, une condition nécessaire à une meilleure réflexion sur le rapport entre formation et employabilité des étudiants en Afrique.
2.1. Enquête sur l’acte de naissance de l’économie moderne et du marché du travail africains
Les économies et le marché du travail africains sont des legs de la colonisation. Dès lors, penser l’extrait de naissance de ces économies et le marché du travail subséquent, passe nécessairement par la médiation de l’histoire économique et sociale de la colonisation. Dans ce cas, il nous paraît nécessaire, dans une perspective philosophique, d’interroger cette histoire, à l’instar du psychanalyste qui questionne le passé des individus pour mieux cerner leur personnalité. Interroger l’histoire, c’est questionner des chercheurs-auteurs spécialistes de l’histoire sociale africaine. Ainsi, chez A. Lux, nous découvrons l’inexistence d’un marché du travail avant l’implantation des colons européens.
En effet, Lux démontre que l’organisation sociale du travail en Afrique noire précoloniale, repose sur l’identité entre les producteurs et les moyens de production que sont les terres et les outils. De ce fait, les décisions d’emploi ne se font pas dans le cadre d’un marché, c’est-à-dire le marché du travail, parce que la nécessité d’aliéner sa force de travail est absente en raison des facteurs économiques et sociologiques. Il a fallu alors attendre l’arrivée des européens pour qu’on assiste au « développement du salariat » par des « procédés de détribalisation forcés ». (A. Lux, 1962, p. 365)
J.-N. Loukou (2007, p. 22) fait observer dans son livre Côte d’Ivoire : Les résistances à la conquête coloniale que les traits généraux de l’économie précoloniale sont marqués par « deux modes de production dominants : le mode de production lignager et le mode de production esclavagiste. ». Dans le cadre du mode de production lignager, l’unité économique élémentaire est le lignage, centre de production et de consommation ; et la production est essentiellement destinée à l’autosubsistance. La tenure du sol n’est point aliénable. Chaque lignage reçoit, en effet, de la communauté villageoise les terres de culture nécessaires à sa subsistance (J.-N. Loukou, 2007, p. 22-23).
Tout le système de production s’organise autour de la parenté. Les membres des lignages dans le cadre des réseaux de parenté, par principe de solidarité, s’entraident pour mettre en valeur les portions de terre des uns et des autres. Le mode de production lignager exclut ainsi toute idée de salariat et par voie de conséquence, de marché du travail. Dans un tel contexte, il est quasi-impossible d’assister à une asymétrie entre l’offre et la demande du travail. Tous les jeunes que la société forme trouvent aisément leur place dans le procès de production. Il en résulte que la notion de chômage est totalement absente dans cette forme d’organisation sociale.
Selon J.-N. Loukou (2007, p. 23), « dans le mode de production esclavagiste, l’esclave est le moyen essentiel de production ». En effet, contrairement au mode de production lignager où tous les bras valides de la société sont directement impliqués dans le procès de production, dans le mode de production esclavagiste, une classe de personnes privées de liberté, est chargée de la production économique. Elle forme ainsi le pivot de la structure économique de la société. Il est bien clair que dans un tel contexte, la référence au marché du travail n’existe pas. Sur ce point, le mode de production esclavagiste ne diffère pas du mode de production lignager. On peut certes supposer l’existence d’un marché d’esclaves dans ce mode de production esclavagiste, mais force est de reconnaitre que celui-ci diffère du marché du travail. Cela, en raison du fait que l’esclave qui est la marchandise mise en vente sur le marché d’esclaves, une fois acheté ne s’appartient plus et le produit de son travail ne lui appartient pas non plus. Il est corvéable à souhait sans aucune rémunération parce qu’il n’est pas lié à son maître par un contrat de travail. Il est plutôt lié par un rapport de maître et d’esclave. Il ne peut rompre ce rapport quand il veut. Sa personne et tout le produit de son travail appartiennent à son maître tandis que sur le marché du travail, le travailleur ne se vend pas, mais plutôt sa force de travail contre un salaire. Il peut quand il le veut, rompre le contrat de vente de sa force de travail.
Au regard de ce qui précède, nous retenons que le procès de production des sociétés de l’Afrique noire précoloniale ne fait pas appel au salariat. Cette relation économique et sociale entre un travailleur et un employeur où le travailleur vend sa force de travail dans le cadre d’un contrat formel ou informel, en échange d’un salaire qui garantit que les produits du travail réalisé par l’employé demeurent la propriété de l’employeur. Cela induit l’absence du marché du travail et des contradictions subséquentes, notamment, la surpopulation de la force de travail produite par l’asymétrie fréquente en économie capitaliste, entre l’offre et la demande du travail désignée par le concept de chômage.
C’est dans ce contexte économique et social que l’Afrique noire entre en contact avec le mode de production capitaliste par le biais des Européens. Ceux-ci, en quête de nouveaux marchés pour leurs industries en crise, ouvrent les chantiers de sa colonisation. L’absence systémique du salariat dans les différentes régions du continent africain y rend difficile la reproduction du mode de production capitaliste caractéristique des sociétés européennes. Andrée Lux (1962, p. 365), le souligne éloquemment en ces termes : « Le gros problème (avant la deuxième moitié du XXIe siècle) qui a dominé l’histoire économique de ces régions, a été de trouver de la main d’œuvre pour exploiter les richesses naturelles ; main d’œuvre caractérisée par sa rareté et le manque d’adaptation typique des sociétés traditionnelles. »
Nous observons dans ces propos et en filigrane, la théorie de Marx sur les conditions de naissance du salariat et du mode de production capitaliste sur un territoire donné. En fait, il développe l’idée selon laquelle« quand le travailleur peut accumuler pour lui-même, et il le peut tant qu’il reste propriétaire de ses moyens de production, l’accumulation et la production capitalistes sont impossibles »(K. Marx, 1963, p. 1227) L’accumulation et la production capitalistes, en fait, exigent que le travailleur, ce « propriétaire de la force de travail, non seulement doit être libre de la vendre mais doit être aussi dans la nécessité de le faire. Ce qui suppose qu’il ne soit pas possesseur des moyens de la mettre en œuvre pour son propre compte. » (H. Nadel, 1994, p. 129).
Les colons vont procéder à la mise en place des conditions de formation du salariat en Afrique. Ils inaugurent ainsi les « phases successives de la formation d’un marché du travail de quelques pays africains » (A. Lux, 1962, p. 364). Ces phases successives sont les corvées « travail forcé », les expropriations des terres en vue de créer un prolétariat et l’impôt de capitation et l’urbanisation progressive. Les emplois disponibles sont premièrement dans les exploitations agricoles, minières, les travaux publics (création de chemins de fer et de routes), la sécurité, ensuite dans les services sociaux de base (santé et éducation), dans l’administration coloniale et, un peu plus tard, dans les petites unités industrielles de substitution. Sous la pression et l’impulsion de l’Etat colonial, l’espace et l’organisation économique et sociale africains se modifient ainsi en profondeur. L’on assiste à l’émergence d’une nouvelle architecture économique et sociale en Afrique qui opère le « retrait de l’Africanité » entendu ici comme « l’abandon de la rationalité ethno-tribale » et la dépossession «de son pouvoir d’autoproduction et donc de sa nature initiale » (Z. Biaka, 2002, p. 109).
2.2. L’état des lieux de l’ordre économique et social en Afrique
Les États-nations africains héritent de l’architecture économique et sociale coloniale lors de l’accession des peuples africains à l’indépendance. Nés des entrailles des États coloniaux, les États-nations africains vont se construire à partir des structures économiques et sociales de ces derniers. On constate de ce fait, une décolonisation conservatrice qui reprend à son propre compte, mais dans une version approfondie, la philosophie économique et sociale du colonisateur avec l’expertise de celui-ci. Dans les sillages de l’État colonial, les États-nations africains font le choix du mode de production étatique. L’État postcolonial est de ce fait, un État à la fois entrepreneur et employeur. Il est de loin le plus gros employeur dans le cadre de l’emploi formel, faute de capitalistes nationaux.
En effet, né dans le contexte des Trente Glorieuses caractérisées dans le domaine financier, par un flux massif de capitaux prêtables à souhait et au niveau de la théorie politique par l’État providence soutenu par un essor économique dû à la forte demande liée à la reconstruction de l’Europe de l’après-guerre, l’État post-colonial procède à un recrutement massif de personnel administratif, enseignant, médical, militaire et para-militaire pour s’affirmer comme État dans le concert des Nations. Il s’ensuit que les diplômés des universités à « l’égard desquels les autorités publiques avaient une espèce de « devoir d’embauche »(B. Contamin, Y.-A. Faure, 1992, p. 310), n’éprouvaient aucune difficulté à trouver un emploi. Mais l’État post-colonial ne tardera pas à montrer des signes d’essoufflement. Pour le dire autrement, après avoir déployé des capacités d’absorption des diplômés, notamment ceux des universités, il marque un épuisement certain face à l’explosion de la population estudiantine. Quelques raisons expliquent cet essoufflement.
La première raison est que l’État-postcolonial est un État extraverti, extrêmement dépendant et inscrit fondamentalement dans un cadre de développement minima, en ce sens que toutes ses politiques économiques et sociales sont taillées sur mesure et sont sous influences permanentes des puissances colonisatrices par le biais des réseaux institutionnels internationaux. Cette approche de l’État post-colonial est décrite par B. Contamin et Y.-A. Faure (1992, p. 305) dans leurs travaux en ces termes : « Dans la perspective marxiste, l’État apparaît avant tout comme un vassal du capitalisme international et son action conduit à accentuer la dépendance extérieure et à renforcer les blocages d’un véritable développement. ». On découvre donc que l’État post-colonial s’enlise dans l’inefficacité face aux questions sociales, notamment celles liées la crise de l’emploi des diplômés des universités africaines.
La deuxième raison c’est le surendettement provoqué par une offre particulièrement abondante de capitaux sur le marché international pendant les Trente Glorieuses. Ainsi, « l’abondance des liquidités internationales en quête d’utilisation a donné naissance à un puissant effet d’offre. Les États considérés alors comme nécessairement solvables, ont fait l’objet de démarchages systématiques »(B. Contamin, Y.-A. Faure, 1992, p. 319). Il en résulte que les États africains se sont inscrits massivement dans une politique d’endettement peu ou mal contrôlée. Finalement, ce qui semblait être une opportunité pour amorcer leur développement, est devenu un piège sans fin pour eux. Cela se voit au travers un train de mesures de redressement initié par les bailleurs de fonds en vue du recouvrement de leurs créances. Tout cela porte à croire que l’endettement des États africains a été planifié pour recoloniser l’Afrique. Comme le note bien J. Ki-Zerbo (2013, p. 37), « la dette est structurellement comprise dans le pacte colonial où les uns ont toute la valeur ajoutée des produits et les autres n’en ont presque rien. La dette est le fils naturel de ce type de structure et, pire encore, de ce genre de système. ».
La troisième raison, concerne l’absence de capitalistes nationaux capables de partager valablement avec l’État, les charges de création d’emplois. Contrairement aux pays développés où le secteur privé joue un rôle économique de premier plan, et contribue de façon significative, à la dynamique du marché de l’emploi, on constate une grande faiblesse de ce secteur en Afrique à cause du manque de capitalistes nationaux. Cela est dû au déficit de la culture entrepreneuriale dans de nombreux pays africains notamment, dans les pays francophones où l’on a conféré à l’État un rôle très prépondérant dans les secteurs de la production. De ce fait, cette faiblesse a conduit à attribuer à la puissance publique, le quasi-monopole de la responsabilité de la création des emplois. Cela a eu pour conséquence, en raison de la massification croissante des diplômés des universités africaines, un étouffement inévitable des capacités d’absorption de l’État post-colonial. Ainsi a-t-il fini par sombrer dans les contradictions structurelles de son modèle de développement.
À tous ces facteurs, s’ajoutent, aujourd’hui, la volatilité de la finance et de l’économie mondiales produite par la mondialisation. Or ladite volatilité est une menace ouverte contre les économies des pays africains en construction, sans compter les crises sécuritaires liées au djihadisme qui sapent leur stabilité politique et sociale.
L’état des lieux de l’ordre économique et social en Afrique met à nu un État- employeur essoufflé et marqué par de graves contradictions sociales, notamment le chômage massif des diplômés. Ce qui vient d’être dit augure de la difficile tâche des universités à relever le défi de la symétrie entre formation et emploi. Cependant, une aventure peut être tentée à partir de la réinvention de la pédagogie et de la politique d’orientation.
3. Réussir le rapport entre formation et employabilité par la réinvention de la pédagogie et de la politique d’orientation
3.1. Réinvention de la pédagogie
Le propre des institutions universitaires est le progrès et la diffusion des connaissance. Le rôle classique dévolu aux universités est le développement de la recherche scientifique en vue du progrès et de l’expansion de la science. Mais ces traits ne suffisent plus à caractériser les universités, car ces dernières doivent fonctionner en convergence très affirmée avec l‘univers économique et le monde du travail, d’où la nécessité de faire le lien entre les cours dispensés et ce monde du travail ; d’où ce lien doit être mentionné dans les Syllabus, de manière à aider l’étudiant à transformer ses compétences acquises en emploi.
Le Syllabus, appelé aussi plan de cours, est un exercice d’écriture qui précède tout acte pédagogique. Il constitue un moyen de communication, un outil de planification et une carte cognitive servant de guide à la fois à l’enseignant lui-même et aux étudiants. De façon générale, le Syllabus comprend, structurellement, des rubriques de base que sont l’information de base, l’information concernant l’enseignant, la description du cours, les objectifs d’apprentissage, le programme et le calendrier du déroulé du cours ainsi que le matériel de cours. Pour le dire autrement, le syllabus comprend habituellement, le code du cours, le nom du module, le volume horaire, le nom du chargé du cours, le titre du cours, le résumé, les prérequis, les compétences à développer, le plan détaillé avec le nombre de séances, le matériel du cours, la bibliographie et la webographie.
Mais, dans un contexte où la professionnalisation articulée au concept d’employabilité, est un des thèmes majeurs de la rhétorique des réformes des universités, il nous semble qu’il y a un chainon manquant dans la structuration des syllabus observée chez la plupart des enseignants-chercheurs. Ce chainon manquant, c’est bien le nécessaire lien entre le cours proposé et l’univers économique et le marché du travail. Un tel lien présenterait un double avantage : le premier avantage est de susciter un intérêt chez les étudiants. Et le second, est de leur permettre de mieux s’orienter sur le marché du travail en transformant les compétences acquises en emploi. La nouvelle pédagogie dont la finalité est d’accroître le niveau d’employabilité des étudiants, juge donc nécessaire de préciser dans le Syllabus, la place du cours à dispenser dans l’économie et sur le marché du travail. De ce fait, l’étudiant pourra établir un lien entre le cours dispensé et son environnement social, économique et le monde du travail de manière à transformer ses compétences acquises en emploi.
Cette exigence va, nécessairement conduire les enseignants-chercheurs à prendre davantage conscience du fait que l’université n’est pas un empire. Cela les inclinera à travailler dans un empire et à travailler en tenant compte de l’univers socio-économique et du monde du travail dans la perspective de l’insertion socio-professionnelle des étudiants. À cet égard, les universités africaines doivent élargir leur vision de l’univers économique et du marché de l’emploi en prenant en compte, le procès de dénationalisation des marchés (marchés des capitaux, des biens et des services et des marchés du travail) ouvert par la mondialisation qui marque un tournant nouveau des relations internationales et de la perception que les individus ont du monde en général et du monde du travail en particulier. Favorisée par la multiplication des contacts, la libéralisation et l’accélération des échanges, la mondialisation tend à considérer la terre entière comme « un seul et même marché » (P. M. DÉFARGES, 1997, p. 124) et une maison commune. Il en résulte des « migrations multidirectionnelles »(P. M. DÉFARGES, 1997 ; p. 28) qui se lancent à la conquête « des emplois, des salaires offerts ailleurs. » (P. M. DÉFARGES, 1997, p. 29). La proximité et l’imbrication des espaces créées par la mondialisation entraînent un déracinent croissant des individus qui ne considèrent plus sacrés leurs liens avec leurs pays d’origine et pour qui « le premier des droits semble de plus en plus être celui-ci de pouvoir chercher à s’épanouir là où l’herbe est censée être la plus verte. » (P. M. DÉFARGES, 1997, p. 29).
Pour cette raison, les formations universitaires africaines doivent s’ouvrir aussi aux besoins du marché du travail des pays développés dont les populations sont vieillissantes et même des pays émergents. En effet, l’exportation de la force de travail est une des modalités caractéristiques de la mondialisation en tant que système de libre mobilité des capitaux, des biens et des personnes dans le monde. Comme telle, elle entraîne des exigences dans la formation des compétences qui ne doit plus s’enfermer dans la seule référence au marché national. En conséquence, les universités, en accord avec les ministères des affaires étrangères, doivent étudier l’évolution des populations actives des pays dits développés et les besoins en travail de leurs économies ainsi que l’évolution de leurs marchés de travail. Dès là, les universités et les ministères pourront dégager des stratégies de pénétration desdits marchés par les jeunes diplômés. Les universités africaines devront, à cet égard œuvrer à adapter leurs dispositifs pédagogiques à savoir les maquettes, dans le sens de favoriser l’acquisition de compétences (compétences scientifique, technologique, linguistique et culturelle). Une fois acquises, lesdites compétences faciliteront leur accès à ces marchés du travail où les ressources humaines nationales, en raison du vieillissement de leur population active, sont déficitaires. Ces adaptations pédagogiques devront se faire en étroite coopération avec les institutions universitaires desdits pays. Il leur appartient dans ce sens, de garantir la crédibilité des diplômés africains sur le sol de ces pays. Dans un monde mondialisé où les pays développés et émergents travaillent sans relâche à la consolidation de leurs stratégies d’extension des profits à tirer de la mondialisation, les universités africaines doivent être des institutions stratégiques. L’étant, elles doivent permettre à l’Afrique de tirer le meilleur profit de la dénationalisation des marchés du travail favorisée par la mondialisation. À ce niveau, on veillera à la maîtrise de la taille de la population estudiantine à former.
Par ailleurs, il est aussi nécessaire d’inscrire la formation universitaire dans la flexibilité avec la pratique du concept de double diplôme. Le double diplôme (double licence, double master) comme son nom l’indique, est un cursus double qui permet à un étudiant de suivre une formation dans un domaine qui n’est pas initialement le sien, de préparer deux diplômes et d’acquérir des compétences, par exemple, un au sein d’une école de commerce et un autre au sein d’une université partenaire, ou encore d’une école d’ingénieur. De la sorte, au cours d’une année, l’étudiant pourra prétendre à deux diplômes et à deux compétences. Ce paradigme de formation a ainsi l’avantage, en termes marxiens, de favoriser « le plus grand développement possible des diverses aptitudes »(K. Marx, 1963, p. 992) de l’étudiant. La révolution permanente qui sous-tend le développement de la techno-économie moderne l’exige en ce sens qu’elle nécessite « la fluidité des fonctions » (K. Marx, 1963, p. 992) du travailleur moderne.
Par ailleurs, l’enseignement universitaire doit s’orienter vers la pédagogie coopérative qui peut avoir un impact certain sur l’employabilité des étudiants. La pédagogie coopérative en effet, a partie liée avec la notion de coopération qui est tirée du terme latin cooperatio. « Formé du préfixe latin cum (avec), et du verbe operari (travailler), le mot coopération signifie littéralement « faire œuvre commune ». Le substantif opus, dont le pluriel donne opera, désigne diversement l’œuvre, l’ouvrage, l’acte. Au sens large, la coopération exprime donc la part prise à une œuvre faite en commun. » (N. Go, 2015, p. 2). De ce fait, elle « se caractérise par la double volonté de faire œuvre commune sans aucune sorte d’exclusion, et de faire ainsi du commun en œuvre ». (N. Go, 2015, p.) Cette œuvre commune résulte « d’une transformation des rapports de production des savoirs » (N. Go, 2015, p.) Dans cette perspective, la pédagogie coopérative « se caractérise par des liens horizontaux entre pairs, par une proximité dans la nature et l’ampleur des tâches à résoudre, par la prise en compte d’apprentissages transversaux et la co-construction. » (D. Morin, et al, p. 1). Elle favorise ainsi l’échange des idées, le partage du pouvoir et de la responsabilité dans la construction des savoirs. J. Rancière (2005, p. 106), le souligne bien quand il écrit : « La chose a de quoi susciter de la peur, donc de la haine, chez ceux qui sont habitués à exercer le magistère de la pensée. Mais chez ceux qui savent partager avec n’importe qui le pouvoir égal de l’intelligence, elle peut susciter à l’inverse du courage, donc de la joie. »
En outre, la pédagogie coopérative est un moyen de développer la créativité chez les étudiants. Dans la mesure où elle les met à grande contribution tous les apprenants dans la recherche et la construction des savoirs, elle développe leur imagination créatrice, leurs capacités à identifier les problèmes et à leur trouver des solutions innovantes. Cette démarche entraîne aussi l’amélioration de l’estime de soi, comme l’affirment ABRAMI et al (1996, p. 13) : « des recherches récentes ont démontré les effets positifs que l’apprentissage coopératif a sur le rendement scolaire, le développement des habilités sociales, l’attitude vis-à-vis de l’apprentissage et des pairs, l’état affectif et l’image de soi. »
Dans le champ professionnel, l’esprit de créativité et l’estime de soi que développe la pédagogie coopérative augmentent l’employabilité des étudiants. La créativité doublée de l’estime de soi, permet non seulement de trouver plus rapidement et efficacement des pistes de résolution aux problèmes qui surgissent dans les entreprises, mais aussi et surtout, d’ouvrir de nouveaux horizons à celles-ci en termes de grandes innovations capables d’élever leur niveau de compétitivité. Marx et Engels dans leur étude de la société bourgeoise ont révélé qu’elle se caractérise par la concurrence très féroce entre acteurs économiques et sociaux et l’exigence de « révolution » continue des « des instruments de production » pour le relever le défi de la compétitivité. (K. Marx et F. Engels, 1963, p. 164).
Pour rester compétitives, les entreprises tablent sur des ressources humaines plus créatives et inventives. Ainsi, les étudiants qui font preuve de créativité et d’inventivité ont le vent en poupe dans le recrutement des entreprises. La pédagogie coopérative, de ce point de vue, doit intégrer davantage nos pratiques pédagogiques universitaires. Mais à cela devra s’ajouter une réinvention de la philosophie d’orientation scolaire et professionnelle.
3.2. Réinvention de la philosophie d’orientation scolaire et professionnelle
L’orientation scolaire et professionnelle est un service qui consiste à orienter un élève ou un étudiant dans les différentes filières. Dans ces dernières ce dernier pourrait s’insérer en conformité avec ses parcours scolaire antérieur, de ses intérêts et de sa personnalité grâce aux tests psychométriques et projectifs ainsi que des questionnaires d’intérêts. L’orientation vise le mieux-être personnel et professionnel en mobilisant le potentiel des personnes en les aidant à prendre leur place dans l’organisation sociale et économique. Une bonne orientation est le premier facteur de réussite et d’insertion professionnelle des étudiants. L’orientation précède la formation et conditionne son succès et sa transformation en emploi. Le processus d’orientation des bacheliers doit alors faire l’objet de réflexions sans cesse renouvelées. Cela permet de peaufiner les outils d’orientation des étudiants et de favoriser leur insertion socio-professionnelle. Or à l’état actuel des processus d’orientation des bacheliers, l’on note l’opacité et les incohérences des plates-formes d’orientation scolaire et professionnelle.
Même s’il existe des logiciels d’aide à l’orientation qui aident les étudiants aux choix raisonnés et objectifs des filières, force est de constater que la politique de l’orientation post-secondaire en Afrique est encore à la traîne. Elle se déploie autour des mécanismes d’orientation quasi-autoritaires et closes des commissions nationales d’orientation qui n’ont pas la possibilité d’interagir convenablement avec les bacheliers. Ce qui constitue une grave menace pour l’employabilité des diplômés des universités africaines.
Du reste, la présente réflexion donne de repenser les politiques africaines d’orientation par une nouvelle philosophie d’orientation. Cette nouvelle philosophie d’orientation, loin de rejeter les avancées des recherches psychométriques en matière d’orientation, part du présupposé philosophique de Platon que chaque âme, avant de se réincarner, a choisi librement son destin. Dans le mythe d’Er tiré du livre X de la République, Platon évoque un homme, Er, fils d’Arménios, originaire de Pamphylie. Il meurt au combat mais revient à la vie et raconte ce qu’il a vu : les âmes, après la mort, connaissent souffrance ou récompense, mais après une période de mille ans, elles sont invitées par les dieux à choisir le type de vie qu’elles voudraient mener, avant leur réincarnation. A travers ce mythe, Platon questionne le libre choix de destin laissé à l’âme, tout en mettant en relief, la responsabilité originelle du choix de vie des âmes. Cependant ces choix deviennent un destin implacable pour elles. Il faut en déduire que la découverte de ce destin choisi permet la connaissance de soi et une meilleure orientation de son existence. La réminiscence est ainsi nécessaire à cette connaissance de soi.
Du latin « reminisci » qui signifie rappeler à son souvenir et du grec « anamnesis », signifiant ressouvenir, la réminiscence est un des thèmes centraux de la philosophie de Platon. Il désigne le souvenir d’un état antérieur où l’âme possédait une vue directe des Idées et d’elle-même. La théorie de la réminiscence implique ainsi celle de la transmigration et de l’immortalité des âmes et de la maïeutique. Platon développe celle-ci dans le Menon où un esclave ignorant redécouvre la solution d’un problème géométrique, parce que, selon Socrate, il l’a connue dans une vie antérieure.
Nous notons, à partir de là, la place indispensable de la maïeutique dans la politique d’orientation des étudiants qui ne doit plus s’inscrire dans l’orientation close. Cela suppose une relation très personnelle avec l’étudiant. D’où l’invitation à créer des cellules d’orientation permanentes. Dans ces cellules, on devra par la maïeutique, amener l’étudiant à se découvrir et à découvrir sa destinée professionnelle. Ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles décisions d’orientation, s’il était établi que l’étudiant n’a pas été initialement orienté dans la filière de sa destinée.
Conclusion
Le chômage en Afrique est la résultante de plusieurs variables à savoir la colonisation, décolonisation manquée, l’absence de pouvoir effectif des Etats africains sur leurs politiques économiques et sociales, le poids démographique des jeunes, l’étroitesse des marchés nationaux, aussi bien en termes d’économique que d’emploi. La philosophie est sensible à tous ces facteurs rendant difficile l’équation formation-emploi dont la résolution ne doit pas être le seul fait de l’université. Cependant, celle-ci doit être le fer de lance de l’employabilité des étudiants. Les universités doivent être ainsi les pôles qui favorisent la résilience, l’inventivité continue et la libération de l’énergie créatrice de la jeunesse estudiantine afin de lui garantir les meilleures chances d’insertion socio-professionnelle. Après avoir libéré les énergies syndicales et politiques des étudiants dans les années quatre-vingt-dix, l’heure est venue de libérer leurs énergies économiques et créatrices d’emplois.
Références bibliographiques
BIAKA Zasseli, 2002, « La philosophie de la libération de Marcuse et la problématique du développement techno-économie des Etats africains », in Revue CAMES, Série B, vol 004, pp. 100-114.
CONTAMIN, FAURE Yves-André, 1992, Des économies et des Etats en Afrique francophone : pour comprendre l’interventionnisme, Oxford, Cahier Sciences humaines, No 28, pp. 305-326.
DÉFARGES P. Moreau, 1997, La mondialisation, Paris, PUF.
FABRE Michel, 1992, « Qu’est-ce que la formation ? », in Recherche et formation, pp. 119-134.
GO Nicolas, 2015, Coopération, subjectivation, émancipation : transformer les rapports de production des savoirs. Coopérer ?, Paris, Biennale de l’éducation, juin 2015.
Ki-ZERBO Joseph, 2013, A quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein, Lausanne, Editions d’en bas.
LOUKOU Jean-Noël, 2007, Côte d’Ivoire : Les résistances à la conquête coloniale, Abidjan, Les Editions CERAP.
LUX André, 1962, Le marché du travail en Afrique noire, Louvain, Paris, Nauwelaerts,
MARX Karl et ENGELS Friedrich, 1963, Le manifeste du parti communiste, in Œuvres I économie I, trad. Rubel (M) Paris, Gallimard.
MARX Karl, 1963, Le Capital, in Œuvres I économie I, trad. Rubel (M) Paris, Gallimard.
MORIN Denis et al, Pédagogie coopérative à l’université, une utopie en chantier, https://www.editions-harmattan.fr.
NADEL Henri, 1994, Marx et le salariat, Paris, L’Harmattan.
OBONYO Raphaël, « Éducation et culture, Préparer les diplômés africains aux emplois d’aujourd’hui », in Afrique Renouveau, https://www.un.org.
PLATON, 2002, La République, traduction, introduction et notes de Georges Leroux, Paris, Flammarion.
RANCIÈRE Jacques, 2005, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique.
RATSIMBAZAFY Claudine, Modèle pédagogique et employabilité, https : www.cidegef.org.
Oi Kacou Vincent Davy KACOU
Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’intégration sociale et professionnelle des jeunes diplômés, issus des universités se pose aujourd’hui avec acuité. Une réflexion sur la question laisse poindre deux facteurs fondamentaux parmi tant d’autres qui seraient à la base des problèmes d’insertion socio-professionnelle des jeunes. Il s’agit de la démographie et l’inadéquation entre la formation et le marché de l’emploi. De toute évidence, l’Université est mise à l’épreuve par la forte démographie ainsi que la formation théorique qui y est dispensée. S’inscrivant dans l’axe formation et employabilité des étudiants, la présente communication entend inviter à un nouveau procédé paradigmatique dans la transmission de l’enseignement et propose de nouvelles formalités en vue de stages en entreprise.
Mots clés : Contrat social, réforme, révolution, Université.
Abstract:
The social and professional integration of young university graduates is a pressing issue today. A reflection on the question reveals two fundamental factors among many others that are at the root of the problems of socio-professional integration of young people. These are demography and the mismatch between training and the labour market. Clearly, the university is being challenged by the high demographics and the theoretical training provided. In the context of training and employability of students, this paper intends to invite a new paradigmatic process in the transmission of education and proposes new formalities for internships in enterprises.
Keywords : Social contract, reform, revolution, University.
Introduction
L’Université, est un cadre intellectuel et un tournant décisif pour toute personne suivant un cursus d’étude classique. Elle est une sorte de fabrique de futurs citoyens censés être les responsables du développement de la société. On peut aisément déduire que dans sa mission première, elle objecte une réalisation de la personne qu’est l’étudiant ou l’étudiante, mais aussi de l’enseignant. Toutefois, le système universitaire n’est pas toujours parfait. Il est en Afrique, le théâtre de faits peu reluisants et indignespour le temple du savoir. Face à cette situation, ses administrés demandent un renouvellement de ses structures et de son mode de fonctionnement qui doit nécessairement évoluer suivant deux tendances : la tendance des réformistes et celle des révolutionnaires. Fort de cela, la question est de savoir quelle est la meilleure perspective que l’Université doit adopter en vue de relever son niveau de fonctionnement ?
C’est en ce sens que nous avons recours au philosophe français, Paul Ricœur, en reprenant à nouveaux frais, son article intitulé «Réforme et révolution dans l’Université »[57], écrit en 1968. Il y traite le problème du système universitaire. Mais avant cet article, il a mené une enquête sur les Universités, leur viabilité, leur administration et leur obligation envers les groupes sociaux, qui fut publié en 1964 sous le titre « Faire l’université », dans lequel il montre que l’université est essentiellement confrontée à la fois au défi démographique et à l’obligation constante de faire coïncider rationalité et efficacité. Chaque année des effectifs pléthoriques sont déversés à l’université, destinés à constituer une bonne partie des élites. Cependant, l’université leur offre-t-elle les meilleurs enseignants et enseignements possibles ?
D’ores et déjà, il faut faire remarquer que les critiques faites à l’Université, aujourd’hui, laissent entrevoir la nécessité d’une profonde réforme de cette structure académique et pédagogique responsable de la formation des jeunes étudiants qui doivent constituer l’élite intellectuelle dans différents États. Pour une meilleure appréhension de cette question, l’article va s’appuyer sur l’œuvre « Réforme et révolution dans l’Université » de Paul Ricœur. Dans cette œuvre, l’auteur propose une conciliation de deux tendances, à savoir la tendance réformiste et la tendance révolutionnaire. Cette perspective, selon Paul Ricœur, donne à l’Université un caractère malléable qui s’adapte de toutes formes d’actualisations. Dès lors, les maquettes pédagogiques contribuent-elles à l’insertion des étudiants qui sont formés à l’université dans le monde du travail ? Quelle offre de formation faut-il proposer aux diplômés de l’Université pour qu’ils soient compétitifs sur le marché de l’emploi ?
À l’aide de la méthode analytique, nous tentons, dans un premier axe de notre cheminement, de rendre compte de la pensée de Paul Ricœur concernant la réforme et la révolution dans l’Université, ensuite, dans un second axe, nous procédons à un état des lieux du milieu universitaire en Afrique et, enfin, dans un troisième axe, nous envisageons des réponses aux préoccupations en vue d’une meilleure employabilité.
1. L’administration universitaire
Dès le début de son discours, Ricœur explique clairement la complexité du projet de la réforme universitaire. Il compare ce projet à une révolution qui poussera l’Occident à rompre avec ses perspectives capitalistes. Le lien du capitalisme à l’Occident paraît si solide malgré tous les maux que ce modèle financier crée aux Occidentaux. Le modèle capitaliste est inscrit dans les esprits humains occidentaux et régit leurs entreprises et leurs rapports humains, depuis les hautes sphères, jusqu’aux hameaux les plus reculés. C’est cette situation qui existe dans les universités, du monde entier (cf. P. Ricœur, 1991, p. 382). Dès lors, pour notre auteur, il faudrait procéder à une « dégaoutique» (R. L. Boa-Thiémélé, 2020, p. 131) du système universitaire. Cette dégaoutique, tant colossale soit-elle, doit commencer par la relation d’enseignement.
1.1. La relation d’enseignement
Parler de la relation d’enseignement, c’est évoquer la relation d’enseignant-enseigné. La relation enseignant-enseigné est contenue dans la relation d’enseignement, c’est le rapport qui existe entre le professeur et l’étudiant. Ce rapport est dans son application vicié. Il est devenu essentiellement un rapport de domination. Cette situation est due au mode même d’administration de l’université. Les enseignants, en effet, ne sont pas véritablement associés à la gestion de l’Université. Une telle situation rejaillit évidemment sur les étudiants qui la subissent de leurs enseignants. C’est une gouvernance qu’on pourrait qualifier de descendante. Ricœur préconise alors une reconstruction de cette relation en la rendant ascendante. Il affirme à cet effet (1991, p. 382-383) ceci :
Le premier acte de la présente révolution consiste en un renversement de méthode: dans l’Université napoléonienne ( et ajoutons-le, dans le régime gaulliste, lequel se dédouane aujourd’hui trop facilement en critiquant les structures sclérosées de l’Université, alors qu’il a exercé dans tous les pouvoirs sur le même modèle de l’autorité descendante), la décision appartenait d’abord à l’administration centrale, dont les pouvoirs étaient exercés sans véritable participation des unités d’enseignement ( universités, facultés et instituts divers) et sans consultation du corps enseignant place sous sa juridiction; à leur tour, les professeurs constituaient une oligarchie cooptée, qui gouvernait sans partage les départements en ce qui concerne le cours des études, la forme et le contenu de l’enseignement, la collation des grades; les assistants; les assistants étaient choisis par les professeurs seuls et ne partageaient qu’un petit nombre de précédentes prérogatives ; enfin, les étudiants, placés au bas de la hiérarchie descendante, ne participaient à la décision à aucun de ces niveaux. (…) Le renversement de méthode consiste aujourd’hui – dans l’Université et sans doute ailleurs – à substituer au gouvernement de haut en bas la reconstruction de bas en haut, par une sorte de méthode fédérative de proche en proche. Voilà pourquoi, il faut partir de la relation d’enseignement, c’est-à-dire du rapport de l’enseignant à l’enseigné : toute institution universitaire est, en dernière analyse la mise en forme de cette relation.
De cette observation de Paul Ricœur, il en découle que toute l’administration de l’Université a besoin d’être revisitée. Il convient alors de rendre le gouvernement universitaire participatif. Ainsi, cela devra passer par les rapports entre les étudiants et leurs enseignants. Ricœur (1991, p. 374) renchérit cette idée en montrant qu’« il est important de faire participer les étudiants à la vie de la faculté, à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan intellectuel. » Malheureusement cette perception des choses s’avère une entreprise ardue, car l’étudiant n’a pas de voix au chapitre. Certes, cela serait acceptable si ce n’était qu’à propos des diplômes, mais, cette conception veut aller jusqu’à l’amenuisement de l’humanité de l’étudiant par rapport à son enseignant. Pourtant, ce n’est pas le cas. Même si l’étudiant vient apprendre et qu’il doit se soumettre au professeur, il vient avec une histoire, son petit baluchon de connaissances acquises et une éducation. Dès lors, il a quelque chose à apporter à l’enseignant, quel que soit son grade.
De ce fait, une relation dialogique doit être cultivée et entretenue entre les enseignants et les enseignés. En effet, la forme d’existence la plus authentique réside dans la relation. À l’évidence, la réalisation authentique de l’homme consiste en la relation, à être en relation. C’est par la relation que l’homme se réalise pleinement. L’homme doit vivre pleinement sa condition relationnelle et réaliser sa condition personnelle. Le désir par excellence pour l’homme est la vie pleine de sa condition relationnelle. (F. Jacques, 1982, p. 81). La relation est condition de possibilité de la personne. L’homme est ontologiquement un être de relation. Selon Ricœur, les espaces dialogiques d’interlocution entre enseignants et enseignés sont pléthores : « discussion des programmes, organisation des cours et des travaux pratiques, confection des polycopiés, insertion du travail des « groupes de travail universitaires » dans la trame du cours, organisation de séances-débats intercalées périodiquement dans le cours magistral, etc. » (1991, p. 374). C’est dans cette dynamique dialogique et participative que doit s’inscrire la relation éducative, sans toutefois, tomber dans les chimères de la « cogestion ». Nouer et promouvoir un dialogue avec les étudiants ne leur donne pas le droit de surplomber leurs maîtres.
La relation d’enseignants à enseignés doit être un rapport de réciprocité asymétrique et de responsabilité symétrique. Même s’il y a relation dialogique entre le maître et l’élève, le maître demeure toujours le maître, non pas dans un esprit de surestimation, mais de collaboration. Dans ce sillage Beatrice Afiavi Agbo (2019, p. 14) laisse entendre ceci: « Les jeunes, en l’occurrence les étudiants ont à leur actif la spontanéité et l’imagination créatrice. Le maître, ici, l’enseignant-chercheur, n’est pas le détenteur de quelque vérité absolue. Il innove et conduit à l’innovation, à la création d’un monde nouveau. » La connaissance étant à tous les stades de la vie, l’étudiant ne doit donc pas être exempté du privilège de communiquer un savoir si minime, soit-il.
Ricœur soutient son point de vue en ajoutant qu’en plus de ses acquis, l’étudiant a aussi son projet d’accomplissement personnel. En effet, ce projet ne se réalise pas entièrement dans l’enseignement. L’enseignement n’y joue qu’une part et est une sorte de préparation (Cf. P. Ricœur, 1991, p. 383). L’enseignement existe sur la base d’une réciprocité relationnelle entre apprenant et formateur, chacun ayant le désir de réaliser «sa légende personnelle » (P. Coelho, 1994, p. 35). En d’autres termes, ce serait donc un rapport réciproque profitant aux deux parties prenantes. Et la révolution culturelle universitaire tant attendue tire toute sa force de ce principe d’abolition de la domination professorale.
1.2. La possible dérive de la relation d’enseignement
La relation d’enseignement pourrait être détournée de son objectif en prenant la forme d’une domination de classes. Celle-ci, bien que subtile, est à mesure de polluer la relation d’enseignement. Elle est un tremplin pour la domination pédagogique (Cf. P. Ricœur, 1991, p. 384). Et la conséquence la plus grave est que cette dérive servirait même jusque dans le domaine politique.
On pourrait penser faussement que la révolution culturelle universitaire consisterait dans une utopie, comme l’appelle Ricœur. Cette utopie soutient que l’enseignement ne relèverait que de l’étudiant et de sa propre initiative. Celui-ci serait le point focal d’une soi-disant relation d’enseignement, où le professeur est réduit à un simple support didactique, comme on consulte un livre ou autre support de connaissance. Le système serait géré par les étudiants qui feraient appel aux enseignants, et en useraient à leur guise.
Ce système paraît salutaire pour les étudiants, car il défend, non seulement, une sorte de suprématie de l’étudiant, mais aussi, traite d’une vérité essentielle qui est que l’enseignement est fait pour les étudiants. Cependant, il n’est qu’une auto-justice. Autrement dit, un modèle inverse du modèle de domination pédagogique ou professorale que nous tentons de combattre. En effet, l’enseignant ne peut être réduit à une fonction de support didactique. Parler de la relation d’enseignement, c’est rappeler qu’elle exige un apport des deux protagonistes, un respect de chacun dans sa différence. Pour montrer l’insuffisance de cette utopie, il est nécessaire de rappeler que l’enseignant, à son tour, a son projet d’accomplissement personnel. Dès lors, la limite de l’auto-enseignement est aussi évidente que celle de la domination pédagogique.
2. L’université à l’épreuve des maux
2.1. Les distorsions dans le système universitaire
Les maux qui minent le système universitaire africain sont nombreux. En dresser une liste exhaustive reviendrait à effectuer de minutieuses casuistiques. Cependant, il existe des maux généraux qui n’épargnent personne, depuis les dirigeants éducatifsjusqu’aux plus jeunes apprenants en passant par leurs encadreurs.
En premier lieu, il y a la corruption qui est une gangrène pour toute la structure éducative. La période des examens du BAC est une période pour les enseignants corrompus de gonfler leurs avoirs. Ils proposent des corrigés d’épreuves aux candidats. Les surveillants, quant à eux, imposent à toute une classe d’examen une somme minimale à la bourse de l’ensemble des élèves. Très souvent, ces corrigés sont truffés d’erreurs. Et les élèves les plus paresseux ou les candidats libres dont l’avenir dépend souvent de l’issue de cet examen s’y adonnent. Ensuite, pourrions-nous évoquer dans le milieu universitaire les effectifs pléthoriques. Par exemple, pour l’année académique 2016-2017, dans une université publique de Côte d’Ivoire, les étudiants inscrits en première année étaient environ 2000 pour un seul amphithéâtre. Comment serait-il possible pour ces futurs juristes d’assurer l’avenir judiciaire du pays dans de telles conditions ?
En outre, les universités africaines sont des lieux de bafouement de la dignité et des droits de la personne humaine. En effet, à l’université, est-il courant de constater le marchandage des notes pour la validation des Unités d’Enseignement (U.E). Les filles sont les plus en proie à ce fléau. Elles sont très souvent harcelées par des enseignants qui veulent abuser d’elles. N’oublions pas cependant que celles-ci prêtent aussi le flanc à quelques occasions. Il s’agit des plus paresseuses. Cela sous-entend que l’espace de l’enseignement universitaire est « un terreau bien fertile pour la possession ou la repossession des jeunes filles » (S. Diakité, 2016, p. 44) Dans le jargon universitaire, parlerons-nous de Moyennes Sexuellement Transmissibles. Enfin, nous ne pourrions conclure cette diatribe sans évoquer les violences en milieu universitaire. Ce sont des grèves à répétition, des enseignants qui sont violentés, des élèves studieux, ne voulant se laisser aller à cette forme de violence subissent le même traitement. À cela, il faut ajouter le cas des élèves et étudiants qui réclament des congés à outrance. Avec Ricœur, nous nous accordons pour accuser en premier le système administratif universitaire, avec sa gouvernance descendante presque répressive.
2.2. La forme de l’enseignement
De profondes réformes affectent les systèmes d’enseignement supérieur sur le continent africain depuis plusieurs années. Les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, les ministères en charge du secteur, les Etats, les organisations régionales et internationales, les entrepreneurs privés et les collectivités locales constituent à la fois des acteurs et des témoins de toutes diverses mutations. Dans ce sillage, les enseignants participent à de nombreux ateliers chargés de transcrire leur maquette de formation au format LMD (Licence Master Doctorat).
On assiste à la création d’Universités virtuelles incluant des espaces numériques ouverts répartis sur les territoires nationaux. Ces politiques entendent répondre à l’augmentation de la demande d’enseignement qui passe par une meilleure efficacité du système qui exige la mise en place d’un maillage territorial plus resserré. Tout ceci doit conduire à un aménagement du territoire, à une intégration des zones périphériques, voire à un rapprochement des lieux de formation avec de potentiels bassins d’emplois. L’enseignement supérieur fait face à une forte pression. Il lui est demandé, au-delà de ses missions d’enseignement, de former des diplômés qui s’inséreront effectivement et efficacement dans le marché du travail. Les étudiants à la sortie de l’université intègrent généralement la fonction publique.
3. Perspectives pour une meilleure employabilité
L’enseignement supérieur est en difficulté et nécessite l’intervention de différentes parties prenantes des gouvernements nationaux et des partenaires de développement pour permettre aux étudiants de développer leurs acquis et apporter une contribution efficace sur le marché du travail. Pour ce faire, nous proposons quelques solutions pour la réforme du contenu de l’enseignement universitaire.
3.1. Le contenu de l’enseignement
Pour un meilleur contenu de l’enseignement supérieur, il faut un renforcement des capacités des personnels enseignants. Aussi, il faut penser à une augmentation qualitative des conditions et des structures de recherche (équipement informatique, abonnements à des revues scientifiques et techniques, etc.). Il faut également insister sur l’amélioration qualitative des personnels de gestion et d’administrations universitaires. Il en va de même pour
Aussi, il convient d’aider les gouvernements à une meilleure planification des bourses qu’ils octroient aux étudiants. Les bourses d’études à l’étranger doivent tenir compte des besoins des États. Il faudrait renforcer la capacité des universités en leur permettant de communiquer entre elles, que ce soit par la promotion d’activités conjointes, par des échanges de personnels enseignants ou d’étudiants, par la participation à des projets de recherche communs.
3.2. L’organisation fonctionnelle
La relation d’enseignement nous sert de paradigme pour trouver des solutions en vue d’une meilleure employabilité. D’emblée, il faudrait repenser les relations entre les étudiants et leurs enseignants. Ces derniers ne doivent pas s’ériger en maîtres absolus sur leurs apprenants. Il est nécessaire qu’il existe une relation de proximité entre les étudiants et leurs enseignants.
Par ailleurs, l’éducation ne doit pas être considérée comme un lieu d’enrichissement. L’enseignement est une vocation, un sacerdoce. Une personne qui voudrait s’engager dans ce secteur doit être mue par une perspective d’inter-humanité. En effet, par l’inter-humanité, l’homme apprend à forger son humanité par une écoute de soi et de l’autre que soi. L’Université doit être le lieu de réalisation de tout l’humain. Le milieu du savoir ne doit pas encourager la déshumanisation, mais au contraire le respect de l’autre dans sa différence. Une égalité entre les cultures et entre les sexes doit être de rigueur. Ce serait au moins un début pour assurer une égalité de chances de réussiteentre les différents étudiants.
La situation des étudiants en Afrique est très souvent précaire. Bon nombre d’étudiants africains proviennent de la masse paupérisée. Ils sont prompts à abandonner les études pour une activité lucrative. Les plus conscients s’adonnent à de nobles métiers. L’État devrait donc penser à une sorte de subventions pouvant les aider à subvenir à leurs besoins quotidiens. Ce qui leur permettra de suivre leurs études sans difficultés majeures. C’est dire avec Agbo (p. 15) qu’
en tant que structure de formation des cadres supérieurs de la nation, l’université, a besoin du soutien de l’État. Celui-ci garantit les moyens financiers et matériels, mais aussi les ressources humaines sans s’immiscer pour autant dans la vie des universités, leur administration et leur fonctionnement. Nous voulons surtout parler ici de l’autonomie des universités, leurs relations avec les autres structures de l’État. L’université, en tant qu’institution, est autonome.
C’est pourquoi, il faut repenser les conditions des étudiants et même celles de leurs enseignants pour une optimisation des capacités intellectuelles des universitaires. Un premier intérêt de la recherche scientifique sur les mutations de l’enseignement supérieur en Afrique consiste à discuter l’objet des réformes mises en œuvre dans le secteur. L’intérêt est, en effet, de porter une attention particulière aux transformations des politiques publiques qui organisent la régulation des systèmes universitaires en insistant d’une part, sur la trajectoire historique de ces réformes et, d’autre part, sur des études de cas comparatives afin de discuter tant les convergences que les divergences de réformes au sein même des pays. Cette approche des réformes de l’enseignement supérieur par comparaison permet de tester les hypothèses de mutations similaires sur le continent, notamment en matière de régulation économique et financière du secteur.
Aussi, les réformes de l’enseignement supérieur doivent répondre aux défis de la régulation des modalités de création des institutions universitaires publiques et privées, de la viabilité économique sur le long terme du secteur ou encore de la restructuration des cycles et des offres de formation. On observe des mécanismes d’uniformisation des systèmes universitaires africains au niveau des politiques publiques ayant structuré le secteur depuis les Indépendances. Il convient d’insister sur le rôle des acteurs qui ont participé au processus d’élaboration des politiques publiques ou qui ont été concernés par ces mutations de l’enseignement supérieur. Il nous apparaît désormais important de tester de nouvelles grilles de lecture pour appréhender ces réformes.
La diversification de l’offre d’enseignement supérieur constitue un des phénomènes les plus spectaculaires qui affecte ce secteur. Ses manifestations physiques se donnent à voir dans la plupart des métropoles africaines où se multiplient des établissements universitaires de toute taille et de toute nature. Ces établissements tout comme l’université doivent mettre en place un mécanisme de régulation entre la formation théorique et la pratique. Cela suppose la création d’un enseignement technique à l’Université, dans chaque filière de formation, pour que comme le souligne Ricœur des « passerelles puissent être aménagées, à divers niveaux et dans les deux sens, entre l’enseignement théorique et l’enseignement technique. » (1991, p. 370). Des stages périodiques, également, sont à insérer dans la maquette pédagogique pour aider les étudiants à s’imprégner des réalités professionnelles avant la fin de leurs cursus.
La formation doit associer connaissance et compétence. L’enseignement universitaire ne doit pas être que théorique. Il doit allier théorie et praxis. En effet, « (…) il nous faut un enseignement supérieur de masse préparant les jeunes depuis 18 ans à leur métier. » (P. Ricœur, 1991, p. 371). Et pour cela, Paul Ricœur prône la diversification des « prestations de l’enseignement supérieur. » (Idem).
La tâche qui incombe à l’Université est de penser à de nouvelles perspectives de formation théorico-pratique. Elle doit former les cadres en vue de la grande santé de la nation. En d’autres termes, sa mission est de créer des diplômés qualifiés, de fabriquer, au sens plénier du terme, des citoyens capables de s’intégrer dans tous les secteurs de l’emploi, de fournir à la nation des travailleurs compétents, capables de construire la nation. Irrémédiablement l’adoption de nouvelles politiques éducatives s’impose. L’Université doit former des cadres compétents, responsables et consciencieux dans tous les secteurs d’activités. En tout état de cause, elle a la lourde responsabilité de former à une véritable renaissance africaine, comme le souligne si bien C. M. Phemba (2015, p. 71-72) :
Il est peut-être grand temps que les États africains favorisent des actions de formations pour permettre la vulgarisation des connaissances dont les Africains ont besoin (…) Il est clair que dans un contexte de construction et de développement, penser les politiques éducatives doit intégrer la dimension de la recherche scientifique. Pour cela, la formation technique qui est quasi inexistante en Afrique, a besoin d’être améliorée.
La renaissance africaine passera par la formation des futurs cadres par l’Université. À ce titre, elle doit être inventive, novatrice et surtout éduquer à la confiance en soi, car « c’est avec un peuple qui a confiance en lui-même et qui relève le défi du développement que nous pourrons construire l’Afrique éternelle et moderne. » (R. L. Boa Thiémélé, 2007, p. 182). En ce sens, l’Université doit tenir compte des réalités nationales dans ses maquettes pédagogiques plutôt que de reproduire des modèles occidentaux ou américains qui n’ont parfois pas d’encrage dans la réalité existentielle. Il ne doit pas avoir de dichotomie entre la théorie et la pratique, mais plutôt une discontinuité-continue. La réforme et la révolution dans l’université sous-entend qu’il faut rompre avec la répétition. C. M. Phemba (2015, p. 69) relève si bien cela en ces termes :
Certains diplômés d’Afrique (bacheliers, universitaires et docteurs en différents domaines) sont devenus des répétiteurs des connaissances acquises dans différents milieux. Ils véhiculent, malheureusement et bien souvent d’ailleurs, des réflexions qui n’apportent aucune innovation sociale, ni scientifique car les théories qui les fondent ont été développées sous d’autres cieux pour des applications contextuelles bien précises.
Il appert qu’en Afrique, l’Université a l’obligation de contextualiser la formation pour une meilleure employabilité. Il s’agit alors d’opérer une rupture épistémologique d’avec les anciennes méthodes, afin de permettre aux diplômés d’être plus compétitifs sur le marché de l’emploi. Ainsi, nous devons passer d’une université mimétique à une université engagée et engageante. L’Afrique gagnerait à travailler davantage dans le sens de la fidélité à ses racines, d’une analyse objective de ses problèmes, en cherchant des méthodes propres à elle pour les résoudre. Nous en voulons pour preuve les propos suivants de L. S. Senghor (2014, p. 79) :
Aucune technique, écrit-il encore, aucune théorie, aucun « modèle » ne vaut que repenser par nous et pour nous. Rien ne peut nous apporter un concours efficace qu’en s’intégrant dans nos structures culturelles, sans les détruire, l’indépendance, c’est-à-dire le développement autonome est à ce prix.
On ne saurait clore cette réflexion sur la réforme et la révolution dans l’Université sans inviter les gouvernants africains à un bon traitement des enseignants. Ces derniers sont des acteurs incontournables dans le développement des États. L’Université a énormément besoin du soutien de l’État. Celui-ci doit mettre à la disposition des enseignants des moyens financiers, didactiques, structurels, matériels et aussi des ressources humaines pour former au mieux l’élite compétitive. C’est dire que la gestion administrative et financière est indubitablement l’affaire de l’État, même si l’idéal serait que l’Université soit autonome à part entière. Toutefois, il serait judicieux de séparer la dimension académique et pédagogique de la dimension administrative des Universités. Ainsi les réformes pédagogiques et académiques devraient uniquement être introduites dans les Universités par les enseignants eux-mêmes.
Conclusion
Au terme de notre analyse sur la réforme et la révolution dans l’Université, il convient de souligner que Paul Ricœur met un accent particulier sur le système universitaire. Il souligne également la nécessité et l’importance de la relation d’enseignement. Cela sous-entend une relation dialogique entre les enseignants et les enseignés. Les enseignants doivent encourager et valoriser la formation technique et l’esprit entrepreneurial. Ainsi, les enseignements ne doivent pas être que théoriques, mais aussi pratiques.
Aussi, les enseignants s’ouvriront entre eux dans la mesure du possible et s’entraideront mutuellement au sein des universités allant des facultés, départements et filières d’enseignement. Cela facilitera la transmission du savoir des plus anciens professeurs aux plus jeunes enseignants. Les anciens professeurs feront bénéficier leurs riches expériences et compétences aux plus jeunes. Ainsi, la relève de nos universités africaines sera assurée.
Il est donc impérieux d’instaurer un climat de dialogue et de confiance entre les professeurs expérimentés (Maîtres de conférences et Professeurs titulaires) et les plus jeunes enseignants (Assistants et Maîtres-Assistants). Cela permettra une bonne collaboration afin que la chaîne de transmission du savoir générationnel soit respectée. Cette franche collaboration au sein du corps enseignant doit être débarrassée des intérêts d’ordre politique idéologique etc. En outre, il faudrait développer et intensifier la politique de communication afin de donner plus de visibilité aux expériences que vivent les enseignants. C’est ce que Ivan Illich (1971, p. 370) exprime à travers ces propos :
À la recherche qui ne vise en fait à découvrir que de nouvelles méthodes de « gavage », il faut opposer une autre recherche qui entreprenne de concevoir de véritables « réseaux de communications » à dessein éducatif, par lesquels seront accrues les chances de chacun de faire de chaque moment de son existence une occasion de s’instruire, de partager, de s’entraider.
Il est alors nécessaire pour nos universités africaines de mener une réforme, qui revaloriserait la culture du travail, le professionnalisme et l’intellectualisme africain en vue d’une meilleure employabilité. À cet effet, les maquettes pédagogiques doivent cesser d’être des copies conformes de celles de l’Occident ou d’ailleurs. Au contraire, elles doivent tenir compte des réalités de chaque État eu égard au marché de l’emploi. La formation doit également tenir compte des offres d’emploi. Il s’agit d’intégrer dans la formation les critères et problématiques sous-jacents au marché de l’emploi. Il appartient donc aux décideurs africains de faire le choix historique de réaliser la réforme de l’enseignement supérieur tel que l’exige le concept de développement durable. L’histoire récente de certains pays d’Asie doit nous enseigner une belle leçon d’engagement, de persévérance, de confiance et d’espoir pour que nos lendemains enchanteurs cessent enfin d’être des chimères.
Références bibliographiques
AGBO Afiavi Béatrice, 2019, Paul Ricœur : « Faire l’Université ». Leçons pour une Université au service du développement en Afrique, Editions Universitaires Européennes, 56 p.
BOA-THIÉMÉLÉ Ramsès L., 2020, Reconstituer le corps glorieux d’Osiris, Abidjan, Les Éditions KAMIT, 196 p.
BOA-THIÉMÉLÉ Ramsès L., 2007, Nietzsche et Cheikh Anta Diop, Paris, L’Harmattan, 217 p.
COELHO Paolo, 1994, L’alchimiste, Paris, Flammarion, 253 p.
DIAKITÉ Samba, 2016, Les larmes de l’éducation, Québec, Différance pérenne.
ILLICH Ivan, 1971, Une société sans école, Trad. Gérard Durand, Paris, Editions du Seuil, 222 p.
PHEMBA C. Milène., 2015, « Eduquer pour une renaissance africaine. Quelques piste », in Les réalités et les défis d’une renaissance africaine, (sld) S. Thounkara, C. A. Lolo et P.-N. Mavoungou-Pemba, Paris, L’Harmattan, p. 68.
REBOUL Olivier, 2004, La philosophie de l’éducation, Paris, PUF, 128 p.
RICŒUR Paul, 1964 [1991], « Faire l’Université », in Lectures 1. Autour du politique, Paris, Editions du Seuil, 412 p.
RICŒUR Paul, 1968 [1991], « Réforme et révolution à l’Université », in Lectures 1. Autour du politique, Paris, Editions du Seuil, 412 p.
SENGHOR Léopold Sédar, 2014, Education et culture, Textes réunis par A. Raphaël Ndiaye et Doudou Joseph Ndiaye, Dakar, Présence Africaine, 369 p.
Sambou DIABY
Université de Bordeaux (France)
Résumé :
Inscrit dans le champ la sociologique de l’action, cet article accorde une importance aux actions impliquant non seulement le dysfonctionnement institutionnel mais aussi mettant en cause l’efficacité externe du système de formation universitaire. Il entend articuler la crise de l’université et l’employabilité des diplômés dans des logiques et dynamiques structurelles et institutionnelles conduisant aux déséquilibres entre les offres de formations universitaires et le marché de l’emploi au Mali. L’application d’une méthodologie mixte associant questionnaires et entretiens semi-directifs montre l’existence de dynamiques contradictoires alimentées par des positionnements historico-politiques, économiques et pédagogiques qui, non seulement maintiennent les universités maliennes en situation de crise mais participent aussi à son renouvellement continuel.
Mots clés : Crise universitaire, Employabilité, Formation universitaire, Insertion professionnelle, Réseau relationnel, Sociologie de l’action.
Abstract:
This article is based on the sociology of action and focuses on actions involving not only institutional dysfunction but also the external efficiency of the university training system. It intends to articulate the crisis of the university and the employability of graduates in structural and institutional logics and dynamics leading to imbalances between university training offers and the labor market in Mali. The application of a mixed methodology combining questionnaires and semi-structured interviews shows the existence of contradictory dynamics fueled by historical, political, economic, and pedagogical positions that not only keep Malian universities in a crisis but also contribute to their continuous renewal.
Keywords : Employability, Professional insertion, Relational network, Sociology of action, University crisis, University training.
Introduction
L’abondance de la littérature scientifique sur la question de la crise de l’université en Afrique, depuis des décennies, prouve qu’elle est universelle. Définir cette crise reviendrait à s’affranchir des conceptions génériques de rupture d’une normalité ou d’une stabilité vers une désintégration systémique. La crise de l’université apparaît alors comme une situation permanente empêchant le fonctionnement optimal et entravant les dynamiques socio-politiques, économiques et pédagogiques inhérentes à une efficacité interne et externe du système de formation. Pourtant, il a été constaté depuis des décennies que les diplômés en SHS au Mali s’insèrent difficilement sur le marché du travail. Il est même d’expression courante que l’enseignement supérieur du Mali est réputé pour former des diplômés sans emploi. Cette représentation est appuyée par le rapport de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation qui décrit une situation où le taux de chômage augmente avec la diplomation (ONEF, 2017).
Ainsi, l’objet de cet article n’est pas de discuter l’efficacité externe des formations par l’insertion professionnelle mais de partir des logiques et dynamiques socio-politiques et pédagogiques pour comprendre la permanence de la crise de l’université. Les résultats de notre enquête présentés dans cet article, sont issus d’un corpus de quarante-quatre entretiens semi-directifs avec les autorités politiques, administratives, enseignants-chercheurs et étudiants réalisés entre mars 2019 et mars 2021 dans le cadre de la préparation de notre thèse de doctorat. Ces entretiens ont été complétés et articulés avec un questionnaire adressé aux bacheliers et diplômés. Nous sommes partis de l’idée selon laquelle la crise de l’université en Afrique tire sa source des crises antécédentes occasionnées par la colonisation afin d’expliciter les contextes d’émergence et les dynamiques socio-politiques et pédagogiques qui structurent l’enseignement supérieur au Mali.
Cet article s’intéresse à la crise universitaire en interrogeant plus spécifiquement son impact sur l’insertion des diplômés dans le tissu social. Il s’inscrit donc dans une perspective de compréhension du chômage à partir d’une lecture non seulement historique de l’université mais aussi les dynamiques socio-politiques et pédagogiques qui structurent et organisent les offres de formations et l’entrée sur le marché de l’emploi. Dans un premier axe, nous présentons les éléments historiques et contemporains de la crise de l’université. Dans un deuxième axe, nous montrons les difficultés rencontrées par les diplômés dans le choix des offres de formations et la place du réseau relationnel dans l’accès à l’emploi. Dans un troisième axe, nous découvrons que les dynamiques institutionnelles qui devaient faciliter l’insertion professionnelle des diplômées, constituent plutôt des écueils à cette insertion.
1. Crise de l’université en Afrique
L’analyse de la crise de l’université en Afrique ne peut avoir de sens que lorsque l’on interroge d’un côté le rapport de force qui a existé entre les locaux et les colons et de l’autre côté, le rapport aux savoirs importés de ces derniers. Cette mise en perspective conduit à situer la place de l’histoire coloniale dans la pérennisation des situations dysfonctionnelles de nos universités en Afrique.
1.1. Les antécédents à la crise de l’université
La crise semble être plus aiguë en Afrique du fait des dysfonctionnements flagrants des universités et particulièrement celles du Mali qui sont traversées par des problématiques politiques, structurelles, administratives et pédagogiques. A priori, la crise de l’université est bien plus ancienne que l’on peut croire en contexte africain et malien. On découvre alors quatre temps relatifs à des situations de crise scolaire et universitaire. Dans un premier temps, elle a donc existé bien avant la généralisation de l’université en Afrique à travers le rejet massif de l’école des « blancs ». C’est le temps de la colonisation. Face à la volonté d’assimilation des peuples africains par le colon, le seul mécanisme de défense des pays colonisés était alors le refoulement. Ce refoulement du point de vue freudien, s’appuyait sur l’idée d’une école qui serait un moyen de détournement de nos cultures, de nos traditions originelles et de nos savoirs ancestraux. Comme S. Guth (1990, p. 71), pouvait l’écrire :
L’école altère toutes les identités antérieures, dévalorise certains savoirs ancestraux, nie les aspects extérieurs des identités, lie les classes traditionnelles d’initiation au calendrier scolaire. En d’autres termes, la généralisation de l’école a entraîné la société dans son mouvement, lui a imprimé son temps, son rythme, ses saisons, lui a imposé son paysage.
De fait, l’école et plus tard l’université en Afrique ont constitué les premiers véhicules de l’identification sociale. Elles devenaient ainsi, au XXe siècle, les héritières de cette considération non seulement idéologique mais également factuelle car les dysfonctionnements institutionnels, qui y sont observés, résultent des années de relégation de l’école. Pour cause, celle-ci a d’abord été sélective, posant ainsi les bases d’une inégalité sociale construite autour d’une minorité d’élèves recrutés en son temps dans les élites antérieures à l’arrivée des colons. Ainsi pour V. Isambert-Jamati, ceux qui avaient été formés devenaient sous des formes diverses des auxiliaires de la colonisation (1980, p. 3). Cette sélection du public scolaire, avant les années 60, a conduit les États africains dans une situation de main d’œuvre déficitaire. Dans un second temps post indépendant, pour remédier à cette insuffisance, les autorités politiques d’alors ont entrepris des recrutements massifs d’écoliers. Malgré tout, elles restaient attachées à leur volonté de rompre avec le système colonial en y apportant une particularité africaine. Pour preuve, l’un des objectifs de la réforme de 1962 du Mali illustre bien cette volonté de fournir « un enseignement dont le contenu sera basé non seulement sur les valeurs spécifiquement africaines et maliennes mais aussi sur les valeurs universelles » S. Loua (2012, p. 118). Dans cette optique la crise de l’université prend une forme « identitaire » dans laquelle l’objectivité des réponses institutionnelles apportées reste douteuse. À ce propos, H. Arendt (1972, p. 225) affirmait qu’une
crise ne devient catastrophique que si nous y répondrons par des idées toutes faites, c’est-à-dire par des préjugés. Non seulement, une telle attitude rend la crise plus aiguë mais encore, elle nous fait passer à côté de cette expérience de la réalité et de cette occasion de réfléchir qu’elle fournit.
Pour H. Arendt, seule l’expérience de la réalité objective fournit une occasion de réfléchir les objets dans leur singularité en vue d’y apporter des solutions appropriées. Or, c’est peut-être d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle cette crise perdure et mute de régime politique en régime politique, de pays en pays et semble échapper à toute solution. Pourtant, à chaque fois que cela est nécessaire, des fora, des séminaires, des colloques et autres rencontres scientifiques et politiques sont organisés en vue de parvenir à des réformes, des innovations et des propositions concrètes de sortie de crise.
Dans un troisième temps, les programmes d’ajustement structurel des années 80 et 90 ont plongé les pays africains dans une sorte de récession économique et politique impactant lourdement le fonctionnement et la soutenabilité financière des actions publiques. Ainsi, ces pays ont été contraints de mettre à la retraite anticipée des fonctionnaires, de bloquer les salaires des fonctionnaires et de limiter les recrutements dans la fonction publique tout en encourageant la privatisation. Ici, la crise universitaire est d’origine économique et conduit les pays africains dans une dynamique d’affaiblissement. Situation qui, d’année en année accentue la fragilisation des fonctionnements universitaires.
Enfin, à partir des années 90, on assiste à un renouvellement des situations de crise scolaire et universitaire des pays africains majoritairement imputable à une politique de démocratisation et de privatisation des institutions scolaires universitaires. Dès lors, le constat d’une augmentation flagrante de la population scolaire contraste avec les moyens humains, matériels, didactiques, techniques et financiers limités de l’État pour un fonctionnement optimal des structures. Après avoir situé l’apport de l’histoire dans la crise de l’université en Afrique, la nécessité d’aborder les éléments contemporains semble s’imposer en vue de comprendre la pérennité de ladite crise et de son impact sur l’employabilité des diplômés.
1.2. Les éléments contemporains de la crise universitaire
La crise scolaire et universitaire dans le contexte socio-politique et pédagogique malien se traduit par des défaillances chroniques et structurelles. D. Diakité (2000, p. 13) imputait cette chronicité de la crise scolaire à six situations que sont : la non prise en compte des réalités socio-culturelles du pays ; les revendications corporatistes ; les conséquences de l’ajustement structurel ; le laxisme étatique ; les interférences politiques et enfin la démission des parents dans leur rôle d’éducateur. Selon I. S. Traoré (2010, p. 229), « le propre de la crise scolaire est d’être le vecteur de dysfonctions et de dérapages tant au niveau administratif, pédagogique que dans l’interaction, la synergie d’action des acteurs des établissements scolaires ».
Il semblerait alors, d’après les recherches menées par des experts, qu’il y a une forme de constance dans l’appréciation faite de la crise universitaire. Pour illustrer quelques caractéristiques des dysfonctionnements de l’enseignement supérieur du Mali, le rapport 2014 de la Concertation Nationale sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur (CNAES) a constaté, avec autres, un système d’enseignement supérieur et de recherche peu performant et inefficace ; des effectifs d’étudiants pléthoriques par rapport à l’infrastructure d’accueil et d’encadrement ; une inadaptation de l’offre de formation à la demande économique et sociale du travail ; une faible capacité de gouvernance et d’adaptation ; une insuffisance et la faible valorisation des productions scientifiques, etc.
Or, bien avant ce rapport de 2014, le Forum National sur l’Éducation de 2008 avait recommandé à l’État de prendre des mesures à l’effet de désengorger l’université. C’est ainsi que la réforme des programmes et formations du lycée fut mise en application en 2011 sans qu’une attention ne soit véritablement portée sur la question du passage du secondaire au supérieur concernant les nouveaux bacheliers. En effet, la cartographie de la répartition des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur, plus précisément en sciences économiques et de gestion laisse transparaître des défaillances. Nombreux sont les bacheliers, inscrits en classe de terminale – option sciences économiques qui, sur un effectif de 18 322 étudiants en 2018 – 2019, soit 15,3% selon le Rapport du PADES 2021 ont opté pour cette faculté. Face à cette surpopulation au sein de cette faculté, l’accueil, l’encadrement et la performance du système universitaire s’en trouvent contrariés. Lors des entretiens que nous avons réalisés entre les autorités politiques et les enseignants-chercheurs, de nombreux griefs ont été formulés contre les premiers. On notait, de façon récurrente, des propos du genre : « on forme pour former sans réelle perspective de développement » ; « il faut changer la vision philosophique de la formation dans ce pays » ; « il y a un problème de planification globale » ; « il n’y a pas d’autorité éducative fortement installée ».
À ce sujet, il y a lieu de relever que le passage-éclair des responsables politiques à des postes stratégiques de l’enseignement supérieur est perçu pour les enquêtés comme un manque de projet d’avenir pour le Mali en termes d’éducation et de formation. Ceci n’est pas sans causer d’énormes désagréments aux acteurs sociaux et soulève des questions de gouvernance et de leadership étatiques. C’est cette situation peu reluisante qui prévaut dans l’administration et qui est dépeinte par un enquêté lors de notre entretien en mars 2019 en ces termes :
… au niveau supra on ne sait même pas ce qui se fait au niveau infra. (…) Le ministre vient et on sait qu’il est là parce qu’il a une certaine assise politique alors il vient, il fait son temps et il part. Le laps de temps qu’il passe au niveau du département il ne sait même pas les vrais problèmes de l’université, quels sont les vrais problèmes de l’éducation au Mali. Il n’a pas le temps de les gérer » (Samba Diallo, autorité administrative).
Même lorsque l’État a eu à opérer des reformes, les résultats escomptés n’ont pas suivi au regard de l’énormité des besoins exprimés. Ainsi, pour S. Loua (2017, p. 40),
l’école malienne a connu plusieurs réformes et innovations pédagogiques dans le but de l’améliorer et de l’adapter aux enjeux éducatifs nationaux et internationaux. Cependant, les efforts consentis pour ces réformes n’ont pas été couronnés de succès, en raison de l’immensité des besoins.
Outre ses aspects politico-historiques, la crise de l’université au Mali, se manifeste également sur le plan socio-pédagogique. Et c’est partant de ce constat que la question de l’employabilité se pose avec acuité.
2. L’employabilité à l’aune de l’orientation scolaire et universitaire
L’orientation scolaire et universitaire des élèves et étudiants est la première boussole qui mène à leur insertion professionnelle. Nos enquêtes ont mis à nu une zone d’ombre à éclaircir dans ce processus.
2.1. Du choix de la formation disciplinaire à l’employabilité
Il ressort des enquêtes par questionnaire et par entretien réalisées entre mars 2019 et mars 2021 que les choix d’orientation des élèves et étudiants se font généralement par les parents, par l’administration scolaire, par conviction personnelle mais aussi par accident. Hormis, le choix opéré par l’administration scolaire, tous les autres s’expliquent par le manque d’information sur l’enseignement supérieur et les formations disciplinaires. Nous avons observé l’inexistence d’un dispositif institutionnel devant accompagner les lycéens à cette étape décisive du cursus scolaire surtout qu’il s’agit de passer du système secondaire à celui tertiaire.
Or, il s’avère nécessaire que le néo-bachelier sache dans quelle formation il s’engage. Quelles sont ses chances d’insertion en fonction des choix de formation ? Que doit savoir le bachelier sur l’enseignement supérieur en termes d’informations générales sur les pratiques pédagogiques, les méthodes d’enseignement/apprentissage, les types d’évaluation ? Quelles sont les offres d’emploi que lui propose l’État ? Quelles sont ses chances d’insertion par rapport à son choix de formation ? Ce sont là autant de questions que parents, élèves et étudiants se posent sans que des réponses ne leur soient apportées. Si, trop souvent, ces questions restent posées ou ne trouvent pas de réponses, toutefois, il existe d’autres mécanismes non institutionnels qui constituent des alternatives aux insuffisances susmentionnées. Par exemple, le cercle amical en est l’illustration.
En effet, sur une question concernant les sources d’information sur l’enseignement supérieur, la famille reste la première source d’information du bachelier avec 41,9% des réponses. Elle est et reste incontournable dans les choix d’orientation. Ensuite vient le cercle amical, comme son nom l’indique, est une plate-forme d’informations non négligeable dans la construction des parcours de formation et d’insertion. 22,3% des bacheliers y reçoivent des informations sur l’enseignement supérieur. Puis les enseignants, représentant 21,3% des réponses comme source d’information sont suivis des directions d’établissement secondaire avec 5,8%. Le conseiller à l’orientation participe à l’information avec 2% contre 5% pour le voisinage et 1,7% « autres ».
Ces chiffres décrivent une société de type patrilinéaire où les décisions sont majoritairement prises par le chef de famille. En l’absence de celui-ci, l’oncle a le monopole des décisions suivi de l’ainé. Dans ce type de société, le choix de l’élève compte pour si peu. Ainsi, après s’être informé auprès des camarades de classe et en s’appuyant sur les éclairages de l’enseignant, le choix de la filière est fait par l’élève conformément aux indications et conseils recueillis à ce type de fonctionnement sociétal. Par ailleurs, si ce choix lui est « imposé » ou ne correspond pas à ses attentes, il y a de forte chance que cela impacte négativement sur les études.
À la sortie des facultés, ils étaient 40% sur un effectif de 406 répondants à être au chômage au moment de l’enquête et 49% des répondants ont avoué avoir mis au moins 3 ans avant d’obtenir un premier emploi contre 16% entre 6 mois et 12 mois. Cependant, ceux qui avaient eu un travail exerçaient à 65% dans un autre domaine d’activité en dehors de leur champ de formation. Pour 36% des diplômés, ce taux de chômage s’explique par le fait qu’il n’y avait pas de possibilité d’embauche correspondant à la formation suivie ; 16% disent que c’est parce que leur formation n’était pas complète ; 13% affirment que c’est parce que leur formation n’était pas professionnalisante ; 10% disent n’avoir pas été assez outillés pour chercher convenablement un emploi ; 9% affirment ne pas chercher activement du travail ; 7% disent ne pas développer de compétences réelles dans leur formation et 6% affirment qu’ils comptaient sur leur réseau relationnel pour accéder à un emploi ; seul 1% a répondu qu’il n’a pas été bien formé.
Ces chiffres montrent effectivement qu’il faudrait analyser le problème de l’employabilité du point de vue du marché de l’emploi et non simplement du point de vue de la formation et des choix des étudiants. Ainsi pour accéder au marché de l’emploi, la majeure partie des enquêtés témoigne de la nécessité de disposer d’un réseau relationnel qui favoriserait l’insertion professionnelle.
2.2. Réseau relationnel et accès à l’emploi
Le réseau relationnel (social, politique et/ou économique) n’est pas en marge des difficultés d’accès à un emploi au Mali. Il a été démontré que du fait de la rareté des postes à pourvoir, le népotisme soit un outil mobilisable pour avoir un emploi. La majorité des enquêtés pense que ce phénomène de réseau relationnel est bien réel. Notre enquête auprès des 408 diplômés (répondants) en SHS révèle à 91% l’absolue nécessité d’avoir un réseau relationnel pour avoir un emploi au Mali. Et 23% des diplômés ont reconnu avoir pu obtenir leur emploi grâce à ce réseau relationnel. Pour Patrick Dembélé, étudiant en L3 Sciences de l’éducation, il n’y a pas de doute là-dessus. Il ajoute ceci :
Je dirais que c’est une réalité absolue. C’est une vérité vraiment. Parce que moi-même j’ai tenté beaucoup de concours qui n’ont pas marché. Et finalement je me suis posé la question est-ce que finalement ce n’est pas une question de sous couvert ? et j’ai eu la confirmation avec le papa d’un enfant sur un des chantiers (BTP) où j’ai l’habitude d’y travailler. (Entretien réalisé en mars 2021).
En évoquant sa situation à ce papa, Patrick Dembélé dit avoir noué une relation avec cette personne ressource qui a même aidé sa femme ainsi que son fils ainé à obtenir un concours. Cette personne a donc mis en relation Patrick Dembélé et son ami afin de répondre favorablement à sa préoccupation. Ce dernier lui aurait demandé d’apporter vingt-cinq mille francs CFA pour le motiver dans son action en ajoutant que cela valait beaucoup plus.
Même pour la police, il y a des gens qui me demandaient de payer six-cent mille, les 1 millions, les huit cent mille. Mais je me pose la question, où est-ce que je peux trouver cet argent ? Voilà, quelqu’un qui n’arrive pas à s’habiller correctement en tant qu’un bon étudiant (Patrick Dembélé, étudiant en L3 sciences de l’éducation, mars 2021).
Pour autant, il convient aux diplômés de construire ce réseau relationnel. Cette logique socioconstructiviste du réseau est relativement partagée et prise au sérieux dans le processus d’insertion des diplômés. Recourir à un réseau relationnel n’est pas une nouveauté, il a toujours été mobilisé par le passé dans les processus de recrutement au Mali. Il semble d’ailleurs que l’expression « un coup de piston vaut mieux que 100 ans d’études » soit née sous le régime militaire au Mali entre 1968 à 1991. Depuis, elle a pris d’autres formes et continue de fortifier l’accès à l’emploi car pour Salim Coulibaly, enseignant-chercheur, les études sont le plus souvent subordonnées aux relations.
Tu vas faire ton doctorat mais quelqu’un qui a juste un bac+2 peut être ton chef parce qu’il aura bénéficié d’un coup de pouce. D’ailleurs on parlera d’ascenseur, toi tu prends l’escalier avec des efforts, avec tes entretiens et autres et lui, il prend l’ascenseur et il est vite arrivé avant toi. C’est un fait, mais je ne pense pas qu’on puisse généraliser cela. (Salim Coulibaly, enseignant-chercheur en Anthropologie, mars 2021).
Cela dit, le réseau relationnel n’est pas la seule variable d’ajustement du marché de l’emploi. Il est aussi exigé d’avoir de l’expérience pour accéder à un poste. Chose qui, d’après nos enquêtes est paradoxale du fait que les formations en SHS n’intègrent pas forcément l’obligation de stage de qualification ou de fin d’études. Le blocage se situerait donc à un niveau curriculaire où des lacunes ont été décelées dans son élaboration. Cette question curriculaire, bien que très intéressante ne sera pas l’objet de développement ici.
Cependant, on peut décrocher un emploi sans passer par un réseau relationnel quelconque. Il suffit d’avoir des compétences nécessaires et la chance de croiser des personnes qui cherchent ces compétences. Le fait de recruter sur la base de réseau relationnel ne garantit pas pour autant le maintien à ce poste ou de bénéficier d’une promotion. Il peut aussi aboutir à un licenciement si le diplômé ne démontre pas de compétences nécessaires à l’exercice de la fonction. Lors d’un entretien réalisé en mars 2021, Bamba Traoré, étudiant en master Sociologie nous disait de ne pas avoir confiance au réseau relationnel. Mais qu’il faut avoir confiance en soi. Pour lui,
Quand on s’appuie sur un réseau, le poste qu’on va occuper va être un poste fragile en quelque sorte. Ils peuvent même te mettre la pression, ils peuvent même te dicter leur loi, même en dehors des règles de la structure.
Ainsi, évoluer dans cette dynamique du « réseau » favorise ce que Giorgio Blundo, Jean-Pierre Olivier de Sardan appellent le « régime du devoir ou de la dette ». Pour G. Blundo, J-P. Olivier de Sardan (2007, p. 106),
l’investissement en sociabilité est à la fois une ressource et une contrainte permanente, activée en de multiples circonstances […] et constitue une préoccupation incessante de la vie quotidienne, à travers les multiples obligations qu’impliquent l’entretien et la reproduction des réseaux relationnels de toutes natures.
Cette posture soutient l’idée selon laquelle la structure sociale, dans son fonctionnement, participe au renouvellement des conditions de dépendance à autrui par le biais du réseau. Elle fragilise ainsi les emplois dans leurs modes d’occupation. Ces dynamiques sont donc en partie descriptives de la situation de crise de l’université lorsqu’on s’intéresse à la question de l’employabilité au Mali. Par ailleurs, la crise de l’université au Mali se manifeste également à travers des dynamiques institutionnelles conduisant aux impasses en matière d’accès à l’emploi.
3. Dynamiques institutionnelles et impasses de l’insertion professionnelle
Outre les logiques sociales et relationnelles dans lesquelles le diplômé a du mal à s’extirper, il existe des mesures institutionnelles qui lui obstruent l’accès à l’emploi après sa formation. En effet, il a été constaté, d’après les observations de terrain, que deux logiques de recrutement coexistent le plus souvent dans les institutions publiques qui organisent les concours d’entrée dans l’administration. Il s’agit du recrutement par méconnaissance des formations universitaires et du recrutement par ancienneté ou par confiance tacite.
3.1. Le recrutement par méconnaissance des formations universitaires
Par le système de recrutement par méconnaissance des formations universitaires nous entendons un processus d’organisation des concours de la fonction publique qui ne tiendrait pas compte des formations universitaires. Cette méconnaissance s’explique par la distance qui sépare les décideurs des acteurs administratifs et pédagogiques dans la mesure où il n’existe pas d’espace de dialogue entre les institutions. Nous avons pu observer que l’organisation des concours de la fonction publique ne prenait pas en compte la logique « compétence attendue » du marché mais plutôt obéissait à une double logique d’organisation descendante et financière ; c’est-à-dire qu’elle répondait à des besoins spécifiques de la hiérarchie et des fonds mis à disposition par le ministère de l’économie.
En effet, c’est le ministère de l’économie et des finances qui, chaque année alloue une enveloppe budgétaire pour l’organisation des examens et concours de la fonction publique. Après la centralisation des besoins par le centre national des examens et concours de la fonction publique, les agents les réorganisent en recomposant un tableau cumulatif des besoins similaires exprimés par spécialité, par niveau d’étude et par quota. C’est en fonction de ce tableau cumulatif et surtout le volet « quota » que les agents du centre font un premier tri des corps retenus pour le concours.
Ce processus de recrutement semble être inversé d’autant plus que c’est l’enveloppe budgétaire qui structure et conditionne le processus de recrutement des agents de la fonction publique et non les besoins réels du marché de l’emploi. Ce système puise sa source dans les programmes d’ajustement structurel des années 80 au Mali. C’est une gouvernance pilotée par les finances. À en croire les propos de Pierre Porgo, recueillis en novembre 2021,
tous les concours au Mali sont organisés de cette façon, que ce soit le recrutement dans l’armée nationale, dans la gendarmerie, la garde ou la police nationale ou dans les services techniques et administratifs du pays. C’est un processus qui obéit jusque-là à la restriction budgétaire (Pierre Porgo, autorité politique chargée de recrutement).
Le système organisationnel des concours est basé sur une démarche descendante du ministère de l’économie et des finances vers le ministère de la fonction publique. Or ce fonctionnement ne répond quasiment jamais aux besoins de l’économie du marché et aux attentes des départements demandeurs de mains d’œuvre spécifiques. Il s’agit là d’abandonner cette logique descendante pour accorder une place prépondérante à une logique conjonctivo-structurelle. Le système financier ne devrait pas déterminer les actions publiques. L’institutionnalisation financière des recrutements entrave donc l’émergence et l’adaptabilité de compétences dans un marché en perpétuelle mutation. À côté de ce système de recrutement, il y a aussi le recrutement par ancienneté ou par confiance tacite.
3.2. Le recrutement par ancienneté ou par confiance tacite
Ce type de recrutement est un système qui fragilise le processus d’insertion des diplômés en accordant plus d’importance à l’expérience professionnelle au détriment de la qualification. Ce système de recrutement semble s’être institutionnalisé au regard de la loi n° 08-019 du 22 juillet 2008 portant modification de la loi n°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation de l’éducation au Mali. En effet, cette loi abroge l’article 60 de la loi n°99-046 du 28 décembre 1999 qui stipule que,
les fonctions de chef d’établissement, de conseiller pédagogique, d’inspecteur et de directeur de Centre d’Animation Pédagogique (CAP) sont soumises à un concours. Les modalités d’organisation de ce concours sont fixées par arrêté des ministres en charge de l’éducation.
Ce faisant, l’État donne aux réseaux relationnels une faille à exploiter à bon escient car la validation des acquis de l’expérience suffit à justifier les nominations des personnes pour occuper des postes. C’est par ce biais également que s’organisent et s’intensifient « le régime du devoir ou de la dette » (G. Blundo, J-P. Olivier de Sardan, 2007, p. 102). Cependant, des voies se lèvent pour revenir à cet article 60 même si les acteurs eux-mêmes n’ont pas conscience de l’abrogation dudit article. Face à ce fait, Ibou Sangaré dit qu’il faut qu’on change de fusil d’épaule. Il ajoute,
que les administrateurs soient recrutés non pas forcément par rapport aux expériences mais par rapport aux diplômes de base. On ne va pas demander à un pharmacien pourquoi il est pharmacien, donc on ne doit pas demander un sortant des sciences de l’éducation pourquoi il est censeur ou directeur d’école ? (Ibou Sangaré, autorité politique et universitaire).
Conclusion
L’employabilité des diplômés est un sujet qui préoccupe l’ensemble des acteurs socio-politiques et administratifs du Mali. Elle donne à voir une dimension intégrative et distributive des offres de formations universitaires pour rendre compte de leur opérationnalité sur le marché de l’emploi. Tout en restant vigilant sur la pertinence du lien de causalité entre la qualité de formation et l’insertion professionnelle, nous attirons l’attention sur des facteurs multiples qui conduisent à maintenir les universités maliennes dans une situation de crise perpétuelle et à la problématique d’employabilité des diplômés. Malgré cette vigilance, l’employabilité au sens d’insertion professionnelle en devenir constitue un indicateur commun des acteurs sociaux, politiques et économiques pour mesurer la pertinence des offres de formation universitaires. Cependant la chronicité et la variabilité des situations de crise de l’université ne facilitent pas l’appréhension des dynamiques socio-politiques et pédagogiques qui se mettent en place pour contenir ou aggraver le chômage au Mali.
L’individuation des parcours de formation et d’insertion bute contre un obstacle socioconstructiviste qui structure le fonctionnement relationnel entre les offres de formation et le marché de l’emploi. Ainsi, l’employabilité se traduit par la prise en compte des logiques et dynamiques socio-politiques et pédagogiques qui façonnent le rapport au savoir des étudiants et l’insertion professionnelle des diplômés. Loin de faciliter l’accès au marché de l’emploi, les logiques institutionnelles d’organisation des recrutements créent elles aussi des situations qui écartent de plus en plus les diplômés de ce marché en constante mutation. Des recrutements par méconnaissance aux recrutements par ancienneté, ces logiques entravent l’accès au marché du travail aux plus méritants et fragilisent ainsi la dynamique de compétence et du maintien dans le travail.
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 1972, La crise de la culture, Paris, Gallimard.
BLUNDO Giorgio, OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2007, « La corruption quotidienne en Afrique de l’Ouest », in Giorgio Blundo & al., État et corruption en Afrique, pp. 79-117.
CNAES, 2014, Un enseignement supérieur et une recherche de qualité répondant aux besoins socio-économiques et culturels du pays et ouverts sur l’environnement régional et international, Bamako, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
DIAKITÉ Drissa, 2000, « La crise scolaire au Mali », in Nordic Journal of African Studies, Vol 9 (N°3), pp. 6-28.
GUTH Suzie, 1990, « Note de synthèse, l’école en Afrique noire francophone : une appropriation institutionnelle », Revue française de pédagogie, pp. 71-97.
ISAMBERT-JAMATI Viviane, 1980, « Comment une école importée favoriserait-elle un développement socioéconomique autonome ? Proposition pour analyser le fonctionnement d’un système éducatif », in CEDEJ-Égypte/Soudan, pp. 1-6.
LOUA Seydou, 2012, Efficacité interne de l’enseignement supérieur malien, thèse de doctorat de Sciences de l’éducation, Université Lumière Lyon 2
LOUA Seydou, 2017, « Les grandes réformes de l’école malienne de 1962 à 2016 », in Revue internationale de Sèvres, pp. 34-40.
ONEF, 2017, Enquête nationale sur l’emploi auprès des ménages en 2016, Bamako, Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle du Mali.
PADES, 2021, Enseignement supérieur du Mali, État des lieux en 2020, Bamako, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
TRAORÉ Idrissa Soïba, 2010, « La crise scolaire : la fille de la crise des valeurs sociales », in Symposium Malien sur les Sciences Appliquées (SMSA), Actes de la conférence, pp. 256-262.
Université de Maroua (Cameroun)
Résumé :
Comme d’habitude, il y a en Afrique un hiatus entre les déclarations politiques et les réalités de terrain. S’agissant de l’enseignement supérieur, un slogan circule depuis le début des années 2000 concernant la professionnalisation des enseignements. Mais, si quelque chose a été fait depuis lors, cela concerne en grande partie la production des documents administratifs y afférents et où Système LMD et professionnalisation des enseignements se discutent les pages sans savoir trop qui fait quoi. L’objectif est noble puisque qu’il s’inscrit dans les politiques gouvernementales de « Formation – Emploi » mais les attentes sont loin d’être comblées. Résultat, des particuliers se lancent dans la création des instituts privés d’enseignement supérieur en brandissant des formations dites diplômantes et qualifiantes en termes d’emploi. Clandestins ou reconnus par l’État, ces établissements accueillent de nombreux jeunes décidés à tout tenter pour obtenir un emploi. Là aussi, la réalité est tout autre. On en vient à cette situation peu gaie où, d’un côté, l’État peine à rendre effective la professionnalisation des enseignements et continue de créer d’autres universités d’enseignement général pour satisfaire les demandes politiques, et de l’autre, des particuliers qui ouvrent çà et là des instituts supérieurs délivrant des diplômes qui n’ont de professionnel que le partenariat qu’ils ont noué avec des universités étrangères qu’ils qualifient eux-mêmes de prestigieuses. Peut-être faudrait-il s’entendre sur ce qu’on appelle professionnalisation des enseignements et mobiliser les ressources appropriées pour la rendre effective plutôt que de rester dans le « harcèlement textuel » comme c’est le cas actuellement.
Abstract :
As usual, there is in Africa a hiatus between politiical declarations and the realities on the field. Concerning higher education, a slogan is in motion since the begining of the year 2000 in regard to the professionalisation of education. But if something have been done since then, that concerns in a greater portion the production of administrative documents related and where the LMD system and professionalisation of education are quarreling the pages without really knowing who is doing what. The objective is noble since it registers in the governmental politics of « Training – Employing ». But expections are far from being met. Result, some particulars get launch in the creation of private institutions of higher education brandisching so-called diploma and qualifying training in terms of job. Clandestine or recognized by the State, these structures welcome many youths who are decided to try everything to get a job. There to, the reality is quite different, we come to this not very in a cheerful situation where on the other hand, the State finds difficult to render effective the professionalisation of education and continues to create other universities of general education to satisfy the political demands, while on the other side, some particulars open structures of higher training that deliver diplomas that are not professional than the partnership they have linked with foreign universities that they themselves qualify prestigeous. Maybe we should get along on what we call professionalisation of education and then mobilise resources appropriate to render effective rather than staying in the « textual harassment » like the case is acttually.
Keywords : Education, employment, private institutions of higher education, professionalisation of education, univerties.
Introduction
Parmi les multiples crises qui minent l’Afrique actuellement, figure en bonne place la crise universitaire qui touche un levier important du développement du continent. La vocation d’une université, c’est effectivement la recherche, la recherche pour le développement. Mais la démocratie cognitive observée actuellement en Afrique qui se traduit par une inflation institutionnelle répond plutôt à un autre objectif.
En effet, les politiques africains qui promeuvent ces universités ou qui les baptisent en leurs noms ne les considèrent pas comme des lieux d’incubation de développement. Ils y voient plutôt des offres d’emploi ou à défaut, des casernes estudiantines. Bien que le plein emploi ne soit pas contraire au développement, les politiques utilisent l’offre d’emploi pour se débarrasser d’une jeunesse de plus en plus nombreuse et gênante. Certes, la multiplication des offres d’éducation et de formation relève du rôle régalien de l’État mais les décideurs politiques croient peu ou pas au rôle décisif des intellectuels dans le processus de développement.
On en vient donc à cette situation où les pôles d’excellence sont réduits aux pôles d’emploi et on invoque désormais la professionnalisation des enseignements pour résoudre le problème grandissant du chômage. Mais cette professionnalisation est problématique, elle peine à prendre corps sur le terrain et suscite des interrogations de fond quant aux ressources utilisées pour la rendre effective. Au-delà des ressources matérielles et financières qui se font souvent rares, il faut questionner les ressources humaines chargées d’implémenter le processus. Vu le système de recrutement du personnel enseignant basé sur la simple détention du Doctorat/Ph.D, de quelle qualification dispose celui-ci pour rendre les étudiants et les enseignements professionnels ? Et par où doit-on commencer pour professionnaliser les enseignements dans des universités qui manquent de laboratoires, de salles de cours et même des bureaux ? Par ailleurs, les instituts privés d’enseignement supérieur (IPES) qui profitent de ces manquements pour se faire une place dans ce domaine s’acquittent-ils honorablement de leurs tâches ?
L’objectif de cette réflexion est alors de dénoncer la surenchère qui se construit autour de ce processus dont la seule expression exerce une fascination sur la communauté éducative. La méthode analytico-critique que nous utiliserons ici nous permettra de voir ce qui est réellement fait et ce qui manque dans les universités africaines en matière de professionnalisation des enseignements amorcée il y a quelques années[58]. Ce diagnostic nous amènera à proposer quelques solutions pour une professionnalisation effective. Les universités africaines ne sont pas logées à la même enseigne mais les réalités sont presque les mêmes au Sud du Sahara.
1. Les paradoxes de la professionnalisation des enseignements
Depuis une dizaine d’années, le taux de scolarisation en général et de la formation universitaire en particulier a augmenté un peu partout en Afrique : la pression démographique, le contexte économique et la demande sociale de formation ont conduit les différents gouvernements à multiplier les établissements d’enseignement et à diversifier les offres de formation. Si le souci quantitatif a été plus ou moins relevé, il existe des nouveaux défis d’ordre qualitatif, notamment ceux liés aux contenus des enseignements et leur fiabilité sur le marché de l’emploi. D’où les discours ronflants sur la professionnalisation des enseignements, mais de quoi s’agit-il exactement ?
1.1. Enquête définitionnelle
Le chômage ambiant dû à l’inadéquation entre la formation et l’emploi et la saturation de la fonction publique ont amené les pays africains à décider, à des dates différentes, de la réorientation de l’éducation vers les secteurs techniques à même de promouvoir l’auto-emploi ou de répondre aux besoins des entreprises.
De là, pour le commun des mortels, professionnaliser veut dire qualifier à un emploi, ce qui n’est pas faux. Et c’est même en cela que le terme professionnalisation fascine puisqu’il s’agit enfin de faire des études au bout desquelles on pourra avoir accès à un emploi. Mais cette acception commune n’épuise pas tous les contours de la professionnalisation des enseignements.
Dans le Document de Stratégie du Secteur de l’Education et de la Formation (2013-2020) produit parle Ministère camerounais de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), nous pouvons lire que
L’enseignement professionnel est un enseignement destiné à donner les premiers niveaux de qualification nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’un groupe de métiers. Il permet le développement des qualifications à l’exercice d’un métier ou un groupe de métiers à travers les études techniques théoriques en rapport avec ce métier ou groupe de métiers. L’enseignement professionnel est diplômant. (2013, p. 13).
Ainsi défini, l’enseignement professionnel n’est pas exactement la formation professionnelle qui est un ensemble d’activités visant à assurer l’acquisition des connaissances (savoirs), des qualifications (savoir-faire) et des attitudes (savoir-être) nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession avec compétence et efficacité. L’enseignement professionnel se dispense dans les lycées et collèges et peut aller au-delà – la plupart des ministères africains en charge de l’éducation disposent des directions de l’enseignement technique et professionnel – mais l’expression « professionnalisation des enseignements » a aujourd’hui une connotation particulièrement universitaire, non pas parce que les lycées professionnels n’existent pas, mais parce que l’éducation formelle s’est démocratisée et on s’inquiète désormais seulement des diplômés du supérieur qui manqueraient de travail.
Le 22 février 2022, le Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur du Cameroun, le Professeur Jacques Fame Ndongo, indiquait à travers un arrêté qu’« une filière professionnelle est un champ scientifique et matériel de la formation universitaire qui permet à un apprenant d’acquérir des habiletés et des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier ». Cette définition englobe déjà les écoles de formation logées dans les universités, mais la question reste lancinante s’agissant des établissements facultaires, surtout qu’un autre ministre camerounais, celui-là de l’emploi et de la formation professionnelle, Monsieur Issa Tchiroma Bakary, a créé dernièrement la polémique en affirmant haut et fort que les filières comme Histoire et Géographie ne donnent pas du tout accès à l’emploi et qu’elles ne devraient pas être choisies par les jeunes. On peut donc s’interroger sur le sens de la professionnalisation des enseignements dans les facultés des lettres.
Dans un article paru en 1997 à l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, D. Maingari (D. Maingari, 1997, p. 106) soulignait que la professionnalisation de l’enseignement a deux orientations : la professionnalisation d’expertise et la professionnalisation d’exercice pour spécifier et qualifier d’un côté l’intégration des attributs professionnels par des enseignants et décrire de l’autre les aspects et les conditions relatifs à l’adéquation formation – emploi. Il s’en explique ainsi :
L’orientation interne de la professionnalisation que nous qualifions de « professionnalisation d’expertise » concerne le passage de l’enseignement de métier à profession et sa constitution en un véritable corps avec des données requises dans le contenu de la formation et les signes extérieurs caractéristiques d’un corps de profession comme le parrainage des promotions, des prestations de serment, des remises solennelles de diplômes, des tenues particulières, etc. Il s’agit dans cette dimension de la professionnalisation de donner aux enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur les qualifications nécessaires à l’exercice de leur profession et reconnues par des textes, règles, règlements et codes déontologiques particuliers.
L’orientation externe ou professionnalisation d’exercice (…) se préoccupe quant à elle de la mise en relation de la formation avec l’emploi.
Nous pouvons donc dire après l’auteur que la professionnalisation est le processus ayant pour finalité l’acquisition des aptitudes nécessaires à l’exercice d’un emploi. S’agissant de la professionnalisation des enseignants, elle peut être définie comme le processus permettant la transformation des enseignants de façon à faire acquérir aux apprenants les outils nécessaires à l’exercice des métiers précis. Ce qui suppose que l’on aura affaire à des enseignants qui font leur travail avec professionnalisme, c’est-à-dire selon les règles de l’art et avec objectivité. Mais qu’observe-t-on sur le terrain ?
1.2. La professionnalisation par les amateurs
Prenons le premier volet de la professionnalisation qui concerne les enseignants eux-mêmes. L’Article 36, alinéa 1 de la Loi N° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’enseignement supérieur au Cameroun stipule bien que, l’enseignant, étant le principal garant de la qualité des enseignements et des formations dans les instituts d’enseignement supérieur, a droit à une formation initiale et continue appropriée. Mais de quelle formation dispose les enseignants d’université ? Comment s’opère leur recrutement ?
Les enseignants d’université sont recrutés sur la base d’une détention d’un Master ou d’un Doctorat académique. Qu’appelle-t-on donc « formation initiale » ? Si nous entendons par là, comme le veulent certains, les cours théoriques suivis à l’université, on peut dire qu’ils en ont une puisqu’ils ont passé des nombreuses années sur les bancs des amphithéâtres ; mais si nous admettons avec d’autres que « la formation initiale est une formation à un métier, qui donne à l’individu une qualification professionnelle (P. Touzard, 1988, p. 110), il va sans dire que les enseignants d’université n’ont pas de formation initiale. Et qu’en est-il de la formation continue ? Il n’existe presque pas de tutorats, sinon quelques heures d’une journée ordinaire appelée « journée de pédagogie universitaire » pour les besoins de la cause ou pour justifier quelques lignes budgétaires. La question qui mérite d’être posée est alors celle de savoir comment quelqu’un qui apprend à enseigner sur le tas peut rendre un autre professionnel. On estime par là que des amateurs peuvent professionnaliser l’enseignement supérieur, le haut niveau du savoir. Le doctorat est-il un diplôme de qualification pour l’activité enseignante ?
L’évènement le plus surprenant au Cameroun c’est que dans le cadre du recrutement spécial des titulaires de Doctorat/Ph. D comme enseignants dans les universités d’État en 2020, les autorités ont pris le soin d’écarter les professeurs des lycées docteurs, c’est-à-dire ceux-là mêmes qui ont reçu une formation d’enseignant dans les écoles normales supérieures, qui ont donc des compétences avérées dans le domaine et qui de surcroit ont le diplôme requis, arguant qu’elles veulent lutter contre le chômage. Préférerait-on le learning by doing ou la formation par trials and errors pour les professeurs d’université ? Quoiqu’il en soit, on a ainsi sacrifié la compétence sur l’autel de la lutte contre le chômage et je doute fort que l’université puisse jouer pleinement son rôle dans ces conditions.
Le recrutement se fait sur audition des candidats, et non par concours écrit, ce qui n’exclue pas la compétition mais l’objectivité est réduite. À son époque, M. Weber (1959, p. 58-59) disait qu’il ne connaît pas de carrière au monde où l’arbitraire joue un très grand rôle comme dans la carrière universitaire. Il constatait qu’« un grand nombre de médiocres jouent incontestablement un rôle considérable dans les universités », que « les médiocres et les arrivistes ont seuls une chance d’être nommés. » « Aucun professeur d’université disait-il, n’aime se rappeler les discussions qui eurent lieu lors de sa nomination, car elles sont rarement agréables. » Pour l’auteur, la décision concernant les destinées universitaires est livrée dans une grande mesure au « hasard ». Mais il nous invitait surtout à faire la différence entre le savant et le professeur. Les deux qualités doivent être réunies chez l’enseignant d’université mais malheureusement, remarque-t-il, « l’on peut être un savant tout à fait éminent et en même temps un professeur terriblement médiocre. » (M. Weber, 1959, p. 59).
Lorsqu’on recrute donc les enseignants ou qu’on leur confie des chaires universitaires dans ces conditions, il va sans dire qu’on ne choisit pas forcément les meilleurs. Et le résultat qu’on connaît actuellement c’est la crise des vocations scientifiques.
2. La professionnalisation de l’enseignement supérieur : l’emploi contre la recherche
Autrefois, les débats sur la professionnalisation des enseignements se concentraient sur la possibilité de faire de l’université à la fois un lieu de recherche et un lieu de formation professionnelle. Pour certains, l’université de par sa mission traditionnelle, est mal adaptée pour assurer des formations professionnelles. C. Perron, M. Lessard et P. W. Bélanger (1993, p. 22) estiment qu’« il est possible que la logique de la professionnalisation d’une part et celle de l’excellence universitaire d’autre part (…) soient à terme incompatibles et qu’à poursuivre les deux dans un même cadre institutionnel, on se condamne à un relatif échec sur les deux tableaux ». Pour d’autres par contre, l’instauration d’une formation professionnelle à l’université est tout à fait possible car l’université jouerait alors un rôle de légitimation des savoirs pratiques. Le débat n’est plus d’actualité aujourd’hui, les universités sont résolument engagées sur le chemin de la professionnalisation des enseignements. Mais la poursuite de deux objectifs, ajoutée au recrutement hasardeux du personnel enseignant, a un impact négatif sur la recherche.
2.1. La crise des vocations scientifiques
Si la qualité et le dynamisme des chercheurs africains sont incontestables, il n’en demeure pas moins que nous sommes confrontés à une crise préoccupante des vocations scientifiques. Les docteurs sont nombreux mais les chercheurs le sont moins. Cette désaffection tient sans doute aux conditions précaires dans lesquelles vivent les enseignants et le sous-financement des secteurs de la recherche publique et privée.
En 1987, période de soudure au Cameroun, le Bureau International du Travail (BIT) indiquait qu’à l’Université, « les professeurs et les assistants travaillent comme consultants auprès des sociétés privées et consacrent moins de temps à leurs étudiants et encore moins à la recherche. » (BIT, 1987, p. 10). Ce qui a été dit il y a près de quarante ans n’a pas beaucoup changé aujourd’hui. Les conditions de vie de l’enseignant ne sont pas les plus enviables. Lorsqu’un enseignant peine à joindre les deux bouts, c’est la recherche qui en pâtit. La prime spéciale de recherche octroyée ici par le Chef de l’État et aléatoirement payée par les ministres des finances et de l’enseignement supérieur permet, non pas de booster la recherche, mais d’arrondir les fins du trimestre. La recherche et les publications sont faites dans le but de changer de grade et donc de changer son indice solde.
Il en va de même des laboratoires subventionnés par l’État même si les raisons ne sont pas les mêmes. Les pays africains disposent des ministères de la recherche scientifique, de l’innovation, ainsi que des facultés de médecine et des sciences pharmaceutiques mais ils importent le paracétamol ; ils disposent des instituts de bois mais ils importent le cure-dents. Les centres de recherche en agronomie sont disséminés à travers le continent mais on importe le blé et le riz ; les écoles de mines, de géologie et de pétrochimie ne parlent pas encore le langage de l’extraction et de la transformation. C’est dire combien la recherche n’est pas prise au sérieux. Nos chercheurs sont devenus des politologues. On connaît plus les directeurs des centres de recherche par leurs descentes sur le terrain politique que par les résultats de leurs institutions. Les professeurs d’université quant à eux ont déserté les laboratoires et se discutent les plateaux de télévision pour livrer leurs regards politiques.
Outre les conditions difficiles de vie qui plombent la recherche, la communauté universitaire est aujourd’hui divisée, non pas à cause des paradigmes scientifiques qui peuvent normalement changer, mais à cause d’une pluralité des rationalités qui sont en réalités des idéologies qui n’ont rien à voir avec la science. Le chercheur d’aujourd’hui est plus enclin à vilipender les autres qu’à construire les savoirs.
Le pugilat payé est beaucoup plus visible en philosophie, science par excellence des contradictions. Aux dires de J. Bouveresse qui cite MacIntyre,
Les divisions à l’intérieur des départements de philosophie sont devenues telles que l’on peut se demander s’il est encore possible de s’adresser à la communauté académique ou même simplement à la communauté philosophique en tant que telles. La plupart des livres de philosophie sont destinés à un groupe de lecteurs réduit aux dimensions d’une tendance, d’une école et même quelque fois simplement d’une chapelle, pratiquement jamais à la communauté des philosophes elle-même. Les désaccords sont si fondamentaux et profonds qu’il n’est plus possible de parler de conflits et de controverses qui ont lieu dans le cadre d’une conception commune de la rationalité, mais de conceptions rivales de la rationalité elle-même, à la fois théorique et pratique (J. Bouveresse, 2002, p. 89).
En effet, comme l’écrit MacIntyre, les discussions actuelles en philosophie concernent non seulement la question de savoir ce qui peut être considéré et accepté comme une justification rationnelle, mais également celle de l’intérêt et de l’importance qu’il convient d’accorder à l’idée même de justification rationnelle et, pour couronner le tout, celle de l’utilité et de la nécessité de la discussion en philosophie. Aujourd’hui, on est très éloigné des vrais débats philosophiques. On n’arrive même pas la plupart du temps à la rencontre et à la confrontation. Les représentants des différentes écoles ne partagent souvent presque rien entre eux, en dehors de l’appartenance à une même institution académique. Visiblement, la science a cédé la place à l’idéologie.
Dans un tel climat, il ne peut y avoir ni professionnalisation des enseignements ni professionnalisation des enseignants. Et avec tous ces manquements, les gens se tournent vers les instituts privés en espérant y trouver une formation professionnelle adéquate mais cela ne va pas non plus sans problèmes.
2.2. Le piège du privé ou l’emploi contre l’éducation
La professionnalisation des enseignements impulsée par l’État est assurée en grande partie par les instituts privés de formation. Identifiant les lacunes de ce processus au Cameroun, le Document de Stratégie du Secteur de l’Education et de la Formation (2013-2020) réalisé par le MINEPAT fait état d’« un partenariat avec les acteurs privés peu dynamique dont le renforcement serait bénéfique pour la professionnalisation de l’enseignement supérieur et le développement des formations professionnelles dans les secteurs porteurs de l’économie » (2013, p. 45). C’est dire ici que l’État lui-même compte sur le privé pour rendre ce processus effectif. Les portes de la fonction publique étant de plus en plus fermées aux nouveaux diplômés, il y a une ruée vers les instituts privés où il y a promesse d’emploi.
Le Cameroun par exemple compte à ce jour 349 IPES, tous ne jurent que par la qualité des diplômes et l’assurance de l’emploi ; les spots publicitaires inondent les médias, annonçant parfois des diplômes internationaux mais le chômage des jeunes va grandissant. Cela se termine même souvent par l’arnaque. La course à l’emploi est devenue aujourd’hui un piège dans lequel est tombée l’éducation.
En principe, l’emploi doit s’adosser sur une éducation initiale solide mais le chômage a brouillé les repères si bien qu’on recherche avant tout l’emploi. On se soucie peu de la culture générale et de l’éducation morale des apprenants, on veut juste leur permettre de tirer leur épingle du jeu dans un monde devenu difficile à vivre. Dans le Répertoire de l’offre de formation de l’Enseignement supérieur au Cameroun (MINESUP, 2022, p. XVII), il est clairement dit que
La Stratégie Nationale de Développement (SND 2020-2030) met un accent particulier sur la contribution du secteur de l’éducation à l’atteinte de l’objectif d’émergence du Cameroun, avec pour ambition de procéder à la transformation structurelle de l’économie, à travers la promotion d’un « système éducatif à l’issue duquel tout jeune diplômé sera sociologiquement intégré, bilingue et compétent dans un domaine capital. » (…) C’est dans cette mouvance que le sous-secteur de l’Enseignement supérieur se propose d’orienter sa stratégie vers le triptyque : « professionnalisation – employabilité des diplômes – assurance qualité. ».
Suivant cette orientation, l’accent est mis sur l’insertion socio-professionnelle tandis que le volet moral est escamoté. On forme d’abord à l’emploi pour parler plus tard de déontologie professionnelle. On nous objectera peut-être que l’enseignement supérieur a dépassé le stade d’éducation civique et morale mais le tout professionnel peut conduire à une société perverse.
En effet, l’éducation aujourd’hui a des orientations utilitaires ; les individus sont formés pour se « débrouiller », pour « s’en sortir », pour « entreprendre » bref, à l’auto-emploi. Du constat de J. Leif et G. Rustin (1970, p. 136),
ce n’est plus la société qui impose à ses membres les exigences de son utilité et de sa prospérité ; ce sont les individus qui s’efforcent de tirer de la société le maximum d’avantages et d’agréments. Elle est, pour eux, comme un échiquier compliqué ; et l’éducation se propose de les mettre en mesure d’y jouer au mieux, d’y obtenir une place aussi profitable et honorifique que possible. Bien que ce but ne soit pas toujours ouvertement reconnu, il est pourtant très souvent, plus ou moins consciemment, visé.
La culture que l’on donne, scientifique ou littéraire, n’est alors conçue qu’en fonction des utilités pratiques. Former l’homme d’action ou de caractère, c’est dans ce cas l’armer pour la vie où il ne pourra se soustraire aux difficultés. D’ailleurs, les établissements de formation ne s’en cachent pas, leurs devises rodent toujours autour des termes emploi, réussite ou technoscience qui est en passe de devenir le but même de l’école. C’est ce que dénoncent les auteurs de l’École nouvelle. Pour M. A. Phouet Foe, C. Owona Amougui, T. Mbassi Ondoa et P. Ombiono, (2022), la professionnalisation des enseignements par le truchement de l’Approche par Compétences relève d’une vision économiste et techniciste de l’école voulue par l’économie néolibérale.
Pendant ce temps, l’État dit exercer un contrôle sur l’enseignement supérieur mais a-t-il vraiment le regard sur ce qui se passe dans le privé qui, manifestement, n’existe que pour la recherche de l’emploi ? Déjà le nombre d’établissements privés clandestins dépasse ceux qui sont en règle, ce qui jette un doute sur le sérieux qui pourrait s’y jouer. Ainsi, l’État doit lui-même d’abord chercher des solutions et être regardant sur le respect des valeurs républicaines.
3. Quelques solutions pour booster la professionnalisation des enseignements
Il serait injuste et inexact de ne voir qu’échec dans le processus de professionnalisation des enseignements. Ces dix dernières années, le nombre d’écoles normales supérieures a augmenté, des instituts consacrés à l’étude du climat, de la technologie, de l’agriculture, de la santé, de l’eau et de l’énergie, des mathématiques, de la gouvernance, etc. ont vu le jour au sein de l’Université Panafricaine (UPA). Des nouvelles universités, comme l’Université inter-États Cameroun-Congo, ont été créées avec un point d’honneur sur le développement du numérique. Dans certaines facultés des Lettres, l’entreprenariat a été introduit. Un vrai bilan sans faux procès montre que la professionnalisation des enseignements a franchi un cap, mais beaucoup reste à faire, allant de la formation des formateurs à la disponibilité des infrastructures de formation.
3.1. L’urgence de la formation et du recyclage des enseignants
Disons-le sans détour, il faut créer une école de formation pour les enseignants du Supérieur. Si cela paraît intenable parce qu’on ne recrute pas les enseignants d’université tous les jours, il faudra tout au moins mettre un accent particulier sur le tutorat afin d’aider les jeunes enseignants universitaires à acquérir, sous le guide d’un parrain rompu dans le métier, les non-dits et les astuces du métier sans lesquels il ne sera qu’un professionnel de l’enseignement, mais jamais un enseignant professionnel. Autrement dit, il exercera le métier d’enseignant uniquement pour ses attributs économiques et sociaux sans en épouser l’esprit et la philosophie. Il est inutile et trompeur de prendre six heures parmi les milliers que compte l’année académique pour spéculer sur la pédagogie universitaire. Il faut que les enseignants bénéficient d’une formation initiale et continue appropriée dans des structures spécialisées ou auprès de leurs pairs.
La formation professionnelle s’acquiert, certes, dans les centres de formation, mais aussi sur le terrain, au contact des réalités humaines et économiques. Les réalités de terrain sont variées et changeantes. Il faudra donc procéder à des adaptations. Les changements économiques et sociaux, l’évolution des techniques font qu’à un certain moment, la formation initiale devient insuffisante, il faudra alors mettre en place des actions de recyclage encore appelé formation continue.
Comme le suggère D. Maingari, il faut qu’à la professionnalisation des enseignements, corresponde un modèle pédagogique adéquat. Il propose la pédagogie de l’alternance développée par R. Bourdoncle mais se heurte aussitôt à une inquiétude de taille :
seulement, les enseignants, avant d’y préparer les élèves comme les y invitent les textes proposant les réformes y sont-ils préparés eux-mêmes ? La rareté des stages et des rencontres pédagogiques dans le primaire, le secondaire comme dans le supérieur, la faible utilisation des données des recherches et la timidité de la collaboration entre les universitaires et les chefs d’entreprises rendent pour l’heure difficile sa mise en application. (D. Maingari, 1997, p. 109).
Ceci montre que le chemin de la professionnalisation des enseignements est parsemé d’embûches, allant de la non-préparation des enseignants eux-mêmes aux tracasseries rencontrées pour obtenir les stages en entreprise.
Nous suggérons donc que les États créent des écoles qui soient à la fois des laboratoires pédagogiques pour la recherche universitaire, des écoles d’application, et des lieux de pratique pour la formation des futurs enseignants ; ce qui requiert aussi des infrastructures adéquates. Créer des universités, c’est bien mais il faut aussi penser aux infrastructures devant les faire fonctionner. Les universités coloniales sont vétustes, les nouvelles universités ne jurent que par les nouvelles technologies mais manquent de laboratoires. Cet état de choses doit être corrigé si l’université africaine veut assumer sa double tâche de pôle d’excellence et d’incubateur de l’emploi.
Cela fait, il faudra garder à l’esprit que la professionnalisation des enseignements ne doit pas reléguer les normes sociales au second plan.
3.2. Professionnaliser et socialiser
La professionnalisation des enseignements ne doit pas occulter la recherche universitaire tout comme elle ne doit pas écarter l’aspect moral de l’éducation. De nos jours, les systèmes éducatifs recherchent le bon citoyen ou le grand technicien, bref, la réussite sociale mais nous ne devons pas perdre de vue que l’essentiel c’est d’abord l’homme lui-même, c’est-à-dire les valeurs humanistes, notamment la liberté et la justice.
Les fins de l’éducation peuvent varier selon les sociétés mais il y a des valeurs universelles que toute éducation doit promouvoir. Il est important d’apprendre à gagner sa vie et subsister mais la véritable éducation doit regarder au-delà. Elle doit en définitive former l’homme. L’idéal de l’homme c’est à la fois le lettré, l’homme d’action, l’homme de science, l’homme libre et juste. Aux dires d’E. Morin (2012, p. 251),
aujourd’hui, le problème de l’éducation et de la recherche sont réduits à des termes quantitatifs : « davantage de crédits », « d’avantages d’enseignants », « d’avantage d’informatique », etc. on masque par là la difficulté majeure que recèle l’échec de toutes les réformes successives de l’enseignement : on ne peut pas réformer l’institution sans avoir au préalable réformé les esprits, mais on ne peut pas réformer les esprits si on n’a pas au préalable réformé les institutions.
Certes, reconnaît l’auteur, il faudra bien du temps, des débats et des combats, des efforts pour la révolution de la pensée qui est morcelée dans les différentes disciplines. Bien sûr, dit-il, l’étude de la littérature, de l’histoire, des mathématiques, des sciences contribue à l’insertion dans la vie sociale, et les enseignements spécialisés sont nécessaires à la vie professionnelle. « Mais avec la marginalisation de la philosophie et de la littérature, il manque de plus en plus dans l’éducation la possibilité d’affronter les problèmes fondamentaux et globaux de l’individu, du citoyen, de l’être humain » (E. Morin, 2012, p. 252).
L’auteur milite ainsi pour l’interdisciplinarité. Nous devons aspirer à une connaissance multidimensionnelle. À l’en croire, les développements disciplinaires des sciences n’ont pas apporté que les avantages de la division du travail, elles ont aussi apporté les inconvénients de la sur-spécialisation, du cloisonnement et du morcellement du savoir. Et un enseignement qui part des disciplines séparées au lieu de s’en nourrir pour traiter les grands problèmes casse par là même les curiosités naturelles qui sont celles de toute conscience juvénile qui s’ouvre.
L. Ferry (2003, p. 84-85) est d’accord avec E. Morin pour dire qu’
il existe une deuxième cause aux difficultés que les étudiants rencontrent à leur entrée à l’université et qui est dénoncée par la majorité des enseignants : c’est leur faible niveau de culture générale tant dans le domaine des humanités que dans celui des sciences. Beaucoup manquent des repères culturels indispensables pour replacer les connaissances qu’on leur enseigne dans le cadre où elles prendraient sens. […] Pourquoi en outre les engager si tôt dans des spécialisations extrêmes alors que tout indique aujourd’hui que la formation générale est une clé de la formation professionnelle supérieure, comme l’ont si bien compris les grandes écoles d’ingénieurs, de commerce et de gestion ? […] Peut-on concevoir par exemple, la formation de l’historien sans sociologie ni économie, celle du philosophe sans histoire des sciences, celle du biologiste sans bioéthique, etc. ?
La réponse est évidemment non ! L’auteur a raison d’adosser la formation professionnelle sur une formation générale solide. Les deux ne sont pas purement contradictoires mais plutôt complémentaires. C’est le sens même de l’interdisciplinarité tant recherchée aujourd’hui. Nous disons donc qu’il faut professionnaliser, mais il faut aussi socialiser.
Conclusion
Nous avons présenté les forces et les faiblesses de la professionnalisation des enseignements au niveau de l’enseignement supérieur. Il ressort globalement que le processus est en marche et nourrit des grands espoirs quant à la réduction de la pauvreté et le chômage des jeunes. Au demeurant, les formations professionnelles doivent être développées, les filières d’enseignement doivent être diversifiées, les techniques éducatives ont besoin d’être modernisées, la recherche doit être valorisée en créant des activités industrielles et commerciales, bref les universités doivent être attractives et compétitives. Mais n’oublions pas que le tout professionnel ou l’emploi à tous les prix comporte quelques avatars, notamment l’emploi contre la compétence, l’emploi contre la recherche, l’emploi contre l’éducation.
Par ailleurs, l’État semble abandonner ce processus vital au privé, cela ne va pas sans conséquences. L’apport du privé est significatif dans ce domaine mais il faut se méfier des publicités mensongères qui pullulent partout sur l’adéquation entre la formation et l’emploi. Il faut veiller au respect des normes sociales. Aussi, la professionnalisation des enseignements doit quitter les textes et les décrets pour se faire effective sur le terrain et cela passe par la professionnalisation – et non la prolétarisation – des enseignants et par la disponibilité des infrastructures. La recherche doit aussi être encouragée, car toute politique de recherche se présente comme un mouvement de préparation de l’avenir. Il faut réconcilier l’enseignement supérieur avec la recherche, il faut réenchanter le savoir pour que la relève soit assurée dans nos universités.
Nous sommes pour la professionnalisation des enseignements parce que pour une fois, il ne s’agit pas simplement d’une importation d’un modèle mais d’un outil de création des richesses. Seulement, après avoir confié notre économie aux casinos, il n’est pas question qu’on confie notre éducation aux charlatans.
Références bibliographiques
BOURDONCLE Raymond, 1993, « La professionnalisation des enseignants : les limites d’un mythe », Revue Française de Pédagogie, N°105, octobre-novembre-décembre, Lyon, ENS Éditions, pp. 83-119.
BOUVERESSE Jacques, 2002, « Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? », Université de tous les savoirs, vol. 11, La philosophie et l’éthique, Paris, Odile Jacob, pp. 87 – 103.
MAINGARI Daouda, 1997, « La professionnalisation de l’enseignement au Cameroun : des sources aux fins », Recherche et Formation, L’identité enseignante : entre formation et activité professionnelle, N°25, INRP, pp. 97-112.
FERRY Luc, 2003, Lettre à tous ceux qui aiment l’école. Pour expliquer les réformes en cours, Paris, Odile Jacob.
FILAKOTA Richard, « L’orientation dans l’enseignement supérieur à l’heure du LMD », thème de la table ronde organisée par l’AUF à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie le 20 mars 2008 à Yaoundé.
LEIF Joseph et RUSTIN Georges, 1970, Philosophie de l’éducation, Pédagogie générale, tome 1, Paris, Delagrave.
LESSARD Claude, PERRON Madeleine, BELANGER Pierre W, 1993, « La professionnalisation de l’enseignement et de la formation des enseignants : tout a-t-il été dit ? », in Revue des sciences de l’éducation. Vol. 19, N°1, Montréal, pp. 5-32.
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 2022, Répertoire de l’offre de formation de l’Enseignement supérieur au Cameroun, Yaoundé.
« Arrêté N° 22-00024/MINESUP/SG/DDES/DAJ du 22 février 2022 portant organisation de la professionnalisation dans les établissements facultaires des Universités d’État du Cameroun ».
MINEPAT, 2013, Document de Stratégie du Secteur de l’Éducation et de la Formation (2013-2020), Yaoundé.
MORIN Edgar, 2012, La voie. Pour l’avenir de l’humanité, Paris, Librairie Arthème Fayard.
MUSAU Zipporah, 2017, « Universités entrepreneuriales : associer recherche et affaires », Afrique Renouveau, édition spéciale jeune, www.un.org.
POUET FOE Maurice Angélo et al., 2022, L’École nouvelle, Dschang, Dschang University Press.
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, 2001, « Loi N° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur », Yaoundé.
TOUZARD Philippe, 1988, Pédagogie pratique pour l’Afrique, Le Dictionnaire de l’enseignement en Afrique, vol. 10, Librairie intercontinentale.
WEBER Max, 1959, Le savant et le politique, Paris, Plon.
Lydie Christiane AZAB à BOTO
Université de Yaoundé I (Cameroun)
Résumé :
Le présent article vise à réévaluer la pertinence des sciences sociales et humaines dans les universités camerounaises, au regard de la volonté de nos politiques de passer de la théorisation des enseignements à la professionnalisation tous azimuts. À l’ère où l’émergence de la technoscience tend à déconstruire particulièrement le bien-fondé des sciences humaines et sociales dans le développement d’une société, et instruit par ailleurs la course vers la professionnalisation, nous avons le devoir de poser la question de savoir si nos universités, calquées sur des modèles d’héritages coloniaux répondent aux besoins et aux défis de développement de notre temps. En usant des méthodes analytique et critique, la présente réflexion évalue à la fois, le système universitaire camerounais à partir de la colonisation, et l’importance de ces sciences dans la formation intégrale de l’homme.
Mots clés : Crise, Enseignements, Professionnalisation, Sciences sociales et humaines, Technoscience, Théorisation, Université.
Abstract:
This article aims to re-evaluate the relevance of the social and human sciences in Cameroonian universities, in view of the will of our politicians to move from the theorization of teaching to all-out professionalization. At a time when the emergence of technoscience tends to deconstruct in particular the legitimacy of the human and social sciences in the development of a society and instructs the race towards professionalization, we have a duty to ask the question of whether our universities, modeled on colonial heritage models, respond to the development needs and challenges of our time. Using the analytical and critical method, this reflection evaluates both our university system from colonization, and the importance of these sciences in the integral formation of man.
Keywords : Crisis, Lessons, Professionalization, Social and human sciences, Technoscience, Theorization, University.
Introduction
Selon le Dictionnaire Universel de 1995, la crise est un « moment difficile et généralement décisif dans l’évolution d’une société, d’une institution ». Il est question pour nous d’analyser cette difficulté au sein de l’université camerounaise qui se trouve au milieu d’un dilemme. En effet, la civilisation technicienne imprime une révolution dans le sens classique de la formation que propose l’université. Il s’agit, pour elle, de limiter le chômage grâce à la fourniture d’emplois. Cependant, son contenu classique serait controversé. Certains pensent, en effet, qu’au lieu de rester dans la théorie, elle devrait considérer les canons actuels de formation-emploi. Pour d’autres, le fait d’introduire la professionnalisation dans toutes les disciplines, pourrait modifier l’essence de certaines filières dont la spécificité réside sur le caractère abstrait et théorique. Face à ces positions divergentes, l’on se demande si pour s’arrimer aux exigences actuelles de développement, il est nécessaire que l’on supprime définitivement les filières théoriques proposées par les sciences humaines et sociales ? Par suite, si l’on transforme nos universités dans ce sens, ne perdons-nous pas une grande partie de notre humanité acquise justement à travers l’apprentissage des humanités ? Répondre à ces interrogations nécessite que l’on recoure à l’histoire de l’université camerounaise pour en saisir l’évolution. Il est également question d’analyser l’importance des sciences humaines et sociales, autant que les avantages de la professionnalisation. En clair, à travers un cadre théorique analytique et critique, il s’agira d’évaluer à la fois notre système universitaire à partir de la colonisation et l’importance de ces sciences dans la formation intégrale de l’homme.
1. Sources historiques de création de l’université au Cameroun
En vue de préparer les pays africains vers l’indépendance et pour leur autonomie administrative, la question de la création des universités s’est posée. Cela passe par la formation d’une élite locale capable d’assurer la continuité de l’administration, mais pour cela, il faut des élèves formés au-delà du secondaire. Même si l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) et l’École Militaire Inter-Armes (EMIA) sont respectivement créées en 1958 et 1959, c’est après l’Indépendance du Cameroun en 1960 qu’elles sont implantées sur le territoire camerounais. Alexandrine Bouopda (2016) nous apprend que : « la création de ces établissements est le produit de nombreux débats entre les Camerounais, les puissances administrantes, et les instances internationales de l’ONU. ». Il faut néanmoins préciser qu’au-delà de l’objectif mentionné, il y en avait un autre, plus profond, qui contenait l’idéologie véritable de l’implantation de l’école en Afrique. Elle est énoncée comme ci-après par Albert Sarreau (2020, p. 54) : « Instruire les indigènes est assurément notre devoir (…) ; mais ce devoir fondamental s’accorde par surcroît avec nos intérêts économiques, administratifs, militaires et politiques » Ce postulat montre alors que l’école en Afrique, du primaire au supérieur, a pour objectif de préserver les intérêts coloniaux et de garantir une mainmise de la métropole sur tous les secteurs d’activité dans les colonies. Le contenu didactique des enseignements est donc fonction de l’idéologie coloniale. Si cette vision est générale pour tous les pays africains concernés par la colonisation, elle est complexe dans le cas du Cameroun qui lui, est sous une administration coloniale divergente française et anglaise. En effet, le Cameroun, placé sous-tutelle de l’ONU en 1945, et après la seconde guerre mondiale, a comme administrateurs la France et l’Angleterre. Cette complexité produira alors deux sous-systèmes dont les formations influencent encore aujourd’hui notre structuration universitaire, idée que soutient Alexandrine Bouopda (2016, p. 23) qui estime que « les politiques anglaises ont été différentes des politiques françaises, ce qui a affecté la configuration du Cameroun après la réunification de 1960. ».
Sous la pression de l’ONU qui insiste auprès des pays colonisateurs d’élargir l’horizon de la formation des indigènes, la France inaugure le premier établissement secondaire camerounais, le lycée général Leclerc en 1952, qui offre la possibilité aux élèves d’obtenir des bourses pour aller poursuivre leurs études en France. Cependant, l’université n’existe toujours pas, en raison de l’absence d’enseignants qualifiés. Mais, le troisième rapport du Conseil de tutelle de l’ONU insiste auprès des pays concernés et leur demande, selon A. Bouopda (2016, p. 32), « d’envisager au Cameroun, la création d’un enseignement supérieur » et leur demande par ailleurs d’indiquer les mesures prises par eux pour donner satisfaction à cette résolution. Jusqu’au dixième rapport de tutelle, l’université est encore inexistante au Cameroun. À cette préoccupation, la France et l’Angleterre font remarquer à l’ONU que « le nombre de bacheliers du Cameroun était encore insuffisant pour justifier la création d’une université dans le Territoire, et les dépenses qu’elle entraînerait, et que pour un assez long moment encore, il serait plus sage de s’en tenir au régime de bourse accordées aux gens désireux de poursuivre leurs études supérieures » (A. Bouopda, 2016, p. 33). Examinons de plus près cette question à partir du champ administratif colonial français au Cameroun.
1.1. L’administration française : administration directe
Le début de la première guerre mondiale poussant l’Allemagne à quitter le Cameroun permet à la France d’occuper 80% du Kamerun allemand. Dans cette partie du Cameroun oriental, l’administration française est instaurée. Il faut tout de même relever que l’administration coloniale française comme déjà mentionné, est dans une politique d’assimilation. Elle reproduit sur place, le modèle éducatif français. Cela est relevé par Ernest Folefack (2016, p. 34) qui affirme que « La première décennie de l’université camerounaise (1962-1973), qui correspond à sa mise en place, fut le résultat de l’assistance technique française. Elle a reproduit l’architecture du système universitaire français d’avant 1968, notamment la distinction université- grandes écoles ».
On note une interdiction formelle de l’usage des langues locales d’une part, et d’autre part, aucune des matières enseignées ne cadre avec les réalités locales. C’est ainsi que la « Marseillaise », l’hymne national de la France est enseigné dans cette partie du Cameroun. Même le contenu didactique des programmes d’enseignement fait essentiellement la propagande de la France. L’on ne sera pas alors surpris de savoir qu’en histoire, ce sont les guerres napoléoniennes ou la révolution française qui sont enseignées, tandis qu’en géographie, le relief de la France, son climat, ou encore sa population, constituent le programme d’apprentissage de ces pauvres indigènes. Il s’agit de faire d’eux des français culturels et idéologiques, même si à partir de 1940, la France développe le système de bourse pour l’enseignement supérieur justifié par l’absence d’établissements universitaires. C’est d’abord pour s’assurer de la pérennité du système français, avec la contribution des Camerounais formés à l’extérieur. La France crée d’ailleurs un fonds d’investissement pour le développement économique et social (FIDES) qui a pour objectif de : « financer les institutions médicales, économiques et scientifiques sur le continent. » (E. Folefack, 2016, p. 40). Le financement des bourses FIDES permet la mise sur place de trois catégories de boursiers :
– Les bourses d’enseignement par correspondance qui permettent aux jeunes fonctionnaires d’être formés sans quitter leur pays ou leur emploi.
– Les bourses d’étude sur le territoire qui sont des bourses de perfectionnement dans les établissements secondaires supérieurs du Territoire.
– Les bourses hors du territoire qui permettent aux élèves du secondaire d’aller poursuivre leurs études en France. Cette dernière donne la possibilité aux étudiants de se former aux études supérieures et est fortement encouragée par le Conseil de tutelle. Malheureusement, le coût de la prise en charge devient lourd au vu du nombre croissant des effectifs. À l’automne 1957 par exemple, le Cameroun compte 295 étudiants boursiers répartis entre la médecine, le droit, les sciences, la pharmacie, etc. Il est important de souligner que malgré la pression du Conseil de tutelle des Nations Unies, la France insiste sur le fait qu’il n’y a pas assez d’élèves pour justifier la création d’une université. Cependant, avec l’avènement des indépendances, la France établit avec les pays placés sous son administration et notamment le Cameroun, des accords qui conditionnent leur indépendance. Ces « accords de partenariat » sont appelés, pour le cas du Cameroun, « convention culturelle ». Celle du 10 novembre 1961 stipule que : « la France devra déterminer les choix socioculturels du Cameroun et orienter la détermination des programmes scolaires de ce pays à tous les niveaux » (G. Feuer, 1963). Bien plus, tout comme la démocratie longtemps après, l’indépendance sera accordée aux pays africains sous la condition de respecter les accords culturels établis avec la France. Michel Débré sera très clair sur la question lorsqu’il s’exprimera face à Léon M’BA, futur Président du Gabon : « on donne l’indépendance à condition que l’État s’engage, une fois indépendant, à respecter les accords de coopération signés antérieurement » (E. NNA, 2020, p. 55). Là est le sens de l’enseignement supérieur sous l’administration coloniale française au Cameroun, mais qu’en est-il de l’administration anglaise ?
1.2. Le modèle anglais : administration indirecte
Le mode d’administration choisi par l’Angleterre est l’« indirect rule ». Il sera déterminant pour la qualité de l’éducation dispensée dans les territoires dont elle a la charge. C’est ainsi qu’elle crée le British Council dès 1934 pour la promotion non seulement de l’éducation, mais aussi des relations internationales. Déjà en 1950, « Le British Council applique sa politique via l’attribution des bourses. Ainsi, en 1952, trente et un Camerounais avaient obtenu des bourses du British Council » (A. Bouopda, 2016, p. 43). L’Angleterre crée également la CDC, Cameroon Development Corporation, l’une des premières grandes entreprises qui financent également les bourses. Confiante de sa politique administrative, le modèle anglais se tourne vers la culture locale et donne libre cours à l’utilisation des langues locales au Cameroun. Relevons également que l’Angleterre avait trouvé un moyen pour limiter la présence des apprenants camerounais sur son sol et les envoyait plutôt au Nigéria ou au Ghana qui alors étaient déjà bien fournis en matière d’universités. Tout comme le modèle français, le modèle anglais était loin d’être une panacée à l’espérance nourrie dans le bilinguisme.
1.3. Le bilinguisme comme alternative d’unité nationale
La présence des deux administrations coloniales a scindé le Cameroun en 2 : la partie orientale et la partie septentrionale, chacune d’elle ayant acquis la culture de son pays de tutelle. Ainsi, les Camerounais parlaient français ou anglais en fonction de la partie du pays à laquelle ils appartenaient, et le contenu des enseignements étaient conformes aux standards de chacun des pays ; d’où l’existence de deux systèmes différents en cohabitation sur le territoire camerounais jusqu’à l’indépendance et la réunification des deux parties du pays.
Le choix porté sur le bilinguisme apparaît alors comme la solution idéale de fusion, pour l’harmonisation du système universitaire. C’est ainsi que dès 1960, les enseignements sont dispensés en français ou en anglais selon la formation initiale de l’enseignant, et les étudiants ont également la liberté de choisir leur langue d’évaluation. Malheureusement, le bilinguisme rencontre des difficultés, car les étudiants francophones étant en effet les plus nombreux, l’enseignement se fait plus en français et « de nombreux étudiants anglophones ont fait le choix des universités anglophones d’Afrique, d’Europe, d’Amérique ou d’Asie » (A. Bouopda, 2016, p. 59). Ainsi donc s’entrevoit la généalogie de l’université au Cameroun dont le renouvellement du sens s’inscrit dans la professionnalisation des enseignements.
2. Professionnalisation des enseignements et remise en question de la pertinence des sciences sociales
Si l’on tient compte du contexte mondial essentiellement basé sur le système capitaliste, l’on peut comprendre le besoin d’un pays comme le Cameroun, de s’allier à la mouvance mondiale, dans laquelle les États n’ont plus la possibilité d’employer à cause du nombre élevé des demandeurs d’emploi et d’encourager alors l’initiative privée. Placé en effet au cœur des différents enjeux économiques, politiques ou sociaux, l’enseignement fait face à un environnement devenu complexe par les besoins. Il est néanmoins important de relever que la professionnalisation comme projet au Cameroun, date des années 1970 et que c’est la disparité entre la formation théorique et l’accès à l’emploi, qui a remis sur la table des discussions le problème de la professionnalisation des enseignements dans notre pays. Cette dernière, comme le dit Daouda Maingari, est une notion polysémique qui « renvoie tantôt à la socialisation professionnelle, tantôt au syndicalisme enseignant, ou encore à leur identité professionnelle » (D. Maingari, 1997, p. 97). Nous saisissons la notion ici au niveau de l’adéquation formation-emploi pour constater que l’insertion du Cameroun dans le système anglo-saxon LMD, (Licence, Master, Doctorat), répond à ce besoin de former des personnes qui pourraient se prendre en charge au niveau de l’emploi à la fin de leurs parcours universitaires. Mais, la question ici est de savoir comment procéder ?
Les indépendances avaient construit, dans l’imaginaire de beaucoup d’Africains, l’idée qu’aller à l’école était la garantie pour un accès à l’emploi dans la fonction publique. Si cela a pu être possible au moment où la démographie était raisonnable et les besoins moins exigeants, cela n’est plus le cas aujourd’hui avec cette dernière qui est galopante. Arrimée comme nous l’avons montré aux standards français ou anglais, mais surtout français, l’enseignement au Cameroun s’est cristallisé autour d’une accumulation de savoirs qui rendait inadéquat le rapport formation emploi. L’État camerounais a essayé de résorber le chômage, en lançant des recrutements dans la fonction publique de 1986 à 2022. Cependant, la masse de demandeurs d’emploi toujours grandissante, l’a poussé à restructurer ses priorités éducationnelles. C’est ainsi que dans un arrêté, le Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur, au chapitre I, article 3, précise qu’« une filière professionnelle est un champ scientifique et matériel de la formation universitaire qui permet à un apprenant d’acquérir des habiletés et des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier » (2022 : art 3). Il précise à l’article 3, alinéa 2, l’objectif de la professionnalisation des enseignements qui est l’insertion professionnelle et la création d’emploi. En décidant de choisir ce nouveau paradigme de formation, l’État camerounais montre qu’il est saturé, et qu’il voudrait faciliter la formation de jeunes gens qui pourraient mieux s’insérer dans le monde du travail ; d’où la floraison de nouvelles filières dites professionnalisantes. En quoi consiste-t-elles ?
2.1. Émergence des filières dites professionnalisantes
L’enseignement technique au Cameroun a longtemps été méprisé par les parents pour qui la véritable insertion de leurs enfants, était celle qui passe par l’accès à la fonction publique. Selon eux en effet, la technique rappelait la servitude coloniale précédemment subie. Jacques Philippe Tsala Tsala (2004, p. 177) précise que « cette attitude s’explique en partie par un passé colonial ayant assimilé le travail à la servitude ». Toutefois, il faut également dire que le système colonial recherchait des auxiliaires d’administration et était plus intéressé par ceux qui pouvaient parler la langue et promouvoir les valeurs des colons. De ce fait, les matières enseignées n’étaient pas celles qui permettaient aux indigènes de devenir autonomes puisque cette idée aurait été contradictoire avec la politique d’assimilation mise en place par la France. « Cette option stratégique a entraîné une survalorisation du statut des personnes et professions qui, par la maîtrise de langue, pouvaient servir l’administration et en tirer les bénéfices socio-économiques » (J. P. Tsala Tsala, 2004, p. 179). L’autre raison pour laquelle l’enseignement technique était quelque peu méprisé est que, dans le système camerounais, seuls ceux qui étaient âgés et ceux qui avaient échoué à l’enseignement secondaire général, étaient reversés dans les collèges d’enseignement technique. Ce qui aux yeux de plusieurs, apparaissait plus comme une sanction et une marginalisation. En plus, ceux qui suivaient la formation technique au secondaire, ne pouvaient pas poursuivre leurs études au supérieur parce qu’ils étaient refusés dans les universités. C’est ce qui explique que la première école supérieure d’enseignement technique du Cameroun, à savoir l’ENSET (École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique), n’ait été créée qu’en 1979, soit 19 ans après l’indépendance.
Depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, les Camerounais ont compris l’importance des filières techniques qui permettent une facile insertion professionnelle. L’on a ainsi vu émerger, des Instituts Privés d’Enseignement Supérieur (IPES), orientés vers l’enseignement technique, et le pays compte à ce jour, 113 instituts reconnus par l’État. Le 10 septembre 2020, lors de la quatrième édition du carrefour des métiers et de la bourse de l’emploi, qui avait pour thème : « résilience stratégique des métiers porteurs dans le contexte de la crise sanitaire », le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle présentait aux jeunes présents, les filières porteuses. Il s’agissait entre autres de l’ingénierie, du digital, des énergies renouvelables, de la sécurité incendie, de la menuiserie, de l’agriculture, etc. Ces formations sont toutes encadrées par les instituts supérieurs à vocation technique même s’ils ne tirent leur reconnaissance institutionnelle que lorsqu’ils sont parrainés par une université d’État.
S’il faut saluer l’initiative de l’État qui a le souci de former des individus autonomes, il faut cependant déplorer le fait que les choix opérés par les pays africains de manière générale, comme au temps des indépendances, ne sont pas des choix souverains basés sur les réalités de leur environnement. L’inexistence des industries dans nos pays semble contradictoire avec la volonté de nos États, de techniciser les enseignements. À moins qu’ils veuillent former des techniciens qui iront travailler en Occident comme c’est déjà le cas avec les diverses immigrations choisies. Il faut aussi relever que, la mise en exergue des filières techniques a pour objectif de justifier la professionnalisation des enseignements.
En effet, pour s’arrimer au concept de développement tel que défini par l’Occident et les États-Unis, les pays africains et notamment le Cameroun, ont adoubé ce modèle de formation, en pensant uniquement plus à la technicisation des enseignements. Il faut dire que les pays techniquement et économiquement développés nous servent de modèle. Or, le développement aujourd’hui se décline autour de l’industrialisation, car dit-on, seule cette dernière propulse les pays à un niveau satisfaisant de stabilité. Pour cela, le système tend à minimaliser les sciences sociales sous le fallacieux prétexte qu’elles ne servent qu’à densifier la masse de chômeurs. C’est d’ailleurs cette idée, relayée par le Ministre camerounais de l’emploi et de la formation professionnelle, Monsieur Issa Tchiroma Bakary, qui a suscité un grand remous au sein de l’opinion publique camerounaise, lorsque lors d’un forum sur l’emploi le 22 janvier 2022, il affirma : « Vous envoyez vos enfants dans des facultés qui forment des gens qui ne travailleront jamais. Vous envoyez vos enfants dans la faculté d’Histoire-Géo, je n’ai rien contre… Ils ne travailleront jamais ». C’est dire l’état d’esprit de nos politiques vis-à-vis des sciences humaines et sociales qui, de leur point de vue ne bénéficient plus d’une grande légitimité parce qu’elles semblent trop théoriques.
2.2. Nécessité d’une réévaluation des sciences humaines et sociales
La mondialisation a consacré le décloisonnement des savoirs en voulant imposer au monde, un système éducatif qui empêcherait aux individus d’être intellectuellement autonomes. Cette volonté d’uniformisation des connaissances ne tient pas compte des réalités locales. En réalité, dans notre contexte, la crise de l’université est une crise qui va bien au-delà de la question théorisation/professionnalisation, il s’agit d’une véritable crise intellectuelle. Nos universités ont choisi, depuis bientôt une dizaine d’années, le mode d’évaluation nommé télé-évaluation. Il s’agit d’une méthode basée sur les questions à choix multiples, qui ne demandent plus à l’étudiant de mobiliser sa capacité à analyser et à argumenter, mais simplement à opérer un choix entre des réponses proposées. Il apparaît comme une volonté insidieuse de déconstruire le sens profond de ce que sont les sciences humaines et sociales. Il est vrai que chaque époque a des défis à relever, il est vrai que le monde évolue à une vitesse vertigineuse et l’on a d’ailleurs nommé le 21e siècle, le siècle de la vitesse. Cependant, il est tout aussi vrai que les sciences humaines et sociales, bien que théoriques, participent grandement à la construction des individus en leur donnant non seulement une formation théorique, mais bien une formation humaine et une identité sociale. Nous sommes assurément à une époque où, le développement technoscientifique, la technodivinisation de l’homme, au nom du développement, interpellent encore plus que par le passé, les sciences humaines et sociales. S’il faut dire avec Pius Ondoua (2020, p. 57) que « le monde de « l’homme-dieu », le monde de cette civilisation-monde » technoscientifique, consacre la fin des valeurs, la fin de l’homme, de l’ontologie et de la métaphysique traditionnelle », alors, il faut dire que nous vivons désormais dans un monde désenchanté. Ce désenchantement voulu par l’instrumentalisation du « logos » par les plus puissants, se décline par la volonté de contenir toute propension idéologique que semble faciliter les sciences humaines et sociales. Ces dernières ont la majesté de donner aux individus la capacité de construire des arguments et de les former également à l’esprit dialectique, donc à la contradiction, voire à la contestation. L’argument du chômage est généralement posé à tort pour décrédibiliser les sciences sociales et humaines. Ce fléau n’est-il pas plutôt la responsabilité de nos dirigeants politiques qui semblent ne pas savoir utiliser les ressources humaines formées pour un meilleur rendement ? Dans un pays en développement comme le Cameroun, comment penser qu’on n’a pas besoin d’historiens, de philosophes, de psychologues, d’anthropologues, même de littéraires ?
La notion de développement autour de laquelle sont construites nos politiques publiques contient elle-même sa propre limite et amène (E. Morin, 2004, en ligne), dans une interview donnée à l’espace Mendès, de postuler pour son dépassement. Il affirme en effet, qu’il faut renoncer au développement parce que
Le noyau de ce mot est techno-économique. Il suppose que le développement technique et économique, sur le modèle des nations dites développées, est comme la locomotive qui doit naturellement entraîner derrière elle tous les wagons du développement humain : santé, démocratie, culture, rationalité, mieux-être, etc. la notion de développement est donc fondée sur une logique, je dirais même sur un déterminisme socio-économique sous-jacent, qui oublie toute une série de détermination, lesquelles échappent à la technique et à l’économie. (…). De par son caractère technique et économique, la notion de développement se fonde sur le calcul et se mesure par le calcul. Or le calcul ignore ce qui lui échappe. Et qu’est-ce qui échappe au calcul ? c’est évidemment la vie, c’est la souffrance, c’est l’amour, tout ce qui fait la condition humaine.
En fixant ainsi les limites du développement technologique auquel aspire notre pays, Morin attire l’attention de tous, sur la qualité de notre existence et sur le sens à affecter à la notion de développement. C’est d’ailleurs en se situant dans cette logique que Ondoua ne conçoit pas d’existence sans ancrage axiologique. Quelle autre formation, sinon celle des sciences humaines et sociales confère-t-elle cette dimension au savoir ? C’est dire que la théorisation des sciences humaines et sociales n’est pas un handicap au progrès humain. Notre époque, malgré son apparente « maîtrise du réel », crée en même temps des angoisses existentielles qui nécessitent une remise en question permanente, et parfois des soins spécifiquement psychologiques, psychanalytiques, etc. Dès lors, l’erreur que nos universités pourraient commettre serait de prétendre réduire ou pire, fermer certaines facultés des sciences sociales au nom de la professionnalisation. Pour toutes les raisons sus-évoquées, l’idée d’une réévaluation de l’université camerounaise s’impose comme une nécessité.
3. Repenser l’université camerounaise pour une formation intégrale des apprenants
Toutes les sociétés connaissent des mutations paradigmatiques qui leur permettent de se reconsidérer et de se projeter. Ainsi, les universités, comme toutes les institutions sociales, sont exposées aux exigences de l’adaptation, ce qui fait dire à Quentin Landenne (2020, p. 79) que :
L’université est appelée à jouer un rôle central, en particulier dans la construction d’une nouvelle « société apprenante » (Learning Society), et en reformant ses offres classiques de formations et en promouvant les politiques d’apprentissage tout au long de la vie (Lifelong Learning), censées pouvoir permettre aux individus, aux groupes et aux institutions de s’adapter continuellement aux innovations technoscientifiques et aux mutations rapides du marché de l’emploi.
Il ne serait, par conséquent, pas mal pensé, de soumettre nos universités à une critique sans complaisance, afin d’en faire des pôles de formation sur les plans humains et techniques. Cependant, pour y arriver, il faudrait commencer par repenser leur horizon conceptuel et normatif. L’une des erreurs faites dans l’esprit des décideurs, c’est d’avoir maintenu une confusion entre ce qu’est l’université et l’école de formation. En intégrant les écoles dans les universités, l’on a perdu de vue la fonction de chaque entité. L’université a comme mission, la recherche fondamentale et l’enseignement, la formation qui y est donnée à l’apprenant est le matériau utile pour lui permettre d’autonomiser sa réflexion et d’opérer ses propres choix non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie quotidienne. L’École de formation aux métiers par contre, a pour but de former l’apprenant au monde professionnel ou d’améliorer ses performances puisque très souvent, les écoles forment des professionnels, c’est-à-dire, ceux qui ont déjà un emploi. On voit bien que les objectifs sont différents entre l’école de formation et l’université. À l’école de formation, on n’attend pas des apprenants qu’ils développent leur génie propre, mais qu’ils suivent un esprit bien précis, porté par l’école. Ce qui ne laisse pas une grande marge de liberté aux apprenants tant qu’ils ne sont pas encore sur le marché de l’emploi (pour ceux qui sont dans un besoin d’insertion). Cette distinction entre université et école de formation nous amène à poser une autre condition de l’épuration de nos universités.
3.1. La dépolitisation de l’université
Si les différentes réformes universitaires depuis 1990 jusqu’à nos jours ont eu comme principales motivations la décongestion de l’université de Yaoundé, la redistribution des étudiants entre les différents centres universitaires, la volonté d’offrir aux étudiants de plus vastes opportunités sur le plan pédagogique, entre autres, il ne faut pas occulter la volonté politique qui vise à contenter les différentes revendications communautaires. En effet, chez nous, les universités sont de plus en plus créées en fonction, non plus de la nécessité, mais de la volonté de contenir les velléités communautaristes. Chaque région veut avoir son université et sur les dix régions que compte le Cameroun, chacune est dotée d’une université, ou d’une grande école. Ce qui peut rendre vulnérable l’objectivisation d’une telle approche dans la mesure où, les élites locales en profitent pour en faire une récupération politique. Et lorsque l’université se politise, l’on peut alors voir les enseignants d’université, troquer leurs toges contre des joutes politiques qui peuvent leur permettre de se faire remarquer par la classe politique afin de bénéficier de certains avantages en nature. Emile Bongeli Yeikalo ya Ato (2009, p. 156), critiquant ces universitaires qui se mettent au service du pouvoir, dit d’eux qu’ils sont « les professeurs, chiens de garde de l’oligarchie dominante, [qui] se trouvent, grâce à des mécanismes institutionnels savamment élaborés et mystifiés, à l’abri des critiques et appréciation de la part des étudiants… ». Face à ce qui apparaît comme un fléau quand les universitaires abandonnent les amphis à la recherche des postes de nomination, l’impératif d’objectivité devient une urgence. Il s’agit donc d’avoir des universitaires engagés dans une recherche dont les résultats pourraient révolutionner la qualité de notre science, mais surtout, impacter significativement la qualité de vie des Camerounais. Ainsi, la contribution de tous les universitaires au premier rang desquels se trouvent les universitaires des sciences humaines et sociales est plus qu’un impératif.
3.2. Exclusion des sciences humaines et sociales
L’une des plus grosses erreurs que nos universités commettent c’est d’opérer une mue sans tenir compte de nos réalités socio-anthropologiques. Nous avons relevé au cours de notre analyse que, l’une des causes de notre inadéquation à l’emploi était le fait de n’avoir pas repensé le contenu didactique de nos programmes d’enseignements depuis les indépendances, pour les adapter à nos besoins. Il est important pour un peuple qui veut inscrire son nom au fronton du savoir, de se connaître lui-même, c’est-à-dire, de connaître sa propre histoire. La connaissance de notre histoire et son enseignement nous procure une identité réelle à partir de laquelle nous pouvons saisir notre propre vision du monde. Partant de là, il serait inconcevable de penser une telle étude sans une connaissance anthropologique de nos différentes compositions sociologiques. Comment alors l’idée d’une exclusion des sciences humaines et sociales pourrait-elle-même être envisagée ? Si cela était le cas, alors nous nous demanderons comme Axel Kahn (2000) : « Et l’homme dans tout ça ? ». En effet, les humanités placent l’homme au centre de leurs préoccupations et grâce à elles, l’homme peut se vanter d’avoir acquis une autonomie intellectuelle. La philosophie, par exemple, qui passe dans l’opinion pour une discipline inutile est pourtant le creuset de toutes les révolutions. C’est grâce à elle que la dialectique est possible, car elle prépare l’esprit au dépassement permanent. Dans notre environnement multiculturel, les humanités ont donc toute leur importance. La question ici n’est plus de savoir si elles doivent être bannies des formations académiques, mais il est plutôt question de réclamer que les contenus correspondent à nos besoins. Cette idée interroge alors la professionnalisation tous azimuts à laquelle notre pays est en voie de se livrer.
3.3. Le danger de la professionnalisation tous azimuts
L’on ne saurait penser le changement ou la transformation de l’université, sans tenir compte, ni des idéologies, ni des grandes problématiques qui dominent le monde actuellement. Si comme nous l’avons déjà dit, l’idéologie capitaliste est celle à laquelle sont adossés les secteurs de l’économie, de la politique, de la culture, etc., il ne faut donc pas s’étonner de constater un accroissement des filières qui sont susceptibles de produire de l’argent. Si le désir de tout apprenant, c’est de bénéficier d’une insertion professionnelle plus tard, et même transmettre son savoir-faire à d’autres, nous ne devons pas perdre de vue que notre volonté de résoudre coûte que coûte le problème d’insertion professionnelle peut, si l’on n’y prend garde, engendrer des déficits sur le type d’homme que notre société veut promouvoir. Notre pays est un pays en développement qui a besoin de tous les savoirs. Mais penser nos universités aux seules fins de produire des personnes techniquement aptes, serait priver les Camerounais de leur liberté à choisir la formation qui leur convient.
Au-delà de cette querelle stérile, nous pensons qu’il n’y a pas de choix à faire entre la professionnalisation ou la théorisation des enseignements. L’une et l’autre ont chacune, en fonction des domaines auxquels ils s’appliquent, une importance indéniable. En pensant uniformiser l’enseignement, nous courons le risque d’assassiner les vocations, car en effet, tout le monde n’a pas l’aptitude d’exercer un métier manuel, de même que tout le monde ne saurait être doué pour l’assimilation des connaissances théoriques. M. Tardif (2013, p. 3) attire notre attention sur l’enseignement, lorsqu’il parle de ses formes anciennes et contemporaines, pour montrer son évolution. Il fait cette précision de taille :
L’évolution de l’enseignement n’a rien de linéaire, qu’elle est faite de continuité, de détours, de retours en arrière et d’avancées provisoires. De plus l’enseignement est un travail à évolution inégale et très différenciée selon les pays, voire les régions d’un même pays : il n’évolue pas au même rythme partout et des formes anciennes coexistent avec des formes contemporaines. Parmi ces formes anciennes, on retrouve l’enseignement comme vocation et l’enseignement comme métier. Or ces deux formes, la vocation et le métier subsistent toujours. Elles cohabitent donc avec le mouvement de professionnalisation, engendrant ainsi des tensions, voire des revendications au sein de l’évolution sociale de l’enseignement. L’évolution du monde crée de nouveaux problèmes qui ont besoin de réponses plurielles pour leur résolution.
Cette mise en lumière de Tardif nous montre qu’en réalité, le débat sur la professionnalisation des enseignements est un vieux débat. L’analyse de ce dernier nous fait savoir qu’il y a trois âges dans l’enseignement qu’il décline comme suit :
– L’enseignement à l’âge de la vocation : ici l’enseignement est essentiellement, considéré comme un travail moral consistant à agir sur l’âme des enfants, à la dresser, à la guider, à la surveiller et à la contrôler. L’instruction était subordonnée à la morale et plus à la religion ;
– L’enseignement à l’âge de métier : pour ce deuxième âge, Tardif nous apprend qu’ici : « la fonction est peu à peu intégrée aux structures de l’Etat (national, fédéral, départemental, municipal) » (M. Tardif, 2013, p. 6). Le travail cesse d’être vocationnel pour devenir contractuel et salarial ;
– L’enseignement à l’âge de la profession qui nous intéresse dans cette analyse exige quelques préalables qui sont : l’existence d’une base de connaissance scientifique qui soutient et légitime les actes et les jugements professionnels, la présence d’un ordre professionnel reconnu par l’État regroupant des membres dûment qualifiés et socialisés aux valeurs de la profession, une éthique professionnelle orientée vers les clients, l’autonomie professionnelle et enfin la responsabilité professionnelle.
Ces éléments nous permettent de voir que l’âge de la profession ne se limite pas seulement à l’enseignement. Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a pas lieu de choisir entre théorisation ou professionnalisation car comme le signifie une fois de plus M. Tardif (2013, p. 6) :
La professionnalisation est donc intimement liée à l’universitarisation, y compris pour l’enseignement. D’ailleurs, en Amérique du Nord, l’universitarisation de la formation des enseignants débute dès les années 1930 et 1940 avec l’abolition des écoles normales, et elle est partout achevée dans les années 1960 : l’universitarisation de la formation des enseignants précède donc de quelques décennies la professionnalisation et elle en constitue une condition nécessaire.
À partir de ces images de la pensée non sans connexité à l’expérience potentielle, l’université camerounaise adonnée sans ambages à une formation intégrale des apprenants, sortirait de sa crise des sciences sociales : entre théorisation et professionnalisation.
Conclusion
Toutes les sociétés évoluent chacune avec ses propres codes, même si la mondialisation tend à universaliser les pratiques. Qu’elles soient politiques, économiques ou même éducatives comme c’est le cas pour notre étude, il n’est pas évident d’effectuer un copier-coller des fonctionnements extérieurs. Relevons que pour ce qui concerne l’université camerounaise, sortie des indépendances et cherchant encore ses voies, les attentes que l’on a vis-à-vis d’elle sont peut-être grandes, mais nécessaires. Les universités sont destinées à former l’intelligentsia de chaque pays et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elles appartiennent à l’enseignement supérieur. Supérieur ayant alors véritablement ici le sens de supériorité. Notre université a le devoir de dépasser ses apories en tenant compte des défis contemporains, sans oublier d’arrimer à ses choix les valeurs humaines qui confèrent à l’homme son identité d’être humain. Il n’est pas question de robotiser les individus par des formations mécaniques sous prétexte qu’il faut réduire le chômage, mais de former des individus dotés de toutes les facultés à la fois intellectuelles, humaines et professionnelles. Ce serait alors la promotion de l’homme intégral.
Références bibliographiques
Arrêté N° 22-00024 du 22 février 2022, portant organisation de la professionnalisation dans les établissements facultaires des universités d’État du Cameroun.
BONGELI YEIKALO YA ATO Emile, 2009, L’Université contre le développement au Congo-Kinshasa, Paris, L’Harmattan.
BOUOPDA Alexandrine, 2016, « La genèse de l’enseignement supérieur au Cameroun (1945-1965) », in Histoire, 2016, Dumas, 013623, pp. 1-97.
FEUER Guy, 1963, « Les accords culturels passés par la France avec les États africains et malgache », in Annuaire français de droit international, 2005l//www.persee.fr/collection/afdi_0066, pp. 890-905.
FOLEFACK Ernest, 2016, « L’architecture du système universitaire camerounais : évolution historique et dynamique actuelle », in L’enseignement supérieur au Cameroun depuis la réforme de 1993. Dynamiques et perpestives (sld) Luc Ngwé et Hilaire de Prince Pokam, Codesria, pp. 30-56.
KAHN Axel, 2000, Et l’Homme dans tout ça ? Plaidoyer pour un humanisme moderne, Paris, Nil éditions.
LANDENN Quentin, 2020, « La fonction formatrice de l’université pour une société apprenante : le legs de la philosophie fichtéenne de la Bildung », in Philosophiques, 45/ (1), pp. 79-98.
MAINGARI Daouda, 1997, « La professionnalisation des enseignements au Cameroun. Des sources aux fins », in Recherche et Formation, N°25, pp. 97-112.
MORIN Edgar, 2004, « Dépasser la notion de développement », in L’Actualité Poitou-Charente, n°3, janvier, https://actualite.nouvelle-aquitaine.science.
NNA Emmanuel Thierry. (2020). « La néocolonialité des curricula du primaire au Cameroun (1963-2001), in Historical Studies of education, pp. 49-68.
ONDOA Magloire cité par ABDOURHAMAN Ibrahim, 2018, « La déclinaison de la professionnalisation dans le secteur de l’enseignement au Cameroun », in Éducation et francophonie, (45/3), pp. 128-144.
ONDOUA Pius, 2020, Trajectoire vers « l’homme-dieu ». Quelle ontologie de l’homme au post-homme » ? Paris, L’Harmattan.
TARDIF Maurice, 2013, « Où s’en va la professionnalisation de l’enseignement ? », in Tréma (en ligne), 40/2013 mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 25 mai 2022, http://journals.openedition.org/trema/3066.
THEBERGE. M., BOURASSA, M. LAUZON, Y ET HUARD-WATT G., 1997, « Vers un modèle de cohérence entre formation pratique et formation théorique », in Revue des sciences de l’éducation, 23 (2), pp. 345-370, https://doi.org/10.7202/031920ar.
TSALA TSALA Jacques Philippe, 2004, « L’enseignement technique au Cameroun : le parent pauvre du système ? », in Armand Colin/Carrefours de l’éducation, 2004/2, N°18, pp. 176-193.
DE LA MISSION NOUVELLE DES UNIVERSITÉS AFRICAINES : POUR UNE POLITIQUE D’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES
Miesso ABALO
Université de Kara (Togo)
Résumé :
L’université africaine fait face à de nouveaux défis de deux ordres : ceux directement liés à sa vie interne et ceux liés au rapport qu’elle entretient avec la société. La teneur de ces défis fait que l’université africaine n’est plus apte à pouvoir répondre efficacement à la crise qui secoue nos sociétés. Pour ne pas donner raison aux pessimistes du système universitaire, l’université africaine doit faire face à ces défis en se donnant une nouvelle mission. La crise qui sévit dans les sociétés africaines aujourd’hui et qui s’empare du monde universitaire est une invite pour nos universités de s’engager dans la dynamique d’une ontologie multidimensionnelle. Celle-ci aura pour tâche d’unir éducation et emploi afin d’éviter le problème de l’inadéquation des diplômes à la réalité du terrain. En s’inscrivant dans cette dynamique, elles sont dans la nouvelle mission qui consiste à développer chez les apprenants les talents en fonction des besoins de la société. Il s’agit de créer, à travers les programmes universitaires, de nouveaux profils de sortie permettant aux étudiants, détenteurs des diplômes universitaires, de s’intégrer aisément dans la vie socio-professionnelle. L’objectif de notre recherche est de réexaminer la traditionnelle mission des universités africaines souvent en inadéquation avec les besoins des populations. Il s’agit de montrer la nécessité de l’engagement de l’université africaine dans les secteurs d’activité de la société afin d’éviter les incompréhensions entre le monde universitaire et le marché de l’emploi.
Mots clés : Afrique, emplois, société, universités, vie socio-professionnelle.
Abstract:
The African university faces new challenges of two kinds: those directly related to its internal life and those related to its relationship with society. The tenor of these challenges means that the African university is no longer able to respond effectively to the crisis that is shaking our societies. In order not to give reason to the pessimists of the university system, the African university must face these challenges by giving itself a new mission. The crisis that is raging in African societies today and that is gripping the academic world is an invitation for our universities to engage in the dynamics of a multidimensional ontology. This will have the task of uniting education and employment in order to avoid the problem of the inadequacy of diplomas with the reality on the ground. By being part of this dynamic, they are in the new mission which consists in developing in learners the talents according to the needs of society. It is a question of creating, through university programs, new exit profiles allowing students, holders of university diplomas, to integrate easily into socio-professional life. The objective of our research is to re-examine the traditional mission of African universities, which is often out of step with the needs of the populations. This is to show the need for the commitment of the African university in the sectors of activity of society in order to avoid misunderstandings between the academic world and the job market.
Keywords : Africa, jobs, society, universities, socio-professional life.
Introduction
L’université africaine doit toujours œuvrer, non seulement dans la production du savoir et des compétences, mais aussi jouer efficacement le rôle d’avant-garde pour ces compétences par rapport aux besoins de la société. Le double versant auquel fait face l’université africaine est la preuve qu’elle doit faire son engagement comme quête perpétuelle du savoir. Son engagement doit tenir compte des priorités qu’il convient d’identifier pour que l’université africaine ne soit pas réduite à la seule production de savoirs, mais engagée dans le processus du développement de l’Afrique.
L’identification des priorités auxquelles il convient d’attacher du prix pour les programmes d’enseignement universitaire est le premier indicateur de la bonne implication ou la participation de l’université africaine à la vie socioéconomique. Les défis à relever sont la révision des programmes d’enseignement et la mise en rapport des profils de sortie ou des compétences avec les besoins de la société. Il est donc question de la réorganisation de l’enseignement de telle manière que « l’université puisse remplir d’une manière fructueuse les nouvelles fonctions » (Association des universités africaines, 1970, p. 97) afin qu’elle puisse être à la place qui lui revient de droit dans l’environnement social et culturel en Afrique. Les nouvelles attributions qui ne figuraient pas dans les programmes d’enseignement à cause de la dépendance des pratiques éducatives étrangères doivent servir aujourd’hui l’occasion pour les acteurs du système universitaire de revoir le contenu desdits enseignements. Cela permet de briser les codes éducationnels introduits par l’idéologie coloniale ou occidentale. L’objectif visé ici n’est pas de faire du métier d’enseignant une activité de production des mécanismes et des techniques à usage purement pratique. Toutefois ce métier doit promouvoir une connaissance pragmatique qui se fait à la fois théorique et pratique. L’on doit reconnaître que l’ampleur de la décrépitude de l’enseignement universitaire est due au fait que le cadre théorique dans lequel se déroulent les enseignements comporte « des lacunes secrètes » (H. Tézenas du Montcel, 1985, p. 10) a priori inhérentes à la vie même de ces enseignements.
Les activités para-universitaires qui marquent le tournant décisif du retour de la pédagogie traditionnelle axée sur l’identité africaine précédemment initiées par le séminaire d’Accra (du 10 au 15 juillet 1972), paraissent nécessaires pour que les universités africaines « s’engagent sans réserve à servir la nation » (Association des universités africaines, 1970, p. 93). C’est ce que nous enseigne l’expression ״mission nouvelle des universités africaines״. Elle peut se traduire par le processus d’innovation et de création qui pourrait animer tout enseignant durant ses séances d’enseignement ou de séminaires. Durant un tel processus, l’enseignant peut se rendre aussi bien pratique que théorique. À cet effet, le champ de l’enseignement supérieur ne sera plus réduit au déroulement des savoirs et des compétences dans une sorte de formalisme. Il doit aussi s’ouvrir aux innovations susceptibles de résorber les trépidations érigées sous forme de tares dans le système éducatif. En résorbant ces tares, l’université africaine devient créatrice de valeurs, lesquelles donneront sens aux diplômes et aux capacités que les apprenants auront à la fin de leur formation.
L’objectif de notre recherche est de faire une analyse critique des méthodes classiques en cours dans l’enseignement universitaire africain. En prenant la crise de l’université africaine comme l’objet d’étude ou le champ de savoir, grâce à une approche méthodologique critique, cette recherche vise à saisir la nature réelle des priorités qu’il convient de viser pour que l’université africaine n’apparaisse point comme un entrepôt de savoirs sans incidence sur la vie socio-économique, politique, sociale, humanitaire, religieuse et sur les réalités qui sous-tendent les rapports interhumains. Il s’agit de montrer comment l’université africaine peut sortir du formalisme classique qui la contraint à ce qu’il est convenu d’appeler « crise de l’éducation » pour retrouver sa place d’antan.
Pour atteindre cet objectif, nous procéderons par l’analyse critique des réalités en cours dans les universités africaines. L’analyse débouchera sur des solutions à la crise dans l’université africaine à partir des missions nouvelles que se donneront les institutions d’enseignement supérieur afin qu’elles puissent retrouver l’espoir jadis placé en elles d’être le milieu par excellence des connaissances et des savoirs.
1. La part de responsabilité des universités africaines dans la crise de l’éducation
Les problèmes auxquels l’université africaine fait face sont en partie liés au mode de fonctionnement qu’elle adopte pour assurer ses attributions. Au nombre de ces problèmes, on peut évoquer le cas par exemple de la stagnation et le manque d’esprit d’initiative et d’innovation, qui donnent l’impression qu’il n’y a pas de nouveaux défis pour l’université. En réalité, ce qui pose problème c’est l’idéologie coloniale/occidentale qui fait que « les formations restent exclusivement commandées par les capacités des enseignants et non par les besoins des usagers, celle qui n’ose plus exiger le respect des règles et des formes garantes de la qualité » (H. Tézenas du Montcel, 1985, p. 19). S’il faut analyser ce problème en termes de crise comme celle à laquelle l’université africaine fait face, c’est pour mettre en exergue son ampleur. D’où les questions suivantes : pourquoi parler de crise à l’université et pour quels enjeux ? Pourquoi est-il fondé de parler de crise à l’université africaine aujourd’hui ? Par l’analyse de ces questions, il est clair que la crise dont fait face l’université africaine est à l’image des crises que vivent les sociétés africaines. Autrement dit, l’université africaine n’échappe pas aux différentes crises que vivent les populations au quotidien. Cela signifie qu’il y a entre l’université et la société un rapport étroit, si bien que l’université ne peut prétendre faire face à ses difficultés sans prendre en compte les maux qui minent la société.
En effet, l’université africaine fait beaucoup d’efforts, surtout en termes de productions scientifiques et de savoirs. Malheureusement, malgré les efforts pour rehausser le niveau de l’éducation et promouvoir les acquis, les universités africaines font face à une situation de crise dont les responsabilités sont souvent partagées. D’un côté, on peut affirmer que l’université africaine contribue elle-même aux difficultés qui la plongent dans un état de crise. Les pratiques en cours dans les modes de transmissions des savoirs deviennent obsolètes, rendant quasiment problématique l’objectivation de soi. Celle-ci devrait permettre aux apprenants de répondre de façon adéquate aux besoins et services de la société. Doit-on parler d’une sorte de « laxisme de la gestion » (H. Tézenas du Montcel, 1985, p. 46) de l’université africaine ?
Certes, l’encéphalogramme n’est pas plat en ce qui concerne les productions scientifiques. L’on doit noter que les universités africaines développent une galerie assez fournie, avec des enseignants toujours en pleine recherche à travers des séminaires, des colloques, des journées scientifiques et autres. Cependant, ces productions scientifiques semblent ne pas avoir d’incidence effective sur la vie socioéconomique de la communauté. Celle-ci ne tire pas profit des résultats issus des recherches par manque de politique de diffusion et de vulgarisation des fruits de la recherche. Cette politique n’existe pas comme instance devant faire la promotion des recherches afin d’amener la communauté à la culture de la connaissance et des valeurs de l’éducation. On pourrait peut-être nous rétorquer d’affirmer que les productions scientifiques n’ont d’impact que pour leurs auteurs, uniquement dans l’examen de leurs grades universitaires, ce qui remet en cause les fins de l’éducation et de l’enseignement. Car « l’éducation et l’enseignement n’ont de sens que par rapport aux fins qu’on leur assigne relativement à la condition humaine » (J. Leif et G. Rustin, 1970, p. 13). Or, en s’attelant aux productions scientifiques, ces fins sont mitigées, pour n’être que la part qui revient à l’enseignant après son inscription sur les listes d’aptitudes du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).
Ces productions scientifiques ne profitent pas aussi suffisamment à la communauté scientifique, car de même que la société, la communauté scientifique semble manifester un désintérêt, soit par manque de diffusion des productions scientifiques, soit par le désintérêt des uns et des autres, ou soit par manque de volonté ou du goût de la recherche. Les utilisateurs potentiels des productions scientifiques en font usage, certains par le biais de la nécessité d’un laboratoire ou par le lobbying d’un enseignant dans le cadre d’une activité ou d’une manifestation scientifique.
Un autre aspect aussi important soit-il, pour exprimer le manque d’incidence des produits de la recherche sur le quotidien de la communauté, est le manque de soutien dans la plupart des universités africaines, ce qui contraint les universitaires à demeurer dans la méthode classique de production de savoirs, comme si l’enseignement avait pour seule finalité de produire des connaissances.
En ce qui concerne la production des savoirs, la plupart des universités africaines demeurent dans la méthode classique qui consiste à doter les étudiants des connaissances même si celles-ci se présentent comme « un dinosaure posé sur un aéroport » (H. Tézenas du Montcel, 1985, p. 15), c’est-à-dire sans incidence sur les services ou les besoins de la société. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait devenu alarmant ces dernières décennies. On peut évoquer le cas de l’inadéquation des programmesd’enseignement avec le marché de l’emploi, contraignant les jeunes diplômés à une aventure dont ils ne rêvaient pas. Cela entraîne une certaine psychose, non seulement pour les diplômés, mais aussi pour les parents ou pour toute la communauté se demandant à quoi vaudraient-ils tant d’années d’étude sans pouvoir trouver de quoi se régaler. Tant que cette psychose perdure, l’université africaine perdra son prestige et deviendra pour certains la priorité d’une classe de personnes décidant à poursuivre leur rêve malgré les multiples problèmes auxquels elles sont confrontées.
Un autre facteur aussi important soit-il, est la vétusté du cadre et des outils de travail qui ne sont pas à la hauteur de la tâche dans certaines universités. Face à cette vétusté, les universitaires travaillent en corps défendant puisque l’amélioration du cadre et des outils de travail ne relève pas, en réalité, de leur attribution, mais des pouvoirs publics ou des structures étatiques en charge de l’éducation. Ne considérant pas l’éducation comme la priorité des priorités, les pouvoirs publics ignorent l’horizon normatif et conceptuel, qui devrait être la vision sur laquelle l’éducation sera basée en termes de priorités pour l’université africaine.
2. Le besoin de nouvelles priorités des universités africaines
Les universités africaines doivent revoir leur agenda en ayant en idée que « l’éducation est un projet politique (F. Morandi, 2000, p. 31) et que cette politique doit se faire avec une attention particulière sur « la légitimité, le sens et les fins de l’éducation et de l’enseignement ; des considérations référées aux conceptions élaborées, en ces domaines, depuis les origines jusqu’à nos jours » (J. Leif et G. Rustin, 1970, p. 13). Ces conceptions élaborées depuis les origines doivent s’inscrire aujourd’hui dans une vision qui sera considérée comme l’horizon à viser par le système universitaire. Cela suppose que l’on se demande ce que l’on veut, quel type d’individus l’on veut avoir, quelle société l’on veut développer. Car le système universitaire ne doit pas être suspendu en l’air. Il doit être rattaché à la vision que l’on se donne pour le présent et le futur en s’appuyant sur les dispositions du passé.
Cette vision globale de la société et du développement n’est rien d’autre que l’ensemble des priorités que les autorités universitaires, en collaboration avec les autorités politiques en charge de l’éducation, doivent identifier et prioriser. Ainsi on finira par « se débarrasser des images tenaces et faciles » (B.-H. Lévy, 1977, p. 46) qui ne cessent de peser de leur poids dans le rapprochement de la formation universitaire aux nouveaux défis. Pour se débarrasser de ces images, « le système universitaire devrait comprendre une déclinaison complète de programmes et d’institutions capables de recueillir et de former tous les niveaux possibles de candidats, ceci nettement mieux qu’il ne le fait aujourd’hui » (H. Tézenas du Montcel, 1985, p. 111). Mesure-t-on vraiment l’enjeu et l’ampleur des risques que court le système universitaire africain ? Les incohérences du système universitaire africain face aux nouveaux défis menaçant la vie et les enjeux mettant à rude épreuve les rapports formations-emplois montrent qu’il y a inadéquation dans le rapport formation-emploi. L’on peut noter à travers ce rapport qu’il y a manque d’attention aux problèmes de la société. Ce manque d’attention particulière aux problèmes de la société traduit le caractère irréductible de ces problèmes de telle manière que les sites de formation universitaire ne gardent plus le sens de la compétitivité requise. Le caractère irréductible s’explique par le manque d’élaboration de programmes d’étude et de vision. En effet, nombreuses sont les universités africaines qui ne sont pas encore ouvertes aux innovations et aux changements de paradigmes à travers les offres de formation encore teintées de dépendance extérieure et de manque de créativité. Si le système universitaire africain ne joue nettement pas son rôle de formateur aujourd’hui, c’est parce que les programmes ne subissent pas de changements et de réformes pour répondre aux nouveaux défis auxquels la société est confrontée.
Le changement de paradigmes s’impose au monde universitaire africain à cause des enjeux liés au manque de sérieux dans l’enseignement supérieur avec leurs corolaires qui ne font que s’accroître, contraignant la société à des crises de divers ordres. Dans presque tous les domaines de la vie, des difficultés d’ordres épistémologiques s’imposent. L’identification de ces difficultés, la nécessité de les étudier en vue d’élaborer des programmes d’enseignement ne se font pas sentir comme priorité pour les universités africaines, ce qui fait que les difficultés continuent par peser dans la société à la fois sous forme d’un manque à gagner et du paradis perdu. Car le constat est sans appel : on reconduit les mêmes systèmes d’enseignement en déphasage avec le monde du travail. La situation telle qu’elle se présente ne cesse de créer une disharmonie entre la formation reçue par les apprenants et le marché de l’emploi. Cette situation contraint l’université africaine à une perte de prestige qui ternit l’image des études universitaires.
Certains diront que l’université n’a pas pour attribution de répondre aux problèmes de l’emploi qui se posent aux jeunes en fin de leur cursus universitaire et que chaque étudiant en fin de formation devrait se débrouiller pour créer son propre emploi. En effet, il est vrai que les étudiants les plus assidus durant leur cursus universitaire finissent avec un bagage intellectuel bien fourni pouvant leur permettre de créer leur propre emploi ou de se prendre en charge. Cela peut être l’une des finalités de la formation universitaire. Mais il faut se demander combien d’entre eux peuvent avoir les moyens nécessaires à cette finalité. Un des faits très remarquables est l’absence d’une base et d’une expérience très solides fondées sur l’employabilité de ces jeunes désemparés et meurtris par le système en cours dans nombre d’universités africaines.
Le titre de l’ouvrage de H. Tézenas du Montcel (1985) le dit bien : l’université africaine peut mieux faire. Oui, elle peut mieux faire si elle se guérit des problèmes de son système incohérent dicté par le clientélisme qui la détourne de sa fonction initiale, celle d’être le milieu par excellence des savoirs et qu’elle adopte une bonne politique de base pour son redéploiement avec des objectifs bien définis. Cela est d’autant plus important que la formation universitaire réponde à un objectif précis et défini par la politique basée sur les priorités.Elle doit viser, non seulement l’atteinte des objectifs classiques comme la réussite des apprenants, mais aussi l’acquisition de l’expérience par ces derniers. Car l’expérience permettra aux jeunes diplômés de jauger leur connaissance par rapport aux besoins, aux services et aux mutations socio-économiques de la société africaine. Pour cette raison, elle se présente non pas dans la nature des faits éducatifs, mais dans la corrélation qu’elle pose sous forme d’expérience aux apprenants, du coup à l’université. Celle-ci s’en servira pour redonner l’espoir aux jeunes ayant le désir de se faire former à se voir dans le rapport à soi qu’elle établit avec le vécu. Puisque le vécu est étroitement lié à l’expérience, tout système universitaire voulant atteindre ses fins est appelé à accorder du prix aux intérêts de son espace géographique. E. Njoh-Mouelle, (1975, p. 11) écrit dans cette optique : « Il faut, à cette occasion, comme aux occasions historiques antérieures, distinguer soigneusement entre les intérêts de l’Afrique et les intérêts en Afrique ». Le rapport à soi qu’établit le fait éducatif peut alors être considéré comme une exigence des intérêts de l’apprenant ou de sa société tout entière. L’exigence qu’introduit la politique de l’éducation peut s’exprimer afin de déterminer le type d’hommes que l’on veut pour la société africaine.
3. L’université africaine et le monde du travail
L’université doit, pour ne pas donner l’impression d’être une usine de production des savoirs et des diplômes sans incidence sur le quotidien des populations, montrer les valeurs qu’elle se doit de déterminer. Il s’agit pour les universités africaines d’œuvrer pour une forme de partenariat entre les services universitaires, les diplômes et l’ensemble des couches sociales. Cela peut paraître paradoxal pour certains dans la mesure où la formation des apprenants ne soit plus la seule priorité de nos universités, mais aussi leur insertion dans les corps de métiers ou dans les besoins de nos sociétés. La signification que nous donnons à l’expression « nouvelle mission des universités africaines » tient bien son intérêt de l’insertion des jeunes diplômés dans lesdits corps de métiers. Pour remplir d’une manière efficiente cette nouvelle mission, l’université africaine est appelée à faire la part belle d’une bonne organisation et du personnel requis dans un plan d’action susceptible de faire face à la crise qu’elle traverse.
La première des choses est de redonner à l’université son prestige et ses honneurs d’antan, car pendant ces années de gloire (1960), « l’université était une institution hautement respectée, laquelle, après le gouvernement lui-même, représentait un groupement de talents indispensables au bien-être de la société, et que le diplômé de l’université jouissait d’une place d’honneur spéciale » (Association des Universités Africaines, 1975, p. 25). Si aujourd’hui l’université n’a plus son respect et les diplômés leur honneur, ce n’est pas une fatalité, mais parce que l’université n’a pas su faire des réformes nécessaires pour être à la hauteur des tâches qui lui furent confiées en fonction des mutations que connaissent les secteurs d’activité de la société et de la vie en général.
La nécessité de ces réformes se trouve dans le fait qu’elles permettent de redynamiser les méthodes et les contenus d’enseignement pour que ces derniers répondent aux nouveaux défis avec plus d’optimisme excessif. Le but est de permettre au système universitaire d’assurer les services de qualité et l’épanouissement des apprenants à la fin de leur cursus. H. Tézenas du Montcel (1985, p. 10) écrit : « Pour affirmer ses qualités et réussir l’épanouissement des hommes et des femmes qui l’habitent, l’Université a besoin d’une modification profonde de ses méthodes de gouvernement. Que cela plaise ou non, toute institution universitaire est une entreprise du secteur tertiaire produisant des services de recherche et de formation ». Il s’agit de faire la mise en place des mécanismes de définition des pôles de recherche et de formation qui amènent les apprenants à développer les aptitudes du vivre-ensemble et à prendre conscience des qualités positives de leur communauté en tant que sujets responsables, des modèles pour leur localité. Il s’agit de poser un rapport immédiat entre le savoir et le « comment faire » des fins poursuivies par la société.
La construction du concept d’homme et du citoyen qui sont les fins premières de l’éducation ou de la formation universitaire exprime l’essence même du rapport sur lequel se fonde ce concept. Hisser l’université africaine sur un tel concept d’homme permettra de la rendre créatrice des valeurs humaines et du vivre-ensemble de telle sorte que la société puisse se faire guérir de ses pathologies qui ne sont que d’origines humaines. Les perpétuelles crises qui secouent la société, voire l’université, peuvent être évitées en partie si la formation universitaire, par ses offres de formation, arrive à couvrir les besoins fondamentaux de la société par les apprenants bien formés.
L’exigence de ce rapport dans le système universitaire africain montre qu’il permet de consolider la psychologie des apprenants et les tendances du moment afin de les orienter vers la fin ultime de l’enseignement. Il permet aussi de favoriser l’adéquation entre la formation et le monde du travail. Pour cette raison, le cadre de l’enseignement doit être un espace de libre discussion, c’est-à-dire un espace libre des idéologies politiques et des déterminations particulières. Cet espace doit être aussi propice à la création des valeurs morales, éthiques et citoyennes de telle manière que le jeune diplômé soit un modèle de citoyen pour sa communauté. F. Morandi (2000, p. 19) affirme à cet effet que dans l’enseignement, « le comment faire״ n’est jamais séparable des fins poursuivies. Le rôle d’éducateur qualifié par une communauté ne peut se faire sans l’acceptation tacite de celle-ci, de ses valeurs ». Une telle acceptation intervient du moment où l’enseignement impacte le quotidien des populations par son métier qu’il incarne et qui le présente comme un modèle pour sa communauté.
L’université africaine jouera davantage ce rôle en tenant compte des réalités africaines, des besoins réels du continent, qui méritent réflexion. Cela prend le nom d’africanisation des programmes d’enseignement de telle manière que les problèmes, tels qu’ils se posent, puissent trouver une approche de solution qui soit axée sur les réalités africaines. Quoi qu’on dise l’africanisation des programmes d’enseignement n’est pas discutable si l’on veut vraiment permettre à l’université africaine d’être à la hauteur de ses crises, parce qu’elle a la possibilité d’atteindre le domaine immanent psychique de l’être-africain.
Aussi, peut-on la considérer comme la seule condition permettant aux systèmes universitaires africains d’éviter les clichés de dépendances extérieures afin d’être en rapport avec les réalités africaines. Cela a été le souci majeur de Joseph Ki-Zerbo lorsqu’il « demande que l’on commence par africaniser les programmes d’enseignement universitaire » (Association des universités africaines, 1975, p. 21). Il faut, à cet effet « briser les liens de dépendance intellectuelles qui ont pesé et continuent par peser de leur poids dans l’enseignement en Afrique. Car le constat est qu’en Afrique, l’enseignement dépend des pratiques « éducatives internationales et que les liens de dépendance donateur/bénéficiaire ont freiné le développement des établissements africains et l’aptitude des Africains à élaborer des politiques de l’enseignement qui soient socialement adaptés et financièrement réalisables » (Association des universités africaines, 1975, p. 46). La dépendance intellectuelle dans les pratiques éducatives conduit à l’assimilation des valeurs étrangères, à la paupérisation de l’être africain qui, avec le temps, deviendra complètement déraciné de son identité. La question du sous-développement en Afrique, la crise dans nos sociétés africaines, qui s’empare de nos universités créant « le gouffre insondable » (E. Njoh-Mouelle, 1975, p. 9) provient du fait que l’enseignement est victime de la dépendance intellectuelle qui réduit son espace de réflexion à des normes conceptuelles dictées par l’extérieur. La solution, à cet effet, serait la rupture des liens de dépendance. Cela ne signifie pas que l’enseignement, en Afrique, soit totalement coupé des standards internationaux pour être totalement focalisé sur les valeurs africaines, mais il doit d’abord avoir une base solide constituée par les réalités africaines avant de s’ouvrir à la communauté académie internationale.
L’africanisation de l’enseignement permet aussi de revisiter les profils de sortie en concertation avec les besoins de la société. Puisque ces besoins s’inscrivent dans l’espace géographique africain, il faudrait alors éviter l’assimilation des valeurs étrangères et faire en sorte que l’éducation soit positive et vécue librement dans la conscience de l’apprenant (F. Morandi, 2000, p. 19) et non sous forme de contrainte. La politique de l’éducation doit faire des profils de sortie une préoccupation fondamentale afin d’éviter les déséquilibres psychiques des diplômés en chômage qui, de nos jours, constituent l’un des signes visibles de la crise des universités africaines. Mais cette préoccupation peut être prise en compte par un service compétent d’orientation pour que les étudiants ne s’inscrivent pas dans leurs filières par complaisance, par camaraderie, mais par rapport à leur compétence et surtout en raison des besoins de la société. L’analyse des besoins d’une société, quelle que soit la politique ou la vision qu’elle se donne, a besoin d’une hétérogénéité des disciplines ou des filières.
L’hétérogénéité des filières permet d’avoir, non seulement une idée générale des besoins et des services clés de la société dont le but est de renforcer l’adéquation entre la formation et le monde du travail, mais aussi de réduire le taux de chômage. L’importance de cette hétérogénéité provient du fait qu’elle permet aux filières qui sont « convenablement adaptées aux besoins mais moins sélectives (H. Tézenas du Montcel, 1985, p. 51)) de compter parmi les multiples choix des jeunes pour leur insertion dans la vie socio-professionnelle.
Conclusion
La crise que traversent les universités africaines est diversement appréciée. On peut affirmer qu’elle est la conséquence des pratiques obsolètes encore en œuvre dans le système universitaire africain quelquefois déconnecté de la réalité que vivent les populations. Aussi peut-on dire que les universités africaines semblent ignorer les changements qui s’imposent à la vie, à la société et qui demandent un changement de paradigmes. Ce changement de paradigmes doit se faire, non par ordonnance, mais par une bonne politique qui consiste d’abord à briser les liens de dépendance de notre système universitaire et donner une vision devant s’inscrire dans la logique d’une ontologie multidimensionnelle consolidant le rapport éducation-emploi. C’est avec cette vision que l’université africaine pourra retrouver ses prestiges d’antan et répondre aux aspirations des diplômés en particulier et de toute la société en général. La vision est d’autant plus nécessaire puisqu’avec le système classique, les jeunes dévoués à la formation universitaire sortent de leur cursus et font face à un monde dont les exigences ne relèvent pas de leurs compétences. D’aucuns diraient qu’il faut une autre formation après tant d’années passées à l’université afin d’être compétitif sur le marché de l’emploi. N’est-ce pas là l’une des lacunes de nos systèmes universitaires ?
L’espoir placé aux universités africaines a été mitigé par l’esprit de stagnation auquel elles n’ont pas su apporter une attention particulière. « La gloire n’est pas non plus absente » (H. Tézenas du Montcel, 1985, p. 135) pour qu’on puisse dire que les universités africaines n’ont plus leur place dans le développement de l’Afrique en tant que créatrices des valeurs et des capacités intellectuelles. Cependant, elles se doivent de subir de profondes mutations par les réformes et la dotation du système d’une vision pouvant exercer leur implication sur le quotidien de la société. C’est donc ce qui est convenu d’appeler la nouvelle mission des universités africaines, celle qui fera d’elles des pôles de formations au service des besoins et aspirations de la société afin qu’une fois sortis de leurs cursus universitaires, les étudiants puissent s’intégrer dans la vie socio-professionnelle de façon descente. Car, la fin primordiale de l’enseignement est « l’intégration de l’individu à la société jusqu’à son extrême effacement » (J. Leif et G. Rustin, 1970, p. 13) comme une réalité singulière.
Références bibliographiques
Association des Universités Africaines, 1975, L’édification de l’Université africaine. Les problèmes des années 1970, Accra, Accra Catholic Press.
HOUSSAYE Jean, 2014, La pédagogie traditionnelle. Une histoire de la pédagogie. Suivi de « Petite histoire des savoirs sur l’éducation », Paris, Editions Fabert.
LEIF Joseph, RUSTIN G., 1970, Philosophie de l’éducation, Paris, Librairie Delagrave.
LÉVY Bernard-Henri, 1977, La barbarie à visage humain, Paris, Grasset.
MORANDI Franc, 2000, Philosophie de l’éducation, Paris, Nathan.
NJOH-MOUELLE Ebénézer, 1975, Jalon II. L’africanisme aujourd’hui, Yaoundé, Éditions CLE.
TÉZENAS DU MONTCEL Henri, 1985, L’Université : peut mieux faire, Paris, Editions du Seuil.
FORMATIONS ET RISQUES DE CHÔMAGE DES ÉTUDIANTS AU GABON : QUELLE REPRÉSENTATION SOCIALE ?
Parfait MIHINDOUBOUSSOUGOU
Université Omar BONGO (Gabon)
Résumé :
La recherche traite de la formation universitaire et du risque de chômage des étudiants du Gabon. L’outil est un questionnaire de vingt questions ouvertes pour deux items (N=507). Le problème renvoie au fait qu’au Gabon la formation universitaire avait pour représentation sociale l’emploi. Elle est désormais minée par le risque de chômage. Au Gabon, la formation universitaire a-t-elle encore l’emploi comme représentation sociale ? De cette question découle l’hypothèse selon laquelle, au Gabon la formation universitaire n’a plus l’emploi pour représentation sociale. L’objectif consiste à montrer qu’au Gabon la formation universitaire, au regard des vicissitudes que connaissent les années académiques, n’a plus l’emploi pour représentation sociale. L’intérêt est de promouvoir la professionnalisation de l’Université par la relation formation-emploi. Il y a des effets prédicteurs de la représentation sociale sur le risque de chômage [(Sig =.00), (Sig. =.05), (Sig =0.01) et(Sig =0.02)].
Mots clés : Étudiants, Formation, Représentation sociale, Risques de chômage, Université.
Abstract:
The research deals with university education and the risk of unemployment among students in Gabon. The tool is a questionnaire, twenty open questions, two items (N=507). The problem refers to the fact that in Gabon, university education used to be socially represented by employment. It is now undermined by the risk of unemployment. Does university education in Gabon still have employment as its social representation ? This question leads to the hypothesis that university education in Gabon no longer has employment as its social representation. The objective is to demonstrate that in Gabon, university education no longer has employment as its social representation. The interest is to promote the professionalization of the university through the training-employment relationship. The results show predictive effects of social representation on the risk of unemployment of students [(Sig =.00), (Sig. =.05), (Sig =0.01) and (Sig =0.02)].
Keywords : Students, Training, Social representation, Risk of unemployment, University.
Introduction
La présente recherche traite de la représentation sociale de la formation et du risque de chômage chez les étudiants de l’Université Omar Bongo, l’Université de référence au Gabon, dont la formation jadis avait pour représentation sociale l’emploi. Mais, depuis plus de trois décennies, cette Université traverse une grave crise qui se traduit en termes de longues années d’études pour obtenir le premier diplôme, la licence, dans un contexte universitaire caractérisé par des grèves répétitives, des années universitaires approximatives et le spectre d’une année blanche. L’Université Omar Bongo est restée dans les formations générales, non spécialisées. Ceci dénote de l’absence de professionnalité et d’insertion professionnelle des étudiants. Ce qui précède laisse penser qu’autrefois, les niveaux de qualification progressaient (V. Erlich, 1998, p. 85) et les diplômes représentaient encore le meilleur rempart contre le chômage (C. Béduwéet V. Mora, 2017, p. 60). Garantie d’accès à l’emploi, le diplôme universitaire a servi au départ à mettre le pied à l’étrier dans une carrière au service de la nation (E. Gérard et B. Schlemmer, 2003, p. 305).
Sortie de cette période, le Gabon connaît désormais le chômage des jeunes diplômés. Ceci malgré une croissance économique positive depuis plus de quarante (8329 dollars des États-Unis en 2018) (OIT, 2019, p. 8). Au Gabon, on enregistre 21% de chômeurs en zone urbaine et 19% en zone rurale (OIT, 2019, p. 13). Ce pays connaît un fort taux de chômage des jeunes diplômés (OIT, 2019, p. 13). Le nombre de chômeurs devrait augmenter en raison de l’augmentation de la population active (l’OIT, 2019, p. 8). Dès lors, au Gabon, la formation universitaire a-t-elle encore l’emploi comme représentation sociale ? De cette question découle l’hypothèse selon laquelle, au Gabon la formation universitaire n’a plus l’emploi pour représentation sociale. En effet, il est question ici du rapport communément établi entre l’Université et le monde du travail. Il sied à cet effet de s’interroger sur le statut du savoir universitaire dans la société, en particulier aux yeux des premiers concernés à savoir les diplômés (E. Gérard et B. Schlemmer, 2003, p. 299). La période durant laquelle la formation universitaire, au Gabon, avait pour représentation sociale l’emploi permet de dire qu’il y avait en ce temps une adéquation formation-emploi. Cette idée fait couler beaucoup d’encre depuis des années (R. Michaud, A. Bernier et N. Poulet, 2017, p. 5). Elle est souvent présentée comme l’un des principaux défis à relever tant du point de vue individuel, organisationnel que sociétal (R. Michaud, A. Bernier et N. Poulet, 2017, p. 5).
En effet, de la question de la formation universitaire au Gabon résulte une question sous-jacente qui fait allusion au fait que l’Université Omar Bongo est restée dans les formations générales, non spécialisées. Ceci indique l’absence de professionnalité. Cette absence de professionnalité occasionne des orientations estudiantines de ces jeunes gabonais vers d’autres pays. Mais on reste sans ignorer que les pays dans lesquels ces jeunes vont étudier et le Gabon sont régis par des systèmes académiques internationaux, notamment le système Licence-Master-Doctorat (MLD). A la vue de ces systèmes, les universités ont progressivement mis en place pour chacun de ces trois niveaux de diplôme, une voie dite professionnelle à côté de la voie générale (C. Béduwé et V. Mora (2017, p. 60). Le Gabon n’est pas en marge de cette perspective. Dès lors, quitter le Gabon pour poursuivre les mêmes formations enseignées à l’Université gabonaise nous conduit à la question de savoir quelle représentation sociale ces étudiants ont-ils de l’université gabonaise et de sa formation. À la suite de ce qui est susmentionné, disons avec C. Béduwé et V. Mora (2017, p. 59) que la professionnalité et la formation d’un étudiant résultent d’un processus d’accumulation plus ou moins singulier et riche de compétences et de signaux qui, au-delà de son diplôme terminal influencent son insertion professionnelle à venir.
C. Béduwé et V. Mora (2017, p. 60) pensent à cet effet que, les savoirs ou connaissances délivrés par un processus d’apprentissage souvent long et validé par un diplôme sont élargis à tout ce qui atteste que l’étudiant est également capable de s’adapter, d’évoluer et de mobiliser efficacement les ressources adéquates pour faire face aux problèmes que pose l’évolution rapide du travail et des emplois. Ceci laisse dire que l’étudiant ayant reçu une formation universitaire sans grèves répétitives, ni années universitaires approximatives ou blanches est un réservoir de compétences. Malgré les compétences dont l’étudiant peut faire montre, un constat demeure : nombreux sont les pays africains qui connaissent le chômage intellectuel (P. Antoine, M. Razafindrakoto et F. Roubaud, 2001, p. 32). En Afrique le diplôme n’est plus un viatique contre le chômage (P. Antoine, M. Razafindrakoto et F. Roubaud, 2001, p. 32). Il est devenu un facteur de risque pour trouver un emploi (P. Antoine, M. Razafindrakoto et F. Roubaud, 2001, p. 32). Au Gabon environ 35% de demandeurs d’emplois proviennent de l’enseignement supérieur (ONE, 2019, p. 1). Les étudiants du Gabon au sortir de leurs formations sont inéluctablement exposés aux risques de chômage défini par la reconversion professionnelle, la sous employabilité, la contractualisation dans la fonction publique et la débrouillardise professionnelle.
En engageant la réflexion sur la crise de l’Université en Afrique, et au Gabon en particulier, l’objectif de cette recherche consiste à montrer à la lumière de statistiques qu’au Gabon la formation universitaire, au regard des vicissitudes que connaissent les années académiques, n’a plus l’emploi pour représentation sociale. L’intérêt de cette recherche est de promouvoir la professionnalisation de l’Université par la relation formation-emploi, d’une part. Il vise d’autre part à susciter une gouvernance politique qui davantage va s’investir dans l’adéquation formation-emploi, afin de former les futurs cadres. Cet intérêt se justifie parce que l’université gabonaise est dans l’obligation de se reformer et de se réadapter aux nouvelles donnes que lui impose la mondialisation des standards universels de l’enseignement supérieur. Les dits standard se fondent sur une nouvelle culture académique ayant comme principaux objectifs de créer d’une part, des liens entre l’université et le marché du travail, et de permettre d’autre part une bonne mobilité entre la recherche et la formation (A. Sahraoui, 2019, p. 699).
1. Méthodologie
1.1. Considération théorique
Pour comprendre l’environnement, les individus ont besoin des cadres de référence et des normes pour prendre position face à des situations qui leurs incombent (P. Mihindou Boussougou,2020, p. 244). Parmi ces situations on peut retenir la représentation sociale de l’université, teintée de la traversée d’une grave crise dont le corollaire est le risque de chômage. La représentation étant une activité mentale qui assure la planification et le guidage de l’action (J. Leplat, 1992, p. 269), la théorie de la représentation sociale (J. C. Abric, 1987, p. 64) permet de comprendre l’attitude des étudiants du Gabon face aux situations relatives à leurs formations notamment les longues années d’études pour obtenir le premier diplôme, la généralisation des formations, l’absence d’insertion professionnelle et l’absence de professionnalité de l’étudiant. En effet, la professionnalité de l’étudiant résulte d’un processus d’accumulation, plus ou moins singulier, riche de compétences et de signaux qui, au-delà de son diplôme terminal, influencent son insertion professionnelle à venir (C. Béduwé et V. Mora, 2017, p. 59). Ce qui devance aura entre autres perspectives le fait que les étudiants du Gabon aient une représentation appréciative de leur Université et par voie de conséquence de la formation dont ils sont l’objet.
Ainsi, A. Leroi-Gourhan (1945, p. 25) pense que l’évolution des pratiques sociales ou professionnelles est un déterminant puissant dans le changement d’état des représentations sociales. En fait, la représentation sociale permet de comprendre les attitudes et les comportements des individus aussi bien en situation individuelles qu’en situation de groupe (S. Moscovici, 1969, p. 9 ; D. Jodelet, 1984, p. 362 ; D. Jodelet, 1989.p. 362 et J.C. Abric, 1987, p. 64). La représentation sociale que les étudiants du Gabon ont de la formation universitaire justifierait leurs attitudes et comportements exprimés par la reconversion professionnelle, le sous-emploi, le fait de devenir contractuel de la fonction publique et la débrouillardise professionnelle. Somme toute, la débrouillardise professionnelle ne garantit pas l’emploi. C’est la professionnalité qui le garantirait. Parce qu’elle passe par la formation qui apporte à l’étudiant le savoir nécessaire et l’assurance dont il a besoin pour faire face à une situation professionnelle. Dès lors, les théories des apprentissages (D. Legros, E. Maître de Pmbroke et A. Talbi, 2002, p. 23 ; J. Piaget, 1967, p. 133) disent que la formation est associée à la nécessité d’une connaissance externe, laquelle est sanctionnée par une reconnaissance qui peut être un diplôme. L’apprentissage acquis lors d’une formation a donc pour fondement le développement de l’étudiant ; sa principale fonction est d’assurer la meilleure adaptation possible de celui-ci dans le monde du travail. L’apprentissage est donc le processus qui permet de créer la connaissance par la formation des apprenants à l’instar des étudiants de l’Université Omar Bongo.
Fort de tout ce qui précède, il sied de dire que d’un apprentissage issu d’une formation découle une connaissance qui est le fruit de la transaction entre les capacités de l’étudiant à acquérir les connaissances et les capacités des institutions à disposer les conditions nécessaires à la transmission des connaissances. De ce fait, l’apprentissage comporte ainsi des transactions entre la personne de l’apprenant et l’institution garant de la transmission de la connaissance et du savoir.
1.2. Cadre de recherche et population d’enquête
1.2.1. Cadre de recherche
Cette recherche est menée auprès des étudiants de l’Université Omar Bongo. Elle a pour vocations de comprendre la recherche scientifique, la formation dans les disciplines de lettres, sciences humaines, droits et sciences économiques.
1.2.2. Population d’enquête
La population d’enquête est constituée d’étudiants de licence 3, Master (1 et 2) et des doctorants. Le choix porté sur les étudiants de licence 3 se justifie par le fait qu’ils soient en fin de cycle licence. Quant au choix des étudiants de master et doctorants, il se justifie par le fait qu’ils aient au moins une licence pour les uns et un master pour les autres.
1.3. Échantillonnage
N=507 enquêtés soit Licence3 (212 étudiants), Master1 (107 étudiants), Master2 (176 étudiants) et Doctorants (12 étudiants). Aucune technique d’échantillonnage particulier n’a été utilisée pour obtenir cet échantillon. Nous nous sommes servis d’un échantillon tout-venant, pour saisir les représentations des étudiants sur la formation et le risque de chômage, et cela auprès de tous les étudiants quel que soit le niveau retenu. Les critères d’inclusion étaient la volonté, la disponibilité des étudiants à remplir le questionnaire et faire partie des étudiants régulièrement inscrits dans l’un des 3 cycles à l’Université Omar Bongo. Le critère de non inclusion était de ne pas faire partie des étudiants régulièrement inscrits à l’Université Omar dans l’un des 3 cycles.
1.4. Instrument de mesure
La présente recherche se veut qualitative. De ce fait soulignons qu’en recherche qualitative, les outils les plus usuels sont : l’entretien individuel, l’entretien de groupe, et le zoom : focus groupe. Qu’à cela ne tienne, il sied de dire que le questionnaire qualitatif lequel repose sur des questions ouvertes qui conduisent à des réponses libres, interprétées pour décrire et mettre en évidence les attitudes et les comportements d’une population (Modèle business plan ; 2021, p. 1) est aussi un outil utilisé en recherche qualitative, d’une part. D’autre part, l’analyse des représentations sociales appelle une méthodologie appropriée certes, mais il existe d’autres types d’analyses des représentations sociales selon l’importance de la taille de l’échantillon (P. Vergès, 2001, p. 537). Pour cela, la collecte des données s’est effectuée au moyen d’un questionnaire de vingt questions ouvertes pour deux items. Le premier item comptait 12 questions. Il avait pour objet d’obtenir des données sur la représentation de l’Université. Le second comptait 8 questions. Il visait à des informations sur la représentation de la formation de l’Université et le risque de chômage.
1.5. Variables de recherche
Cette recherche a pour variable indépendante (VI) la représentation de la formation de l’Université. Ses modalités sont : la représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme, la représentation de la généralisation des formations universitaires, la représentation de l’absence d’insertion professionnelle, et la représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant.
La variable dépendante (VD) est le risque de chômage. Ses modalités sont : la reconversion professionnelle, la sous-employabilité, la contractualisation dans la fonction publique, et la débrouillardise professionnelle. Ces variables (VI et VD) ont été mobilisées pour vérifier la présente hypothèse générale : au Gabon la formation universitaire n’a plus l’emploi pour représentation sociale.
1.6. Traitement des données
L’analyse descriptive, de corrélations et de régression linéaire simple ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS. L’analyse descriptive (tableau n°1) a été réalisée pour ressortir les différentes valeurs de chaque dimension de la VI et de la VD. L’analyse de corrélations (tableau n°2) a été faite dans l’optique de prendre la plus pertinente des dimensions. Elle avait pour objectif de vérifier s’il existe des liens forts entre les dimensions (représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP), représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU), représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) et représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD). Les analyses de régression linéaire simple (tableau n°3 ; tableau n° 4 et tableau n°5) avaient pour but d’étudier les effets prédictifs des dimensions de la VI sur celles de la VD.
2. Résultats
Rappelons ici que trois types d’analyses statistiques ont été réalisés dans cette recherche : l’analyse descriptive, l’analyse de corrélations et l’analyse de régression linéaire simple.
Tableau n°1 : Valeurs descriptives des modalités de la VI et de la VD
| Statistiques descriptives | |||
| Dimensions | Effect | M | E.T |
| Représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP) | 507 | 2.67 | 1.170 |
| Représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU) | 507 | 2.46 | 1.325 |
| Représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) | 507 | 2.28 | 1.257 |
| Représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD) | 507 | 2.40 | 1.302 |
| Formé reconverti professionnel (FRP) | 507 | 2.39 | 1.312 |
| Formé contractuel de la fonction publique (FCFP) | 507 | 2.64 | 1.403 |
| Formé débrouillard professionnel (FDP) | 507 | 2.56 | 1.247 |
| Formé sous employé (FSE) | 507 | 2.77 | 1.410 |
Source : Données de l’enquête réalisée
Le(tableau n°1), tableau des statistiques descriptives présente l’effectif total (effect) de la recherche, la moyenne (M) et l’écart-type (E.T) de chaque dimension de la variable indépendante et de la variable dépendante.
Tableau n°2 : Analyse de corrélations
| Dimensions de la variable indépendante | M | E.T. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP) | 2.67 | 1.17 | ||||
| 2. Représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU) | 2.46 | 1.32 | 0.166** | |||
| 3. Représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) | 2.28 | 1.26 | 0.018 | 0.019 | ||
| 4. Représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD) | 2.40 | 1.30 | -0.089 | -0.089 | 0.131* |
Source : Données de l’enquête réalisée.
**La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
Dimensions =ensemble de modalités croisées dans l’analyse de corrélations.
M =moyenne, ET =écarts-types.
Le (tableau n°2) présente l’analyse de corrélations réalisée entre les dimensions de la variable indépendante. La présente analyse est faite pour voir s’il existe des liens forts entre les dimensions précitées dans le (tableau n°2). Ceci dans l’optique de prendre la plus pertinente. Le (tableau n°2) présente qu’il n’existe aucun lien fort entre ces dimensions. Dès lors, toutes les dimensions de la variable indépendante sont admises dans le modèle.
Tableau n°3 : Effet prédictif de la représentation de la formation universitaire (VI) sur le risque de chômage (VD)
| Prédicteurs | β | R² | F | Sig. | Constante | Coefficient de la pente |
| Représentation de la formation universitaire. | 0.241 | 0.0580 | 19.1 | .001 | 1.999 | 0.241 |
Source : Données de l’enquête réalisée
Pour étudier le lien entre la représentation sociale de la formation universitaire et le risque de chômage, nous avons calculé les scores globaux de chacune des variables (VI et VD) à partir de leurs dimensions. Les dimensions de la VI (représentation de la formation universitaire) sont : la représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP), la représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU), la représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) et la représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD). Les dimensions de la VD (risque de chômage) sont : formé reconverti professionnel (FRP), formé contractuel de la fonction publique (FCFP), formé débrouillard professionnel (FDP) et formé sous employé (FSE). Pour observer le lien entre la (VI) et la (VD) nous avons fait une analyse de régression linéaire simple. Le (tableau n°3) montre les principaux résultats de l’analyse de régression linéaire simple du prédicteur représentation de la formation universitaire sur le risque de chômage. Ces principaux indices sont le coefficient de régression (β), la variabilité (F), le seuil de significativité (Sig.), le coefficient de détermination (R²), la Constante (B) et le Coefficient de la pente (A). Les résultats montrent qu’il y a un effet prédicteur de la représentation de la formation universitaire sur le risque de chômage perçu par les étudiants.
Tableau n°4 : Effets prédictifs de (RAIP), (RGFU), (RAPE) et (RLAEPD) sur formé et contractuel dans la fonction publique (FCFP)
| Prédicteurs | β | R² | F | Sig. | R² ajusté | Constante | Coefficient de la pente |
| Model 0.06 5.24 0.00 0.05 1.44 | |||||||
| Représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP) | 0.15 | 0.00 | 0.18 | ||||
| Représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | ||||
| Représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) | 0.12 | 0.03 | 0.13 | ||||
| Représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD) | 0.16 | 0.00 | 0.17 | ||||
Source : Données de l’enquête réalisée
Les résultats montrent que le fait d’être formé puis être contractuel à la fonction publique (FCFP) est prédictif à la fois par la représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP), la représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) et par la représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD).
Tableau n°5 : Effets prédictifs de (RAIP), (RGFU), (RAPE) et (RLAEPD)sur formé sous employé (FSE)
| Prédicteurs | β | R² | F | Sig. | R² ajusté | Constante | Coefficient de la pente |
| Modèle 0.20 0.04 3.23 0.01 0.03 1.91 | |||||||
| Représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP) | 0.00 | 0.92 | -0.01 | ||||
| Représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU) | 0.14 | 0.02 | 0.14 | ||||
| Représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) | 0.11 | 0.04 | 0.14 | ||||
| Représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD) | 0.09 | 0.11 | 0.01 | ||||
Source : Données de l’enquête réalisée
Les résultats montrent qu’être formé sous employé (FSE)est prédit à la fois par la représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU)et la représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE).
3. Discussion
Trois types d’analyses font l’objet de la discussion de nos résultats. Les résultats de ces analyses (descriptives, corrélationnelles et régressions linéaires simples) amènent plusieurs éléments de discussion. Une série de discussion commence entre la représentation des formations universitaires et le risque de chômage. L’étude du lien entre la représentation des formations universitaires et le risque de chômage s’est faite à partir du calcul des scores globaux de chacune des dimensions des deux variables précitées (tableau n°1). En effet, le (tableau n°1) présenteles statistiques descriptives : la taille de l’échantillon (N), la moyenne (M) et l’écart-type (E.T) de chaque dimension de la variable indépendante et de la variable dépendante. Il est remarqué à partir de ce (tableau n°1) que la dimension dite formé sous employé (FSE) présente la moyenne (M= 2.77) et l’écart-type (E.T= 1.410) les plus élevés parmi toutes les dimensions présentées dans ce (tableau n°1). Cette dimension explique mieux le risque de chômage perçu par les étudiants. Le (tableau n°2) présente l’analyse de corrélations réalisée entre les dimensions de la variable indépendante. Ces dimensions sont : la représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP) (M = 2.67 ; ET= 1.17), la représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU) (M = 2.46 ; ET= 1.32), la représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) (M = 2.28 ; ET= 1.26), et la représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD) (M = 2.40 ; ET 1.30). Les résultats de ce (tableau n°2) montrent qu’il n’existe aucun lien fort entre les dimensions de la variable indépendante. Toutes les dimensions de la variable indépendante sont donc admises dans le modèle pour des analyses de régressions linéaires simples. Le (tableau n°3) présente l’analyse de régression linéaire simple. Ce (tableau n°3) comprend les principaux indices : le coefficient de régression (β =0.24), la variabilité (F= 19.1), le seuil de significativité (Sig =.00), le coefficient de détermination (R² = 0.06), la Constante (B = 1.999) et le Coefficient de la pente (A = 0.24). Les résultats de ce (tableau n°3) montrent qu’il y a un effet prédicteur de la représentation de la formation universitaire sur le risque de chômage perçu par les étudiants. Ce résultat corrobore aux travaux de C. Trottier, L. Laforce et R. Cloutier (1997, p. 61) pour qui l’étude de l’insertion professionnelle doit tenir compte des représentations que les individus se font sur la stabilité dans l’emploi, mais aussi, la correspondance formation emploi et la construction de l’identité professionnelle. En nous inscrivant dans la perspective des travaux de C. Trottier, L. Laforce et R. Cloutier (1997, p. 61), on peut ainsi penser que le phénomène de la précarisation du travail semble irréversible, et affecte un nombre toujours croissant de détenteurs d’un titre universitaire.
En effet, les résultats du (tableau n°3) et les thèses développées par C. Trottier, L. Laforce et R. Cloutier (1997, p. 61) valident l’hypothèse selon laquelle : chez les étudiants de l’Université Omar Bongo, la représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP)a pour corollaire formé débrouillard professionnel (FDP). C. Siino, M. Lacoste et D. Guy (2018, p. 4) pensent à cet effet que, la diversité des chômeurs par rapport au travail suivant leurs trajectoires et leurs situations personnelles recherchées de façon non exclusive par des moyens d’entrer dans le monde du travail et droits sociaux pour des compensations au déficit de socialisation entraînent leur exclusion de l’emploi et leur dénuement dans une activité bénévole. Le (tableau n°4) présente les analyses de régressions linéaires simples réalisées entre les prédicteurs représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP), représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU), représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE), et représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD), sur le fait d’être formé et contractuel dans la fonction publique (FCFP). Les résultats de ce (tableau n°4) (β = 0.06 ; R² = 5.24) ; (F = 0.00) ; (Sig. =.05) ; (R² ajusté = 1.44) montrent que le fait d’être formé et contractuel à la fonction publique (FCFP) est prédictif à la fois par la représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP), la représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE) et par la représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD). Les résultats de ce (tableau n°4) confortent l’hypothèse suivante : chez les étudiants de l’Université Omar Bongo, la représentation des longues années d’études passées pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD) a pour corollaire formé contractuel de la fonction publique (FCFP). A l’issue de ce qui précède, on peut penser avec J. Lamour (2007, p. 1) que les universités sont des « usines à chômeurs ». Elles sont comme des tours d’ivoire recroquevillées sur leurs disciplines académiques (J. Lamour, 2007, p. 1). Dès lors, les caractéristiques de niveau et de contenu des formations ne sont pas sans effet sur la plus ou moins grande exposition au chômage (J. Lamour, 2007, p. 3). Ainsi, convenons avec J. Lamour (2007, p. 1) que c’est la professionnalisation de l’Université qui changera la donne.
Le (tableau n°5) présente les analyses de régressions linéaires simples réalisées entre les prédicteurs représentation de l’absence d’insertion professionnelle (RAIP), représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU), représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE), et représentation des longues années d’études pour obtenir le premier diplôme (RLAEPD), sur la dimension dite formé sous employé (FSE).Les résultats de ce (tableau n°5) (β = 0.20) ; (R² = 0.04) ; (F = 3.23) ; (Sig =0.01) ; (R² ajusté = 0.03),et (A = 1.91) montrent que formé et être sous employé (FSE)est prédit à la fois par la représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU)et par la représentation de l’absence de professionnalité de l’étudiant (RAPE).Les résultats de ce (tableau n°5) valident l’hypothèse selon laquelle: chez les étudiants de l’Université Omar Bongo, la représentation de la généralisation des formations universitaires (RGFU) a pour corollaire formé sous employé (FSE). Fort de tout ce qui précède, nos universités se doivent d’être désormais professionnelles. Une professionnalisation qui relèverait à tout le moins d’une conception étroite de la relation formation-emploi. A l’heure des bilans de compétence, de la valorisation des acquis de l’expérience, il semblerait paradoxal de faire l’impasse sur les compétences que peuvent acquérir les étudiants au sein de formations générales. Il faut donc la construction d’une orientation professionnelle à partir de formations initiales de qualité afin de définir les besoins de formation en fonction des besoins d’emploi estimés par niveau et spécialité (J. Lamour, 2007, p. 14). Dès lors, la nécessaire professionnalisation des enseignements universitaires doit de ce fait être entendue au sens le plus large dans toutes ses configurations possibles et sans exclusive. Les formations générales participeraient à cette professionnalisation en permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances de base et des méthodes utiles aux apprentissages professionnels.
In fine, la professionnalisation doit transcender les clivages facultaires entre disciplines littéraires et de sciences humaines et disciplines scientifiques, mais aussi juridiques et économiques. La professionnalisation ne pourrait donc être qu’un jeu à partenaires multiples. Elle impliquerait non seulement les enseignants, sa tutelle, mais aussi l’ensemble des partenaires sociaux et économiques. La qualité et la pertinence de la professionnalisation serait déterminée par le niveau d’implication de chacun de partenaires et de ses objectifs.
Conclusion
Au regard de tout ce qui précède, disons en définitive que les résultats de cette recherche permettent de dire que les étudiants du Gabon ont en idée le risque de chômage après leurs formations. Lesdits résultats présentent des liens significatifs entre les dimensions de la représentation sociale de la formation universitaire et celles du risque de chômage. Les dimensions de la représentation sociale de la formation universitaire prédisent celles du risque de chômage. Les résultats nous enjoignent à considérer notre hypothèse générale. La représentation sociale constitue ici la variable que nous avons utilisé afin d’étudier les risques de chômage chez ces étudiants. En effet, chez les étudiants de l’Université Omar Bongo, la formation universitaire n’a plus l’emploi pour représentation sociale, mais un illustre parcours exposant au risque de chômage. Il est donc urgent que cette Université s’inscrive dans un élan de professionnalisation à partir de formations initiales, afin de définir les besoins de formation en fonction des besoins d’emploi estimés par niveaux et spécialités. Cette professionnalisation des enseignements universitaires doit être perçue dans toutes ses formes. Les formations générales participeraient à cette professionnalisation en permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances de base et des méthodes utiles aux apprentissages professionnels. Il conviendrait de ce fait à la gouvernance politique du Gabon de s’investir à bras-le corps dans les questions immanentes de l’Université dont la vocation est de former des cadres et non des chômeurs. Pour cela, elle doit mettre l’accent sur la professionnalité des étudiants à leur employabilité.
Références bibliographiques
ABRIC Jean Claude, 1987, Coopération, Compétition et représentations sociales, Cousset, Delval.
ANTOINE Philippe, 2001, RAZAFINDRAKOTO Mireille, ROUBAUD François, Contraints de rester jeunes ? Évolution de l’insertion dans trois capitales africaines, Dakar, Yaoundé, Antananarivo, https://www.academia.edu.
BEDUWE Catherine et MORA Virginie, 2017, « De la professionnalité des étudiants à leur employabilité, n’y-a-t-il qu’un pas ? », Formation emploi, in Revue française de sciences sociales, 138, p. 59-77.
BERNIER Amélie, MICHAUD Renée, POULET Normand, 2017, « L’adéquation entre les compétences et l’emploi occupé : pratiques des employeurs dans les PME québécoises du secteur manufacturier », in Rapport de recherche présenté à la Commission des partenaires du marché du travail, Québec.
ERLICH Valérie, 1998, « Les nouveau étudiants, un groupe social en mutation », in Revue française de pédagogie, 128, p. 144-146.
GERARD Étienne et SCHLEMME Bernard, 2003, Les travers du savoir représentations du diplôme et du travail au Maroc, in Cahiers d’études africaines, 169, p. 299-319.
JODELET Denise, 1989, Folies et représentations sociales, Paris, PUF.
JODELET Denise, 2003, Les représentations sociales, Paris, PUF.
JODELET Denise, 1984, Représentations sociales : phénomènes, concept et théorie, Paris, PUF.
LAMOUR Jean, 2007, « Formation professionnelle à l’université, et après ? », in Jeunes vers l’emploi, www.revue-projet.com.
LEGROS Denis, MAITRE DE PMBROKE Emanuelle, TALBI Assia, 2002, « Psychologie de l’apprentissage et les systèmes multimédias », in researchgate.net.
LEPLAT Jacques, 1992, L’analyse du travail en psychologie ergonomique, Octarès.
LEROI-GOURHAN André, 1945, Evolution et techniques II- Milieu et techniques, Bruxelles, De Boeck Université.
MICHAUD Renée, BERNIER Amélie et MANSOUR Jamal Ben, 2017, « L’adéquation formation-emploi : concepts et pratiques de gestion des ressources humaines », in Relations industrielles, 75, p. 296-320.
MIHINDOU BOUSSOUGOU Parfait, 2020, « Prise de risque de contamination de la Covid-19 chez les infirmiers de quatre structures hospitalières de Libreville-Gabon : recherche par la représentation, les croyances illusoires et culturelles », in Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3, p. 241-254.
MOSCOVICI Serge, 1969, « Marxisme et la question naturelle », in L’homme et la société, 13, p. 59-109.
OIT, 2019, « Rapport emploi et questions sociales dans le monde : Tendances Office National de l’Emploi. Gabon : 20 000 demandeurs d’emplois enregistrés en 2019 », in Direct info.
PIAGET Jean, 1967, Logique et connaissance scientifique, Paris, Gallimard.
SAHRAOUI Antissar, 2019, « Le système LMD entre l’idéalisme des reformes et le réalisme du terrain », in Journal Dirassat InsaniyawaIjtimaiya / Univ Oran 02, 9, p. 699-711.
SIINO Corinne, LACOSTE Marie, GUY Daniel, 2018, « La représentation des chômeurs et des précaires, quelle place pour la revendication au travail hors du travail ? », in Hal, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01897524.
TROTTIER Claude, LAFORCE Louise, CLOUTIER Renée, 1997, « Les représentations de l’insertion professionnelle chez les diplômés de l’université », in Formation Emploi, 58, p. 61-77.
VERGES Pierre, 2021, « L’analyse des représentations sociales par questionnaires », in française de sociologie, 42, p. 537-561.
QUATRIÈME AXE : UNIVERSITÉ ET CULTURE DE L’EXCELLENCE
DE LA PROMOTION DE L’ÉDUCATION POSITIVE POUR UNE UNIVERSITÉ PLUS CRÉATIVE
Hyacinthe Aboa ACHI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La crise de l’université révèle de nombreux dysfonctionnements au sein de cette institution. L’un de ces dysfonctionnements tient au fait que l’université a longtemps fait la promotion d’un modèle éducationnel inconvenant : l’éducation négative. En effet, le système éducatif traditionnel sur lequel s’appuie toute la culture ancienne et moderne est porteur d’un handicap : il enseigne le savoir par-delà son contraire. Autrement dit, la thèse s’apprécie constamment à l’épreuve de l’antithèse qui la borde. Contre ce type d’éducation, se profile l’éducation positive qui pourrait consister à enseigner aux apprenants des thèses, sans confronter celles-ci à des antithèses. L’institution et la promotion de cette éducation pourrait constituer une des réponses au manque de performance et de compétitivité dont souffre l’institution universitaire sous nos tropiques.
Mots clés : Antithèses, Crise de l’université, Dysfonctionnements, Éducation négative, Éducation positive, Thèses.
Abstract:
The university crisis reveals many dysfunctions within this institution. One of these dysfunctions is that the university has long promoted an inappropriate educational model: negative education. Indeed, the traditional education system on which all ancient and modern culture is based carries a handicap: it teaches knowledge beyond its opposite. In other words, the thesis is constantly assessed by the test of the antithesis that surrounds it. Against this type of education, positive education is looming which could consist in teaching learners theses without confronting them with antitheses. The institution and the promotion of this education could constitute one off the answers to the lack of performance and competitiveness from which the university institution suffers in our tropics.
Keywords : Antitheses, Dysfunctions, Handicap, Lack of performance and competitiveness, Negative education, Positive education, Theses, University crisis.
Introduction
Pour mieux appréhender la crise de l’université il conviendrait de situer l’université dans le vaste programme de l’éducation nationale, en tant qu’institution placée au sommet, dans la hiérarchie des institutions relevant de l’enseignement. Il s’agit d’institutions qui, avec le concours de celle de la sécurité intérieure et de la justice, œuvrent avant tout à l’exécution du programme d’éducation nationale dans l’organisation de l’Etat. L’objectif à terme de tout cela étant incontestablement la promotion du progrès social et intellectuel du citoyen. Aussi bien, si l’on considère le citoyen dans le projet culturel et/ou cultural qui l’assimile de cette façon à une plante, une telle plante est celle qui parvient au stade de l’université, comme au bout de ce projet culturel qui le porte à sa maturité. Ce qui laisse apparaître l’université dans un tel cas, comme le lieu d’épanouissement de la fleur de cette plante, dont la tige se forme par l’enseignement secondaire, et qui se prolonge par l’enseignement primaire et préscolaire comme les racines du sujet culturel. Toutes choses qui autoriseraient à redresser la métaphore platonicienne assimilant l’homme à une plante céleste inversée, dans le Timée. En effet, c’est Platon qui écrivait dans ce dialogue (2021, 90a) « L’homme est une plante céleste, ce qui signifie qu’il est comme un arbre inversé, dont les racines tendent vers le ciel et les branches en bas vers la terre. » Tandis qu’ici de l’homme éduqué, l’on ne peut que dire qu’il est une plante culturelle bien dressée, ce qui signifie qu’il est comme un arbre debout dont les racines s’enfoncent dans l’enseignement primaire et préscolaire, et les branches en haut vers l’université, sa fleur.
La crise que connaît l’université et qui est un reflet de divers dysfonctionnements au sein de cette institution, pourrait valablement se traduire dans un tel cas, par le constat d’un projet cultural se soldant par une fleur qui est pale. Ce qui justifie amplement que la recherche de solutions à l’épanouissement de l’université, passe entre autres orientations, par une analyse du programme culturel qui se couronne par elle. Dès lors, quelle est la nature du programme éducatif telle que celle-ci constitue un obstacle à la recherche, et est susceptible de faire échec au projet de rayonnement de l’université ?
Notre contribution vise à remettre en question une méthode éducationnelle séculière, qui fait la promotion d’une éducation d’allure négative conduite depuis la formation de base, et dont l’université située au bout de la chaîne de formation, endosse les conséquences qui se traduisent en partie dans la crise que l’université traverse. Il s’agit surtout pour nous, de proposer une alternative à une telle option en réalité, finalement contreproductive.
1. L’éducation négative
L’éducation institutionnelle est axée sur une méthodologie qui consiste à prévenir contre l’erreur et l’ignorance. Ce qui conduit à mettre en avant dans la formation, les faux savoirs, pour espérer d’une part mieux les contourner, et d’autre part pour évaluer les apprenants par la recherche systématique des fautes qui se cachent dans les contrôles de leur apprentissage. Or, une telle fixation sur le négatif qu’induit une pareille pratique, est ce qui ne manque d’aboutir à promouvoir le faux savoir et à pervertir le jugement du formateur, lequel s’habitue dès lors à déprécier le résultat de l’apprentissage, au lieu de s’ouvrir à ses promesses.
1.1. La pédagogie négative et ses conséquences
Si l’université ne connaît pas le rayonnement espéré et est plutôt la proie des crises interminables, c’est une raison de revoir le système d’enseignement dont elle est elle-même le maillon final, et dont elle porte bien malgré elle le bilan. Or, s’il est un caractère récurrent de l’éducation humaine qui transcendante même les stades d’évolution de la psychologie humaine, c’est sans conteste l’enseignement de la règle de conduite et de celui de son contraire à la fois qui la limite. Depuis la formation de base, toute l’éducation humaine consiste ainsi à recommander certaines pratiques et à bannir leurs contraires. Même pour un apprentissage aussi basique comme celui de la langue, il n’en va pas autrement : devant la maladresse d’une prononciation, l’on ne manque de souligner à l’enfant l’incorrection que cela représente avant de rectifier. Et les règles de grammaire de nos diverses langues, à cet effet comportent presque toutes des limites clairement définies, qui préviennent contre leur usage incorrect voire abusif, puis ces contre-indications sont celles sur lesquelles s’appuie régulièrement l’apprentissage. C’est l’application de l’adage selon lequel « c’est l’exception qui confirme la règle ». Et une pareille attitude qui enseigne l’interdit pour instruire de la règle, est celle qui se remarque également lorsqu’il s’agit de connaissances qui par ailleurs mettent en jeu le raisonnement déductif, etc.
Quel que soit le domaine d’apprentissage où l’on se situe, l’on remarque ainsi que c’est un souci constant de baliser les acquis d’un savoir qui finalement, ne s’éclaire que par le contraste créé avec l’obscurité qui l’environne. « Ne pas faire ceci », mais « faire plutôt cela ». De la sorte, la thèse s’apprécie constamment à l’épreuve de l’antithèse qui la borde, tandis que le savoir s’affirme partout en écartant l’ignorance, tout comme au plan de l’éducation morale, le bien se dévoile en contournant constamment le mal. Comment expliquer la survivance d’une pratique aussi immémoriale dans nos méthodes éducatives actuelles dites modernes ? Sans doute la volonté de rompre avec un enseignement dogmatique a-t-elle poussé la méthode éducative, à tomber dans le travers de systématiser la bonne vieille méthode d’enseignement des thèses par leurs antithèses et/ou des thèses et de leurs antithèses à la fois ? Car, le système éducatif contemporain est beaucoup redevable, dit-on, au passé moyenâgeux et nos universités actuelles remonteraient même aux universités du moyen-âge. Selon R. Gal (1948, p. 54) « elles en portent encore aujourd’hui le nom ; les divisions de nos facultés sont encore celles du moyen-âge ». Et le psychologue E. Claparède (2003) ne manqua pas de dénoncer comme un legs du passé moyenâgeux, le système de fonctionnement monarchique de l’éducation classique, qui donne toute autorité au maître devant les élèves, d’après A. Souché qui le cite (1948, p. 351) : « Notre conception éducative est tout imprégnée encore du principe d’autorité qui fausse, non seulement l’éducation morale, mais aussi l’éducation intellectuelle. »
Certes, dans leur ensemble, ces critiques adressées à l’éducation moyenâgeuse, se justifient dans leur caractère dogmatique qui consacre de façon récurrente l’autorité du maître devant l’élève, tel que cela se retrouve encore de nos jours dans le système éducatif. Toutefois, il convient de ne point être dupe et de savoir distinguer proprement de tels griefs, de l’attitude ici dénoncée, qui apparaît quant à elle une habitude humaine, voire trop humaine, très enracinée et à laquelle le moyen-âge lui-même après, tout n’échappa guère : le fait de donner un enseignement par la prévention contre son contraire. Ce qui revient à prêcher systématiquement le non-savoir, pour le distinguer de son autre, autrement dit, enseigner le vrai en montrant ce qui ne l’est pas : le faux.
Mais comment peut-on vouloir confronter systématiquement thèses et antithèses à chaque fois dans un tel modèle d’enseignement, en s’efforçant de penser à la fois une chose et son contraire, si le contraire représente ce qui s’écarte de la voie ? Pourquoi vouloir remettre systématiquement ainsi en question toute intuition première, pour imposer nécessairement la discussion sur tout sujet, et ériger de cette façon la dialectique en une panacée du raisonnement, au lieu que celle-ci ne suscite notre méfiance ? Car ce faisant, l’on ignore l’avertissement de F. Nietzsche (1985, p. 18) qui prévenait pourtant contre l’usage abusif de la dialectique : « Mes lecteurs savent peut-être à quel point je considère la dialectique comme un symbole de décadence, par exemple dans le cas le plus fameux : le cas de Socrate. ». La crise que traverse l’université ne serait-elle pas l’expression de cette décadence dont nous prévenait Nietzsche, et dont porte ici trace la méthode d’éducation ci-avant décrite, qui postule la thèse par-delà l’antithèse ? En effet, on peut valablement s’interroger sur la valeur heuristique de cette méthode négative que véhicule le système éducatif dans son ensemble, telle que couronnée par l’université.
D’une part, une telle délimitation permanente de thèses par leurs antithèses, emporte le risque d’enraciner finalement l’esprit éduqué dans la recherche du négatif comme condition de son affirmation, au détriment de la spontanéité et de la créativité. Or, l’on ne peut aboutir de la sorte qu’à émousser efficacement, l’élan de pensée créatrice d’un entendement humain plutôt connu pour être naturellement folâtre ! Ainsi s’expliquerait le fait que le système éducatif traditionnel forme des esprits qui n’osent guère bousculer les limites du savoir acquis, parce que ce savoir est dorénavant borné par la non-science. D’autre part, l’attitude de dénigrement automatique de toute opinion en vue d’instaurer la discussion qui accompagne pareille méthode, n’emporte-t-elle pas une surestimation de la position adverse et d’autrui au détriment de celle du moi ?
En réalité, toute cette attitude réfractaire à l’affirmation souveraine des idées, qui valorise de ka sorte un modèle réactif d’éducation contre le modèle aristocratique maladroitement calomnié, semble globalement portée par un courant anthropologique dominant de tendance plutôt esclavagiste. Un courant anthropologique qu’entérine dans l’inconscient collectif, l’aliénation de la conscience de soi à autrui. Une telle aliénation convenue de la conscience de soi à autrui, dont porte trace dans la conscience populaire, des formules langagières consacrées par l’usage, comme c’est le cas de l’expression française « toi et moi » par exemple, jugée syntaxiquement correcte, au contraire de l’expression inverse « moi et toi ». Une option qui entérine la prépondérance accordée à autrui sur le moi, posture qui semble trahir plus un complexe d’infériorité du moi devant autrui, qu’autre chose. Car, cette soumission du je à autrui est loin d’être avérée, en dépit du fait qu’elle ne manque d’être largement cautionnée par certaines philosophies du sujet. A l’image de celle de M. Buber (2012, p. 61) au dire de qui « l’homme devient un Je au contact du Tu. »
Et par-dessus tout, ce choc constamment créé à la fois par la force des thèses exposées, et le contraste de la mise en évidence automatique de leurs antithèses au nom d’un certain esprit de raffinement ; un choc entre l’autorité des arguments offerts, et l’ouverture faite dans le même temps à leur critique par le moyen des antithèses exposées, tout cela ne manque-t-il pas de secréter également chez les apprenants, l’illusion d’un savoir exhaustif reçu puisqu’ayant fait sa toilette ? Toutes choses qui auraient pour conséquence d’inhiber à court terme, tout esprit d’innovation chez les apprenants et de cultiver au final une paresse intellectuelle chez ceux-ci, par le fait de créer en eux le sentiment rassurant que tout a été dit. Une telle méthode d’éducation traduite en une pédagogie négative, est celle qui ne manque de se compléter comme il se doit, d’une méthodologie d’évaluation également négative. En effet, comment pourrait se concevoir l’évaluation des apprenants dans un système éducatif où le non-savoir est le contour qui délimite en permanence le savoir ? Il va de soi que le contrôle des connaissances acquises ici, ne peut manquer d’être à son tour, une mise en évidence de l’ignorance, autrement dit une mise en évidence du non-savoir de l’apprenant. Telle se veut l’évaluation négative.
1.2. L’évaluation négative
Nous appelons évaluation négative, l’évaluation telle qu’elle dérive de la méthode traditionnelle d’enseignement ci-avant décrite, et qui consacre une méthodologie pédagogique globalement négative, en raison du fait qu’il s’agit d’une évaluation au cours de laquelle, l’on ne juge la valeur de la production de l’apprenant, qu’à partir de ses défauts. Ce qui conduit l’évaluateur à rester plus attentif aux fautes commises plutôt qu’aux réussites qui, elles, passent pour aller de soi, et qui pour cette raison, peuvent finalement manquer d’effleurer l’attention de l’évaluateur, voire lui échapper. C’est ainsi qu’après avoir enseigné à la fois à « faire » et à « ne pas faire », on contrôle les interdits et les entorses aux règles, pour juger de la réussite de l’apprentissage. Certes, en soi l’idée qui consiste à rechercher les défauts pour juger de la qualité de l’œuvre, peut se défendre valablement selon un argument de pragmatisme, étant donné l’économie de temps et d’énergie qu’elle permet à l’évaluateur de réaliser, convaincu qu’il y en aura moins à dénoncer chez l’apprenant, qu’à apprécier. Le pire est qu’une pareille méthode ne manque d’aboutir à déformer le regard du formateur, lequel à force de rechercher les maladresses, s’habitue à ne voir en définitive que le mauvais côté des choses, et à perdre de vue les acquis tangibles d’un programme d’enseignement. Cette méthodologie d’évaluation dans ses aspects les plus raffinés, peut tendre même à piéger dans l’évaluation l’attention des apprenants, en essayant de prendre leur intelligence à défaut à travers des exercices de contrôle qui mettent en avant des faux savoirs, qu’il leur appartient dès lors de pouvoir débusquer, pour faire la preuve de leur savoir.
Enfin, la valeur docimologique de la production viendra sanctionner l’évaluation au moyen de la notation. Celle-ci est conçue à son tour pour déterminer le nombre de points acquis, sur un total de référence (10/20 ; 8/20 ; 15/20, etc.). Un système de notation par lequel se trouve essentiellement indiquée à chaque fois ainsi, la part non comblée du total requis et qui est le déficit représentatif de l’ignorance quantifiée. Comme telle se présente, après un enseignement à tendance négative, l’évaluation corollaire qui doit sanctionner aussi naturellement l’échec de l’apprentissage. Se décline en gros comme ci-dessus présentée, la méthode pédagogique à laquelle l’écolier est nourri tout au long du système éducatif qui le conduira à l’université comme au sommet de ce système, en tant que niveau d’enseignement supérieur. Dès lors, se résument au total en ces maux, les handicaps à l’esprit de la recherche que contient la méthode négative d’enseignement dans le système éducatif. Un système qui pourtant doit produire des chercheurs au stade de l’université.
En effet, bien qu’elle s’intègre dans le système éducatif général, l’université revendique cependant un développement autonome par le biais de la recherche par laquelle elle aspire à ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. « Tout d’abord, nous dit H. Janne (2016, en ligne) elle tend à s’intégrer dans le système éducatif général mais, en même temps, cherche un développement autonome. ». Ce qui place la recherche et l’innovation au centre des missions de l’université. Comme pour mieux souligner une telle réalité, en Côte d’Ivoire par exemple il n’y a pas si longtemps, le ministère de l’enseignement supérieur avait pour dénomination « Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation technologique ». Mais s’il paraît évident pour tous que l’université poursuive le but de la recherche, en revanche comment est-il possible d’innover alors que longtemps formé à l’inhibition des intuitions non cadrées qu’emporte une prévention constante contre la défiance des règles conforme à l’éducation institutionnelle, l’écolier devenu maintenant chercheur se retrouve au pied d’un mur dressé par les censures contre lesquelles son savoir s’est constitué ? Tel est l’écueil qui oblige à nous orienter vers un modèle éducatif alternatif qui s’écarte du négatif. Et une pareille méthode éducative qui se bâtirait autour d’une pédagogie de l’affirmation du savoir, voilà ce qui mériterait d’être appelée une éducation positive.
2. L’éducation positive
Après avoir longtemps erré sur des voies hasardeuses à retrouver le chemin conduisant à sa destinée, il urge de donner à l’éducation ce qui se présente comme la clé de son succès. Il nous faut imaginer une autre façon d’éduquer qui restaure les lettres de noblesse de l’éducation. Ces lettres qui sont celles qui transcrivent en filigrane, l’avènement d’une société de personnes agissant exclusivement par les valeurs socialement sélectionnées comme positives, et en conformité uniquement avec celles-ci.
2.1. La pédagogie positive
L’idée de la nécessité d’une éducation positive surgit devant l’essoufflement d’une culture humaine poursuivant le progrès en se développant autour d’un modèle qui met en avant le négatif, pour valoriser le positif, et entrechoque de la sorte constamment les contraires. Aussi bien, il nous incombe de commencer à remettre en question, l’éducation qui veut que l’homme cultivé soit aguerri à penser le pour et le contre des choses. Il convient en effet, de sortir de ce format intellectuellement correct de réflexion, dont on fait si souvent la promotion dans la formation des apprenants à travers la valorisation de l’esprit dit critique. Car, il nous faut désormais enseigner toujours des thèses et jamais à la fois ce qui serait leurs antithèses, et nous méfier de ce genre de philosophie du « non » en matière de pédagogie. L’on devrait désormais se contenter d’enseigner des thèses et rien que des thèses et former plutôt les apprenants à enraciner des convictions. Bref, renoncer à « lutter contre les intuitions premières » au motif que « les intuitions premières sont toujours à corriger » G. Bachelard (2002, p. 75). Telle est notre thèse. De la sorte, on laisserait à l’apprenant l’initiative de développer des thèses personnelles et neuves, que le foisonnement de thèses diverses à lui inculquées, ne manquerait certainement pas de susciter en lui. Car, c’est à ce prix que sa fécondité intellectuelle sera efficacement entraînée. Comme l’ont dit Charles Charretier et R. Ozouf. (1948, p. 162) :
A un autre point de vue, il y a lieu de recommander aux maîtres de formuler toujours en termes impératifs les ordres et les « résolutions » par lesquels se termine généralement la leçon de morale : Sois laborieux ; – Je veux être sincère, etc. De telles paroles poussent l’enfant au bien, provoquent en lui un salutaire effort. Il n’est pas sans inconvénient, et sans danger même, d’exprimer, au contraire, ordres et « résolutions » en termes négatifs…
De même qu’en morale, l’on devrait dispenser donc à l’apprenant, les connaissances diverses en évitant partout de les formuler en termes négatifs et d’éviter d’exposer par-là, des antithèses aux connaissances inculquées. Car, en agissant comme tel, on parviendra au mieux à exciter l’esprit de recherche de l’apprenant, tout en le poussant in fine à vouloir « apporter quelques pierres à cette grande cathédrale du savoir bâtie par l’effort collectif » ainsi que l’affirmait Ritschl d’après Ch. Andler, (1979, T. I, p. 302). Tandis qu’à force de prodiguer à chaque fois thèses et antithèses, on ne parvient qu’à laisser dans l’âme de l’apprenant, le sentiment que l’édifice est déjà achevé. Ce qui a pour inconvénient de fermer l’horizon de toute pensée neuve chez lui. En revanche, dispenser les enseignements conformément à une exposition exclusive de thèses, c’est ce qui nous paraît digne d’une pédagogie positive capable de forger l’esprit critique au lieu de l’étouffer à jamais, comme on l’a jusqu’ici fait en offrant l’esprit critique comme une donnée. Tel nous paraît être le compendium d’une éducation intellectuelle ambitieuse et innovante, plutôt que conservatrice et stagnante. Ainsi, contrairement à l’adage qui soutient que « la critique est aisée, l’art difficile », il conviendrait de dire qu’en réalité la vraie critique est tout aussi difficile que l’art, mais qu’assez souvent, hélas un penseur ne dépasse les vues d’un devancier, que précisément au prix d’une déformation avantageuse de sa pensée, pour l’adapter à la polémique qu’il veut soulever contre lui. Ce qui est cause que sous le prétexte d’antithèses, d’une façon générale, il n’y a que des thèses qui se côtoient sans jamais se rencontrer ni s’entrechoquer véritablement et qui nous privent de cette façon, du moment moteur de la confrontation.
Or, c’est là une des conséquences auxquelles conduit l’éducation négative comme vestige d’un esprit critique dévoyé en esprit de critique, parce qu’offert plutôt que cultivé. Se trouve globalement décrite en ces termes, l’éducation négative telle qu’il conviendrait de la remplacer par une éducation positive, qui s’accompagne nécessairement d’une évaluation également positive.
2.2. L’évaluation positive
Comment devra-t-on évaluer lorsque l’on a dispensé un savoir qui n’a laissé aucune place à des idées contraires ? D’abord l’évaluation dans un tel contexte, devra se contenter de vérifier exclusivement que l’enseignement a été tout simplement assimilé, et non pas qu’il a été assimilé ou non. Parce qu’une telle évaluation est dorénavant orientée par une présomption de science chez l’apprenant, plutôt que par une présomption d’ignorance ou de faux savoir chez celui-ci, comme c’est le cas dans l’éducation traditionnelle. En effet, il s’agit ici d’une évaluation respectueuse et pleine de considération pour l’apprenant reconnu avant tout comme un égal sujet de raison. C’est pourquoi, cela va de soi, dans un tel contexte, on contrôlera les connaissances par des questionnements qui visent uniquement à évaluer les connaissances acquises. Cette pratique éducative nouvelle est celle qu’anticipe fort bien Albert Einstein lorsqu’il observe, d’après A. Moszkowski, (1971) : « La plupart des enseignants perdent leur temps en posant des questions qui visent à découvrir ce qu’un élève ne sait pas, alors que le véritable art du questionnement consiste à découvrir ce que l’élève sait ou est capable de savoir ». Il en résulte que dans le modèle d’éducation positive que nous proposons, l’enseignant affichera une attitude positive aussi bien dans la formulation des interrogations à l’endroit des apprenants, que dans l’attitude devant les réponses données par ceux-ci. Il s’agit plus précisément pour le formateur, de vérifier les acquis enregistrés par les apprenants, au moyen de questionnements qui visent avant tout la manifestation des connaissances et non leur déni.
Ensuite, l’évaluateur devra se contenter de récolter les bons fruits produits par l’apprenant, suite à l’exercice à lui soumis ou à l’interrogation à lui faite. En un mot, il s’agira pour le formateur, de pratiquer la maïeutique socratique, toutefois ici en ayant soin de recueillir le bébé sans s’occuper de tout le reste. En clair, cela revient pour le formateur, à recueillir au cours de l’évaluation à chaque fois les bonnes réponses des apprenants, tandis qu’il s’efforcera de rester muet devant leurs réponses déviantes. Tout comme Platon à la suite de Socrate et conformément à la méthode de division dichotomique qui est la sienne, savait quant à lui se contenter des réponses utiles dans ses conversations, et ne développait point les réponses de ses interlocuteurs qui ne lui étaient d’aucune utilité dans la recherche qu’il poursuivait. Ainsi, disait-il de lui K. Niamkey (1996, p. 49-50).
Nous avons vu que Platon a remplacé la méthode socratique de définition universelle par la diérèse, la méthode de division… Pour illustrer cette méthode, Platon prend l’exemple de la pêche à la ligne considéré comme un art. Mais il affirme que celui-ci se divise en deux : les arts de la production et les arts de l’acquisition. Parmi ceux-ci, certains se font par échange, d’autres par prise. De ces derniers, les uns sont une lutte, les autres une chasse…La méthode de division permet ainsi d’enrichir la compréhension du concept en restreignant son extension afin de mieux le cerner.
De même dans l’éducation positive, toute réponse qui s’écarte des thèses enseignées, ne devant ni être réfutée, ni être commentée par le formateur, mais volontairement ignorée, son oubli ne pourra qu’en être naturellement favorisé dans le processus éducatif. Car en réalité, l’éducation a à enseigner uniquement ce qui est à faire et cela, d’un point de vue purement pragmatique. En cela seule consiste l’éducation en tant que théorie pratique de l’action qui, en soi, est une géométrie de l’action dénuée de toute moralité qu’elle a déjà dépassée et au-delà de laquelle elle s’est établie.
Conclusion
S’il est juste de dire comme Henri Janne (2016, en ligne) qu’ « on ne peut guère comprendre, comme il faut, la signification exacte de la crise universitaire d’un pays ni apprécier à leur valeur les projets de réforme suggérés sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs », il est tout aussi correct de dire qu’on ne peut non plus comprendre comme il faut, la signification exacte de la crise universitaire d’un pays, ni apprécier à leur valeur les projets de réformes y entreprises, sans tenir compte de ce qui se passe particulièrement dans ce pays. L’université en tant que lieu d’apprentissage et de recherche, se donne des ambitions scientifiques que les membres qui l’animent s’imposent le devoir de réaliser. S’il est vrai qu’au nom d’une politique de la mondialisation aux raisons obscures, l’on observe une harmonisation des systèmes de formation, cela ne saurait occulter la disparité des problèmes dans les universités, que souligne éloquemment leur classement qualitatif au plan mondial qui ne les loge guère toutes au même rang.
Le talon d’Achilles des universités africaines demeure entre autres maux, leur manque de performance en matière de recherche et que résume la boutade selon laquelle « les chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche ». Notre contribution a consisté à rechercher les raisons de ce défaut de compétitivité, dans la méthode éducative institutionnelle sur laquelle a été bâti tout le système éducatif traditionnel, une méthode pédagogique négative qui dessert en réalité l’esprit d’initiative et de créativité. Pour résoudre ce problème majeur, nous avons proposé une méthode d’enseignement qui nous est apparue heuristiquement plus adaptée à l’objectif de la recherche. Tel est l’enjeu de l’éducation positive qui mériterait d’orienter des réformes à venir, sans toutefois prétendre pouvoir éteindre la crise multiforme que traverse l’institution universitaire d’une façon générale. Car, ainsi que concluait A. Prost (2004, p. 711) le volume 4 de son ouvrage monumental consacré à l’Histoire de l’enseignement et de l’éducation : « La vrai réforme ne consiste pas à mettre fin à la crise, mais à donner les moyens de l’assumer lucidement pour la rendre féconde. »
Références bibliographiques
ANDLER Charles, 1979, Nietzsche sa vie et sa pensée, Paris, Gallimard.
BACHELARD Gaston, 2002, Etudes, Paris, Vrin.
CHARRIER Ch., OZOUF R., 1948, Pédagogie vécue, Paris, Fernand Nathan.
CLAPARÈDE Edouard, 2003, L’éducation fonctionnelle, Paris, Fabert.
GAL Roger, 1948, Histoire de l’éducation, Paris, PUF.
JANNE Henri, « Crise de l’université », in Revue de l’institut de sociologie (en ligne), N°86, 2016, http://journals.openedition.org/ris/398, consulté le 02 mars 2022.
« Le Monde diplomatique » septembre 1968 page 2 monde-diplomatique.fr consulté le 2 mars 2022.
MOSZKOWSKI Alexander, 2022, Entretiens avec Einstein, éditeur Books on Demand, 12 février 2018 Trad. amazon.fr., consulté le 21 avril 2022.
NIAMKEY Koffi, 1996, Les images éclatées de la dialectique, Abidjan, PUCI.
NIETZSCHE Friedrich, 1985, Ecce homo, Trad. Jean-Claude Hémery, Paris, Idées.
PLATON, 2021, Timée, Critias, trad. Luc Brisson, Michel Patillon, Paris, GF.
PROST Antoine, 2004, Histoire de l’enseignement et de l’éducation, depuis 1930, Paris, Tempus.
SOUCHE Aimé, 1948, Nouvelle pédagogie pratique, Paris, Fernand Nathan.
Franck KOUADIO
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’université est le creuset des savoirs et de la recherche scientifique. Elle se doit de viser la fine pointe du concept : l’excellence. L’excellence est le meilleur et l’exigence absolue de la qualité dans toutes les missions qu’assume aujourd’hui, la communauté universitaire. Seulement, l’accomplissement desdites missions est parfois compromis par des dysfonctionnements systémiques qui gangrènent l’université : effectifs pléthoriques, faible compétitivité, déficit d’enseignants, retards chroniques, chevauchement des années académiques, faible financement de la recherche scientifique, etc. Dans ces conditions, les universités africaines auront du mal à relever les défis de la productivité scientifique, de la compétitivité et de la visibilité internationale, sans une refondation préalable. Mais comment cette refondation est-elle possible ? Conscient de l’importance du rôle des universités, nous formulons, dans cette étude analytico-critique, l’impératif catégorique de la refondation de l’université en Afrique sur le mérite, en vue de réaliser l’excellence.
Mots clés : Culture du mérite, Excellence, Impératif catégorique, Refondation, Université.
Abstract:
The university is the crucible of knowledge and scientific research. It must aim for the cutting edge of the concept: excellence. Excellence is the best and the absolute requirement of quality in all the missions assumed by the university community today. However, the accomplishment of these missions is sometimes compromised by systemic dysfunctions that plague the university: overstaffing, low competitiveness, lack of teachers, chronic delays, overlapping of academic years, low funding for scientific research, etc. Under these conditions, African universities will find it difficult to meet the challenges of scientific productivity, competitiveness and international visibility, without a prior overhaul. But how is this refoundation possible? Aware of the importance of the role of universities, we formulate, in this analytical-critical study, the categorical imperative of the refoundation of the university in Africa on merit, in order to achieve excellence.
Keywords : Culture of merit, Excellence, Categorical imperative, Refoundation, University.
Introduction
1. La typologie des crises à l’université
Différents types de crises gangrènent l’université africaine, avec pour inconvénient d’en saper le dynamisme et d’en compromettre l’efficacité et la compétitivité. La présente étude en identifie principalement deux : la crise de motivation des acteurs et la crise des valeurs.
1.1. La crise de motivation des acteurs
La motivation est une attitude positive relevant du désir et de la volonté de faire une chose, de poser un acte. C’est un désir spontané qui insuffle une certaine énergie, un certain dynamisme propice à la réalisation d’un projet. Elle est nécessaire à tout homme désireux de réussir une mission à lui confiée. La motivation requiert un état d’esprit positif, c’est-à-dire une mentalité confiante et conquérante. Elle renvoie à l’ensemble des manières d’agir, de penser d’une personne ou d’un groupe de personnes ; c’est son état d’esprit. La mentalité représente une donnée fondamentale indispensable à l‘équilibre de la personne ou du groupe. Ladite mentalité est le ferment du capital confiance, de l’optimisme conquérant et de la vitalité humaine. Elle est le moteur du penser et de l’agir. Lorsque la mentalité est en crise, alors l’homme chancelle, vacille et tâtonne : c’est l’échec programmé. La crise de motivation, doublée d’une crise des mentalités, est le signe d’une faillite imminente de la société. Elle est d’autant plus redoutable qu’elle donne des raisons légitimes de s’inquiéter lorsqu’elle survient dans une institution aussi essentielle et prestigieuse que l’université. En quels sens y a-t-il une crise de motivation dans les universités africaines ?
La crise de motivation est saisissable à tous les niveaux de l’université africaine. Aussi bien chez les étudiants que chez leurs maîtres et les enseignants, le constat amer d’une démotivation sans cesse croissante, se fait sans difficulté. L’on remarque aussi chez les personnels administratifs le même agacement quant à la nécessité de travailler pour une institution qui peine à offrir à ses employés, le strict minimum pour créer des conditions de travail et de vie dignes. Ainsi,
en l’absence de vision, de prise de conscience et de volonté politique autour de l’enjeu des rapports entre l’université et la science, on assiste à une sorte de démotivation et de démobilisation des hommes et des femmes dont les capacités de recherche sont freinées par un environnement qui les condamne à la clochardisation. Demi salaire, demi travail, disait-on naguère dans le campus d’Abidjan, en Côte d’Ivoire (J.-M. Éla, 2006, p. 201).
Le politique est, pour une bonne part, responsable de la crise de motivation, qui menace de délitement l’université. L’enseignement est un sacerdoce. Il relèverait du don de soi, du sacrifice pour les autres. Soit ! Mais ? c’est aussi un travail, et en tant que tel, la rétribution qui en découle doit être conséquente afin d’intéresser durablement l’enseignant à l’idée de servir avec plaisir, amour et entrain. Le sentiment de « laissés pour compte » éprouvé par les professionnels de l’enseignement a des effets inhibiteurs sur leur moral, leur mentalité et sur la motivation qu’on pourrait attendre d’eux. « Un homme qui a faim n’est pas un homme libre », disait Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Comment peut-on servir avec abnégation et amour en étant démuni, vilipendé et avili ?
Faire de la recherche scientifique sans moyen est nécessairement source de démotivation et de démobilisation. « Le financement est également un problème majeur. Une étude menée par le comité de développement d’Afrique australe en 2008 a constaté que les niveaux de financement n’avaient pas évolué au cours des dix dernières années » (P. Pol, 2012, p. 1). Or, la fertilité et la créativité des enseignants-chercheurs et chercheurs, ne peuvent être productives en l’absence de moyens financiers et de conditions matérielles de travail décentes et de vie saines. Le quasi délaissement de l’université africaine en équipement et en financement de la recherche, met à mal la productivité scientifique, la compétitivité internationale et l’honorabilité des acteurs.
Il en va de même pour les étudiants, qui arpentent chaque jour, les routes des universités pour suivre les cours dans des amphithéâtres et salles de travaux dirigés aux effectifs pléthoriques sans être sûrs de trouver un emploi après l’obtention de leurs diplômes. Dans des États où le taux de chômage est vertigineux, l’absence de perspectives durables en matière de planification de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, alimente et exacerbe l’angoisse des étudiants dont beaucoup perdent l’espoir de pouvoir s’autonomiser un jour grâce aux fruits de ce précieux sésame : le diplôme. La démotivation est bien réelle. Elle compromet le dynamisme des universités africaines, pourtant essentielles à la course au développement où sont engagés les États du continent. La démotivation est source d’improductivité scientifique. L’improductivité scientifique signifie la faiblesse du niveau de connaissance et l’incompétence des ressources humaines. Or le développement, pour être soutenu, a besoin de ressources humaines bien formées, qualifiées et compétentes. Nos sociétés se condamnent au sous-développement tant que nos universités sont privées de moyens indispensables au dynamisme de la recherche scientifique et à la promotion du capital humain, principaux moteurs du développement.
Les universités africaines, sous-équipées et en manque de financement produisent des diplômés dont la formation se fait au rabais. L’on assiste, dans ces universités, à des pratiques peu honorables telles que la fraude aux examens, le laxisme, la soutenance de Mémoires et de Thèses rédigés par des tiers, prétendument experts dans ces domaines, la culture de l’incompétence et la promotion de la médiocrité. Là où, pour Jean Marc Éla (2006, p. 183), « le chercheur africain n’a pas le droit de faire l’économie d’une formation technique suffisante qui lui donne accès aux débats scientifiques les plus élevés de notre temps, où se scelle l’avenir culturel de son pays », l’on assiste, malheureusement, à la démission coupable des principaux acteurs : des gouvernants et administrateurs qui marchandent les services administratifs, des enseignants chercheurs et chercheurs peu soucieux d’actualiser leurs connaissances et se complaisant dans la routine avec des anciennes fiches de cours et des livres (bibliothèques) jaunies par l’usure du temps, des étudiants insouciants occupés à sous-traiter l’obtention de leurs diplômes.
En voyant des incompétents réussir là où les esprits les plus brillants échouent, il est évident que la démotivation s’installe chez certains étudiants et les pousse à privilégier des voies détournées au détriment de la qualité requise en matière de compétition scientifique. L’insuffisance et/ou l’absence de bourses d’étude, de cités universitaires et de moyens de locomotion adéquats viennent amplifier, par ailleurs, la démotivation des étudiants. Lorsqu’à ces difficultés se greffent des problèmes infrastructurels tels que l’absence de connexion internet haut débit, de bases de données documentaires physiques et virtuelles, la non application effective du système Licence-Master-Doctorat (LMD)[59], les étudiants sont désemparés et peinent à réaliser leurs études dans la sérénité.
Plus ahurissant encore est l’esprit de paresse et de médiocrité qui plane sur l’université. Il se caractérise par l’absence et/ou l’insuffisance de prise de conscience de certains étudiants peu soucieux de la nécessité de s’autoformer et de s’auto-cultiver conformément à l’esprit de la recherche. Ils viennent à l’université juste pour valider leurs diplômes, notamment par le fait de la tricherie, la connaissance ; la compétence et l’expertise leur important peu.
Au lieu de s’appliquer eux-mêmes au développement de leurs compétences par l’accroissement de leurs connaissances, certains étudiants préfèrent sous-traiter l’obtention de leurs diplômes avec des soi-disant experts : experts en rédaction de Thèses, de mémoires, de rapports, d’articles scientifiques, mais aussi experts en matière de validation des unités d’enseignement. Ce faisant, ils font preuve d’irresponsabilité. Dans les universités ivoiriennes, ce faux-concept d’experts est malheureusement en vogue et prend l’appellation de « mercenaires ». Le mercenaire est, en matière de droit international humanitaire, celui qui est spécialement recruté dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé. Il prend effectivement part aux hostilités en vue d’un avantage personnel à lui promis. Le principe reste le même lorsque cette notion est transposée dans nos universitaires par des étudiants paresseux, irresponsables et incapables de se servir convenablement de leur raison et de leur intelligence. Aussi,
il est si commode d’être mineur. Si j’ai un livre qui me tient lieu d’entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge de mon régime à ma place, etc., je n’ai pas besoin de me fatiguer moi-même. Je ne suis pas obligé de penser, pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront pour moi de cette besogne fastidieuse (E. Kant, 1985, p. 47).
Il y a, dans les universités africaines, une démission consciente doublée d’une inconscience fâcheuse qui menace, en leurs fondements mêmes, l’État et la société tout entière. La prise d’initiatives et le goût de l’effort personnel sont curieusement relayés par l’indolence et la paresse, entretenues par la conjoncture économiciste et mercantiliste du monde contemporain. À cela, s’ajoutent le complexe d’infériorité, le manque d’audace et de courage, la crise d’autorité, signes distinctifs d’un esprit de platitude et de mentalités en crise. Des étudiants peu audacieux, complexés et n’ayant plus de respect pour l’autorité amplifient la crise de l’université. Cette crise est aussi une crise des valeurs.
1.2. La crise des valeurs
Les valeurs se réfèrent aux principes régissant le fonctionnement de l’université. Ces principes ont vocation à préserver ce qu’il y a de plus élevé, ce qu’il y a de plus estimable en l’homme : la dignité. L’affirmation et la reconnaissance de l’humanité en soi, dans la moralité soumise à la détermination de la liberté, est nécessaire et indispensable pour susciter la reconnaissance de la dignité et sa promotion à travers l’impératif du devoir. La dignité découle nécessairement du devoir d’universalité de la liberté prescrit par la loi qui commande de considérer tout être raisonnable comme fin. Il est contraire à la législation de la raison pratique de déchoir l’homme de sa dignité. Par respect pour la loi, chacun doit s’imposer le devoir de reconnaître inconditionnellement et universellement, la dignité de tout autre. Car « la dignité de l’humanité consiste précisément dans cette faculté d’établir des lois universelles, à la condition toutefois d’être en même temps soumise elle-même à cette législation » (E. Kant, 1985, p. 301-302). Se donner un principe de l’agir tel que par ce principe, on nie à tout autre la dignité comme personne humaine et fin en soi, c’est obéir à une maxime subjective qui est contraire au devoir. Par-là, on s’inscrit en-deçà de l’idéal d’humanité et d’universalité tel que requis par la moralité. Une loi de l’agir qui serait contre cet idéal, s’érigerait de facto contre la vie et contre l’humanité elle-même, mais surtout, elle donnerait la preuve qu’elle est elle-même encore au seuil de l’humanité, les racines plongées dans l’animalité. Et on sait que,
dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, et par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité (E. Kant, 1985, p. 301-302).
La dignité humaine est sacrée, et comme telle, incessible, inviolable et inaliénable. Pourtant, à l’université, cette dignité est parfois bafouée. Bafouer la dignité de l’homme, c’est nier son essence même, c’est le chosifier et l’animaliser. L’animalisation de l’être humain par le truchement de la négation de sa dignité, constitue un dévoiement dans l’exécution des missions de l’université africaine. En tant que haut-lieu du savoir, l’université forme également à la culture du savoir-vivre et du savoir-être. Mais elle est malheureusement prise dans l’étau de crises répétitives qui dénotent très souvent, d’un manque de savoir, de savoir-vivre et de savoir-être de certains acteurs, notamment les étudiants. Cela a pour inconvénient, de porter atteinte à la dignité des universitaires. Or le savoir-vivre et le savoir être constituent des valeurs sociales nécessaires à la formation civique et citoyenne des hommes qu’il faut promouvoir. Le constat démâtant d’un manque de savoir-vivre et de savoir-être, prouve l’existence d’une crise des valeurs. Mais, en quel sens ?
La crise des valeurs, identifiée ici, à un défaut de savoir-vivre et de savoir-être, est saisissable aux travers de certains fléaux qui gangrènent l’université, et qui prolifèrent curieusement à un rythme vertigineux. Au nombre de ces fléaux, figurent l’incivisme et l’incivilité. L’incivisme, c’est l’absence de civisme[60], qui se manifeste par le déni de l’État et de sa légitimité, avec la légitimation de la fraude et de la corruption, ainsi que par le non-respect des textes et des règles de bienséance dans le quotidien.
L’incivisme se manifeste en général, sous le mode de l’incivisme de conviction, l’incivisme de misère, l’incivisme d’État et l’incivisme de comportement. Dans l’incivisme de conviction, il y a un déni de l’État, mais aussi de sa légitimité, en en sapant les fondements, par la légitimation de la contrebande, de la fraude fiscale, de l’insubordination, de l’occupation illégale de l’espace public, etc. L’incivisme de misère quant à lui, est qualifié d’incivisme d’autodéfense, compréhensible par certaines personnes, et pose la question du comment se considérer comme citoyen à part entière d’une société qui ne nous assure ni travail, ni éducation, ni santé, ni protection véritable. L’incivisme d’État se réfère, quant à lui, à une représentation de l’État comme un monstre lointain qui inspire la peur pour convaincre les citoyens qu’ils sont coresponsables de la politique de la cité. Le plus fréquent d’entre tous est l’incivisme de comportement, qui se rapporte au non-respect des textes et règles de bienséance dans le quotidien.
Quant à l’incivilité[61], elle se réfère à l’attitude de non-respect, à la fois à l’égard des autres citoyens et du bien public. Dans une société qui se veut policée, chaque citoyen doit faire preuve de civilité en respectant aussi bien ses concitoyens que les biens publics. Cela contribue à la préservation d’une ambiance sociale apaisée. Dans une telle société, le respect des lois et des règles préserve également de possibles atteintes à la dignité de la personne humaine. Dans la mesure où l’université fait partie de la société, en général, il est nécessaire qu’en son sein, règnent le civisme et la civilité, qui sont des marques de la citoyenneté. Mais la réalité, trop souvent, contraste avec cet idéal d’un monde universitaire affranchi de crise des valeurs citoyennes que sont le civisme et la civilité. Au cours de l’année universitaire 2012-2013, le Ministre de l’enseignement supérieur ivoirien, M. Cissé Ibrahima Bacongo, a ainsi échappé à un lynchage, alors qu’il tentait d’apaiser, par son discours, des étudiants mécontents et révoltés contre l’État ainsi que cela est rapporté en ces termes :
Informés de sa présence à la présidence de l’université, des étudiants se sont attroupés, comme s’ils avaient été alertés, pour exprimer leur mécontentement à l’endroit de leur autorité de tutelle. L’attroupement et les vives clameurs se faisaient grandissant, le ministre est sorti pour une adresse aux mécontents afin de les calmer, et s’enquérir de leur mouvement d’humeur, mais mal lui en prit, et il essuya des huées et jurons. Faisant ainsi connaître leur hostilité à l’endroit de leur autorité de tutelle, ces hordes ont même essayé d’attenter à son intégrité physique (AIP, 2013).
S’en prendre verbalement et physiquement à un être humain, quelle que soit sa faute, est en soi une atteinte à sa dignité. Si un tel acte dénote de l’incivisme et de l’incivilité, il a surtout l’inconvénient de rabaisser l’homme, de le vilipender indépendamment de son titre de ministre. Agir de la sorte, c’est porter atteinte à sa dignité. Mais pourquoi des étudiants s’autorisent-ils à bafouer ainsi, la dignité de l’homme-ministre ?
En tant que représentant de l’État, le ministre de l’enseignement supérieur incarne l’autorité publique garante de l’université. Il y a, en principe, et tout naturellement, une relation de confiance entre l’administrateur en chef qu’il est et les administrés, à savoir les étudiants. Mais au-delà de cette relation verticale de type fonctionnel, le ministre peut être représenté comme l’autorité parentale, la figure paternelle. Or, à l’égard d’un parent ou d’un père, il y a un devoir inconditionnel de respect. Toute attitude de défiance est en principe, contre-nature. Si la paternité impose le respect absolu, l’humanité du père devrait dissuader, quant à elle, toute velléité d’insoumission et/ou d’indiscipline, voire toute attitude de défiance et d’indignation. Le fait de bafouer la dignité de l’homme-ministre relève certainement d’une crise plus profonde : la crise de confiance. Si le respect inconditionnel ne saurait trouver sa justification dans la confiance que l’enfant trouve dans la figure paternelle, la méfiance est tout de même susceptible de dériver en insoumission et pousser l’enfant à bafouer la dignité du père. Le père mérite la confiance de l’enfant pour que soit possible la révérence naturelle.
La confiance représente la force qui maintient en relation les différents acteurs du système universitaire. Lorsqu’elle est en crise, c’est tout le système qui court le risque de se désagréger et de disparaître. Trop suspicieux à l’égard des autorités, les étudiants se méfient d’elles et sont prompts à saper et à compromettre la réussite de toute mesure venant desdites autorités. De leur côté, les autorités doutent des compétences réelles des étudiants si bien qu’elles peinent à leur octroyer des bourses d’étude dans bien des cas, et compliquent leur accès à certains cycles de formation (Master et doctorat notamment), ou complexifient les processus de recrutement qui les ouvriraient au monde professionnel. Cette atmosphère de méfiance réciproque crée un climat délétère, avec des cours et examens perturbés, des grèves intempestives, des marches, des affrontements inter-syndicaux, des années blanches et des sessions uniques.
Selon toute vraisemblance, les universités africaines, surtout francophones, courent le risque de manquer cet important rendez-vous historique : s’affirmer, dans un esprit de compétitivité internationale, sur la scène scientifique comme une référence qui compte. C’est pour prévenir un tel risque que nous formulons l’impératif catégorique de la refondation de l’université sur l’excellence. Comment cet impératif s’articule-t-il ? En quel sens peut-il se réaliser ?
2. La nécessité de la refondation de l’université
Sous ce titre de nécessaire refondation de l’université, il s’agit de présenter le mérite comme une valeur indispensable à cultiver, un devoir inconditionnel à accomplir dans l’optique de parvenir à l’excellence au sein des universités africaines. En d’autres termes, en saisissant la culture du mérite comme un impératif catégorique, les universités africaines se disposent à l’éclosion et à l’édification d’une société de l’excellence.
2.1. La culture du mérite
Le mérite est ce qui rend une personne digne d’estime. Il s’accompagne d’un effort pour surmonter des difficultés, et spécialement, pour surmonter des obstacles intérieurs qui s’opposent au respect du devoir, c’est-à-dire à l’accomplissement de la loi morale. En tant que tel, le mérite est une qualité hautement louable chez une personne, dans la mesure où il dénote d’un effort d’élévation morale et/ou de distinction[62] sociale. Il s’affirme davantage comme une qualité morale, voire sociale. Or, les qualités morale et sociale inspirent le respect, la considération des pairs. « Dans une société dite « méritocratique », un lien direct est établi entre le mérite et le pouvoir, que l’individu ne doit plus à sa naissance, à sa richesse ou à ses appuis personnels, mais à ses qualités propres, à son travail et à son talent » (V. Morin, 2018, p. 2). C’est dire que la méritocratie est une approche qui valorise l’individu sur la base de principes impartiaux, objectifs et universels. Le mérite ainsi reconnu, inspire le respect, la justice et l’équité. Dans le domaine scientifique, inspirer le respect des spécialistes et des profanes commande surtout d’avoir des compétences et du génie ; en somme, c’est être méritant. Ici, plus que partout ailleurs, c’est sur la base du mérite qu’on a que les paires nous témoignent du respect ou non. L’université étant le haut-lieu de production et de promotion de la science, son prestige dépend alors de la qualité de ses ressources humaines, de leur mérite. Or,
la qualité fait référence à ce qu’il faut à l’enseignement pour répondre aux normes définies par les instances d’assurance qualité et les instances professionnelles et universitaires appropriées. Dans l’enseignement supérieur, la qualité englobe toutes les fonctions et activités, notamment les programmes universitaires, les ressources humaines, les étudiants, l’enseignement et l’apprentissage, l’infrastructure et recherche et l’innovation telles que définies dans le cadre des valeurs culturelles nationales et des objectifs et aspirations de développement (P. Pol, 2012, p. 1).
Il faut, sans complaisance, tenir le pari de la refondation de l’université. Cette refondation, pour être durable, doit s’articuler autour de la culture du mérite. L’université doit revenir aux plus méritants, c’est-à-dire à ceux qui ont les compétences intellectuelles requises, qui ont une culture citoyenne avérée, et qui possèdent des qualités morales indéniables. Le but est de former une élite de chercheurs et de technocrates capables de tenir, avec probité, le gouvernail du développement de nos États. Le favoritisme, le laxisme, la tricherie, l’incivisme, l’incivilité et bien d’autres maux du même genre, doivent céder le pas à la culture de l’effort, du travail assidu, de la perfection et du mérite. Si l’école pour tous est sans doute une politique salutaire, nous ne relèverons le défi du développement qu’à la condition de soumettre les acteurs du système universitaire à la saine émulation, à l’effet de créer une mentalité de vainqueurs et de méritants dans toutes les sphères de la vie sociale. En effet,
il faut bien redécouvrir la responsabilité des Africains dans un domaine stratégique que l’on ne peut confier indéfiniment aux autres sous peine de démission historique. Pour rompre avec la racine et poser les conditions humaines, sociales et intellectuelles qui exigent d’acquérir l’esprit d’invention et de découverte afin de permettre aux Africains de devenir, à leur manière, maîtres et possesseurs de la nature. D’où la nécessité de rendre la nouvelle génération disponible à la recherche des solutions inédites face aux problèmes de développement durable qui imposent d’enraciner dans nos sociétés un potentiel de connaissances scientifiques. C’est là la condition primordiale pour domestiquer la modernité en Afrique (J-M. Éla, 2006, p. 183).
Aspirer au développement intégral et durable tout en négligeant certains secteurs clés (notamment l’éducation et la formation de ressources humaines de qualité, la moralisation de la vie publique, la science et les technologies) qui en sont pourtant les leviers, c’est compromettre l’avenir du continent africain, le condamner à se complaire dans une culture consumériste. Dans leur processus de développement, la plupart des États africains, donnent l’impression de préférer mettre la charrue avant les bœufs, et donc de se condamner à tâtonner dans le sous-développement. Les discours, les programmes et les politiques publics témoignent d’une valorisation niaise de l’économie au détriment de l’homme, qui est pourtant la ressource centrale dans tout processus de développement.
En mettant en avant l’économie, et en lui subordonnant tout le reste, y compris l’éducation-formation de l’homme, on sape les fondements mêmes du développement. Or, on oublie trop souvent que tous les pays développés le sont grâce à des ressources humaines hautement qualifiées, rompues à la théorie et à la pratique de la recherche scientifique, et aptes à exercer avec professionnalisme, dans un esprit de productivité compétitive. Il est nécessaire de redonner à l’université toute la place qu’elle mérite, en en faisant le centre par excellence de production de connaissances scientifiques de pointe, d’experts de renom, de cadres méritants et compétitifs à même de mener, avec probité, les États africains au développement tant escompté. En somme, le mérite doit être le levier qui nous conduise à l’excellence : cela représente un impératif catégorique pour les universités africaines.
2.2. La culture du mérite, un impératif catégorique dans la recherche de l’excellence
Le mérite est une qualité à cultiver, c’est-à-dire à ancrer solidement dans les consciences, dans les habitudes et dans les sociétés soucieuses de se développer durablement et efficacement. Il s’agit, en d’autres termes, de promouvoir l’élitisme pour bâtir des sociétés de l’excellence. Dans ces conditions, « l’idée du mérite peut servir de base à la hiérarchisation des performances des individus dans un milieu social ordonné et plus encore dans le cadre d’une activité professionnelle » (D. Mélèdje, 2020, p. 71). La référence au mérite commande des fondations solidement et objectivement ancrées. Ces bases sont fixées par l’État, et supposent qu’un cadre réglementaire soit clairement défini pour fixer les conditions de reconnaissance du mérite. Il y a également une exigence fondamentale et nécessaire d’énonciation de principes déontologiques et éthiques. Nous présentons alors l’impératif catégorique comme modèle référentiel tout à la fois réglementaire, déontologique et éthique d’édification d’une société méritocratique capable de promouvoir l’excellence à l’université. La société méritocratique encourage à la promotion de l’élitisme, qui pourrait susciter, dans la conscience collective, une volonté résolument engagée dans la saine émulation pour atteindre collectivement l’excellence. En d’autres termes, lorsque chaque citoyen obéit à l’impératif catégorique de la culture du mérite, il entre dans une concurrence loyale avec les autres citoyens, créant ainsi un dynamisme intellectuel propice à la culture de l’excellence.
L’impératif catégorique est un principe objectif contraignant pour toute volonté. L’impératif porte sur les lois. Or, toute loi pratique représente une action possible comme bonne, et de ce point de vue, comme nécessaire et universalisable pour un sujet capable d’être déterminé pratiquement par la raison. « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (E. Kant, 1985, p. 285). L’impératif catégorique détermine l’action selon le principe d’une volonté bonne, de sorte que cette action se révèle finalement nécessaire et universelle. Kant postule l’impératif catégorique en en faisant la loi suprême de la moralité.
L’analogie avec la philosophie pratique de Kant nous fait saisir la promotion du mérite comme un impératif catégorique pour la refondation de l’université en vue de l’excellence. Le mérite s’entend comme « l’accomplissement des devoirs de vertu, la vertu étant elle-même la force de la résolution dans le mérite » (Rudolf Eisler, 1994, p. 678). Devoirs et vertu caractérisent donc le mérite. Penser dès lors, l’université comme une institution méritocratique, c’est en même temps, travailler à la réalisation d’une telle pensée sous le mode d’un devoir. C’est ce devoir que nous théorisons comme impératif catégorique.
La sélection au mérite est fondée sur l’égalité des chances et des droits entre les citoyens. Cette égalité offre à la société une fondation solide. Elle représente un modèle positif qui exprime le souci de ne pas subir des interférences arbitraires dans les choix de vies et d’être égaux face aux opportunités. L’égalité des chances favorise l’éclosion de citoyens méritants potentiellement susceptibles de contribuer à la promotion de l’excellence et à l’édification de sociétés développées. C’est pourquoi,
la prise en compte du mérite et donc des inégalités sociales parait inévitable. L’égalité formelle et sans saveur, le nivellement par le bas ne peut pas être un mode de vie, un code de fonctionnement pour une société qui entend évoluer. La reconnaissance du mérite doit permettre de construire un système de méritocratie. Et sans pour autant que soient réduits ceux dont on peut penser qu’ils n’ont aucun mérite (D. Mélèdje, 2020, p. 70).
La société ne peut faire l’économie du mérite sous prétexte de promouvoir l’égalité des chances et des hommes. Il existe bien des différences naturelles qui ne peuvent être comblées par des tentatives artificielles d’égalisation. Et la promotion du mérite n’exclut pas l’encouragement des moins méritants et le renforcement continu de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales. Le mérite « relève simplement d’un système de valeurs dans lequel nous avons choisi de valoriser certaines qualités, et d’en dévaloriser d’autres » (P. Savidan, 2018, p. 3). Le mérite comme système de valeurs, est pensé comme un impératif catégorique qui rejette les antivaleurs, c’est-à-dire les valeurs décadentes de tricherie, de corruption, de laxisme, etc.
Certes, l’impératif catégorique kantien commande des devoirs moraux. Mais ce qui retient l’attention dans un tel impératif, c’est sa rigueur, sa clarté et sa finalité. En formulant l’impératif catégorique de la refondation de l’université en Afrique sur le mérite, notre projet est celui de réaliser, chez les universitaires, ce qu’il y a de meilleur, le bien, et d’atteindre la fin suprême : l’excellence par le savoir. Cet impératif pourrait se formuler ainsi pour chaque universitaire : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir que le mérite (et l’excellence) devienne (nt) une loi universelle dans la gouvernance universitaire et la recherche scientifique ». Pour les universitaires, le passage des grades et la mobilité verticale doivent découler du mérite qu’ils ont et dont ils font preuve dans leurs travaux et leurs cours. La culture méritocratique chez les universitaires doit servir de modèle aux étudiants, de sorte qu’ensemble, enseignants et apprenants positionnent les universités africaines sur la voie de l’excellence. Afin de réaliser cet idéal, la gouvernance universitaire doit être confiée aux plus méritants, c’est-à-dire aux experts en matière de gouvernance institutionnelle, dont la probité intellectuelle et morale sont dûment établie.
Le défi pour les universités africaines, c’est de sortir de l’enfermement, de la médiocrité et de la minorité dans lesquelles elles semblent se complaire. Elles doivent jaillir à la lumière du savoir, s’élever à la fine pointe de la connaissance scientifique. L’esprit des Lumières européennes doit habiter les Africains et les inciter à assumer, avec responsabilité, leur destin dans un monde de plus en plus concurrentiel. Dans les universités africaines, enseignants et étudiants doivent s’assumer pleinement et assumer la responsabilité insigne de produire, par-eux-mêmes, des savoirs susceptibles d’enrichir le patrimoine scientifique et culturel du continent, mais aussi de contribuer à son essor économique et social. Il est nécessaire de susciter l’éclosion des Lumières africaines comme source de libération pour illuminer les sentiers du développement intégral du continent, à l’instar de l’Europe du 18ème siècle. C’est une exigence fondamentale dont nous trouvons l’expression lumineuse dans ce passage de Kant, où il interpelle le sujet à se prendre en charge en ces termes :
Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise des Lumières. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes, alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute direction étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant, mineurs ; et qu’il soit facile à d’autres de se poser comme leurs tuteurs. (E. Kant, 1985, p. 210).
Les acteurs de l’université en Afrique (Administrateurs, Enseignants-chercheurs, étudiants, personnels techniques) doivent refuser la minorité en pensant et en pratiquant le mérite, et en agissant efficacement pour établir la qualité et le rayonnement des universités africaines. Cela implique d’assumer, avec responsabilité, la fonction première de l’université, et d’en réaliser le projet essentiel de constitution d’une société scientifique et savante soucieuse de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Au demeurant,
l’inspiration ne fut pas mauvaise de celui qui conçut d’abord l’idée, et en proposa la réalisation publique, de traiter l’ensemble tout entier du savoir (…) de façon pour ainsi dire industrielle, par la division des travaux, en en faisant un domaine où, autant il y a de secteurs scientifiques, autant d’enseignants, de professeurs publics seraient nommés en tant que dépositaires de sciences, qui ensemble constitueraient une sorte de république savante, appelée université (E. Kant, 1986, p. 813).
C’est bien l’intelligence humaine qui a créé l’université comme haut-lieu de science où exercent des professionnels et experts. Étant réservée à la science, l’université doit alors demeurer dans les mains des scientifiques et savants afin de pérenniser la culture scientifique et de la rendre apte à soutenir le développement de l’Afrique. Si son histoire est liée à un plan général tracé par l’État[63], son fonctionnement, lui, doit être affranchi des influences politiciennes et partisanes afin que soit préservés son prestige et sa notoriété. Seule une gestion rationnelle de l’université peut lui garantir l’excellence et le succès fondés sur le mérite. « À chacun ses Harvard » (P. Pol, 2012, p. 3) devrait devenir le slogan de la recherche de l’excellence. « Aussi, pour faire face au défi que constitue, pour l’Afrique, l’entrée dans le temps du monde, il importe de repenser » l’université (J-M. Éla, 2006, p. 183). « Il faut restaurer ce que j’ai appelé l’honneur de penser ». Pour réaliser un tel objectif, l’idée s’impose d’assumer entièrement l’héritage de Cheikh Anta Diop. Et pour cause,
le chercheur africain n’a pas le droit de faire l’économie d’une formation technique suffisante qui lui donne l’accès aux débats scientifiques les plus élevés de notre temps, où se scelle l’avenir culturel de son pays. Aucune arrogance ou désinvolture pseudo-révolutionnaire, aucun gauchisme, rien ne saurait le dispenser de cet effort. Tout le reste n’est que complexe, paresse, incapacité : l’observateur averti ne s’y trompe pas. En effet, on doit dire aux générations qui s’ouvrent à la recherche : armez-vous de la science jusqu’aux dents et allez arracher, sans ménagement, des mains des usurpateurs le bien culturel de l’Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés » (C. A. Diop, In T. Obenga, 1973, p. IX).
Le pessimisme, le laxisme et la paresse sont le signe d’une mentalité décadente et rétrograde, qui freine le dynamisme de l’université, démotive les universitaires et les étudiants et empiète sur le développement de l’Afrique. Il est impératif de prendre conscience de la centralité de l’université et de la nécessité de travailler à son rayonnement intellectuel et scientifique. En valorisant davantage le potentiel de connaissances scientifiques et de rationalité que porte l’humain, l’on encourage ainsi, l’innovation, la créativité et la qualité. Innovation, créativité et qualité sont les signes du souci de l’excellence.
Conclusion
La refondation de l’université en Afrique sur le principe du mérite comme impératif catégorique pour les acteurs des universités, est un appel au sens du devoir de scientificité innovante et créatrice. La scientificité innovante et créatrice est possible là où les acteurs du système universitaire et les gouvernants assument, chacun en ce qui le concerne, les responsabilités liées à l’exercice de sa fonction en toute honnêteté, en faisant preuve d’engagement citoyen.
Les crises font partie du processus de croissance des choses. En ce sens, elles ne sont pas une fatalité. Les crises constituent des épreuves qu’il convient de surmonter sagement afin de se fixer solidement sur l’échiquier des savoirs et des sciences. Par-delà le développement qu’il convient de réaliser impérativement à travers la culture du mérite et de l’excellence, c’est, en fait, la survie de l’homme africain qui est visée. « Le potentiel d’une nation à s’adapter au monde moderne est fonction de ses capacités d’innovation, elles-mêmes assises sur sa recherche scientifique qui constitue la pierre angulaire de toutes ses technologies » (P. Deheuvels, 1990, p. 4). Les États africains ont le devoir d’édifier des universités à la pointe des sciences et technologies en se dotant de ressources humaines hautement qualifiées, à même de répondre aux exigences sans cesse croissantes de la compétitivité internationale et du bien-être des peuples.
Les universités africaines, pour répondre à cette exigence, gagneraient quant à elles, à faire de la recherche et de la promotion du mérite et de l’excellence, des objectifs cardinaux. L’atteinte de ces objectifs sera fonction de la rigueur et la prise de responsabilités qui accompagneront la sélection des ressources humaines devant non seulement tenir les rênes de la gouvernance universitaire, mais aussi et surtout dans la sélection, l’évaluation et la certification des acteurs du monde universitaire.
Références bibliographiques
CONSEIL Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur, 2012, « Construction du Nouvel Espace Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur dans le contexte de la mise en place du système académique Licence-Master-Doctorat (LMD) dans les établissements d’enseignement supérieur de l’espace CAMES », Projet AGURES.
DEHEUVELS Paul, 1990, La recherche scientifique, Paris, PUF.
EISLER Rudolf, 1994, Kant-Lexicon, I, Paris, Gallimard.
GAY Michel, 2012, « Ouverture du colloque », in Le rôle des universités et des universitaires dans l’économie de la connaissance, Ouvrage collectif coordonné par Valentin RAILEAN, Michel GAY et Oleg CURBATOV, Paris, Chişinău, p. 15-17.
KANT Emmanuel, 1986, Le conflit des Facultés, in Œuvres philosophiques III, Trad. de l’Allemand par Alain Renaut, Paris, Gallimard.
KANT Emmanuel, 1985, Qu’est-ce que les Lumières ?,in Œuvres philosophiques II, Trad. de l’Allemand par Heinz Wizmann, Paris, Gallimard.
KANT Emmanuel, 1985, Fondements de la métaphysique des mœurs,in Œuvres philosophiques II, Trad. de l’Allemand par Victor Delbos, revue et modifiée par Ferdinand Alquié, Paris, Gallimard.
MELEDJE Djedjro Francisco, 2020, « Le mérite », Gnomus, Revue scientifique de l’Université Méthodiste de Côte d’Ivoire, N°6, Presses universitaires méthodistes de Côte d’Ivoire (PUMCI), p. 63-74.
MORIN Violaine, 2018, « La méritocratie, une utopie féroce », in Le Monde, Idées, p. 2-3.
OBENGA Théophile, 1973, L’Afrique dans l’Antiquité : Égypte ancienne, Afrique noire, Paris, Présence africaine.
POL Patricia, 2012, « La passion de l’excellence dans l’enseignement supérieur en Allemagne », in Repères, N° 14, Disponible sur www.campusfrance.org, repere_14_fr. rpdf, consulté le 27/04/2022.
SAVIDAN Patrick, 2018, « Le système a du mal à s’adapter aussi vite que les stratégies des parents les plus privilégiés, qui reconstituent leurs avantages à chaque réforme », in Le Monde, Idées, p. 3.
CULTURE ORGANISATIONNELLE ET EXCELLENCE À L’INSTITUT SUPÉRIEUR DU GÉNIE ÉLECTRIQUE DU BURKINA FASO (ISGE-BF)
Marcel ZERBO
Centre universitaire de Dori / Université Thomas Sankara (Burkina Faso)
Résumé :
Les approches de l’excellence en milieu universitaire n’accordent pas une attention particulière à la culture organisationnelle des institutions d’enseignement supérieur. Ainsi, l’objectif de cette étude est d’analyser la relation entre la culture organisationnelle et l’excellence en milieu universitaire à travers le cas de l’ISGE-BF. Les investigations de terrain ont été menées à partir d’une recherche documentaire et d’entretiens semi-directifs auprès de 32 personnes parmi lesquelles 8 enseignants 20 étudiants et 4 agents de la direction de l’institut étudié. Les résultats de l’enquête montrent que les traits caractéristiques de la culture organisationnelle de l’ISGE-BF, à savoir la valorisation des performances et des compétitions, les attentes très élevées du métier d’ingénieur, l’évaluation des enseignants par les étudiants, la politique d’amélioration continue des résultats, favorisent l’excellence universitaire.
Mots clés : Amélioration continue des résultats, Attentes du métier de l’ingénieur, Culture organisationnelle, ISGE-BF, Excellence universitaire.
Abstract:
Approaches to excellence in academia do not pay particular attention to the organizational culture of the institutions of higher learning. Thus the objective of this study is to analyse the relation between organizational culture and academic excellence through the case of the ISGE-BF. Field investigations were conducted based on documentary research and semi-structured interviews with 32 people including 8 teachers 20 students and 4 management staff. The results of the survey show that the characteristic features of ISGE-BF’s organizational culture, namely the promotion of performances and competitions, the very high expectations of the engineering profession, the evaluation of teachers by students and the policy continuous improvement of results, promote academic excellence.
Keywords : continuous improvement of results, expectations of the engineering profession, organizational culture, ISGE-BF, academic excellence.
Introduction
De nos jours, les classements nationaux et internationaux des universités selon des critères mesurant le niveau de performance connaissent un succès. Ils sont utilisés par les institutions d’enseignement supérieur bien classées à des fins publicitaires (R. Lacroix et L. Mayeu, 2015). Le principal message que véhiculent ces classements est qu’il y a des universités plus performantes que d’autres. Ainsi, l’Institut supérieur du génie électrique du Burkina Faso (ISGE-BF) est régulièrement classé parmi les meilleurs instituts d’enseignement supérieur privé du pays. Créé en 2003 par une association de dix-sept entreprises avec le concours de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), l’institut est classé deuxième meilleur institut par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRSI) en 2019 puis en 2021 (MESRSI, 2019, 2021).
S’il est habituellement établi qu’il y a des universités meilleures que d’autres, on peut regretter le fait que les études sur les facteurs déterminants de l’excellence universitaire n’accordent pas une attention particulière à la culture organisationnelle. Or, l’excellence est entretenue par la culture de l’organisation universitaire. Les institutions d’enseignement supérieur ont leurs cultures organisationnelles et leurs performances en dépendent. L’objectif de cette étude est d’analyser la relation entre la culture organisationnelle et l’excellence en milieu universitaire à travers le cas de l’ISGE-BF. Comment la culture organisationnelle de l’ISGE-BF influe-t-elle sur ses performances ? Comment la valorisation des performances et des compétitions stimule-t-elle l’excellence à l’ISGE-BF ? Comment les attentes de l’ingénieur influent-elles sur la qualité de la formation ? En quoi la culture d’amélioration continue des résultats et d’évaluation des enseignants contribue à la promotion de l’excellence à l’ISGE-BF ? Le travail a consisté à apporter des éléments de réponse à ce questionnement.
1. Analyse conceptuelle et problématique de la recherche
Il convient de préciser le sens et les contours des principaux concepts convoqués dans l’analyse du problème. Cet éclairage conceptuel permet de formuler clairement la problématique de recherche.
1.1. Excellence en milieu universitaire
En général, l’excellence désigne un niveau très élevé de qualité. Selon J-M De Ketele et al. (2016), elle renvoie davantage à des palmarès, à des réputations, à des moyens et à des méthodes. L’excellence d’une université se mesure à travers son classement à un niveau élevé dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de sa participation au réseau mondial du savoir (P.G. Albach et J. Salmi, 2012). Elle fait référence aussi à l’amélioration de la qualité de la formation d’une institution d’enseignement supérieur et de recherche, à l’incitation à l’innovation, à la création des filières d’excellence et à l’ouverture sur l’international (Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, 2019). Pour F. Dubois-Shaik, B. Fusulier et G. Lits (2019), les publications d’article scientifique, la mobilité des enseignants-chercheurs, l’obtention des crédits de recherche sont des critères de l’excellence en milieu universitaire. Selon le classement de Shanghai, les critères d’une université excellente sont, entre autres, la qualité de la formation universitaire, la qualité du corps professoral et la productivité de l’université en matière de recherche (R. Lacroix., L. Mayeu, 2015). Pour ce qui est des écoles d’ingénierie, les critères d’excellence renvoient à l’insertion socioprofessionnelle des diplômés, à la proximité avec les entreprises et à la productivité en matière de recherche.
1. 2. Culture organisationnelle
L’intérêt pour la notion de culture organisationnelle dans les sciences sociales remonte aux années 80 (N. Delobbe, C. Vandenberghe, 2004). L’usage du concept renvoie à une approche culturaliste des organisations qui considère que l’entreprise a une culture qui lui est propre. L’entreprise fonctionne sous de multiples influences idéologiques, à savoir les représentations, les valeurs et les normes (A. Bouvier, 2007). La culture organisationnelle peut être définie comme les manières de penser, de sentir et de se comporter qui permettent de distinguer les membres d’un groupe ou d’une organisation (R. A. Cooke, D. M. Rousseau, 1988, G. Hofstede, 1991).
En outre, la culture organisationnelle détermine la performance d’une entreprise. En effet, selon D.R. Denison (1990), les entreprises qui se caractérisent par une organisation de qualité et par des pratiques de décisions participatives sont plus performantes. Si la culture organisationnelle influe sur la performance de l’entreprise, c’est parce qu’elle détermine le comportement de ses acteurs. Selon A. Bouvier (2007), la culture organisationnelle permet à l’organisation d’investir les consciences de ses membres. La culture d’une entreprise peut susciter le dévouement pour la cause de l’entreprise si elle est source de satisfaction pour les travailleurs (T. J. Peters, R. H. Waterman, 1982).
1. 3. Problématique
La littérature sur l’excellence dans l’enseignement supérieur permet de distinguer quatre approches. La première approche est l’augmentation significative des moyens matériels et financiers. L’excellence, de ce point de vue, est appréhendée comme le résultat d’investissements conséquents en moyens matériels et financiers (J. Salmi, 2009). En effet, R. Lacroix et L. Mayeu (2015) font observer que les universités de recherche de renommée mondiale se situent dans des espaces économiques qui permettent l’accumulation de moyens financiers importants pour l’éducation et la recherche. La deuxième approche est celle des mesures incitatives. Cette approche stipule qu’à travers des mesures incitatives comme le financement de la recherche conditionnée par le résultat on peut stimuler l’excellence (P. Aghion, 2010). La troisième approche est relative à l’environnement dans lequel les universités évoluent. Un environnement national marqué par la concurrence et l’autonomie des universités favorise le développement de l’excellence (P. G. Albach et J. Salmi, 2012 ; R. Lacroix et L. Mayeu, 2015). La liberté de recruter les meilleurs étudiants et les meilleurs enseignants sont les aspects clés de cette approche. La quatrième approche est l’approche par la gouvernance. Une université engagée sur la voie de l’excellence doit améliorer sa gouvernance. Elle doit avoir une gouvernance équilibrée (P. Aghion, 2010 ; Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, 2019).
Ces approches de l’excellence universitaire n’accordent pas une attention particulière à la culture organisationnelle des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Or, si l’on considère les travaux de D. R. Denison (1990), il apparaît que l’excellence est entretenue par une culture organisationnelle. Les organisations performantes, qu’elles soient universitaires ou non, se caractérisent par des pratiques culturelles, des valeurs et des normes. Les institutions d’enseignement supérieur ont des cultures organisationnelles et leurs performances en dépendent. De ce fait, la présente recherche a pour objectif d’analyser la relation entre la culture organisationnelle et l’excellence en milieu universitaire à travers le cas de l’ISGE-BF. Les investigations de terrain ont été menées à partir de l’hypothèse selon laquelle la culture organisationnelle de l’ISGE-BF favorise l’excellence universitaire.
2. Méthodologie
La méthodologie de la recherche comporte deux parties. La première partie décrit le processus d’échantillonnage de la recherche. La deuxième partie présente les méthodes de collecte et d’analyse des données.
2.1. Échantillonnage et échantillon
Cette recherche utilise le paradigme qualitatif comme mode d’administration de la preuve. L’échantillonnage est lié à cette orientation méthodologique de la recherche. Pour ce faire, la prise en compte de l’hétérogénéité de la population d’étude a guidé le choix des personnes interrogées (Bertaux, 2003, A. Pires, 2007). En appliquant le principe d’hétérogénéité de la population d’étude, il nous est apparu nécessaire de représenter dans l’échantillon les différentes sous-catégories de la population d’étude (Bertaux, 2003). Il s’agit notamment des enseignants, des étudiants et des agents de la direction. Ainsi, l’échantillon est composé de 32 personnes parmi lesquelles 08 enseignants 20 étudiants et 04 agents de la direction de l’institut.
Tout compte fait, une préférence pour l’ancienneté, évaluée en termes de nombre d’années d’études au sein de l’institut (1re, 2e et 3e année) a été observée pendant le choix des étudiants. En effet, les étudiants les plus anciens sont à même de mieux nous renseigner sur la culture organisationnelle de l’institut. Outre l’ancienneté, le choix des étudiants enquêtés repose aussi sur la représentativité des différentes filières d’études. Les critères de choix des enseignants reposent sur l’ancienneté et le statut (vacataire ou permanant). Tous les agents de la direction qui ont une responsabilité dans l’organisation de l’institut, ont été de facto, interrogés.
2.2. Méthodes de collecte et d’analyse des données
L’entretien semi-directif est la technique de recherche principalement déployée pour la collecte des données. Cette technique nous a permis de recueillir des propos des enquêtés sur les thématiques de compétitions, de sortie de promotion, de la discipline, de l’esprit d’innovation, de l’évaluation des enseignants, de la politique d’amélioration continue des résultats de l’institut. La collecte des données a été complétée par la recherche documentaire. Elle nous a permis de collecter des données théoriques et empiriques issues des études antérieures sur la culture de l’excellence en milieu universitaire et sur la culture organisationnelle. Le corpus de données obtenues a fait l’objet d’une analyse qualitative des données. Les données ont ensuite été confrontées aux résultats des études antérieures en vue de les discuter et de dégager des perspectives pour un enseignement supérieur excellent.
3. Résultats
Les résultats de la recherche sont présentés en trois grands axes. Le premier axe est relatif à la valorisation des compétitions et des performances. Le second axe présente les attentes de l’ingénieur à l’ISGE-BF. Le troisième axe rend compte de la culture d’évaluation des enseignants et de la politique d’amélioration continue des résultats.
3.1. Incitation à l’excellence par la valorisation des compétitions et des performances
L’enquête que nous avons menée révèle que la culture organisationnelle de l’ISGE-BF accorde de la valeur aux compétitions entre les étudiants dans les domaines de la technologie et du numérique. On distingue des compétitions entre les étudiants de l’ISGE-BF eux-mêmes et des compétitions entre les étudiants de l’institut et les étudiants des écoles supérieures nationales et internationales.
Les compétitions entre les étudiants à l’interne de l’ISGE-BF ont lieu dans les clubs. En effet, l’ISGE-BF a mis en place des clubs pour promouvoir l’excellence à travers les compétitions. On dénombre à cet effet, trois (3) clubs. Il s’agit du club d’informatique, du club de génie électrique et du club d’art oratoire. Les clubs participent à cette valorisation des compétitions au sein de l’institut. Des compétitions sont organisées en leur sein et des prix sont décernés aux meilleurs étudiants comme l’attestent les propos de cet enseignant :
Actuellement on a des clubs. On a le club de génie électrique qui organise des compétitions. La semaine passée, ils ont organisé un mini hackathon. Les jeunes ont présenté leurs projets. Le finaliste a eu un prix et le deuxième aussi a eu un prix. Tout ça ce sont des petites idées que l’on met en place pour les aider [Enseignant vacataire, 8 ans d’ancienneté à l’ISGE-BF].
Pour ce qui est des compétitions nationales et internationales, l’ISGE-BF s’implique activement dans la préparation de ses étudiants candidats. D’abord, l’institut travaille à mettre à la disposition des étudiants des informations relatives aux différents concours. Ensuite, il encourage les étudiants à participer à ces compétitions. Enfin, l’institut met à la disposition des étudiants porteurs de projet des salles d’études, des laboratoires équipés et même des techniciens, des experts pour développer leurs projets. Les enseignants de l’ISGE-BF sont aux avant-postes de ce soutien apporté aux étudiants. Ils sont toujours disposés à recevoir, écouter, donner des conseils et parfois des explications supplémentaires comme l’attestent les propos de cet enseignant responsable du cycle des ingénieurs de conception :
Quand ils viennent nous voir, nous les assistons. Ils posent des questions pour comprendre. Nous leur apportons ce qu’il faut pour faire le travail. On les aide jusqu’à ce que leur projet aboutisse. Je me rappelle aussi, il y a eu des étudiants qui ont été finaliste d’un concours international appelé Actinspace. Pour ce concours, l’ISGE a fait ce qu’il pouvait. On a fait appel aux enseignants pour qu’ils suivent la présentation des étudiants et critiquent leurs projets. On a fait aussi appel aux enseignants bilingues pour les préparer pour qu’ils soient opérationnels [Enseignant permanant, responsable du cycle des ingénieurs de conception, 5 ans d’ancienneté à l’ISGE-BF].
Par ailleurs, lorsque les étudiants reviennent des compétions avec des prix, c’est toute l’institution qui valorise le prix. D’abord, les lauréats sont accueillis par la direction avec les honneurs. Elle les félicite et les encourage à mieux travailler pour développer leur projet. Ensuite le service de la communication de l’institut va porter l’information au public et à l’ensemble des acteurs de l’institut. La page Facebook de l’institut et son site web sont des canaux utilisés pour annoncer le succès des étudiants aux concours nationaux ou internationaux. Le traitement réservé aux étudiants qui remportent des prix est décrit par le responsable chargé de la promotion et de la communication en ces termes :
Quand les étudiants remportent les prix, l’établissement les reçoit pour les féliciter, les encourager. On fait également un article et on publie sur nos différentes pages, la page Facebook et le site web de l’institut pour dire que nos étudiants ont remporté un prix [Responsable chargé de la promotion et de la communication à l’ISGE-BF].
Cette valorisation des compétitions par l’institution d’enseignement supérieur entraine une émulation chez les étudiants. En effet, après les compétitions, les meilleurs étudiants sont primés. Ils bénéficient d’un accompagnement dans le but de leur permettre de créer leurs propres entreprises. Pour cet enseignant permanant, les mesures incitatives de l’institut gagnent la faveur les étudiants :
Le but des récompenses, c’est quand vous gagnez, on vous aide à vous installer à votre propre compte. On a un incubateur ici dans le but de les aider à mettre en place leurs sociétés. Et s’ils ont leurs sociétés, c’est plus parlant. On dira, ha, lui il a pu créer sa propre société et donc tout le monde peut créer sa société et rapidement tout le monde, ça les emballe rapidement quoi [Enseignant permanent, 3 années d’ancienneté à l’ISGE-BF].
La valorisation des performances au sein de l’institut est matérialisée par la cérémonie de sortie de promotion qui a lieu chaque année durant le mois d’octobre. Elle se déroule en présence des personnalités de renommée nationale. Des artistes sont invités pour célébrer l’excellence. Les parents des étudiants sont également présents. À l’occasion de cette sortie de promotion, les meilleurs étudiants de l’institut sont récompensés pour leurs efforts dans le travail. Ce sont les entreprises fondatrices qui apportent des récompenses aux meilleurs étudiants. Les étudiants primés sont les premiers de chaque promotion allant de la première à la cinquième année. Les récompenses sont de nature diverse. Les bourses d’études, les ordinateurs, les fournitures scolaires sont entre autres les récompenses reçues par les étudiants :
La sortie de promotion est organisée mais il y a un parrain. La promotion va être baptisée au nom d’un parrain. Le parrain peut être un ministre. Cette année, c’était le ministre A. M. L’année passée il y’avait aussi un ministre qui était là. C’était le ministre de l’énergie. Lui il était là. Lors des sorties de promotion on remet des prix aux majors, ceux qui ont été les majors dans les différentes filières. Par exemple maintenance industrielle, il peut y avoir un major là-bas. Il y a un prix pour lui qui peut être un ordinateur. Informatiques réseaux et télécommunication, il peut y avoir un major là-bas aussi. Après les prix, on donne les diplômes. Il y a des prestations d’artistes [Étudiante en électricité industrielle, 2e année d’études à l’ISGE-BF].
Au regard de l’enthousiasme, de la solennité autour de la cérémonie de sortie de promotion, on peut dire qu’elle constitue un mécanisme d’incitation à l’excellence. Du reste, c’est l’excellence qui est magnifiée à travers ces prix décernés aux meilleurs étudiants par l’entremise des entreprises fondatrices de l’institut.
3.2. Des attentes très élevées de l’ingénieur pour stimuler l’excellence
L’environnement d’apprentissage à l’ISGE-BF est marqué par des attentes très élevé de l’ingénieur :
Ici, c’est la formation de haut niveau. Il y a des choses qu’on ne peut pas admettre chez un ingénieur. Quand on prend le port de la tenue. C’est eux qui doivent donner l’exemple. Les ingénieurs doivent donner l’exemple en termes de comportement [Chef de service de la surveillance à l’ISGE-BF].
Ainsi, un ensemble de valeurs et d’attentes de l’ingénieur sont prônées en vue de faire de l’étudiant formé à l’institut, un produit, un label de qualité en entreprise. De ce fait, à l’institut, il est couramment admis l’idée qu’« un ingénieur doit être ponctuel ». Pour promouvoir cette valeur de ponctualité, les retards des apprenants sont sanctionnés. Selon le règlement intérieur de l’institut, après 15 mn de retard, aucun étudiant n’est autorisé à rentrer en classe. En plus de la ponctualité, il est attendu du futur ingénieur en formation à l’ISGE-BF, l’assiduité dans le travail. Ainsi, une sanction est prévue pour les étudiants qui ne respectent pas la règle. Selon le règlement intérieur un étudiant qui s’absente plus de deux fois ne peut plus participer au prochain devoir. En plus, les absences des étudiants sont notifiées à leurs parents d’autant que ceux-ci ne sont pas toujours au courant de l’inconduite de leurs enfants.
L’intérêt qu’accorde la culture organisationnelle de l’ISGE-BF à la ponctualité et à l’assiduité a conduit l’institut à se doter d’un service de surveillance pour renforcer la discipline chez les étudiants. Les propos de cet étudiant décrivent le travail des surveillants à l’ISGE-BF en ces termes :
Chaque jour, ils viennent et puis, ils font l’appel. Surtout en première année. Ils viennent fréquemment. Souvent, ils demandent au chef de classe de faire l’appel et de cocher le nom des absents. Et après il leur transmet la liste des absents [Étudiant en ingénierie des systèmes électrique, 4e année d’études à l’ISGE-BF].
En plus du service de la surveillance, les enseignants veillent aussi à ce que les étudiants viennent à l’heure. C’est d’ailleurs ce qui ressort des propos de cet enseignant permanent :
Moi par exemple, ce que je ne tolère pas, c’est les retards. Si le cours commence à 7 h, si je rentre en classe personne ne rentre. Pour dire qu’un technicien, un entrepreneur ou un ingénieur, il doit être rigoureux sur la ponctualité. Et beaucoup d’enseignants sont sur ce registre-là. Donc du coup, quand je rentre en classe je fais l’appel, voici ma liste [Enseignant permanent, permanent, 3 années d’ancienneté à l’ISGE-BF].
En outre, à l’ISGE-BF, les étudiants sont sommés de préparer leurs travaux dirigés et pratiques avant d’entrer en laboratoire. Au sujet des étudiants qui ne le font pas, un enseignant affirme :
On les met dehors. Il y a des matières où on les renvoie. On vérifie si tu n’as pas fait on te met dehors avec une pénalité. Ce qui fait qu’ils travaillent avant de venir en classe. [Enseignant permanant et responsable du cycle des ingénieurs de travaux et directeur des études, 5 années d’ancienneté à l’ISGE-BF].
Tout compte fait, il ressort des propos de cet enseignant que les sanctions ont un effet positif sur le comportement des étudiants qui se voient désormais obligé de préparer les travaux dirigés et pratiques. De même, les sanctions contre les retards et les absences sont suffisamment dissuasifs pour les étudiants de l’institut qui finissent, avec le temps, par se conformer aux valeurs et aux attentes de l’institut. Les propos de cet étudiant confirment cet état de fait :
Ici, les gens ne viennent pas en retard comme ça. Si tu t’amuses avec les retards et les absences tu risques de ne pas composer les devoirs. C’est toi qui perds. Ici, ils sont très durs. Ils ne nous laissent pas faire [Étudiant en maintenance industrielle, 2e année d’études à l’ISGE-BF].
L’innovation est aussi une valeur prônée par la culture organisationnelle de l’ISGE-BF. Le discours dominant à l’institut, c’est-à-dire celui porté par la direction de l’institut et les enseignants est qu’un ingénieur doit avoir « l’esprit d’innovation ».
Nous avons l’habitude de dire que l’ingénieur doit être en avance sur son temps. Les ingénieurs ce sont des techniciens qui doivent se projeter dans le temps. C’est ce qu’on leur dit. Aujourd’hui, il faut de l’innovation. [Enseignant permanant à l’ISGE, responsable du cycle des ingénieurs de travaux, directeur des études, 6 années d’ancienneté à l’ISGE-BF].
L’ensemble de ces discours tenus en contexte de formation par les enseignants finit par développer chez les apprenants une culture de l’innovation. En témoignent les propos de cette étudiante sur l’origine de l’esprit d’innovation à l’ISGE-BF :
Sur ce point je dirais que c’est l’encadrement, l’enseignement qu’on donne ici, à l’ISGE-BF. Avec l’enseignement des professeurs et les problèmes que la société a, les étudiants essaient du mieux qu’ils peuvent de trouver des solutions pour améliorer la société. Donc sur ce point, je dirais juste que c’est l’enseignement. [Étudiante en réseaux informatiques et télécommunication, 3e année d’études à l’ISGE-BF].
Les résultats de l’enquête révèlent aussi que l’environnement d’apprentissage à l’ISGE-BF est très studieux. De l’avis des étudiants, choisir l’ISGE-BF, « c’est choisir d’étudier tous les jours sans relâche ».
Ici à l’ISGE, il n’y a pas le show comme ailleurs, on ne peut pas faire le show. Même si vous faites le show aujourd’hui samedi, dimanche matin venez voir le programme, c’est chargé. Moi on m’a dit que l’ISGE, c’est un camp militaire, si tu viens tu ne pourras pas supporter. Il y a la rigueur, c’est dur. Il faut étudier seulement [Étudiante en électricité industrielle, 2e année d’études à l’ISGE-BF].
Le discours des étudiants sur la rigueur avec laquelle les études sont menées au sein de l’institut peut s’apparenter à de l’exagération, mais il traduit une certaine réalité propre à l’ISGE-BF. En effet dans les propos des étudiants, il ressort une comparaison entre ce qui se fait à l’ISGE-BF et ce qui se fait ailleurs. L’ISGE-BF est décrit dans le discours des étudiants comme le lieu des études sans relâche.
3.3. Évaluation des enseignants et amélioration continue des résultats
L’évaluation des enseignants et la politique d’amélioration Continue des résultats constituent des traits caractéristiques de la culture organisationnelle de l’ISGE-BF. L’évaluation des enseignants est faite par les étudiants. Deux possibilités sont accordées aux étudiants pour évaluer leurs enseignants. Il s’agit du questionnaire mesurant le degré de satisfaction du cours à répondre en ligne et le questionnaire à remplir manuellement. Le directeur général de l’institut décrit ces deux modes d’évaluation des enseignements par les étudiants en ces termes :
L’évaluation manuelle de l’enseignant est destinée aux nouveaux étudiants de l’institut à savoir ceux de première et deuxième année. Par contre, l’évaluation en ligne de l’enseignant par les apprenants est réservée aux anciens étudiants. L’évaluation des enseignements en ligne par les anciens étudiants s’explique par le fait qu’ils sont plus familiers avec la plateforme d’évaluation en ligne [Directeur général de l’ISGE-BF].
Les critères de l’évaluation des enseignants portent sur la qualité du support de cours, sur la clarté du cours, la capacité de l’enseignant à faire passer le message, la ponctualité de l’enseignant, etc. Les résultats de cette évaluation sont étudiés par le conseil scientifique de l’ISGE-BF. Si un enseignant n’a pas obtenu un résultat satisfaisant, il est interpelé. Le conseil scientifique lui notifie les résultats de son évaluation. Les aspects sur lesquels l’enseignant doit faire beaucoup d’effort pour améliorer son enseignement sont évoqués au cours d’un entretien avec le conseil scientifique.
Par ailleurs, l’évaluation des enseignants fait partie d’une politique globale d’amélioration continue des résultats. En effet, l’ISGE-BF pratique une politique d’amélioration continue des résultats. Cette politique d’amélioration continue des résultats de l’institut est basée sur l’autoévaluation avec pour objectif d’améliorer les indicateurs de performance. L’autoévaluation au sein de l’institut porte sur les normes en matière d’enseignement supérieur édictées par les institutions de régulation de l’enseignement supérieur comme le Conseil africain et malgache pour enseignement supérieur (CAMES) et le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. S’agissant de l’autoévaluation du CAMES le directeur des études de l’institut affirme :
Le CAMES même nous recommande de faire l’autoévaluation. Les critères de cette évaluation reposent sur les normes en matière d’enseignement. Sur chaque critère nous avons les preuves à montrer. On peut dire que si vous avez des preuves vous avez 1 ou 2 points. Si vous n’avez pas de preuves vous avez 1 ou 0. C’est comme ça que l’on procède et après on fait un rapport. Ça nous permet d’apprécier la qualité de l’enseignement dans notre établissement. Ça nous permet de nous améliorer [Enseignement permanant, responsable du cycle des ingénieurs de travaux, directeur des études, 6 ans d’ancienneté à l’ISGE-BF].
L’institut pratique l’autoévaluation en vue d’obtenir, particulièrement, un bon rang au classement du ministère de l’enseignement supérieur. À ce sujet le directeur général de l’ISGE-BF nous a confié :
Quand quelqu’un vient ici pour dire qu’il y a des aspects à améliorer nous travaillons à faire en sorte que la personne ne puisse pas venir trouver la prochaine fois la même chose. Nous sommes permanemment en évaluation [Directeur général de l’ISGE-BF].
Cette politique d’amélioration continue des résultats de l’ISGE-BF se manifeste aussi par des visites de classe conduites par le directeur général et le directeur des études pour exhorter les étudiants à travailler davantage.
4. Discussion
Les résultats de la présente recherche convergent avec ceux d’autres auteurs. Ainsi, selon P. Aghion (2010), l’excellence en milieu universitaire est stimulée par des mesures incitatives comme le financement de la recherche conditionnée par le résultat. Il ressort également des résultats de cette étude que la culture organisationnelle de l’ISGE-BF est marquée par des mesures incitatives à l’excellence. La cérémonie de sortie de promotion, les compétitions nationales et internationales, les compétitions à l’intérieur des clubs sont, entre autres, les mesures incitatives de l’institut pour amener les étudiants à s’engager dans la voie de l’excellence. Dans l’un ou dans l’autre cas, des récompenses sont données aux meilleurs étudiants ou chercheurs. Aussi, H. H. Gaziel (1997) affirme que dans les établissements d’enseignement secondaire performants, on accorde plus de la valeur aux performances et aux résultats des élèves. Nous avons découvert qu’il en est de même pour l’institution d’enseignement supérieur que nous avons étudiée. Les étudiants qui ont de très bonnes performances sont primés à l’occasion de la cérémonie de sortie de promotion.
Par ailleurs, selon L. Mayeu R. Lacroix (2015) l’évaluation des enseignants par les étudiants est une pratique caractéristique des institutions d’enseignement supérieur performantes. Les résultats de la recherche indiquent aussi que l’évaluation des enseignants est une pratique de la culture organisationnelle de l’ISGE. Toutefois, nous avons aussi observé des dissemblances entre les résultats de notre étude et ceux des études antérieures. Lorsqu’il est question d’excellence universitaire, certains auteurs semblent mettre en avant les moyens matériels et financiers (L. Mayeu, R. Lacroix, 2015, P.G. Albach et J. Salmi, 2012). Sans remettre en cause le primat des moyens matériels et financiers, les résultats de cette étude montrent que la culture organisationnelle de l’institution d’enseignement supérieur que nous avons étudiée gagne l’adéquation les différents acteurs et a réussi à impulser une dynamique d’excellence.
Aussi, les études antérieures sur l’excellence en milieu universitaire accordent plus d’importance à la gouvernance, notamment à la participation au processus de prise de décision (P. Aghion, 2010 ; Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, 2019). Ce que nous avons découvert dans notre étude comme facteurs déterminants de l’excellence, c’est moins le processus de prise de décision que les mesures incitant à l’excellence, l’institution d’un ensemble de valeurs et d’attentes liées au métier de l’ingénieur, l’évaluation des enseignants par les étudiants et la mise en place d’une politique d’amélioration continue des résultats.
Conclusion
L’objectif général de cet article était d’analyser la relation entre la culture organisationnelle de l’ISGE-BF et l’excellence en milieu universitaire. L’hypothèse que nous avons formulée stipulait que la culture organisationnelle de l’ISGE-BF favorise l’excellence universitaire. Les données de terrain révèlent que la culture organisationnelle de l’ISGE-BF est marquée par des mesures incitatives à l’excellence. Il s’agit, entre autres, de la valorisation des compétitions nationales et internationales entre les étudiants, de la cérémonie de sortie de promotion. Aussi, la culture organisationnelle de l’institut que nous avons étudié se caractérise par des attentes très élevées du métier de l’ingénieur. La ponctualité, l’assiduité au travail, l’esprit d’innovation, sont des valeurs attendues chez le futur ingénieur en formation à l’ISGE-BF. L’institut se caractérise aussi par l’évaluation des enseignants par les étudiants et par une politique d’amélioration continue des résultats. L’ensemble de ces traits caractéristiques de la culture organisationnelle de l’ISGE-BF favorise l’excellence universitaire. De ce point de vue, nous pouvons affirmer que les données collectées confirment l’hypothèse que nous avons formulée.
Les résultats de la recherche confortent le modèle d’analyse selon lequel, il y a une relation entre la culture organisationnelle et la performance des organisations. Les recherches à venir sur la culture de l’excellence en milieu universitaire gagneraient à explorer davantage ce modèle d’analyse, car appréhender l’université comme une organisation ayant une culture propre est une perspective intéressante pouvant aider à élucider les questions de qualité, d’assurance-qualité et d’excellence en milieu universitaire. La recherche suggère aussi quelques pistes à explorer pour des établissements d’enseignement supérieur qui souhaitent s’engager sur la voie de l’excellence. La transformation de l’environnement d’apprentissage en un espace de compétitions et de valorisation des performances, l’évaluation des enseignants par les étudiants, l’adoption d’une politique d’amélioration continue des résultats, la dotation des universités en service de surveillance (comme au lycée) pour renforcer la discipline chez les étudiants sont des pistes pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur.
Références bibliographiques
AGHION Philippe, 2010, L’excellence universitaire : Leçons des expériences internationales, [en ligne] https://www.vie-publique.fr, consulté le 13/10/2022.
ALTBACH Philip, SALMI Jamil, 2012, La voie de l’excellence académique. La création d’université de recherche de rang mondial, Washington, Banque Mondiale, [en ligne] www.worldbank.org, consulté le 15 /03/2022.
BERTAUX Daniel, 2003, Les récits de vie, Paris, Nathan.
BOUVIER Alain, 1994, Management et Projet des établissements scolaires, Paris, Hachette.
COOKE A., Robert, ROUSSEAU M. Denise, 1988, « Behavioral norms and expectations, A quantitative approach to the assessment of organizational culture » Group and Organization Studies, 13, 3, 245-273.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2019, Reformer l’enseignement supérieur : perspectives stratégiques, [en ligne] https://www.csefrs.ma/wp-content/up, consulté le 14/05/2022.
DE KETELE Jean-Marie, HUGONNIER Bernard, PARMENTIER Philippe, COSNEFROY Laurent, 2016, Quelle excellence pour l’enseignement supérieur ? Bruxelles, De Boeck.
DELOBBE Nathalie, VANDENBERGHE Christian, 2004, « La culture organisationnelle » in Brangier Eric, Lancry Alain et Louche Claude (eds), Les dimensions humaines du travail. Théories et pratiques en psychologie du travail et des organisations, Nancy, PUN.
DENISON R. Daniel, 1990, Corporate culture and organizational effectiveness, New York, Wiley and Son.
DUBOIS-SHAIK Farah, FUSULIER Bernard et LITS Grégoire, 2019, « L’excellence académique entre « compétition » et « intégration ». Analyse des critères de recrutement et des biais de genre qu’ils induisent », Sociologies [en ligne] https://journals.openedition.org/sociologies, consulté le 07/01/2022.
GAZIEL H. Haim, 1997, « Impact of school culture on effectiveness of secondary schools with disadvantaged students », in Journal of educational research, vol. 90, N°5, pp. 310-318.
HOFSTEDE G., 1991, Cultures and organizations, software of the mind, London, McGraw-Hill.
LACROIX Robert, MAYEU Louis, 2015, Les grandes universités de recherches. Institutions autonomes dans un environnement concurrentiel, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION, 2019, Rapport des sorties de suivi contrôle des institutions privées d’enseignement supérieure (IPES), Ouagadougou, MESRSI.
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION, 2021, Rapport des sorties de suivi contrôle des institutions privées d’enseignement supérieure (IPES), Ouagadougou, MESRSI.
PETERS J. Thomas, WATERMAN H. Robert, 1982, in search of excellence: Lessons from America’s best-run companies, New York, Harper and Row.
PIRES Alvaro, 1997, « Echantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique », (Les classiques des sciences sociales), [en ligne], http://www.uquac.cajmt-sociologue, consulté le 14 décembre 2014.
SALMI Jamil, 2009, Le défis d’établir des universités de rang mondial, Washington DC, Banque Mondiale [en ligne] www.worldbank.org, consulté le 20/05/2022.
LE FINALISME ARISTOTÉLICIEN : UNE INVITATION À L’EXCELLENCE POUR NOS UNIVERSITÉS AFRICAINES
Arnaud-Olivier GNAHOUA
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Dans un monde en proie à la facilité et à la perte des valeurs, la culture de l’excellence se veut le moyen pour parvenir au salut du genre humain. À travers le finalisme qui se veut l’épicentre de toute sa philosophie, Aristote peut nous aider à susciter un regain d’intérêt pour la culture de l’excellence qui s’étiole au profit de la médiocrité qui se hisse en valeur normative de nos jours. Cet appel à l’excellence, Aristote le lance clairement au livre I de l’Éthique à Nicomaque en affirmant que toute activité humaine tend nécessairement vers l’excellence, vers le Bien qui est la meilleure finalité. L’excellence en toute entreprise est donc la finalité naturelle tandis que la médiocrité est contre-nature et détourne l’homme de sa fin ultime. Dès lors, le Bien doit être la finalité qui motive l’action humaine. C’est cette finalité (le Bien) qui doit guider toutes nos actions et non la course au gain facile avec son cortège de précarité et de manque d’épaisseur ontologique. Une bonne relecture et une intégration du finalisme aristotélicien dans l’éducation de base peut ainsi être l’antidote contre le déclin des valeurs de nos sociétés actuelles ainsi que nos institutions. S’il est bien assimilé, le finalisme peut être la boussole d’une société qui se veut épanouie et épanouissante pour ses sujets. Il peut ainsi redonner goût à la culture de l’excellence dans nos universités africaines.
Mots clés : Éducation, Excellence, Finalisme, Médiocrité, Meilleur.
Abstract:
In a world plagued by ease and the loss of values, the culture of excellence is the means to achieve the salvation of the human race. Through finalism, which wants to be the epicenter of all his philosophy, Aristotle can help us to arouse a renewed interest in the culture of excellence which is withering away in favor of mediocrity which is rising as the normative value of our days. This call to excellence, Aristotle launches it clearly in book I of the Ethics to Nicomache by affirming that all human activity necessarily tends towards excellence, towards the Good which is the best end. Excellence in any enterprise is therefore the natural end, while mediocrity is against nature and diverts man from his ultimate end. Therefore, the Good must be the purpose that motivates human action. It is this purpose (the Good) that must guide all our actions and not the race for easy gain with its procession of precariousness and lack of ontological depth. A good rereading and integration of Aristotelian finalism in basic education can thus be the antidote against the decline of the values of our current societies as well as our institutions. If properly assimilated, finalism can be the compass of a society that wants to be fulfilled and fulfilling for its subjects. It can thus restore a taste for the culture of excellence in our African universities.
Keywords : Education, Excellence, Finalism, Happiness, Mediocrity.
Introduction
Depuis plusieurs décennies, nous assistons une dégénérescence des valeurs qui touche malheureusement à presque toutes les composantes de nos sociétés. De la vie ordinaire à nos institutions, nous faisons le constat amer d’une dégradation des valeurs et d’une promotion de la médiocrité. Nos écoles et nos universités sensées être les cadres appropriés de la promotion des valeurs et de la recherche de l’excellence n’en sont pas épargnées. Nobles dans leur être et dans leur essence, les écoles et les universités qui devraient être les lieux du savoir, sont devenues, sous nos cieux, un terrain de crises et de violences. La recherche de l’excellence tant prônée en son matin inaugurale s’est transmuée en un champ de bataille où les plus violents l’emportent sur les érudits. Des décideurs aux enseignants en passant par la direction pour arriver aux étudiants, l’atmosphère universitaire semble se dégrader au fil des années. Et cela ne va pas sans inconvénients : les grèves à répétition qui perturbent le chronogramme académique, les bourses d’études octroyées sur une base d’une géométrie aux postulats inconnus, les résidences universitaires dont le contrôle échappe à la structure dirigeante, la violence érigée en moyen efficace de revendication, etc.
Face à cette perte des valeurs et la promotion de la médiocrité dans la société en général, et dans le milieu éducatif en particulier, nous nous sommes orientés vers Aristote, philosophe grec de l’Antiquité, pour puiser dans son corpus un antidote susceptible de freiner ce mouvement délétère afin d’éviter l’impasse. Cet antidote, c’est le finalisme qui se veut l’épicentre de la philosophie du Stagirite, nonobstant le fait, selon P. Pellegrin (2001, p. 25) qu’il soit « l’un des aspects les plus critiqués de la pensée d’Aristote ». Dès lors, qu’est-ce que le finalisme ? En quoi constitue-t-il une invitation à l’excellence ? Et comment peut-il aider nos États ainsi que nos universités à faire la promotion de l’excellence ? Voilà quelques questions qui guideront notre présente étude.
1. Les prolégomènes au finalisme aristotélicien
On ne peut bien cerner le finalisme d’Aristote sans un rappel de son étiologie. En effet, cette thématique aristotélicienne s’inscrit dans sa philosophie de la nature, dont l’analyse de la notion de cause se veut les prémisses.
1.1. Analyse de la notion de cause
Le finalisme, comme une philosophie de l’excellence, serait incomprise sans l’exposition préalable de l’étiologie aristotélicienne. Aux questions « Qu’est-ce que la cause ? » ou « Qu’est-ce qui est à l’origine de ? », « Qu’est-ce qui provoque ? », Qu’est-ce qui est responsable de ? », « En vue de quoi ? », etc., Aristote donne une réponse quadripartite : la matière, la forme, l’origine du mouvement et la fin en raison de laquelle la chose est faite[64]. Aristote définit donc quatre causes comme étant le vademecum dans l’explication du « pourquoi » des choses. Cette analyse de la notion de cause dans la compréhension du finalisme aristotélicien est motivée par le postulat suivant : « Nous ne connaissons pas le vrai sans connaître la cause » (Aristote, 1991, α, 1, 993b23). Le Stagirite est encore plus explicite dans les Seconds analytiques :
Nous estimons posséder la science d’une chose d’une manière absolue, et non pas, à la manière des Sophistes, d’une manière purement accidentelle, quand nous croyons que nous connaissons la cause par laquelle la chose est, que nous savons que cette cause est celle de la chose, et qu’en outre il n’est pas possible que la chose soit autre qu’elle est ». (Aristote, E, 1970, I, 2, 71b10).
Cela revient à dire que la vérité au sujet d’une chose réside dans la connaissance et dans la reconnaissance de sa cause. On ne peut donc pas outrepasser une telle analyse et se jeter à pieds joints dans la quête de la vérité d’une chose. Une telle recherche serait superficielle, sans aucune épaisseur intrinsèque à la manière des sophistes.
La recherche de la cause d’une chose conduit tout d’abord Aristote à considérer sa matière. En effet, à la question « qu’est-ce qui est la cause de telle ou telle chose ? », le Stagirite oriente de prime abord le regard vers la matière : c’est la cause matérielle. Celle-ci est la substance, voire l’essence constitutive de la chose. Pour l’illustrer, Aristote prend l’exemple d’une statue d’airain ou d’une coupe en argent. À la question de savoir quelle est la cause de la statue ou de la coupe ? Le Stagirite affirme qu’on peut répondre en évoquant la matière dont est composée cette chose. Pour la statue, c’est l’airain ; pour la coupe, c’est l’argent.
Dans un deuxième sens, la cause, c’est la forme de la chose : c’est la cause dite formelle. Elle est le modèle, l’idée qui guide et oriente l’artisan dans la réalisation de son œuvre. Elle ne doit cependant pas être confondue avec la cause finale dont nous parlerons en fin d’analyse même si ces deux causes semblent être proches quant à la compréhension. La forme ici doit être comprise comme ce qui rend actuel ce qui était de l’ordre du probable ou du possible. Par exemple, il est possible que l’argent devienne une coupe si la forme s’y invite. Sans la forme (de la coupe), l’airain ne saurait à lui seul subir cette transformation. La forme a donc présidé à cette transformation et à la production de la coupe d’airain. Mieux, la forme a mis en acte l’airain en tant que matière qui demeurait encore de l’ordre des choses en puissance.
Tout en gardant l’exemple de la coupe d’airain, Aristote, dans un troisième élan définitionnel, définit l’origine du mouvement qui fait être la chose comme cause : c’est la cause motrice ou cause efficiente. Bien qu’il faille de l’airain et la forme ou le modèle pour avoir une coupe d’airain, il faut encore un agent pour associer la matière (airain) et la forme (la coupe) pour que l’œuvre soit exécutée. C’est ici qu’intervient la cause efficiente qui n’est autre que le mouvement ou le moteur qui fait passer la chose de la puissance à l’acte. En clair, il peut y avoir de l’airain et une forme qu’on veuille lui donner, mais sans l’intervention de l’artisan, il n’y aura pas de coupe d’airain. Ainsi, à la question de savoir la cause (responsable)[65] de la coupe d’airain, hormis la matière (l’airain) et la forme (la coupe), l’artisan est également cause de la coupe d’airain en tant que celui qui a exécuté l’œuvre.
En quatrième phase analytique, il y a la fin qu’Aristote appelle cause, c’est-à-dire ce en vue de quoi une chose est faite : la cause finale. Cette cause est ce vers quoi tend toute chose. C’est la raison d’être de la chose. Considérant toujours l’exemple de la coupe, la cause finale de la coupe serait ici son usage, c’est-à-dire ce pourquoi la coupe a été faite. Mais l’exemple qui illustre bien cette cause est celui de la promenade relativement à la santé. À la question « pourquoi se promène-t-on ? » le Stagirite répond que c’est « en vue de la santé » (Aristote, 1996, II, 3, 194b33 ; 1991, Δ, 2, 1093a34). Dès lors, « ce en vue de quoi » une chose est faite est la cause finale (la cause véritable) de la chose, car elle « enveloppe […] les trois autres ordres de causes » (A. Cauquelin, 1994, p. 112).
1.2. La cause finale : cause motivatrice
Il ressort de l’étiologie aristotélicienne que la cause finale, en tant que “ce en vue de quoi” se fait toute chose, est la cause qui motive toute chose. À partir de cette cause motivatrice, surgit le postulat aristotélicien suivant : « Tout art et toute investigation, et pareillement toute action et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu’il semble. Aussi a-t-on déclaré avec raison que le Bien est ce à quoi toutes choses tendent » (Aristote, 1990, I, 1, 1094a1).
Nous remarquons dans ce passage, qui est comme un leitmotiv chez Aristote, que la cause finale s’identifie et coïncide avec le Bien. La fin ultime de toute chose constitue donc son Bien. Et c’est en vue de ce Bien que toute chose se fait. La cause finale est donc le but, le τελος, ce qui apparemment se situe à la fin, mais qui originellement se trouve au début de toute chose en tant que sa raison d’être. Par exemple, nous allons à l’école pour nous instruire. Ici l’instruction est le but, le τελος du fait d’aller à l’école ; c’est la finalité. Cependant, c’est cette instruction qui nous motive à aller à l’école : sans elle, le fait d’aller à l’école serait une vaine entreprise. L’instruction est ainsi originellement au début du fait d’aller à l’école, mais elle est matériellement à la fin. Le but de toute chose, mieux, « ce en vue de quoi une chose est produite ne se trouve donc pas en fin de parcours, mais à son origine » (A. Cauquelin, 1994, p. 123). Ce but, en tant que Bien, est le moteur qui met en mouvement toute œuvre, mais qui l’attire également. En ce sens, il est le point de départ et le point d’arrivée de toute œuvre naturelle et humaine.
De cette analyse, il ressort que l’étiologie aristotélicienne est en fin de compte une téléologie. Ce terme composite (τελος = fin et λογος = parole, étude ou science) ne désigne rien d’autre que l’« Étude de la finalité » ou « Science des fins (humaines) » (A. Lalande, 1999, p. 1107). Ainsi, le finalisme, plus qu’une théorie singulière de la nature matérielle, est une théorie englobante. Il englobe la nature dans sa totalité et stipule que tout a un sens et émane d’un Bien qui est en même temps sa fin. Ce Bien ultime que le Stagirite appelle le « Souverain Bien » (Aristote, 1990, I, 1, 1094a22) n’est autre chose que Ευδαιμονια (Bonheur). Celui-ci est le τελος de toute investigation humaine selon le Stagirite : « le bonheur est la fin de nos actions » (Aristote, 1990, I, 5, 1097b20). C’est ce bonheur que la politique comprise comme la technique de gestion des hommes en société doit garantir.
F.-N. Ahoto (2016, p. 123) synthétise si bien cette pensée aristotélicienne lorsqu’il affirme :
L’origine de la finalité de ce bien qui se confond avec le bonheur n’est pas à rechercher dans un monde transcendant, mais dans le cadre et les limites de la cité, réalité politique supérieure, parfaite, d’où son importance pour la conduite morale de l’individu, que présente la science de l’État, de la cité.
Mais avant d’en faire une réduction humaine voire sociale, rappelons tout d’abord que le finalisme est une thèse qui s’insurge contre une autre thèse : le mécanisme comme théorie explicative de la nature et de toute chose.
1.3. Le finalisme : une thèse contre le mécanisme aveugle
De l’étiologie aristotélicienne, nous sommes parvenus à sa téléologie comprise comme étude de la finalité ou science des fins humaines. Le finalisme d’Aristote, il faut le souligner s’insurge contre les partisans du mécanisme développé avant lui par Démocrite d’Abdère. M. Crubellier et P. Pellegrin (2002, p. 237-238), en donnent l’éclairage en affirmant qu’« en s’opposant au mécanisme de beaucoup de ses devanciers, il a fourni l’approche finaliste qui convient aux phénomènes naturels et notamment aux caractères des vivants ». C’est ce qu’A. Mansion (1987, p. 152) renchérit en ces termes : « la première des affirmations du Stagirite est dirigée contre les vues mécanistes des Présocratiques ; c’est contre eux qu’il pose en thèse (le finalisme) et, en même temps qu’il cherche à l’établir par divers arguments ».
Les présocratiques qui sont indexés ici ne sont autres que Démocrite d’Abdère et Empédocle d’Agrigente qui expliquent la morphologie des vivants et les phénomènes vitaux par la combinaison de rencontres fortuites et de processus automatiques. Donald J. Allan, (1970, p. 57) écrit à cet effet :
Au Ve siècle avant Jésus-Christ le système des atomistes et celui d’Empédocle avaient, malgré leurs divergences, conjoint leurs efforts en vue d’éliminer sans merci de la physique le concept même de fin, et pour montrer que les phénomènes résultant apparemment d’un dessein peuvent et doivent être expliqués d’une autre façon.
Contre cette vision mécanique, le finalisme aristotélicien nous invite à tourner le dos au hasard en toute chose. Tout s’explique, non pas par un mécanisme aveugle, mais par une fin, un Bien qu’Aristote décrit par les termes de « meilleur » et d’« excellence ». Le Stagirite fait cette précision au chapitre 2 du livre II de la Physique : « ce n’est pas toute espèce de terme qui prétend être une fin, c’est le meilleur » (Aristote, 1996, II, 2, 194a32), ce qu’il confirme au chapitre 2 du premier livre de la Politique : « En outre, la cause finale, la fin d’une chose est son bien le meilleur, et la pleine suffisance est à la fois une fin et un bien par excellence » (Aristote, 1995, I, 2, 1253a1).
Il existe donc une trajectoire, un ordre naturel qui motive et oriente les choses et les actions humaines. A. Mansion (1987, p. 270) nous le confirme lorsqu’il dit : « L’ordre est un bien et, dans la mesure où c’est un ordre dynamique, il mène à un terme qui est un bien ». Tout est donc ordre et méthode dans la nature, dans le règne animal en général et dans le cadre humain en particulier. Cela est d’autant plus vrai que « Dieu et la nature ne font rien en vain », nous dit Aristote, (1949, 270b33). Si nous parvenons à cette conclusion avec le finalisme que tout a un but, une fin qui soit le Bien, le meilleur, l’excellence de la chose en question, nous devons prendre le finalisme comme le vecteur directeur de toute chose en vue d’une existence excellente.
Soulignons au passage que le finalisme aristotélicien n’enseigne pas que la nature fait toujours le meilleur cosmique, mais bien que la nature va dans le sens du meilleur à l’échelle des possibilités propres à chaque être. Et l’homme, en tant que partie intégrante de la nature devra, dans la mesure du possible, aller dans le sens du meilleur. Dès lors, aucune action humaine et étatique ne doit être accomplie en vain, mais elle doit, au contraire, être guidée par une cause noble et en vue d’un objectif noble.
2. Le finalisme : un guide des actions humaines
2.1. Le finalisme au plan individuel
L’homme, pris individuellement, doit s’efforcer de suivre les sentiers battus du finalisme aristotélicien d’autant plus que le Bien, le bonheur, se donnent comme sa raison de vivre. Et ce bien est d’une nécessité primordiale selon le Stagirite, car « pour la conduite de la vue, la connaissance de ce bien est d’un grand poids » (Aristote 1990, I, 1, 1094a23). Aristote semble nous dire qu’il faille se laisser conduire par les principes du finalisme en vue de vivre une vie pleinement responsable, une vie qui ne s’en remet pas à un déterminisme aveugle ni au hasard, mais qui se construit plutôt sur un fond de vertu. Et une vie qui se modèle sur un fond vertueux n’est autre qu’une vie excellente, ce qui manque malheureusement à la plupart de nos étudiants qui s’adonnent à la facilité en confiant leur sort au hasard.
En effet, il y a un jeu de mots en grec entre vertu et excellence. La vertu, en grec se dit αρετη/aretê. Elle une « disposition spirituelle à agir en accord avec la loi divine » nous précise Le petit Larousse illustré (2011, p. 1137). Ainsi définie, la vertu est cette volonté innée qu’a l’homme à tendre au bien, au meilleur, à l’excellence. Cette définition de la vertu nous permet ainsi de comprendre le souci du Meilleur et de l’Excellence qui sont comme le dénominateur de la pensée aristotélicienne. C’est cette tension vers le meilleur, vers l’excellence qui doit habiter tout homme et qui doit motiver toutes ses actions. C’est le bonheur, en tant que résultat d’une vie vertueuse qui doit être la fin poursuivie par toute action et non la poursuite de plaisirs passagers et chimériques exempts de vertu et source de conflits et de dépravation des mœurs. Suivre la théorie aristotélicienne du finalisme, c’est faire le pari de l’excellence au détriment de la médiocrité qui est le propre de ceux qui se laissent guider par un mécanisme aveugle. Si le finalisme aristotélicien est bien compris et intériorisé au plan individuel, cela devient le gage d’une société épanouie et épanouissante en tant qu’elle est la somme des individus (vertueux). Au plan individuel, le finalisme invite chaque personne physique ou morale à se fixer des objectifs nobles, car « l’homme, en tant qu’il est l’animal évaluateur par excellence, doit se fixer des fins » nous dit J-M. Vaysse (1999, p. 45). Au plan individuel donc, nous, enseignants ainsi que les étudiants devons-nous fixer des objectifs nobles et rechercher l’excellence dans nos universités ; cela sous la supervision d’une bonne politique de l’État par l’entremise du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
2.2. Le finalisme au plan social
Puisque le bonheur est la fin de l’existence humaine et que l’homme est par nature un ζωον πολιτικον, c’est-à-dire un animal politique comme dit Aristote (1995, I, 1, 1253a3), l’État doit tout faire pour garantir l’épanouissement tant matériel qu’humain des citoyens. Dans toutes ses entreprises, la satisfaction du besoin matériel, humain voir spirituel doit présider à tout projet social. Si c’est dans la société que l’homme s’épanouit nécessairement, cette société n’a aussi de sens que par ce bonheur qu’elle procure aux hommes.
L’État a donc le devoir urgent de créer une atmosphère propice à l’épanouissement de ses citoyens en prônant la culture de l’excellence et en créant les conditions de son effectuation. La dépravation des mœurs et la culture de la médiocrité auxquelles nous assistons sous nos tropiques sont, en grande partie, imputables à l’État en tant que garant de la probité. Dès lors, nous rappelons, à travers cette étude, à l’État sa fonction première : former des élites et éduquer les futurs cadres de nos pays à la culture de l’excellence.
Si nos institutions éducatives et nos universités africaines sensées former les citoyens à la culture de l’excellence battent de l’aile, si nos écoles et nos universités sont en proie aux crises et aux grèves à répétition, si aucune université africaine ne fait partie du top 50 des meilleures universités au monde, de même aucune ville africaine ne fait partie du top 50 des villes universitaires du monde[66] ; nos États africains doivent se remettre en cause et opter pour la culture de l’excellence que prône le finalisme aristotélicien.
Les États africains doivent donc revoir leur politique structurelle et éducative en l’orientant vers la culture de l’excellence ; ce qui pourrait hisser et rehausser l’image de nos universités au concert des nations. Nous proposons, pour ce faire, ce qui suit :
- Nos États africains doivent faire de l’éducation et de la formation universitaire leur priorité, non pas en paroles, mais en actes. Nos États, en effet, semblent faire des secteurs d’activités pourvoyeurs de fonds leur priorité, en oubliant que ceux-là sont formés dans les universités et dans les grandes écoles.
- Les formations primaire et secondaire doivent être de qualité, car les crises des universités sont aussi tributaires des tares de l’enseignement scolaire.
- Les infrastructures universitaires doivent être excellentes afin de procurer le bien-être et favoriser l’enseignement.
- La promotion de l’excellence à travers des prix aux meilleurs universités, aux meilleurs UFR, aux meilleurs Départements, aux meilleurs enseignants, aux meilleurs étudiants, etc.
- Nos États africains doivent octroyer des bourses d’étude nationale et internationale aux meilleurs étudiants et aux meilleurs enseignants-chercheurs sur la base du mérite et non du népotisme ou de la corruption.
Nous pensons que si ces quelques propositions que nous avons faites ci-dessus sont prises en compte, nos universités africaines émergeront et retrouveront leur place dans le concert des universités internationales.
Conclusion
De ce parcours analytique du finalisme aristotélicien, nous retenons que la recherche de l’excellence est au cœur de la pensée d’Aristote. Ainsi, toute personne physique ou morale habitée par la même quête de l’excellence devra intérioriser le message du finalisme. Celui-ci nous invite à rechercher la cause véritable en toute chose. Mieux, le finalisme nous invite à rechercher la raison d’être de toute chose, sa fin qui constitue son parfait accomplissement, car « c’est la finalité qui a le dernier mot, et donc en réalité le premier mot » (A. Merker, 2017, p. 93). Ce premier et dernier mot, c’est l’Excellence qui doit être le credo de tout existant. Si nous (étudiants, enseignants et structures éducatives, bref, l’État) suivons bien cette pensée aristotélicienne, nous pourrons, avec la bonne volonté, parvenir à surmonter toutes blessures ontologiques, morale et sociale qui minent nos sociétés en général et nos institutions en particulier.
Références bibliographiques
AHOYO Félix-Nestor, 2004, Histoire de la philosophie grecque, Ibadan, Hope Publications.
ALLAN J. Donald, 1970, Aristote le philosophe, trad. CH. Lefèvre, Oxford university press.
ARISTOTE, 1990, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin.
ARISTOTE, 1991, Métaphysique, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin,
ARISTOTE, 1995, Politique, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin.
ARISTOTE, 1996, Physique, trad. Henri Carteron, Paris, Les Belles Lettres.
CAUQUELIN Anne, 1994, Aristote, Paris, Seuil.
CRUBELLIER Michel et PELLEGRIN Pierre, 2002, Aristote, Le philosophe et les savoirs, Paris, Seuil.
MANSION Augustin, 1987, Introduction à la physique d’Aristote, Louvain, Édition de l’Institut Supérieur de Philosophie.
MERKER Anne, 2017, Aristote, une philosophie pour la vie, Paris, Ellipses.
PELLEGRIN Pierre, 2001, Le vocabulaire d’Aristote, Paris, Ellipses.
QS World University Rankings 2020-2021, fr.m.wikipedia.org, consulté le 25 mai 2022 à 20h35mn.
VAYSSE Jean-Marie, 1999, Kant et la finalité, Paris, Ellipses.
Zolou Goman Jackie Élise DIOMANDÉ
Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’université est un espace de diffusion et d’acquisition du savoir. Elle forme les élites dont la société a besoin pour son développement. Dès lors, elle est amenée à promouvoir des valeurs ; et la culture de l’excellence en est une. Mais, depuis des décennies, cet espace sanctuarisé du savoir est devenu le théâtre de violences dans bon nombre de pays africains. Avec la diversité des raisons qui expliquent cet état de fait, il y a lieu d’observer que le visage hideux que présentent nos universités est loin de refléter la culture de l’excellence dont les gouvernants en ont fait une priorité. Nos universités en Afrique sont en crise et il faut se poser les bonnes questions pour envisager les solutions qui siéent à cette crise. Alors, pour faire une analyse rationnelle de notre sujet et proposer des solutions réalisables, nous articulerons notre réflexion autour de trois axes, à partir de la méthode analytico-critique. Ainsi, nous ferons en premier lieu l’état des lieux du système éducatif en Afrique. Ensuite, il sera question de montrer les obstacles que rencontrent les universités africaines dans leur quête de l’excellence. Et enfin, nous présenterons les pistes et les stratégies que propose Njoh-Mouelle Ébénézer pour restaurer l’image écornée des universités africaines.
Mots clés : Afrique, Crise, Culture de l’excellence, Gouvernants, Système éducatif, Université.
Abstract:
The university is a space of diffusion and acquisition of knowledge. It trains the elites that society needs for its development. Consequently, it is brought to promote values; and the culture of excellence is one of them. However, for decades, this sanctuary of knowledge has become the scene of violence in many in many African countries. With the varieties of reasons that explain this state of affairs, it is worth observing that the negative face that our universities present is far from reflecting the culture of excellence that governments have made a priority. Our universities in Africa are in crisis and we need to ask ourselves the right questions in order to find the right solutions to this crisis. Therefore, in order to make a rational analysis of our subject and to propose feasible solutions, we will articulate our reflection around three axes, based on the socio critical method. Firstly, we will take stock of the education system in Africa. Secondly, we will show the obstacles encountered by African universities in their quest for excellence. Finally, we will present the avenues and strategies proposed by Njoh-Mouelle Ebenezer to restore the battered image of African universities.
Keywords : Africa, crisis, culture of excellence, governments, education system, university.
Introduction
La réflexion de E. Njoh-Mouelle relative à la culture de l’excellence dans l’espace universitaire africain, lui permet de relever le double objectif que s’est assignée l’Université. Celle-ci vise d’abord la transmission de savoirs, c’est-à-dire de l’héritage culturel, scientifique et techno-numérique à la jeune génération afin qu’elle parvienne à intégrer aisément le tissu socio-culturel. L’Université a, ensuite, pour but de promouvoir et de développer le goût de la recherche dans tous les domaines de connaissance afin d’améliorer les savoirs-faire et les savoirs-être de leurs sociétés respectives et au-delà (E. Njoh-Mouelle, 1975, p. 65). Mais, cette vision idéalisée de l’Université subit le contrecoup des crises multiformes auxquelles elle se trouve confrontée, remettant ainsi en cause les objectifs de départ. Pourtant, l’Université se doit de se conformer à ces objectifs, en conservant ainsi la culture de l’excellence sensée la caractériser. Se dégage alors le problème central suivant : l’Université en Afrique est-elle à même de promouvoir la culture de l’excellence ? La résolution d’un tel problème engendre d’autres interrogations : quel est l’état des lieux du système éducatif en Afrique ? Quels sont les obstacles auxquels sont confrontées les universités africaines dans leur quête de l’excellence ? Et pour finir, quelles sont les pistes et les stratégies, que propose Njoh-Mouelle Ébénézer pour promouvoir l’excellence en milieu universitaire en Afrique ? Pour fonder en raison notre réflexion sur le sujet, la démarche analytico-critique guidera notre travail qui se dévoilera autour d’un plan tripartite. D’abord, il s’agira de faire l’état des lieux du système éducatif en Afrique. Ensuite, montrer les obstacles auxquels les universités africaines sont confrontées, dans leur quête de l’excellence. Et enfin, s’appuyer sur les pistes et les stratégies que Njoh-Mouelle Ébénézer nous propose pour atteindre notre objectif, qui est d’avoir un système académique de qualité et adéquat.
1. De l’état des lieux du système éducatif en Afrique
Dans cet état des lieux, il est question de montrer comment le système éducatif traditionnel en Afrique a été bouleversé par les effets de la colonisation. Par conséquent, l’Afrique se verra imposée le système éducatif du colonisateur. Dès lors, elle cherchera par tous les moyens à retrouver sa liberté, son autonomie. Malheureusement, elle se trouve prise dans le piège de la colonisation. De ce fait, dans nos investigations, nous ferons une analyse binaire de cette partie, en montrant jusqu’où l’Afrique ne pourra se départir du système éducatif de l’Occident. Ainsi, dans un premier temps, il sera question de montrer comment l’Afrique s’est vue imposer le système éducatif colonial. Et dans un second temps, il s’agira de montrer que la décolonisation africaine s’est muée en une colonialité.
1.1. De l’imposition du système éducatif colonial à l’Afrique
L’Afrique est un continent qui a connu les affres de la colonisation sur tous les plans, précisément dans le domaine éducatif. Pourtant, pour ce que l’on sait, l’éducation est le fondement de tout développement. Bien avant l’invasion coloniale, les Africains avaient leur paradigme de système éducatif qui permettait la formation et l’instruction des apprenants. Cela permettait la transmission des savoirs endogènes, des valeurs endogènes africains à la jeune génération, pour qu’elle ait toutes les armes afin de mieux aborder la vie ou affronter les vicissitudes de l’existence. L’éducation en Afrique ancestrale suivait un système initiatique qui avait pour instrument de transmission de savoir : l’oralité et l’observation. Elle se faisait sous une forme collective. Les plus jeunes apprennent de leurs ainés et c’est en se conformant aux réalités de son milieu de vie que l’apprenant devient un homme accompli. Il intègre la classe des sages et devient apte, dès lors, à prendre des décisions pour l’avenir de la communauté à laquelle il appartient.
Sont considérés comme ainés, ceux ayant acquis des expériences et qui sont une source d’inspiration, d’admiration et un modèle pour les plus jeunes. L’ainé, est celui qui détient la sagesse. C’est dans cette perspective que cette pensée de Amadou Hampâté Bâ, qu’il a prononcé dans son discours en 1960 devant l’assemblée de l’UNESCO, prend tout son sens : « En Afrique quand un vieillard meurt c’est une bibliothèque qui brule ». Cette pratique ancestrale de l’enseignement en Afrique a été bouleversée par la colonisation. Ce phénomène historique a mis en crise tous les systèmes éducatifs traditionnels de l’Afrique pour imposer celle du colonisateur, de l’autre, de l’étranger. Ce système enseigne les savoirs-faires, les savoirs-être et les savoirs-dire de l’autre, de l’Occident à l’Afrique. C’est sa vision ou sa conception du monde qui est véhiculée dans ce nouveau modèle d’enseignement en Afrique. Les Africains se sont alors vus embarqués dans la barque de la colonisation, en abandonnant, malgré eux, leurs modèles éducatifs endogènes.
L’Afrique a perdu le code de son système éducatif, selon E. Njoh-Mouelle (2011, p. 37), à partir « de l’impact avec la civilisation occidentale, brutalement brisé par la colonisation ». Pourtant, tout système éducatif n’a de valeur qu’en fonction de la vision globale de la société pour laquelle il est mis en place. Ici, cette crise apparaît comme un abandon, un refus de se relever pour prendre les choses en main. Elle n’est pas un manque, une absence, dans la mesure où une culture ne se perd pas ou ne s’oublie pas à la manière d’un malade atteint d’Alzheimer dont la défaillance de sa mémoire l’empêche de savoir son identité réelle. Tout se passe comme si la période coloniale a totalement eu raison des cultures des sociétés africaines. Cette situation a amené l’Africain, de manière inconsciente ou par manque de confiance en lui, à nier et même à renier sa méthode éducationnelle et même sa culture. Cet état de fait a suscité ce que E. Njoh-Mouelle appelle « l’homme médiocre » qui est en manque d’initiative personnelle pour sortir du moule dans lequel il a été formé et fermé par la colonisation. L’Africain a perdu tout repère et toute référence, avec en prime une mauvaise adaptation à des valeurs éducatives exogènes intériorisées et qui mettent à mal l’organisation et le système de valeurs africains. Cela conduit à ce qu’on pourrait appeler une aliénation culturelle qui, à son tour, aboutit à la crise de l’initiative, de la créativité en Afrique.
De ce qui précède, il convient de retenir que les modèles éducatifs en Afrique, c’est-à-dire del’enseignement primaire à l’université, sont fonction d’une politique basée sur l’assimilation. Cela montre que les systèmes éducatifs en Afrique fonctionnent à partir des principes qui ont été établis depuis l’époque coloniale. Malgré les indépendances africaines, les africains demeurent sous la tutelle des “anciennes” métropoles. Ainsi, nous passons de la décolonisation à la colonialité.
1.2. De la décolonisation à la colonialité du système colonial en Afrique
Décoloniser qui est l’une des exigences de l’existence humaine, est un processus légitime dont l’objectif est de mettre fin à la domination exercée par un peuple ou un individu sur l’autre, en vue de la reconquête de la liberté, dans la mesure où l’existence coïncide avec la liberté. À partir de cette définition de la décolonisation, il importe pour les Africains de s’approprier les systèmes éducatifs en Afrique et leur fonctionnement, en y intégrant leur propre vision, c’est-à-dire le type de développement qu’ils souhaitent pour l’Afrique, dans la perspective éducative.
Malheureusement, le système éducatif colonial demeure, même après la décolonisation. Les écoles modernes africaines ont été construites à partir des modèles des écoles missionnaires. C’est pourquoi, l’on observe toujours les traces et les mains du colonisateur dans les décisions et les résultats des politiques éducatives dans l’Afrique actuelle. Cela apparaît comme une sorte de malédiction, une tache indélébile, pour l’Afrique. Elle a du mal à s’en départir, pour trouver sa propre voie. Les systèmes éducatifs africains actuels, il faut le dire sans ambages, ont été hérités de la colonisation. Cette démarche est appelée la colonialité. Celle-ci pourrait se définir comme une persistance du phénomène colonial après la décolonisation historique dans les relations du pouvoir et du savoir au plan éducation-formation, dans notre contexte-ci.
Cependant, il n’est pas question pour l’Afrique de se replier sur elle-même, ni de retomber dans cette idéologie d’originalité, d’authenticité, dans la mesure où l’Afrique ne peut plus devenir ce qu’elle a été dans le passé ancestral. C’est en cela que Amadou Hampâté Bâ (2001, p. 91) s’adresse à la jeunesse africaine, en ces termes :
Soyez authentiques, mais sans fermer le hublot qui vous permet de regarder à l’extérieur. Vous existez, mais l’autre aussi existe. Servez-vous de lui. (…) Les idées qui viennent de l’extérieur, je ne dis pas qu’il faut les exclure, mais il faut les passer au tamis. L’Afrique sera demain ce que vous ferez d’elle. Si vous cessez d’être africains, il n’y aura pas une Afrique, il y aura seulement un continent. Et là, vous aurez arraché une page de l’histoire de l’humanité. Vous serez absents.
Il s’agit de savoir faire une synthèse culturelle rationnelle nécessaire pour aboutir à un système hybride de qualité, dans la mesure où les pays africains sont indépendants, même si cette indépendance se trouve encore torturée, angoissée. Aujourd’hui la jeune génération ne s’exprime presque plus dans les langues locales, mais dans celle de l’autre, aussi bien à la maison, à l’école, qu’aux aires de jeu. Il est clair que l’Afrique est dans la dynamique de la mondialisation et qu’il est nécessaire pour les africains de comprendre et de parler la ou les langues des autres. Car, ils iront apprendre les expériences, les secrets du succès des autres pour venir parfaire leur mode de vie. Ces échanges se feront absolument dans les langues étrangères. Par conséquent, il ne sera pas profitable pour l’africain de fait fi de la langue des autres, c’est-à-dire de l’Occident. Néanmoins, il doit prioriser sa langue, vu que la langue est l’élément centrale de toute culture. C’est d’elle que tous les autres éléments culturels émanent. Alors, si les Africains ne s’expriment plus dans leurs langues, cela montre que le colonisateur, en leur imposant son système éducatif, son système de pensée, les a aussi vaincus au plan linguistique, donc culturel.
Cependant, il ne s’agit pas de désespérer. Il revient maintenant d’utiliser ce brassage culturel né de la colonisation à bon escient, afin qu’il soit profitable pour le développement des sociétés africaines. Ce qui importe ici, ce n’est pas de faire disparaître toutes les frontières ou les renforcer ; mais, comme le dit E. Njoh-Mouelle (1971, p. 64), de limiter l’invasion de notre intériorité par une extériorité qui ne nous laisse plus jamais le loisir de penser par nous-mêmes et de vivre comme nous le souhaitons. Nous sommes contraints de nous ouvrir aux autres, surtout dans le domaine éducatif, en confrontant nos réalités académiques à celles des autres, dans la mesure où les universités africaines connaissent des difficultés dans leur quête de l’excellence.
2. Des obstacles à la quête de l’excellence dans les universités africaines
Les universités africaines, dans leur quête de l’excellence, sont confrontées à des obstacles d’ordre structurel, infrastructurel, financier. Bien au-delà de tous ces obstacles cités, il y a l’inadaptation du système éducatif aux réalités africaines. Cependant, que faut-il faire pour y remédier ? Pour ce faire, il convient de prôner l’excellence dans les écoles africaines, voire dans les universités africaines, en y balayant toute idée de médiocrité.
2.1. De l’inadaptation du système éducatif aux réalités africaines
Parmi les obstacles que connaissent les universités africaines, il y a le problème d’inadaptation du système éducatif aux réalités africaines. Les Africains ont leurs cultures, leurs traditions, leurs matières premières, leurs sols et leurs sous-sols. Les Universités africaines devaient d’abord être construites à partir des ressources de chaque région afin de remédier aux difficultés qu’elles rencontrent et penser à leur développement. À ce que l’on sache, les réalités occidentales diffèrent de celles de l’Afrique. Ainsi, en premier lieu, toutes les décisions académiques qui sont prises devraient être prises en direction des besoins des Africains en premier. Cette transposition épistémologique du système éducatif occidental en Afrique est un obstacle à la bonne marche des instituts de formation en Afrique.
Il y a la vétusté des infrastructures et une inadéquation des moyens, des méthodes et des techniques ne permettant pas aux enseignants et aux étudiants de mieux faire leurs recherches. À l’ère où le numérique est à la portée de tous, les Universités africaines ont des soucis de connexion, de wifi. L’on assiste à des soutenances de Mémoires et de Thèses qui ne peuvent rien apporter ni au progrès de la recherche locale ni à celui du pays. En vrai, il faut « donner la possibilité aux étudiants africains de s’inspirer de nos cultures, de nos traditions pour proposer des alternatives » (S. Tonme, 2009, p. 126). Cette idée sous-entend que les étudiants et les chercheurs africains mettent en rapport les expériences ou les résultats scientifiques de l’Europe avec les éléments et valeurs culturels africains afin de participer au développement des pays africains. Le résultat de leur travail de recherche scientifique doit répondre en priorité aux attentes et aux préoccupations des pays africains et du public africain. Ainsi donc, l’encadrement, la formation et l’émancipation des Africains doivent, par conséquent, être fondés sur les valeurs africaines d’orientation, c’est-à-dire la vision du monde des Africains du développement.
Il y a aussi, l’absence du génie créateur, le suivisme, l’inadaptation chronique du système éducatif aux réalités africaines. En effet, comme le souligne S. Tonme (2009, p. 127), « Il existe une grossière inadéquation entre les enseignements et les programmes d’une part, et les besoins de développement et de prise en compte des besoins réels du pays, d’autre part ». En créant une université, le but est de répondre aux besoins de la localité où elle se trouve, sinon elle sera inutile. Les programmes ou les maquettes des universités doivent être en phase avec les activités pratiquées par la population. Malheureusement, l’on se trouve dans ce qu’on pourrait appeler une transposition épistémologique d’une éducation inadaptée. Cela montre clairement, le caractère extraverti du système éducatif africain. Cette attitude conduit inévitablement à la promotion de l’homme médiocre, car manquant d’objectif clair.
2.2. La promotion de l’homme médiocre dans l’espace universitaire africain
Parler de promotion de l’homme médiocre dans l’espace universitaire, cela revient à dire qu’il y a un laisser-aller, dans le fonctionnement du système éducatif même, dans l’orientation des étudiants. Cela amène souvent les étudiants à être démotivés dans leurs différentes filières. Par conséquent, ils ne montrent aucun engouement, aucune volonté pour leurs études. Cela se perçoit dans le manque de confiance en leur capacité de compréhension, de rétention et d’analyse des cours. Alors, ils recourent à la facilité et à la tricherie, qui sont convoquées comme solution à leur mal-compréhension des cours magistraux. Toutes ces attitudes participent à la construction de l’homme médiocre. En fait, selon E. Njoh-Mouelle (2011, p. 56), « l’homme médiocre est un être qui se réfugie derrière la facilité du suivisme et de l’auto-répétition habituelle, un être par conséquent qui tourne le dos à la liberté (…) et au génie créateur de l’homme » L’homme médiocre, c’est celui qui a perdu confiance en ses propres capacités, qui pense sa réussite par des méthodes tortueuses, la tricherie, la corruption, l’intimidation, la violence au sein de l’Université. Il a du mal à compter sur ses propres forces. Cela joue en défaveur de l’image des Universités africaines et par extension celle de l’Afrique. Car, le fondement de tout développement c’est l’éducation, la formation et l’instruction. Sans une éducation de qualité, sans une formation de qualité toutes idées de développement n’est qu’un leurre. Le développement ne peut se faire dans un esprit conformiste, conservateur ou dans une auto-répétition, le suivisme absolu, dans une pensée close. Même si la répétition est souvent valorisée parce qu’ayant un fond pédagogique, néanmoins il ne faudrait pas oublier son aspect abrutissant. Car, elle inhibe l’esprit de créativité, d’innovation en l’homme qui refuse le progrès. Cela fait de ce dernier un être superficiel.
Être superficiel, c’est être sans fond, sans contenu, c’est être vide de sens et d’essence, et donc être inutile au progrès de l’humanité. Ce type d’homme préfère rester à la marge, à la périphérie et s’en contente. Par conséquent, il est comparable au consommateur des idées des autres. C’est dire qu’il agglutine tout ce qu’il reçoit sans tri, sans analyse. Il est comparable à un réceptacle qui consomme tout ce qu’il reçoit. Cette attitude amène les Africaines à renoncer à eux-mêmes, à leur être au monde, à leur responsabilité et à leur autonomie et à les laisser conduire par la vision de l’Autre ou de la société. Nous nous aliénons dans « l’anonymat des conventions et des idées reçues. » (E. Njoh-Mouelle, 2011, p. 55). C’est dire que nous nous laissons phagocyter par les idées et les règles des autres sans chercher à affirmer notre particularité. Pourquoi ? Parce que nous sommes animés par l’instinct de conservation et la peur de sortir de notre minorité pour exprimer notre créativité, en apportant de l’innovation à du déjà-là. Et c’est cet instinct de conservation qui anime nos universités et universitaires. Toutes les innovations sont d’ordre théorique et non pratique.
Cela ne peut toutefois pas être considéré comme une fatalité pour les Africains. En tout être humain, il y a ce désir de mieux faire, de perfection qui mène à la créativité et l’innovation en vue du dépassement du déjà là, du déjà-vu. Par conséquent, comme l’asserte S. Tonme (2009, p. 134) :
Dans le supérieur, même s’il est incontestable que le suivisme est de règle, c’est-à-dire que l’on copie souvent bêtement les réformes européennes et américaines, il demeure possible, s’agissant d’adultes, de compter sur le sursaut individuel de chaque acteur académique pour atténuer les éléments d’extraversion et intégrer une dose de facteurs locaux.
Il est clair qu’à l’Université, l’on a affaire à des adultes, à des intellectuels, des étudiants, comme des enseignants-chercheurs. Ce sont toutes des personnes responsables qui ont la capacité de prendre des décisions individuelles pour leur propre intérêt et celui du Département scientifique auquel ils appartiennent. Alors, en fusionnant leurs différentes idées, les universitaires africains pourraient asseoir le fondement de leur système éducatif endogène, pour leur développement endogène. C’est pourquoi, en nous penchant sur les pistes et les stratégies que nous propose E. Njoh-Mouelle, nous envisageons promouvoir l’excellence en milieu universitaire en Afrique.
3. Les pistes et stratégies pour un système académique africain d’excellence au miroir d’Ébénézer Njoh-Moulelle
Comment faire pour parvenir à un système éducatif de qualité, ou encore à un système académique d’excellence avec des étudiants qui auront pour seul objectif : être les meilleurs dans leur discipline, dans leur filière en vue de participer au développement de leur société ? Pour y répondre, nous allons nous référer aux pistes et stratégies que Njoh-Mouelle Ébenezer propose aux universités africaines. Selon lui, pour exceller ces dernières doivent être des universités militantes, tout en optant pour une réforme rationnelle de l’espace universitaire africain.
3.1. De la promotion d’une université militante en Afrique
« L’université africaine aujourd’hui doit être une université sans passion sachant intégrer les particularismes africains au patrimoine humain universel. C’est à ce prix qu’elle pourra se mettre au service du développement économique et social de l’Afrique » (E. Njoh-Mouelle, 1975, p. 74). Les Universités en Afrique doivent pouvoir participer logiquement au développement scientifique et économique de ce continent. Pour ce faire, les recteurs des universités en Afrique, les autorités politiques africaines ont pour tâches de se libérer de tout complexe, de la politique de la main tendue. Sinon, les Africains se trouveront à plagier le paradigme du système occidental sans jamais apporter ou ajouter leurs savoirs faire à l’universel. Cette attitude met les Africains dans une mauvaise posture et les place à la traine du progrès universel. En ayant cette posture, les Africains s’érigent en des éternels consommateurs improductifs.
S’ils choisissent de rester en retrait, ils feront défaut au progrès de l’humanité. Car, la science n’est pas l’apanage de l’Occident. Il importe pour les Africains de décomplexer, sinon ils feront entorse à l’”Intelligence africaine, la raison africaine”. Ils donneront alors raison aux philosophes ou aux auteurs de la pensée dite primitive tels que Hegel et Levis-Bruhl, pour qui la philosophie et la science sont immanentes à l’Occident. Il est clair que la raison qui est la chose la mieux partagée au monde, ainsi que le pense Descartes, est aussi présente en Afrique.
Si les Africains veulent sedéfaire des préjugés coloniaux, quitte à eux de se mettre au travail en développant ou en construisant des structures, des laboratoires spécialisés qui permettront aux scientifiques de tous les horizons de venir s’y former et non se cacher désespérément derrière le passé colonial pour justifier le manque de volonté, alors, l’occasion leur est donnée de faire leur preuve afin de participer ostensiblement au progrès de la connaissance dans le monde.
Sans risque et sans prise d’initiative, il ne peut y avoir de développement. Il leur faut apprendre à risquer, à oser, à ne pas avoir peur d’échouer, de perdre, de se tromper ou de faire des erreurs. Car sans les erreurs il n’y aura point de découvertes extraordinaires. C’est dans la persévérance qu’ils pourront atteindre leur objectif et avoir le droit d’être cité parmi les pays ou les continents les plus avancés, les plus industriels en matières technologique. Car, le secret de la puissance et de la domination de l’Occident se trouve dans la science et la technologie, comme le dit M. Towa (1971, p. 7). Il importe que les Africains s’éloignent des attitudes tels que la démagogie et le sentimentalisme effrénés pour assoir les fondements de leurs universités, afin qu’elles soient classées parmi les meilleures au monde. La question n’est pas d’être en compétition ou de battre l’Occident, mais de pouvoir réussir dans les mêmes domaines de connaissances. Le problème n’est pas de vivre en vase clos, replié sur soi. Car le faisant, on vivrait coupé du monde, ou encore on cacherait ses insuffisances derrière l’époque coloniale.
L’université africaine d’aujourd’hui doit, selon E. Njoh-Mouelle (1975, p. 77), « être certes une université sans passion mais demeurer une université militante. » dans le sens de la promotion des valeurs culturels. Il ne s’agit pas de tropicaliser l’université ou de l’Africaniser. Promouvoir nos valeurs culturelles dans les espaces universitaires africains, c’est y manifester l’initiative créatrice, l’innovation à partir de notre vision du développement, qui va nous conduire à ce que E. Njoh-Mouelle (2011, p. 160) appelle le « soulèvement des profondeurs ». Cette expression signifie mettre en mouvement nos savoirs endogènes, ce qui est enfoui dans nos cultures, nos sols et sous-sols, les passer au crible de la science pour qu’ils participent au développement endogène de l’Afrique.
Alors, pour que les universités africaines soient comptées parmi les universités de renom et faire partir des universités scientifiques il nous faut plus d’initiative créatrice. Pour y parvenir, il faut à l’Africain un peu « plus d’initiative créatrice pour pouvoir envisager avec optimisme de faire échec aux diverses formes d’aliénation que lui présente en perspective la société devant sortir de la bataille du développement ». (E. Njoh-Mouelle, 2011, p. 139). Dans ces conditions, il serait souhaitable d’opter pour une reforme rationnelle, et non artificielle, du système éducatif ou académique dans leurs espaces universitaires.
3.2. Pour une réforme rationnelle de l’espace universitaire africain
Reformer ne doit pas être compris dans ce contexte comme former de nouveau quelle que chose, ni comme reconstituer ce qui avait été déconstruit, refaire ce qui était défait. Reformer ne signifie pas revenir aux origines des choses, aux sources ou encore recourir aux sources. Par reformer, il faut entendre : « élaborer une politique solide et ambitieuse de l’éducation et de la formation en y consacrant tous les investissements nécessaires sur une longue période, pour éviter cette chaîne de conséquences négatives et compromettant » (S. Tonme, 2009, p. 134) que l’on observe dans les pays africains.
Cela ne signifie pas aussi qu’il faut s’enfermer dans les modèles de système éducatif colonial. Cela implique qu’il faudrait, pour les élites africaines, faire preuve de plus d’initiative, de plus d’autonomie, de plus d’originalité et de plus d’audace, comme le fait « l’homme excellent ». Ce dernier n’est pas quelqu’un qui sort de l’ordinaire, mais c’est celui qui marque un arrêt dans le déroulement de son existence, qui prend conscience pour sortir de la routine. Car, L’homme excellent « sort effectivement d’une condition partagée par un grand nombre dans la médiocrité pour se poser supérieurement en marge du groupe » (E. Njoh-Mouelle, 2011, p. 151). Il est celui qui pose des actes pour parfaire sa condition d’existence sans chercher à faire comme tout le monde, comme sa communauté.
Il n’agit pas selon ce que sa communauté lui impose, mais plutôt apporte de nouveaux éléments pour l’amélioration de la condition de vie de celle-ci. Les caractéristiques de l’homme-excellent sont l’aptitude à la liberté, à la créativité, l’exigence de connaissance et de sens de la responsabilité. C’est ce modèle d’homme qui doit être mis en avant dans l’espace universitaire africain pour penser et panser le développement en Afrique. Pour le faire, les universités africaines ont le devoir de créer des espaces d’échange, des plates-formes, entre les universitaires africains pour penser le développement endogène en Afrique. Ainsi que l’affirme P. J. Hountondji (1976, p. 49), il s’agit de discuter, de débattre entre Africains, des problèmes qui minent les espaces universitaires africains afin d’y trouver des solutions. Pour cela, il faudrait revoir le système académique ou peut-être le réorienter dans le sens des besoins industriels en Afrique et non seulement dans celui des besoins économiques. En effet, comme l’argumente E. Njoh-Mouelle (2011, p. 8) :
L’idée de développement est incontestablement une notion économique ; mais la réduire rigoureusement à l’économique serait la restreindre outre mesure. Le développement est un processus complet, total, qui déborde par conséquent l’économique pour recouvrir l’éducationnel ou le culturel.
Autrement dit, le développement, avant d’être économique, est fondé sur la culture ou l’éducation, dans la mesure où toute éducation prend sa source dans une culture. Ainsi, un peuple qui n’a aucune notion de sa culture est un peuple aliéné, égaré, qui ne peut que stagner dans le sous-développement ; car, n’ayant aucun repère. Les éléments du sous-développement sont l’ignorance, la superstition, l’analphabétisme. Alors, l’Université qui est un lieu par excellence où l’on pense le développement, doit mettre en exergue la culture de l’excellence en prenant appui sur les valeurs culturelles locales. Cela se fera de manière rationnelle, sans émotion.
Que les pays africains arrêtent de dormir sur la natte des autres, le modèle ou le système éducatif des autres, pour emprunter l’expression de J. Ki-Zerbo. Ils doivent tisser leur propre natte afin d’arrêter de subir les manipulations ou les chantages de l’autre, de l’extérieur. Le siècle des “Lumières” en Afrique sera à ce prix. Il s’agit pour les intellectuels africains de définir ou redéfinir leur propre programme éducatif et les proposer au reste du monde. Car, d’un continent à un autre les réalités divergent. C’est à partir des besoins des sociétés africaines que les programmes éducatifs scolaires ou académiques doivent être planifiés. Comme le souligne P. J. Hountondji, (1973, p. 52) :
Confiner les [chercheurs africains] à la recherche appliquée, ou à des recherches portant sur leurs propres pays, leur interdisant ainsi indirectement, (…) l’accès aux arcanes les plus secrets du savoir. (…) en dotant nos Universités de tout l’équipement technique et bibliographique nécessaire, ainsi que d’un encadrement approprié, et en inaugurant consciemment, lucidement, une politique de la science accueillant sans exclusive toutes les disciplines fondamentales, dans leur riche et féconde diversité.
Cela sous-entend que les Africains doivent sortir du mimétisme artificiel et pratiquer le mimétisme rationnel, en traçant leur propre voie, en imposant leur modèle de système éducatif, afin que les universités africaines aillent mieux !
Conclusion
À l’issue de cette analyse, nous notons que les universités africaines ont besoin de promouvoir la culture de l’excellence dans leur espace, à partir des réalités culturelles africaines. Car, le développement d’un pays, d’un peuple a pour fondement l’éducation. Ainsi, l’Université qui est un espace où se conjuguent l’éducation, la formation et l’instruction, apparait comme le lieu approprié où la culture de l’excellence doit être manifeste, en intégrant les valeurs traditionnelles africaines. C’est cette vision qui a fondé notre réflexion à partir de la pensée du philosophe africain Ébénézer Njoh-Mouelle. Selon lui, pour que les universités africaines participent au développement de l’Afrique, elles doivent établir leur programme d’étude et de recherche à partir des activités quotidiennes des Africains. En effet, toute Université devrait prioriser les valeurs locales de la société dans laquelle elle se trouve. Il s’agit de vulgariser les valeurs qui ont un impact sur les activités exercées dans les sociétés africaines et concomitamment promouvoir le type d’homme que Njoh-Mouelle nomme « l’homme excellent ». Alors, pour sauver nos Universités des crises qu’elles traversent, il conviendrait plutôt pour elles de penser l’adaptation des formations académiques aux besoins des pays africains, en tenant compte des réalités extérieures, et des défis de développement liés aux enjeux de l’avenir de la planète et de l’humanité. Car, l’humanité est un patrimoine commun qui a besoin de la participation active de tous les continents, l’Afrique y compris !
Références bibliographiques
FANON Frantz, 1968, Les damnés de la terre, Paris, Maspero.
HOUNTONDJI Jidenu Paulin, 1973, Liberté : contribution à la révolution dahoméenne, Cotonou, Renaissance.
KANT Emmanuel, MENDELSSOHN Moses, 2006, Qu’est-ce que les Lumières ?, Traduction de l’allemand par Dominique Bourel et par Stéphane Piobetta, revues par Cyril Morana, Éditions Mille et une nuits.
NJOH-MOUELLE Ébénézer, 2011, De la médiocrité à l’excellence : Essai sur la signification humaine du développement, CLÉ, Yaoundé.
NJOH-MOUELLE Ébénézer, 1980, Développer la richesse humaine, CLÉ, Yaoundé.
NJOH-MOUELLE Ébénézer, 1970, Jalons : Recherche d’une mentalité neuve, Yaoundé, CLÉ.
NJOH-MOUELLE Ébénézer, 1975, Jalons II : L’africanisme aujourd’hui, Yaoundé, CLÉ.
TONME Shanda, 2009, Fondements culturels de l’arriération de l’Afrique Noire, Paris, L’Harmattan.
TOWA Marcien, 1971, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, CLÉ, Yaoundé.
UNE AURATISATION DE L’ENVIRONNEMENT ACADÉMIQUE PEUT-ELLE SAUVER L’UNIVERSITÉ DE LA GRISAILLE ?
Masséké OPONOU
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Le but de cet article est de panser la crise de l’éducation scolaire académique en Afrique, par le remède d’une auratisation des pratiques pédagogiques, de l’environnement désenchantant des campus et de l’atmosphère inappropriée pour les noces de l’esprit avec le savoir. La notion d’aura est un philosophème cher au philosophe Walter Benjamin qui traduit le fondement magique des choses et des êtres, dont le défaut, l’absence ou la perte poussent les éléments et l’être à la pétrification. Une auratisation de l’environnement académique peut-elle sauver l’université de la grisaille ? À notre avis, penser l’éducation par voie de recours à l’aura, c’est se souvenir que l’enfant, mieux que l’adulte, conserve encore en lui, la magie de l’aura dont il en joue pour déjouer la trappe du mythe, de l’ensorcellement démonique, de la réification et de l’éternel retour de l’enfer. Il s’agit d’un procès dans lequel le maître, l’éducateur ne peut sortir qu’en croisant le regard libérateur, magique et pédagogique de l’enfant. L’enfant devient ici le maître et le maître l’enfant, pour conduire l’école et l’université à la Rédemption.
Mots clés : Aura, Enfant, Éducation, Excellence, Pédagogie, Remémoration, Université.
Abstract:
This article is an attempt at solving the issue of academic school education in Africa by improving throught ‘’auratisation’’the pedagogical practices and the unflattering learning environment of students so as to actually keep them with the production of knowledge. The concept of ‘’aura’’ is a philosophical theory from the philosopher Walter Benjamin aiming to convey the magical foundation of beings and things whose lack is harmful to human beings. To have an educative project by resorting to the ‘’aura’’ concept is to remember that the child keeps the magic of ‘’aura’’ inside and it builds up better than the adult. This prevents the child from the trap in which the teacher, the educator and the adult are caught. Thus the child symbolises freedom, magic and pedagogy that enlighten.
Keywords : Aura, child, adult, education, pedagogy, excellence, university, remembrance.
Introduction
Les universités africaines sont plongées depuis les années 90 dans un marasme endémique aux imbrications multiples. Nombre pléthorique d’étudiants, manque d’enseignants, état de délabrement des structures d’accueil, manque de salles de cours, grèves à répétition motivées par l’indisponibilité des bourses scolaires, déchaînements de violence sur les campus…autant d’épreuves qui sonnent le désenchantement, et qui induit le sentiment que l’université a perdu de son aura. Les universités africaines ne font plus rêver. Elles sont en mal de gravitation.
Dans cette faillite généralisée et épidémique des universités, les solutions apportées par les pouvoirs publics successifs et les décideurs académiques relèvent très souvent de l’infrastructurel (construction d’université, d’amphithéâtre, augmentation du volume des bourses, installation d’équipements nécessaires, accroissement des structures d’accueil…), des bourses et rémunérations, sinon des questions syndicales avec leur problématique de rapport avec le pouvoir, de légitimité d’action et de gestion pacifique de la cohabitation entre les organismes syndiqués.
Le problème des « 3000 docteurs non recrutés » en Côte d’Ivoire qui secouent les tabloïds des réseaux sociaux actuellement révèle que la crise est profonde et qu’il y a des pans de la problématique qui ont été occultés, escamotés, qui ont été tus, passés sous silence dans l’atmosphère ouatée, feutrée des salles disposées à cet effet pour les mille et deux mille séminaires, symposium, ateliers sur l’école qui n’aboutissent à rien, comme nous aimons le faire en Afrique.
La réflexion que nous voudrions initier ici interroge le mal d’attraction de l’université, mais le mal dans son expression esthétique, social et métaphysique, tant qu’il peut référer à un déficit d’aura pédagogique, d’ingénierie académique, de « marketing » social, d’inadaptabilité de la pratique scolaire aux demandes des jeunes. C’est dire qu’en ligne de mire nous visons à redonner à l’université son charme, moyennant la magie de l’aura, de sorte à la rendre encore plus fréquentable et à susciter chez les apprenants l’excellence et le goût des études. L’aura est l’apport conceptuel du philosophe allemand Walter Benjamin (15 juillet 1892-26 septembre 1940) dans l’économie de la philosophie esthétique. L’aura est le halo de mystère qui se dégage d’un objet naturel, cultuel, ou historique, qui nous relie à l’au-delà de la représentation. Walter Benjamin investit cette notion dans les faisceaux éclectiques de sa pensée (la théologie, l’art, le cinéma, le film, le messianisme et la révolution…) et mandate l’enfant d’instruire l’adulte sur la fiction et le danger qui guette à terme l’humanité dès lors qu’elle manque à la méthodologie de la Rédemption, dont l’enfant a été investie. Parlant d’enfance et de jeunesse, notre développement nous installera d’abord dans l’engagement qu’a pris Walter Benjamin, alors qu’il n’était qu’un apprenti-philosophe dans les mouvements de jeunesse, pour penser le statut de l’éducation et le devenir des étudiants, conformément à l’idéal qu’il conférait à l’université. Par où l’on verra que les questions de paradigme scolaire occultées par nos décideurs étaient des questions soulevées par notre auteur depuis la République de Weimar. Nous voici justifiés à orienter notre article sur l’axe de réflexion : « Université et culture de l’excellence » par une double présentation de la question : la réforme benjaminienne de l’éducation pédagogique comme moment idéologique de la solution de la crise universitaire en Afrique et l’innervation de l’aura dans la pratique enseignante et l’enchantement de l’espace-temps comme coupure et rupture au désenchantement.
1. L’université comme champ de productions et de créativités intellectuelles
L’investissement de Benjamin dans les mouvements de jeunesse dessine les linéaments théoriques et métaphysiques de ce philosophe juif-allemand. Apparus au début du XVIIIe siècle en Allemagne, les mouvements de jeunesse protestent contre l’ordre bourgeois et l’idéologie du progrès et raillent son prosaïsme ainsi que sa posture réactionnaire, ses idéaux chloroformés et passéistes. Contre ces idéaux jugés hiératiques et anachroniques, la jeunesse allemande de l’époque en appelle à un idéal bohémien, romantique et mystique capable de réenchanter l’Europe, désenchantée par les lubies de l’industrialisation et de la société marchande.
1.1. Pour une réforme de l’éducation à partir du projet de jeunesse de Walter Benjamin
Déjà lycéen, l’adolescent W. Benjamin rejette l’éducation figée, autoritaire, tyrannique, de son école, obligeant alors ses parents à le transférer à l’internat de Wickersdorf, une communauté scolaire qui répondait à son tempérament.
Il s’agit là de l’un des projets pédagogiques réformistes les plus importants d’Allemagne, mené par un petit groupe de pédagogues dits rebelles. Là, garçons et filles, grands et petits, maîtres et élèves ne se trouvent plus séparés hiérarchiquement, mais collaborent d’égal à égal. Autonomes, les élèves organisent leur temps à leur goût, participent aux prises de décisions qui concernent la vie en commun et peuvent s’adonner à des activités physiques, intellectuelles et surtout artistiques (M. Berdet, 2014, p. 26).
C’est dans l’élan de ce mouvement de jeunesse que le jeune Benjamin rencontrera Gustav Wyneken (1875-1964), pédagogue réputée et maître à penser de cette pédagogie libérale, accueillie par les activistes du mouvement de jeunesse. Prenant acte du vide intérieur laissé par la religion, Gustav Wyneken, fils de pasteur entend raviver l’instinct mystique et le génie individuel brimé par une religiosité essoufflée. Pour atteindre cet objectif, Wyneken entend éveiller l’école à une éducation libératrice alors qu’elle est aliénée par l’État qui ne promeut et ne promet aux étudiants que le carriérisme professionnel, le fonctionnariat, le corporatisme administratif au lieu que l’université éveille à la créativité et élève l’apprenant à la dignité de l’esprit.
Dans la philosophie de l’éducation qu’il pratique à Wickersdorf, Wyneken s’inspire d’une dialectique hégélienne de la conscience. Éduquer, cela revient pour le pédagogue à arracher l’enfant à ses certitudes sensibles, c’est –à-dire à le sortir de son état primitif d’animal dominé par des sentiments obscurs de plaisir et de déplaisir (premier dégré), en le faisant accéder aux formes historiques de la langue, puis de la justice et du devoir (deuxième degré) et enfin en lui permettant d’agir lui-même sur ces formes, de les critiquer et de les créer (troisième degré)(M. Berdet, 2014, p. 27).
Dit en termes hégéliens, le paradigme de l’éducation que reprend Wyneken, déjoue l’esprit subjectif englué dans les inclinations, et les pulsions, pour les confronter à l’esprit objectif (le droit, l’éthique, l’État) et en a cueillir les fines fleurs avec l’esprit absolu (l’art, la religion, la philosophie).
Mais si Benjamin estime en Hegel sa dialectique de subjugation de l’esprit subjectif de l’enfant en une apothéose transcendantale via le filtre de son objectivation dans le droit, Benjamin postule le recours à Hegel en termes de programme plutôt qu’en dogme, la réconciliation des contraires en une synthèse positive jugée chez lui d’aberrant. Cette fronde de Benjamin contre la dialectique positive de Hegel anticipe depuis sa jeunesse sa théorie de la dialectique aux arrêts, dont Adorno et Horkheimer en feront une réappropriation avec la théorie de la dialectique négative.
En somme, la réforme pédagogique inspirée par la communauté de Wickersdorf avec le philosophe Wyneken, installe la jeunesse, les idéaux de la jeunesse au cœur de la pratique pédagogique. En sublimant l’énergie de la jeunesse, on guérit la société, on la libère de ses formes sclérosées des directives bourgeoises, sociales, politiques qui maintiennent l’Allemagne et l’inhibe à l’élan mystique du dépassement et de la transcendance. Wyneken écrit : « Une jeunesse que l’on laisse vraiment jeune est le grand remède de la société contre les conventions, le philistinisme et l’angoisse » (G. Wyneken, 1963, p. 122). Benjamin saura gré à son maître d’avoir indiqué et montré aux didacticiens que la pédagogie nouvelle doit être « anti-autoritaire [et] fondée sur les potentialités de la jeunesse » (M. Berdet, p. 31). Benjamin sera pour autant déçu de Wyneken qu’il accuse de compromission avec l’idéologie nationaliste, puisqu’en 1914, Wyneken va encourager les jeunes à s’engager pour la « guerre » (W. Benjamin, 1972, p. 113).
Le jeune Benjamin néanmoins va investir le mandat de son maître dans ses articles de jeunesse qui restent marqués par « l’empreinte de l’idéalisme émancipatrice de Wyneken » (M. Berdet, 2014, p. 31), à savoir une éducation qui, en arrachant le jeune à ses inclinations animales, les sublime en expressions créatrices, fait de lui un critique des valeurs pétrifiées de la société et un agent de l’esprit universel.
Benjamin veut libérer la jeunesse de la tutelle des adultes pour la faire accéder au statut de sujet : non-corrompue par les choses matérielles, elle se tient au plus près de la source métaphysique d’où surgit, comme un geyser en haute montagne, des beautés futures, comme l’explicitent le titre et le sous-titre de la revue fondée en 1908 dans laquelle il publie : Le commencement. Revue pour l’art et la littérature qui viennent. Les jeunes se trouvent eux-mêmes chargés de fonder une communauté au service des valeurs spirituelles dont la vertu consiste à protéger les individus des corruptions futures. (M. Berdet, 2014, p. 31)
Cette marque spirituelle de l’esprit propre à la jeunesse n’est pas impropre pour autant à l’adulte. La jeunesse dont parle Benjamin ne renvoie pas à un stade biologique ; c’est une qualité psychologique, un éthos qui peut manquer même à certains jeunes alors même que bien des adultes le manifestent, en font une trame de vie. Benjamin dit que cette qualité singulière de l’esprit qu’incarne la jeunesse est l’interstice de la porte qui rouvre au royaume de Dieu comme disponibilité messianique. C’est pour expliciter ce fait qu’il écrit ceci : « Le tout est de ne pas la gâcher en se rigidifiant dans le mysticisme ou les conventions : il faut toujours, contre les réifications séniles, revenir à la vitalité de la jeunesse comme disposition métaphysique » prévient M. Berdet (2014, p. 36), commentateur de Walter Benjamin. L’apprenti-philosophe qu’il était entend subvertir le schéma pédagogique traditionnel en désaxant le régime hégémonique et vertical de l’autorité du maître face à l’apprenant pour placer l’apprenant au cœur du dispositif d’apprentissage puisqu’à l’apprenant, au jeune, est conféré une réserve du potentiel métaphysique du réveil. Le rêve qui habite le réveil, l’instant présent, est peuplé des messages du passé, ceux de nos ancêtres, rêves enfouis dans les décombres mais qui attendent, dans une mince espérance ressurgir dans l’expérience de la Rédemption, dans la fulgurance de l’Autrefois, du passé lointain à même de se présentifier : l’aura.
Dans La vie des étudiants, Benjamin engage les décideurs académiques et politiques à une réforme de l’université, une réforme en rupture avec les pratiques pédagogiques et éducatives qui relèvent du paradigme bourgeois de dressage pour le compte d’un fonctionnariat improductif et stérile puisque ces pratiques pédagogiques ne s’appuient pas sur l’élan spirituel de la jeunesse pour atteindre au génie et à la transcendance. Les jeunes auront manqué à la sphère métaphysique de leur aspiration, ils n’auront pas atteint la révolution culturelle et politique que Benjamin investissait au projet des mouvements de jeunesse. Benjamin lui-même, s’étant aperçu de cela écrira : « Les étudiants n’ont pu en traduire clairement la nécessité spirituelle, en sorte que jamais ils n’ont réussi à fonder sur lui une communauté d’esprit véritablement sérieuse, mais seulement une communauté où le zèle du devoir accompagne l’intérêt » (W. Benjamin, 2003, p. 131).
Mais Walter Benjamin ne renonce pas à son projet de désaliénation de la conscience et de réification du réel. Pour libérer l’esprit de la réification, pour renouer l’espace académique, les pratiques pédagogiques à l’enchantement, le maître, l’adulte doit solliciter l’enfant et son imaginaire, l’enfant le puise dans un medium, une catégorie que Walter Benjamin nomme l’aura.
1.2. L’enfant et le référentiel auratique
Si l’univers académique universitaire s’est enrhumé dans notre modernité, c’est parce que l’adulte n’a pas su croiser le regard de l’enfant, il n’a pas su prendre la mesure de la puissance utopique de l’enfant inscrit en chacun de nous. Le référentiel imaginaire, le rêve éveillé de l’enfance a été détourné, court-circuité par les calculs et le principe de réalité, de rendement de l’idéologie du progrès, autre déclinaison de la fiction de l’omnipotence de la raison. L’enfance déroge au temps vide de l’adulte, temps linéaire et mortifère, le temps de l’horloge et de la rentabilité. Contre ce temps physique, mécanique, la magie de l’enfance vire à la temporalité brisée, le temps irrégulier, intérieur, le temps des anniversaires, des vacances, de l’été et de la fête. Le temps de l’enfant est un temps ‘’originaire’’, libéré du carcan de la modernité, de l’enfer et de son retour.
Ce temps qui structure nos régimes institutionnels, les programmes d’école et de nos administrations évoque la répétition des choses, du même dans la sphère de la communication, des partiels, de la compétition, du flot d’informations, du flux des messages, des injonctions au rendement. Ce temps est désenchanteur, il manque d’épiphanie, il manque aux épiphanies. L’épiphanie est expérience vécue de la traversée de kaïros[67] passé le bavardage (Kierkegaard). Le kaïros est le moment divin que Dieu choisit pour s’acter, pour s’accomplir. Ce moment est particulier en tant qu’il est unique, fugace, imperceptible à la conscience humaine éprise de bavardages et de futilités. kaïrosarrache à Chronos ses occupations pour rendre sa visibilité à l’humain plutôt prisonnier des multiples occupations du monde du travail, de la course capitalistique au rendement. Chronos est le temps du mauvais infini qui livre l’homme et Sisyphe à la besogne, à l’activité, à la tâche toujours recommencée aux fins d’une libération de l’humanité toujours promise mais ajournée par la raison de l’histoire, par l’histoire en raison de son auto-élévation à la posture de Dieu. Le regard de l’enfant voudrait semble-t-il ramener l’adulte à la raison, la raison à la raison, l’histoire à sa propre intériorité de sorte à nous ouvrir l’œil, le troisième œil perdu, à la présence toujours renouvelée, mais tellement discrète du kaïros, le temps de Dieu, le temps de l’avènement sur celui des événements. Le regard de l’enfant est le regard de l’Ange de l’histoire qui échoue à prévenir l’adulte, la raison hégémonique de la catastrophe. C’est pourquoi, Benjamin investit l’enfant d’une mission politique, justement parce que révolutionnaire. À l’adulte, ensorcelé par la logique de la rationalisation, kaïros se fait deux fois discret ; à l’enseignant imbu de son entendement, c’est Chronos dieu pour l’éternel ennui qui sature ses cours et son hémicycle, théâtre routinier de nos amphithéâtres où le magistère ne communique rien qui relie, qui connecte les disciples au Logos, à la Parole, au Verbe perdu mais non disparu de la nomination adamique.
La théorie du langage chez Walter Benjamin s’adosse à une conception théologique( la Bible) de la déchéance de la pureté du Verbe après le péché adamique que redouble l’épisode de Babel, soldé par la confusion extrinsèque du langage, symptôme du mutisme du cosmos qui demeure en attente de nous communiquer un reste d’aura comme expérience parousiaque du Nom, rendu inaudible par le brouillage, le brouhaha et le bruitage des mécanismes sériés de la reproduction technique, du sensationnel et de sa publicité, du choc psychologique et des excitations induits par la vie urbaine.
Se tenir face aux apprenants, leur inculquer le savoir, c’est en même temps qu’on leur fait accéder au champ sacré du savoir, en creux, leur faire signe vers cette disponibilité auratique qui par notre maintien, notre posture, notre façon de dire, d’être et de communiquer déborde notre individualité, pour faire confluer l’auditoire vers l’originel. C’est cette requête de l’aura, les pistes pour la rendre disponibles à l’école, dans l’amphithéâtre, dans l’environnement universitaire que nous allons à présent analyser.
2. Jeu et méthodologie de l’aura
Ce qui manque aux enseignants et aux universitaires en particulier, c’est cette pédagogie de l’aura, leur non disponibilité à la magie de la chose qui dialectise le lointain et le proche dans le mystère de l’apparaître et de l’élévation, qui pour s’être approché indique le chemin de l’originel, du lointain. On connaît la définition que Benjamin a donné à l’aura dans son essai Petite histoire de la photographie : « Un étrange tissu d’espace et de temps : l’apparition unique d’un lointain, aussi proche soit-il » (W. Benjamin, 2014, p. 39-40). Dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Benjamin rejoue la définition énigmatique de l’aura, rendue à une manifestation singulière, une et unique dans la trame d’un temps et d’un espace unique, où la chose comme émotion, comme halo de mystère, effluve d’énigme recouvre le champ de la conscience du sujet qui en fait l’expérience comme cadeau et présent d’une présence, la présence fugace d’une visitation. En un mot, c’est l’atmosphère qui entoure ou semble entourer un être, une chose.
2.1. Pour une auratisation de l’environnement et de l’espace universitaire
Si les machettes pleuvent dans nos universités, c’est aussi parce que le cadre et l’environnement même de nos espaces académiques s’y prête. Ce sont des espaces désauratisés, pauvres en enchantement et en expression artistique. Les universités sont justes déposées, flanquées dans la ville, toutes dénuées de qualités floristiques, d’arbres, de cocotiers, de cours d’eau, de fontaine, d’espace de contemplation et de méditation, de sites écologiques qui relèvent de l’empreinte supérieure et de l’expertise d’un paysagiste averti. Les étendues herbues qui gazonnent nos cités universitaires restent en deçà de la mimèsis auratique.
L’écologie ne peut pas être seulement qu’une doctrine, à faire valider aux étudiants moyennant des épreuves cognitives, clichées hautement estimées dans nos universités ; chez les japonais « l’ikebana » signifie « la voix des fleurs » (on aurait pu dire l’aura des fleurs), ou « l’art de faire vivre les fleurs ». Cet art floral est une véritable œuvre vivante de portée spirituelle qui lie la philosophie à la créativité artistique, le symbolisme à la nature, la beauté au sublime. Le beau conjugue au bien. Il ne faut pas négliger la fonction prophylactique de l’environnement ; la nature belle apaise, comme la musique, elle peut adoucir les vilaines mœurs. L’écologie est une solution à la violence estudiantine, à la voie des machettes sur nos campus. Les images, les vues, les photographies, l’environnement des universités, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis, partout ailleurs, sauf très souvent en Afrique, communient à une beauté docte, à une commotion psychologique, noématique pour les études. Partout ailleurs, le cadre d’étude met l’esprit en génuflexion, en état de grâce de prendre les études à-bras-le corps. Chez nous, plutôt que d’enchantement, ce sont des espaces sémi-urbains et prosaïques, qu’on peut fouler, parcourir, traverser sans être convoqué, par le moindre monument représentatif, de sculpture, de statue, d’œuvre d’art élevés en hommage aux maîtres disparus. Adorno mort dispose d’un monument à Francfort.
Les décideurs académiques et politiques en Afrique, comme en Côte d’Ivoire ont trop de respect pour les morts pour élever des monolithes à Laurent Aké Assi, Harris Memel-Fotê, Zadi Zaourou…Comment mobiliser alors l’esprit du jeune étudiant dans cet environnement prosaïque, morne et non stimulant ? Que dire alors des étudiants même ? Sous couvert de pauvreté, de bourses non allouées, de précarité sociale, les jeunes étudiants manquent à ce qui caractérise en propre la jeunesse : le goût de la beauté, la passion de la beauté. Le spectacle de ces étudiants bigarrés, éloignés des étiquettes, non racés et spontanément et bougrement grossiers interroge l’éthos de ces adolescents, en quête de savoir mais qui n’entendent pas l’accommoder au savoir vivre. Le Vrai, le Beau, le Bien ! Platon !
L’image dialectique, concept cher à Walter Benjamin autorise la mise à l’arrêt, en suspension du temps dans l’expérience inédite de ce qui se dérobe, se refuse aux excès à la surcharge, à l’hypertrophie de l’exubérance bureaucratique du progrès, facteur d’ennui et de dépression. La dialectique positive n’est pas la dialectique du bon infini, elle est la ruse du mauvais infini qui masque sous les traits de son éclat apollinien, son appétit d’ogre. Gloutonnerie à en demander davantage, à courir terre et mer, terre et ciel à la recherche du profit, du gain, du cumul du capital, de la puissance, de la course à l’armement, des guerres et de la Guerre. La conscience d’être investi, d’être mandataire de l’esprit universel est une conscience belliqueuse, agonistique, qui par son sérieux même et l’urgence qui le fait courir n’a que faire de ce qui ne rentre pas dans son rang.
2.2. Pour une auratisation de la pratique pédagogique par le renouvellement didactique et le jeu
Il y a des imprenables, de l’irréductible dans l’histoire, des choses qui pour échapper à la prise, à la reprise, paient la sentence de la méprise au tribunal de la raison qui en insupporte la déprise. Ainsi du rebut, du rejeté, du débris, de la prostituée, des minorités, des colonisés, des révolutions inabouties des voix des sans voix qui bruissent dans le vent, réclamant justice. Benjamin est resté attentif à tout ce qui a été délaissé à la marge de l’histoire officielle. Pour lui, l’historien qui ne rame pas à contre-courant de cette historiographie, qui reproduit le narratif de la victoire sans réinterroger les faits est complice de la barbarie, cet historien-là trahit la lutte. Il participe des cohortes des recéleurs des butins de guerre élevés à l’indignité de la culture. À l’autisme, Benjamin oppose le souvenir, non pas dans un immobilisme dans le passé, mais dans un recours au passé qui libère dans le Maintenant, dans l’« à-présent», la possibilité de la Rédemption.
Chaque instant abrite des interstices qui attendent la fulguration du perdu, du tort, du mensonge infligé aux sans nom. Le temps de Dieu qui n’est pas le temps physique du rythme de l’horloge n’attend pas une apothéose au terme de l’auto-accomplissement de la raison, c’est un temps messianique abrité dans le regard de l’enfant et qui le dispose à soupçonner dans l’objet, dans les gadgets, les figurines, la terre et la poussière l’espérance d’un monde prêt à surgir de l’aliénation, la rencontre du nouveau qui fête les retrouvailles. Enfance berlinoise, œuvre de Benjamin, est un livre didactique qui réconcilie la génération de l’enfant à celle de l’adulte dans l’entente sécrète des promesses à venir et de la dette payée aux oubliés, aux vaincus par voie de remémoration et qui assigne à l’humanité un devoir théologico-politique : rassembler les débris de ce qui s’est cassé selon l’eschatologie de la Kabbale. Enfance berlinoise est programmatique des Thèses sur le concept d’histoire où Benjamin proclame le verdict de l’histoire au tribunal de la raison. L’enfant est le savant du monde, l’adulte son apprenant. À travers une gnoséologie ludique, l’enfant veut apprendre à l’adulte la sécrète charge apotropaïque et libératrice du jeu. L’enfant contre les Lumières est mandaté par le réel pour être aussi son avocat.
Le jeu restitue les choses à leur authenticité en détournant les objets de leur fonctionnalité, de la finalité utilitaire de leur réception. Il n’y a que le joueur qui peut opposer sa joyeuse désinvolture à la positivité de la marchandise, fétiche de l’ordre bourgeois. Dans L’œuvre d’art à l’ère de sa reproduction technique, Benjamin nous montre comment le film est constitutif du jeu. La réalisation d’un film, est proprement joué dans le sens qu’il y a jeu de prise et de reprise de l’image, d’agrandissement, de montage et de démontage, qui choquent la perception visuelle auratique qu’engage l’œuvre d’art traditionnelle. La caméra aménage un espace de jeu entre l’homme et la nature, un forum propice à la conscientisation de la masse, à une éducation politique.
À l’ère des NTIC et des réseaux sociaux, comment l’université peut-elle être en retrait des flux d’images et de vidéos (whatsapp, facebook, tik tok..) que le monde s’envoie, particulièrement les jeunes pour ne pas s’en servir comme matériaux de travail et de renouvellement de la salle de cours. Il y a que nos pratiques discursives, académiques, classiques ne se sont pas autonomisées des référentiels et dispositifs cognitifs cartésiens et kantiens du sujet en face de l’objet. Dans Sur le programme de la philosophie qui vient, Benjamin remet en question la nature de l’expérience telle qu’elle appert chez Kant dans la Critique de la raison pure. Chez Kant en effet, l’expérience est proprement objective. Elle relève de la sensibilité, de l’intuition sensible. La métaphysique n’est pas une science parce que ses objets ne relèvent pas de l’expérience.
Pour Benjamin, Kant en défenseur des Lumières ne pouvait trahir au projet d’institutionnalisation de l’entendement comme faculté exclusive d’intellection des choses, c’est pourquoi sa théorie délimite la sphère du connaître à l’entendement comme unité de production des catégories qui subsument le divers empirique. Benjamin dit que Kant a appauvri la notion d’expérience. Si Benjamin reprend à Kant la notion d’expérience, il la recouvre d’une légitimité transcendante, parce que certaines consciences font l’expérience de perception qui échappe aux mailles de la conscience empirique. Les chamans, les schizophrènes, les Abidjis, les Ajoukrou, les sujets en transe ont aussi des expériences de perception qu’on ne peut pas leur nier. C’est pourquoi Benjamin va jusqu’à inclure les sciences divinatoires et les disciplines mantiques dans la notion d’expérience.
L’enseignant tient déjà la classe institutionnellement, à quoi cela le gênerait-il d’inviter des magiciens, des astrologues, ou des sorciers dans l’amphithéâtre sur des sujets ou problématiques y afférents ? Pourquoi s’interdire, refouler l’intervention dans nos salles de cours des devins, des magnétiseurs, des rebouteux, des sorciers, des « Glaès » (masque chez les Guérés) ? « Tout racisme, du reste, ne relève –t-il pas du magisme ? Et toute crainte de la magie n’implique-t-elle pas une croyance sécrète » C. Bonnefoy, 1964, p. 34) ? Pourquoi se raidir dans cette infatuation de la raison qui s’arroge le droit de la connaissance et de la vérité, alors que Benjamin n’y voit que tristesse au sens métaphysique du terme ? Si l’art, mieux que tout peut rendre disponible les virtualités de l’aura, pourquoi les tam-tams n’investissent pas l’espace de nos universités pour donner un peu de chaleur, de dissonance au milieu ? Et que dire de la dance, de la transe, des spectacles de chants mantriques, de visites surprises d’authentiques stars, de conteurs traditionnels ou professionnels dans les salles de cours, d’assiègement, à l’occasion du campus par les Dj ? À quand la folie, le carnaval, à qui danser fait-il honte ?
À ceux qui poufferaient du caractère saugrenu de telles propositions, le philosophe Niamkey Koffi (2019, p. 99) leur répond :
Comme le disait Nietzsche, le courage aime à rire…Qui de vous sait encore rire, même après avoir atteint la cime ? Les intellectuels aiment à se prendre au sérieux et l’air grave de leur sérieux les empêche de rire,…de rire d’eux-mêmes ! C’est-à-dire de soumettre leurs propres idées à la critique. Mais comment le pourraient-ils ? Comment pourraient-ils se poser à eux-mêmes la question des titres de leur conscience pensante, de son lieu et de sa fonction quand de façon naturelle et instinctive ils pensent que leur conscience est la Raison même toujours présente à soi ? C’est pourquoi dans le ciel de leur pensée, le rire ne peut avoir droit d’asile. C’est pourquoi tout ce qui est bas et source de rire ne peut leur être intelligible comme source de pensée et de chose sérieuse. Tout ce qui est bas et en bas est instinctif. Comme du peuple, de ce qui est en bas, de ce qui est du peuple, rien de sérieux ne peut sortir qui mérite valorisation et considération. Contre un tel état d’esprit, il convient de revenir au « peuple » à sa culture pour voir si dans ces productions intellectuelles dites grossières et instinctives, il ne nous présente pas un modèle de société en rapport avec sa volonté de liberté.
Conclusion
L’Afrique est trop en retard et elle a été trop méprisée pour que les structures de l’histoire et de l’école ne travaillent pas avec acharnement pour le réveil des consciences. L’école dévastée, la passion enseignante réduite comme peau de chagrin doit mobiliser malgré tout à un renouvellement de la pratique enseignante qui tisse le rêve au réveil. Benjamin nous a communiqué l’épistémologie de l’enfant dont l’objet d’étude renvoie à l’éthique de la récupération, récupération de ce qui dans l’orthodoxie de nos programmes scolaires et académiques fait front à la pétrification. Il faut de la créativité, du neuf, de l’insolite, de la provocation pour déjouer et re-jouer l’encerclement du mythe, du progrès, pour entrer dans le délassement. Il faut inscrire l’insolite au cœur des pratiques enseignantes. Il faudrait aussi anticiper les fêtes pour n’obliger personne à anticiper les congés.
Références bibliographiques
BENJAMIN Walter, 2000, Correspondance complète I, Francfort, Suhrkamp.
BENJAMIN Walter, 1999, « La réforme scolaire, un mouvement culturel », in Œuvres complètes II, Francfort, Suhrkamp.
BENJAMIN Walter, 2003, « La vie des étudiants », in Œuvres I, Paris, Gallimard.
BENJAMIN Walter, 1999, « Métaphysique de la jeunesse, le dialogue », in Œuvres complètes II, Francfort, Suhrkamp.
BENJAMIN Walter, 2014, Petite histoire de la photographie, Paris, Allia.
BENJAMIN Walter, 2000, « Sur le concept d’histoire », Œuvre III, Paris, Gallimard.
BENJAMIN Walter, 2000, « Sur le langage en général et sur le langage humain », Œuvres I, Paris, Gallimard.
BERDET Marc, 2014, Walter Benjamin, La passion dialectique, Paris, Armand Collin.
BONNEFOY Claude, 1964, Science et magie, Paris, Hachette.
MOSES Stéphane, 2006, L’Ange de l’Histoire, Paris, Gallimard.
NIAMKEY Koffi, 2019, Révolution et liberté, Paris, L’Harmattan.
CONDITIONS POUR UN EXCELLENT ENSEIGNEMENT À L’UNIVERSITÉ
Niali Armand-Privat PILLAH
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’université est l’un des lieux d’éducation en vue de procurer à la société ce dont elle a besoin pour sa prospérité. C’est la raison pour laquelle un enseignement de très bonne qualité s’avère nécessaire dans les établissements publics et privés. Pour que cet objectif soit effectif, il convient que les formateurs et les apprenants évoluent dans un environnement sain. Ce qui sous-entend que les infrastructures sont à la fois en nombre suffisant et adaptées aux défis du présent et du futur dans le respect des droits humains. Les enseignants-chercheurs ne peuvent vraiment donner le meilleur d’eux-mêmes que s’ils ont un salaire et des primes qui leur permettent de faire de sérieuses recherches : achats de documents, participation aux colloques nationaux et internationaux, conduites d’enquêtes sur le terrain, investigations scientifiques dans des laboratoires personnels, privés ou publics. Un autre facteur qui contribue au prestige de l’école et à la grandeur de la nation est d’octroyer régulièrement aux enseignants-chercheurs des bourses d’études à l’étranger afin qu’ils soient toujours connectés aux progrès réalisés dans le monde, dispensent des cours de très haut niveau et rédigent des articles et livres d’excellente qualité. C’est à ce prix que les universités africaines pourront, sans complexe, se mesurer à celles des pays dits développés et figurer parmi les meilleures du monde.
Mots clés : Bourse, Droit, Enseignant-chercheur, Étudiant, Excellence, Liberté, Salaire.
Abstract:
The University is one of the places where students get educated in order to preserve society’s human character and provide it with what it needs for its prosperity. This is why very good quality education is necessary in both public and private establishments. For this objective to be effective, trainers and learners must evolve in a healthy environment. This implies that the infrastructures are in sufficient number and adapted to the challenges of the present and the future, that respect for human rights is really observed. Teacher-researchers can only really give the best of themselves if they have a salary and bonuses that allow them to do serious research: purchase of documents, participation in national and international colloquia, conduct of field surveys, scientific investigations in personal, private or public laboratories. Another factor that contributes to the prestige of the school and to the greatness of the nation is to regularly grant teacher-researchers scholarships to study abroad so that they are always connected to the progress made in the world, give very high-level courses and write excellent quality articles and books. It is at this price that African universities will be able, without complex, to measure up to those of so-called developed countries and be among the best in the world.
Keywords : Excellence, Freedom, Right, Salary, Scholarship, Student, Teacher-researcher.
Introduction
La reconnaissance des universités et grandes écoles comme temples du savoir est une réalité mondialement admise. Mais elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Les classements d’ordre planétaire, continental, régional et national effectués chaque année[68], pour désigner les meilleures en leur sein, sont le témoignage qu’il existe entre elles une inégalité de rendement et de prestige. Leur hiérarchisation est motivée par plusieurs raisons dont celle-ci : permettre à tout pays de s’autoévaluer, c’est-à-dire de mesurer l’effort qu’il lui revient de fournir pour demeurer devant les autres nations ou réduire, combler totalement le retard qu’il accuse vis-à-vis de celles-ci ou encore pour les dépasser.
Cette compétition est prise très au sérieux, car l’école est l’un des facteurs clés qui permet de quantifier ou de qualifier le niveau de développement des États. C’est pourquoi les dirigeants politiques, consciencieux bâtissent des universités et grandes écoles qui relèvent, avec maestria les défis actuels et futurs de leurs patries, exhortent le secteur privé à les accompagner dans cette dynamique.
L’amour pour les établissements les plus performants est également une affaire des citoyens de toutes les stratifications sociales. C’est ainsi que les parents encouragent leurs enfants à étudier durement afin qu’ils soient orientés dans des établissements de renommée nationale ou internationale ou en vue de leur admission à des concours qui les introduiront dans certaines grandes écoles ou universités de références.
Suivre les cours dans ces hautes sphères du savoir entretient l’espoir d’être compté parmi les personnes qui ont le plus de chance d’être recrutées, au terme de leurs formations, par la fonction publique et, surtout, par une entreprise privée respectable, qui rémunère très bien ses salariés et les fait travailler aussi dans un environnement répondant aux normes du Bureau Internationale du Travail. La fréquentation d’un établissement d’excellence serait donc une clé qui ouvre les portes de l’emploi et garantit un avenir radieux (S. Dumoulin, 2013, p. 116). Pour réaliser ce rêve, des parents font d’énormes sacrifices en sollicitant, en dehors des heures de classe ordinaires, l’expertise de professeurs ou d’autres personnes, qu’ils payent à prix d’or, en vue du renforcement des capacités de leur descendance.
Qu’est-ce qui fait la particularité de ces temples exceptionnels de la connaissance ? L’élucidation de ce problème exige de nous la réponse aux questions suivantes : dans quels contexte ou cadre les étudiants sont formés dans les universités et grandes écoles ? Quel est l’indice de sécurité et du respect des droits de l’homme qui prévaut en leur sein ? Notre article a pour dessein de démontrer que l’excellence ne dépend ni du hasard ni de la subjectivité des citoyens lambda ni de la décision arbitraire des politiques mais elle est l’aboutissement d’un travail scientifique bien conçu et exécuté suivant des voies et moyens adéquats. Il y a donc des critères à observer scrupuleusement pour qu’une université ou une grande école soient acceptées dans le cercle actuellement très restreint des établissements dispensant un enseignement d’excellence. C’est le respect de ces conditions qui meuble notre réflexion relative aux solutions à la crise des universités en Afrique. Pour atteindre ce but, notre travail s’articule en deux axes. Le premier met en lumière les facteurs qui favorisent une très bonne formation théorique et pratique des étudiants, tandis que le second s’intéresse au rôle déterminant que jouent la sécurité et le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine dans la compétence et la considération des universités et grandes écoles. Les méthodes socio-historique, démonstrative et critique servent de fil conducteur dans l’argumentation de notre travail.
1. Contexte de la formation des étudiants
Dispenser des cours de qualité revient, avant tout, à dire que les enseignants ont non seulement le diplôme requis pour exercer leur métier mais aussi le niveau intellectuel convenable pour occuper leur poste. Il n’est donc pas normal que dans nombre d’universités et grandes écoles privées, hors-la-loi, travaillent des formateurs qui n’ont qu’un BTS, une licence, une maîtrise et qui, en raison de leurs lacunes de rendement, compromettent gravement et durablement une partie du destin de leurs pays, voire de l’Afrique. Bref, ils n’ont pas le diplôme universitaire officiellement reconnu, c’est-à-dire le doctorat, pour remplir efficacement les tâches qui leur sont confiées. En plus de dispenser des enseignements au rabais, ils dirigent, malheureusement, des mémoires de BTS et de Master.
La Côte-d’Ivoire est victime de ce genre de pratiques. Elle subventionne une grande partie des établissements supérieurs privés parce qu’elle y oriente certains nouveaux bacheliers. Les autorités ivoiriennes doivent mettre de l’ordre dans l’enseignement supérieur privé en incitant les fondateurs ou propriétaires des universités et grandes écoles à embaucher les milliers de docteurs qui sont, depuis des années interminables, à la recherche d’un premier emploi. Leur recrutement devrait être également déclaré à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et leur salaire sensiblement égal à celui de leurs collègues du secteur public.
Le recrutement des docteurs qui est plus qu’urgent indique nettement que l’élément central de la prouesse des établissements d’excellence est le corps des enseignants-chercheurs. C’est pourquoi, pour un enseignement de très bonne qualité, la première priorité à prendre en compte est la formation des futurs enseignants-chercheurs, depuis la première année d’université à la soutenance de la thèse de doctorat. Étant donné qu’il est quasiment impossible de détecter, dès leur entrée à l’université ou dans une grande école, les étudiants qui deviendront des enseignants-chercheurs, il est raisonnable et responsable de faire comme si tous les étudiants étaient de potentiels enseignants-chercheurs et de leur dispenser des cours d’un très haut niveau.
Pour que les enseignements ne soient pas au rabais, il est impératif qu’ils se déroulent dans le temps normal prévu et non en-dessous de celui-ci, faute d’amphithéâtres, de salles de travaux dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP). Par exemple, un cours de vingt-et-une heures ne devrait pas être réduit à cinq heures et un groupe de travaux dirigés ou de travaux pratiques qui est supposé compter vingt-cinq apprenants ne devrait pas en avoir soixante-quinze. Pourquoi le temps et le nombre sont, pédagogiquement parlant, si importants dans l’élévation intellectuelle des étudiants ?
L’une des raisons capitales est que la maquette pédagogique et l’emploi du temps universitaires ne s’établissent nullement au hasard et par n’importe quel individu, car cette tâche, pour une question d’efficacité et de scientificité, revient à des spécialistes (T. Dromard, 2011, p. 14) : ils savent le temps nécessaire, concernant telle ou telle matière, pour que l’enseignant-chercheur atteigne l’objectif de son cours, c’est-à-dire se fasse comprendre de façon satisfaisante par son auditoire. S’agissant de l’effectif des apprenants par groupe de TD ou de TP, les spécialistes de l’école n’ignorent pas non plus qu’au-delà d’un certain nombre d’étudiants le but initial poursuivi par le formateur ne peut être adéquatement atteint.
Pendant la manipulation du matériel d’apprentissage (microscopes, produits chimiques, cobayes, etc.), le temps et l’attention que consacre le pédagogue à chaque apprenant s’amenuisent car l’excès des personnes à sa charge nuit à la qualité de son travail. Les infrastructures consacrées aux cours jouent un rôle décisif dans la qualité de l’enseignement dispensé. Nous faisons, entre autres, allusion au bon fonctionnement des ampoules, des microphones et de la logistique dans son ensemble.
Une université ou une grande école qui ne possèdent pas de bibliothèque ou qui en ont une, mais celle-ci est pauvrement pourvue en matériels didactiques que requièrent les études supérieures peuvent être sûres de ne pas figurer parmi des établissements d’élites de leur pays. La bibliothèque, qu’elle soit physique ou numérique, est « le laboratoire, le terrain d’expérimentation des nouvelles formes d’écriture et de lecture » (F. Roche, 2013, p. 149).
Elles sont des réservoirs de savoirs qui viennent en renfort aux connaissances véhiculées par les enseignants-chercheurs, parce que bien que les objectifs de ceux-ci soient atteints à l’issue de leurs cours, ces enseignements ne se suffisent pas à eux-mêmes. L’étudiant ne peut donc tout apprendre auprès de ses encadreurs pédagogiques parce que telle n’est nullement la vocation des universités et grandes écoles qui lui enseignent ce dont il aura besoin pour s’orienter dans la vie avec assurance. Ce qui explique que même si Albert Einstein était considéré au départ comme un cancre car il « était lent et avait du mal à apprendre par cœur » (H. Prolongeau, 2007, p. 53), l’essentiel des connaissances qu’il a emmagasinées pendant son cursus scolaire et universitaire combiné à ses nombreuses et assidues lectures de sa vie de travailleur lui a permis de devenir « une légende vivante » (S. Veille, 2013, p. 44), le plus grand savant de tous les temps. La finalité des enseignements universitaires justifie l’usage des bibliothèques afin que les étudiants soient mieux outillés pour comprendre et critiquer le contenu des cours.
Si la bibliothèque est l’affaire de tous les étudiants, tel n’est aucunement le cas des laboratoires scientifiques qui concernent exclusivement les étudiants des sciences expérimentales[69]. L’absence d’instruments d’investigations dans ces disciplines ou le manque du minimum qu’exige un laboratoire scientifique pour former dignement les travailleurs d’aujourd’hui et ceux de demain excluent logiquement les établissements qui vivent cette réalité de la cour des grands. Par exemple, les cours de physique ou de chimie qui sont purement théoriques sont improductifs, car personne de sensé ne peut, aujourd’hui, fonder un espoir solide et durable sur le néant ou envisager de faire des pays africains des États émergents à partir du vide, du rien : les enseignants-chercheurs et les étudiants ne sont pas Yahvé qui, selon les chrétiens, a créé le monde et tout ce qu’il contient à partir de rien ou si l’on veut à partir de sa simple parole (Gen. I, 1-31).
L’absence de phase scientifique pratique est un véritable « poison », car elle frustre, démotive les enseignants-chercheurs et les étudiants. Dans le pire des cas, elle les pousse à s’expatrier pour travailler ou étudier dans de meilleures conditions (même en Europe et dans les autres continents, lorsque les critères pour travailler et étudier dans d’excellentes conditions ne sont pas réunis, nombre d’enseignants-chercheurs, de chercheurs, de thésards et d’étudiants s’exilent en vue de mener des activités dans un environnement plus accueillant et valorisant (J. Remy, 2009, p. 61-66). Cette réalité témoigne que prendre soin du matériel d’étude et de travail des universités et grandes écoles comme la prunelle des yeux est un devoir pour les laborantins, les étudiants, les chercheurs et les enseignants-chercheurs : par exemple, lorsque les étudiants détruisent ou volent le matériel de recherches, lors de leurs grèves, c’est à eux-mêmes qu’ils font du tort et pas vraiment au pouvoir politique qui ne se presse, généralement, pas de remplacer le matériel vandalisé, afin de les punir ou pour d’autres motifs.
Mais, les principaux responsables de l’état calamiteux des laboratoires sont les dirigeants politiques africains qui participent directement ou indirectement à la dévalorisation des formateurs et à la crétinisation des apprenants, quand ils n’incluent guère l’école dans la liste de leurs priorités gouvernementales ou lorsqu’ils n’appliquent point rigoureusement les objectifs éducationnels qu’ils se sont fixés. Il est ainsi primordial que ceux-ci sortent de leur laxisme, investissent massivement dans l’instruction des apprenants, du préscolaire au supérieur : la Chine et la Corée du Sud, qui étaient au même niveau de développement que la plupart des pays africains dans les années 1960, rivalisent actuellement avec les nations dites développées grâce au caractère tout particulier qu’elles ont accordé et continuent d’accorder à la locomotive de leur essor qu’est l’école.
La culture ou la tradition de l’excellence n’est donc pas due au hasard, à une génération spontanée, mais à une planification rigoureuse des gouvernants concernant l’école publique et des entrepreneurs s’agissant de l’école privée. À ce sujet, les pays africains ont l’obligation de s’inspirer de ce que les autres continents possèdent de bien et de beau pour se recréer, le devoir de copier ce que certains parmi eux réalisent d’admirable. Ils ont également la mission de ne pas se contenter de consommer ce qu’autrui leur exporte en proposant au monde leurs découvertes et inventions à envergure internationale ou universelle. Le groupe Université Centrale de Tunisie est l’un des fleurons de l’enseignement supérieur privé en Afrique. Sa compétence s’apprécie, entre autres détails, dans sa formidable collaboration avec le patronat : « Des programmes co-construits avec des employeurs mettent en adéquation les programmes de l’Université Centrale et les besoins du marché de l’emploi » (Jeune Afrique, 2017, p. 69). Cet établissement forme des étudiants qui n’ont pas vraiment peur de la période post-étude, puisqu’il leur garantit presqu’à cent pour cent un emploi au terme de leur formation.
Cette politique, qui accorde du prix à l’employabilité, prévient aussi les troubles sociaux liés au chômage et participe à la prospérité de la collectivité. Les relations entre l’école, l’État patronat et le patronat ne sont cependant pas parfaites car trop de diplômés formés par les institutions privées et publiques sont sans travail. Dans chaque discipline, les maquettes pédagogiques et les contenus des cours sont à modifier régulièrement, surtout en fonction du contexte historique et des besoins avérés du marché afin de former des étudiants et des travailleurs nationalement et internationalement compétitifs et employables.
S’agissant de la suppression de certaines filières estimées non opérationnelles[70], elles sont, généralement, victimes de préjugés défavorables dans la mesure où toutes les disciplines se valent. Le fort taux de sans-emplois et de chômeurs s’explique aussi par le retrait des investisseurs étrangers de certains pays africains ou la crainte de ceux-ci de s’y installer en raison de la corruption endémique, du terrorisme, des récurrents coups de force et des guerres civiles qui les handicapent.
Autrefois, les universités et grandes écoles étatiques étaient en phase avec les aspirations, les projets, les réalités nationales publiques et privées : cette osmose facilitait l’embauche des étudiants issus de celles-ci. Cependant, à un certain moment de leur développement, les nations africaines se sont subitement et tristement rendus compte des limites de leurs objectifs éducationnels, faute d’infrastructures suffisantes pour accueillir tous les bacheliers. Ce qui a nécessité la naissance des universités et grandes écoles privées (C. Marot, 2013, p. 43).
Pour être encore plus compétitifs, des établissements, qui n’appartiennent pas à des pays anglophones, jugent que l’une des conditions pour figurer parmi les universités et grandes écoles d’excellence est de dispenser tous leurs cours ou une partie de ceux-ci en anglais parce qu’il est la langue des affaires et de la mondialisation (S. Dumoulin, 2013, p. 116 et R. Kéfi, 2010, p. 29-30). Les établissements les plus audacieux font même venir d’éminents enseignants-chercheurs des meilleures grandes écoles et universités de la planète pour dispenser des cours à leurs étudiants. Parmi ceux-ci, se distingue l’African Institute for Mathematical Sciences-Next Einstein Initiative (AIMS-NEI) créé en Afrique du Sud par un cosmologiste mondialement respecté, Neil Turok. Ce centre s’internationalise car il ne cesse de s’implanter, çà-et-là, en Afrique et son fondateur est convaincu que, dans quelques dizaines d’années, « « ‘Le futur Einstein sera Noir » » (V. Gairin et O. Recasens, 2014, p. 122), c’est-à-dire originaire de l’Afrique subsaharienne.
À côté de la bataille des établissements qui fait rage, se signale, également, celle entre les étudiants qui a atteint son paroxysme dans la mesure où, pour avoir le plus de chance d’être recrutés, les apprenants s’efforcent, de plus en plus, d’obtenir les plus hauts et rares diplômes dans les meilleurs établissements (S. Dumoulin, 2013, p. 115-116), qui sont aussi les plus chers ou les plus difficiles d’accès par voie d’orientation ou de concours.
Pour remédier, partiellement, à la mort de l’État providence et au déficit d’investisseurs privés nationaux et étrangers, les pays africains encouragent, désormais, l’auto-emploi. Au Burkina Faso, par exemple, en 2008, avait débuté « un programme de formation à l’entrepreneuriat visant 5000 jeunes par an » (M. Devey, 2009, p. 64). Les meilleurs projets étaient récompensés par un crédit non assorti d’une quelconque garantie qui nécessitait néanmoins « un parrainage fourni par le fonds d’appui aux initiatives des jeunes » (M. Devey, 2009, p. 64). Par l’auto-emploi, le pouvoir politique reconnaît que les excellents projets et réalisations ne peuvent guère émaner uniquement de lui et des entreprises privées.
L’un des défauts de l’école contemporaine africaine, surtout francophone, est que la grande majorité des enseignants-chercheurs ne savent rien de l’entrepreneuriat, ignorent comment monter un projet de financement et ne comptent que sur leurs maigres soldes pour survivre parce qu’ils n’ont pas appris, à l’école, à s’auto-employer. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart de leurs grèves échouent : ils ne sont pas autonomes mais dépendent exclusivement de leurs salaires payés par l’État patronat et le patronat qui, parfois de façon arbitraire et illégale, refusent de les rémunérer pour « casser » leurs grèves.
Cette lamentable vérité montre bien qu’il est urgent que soit, du primaire au supérieur, enseigné aux apprenants à s’auto-employer, à compter d’abord sur eux-mêmes avant d’espérer recevoir quelque privilège que ce soit des employeurs. Ici, renaît le pouvoir politique de J. Locke qui n’a nullement pour rôle premier de créer des emplois mais de garantir le bien public ainsi que la liberté, la vie et les biens des gouvernés (J. Locke, 1965, p. 11, 49). Parmi les seconds rôles du pouvoir politique figurent l’instruction et l’embauche des citoyens (J. Locke, 2013, p. 25, 41).
Les Africains, principalement ceux qui sont démunis, sont des experts en débrouillardise et, tôt ou tard, grâce à leurs expériences théoriques et pratiques acquises dans une université, une grande école et dans la vie ordinaire, ils cesseront de tendre la main pour implorer l’aide d’autrui afin de se prendre eux-mêmes en charge. L’afro-optimiste et proche du fondateur de l’AIMS-NEI, Mamadou Sangharé, exprime très bien cette pensée : « ”Neil Turok a réveillé un rêve […]. L’Afrique est empêtrée dans des problèmes qui paraissent insurmontables, mais elle a pour elle sa jeunesse, son énergie et cette capacité à se débrouiller toute seule en toutes circonstances” » (V. Gairin et O. Recasens, 2014, p. 122) qui la feront sortir de l’abîme où elle se trouve présentement. L’abandon de l’amateurisme politique par les gouvernants, la réforme de l’école ainsi que le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, que réclame l’histoire actuelle de l’Afrique, participeront à la réalisation de l’indépendance véritable et de l’émergence de ce magnifique continent.
2. Droits de l’homme et exigence d’excellence dans les universités
Le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine est l’un des baromètres qui indiquent le degré de démocratie qui règne au sein d’une université ou d’une grande école et, par contrecoup, dans un État. Par exemple, enseigner ou suivre des cours dans un établissement donné sans avoir peur de critiquer objectivement et respectueusement ses étudiants, ses personnels technique, administratif et enseignant, le pouvoir politique en place, telle ou telle personnalité politique ou les personnes influentes du pays, de la région, du continent ou du monde entier, est un gage de sécurité relatif à la franchise universitaire. Cette liberté est également un frein à la dépression et favorise l’esprit de tolérance, le dialogue fraternel, l’épanouissement individuel et collectif ainsi que la saine concurrence entre les formateurs mais aussi entre les apprenants d’une même université ou grande école ou de différents horizons.
Le droit de manifester pacifiquement en vue de revendiquer ceci ou cela par une grève légale et légitime, un sit-in, une pétition, une marche ou par d’autres canaux, sans crainte de voir son salaire ou sa bourse suspendus, d’être exclu de la fonction publique ou de la structure publique dans laquelle l’on est apprenant, de l’établissement privé dans lequel l’on est étudiant ou travailleur ou de subir toute sorte d’intimidation verbale ou physique de qui que ce soit, est consubstantiel à la liberté d’expression, d’opinion et de pensée. Il crée notamment un climat de confiance et de respect entre les différents acteurs de l’école et participe au rayonnement de celle-ci. Tous les voies et moyens de lutte non violente qui prennent en compte le respect des droits de l’homme et la dignité de l’être humain sont comme un médicament en ce sens qu’ils guérissent l’école de ses maux, la déparasitent, la vaccinent contre les dangers qui la guettent.
Lorsque la violence injustifiée[71], orchestrée par les autorités politiques, les présidents, recteurs ou directeurs d’établissement, les personnels enseignant, administratif et technique, les étudiants et autres personnes, s’invite, dans le milieu universitaire, alors l’école se transforme en une bombe aux conséquences énormes. Une école caractérisée par la violence ne peut mettre au monde que des monstres, des adeptes de la force gratuite et irresponsable. Soro Guillaume et Eugène Djué sont quelques-uns des terroristes engendrés par l’anarchie scolaire et universitaire qui régnait, dans les années 1990, en Côte-d’Ivoire.
Soro Guillaume, par exemple, après avoir semé, en tant qu’étudiant, la terreur dans les secteurs de l’éducation ivoirienne (D. K. N’Goran, 2015, p. 117-128) a fini par attaquer son pays, à la tête d’une rébellion armée, le 19 septembre 2002 (K. Soro, 2005, p. 17-24, 81-113). Aujourd’hui, il est un fugitif parce que la justice de son pays a lancé un mandat d’arrêt international contre lui, l’accusant de malversation financière et de vouloir renverser le régime politique ivoirien en place. Quelle est l’importance de parler de celui-ci ici ? C’est tout simplement parce qu’il sert de mauvais exemple à certains jeunes qui ne jurent que par lui. De quoi il s’agit ?
Des jeunes gens sont persuadés qu’ils n’ont point besoin de faire de longues études ou d’aller à l’école pour réussir dans la vie dans la mesure où il est possible d’être jeune et d’occuper de hauts postes étatiques, de s’enrichir rapidement, d’être craint et respecté. En d’autres termes, ce ne sont pas vraiment les études universitaires qui ont permis à Soro de remplir les fonctions de député, de ministre, de premier ministre, de président de l’Assemblée nationale et de connaître une renommée internationale, mais la violence aveugle depuis son statut de secrétaire général national de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte-d’Ivoire (Fesci) à celui de chef de guerre sanguinaire. À dire le vrai, il n’a aucunement inventé la violence scolaire et universitaire ivoirienne mais l’a amplifiée, et la guerre civile qu’il « a créée » a aggravé la situation : la drogue circule à flot de l’école primaire à l’enseignement supérieur. Il en est, malheureusement, de même pour l’alcool.
Le résultat est qu’il y a de plus en plus d’écoliers, d’élèves et d’étudiants irrespectueux, paresseux et tricheurs qui croient pouvoir tout obtenir au moyen de la force verbale ou physique et de la ruse. C’est ainsi qu’il y en a qui courent même le risque de se faire remplacer par des « mercenaires », c’est-à-dire des condisciples ou autres personnes lors des examens. Cette triste réalité justifie la présence obligatoire des enseignants-chercheurs convoqués à la surveillance des épreuves écrites et pratiques des apprenants et la vérification de l’authenticité de leurs mémoires et thèses en vue d’éviter les plagiats. Chose plus choquante, c’est que parmi les formateurs se dénombrent notamment des tricheurs (C. Bonneau, 2008, p. 59). Les enseignants-chercheurs (les chercheurs aussi) trichent parce qu’ils rêvent de gloire, sont en quête d’une promotion (inscription sur une liste du CAMES, etc.), sont mis sous pression par les sources de financement de leurs recherches qui attentent d’eux des résultats rapides et concrets, principalement ceux qu’elles pourront exploiter, etc.
Les mauvais comportements au sein des établissements sont multiformes : sous prétexte de grève, des étudiants, par exemple ceux de la Fesci et du Comité des élèves et étudiants de Côte-d’Ivoire (CEECI) se permettent de détruire les infrastructures universitaires, empêchent l’accès des établissements à qui que ce soit et n’hésitent pas à chasser des amphithéâtres, des salles de TD et TP, des bureaux, la plupart du temps violemment, leurs condisciples et les enseignants-chercheurs. Quand les boursiers perçoivent leurs payes, ils les obligent, verbalement ou physiquement, de leur remettre une partie de celles-ci. La corruption et la violence qui caractérisent nombre de dirigeants politiques, de travailleurs ne débutent nullement quand ils commencent à occuper un poste politique ou à exercer un métier mais depuis leurs années d’études. Pour mettre complètement fin à la violence ou la réduire considérablement dans les structures universitaires, surtout que parfois des enseignants-chercheurs sont violents ?
Adresser, selon la gravité des forfaits commis, des avertissements verbaux ou écrits aux fauteurs de troubles (les étudiants, l’un quelconque des personnels ou les responsables des établissements). Les sanctionner aussi, objectivement, lorsque cela s’impose, car l’impunité conduit au libertinage et à la compromission de l’avenir de l’éducation et donc du futur du pays. Ne pas punir alors que la situation exige la condamnation du fautif, c’est s’illustrer comme son complice, un ennemi de l’excellence, principalement de la patrie. Une école d’excellence est, généralement, vue comme un havre de paix, un lieu qui inspire la confiance, garantit la sécurité et la justice en son sein et procure la joie d’enseigner et d’apprendre. C’est pourquoi, il est bien d’adapter l’école africaine aux réalités du XXIe siècle, à savoir installer des caméras dans les amphithéâtres, les salles de TD et de TP, les bureaux, les restaurants, la cour, etc., afin que les mouvements des uns et des autres soient identifiés, qu’on sache qui a posé tels ou tels actes immoraux. L’omniprésence des caméras dissuadera les personnes animées de mauvaises intentions de passer aux actes, c’est-à-dire de vandaliser l’espace universitaire, et permettra de démasquer aussi les responsables des dégâts et désordres causés afin de les sanctionner. Ici, se pose la question de la liberté et de l’intimité des individus.
Cette remarque est exacte, mais pour une question de sécurité collective, les libertés individuelles passent au second plan. Bien de rues, de magasins, de maisons d’habitation, d’aires de sports, d’aéroports, de cars, etc., sont équipés de caméras et cette disposition est logique : elle protège les biens, la liberté et la vie individuels ainsi que le bien commun. La fouille systématique des véhicules et de leurs occupants et des piétons aux entrées des universités et des grandes écoles renforcera, notamment, la sécurité, comme cela s’opère déjà dans des écoles américaines. C’est un puissant moyen de lutte contre la drogue, la circulation des armes, etc. et ceci sous-entend que les établissements sont clôturés. L’effectif des vigiles qui assurent la sécurité est, la plupart du temps, dérisoire. C’est la raison pour laquelle quand des manifestations hostiles au vivre-ensemble éclatent, ceux-ci n’interviennent pas pour faire obstacle au danger mais se cachent ou assistent, impuissants, au « spectacle ». Une révision à la hausse de leur nombre est donc recommandée : le recrutement pourrait se faire parmi les étudiants (les policiers, gendarmes, militaires n’ont le droit d’intervenir dans les universités et grandes écoles qu’en cas de raison d’État : prise d’otages, fusillades, graves affrontements entre étudiants, etc.). Toutes ces propositions d’ordre matériel ne constituent-elles pas des dépenses trop élevées pour l’État et les propriétaires des établissements privés ? Pas du tout : les grandes choses nécessitent d’énormes sacrifices et qui veut siéger dans la cour des grands doit mettre la main à la poche pour atteindre son objectif.
Un autre pan du succès des établissements très convoités est la crédibilité de leurs évaluations. En effet évaluer, consciencieusement, les travaux des étudiants conduit ceux-ci à étudier sérieusement, à ne compter que sur eux-mêmes et Dieu pour leur réussite universitaire et extra-universitaire, quand ils passeront des concours ou des tests pour leur intégration à la fonction publique ou leur recrutement dans une société privée. Travailler honnêtement et étudier comme il se doit reviennent à dire « non » au harcèlement sexuel des enseignants-chercheurs et des étudiants, à fuir la corruption en se contentant de son salaire, de sa bourse, de ce qu’on a en propre. Il est avilissant qu’un étudiant propose à un enseignant-chercheur de l’argent ou autre chose en vue d’obtenir, de lui, illégalement et illégitimement des faveurs. De semblables pratiques n’encouragent point à la culture de l’excellence mais ouvrent les portes de la prison, dévalorisent l’enseignant-chercheur mais aussi l’étudiant aux yeux de la société, clouent aux piloris la science, le mérite, l’émulation à l’honneur et à la justice et surtout la prospérité présente et future du pays.
Les étudiants, les enseignants-chercheurs et le pouvoir temporel sont perfectibles, à condition qu’ils s’écoutent mutuellement, de façon sincère et durable, et s’engagent franchement à mettre de côté leurs intérêts partisans pour ne considérer que le bien public. Si chaque camp s’arcboute sur sa logique, c’est-à-dire sur sa position, de façon radicale, alors on a affaire à un dialogue s’apparentant à celui de la tour de Babel. Pour échapper à ce type d’imbroglio, Christian Morel confie à Louise Cuneo :
Il faut se méfier de la logique ; elle n’est pas toujours fiable. Et il ne faut pas oublier que la logique des uns va parfois à l’encontre de celle des autres, alors même qu’aucun ne se trompe. Il peut s’agir, par exemple, de la confrontation de plusieurs rationalités. C’est le cas de la logique économique qui s’oppose à celle des cheminots de la SNCF. C’est toute la difficulté des négociations : il faut trouver des compromis entre des modes de raisonnements différents (L. Cuneo, p. 33).
Si les différents syndicats des enseignants-chercheurs s’unissent pour mener un même combat, si la concurrence insensée ne les conduit pas à casser, pour cause de jalousie, de sadisme, d’inféodation à l’État, à un parti politique ou à une structure de l’obscurantisme la grève raisonnable que planifie ou organise l’un quelconque des syndicats, alors les revendications des enseignants-chercheurs seront, en un temps record, couronnés de succès : le dialogue avec les autorités politiques sera apaisé et la trêve sociale un franc succès (cette réalité des choses est également valable pour les syndicats des étudiants).
La cherté actuelle de la vie est une sage conseillère qui recommande aux enseignants-chercheurs de faire preuve d’humilité afin de révolutionner leur existence. Effectivement le coût de la vie est tellement élevé que leurs salaires et accessoires de salaires sont largement insuffisants pour qu’ils subviennent, la tête haute, aux besoins de leur famille qui ne se limite pas à la famille nucléaire mais s’étend bien au-delà de la grande famille pour inclure des ressortissants de leurs villages respectifs. Il convient donc de relever leurs salaires et accessoires de salaires pour qu’ils s’occupent, comme il se doit, de leur famille et investissent suffisamment d’argent dans les achats de documents qui vont rehausser leur niveau intellectuel et, partant, celui des apprenants et la qualité de prestation des travailleurs du pays.
Ce changement de revenus leur permettra notamment de participer de plus en plus aux colloques nationaux et internationaux qui poliront en eux l’art de la discussion constructive et d’importer dans leurs universités, grandes écoles et nations les acquis ou expériences dont ils se sont enrichis pendant leurs contacts avec autrui. L’amélioration de leurs gains universitaires les poussera également à multiplier les enquêtes sur le terrain, à accorder une priorité inestimable aux investigations dans des laboratoires personnels, privés ou publics. Les résultats de leurs recherches, qu’ils mettront au service de leurs établissements, patries, régions, continents et du monde, apporteront un plus, un mieux être à l’humanité (malheureusement eux-mêmes et leurs travaux sont, la plupart du temps, méconnus du grand public). L’augmentation des salaires et accessoires de salaire sauvera de nombreuses vies au sein des enseignants-chercheurs des établissements publics qui décèdent, malheureusement, de plus en plus jeunes à force de stress, d’épuisement, de courir, par-ci par-là, pour travailler dans plusieurs structures privées éducationnelles afin de répondre présents aux exigences de survie de leur famille.
Conclusion
Les universités et les grandes écoles, publiques comme privées, sont uniques en leur genre parce qu’elles sont des « industries » qui enfantent, « fabriquent » les futurs présidents de la république, premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, savants, entrepreneurs, etc. À ce titre, elles sont indispensables à la stabilité et à l’essor des nations, surtout celles de l’Afrique qui aspirent à l’émergence. C’est la raison pour laquelle pour un enseignement de qualité, ces établissements ne doivent pas être seulement l’affaire des enseignants-chercheurs et des étudiants, mais aussi celle de l’État-patron, du patronat, des parents et de tous les autres acteurs du système éducatif.
D’autres facteurs non moins importants qui concourent au succès de ces temples du savoir concernent les conditions de travail des apprenants et des formateurs. Celles-ci doivent être le souci sempiternel de tout pouvoir politique et des propriétaires des établissements privés du supérieur car sans elles, rien de bon ne peut être enseigné ou appris : doter les universités et grandes écoles de toutes les infrastructures indispensables, tant en qualité qu’en quantité suffisante ; veiller au respect des volumes horaires des cours, des droits de l’homme et de la dignité humaine. La récompense objective des meilleurs établissements, enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants voire agents administratifs et techniques, quant à elle, stimule ces acteurs de l’éducation à toujours se surpasser dans une saine concurrence et contribue au rayonnement de leur pays. Les performances atteintes par ceux-ci deviendront, notamment, de plus en plus satisfaisantes à mesure que les salaires et accessoires de salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs seront en rapport étroit avec leur temps, c’est-à-dire avec les réels besoins qu’exigent leurs conditions d’existence.
Pour l’excellence à l’enseignement supérieur privé, il est raisonnable de ne plus permettre à n’importe quel individu ou groupe de personnes d’ouvrir un établissement, car avoir assez d’argent pour le faire ne suffit pas : les fondateurs ou propriétaires doivent être titulaires d’une thèse de doctorat, tout comme il est exigé d’être docteur en pharmacie pour être autorisé à posséder une pharmacie. Les docteurs sans-travail et désargentés pourraient faire appel à des actionnaires pour ouvrir leurs universités et grandes écoles.
Références bibliographiques
ATANGANA Ngono Vanessa, 2021, « L’Université du Rwanda entame un processus de suppression des filières jugées inadaptées au marché de l’emploi », in agenceecofin.com/formation/2105-88428-l-universite-du-rwanda-entame-un-processus-de-suppression-des-filieres-jugees-inadaptees-au-marche-de-l-emploi. Article publié le 21 mai 2021 à 15h01 et modifié le même jour à 20h13. Site consulté le 25 octobre 2022 à 02h45.
BONNEAU, novembre 2008, Cécile, « Quand les scientifiques trichent », in Science et vie, numéro 1094, p. 56-69.
CUNEO Louise, pas de date de publication, « Christian Morel : « L’Excès de règles mène à des décisions absurdes » », in Le Point hors-série, numéro 4, p. 33-35.
DEVEY Muriel, du 20 au 26 décembre 2009, « Aide-toi, l’État t’aidera », in Jeune Afrique, numéro 2554.
DROMARD Thiébault, 1er septembre 2011, « Décentralisation, le nouveau maître mot de l’école », in Challenges, numéro 266, p. 14-17.
DUMOULIN Sébastien, du 27 octobre au 9 novembre 2013, « Business school. Passeport pour la mondialisation », in Jeune Afrique, numéro 2755, p. 114-117.
GAIRIN, Victoria et RECASENS, Olivier, 20 mars 2014, « Le futur Einstein sera Africain ! », in Le Point, numéro 2166, p. 122-123.
Jeune Afrique, du 04 au 10 juin 2017, « Université Centrale », in Jeune Afrique, numéro 2943, p. 68-69.
KÉFI Ridha, septembre-octobre 2010, « Do you speak French [Parlez-vous français] ? », in New African. Le Magazine de l’Afrique, numéro 16, p. 28-30.
La Banque mondiale, 2014, « L’Avenir de l’Afrique passe par l’enseignement des sciences et de la technologie, affirment Paul Kagamé, président du Rwanda, et Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale », in banquemondiale.org/fr/news/press-release/2014/03/13/higher-education-in-science-technology-critical-for-africa-s-future-say-rwanda-s-president-kagame-wb-s-makhtar-diop. Article publié le 13 mars 2014. L’heure de la publication n’est pas mentionnée. Site consulté le 25 octobre 2022 à 02h00.
La Bible des communautés chrétiennes, 1998, trad. de HURAULT, Bernard et HURAULT Louis, Kinshasa, Médiaspaul.
LOCKE John, 1965, Lettre sur la tolérance, trad. de POLIN, Raymond, Paris, Quadrige / PUF, deuxième édition.
LOCKE John, 2013, Que faire des pauvres ?, trad. de BURY, Laurent, Paris, PUF, première édition.
LOCKE, John, 1977, Deuxième traité du gouvernement civil,trad. de GILSON, Bernard Paris, Librairie philosophique jean Vrin, seconde édition.
MAROT Christelle, octobre-novembre 2013, « L’enseignement public, un grand corps malade », in New African. Le Magazine de l’Afrique, numéro 34, p. 42-43.
N’GORAN David K., 2015, Les enfants de la lutte. Chronique d’une imagination politique à Abidjan, Abidjan, Nouvelles Éditions Balafons, première édition.
N’GORAN David, KLOINWHELE Koné et ADJOUMANI Élise Mia, 2014, « Côte-d’Ivoire-De « ‘la culture littéraire » à l’attention de M. Gnamien Konan, ministre de l’enseignement supérieur », in https://connectionivoirienne.net/2014/05/22/cote-divoire-culture-litteraire-lattention-m-gnamien-konan-ministre-lenseignement-superieur, Article publié le 22 mai 2014. L’heure de la publication n’est pas mentionnée, consulté le 25 mai 2022 à 01h15.
PROLONGEAU Hubert, 13 décembre 2007, « C’était des cancres », in Le Point, numéro 1839, p. 50-53.
REMY Jacqueline, du 14 au 20 février 2009, « Biologistes, mathématiciens, chimistes, physiciens, économistes. Mais où sont passés les cerveaux français ? », in Marianne, N°617, p. 60-66.
ROCHE Florence, 2013, « Quel avenir pour la bibliothèque en tant que lieu ? », in ROCHE Florence (sous la dir. de) et SABY Frédéric (sous la dir. de), L’Avenir des bibliothèques : l’exemple des bibliothèques universitaires, Presses de l’enssib, Première édition, p. 139-161.
SORO Guillaume, 2005, Pourquoi je suis devenu rebelle. La Côte-d’Ivoire au bord du gouffre, Paris, Hachette Littératures, première édition.
VEILLE Simon, mai-juin 2013, « Albert Einstein, science et conscience », in Historia (spécial), N°11, p. 42-47.
CINQUIÈME AXE : SYNDICALISME, POLITIQUE ET VIOLENCE À L’UNIVERSITÉ
Youldé Stéphane DAHÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Si l’apparition de la violence du système coïncide avec la crise du système, comme le soutient Yves Michaud dans Violence et politique, (1978, p. 111), autant affirmer que la violence politique et syndicale se trouve incrustée dans l’instrumentation sociale ; et ce, depuis l’avènement du multipartisme dans les années 1990 en Côte d’Ivoire. Cette effervescence politique a occasionné la création de nombreux syndicats, qui n’ont pas échappé aux manipulations politiques. L’acuité persistante de la violence dans l’instrumentation sociale universitaire s’explique, pour ainsi dire, par la fragilité des règles et la présence du non social au sein du social universitaire. La violence s’érige, dès lors, en élément normal du processus politique et syndical, et devient un moyen de contrôle dont l’emploi expose à des conséquences subsidiaires. Nous entrons, pour ce faire, dans une problématique instrumentale où la fin justifie les moyens. L’analyse de ce principe, aujourd’hui largement en vigueur, montre comment il peut couvrir des comportements conduisant à la violence. Ainsi, considérée comme une bêtise de la raison par Horkheimer, la violence politique et syndicale dans les universités ivoiriennes semble finalement s’auto-justifier comme un moyen efficace pour atteindre un objectif bien précis, celui des intérêts particuliers de chaque entité. Le présent texte s’intéresse de plus près aux causes de l’émergence de la violence politique et syndicale dans nos universités, mais aussi aux tentatives de solutions, en vue de, non seulement prévenir mais aussi de guérir cette crise existante et persistante depuis quelques décennies.
Mots-clés : Fin, Force, Moyen, politique, syndicat, violence.
Abstract :
If the appearance of the violence of the system coincides with the crisis of the system, as Yves Michaud maintains Violence et politique, (1978, p. 111), one might as well affirm that political and union violence is embedded in social instrumentation, and this, since the advent of the multiparty system in the 1990s in Côte d’Ivoire. This political effervescence has led to the creation of many unions, which have not escaped political manipulation. The persistent acuteness of violence in university social instrumentation can be explained, so to speak, by the fragility of the rules and the presence of the non-social within university social. Violence therefore sets itself up as a normal element of the political and union process, and becomes a means of control, the use of which exposes to subsidiary consequences. To do this, we enter into an instrumental problematic where the end justifies the means. The analysis of this principle, now widely in force, shows how it can cover behavior leading to violence. Thus, considered a stupidity of reason by Horkheimer, political and union violence in Ivorian universities finally seems to be self-justifying as an effective means to an end. This text takes a closer look at the causes of the emergence of political and union violence in our universities, but also at attempts at solutions, with a view to not only preventing but also curing this existing and persistent crisis for some time decades.
Keywords : End, Force, Means, Politics, Union, Violence.
Introduction
Notre époque est perturbée par les crises persistantes, notamment dans nos sociétés en général et dans nos universités en particulier. Depuis les années 1990, qui marquent l’ère du multipartisme dans la quasi-totalité des États africains, notamment en Côte d’Ivoire, on relève un regain effrayant de violence dans les universités ivoiriennes. Cette crise est profonde, car elle implique non seulement celle de la confiance en la politique nationale, qui porte à la fois sur son sens et sur ses capacités, mais aussi celle des structures syndicales (celles des enseignants et des étudiants) qui est confrontée à une crise plus globale. C’est une crise de la normativité, c’est-à-dire des valeurs susceptibles de nous orienter dans notre vie individuelle et surtout collective, en nous imposant des fins dignes d’être poursuivies. Il faut ajouter à tout cela, la dégradation des comportements politiques collectifs et individuels (corruption, ambition, mensonge, haine des uns contre les autres, rivalité) etc. Ce qui est le plus effroyable, c’est le sentiment à la fois d’absurde et d’impuissance qui habite toutes les parties (États, syndicats et tout le monde universitaire) face à cette violence dont ils sont les principaux acteurs. Cette violence des uns contre les autres est celle qui se justifie dans la problématique de la fin et des moyens qui serait la seule violence absolument bonne éthiquement ; puisque plaçant au-dessus de tout intérêt particulier, celui de la nation. Machiavel (1972, p. 8) s’interroge en ces termes :
la politique est action et l’action tend à la réussite. Si la réussite exige l’emploi des moyens moralement répréhensibles le prince doit-il renoncer au succès ? Se salir les mains ? Sacrifier le salut de son âme au salut de la cité ? Ou s’arrêterait-il sur la voie qu’il ne peut pas ne pas emprunter ?
Pour lui, le choix est clair : « un prince ne doit se soucier aucunement d’être traité de cruel si l’unité et la fragilité de ses sujets sont en jeu ». (N. Machiavel, 1972, p. 86). C’est pourquoi, pour établir et maintenir cet ordre et cette paix, tous les moyens sont bons. C’est sans doute cette perception machiavélienne de la politique qui jette implicitement les bases d’une violence orientée et calculée. Laquelle a motivé le choix de l’analyse de ce sujet portant sur : « la fin et les moyens, conséquence de l’autojustification de la violence politique et syndicale dans les universités ivoiriennes. » Au regard de ce sujet, on pourrait déduire que la politique ne vise que le pouvoir en lui-même et sa conservation. Il y est donc question de réussite qui devient la fin de la politique, et peu importe les moyens employés pour faire advenir un ordre social meilleur. Au cœur du débat contemporain sur la violence perpétrée par les politiques sur les syndicats ou par les syndicats sur les syndiqués et les infrastructures étatiques dans les universités ivoiriennes, la perception machiavélienne de la question semble dès lors la mieux indiquer pour tenter de situer les responsabilités et de résoudre cette question épineuse. À cet égard, qu’est-ce que la violence ? Quelles sont les causes et les conséquences de l’émergence et de l’escalade de la violence dans les universités ivoiriennes ? En d’autres mots, pourquoi nos sociétés (étudiants, enseignants, le gouvernement) éprouvent-elles le besoin de se rapporter à elle-même par le biais de la notion de violence, avec sa charge émotive, ses menaces, ses craintes ou ses espoirs ? Et quelles sont les solutions ?
À travers une méthode historique et analytique, nous élaborerons ce sujet en trois parties : nous partirons des approches définitionnelles de notions aux origines de la violence politique dans nos universités. Nous parlerons de la perception machiavélienne de la violence et de ces implications sur l’environnement universitaire et nous aborderons dans la troisième partie les éventuelles solutions préventives et curatives.
1. De la définition de la violence et des conditions sociopolitiques de son émergence dans les universités ivoiriennes
1.1. De la définition de la violence
« La violence est définie au sens étroit, comme un comportement visant à causer des blessures aux personnes ou des dommages aux biens ». (Y. Michaud, 1978, p. 14-15) La force, quant à elle, est un concept plus général. Nous la définissons comme l’usage actuel ou potentiel de la violence pour forcer autrui à faire ce qu’autrement, il ne ferait pas. La force comme la violence peut être jugée bonne ou mauvaise. Force et violence sont donc des concepts étroitement liés. La force implique la menace, et non l’usage actuel de la violence. La violence a les caractères de la force si elle est utilisée pour modifier l’action d’autrui. Comme on peut le constater à travers cette définition, référence est faite à des comportements assignables aux atteintes physiques aux personnes et aux destructions des biens. La distinction faite entre force et violence exclut les évaluations qui lient à la force un caractère ordonné et organisé, contrairement à la violence qui serait un simple désordre. De manière générale, cette définition a une double fonction à savoir, redresser l’unilatéralité des jugements historiques en donnant toute son extension au champ de la violence et constituer le préalable à des investigations historiques et sociologiques sur la violence et ses causes dans une situation donnée : celle des universités ivoiriennes. Il nous revient d’évaluer le volume de violence politique et les types de groupes impliqués dans nos universités. On passe donc d’une définition opératoire à une définition précise et théorique qui implique du coup toute une évaluation de l’étendue du phénomène.
Ainsi, « à bien des égards, les interprétations multiples qu’on peut donner de la violence, ses représentations, sont aussi des faits qui font partie intégrante de sa réalité ». (Y. Michaud, 1972, p. 23). Après ces définitions indispensables, examinons les traits pertinents ou les causes de l’émergence de la violence politique et syndicale dans les universités ivoiriennes.
1.2. Des causes ou des conditions de l’émergence de la violence politiques et syndicale dans les Universités ivoiriennes
Aujourd’hui, c’est avec regret qu’on parle de la violence politique et syndicale dans les universités ivoiriennes. En effet, ce qui semble caractériser la notion proliférante de ce problème, c’est qu’on ne sait pas trop ce qu’il convient d’en dire d’autre, d’autant plus que les problèmes sont devenus informulables et l’humanité ne semble plus se poser que ceux qu’elle ne sait pas résoudre. Très souvent, ne constituant pas un problème objectif (maladie à guérir, solution à trouver), la violence dans nos universités doit faire l’objet d’une question : pourquoi nos sociétés (étudiants, enseignants, le gouvernement) éprouvent-elles le besoin de se rapporter à elle-même par le biais de la notion de violence, avec sa charge émotive, ses menaces, ses craintes ou ses espoirs ? Cette question mêle indissolublement réalité d’un social violent et aspiration de la violence de ce social. En parlant de la violence, nous parlons du politique contemporain et de son étrangeté. Les causes principales de l’émergence de la violence politique et syndicale dans les universités ivoiriennes sont de deux ordres : structurel et politico-managériales.
Du point de vue structurel, il faut relever que les objectifs et les orientations des universités sont mal élaborés. Le système LMD (Licence Master Doctorat), imposé par les autorités politiques, ne répond pas aux attentes parce que les moyens financiers et même d’ordre structurel de sa pleine mise en œuvre ne sont pas dégagés. L’administration universitaire nage donc à vue, essayant de vouloir sauver un système qui, lui-même, est mort-né. Il faut noter au-delà de tout cela, le manque criard d’infrastructures, et il n’y a aucune politique prévisionnelle ou anticipative.
Du point de vue politico-managérial, il faut relever que la survenance de la crise se trouve dans le non-respect des promesses faites et de certains engagements pris par les gouvernants relativement aux revendications syndicales. Toutefois, il y a dans la position de chaque partie, une volonté manifeste d’affirmation de son hégémonie. La leçon qu’on pourrait tirer est que tout politicien est un peu ‘‘machiavélique’’ (qui fait usage des pratiques immorales pour atteindre ses objectifs) puisque, comme le dit M. Weber, (1963, p. 103), « jamais, pour atteindre nos buts, nous n’avons à employer seulement des moyens conformes à nos volontés de valeur ». Pour Weber, l’homme politique ne doit pas hésiter à faire usage des moyens de répression et de dissuasion nécessaires. L’État étant une entreprise rationalisée, la politique vise avant tout la puissance. Envisager l’action dans cette seule perspective ne peut que conduire à des difficultés parfois insurmontables, tant il est évident que toute politique concrète vise l’impossibilité de traiter toujours son semblable en fin et jamais en moyen. C’est pourquoi, lorsque les positions sont tranchées et qu’il n’y plus de dialogue entre les entités, on débouche inéluctablement sur la violence parce que les intérêts sont en jeu. En somme, retenons que l’homme politique est en effet nécessairement amené, au cours de son action, à combiner les moyens et à calculer les conséquences.
Toutefois, du point de vue des syndicats, cette répression, considérée comme conséquence des moyens calculés, est un abus de pouvoir, une intimidation, car ne pouvant honorer ses engagements et ses devoirs vis-à-vis du peuple. Or, le peuple ne désire rien d’autre que de jouir de sa liberté, de ses biens, de bénéficier de la sécurité sociale et d’un cadre de travail adéquat. Ainsi, s’il a besoin d’un gouvernement, comme le dit P. Valadier, (1972, p. 94), « c’est dans la seule mesure où celui-ci peut garantir la jouissance de ses libertés essentielles ». C’est pour cela qu’une fois que ces prérogatives sont considérées comme secondaires (pas prioritaire de leur point de vue) par l’État, et qu’il ne trouve pas un cadre de dialogue et d’échange pour aborder calmement ces questions qui fâchent la plupart du temps les syndicats, on aboutit à des manifestations violentes. La violence devient pour ainsi dire le moyen indiqué pour exprimer leur mécontentement et le mode le plus expressif pour aboutir à l’obtention de leurs revendications. Cependant, Machiavel pense que la politique est instauration de la loi, là où cette dernière n’est pas. Mais en réalité, est-ce parce qu’il n’y a pas de loi ou de règles établit qu’il y a désordre ou violence dans l’université ? Non !
En notre sens, c’est le refus de se conformer aux lois et règlements qui entraînent à la violence parce que l’autre voit ses droits méprisés. Alors, si nous nous en tenons aux dires de (J. F. Duvernoy, 1978, p. 103), « l’acte propre de la politique n’est donc pas, aux yeux de Machiavel, la mise en œuvre de la volonté de puissance, mais l’instauration de la citoyenneté médiatisée par l’obéissance à la loi ». Il faut comprendre à travers cette pensée, que la fin dernière de tout État chez Machiavel, c’est d’assurer la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Mais quelle est la perception machiavélienne de la violence politique ?
2. De la perception machiavélienne du concept de la violence et de son impact dans l’environnement universitaire
2.1. De la perception machiavélienne de la violence
De quelque côté que l’on aborde Machiavel, il y est aussitôt question de politique, de sécurité, de défense et de paix sociale. En effet, rien ne le préoccupe qui ne soit appelé par sa réflexion sur la politique. Véritable homme politique, il nous permet de comprendre le rapport qu’il établit entre la question de la violence et celle des moyens employés pour atteindre une fin, qui sont des problèmes majeurs de notre vie politique et sociale. Et comme le temps qui nous sépare des premières années du XVIe siècle n’a pas rendu caduques les questions énormes qui l’habitèrent, il nous semble nécessaire à travers ce sujet, et ce par les concepts qui nous permettent de penser aujourd’hui l’univers politique, de placer Machiavel parmi ceux qui instaurèrent notre modernité. L’enjeu est en effet de montrer que l’auteur du Prince ne s’en tient pas à un tableau pessimiste de la vie sociale et politique, mais de mettre l’accent sur l’option populaire de la politique qui est un thème central de la pensée politique de Machiavel. Ce qu’il met en évidence, c’est la fonction du conflit comme changement historique. Nous pouvons donc établir un lien entre le conflit social et la dynamique politique. Ainsi, la lucidité de Machiavel réside dans sa manière de désigner le conflit comme ineffaçable. L’enseignement de Machiavel au tour du conflit révèle en quelque sorte une structure de l’histoire que l’on pourrait énoncer ainsi que le fait mentionner S. Auditer (2005, p. 254) « tout projet politique qui vise l’affranchissement total de la domination et de l’élimination de la classe dominante, conduit inéluctablement à la création d’une division sociale ».
Pour lui, comme le soutient S. Auditer (2005, p. 177), « toute politique en quête de légitimité doit s’appuyer sur le peuple ». Cela sous-entend que le pouvoir politique est déterminé certes, mais n’est pas pour autant dévolu au peuple. Car il revient au prince de mettre en place des mécanismes de l’exercice politique des droits politiques dans la cité en vue de résorber toute éventualité. Mais comprenons que, chez Machiavel, la fin du monopole n’est pas un retour à une sorte de concurrence parfaite comme s’il existait une loi du milieu. Avec lui, il ne faut pas exclure la violence de l’arène politique et de la société. Elle doit être perçue comme un moyen d’action, capable de nous plonger dans un continuum d’autres moyens. Ainsi, pour Y. Michaud, (1978, p. 67), « elle doit faire l’objet d’un management ou d’une stratégie qui en évalue la responsabilité différentielle selon les objectifs et les circonstances ». Cela voudrait dire que c’est dans sa maniabilité que réside sa différence. On parlerait ici de la notion de stratégie.
En effet, cette notion a un sens strictement militaire qui signifie « emploi de la bataille pour gagner la guerre » (Y. Michaud, 1978, p. 69). Elle a pris d’autres proportions considérables à savoir, « l’art d’employer la force pour atteindre les objectifs que se fixe la politique, et a fini par renvoyer à toute conduite d’opération en vue de certains résultats » (Y. Michaud, 1978, p. 68). Il en résulte qu’il ne subsiste plus dans nos sociétés que l’idée d’un agencement calculé de moyens en vue de fins. Nietzsche, de son point de vue, a toujours soutenu que la force brute et la cruauté sont autant d’expressions de l’énergie vitale qui fait goûter l’ivresse de la vie ; et que vivre, c’est essentiellement dépouiller, blesser, violenter les faibles et l’étranger, l’opprimer, et à la limite lui imposer durement ses formes propres, l’assimiler ou tout au moins, l’exploiter. Refuser la violence, nous explique le philosophe Allemand, c’est « nier la vie ». Cette optique est également celle de Carl Schmitt, pour qui une société sans violence, sans ennemis et sans guerre est une société morte. La violence acquiert particulièrement une fonction vitale lorsqu’elle est associée à la défense de la nation. De nombreux militants ethno-nationalistes justifient leur recours aux armes par un discours vitaliste selon lequel, celui qui ne lutte pas est précisément celui qui est en train de mourir.
L’usage de la violence devient pour ainsi dire une nécessité pour exister et s’affirmer non seulement comme un homme libre, mais comme un homme vivant. Toutefois, la force peut être l’un d’eux, mais elle n’est pas indispensable. En définitive, retenons que du point de vue de Machiavel, la violence n’est plus un accident de la vie politique, mais un instrument que tout acteur rationnel (État, syndicat) peut envisager d’utiliser.
La politique n’est pour ainsi dire, rien d’autre que la violence poursuivie par d’autres moyens. Lorsqu’elle est utilisée ouvertement, elle fait l’objet « d’un usage maitrisé et calculé qui n’est plus seulement l’affrontement d’adversaires visant la destruction mais un jeu contrôlé » (Y. Michaud, 1978, p. 69). Il apparaît ainsi d’une part, que tous les moyens se valent et n’ont de différence que d’efficacité selon les situations ; d’autre part, la violence semble avoir perdu son caractère sacrilège et sa charge d’incertitude : il revient de la gérer précautionneusement. À cela, comme soutient S. Auditer, (2005, p. 90) « Weber n’a jamais dit ni pensé que la fin ne justifie tous les moyens ». Car il y a des moments où l’autonomie de l’éthique de la conviction et de l’éthique de la responsabilité doit disparaître. C’est pourquoi, dit-il, « si la politique est l’art du possible, il faut souvent tenter l’impossible pour atteindre le possible ». (S. Auditer, 2005, p. 90). Toutefois, malgré les précautions prises dans la gestion de la violence, elle laisse des impacts très souvent négatifs sur notre société.
2.2. L’impact de la violence dans l’environnement universitaire
La stratégie de la vie politique intérieure reste un jeu contrôlé et payant tant que les adversaires partagent des critères communs concernant le coût de la violence et ses bénéfices aussi bien politiques que syndicales. On pourrait dire qu’il y a, en ce sens, un salaire à la violencepuisque chacun l’emploi par certaines manifestations (l’émeute, le soulèvement, le terrorisme) qui peuvent être des moyens efficaces pour imposer des concessions. Et comme le dit Y. Michaud, (1978, p. 80), « une stratégie de la violence peut aboutir à des compromis ».
Le compromis se présentant comme une solution de raison qui vient de la violence et qui correspond à un équilibre dans le conflit, tenant compte des divers calculs des deux adversaires. On est donc ici face à une interaction. Nous pensons, à cet effet, que l’usage calculé de la violence à très souvent un impact réformiste de la société. On assiste à une banalisation de la violence, puisqu’elle se présente désormais comme l’instrument du réformisme.
Que ce soit l’État ou les syndicats, il y a des formes de marchandages qui sont entrecoupés de violation intermittentes de la légalité, qui finissent par faire partie du visage normal du processus politique. Ainsi, « tout conflit se retrouve transformé en marchandage décidé entre des acteurs aussi raisonnables que résolus qui calculent comme des épiciers » (Y. Michaud, 1978, p. 80). On assiste donc à l’introduction d’une nouvelle forme de communication politique dans notre société, qui banalise la violence sous prétexte qu’il n’y a jamais que des forces qui s’affrontent sur des revendications justifiées qu’ils essaient de présenter vigoureusement. L’État et les syndicats déplorent la violence, mais marchandent, calculent à leurs avantages, et cela au détriment des réalités socio-existentielles des populations.
En somme, notons qu’à vouloir domestiquer la violence en l’introduisant dans le processus politique et syndical, on court des risques qu’elle échappe aux règles. Que ce soit donc dans la direction d’une homogénéisation des moyens d’action politique ou syndicale qui se valent tous, ou dans celle de l’usage maitrisé de la violence, ce qu’il importe, c’est sa neutralisation ou mieux, son désenchantement. Mais quelles solutions préconiser ?
3. Des solutions préventives et curatives durables au règlement des violences syndicales dans nos universités
3.1. Des solutions préventives durables
Face à cette agressivité émergente, évanouissante et réelle dans les universités, il ne reste plus qu’à repenser tous les contours du système politique, du système syndical et éducatif de notre pays. Il faudrait un peu plus de contrôle culturel qui la maîtriseront, car « la violence n’est pas ce qui se réprime mais ce qui s’endigue d’abord et se prévient ensuite » (Y. Michaud, 1978, p. 120). Mais on pourrait se demander pourquoi soigner la violence, mieux, comment soigner la violence ? L’objectif est-il de faire marcher les États ? De rendre les hommes heureux ? De quel bonheur s’agit-il ?
Voilà en réalité autant de questions qui n’ont rien de scandaleux ; car elles prennent en compte la gestion technique du social. En effet, il y a longtemps que la théorie sociale a montré la voie au nom de l’objectivité, au désenchantement de la violence dont nous avons suivi les manifestations dans nos universités depuis plus d’une décennie. Ce que nous pensons comme solution, c’est de penser et concevoir le social comme économie de la violence, c’est-à-dire de mettre un système de règlement des divergences des points de vue entre l’État et les syndicats. Cela favorisera la circulation de la violence et la rendra à la fois marginale et centrale dans le processus politique.
En fait, l’État qui est le garant de l’unité, de la paix et de la stabilité sociale, est dans la nécessité de disposer de plusieurs moyens, autre que la violence pour le contrôle social. Il peut soit procéder par une incitation économique, c’est-à-dire régler toutes les revendications liées aux finances posés par les syndicats, régler les problèmes d’infrastructures, qui sont très souvent les causes principales des agitations sociales. L’État doit chercher à persuader par l’influence, c’est-à-dire faire en sorte de convoquer ou initier des plates-formes d’échange entre le gouvernant et les syndicats d’enseignants, des étudiants et du personnel administratif, et cela même s’il n’y a pas de crise. Il revient enfin à l’État de contraindre par le pouvoir, car le dernier mot lui revient. Et si comme le dit Y. Michaud (1978, p. 160),
Toute incitation fonctionne sur la base générale de l’intérêt, on obéi aux prescriptions parce que l’on attend une contrepartie économique; a persuasion fonctionne sur la base du consensus et il y a obéissance parce que les acteurs partagent un certain accord sur les valeurs, les règles ou les représentations de la société.
Dans une telle représentation du social, on peut y discerner une présence de la violence ; mais celle-ci sera toujours marginalisée, étouffée et circonscrite parce que tous ces acteurs y trouvent leurs intérêts. C’est ce que fait observer Machiavel en ces termes : « En toute cité on trouve ces deux humeurs diverses : cela vient de ce que le peuple désir ne pas être commandé et ni opprimé des grands, et les grands désirent commander et opprimer le peuple » (N. Machiavel, 2000, p. 94). Et de ces deux appétits divers naît dans la cité, un des trois effets à savoir, le principal ou la liberté ou la licence. Cela dit, le peuple universitaire et ses organes (syndicats) ne sont pas oppresseurs ; puisque leur désir ne heurte personne. Ceux qui ont à charge d’assurer, par contre, cette jouissance, sont en position dissymétrique par rapport à lui. Ce sont eux qui, à travers l’exercice du pouvoir tirent parti de cette situation pour satisfaire leurs propres intérêts, à savoir opprimer le peuple les étudiants. On entre donc dans une problématique instrumentale où la fin justifie les moyens.
L’analyse de ce principe largement en vigueur dans la société, montre comment il couvre toute une gamme de comportement des gouvernants, sans toutefois savoir quelles solutions proposent-ils pour endiguer cette violence dans les universités. Pour les syndicats, c’est l’amélioration des conditions de vie et du travail. Au-delà de cette analyse des solutions préventives durables, qui nous permet de connaître ce qui est voulu de part et d’autre, la perspective est donc celle d’un compromis rationnel en vue d’un choix rationnel des moyens pour le règlement des différends. D’où l’analyse des solutions curatives durables, susceptibles de mettre fin au monopole réglé de la violence perpétrée par les différentes entités (État et syndicats) dans nos universités.
3.2. Des solutions curatives durables
Pour Y. Michaud (1978, p. 120), « la violence n’est pas ce qui se réprime mais ce qui s’endigue d’abord et se prévient ensuite ». Il faut donc dans le maintien de l’ordre, renforcer la sécurité. Ce qui nécessite la mise en place d’un nouveau contrôle et du quadrillage de la vie sociale. Il faut de ce fait un retournement normal de cette vie, c’est-à-dire le recours à l’éducation à la citoyenneté, susceptible de créer ou d’engendrer des citoyens disciplinés et respectueux des lois, afin de créer la sécurité sur l’espace universitaire. Au-delà de cette éducation à la citoyenneté, il faudrait une formation au syndicalisme. En effet, le syndicalisme n’est pas du banditisme, encore moins un moyen pour laisser libre cours à toutes ses pulsions et instincts « animales ». Il se présente comme un fait social et politique que représentent l’existence et l’action des syndicats. Cette action syndicale est composée de deux objectifs que tous les syndiqués doivent connaître : il s’agit de la défense du salarié et de l’activité de gestion qui s’exerce en marge de l’activité professionnelle. Et la loi permet aux syndicats de mener à bien des actions revendicatives qui s’exercent au niveau interpersonnel. Si donc la loi autorise les actions syndicales, c’est dire aussi que la loi prévoit des balises pour éviter ou prévenir tout débordement très souvent lié à l’ignorance et à la mauvaise formation des syndiqués sur les principales fonctions des syndicats. Ces fonctions sont au nombre de trois (3).
Garantir les droits des salariés, exprimer les revendications et les protestations, mais également permettre le dialogue social entre l’État, le patronat et les salariés. Les syndicats doivent donc être conscients de cette lourde responsabilité qui consiste à unifier les syndiqués au sein des groupes sociaux pour la défense des intérêts collectifs. Cela exige d’eux une autre mentalité de lutte, s’ils espèrent obtenir des résultats probants. Cela implique que la fin soit mise au monopole réglé de la violence perpétrée par les différentes entités (État, syndicats) pour un bon fonctionnement durable de nos universités. Faire en sorte qu’il ne s’introduise plus sur le champ universitaire, les violences individuelles, si nous admettons que l’équilibre naît de la concurrence. Or, si la puissance se présente comme « la possibilité de prendre des décisions indépendantes » (J. Houssiaux, 1958, p. 65) dans une situation de concurrence parfaite, plus personne n’aurait de puissance et la guerre serait incertaine de tous contre tous. Mais comment mettre fin définitivement à ce monopole qui n’est pas forcément le retour à une concurrence parfaite entre l’État et les syndicats ?
Le constat fait, est que la répression indistincte qui s’abat très souvent sur la population à la suite de quelques troubles fait apparaître la lutte ‘‘armée’’ des syndicats comme une légitime défense. Or, une répression modérée et sélective isole ce que l’information officielle pourrait appeler une poignée d’aventuriers. Cela signifie qu’il existe sur le champ politique des imperfections structurelles dans la gestion de la société non seulement, mais dans celle des Universités et dans la collaboration avec les différents syndicats. C’est pour cette raison que le contrôle administratif, la menace répressive et très souvent la pression idéologique exercée soit par l’État, soit par les syndicats des différentes entités, doivent faire l’objet d’un management ou d’une stratégie, capable d’évaluer la rentabilité des différentes entités selon les objectifs visés. La désillusion est peut être grande, mais nous pensons qu’il est possible de sauver encore quelque chose de cette conceptualisation de la violence, si l’état civil devient de plus en plus rationnel et proscrit de son sein toute sorte de violence dans l’optique d’un changement politique. La violence, certes joue un rôle important dans les changements politiques ou dans la conservation du pouvoir comme l’ont fait remarquer Aristote et Machiavel. Mais, même si elle constitue un élément central de l’action politique, nous ne devons pas faire de cette violence un instrument normal d’action politique.
Conclusion
Le principe même d’une instrumentalisation désenchante toutes les actions qui peuvent intervenir dans sa réalisation, et seul le sérieux des fins peut réintroduire des différences. Ainsi, cette thèse selon laquelle « la fin justifie les moyens » bascule du côté de la pure et simple justification de la puissance par son triomphe, ou de la violence par son efficacité politique. C’est justement sur cette efficacité politique que Machiavel fonde tout son combat qui est de défendre et de conserver la nation dans la paix. Or, dans cette politique de conservation de la nation, se justifie celle de sa pacification et du maintien de la paix en son sein. Ce maintien de la paix passe aussi par le règlement des crises qui minent l’Université. Pour Machiavel, au terme de cette réflexion, même s’« il y a deux sortes de conflits, qui se règlent : les uns par un débat, les autres par la violence » (N. Machiavel, 1998, p. 128), il faut toujours privilégier le premier puisqu’il est particulier à l’homme. L’autre lui est commun aux bêtes ; il ne faut recourir au second que s’il est impossible d’employer le premier. Toutefois, vouloir domestiquer la violence en l’introduisant dans le processus politique et syndical, expose au risque du désordre, à l’anarchie. C’est pourquoi, le politique doit créer un cadre de dialogue inclusif de toutes les couches universitaires et répondre aux attentes du corps enseignant qui ne demande rien d’autre que de disposer de moyens et un cadre agréable pour travailler.
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 1972, La crise de la culture, Paris, Gallimard.
AUDITER Serge, 2005, Machiavel, Conflit et liberté, Paris, Éditions l’EHESS.
BELLA BALDÉ Mamadou, 2008, Démocratie et éducation à la citoyenneté en Afrique, Paris, L’Harmattan
DUVERNOY Jean François, 1974, Pour connaitre la pensée de Machiavel, Paris, Éditions Bordas.
GAILLE-NIKODIMOV Marie, MÉNISSIER Thierry, 2006, Lecture de Machiavel, Paris, Éditions Ellipses.
GAZOA Germain, 2006, Les conflits en Afrique noire, Abidjan, Frat-Mat Éditions.
HOUSSIAUX J., 1958, Le Pouvoir du Monopole, Paris, Sirey.
MACHIAVEL Nicolas, 2000, Le Prince, Trad. Marie Gaille-Nikodimov, Paris, LGF.
MICHAUD Yves, 1978, Violence et politique, Paris, Édition Gallimard.
SKINNER Quentin, 2000, Machiavel, Paris, Seuil.
VALADIER Paul, 1996, Machiavel et la fragilité du politique, Paris, les Éditions du Seuil.
WEBER Max, 1965, Essai sur la théorie de la science, Paris, Plon, Traduction Française.
WEBER Max, 1963, « Le métier et la vocation de l’homme politique », in Le savant et la politique, Trad J. Freund, Préf. R. Aron, Paris, Plon.
LA DÉMOCRATISATION DES LIBERTÉS CHEZ MARX : UNE PROPÉDEUTIQUE À LA PACIFICATION DE L’ESPACE UNIVERSITAIRE IVOIRIEN
Jean-Joel BAHI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Plusieurs universités ivoiriennes connaissent des perturbations parce que certains droits de l’homme ne sont pas toujours respectés. Cette situation est désobligeante et conduit quelques fois à la réaction de syndicats et associations qui défendent l’intérêt de leurs membres. Dans cette perspective, la philosophie marxienne, maintes fois exploitée par les mouvements syndicaux comme modèle à penser des luttes révolutionnaires, est souvent résumée à l’usage de la violence. Et pourtant, une analyse plus approfondie des écrits de Marx, à partir des méthodes historique et critique, nous permet de montrer que l’usage de la violence n’est pas la première des solutions aux diverses revendications. A contrario, la démocratisation des libertés humaines qu’ils promeuvent doit être privilégiée, car elle constitue un recours fondamental à la pacification du monde et particulièrement du milieu universitaire ivoirien.
Mots clés : Afrique, Démocratie, Droits de l’homme, Liberté, Pacification, Syndicat, Université, Violence.
Abstract :
Several ivorian universities are experiencing disruptions because certain human rights are not always respected. This situation is derogatory and sometimes leads to the reaction of unions and associations that defend the interests of their members. From this perspective, Marxian philosophy, repeatedly exploited by trade union movements as a model for thinking about revolutionary struggles, is often summed up in the use of violence. And yet, a more in-depth analysis of Marx’s writings, based on historical and critical methods, allows us to show that the use of violence is not the first solution to the various claims. Conversely, the democratization of human freedoms that they promote must be privileged, because it constitutes a fundamental recourse to the pacification of the world and particularly of the ivorian university environment.
Keywords : Africa, Democracy, Human Rights, Freedom, Pacification, Union, University, Violence.
Introduction
Un spectre hante les universités ivoiriennes : le spectre de la violence. C’est un phénomène qui prend plus d’ampleur et inquiète non seulement les acteurs directs de l’enseignement supérieur (enseignants, étudiants, administration), mais également les pouvoirs publics, la société civile et même les partenaires nationaux et internationaux. Le phénomène de la violence n’est ni nouveau ni un tabou. Il s’inscrit d’ailleurs dans la suite des nombreuses crises socio-économiques et géopolitiques que connaissent la plupart des pays du monde, crises qui affectent les droits de l’homme et plus particulièrement les libertés académiques. Malheureusement, il est difficile de situer réellement les responsabilités lorsque les acteurs du système se rejettent mutuellement la faute du cycle de violence. Pour les autorités académiques et même politiques, les premiers mis en causes sont les associations d’étudiants et les syndicats d’enseignants. En revanche, sans nulle doute, inspirés par certaines grandes figures révolutionnaires comme Marx et Engels qui, dans le Manifeste du parti communiste (2010, p. 9-17), « ont admis dès son origine l’hypothèse du recours à la violence fondatrice contre la violence quotidienne de l’exploitation capitaliste et des inégalités sociales », certains syndicalistes estiment qu’en Côte d’Ivoire « quand les gens revendiquent leurs droits sans violence, il n’y a jamais de solutions » (ASCAD, 2019, p. 104). Cela suggère que ceux qui s’inspirent des idéologies révolutionnaires comme celle de Marx pour manifester, se justifient par l’idée que s’exprimer par la violence est une arme indispensable pour avoir des résultats. Et pourtant, Marx est mort il y a bien longtemps, le communisme a du mal à se développer et le libéralisme est de plus en plus triomphant en Afrique. D’où vient le mal qui occasionne tant de violence dans nos universités ?
Au demeurant, il nous faut relire Marx, car au-delà de la révolution violente dans ses écrits, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales chez lui, ne constitue-t-il pas un levier important que nous pourrions privilégier pour penser un monde où la violence est réellement réduite ? Pour cette contribution, notre objectif en utilisant les méthodes historique et critique est d’identifier d’une part les causes de la violence sur l’espace universitaire ivoirien et d’autre part, analyser le sens de ce phénomène et montrer en quoi la démocratisation des libertés chez Marx pourrait contribuer à une pacification du monde en général, et de l’espace universitaire en particulier.
1. Les causes académiques et socio-politiques de la violence dans les universités de Côte d’Ivoire
1.1. Des problèmes liés à l’institution universitaire
Depuis les trois dernières décennies, les universités ivoiriennes sont en proie à la violence pour plusieurs raisons non exhaustives. Entre autres, il existe des problèmes liés au fonctionnement interne des universités. Ces problèmes sont en rapport à l’inadéquation entre la masse galopante d’étudiants et les infrastructures d’accueil. Les étudiants qui étaient de 235.902 en 2018 sont estimés à 253.955 en 2019[72]. Cela suggère qu’avec la forte demande de formation à l’université, les amphithéâtres, les salles de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP) deviennent de plus en plus insuffisants. Ces problèmes constituent l’objet de manifestations car, les conditions de travail et d’étude non aisées avec cette insuffisance d’infrastructures, ne permettent pas l’obtention de meilleurs résultats. C’est le lieu de rappeler que cette situation n’est pas singulière à la Côte d’Ivoire. Marx en parlait déjà dans Le Capital en faisant allusion aux élèves qui étaient entassés dans les salles de classe, ce qui ne facilitait pas la transmission du savoir, même pour l’enseignant le plus compétent et passionné. À ce sujet, le philosophe révolutionnaire affirme que les écoles « ressemblent à des offices sans foyer ni poêle. L’encombrement de ces espaces de trous en empeste l’air » (K. Marx, 2018, p. 315). En d’autres termes, les effectifs pléthoriques dans les salles de cours soumettent les apprenants et les enseignants à des pressions atmosphériques qui influencent négativement les neurones et augmentent les niveaux de tension de part et d’autre.
À cette réalité, s’ajoute une insuffisance de communication entre responsables académiques et étudiants, surtout lorsqu’il s’agit d’appliquer des décisions qui pourraient menacer les droits ou bouleverser le cursus des apprenants. Par exemple, dans les années 1990, les étudiants ont mené des grèves pour annuler le système de « la propédeutique » (ASCAD, 2019, p. 65), une sorte de tronc commun avec plusieurs matières (Latin, Philosophie, Sociologie, etc.). Bien que ce système ait participé à une bonne formation des étudiants d’alors, la communication autour de son importance n’a pas certainement été assez expliquée aux étudiants, qui après leur orientation dans les différentes filières voulaient voir leur vœu se réaliser.
La violence n’est pas que manifeste avec les étudiants. Le phénomène s’observe également chez les enseignants et les responsables de l’institution universitaire. Durant les vingt dernières années, les syndicats d’enseignants ont mené des protestations souvent violentes pour revendiquer certains droits. En conséquence, pour rétablir l’ordre sur les campus, les autorités académiques ont dû faire « appel à la police (…) pour faire régner le calme » (ASCAD, 2019, p. 59). Cette violation de la franchise universitaire par les responsables premiers de l’institution universitaire n’était certainement pas la meilleure manière de résoudre le problème des enseignants. Bien plus, elle a toujours augmenté les tensions et cristallisé les relations entre l’administration et les enseignants. Autrement dit, l’intrusion des forces de l’ordre sur le campus pour contenir la violence physique ou morale lors des manifestations est souvent contreproductive lorsque la communication entre les parties n’est pas établie pour anticiper sur les crises à venir.
Aussi, en définissant la violence physique comme une atteinte à l’intégrité de l’individu (coups et blessures) et la violence morale comme l’ensemble des paroles ou des attitudes (injures, moqueries) portant atteinte à la dignité de l’être humain, on peut noter que le phénomène n’est pas rare entre enseignants et étudiants. Entre ces différentes entités, la violence se présente comme un abus de la force ou de l’autorité afin de soumettre l’un ou l’autre. En effet, la méthode magistrale dans l’enseignement met en rapport le maître (qui soumet) et l’apprenant. Si dans les pratiques traditionnelles, le maître soumettait par la chicotte l’enfant dans le scolaire, on peut remarquer que dans l’enseignement supérieur, plusieurs enseignants ont fait subir des humiliations aux étudiants, au nom du rapport « Maître-étudiant » : hormis les harcèlements, leur dignité d’être humain est souvent piétinée et leurs droits parfois ignorés. Mais avec l’évolution des droits de l’homme et la promotion des droits de l’enfant, on assiste à un renversement de situation où ce sont les étudiants désormais qui semblent devenir les « maîtres » : refus d’exécution des ordres, embuscades, et « séquestrations » (ASCAD, 2019, p. 144) constituent leur mode opératoire.
Toutes ces formes de violence entraînent des grèves qui conduisent au dysfonctionnement de l’administration. Ainsi, on assiste à un blocage des années académiques qui ne s’achèvent pas ou qui s’achèvent dans des conditions difficiles. Ces situations font qu’il n’y a pas réellement de vacances pour certaines universités car, à peine une année universitaire achevée, une autre reprend avec l’application immédiate de nouvelles mesures venues « d’en haut (…) en direction du bas » (Hegel, 1999, § 290). Ce sont des mesures recommandées par les autorités de la tutelle via la gouvernance des universités et qui doivent s’appliquer absolument en pleine année académique. Ces dispositions, même avec de bonnes intentions qui promeuvent l’excellence et la qualité des offres de formation dans l’enseignement supérieur, délétèrent souvent fois les relations entre enseignants, étudiants, administrateurs et autorités politiques, parce que n’ayant pas fait l’objet d’une communication suffisante. Il n’est donc pas incongru d’affirmer que les causes de la violence dans les universités ivoiriennes sont à rechercher aussi bien du côté de l’institution universitaire que de l’autorité politique.
1.2. Les causes socio-politiques de la violence dans les universités ivoiriennes
L’État est l’autorité politique qui détient les pouvoirs de décisions. Et comme tel, il a une grande responsabilité dans les crises d’ordre social et politique qui minent les universités ivoiriennes.
Sur le plan social, il revient au gouvernement de garantir le bien-être social, c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie et de travail aussi bien des enseignants que des étudiants. D’ailleurs, pour Bakary Tio Touré, ancien Recteur de l’université de Cocody, « la première cause de la violence en milieu universitaire n’était rien d’autre que des revendications sociales » (ASCAD, 2019, p. 60). Autrement dit, il existe des mécontentements qui virent à la violence parce que enseignants et étudiants accusent l’État de ne pas jouer son rôle en respectant ses engagements lorsqu’il s’agit d’argent à débourser. Si les étudiants entreprennent des grèves pour des bourses en retard, Komenan Aka Landry, ancien Président de l’université de Bouaké (1994-2009), confirme bien l’idée suivante : « C’est pour les heures complémentaires qu’en fin d’année les enseignants font généralement la grève. Le budget est insuffisant alors que les enseignants veulent qu’on leur verse la totalité de leurs sous » (ASCAD, 2019, p. 60). Ces propos confirment, dans un premier temps, l’idée que c’est bien l’État qui décide de ce qui est prioritaire dans son programme d’investissements. Dans un second moment, ils montrent qu’en dépit des efforts effectués par les autorités gouvernementales, l’insuffisance du budget alloué à l’enseignement supérieur pourrait faire l’objet d’interprétation. Cette insuffisance répétée des moyens financiers peut donner l’impression d’un manque d’attention ou de valorisation de l’enseignement supérieur. C’est pour réclamer leurs droits que des manifestations souvent violentes sont organisées pour contraindre l’autorité étatique à améliorer les conditions d’existence.
Sur le plan politique, deux problèmes entreliés retiennent notre attention : la question de la liberté et celle de la politisation du milieu académique. Relativement à la liberté, M. A. Montclos, (2002 p. 22) pense que les pères de la Nation ivoirienne n’avaient pas envisagé « l’université comme un espace de liberté et de créativité [mais plutôt comme un] lieu d’encadrement social ». Cela veut dire que l’espace universitaire devrait être tout simplement le lieu de formation des élites du pays et non celui des grèves. L’université n’était pas non plus le lieu de former des opposants pouvant perturber la gouvernance du parti unique. Or, le vent de la liberté et de la démocratie se faisait déjà sentir. C’est ce vent de liberté et de démocratie qui a favorisé par ailleurs la politisation des universités. Aussi bien les associations d’étudiants que les syndicats d’enseignants ont été inféodés aux partis politiques. Pour l’enseignant syndicaliste Johnson Kouassi Zamina (ASCAD, 2019, p. 105), « le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (MEECI) était affilié au parti politique du pouvoir », c’est-à-dire le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) ; « la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) était proche de l’opposition politique », le Front Populaire Ivoirien (FPI) ; l’Association générale des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (AGEECI) était fortement lié au parti le Rassemblement des Républicains (RDR). Des alliances se sont créées si bien que le Syndicat National des Enseignants du Supérieur (SYNARES) soutenait la FESCI de telle sorte que « les revendications sociales débordaient toujours le cadre universitaire pour atteindre toute la société ivoirienne » (ASCAD, 2019, p. 61).
Notons que la politisation du milieu académique a favorisé la naissance de plusieurs mouvements estudiantins et syndicats d’enseignants créant ainsi des oppositions et un problème de leadership pour le contrôle de l’espace universitaire. Il s’en est suivi des périodes de violence sans précédent. Le lynchage à mort de l’étudiant Thierry Zébié en 1991 et les brutalités policières suivies d’emprisonnements d’étudiants observés par la suite dans les cités universitaires en disent long. Mais quel sens peut-on donner à l’usage de la violence dans les universités ivoiriennes ?
2. Analyse de la violence sur l’espace universitaire ivoirien
2.1. La violence comme une protestation et une modalité communicationnelle.
Si pour Marx, la violence en elle-même comporte des vertus édificatrices et s’impose comme le moteur de transformation des conditions de vie, il est aussi vrai qu’elle s’impose davantage comme une modalité communicationnelle entre les mains de tous les acteurs du système universitaire. Dans le Manifeste du Parti communiste, K. Marx et F. Engels (2010, p. 62) lançaient : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » Cet appel à fédérer les forces n’a pas été sans conséquences dans les luttes revendicatives qui ont été parfois émaillées de violence. La violence est aussi devenue pour les universitaires un moyen de communication.
Pour F. Delepierre (1969, p. 29), utiliser la violence dans les revendications, c’est contester une situation donnée, c’est « défier toute rigidité idéologique, lutter contre la sclérose de chaque institution. Remettre en question, suivre le mouvement d’une révolution permanente (…) entre quelques privilégiés, les décidants et la masse, qui est exécutante ». Les revendications violentes visent à braver la tyrannie des autorités, ce qui est établi comme idée doctrinale, ce qui ne peut plus faire évoluer une situation et se constitue même en obstacle à l’évolution, voire à l’épanouissement des individus. Elles répondent au message de la violence envoyé par les autorités elles-mêmes. Autrement dit, qu’elle soit physique, verbale, économique ou psychologique, la violence naît d’abord d’une situation elle-même violente. Elle n’est jamais innocente au sens marxien du terme dans la mesure où face aux revendications du prolétariat, la bourgeoisie a maintes fois opposé une fin de non-recevoir et réprimé violemment les masses ouvrières.
Il en est de même dans les universités ivoiriennes où face à la menace de l’autorité, face à la radicalité des autres, ceux qui usent de la violence estiment être en légitime défense pour préserver l’intérêt général de leur groupe ou de leur corporation. Il s’agit de faire prévaloir la justice sociale sur l’injustice. Devant une oreille non attentive naît des frustrations accumulées qui laissent place à la violence pour contraindre l’autre à prendre en compte ses attentes : un avatar de la communication s’installe. À partir de cette forme d’expression, un message est transmis par les différents acteurs opposés pour attirer l’attention sur des problèmes vitaux.
Relativement aux étudiants, plus enclins à l’usage tous azimuts de la force, Paul N’Da (ASCAD, 2019, p. 16) estime que « les demandes des étudiants, aussi bien matérielles, académiques que sociale, théâtralisées par des actions violentes, affichent néanmoins une revendication de dignité : ces jeunes veulent qu’on compte avec eux et sur eux… ». Cela signifie qu’en utilisant la violence, les étudiants passent un message qui ne serait pas perçu dans d’autres conditions plus paisibles pensent-ils. Ils constituent une masse à considérer dans l’institution universitaire. Ce qu’ils souhaitent, c’est le respect de leurs droits : ils souhaitent être consultés et donner leur opinion quant aux décisions qui concernent leur vie académique. On comprend qu’avec eux, la violence est une arme qui garantit non seulement l’attention des autorités administratives et politiques à leurs différents problèmes, mais elle est également un message qui intime l’ordre de composer désormais avec la masse estudiantine.
Avec cette manière de poser les problèmes pour se faire entendre, la violence semble marquer une rupture du dialogue entre les acteurs qui s’opposent temporairement. On pourrait penser que la violence surtout physique intervient lorsque le verbe et l’argumentation perdent leur sens : ils n’arrivent plus à convaincre l’autre en face. Or, il n’en est rien. Bien plus, la communication est maintenue dans « un échange qui prend une autre allure » (ASCAD, 2019, p. 13). Dans cette nouvelle allure, les acteurs opposés perdent le sens et le fil de la communication verbale pour faire valoir ce dont ils sont convaincus et qui les conduira à une gestion négociée des difficultés ressenties à l’université ou dans la société en général.
Cette analyse de la violence montre qu’il y a une nécessité de renforcer la communication puisque c’est par elle que des solutions aux problèmes posés finissent par être trouvées. Aucune des parties n’est assez forte pour imposer aussi longtemps son dictat aux autres. Il faut savoir privilégier une attitude pacifique lorsque la possibilité est donnée. Marx s’inscrit dans cette dynamique même si la caricature de sa pensée semble donner une lecture erronée de l’usage de la violence.
2.2. D’une lecture erronée de la violence chez Marx
Il est indéniable que Marx est l’un des pères fondateurs avec Émile Durkheim de la sociologie des conflits. Et pour lui, le remède aux conflits sociaux se trouve dans la révolution voire dans la dictature du prolétariat. Dans cette perspective, certains auteurs se sont présentés comme des disciples de Marx. D’autres en sont allés au-delà. Friedrich Engels, Lénine, Mao Tsé-toung, Rosa Luxembourg en sont les parfaites illustrations. En Afrique également, des universitaires, des panafricanistes comme Kwamé Nkrumah, des écrivains de la négritude tels que Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor se sont inspirés des idées de Marx pour prôner un socialisme africain, arme d’une revendication des libertés africaines et d’une réhabilitation de l’image du noir.
Malheureusement, on peut constater que bon nombre des lecteurs, de disciples ou de continuateurs de Marx se sont adonnés à une caricature de sa pensée, précisément celle touchant à l’idée de violence. Par exemple, pour Jacques Attali, Lénine se trompe lorsqu’il fait à la fois de la violence une chose durable et une arme pouvant aider les hommes à changer coûte que coûte la réalité ambiante. J. Attali (2014, p. 505) nous rappelle que pour Marx, la violence « est le règne provisoire d’une large majorité, qui représente le droit des gens, la liberté des gens, la liberté de la presse, les partis d’opposition et la séparation des pouvoirs ». Contrairement à Lénine qui est favorable à l’instauration d’un régime de terreur continue contre tous les opposants politiques, Marx pense que l’usage de la violence ne doit pas perdurer. En prenant le pouvoir politique, le prolétariat doit veiller au respect des droits des gens et à la séparation des pouvoirs qui garantissent la justice entre les membres de la société. Dans un autre passage fort édifiant de son ouvrage, Jacques Attali nous montre que lors d’une interview accordée à un journaliste suite à une question que celui-ci lui posa sur les formes démocratiques de la violence, Marx répondit : « la révolution est inutile en situation démocratique » (J. Attali, 2014, p. 380). C’est là, sans doute, l’une des raisons fondamentales qui nous amène à considérer Marx non comme un révolutionnaire qui n’agit que par la violence, mais comme un philosophe ouvert à la démocratie.
Ces propos de Marx montrent que la révolution violente n’est menée que là où il y a absence de liberté et de démocratie, notamment dans les États tyranniques et dictatoriaux. Il est important de noter que Marx a eu des étapes dans sa propre maturation intellectuelle. Il est certes d’abord révolutionnaire, mais il est épris de liberté et des valeurs démocratiques. Même s’il ne réduit pas la démocratie au jeu électoral, il y adhère lorsque les conditions d’égalité de chance et de liberté sont réunies. C’est pourquoi, chez Marx, l’option d’un engagement dans le jeu électoral se fera au cas par cas. Dans les pays impérialistes où les capitalistes ne sont pas favorables à la démocratisation des libertés, c’est-à-dire la libre expression des masses populaires, il faut trouver d’autres moyens pour faire entendre la voix de la masse et faire bouger les lignes. Les masses ouvrières constituent la force de travail qui est au fondement de la production industrielle. Il faut donc permettre qu’elles s’expriment au risque qu’elles se révoltent violemment pour renverser l’ordre ancien défavorable à leur épanouissement. Dans ce contexte, si « à partir de formules concises, populaires qui passent pour résumer sa pensée » (H. Lefebvre, 1966, p. 31), Marx est mal compris sur la question de la violence, une relecture de sa philosophie sur les libertés et la démocratie pourrait contribuer à penser la pacification de la société et particulièrement des universités ivoiriennes.
3. La démocratisation des libertés chez Marx : une approche pour pacifier l’espace universitaire ivoirien
3.1. Les enjeux de la démocratie et de la liberté à partir de Marx
La démocratie, c’est-à-dire le gouvernement qui donne le pouvoir au peuple de décider, occupe une place déterminante dans le philosopher marxien. Dans le Manifeste du parti communiste, K. Marx, et F. Engels (2010, p. 44) invitent la classe prolétarienne à aller à « la conquête de la démocratie ». La quête permanente de la démocratie est la condition sine qua non pour arracher la liberté et les droits de l’homme confisqués par une minorité dominante. L’importance de la démocratie chez Marx (le philosophe et journaliste) est suscitée par les difficultés qu’il rencontre avec l’État prussien, notamment la censure de ses articles et les différents moments d’exil qu’il connaît. Ces moments difficiles, constituent entre autres événements, les raisons de son intérêt pour la liberté, d’où son adhésion à la démocratie. Ce que Marx revendique dans cette démocratie aussi radicale soit-elle, c’est la liberté de presse, la liberté des débats parlementaires, l’indépendance de l’État à l’égard de la religion. Dans ses différents ouvrages, notamment Le Manifeste du parti communiste, Les luttes de classes en France, La guerre civile en France, Sur la commune de Paris ou Sur la question juive, une lecture défaite de tous préjugés nous fait redécouvrir un Marx épris de liberté et de justice, fondement de la démocratie. La démocratie, à travers ses principes universels de liberté et de transparence qu’elle suggère est pour Marx, l’occasion de dénoncer l’exclusion dont certaines classes sociales sont victimes par exemple en France. À ce sujet, K. Marx (1994, p. 238) révèle : « la petite bourgeoisie dans toutes ses catégories ainsi que la classe paysanne étaient complètement exclues du pouvoir politique ». La liberté d’expression et le respect des principes démocratiques ont longtemps été violés par une minorité qui détient le pouvoir d’État. Et parce que, petits bourgeois et masses paysannes constituent une menace pour la minorité dominante bourgeoise, il faut donc les empêcher de prendre le pouvoir politique.
La valeur de la démocratie et de la liberté d’expression réside ainsi en ce qu’elle permet aux masses ouvrières, de donner libre cours à leurs opinions sans qu’elles en soient inquiétées par un pouvoir politique quelconque. Qui plus est, ces droits doivent être garantis par l’État puisque pour K. Marx (2006, p. 40), « l’État est le médiateur entre l’homme et la liberté de l’homme ». En d’autres termes, le pouvoir politique doit jouer son rôle en donnant la possibilité aux hommes de s’exprimer librement sur les problèmes qui minent leur société.
En faisant un parallèle avec la Côte d’Ivoire, cela voudrait dire que la démocratie et la liberté d’expression doivent constituer le moteur de la vie universitaire. L’existence de plusieurs associations d’étudiants ou syndicats d’enseignants n’est pas une occasion de les politiser, mais de permettre leur libre expression dans un environnement qui se veut démocratique. L’université est un milieu intellectuel qui doit aider à sortir les peuples de l’obscurantisme par le respect des principes démocratiques et des libertés publiques. À ce sujet, K. Marx, (2006, p. 8) nous dit ceci : « nous devons pour notre part mettre le vieux monde en pleine lumière et travailler positivement à la formation du nouveau ». Les pratiques d’intimidation, la mauvaise gouvernance et l’injustice doivent être dénoncés et c’est par la liberté d’expression que cela reste possible. Le nouveau monde à construire, c’est celui de la justice, celui d’un État véritablement démocratique où la liberté des universitaires et la souveraineté des peuples sont réaffirmées et participent à la pacification du milieu académique.
3.2. Des conditions pour pacifier les universités ivoiriennes
Il n’est pas exagéré de dire avec K. Cyrille (2017, 4ème de couverture) que « la violence, qui sans être nouvelle menace aujourd’hui dangereusement l’humanité) ». Elle met péril tous les efforts de construction et de développement réalisés par des générations de travail. En s’invitant dans le milieu universitaire, elle devient ainsi l’objet d’une réflexion qui mérite que des solutions soient proposées pour limiter au maximum le phénomène qui devient de plus en plus complexe et inquiétant.
Les crises de violence dans les universités ivoiriennes ne sont en rien à l’avantage du pays, car elles compromettent l’avenir des générations présentes et futures et ralentissent tous les progrès. Pour éviter de sombrer dans le cycle infernal de la violence, il faut mettre l’accent sur l’éducation continue des étudiants, la formation syndicale des enseignants et le respect des droits de l’homme avec un accent particulier sur la liberté d’expression. Au-delà des enseignements, l’éducation continue des étudiants nécessite de définir un rapport bien précis entre apprenants et enseignants.Ce rapport ne doit pas être celui d’« une relation hiérarchique propre à maintenir les « enseignés » dans une situation de soumission » (D. Lochack, 2014, p. 255-261) ni l’occasion d’une dictature des apprenants. Bien au contraire, les termes d’« enseignant » et d’« étudiant » doivent prendre tout leur sens dans le strict respect des uns et des autres. C’est pourquoi, il faut une éducation continue et une sensibilisation importante à ce niveau. Cela passe par la promotion de certaines valeurs : le don de soi, l’humilité, le respect de l’autre, l’objectivité et la promotion de l’intérêt général.
Relativement aux enseignants, l’accent doit être mis sur la formation syndicale et politique pour une approche non violente des revendications car, cette formation fait énormément défaut. J. Attali (2005, p. 380) insiste pour signifier que chez Marx « une insurrection serait une folie là où l’agitation pacifique peut tout accomplir avec promptitude et sureté ». Il serait inconséquent d’user de violence où la discussion et la liberté d’expression sont garanties. Certes, les luttes sont nécessaires pour arracher des droits, mais il est aussi possible de revendiquer sans violence et d’obtenir des avantages. On peut observer cette possibilité avec le Protocole d’accord portant trêve sociale 2017-2022 entre les centrales et faitières des organisations syndicales et le gouvernement de Côte d’Ivoire. Même si cet accord n’est pas satisfaisant pour tous les enseignants, il a tout de même permis d’avoir des acquis, notamment l’instauration d’une prime exceptionnelle de fin d’année représentant le tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base ; la revalorisation de l’indemnité de transport des fonctionnaires et agents de l’État ; la revalorisation des allocations familiales et la revalorisation de l’indemnité contributive au logement.
S’il est vrai que ce sont très souvent les conditions de vie et de travail qui constituent l’objet de grèves ou de manifestations violentes dans les universités, il est donc nécessaire d’adopter une attitude d’anticipation sur les crises à venir en privilégiant la communication entre l’État, les responsables administratifs, les enseignants et étudiants. En respectant les droits des uns et des autres, ces différents acteurs créent les conditions d’un climat apaisé et d’une université redynamisée et compétitive.
Conclusion
En somme, on peut observer que la violence est inhérente aux êtres humains, elle semble avoir un caractère multiforme et multiséculaire, latent tel un volcan au repos et qui peut se réveiller à tout moment. Cependant, elle peut être également maîtrisée car, les hommes sont doués de raison. À ce titre, les enseignants, les étudiants, les responsables académiques et le gouvernement qui partagent la responsabilité de la violence sur l’espace universitaire, peuvent savoir raison garder et faire prévaloir le respect de la dignité humaine pour le règlement apaisé de tout conflit dans une société qui se veut libre et démocratique. Quels que soient les problèmes qui gangrènent nos universités, il existe des possibilités de les résoudre avec le bon sens. Autrement dit, la radicalité des positions doit désormais faire place à la flexibilité et au consensus. L’objectif est de faire prévaloir la liberté d’expression, le respect des principes démocratiques et de créer toutes les conditions nécessaires pour la quiétude dans les universités ivoiriennes. Il s’agit donc de donner aux enseignants et aux étudiants ce dont ils ont besoin pour travailler dans de meilleures conditions.
Références bibliographiques
ASCAD, 2019, Face au problème de la violence en milieu universitaire ivoirien, Préface N’DA Paul, Paris, L’Harmattan.
ATTALI Jacques, 2005, Karl Marx ou l’esprit du monde, Paris, Librairie Arthème Fayard.
BALIBAR Étienne, 1993, La philosophie de Marx, Paris, Éditions La découverte.
COLLIN Denis, 2009, Comprendre Marx, Paris, Armand Colin.
DELEPIERRE Fréderic, 1969, « Révolution et catholicisme », in Lutte des classes ou conflits de générations, Bruxelles, Cercle d’éducation populaire a.s.b.l
ENGELS Friedrich, 1976, Le rôle de la violence dans l’histoire, de la propriété privée et de l’État, Paris, Éditions Tribord.
ENGELS Friedrich, 2007, Anti-Dühring (M.E Dühring bouleverse la science), trad. Arrigo Cervetto, Paris, Éditions Science marxiste.
HEGEL, 1999, Principes de la philosophie du droit, trad. Jean-Louis Viellard-Baron, Paris, GF Flammarion.
KONE Cyrille, 2017, Sur la maîtrise de la violence, Paris, L’Harmattan.
LEFEBVRE Henri,1966, Pour connaître la pensée de Karl Marx, Paris, Bordas.
LÉNINE Vladimir, 1978, L’État et la révolution. La doctrine marxiste de l’État et les taches du prolétariat dans la révolution, Pékin, Éditions en langues étrangères Pékin.
LOCHACK Daniel, 2014, Pédagogie et Droits de l’homme, Paris, Presses universitaires de Nanterre.
MARX Karl et Friedrich ENGELS, 2010, Manifeste du parti communiste suivi de 18 brumaire de Louis Napoléon Bonaparte, trad. Émile BOTTIGELLI, Éditions Flammarion.
MARX Karl, 1994, « Les luttes de classes en France », in Œuvres IV, Politique I, trad. Maximilien Rubel, Paris, Gallimard.
MARX Karl, 1996, Manuscrits de 1844, trad. Trad. Jacques-Pierre Gougeon, Paris, GF-Flammarion.
MARX Karl, 2006, Sur la question juive, trad. Jean-François Poirier, Paris, La Fabrique Éditions.
MARX Karl, 2008, Critique du programme de gotha, trad. Sonia Dayern-Herzbrun, Paris, Éditions Démopolis.
MARX Karl, 2009, Les crises du capitalisme, trad. Jacques Hebenstreit, Paris, Éditions Démopolis.
MARX Karl, 2018, Le Capital suivi du manifeste du parti communiste, trad. Joseph Roy et Charles Andler, Paris, Amazone Éditions.
PÉROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, 2002, Villes et violence en Afrique noire, Paris, IRD-Karthala.
LES UNIVERSITÉS IVOIRIENNES À L’ÉPREUVE DE LA VIOLENCE DES SYNDICATS ESTUDIANTINS
1. Koffi Décaird KOUADIO
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
2. Alice KOUAKOU
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Depuis des décennies, les universités ivoiriennes sont éprouvées par la violence des syndicats estudiantins qui ont fait de ces espaces du savoir, des champs d’affrontements violents. Ces violences qu’exercent les syndicats estudiantins ne vont pas sans destruction de biens publics et privés, atteinte aux libertés d’expression, séquestrations des personnes, meurtres, viols, perturbation des cours et des activités académiques, etc. Ces violences ont fini par déstabiliser le système universitaire et ternir son lustre d’antan. Nous montrerons dans ce texte que la violence des syndicats estudiantins éprouve les universités ivoiriennes et les met en crise. Pour sortir de la violence, ces syndicats doivent être dépolitisés et démilitarisés.
Mots clés : Impunité, liberté d’expression, savoir, syndicats estudiantins, Système universitaire, violence.
Abstract:
For decades, the Ivorian universities have been tested by the violence of the student unions which have made these spaces of knowledge, fields of violent confrontation. This violence carried out by the student unions is not without the destruction of public and private property, the attack on freedom of expression, the kidnapping of people, murders, rapes, the disruption of classes and academic activities, etc. .This violence ended up destabilizing the university system and shattering its former glory. We will show in this text that the violence of the student unions tests the Ivorian universities and puts them in crisis. To emerge from the violence, these unions must be depoliticized and démilitariser.
Keywords : Impunity, freedom of expression, student unions, university system, violence, knowledge.
Introduction
Les universités ivoiriennes qui devraient être des espaces civilisés de recherche, d’apprentissage, de formation, etde la conquête du savoir, sont en proie à la violence terrifiante des syndicats estudiantins qui les ont plongéesdans une crise profonde. Pourquoi les universités ivoiriennes sont-elles aujourd’hui otages des syndicats estudiantins qui sont organisés en bande d’agresseurs faisant impunément ce qu’ils veulent ? Quelles sont les causes de cette violence dans l’espace universitaire ? N’est-ce pas ces violences déshumanisantes qui déstabilisent et font régresser en performance les universités ivoiriennes ? Comment construire des universités d’excellence, exemptes de violence et capables de se poser comme de véritables moteurs de développement ? Telles sont les préoccupations que nous avons choisies d’examiner dans ce texte. Dans cette communication, nous voulons montrer que les universités ivoiriennes sont éprouvées par la violence des syndicats estudiantins. Pour leur pacification, ces syndicats doivent être dépolitisés et « démilitarisés », afin que ces universités retrouvent leur lustre d’antan. Dans une démarche analytique et critique à la fois, qui nous permettra de dégager des perspectives nouvelles pour nos universités, nous subdivisons notre texte en trois parties : 1. étiologie de la violence syndicale en milieu universitaire, 2. violence syndicale et universités en crise et 3. Perspectives d’universités exemptes de violences syndicales.
1. Étiologie de la violence syndicale en milieu universitaire
Depuis plusieurs décennies, les universités ivoiriennes sont confrontées à de nombreux problèmes qui ont fini par faire d’elles, des universités en crise permanente. Ces crises ont profondément impacté le rayonnement des universités et réduit les acquis sociaux des acteurs, voire, bloqué le dispositif de l’environnement du travail, de la formation et de l’apprentissage. En effet, depuis les années 1990, au moment où la Côte d’Ivoire s’ouvrait à l’ère du multipartisme, la crise politique qui lui est consécutive coïncide avec les revendications syndicales à l’université, dans les Lycées et collèges avec la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), née dans cette période de crise. Avant l’avènement de la F.E.S.C.I., c’est le mouvement des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (M.E.E.C.I), proche du parti au pouvoir d’alors, le P.D.C.I qui occupait l’espace universitaire et scolaire de la Côte d’Ivoire. Ce mouvement des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (M.E.E.C.I), était un mouvement syndical et politique d’élèves et d’étudiants créé en 1969 après la dissolution de l’Union nationale des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (U.N.E.E.C.I). C’est donc le M.E.E.C.I qui, de 1969 à 1990, représentait les élèves et étudiants jusqu’à sa dissolution en 1990. Dans la même année, comme nous l’avons souligné plus haut, précisément, le 21 avril 1990, à l’église sainte famille de Riviera 2 à Abidjan, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (F.E.S.C.I.) voit le jour et se fixe pour objectif, la lutte pour les intérêts moraux et matériels des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire. Elle a, pour ce faire, travaillé à installer ses sections sur toute l’étendue du territoire, dans les universités, puis dans les Lycées et collèges. En arrière-fond de l’objectif qu’elle s’est fixée, son but était de se débarrasser du P.D.C.I., car, pour ses responsables, il n’y avait aucun moyen d’améliorer l’école sans démocratie. Ainsi, pour eux, le P.D.C.I., qui a incarné le parti unique des indépendances aux multipartismes, ne pouvait pas être un gage de démocratie. De cette façon, les revendications corporatistes étaient soupçonnées par le parti au pouvoir de cacher une démarche politique. Cette confusion ne pouvait donc disposer véritablement le pouvoir à régler les problèmes posés par les étudiants. En plus de cela, les politiques d’ajustement structurelles, P.A.S., qui ont sapé les dispositifs de l’État dans le secteur de la santé et de l’éducation, ont créé une crise grave qui a brisé la volonté des autorités à faire face aux problèmes de l’école. Comme le souligne J.-M. Ela (2007, p. 164), « face à la crise que traverse l’université en Afrique, les programmes d’ajustement structurel sont, pour les experts de Brettons Woods, le chemin à suivre, si les pays africains veulent renverser les tendances actuelles » en vue de sortir de la crise et amorcer la croissance économique. Leur projet était d’inscrire et de soumettre l’enseignement supérieur dans l’ordre marchand, c’est-à-dire dans l’économie de marché en réduisant d’une part, le rôle de l’État dans le secteur de l’économie, et d’autre part, en faisant la promotion du secteur privé.
En fin de compte, ces politiques d’ajustement structurel, d’inspiration libérale, mises en œuvre dans de nombreux pays à partir des années 1980, en contraignant l’État à réduire son rôle dans les secteurs clés de son développement, à savoir l’agriculture, la santé, et l’éducation par exemple, ont eu des conséquences dramatiques sur le plan social. Or, « la réduction du rôle de l’État entraine nécessairement une diminution des dépenses sociales ou des subventions accordées aux couches vulnérables ». (A. Adou, 2013, p. 124). Toutes les couches sociales en lien avec ces reformes antisociales en sont victimes. Dans les universités, on assiste à la fin de l’âge d’or des étudiants et l’accroissement des inégalités. Des théories controversées de réduction des effectifs d’étudiants dans l’enseignement supérieur ont commencé à occuper la réflexion, avec une incitation à l’ouverture des grandes écoles et universités privées. Les P.A.S ont fait croire que le nombre pléthorique d’étudiants inscrits dans les universités ne peut assurer une croissance économique. Il faut donc procéder à une sélection des candidats à l’université.
Les politiques d’austérité imposées par la banque mondiale et le Fonds monétaire international (F.M.I.) ont infesté le système éducatif et universitaire, dans la mesure où l’État, a fini par abandonner les secteurs clés de son développement en en réduisant, voire supprimant son investissement. L’État ivoirien, prisonnier des impératifs économiques imposés, ne mise plus dans le social. Il devra désormais faire face aux problèmes que rencontrent les universités, à savoir, la réduction ou la suppression de la bourse d’étude, l’insuffisance des salles de travaux dirigés (T.D), de travaux pratiques (T.P.), d’Amphithéâtres et les conditions de vie et d’étude qui ne cessent de se dégrader. J-M. Ela (1994, p. 50-51) a raison dans une certaine mesure, de faire le diagnostic des universités et les conditions de vie précaires des étudiants en Afrique :
Dans cette perspective, qu’on se représente les conditions de vie des étudiants sans bourses ni chambres dans les grandes villes qui, souvent, sont parmi les plus chères du monde (…). Ceux que l’on a pu considérer longtemps comme les enfants privilégiés sont aujourd’hui les exclus d’un système qui les rejette dans les zones de marginalité sociale dont ils ont parfaitement conscience.
Les universités sont dans l’impasse et ne semblent plus garantir un avenir à la jeunesse. L’État ivoirien en crise, appliquant les réformes iniques des institutions de Brettons Woods, ne pouvait pas régler efficacement les problèmes que posent les syndicats. Cette incapacité de l’État à régler efficacement et durablement les problèmes posés, est vue par la F.E.S.C.I., comme un manque de volonté politique dont l’objectif est de sacrifier la jeunesse sur l’autel de la conjoncture. Ainsi, la seule alternative, pour elle, c’est la voie de la violence pour contraindre le pouvoir à régler les problèmes posés. C’est donc par la violence que la F.E.S.C.I. posait ses revendications.
La crise de l’écoute est, de cette façon, à l’origine de la violence des syndicats estudiantins. K. Niamkey (2019, p. 65) définissant la violence écrit ceci : « on peut dire globalement que la violence est un mode d’expression qui est fonction du conflit social dont elle se veut la solution ». Pour Niamkey Koffi, la violence s’exprime en fonction de la situation qui prévaut et se pose comme le moyen de règlement d’un différend. L’année 1990, est une année particulièrement trouble, avec le spectacle de la violence lors des manifestations des partis d’opposition, la contestation de plus en plus violente de la F.E.S.C.I. qui veut, par le langage de la violence obtenir les droits dont elle pense être privés ou qui ne lui étaient pas reconnus et de certains droits acquis qu’elle était en train de perdre sous le régime du P.D.C.I. En se servant de la force, nous dit G. B. C. Koné (2017, p. 20), « l’individu usant de la violence cherche en fait à changer et à modifier la réalité ou le cours des choses à son avantage. Il impose ainsi une sorte de diktat, de domination qui soumet autrui à sa volonté pour mieux lui retirer son droit, son bien et/ou lui contester une émotion, une vision ». Le chemin de la violence emprunté par la F.E.S.C.I. avait pour visée, le bouleversement de la stabilité politique, l’ordre établi, afin d’arracher le changement. La violence des syndicats estudiantins dans l’espace universitaire va prendre sa source dans un contexte de crise sociopolitique, de crise économique et de mutation dans la construction de l’État-nation que le processus de démocratisation du pouvoir a fait voir. C’est à partir de cette pression violente exercée par les étudiants et leurs soutiens que le système éducatif et universitaire a été entamé.
2. Violence syndicale et universités en crise
Les politiques d’austérité suscitée par le F.M.I. et la banque mondiale ont soumis l’État ivoirien à des grèves violentes conduites par le syndicat des élèves et étudiants (F.E.S.C.I.). Cette violence et les incivilités dans les espaces scolaires et universitaires se sont multipliées et sont devenues comme un cancer que portent ces espaces. Selon G. B. C. Koné (2017, p. 21), « à bien analyser le phénomène, on aperçoit qu’il est premièrement une remise en cause de la quiétude, de la paix, du calme et de l’ordre qui prévalaient. Deuxièmement, la violence est démesure, chaos, puisqu’au cœur du concept se trouve l’idée de déchaînement ». Les actes de défiance et la remise en cause permanente de l’autorité académique et administrative sont devenus les caractéristiques de nos espaces universitaires et scolaires. Pendant des années, nous avons assisté à des affrontements violents intersyndicaux et extra syndicaux qui n’ont cessé d’installer sur les espaces universitaires, un climat de terreur, de chaos et de non droit, à travers les actes d’incivilité et l’atteinte à l’intégrité physique sur les étudiants, le personnel enseignant et administratif.
Le projet de revendication de conditions meilleures d’études pour les élèves et étudiants engagé par la F.E.S.C.I., s’est mué en une lutte d’occupation et de domination des espaces scolaires et universitaires de Côte d’Ivoire. Ce contrôle de l’espace scolaire et universitaire, est un contrôle de la jeunesse de ces espaces pour servir d’instrument à la lutte de positionnement politique ou peser dans les stratégies politiques des partis dont elle est proche. Les moyens utilisés pour exercer la violence ont évolué avec l’usage de la machette qui a fait irruption dans leur fonctionnement. Comme le fait remarquer Y. Konaté (2003, p. 49-70),
Pendant longtemps, en Afrique, un combat entre hommes se passait à la loyale, mains nues. Recourir au moindre bâton était synonyme de lâcheté et le lâche était immédiatement désarmé par le public… Aujourd’hui, voilà que les jeunes empoignent des machettes contre d’autres jeunes, sans honte… Ces jeunes qui sortent les grands couteaux et se trucident sans égard pour les valeurs dont l’Université est le garant, (…) ont mis le pied à l’étrier du pouvoir d’État !
Le temple du savoir, lieu d’apprentissage et d’humanisation, est devenu, le temple de la violence et de la déshumanisation : les étudiants se découpent à la machette.
Notre université, lieu de l’intelligentsia, creuset des valeurs sociales, partage les traits caractéristiques de l’état de nature. (…). Les étudiants n’hésitent pas à se découper à la machette, à frapper un des leurs jusqu’à ce qu’il perde la vie. Comme à l’état de nature, ce qui prime c’est l’asservissement de l’autre pour avoir le monopole de la parole, chacun pensant à son intérêt personnel (D. L. Fie, (2007, pp. 71-89).
Après le premier gouvernement de Robert Guéi, en janvier 2000, la F.E.S.C.I. qui était le syndicat allié au Front républicain ivoirien a connu sa première grave crise, appelée la guerre de la machette qui a opposé les syndicalistes membres de la F.E.S.C.I., proche du RDR et ceux proches du F.P.I. Selon I. Diarassouba (2017, pp. 379-398), « cette violence qui opposait les syndicats entre eux, mais aussi les militants d’un même syndicat, s’est intensifiée au fil des années, et a finalement intégré le fonctionnement des syndicats et les habitudes des militants syndicalistes ». Pour conforter sa mainmise sur l’université, la F.E.S.C.I., use depuis longtemps de violences et d’intimidations. De 1990 à aujourd’hui, la culture de la violence n’a fait que se renforcer. La F.E.S.C.I. a mis les campus en coupe réglée, en imposant sa logique, la logique de la force, par laquelle, sur les campus et aux alentours des résidences universitaires, elle installe des commerces, des buvettes, voire une boîte de nuit, qui lui payent un « quota » ou des taxes. Faisant la loi, certains membres de la FESCI, se sont souvent permis de se servir dans ces commerces sans payer la facture. Aujourd’hui encore, ce syndicat prélève des taxes sur les bourses des étudiants. Comme nous l’avons souligné dans un texte antérieur,
La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, cette association sensée être le syndicat pour la défense des élèves et étudiants s’adonne depuis plusieurs années au racket des étudiants boursiers sans que personne ne soit dérangée. C’est de 10 000 frs à 20 000Frs que chaque boursier est obligé de payer comme taxe. Leurs attitudes sur l’espace universitaire portent les traits de fonctionnement d’une milice armée. (K. D. Kouadio, 2021, pp. 107-120).
Les chambres d’étudiants qu’elle a réquisitionnées sont mises à la disposition de ses membres, d’autres chambres sont mises en location par celle-ci, d’où elle récupère le loyer, avec parfois des possibilités de vider nuitamment les occupants. C’est de cette façon que de nombreux étudiants sont constamment bastonnés et humiliés. Comme on peut le constater, la F.E.S.C.I., a imposé la pensée unique par la terreur, alors qu’elle s’est faite passer depuis son avènement, pour un syndicat qui promeut la démocratie et l’État de droit. Or, souligne A. A. Hauhouot (2015, p. 118-119), « tous ceux avec lesquels on a discuté se prétendent démocrates convaincus, mais leur vision de la démocratie et ainsi que de sa pratique sont plus proches de la dictature. Il n’y a pas pire preuve que le refus du pluralisme syndical par la FESCI ». Ce syndicat aux méthodes tyranniques, rame à contre-courant de sa prétendue lutte pour l’instauration de la démocratie, avec son slogan : pas d’école nouvelle sans démocratie véritable, alors que dans la pratique, c’est la dictature qu’il exercice sur les campus. Même les élections qu’il organise en son sein, sont bien souvent manipulées, frauduleuses et se terminent par la violence.
Ce syndicat s’est spécialisé dans des pratiques peu recommandables dans les universités de Côte d’Ivoire. Les incidents observés sur les campus vont de simples problèmes de disciplines aux gestes obscènes, aux crimes. Dans son action sur les campus, nous sommes souvent témoins des menaces verbales et physiques, les agressions, le vandalisme et les extorsions de toute nature qu’il exerce sur les autres. Nous assistons, bien souvent, à des confrontations de plus en plus violentes entre les manifestants et les forces de l’ordre qui, en violation des franchises universitaires, interviennent pour rétablir l’ordre. Dans cette confrontation violente, le campus est troublé et devient un espace où règnent l’insécurité et la peur.
La F.E.S.C.I. garde dans son histoire, de nombreux cas de meurtres sur ses propres militants et sur des militants de syndicats adverses : « À Abidjan, le 16 juin 1991, Thierry Zébié, un étudiant loubard, transfuge de la Fesci passé du côté du pouvoir, est tué à coups de projectiles par une foule d’étudiants descendus du campus jusqu’à la cité Mermoz ». (Y. Konaté, 2003, p. 49-70). C’est aussi le cas de l’étudiant Abib Dodo Borice, torturé puis assassiné en juin 2004 sur le campus universitaire de Cocody, sans oublier d’autres cas similaires, où des étudiants ont été ensevelis en toute discrétion, sur le campus universitaire. Sous ce rapport, on peut saisir cette organisation syndicale comme un escadron de la terreur, une mafia qui s’est installée au cœur des universités pour asseoir sa domination et décider de l’ordre à l’université. Dans cette situation, les universités sont en crise permanente, elles ne sont pas des espaces de stabilité et de tranquillité certaines pour des études. Elle s’autorise la fermeture des départements avec qui, elle a des incompréhensions, pose des actes de vandalisme et bloque des délibérations de jurys d’examens quand les résultats publiés ou en cours de publication ne sont pas en sa faveur.
Les universités de Côte d’Ivoire sont éprouvées par cette violence inouïe et impunie, qui viole tout droit. Les grands campus, partagés entre la F.E.S.C.I à Abidjan et Daloa, le C.E.E.C.I. à Bouaké et l’A.G.E.E.C.I. à Korhogo connaissent les mêmes situations, les mêmes modes de fonctionnement, et le même mode opératoire. Les universités ivoiriennes sont à l’épreuve de cette jeunesse turbulente et insolente qui s’est plusieurs fois illustrée dans les perturbations intempestives et musclées des cours et des rencontres académiques.
Comme on le voit, cette violence syndicale institutionnalisée dans les universités, met en crise les universités de Côte d’Ivoire, autrefois, carrefour du savoir, mais aujourd’hui, nid de voyous qui, sous le couvercle de leurs syndicats, ont défiguré l’espace universitaire, en le transformant en champ de bataille. La F.E.S.C.I. et les nouveaux syndicats qui s’imposent par leur capacité de nuisance, n’ont pas relevé les défis de leur existence. Nos universités paralysées par ce flux de violences, sont en crise et ne peuvent plus, de cette façon, refléter le statut de noblesse qui caractérise le concept même d’université.
3. Perspectives d’universités exemptes de violences syndicales
Jusqu’ici, les stratégies pour mettre fin à la violence des syndicats estudiantins n’ont pas tenu leurs promesses. La pacification des campus et espaces universitaires a été un leurre dans la mesure où ces espaces sont de plus en plus contrôlés et maîtrisés par les différents syndicats qui y imposent leurs volontés. La violence est latente et peut exploser à tout moment et cela met les universités en situation de crise permanente. Les autorités administratives, pour faire revenir le calme et prétendre maîtriser la violence des syndicats, procèdent par la corruption pour acheter leur silence. Dans cette posture, les problèmes que rencontrent les étudiants et étudiantes, semblent ne plus intéresser les syndicats qui feignent de les ignorer. Désormais, ils peuvent avoir beaucoup d’argent, voire obtenir leur insertion professionnelle, par leur inscription sur les listes d’admission aux concours, s’ils restent tranquilles. Or, cette approche est loin d’assurer une pacification permanente des espaces universitaires, dans la mesure où, ces syndicats qui, par le jeu de la corruption et de la facilité, font de cette solution précaire un fonds de commerce pour se financer et renforcer leur puissance sur les campus. Il faut donc des décisions courageuses pour disqualifier la violence et le désordre qui ont fait irruption sur les campus depuis plusieurs décennies. Comment sortir de cette crise des universités dont un des facteurs importants déclencheurs est la violence des syndicats estudiantins ?
Jean-Marc Ela, faisant le diagnostic des politiques d’ajustement structurels des années 1980, a montré leurs effets dévastateurs sur les systèmes éducatifs, universitaires et sanitaires, qui ont fragilisé l’État et démoli son potentiel de développement. Il y a, dit-il une inadéquation entre les mesures d’ajustement structurel imposées de l’extérieur et les politiques d’éducation et de santé qui répondent aux besoins et aux urgences des pays africains. « Il est maintenant de plus en plus clairement reconnu que, dans la plupart des cas, il ne peut y avoir de sortie de la crise sans que l’étau financier soit considérablement desserré. Cet allégement de la contrainte financière est la condition de toute perspective de développement et d’équilibre social » (J.-M. Ela, 1994, p. 57). En disqualifiant la théorie régressive des institutions de Brettons Woods, les États africains en général et l’État ivoirien en particulier, doivent se réapproprier leurs systèmes universitaires et sanitaires, puis en prendre le contrôle. Pour ce faire, il faut mener une lutte farouche contre la corruption et l’impunité, ensuite mobiliser les ressources pour investir sérieusement dans l’école et dans l’université, en améliorant les conditions de vie et de travail des acteurs (enseignants, personnel administratif et technique, puis des étudiants). J.-M. Ela (1994, p. 57) prévient qu’« il faut aujourd’hui redouter une emprise accrue des formes d’ingérence et des mécanismes d’intervention extérieure mettant en cause la prise d’initiative des acteurs locaux, notamment dans le domaine de la planification et de la mise en œuvre des politiques réelles d’éducation et de santé ». Cette ingérence extérieure veut prendre le contrôle de notre système universitaire pour, en réalité, servir ses intérêts. La réforme des maquettes pédagogiques et les restructurations de l’enseignement supérieur doivent s’opérer à l’initiative des autorités et des acteurs. Il ne s’agit pas de réformes unilatérales prises par le ministre de l’enseignement supérieur, coupé souvent des réalités et incapables de mettre en place une réforme intersubjectivement partagée.
Dans l’actualité de la reforme de nos maquettes pédagogiques, c’est malheureusement la banque mondiale qui est à la manœuvre. Avec le financement qu’elle propose, elle prend le contrôle de notre système universitaire et l’oriente en fonction de ses intérêts. Le projet de performance des maquettes pédagogiques initié et financé par la banque mondiale, tel qu’engagé, avec des procédures irrationnelles qui font travailler les enseignants-chercheurs sans les rémunérer, en faisant bénéficier à leurs experts, le travail que font ces enseignants, est difficile à réaliser. Avec l’obsession de l’emploi jeune, les maquettes risquent de se vider de leurs contenus et la formation risque d’être instrumentalisée. Nous craignons que cette nouvelle initiative plombe à nouveau, nos universités déjà en crise.
Il faut dépolitiser les syndicats estudiantins à travers une reforme rigoureuse dans laquelle leur structure actuelle soit démolie. « Il s’agit de libérer l’école de la manipulation idéologique, des luttes politiciennes » (D. L. Fié, 2007, pp. 71-89). L’impunité dont jouissent ces jeunes, doit prendre fin, par des enquêtes sérieuses qui pourront nous ramener sur leurs crimes passés, retrouver les coupables, les traduire en justice et les condamner si les preuves de leurs participations dans ces crimes sont avérées. L’État doit prendre ses responsabilités pour « démilitariser » les syndicats estudiantins qui ont érigé les résidences universitaires et tous les espaces universitaires en des « camps militaires », avec des unités dans les différentes sections, qui s’entrainent nuits et jours pour se préparer à des affrontements ou continuer d’exercer leurs influences et leurs dominations violentes dans les universités. Cette dérive des syndicats, observée jusque-là, sans être inquiétés, qui leur donne le sentiment de l’impunité, doit prendre fin. La violence ici, comme hors-la-loi, doit être pénalisée, car elle est l’instrument de déstabilisation et de destruction des universités et de la jeunesse. De la sorte, dé-barbariser l’espace universitaire est le lieu d’émergence de sa pacification et de sa régénérescence. De ce point de vue, l’État doit donc prendre ses responsabilités pour restaurer l’autorité des enseignants-chercheurs et celle du personnel administratif, afin que l’université retrouve son lustre d’antan. Dans cette tâche, les conditions de vie et de travail des acteurs de l’espace universitaire doivent trouver définitivement des solutions susceptibles de mettre les universités à l’abri du besoin.
Dans les sociétés bloquées où des milliers de jeunes sont exposés à camper sur les trottoirs, une tâche s’impose : « investir dans l’homme » pour préparer l’avenir. Car, c’est bien l’homme africain, notre dernière chance, qui est aujourd’hui menacé au moment où l’Occident s’organise pour se réapproprier les ressources de la planète. (J.-M. Ela, 1994, p. 59-60).
Pour Jean-Marc Ela, l’homme est notre ressource fondamentale et notre seule richesse. S’il faut s’efforcer de promouvoir la qualité de la vie dans tous les domaines de la société, il importe d’avoir à cœur l’impact socio-politique de toute déflation massive dans le secteur public. C’est pourquoi, dit-il, dans les lieux de parole, de réflexion et de décision, l’on doit remettre en question la pertinence des programmes qui, en fin de compte, sont destinés à aggraver les conditions de vie en Afrique. Investir dans l’homme ici, c’est choisir de mettre à sa disposition, les moyens nécessaires pour assurer une formation de qualité. Dans cette perspective, les formateurs doivent être mis à l’abri du besoin si nous voulons qu’ils fassent de l’enseignement une passion heureuse. L’enseignant-chercheur, comme maître initiateur des étudiants au savoir, est la mesure du développement. Le mépriser et créer les conditions de son appauvrissement, c’est mépriser l’avenir en entretenant l’ignorance et la médiocrité, c’est-à-dire, ouvrir pour l’avenir, les portes de la régression. Les problèmes de nos universités sont connus. Les solutions ont plusieurs fois été élaborées à l’occasion d’ateliers de réflexion organisés avec les autorités académiques et universitaires, mais, par la ruse et le manque de volonté politique, les universités sont toujours en crise et abandonnées par L’État.
Penser la crise dans les universités ivoiriennes, c’est interroger la violence qui s’y est installée et moraliser l’activité syndicale. Le syndicalisme est une activité responsable, menée avec des responsables qui ont une grandeur d’esprit et qui travaillent à l’avènement d’une atmosphère exempte de violence. Dans la perspective d’universités exemptes de violence, il est question de réinterroger le système universitaire dans sa structuration, son organisation, son fonctionnement et repositionner l’université comme le lieu du savoir, dont la mission est de préparer les jeunes à la citoyenneté et à la construction de la nation. L’université n’est pas un camp militaire, encore moins le lieu de fabrication de voyous et de délinquants qui utilisent la violence pour s’épanouir. L’université est le temple du savoir. Comme l’indique J.-M. Ela (2007, p. 168), « en Afrique, c’est dans le savoir que se trouve une des clés pour sortir de la pauvreté. Bien plus, le savoir est une condition du développement durable ». Notre jeunesse doit donc fréquenter les bibliothèques, lire et se cultiver pour trouver la clé du savoir qui affranchit de la pauvreté. La quête d’un développement durable trouvera ses fondements, non pas dans la violence des syndicats estudiantins, mais dans l’abnégation au travail, à la culture et au savoir. Ainsi, écrit J.-M. Ela (2007, p. 187) « les choix d’avenir s’opèrent désormais autour du savoir ». Dans notre société qui a fait de l’avoir et de la richesse, la priorité des priorités, Jean-Marc Ela nous indique une nouvelle voie, celle du savoir pour prétendre se réaliser. Sans connaissance, on pêche et on périt toujours par naïveté. L’université est le lieu de ce savoir et de la formation de l’homme. Dans cette perspective, une université exempte de violence doit, pour ainsi dire, se réconcilier avec elle-même, pour qu’elle redevienne un espace civilisé de recherche, d’apprentissage et de formation pour le développement de la Côte d’Ivoire.
Conclusion
Il ressort de notre analyse que la FESCI, née en 1990, à l’occasion de l’ouverture de la Côte d’Ivoire au multipartisme, est à l’origine de la violence dans les universités ivoiriennes. Les revendications engagées avec violences ont déstructuré l’ordre et la paix dans l’espace universitaire. Ses méthodes tyranniques, ont écrasé les autres syndicats, et l’on propulsé sur les campus pendant longtemps comme la seule structure syndicale des élèves et étudiants. Elle s’est rendue coupable, au fil des années, d’actes de vandalisme, de meurtres, de casses, de bastonnades d’enseignants, d’étudiants, du personnel administratif et autres qui ont terni l’image des universités ivoiriennes en les plongeant en situation de crise permanente. Les autres syndicats nés après la crise postélectorale qui occupent les espaces universitaires de Bouaké et Korhogo, ont adopté les mêmes pratiques violentes pour intimider et dominer l’espace universitaire. Les universités ivoiriennes sont donc éprouvées par cette violence des syndicats estudiantins qui sape la qualité des études et de la formation. C’est pourquoi, pour sortir de la grisaille, nous invitons l’État à prendre ses responsabilités, afin de dépolitiser et de « démilitariser »les syndicats estudiantins pour l’avènement d’une paix durable et la réhabilitation des universités de Côte d’Ivoire. La résolution sérieuse, sans ruse, de tous les problèmes connus des universités, est un viatique pour remettre l’université sur la voie de la performance et de l’excellence.
Références bibliographiques
ADOU Appiah, 2013, Le syndicalisme en Afrique subsaharienne, l’expérience de la Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan,
DIARASSOUBA Ibrahima, 2017, « Violence Syndicale Estudiantine Dans Les Universités Publiques De Côte d’Ivoire : Perceptions Et Enjeux ». European Scientific Journal, ESJ. 13, 7 (Mar. 2017), pp. 379-398. DOI: https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n7p379.
ELA Jean-Marc, 1994, Afrique, l’irruption des pauvres (société contre Ingérence, Pouvoir et Argent, Paris, L’Harmattan.
ELA Jean-Marc, 2007, Les cultures africaines dans le champ de la rationalité scientifique, Paris, L’Harmattan.
FIE Doh Ludovic, 2007, « École et violence : contribution à la critique de la régression vers la barbarie », In le Kore, Revue ivoirienne de philosophie et de culture, Abidjan, N°38, pp. 71-89.
HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2015, Côte d’Ivoire, À quand la puissance éducative ? Abidjan, Nouvelles Editions Balafons.
KONATE Yacouba, 2003, « Les enfants de la balle. De la Fesci aux mouvements de patriotes », in Politique africaine, (N°89), p. 49-70. DOI : 10.3917/polaf.089.0049, https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2003-1-page-49.htm.
KONÉ Cyrille, 2017, Sur la maîtrise de la violence, Paris, L’Harmattan.
KOUADIO Koffi Décaird, 2021, « Penser la mobilité et l’immobilisme dans l’espace universitaire ivoirien », in Revue le Caïlcédrat, revue canadienne de philosophie, de lettre et de sciences humaines, décembre 2021, N° spécial, les éditions Différance Pérenne, Québec, pp. 107-120.
NIAMKEY Koffi, 2019, Écrits politiques, Paris, L’Harmattan.
LE PARADIGME ESTHÉTICO-ÉDUCATIF ARISTOTÉLICIEN ET SCHILLÉRIEN FACE À LA PROBLÉMATIQUE DE LA VIOLENCE DANS L’ESPACE UNIVERSITAIRE IVOIRIEN
Koudou François OZOUKOU
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Depuis plusieurs décennies, l’espace universitaire ivoirien est en proie à une profonde crise. La violence aussi bien verbale, physique, psychologique que morale est l’un des prodromes attestant de cette vérité. Pour remédier à cette situation des efforts aussi bien politiques qu’intellectuels sont entrepris et déployés. Mais force est de constater que face à la problématique de la violence et en vue de sa résolution, la perspective esthétique ou artistique est insuffisamment explorée. Or, au regard de l’important potentiel éducatif qu’elle recèle, une attention particulière lui devrait être consacrée. Au demeurant, l’esthétique aristotélicienne et schillérienne méritent alors à n’en point douter d’être reconsidérée dans la quête de solutions face à la crise de la violence dans l’espace universitaire ivoirien.
Mots clés : Beau, Côte d’Ivoire, Éducation, Esthétique, Jeu, Université, Violence.
Abstract:
For several decades, the Ivorian university system has been in the grip of a deep crisis. Verbal, physical, psychological and moral violence is one of the signs of this. To remedy this situation, both political and intellectual efforts are being made and deployed. However, it is clear that the aesthetic or artistic perspective on the problem of violence is underestimated and insufficiently explored. However, in view of its important educational potential, it should be given special attention. In any case, Aristotelian and Schillerian aesthetics deserve to be reconsidered in the search for solutions to the crisis of violence in the Ivorian university environment.
Keywords : Beauty, Côte d’Ivoire, Education, Aesthetics, Game, University, Violence.
Introduction
La Côte d’Ivoire après la proclamation de son accession à l’indépendance en 1960, connaît une embellie économique sans précédent. En effet, sous le leadership de son premier président, Felix HOUPHOUET BOIGNY, le pays est hissé au rang des nations économiquement prospère. Cette situation économique reluisante s’est étendue sur plus d’une décennie (1960-1980). Mais au-delà de cette période favorable économiquement, la Côte d’Ivoire sombre dans une crise économique avec la chute des coûts des matières premières, du café et du cacao notamment qui constituaient le poumon de son économie.
Cette situation impacta significativement le vécu social des populations, ce qui suscita des remous et des contestations dont le point culminant sera atteint dans les années 90. Le monde universitaire en tant que l’un des maillons de la vie sociale, sera dès lors frappé de plein fouet par cette situation économique délétère et morose, qui sans nul doute est à l’origine de revendications et de violences en son sein. Depuis lors, comme le dit si bien L. D. Fié (2007, p. 71), « l’Université qui est le lieu de formation de l’élite s’est transformée en un champ de batailles où la violence chaotique est devenue le quotidien des étudiants. Ces derniers n’hésitent pas à s’affronter, armés de machettes et de gourdins (…) partout sur les campus, c’est le règne de la force. »
Pour apporter une solution à cette situation de violence qui gangrène l’espace universitaire ivoirien, des efforts aussi bien politiques qu’intellectuels sont entrepris et déployés. Mais force est de constater que la perspective esthétique est inexplorée en dépit du fort potentiel éducatif ou éthique qu’elle recèle. Sous ce jour, l’esthétique peut-elle contribuer à pacifier l’espace universitaire ivoirien ? Tel se formule le problème principal autour duquel s’articulera notre analyse du sujet. L’examen de cette préoccupation principale nous conduira dans un premier instant à nous interroger sur les fondements de la violence dans l’espace universitaire ivoirien. Quel est le fondement de la violence dans l’espace universitaire ivoirien ? Ainsi formulons-nous la question qui nous servira de viatique à notre analyse des causes de la violence en milieu universitaire.
Dans un deuxième moment, l’esthétique aristotélicienne et schillérienne peut-elle servir de paradigme pour la résolution de la violence dans l’espace universitaire ivoirien ? L’intention fondatrice de cette analyse est de montrer qu’en raison du potentiel éthique ou éducatif que recèle l’esthétique aristotélicienne et schillérienne elle peut considérablement contribuer à la résolution de la crise de la violence dans les universités ivoirienne. Notre analyse se déploiera à travers la sociocritique.
1. Contexte d’émergence et manifestation de la violence dans l’espace universitaire
La violence est un concept polysémique mais pour notre présente analyse nous l’appréhendons comme le déploiement ou l’usage d’une force extrêmement brutale contre un individu ou une chose. Cette approche de la violence se perçoit avec J. Lazar (2002, p. 24), lorsqu’il écrit : « la caractéristique essentielle de la violence se résume dans l’attaque physique visant à meurtrir, blesser ou invalider l’autre, de manière directe ou indirecte. » Ce sens de la violence n’est pas exhaustif en ce sens qu’il existe des violences d’ordre psychologique et moral. Même si cette conception de la violence ne couvre pas tout le sens de la violence, elle en donne néanmoins un aperçu. Au-delà de la clarification conceptuelle de la violence avec laquelle commence notre argumentation, l’intérêt de notre propos réside dans la levée de voile sur le fondement et la manifestation de la violence sur l’espace universitaire ivoirien.
1.1. La crise des valeurs et la conjoncture politico-sociale, prolégomènes de la violence dans l’espace universitaire ivoirien
La question de la violence dans l’espace universitaire ivoirien ne peut s’analyser sans le prisme éthique dont la crise politique et la conjoncture sociale sont la face visible. En effet, l’une des causes de la violence se trouve dans l’érosion des valeurs éducatives ou éthiques. Nos universités qui devraient être le creuset des valeurs sont depuis lors devenues des hauts lieux de décadence morale. On ne peut s’empêcher de voir la croissance vertigineuse de la prostitution, les harcèlements sexuels et toutes sortes de déviations sexuelles dans ce milieu. L’université à dire vrai, est moralement pervertie au regard de l’immoralité sexuelle qui y est pratiquée. Comme on le voit, cette réalité consacre à n’en point douter la décrépitude des valeurs éthiques. Aussi, le respect de la vie humaine qui est une valeur cardinale en termes d’éducation est foulée aux pieds dans l’espace universitaire. Or, comme l’écrit C. G. Koné (2017, p. 126), « le respect est constitutif de l’humanité car intrinsèquement l’homme. Celui-ci serait indigne de l’humanité sans le respect. » Le respect de soi et de l’autre, c’est le respect de ce que l’homme a de sacré, à savoir la vie. Mais dans nos universités, le respect de l’autre, de l’autorité, des principes règlementaires sont transgressés ou violés. Comme on s’en aperçoit, le milieu anniversaire est éthiquement malade depuis belle lurette. On ne peut donc pas faire l’économie de cette crise morale dans l’appréhension de la violence dans l’espace universitaire ivoirien.
Outre l’aspect éthique ou moral, il faut considérer la crise politique et sociale comme des ferments à la violence dans le milieu universitaire. Comme évoqué dans nos propos liminaires à cette étude, la Côte d’Ivoire dans la première décennie de son accession à la souveraineté connaît une prospérité économique et une stabilité politique. Mais autour des années 80, le pays sera frappé par une conjoncture économique, ce qui suscitera des remous sociaux qui ont eu de véritables répercutions sur l’aspect politique. Cette situation qui consacre l’effondrement de l’économie du pays voit émerger des contestations et des revendications de toutes les couches sociales qui atteindront leur plein essor autour des années 90. Cette même période connaît une reconfiguration de la vie politique, la fin du parti unique au profit du multipartisme.
L’université en tant que structure microcosmique dans le macrocosme qui est le pays n’échappe pas à tous ces mouvements sociaux et politiques. On notera à ce titre la misère et la précarité de la vie estudiantine. Ce qui aura comme corollaire l’émergence de syndicats d’enseignants et d’étudiants en vue de réclamer des meilleures conditions de vie et de travail. Au regard de ce qui précède, l’on note que les éléments déclencheurs de la violence sont très patents et tangibles. Les faits de violence en milieu universitaire tiennent leurs origines donc du climat de crise éthique, politique et social que connaît la Côte d’Ivoire. Si à travers le tableau peu reluisant de la vie morale, politique et sociale nous voyons ouverte la voie à la violence, nous nous attèlerons dans les lignes qui suivront à parler de l’effectivité de la manifestation de la violence dans la sphère universitaire.
1.2. De la manifestation de la violence dans l’espace universitaire
L’université, cadre par excellence de formation et d’instruction, s’est transformé depuis un certain temps, en un espace d’expression de la violence. Selon L. D. Fié (2007, p. 73), « l’Université en Côte d’Ivoire entièrement « éclairée », resplendit sous le signe de la violence triomphant partout. (…) Elle est devenue le lieu de la violence permanente, de l’errance du chaos, de la peur généralisée. » Ces propos traduisent très clairement ce qu’est devenu le milieu universitaire ivoirien. Il faut noter que la violence dans l’espace universitaire est multilatérale. Elle s’exerce contre les étudiants, les enseignants, le personnel technique et administratif. Ces violences partent de la violation de l’intégrité physique aux libertés de travail et du droit à l’éducation.
Les violences contre l’intégrité physique impliquent les mauvais traitements (sévices corporels) et la violation du droit à la vie. Parlant ici de violence contre l’intégrité physique, il s’agit de tous les actes portant sur les traitements dégradants, inhumais, les tortures et la suppression de la vie. Cette catégorie de violence est bien une réalité dans l’espace universitaire. À preuve, à l’université de Bouaké en 2002, un enseignant a été pris à parti, mis à nu et copieusement battu par un groupe d’étudiants. En outre, en 2021, un groupe d’étudiants se réclamant de la CEECI (Coordination des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire) ont fait irruption en salle de délibérations où les enseignants étaient à la tâche pour rendre les résultats des compositions. L’ordre a été intimé à ces derniers de mettre fin aux travaux de délibérations dans un langage discourtois et violent.
Ces scènes de violation de l’intégrité physique sur l’espace universitaire sont légions. En dehors des enseignants qui sont souvent victimes des actes violents des étudiants, les étudiants eux aussi subissent ces mêmes traitements dégradant de la part d’autres étudiants. À titre d’illustration, nous avons le cas d’une étudiante à l’Université de Cocody en 2004 qui a été séquestrée et violée alors que cette dernière ne distribuait que des affiches sur la mort d’un autre étudiant. À l’université Alassane Ouattara en 2021, un étudiant délégué d’amphi a fait l’objet d’agression physique sous le prétexte que ce dernier en sa qualité de délégué prenait sur lui la responsabilité d’imprimer les textes et les syllabus mis à la disposition des étudiants.
Tous ces actes de violence qui partent des dérives verbales aux sévices corporels et même à la mort, nous les rencontrons sur les campus universitaires ivoiriens. Il faut aussi ajouter que cette violence s’étend aux violations du droit à l’éducation à travers des grèves intempestives et du droit à la liberté d’association. Cette pratique s’illustre bien avec des syndicats d’étudiants, notamment la FESCI (Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire et la CEECI qui interdisent toute activité à l’une ou à l’autre structure. Comme on le voit, depuis les années 90 jusqu’aujourd’hui et donc sans discontinuité, les campus universitaires sont les théâtres d’actes d’une extrême violence.
Tout ce qui précède nous autorise à affirmer avec L. D. Fié (2007, p. 73) que ; « Notre université, lieu de l’intelligentsia, creuset des valeurs sociales, partage les traits caractéristiques de l’état de nature. La violence, la prévalence de la force, l’anarchie et la peur généralisée indiquent que notre institution opère un retour à l’état de nature. » Face à une telle situation où la violence est érigée en maître depuis des décennies, de quelle contribution peut être l’esthétique aristotélicienne et schillérienne en vue de la pacification de l’espace universitaire ?
2. L’esthétique aristotélicienne et schillérienne recours et au secours pour la pacification de l’espace universitaire
Faire intervenir l’esthétique dans un débat sur la violence paraît pour nous très opportun en ce sens que tous les efforts investis jusqu’à ce jour pour résoudre le problème de la violence en milieu universitaire n’ont pas donnés les résultats escomptés. Notre analyse dans cette partie de l’étude consistera, à partir de l’esthétique aristotélicienne et schillérienne à travers leurs fonctions éducatives ou éthiques, à montrer en quoi l’art peut contribuer à la pacification de l’espace universitaire.
2.1. L’expérience esthétique pour une restauration de l’éthique, gage de stabilité et de paix dans l’espace universitaire ivoirien
Dans notre approche de la violence en milieu universitaire, nous avons fait le constat selon lequel l’une des causes de la violence réside dans l’effritement des valeurs morales sur nos campus universitaires. C’est pourquoi, pour ramener la stabilité et la paix dans nos universités, il est impérieux ou nécessaire de restaurer l’éthique dans cet espace. Pour ce faire, nous avons jugé opportun de nous tourner vers l’esthétique aristotélicienne et schillérienne qui nous offre matière à édifier notre analyse portant sur la problématique de la violence en milieu universitaire. Spécifiquement ici, notre réflexion s’articulera autour de l’expérience de la tragédie et celle de la beauté chez Aristote et Schiller en ce sens qu’elles induisent chez l’individu un comportement de type moral.
De la lecture de la Poétique mais aussi de La politique aristotélicienne, nous puisons ou tirons des enseignements pouvant contribuer à l’édification de l’éthique dans la cité. Cette perspective passe nécessairement par la considération du concept de catharsis associé au domaine de l’art, la tragédie et la musique notamment. Selon Aristote (2007, 49b 21), « La tragédie est la représentation d’une action noble, menée jusqu’à son terme et ayant une certaine étendue (…) la représentation est mise en œuvre par les personnages du drame et n’a pas recours à la narration ; et, en représentant la pitié et la frayeur, elle réalise une épuration de ce genre d’émotions. »
Le terme épuration a trait à la catharsis. Il faut donc comprendre que la catharsis est un concept fondamental pour qui veut comprendre la fonction éthique de l’art dans le philosopher aristotélicien. Pour mieux nous en apercevoir, écoutons encore attentivement les propos suivants d’Aristote (2015, VIII, 7-1342a), « nous voyons que quand ces gens les hommes) ont eu recours aux mélodies qui jettent l’âme hors d’elle-même, ils recouvrent leur calme comme s’ils avaient subi un traitement médical, une catharsis. » À travers ces deux différentes assertions on voit qu’Aristote aborde le concept de la catharsis. Mais quel sens recouvre-t-il ?
Loin de nous l’idée d’exposer tout le débat autour de l’interprétation de la catharsis aristotélicienne, nous postulons pour le sens éthique pour notre analyse. Pour Aristote, la catharsis telle que perçue dans la tragédie comme dans la musique a une finalité éthique. Dans la tragédie en l’occurrence comme on l’a vu, la « catharsis est réalisée par les émotions de peur et de pitié qu’elle suscite (…) l’effet de la peur et de la pitié consiste à libérer l’âme de l’auditeur ou du spectateur des émotions nocives et dangereuses. » (K. F. Ozoukou, 2018, p. 205). Cela sous-entend que l’individu face à la scène tragique est libéré des émotions en rapport aux vices, jugées donc négatives. Cette approche interprétative est partagée par E. Belfiore (2005, p. 458) lorsqu’elle affirme que « la catharsis aide à modérer les tendances agressives. »
Comme on le voit, la capacité de la tragédie à instiller chez l’individu une conduite de type éthique est clairement établi par le truchement de l’art de la tragédie au regard de son effet cathartique, il est clair que l’éthique peut être instaurée. Sous ce jour, l’art se voit comme un instrument à haute portée éthique. Cette perspective invite à considérer la tragédie, en raison du potentiel éthique qu’elle recèle comme un moyen sûr pour faire face à l’érosion des valeurs qui engendre la violence dans l’espace universitaire. Pour donc faire face à la question de la violence en milieu universitaire la voie passe indubitablement par l’art. Cette lecture faisant de l’esthétique un tournant important dans la résolution de la violence en milieu universitaire est aussi notable chez Schiller.
Pour comprendre l’intérêt de l’esthétique à contribuer à la quête de solutions face à la problématique de la violence, un regard mérite d’être porté sur l’analyse schillérienne du beau. Dans sa pensée, en effet, le beau se définit en rapport avec le jeu. Il écrit, « l’objet de l’instinct de jeu pourra donc, représenter par un schème général, s’appeler forme vivante, ce concept servant à exprimer toutes les qualités esthétiques des choses et en bref ce qu’au sens large du mot on appelle beauté. » (Schiller, 1992, p. 215). Comme cela apparaît ici, l’instinct de jeu s’identifie au beau. Mieux, cet instinct de jeu qui s’entend par beauté est important dans l’anthropologie schillérienne. Le beau ou le jeu y est perçu comme l’instrument d’expression de l’humanité de l’individu, en ce sens que c’est par son canal que l’homme retrouve son harmonie et son unité.
L’homme en proie aux forces de l’instinct sensible et de l’instinct rationnel vit un déséquilibre moral. C’est donc par l’expérience de la beauté que l’homme recouvre son humanité. À y voir de près, le beau a chez ce philosophe une finalité éthique. Ces propos suivants le témoignent si bien : « Les résultats de mes investigations sur la Beauté et sur l’art, je sens vivement le poids de mon entreprise, mais aussi son attrait et sa dignité. Le sujet dont je vais parler a un rapport immédiat avec notre bonheur (…) Il a un rapport étroit avec la noblesse morale de la nature humaine. » À travers ces propos, on voit clairement que la beauté a partie liée avec la morale. Il est convenu que la beauté intervient dans la sphère morale, soumettre donc l’individu à l’expérience du beau, c’est l’anoblir moralement.
Cette articulation du beau à l’éthique nous semble bien à propos, elle tire ses sources de l’Antiquité où il est établi une analogie entre le beau et le bien. S’il est donc admis que le beau a quelque chose à avoir avec le bien, il s’avère par la même occasion qu’être auprès du beau, c’est être auprès du bien. On comprend, de ce point de vue, que l’expérience esthétique est incontournable dans la formation de la vertu. Éduquer esthétiquement, c’est favoriser l’éclosion morale dans la société. Cette approche schillérienne de l’expérience esthétique mérite à bien d’égard une attention soutenue. Pour rétablir les valeurs morales tombées en désuétude dans nos universités et pour faire face à la violence galopante, la solution passe par la soumission de tous les acteurs du monde universitaire à l’expérience du beau.
2.2. La fonction éducative de l’art, une thérapie contre la pathologie de la violence
Dans l’esthétique aristotélicienne et schillérienne, l’art est crédité d’une vocation éducative. Cette approche mérite d’être explorée, car le remède contre la violence dans nos universités, c’est bien l’éducation. Pour un espace universitaire stable et pacifié, la solution passe par l’éducation esthétique de l’homme. Cette perspective implique que l’on se tourne dans un premier temps vers le jeu qui à valeur éducative chez Aristote et Schiller.
Si on ne peut considérer l’éducation comme un sujet mineur dans la philosophie d’Aristote, le jeu non plus ne doit l’être dans la mesure où dans son système éducatif, le jeu tient une place capitale. Le jeu dans la philosophie d’Aristote à une valeur propédeutique, elle prépare au devenir de l’enfant. Par le jeu qui revêt un sens artistique, est forgée la personnalité future de l’enfant. C’est cette idée que traduit les propos suivants d’Aristote (2015, VII, 16-1337a) en ces termes, « tout dans l’éducation des enfants doit être disposé en vue des travaux qui les attendent. Que leurs jeux même soient comme les ébauches des exercices auxquels ils se livreront dans l’âge avancé. » À travers cette assertion, le Stagirite nous apprend que l’éducation de l’enfant doit être faite dans la perspective de son devenir. Pour atteindre cet objectif, le philosophe voit dans le jeu le moyen le plus adéquat. En clair, « l’enfant doit s’amuser à devenir, par imitation (mimèsis), ce qu’il doit être en jouant. » (L. Bachler, 2016, p. 63).
Cette approche fait de l’expérience ludique un moment incontournable dans l’éducation de l’enfant. Cette perspective mérite alors d’être explorée pour faire face à la problématique de la violence dans l’espace universitaire. Voulons-nous un milieu universitaire stable et pacifique ? La solution passe par la soumission des enfants dès leurs bas âges à l’expérience du jeu. Mais chez Aristote, il ne s’agit pas de n’importe quel jeu. Il indique à ce titre quelques formes de jeux, à savoir ; la gymnastique ou la danse et la poésie. En raison de cette valeur propédeutique du jeu on peut choisir d’autres jeux pour préparer la paix dans l’esprit des jeunes. Le jeu est un instrument pour la culture de la paix.
L’expérience ludique schillérienne dans la même perspective qu’Aristote nous permet également de penser la question de la violence. Chez Schiller, l’homme se définit par le jeu. Pour nous en convaincre, il écrit ceci « l’homme ne joue que là où dans la pleine acception de ce mot il est homme, et il est tout à fait homme que là où il joue. » (F.V. Schiller, 1992, p. 221). À suivre Schiller, le jeu est inhérent à la nature mais mieux, c’est lui qui confère à l’homme son humanité. En d’autres termes, c’est en jouant que s’exprime l’humanité de l’homme. L’homme n’a donc d’autre choix que de jouer. L’expérience ludique schillérienne est un moment de libération et de réconciliation en ce sens que l’instinct de jeu en un médiateur permet à l’homme de recouvrer son unité ou sa totalité. Ce rôle du jeu est plus que déterminant dans la construction de l’individu et partant dans la construction de la paix sociale. Un homme intérieurement stable et réconcilié avec lui-même grâce à la beauté ou le jeu sera par la même occasion réconcilié avec son prochain.
Au regard de ce qui précède, l’expérience ludique se présente un puissant moyen de resserrement de liens sociaux. Vu sous cet angle, l’esthétique dans son acception ludique donne à penser qu’il est possible de construire une société littéralement stable et pacifiée. Cette perspective autorise à considérer l’art comme un moyen de lutte contre la violence en milieu universitaire.
Conclusion
Au terme de cette étude, il convient de retenir que le milieu universitaire est éthiquement agonisant. Cette décadence morale est perçue comme une porte ouverte au vent de la violence qui y souffle depuis belle lurette. C’est vrai, l’espace universitaire ivoirien sans exception est pris dans un tourbillon de violence aussi bien physique que psychologique. Face à cette situation implacable, il nous a paru nécessaire de faire un recours à l’esthétique, notamment à celle d’Aristote et de Schiller. Le facteur qui a milité au choix de l’esthétique de ces auteurs tient au fait que dans leurs pensées respectives, l’éducation ou l’éthique est corrélée à l’art. Cette perspective esthético-éducative aristotélicienne et schillérienne est un paradigme pour résorber la question de la violence dans l’espace universitaire ivoirien.
Références bibliographiques
ARISTOTE, 2015, Les Politiques, trad. et prés. Pierre Pellegrin, Paris, G.F. Flammarion.
ARISTOTE, 2007, Poétique, trad. Roselyne Roc Dupont et Jean Lallot, Paris, Éditions du Seuil.
BACHLER Laurent, 2016, « Trois conceptions philosophiques de l’enfance », in Spirale, N°79, 2016, pp. 48-57.
BELFIORE Elizabeth, 2005/4 « Tragédie, thumos et plaisir esthétique », in Les Études Philosophiques, N°67, p. 451-465.
DUFLO Colas, 2006, « Approche philosophique du jeu », in La performance humaine : art de jouer, art de vivre, sous la direction de F. BIGREL, éditions du CREPS Aquitaine, p. 61-76.
FIÉ Doh Ludovic, 2007, École et violence : contribution à la critique de la régression vers la barbarie, in LE KORE, Revue ivoirienne de philosophie et de culture, N°38-2007, p. 71-89.
KONÉ G. B. Cyrille, 2017, Sur la maîtrise de la violence, Paris, L’harmattan.
LAZAR J., 2002, La violence des jeunes. Comment fabrique-t-on des délinquants ?, Paris, L’harmattan.
OZOUKOU François Koudou, 2018, « Mimèsis et Catharsis, pour une compréhension cognitiviste et éthique de l’art chez Aristote », in Nazari, N°6, pp. 193-209.
SCHILLER Von Friedrich, 1943, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Traduction de Robert Leroux, Paris, Aubier, 2e édition, 1992.
LA FESCI, CE BOULET QUE PORTE L’UNIVERSITÉ IVOIRIENNE DANS UN ÉLAN DE SERVITUDE VOLONTAIRE
Bledé SAKALOU
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Un syndicat est une association de personnes ayant pour but la protection d’intérêts communs, spécialement dans le domaine professionnel. Dans un deuxième élan définitionnel, le syndicat est une association qui a pour but de gérer, de défendre les intérêts communs à plusieurs personnes ou plusieurs groupes. Que l’on s’en tienne à l’un ou à l’autre sens et fonction de tout syndicat, celui-ci ne doit son fonctionnement qu’au nom de la liberté que lui confère la puissance publique qui n’est autre que l’État. Qu’un syndicat, au nom de la liberté de manifester, se mette à perturber l’ordre public ; manifestation susceptible de mettre à mal le bon fonctionnement des activités et actions gouvernementales, l’État qui a le monopole exclusif de l’usage de la force, peut se prévaloir de cette prérogative à l’effet d’assurer la sécurité sur l’espace universitaire. Toute autre forme de laxisme de l’État vis-à-vis d’un syndicat dont les activités subversives et confligènes à répétition pourrait laisser suggérer des accointances de celui-ci avec les membres de ce groupe. Cette étude entend non seulement analyser les raisons profondes de la « soumission » de l’État ivoirien à un syndicat, en l’occurrence la FESCI dont il a pourtant lui-même autorisé l’existence, mais également envisager des pistes de solutions en vue de mettre fin aux nombreuses crises que traversent les universités publiques ivoiriennes.
Mots clés : État, Liberté, Prérogative, Syndicat, Université, Violence.
Abstract:
A trade union is an association of people whose purpose is the protection of common interests, especially in the profesional field. In a second definitional momentum, the trade union is an association whose purpose is to manage and defend the common interests of several people or several groups. Whether we stick to one or the other meaning and function of any union, it owes its functioning only to the name of freedom conferred on it by the public power which is none other than the State. That a trade union, in the name of the freedom to demonstrate, begins to disturb public order, manifestation likely to jeopardize the proper functioning of government activities and actions, the State which has the exclusive monopoly on the use of force may avail itself of this prerogative at the effect of providing security on university space. Any other form of State laxity vis-a-vis a union whose repeated subversive and conflicting activities could lead to the suggestion of acquauintances of the latter with members of this group. This study intends not only to analyze the underlying reasons for the ‘’submission’’ of the Ivorian State to a trade union, in this case FESCI, the existence of which it nevertheless authorized itself, but also to consider possible solutions with a view to put an end to the many crises that are going through Ivorian public universities.
Keywords : Freedom, Prerogative, State, Trade union, University, Violence.
Introduction
La liberté syndicale est consacrée par la Convention numéro 87 de l’O.I.T. (0rganisation Internationale du Travail). Cette convention ayant été ratifiée par l’État de Côte d’Ivoire, il va sans dire que différents groupes d’intérêts communs (socio-professionnel) avaient toute latitude de se constituer en syndicat en vue de la promotion et de la défense des droits fondamentaux de tous ceux qui se reconnaissent en eux en tant que membres. Ainsi, à la faveur des frémissements de la volonté d’émancipation ressentis dans le monde consécutivement à la chute du Mur de Berlin en 1989, plusieurs groupes de pression à vocation politique et syndicale ont été portés sur les fonts baptismaux un peu partout dans le monde. Dans l’univers socioprofessionnel ivoirien, en plus de nouveaux syndicats qui se sont créés en ajout à l’UGTCI (Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire) ; et pratiquement le seul reconnu et en exercice jusqu’en 1990, nous avons enregistré dans le milieu scolaire et universitaire la naissance de la FESCI (Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire) en 1991. De sa date de création jusqu’à nos jours, ce mouvement d’élèves et étudiants a été au cœur de la quasi-totalité des crises et tensions observées et vécues dans le milieu scolaire et universitaire en Côte d’Ivoire.
En effet, ce groupe de pression abusivement appelé syndicat fut bien des fois responsable de l’exacerbation de vives tensions émaillées très souvent de violence physique, de destruction d’édifices et de matériels de travail en milieu scolaire et universitaire. Des situations qui ne manquent pas de mettre à mal et de perturber durablement le fonctionnement harmonieux des universités publiques et privées. Au nom du sacro-saint principe régalien de la force publique dont il est l’exclusif détenteur, l’État de Côte d’Ivoire a plus d’une fois décrété la dissolution de la FESCI. Seulement voilà : ce mouvement syndical semble avoir les vertus du phénix qui renaît toujours de ses cendres. Ce syndicat continue en effet, de mener ses activités syndicales au vu et au su non seulement des autorités gouvernementales, mais aussi et surtout des autorités universitaires ivoiriennes. À partir d’une méthode analytique quadripartite, ou qui se décline en quatre parties, le principal objectif de la présente étude dont le titre est : « La FESCI, ce boulet que porte l’université ivoirienne dans un élan de servitude volontaire »consiste à analyser les raisons profondes de la ‘’ soumission’’ volontaire des différents gouvernements de l’État ivoirien de 1990 à nos jours, à l’autorité d’un syndicat dont il a lui-même autorisé l’existence. Dans une démarche ultime, nous entendons explorer les réformes susceptibles d’instaurer un climat de quiétude qui pourrait lui-même participer au processus de redynamisation de nos universités alors en crise permanente ou persistante.
1. Nature et fondement idéologique d’un syndicat
Sans trop vouloir faire une historiographie du syndicalisme, il convient de faire remarquer ici, que l’avènement des syndicats perçus comme groupements de défense d’intérêts communs propre à une corporation professionnelle, est consécutif à l’introduction des notions de capital et de salaire dans l’univers du travail notamment. De façon coutumière et d’un point de vue économique surtout, le capital est l’ensemble des moyens financiers et techniques dont dispose un particulier ou une entreprise commerciale ou industrielle à des fins d’investissement durable et rentable. Quant au salaire, et cela toujours d’un point de vue purement économique, il est appréhendé comme la rémunération d’un travail ; rémunération payée régulièrement par un employeur à un employé dans le cadre d’un contrat de travail.
Au demeurant, c’est à Karl Marx que nous devons les approches philosophiques des notions de capital et de salaire précisément en économie politique précisément. Dans son texte Manuscrits de 1844, K. Marx (1990, p. 64) nous éclaire sur l’objet ou le but fondamental du travail dans la vie de l’homme en ces termes : « L’objet du travail est l’objectivation de la vie générique de l’homme : car celui-ci ne se double pas lui-même d’une façon seulement intellectuelle, comme c’est le cas dans la conscience, mais activement, réellement, et il se contemple donc lui-même dans un monde qu’il a créé. » Dire de l’homme qu’il est un être générique, revient à dire que ce dernier s’élève au-dessus de son individualité subjective, mieux encore, qu’il reconnaît en lui l’universel objectif et se dépasse ainsi en tant qu’être fini. Autrement dit, il est individuellement le représentant de l’Homme générique. Et cette représentation se manifeste concrètement dans son activité vitale qu’est le travail. L’homme fait de son activité vitale elle-même l’objet de sa volonté et de sa conscience. C’est pour cela seulement que son activité vitale est une activité libre. Cependant, avec la révolution industrielle dont les premiers moments de manifestation concrète remontent au début du XVIIe siècle, nous assistons à la fragmentation de la société en couches antagonistes. Suite à cette fragmentation de la société avec d’un côté la masse laborieuse et de l’autre la portion menue de la société ; c’est-à-dire la classe des propriétaires des moyens de production, le travail qui était pour l’homme manifestation de sa volonté, n’est plus qu’un moyen de subsistance lorsque s’opère une mutation qui fait de l’homme un ouvrier désormais. L’homme ne peut plus se conserver en tant que sujet physique qu’en qualité d’ouvrier, et non en qualité d’homme ayant directement accès aux moyens de conservation de son être que lui offre la nature. L’époque moderne coïncide pour ainsi dire avec le travail dont l’essence n’est plus une manifestation de la personnalité de l’homme, l’objectivation de cette personnalité. D’extériorisation des forces essentielles de l’homme, le travail s’est transformé en une activité consentie en vue d’un gain. Il devient extérieur à l’ouvrier lui-même. Alors qu’il était jusqu’alors une activité consubstantielle à la nature humaine, le travail devient une activité socio-professionnelle. Il requiert en effet, pour son accomplissement des compétences, des qualifications, des qualifications reconnues comme telles par la société, etc.
La division des tâches, héritée du taylorisme et qui accompagne la professionnalisation du travail a pour principales implications « l’accroissement de volume et de densité des sociétés humaines qui renforcent l’intensité de la lutte pour la vie » selon E. Durkheim (1993, p. 12) d’une part, et d’autre part un travail dorénavant effectué dans la douleur de l’effort physique. En effet, la machine qui possède le merveilleux pouvoir d’abréger le travail et de le rendre plus productif induit programmatiquement la faim et surtout fatigue nerveuse à l’excès. Par un étrange caprice du destin, les nouvelles sources de richesse se transforment à contrecoups, en source de détresse. Le processus qui mène au gain susceptible de permettre à l’ouvrier de gagner ou d’entretenir sa vie est caractéristique du labeur, de ce que Marx (1990, p. 60) a appelé, le travail aliéné ainsi qu’il le dit :
Le travail extérieur, le travail dans lequel l’homme s’aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l’ouvrier du travail apparaît dans le fait qu’il n’est pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même, mais appartient à un autre.
Il serait donc loisible de dire que l’avènement de l’idée du syndicalisme s’inscrit au départ dans l’univers exclusif du travail. Cependant, le syndicalisme finit par gagner le monde scolaire et universitaire notamment à partir de l’explosion en France de ce qu’il est convenu d’appeler l’insurrection estudiantine de Mai 1968. Bien avant d’analyser l’irréversible impact de ces évènements estudiantins de mai 68 dans tous les espaces universitaires dans le monde en général et dans la plupart des pays sous-développés comme la Côte d’Ivoire en particulier, il est judicieux de faire un éclairage sur ce qui relève des prérogatives de tout syndicat et les contraintes auxquelles il devrait être en principe et légalement astreint.
2. Prérogatives et limites d’un syndicat
2.1. Les prérogatives de toute association syndicale
Le syndicalisme appréhendé aujourd’hui comme une réalité sociologique intangible, participe de la modernisation de la société elle-même. Au départ vécu dans une espèce d’ambiance anarchiste faite de défiance et même d’attaque physique des membres et autres responsables du patronat, le syndicalisme a fini par acquérir au fil du temps une assise juridique en tant que son existence et son fonctionnement seront prescrits par des dispositions légales. À partir de là, la présence des syndicats dans le milieu du travail, va répondre à un double impératif : améliorer les conditions dans lesquelles les ouvriers et autres travailleurs sont appelés à remplir leurs tâches d’une part, et d’autre part, garantir ou assurer un gain matériel susceptible d’assurer une vie décente aux travailleurs. Au vu des différentes législations qui déterminent et règlementent les conditions dans lesquelles le travail devrait être effectué, les syndicats constituent un véritable contrepoids à toute intention d’abus de pouvoir dont pourraient se rendre coupables les employeurs ; propriétaires des moyens de production. Tout syndicat susceptible de mobiliser une frange importante de la population est une force révolutionnaire indéniable. À partir d’actions stratégiques et non violentes, il est capable de faire plier n’importe quel pool de décision ; qu’il soit patronal ou étatique. À ce propos, J. Préposiet (2012, p. 431) nous rapporte l’idée suivante :
c’est donc à vous producteurs, à vous détenteurs du capital réel, qu’il appartient de faire la révolution ; ce que vous n’avez pu obtenir par persuasion, obtenez-le par la force ; non par la force violente, par les barricades et le plomb, mais par la force légale, si je puis m’exprimer ainsi, en vous croisant les bras.
« Croiser les bras » signifie ici observer un mouvement de grève caractéristique du débrayage ou du refus par les travailleurs d’accomplir leurs tâches dans une entreprise privée ou un secteur d’activité professionnelle étatique. En sa forme la plus radicale, l’idée de croiser les bras est caractéristique de la grève générale. Celle-ci peut être menée sans recours à la violence, sans effusion de sang, sans sortir du terrain de la légalité ; elle est une forme de révolution susceptible de détruire de fond en comble, l’ordre bourgeois et la propriété capitaliste. La grève générale, symptomatique de l’idée de croiser les bras, « signifie que la classe ouvrière, en sa réaction contre le milieu actuel, n’attend rien des hommes, des puissances et des forces extérieures à elle, mais qu’elle crée ses propres conditions de lutte et puise en soi, les moyens d’action. Elle signifie que, contre la société actuelle qui ne connaît que le citoyen, se dresse désormais le producteur. » (J. Julliard, 1971, p. 214.) Face à la morale de tous ceux qui se contentent de posséder, la grève générale fait se dresser la morale des producteurs, la morale de l’homo faber, de l’homme qui produit, qui fabrique, du créateur qui travaille et façonne en profondeur la matière. La lutte syndicale seule permet aux travailleurs de mener un combat qui est le leur et de défendre les intérêts de leur classe ; en un mot d’être eux-mêmes. Cependant, si la liberté d’expression et la latitude à mener des luttes en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des syndiqués constituent les principales prérogatives de tout mouvement syndical, celui-ci est tout aussi bien astreint à des contraintes, à des limites.
2.2. Les limites opposables à tout mouvement syndical
La politique est une modalité qui suggère l’idée de gestion des affaires de la cité selon la définition étymologique grecque que nous avons du mot politique. À partir de joutes électorales démocratiques où il est question de suffrages universels en effet, des groupements politiques, tout comme des individus isolés ou indépendants sont appelés ou coptés pour l’exercice et /ou la gestion du pouvoir politique selon que le corps social lui-même en décide ainsi. Qu’un syndicat qui a pour vocation essentielle de défendre les intérêts de ses membres en vienne alors à interférer dans des questions purement politiques, cela fait désordre. Par ailleurs, pour garantir la continuité du service public en cas de cessation générale de travail, les syndicats ; qu’ils soient du secteur public ou du secteur privé où ils remplissent une mission de service public, sont tenus d’assurer un service minimum pour ne pas mettre à mal les fondements sociologiques de la communauté. C’est notamment le cas du secteur de la santé publique. En outre, tout syndicat a l’obligation d’avertir l’autorité dont il relève ou dont il dépend de son intention d’arrêter le travail en faisant parvenir à cette autorité un préavis de grève soixante-douze (72) heures avant. Ainsi, il est à noter par définition, que la mission de tout syndicat est d’ordre corporatiste ; en rapport étroit avec le monde du travail et rien de plus. Et en conséquence, c’est par des glissements sémantiques malencontreux que nous en sommes arrivés à l’appellation de syndicats des groupes de défenses d’intérêts communs dans le milieu scolaire et universitaire.
3. Contexte de l’avènement des mouvements syndicaux dans le milieu universitaire ivoirien et leur gestion par les différents gouvernements de 1990 à nos jours
3.1. Le « vent de l’Est » ou l’impulsion démocratique des mouvements de protestation
L’explosion sociale en France de mai 1968 constitue incontestablement un facteur déterminant dans l’histoire du « syndicalisme » en milieu universitaire. L’insurrection des étudiants en mai 1968 en France, mouvement dont l’ampleur semble avoir énormément surpris ses principaux acteurs eux-mêmes, s’inscrit dans une vague de radicalité et d’agressivité revendicative. Dans la continuité de ces événements avec la chute du Mur de Berlin en 1989 notamment, tous les pays, riches ou pauvres, auront été gagnés par le virus de la contestation en milieu universitaire. À l’Ouest, au cœur de la civilisation occidentale, c’est la société de consommation, reposant sur le gaspillage et l’injustice sociale avec son culte du confort matériel et intellectuel qui est dénoncée. À l’Est, on réclame plus de liberté d’expression et on conteste le caporalisme idéologique de type néo-nazi des partis au pouvoir. Au sud, dans les pays du tiers monde, c’est à la dictature des gouvernements et à l’impérialisme exacerbé du monde occidental que l’on s’en prend. Un peu partout dans le monde, on constate le même conflit de générations. Spontanément, une solidarité de fait s’est établie au sein de la jeunesse, à l’intérieur d’un même pays et sur le plan international, face à la génération précédente et contre ce qui passe aux yeux de la jeunesse pour du mandarinat et l’establishment. Dans cette perspective, Rudi Dutchke, leader des étudiants grévistes allemands de l’époque de Mai 68 dit ce qui suit :
Notre contestation de la culture n’est pas superficielle. On sait très bien qu’on ne peut créer une culture révolutionnaire avant qu’une révolution ait pris le pouvoir. On sait très bien aussi que, plongé dans la culture bourgeoise, on ne peut pas s’en sortir complètement. Ce que nous pouvons essayer d’élaborer pour l’instant, c’est une critique de la culture, qui envisage une culture non bourgeoise, et qui restera liée à la société dans laquelle elle s’élaborera. (…) Il faut faire une révolution de la culture, une révolution de la sexualité. Nous ne voulons pas seulement transformer le monde, mais aussi changer la vie. M. Kravetz (1968, pp. 469-470)[73]
À l’origine de tous les mouvements de protestation, on trouve une jeunesse en proie à un profond désir de changement dans un monde clos où l’on se sent à l’étroit ; univers dans lequel l’abondance des biens matériels s’accompagne d’un vide spirituel et démocratique. C’est le constat du déficit démocratique qui sera du reste, à l’origine de l’avènement de la pluralité des mouvements syndicaux dans les milieux universitaires en Afrique notamment. Pour rappel, sous l’impulsion des standards démocratiques observés à l’Ouest, les pays sous occupation et domination idéologique soviétique appelés pays de l’Est aidés par certains pays occidentaux, ont remué le « cocotier » pour faire vaciller tous les régimes répressifs de l’époque. Ainsi, le 09 novembre 1989, le principal symbole de l’absence de démocratie dans ces pays ; symbole que l’histoire contemporaine appellera le Mur de Berlin, s’écroule. Une vague successive et manifeste de volontés de liberté effective s’empare alors de tous les pays en proie à la domination sociopolitique et économique. La plupart des pays africains qui faisaient jusque-là la non moins douloureuse et répressive expérience des partis uniques ne seront pas épargnés par cette frénésie de liberté totale recouvrée. Toute l’écologie sociale de ces pays africains sera en effet bouleversée induisant une floraison de partis politiques et groupements associatifs socioprofessionnels. Ce mouvement de libération que l’on baptisera symptomatiquement « vent de l’Est » annonçait alors des signes encourageants d’un renouveau démocratique espéré et attendu par toutes les couches socioprofessionnelles et politiques de chaque pays. Dans l’univers scolaire et universitaire de la Côte d’Ivoire, ce renouveau démocratique hérité du « vent de l’Est » sera caractéristique de la naissance de plusieurs syndicats d’étudiants dont un d’entre eux sera de loin, le plus en vue ou représentatif d’une jeunesse en quête de liberté et de réalisation de soi ; en l’occurrence la FESCI (Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire) avec à sa tête Martial Ahipeaud.
3.2. Le laxisme de l’État ivoirien face aux actes de violence imputables à la FESCI
C’est en marge des troubles sociaux vécus en Côte d’Ivoire au début des années 1990, que la FESCI (Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire) a vu le jour exactement le 21 Avril 1991. Dans la trame principale de sa charte, ce mouvement d’étudiants a d’emblée inscrit son mode de fonctionnement dans une perspective de gauche alors que le régime politique du parti unique d’alors tenu par le premier président du pays, Félix HOUPHOUËT-BOIGNY était dans une dynamique historique d’idéologie politique de droite qui ne dit pas son nom. Par définition, l’idéologie politique d’obédience gauchiste, a généralement en vue la promotion et la défense des valeurs caractéristiques de la démocratie. Pour les partisans de cette idéologie politique, celle-ci doit impérativement être l’incarnation des exigences et principes suivants : une garantie des libertés civiles et religieuses, l’institution du jury, l’instauration du suffrage universel, la limitation des mandats électifs, une stricte subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil, l’accès de tous aux fonctions publiques, administratives, et militaires, l’accès de tous à la formation (éducation), à l’information, aux soins de santé et à la sécurité sous ses diverses formes. Le but ultime de ces principes et dispositions étant de protéger l’individu, le citoyen des empiètements de l’autorité politique publique incarnée par l’État. Il s’agit en clair de reconnaître à l’individu en tant que citoyen ses droits et libertés dans le cadre d’une vie démocratique effective en opposition au parti unique. La démocratie est pour ainsi dire une institution globale de la société qui se présente comme l’effet d’une mutation historique, une fois que la modernité a rompu les amarres d’un fondement extra-social du pouvoir. La démocratie est pour ainsi dire caractéristique de l’idée que le droit et le pouvoir ne proviennent plus d’un quelconque ordre divin ou absolu, immuable et indiscutable ; mais que le droit et le pouvoir se posent comme des dimensions ou des institutions socio-historiques dont le critère de légitimité est la société civile elle-même. La démocratie est en définitive universellement reconnue comme l’incarnation du pouvoir dont le peuple en constitue la structure fondamentale et le détenteur exclusif. Aussi, l’érosion de la confiance placée par les citoyens en leurs dirigeants et en les institutions politiques est-elle au fondement des manifestations et autres mouvements de rue à l’effet de rétablir cette démocratie.
L’État de Côte d’Ivoire devrait-il toujours accuser un profond déficit démocratique avéré dans son fonctionnement au point d’avoir des rapports conflictuels à répétition avec la FESCI depuis la naissance de ce mouvement syndical ? Henry David Thoreau nous rappelle qu’« une corporation ne possède pas de conscience mais une corporation d’hommes de conscience est une corporation qui dispose d’une conscience. » (Thoreau H.D, 2017, p. 7). Cette idée est symptomatique d’une remarque qui suggère elle-même une question. En tant que mouvement de masse à caractère révolutionnaire, ayant vu le jour suite à des manifestations de rue, la FESCI pouvait-elle disposer d’une conscience sans impulsion et propension à la violence ? Nul n’est sans ignorer en Côte d’Ivoire que pratiquement toutes les crises vécues dans les écoles et universités ivoiriennes ; certaines occasionnant même bien souvent des pertes en vie humaine, la FESCI est la plupart du temps au cœur des dites crises.
Une longue, une très longue liste d’actes de violence et de morts d’élèves et d’étudiants est en effet associée à l’histoire de ce mouvement syndical. Par décence, nous éviterons de procéder ici à une énumération exhaustive des actes de violence imputables à ce mouvement syndical. Il est néanmoins, utile de rappeler quelques faits tragiques et marquants qui auront inscrit la FESCI dans le giron des organisations aux pratiques mafieuses. Il y a d’abord eu la toute première crise sanglante et mortifère du 16 juin 1991. En ce jour, en effet, une immense foule d’étudiants répondant à l’appel de la FESCI pour, dit-on, libérer « le Koweit » c’est-à-dire la cité universitaire de Mermoz située dans la commune de Cocody, part du Campus de Cocody, emprunte des chemins vallonnés de la broussaille appelée « Dien Bien Phu » qui sépare le campus de la cité Mermoz. Une fois sur place, un étudiant loubard dénommé Thierry Zébié anciennement membre de la FESCI, sera tué à coup de gourdin et autre arme blanche. Comme mentionné plus haut, durant les années qui suivront, d’autres évènements tragiques avec mort d’homme allongeront la liste. Parallèlement à ces évènements tragiques, d’autres faits qui rappellent les méthodes mafieuses dont la FESCI se rend responsable ou coupable sont à mentionner. Il s’agit entre autres de la gestion des résidences universitaires en ce qui concerne notamment les admissions des étudiants dans les chambres des cités universitaires, du rançonnement des étudiants qui perçoivent leurs bourses d’étude, etc.
Depuis une quinzaine voire même une vingtaine d’années, la FESCI s’est arrogée le droit ou la légitimité d’avoir un droit de regard sur le processus d’admission des étudiants dans les chambres des cités universitaires. Certains responsables du mouvement réquisitionnent, au su et au vu des autorités universitaires, des chambres qui seront louées à des étudiants. Les sommes d’argents versées par les étudiants locataires de ces chambres n’auront évidemment jamais de traces comme écritures dans les registres de comptabilité du CROU (Centre Régional des Œuvres Universitaires). Un autre fait qui a trait aux pratiques mafieuses de la FESCI est à signaler. Il s’agit de cette espèce d’impôt qui est pris de force sur les bourses des étudiants lorsque ces derniers les perçoivent. Autant de dérives qui suscitent de nombreuses interrogations. La FESCI est-elle au-dessus des lois en Côte d’Ivoire pour qu’elle survive chaque fois à sa dissolution lorsque celle-ci est prononcée par les services compétents du pays ? Y a-t-il un intérêt particulier inavoué qui expliquerait le statut d’impunité dont jouit la FESCI ? Les crises permanentes vécues dans les universités et dans les établissements secondaires en Côte d’Ivoire profiteraient-elles à certains ? Se satisfait-on de la situation peu reluisante de nos universités qui n’apparaissent dans aucun classement des meilleures universités africaines parce que non performantes ?
Les questions ci-dessus appellent à un moment de réflexion sur l’idée de la servitude volontaire qui semble correspondre à l’attitude de l’État de Côte d’Ivoire dans son rapport à la FESCI. Et concernant cette idée de servitude volontaire notamment, l’excellent texte « Discours de la servitude volontaire » d’Étienne de La Boétie nous sert de référent historico-théorique adéquat. La principale remarque qui se dégage de ce texte c’est qu’à travers celui-ci, l’auteur aborde l’épineuse question du principe d’autorité dans le rapport que les peuples entretiennent avec leurs dirigeants dépeints sous les traits du tyran par La Boétie lui-même. Comment peut-il se faire que « tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations, endurent quelquefois un tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent ? » (E. De La Boétie, 2016, p. 14.)
Telle est la principale question que pose l’auteur qui, en vérité, cherchait une explication à l’étonnant et tragique succès que connaissent les tyrannies de son époque. Dans un parallélisme des formes, nous pouvons poser cette même question pour essayer de comprendre le rapport ambigu que l’État de Côte d’Ivoire entretient avec la FESCI. Comment peut-il se faire qu’un seul ‘’syndicat’’ réussisse à imposer ses façons de faire peu recommandables à plusieurs autres groupements d’intérêt commun ? Pourquoi l’État de Côte d’Ivoire n’use-t-il pas des prérogatives que lui donne la loi pour régler une fois pour toute la question des violences récurrentes dans le milieu universitaire ? Autant de questions qui appellent des solutions d’urgence.
4. Solutions alternatives pour faire face aux récurrentes crises en milieu universitaire
Pour éviter la périlleuse aventure de l’exhaustivité, nous voudrions retenir ici trois (3) perspectives d’alternatives qui pourraient aider à une sortie durable de crises vécues par les universités publiques en Côte d’Ivoire. Il s’agit de la réaffirmation de l’État de droit pour lequel la FESCI ne semble avoir aucun égard, de la redéfinition des prérogatives reconnues à tout mouvement d’ordre syndical, l’intégration des responsables des différents mouvements d’étudiants dans les conseils d’UFR des universités pour une sorte de mise en responsabilité de ces derniers.
L’État est un organisme ou une personne morale de droit commun qui est astreint à trois principaux devoirs régaliens. Il s’agit de la santé, de l’éducation et de la sécurité des biens et des personnes. À partir de ce qu’il assure la sécurité des uns et des autres, l’État permet à chacun de faire l’expérience de la liberté. Au demeurant, l’essence de l’État va même au-delà de ces trois prérogatives selon Hegel. Pour ce dernier, en effet, « l’État, d’une manière générale, n’est pas un contrat, et son essence substantielle n’est pas si exclusivement la protection et la sécurité de la vie et de la propriété des individus. Il est plutôt la réalité supérieure et même il revendique cette vie et propriété et réclame qu’on les sacrifie. » F. Hegel (1940, p. 221.)
Par ailleurs le cadre juridique qui régit non seulement son fonctionnement, mais aussi et surtout permet la fixation des droits et limites auxquels tous les membres du corps social sont tenus, est le principal socle de sa légitimité. Tout individu ou groupes d’individus ne sont citoyens que parce qu’ils sont membres d’un État. C’est dans l’État que les hommes qui le constituent possèdent dans leur entièreté et dans leur diversité, la liberté, la moralité objective. Toutes choses pour dire qu’il est du devoir de l’État de Côte d’Ivoire, de rappeler et d’affirmer son autorité en toutes circonstances. Gouverner et juger participent bien d’une entreprise d’intervention dans la vie des membres de la cité en vue de réaliser le bien commun. Une décision gouvernementale doit souvent être restituée dans une longue chaîne d’actions et de projets : elle s’inscrit dans une politique de sens où elle ouvre des possibles et dessine un nouvel horizon. Rappeler bien souvent aux personnes physiques ou morales, la notion de responsabilité participe de la construction et de la consolidation de ce nouvel horizon social. De façon classique, le concept de responsabilité renvoie à trois idées distinctes mais intimement liées : d’abord à l’idée d’état au sens où l’on dit par exemple de parents qu’ils sont responsables de leurs enfants et des actes de ces derniers, ensuite de l’idée de capacité au sens d’être en mesure de discernement nécessaire entre le bien et le mal ; le permis et le défendu, et enfin de l’idée d’obligation au sens d’avoir à assumer ses propres actes. Et c’est cette troisième approche sémantique de l’idée de responsabilité ; celle d’avoir à répondre de ses actes qui doit être la forme d’affirmation de l’état de droit dont il est question dans la présente démarche.
D’un point de vue juridique, la responsabilité désigne le fait pour une personne juridique (physique ou morale) d’être tenue à certaines obligations, en conséquence de certains actes qu’elle est reconnue avoir accomplis. La responsabilité est soit de nature contractuelle, c’est-à-dire procédant d’un manquement à l’accord des volontés, soit de nature délictuelle, c’est-à-dire déterminée par une attitude déviante qui a la fâcheuse conséquence d’entraîner un dommage pour autrui. Ici se situe alors la distinction classique entre responsabilité civile et responsabilité pénale. La première renvoie au dommage causé, la seconde à la violation délibérée de la loi. Si, en matière civile, la seule causalité suffit à fonder la responsabilité, dans le registre pénal, on établit celle-ci à partir des situations, des circonstances et des intentions. Cela dit, dans l’un comme dans l’autre cas, il s’agit de répondre de ses actes et de leurs conséquences pour autrui. Un gouvernement ne saurait s’abstenir ; au risque de se renier soi-même, de trancher une question sous prétexte qu’elle serait délicate ou controversée. Au contraire ; c’est parce qu’une question est difficile qu’elle est soumise à un jugement. Celui du gouvernement ivoirien ; pour ce qui est de l’affirmation de son autorité communément appelée état de droit, ne devrait aucunement s’accommoder avec une quelconque fioriture ; encore moins être sujet à toute compromission.
Concernant la deuxième alternative comme solution préconisée, il est bon de rappeler que les années 1990 constituent un tournant décisif dans l’histoire du syndicalisme en Côte d’Ivoire. Ne voulant pas avoir le sentiment diffus d’être « restée au-dehors » ; pour reprendre une saisissante formule de Blanqui L.A. (2009, p. 65), la FESCI s’est dans ses premiers moments d’existence, d’emblée manifestée comme une puissance sociale cherchant à affirmer sa dignité dans la revendication positive de sa distance, une certaine aspiration de sa reconnaissance en tant que sujet politique majeur. Mais qu’à cela ne tienne, l’existence des différents groupements d’intérêts commun ayant été entérinée par l’État de Côte d’Ivoire, il appartient à ce dernier de rappeler aux différents groupements mentionnés plus haut, à la limite même de redéfinir les prérogatives qui sont les leurs sans oublier les obligations auxquelles ils sont légalement soumis. Si la garantie des libertés civiles, religieuses et syndicales ; si l’accès de tous à la formation (éducation), à l’information, sont constitutifs de la démocratie en termes de droits sociaux et individuels, les mêmes principes démocratiques exigent que tout membre du corps social se soumette aux prescriptions légales qui régissent le fonctionnement de l’État. Rousseau ne nous rappelle-t-il pas que l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ? La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles de la société et la société elle-même. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ou à subir ce qu’elle n’ordonne pas. La démocratie, ce n’est pas seulement la loi de la majorité et la défense des intérêts des grandes communautés, mais aussi et surtout la protection des minorités.
La troisième alternative que nous entrevoyons dans la perspective des solutions durables aux récurrentes crises vécues dans le milieu universitaire est d’ordre participatif. Elle a trait une fois de plus à l’idée de responsabilité mais comprise sous un autre angle. Nous avons analysé plus haut que dans un cadre juridique, être responsable signifie répondre de soi et de ses actes devant la loi. Mais avec un auteur comme Emmanuel Levinas, être responsable ne consiste plus à répondre seulement de soi, mais plus fondamentalement, à répondre d’autrui, à répondre de ce qui est fragile, de ce qui se donne comme éminemment vulnérable.
Si le principe de l’acceptation de la présence de groupes de défense des intérêts des étudiants a été entériné par les instances gouvernementales, cela revient à dire que l’on reconnaît que ces groupements de défense d’intérêts communs aux étudiants, groupements pris dans leur diversité, constituent des acteurs majeurs dans la vie et la marche des universités. Aussi, copter les différents responsables des syndicats d’étudiants dans les conseils d’UFR (Unité de Formation et de Recherche) serait-il une forme de responsabilisation de ces derniers. Encore faut-il que les leaders des syndicats d’étudiants soient instruits de l’idée qu’être responsable, ce n’est pas simplement être considéré à bon escient comme tel par les autres, par les institutions qui assurent le contrôle et la cohésion sociaux, mais s’affirmer soi-même responsable. Démarche qui renvoie à la responsabilité morale, qui elle-même ne présuppose aucune réciprocité et ne s’accompagne d’aucune attente, si ce n’est celle de protéger ceux pour qui nous avons tenus ou accepter d’être responsable. E. Levinas (1976, p. 406) nous rappelle de surcroît que « la responsabilité de protéger, relève d’une discipline dynamique et active qui met en avant les droits des autres. » Pour sa part, l’éthique kantienne nous enseigne qu’un acte est moralement bon si et seulement s’il est accompli par devoir. En conséquence de cela, face à l’autorité de l’État perçue comme puissance publique, la FESCI doit faire sienne la notion de responsabilité. Elle doit, dès lors, faire un point d’honneur éthique à sa responsabilité et ne défendre que les intérêts et les droits fondamentaux des élèves et étudiants sans autre forme d’intéressement, car, comme dit encore Levinas (2001, p. 27), « Le désintéressement est sortie de l’être, oubli de soi, pour pouvoir précisément s’ouvrir à l’autre. »
Conclusion
Conscient qu’une vie sans un minimum d’organisation les mènerait dans une aventure périlleuse, les hommes s’associent en vue de former une alliance interne susceptible de contrer toute forme d’injustice. En effet, il est établi que l’homme a tendance ou est naturellement porté à agir par la voie de l’injustice et à la commettre volontairement ; vu qu’il est bien souvent prompt à faire prévaloir par tous les moyens ses intérêts personnels matériels au détriment de l’intérêt collectif.
L’État, forme cristallisée de cette association de sauvegarde des intérêts des citoyens concentre avec lui toutes les prérogatives y compris l’usage de la violence. La violence perçue comme ivresse et folie de la négation est certes caractéristique du refus irrationnel de tout discours. Elle enfante le désordre et la discorde. De celle-ci, la mythologie romaine nous enseigne qu’elle est une divinité malveillante que Jupiter a chassée du ciel, car elle ne cessait de troubler et de brouiller entre eux les habitants de l’Olympe. Descendue sur terre, elle se fait un criminel plaisir de semer partout où elle passe les querelles et les dissensions, dans les États, dans les familles, dans les ménages.
Cependant, l’usage qui peut être fait de la violence par l’État en cas de trouble à l’ordre public participe de la volonté pour lui d’assurer avec succès l’une de ses fonctions régaliennes en l’occurrence la sécurité pour tous. M. Weber (1991, p. 100) nous rappelle à cet effet ce qui suit : « Il faut concevoir l’État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. » La liberté signifie autodétermination et autonomie aussi bien pour l’État lui-même, que pour les individus-citoyens. L’État apparaît pour ainsi dire comme le principal facteur de préservation des libertés individuelles et collectives à partir de l’usage légitime de la violence physique. Il est et demeure le régulateur exclusif de toute l’écologie sociale d’un pays reconnu comme tel. F. Hegel (1958, p. 65) précise même que « c’est dans l’État, réalité supérieure que la liberté acquiert une existence objective et jouit de son objectivité. » Aucune action gouvernementale, aucun projet de développement socioéconomique d’intérêt public ou même privé ne peuvent connaître un début d’exécution et encore moins un aboutissement souhaité dans un pays régulièrement enclin à un climat social délétère. Au-delà du cadre de formation académique qu’elle représente, l’université est par principe un formidable facteur de développement socioéconomique et culturel d’un pays. Encore faut-il que les conditions de réussite de cette noble vocation soient réunies.
Selon P. Hountondji (2003, p. 11), « l’origine de la guerre et de la violence se trouve dans la crise du langage qui fait qu’on emploie les mêmes mots en leur donnant des sens totalement différents, développant ainsi un dialogue de sourds. » Le dialogue de sourds qui a cours entre l’État de Côte d’Ivoire et la FESCI depuis plus de trois décennies avec pour principale conséquence, la persistance des crises dans les universités publiques ivoiriennes, est consécutif au rapport ambigu que l’État de Côte d’Ivoire entretient avec les notions de vérité et de responsabilité. Depuis la charte de l’ONU en date de 1948 qui consacre la liberté et l’égalité pour tous devant la loi, tous les hommes ou presque reconnaissent qu’il existe un droit à la revendication. Il s’agit du droit de refuser de prêter allégeance au gouvernement, et le droit de lui résister lorsque sa tyrannie et son inefficacité sont manifestes et mettent en cause leurs droits. L’État de Côte d’Ivoire est-il pour autant si tyrannique avec une inefficacité profonde et avérée pour ne pas être en mesure d’instaurer de manière pérenne un climat de paix et de stabilité dans nos universités publiques ? Faire régner la liberté dans toutes ses formes d’expression possibles par la force ne fait pas d’un État une tyrannie exerçant sans limite un pouvoir totalitaire ; car, « l’État totalitaire est une forme de retour des croyances qui fonde l’asservissement d’un conglomérat d’individus déboussolés en un peuple au destin particulier, providentiel » nous dit P. Riviale (2005, p. 134). Il est fort possible pour l’État ivoirien dans son rapport avec la FESCI et aux autres groupements d’intérêt commun de fonder la paix et la quiétude sur la puissance publique, la force de pouvoir légitimement adossées à la force de la loi. Le tout, en définitive, c’est que le gouvernement ivoirien soit en mesure de surmonter ce hiatus en posant la culture de la paix comme valeur première de notre propre société.
Références bibliographiques
BLANQUI Louis Auguste, Ni Dieu Ni Maître, Paris, Éditions Aden.
De LA BOÉTIE Étienne, 2016, Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion.
DURKHEIM Émile, 1993, De la division du travail social, Paris, Alcan.
HEGEL Georg Wilhelm, 1958, Principes de la philosophie du droit, Trad. André Haan, Paris, Gallimard.
HOUNTONDJI Paulin, 2003, L’acte et la parole : pour penser la violence aujourd’hui. Actes du Colloque « Paix, Violence et Démocratie en Afrique » du 9 au 11 janvier 2002 à Abidjan, Paris, L’Harmattan.
JULLIARD Jacques, 1971, Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d’action directe, Paris, Seuil.
LEVINAS Emmanuel, 2001, Autrement qu’être, Paris, Librairie générale française. (Le Livre de poche).
LEVINAS Emmanuel, 1976, Difficile Liberté, Paris, Albin Michel.
KARL Marx, 1990, Manuscrit de 1844, Trad. Emile Bottigelli, Paris, Éditions Sociales.
KRAVETZ Marc, 1968, L’insurrection étudiante 2- 13 Mai 1968, Paris, Union Générale d’Éditions.
PRÉPOSIET Jean, 2012, Histoire de l’anarchisme, Paris, Éditions Arthème Fayard.
RIVIALE Philippe, 2005, Un revers de la démocratie, Paris, L’Harmattan.
THOREAU Henry David, 2017, La désobéissance civile, Trad. Jacques Mailhos, Éditions Gallmeister.
WEBER Max, 1991, Le savant et le politique, Trad. Isabelle Kalinowski, Paris, Flammarion.
Tiasvi Yao Raoul AGBAVON
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Les espaces universitaires tendent à devenir le lieu d’incubation de différentes formes de violences dont les causes réelles ne sont pas toujours clairement identifiées. Des revendications des acteurs de cet espace débouchent, le plus souvent, sur des mouvements violents qui rendent délétère l’atmosphère universitaire. Ces violences, qui se sont estompées après la crise postélectorale ivoirienne de 2011, ont repris de plus belle depuis 2018 et connaissent une recrudescence avilissante dans le milieu universitaire ivoirien. Si ces violences ont connu un regain extraordinaire ces dernières années sur les espaces universitaires ivoiriens, cela pourrait être dû aux maintes crises socio-politiques et militaires qui ont secoué la Côte d’Ivoire. Dès lors, il convient de rechercher le déterminisme de ce phénomène ainsi que la normativité qui l’accompagne. Tel est l’objet de cette contribution qui, à partir des concepts de déterminisme et de normativité chez Claude Bernard et Georges Canguilhem, qui permet d’identifier quelques raisons subtiles des violences en milieux universitaires comme un phénomène pernicieux qui semble s’ériger en normes de méthodes revendicatives.
Mots clés : Espace universitaire, déterminisme, normativité, phénomène pernicieux, violence.
Abstract:
Universities tend to become the breeding ground for various forms of violence, the real causes of which are not always clearly identified. The demands of the actors in this space most often lead to violent movements that make the university atmosphere unhealthy. This violence, which faded away after the Ivorian post-electoral crisis of 2011, has resumed in earnest since 2018 and is on the rise again in the Ivorian university environment. If this violence has had an extraordinary resurgence in recent years in Ivorian universities, this could be due to the many socio-political and military crises that have shaken Côte d’Ivoire. It is therefore necessary to investigate the determinism of this phenomenon as well as the normativity that accompanies it. This is the purpose of this contribution, which, based on the concepts of determinism and normativity in Claude Bernard and Georges Canguilhem, identifies some subtle reasons for violence in universities as a pernicious phenomenon that seems to set itself up as a norm of protest methods.
Keywords : University space, determinism, normativity, pernicious phenomenon, violence.
Introduction
En date du 06 janvier 2022, l’un des titres de L’infodrome était intitulé : « Université Alassane Ouattara : des étudiants font la loi, de très graves cas d’indiscipline révélée, voici la réaction du Synares Uao ». Ce billet de presse, qui a relaté la prise de position d’un syndicat d’enseignants-chercheurs, a mis en exergue l’image d’une atmosphère délétère à l’Université Alassane Ouattara. Toujours dans les rets d’une inclinaison à des mouvements dégradant pour les universités ivoiriennes, le 26 avril 2022, T. K. Émile (2022) a intitulé le titre de son article de presse de la manière suivante : « Côte d’Ivoire : Confusion totale à l’université de Bouaké, les étudiants gazés par les forces de l’ordre au campus 1, plusieurs blessés enregistrés ». Ces deux informations qui sont les plus récentes sur la vie universitaire, dépeignent les difficultés que rencontrent les universités ivoiriennes en général, et l’université Alassane Ouattara en particulier.
L’espace universitaire ivoirien, qui devrait être le lieu de la culture intellectuelle, se présente quelquefois comme le terreau de plusieurs formes de réactions opposées à toute expression de l’intellect. Ainsi, l’inexpressivité du rationnel et du raisonnable laisse la place à l’éruption de la violence qui sape des caractéristiques fondamentales d’une université génératrice de l’intelligentsia ivoirienne. Une telle situation, assez dégradante pour l’image de l’université ivoirienne, nécessite qu’on lui accorde une réflexion approfondie pour en saisir les raisons. Si en 2017 l’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD) a engagé une étude sur la violence dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) en Côte d’Ivoire, c’est bien dans les perspectives de trouver des pistes de solutions adéquates à ce problème dérangeant. Après la publication de leurs résultats en 2019, il semble que certains foyers de violence n’ont pas cessé d’être alimentés, posant ainsi une approche à nouveaux frais, du problème. Qu’est-ce qui justifie la persistance de la violence sur les espaces universitaires ivoiriens ? Cette question invite à l’identification des motifs de la violence, afin de pouvoir agir sur leurs survenues.
Cet article dans lequel nous analysons la violence comme mode d’expression de la crise de l’université ivoirienne, deux concepts sont convoqués pour mener notre réflexion. Il s’agit d’une part, du concept du déterminisme bernardien selon lequel chaque manifestation phénoménale est soumise à des conditions d’existence déterminées qu’il faut rechercher, et d’autre part, de la normativité canguilhémienne selon laquelle chaque organisme a tendance à s’instituer de nouvelles normes surtout dans des conditions pathologiques. Prenant appui sur ces concepts théoriques, cette réflexion s’articule autour de trois points, dont le premier saisit la violence sur l’espace universitaire comme un avatar de la crise de l’université ; le deuxième appréhende la violence à partir des concepts bernardien et canguilhémien ; le troisième et dernier point, traite d’un déterminisme de la violence qui vire vers une normativité crisique dont il faudrait prendre le contrepied en vue d’une normativité dé-constructrice de la crise.
1. La violence universitaire : un avatar de la crise de l’université
À en croire Y. Michaud (2012, p. 9),
le terme « violence » désigne (…), d’un côté, des faits et des actions, ce que nous appelons couramment des « violences », d’un autre une manière d’être de la force, du sentiment ou d’un élément naturel – qu’il s’agisse d’une passion ou de la nature. Dans le premier cas, la violence s’oppose à la paix ou à l’ordre. Dans l’autre, elle s’oppose à la mesure.
Selon l’analyse de Michaud, il y a une double dimension de la violence. Cette dualité caractéristique de la violence est telle que celle-ci relève soit du désordre, soit de la démesure. Toutefois, trouver une caractéristique globale à la violence n’est pas impossible. D’une vue synoptique, l’on peut considérer la violence comme la synthèse du désordre et de la démesure que ce soit du domaine de l’action ou des sentiments. Les excès en sont donc les maîtres-mots, d’où l’apparition d’un manque de contrôle de la situation qui s’ensuit.
La violence, d’une manière ou d’une autre, est le théâtre de la brutalité ou de la barbarie. Étant une forme d’expression, son message est presque toujours accompagné de l’exercice de la force au détriment de la mise en place d’une dialogique rationnelle et raisonnée pacifique. La violence se présente comme un moyen. Une telle idée peut être déduite des dires de B. Walter (2019, p. 7) lorsqu’il souligne ceci : « (…) si la violence est un moyen, il pourrait sembler que l’on dispose d’emblée d’un critère pour sa critique. Celui-ci s’impose lorsqu’on se demande si la violence (…) est un moyen en vue de fins justes ou injustes. » À l’analyse, Benjamin Walter recherche des pistes de réflexion pour une critique de la violence, et cette quête laisse entrevoir dans son raisonnement que cette dernière, quelles qu’en soient les fins, demeure toujours un moyen d’expression. Cette manière de s’exprimer indique alors qu’il y a un problème que l’on veut poser, dont l’immédiateté des réponses ou des solutions constitue la norme.
Au sein des universités en général et en particulier celles de la Côte-d’Ivoire, il convient de noter avec Paul N’Da, dans sa préface à l’ouvrage de l’ASCAD (2019, p. 13) que « la violence en milieu universitaire a des causes académiques, des causes sociales, qu’alimente chez les étudiants le sentiment de ne pas être écoutés et pris en considération par rapport à leurs problèmes et à leurs conditions ». En identifiant de telles causes, Paul N’Da met en évidence, le caractère complexe des violences dans les universités africaines. Il va sans dire que parler de violence tout en recherchant à appréhender les mobiles, c’est orienter la recherche causale vers un ensemble de critères aussi bien sociaux qu’académiques. Si les violences universitaires ont plusieurs causes extérieures à l’université, elles dépeignent toutefois un malaise de celle-ci. Ce malaise s’appréhende avec le fait que « la violence sur les campus est bien l’un des avatars de communication qui traduit et trahit les difficultés d’une université en crise » (ASCAD, 2019, p. 15). Une traduction des difficultés pour mettre en exergue des revendications qui ont trait aux conditions d’apprentissage et de vie difficile qui favorisent une crise ; une trahison pour relever que cette crise universitaire ou de l’université pourrait être masquée par les violences.
En tout état de cause, la violence en milieu universitaire est symptomatique d’une université en crise, voire d’un système éducatif en crise.
Étymologiquement, le terme crise désigne, particulièrement dans le domaine de la médecine hippocratique et dans la sphère judiciaire, un changement brusque, intense, exceptionnel, paroxystique, d’une durée assez nettement circonscrite, permettant le diagnostic et la décision et laissant augurer un changement décisif (…) d’une situation ou d’un état de santé donnés (L. Gutierrez, S. Alix, 2022, p. 20).
Partant de cette étymologie L. Gutierrez et S. Alix (2022, p. 20) renchérissent pour souligner que « la crise qui traverse et envahit nos sociétés – et en leur sein, l’éducation – s’inscrit dans la durée au point de devenir une sorte d’état permanent d’indécision et de doute qui tend à se généraliser à tous les horizons ». Le plus important ici, c’est le fait de loger à l’intérieur de la crise sociétale, la crise de l’éducation. Or, en faisant mention d’une crise de l’éducation, il ne serait pas incongru d’y loger celle de l’université, d’autant plus que l’université n’est pas en marge du système éducatif.
En considérant que la crise est « un changement rapide et involontaire, qui peut s’avérer favorable ou défavorable, mais qui est toujours difficile et souvent douloureux » (A. Comte-Sponville, 2013, p. 214), il ne faudrait surtout pas perdre de vue qu’elle est le reflet d’un déséquilibre ou d’une rupture. Ainsi, lorsque Thomas Kuhn analyse, au chapitre VI de La structure des révolutions scientifiques, la notion de crise et l’apparition des théories scientifiques, il met en évidence, le fait que les changements de paradigmes sont produits par une crise. En outre, « la prolifération de versions différentes d’une théorie est un symptôme de crise » (T. Kuhn, 1983, p. 106). S’il y a changement de paradigmes, c’est bien parce qu’il y en a plusieurs qui entretiennent un rapport antagonique. Cet antagonisme sous-tend les différentes versions d’une théorie qui font naître alors, une sorte de rupture théorique qui fait que l’on abandonne soit une théorie pour une autre, soit on la privilégie à une autre. Ce cas typique des sciences peut servir de modèle pour comprendre la crise de l’université.
Il y a crise en science, lorsque dans la science normale, il y a présence d’anomalies et que les paradigmes révèlent leurs insuffisances, notamment à partir des théories qui ne fournissent plus les explications nécessaires à l’interprétation d’un phénomène particulier. Partant, il y a crise à l’université, lorsque son fonctionnement normal est perturbé par des manifestations qui n’entrent aucunement dans les pratiques normales de cette dernière. Dès lors, si les violences ne sont aucunement des moyens expressifs légaux au sein des espaces universitaires, il faut comprendre qu’elles y introduisent un désordre témoignant ainsi d’un milieu en crise. Examiner, à cet effet, la crise de l’université à partir de la violence universitaire, c’est aussi l’appréhender à l’ornière de certaines théories qui peuvent en livrer d’autres intellections possibles. C’est dans cette perspective qu’on peut faire passer la violence universitaire au crible des théories bernardienne et canguilhémienne que sont le déterminisme et la normativité.
2. La violence universitaire au prisme du déterminisme bernardien et de la normativité canguilhémienne
L’un des concepts clés de la philosophie bernardienne, c’est le déterminisme. Il occupe une place importante si bien que l’on ne saurait analyser les phénomènes de la nature sans en tenir compte. En effet, chez Cl. Bernard, étudier un phénomène pour le cerner, c’est connaître son déterminisme. À cet effet, le déterminisme chez C. Bernard (2008, p. 164-165) signifie « la cause déterminante ou la cause prochaine qui détermine l’apparition des phénomènes ». En parlant de cause prochaine d’un phénomène, il ne vise que les conditions qui peuvent en permettre l’effectivité. C’est ce que G. Canguilhem (1991, p. 64) traduit bien lorsqu’il fait cette comparaison entre Auguste Comte et Claude Bernard en ces termes : « ce que Comte appelle, dans sa philosophie biologique, la doctrine des conditions d’existence, Claude Bernard l’appelle le déterminisme ». Au fond, par déterminisme, Claude Bernard entend conditions d’existence d’un phénomène, c’est-à-dire tout ce qui rentre en ligne de compte dans l’apparition ou la manifestation dudit phénomène. Par exemple, si un phénomène morbide apparaît, ce n’est qu’un ‘‘ensemble de conditions’’ qui permettent cela. À cet effet, pour connaître un phénomène, il convient de maîtriser les conditions qui le rendent possible.
Selon Gayon (2011, p. 120), chez C. Bernard, il faut entendre par déterminisme « “cause prochaine”, “cause efficiente réelle”, “cause déterminante”, “conditions d’existence” ». Cette approche justifie combien de fois, la résonnance de ce concept a trait aux conditions d’existence d’un phénomène, si bien qu’elle traduit la pensée de C. Bernard (1987, p. 265) lui-même quand il le conçoit au sens d’un « conditionalisme ». Ainsi, le déterminisme bernardien peut servir de base théorique à l’analyse d’un phénomène comme la violence. Cela, parce que, rechercher le déterminisme de la violence universitaire, ce serait rechercher les conditions d’existence qui en permettent les manifestations. S’il faut considérer que la violence universitaire a des causes aussi bien sociales qu’académiques, il va sans dire que le déterminisme de celle-ci s’inscrit dans un complexus socio-académique en crise.
La crise universitaire est, à dire vrai, la cause des violences universitaires en Côte-d’Ivoire. Et, cette crise elle-même naît de la crise des valeurs sociales ivoiriennes. En effet, l’université étant le reflet d’un modèle d’éducation d’une société, elle ne saurait être le théâtre d’anomalies que parce que la société elle-même subit des bouleversements et des ruptures importantes. Outre les crises estudiantines de 1990 aux années 2000 avec d’intenses manifestations violentes, au nombre des ruptures importantes que l’on pourrait identifier comme constituant une condition d’existence de la violence, il y a les crises socio-politiques qui ont secoué la Côte d’Ivoire. Depuis le coup d’État du 24 décembre 1999 à la tentative d’un autre coup d’État le 19 septembre 2002 qui ont plongé le pays dans une crise militaro-socio-politique, le pays n’a cessé d’être enclin aux situations exacerbant la violence. D’ailleurs, la tentative de renversement du gouvernement en 2002, qui a plongé le pays dans près d’une décennie de crise, n’a pas laissé le climat social immaculé. Jusqu’aux élections de 2015, en passant par la mutinerie de janvier 2017, à la crise postélectorale de 2020, il n’y a eu qu’une sorte d’apologie de la violence. De la sorte, la violence, symptôme d’une société crisique, s’est érigée en modèle en termes de moyen de revendication approprié ou qui convienne. Un tel déterminisme de la violence en Côte d’Ivoire est tel qu’il donne le sentiment d’une normativité crisique des actes violents.
Parler de normativité crisique, c’est faire recours au concept de normativité tel que théorisé par Georges Canguilhem en vue de l’appliquer à la crise, notamment à celle de l’université en Côte d’Ivoire. En tout état de cause, les concepts canguilhémiens ont été développés dans un contexte biologique. G. Leblanc (1998, p. 5) le souligne si bien en affirmant que « la philosophie de Canguilhem consiste en une réflexion sur la vie et sur la connaissance que nous pouvons en avoir ». Toutefois, la réflexion sur la vie qui conduit Canguilhem à analyser le normal, puis le concept de norme, afférents à la vie, l’amène à postuler que « le normal c’est donc à la fois l’extension et l’exhibition de la norme » (G. Canguilhem, 1984, p. 176). Le rapport du normal à la norme tient lieu dans l’érection de la seconde en la considérant comme une sorte d’idéal, dont on ne peut s’en écarter au risque d’être en défaut ou en excès vis-à-vis du premier. De la sorte, « la normativité fonde le normal » (G. Leblanc, 1998, p 57), sans perdre de vue qu’elle « désigne la puissance de la vie à créer de nouvelles normes » (Idem). Ce sont ces normes instituées que l’on considère comme normales à un certain moment.
La normalité trouve un sens dans une sorte de capacité normative. L’état pathologique aussi bien que l’état normal sont appréhendés comme des allures de la vie obéissant à leurs propres normes, et non dans un rapport antagonique. Si « la vie à l’état pathologique n’est pas absence de normes, mais présence d’autres normes » (G. Canguilhem, 1975, p. 166), il va sans dire que la crise n’est pas absence de normes, mais présence de normes crisiques. Celles-ci laissent entrevoir une normativité de la crise qui tend à porter au pinacle, la violence si tant est que cette dernière se soit érigée en modèle.
Quand la société est le lieu de manifestations récurrentes d’actes violents, ceux-ci ont tendance à se présenter comme relevant d’une situation normale. Au fond, ce qui était perçu comme anormal du fait d’une répétition exagérée finit par devenir une mesure. En ce sens, il y a lieu de se poser la question de savoir si la violence n’a pas fini par s’instaurer dans l’esprit de la société ivoirienne comme un beau moyen de se faire entendre. À n’en point douter, l’exercice de la violence orchestré par les différentes crises ivoiriennes n’a pas été anodin pour toutes les formes de représentation aussi bien de l’éducation que de la société et la politique. Les paradigmes ont donc changé, entraînant à leur suite, une légitimation de la violence comme norme.
Vu que le déterminisme des violences universitaires en Côte d’Ivoire se retrouve dans une sorte de normativité crisique ivoirienne, tout se passe comme si les crises devenaient normales, ainsi que les violences. Pourtant, ici, ce qui importe, ce n’est pas une justification des rapports violents, mais une appréhension de ceux-ci au prisme des concepts de déterminisme et de normativité pour les juguler. À dire vrai, même si le désordre semble obéir à ses propres normes selon l’approche canguilhémienne, cela ne signifie pas qu’il ne faudrait pas opter pour une approche dé-constructive d’un tel phénomène. Par une recherche permanente du déterminisme de la violence à la compréhension de la normativité crisique, il convient de s’investir dans une normativité de déconstruction de la crise de l’université.
3. Du déterminisme de la violence à une normativité de la crise : pour une normativité de déconstruction de la crise de l’université en Côte d’Ivoire
Après avoir exposé ce qu’il faut entendre par déterminisme du phénomène de la violence et normativité crisique, il convient de relever que le déterminisme des violences universitaires réside dans un complexe scientifico-socio-politique. En effet, il s’agit de la représentation sociale de l’éducation qui entretient des rapports étroits avec les perspectives politiques qui parfois, sont en rupture. En observant les regains de violence sur les espaces universitaires, l’un des indicateurs se trouve dans le modèle de violence présent dans la société. Vu que l’université n’est pas hors de la société, elle incarne naturellement le modèle que la société promeut aussi implicitement qu’explicitement. D’une manière implicite, les relents des différentes crises ivoiriennes sont imprimés, autant que faire se peut, dans la conscience collective. L’apologie inconsciente de la violence exprimée par ces crises, se répercute bien évidemment sur le système éducatif.
Quoi qu’il en soit, la crise de l’éducation,
apparaît comme le symptôme d’une difficulté (peut-être insoluble) de notre temps à se représenter la forme et les modalités concrètes d’une éducation et d’un enseignement public – y compris universitaire – qui, dans une société de masse caractérisée par un chômage structurel, soient véritablement démocratiques (L. Gutierrez et S. Alix, 2022, p. 22).
Cette approche de Gutierrez et Alix, bien que ne concernant pas la Côte d’Ivoire, pourrait permettre de penser le contexte ivoirien qui lui-même est enclin aux difficultés similaires et bien plus. À cet effet, ce qui importe dans cette affirmation, c’est le rapport problématique entre représentation des formes et modalités du système éducatif avec l’université et la question du chômage. Tout part de l’approche que l’on a de l’université qui semble être un “centre d’incubation” d’un nombre plus important de chômeurs. Dans le cas de la Côte d’Ivoire, cette situation est avérée, mais elle ne fait pas partie des mobiles clés des violences universitaires. L’une des causes profondes est plutôt une normativité crisique mise en évidence par la perte de l’appréciation du système universitaire à sa juste valeur aussi bien par les étudiants que par les enseignants et les autorités administratives universitaires. Cette mauvaise appréciation se traduit au niveau des enseignants et des autorités administratives, par, entre autres, l’influence d’approches partisanes sur fond politique qui biaisent la qualité des démarches dialogiques, le manque de revalorisation des indemnités et des tâches administratives.
Selon Pierre N’Da (ASCAD, 2019, p. 16), en ce qui concerne les étudiants,
les violences en milieu universitaire n’ont pas un caractère articulé : elles laissent apparaître leur pauvreté idéologique, leur indigence en utopie. Mais c’est en cela même que réside paradoxalement la force des étudiants. Parce qu’ils n’ont pas de solutions toutes faites aux déficiences qu’ils relèvent, ils peuvent s’ouvrir à des solutions négociées afin de sauver leur vie (survivre), leurs études, leur avenir en faisant aboutir les revendications. Ils sont conscients qu’ils ont à négocier tout, de toutes les manières, autour de revendications ciblées, avec s’il le faut, des prières inversées que sont les violences.
À travers ces affirmations, il ressort que la violence a tendance à s’ériger en un moyen exclusif d’expression et de revendications. À y voir de près, si cette forme d’expression s’érige en norme, ce n’est plus la manifestation d’une situation anormale, mais plutôt l’exhibition une normativité de la crise par la violence.
Certes, toute situation pathologique ou anormale, comme G. Canguilhem (1975, p. 166) le montre, n’est pas « absence de normes, mais présence d’autres normes », néanmoins les normes ayant trait aux valeurs négatives (l’incivisme, le favoritisme, etc.) doivent être déconstruites. Dans cette perspective, il convient de penser une normativité dé-constructrice de la violence qui consiste à créer permanemment des normes anti-violences. D’une manière ou d’une autre, le système éducatif nécessite d’être revu, d’autant plus qu’il ne concorde plus assez avec les réalités sociales. Pourtant, si les représentations sociales influencent considérablement le secteur éducatif en général, en particulier l’université, n’empêche qu’elles peuvent être forgées par l’éducation. Il y a une sorte de va-et-vient entre représentations sociales de l’éducation et l’éducation aux représentations de la société. Quelle société voulons-nous ? Quelle université souhaitons-nous voir ? En tout état de cause, l’université dépend du climat social et du modèle de réussite, basé presque quasiment sur l’avoir, qui s’est institué démesurément en Côte-d’Ivoire. Dès lors, il est nécessaire de repenser tout le système social ivoirien, afin d’avoir un impact sur l’université.
La remarque de Joseph Ki Zerbo (2013, p. 207) est, à cet effet, très significative lorsqu’il écrit ceci :
Le système est susceptible de modification et de transformation. Je dis bien transformation : il ne s’agit ni de le détruire entièrement ni non plus de le réformer simplement, c’est-à-dire d’appliquer des pommades cosmétiques pour atténuer les souffrances des gens. Il s’agit de repérer les structures qu’on peut changer et de penser un autre système total.
Cette note met en exergue comment l’identification précise des causes des actes violents qui minent l’université, donc le déterminisme de ces actions, doit permettre de penser un autre système par une sorte de normativité de déconstruction des violences.
L’homme normal, c’est, chez G. Canguilhem, « l’homme normatif, l’être capable d’instituer de nouvelles normes » (G. Leblanc, 1998, p. 57). Par analogie, la société normale est celle qui est capable de faire face à la crise en s’instituant des normes pour la déconstruire et par-delà, enrayer sur elle, les impacts d’une normativité de la violence. Ainsi, la capacité à toujours réfuter la violence doit partir de la sphère socio-politique, afin d’innerver le système éducatif, et par ricochet, l’université. Cette capacité de réfutation doit aussi tenir compte de la structuration d’un permanent dialogue raisonnable et rationnel entre les perspectives socio-politiques et tout le système éducatif.
Les programmes proposés en contexte ivoirien par l’ASCAD (2019, p. 218) pour juguler ce phénomène pernicieux consistent en l’instauration des structures suivantes :
- Conseil de Dialogue, de Prévention et de Règlement des conflits (CDPRC) ;
- Service civique universitaire (SCU) ;
- Conseil des Délégués de Filières (CDF) ;
- Bureau Universitaire de Prestation de Services (BUPS) ;
- Service Universitaire d’Insertion Professionnelle des Étudiants (SUIPE) ;
- Commission Permanente de Veille sur la qualité de vie estudiantine (CPVE).
Toutefois, il faut tenir compte du déterminisme du phénomène dans la conscience sociale afin de procéder à une normativité contre-adaptative à la violence comme norme qui a créé subrepticement dans la conscience collective, un sentiment d’indifférence et de résignation face aux actes violents en Côte d’Ivoire.
Conclusion
Le déterminisme de la violence se justifie dans un complexe scientifico-socio-politique qui est le reflet d’une société ayant tendance à aller vers une normativité de la violence et crisique en Côte d’Ivoire. En identifiant les causes socio-politiques des violences universitaires dans ce pays, on décèle par-là même, une inclinaison à ériger la violence comme moyen d’expression par excellence.
Les concepts bernardien et canguilhémien permettent d’analyser le phénomène de la violence comme la résultante d’un système éducatif en crise, voire d’une université en crise. Pour ce faire, il est nécessaire de lutter contre la violence symptomatique de la crise par une contre-adaptation à celle-ci toujours en termes de normativité. Et si le déterminisme du phénomène des actes violents en milieu universitaire, semble être trouvé que si le phénomène persiste, c’est bien parce que toutes les conditions d’existence pourraient ne pas être décelées clairement.
Le déterminisme des violences universitaires n’est pas un acquis définitif, d’autant plus que leur apparition doit toujours interpeller qu’il y a encore des conditions d’existence à rechercher. Qui plus est, la normativité dé-constructrice de la violence doit s’inscrire dans un renouvellement permanent, car si l’institution de normes anti-violences s’arrête, le chaos peut s’installer dans tout le système éducatif et la société. Il convient, à cet effet, de procéder à une veille sur la conciliation entre les réalités académiques et les perspectives socio-politiques.
Références bibliographiques
AIP, 2021, « Une étude révèle les causes des violences en milieu universitaire », in https://news.abidjan.net/articles/698481/une-etude-revele-les-causes-des-violences-en-milieu-universitaire, consulté le 20/05/2022.
BERNARD Claude, 2008, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion.
BERNARD Claude, 1987, Principes de médecine expérimentale, Paris, PUF.
CANGUILHEM Georges, 1975, La connaissance de la vie, Paris, Vrin.
CANGUILHEM Georges, 1984, Le normal et le pathologique, Paris, PUF.
COMTE-SPONVILLE André, 2013, Dictionnaire philosophique, Paris, PUF.
GAYON Jean, 2011, « Déterminisme génétique, déterminisme bernardien, déterminisme laplacien », in Jean-Jacques KUPIEC et al. (dir.), Le hasard au cœur de la cellule, Paris, Éditions Matériologiques, pp. 115-129.
GUTIERREZ Laurent et ALIX Sébastien-Akira, 2022, Crise(s) en éducation et en formation, Paris, L’Harmattan.
KI-ZERBO Joseph, 2013, À quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein, Lausanne, Éditions d’en bas.
KUHN Thomas Samuel, 1983, La structure des révolutions scientifiques, Traduction de Laure Meyer, Paris, Flammarion.
LALANDE André, 2013, Vocabulaire critique et technique de la philosophie, Paris, PUF.
LEBLANC Guillaume, 1998, Canguilhem et les normes, Paris, PUF.
MICHAUD Yves, 2012, La violence, Que sais-je ? N° 2551, Paris, PUF.
WALTER Benjamin, 2019, Pour une critique de la violence, Trad. Wiser Antonin, Paris, Éditions ALLIA.
Barthelemy Brou KOFFI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Notre société est en proie à des crises de tout genre. Ce constat amer qui persiste dans le quotidien des hommes nous interpelle dans cet article qui se propose de réfléchir sur les crises universitaires dans l’espace africain en général, et particulièrement sur celles qui minent le milieu ivoirien. Ayant constaté l’implantation des syndicats d’Enseignants et d’Étudiants, leur affiliation aux partis politiques sans omettre le règlement des problèmes par la force dans le milieu universitaire en Côte d’Ivoire, il paraît essentiel d’analyser et de critiquer cette situation afin de comprendre qu’il est possible d’interpeler, à travers l’art musical et cinématographique, les acteurs qui animent le milieu universitaire pour que ce secteur, aussi important dans la vie et le développement des nations, puisse sortir ce pays des crises à répétitions.
Mots clés : Art, cinéma, crise, musique, politique, syndicalisme, université, violence.
Abstract:
Our society is plagued by crises of all kinds. This bitter observation, which persists in the daily life of people, calls for our attention in this article, which proposes to reflect on university crises in the African space in general, and particularly on those that undermine the Ivorian environment. Having noted the establishment of teachers’ and students’ unions, their affiliation with political parties and the use of force to resolve problems in the university environment in Côte d’Ivoire, it seems essential to analyze and criticize this situation in order to understand that it is possible to call upon the actors who animate the university environment, through the art of music and film, so that this sector, which is so important to the life and development of nations, question, through musical and cinematographic art, the actors who animate the university environment so that this sector, so important in the life and development of nations, can help this country to emerge from repeated crises.
Keywords : Art, cinema, crisis, music, politic, trade unionism, university, violence.
Introduction
L’on a tendance à réduire l’art à la simple production du beau. Or, avec l’évolution des connaissances, l’on doit comprendre que c’est un domaine qui s’étend à tout puisqu’il s’interroge sur les faits de la société. Son caractère social est de prime abord, énoncé par W. Benjamin (2000, p. 105) lorsqu’il avance l’idée du divertissement à partir du « cinéma » qui semble frapper le récepteur. Ce volet social est partagé par D. L. Fié (2011, p. 33) qui indique que l’art « est à la fois autonome et fait social. (…), l’art n’est pas coupé du monde, mais s’efforce de s’inscrire en son sein pour mieux en exprimer les contradictions ». À partir de cette appréhension, l’on peut noter que l’art est une donnée sociétale qui s’inscrit dans l’ordre de la contradiction. Il est dans le monde et se donne en même temps le droit de s’interroger sur lui. Cette vision de Fié s’accorde avec celle de W. T. Adorno (1995, p. 22) selon laquelle « l’art est pour-soi et ne l’est pas », pour dire qu’au-delà de sa forme esthétique, il s’oriente vers d’autres horizons de la cité afin d’apporter des éclaircissements.
Pour lui, « l’art était incontestablement, et dans un certain sens, plus directement quelque chose de social. (…), l’art était bien en soi en contradiction avec la domination sociale » (W. T. Adorno, 1995, p. 311). Ce qui entérine l’idée de W. Benjamin (2000, p. 77) qui parle de l’œuvre d’art « autonome » et de son caractère d’« émancipation ». Il convient de préciser que c’est une attitude qui permet de voir l’art passer de sa structure sociale à l’émancipation. Ayant constaté la récurrence des crises vécues dans les Universités africaines depuis des décennies, mettant à mal, l’expression de la liberté des uns et des autres, il importe de faire un diagnostic de cette situation alarmante afin de saisir certaines causes à leur origine.
Commençons avec Fié (2011, p. 85) qui s’intéresse aux écrits de Y. Konaté en formulant ce passage : « La jeunesse africaine du Sud du Sahara, (…) vit une véritable crise. Depuis les années 90, elle est au cœur d’une culture de la violence qui semble indiquer que « la raison du plus fort est toujours la meilleure » ». En suivant l’actualité, on se rend compte que les crises universitaires tendent à discréditer les diplômes de la zone ouest-africaine, sous prétexte que les formations ne répondent pas aux normes internationales.
Notre attachement au berlinois dans l’examen de cette situation, aussi cruciale soit-elle, dénote du caractère progressiste des productions artistiques, rendu possible par les instruments technologiques du moment. Comprenons avec Benjamin (2000, p. 69) que « la reproduction technique » des œuvres d’art devient légion et fait le bonheur de l’humanité puisqu’elle permet au plus grand nombre d’individus de posséder les produits de leur choix et de les utiliser en temps voulu. À y voir de près, le type d’art dont il est question ici, est celui qui relève de la technologie actuelle qui décharge « les mains de l’homme » (W. Benjamin, 2000, p. 72) dans les réalisations artistiques.
D’abord, nous recherchons à comprendre comment certaines productions culturelles comme la musique et le cinéma peuvent contribuer à apaiser les esprits des universitaires. Ensuite, il conviendra d’affirmer avec le berlinois que la reproduction massive des œuvres d’art rend possible l’enregistrement des sons et des images. Ce qui favorise l’écoute des musiques allant dans le sens d’un éveil de conscience qui passe par la dénonciation de certaines tares de la société en vue de les réparer. Enfin, face à la mondialisation des cultures, l’enseignement supérieur ivoirien doit tenir compte des réalités existentielles avant de changer son système. En vérité, notre regard portera sur une sorte de dénonciation de l’instrumentalisation de la jeunesse estudiantine, et de certains processus idéologiques qui pourraient conduire à une crise de l’éducation.
La question centrale qui guide notre réflexion est la suivante : quelles sont les contributions des productions artistiques dans la gestion des crises universitaires en Côte d’Ivoire ? Pour parvenir à cette démonstration, n’est-il pas primordial de saisir l’impact des mouvements syndicaux et des politiques dans le monde universitaire ? Hormis cet aspect, quelle est la portée sociale de la pensée artistique du juif allemand dans ce monde universitaire chaotique ?
Avec les avancées technoscientifiques, l’art doit se percevoir comme un moyen de revendication qui panse aussi les maux de notre cité. D’où notre option pour laméthode analytique qui permettra de comprendre le bien-fondé des mouvements syndicaux et l’intérêt des politiques dans le champ universitaire. L’on a aussi la méthode socio-critique qui se veut une théorie critique. Face aux modèles de revendications violentes et souvent sans raison ‘’calculante’’ et soutenable de la part des syndicats d’étudiants, il importe de rechercher à partir d’une critique objective, les raisons principales qui les poussent à agir de gré ou de force et de façon barbare.
Ce travail a pour objet principal de montrer que l’accès plus facile aux productions culturelles est un moyen efficace dans la gestion de certaines situations crisiques comme celles vécues dans nos universités. Pour y parvenir, nous montrerons dans un premier temps que le syndicalisme, la politisation des universités et le pouvoir de l’argent constituent des facteurs de troubles dans nos institutions universitaires africaines. Dans le second moment, il s’agira de montrer que l’on peut passer par les arts tels que la musique et le cinéma pour sensibiliser les acteurs du monde universitaire afin qu’il y règne un véritable climat de paix avant de terminer par la proposition d’un nouvel ordre artistique pouvant dynamiser nos universités.
1. Origines des crises en milieu universitaire en Côte d’Ivoire
L’histoire des premières universités ivoiriennes répondait au souci de vouloir former des cadres supérieurs qui allaient contribuer à l’avènement d’une ère de véritable prospérité en termes d’acquis au niveau de la jeunesse qui représente la cheville ouvrière de nos différentes nations. Contre toute attente, on se rend compte que depuis les années 1990, le milieu universitaire ivoirien connaît de nombreuses crises qui semblent devenir une tradition jusqu’à ce jour. Alors, on se demande : pourquoi ces crises sans fin ?
1.1. Le syndicalisme en milieu universitaire : cause de désordres
De prime à bord, notons que le syndicalisme est une réalité existentielle au sein de notre société. Selon L. M. Morfaux (2001, p. 354), il est une « organisation (…) indépendante de l’État mais reconnue par lui (…), ayant pour but la défense économique devant le patronat des membres de ce groupe ». Originairement, le rôle primordial d’un mouvement syndical est de contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs affiliés, c’est-à-dire veiller à assurer la sécurité de ces derniers sur les lieux du travail en protégeant leur emploi et en sécurisant leurs revenus. Pour ce qui est des syndicats d’étudiants dans notre pays, nous cherchons à comprendre leur amour pour la brutalité lorsqu’il est question d’exprimer leurs besoins. Mais avant d’y arriver, voyons l’idée proposée par Benjamin quand il était à la tête d’un mouvement d’étudiants dans l’Allemagne des années 1914.
Il faut savoir qu’à Vingt-deux ans, étant étudiant en Philosophie à Fribourg, W. Benjamin (2000, p. 128) est élu Président d’un mouvement d’étudiants baptisé « Libres étudiants ». Ce poste lui a permis d’évaluer un certain nombre d’éléments relevant des attitudes et aptitudes des étudiants de son époque. Analysant le comportement des étudiants, il a estimé qu’ils sont dans un esprit de profit à tous les niveaux puisqu’ils ne se soucient pas du tout de leur avenir, mais préfèrent jouir de ce que leur offre le présent. La vie, pour eux, n’est que jeu et un moment de passe-temps. Ce qui permet de dire qu’ils vivent bourgeoisement leur liberté qui les laisse apparaître comme des êtres nés pour le plaisir du corps. Or, en voulant réduire la « formation universitaire à la fonction d’enseignant » (W. Benjamin 2000, 140), l’on tombe dans ce qu’on peut considérer comme ‘’une vie sans référence’’ puisque chacun vit son temps comme il l’entend sans penser à une nouvelle génération. C’est pour cela qu’il souhaite qu’on quitte la société de pure consommation pour nous transformer en de véritables créateurs ou producteurs d’œuvres pouvant servir la postérité.
Nous pensons que c’est au vu du comportement des étudiants de son âge que le berlinois nous invite à la production de biens au lieu de rester dans la passiveté. Il est souhaitable d’analyser les agissements des étudiants ivoiriens. Notons que depuis l’avènement des mouvements de syndicats estudiantins tels que le Mouvement des Élèves et Étudiants de Côte d’Ivoire (MEECI), la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) et tout récemment, avec le Comité des Élèves et Étudiants de Côte d’Ivoire (CEECI), le système universitaire ivoirien, va de mal en pis. Si nous le disons, c’est parce que le constat est évident : on assiste à des grèves répétées de la part des Enseignants qui souhaitent bénéficier d’un bon traitement de la part de leur ministère de tutelle ; le même scénario de grèves se produit chez les étudiants qui ont opté pour les jets de pierres, les barricades (…), comme ultime moyen de revendication initiés au nom de leurs syndicats.
Face à de tels agissements, les forces de l’ordre sont pour la plupart du temps, obligés d’user de la force pour rétablir l’ordre. Ce qui entraîne des pertes en vie humaine sur les campus universitaires. Le cas de la descente des éléments de l’école de police d’Abidjan sur le campus universitaire de Cocody en juillet 2016 en est la parfaite illustration. Relatant les faits, le Secrétaire Général (www.afriuque-sur7.ci, 2016) de la FESCI, a fait savoir que ses camarades « manifestent contre la décision du gouvernement de les déguerpir des cités universitaires pour y loger les athlètes des Jeux de la Francophonie » de l’année suivante. Ayant répondu à l’appel du syndicat, l’opposition s’est muée en bataille ouverte entre étudiants et policiers. Bataille qui s’est soldée par des dizaines de blessés et par la mort, malheureusement d’un étudiant.
En suivant de près leurs réactions, il est à noter que c’est la forte incitation au leadership qui entraîne bon nombre de dérapages dans les comportements des apprenants africains et particulièrement ceux de notre pays. Il revient régulièrement que des syndicalistes portent atteinte à l’intégrité physique et morale de leurs condisciples sans subir de sanctions. La méfiance s’installe donc sur les campus. Face à de tels actes de vandalisme qui restent impunis, s’ajoute un autre phénomène, l’immiscion de la politique dans le milieu universitaire ; celle-ci se présentant comme « une force messianique » (W. Benjamin 1991, p. 429), qui vient, semble-t-il, libérer l’univers des cités en le désenchantant.
1.2. La politisation des universités : source de violences et de divisions
Le rapport art-technique a permis à W. Benjamin (2000, p. 278) de déceler dans le tournant esthétique de sa pensée que l’art a changé de fonction en passant de son caractère « auratique » à sa « politisation ». On constate également que l’université a glissé vers ce versant dans les pays africains. Avec le mode de fonctionnement de nos institutions universitaires, mentionnons qu’elles sont plus soumises au politique dans la gestion des ressources humaines qui animent ce secteur aussi important du développement des Nations. Aujourd’hui, la plupart des dirigeants des institutions ivoiriennes ont les mains liées à la politique, du moment où toutes les nominations dépendent du Président de la République. Un poste tel que celui de la Direction de la Présidence des universités qui passait par des élections entre les Enseignants-chercheurs et Chercheurs de ces institutions, se trouve aujourd’hui entre les mains du premier responsable de l’État. Nous sommes alors passés du vote à la nomination qui dépend désormais du gouvernement. Ce sont-là, des situations qui frustrent dans la plupart des cas, puisqu’en pareille circonstance, ce sont des rapports de « copinage » qui s’installent. Précisons donc que la fragilisation des rapports entre certains acteurs du monde universitaire est liée à la forte implication des politiques dans ce domaine de l’activité humaine. Voyant la manière dont évolue notre société, il est évident que l’on assiste partout, à des rapports conflictuels.
À cet effet, l’approche sociologique d’A. Touraine que présente M. Amiot (1970, p. 95) nous semble essentielle lorsqu’il affirme que « la politique est entrée à l’université et elle n’en sortira plus jamais ». La politisation de nos universités est une réalité patente. Dès lors que les considérations d’un point de vue idéologique, s’invitent dans le débat universitaire, alors s’installe un esprit purement clanique qui ne favorise pas l’harmonie entre les animateurs. Ce qui va sûrement engendrer des mouvements de contestations récurrentes, créant ainsi des perturbations dans le processus d’apprentissage. Ainsi parait–il nécessaire d’avouer qu’à force de contester on finit toujours par tomber dans la violence ; violence qui provient le plus souvent de l’amour exagéré de l’argent.
1.3. Le monde universitaire face au pouvoir de l’argent
Le besoin des moyens financiers devient de plus en plus croissant au point où l’on cherche tous les moyens pour s’en procurer. C’est l’une des causes de la fragilisation de nos universités qui passe par « l’achat des consciences », aussi bien des administrateurs que des étudiants. On s’intéressera de façon particulière au cas des étudiants puisqu’ils sont généralement ceux qui dictent la ligne à suivre à l’administration, troublant ainsi le fonctionnement des universités. Il faut d’emblée noter que les politiciens ont trouvé les étudiants comme une cible facile à convaincre. Cela pour dire que des étudiants sont manipulés par ces derniers en échange de billets de banque. C’est donc fort de cette constatation qu’il est écrit :
Tapis dans l’ombre, ces pêcheurs en eaux troubles ont encouragé la création de multiples syndicats ou clubs d’étudiants financés à coup de millions de F CFA pour occuper le terrain. Du coup, les politiciens (du pouvoir comme de l’opposition) ont développé chacun une antenne, prenant ainsi en otage l’université. Cette situation constitue assurément le terreau de la violence dans les cités et au campus […]. (J. Pogorowa, 2016, p. 3).
Ce passage nous indique clairement que les syndicats estudiantins sont à la solde des politiques puisque ces derniers se servent de leurs moyens financiers pour les instrumentaliser afin qu’ils leur soient toujours favorables. En nous appuyant sur le cas de la Côte d’Ivoire, on peut affirmer que la politique s’est véritablement enracinée dans nos universités au point où l’on évoque parfois des questions liées aux parrainages dans les cas de recrutements pour l’insertion socioprofessionnelle. En plus de cet aspect, il convient de souligner l’existence des mouvements d’étudiants représentant les différents partis politiques de Côte d’Ivoire, en l’occurrence la Jeunesse du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (JRHDP) et celle du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (JPDCI), pour ne citer que ceux-là. Tous ces clubs ne vivent qu’à partir des retombées qu’ils reçoivent des politiques. Du coup, en remontant à la préoccupation du burkinabè, on saisit aisément que l’instrumentalisation politique qui entraîne des déchirures entre les syndicats d’étudiants, est l’une des principales causes des crises dans nos universités africaines et particulièrement en Côte d’Ivoire.
Constatant que le mal demeure, l’on se demande : par quoi pourrions-nous tenter de sauver nos universités africaines ? Pour nous, l’une des pistes de solutions se trouve dans le vaste champ de l’art technologique qui passe par l’écoute et le discernement. Il est donc intéressant qu’on s’approche des offres de cet art moderne qui est plus admis et partagé par la jeunesse estudiantine.
2. La pensée benjaminienne de l’art technologique : une solution aux crises universitaires ivoiriennes ?
L’art musical et celui cinématographique sont des canaux de sensibilisation du monde universitaire en vue de le conscientiser face aux différentes crises qui ne cessent de « défigurer » (W. Benjamin, 2000, p. 126) nos sociétés modernes.
2.1. L’art musical comme moyen de conscientisation en milieu universitaire
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui à chaque citoyen de bénéficier d’une longue chaine d’appareils électroniques. L’industrialisation du monde a permis que l’on passe par le canal de plusieurs moyens tels que les radios, les téléphones portables et autres pour apprendre à travers l’écoute et la vue. Notre tâche consiste à montrer comment à travers l’art musical, l’on peut parvenir à sensibiliser les acteurs du monde universitaire afin de se projeter dans un avenir où l’université s’inscrira dans un esprit de stabilité totale. Certains genres musicaux parviennent à dénoncer certaines tares de la société en vue de les réparer. À travers eux, il est possible qu’on arrive à éveiller les consciences des uns et des autres sur les crises répétées que connaissent nos institutions universitaires.
C’est pour cette raison qu’il nous est donné de lire la formule suivante chez F. Nietzsche (1981, p. 21) : « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Se prononçant ainsi, il voit l’indispensabilité de cette pratique pour l’humanité ; laquelle humanité se doit de s’approprier la chose musicale afin de vivre une vie heureuse. Pour lui, la musique constitue un élément essentiel dans le vécu de tout individu puisqu’elle contribue d’abord à l’épanouissement du sujet et lui permet de vivre sa propre réalité dans le but d’une satisfaction. Elle se présente comme une arme invisible qui soulage les douleurs de l’homme à travers des rythmes et des paroles émotionnelles.
Abondant dans le même sens, nous devons comprendre que la musique produit un effet sur l’esprit de l’homme. Cette dimension qui vise à conscientiser la population estudiantine à travers l’œuvre musicale paraît incontournable. Notons que l’esthétique musicale agit profondément sur le cerveau de l’individu ; ce qui l’amène à capter les messages véhiculés par l’artiste musicien. L’homme de ce point de vue, est à considérer comme un être musicalement reconnu. C’est sans doute pour cela que A. Schopenhauer (2009, p. 328) soutient que la musique « est plus nécessaire » pour l’homme.
Ayant pour base le monde universitaire, « le zouglou, danse philosophique » (D. L. Fié, 2012, p. 9), est le genre musical qui puisse provoquer une attention particulière de la part des étudiants. Cela nous amène donc à le considérer comme la musique représentant l’identité estudiantine et par ricochet, celle qui exprime le mieux la misère de la jeunesse d’une façon générale. Si tel est le cas, il va sans dire que le zouglou soit encore le mieux approprié pour conscientiser tous les acteurs de nos universités afin qu’on assiste désormais à une meilleure formation des élites à venir pour le développement de l’Afrique. Le zouglou apparaît de ce point de vue comme l’un des canaux par lequel le jeune étudiant qui traumatise ses amis, parce qu’étant syndicaliste, doit prendre conscience du tort qu’il fait subir à son condisciple, surtout que les rapports entre des personnes partageant un même espace vital, sont codifiés et respectés de tous. Il faut, pour ainsi dire, entretenir des relations d’amitié sincère, et partant, de fraternité pour que les campus universitaires connaissent des moments d’accalmie.
Pour revenir à l’actualité musicale, nous pouvons traduire cet élan de conscientisation à partir du mythique groupe reconnu au plan mondial, en l’occurrence « Magic System » à travers son opus intitulé « génération politisée ». Dans le texte qui alimente ce morceau, il est possible de lire les passages suivants : « Jeunesse politisée iffo oh ! » ; « Yééé idjééé éééééh ! » À travers ce titre, il lance un appel à la jeunesse africaine qui ne pense gagner son pain quotidien qu’en suivant le politique à longueur de journée. L’histoire nous révèle des choses du passé et doit aussi normalement nous inviter à éviter les erreurs du passé pour construire un avenir meilleur. L’on doit comprendre, à partir de ces interpellations, qu’un éveil des consciences est bien possible si nous prenons au sérieux les conseils donnés par nos artistes qui représentent la Voix des sans voix dans nos sociétés. C’est pour nous, une manière d’avouer que les messages véhiculés par certains artistes, véritablement engagés, visent à parvenir à une société beaucoup plus juste.
Cela pour dire que la musique est d’un apport capital dans toutes les sociétés humaines du point de vue social. C’est pour cela qu’en l’approchant D. L. Fié (2012, p. 14) précise qu’elle « a une visée moralisatrice ». Étant un moyen efficace de communication, le cinéma, tout comme la musique semble essentiel pour le but visé. C’est pour cela qu’on s’attèlera à comprendre dans quel sens, il peut aider le monde universitaire à s’éloigner des facteurs favorisant les crises.
2.2. L’art cinématographique comme porte de sortie des violences universitaires
L’élément primordial qui nous pousse à parler de l’art cinématographique comme moyen de sortie des crises est qu’il se présente comme une satire de la société, mais cette fois-ci en combinant la parole et le gestuel. C’est un art qui semble être de l’ordre des œuvres distractives. Or, il livre de véritables enseignements propres à la vie des hommes. Il traduit la vie de l’homme en société et finit toujours par une moralité. Alors, en approchant l’écrit de Benjamin sur la notion de reproductibilité technique, on se rend compte que tout cela est rendu possible qu’à partir de l’apport de la technique dans le champ culturel. On en veut pour preuve, l’idée selon laquelle « comme l’eau, comme le gaz, comme le courant électrique viennent de loin, dans nos demeures, répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul, ainsi serrons-nous alimentés d’images visuelles et auditives. » (W. Benjamin, 2000, p. 273). Au-delà de son caractère d’œuvre de divertissement que l’on lui concède, comprenons que cet art participe à l’édification de nos sociétés puisqu’il délivre des messages en vue d’apaiser les cœurs en ce qui concerne la vie des hommes à tous les niveaux.
L’acteur de cinéma traduit une situation qui touche à la réalité sociale comme cela est le cas de la musique évoquée un peu plus haut. Ce sont des œuvres qui visent à redonner du goût à la vie. Ainsi est-il évident que par la force de la mémoire-souvenir, l’on marque un arrêt après avoir suivi une série télévisée, par exemple, qui met en exergue l’exercice de la violence de la part d’un étudiant sur un Enseignant. C’est que toutes les fois qu’il sera en situation contraignante ou volontaire de reproduire un tel acte, il auraune idée forte de la punition subséquente à une action du même genre. C’est la moralisation de l’être qui surgit du cinéma qu’il faut retenir et pratiquer. Il en ressort plusieurs bels enseignements dont l’humanité doit se servir pour que règne un climat de paix et d’harmonie dans les milieux universitaires. En ce sens, nous devons comprendre que l’art cinématographique est capable de révolutionner le monde en vue de le pacifier.
Cette approche semble bien comprise par l’écrivain suisse et français qui l’a perçu comme un art révolutionnaire et libérateur en analysant la vie intellectuelle française de l’entre-deux-guerres qui semble tomber dans l’abîme. Le cinéma est apparu comme l’idéal artistique qui a donné de l’espoir à la génération future après toutes les atrocités occasionnées au cours de la longue période où le monde a sombré dans le désespoir. B. Cendrars (1987, p. 213-214), croyant au cinéma se prononce en ces termes : « Renouveau ! Éternelle Révolution. (…), tout fait prévoir que nous nous acheminons vers une nouvelle synthèse de l’esprit humain, vers une nouvelle humanité et qu’une race d’hommes nouveaux va paraître. Leur langage sera le cinéma ».
Au travers de cette éternelle révolution qui semble avoir comme pilier essentiel, l’art cinématographique, se dessine l’apport indéniable de cet outil comme une nouvelle donne capable d’émerveiller la planète en déployant des moyens qui puissent ré-exprimer la valeur de l’homme ainsi que celle de la vie elle-même. Cela dit, il est nécessaire que le cinéma soit épousé et mieux, qu’il soit encore plus vulgarisé pour que chacun en tire des leçons pour son avenir en se rattachant surtout à son caractère d’œuvre moralisatrice.
À ce titre, notons que l’acteur de cinéma parvient à dire haut ce que le monde scientifique refuse d’exposer au grand jour pour en faire un débat aussi public soit-il. Pour preuve, lors de la cérémonie d’ouverture du colloque sur « la crise de l’université en Afrique : diagnostic et éléments de stratégies transversales », il a fallu l’intervention d’un groupe animant un sketch pour exprimer haut et fort les situations de précarités avancées que vivent et les Enseignants et les étudiants de notre pays pour attirer l’attention des représentants du gouvernement qui étaient dans l’Amphithéâtre alloué à cette activité scientifique.
Pour ce faire, retenons que les œuvres artistiques traduisent des réalités sociales puisqu’elles ont pour tâche de communiquer quelque chose aux humains afin d’avoir un sens dans le monde. C’est pour cela qu’on trouve l’art cinématographique comme un art essentiel contribuant à la sensibilisation des étudiants et partant, l’ensemble du monde universitaire face à la recrudescence des crises que traversent nos universités africaines. Avec l’avènement de l’art technologique, on peut de nos jours suivre une longue chaine de séries cinématographiques et en tirer les conséquences. Cependant, quelles nouvelles orientations artistiques pour dynamiser nos universités ?
2.3. Pour un nouvel ordre artistique de dynamisation des universités de Côte d’Ivoire
Au regard de l’attitude des étudiants à vouloir faire basculer les programmes universitaires chaque année, il est évident qu’on attribue ce fait à l’oisiveté et qu’on arrive à une éducation universitaire qui passe par l’art. C’est pourquoi, nous pensons qu’il serait intéressant que les responsables des programmes académiques se penchent sur certaines activités culturelles pour maintenir constamment les apprenants en activité. Pour dire qu’il faut dégager des plages horaires consacrées à des caravanes de sensibilisation à la paix sur les campus. Par exemple, un thème comme : « Politiques culturelles universitaires et vie étudiante », peut contribuer à réorienter les étudiants sur ce qui leur revient comme tâche à accomplir en tant qu’étudiants. Cette idée traduit nettement que la pratique artistique est au cœur du dispositif de l’action culturelle universitaire.
Nous vivons dans des sociétés de type technologique où les arts participent avec une dimension affective, à nos vies collectives. Dès lors, il importe d’intéresser les étudiants aux arts tels que la peinture, la sculpture et l’infographie qui « trouve de plus en plus sa place aujourd’hui dans l’enseignement artistique dans le but de renforcer les compétences artistiques des apprenants et faciliter aussi leur insertion dans la vie professionnelle envahie aujourd’hui par la technologie numérique » (B. A. N’taye, 2014, p. 75). En le faisant, les étudiants s’adonneront aux métiers de l’art tout en tournant le dos au suivisme qui les engage dans leur attachement au syndicalisme.
Enfin, nous précisons que l’université est un espace qui obéit à des normes culturelles qui lui sont propres. De ce point de vue, pour ne pas perdre de vue la culture de l’esprit de tolérance à l’université, P. Garigue (2022, p. 27) nous interpelle sur le fait que « du point de vue de l’avenir de chaque culture, les peuples qui ne possèdent pas un système d’éducation supérieure capable de franchir les seuils requis d’organisation professionnelle dans les arts, se trouvent à perdre leur culture ». Les acteurs du milieu universitaire qui représentent ce peuple sont appelés à créer les conditions, qui passent par l’art, pour que l’université soit un espace propice à la formation de l’élite de demain pour le bonheur de l’Afrique.
Conclusion
Selon nos investigations, trois facteurs sont déterminants dans les crises récurrentes dans nos universités africaines. Il s’agit d’abord, de l’implantation des syndicats estudiantins sur les campus. Ensuite, la question de la politisation des institutions universitaires s’impose comme une norme, et enfin, avec le politique, l’idée d’instrumentaliser la jeunesse estudiantine en lui proposant des moyens financiers et le parrainage. Bénéficiant donc de la couverture des régimes gouvernementaux en place, ces syndicats agissent avec assurance dans les universités en dictant la ligne à suivre à l’administration qui est censée diriger l’institution.
Pour y remédier, la musique et le cinéma apparaissent comme des moyens essentiels pour parvenir à la sensibilisation ou du moins, à la conscientisation des étudiants qui sont pour la plupart du temps, à l’origine des troubles sur les campus. Cette proposition trouve ses assises dans le fait que ceux-ci sont des amoureux de ces genres artistiques. À côté de cet aspect, il importe de souligner qu’une éducation artistique doit être instituée à l’université afin de montrer les bienfaits de l’art dans la vie des hommes. Pour finir, il est judicieux qu’on privilégie la formation syndicale afin que le dialogue soit désormais l’arme de toutes les revendications dans le monde universitaire au détriment de la violence.
Références bibliographiques
ADORNO Theodor, 1995, Théorie esthétique, trad. de Marc Jimenez, Paris, Klincksieck.
AMIOT Michel, 1970, « La politique à l’université », in L’homme et la société, numéro 16, Sociologie et contestation, pp. 95-110, in http://www.persee.fr, consulté le 24 Janvier 2022.
BENJAMIN Walter, 1991, « Sur le concept d’histoire », in Écrits français, Paris, Gallimard.
BENJAMIN Walter, 2000, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », in Œuvres III, trad. de Maurice de Gandillac, Pierre Rusch et Rainer Rochiltz, Paris, Gallimard.
BENJAMIN Walter, 2000, « La vie des étudiants », in Œuvres I, trad. de Maurice de Gandillac, Pierre Rusch et Rainer Rochiltz, Paris, Gallimard.
CENDRARS Blaise, 1987, « L’ABC du cinéma », in Hollywood, La Mecque du cinéma, Paris, Ramsay Poche Cinéma.
FIÉ Doh Ludovic, 2011, « Jeunesse et violence : contribution de Konaté à la critique de la culture contemporaine », in Autour de l’œuvre de Yacouba Konaté, Ouvrage collectif, Abidjan, Balafons.
FIÉ Doh Ludovic, 2011, « Le paradoxe de l’œuvre d’art : contribution francfortoise à la critique de la modernité », in Revue Baobab, Université de Cocody/ Abidjan, pp. 33-54, in http://www.revuebaobab.org, Abidjan, consulté le 24 Janvier 2022.
FIÉ Doh Ludovic, 2012, Musiques populaires urbaine, et stratégies du refus en Côte d’Ivoire, Paris, Edilivre.
GARIGUE Philippe, 2022, « Les arts à l’université : Un objectif prioritaire de développement », in La création dans les universités, numéro 44, pp. 27-28, https://id.erudit.org/iderudit/42811ac, consulté le 12 Mai 2022.
Intervention sur les mouvements syndicaux d’étudiants, 2016, (www.afriuque-sur7.ci) / (abidjantv.ci), Abidjan, consulté le 15 Mai 2022.
Magic system, 21 Juin 2021, ALBUM : Envolement Zougloutique, Titre : Jeunesse Politisée, (feat. Mix Premier), Gaou Production Multivision.
MORFAUX Louis Marie, 2001, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Paris, Armand Colin.
N’TAYE Adjé Blaise, 2014, « Introduction de l’infographie dans l’enseignement supérieur artistique en Côte d’Ivoire », in Revue universitaire des sciences de l’éducation, numéro 3, pp. 61-77, https://revues-ufhb-ci.org, consulté le 20 Février 2022.
NIETZSCHE Friedrich, 1981, Crépuscules des idoles, Paris, Fayard.
POGOROWA Jérémie, 2016, Contribution à une sociologie politique des mouvements étudiants au Burkina Faso : l’ANEB et la FESCI-BF entre autonomisation et instrumentalisation politique, Mémoire de Master, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 174 p, in https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01293477, consulté le 12 Janvier 2022.
SCHOPENHAUER Arthur, 2009, Le monde comme volonté et comme représentation, Trad. Christian Sommer, Vincent Stanek et Marrianne Dautrey, Paris, Gallimard.
VIOLENCES ESTUDIANTINES SYNDICALES EN CÔTE D’IVOIRE : ENTRE REVENDICATIONS LÉGITIMES ET DÉLINQUANCE
Kouassi Marcelin AGBRA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
agbrakouassimarcelin@gmail.com
Résumé :
Depuis les années 90, les universités ivoiriennes traversent une crise multiforme dont la violence est l’une des manifestations les plus importantes. Cette violence qui perdure s’explique par le contexte socio-politique et par la crise des valeurs. La présente étude qui veut proposer des solutions à cette crise s’organise autour de la question suivante : est-il possible de ramener la paix et la sécurité dans l’espace universitaire ? L’hypothèse esquissée ici est que la paix peut revenir dans l’espace universitaire à condition que le couple autorité/sanction soit imposé de façon efficiente. Nous nous appuierons pour ce faire sur une démarche à la fois critique et analytique.
Mots clés : Autorité, Crise, Éducation, Politique, Sanction, Université, Violence.
Abstract:
Since 1990s, Ivorian universities have been going through a multifaceted crisis, of which violence is one of the most important manifestations. The continuing violence is explained by the socio-political context and by the crisis of values. This studies which aims to propose solutions to this crisis is organized around the following question: is it possible to bring peace et security to the university space? The hypothesis outlined here is that peace can return to the university space provided that the authority/sanction couple is imposed efficiently. To do this we will rely on an approach that is both critical and analytical.
Keywords : Authority, Crisis, Education, Polotics, Sanction, University, Violence.
Introduction
Les universités ivoiriennes ont en leurs seins plusieurs types d’associations estudiantines. Il s’y trouve des associations à caractères religieux, politiques ou des associations de défense des droits des étudiants appelés syndicats. Toutes ces associations se disputent l’espace universitaire et entretiennent parfois des rapports de rivalité : il s’agit surtout de celles qui revendiquent le monopole de la défense des droits des étudiants. On peut citer la FESCI[74] et le CEECI[75]. Ces associations doivent leur existence au manque d’infrastructures dans les universités publiques. Elles se créent pour servir de porte-parole de la population estudiantine. Ce sont elles qui portent devant les autorités universitaires et étatiques, les plateformes revendicatives des étudiants afin que leurs conditions d’étude soient améliorées. Cependant, elles n’hésitent pas à utiliser la violence comme moyen de revendication ou comme moyen pour asseoir leur hégémonie sur l’espace universitaire. Ainsi, certains enseignants ou étudiants sont brutalisés ou molestés par des étudiants grévistes parfois à l’aide d’armes blanches. Les pratiques militaro-guerrières de ces associations contrastent avec le milieu universitaire où est recherchée l’excellence intellectuelle et morale. On peut alors se demander : doit-on légitimer ou ériger la violence comme mode d’expression dans l’espace universitaire ? Dans quel contexte la violence s’est-elle installée à l’université ? Pour pacifier l’espace universitaire, ne faut-il pas recourir à un dosage mesuré de la persuasion et de la sanction ? C’est à ces interrogations cruciales que tente de répondre cet article. En s’appuyant sur une méthode analytique, il veut montrer que l’université en tant que temple du savoir, ne saurait s’accommoder de pratiques violentes et barbares. Ainsi, pour juguler la violence sur l’espace universitaire, il faut renforcer l’éducation et les pratiques punitives. Notre démarche est constituée par deux étapes : nous décrypterons d’abord le contexte et les origines de la violence estudiantine, et ensuite nous proposerons des solutions pour pacifier l’espace universitaire.
1. Contexte et origine de l’exercice de la violence estudiantine
1.1. Monolithisme syndical et multipartisme politique : le paradoxe
Historiquement, l’existence des associations estudiantines n’est pas liée au multipartisme en Côte d’Ivoire. Bien avant le retour au multipartisme, existaient dans ce pays d’Afrique de l’ouest, des associations estudiantines et scolaires dont la plus connue étaient le MEECI (Mouvement des Élèves et Étudiants de Côte d’Ivoire). Tous les élèves et étudiants y étaient membres avec ou sans leur consentement. Quand ils bénéficiaient d’une bourse d’étude, il leur était prélevé la somme de deux cent francs CFA comme cotisation pour la carte de membre : c’est la logique du parti unique. Mais certains ivoiriens militants ou sympathisants des partis politiques officieux ont réclamé parfois de manière violente le multipartisme. Exaspérés par les errements du parti unique, ils ont voulu, par des moyens tantôt pacifiques tantôt violents, obtenir la réinstauration du multipartisme. Ce qui fut fait en 1990. Le retour au multipartisme, en donnant la possibilité aux citoyens de créer des partis politiques, a par la même occasion donné la possibilité aux étudiants de créer plusieurs associations d’élèves et étudiants. En réalité, tous les partis politiques, qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition, ont voulu utiliser les étudiants pour être leur porte-voix dans les campus et dans les cités universitaires. Naît alors la lutte violente pour l’occupation de cet espace : l’exemple le plus connu est l’assassinat de l’étudiant Thiery Zebié accusé de « rouler » pour le PDCI RDA, parti au pouvoir. D. L. Fié (2003, p. 342) écrit à ce propos : « L’université qui est le lieu de formation de l’élite s’est transformée en un champ de bataille où la violence chaotique est devenue le quotidien des étudiants ». Cela apparaît comme un paradoxe. Comment l’université, temple du savoir, peut-elle substituer au débat intellectuel la violence verbale et physique ? Comment l’université, espace de la contradiction, peut-elle substituer à la divergence, la pensée unique ? La vérité n’est-elle pas fille de la contradiction ?
À la vérité, la violence estudiantine est née du monolithisme engendré par le multipartisme : c’est bien là un paradoxe. Car la multiplication des partis politiques devrait être compatible à la multiplication des associations d’étudiants. Et ce, d’autant plus que les universitaires devraient être les premiers à comprendre la multiplicité et la divergence des intérêts humains. Mais c’est l’inféodation du syndicalisme au politique qui a provoqué les rivalités associatives qui ont abouti à la violence sur l’espace universitaire. Les libertés d’association et d’expression autorisées et acceptées dans l’espace politique sont refusées dans l’espace universitaire. Car chaque parti politique voulait avoir le contrôle des mouvements estudiantins. En Côte d’Ivoire, tout le monde sait que la FESCI est proche du FPI de Laurent Gbagbo, c’est un secret de polichinelle. Relevant ce fait, D. L. Fié (2007, p. 75) écrit encore :
En effet, depuis sa création en mille neuf cent quatre-vingt-dix, qui coïncide avec l’instauration du multipartisme politique en Côte d’Ivoire, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), est apparue toujours comme le bras séculier de partis politiques se réclamant de gauche. À dire vrai, depuis ces années dites de multipartisme, il n’est pas rare de voir les militants des partis d’opposition, participer aux meetings de la FESCI, pour disent-ils, soutenir la lutte d’étudiants, lutter pour le bien- être de la gente estudiantine.
Ici apparaît un rapport étroit entre le « syndicalisme » estudiantin et la politique. Les étudiants sont parfois manipulés par des hommes politiques tapis dans l’ombre et qui espèrent tirer des grèves et manifestations des étudiants des bénéfices politiques. Il arrive parfois que des manifestations d’étudiants dégénèrent en marche et violence politique. Alors, surviennent des casses, des actes de vandalisme et des chasse-à-l ’homme entre manifestants et forces de l’ordre. D. L. Fié (2007, p. 76) conclut que « la tactique était d’instaurer un climat de terreur qui pousserait le pouvoir en place à des attitudes aux allures fascistes, en l’entraînant dans une logique de répression qui finirait par soulever contre le gouvernement la colère du peuple ». La collusion entre politique et « syndicalisme » ne tient qu’à un fil.
Les méthodes de ces « syndicats » sont connues : l’intimidation, la torture et parfois l’assassinat. Ce qu’ils redoutent et récusent, c’est la contradiction. Ils réclament pour eux le monopole de la défense des droits des étudiants. Mais ce combat, si noble soit-il, autorise-t-il la violence et la barbarie ? Pourquoi la tolérance, la diversité acceptée en politique et dans les religions n’auraient-elles pas droit de cité dans le milieu universitaire ? Mais avant, tâchons de répondre à cette autre interrogation : pourquoi plusieurs « syndicats » pour les mêmes étudiants ? La défense des droits des étudiants nécessite-t-elle la création de plusieurs « syndicats » ?
Il apparaît plus facile d’avoir un seul syndicat pour que la défense des droits des étudiants soit efficace. Car moins les « syndicats » sont nombreux plus il y a de la cohérence dans les actions. Tout compte fait, les bénéfices sont partagés par tous. L’idéal serait donc d’avoir une seule association pour la défense des droits des étudiants. Sous cet angle, l’hégémonie de la FESCI n’est pas à blâmer mais plutôt à saluer. C’est ici qu’il faut distinguer les principes syndicaux des principes politiques et religieux. Dans le domaine politique, le multipartisme se justifie par le fait que les intérêts des hommes sont divers et divergents. Il en est de même dans la religion où le principe de base et que le salut est personnel. En revanche, dans le milieu syndical, les intérêts d’une même corporation sont les mêmes. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour refuser l’existence de plusieurs syndicats. La création d’un syndicat découle des libertés d’association et de pensée. Toutefois, les raisons de la violence estudiantine ne sauraient se limiter à la rivalité « syndicale ». La crise des valeurs dans la société ivoirienne peut être explorée comme une autre raison de la violence estudiantine et scolaire.
1.2. Crise des valeurs et violence syndicale
L’une des vérités qui apparaissent comme une lapalissade est la crise des valeurs. Comme le faisait remarquer Rousseau, les sociétés contemporaines sont marquées par cette crise entendue comme une dépravation des mœurs. Sigmund Freud et Hannah Arendt lui emboitent le pas en écrivant respectivement Le malaise dans la culture et La crise de la culture. Il y a effectivement un malaise lié à une crise des valeurs. La délinquance, la criminalité et la drogue font partie des pratiques de la jeunesse déscolarisée, scolaire ou estudiantine. Les règles élémentaires de vie en société sont foulées au pied par une jeunesse qui n’a que faire de la vertu et de la discipline. Comment expliquer cette dépravation inquiétante des mœurs ?
Les causes principales sont l’évolution de la science et de la technique et la crise de l’éducation : le droit d’ainesse, le respect de la hiérarchie encore moins celui de l’autorité ne sont plus de mise dans nos sociétés. La vertu est en train de disparaître pour faire place au vice. L’avènement d’Internet et des réseaux sociaux contribue à ce changement négatif. En effet, l’accès facile aux réseaux sociaux par la jeunesse via le téléphone portable et/ou l’ordinateur leur permet d’échapper au contrôle parental pour s’adonner à des vices insoupçonnés. Il découle de cela que les règles de vie ne sont plus l’apanage des parents mais qu’elles sont aussi apprises sur les réseaux sociaux. Que faut-il attendre de toutes ces insanités débitées sur ces réseaux sociaux ? Qu’est-ce qu’un pasteur « marmailleur »[76] peut-il enseigner à la jeunesse ? Rien, si ce n’est la dépravation. Qu’est-ce que la dépravation des mœurs ? Les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie d’un groupe social. Elles varient d’un peuple à un autre. La dépravation des mœurs est donc l’abandon des bonnes mœurs au profit des mauvaises. En d’autres mots, les mœurs sont dépravées quand les vices prennent le dessus sur les vertus. Et cela est indéniable dans la société ivoirienne.
La jeunesse ivoirienne a pris le chemin du gain facile. Ce qui a entrainé, par exemple, le phénomène du « broutage »[77]. Ce penchant pour le gain facile a infecté les « syndicats » d’étudiants qui voient dans l’association syndicale un moyen de racket et d’enrichissement. Ainsi, par exemple, sur les campus ivoiriens, les étudiants « syndicalistes » ont pris l’habitude de prélever des montants sur les bourses d’étude de leurs condisciples. Ils s’approprient également les marchés informels sur les espaces universitaires et imposent des taxes aux commerçants qui s’y trouvent dans l’indifférence totale des autorités universitaires. Ces attitudes illégales font de ces « syndicats » d’étudiants, des formes de « mafia » dont la seule arme est la violence. Par conséquent, la naissance d’un nouveau « syndicat » est vue comme une défiance. C’est un « clan » rival qu’il faut neutraliser afin de profiter seul de ce monopole juteux. L’intellectualité qui donne sens à l’université fait place à la « loubardisation ». On entend par ce néologisme l’attitude guerrière qui remplace l’usage de la raison pour convaincre par l’usage de la force pour vaincre. Il n’est pas rare de voir sur les campus ivoiriens, des étudiants esquisser des pas de danse guerrière comme si c’était par la force qu’on défendait les droits des étudiants. Ainsi y avaient-ils des groupes spéciaux chargés des expéditions punitives.
À l’attitude oligarchique de ces étudiants, s’ajoute une autre attitude « timarchique » (Platon, 1966, p. 221) selon l’expression platonicienne. La timarchie est le gouvernement de l’honneur. Le gouvernant timarchique aime l’honneur par-dessus tout. L’homme timarchique, au final se reconnait par sa passion de la richesse, l’amour de l’honneur et ses pratiques violentes et guerrières. Cela caractérise bien les responsables syndicaux estudiantins qui se comportent, qui ne vivent pas de peu et qui font de la violence un moyen privilégié de lutte. Il leur arrive parfois de mener des expéditions punitives pour réprimer un groupe rival ou un dirigeant syndical « traitre ». Cette façon rebelle et violente de conduire les associations estudiantines les a amenés à se donner des surnoms (Bogota, Che Guevara). L’amour de l’honneur les a également amenés à se doter d’objets de luxe (voiture) et de gardes rapprochés à l’image des hautes personnalités de l’État ivoirien.
La crise des valeurs a empesté tout l’espace universitaire. Le respect du « maître » n’existe plus parce qu’à plusieurs reprises des enseignants ont été victimes de violences verbales et physiques. Même des syndicats d’enseignants n’hésitent pas à brutaliser leurs collègues et les autorités universitaires pendant des moments de grève. Finalement, l’usage de la violence est devenu une pratique commune sur l’espace universitaire ivoirien. Est-il possible de remédier à cet usage de la violence ? La partie suivante est une tentative pour répondre à cette interrogation.
2. Projet pour la pacification de l’université
La pacification de l’espace universitaire nécessite deux solutions complémentaires : la persuasion et la dissuasion. La persuasion est l’action d’amener quelqu’un à faire quelque chose sans recours à la violence. C’est aussi l’art de convaincre par des moyens pacifiques. Dans le domaine éducatif, l’art de convaincre s’accompagne toujours d’un moyen de dissuasion : la sanction.
2.1. L’éducation par la persuasion
Comment passer de la violence à la paix ? Comment passer du vice à la vertu ? Platon nous donne des pistes à travers sa théorie du philosophe-roi. En effet, le philosophe-roi tout comme l’étudiant qui accède à l’université a passé des épreuves lui permettant d’acquérir une certaine maturité qu’il doit simplement parfaire à l’université. Selon la théorie éducative de Platon, sortir de la caverne n’est qu’une étape vers la connaissance et la vertu. Tout comme le prisonnier qui sort de la caverne, l’étudiant qui sort du secondaire, n’a pas encore fini sa formation intellectuelle et morale. S’il a appris les sciences subalternes dans la première étape, il doit parfaire son éducation par les sciences abstraites qui permettent de connaître le Bien. À l’université, d’une manière générale, on ne se préoccupe pas de l’éducation mais seulement de l’instruction. Il est admis que l’enfant qui accède à l’université a reçu le minimum en matière d’éducation pour pouvoir intégrer la société. Dans ces conditions, comment maintenir le respect et l’autorité sur les campus et les cités universitaires ivoiriennes ? Mieux, comment pacifier et sécuriser l’espace universitaire gangrené par la violence et la délinquance ?
Même si à l’université l’accent n’est pas mis sur l’éducation au sens plein du mot, il est possible d’envisager des solutions alternatives pour une pacification durable de l’espace universitaire : il s’agit principalement de la restauration de l’autorité. Sur les campus universitaires se constate un recul de l’autorité qui donne l’impression aux étudiants que tout leur est permis. Les exemples où des étudiants molestent des enseignants sont nombreux. Des étudiants rançonnent aussi leurs condisciples et se poursuivent avec des armes blanches sans qu’un œil n’ose siller dans le campus. Pour remédier à ce genre de pratiques, il est indispensable de rétablir l’autorité. Qu’est-ce que l’autorité ? Peut-elle être séparée de l’éducation ? De quel pouvoir les autorités académiques disposent-elles pour garantir la sécurité sur les campus ? Nous allons recourir aux termes latins ‘’potestas’’ pour élucider le statut et la fonction de l’autorité. En effet, la potestas désigne la puissance, le pouvoir détenu par une personnalité. Cette puissance est fondée sur le statut, la fonction ou le grade et reconnue par les autorités universitaires et étatiques en ce qui concerne la Côte d’Ivoire, par exemple. C’est par ce pouvoir que les autorités peuvent à la fois commander et exiger l’obéissance des étudiants qui peuvent être contraints au besoin. Il leur revient d’utiliser ce pouvoir à bon escient pour établir l’ordre et la sécurité sur les campus. Comment utiliser ce pouvoir à bon escient ? Comment peut-on imposer l’autorité sans violence ?
La réponse est à chercher du côté de la personnalité de l’individu. Pour assouplir l’application de la loi, la « potestas » doit s’accompagner de ‘’l’auctoritas’’. Ce dernier est la capacité qu’a un individu d’imposer son autorité sans être investi par une instance supérieure : c’est le charisme qui est défini par (Max Weber 1971, p. 249) comme étant « La qualité extraordinaire d’un personnage pour ainsi dit doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains en dehors de la vie quotidienne inaccessibles au commun des mortels ». Sans ce dernier, l’application stricte, rigoureuse et mécanique de la loi galvaude l’autorité. Le charisme de l’individu conduit à l’obéissance sans contrainte. Il impose le respect sans menace, car comme l’indique l’étymologie du terme auctoritas, c’est l’individu acteur et auteur de l’acte qui lui confère sa valeur. En somme, pour réussir la pacification de l’espace universitaire, les autorités académiques doivent lier la « potestas » à « l’auctoritas ». Pour le dire autrement, elles doivent accorder la puissance légale et le charisme.
L’autorité éducative s’exerce non point pour régenter mais pour guider et éclairer la liberté des apprenants. Hannah Arendt (1972, p. 123) dit à ce sujet : « là où la force est employée l’autorité proprement dite a échoué ». L’exercice de l’autorité est donc incompatible à l’usage de la force. La force dissuade alors que l’autorité persuade. Elle éclaire car à côté de l’instruction que l’université donne, elle prépare le futur citoyen à intégrer la société où l’une des vertus cardinales est la liberté. Par conséquent, loin d’exercer une influence manipulatrice, elle exerce une influence libératrice. Le but de l’autorité éducative est d’amener l’apprenant à faire usage de sa propre raison afin de privilégier le chemin de la paix et de la tolérance. L’élève qui accède à l’université devrait quelques temps après pouvoir se servir « de son propre entendement » comme le disait Kant (2006, p. 13). Il quitte un monde qui est celui de l’école pour entrer dans un univers qui est différent de celui d’où il vient : l’Université. Contrairement au monde scolaire, celui de l’université est le lieu de l’émancipation. L’étudiant est presqu’un adulte qui doit user de sa propre raison. On sait que l’enfance est synonyme d’innocence, de minorité. L’étudiant, par contre, est majeur et a une responsabilité pénale. Ce statut l’oblige à reconsidérer son rapport à l’autorité qui bénéficie d’un statut légal et légitime. Dans l’Émile ou de l’éducation, Rousseau (1966, p. 106-107) écrit : « Le chef-d’œuvre d’une bonne éducation, est de faire un homme raisonnable ». Par conséquent, il faut bannir la violence dans le processus d’éducation. La violence ou les menaces finissent par abrutir l’enfant. De toute façon, la différence d’âge et le niveau d’étude constituent de vrais moyens de persuasion et de dissuasion. Cela suffit pour qu’il sache que l’éducateur est fort et que l’apprenant est faible. Dans ce contexte, l’éducateur, au lieu d’user de violence, doit amener, par un raisonnement logique, l’étudiant à reconnaître et accepter ses erreurs pour ne plus être amené à les commettre. Leur faire admettre la maladresse de leurs actes et les conséquences qui en découlent est une arme plus puissante que la répression. Les conseils suivants de Rousseau leur peuvent être utiles : l’apprenant doit savoir qu’il y a une différence entre « la licence et la liberté », qu’on peut le rendre heureux sans le gâter. C’est pourquoi, il ne faut point l’accoutumer à tout obtenir l’apprenant « qui n’a qu’à vouloir pour tout obtenir se croit le propriétaire de l’univers » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 129). L’éducation ne doit pas former des citoyens capricieux mais humbles, modestes et responsables. Elle accomplira alors sa double mission de faire un homme et un citoyen ainsi que le dit Vincent Lemiere (2017, p. 1) : « apprendre peut humaniser l’homme d’un côté et de l’autre côté, lui permettre d’exercer son rôle de citoyen en pleine conscience des responsabilités qui lui sont conférées ». D’ailleurs on ne finit pas d’apprendre. L’éducation est un processus infini qui permet à l’homme de se bonifier et « naître de nouveau à chaque génération et l’éducation est sa sage-femme » (P. Chanial, 2006, p. 205).
2.2. Le sens de la sanction
La Côte d’Ivoire connaît, depuis les années 90, une dégradation lente mais certaine de la vie estudiantine et scolaire. Cette dégradation a continué sans qu’elle n’inquiète personne jusqu’à ce qu’elle débouche sur la violence meurtrière. La négligence avec laquelle les autorités politiques et administratives ont traité ce problème a fait croire aux étudiants que l’université est un « État » dans l’État. Cette situation a connu son paroxysme avec la crise militaro-politique de 2011 à laquelle les étudiants ont activement pris part. Ainsi, les universités ont vu leurs portes fermées par le pouvoir politique de monsieur Alassane Ouattara pendant deux ans. L’espace universitaire est-il pacifié pour autant ? Les comportements barbares ont-ils été abandonnés par les « syndicats » d’étudiants ? Quelles solutions durables faut-il envisager pour pacifier l’espace universitaire ? Pour réussir ce pari ne faut-il pas adjoindre la sanction à la persuasion ?
Si le but de l’éducation est la formation du citoyen libre et épanoui, alors il appartient aux éducateurs d’insister sur la discipline et le respect de l’autorité. Rousseau donne le chemin à suivre. Pour lui, la sanction consiste à faire sentir à l’enfant les conséquences de son acte. Il y a un lien de causalité entre la faute et la punition. C’est l’autorité éducative qui doit faire comprendre ce lien à l’étudiant. Si la Bible (Romains 6, 23) insiste sur l’idée que « la mort est le salaire du péché », c’est pour montrer aux hommes que le mal est toujours puni. Spirituellement ou socialement, le mal a des conséquences négatives. Le mal est « un élément de destruction sociale » écrit Jean-Marie Guyau (1985, p. 177). C’est d’ailleurs pourquoi, selon Rousseau, la meilleure façon d’éduquer est d’empêcher le mal d’entrer dans le cœur de l’enfant. Toutefois, à l’université, nous n’avons plus affaire à des enfants incapables de faire usage de la raison. C’est au contraire des hommes soumis à l’injonction kantienne de faire usage de leur « propre entendement » (E. Kant, 2006, p. 43). Dès lors, la sanction doit changer de nature, car les étudiants sont capables de raisonner et de comprendre les principes du contrat social. En ce sens, ils doivent comprendre que l’ordre social est régi par des lois issues de la volonté générale et non par des caprices des uns et des autres, d’où cette formule : « N’offrez jamais rien à ses volontés indiscrètes que des obstacles physiques ou des punitions qui naissent des actions mêmes et qu’il se rappelle dans l’occasion ; sans lui défendre de mal faire ; il suffit de l’en empêcher. L’expérience ou l’impuissance doivent seules tenir lieu de loi » (J.-J. Rousseau, 1960, p. 101). Ce passage suggère deux idées. La première est qu’il ne faut jamais céder aux caprices des apprenants. L’éducateur doit avoir une attitude ferme sans jamais faiblir. La seconde consiste à opposer à ses caprices des obstacles impersonnels. Ces précautions lui permettront de prendre conscience de ses faiblesses afin qu’il adopte des attitudes et habitudes modestes et humbles. Ce faisant, il ne verra point la sanction comme venant de votre volonté mais de ses propres limites. Rousseau (1960, p. 9) recommande donc ceci :
Ne lui commandez jamais rien, quoi que ce soit au monde, absolument rien. Ne lui laissez pas même percevoir que vous prétendiez avoir aucune autorité sur lui. Qu’il sache seulement qu’il est faible et que vous êtes fort ; que, par son état et le vôtre, il est nécessairement à votre merci ; qu’il le sache, qu’il l’apprenne, qu’il le sente.
Il ajoute : « Ne vous plaignez jamais des incommodités qu’il vous cause, mais faites qu’il le sente le premier » (J.-J. Rousseau, 1960, p. 112).
Cette pédagogie rousseauiste, loin d’être laxiste apparaît comme une manière raisonnable de limiter la violence et la criminalité juvénile. Car les méthodes violentes, au lieu de faire des hommes pacifiques, font plutôt des hommes violents et indisciplinés. L’adolescent qui frappe aux portes de la société, doit être éduqué à être sociable. C’est pourquoi, plutôt que d’avoir peur de ses semblables, il doit s’attacher à eux et craindre les mauvais actes dont les conséquences seraient dommageables pour lui. En définitive, si on évite la violence, il reste une seule voie de pacifier l’université : c’est le dialogue. Il est possible de dialoguer avec les étudiants parce qu’ils ont l’âge de la raison. « Le chef d’œuvre d’une bonne éducation est de faire un homme raisonnable » (J.-J. Rousseau, 1960, p. 107). Le dialogue est la voie de la sagesse car il permet, dans un enchainement logique, de déceler les erreurs pour ne plus y retomber. L’homme est naturellement bon, mais il peut se tromper de bonne foi. Même quand il est trompé, il peut s’en rendre compte par le dialogue pour revenir sur le droit chemin. Mais, contrairement à ce que pense Rousseau, l’homme a un côté barbare que seule la discipline peut étouffer.
Pour Kant, la discipline est l’essence de l’éducation, puisque sans elle, l’homme serait pis qu’un animal sauvage. C’est parce que la destinée de l’homme est la liberté qu’il faut le contraindre, le punir si nécessaire, pour que son destin s’accomplisse. Éduquer c’est ordonner, guider l’enfant qui, laissé à lui-même ne saurait trouver le chemin de l’autonomie. La finalité de l’éducation n’est rien d’autre que l’autonomie, c’est-à-dire la capacité qu’a tout être humain de se servir de son propre entendement. Au sens kantien, la discipline est nécessaire parce que l’homme n’est pas forcément un être débonnaire. Il ne faut donc pas se voiler la face et se faire des illusions. L’homme ne peut pas être bon de lui-même, il lui faut l’aide de son prochain pour devenir bon et libre. Abondant dans le même sens, Alain soutient que la bonne éducation doit concilier la discipline et la liberté.
J’ai observé quand j’étais enfant que ceux qui maintenaient l’ordre comme on balaie, comme on range les objets matériels, étaient aussitôt redoutés par cette indifférence qui enlevait tout espoir. Et, sans exception, ceux qui voulaient persuader, écouter, discuter, pardonner enfin aux promesses étaient méprisés, hués, et, chose triste à dire, finalement haïs ; au lieu que les autres, les hommes sans cœur, étaient finalement aimés ». (Alain, 1932, p. 34-35)
Il ressort de ces propos que les hommes comprennent parfois mieux le langage de la dissuasion que celui de la persuasion. En d’autres termes, pour être écouté, il faut être craint. Mais la force éduque-t-elle mieux que le langage ? Pour éduquer, faut-il réprimer ou convaincre ? Quelle est la place de la punition dans le processus éducationnel ?
Il est vrai que l’usage abusif de la discipline dévoie l’éducation mais une éducation sans punition est vaine. Punir, c’est réprimer, châtier, infliger une souffrance à quelqu’un qui a commis une faute. « Punir c’est infliger un mal pour compenser ou annuler un autre mal » (E. Prairat, 2001, p. 28). Si on pousse la rigueur plus loin, on peut établir une distinction entre la punition et le châtiment. Prairat trouve cette distinction dans la tradition chrétienne. À ce titre, il rappelle :
La tradition chrétienne ne manque pas une occasion d’opposer le châtiment à la punition avec le souci affiché de valoriser le premier terme. On châtie celui qui fait une faute afin de l’empêcher d’y retomber, on veut le rendre meilleur… On punit celui qui a fait un crime pour le faire expier : on veut qu’il serve d’exemple. Le châtiment dit une correction, mais la punition ne dit précisément qu’une mortification faite à celui qu’on punit. […] Le châtiment lui-même est plus moral, plus paternel que la punition proprement dite, même quand il semble plus humiliant et plus sévère. Les pères châtient leurs enfants ; les juges font punir les malfaiteurs… Le châtiment dit surtout une correction profitable à celui qui la reçoit ; mais la punition dit avant tout une peine infligée à celui qu’on veut punir […] Si punir c’est venger l’infraction de la loi, châtier, c’est tendre à améliorer (E. Prairat, 2001, p. 30)
Ce long texte permet de comprendre la différence entre le châtiment et la punition selon le but assigné à chacun d’eux : le premier sert à améliorer tandis que le second sert à infliger une douleur.
C’est le prix à payer. L’adage dit : « qui aime bien châtie bien ». Châtier au nom de l’amour signifie qu’on ne veut plus que l’être aimé retombe dans les travers d’hier. Mais comment faire accepter au châtié et au puni leur sort ? Ici intervient un autre terme : la sanction. Elle diffère des deux premiers termes en ce qu’il renferme à la fois la répression et la récompense, car elle est en définitive la conséquence d’une action.
Conclusion
En Côte d’Ivoire, le retour au multipartisme s’est accompagné d’une multiplication des associations d’élèves et étudiants. Certains, appelés par abus de langage « syndicats », s’illustrent par la violence. Refusant le pluralisme syndical, ils n’hésitent pas à pourchasser, violenter et parfois assassiner des militants de syndicats rivaux. Cette violence congénitale s’explique d’une part par l’influence et la manipulation de dirigeants politiques voulant se servir de ces associations pour imposer et maintenir leur influence sur l’espace universitaire, et d’autre part par la dépravation constante des mœurs dont l’un des effets est la violence estudiantine exercée à la fois sur les étudiants, le personnel administratif et académique. Nous avons mené cette étude pour proposer des solutions qui pourraient permettre de ramener la paix et la sérénité dans l’espace universitaire. La première solution est d’ordre éducatif et pédagogique. En Côte d’Ivoire, l’université n’a pas une vocation éducative contrairement au secondaire. Cependant elle peut combler ce déficit en restaurant et en renforçant l’autorité dont Hannah Arendt dit qu’elle « a disparu du monde moderne » (H. Arendt, 1972, p. 121). Cette autorité peut s’exercer par le pouvoir de la connaissance que détiennent les enseignants et l’administration universitaire. Au pouvoir de la connaissance peut s’ajouter le charisme en tant que pouvoir naturel qu’a un homme pour se faire accepter et respecter. Les étudiants étant des êtres raisonnables, le pouvoir de la connaissance et du charisme peut les persuader et les convaincre de renoncer à la violence. Mais si cette solution s’avère insuffisante, son efficacité peut être renforcée par la sanction qui, en écartant la violence doit conduire les étudiants à subir les conséquences de leurs actes.
Références bibliographiques
ALAIN, 1932, Propos sur l’éducation, Paris, PUF.
ARENDT Hannah, 1972, La crise de la culture, trad. Patrick Lévy, Paris, Gallimard.
CHANIAL Philippe, 2006, « Une foi commune : démocratie, don et éducation chez John Dewey », in Revue du Mauss, n° 28/2, Paris, La Découverte, pp. 205- 250.
FIÉ Doh Ludovic, 2003, La Théorie Critique chez Herbert Marcuse, thèse de Doctorat Unique, Bouaké, Université.
FIÉ Doh Ludovic, 2007, « École et violence. Contribution à la critique de la régression vers la barbarie », in LE KORE, Revue ivoirienne de philosophie et de culture, N°38, pp. 71-89.
FREUD Sigmund, 2010, Le malaise dans la culture, trad. de Dorian Astor, Paris, Flammarion.
GUYAU Jean-Marie, 1985, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, Paris, Fayard.
KANT Emmanuel, 2006, Qu’est-ce que les Lumières ?, trad. Dominique Bourel et Stéphane Piobetta, Paris, Éditions Mille et une nuits.
KANT Emmanuel, 1993, Réflexion sur l’éducation, trad. Alexis Philonenko, Paris, Vrin.
La BIBLE, 2000, Paris, société biblique française.
LEMIERE Vincent, 2017, « Politique et éducation chez Rousseau », in Enseignement Catholique, 15 et 16 juin, www.ensignement-catholique.fr, consulté le 12 mai 2022.
PRAIRAT Eirick, 2001, Sanction et socialisation, Paris, PUF.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1960, Émile ou de l’éducation, Paris Flammarion
WEBER Max, 1971, Économie et société, traduction de J. Chavez G. de Dampierre, Paris, Plon.
LES RELATIONS CONFLICTUELLES ENTRE LES SYNDICATS ET L’ADMINISTRATION GABONAISE. CAS DU SNEC DE 1991 À 2020
1. Lucien MANOKOU
Institut de Recherche en Sciences humaines (Gabon)
2. Nathalie EBANETH
École Normale supérieure (Gabon)
Résumé :
Les organisations syndicales ont pour mission la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs des syndiqués. Mais au Gabon, l’exerce de ce sacerdoce est rendu difficile par les manigances des responsables des administrations. Le Syndicat National des Enseignants et Chercheurs (SNEC) n’échappe pas à ces manœuvres nuisibles pour l’action syndicale. Ses membres et surtout ses leaders font l’objet d’intimidations, de suspensions de salaire, de filatures, de mise sur écoute, d’arrestations qui participent à saper l’action syndicale. Ceci révèle une absence totale de dialogue social, pourtant prôné par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et qui aurait pu assainir les relations entre partenaires. Cette réflexion tente de retracer les actions menées par ce syndicat dans une relation conflictuelle qui l’oppose aux autorités administratives et politiques.
Mots clés : Autorités, Chercheurs, Enseignants, Relations conflictuelles, SNEC, syndicat, gouvernement.
Abstract:
Union organizations have the mission of defending the professional, moral and material, social and economic, individual and collective interests of union members. But in Gabon, the exercise of this priesthood is made difficult by the shenanigans of the heads of the administrations. The National Union of Teachers and Researchers (SNEC) is no exception to these maneuvers that are harmful to union action. Its members and especially its leaders are subject to intimidation, salary suspensions, shadowing, wiretapping, arrests which contribute to undermining union action. This reveals a total absence of social dialogue, yet advocated by the International Labor Organization (ILO) and which could have improved relations between partners. This reflection attempts to retrace the actions carried out by this union in a conflictual relationship that opposes it to the administrative and political authorities.
Keywords : Authorities, researchers, teachers, conflictual relations, SNEC, union, government.
Introduction
Au début des années 1990, le paysage syndical gabonais s’est élargi avec la création de nombreux syndicats et centrales syndicales, tant dans l’administration publique que dans les entreprises privées. Ce retour de l’expression syndicale pluraliste dans le pays est consécutif à l’avènement du multipartisme. C’est dans cette conjoncture que se crée d’abord une Mutuelle des enseignants en 1989, avant qu’elle ne se mue ensuite en Syndicat National des Enseignants et Chercheurs (SNEC) de l’Enseignement supérieur le 17 mars 1990. Sa légalisation est obtenue trois ans plus tard, le 30 juillet 1993. Il faut rappeler que le syndicat est un regroupement de personnes destiné à assurer la défense collective et individuelle des intérêts matériels et moraux des salariés,aussi biendans les entreprises que dans les administrations publiques. En réalité, tout en se fondant sur les normes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le syndicat a pour vocation de promouvoir la justice sociale, les droits de l’homme et les droits au travail reconnus internationalement, œuvrant ainsi à garantir une paix sociale durable et universelle[78].
En rassemblant les membres d’une corporation, le syndicat est un lieu de socialisation au même titre que le milieu scolaire, les formations politiques, les ONG et les associations diverses. C’est pourquoi l’adhésion à un syndicat est considérée non seulement comme l’affirmation à l’appartenance à une corporation, mais aussi la volonté de participer au bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’administration dans laquelle on travaille. Pour cela, le syndicat s’assure que ses membres ont une bonne connaissance de leurs droits et des textes législatifs et règlementaires qui régissent leur secteur d’activité.
Dès sa création, le SNEC s’est investi dans sa mission de défense des intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs des enseignants et chercheurs. Mais il n’est pas souvent aisé d’assumer ce sacerdoce dans un environnement où les gouvernants ne sont pas disposés à accepter la revendication et la contestation qui sont pourtant des formes de participation citoyenne, et par conséquent des indicateurs du niveau de démocratie dans un Etat de droit,comme le confirme l’enquête « Afrobarometer » (L. Osse, 2020)de 2020.
Malgré un environnement difficile, et à l’instar d’autres syndicats qui voient le jour à la même période, le SNEC s’est assigné comme objectif de « rechercher auprès des autorités universitaires et politiques l’amélioration des conditions de travail et d’existence des enseignants et chercheurs gabonais, en exerçant ses activités dans le respect des lois et règlements en vigueur », selon les termes de l’article 2 de ses statuts.
Mais ses activités ont souvent été entravées par des manigances des autorités universitaires ou gouvernementales. Enlèvements, suspensions de salaires, débauchage des responsables syndicaux par des nominations administratives, intimidations (signatures des attestations spéciales), mise sur bons de caisse, mise sur écoutes téléphoniques et filatures sont les pratiques usitées par les autorités pour violer les droits syndicaux[79] et affaiblir ainsi l’action syndicale. Toutefois, cela n’a pas entamé l’activité syndicale qui a permis d’obtenir un certain nombre d’acquis tels que l’instauration et l’augmentation progressive de la Prime d’Incitation à la Recherche (PIR) pour soutenir les universitaires gabonais dans leurs activités de recherche, lesquelles ont permis de passer les grades.
Cette réflexion, qui traite de la relation problématique entre le SNEC et les autorités administratives et politiques, s’inscrit dans une perspective de dialogue social qui devait régir cette relation. De ce fait, cet article vise à questionner les initiatives du SNEC de 1991 à 2020 dans le but d’améliorer la condition enseignante au sein des universités et grandes écoles gabonaises. En effet, analyser les succès et les échecs passés permet de comprendre, comme l’affirme J. Freyssinet (2017, p. 9) « les facteurs qui peuvent pousser les différents acteurs à s’engager activement dans une démarche … du dialogue social ».
Le travail s’appuie sur une bibliographie variée, complétée par des témoignages recueillis auprès de quelques acteurs vivants de cette organisation syndicale. Ces témoignages constituent des sources importantes pour notre travail. Cette étude se propose donc de retracer les actions menées par le SNEC pendant cette période, malgré l’hostilité de l’administration. C’est la raison pour laquelle au terme d’une réflexion sur les enjeux du dialogue social dans le contexte social gabonais, nous aborderons le rôle du syndicat en général et son importance dans la société gabonaise en particulier. Ensuite, nous présenterons les actions engagées par le SNEC malgré les manœuvres orchestrées par les responsables administratifs et politiques, avant d’indiquer les voies susceptibles d’améliorer les relations entre ces deux partenaires.
1. Enjeux et théories du dialogue social
1.1. Les avantages du dialogue social
Le dialogue social a joué un rôle important à travers l’histoire des relations professionnelles. Il est au cœur des réflexions sur l’avenir du travail. C’est pourquoi il apparaît aux yeux de nombreux auteurs comme étant un facteur d’efficacité économique et de progrès social (Serna et Ermida, 1994, 1995 ; Oscar Ermida, 2000 ; Freyssinet, 2017).
En effet, grâce au compromis qui résulte de toutes les formes d’interaction entre partenaires, à savoir le conflit et la négociation au sens large, le dialogue social fait intervenir le partage d’informations, les mécanismes de consultation, la négociation collective, la participation, la concertation sociale, etc. À ce propos, la concertation peut être institutionnalisée ou non. Cependant, elle accorde une place de choix au sein des instances sectorielles et nationales aux méthodes participatives et volontaires de règlement des conflits.
Un autre avantage du dialogue social réside dans son caractère d’ouverture. En effet, au gré des problématiques posées, les partenaires appelés à siéger peuvent appartenir à des groupes d’intérêts plus larges. De fait, le dialogue social tend à susciter un esprit de collaboration et d’harmonie, tant il privilégie un partenariat bénéfique à toutes les parties. Il implique en conséquence une participation à la prise de décision et assure aux travailleurs une plus grande influence sur les décisions à prendre. Dans sa matérialisation, le dialogue social peut, au moyen de la concertation sociale, déboucher sur des pactes sociaux, des accords-cadres bipartites ou tripartites, gages de la sauvegarde des intérêts professionnels.
1.2. Les différentes formes de dialogue social
Afin de poser une plate-forme à partir de laquelle se construisent les responsabilités des partenaires, la littérature présente plusieurs types de dialogue social. Nous allons à cet effet emprunter la typologie du dialogue social présentée par Oscar Ermida (2000, p. 52-53) dans son analyse des relations professionnelles au sein des pays du MERCOSUR. L’auteur présente une typologie du dialogue social en cinq dimensions.
Le premier type de dialogue social est le mode formel. Il intègre les cadres légaux et les instances prévues en vue de la négociation entre partenaires pour le règlement d’un différend. C’est essentiellement le domaine de la norme juridique qui prévaut.
Le deuxième type opère une distinction claire entre modes de dialogues formels qui institutionnalisent le dialogue et modes informels relevant d’initiatives plus ou moins spontanées et non réglementées. Ce mode donne lieu à des relations professionnelles informelles.
Le troisième type de dialogue social proposé par l’auteur est celui qui se déroule ou non au sein d’un organe spécialement créé à cet effet. Cet organe revêt un caractère consultatif. En l’absence de ce cadre spécifique, le dialogue est considéré comme étant spontané. Cependant, il n’est pas exclu pour l’auteur que ce dialogue informel puisse déboucher sur un accord qui revêt un caractère formel, à l’image d’une convention, etc.
Le quatrième type met l’emphase sur la dimension temporelle du dialogue social. Sur la base d’un consensus, ce dernier peut arborer un caractère permanent, intermittent et/ou sporadique.
Enfin, la cinquième dimension renvoie aux différents niveaux du dialogue social. Ce modèle fait abstraction de la dimension formelle ou non du dialogue. Il peut être centralisé ou se situer à l’échelon national, voire international. Ce développement sur le dialogue social montre les bénéfices que l’on peut en tirer lorsqu’il est appliqué. Malheureusement, ce n’est pas réellement le cas au Gabon.
2. Le syndicat au Gabon : une existence difficile
En tant que syndicat, le SNEC s’est donné comme mission de porter les revendications des universitaires gabonais auprès des autorités[80] en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail et d’existence. Pour cela, le syndicat est amené à entrer en contact avec ces autorités pour la satisfaction de ses revendications. En effet, comme le faisait remarquer déjà J. Chevallier, (1987, p. 65-66), cette relation est nécessaire car, d’une part, l’Etat ne peut ignorer le fait syndical et, d’autre part, le syndicalisme ne peut se passer de l’Etat. Puisque « les luttes syndicales débouchent sur l’arbitrage étatique, l’Etat est directement présent dans le jeu social ». C’est pourquoi, il est important de voir, à ce niveau de la réflexion, la position du syndicat vis-à-vis des autorités et comment ces autorités perçoivent l’action syndicale.
2.1. Le syndicat : partenaire légal de l’État
Au Gabon, les syndicats s’estiment des partenaires légaux des organisations patronales et du gouvernement, car leurs actions se fondent sur les lois en vigueur. Pour les syndicats, le premier instrument juridique qui régit la société en République gabonaise est naturellement la loi fondamentale[81]. L’alinéa 13 de son article 1er autorise entre autres la formation des syndicats sous réserve du respect des lois en vigueur. Ensuite, le Code du Travail[82] qui s’applique surtout dans le secteur privé. L’article 15 de ce Code garantit la liberté et l’exercice du droit syndical et reconnait le droit de grève. De même, il interdit à tout employeur de ne pas saboter l’action syndicale en « usant de moyens de pression à l’encontre ou en faveur d’une organisation syndicale des travailleurs ». Enfin, la loi 18/92[83] qui régit les organisations syndicales des agents de l’Etat. Ses articles 5 et 6 permettent aux fonctionnaires non seulement de former des syndicats, mais aussi d’adhérer aux organisations syndicales de leur choix. Le SNEC, dont tous les adhérents sont fonctionnaires, est plus concerné par cette loi à laquelle s’ajoutent d’autres lois générales[84] sur la Fonction publique et spécifiques[85] pour la corporation.
À côté de ces textes nationaux, les syndicats légitiment leurs activités en s’appuyant également sur les conventions internationales ratifiées par le Gabon, notamment celles de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Pour le cas du SNEC, il s’appuie également sur les recommandations de l’UNESCO concernant l’enseignement supérieur[86]. Tous ces instruments juridiques démontrent que les syndicats mènent leurs activités en toute légalité, conformément aux textes en vigueur. Même si le gouvernement peut souvent avoir une autre perception de l’action syndicale.
2.2. Le gouvernement et les syndicats : une relation difficile
Dans l’ensemble, les autorités gabonaises et les chefs d’entreprises considèrent les syndicats comme des éléments subversifs dont la seule ambition est de perturber leur pouvoir pour les premières et comme des agitateurs contestant leur gestion pour les seconds. Pour ce qui est de l’administration, le syndicaliste est souvent la bête noire des responsables administratifs et politiques. Et pourtant, tous reconnaissent non seulement la légitimité des revendications exprimées, mais aussi la contribution des syndicats dans l’amélioration des conditions de travail et de vie des fonctionnaires en général. Ce qui ne les empêche pas de menacer les syndicalistes. Les propos du ministre de la Réforme de l’Etat en 2017 révèlent la teneur de ces menaces :
Je suis un défenseur de MOUSSAVOU Florentin (son collègue de l’Education nationale) et défenseur de la solidarité gouvernementale. Il n’y a pas d’opposition au Gabon. Vous êtes les seuls qui, aujourd’hui, nous empêchez d’asseoir notre pouvoir…Quand je veux asseoir mon pouvoir, si quelqu’un m’embête, je le tape et puis voilà. On va vous liquider. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Vous êtes en danger, on va vous liquider…[87].
À travers ses propos, le membre du gouvernement considère les syndicats comme des ennemis. Dans la même lancée, lors de l’adresse à la nation du 16 août 2018, le président de la République traitait les syndicalistes de « professionnels de la contestation ». Cette attitude des gouvernants est corroborée par un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007 qui concluait que : « l’exercice du droit de grève est limité au Gabon » et que « les syndicalistes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, font souvent l’objet de discriminations. Ils sont régulièrement harcelés ou tout simplement licenciés ».
Considérant les syndicats comme des agitateurs à éliminer, les autorités montrent leur inimitié envers les syndicalistes soit en manifestant de la mauvaise foi, soit en châtiant avec une extrême sévérité. La mauvaise foi se manifeste lorsque les ministres sont curieusement étonnés des grèves qui se déclenchent dans leur département ministériel. Or, la pratique syndicale, appuyée par la loi 18/92, veut qu’un cahier de charge soit d’abord déposé auprès de la tutelle. Si elle n’y prête pas attention, le syndicat dépose ensuite un préavis pour rappeler l’importance des revendications. Ce dernier court huit (8) jours francs. Si à ce niveau la tutelle demeure inaudible, c’est alors que le syndicat décide d’entrer en grève. De ce fait, plusieurs étapes précèdent l’entrée en grève. Donc, lorsqu’un ministre s’étonne du déclenchement d’une grève dans son département, ce n’est que de la roublardise[88] qui traduit peut-être ses limites à apporter des solutions aux revendications légitimes des syndicats.
Étant dans l’incapacité de satisfaire les revendications posées, les ministres optent très souvent pour des sanctions extrêmes telles que les coupures de salaires. Les membres du SNEC en ont été victimes en 2015 lorsque la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, à laquelle le SNEC est affilié, avait déclenché une grève le 09 février pour exiger l’application du nouveau système de rémunération des fonctionnaires gabonais, longtemps promis par le gouvernement. À l’Enseignement supérieur, vingt-sept enseignants de l’Université Omar Bongo (UOB) et près de cent soixante-quinze de l’École Normale Supérieure (ENS) ont été privés[89] de leurs salaires pendant quatre mois (février-mai 2015), avec deux mois supplémentaires pour les leaders syndicaux. Mais aucun enseignant de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), ni ceux de l’Université des Sciences de la Santé (USS) n’avaient été frappés[90] par cette mesure, alors que tous les établissements observaient le débrayage à des degrés divers.
À l’inverse, de nombreux griefs peuvent être relevés à l’encontre des organisations syndicales. Ce sont notamment les déclenchements des grèves intempestives qui ne respectent pas la procédure légale. C’est le cas lorsque les syndicats barricadent les établissements, en ne prévoyant pas des issues permettant aux non-syndiqués d’aller et venir en toute liberté. L’autre grief imputé aux syndicalistes c’est le fait de se laisser corrompre, avec pour conséquence de porter atteinte à la crédibilité et à la légitimité d’autres leaders syndicaux. Par rapport à ces dérapages, l’un des éléments explicatifs possibles serait le manque de formation syndicale.
3. Les victoires du SNEC
Malgré l’environnement conflictuel dans lequel le SNEC exerce, des actions ont été menées qui ont abouti à des résultats concrets aussi bien pour le bon fonctionnement des universités et grandes écoles gabonaises, mais également pour les conditions de vie et de travail des universitaires.
3.1. Quelques avancées au niveau des conditions de vie
Dans ce registre, depuis sa création, le SNEC a pu obtenir satisfaction de certaines revendications grâce aux luttes syndicales. Dans un article consacré au président de ce syndicat, A. Adjo (2018, p. 8) énumère quelques acquis : « la parcelle d’Angondjé, la mesure dite « un enseignant, un ordinateur »[91], le doublement de la prime de l’année sabbatique, l’augmentation de la Prime d’Incitation à la Recherche (PIR) »[92]. On peut ajouter l’élection comme mode de désignation des chefs d’établissements et recteurs d’université pendant un temps, les équipements ponctuels des laboratoires et centres de recherche, les présalaires pour les universitaires nouvellement recrutés avant l’obtention du poste budgétaire. Toutefois, nous nous focalisons sur la PIR et la parcelle d’Angondjé.
L’un des acquis qui a aidé les universitaires gabonais dans leurs activités de recherche c’est la Prime d’Incitation à la Recherche (PIR) obtenue en 1991, juste un an après la création du SNEC. Dans ses revendications de l’époque, le syndicat avait demandé l’augmentation de salaire. A la place, le gouvernement a donné cette prime de 100.000 FCFA[93] mensuel, respectant ainsi la pratique du président Omar Bongo qui, devant les revendications d’augmentation de salaire des syndicats, créait des primes sectorielles. N’ayant connu aucune augmentation pendant dix ans, malgré le coût élevé de la vie, l’augmentation de la PIR fut à nouveau un point de revendication lors de la grève de 2000. Une fois de plus, une augmentation de 150.000 FCFA fut obtenue[94], portant à 250.000 FCFA le montant de la PIR. En février 2013, lassée par les multiples promesses[95] d’augmentation des salaires des enseignants du président de la République au début de son mandat, l’Assemblée générale du SNEC décide d’une grève pour exiger cette augmentation. A l’issue d’une grève de plus de trois mois, le Premier Ministre décide d’une augmentation de 250.000 FCFA de plus avec la promesse de la mensualiser[96] sur la base d’un protocole d’accord.
L’autre acquis qui fait la fierté des universitaires au Gabon c’est la cité d’Angondjé. En effet, lors de la grève de 2000, les universitaires demandaient des crédits à taux zéro pour être propriétaires immobiliers. A cette demande, le président Bongo proposa plutôt trois sites. Finalement, c’est la seule parcelle d’Angondjé que les universitaires ont acquis à partir de 2005, après moult rebondissements. Aujourd’hui, la société immobilière SCI-Serpentin mise en place regroupe trois cent seize (316) sociétaires enseignants et chercheurs, dont soixante (60) résidences habitées et plusieurs maisons en construction.
Si au niveau des conditions de vie des enseignants et des chercheurs, des choses ont été faites, c’est au niveau des conditions de travail, surtout sur le plan pédagogique, que les propositions du SNEC n’ont pas souvent été prises en compte.
3.2. Des conditions de travail insuffisantes
Tout au long de son existence, le SNEC a fait des propositions susceptibles de parfaire la gouvernance universitaire et permettre à l’enseignant de donner le meilleur rendement dans l’accomplissement de son sacerdoce, mais ces dernières n’ont pas souvent été prises en compte.
Il y a d’abord la question de l’élection des chefs d’établissements. A la fin des années 1990, le ministre de l’Enseignement supérieur supprime l’élection comme mode de désignation des chefs d’établissements et de départements. Ce fut l’un des points de revendication de la grève de 2000. Le SNEC estimait que l’élection d’un chef d’établissement lui donnait plus de légitimité auprès de ses collègues et le devoir de rendre compte. Ce qui conduirait inéluctablement à une bonne gouvernance des établissements d’Enseignement supérieur. A l’issue de la grève de 2000, le SNEC obtient l’élection des chefs d’établissements. Malheureusement, deux ans après le gouvernement la supprima, comme le rappelle G. Moussavou (2020, p. 71) qui cite le quotidien gabonais L’Union[97] :
Des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la désignation des chefs d’établissements d’Enseignement supérieur sont abrogées. Dorénavant, ces responsables seront nommés par décrets pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Depuis cette date, les chefs d’établissements sont nommés en Conseil des ministres. Il y a ensuite l’épineux problème des capacités d’accueil des établissements d’Enseignement supérieur. La genèse des établissements universitaires gabonais révèle qu’en dehors de l’USTM qui a été pensée comme université, tous les autres ont hérité des bâtiments divers qui ont été transformés en établissements. Par conséquent, ils n’ont pas été préparés à recevoir une grande population estudiantine. Au fil des années, le nombre d’étudiant a grossi et les structures devenues obsolètes. Depuis plusieurs années, le SNEC appelle les autorités ministérielles à se pencher sérieusement sur ce problème, en vain. L’un des points de revendication de la grève de juin 2019 portait justement sur « l’augmentation des capacités d’accueil dans les universités, grandes écoles et les instituts de recherche ». Aujourd’hui, l’insuffisance des capacités d’accueil est à l’origine du décalage calendaire dans la majorité des établissements. Une note du ministère de 2018 comptabilisait à 45.000 le nombre d’étudiants pour 33.000 places. Ce qui traduit un déficit de 12.000 places.
4. Le SNEC et les autorités : une entente nécessaire
Dans toutes les administrations ou institutions, le syndicat est un acteur qui concourt au bon fonctionnement de la structure dans laquelle il exerce. Pour le cas des universités ou grandes écoles au Gabon, le SNEC, tout comme l’administration universitaire, la mutuelle des étudiants et le personnel ATOS[98] participent chacun à son niveau au bon fonctionnement des établissements de l’Enseignement supérieur. Toutefois, pour qu’une relation plus constructive s’établisse entre le syndicat et les autorités, il est nécessaire de revoir certaines pratiques. Mais avant tout, une révision des textes est importante pour avoir un cadre juridique qui facilite l’exercice du droit syndical.
4.1. L’impérieuse nécessité de revisiter les textes
Dans son rapport de 2007, la CSI relevait que la loi reconnaissait le droit des citoyens à former des syndicats. Mais elle constatait tout de même que l’exercice du droit de grève est limité au Gabon. C’est la raison pour laquelle elle recommandait au pays de « modifier sa législation pour permettre à tous les travailleurs d’exercer leur droit de grève ». Mais le Gabon n’a pas répondu favorablement à cette recommandation. Certes, le pays a lancé le chantier de la révision du code du travail, mais jusqu’en 2020 le nouveau code du travail n’était pas promulgué. Quant à la loi 18/92[99], qui régit les organisations syndicales des agents de l’Etat, elle n’a pas fait l’objet d’une quelconque modification ou révision. Au contraire, la loi 001/2017 relative aux manifestations en République gabonaise est venue renforcer l’arsenal répressif sur les syndicats.
4.2. Des propositions pour une relation plus apaisée
Pour établir un climat de confiance entre partenaires, il est nécessaire de passer par le fil du dialogue. Ce dialogue doit se traduire par la régularité des échanges entre les acteurs du monde universitaire et par la mise en place d’un véritable dialogue avec la tutelle.
Dans son objectif de dialogue permanent avec tous les acteurs du monde universitaire, le Bureau national du SNEC entreprend périodiquement des tournées d’explication et de sensibilisation auprès des chefs d’établissements. C’est l’occasion d’échanger sur le cahier de charge du syndicat et rappeler les droits et les devoirs de chaque acteur. In fine, ces échanges permettent de régler les problèmes dans les établissements.
En plus de ces discussions avec les chefs d’établissements, un cadre du dialogue social doit impérativement être mis en place au sein du ministère de l’enseignement supérieur. En effet, comme le définit l’OIT : « le dialogue social englobe toutes formes de négociation, de consultation ou d’échange d’informations entre partenaires ». Ainsi, ce dialogue serait le cadre formel de règlement des problèmes au sein du ministère.
Conclusion
Au sortir de cette analyse, il apparaît clairement que le Gabon manque de vision dans la gestion des relations professionnelles. En effet, le manque d’un cadre du dialogue social fonctionnel[100] et l’absence des élections professionnelles constituent des handicaps majeurs à l’épanouissement de l’action syndicale. Certains acquis du SNEC (parcelle d’Angondjé, relèvement de la PIR, etc.) n’ont pu être obtenus que grâce à la volonté du Chef de l’Etat ou du Premier Ministre.
La tradition qui semble se dégager, dans le règlement des conflits, privilégie le règlement spontané des crises en lieu et place du respect d’un cadre formel prévu par la loi. Pour rappel, la loi 1/2005 prévoit des organes consultatifs dont les commissions paritaires, qui sont des cadres formels de négociation. Dans les rares occasions où le cadre légal est respecté, l’expérience a montré que chaque fois que le syndicat et les autorités discutaient franchement des engagements étaient pris. Mais ils n’étaient pas souvent respectés.
Références bibliographiques
« Le SNEC réclame le rétablissement des salaires des enseignants de l’Ecole normale supérieure (ENS) », in https://www.lenouveaugabon.com, consulté le 22 avril 2022.
ADJO André, 2018, « Jean Rémy YAMA : intellectuel pragmatique aux convictions constantes », in Moutouki, N°127, p. 8.
CHEVALLIER Jacques, 1987, « Le syndicalisme et l’Etat : entre l’autonomie et l’intégration », in L’actualité de la charte d’Amiens, pp. 65-120.
Comité de la liberté syndicale du Conseil d’Administration, La liberté syndicale. Recueil de décisions et de principes, 4e édition, Genève, BIT, OIT. 1994.
CSI, 2007, « Nouveau rapport de la CSI sur les droits des travailleurs au Cameroun et au Gabon »,in https://survey.ituc-csi.org/Gabon.html?lang=fr, consulté le 05 mai 2022
Décret n°371/PR/MESRS du 21 mars 1988 fixant le statut particulier des personnels de la recherche scientifique et technologique.
Décret n°866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier du personnel enseignant de l’enseignement supérieur.
Dynamique Unitaire, 2018, Rapport sur les violations des droits humains et les libertés fondamentales au Gabon, Libreville, Document inédit, 19 p.
Entretien avec Dr Jean ZEH ONDOUA, membre fondateur du SNEC, retraité de la FDSE, ancien membre et conseiller juridique du SNEC, le vendredi 13 mai 2022 à son domicile.
Entretien avec le Pr Marc Louis ROPIVIA, membre fondateur du SNEC, ancien ministre, ancien recteur. L’entretien a eu lieu à son domicile le 04 juin 2022, à 10h55.
ERMIDA Oscar, 2000, « Dialogue social : théorie et pratique » in Syndicats et dialogue social : situation actuelle et perspectives d’avenir, Education ouvrière, N°3, pp. 51-60.
FREYSSINET Jacques, 2017, Le dialogue social : nouveaux enjeux, nouveaux défis, BIT, Genève, 54 p.
GUIBOUMOU Christelle, 2007, Action syndicale et impact sur la situation socio-économique des populations ouvrières au Gabon de 1960 à nos jours, Thèse de Doctorat en Sciences économiques, Université de Lille, 313 p.
LINARD André, 2000, « Dialoguer sans perdre son âme », in Syndicats et dialogue social : situation actuelle et perspectives d’avenir, Education ouvrière, numéro 3, pp. 22-25.
Loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat.
Loi 21/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de l’enseignement supérieur en République gabonaise ;
Loi 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche.
Loi 22/2000 du déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique en République gabonaise.
MOUSSAVOU Georges, 2020, Organisation et système universitaire au Gabon, L’Harmattan, Paris, 154 p.
NTOUTOUME Loïc, 2015, « Des enseignants et chercheurs privés de salaire », in https://www.gabonreview.com, consulté le 06 avril 2022.
OIT, 1996, Liberté syndicale et négociation collective. Étude d’ensemble, 81e session, Conférence internationale du Travail, Genève, BIT.
OSSE Lionel, « Les Gabonais demandent plus de liberté d’expression, mais pas pour critiquer le président », in Dépêche N°391 d’Afrobarometer, 15 septembre 2020.
OZAKI Muneto, RUEDA-CATRY Marleen, 2000, « Le dialogue social : aperçu international », in Syndicats et dialogue social : situation actuelle et perspectives d’avenir, Education ouvrière, N°3, pp. 1-10.
Protocole d’accord entre le Gouvernement et les syndicats de l’Enseignement supérieur, 21 avril 2013, 3 p.
SIXIÈME AXE : RESPONSABILITÉS ÉTHIQUES, PÉDAGOGIQUES ET ACADÉMIQUES DES UNIVERSITAIRES
DÉCOLONISATION DE LA PENSÉE : EXIGENCE DE QUALITÉ ACADÉMIQUE
Mafa Georges ASSEU
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La recherche universitaire nourrit l’ambition de conduire les hommes dans la fine pointe du progrès. Si les pays du Nord ont pu s’inscrire à un niveau de recherche qui favorise une prise sur leur réalité sociale, cela l’est autrement pour les pays du Sud. Au regard de l’héritage colonial, la recherche universitaire africaine garde les stigmates d’une institution qui verse dans l’extraversion scientifique, parce qu’elle est consommatrice des savoirs et pensées en rupture d’avec les critères de vérité de son espace. La dépendance à l’égard des pays du Nord se rend pour ainsi dire, ostensible. Cela requiert une nouvelle approche qui devra conduire l’Afrique et les Africains à une réorientation institutionnelle et à des réformes conduisant à des connaissances scientifiques prenant en compte le potentiel endogène. C’est sur la base de cette autonomie intellectuelle et scientifique qu’il sera possible de garantir le développement économique et social de l’Afrique.
Mots clés : Décolonisation, Endogénéité, Extraversion, Pensée, Scientifique.
Abstract:
University research has the ambition to lead people to the cutting edge of progress. If the countries of the North have been able to achieve a level of research that favors a grasp of their social reality, it is different for the countries of the South. With regard to the colonial heritage, African university research retains the stigma of an institution that is extraverted scientifically, because it is a consumer of knowledge and thoughts that are at odds with the criteria of truth in its own space. The dependence on the countries of the North has become, so to speak, ostensible. This implies a new approach that will have to lead Africa and Africans to an institutional reorientation and to reforms leading to scientific knowledge taking into account the endogenous potential. This requirement will have to be accompanied by an awareness of quality that takes into account the management of human and financial resources and infrastructures. It is on the basis of this intellectual and scientific autonomy that it will be possible to guarantee the economic and social development of Africa. Our work aims to show the weaknesses related to university research in Africa.
Keywords : Decolonization, Endogeneity, Extraversion, Thought, Scientist.
Introduction
L’Afrique est en crise et cette crise se perçoit bien dans la fracture de la coexistence entre les réflexes d’un ordre colonial et la posture d’un nouveau mode de vie. Autrement dit, le mouvement d’affranchissement de l’ancien et la transition vers le nouveau, restent problématiques. L’Université africaine est une expression éloquente de cet état de crise. En tant qu’ancrage de production de connaissance, elle constitue, par sa richesse holistique, une figure essentielle de nos sociétés. Elle a une orientation portée sur la formation et la recherche scientifique. Par cette qualité, elle se fonde à élaborer des stratégies pour penser une société dans le but de sa transformation. Dans ce sens, son efficacité ne saurait faire mention de toute abstraction au sol historique. Or, il apparaît que les Universités africaines, du fait de leur origine coloniale, apparaissent comme des réalités appendiculaires des puissances occidentales. Elles se présentent sous les traits de la domination occidentale parce que la formation et la recherche sont loin des critères de vérité de l’Afrique. Si la crise est, par son histoire, le lieu de manifestation d’un malaise, elle est sous un autre angle, un opérateur de révolution ou expression d’une dynamique nouvelle. La problématique dans ce travail s’énonce comme suit : quelle est la condition de possibilité d’un discours libre et responsable lié à la recherche universitaire en Afrique ? La sortie de cette situation de crise pourrait se comprendre comme une volonté d’assomption caractéristique d’une révolution épistémologique. L’on pourrait partir de l’hypothèse que l’adaptation de l’enseignement et la recherche universitaire aux besoins politique, économique, culturel et social est susceptible de répondre à l’exigence de transformation des sociétés. Notre objectif dans ce travail, est de montrer que le devenir de la recherche universitaire doit porter sur le sens de la liberté, la production de la qualité et de la responsabilité. Nous envisageons conduire cette réflexion, selon la méthode analytique et la méthode critique. Cette réflexion comprend trois moments. Le premier part du sens de l’éducation au rôle de l’Université. Le deuxième s’articule à faire l’état des lieux de l’Université en Afrique. Le troisième invite à une action citoyenne pour une Université renaissante.
1. Du sens de l’éducation au rôle de l’Université
1.1. De l’éducation
L’éducation est un moyen de socialisation et d’élévation permettant à toute personne d’exprimer son être au monde. C’est un concept qui, dans son fond, déploie l’idée de conduire, de guider, de commander. L’éducation nous inscrit dans le cadre d’un processus qui part de l’enfance à l’âge adulte en passant par l’adolescence. Faire naître et développer chez l’enfant des qualités physiques, morales et intellectuelles afin de le rendre adolescent, puis adulte, et de le conduire dans la socialité, tel est l’objectif de l’éducation. Selon J. J Rousseau (1762, p. 13-14),
L’on façonne… les hommes par l’éducation. Nous naissons faibles, nous avons besoin de force : nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin d’assistance : nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous n’avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l’éducation.
Assurer l’éducation d’une personne, c’est lui donner les moyens de son épanouissement intellectuel, morale, physique. Autrement dit, c’est faire de lui un être intégral dans la société. C’est lui donner les moyens de s’assumer et d’acquérir sa maturité. Il y a que l’éducation a un caractère complexe. Elle se perçoit dans le milieu familial, dans le milieu scolaire et par nos rapports avec le monde extérieur. Autant dire que la vie de l’école et l’école de la vie, sont les lieux de son expression. L’éducation s’offre comme le lieu qui conduit à aider une personne dans le développement des aptitudes intellectuelles, physiques ainsi que des principes moraux. C’est un moment de préparation pour son adaptation à la vie sociale.
L’éducation apparait dans trois sens qui se donnent en termes de dynamique, de statique et de structurel. Au sens dynamique, elle est, comme le pense Abdou Moumouni (1964, p. 255), la « transmission d’un patrimoine ou d’un héritage d’une génération à l’autre. Elle vise à assurer une continuité, à être l’instrument par lequel les civilisations se perpétuent et grâce auquel les membres d’une société…s’assurent que les conduites nécessaires à la survie de celle-ci sont apprises ». L’éducation devient ainsi le lieu d’un dépôt qui s’ouvre à la pérennité par la prise en compte de la nouvelle génération.
Au sens statique, l’éducation est le moyen par lequel une personne s’intègre dans la communauté. C’est cette communauté qui lui fournit tous les rudiments nécessaires et utiles à un savoir-vivre. Car, toute personne est avant tout, un être de la communauté. Au sens structurel, c’est l’éducation qui affine l’homme par les moyens qu’elle met à sa disposition. Ce sont les livres, les langues, les idées, les techniques. Tous ces moyens ont pour objectif sa transformation sur le plan socio-culturel.
L’éducation est et reste un lieu d’acquisition de reflexes qui permettent de conduire sa vie de manière responsable, de cultiver un modèle d’humanité, d’accéder à un ensemble de savoir. Benjamin Barber (1993, p. 20) pose un questionnement fondamental qui nous donne le véritable sens de l’éducation « Qu’est-ce qu’un grand pays, qu’une grande nation, qu’une communauté sinon un pays où l’on est bien éduqué, une société où il y a des savants, une communauté où l’on peut exceller » ? L’école est, par excellence, un cadre où se déploie cette éducation, et l’Université en constitue une figure essentielle.
1.2. Du rôle de l’Université
L’Université est un lieu de recherche et d’enseignement qui a pour compétence la production du savoir, sa conservation et sa transmission. Ebénézer Njoh-Mouelle (1975, p. 65) lui confère un double rôle :
C’est d’abord assurer la transmission aux jeunes générations de l’héritage culturel, scientifique et technologique de la société dans laquelle elles sont appelées à vivre ; c’est ensuite promouvoir et développer la recherche dans tous les domaines de la connaissance afin de compléter et d’enrichir l’héritage reçu.
L’Université, c’est l’univers du savoir qui s’articule à faire face à tous les problèmes qui apparaissent dans la société. Elle doit être en interaction avec les différentes structures sociales. L’Université, c’est la manifestation du savoir dans son caractère holistique ou éclectique. Cela renvoie dans l’Antiquité égyptienne au monde des prêtres aux crânes rasés qui enseignaient le savoir dans les écoles d’initiation encore appelées palais ou temples. Thalès et Pythagore en sont deux figures essentielles. Thalès séjourna seize ans en Égypte, Pythagore en fit vingt-deux pour s’armer de science auprès des prêtres de l’Antiquité égyptienne.
L’Université apparaît comme un corps social qui s’exprime à la manière du cœur dans le corps animal. Autant le cœur assure le fonctionnement de l’organisme pour son équilibre vital, autant l’Université en tant que productrice du savoir a un rôle fondamental dans l’approche du développement. Aucune stratégie de développement ne peut se passer du savoir qui constitue un pouvoir pour l’Université. Ainsi que le note Koffi Niamkey (2001, p. 57), la recherche universitaire est « un moteur indispensable, une source d’inspiration, de rénovation et de référence fondamentale pour la mise en œuvre de toute stratégie de développement ». L’on peut, en cela, comprendre qu’elle est une figure essentielle de la société. L’on ne saurait dans ce sens passer sous silence le rôle joué par l’Université dans le développement prodigieux que connaît l’Europe. La science, la technique, la médecine, les arts, la philosophie, les lettres, sont des domaines de connaissance qui donnent accès à la vérité, affine l’esprit critique et ouvre à la connaissance de notre monde. Selon Patrice Aké (2007, p. 56) :
Le rôle de l’université est de former à la liberté. Et c’est parce qu’il croit à la parole, pas au bavardage, à la parole libre vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l’autre, que l’enseignant est susceptible de créer et d’affronter les tâches de l’avenir. La liberté académique est en même temps une responsabilité vis-à-vis de la société et du monde.
L’Université libère les esprits, permet la créativité et ouvre à la contradiction. Elle favorise l’excellence et l’expression de la raison. Elle est un lieu d’expression de la parole libre et aide à s’affranchir de toute tutelle afin de s’exercer à la responsabilité. Elle ouvre aux différentes connaissances qui permettent aux hommes et aux femmes de gagner le pari du devenir des peuples. C’est un lieu qui fait rupture d’avec la rationalité fermée. Autrement dit, l’Université peut se penser sous la figure d’un désir et d’un surgissement de lumière dans un espace qui en était privé. La recherche qui s’y exprime, donne à cette image, toute sa signification.
2. État des lieux de l’Université en Afrique
2.1. L’Université africaine, un appendice de l’Université occidentale
Le niveau de respectabilité d’un pays vaut bien souvent le respect que l’on doit à son Université ou à ses Universités. L’Université est sûrement ce lieu où se laisse éclore la pensée, la vraie pensée. Rester dans une pensée close, c’est se fermer à toute alternative qui ouvre à la compréhension de la vie dans sa polyphonie. Martin Heidegger (1959, p. 22), dans une réflexion, nous instruit sur l’idée de penser :
L’homme peut penser en ce sens qu’il en a la possibilité. Mais cette possibilité ne nous garantit encore pas que la chose est en notre pouvoir, nous devons l’apprendre. Qu’est-ce qu’apprendre ? (…) Nous apprenons la pensée en prêtant attention à ce qui exige d’être gardé dans la pensée.
Pour Heidegger, ce qui mérite d’être gardé dans la pensée, c’est le pensable, c’est-à-dire, tout ce qui donne à penser. Pour cela, tout ce qui peut bien provenir de nos représentations et de nos expériences, constitue une source d’enrichissement. Au regard de cette réflexion, ce qui fait problème, c’est bien le refus de penser qui renvoie au lieu clos de l’esprit, un esprit qui stagne, sort de son lieu propre, et est étranger à lui-même. Cet esprit n’est plus capable d’opérer une action dynamique pour accompagner le mouvement des choses. La crise de l’Université africaine se perçoit bien évidemment dans le refus ou l’absence de penser qui porte le nom du mimétisme. Or l’université, c’est le lieu de la parole libre, responsable et intelligente. Mais, comment penser une parole libre et responsable si l’on n’est étranger à soi ? Comment penser une parole libre si l’on s’est affranchi de ses critères de vérité ou si selon les mots de Joseph Ki-Zerbo, l’on dort sur la natte des autres ? Pour J. Ki-Zerbo (1992, préface VII) en effet, « dormir sur la natte des autres, c’est dormir par terre ». Autant dire qu’il est impératif de dormir sur notre propre natte qui est pour nous, le bien le plus précieux. Autrement dit, les intelligences africaines ont-elles développé des domaines au niveau de la recherche qui font place à la créativité endogène ?
La recherche universitaire africaine porte un passé colonial et pour cela, toutes ses déterminations sont orientées dans un sens d’extraversion qui renforce sa dépendance vis-à-vis des pays du Nord. Le chercheur africain est bien souvent celui qui produit un savoir bien loin de l’approche de l’endogénéité, parce qu’il édifie ses recherches selon les cadres conceptuels de l’Occident. De telles pratiques, contribuent à maintenir et à accroître le lien de dépendance Afrique-Occident. Quand l’on comprend que c’est l’Occident qui s’ingénie à financer les recherches, les enquêtes de terrains, les programmes, l’on se rend bien à l’évidence que toute indépendance de la recherche académique est remise en cause. C’est cette situation qu’exprime Jean-Marc Ela (2006, p. 206) :
Dans le cadre des programmes de recherche soutenus par les organismes extérieurs, le choix des thèmes et des méthodes d’approches sont imposés aux chercheurs africains. En effet, les organismes étrangers et leurs experts en gardent la responsabilité. Souvent l’expertise dite locale doit suivre un stage pour entreprendre ou superviser efficacement des enquêtes de terrain selon des règles établies par les experts étrangers. Dans ces conditions, le scientifique africain ne peut acquérir de l’envergure.
Cette possibilité de faire place aux savoirs africains dans les programmes, trouve toute sa signification. Ainsi, par exemple, la philosophie ne tient pas sa signification qu’en référence uniquement à l’historiographie occidentale en rapport avec les penseurs grecs comme Thalès de Milet. Il y a possibilité de faire l’évocation d’autres lieux d’émergence avec des penseurs comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Martin Bernal. Ainsi par exemple, Diop a pu sur la base de la découverte d’une parenté phénotypique entre l’Égypte ancienne et les peuples subsaharienne, écrire une histoire authentique de l’Afrique. Il s’inscrit par le biais de cette réconciliation entre les populations africaines et l’histoire, dans le sens d’une réappropriation qui fonde leur être. Ces travaux seront enrichis par Théophile Obenga et par Martin Bernal. Ces penseurs se fondent sur un ancrage ou des critères de vérité du peuple africain. L’Égypte sera une thématique principale parce qu’elle est le référent qui permettra aux Africains de produire les conditions matérielles et immatérielles de leur existence. Cheikh Anta Diop (1981, p. 12) écrit à ce sujet :
Pour nous, le retour à l’Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l’histoire, pour bâtir un corps de sciences moderne, pour rénover la culture africaine. Loin d’être une délectation sur le passé, un regard vers l’Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. L’Égypte jouera dans la culture africaine repensée et rénovée, le même rôle que les Antiquités latines dans la culture occidentale.
Au niveau de la philosophie politique et juridique, Montesquieu, Locke, Hobbes, Rousseau doivent-ils être comptés comme des référents exclusifs ? La littérature ancienne de l’Afrique à travers la charte du Mandé du XIIe siècle après Jésus-Christ, la gestion du pouvoir royal dans les grands empires ne nous offrent-elles pas des modèles de vivre-ensemble ? Si l’on comprend bien que chaque espace est la vérité de sa philosophie, il y a à comprendre que chaque philosophe porte en lui tout le sens de sa culture qui à son tour, le porte à faire le mouvement du particulier à l’Universel. Dans ce sens, quand l’on parle avec Meinrad Hebga (2003, p. 38) de
pensée universelle en lorgnant Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel, Bergson, Heidegger et autres philosophes parentés, faisons attention que tout universel attribué à un individu ou à une aire culturelle donnée, n’est qu’un particulier porté à l’infini par une induction audacieuse.
La réflexion philosophique tient son sens de ce qu’elle porte sur la vie et interroge cette vie. Or, la recherche universitaire intéresse la vie des Africains qui se voient imposer des réalités qui ne sont pas les leurs. À quoi servirait à un chercheur africain d’étudier Descartes, Kant, Hegel s’il n’en tire pas un bénéfice qui l’aiderait à rendre cette philosophie profitable aux Africains, ou encore, si ces philosophies ne sont pas mises en relation avec le contexte africain ? Ce qui est en cause, c’est l’absence d’un processus de décentrement des lieux de production des connaissances. Cheikh Anta Diop nous renvoie à ce sujet à l’attitude de ceux qu’il appelle les « cosmopolites-scientistes-modernisants ». C’est l’intellectuel qui n’exprime pas de fierté vis-à-vis de son ancrage ; mais qui se résout à emprunter la voie de l’assimilation. Ch. A. Diop (1979, p. 15) pense que ce groupe
contient les individus les plus atteints de l’aliénation culturelle. Comme on le voit, il n’y a pour eux d’autre issue que l’assimilation. Leur attitude lorsqu’ils sont sincères provient d’une cécité culturelle ou de leur incapacité à proposer des solutions concrètes, valables aux problèmes qu’il faut résoudre pour que l’assimilation cesse d’être une nécessité apparente ; on nie alors l’existence, l’objectivité de ces problèmes : cela évoque l’autruche.
De ce qui précède, l’on voit que la crise de l’Université se pose en termes de crise de la qualité. La qualité exclut une non-conformation des programmes aux réalités intérieures, c’est-à-dire des programmes standardisés, des programmes prescrits qui sont sous la tutelle de l’autre extérieur à soi. Cette crise de la qualité se manifeste sous d’autres formes.
2.2. Des autres figures de la crise
La recherche universitaire ne peut se penser sans les étudiants qui ont besoin de travailler dans des conditions rassérénantes. Les Universités africaines, dans ce sens, offrent une image peu reluisante qui pose le problème de la gestion rationnelle des ressources financières. Ainsi par exemple, en Côte d’Ivoire, l’Université Felix HOUPHOUËT-BOIGNY offre l’image d’amphithéâtres et de salles de cours quelquefois surchargés et surchauffés, c’est-à-dire sans climatisation, de salles peu éclairées. L’image irénologique censée être le gage d’étude dans des conditions sereines, est souvent mise en cause par la bruyance des membres du syndicat de la Fédération estudiantine de Côte-d’Ivoire (FESCI)[101]. Le campus est bien souvent le théâtre de violence entre étudiants de ce syndicat.
Étudiants et enseignants-chercheurs sont à l’image de l’avers et du revers d’une pièce de monnaie. Que serait l’enseignant-chercheur sans l’étudiant et vice-versa ? La transmission du savoir et l’écoute ne sont possibles que par la présence des deux corps. Les enseignants-chercheurs ne bénéficient pas de ressources pour des voyages d’étude, de formation et même pour la participation à des colloques internationaux. La situation de précarité et les conditions de travail difficiles des enseignants-chercheurs s’expliquent par le fait que les priorités des gouvernants des pays africains se trouvent dans le domaine de l’économie et des finances. Aussi, le manque de motivation constitue un autre goulot d’étranglement. Faire ou effectuer des études jusqu’au niveau du Doctorat, devrait en principe permettre aux enseignants-Chercheurs de s’offrir une vie de qualité. L’Université doit être un lieu où se manifeste la bonne rencontre qui fait de l’enseignant-chercheur, l’ami de la science. Comme le note si bien Kouadio Dibi (2007, p. 6), il faut :
Envisager de construire des salles polyvalentes avec des cafés, leur permettant d’échanger, de nouer des liens, et de faire ainsi de leur métier une manière élégante et noble de respirer, en s’ouvrant à ce qui ne rétrécit pas, mais élargit, qui n’obscurcit pas, mais unit en se tenant à la jointure des choses.
Or contrairement à cette belle image de l’enseignant que présente Dibi, l’on est encore loin de la réalité au regard de l’insignifiance des salaires et des conditions de vie des enseignants qui ne fait nullement rêver. Lorsque l’enseignant compare sa situation à des collègues qui se sont mués en consultants dans des organismes internationaux, le manque de stimulation et la démotivation ne font que grandir. Lorsqu’il compare encore sa situation à ses collègues qui au détriment de l’expression véritable de la science, font l’apologie des gouvernants, il ne reste vraiment plus de place évidente pour la recherche scientifique. Ainsi, face au peu d’intérêt que les élites au pouvoir manifestent pour la science, l’on comprend aisément la clochardisation à laquelle sont soumis les chercheurs. Jean-Marc Ela (2006, p. 201) écrit :
En l’absence de vision, de prise de conscience et de volonté politique autour de l’enjeu des rapports entre l’Université et la science, on assiste à une sorte de démotivation et de démobilisation des hommes et des femmes dont les capacités de recherche sont freinées par un environnement qui les condamne à la clochardisation.
L’Université apparait quelquefois comme le lieu où la sphère du politique et celle de la science, se confondent. Quand un président d’Université n’est pas élu par ses pairs que sont les enseignants-chercheurs, mais qu’il est nommé au nom de son allégeance ou en vertu de son militantisme au parti politique du pouvoir en place, cela constitue un problème pour la science et pour l’essor de l’Université. Au regard de tout ce qui précède, il serait fort souhaitable de penser à la Renaissance de l’université.
3. Une action citoyenne pour une université renaissante
3.1. L’excellence et la culture du sol historique
La recherche scientifique est une question fondamentale qui s’inscrit au cœur d’un projet qui vise la construction du devenir d’un pays, d’un continent. Opter pour le renforcement des capacités, c’est se donner les moyens de réduire la dépendance vis-à-vis des pays du nord. Fonder une Université et créer les moyens de la recherche, c’est se doter d’un potentiel d’intelligence dont un pays a besoin. L’Afrique a besoin de jeter les bases d’une recherche académique susceptible de lui assurer une autonomie et de garantir les bases d’un développement social et économique. Elle ne peut le faire sans prendre pour référent son ancrage propre ou ses critères de vérités. L’Africain, il est vrai, a été coupé de ses origines par le projet colonial en tant qu’expression d’une aliénation culturelle. Pour Cheikh Anta Diop, (1990, p. 51) le projet de désaliénation n’aura son sens que si l’Africain se trouve relié aux éléments fécondants de son sol historique. Son sol originel et originaire doit être cela même qui fonde son être :
– en prenant conscience du fait que ce sont ses ancêtres qui ont civilisé et colonisé le monde jusqu’à la fin de l’époque égéenne (XIIe siècle avant Jésus-Christ), l’Africain doit retrouver une confiance en soi, acquérir une fierté légitime (différente de la suffisance) incompatible avec l’idée d’un joug étranger, sous quelque forme que ce soit.
– le problème des humanités africaines est résolu. Quel que soit le point du continent sur lequel il vit, l’Africain sait qu’il peut et doit contribuer à l’élaboration d’humanités africaines à base d’égyptien ancien, aussi légitimement que l’Occident a bâti ses humanités à partir d’une base gréco-latine.
Cheikh Anta Diop contribue par cette réflexion à montrer non seulement les origines historiques de ce qui fait la crise des sociétés africaines, mais également la crise de l’Université africaine. Autrement dit, les Université africaines sont en crise parce qu’elles sont coupées de leur sol historique. Autant dire que le principe de l’endogénéité doit présider à la réorientation de la recherche académique en Afrique.
L’Université africaine est en crise. La crise est cela même qui vient dire ce qui se meurt, ce qui va à vau-l’eau. Or, c’est vers l’Université que tous doivent pointer le regard pour rechercher une étincelle de lumière. L’Afrique est donc appelée à opter pour une politique de développement scientifique. C’est le moyen de faire cesser le mimétisme servile et même le chantage. C’est le lieu de comprendre le souci d’une réactualisation du paradigme de l’Égypte nègre qui fut un lieu de puissance et de savoir. C’est ce que nous fait comprendre le travail génial et monumental de Cheikh Anta Diop (1973, Préface à l’ouvrage d’Obenga) en ces termes :
Le chercheur africain n’a pas le droit de faire l’économie d’une formation technique suffisante qui lui donne l’accès aux débats scientifiques les plus élevés de notre temps, où se scelle l’avenir culturel de son pays. Aucune arrogance ou désinvolture pseudo-révolutionnaire, aucun gauchisme, rien ne saurait le dispenser de cet effort. Tout le reste n’est que complexe, paresse, incapacité : l’observateur averti ne s’y trompe pas. En effet l’on doit dire aux générations qui s’ouvrent à la recherche : armez-vous de la science jusqu’aux dents et allez arracher sans ménagement, des mains des usurpateurs le bien culturel de l’Afrique dont vous avez été longtemps frustrés.
L’on voit et comprend que les chercheurs africains sont appelés à rechercher ou à opter pour la voie des savoirs endogènes et des savoirs locaux. Ces savoirs se doivent d’être valorisés et intégrés au corpus universitaire. En cela, la décolonisation des savoirs ou de la pensée, se pose en termes d’impératifs. Cette perspective, selon Ernest-Marie Mbonda (2021, p. 266)
exige un travail herculéen de refonte des programmes que les autorités académiques, toujours essentiellement préoccupées par leur carrière et leur promotion politico-administratives ne songent nullement à entreprendre, et que les universitaires revendiquent quelquefois sans pouvoir transformer leur revendications en actions ou en évènements.
Il faut changer d’échelle d’action, parce que le discours est contingent. En cela, il ne convient pas à la réalité parce que l’on a affaire à un discours de subordination. Exclure ou s’affranchir de discours de subordination ne signifie pas qu’il faut se fermer à d’autres paradigmes ou à d’autres savoirs. Dans la recherche de la qualité, l’enseignant doit faire montre de son sens éthique et de sa capacité à accepter la critique pour apprendre des autres, car l’on n’est jamais seul à détenir la vérité.
3.2. Du sens holistique de la qualité académique
La qualité académique dans son sens holistique fait appel à un certain nombre de facteurs. La mise en route de ces facteurs est l’expression d’une colligation adéquate de la crise que connaît l’Université africaine. C’est pour cela qu’il importe de procéder à une gestion transversale de tout ce qui concourt à la crise. Dans cette optique, savoir, savoir-faire et savoir-être doivent caractériser l’enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur doit être bien formé. Cette bonne formation met en confiance l’apprenant qui, du coup s’ouvre à la formation que lui donne ce dernier. Un bon enseignant sait allier savoir, savoir-faire et savoir-être. C’est celui qui sait conduire l’étudiant à apprendre sur soi, à apprendre tout ce qui relève de sa culture, de sa civilisation de son monde. Ce souci de la qualité de la formation est partagé par Ebénézer Njoh-Mouelle (1970, p. 64) :
la bonne qualité de l’éducation est celle où les besoins de l’individu et ceux de la société trouvent leur satisfaction. Enfin pour qu’une éducation au service du développement soit dite de bonne qualité, il faut qu’elle se situe dans le sens général étendu du progrès et diffuse une culture générale étendue et profonde qui rapproche de plus en plus l’homme de sa réalisation totale.
L’État est appelé à accomplir ses devoirs régaliens car quel rôle efficace pourra jouer le bon enseignant si les moyens infrastructurels et les accompagnements liés à ses conditions de travail et d’existence ne se rattachent pas à son devoir ? La qualité fait-elle sens dans nos sociétés ? Il convient, dans cet ordre d’idées, d’instiller à la société le sens de la qualité à un niveau pluriel. Le prestige que nous accordons à la qualité doit verser dans un sentiment global d’appréciation de ce qui enrichit. Une véritable publicité doit accompagner la qualité de sorte que la science soit célébrée par les gouvernants et la société en général. Il s’agit de comprendre que la qualité est une donnée première-indispensable à partir de laquelle, le rapport à la science en Afrique peut et doit avoir sa signification. Ce souci de la qualité doit conduire à une refonte épistémologique des savoirs et à une reformulation de ses bases gnoséologiques. Dès lors, comment ne pas comprendre Jean-Marc Ela (2006, p. 384) qui se fait le messager du projet de Cheikh Anta Diop :
Nous n’avons pas le droit de démissionner face aux urgences intellectuelles et scientifiques de l’Afrique dans un système mondial où la connaissance s’inscrit dans des rapports de pouvoir. Il faut donc que les Africains s’interrogent sur leur place dans les sciences. Ce défi nécessite de réévaluer le métier de chercheur et de trouver les moyens de reconsolider les équipes de recherche dont les réseaux constituent un espoir pour une recomposition intellectuelle et la base d’une communauté scientifique forte.
S’il est vrai que chaque peuple porte le sens et la vérité de son discours, le chercheur africain est appelé plus encore à porter par sa voix, la construction du devenir africain en toute liberté et en toute responsabilité. Cela ne peut s’obtenir qu’à travers un mouvement de rupture d’avec la tutelle. C’est en cela qu’on comprend bien la pertinence de l’approche d’E. Kant (1991, p. 43) relative à l’homme aux Lumières :
Les Lumières, c’est la sortie de l’homme de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d’un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l’entendement mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s’en servir sans la conduite d’un autre. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement !
L’encouragement au financement des voyages d’étude doit être à l’ordre du jour, car cela pourrait être pour les enseignants, le lieu de faire le point de leurs recherches, de renouer des contacts, de confronter leurs connaissances à celles de leurs collègues de l’étranger. Cela pourra également être le lieu de présenter fièrement les savoirs conçus et construits à partir de leurs réalités endogènes. Aller dans ce sens, c’est comprendre qu’il n’y a pas de honte à porter un discours scientifique provenant de ses propres critères de vérité. Ainsi pour Ch. A. Diop (1981, p. 12)
C’est donc en toute liberté que les Africains doivent puiser dans l’héritage intellectuel commun de l’humanité, en ne se laissant guider que par des notions d’utilité, d’efficience. C’est aussi le lieu de dire qu’aucune pensée, et en particulier aucune philosophie, ne peut se développer en dehors de son terrain historique.
Cette réflexion diopienne met en évidence le sens de l’éducation. C’est un moyen de construction de soi, de modélisation de son rapport à soi-même, mais également de son rapport aux autres. Faire mention de l’éducation, c’est comprendre que l’exigence de qualité a en réalité, un sens holistique qui s’imprime à travers le savoir, le savoir-faire, le vivre-ensemble et le savoir-être.
Conclusion
L’esprit des Humanités nous engage dans ce qui concourt au bien et inscrit dans une vision porteuse de richesse. C’est pourquoi, l’Université africaine est appelée à renaître à travers une révolution des paradigmes et des pratiques. Conduire une réflexion dans l’approche des critères de vérités propres à l’Afrique, c’est sortir de l’aliénation savante. La décolonisation des institutions universitaires exige la mise en place de ce que Jacques Derrida (2001, p. 12) appelle « université sans condition » : « Cette université devrait se voir reconnaitre le principe de (…) la liberté académique, une liberté inconditionnelle, de questionnement et de proposition, (…) le droit de dire publiquement tout ce qu’exigent une recherche, un savoir et une pensée de vérité ». L’Université africaine doit prendre la part qui lui incombe dans un mouvement de maturation qui ouvre à la créativité, à une volonté de réorientation de la recherche et de développement. Cette décolonisation réflexive doit s’accompagner de la recherche de la qualité qui doit se comprendre dans le sens de la qualité de la formation, de la recherche, des besoins infrastructurels. Elle doit se comprendre également dans l’optique de l’excellence managériale, de la valorisation de l’expertise des enseignants chercheurs ainsi que de la pacification de l’Université. C’est cela même qui permettra au discours de la recherche universitaire de s’ouvrir et de porter du fruit.
Références bibliographiques
ABDOU Moumouni, 1964, L’éducation en Afrique, Paris, Maspero.
AKE Patrice, 2007, « De la motivation dans nos universités : le cas de l’université d’Abidjan-Cocody », in La Palabre, N°1, p. 51-64.
BARBER Benjamin, 1993, L’excellence et l’égalité. De l’éducation en Amérique, Paris, Belin.
DIBI Kouadio, 2007, « Programme de l’Université citoyenne : pour un rayonnement académique de UFR-SHS-DECANAT 2004 », in La palabre, N°1, p. 41-49.
DIOP Cheikh Anta, 1990, Alerte sous les Tropiques, Paris, Présence africaine.
DIOP Cheikh Anta, 1981, Civilisation ou barbarie, Paris, Présence africaine.
DIOP Cheikh Anta, 1979, Nations nègres et culture, Paris, Présence africaine.
DERRIDA Jacques, 2001, L’Université sans condition, Paris, Gallilée.
ELA Jean-Marc, 2006, l’Afrique à l’ère du savoir : science, société et pouvoir, Paris, L’Harmattan.
HEBGA Meinrad, 2003, « Pour une rationalité ouverte. Universalisation de particuliers culturels », in Revue Mosaïque, N°001, p. 33-45.
HEIDEGGER Martin, 1959, Qu’appelle-t-on penser ? Paris, Collection Épiméthée, PUF.
KI-ZERBO Joseph, 1992, La natte des autres. Pour un développement endogène en Afrique, Dakar, Codesria.
KANT Emmanuel, 1991, Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ?, Traduction par Jean-François Poirier et Françoise Proust, Paris, G F Flammarion.
MBONDA Ernest-Marie, 2021, une décolonisation de la pensée. Étude de philosophie afrocentrique, Paris, Mainaibuc.
NIAMKEY Koffi, 2021, Philosophie, culture et développement, Paris, L’Harmattan.
NJOH-MOUELLE Ebenezer, 1975, Jalons II L’Africanisme aujourd’hui, Yaoundé, Clé.
OBENGA Théophile, 1973, L’Afrique dans l’Antiquité, Paris, Présence africaine.
DU MODÈLE ANTHROPOLOGIQUE CANGUILHEMÉEN : UNE THÉRAPIE À LA CRISE DE L’UNIVERSITÉ EN AFRIQUE
Florence BOTTI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Voilà des décennies que les universités africaines dans leur ensemble, connaissent des crises d’ordre structurel, fonctionnel et organisationnel ; crises multiformes qui sont la conséquence de leurs dysfonctionnements internes. Des solutions sont régulièrement proposées par des experts. Toutefois, la persistance de ces crises ou de ces pathologies montre bien l’insuffisance de leur efficacité, et par ricochet, le manque de compétitivité de ses institutions. Dès lors, la similitude structurelle et fonctionnelle entre crise sociale et pathologie suscite une nouvelle approche dans le traitement des crises que celles-ci traversent. Considérant que nos universités sont de grands malades auxquels il faut donc administrer une thérapie de choc, par notre réflexion, nous entendons mettre en lumière, le modèle anthropologique proposé par Canguilhem en médecine, et ce comparativement à celui, positiviste de Claude Bernard.
Mots clés : Crises, Maladie, Médecine, Pathologie, Thérapeutique anthropologique, Thérapeutique positiviste, Université africaine.
Abstract:
African universities as a whole have been experiencing structural, functional and organizational crises for decades; multiform crises which are the consequence of their internal dysfunctions. Solutions are regularly proposed by experts. However, the persistence of these crises or pathologies clearly shows the inadequacy of their effectiveness, and by extension, the lack of competitiveness of its institutions. Therefore, the structural and functional similarity between social crisis and pathology gives rise to a new approach in the treatment of the crises that they go through. Considering that our universities are seriously ill to whom we must therefore administer shock therapy, through our reflection, we intend to highlight the anthropological model proposed by Canguilhem in medicine, and this compared to that, positivist of Claude Bernard.
Keywords : African university, Anthropological therapeutic, Crises, Illness, medical science, pathology, positivist therapeutic.
Introduction
Depuis plusieurs années, les universités africaines, surtout celles au sud du Sahara connaissent des crises (structurelles, fonctionnelles, organisationnelles, économiques). Des approches de solutions sont régulièrement proposées. Mais le constat est que presque toutes se résument à des réajustements quantitatifs (augmentation des budgets alloués à l’université, diversification des sources de financement de l’université, revalorisation salariale des acteurs du système universitaire, etc.). Cette priorité accordée aux données quantitatives se justifie dans le sens où, selon certains experts, « la crise de l’enseignement supérieur en Afrique est avant tout d’ordre économique ». (B. Makosso 2006, p. 75). En effet, l’université africaine est entièrement dépendante de l’aide publique qui elle-même subit le diktat des bailleurs de fond. Cette situation la rend vulnérable et l’empêche de se développer. C’est d’ailleurs, cette triste réalité que souligne A. C. Robert (2006, p. 79) en ces termes :
En Afrique, l’enseignement supérieur est presque totalement public (construction des locaux, paiements des professeurs et des personnels, bourses…). Or, les prescriptions des bailleurs imposent la réduction du train de vie de l’État, celle de la masse salariale et du taux des bourses. Les universités sont littéralement asphyxiées.
Sous nos tropiques, de nombreux pays font des efforts malgré les restrictions budgétaires auxquelles ils sont soumis, pour redorer le blason de l’université africaine. Ainsi, en Côte d’Ivoire, par exemple, on a assisté ces dernières années, à la réhabilitation et à la construction d’infrastructures universitaires pour faire face à l’un des maillons de cette crise, en l’occurrence la surpopulation estudiantine. Mais, nonobstant ces solutions apportées, les crises persistent dans presque toutes les universités africaines et surtout celles au sud du Sahara. Avons-nous fait le bon diagnostic ?
Notre approche est que les solutions aux maux de l’université africaine ne résident pas seulement dans l’accroissement des données matérielles ou quantitatives, elles sont d’ordre social. En réalité, les crises dont souffrent les universités africaines, sont des maux sociaux, c’est-à-dire des maladies ou des pathologies sociales. Comme la maladie dans le corps vivant qui bouleverse et contrarie le fonctionnement normal de l’organisme, la crise est un dysfonctionnement à l’image des pathologies chez le vivant. La crise vient interrompre la normalité et c’est justement ce qui se passe dans ce grand corps social qu’est l’université. En médecine, la méthode thérapeutique positiviste de Claude Bernard et celle anthropologique de Georges Canguilhem constituent les remèdes aux pathologies. Ainsi, lorsque la pathologie est due à un « dérangement interne de l’organisme » alors la thérapie sera positiviste. Si, au contraire, la pathologie diagnostiquée a trait à un élément extérieur à l’organisme, alors la thérapie anthropologique, voire clinique est mise en œuvre. Dès lors, en quel sens ces méthodes thérapeutiques, positiviste et anthropologique, qui guérissent les pathologies pourraient-elles aider à guérir nos universités africaines de leurs maux ?
Il s’agira de montrer dans une démarche analytico-critique, que la solution à la crise des universités africaines réside dans une approche holistique qui tient compte des aspirations de tous les acteurs du système.
1. La thérapie positiviste de Claude Bernard : un modèle de solution à la crise de l’université ?
En médecine, deux approches thérapeutiques essentielles s’opposent lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes pathologiques. Le premier modèle est inspiré de l’approche de Claude Bernard qui lui s’inspire de l’approche positiviste d’Auguste Comte. En effet, dans cette approche, la pathologie est un simple dérangement de la physiologie. Celle-ci exprime l’état normal du système physiologique et la pathologie survient lorsqu’il y a un défaut ou un excès dans le fonctionnement normal d’un appareil, d’un organe, d’un tissu ou d’une cellule. Ainsi, C. Bernard (1947, p. 282) écrivait que, « la maladie n’est qu’une exagération de la faculté physiologique ; d’autre fois, la maladie est une diminution de la faculté physiologique ». La maladie se conçoit, dès lors, en termes d’excès, de déficit ou de degré. Elle est locale et est produite par l’organisme lui-même. De ce fait, elle ne se différencie pas essentiellement ou fondamentalement de l’état physiologique normal. Autrement dit, la différence entre l’état pathologique et l’état physiologique normal n’est que de degré et non de nature. C’est pourquoi d’ailleurs, C. Bernard (1872, p. 7) pense qu’« il n’est pas nécessaire d’aller chercher l’explication des maladies dans des forces ou des lois qui seraient d’une autre nature que celles qui régissent les phénomènes ordinaires de la vie ».
Dans cette vision des rapports entre la physiologie et la pathologie, la thérapeutique consiste à restaurer la normalité, c’est-à-dire à ramener le corps malade à ses fonctions physiologiques normales. La normalité est donc un modèle parfait de fonctionnement de l’organisme qui est fixé par la nature et dont la défaillance entraîne la maladie ou la pathologie. La guérison dans ce cas, est un retour à l’ordre normal ou au modèle physiologique normal.
Le rôle de la thérapeutique est de faire de l’épisode pathologique un accident, une simple parenthèse dans la vie normale de l’individu. Dans ce cas, le pathologique n’est pas une fatalité. Il est un état passager et finalement marginal, une sorte d’épiphénomène qui disparaît aussitôt que les propriétés physiologiques ont été rétablies. Les épisodes morbides sont par conséquent, enserrés dans un court moment physiologique où ils s’expriment comme des moments de défaillances et d’exception. En réalité, dixit C. Bernard (1947, p. 140),
l’état physiologique et l’état pathologique ne sauraient être considérés comme deux états distincts qui se remplacent. L’état pathologique ne chasse jamais l’état physiologique. L’état physiologique est toujours présent ; sans cela la santé ne pourrait jamais réapparaître.
Le retour à la santé ou à la guérison est un retour à la norme physiologique antérieure. Ce qu’il convient de retenir d’essentiel, c’est le retour à l’ordre normal qui est intangible et immuable en tant que modèle. Cela veut donc dire qu’il n’y a pas plusieurs modèles de normalités physiologiques, mais, qu’il en existe un seul pour chaque espèce auquel le malade retourne quand il guérit de sa maladie. L’avis du malade qui fait l’expérience de la maladie n’est pas vraiment pris en compte dans cette approche. C. Bernard privilégie les données de laboratoire qui sont mesurables, quantifiables et sont plus objectives au détriment du point de vue du malade lui-même, considéré comme subjectif et donc peu crédible. Cette approche thérapeutique est basée sur les faits et généralise les traitements sans tenir compte des individualités idiosyncrasiques.
Mais qu’en est-il de cette approche thérapeutique de Claude Bernard si l’on veut l’appliquer à la crise des universités en Afrique ? En réalité, cette approche se nourrit de l’idée qu’il y a un modèle d’université parfait auquel toutes les universités doivent se référer. La crise s’exprime ainsi comme un écart intolérable entre le modèle universitaire parfait et la réalité d’une université précise, une université africaine. La crise est jaugée à la mesure de ce modèle parfait, et les solutions proposées par les experts doivent concourir à retrouver l’état physiologique normal « universel » de l’université.
En général, les experts qui préconisent cette solution ne tiennent pas compte des réalités culturelles et socio-anthropologiques des universités spécifiques, mais regardent simplement le modèle universitaire virtuel ou réel qui leur sert de modèle ou de référence. Ce modèle a des exigences et surtout des constances. Celles-ci sont liées par exemple, aux taux d’encadrement des étudiants par enseignant, aux taux d’occupation des salles lors des cours magistraux, des salles de travaux dirigés, des travaux pratiques, aux programmes universels des curricula, etc. Et c’est exactement de cette même manière que Claude Bernard fixait des critères de la normalité physiologique en termes de seuils quantitatifs en deçà et au-delà duquel, la situation devenait pathologique.
Le diabète avait éloquemment servi à Bernard pour montrer que la maladie est le franchissement d’un seuil quantitatif : celui du taux normal de glycémie en deçà duquel le malade souffre d’hypoglycémie et au-delà duquel il souffre d’hyperglycémie. De la même manière, dans l’approche positiviste ou quantitative des crises universitaires en Afrique, on considère qu’il y a crise lorsque les facteurs quantitatifs sont défaillants soit par excès, soit par défaut. Les symptômes de ces crises se manifestent dans la réaction de rejet plus ou moins violente, des acteurs des universités : enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants, personnels administratifs, etc. Quelques-uns des facteurs quantitatifs sont justement, l’insuffisance de salaire, de bourses, le manque d’infrastructures, de matériels pédagogiques, les conditions de vie précaires des étudiants, etc.
Les facteurs quantitatifs sont internes et provoquent des remous sociaux importants dans le fonctionnement des universités africaines généralement pauvres et sous équipées. La solution positiviste de ces crises, proche de ce que propose Claude Bernard des pathologies, va consister à des aménagements quantitatifs pour restaurer la « normalité physiologique » de l’université africaine. En d’autres termes, il s’agit, pour l’université africaine, de faire un retour à la normalité, c’est- à-dire de revenir là où tout a fonctionné normalement. Il faut revenir ou rechercher l’état normal antérieur de l’université africaine. Ả ce niveau, nombreux sont les experts qui pensent que l’université africaine a connu un rayonnement pendant des décennies après les indépendances qui, pour la plupart des Nations africaines, a eu lieu en 1960. Mais, selon B. Makosso (2006, p. 78), « la condition enseignante au sein des universités africaines s’est considérablement détériorée entre 1970 et 1999 ».
Toutefois, on pourrait supposer qu’il n’y avait pas eu de crises majeures avant cette période de grande détérioration. Les infrastructures étaient suffisantes pour accueillir les étudiants, les bourses d’études et les aides financières s’octroyaient dans la transparence ; les enseignants étaient dans des conditions de vie et de travail acceptables, etc. Le retour à la normalité de l’université africaine doit consister aujourd’hui, en l’augmentation des salaires, des primes des chercheurs, des enseignants-chercheurs et aussi du personnel administratif, à l’acquisition de nouvelles infrastructures pour accueillir le nombre d’étudiants devenu pléthorique, à la réorganisation de la bourse et des aides basée sur des critères objectifs et transparents, etc. On observe que, dans de nombreux pays africains, des efforts sont faits pour agir sur ces données quantitatives afin de retrouver le seuil de normalité de l’université. Par exemple, en Côte d’Ivoire, le gouvernement a investi des sommes colossales dans la construction d’infrastructures universitaires, dans les grandes villes de l’intérieur, à savoir Man, Korhogo, Bondoukou et, San-Pedro, etc.). Cependant, malgré ces efforts consentis censés résorber la crise, force est de constater que celle-ci se fait plus persistante dans la plupart des universités africaines ? Comment expliquer cet état de fait ? Notre approche est que cela est dû au caractère évolutif et spécifique des seuils de la normalité.
En effet, chaque contrée a son seuil de normalité. Par exemple, dans certains pays, surtout occidentaux, les spécialistes existent et sont nombreux dans presque tous les domaines de connaissances. Ce qui fait que les normes fixées pour le nombre d’encadrement par enseignant, le nombre d’étudiants par salle de travaux dirigés ou de nouvelles pratiques, peuvent être respectés sans problème. Mais ailleurs, surtout dans les pays africains, ces mêmes exigences sont difficiles à appliquer vu le nombre insuffisant parfois de spécialistes par rapport aux effectifs pléthoriques d’étudiants. Les besoins changent donc d’un pays à un autre et les seuils de tolérance aussi. Ainsi, les seuils ne sont pas les mêmes et diffèrent d’une contrée à une autre. Ce qui fait qu’il ne devrait plus avoir un seuil modèle. De ce fait, le modèle universel des universités ne doit plus tenir la route aujourd’hui. Chaque contrée spécifique a et doit avoir ces modèles spécifiques, et une université ne peut plus chercher à ressembler à une autre. Il ne s’agit donc plus d’universaliser un modèle parfait de normalité. Le paradigme positiviste bat de l’aile dans ses conditions. Il est insuffisant et limité comme solution aux maux des universités africaines.
Aussi cette solution thérapeutique marcherait-elle peut-être, si l’université africaine fonctionne de façon libre et autonome. Or, le constat est que cela n’est pas le cas. Toutes les universités africaines surtout celles au sud du Sahara reçoivent l’essentiel de leur financement de l’extérieur, c’est-à-dire de l’État et des partenaires occidentaux. Autrement dit, elles reçoivent leurs budgets de fonctionnement des politiques et des bailleurs de fonds. Et, c’est justement cette lecture que fait A. C. Robert (2006, p. 81) lorsqu’elle écrit qu’« aucun candidat à un poste de responsabilité politique en Afrique ne peut être élu sans avoir l’assentiment des bailleurs de fonds qui menacent implicitement ou explicitement de retirer leur aide ». Ainsi, lorsque la norme est dictée de l’extérieur à l’université africaine, elle engendre également des maux ou des crises. D’ailleurs, l’immixtion des politiques dans la gestion de l’université en Afrique, avec son corolaire de crises, est une réalité. Dans ce cas, la thérapie positiviste de Claude Bernard se trouve limitée pour juguler ces crises. Face à cette situation, l’approche thérapeutique anthropologique plus holistique apparaît comme la meilleure.
2. L’approche anthropologique canguilhemienne : le modèle de solution aux crises de l’université
Dans Le normal et le pathologique, Canguilhem rejette l’approche de Claude Bernard en centrant la stratégie thérapeutique non plus sur la maladie théorique, mais sur le malade réel. Canguilhem préfère l’approche clinique et différentielle à l’approche de laboratoire plus universaliste et plus quantitative : la maladie lui apparaît non plus comme un dérangement du seuil quantitatif, mais comme un dérangement d’état qualitatif.
Pour G. Canguilhem (1943, p. 45) « la maladie diffère de l’état de santé, le pathologique du normal comme une qualité d’une autre ». De ce fait, la maladie, loin d’être une simple variation quantitative de la physiologie, est une altération qualitative de l’état physiologique. Dans l’organisme, elle modifie considérablement l’identité du malade en lui imposant une nouvelle allure de vie. Autrement dit, la maladie a une origine externe et lorsqu’elle s’introduit dans l’organisme, elle impose au malade d’autres conditions de vie que la vie physiologique normale. La maladie ou le pathologique devient par conséquent, une expérience subjective et surtout qualitative. Ainsi, comme le note G. Le Blanc (1998, p. 8), « le pathologique n’est pas absence de norme. Il indique au contraire une configuration nouvelle de l’organisme, une adaptation possible du vivant aux perturbations du milieu extérieur ou intérieur, par la mise en place d’autres normes ».
C’est pourquoi, le pathologique ne doit pas être nié ou supprimé au profit de la quantité comme l’a fait Claude Bernard. Dans ce cas, la thérapeutique ne se résout plus par une veine tentative de ramener le malade à un seuil de normalité universel. Elle consiste à prendre en compte la situation clinique de chaque patient afin de déterminer le traitement qui convient. Il s’agit d’invoquer le « génie physiologique » propre de chaque patient susceptible d’inventer de normes nouvelles pour faire face à sa nouvelle expérience ou réalité. La normativité : voilà la solution anthropologique. Voilà la clé des résolutions des problèmes humains et sociaux. Or, qu’est-ce que la normativité chez Canguilhem ? C’est la capacité qu’a un corps soumis à la maladie de se réinventer afin de pouvoir s’adapter à sa nouvelle condition. En d’autres termes, « la normativité désigne la puissance de la vie à créer de nouvelles normes. » G. Le Blanc, (1998, p. 57).
Pour Canguilhem, lorsqu’il s’agit de soigner des êtres humains, l’on ne doit pas plaquer des seuils qui ne sont pas rationnels. Il ne faut pas appliquer mécaniquement des seuils quantitatifs. En réalité, tout ce qui s’impose de l’extérieur, est faux. Bien au contraire, il faut privilégier et non banaliser le point de vue du malade qui fait l’expérience de la maladie donc de la souffrance. Telle est la solution qu’on pourrait suggérer pour les crises à l’université dans nos pays africains, car les corps sociaux tout comme les corps biologiques, sont capables de normativité, c’est-à-dire d’inventer des normes vitales. C’est donc l’université qui, faisant l’expérience de son mal, est à même de dire exactement ce dont elle a besoin pour guérir. Il n’est plus question que ce soit l’État ou d’autres structures qui devinent son mal et lui proposent des solutions sans tenir compte de son avis.
C’est dire que les universités africaines doivent trouver des solutions à leurs problèmes en dehors du modèle universel des universités. Elles doivent penser leurs propres solutions, des solutions endogènes en s’appuyant sur le paramètre de leurs conditions anthropologiques. Une telle université ne se démarquera pas, dans ses objectifs scientifiques, des autres universités. Loin s’en faut. Par exemple, l’université Alassane Ouattara sise à Bouaké (Côte d’Ivoire) ne saurait résoudre ses problèmes propres en s’inspirant exclusivement de ce que, dans la même situation, une université française, canadienne ou australienne aurait envisagé. Mais elle imaginera des solutions qui tiennent compte des réalités anthropologiques qui participent à son rayonnement c’est-à-dire les croyances, les cultures, les mœurs de la population, etc. C’est de cette seule façon que son image sera redorée et sa dynamique retrouvée. Nous devons éviter des solutions « hors sol » si nous voulons résoudre efficacement les difficultés de tout acabit que rencontrent les universités africaines. En effet, il n’est pas interdit de s’inspirer des autres, mais l’erreur à ne pas commettre, est d’importer des solutions d’ailleurs pour les imposer comme modèle parfait.
Certes, il existe des lois générales ou universelles à partir desquelles s’identifie toute institution universitaire. Mais nous pensons que chaque université doit avoir son génie propre, c’est-à-dire qu’elle doit faire appel à sa créativité et à son inventivité en vue de faire face aux défis auxquels elle est confrontée. La thérapie anthropologique proposée par Canguilhem pour guérir les pathologies apparaît comme la solution qui sied aux crises interminables que vivent les universités africaines. De même que chaque corps développe sa propre norme après chaque maladie pour pouvoir s’adapter, de même chaque université en Afrique, doit trouver sa propre norme pour résoudre ses difficultés.
Généralement, en Afrique, l’étudiant, malgré sa maturité juridique et physiologique, reste dépendant des parents jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi. Or, en Europe, un étudiant est autonome et décide pour lui-même de ce qu’il veut faire une fois mature. Dans le contexte africain, il y a donc lieu, une fois que surviennent des crises en milieu scolaire et universitaire, d’associer et d’impliquer les parents d’élèves et d’étudiants dans leur gestion si tant est que ce sont eux qui assurent leur scolarité. Rien de tout cela, n’est envisagé comme solution par les autorités universitaires et politiques. Elles se contentent très souvent, et malheureusement d’imposer leurs vues aux acteurs du secteur éducatif. Ce qui explique quelques fois les dysfonctionnements constatés dans la gestion des structures universitaires. Celles-ci sont gravement malades de toutes les réformes qui leur sont de plus en plus imposées de l’extérieur par les politiques et les bailleurs de fonds. Par conséquent, tous les acteurs directs (enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants, personnels administratifs) comme indirects (les parents d’étudiants, les politiques) doivent participer aux prises de décision pour éviter ces crises, car comme le souligne justement C. Yao, (2021, p. 43) « la maladie ne se développe pas en dehors du malade. Il ne peut, par conséquent, y avoir de projet de soins sans la prise en compte de la dimension anthropologique du patient ».
Comme le corps vivant, nos universités sont capables de normativité, c’est-à-dire de faire appel à leur génie propre pour se développer en prenant en compte leurs réalités socio-anthropologiques. C’est cette approche holistique, comme preuve d’inventivité et de créativité, qui pourrait certainement mettre fin aux crises incessantes des universités africaines. Tant que les personnes pour qui ses solutions sont prises ne sont pas effectivement intégrées dans le fonctionnement de nos universités, les crises auront encore de beaux jours devant elles. L’image de l’arbre à palabre sous lequel se posent et se règlent tous les préoccupations sociétales en Afrique, devrait pouvoir inspirer les politiques et responsables commis à la gestion des universités.
Conclusion
En définitive, nous disons que les solutions à la crise de l’université africaine ne doivent pas se réduire à des considérations de données quantitatives ou matérielles, car tout n’est pas réductible au quantitatif. Il faut aussi et surtout prendre en compte l’aspect qualitatif, donc anthropologique. Autrement dit, nous pensons que l’université africaine doit penser ses propres solutions, en s’appuyant sur le paramètre de ses conditions anthropologiques et culturelles. Cela ne signifie pas qu’il faille se refermer sur soi et se démarquer des objectifs scientifiques des autres universités, celles des autres continents.
Mais, parce que nos seuils de la normalité ne sont pas les mêmes et sont évolutifs d’un pays à un autre, et même d’un continent à un autre, chaque université doit faire appel à son génie propre pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles elle est confrontée. Il faut donc éviter des solutions « hors-sol » considérées souvent comme étant des modèles parfaits et universels pour résoudre les crises que connaissent nos universités en Afrique. Pour notre part, l’approche anthropologique, plus transversale des problèmes et des solutions des universités africaines, devrait être la voie à suivre. En réalité, une crise ne survient pas ex-nihilo, elle s’annonce toujours par des signes exactement comme une pathologie. Et c’est en ce sens que la communication permanente entre les acteurs du secteur éducatif est ardemment souhaitée pour anticiper et prévenir les crises.
Références bibliographiques
BERNARD Claude, 2010, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Le Monde-Flammarion.
BERNARD Claude, 1872, Leçons de pathologie expérimentale, Paris, Baillière et Fils.
BERNARD Claude, 1947, Principes de médecine expérimentale, Paris, PUF.
CANGUILHEM Georges, 1966, Le normal et le pathologique, Paris, PUF.
HIPPOCRATE, 1999, L’Art de la médecine, Traduction et présentation de Jacques JOUANNA et Caroline MAGDELAINE, Paris, Garnier-Flammarion.
LE BLANC Guillaume, 1998, Canguilhem et les normes, Paris, PUF.
MAKOSSO Bethuel, 2006, « La crise de l’enseignement supérieur en Afrique francophone : une analyse pour les cas du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, et de la Côte d’Ivoire » in file:///c:users/acer/Downloads/05-document%20sur%20 la % crise, consulté le 04/06/2022 à 20h 29.
ROBERT Anne-Cécile, 2006, L’Afrique au secours de l’Occident, Paris, Les éditions Ouvrières.
YAO Christian, 2021, Claude Bernard et la science, Essai collectif, sous la direction de Ignace YAPI, Bouaké, Le Papyrus.
YAPI Ayénon Ignace, 2015, Approches du vivant. Etudes d’épistémologie biologique, Paris, L’Harmattan.
LE SAVOIR OU LA POLITIQUE : LA MISSION DES UNIVERSITAIRES AFRICAINS EN QUESTION
Dotsè Charles-Grégoire ALOSSE
Université de Kara (Togo)
Résumé :
Le monde universitaire africain est tiraillé entre deux grands pôles perceptibles : d’un côté se trouve le penseur critique, l’intellectuel qui tient à la vérité et s’engage dans de divers débats d’idées, dans les causes humanitaires et sociales ; d’un autre côté se trouve le pôle de l’expert en politique ou de conseiller politique qui s’associe parfois aux pouvoirs politiques afin d’étendre son aire d’influence théorico-pratique moyennant le numéraire. Les universitaires prétendument experts de l’une ou l’autre des questions sociales et politiques sont souvent au garde-à-vous en attendant qu’on les invite à donner leurs avis qui satisfont naturellement les politiques mais qui ne permettent pas de régler concrètement les problèmes réellement. L’objectif de notre propos est d’examiner la place des universitaires dans nos sociétés africaines et d’analyser leur mission de producteurs scientifiques mais aussi de la tentation qui les guette de plus en plus d’être tirés vers la caution politique. Il agit de situer la responsabilité des universitaires africains quant à leurs missions et de la possibilité d’être dévoyés de leur fonction fondamentale d’éclaireurs de la société à travers l’appât du gain qu’offre le monde politique.
Mots clés : Afrique, Éthique, Politique, Responsabilité, Universitaires.
Abstract:
The African academic world is torn between two major perceptible poles: on the one hand there is the critical thinker, the intellectual who holds to the truth and engages in various debates of ideas, in humanitarian and social causes; On the other hand, there is the pole of the political expert or adviser who sometimes associates himself with the political powers in order to extend his area of theorico-practical influence through money. Academics supposedly experts on either social or political issues are often on the alert-You’re waiting until they’re invited to give their opinions that naturally satisfy the policies but don’t actually address the issues. The aim of our discussion is to examine the place of academics in our African societies and to analyse their mission as scientific producers but also of the temptation that is increasingly lurking them towards political caution. It is a matter of situating the responsibility of African academics for their missions and the possibility of being diverted from their fundamental role as scouts of society through the lure of the gain offered by the political world.
Keywords : Africa, Ethics, Politics, Accountability, Academics.
Introduction
La mission des universitaires en général et celle des universitaires africains notamment consiste à enseigner, à faire la recherche et à rendre service à la communauté. Dans toutes ces activités susmentionnées, l’universitaire est tiraillé entre deux postures, à savoir se maintenir dans la diffusion du savoir-savant ou faire le savoir-action, non pas seulement pour rendre service à la société mais aussi aux politiques. L’université en Afrique, de la période coloniale à nos jours, épouse trois profils de reformes : université coloniale, université des indépendances, université de développement. Si l’université coloniale a été un vecteur de politique de mise en valeur de l’Occident au détriment de l’Afrique, dans la logique de l’université des indépendances et de l’université de développement, elle était appelée à s’émanciper des carcans de la colonisation et soutenir l’action gouvernementale dans le cadre des politiques de développement. Les deux premiers rôles susmentionnés de l’université en Afrique ont une visée idéologique qui cherche à maintenir l’hégémonie de l’Occident sur l’Afrique colonisée ou à s’affranchir mais difficilement de la tutelle de l’Occident et de ses paradigmes méthodologiques et épistémologiques. C’est au niveau du dernier rôle, à savoir allier l’université et le développement, et faire des universitaires des conseillers politiques, que la mission des universitaires s’est dévouée ces derniers temps. La question du développement se pose en Afrique avec acuité et les universitaires, qui sont aussi et avant tout des citoyens, sont de plus en plus visibles dans les arcanes du pouvoir politique soit qu’ils sont consultés, soit qu’ils sont eux-mêmes amenés à exercer la fonction politique. La raison essentielle qui motive ce dernier rôle des universitaires africains est que les universités publiques sont sous le joug des pouvoirs publics de par leurs financements. Toutes ces pesanteurs font que la mission des universités et des universitaires africains se trouvent véritablement en situation dilemmatique entre la diffusion du savoir et la caution au politique.
Le problème qui se pose est celui de la mission des universitaires africains. La question principale est : l’universitaire, dans le contexte africain, doit-il maintenir sa posture de neutralité axiologique, en faisant uniquement la science, qui est par principe désintéressée, ou bien doit-il faire de la recherche-action en s’engageant politiquement ? De cette question principale découlent deux autres subsidiairement, à savoir : en quoi consistent la neutralité axiologique et l’engagement pour les universitaires africains ? Quels types de neutralité et d’engagement pour les universitaires africains ? Notre hypothèse principale est que les universitaires africains ne doivent pas ignorer leur vocation première de producteurs de savoir même s’ils sont appelés à se prononcer sur des questions politiques. Celle-ci se déploie en deux autres hypothèses spécifiques, à savoir : la neutralité axiologique consiste pour les universitaires africains à se limiter à leur amour pour le savoir et pour la science et à leur diffusion auprès de leur public, mais la tentation est tout aussi grande de verser dans l’arène politique quand on sait que c’est au politique de porter en tout état de cause les projets de société. La neutralité axiologique de l’universitaire africain ne saura être un silence coupable et son engagement même en politique doit être fondamental et non militant. Notre approche méthodologique consiste à s’appuyer sur les thèses qui appellent à la neutralité axiologique du savant face à la politique et sur celles qui dédient à l’intellectuel un engagement politique et social. Ces thèses sont mises en perspectives dans le contexte africain. Pour ce faire, l’argumentaire procède en deux parties : après avoir présenté le tableau binaire de la mission des universitaires africains entre le savoir et le pouvoir, nous situerons leur responsabilité face au dilemme de la neutralité axiologique et de l’engagement politique.
1. La mission des universitaires africains entre savoir et pouvoir
Les universitaires africains sont écartelés, dans leurs missions régaliennes, à produire le savoir mais aussi à faire de la recherche – action et même la politique. Ce dernier rôle est, de plus en plus, visible aujourd’hui sûrement à cause de la reconnaissance, par les politiques classiques, de l’apport pratique des universitaires qui sont censés avoir contemplé la lumière pour pouvoir l’enseigner aux autres et même l’appliquer dans l’arène politique. Comment ces missions sont-elles remplies de ce double point de vue ?
1.1. La mission des universitaires africains : l’engagement pour le savoir
Dans le cadre de l’engagement théorique, les universitaires répondent à l’urgence d’agir en proposant des solutions théoriques. Ces intellectuels se placent en position de retrait par rapport à l’action directe. Ils dressent un portrait de la réalité, analysent les problèmes et terminent leur réflexion en identifiant une solution opératoire ou un plan d’action pragmatique. Les universitaires africains, c’est-à-dire les carriéristes de l’enseignement et de la recherche à l’université en Afrique, ont pour vocation première et irremplaçable de faire dissiper les ombres partout où elles se trouvent pour diffuser la lumière, le savoir. Cela vise à éloigner du continent africain l’ignorance, source d’abrutissement et de sous-développement pour le faire tendre vers la connaissance, l’indépendance, le développement (C. C. Kayombo, 2017).
Le métier de professionnel universitaire est souvent décrit comme correspondant à la mission d’enseignant-chercheur. L’universitaire pratique à la fois l’acte formel d’enseigner et celui de créer des connaissances, acteur d’un débat intellectuel, donc fin connaisseur de l’état de la science et tout autant producteur de connaissance. Les universitaires répondent aux multiples attentes de la société et réalisent leurs différents objectifs qui ont tous la même valeur. Il s’agit de la préparation à une vie de citoyens actifs dans des sociétés démocratiques ; le développement personnel ; le développement social par l’enseignement, l’apprentissage et la recherche d’une base de connaissances approfondie et diversifiée ; ainsi que la préparation à un emploi durable.
L’université se doit de définir les valeurs qu’elle doit mettre en avant et les inculquer à ses membres, aux enseignants, aux étudiants, et personnels administratifs, techniques et de service. Elle renouvèle ses missions multiples et son impact sur l’économie et la société en général à travers la compétitivité, l’employabilité, l’innovation, l’entrepreneuriat, la gouvernance face aux nombreux défis auxquels elle fait face pour exister dans une poussée de la mondialisation.
Les valeurs communes à tous les universitaires sont définies comme : l’engagement à poursuivre la vérité ; la responsabilité de partager la connaissance ; la liberté de pensée et d’expression ; l’analyse rigoureuse des preuves et le recours à une argumentation raisonnée pour atteindre une conclusion ; la volonté d’écouter les autres points de vue et de les juger sur leurs mérites ; la volonté de tenir compte des implications éthiques de certains résultats et de certaines pratiques.
Ces valeurs de l’éthique et de la déontologie concernent à plus d’un titre le milieu universitaire et donc les universitaires africains. L’éthique et la déontologie du métier de l’enseignant-chercheur sont celles-ci : « Écrivains et savants sont des citoyens ; il est donc évident qu’ils ont le devoir strict de participer à la vie publique. Reste à savoir sous quelle forme et dans quelle mesure » (É. Durkheim, 2002, p. 41).
Les règles déontologiques applicables aux enseignants-chercheurs procèdent, en général, de deux corps, à savoir celui applicable en général à l’ensemble des fonctionnaires de l’administration publique et celui qui s’impose, statutairement et spécialement, aux enseignants-chercheurs eux-mêmes. De cet ensemble, s’ajoutent aux qualités générales exigées de tous les fonctionnaires, l’interdiction du conflit d’intérêt dans des cas génériques et, enfin, des interdictions de comportements dans des situations particulières propres aux enseignants-chercheurs. Cette combinaison de règles semble permettre, soit d’imposer des devoirs au-delà des seules situations concrètes explicitement visées (recrutement, évaluation, recherche et direction de recherche), soit d’imposer d’autres règles, plus contraignantes, que celles qui sont explicitement prévues dans ces situations concrètes (pour les comités de sélection en particulier). Les règles déontologiques se trouvent d’autant plus efficaces qu’elles réunissent des exigences relevant de qualités générales, des obligations plus précises de comportements dans des situations générales (l’interdiction du conflit d’intérêt) et des obligations spécifiques dans des situations particulières.
É. Durkheim (2002, p. 42) écrivait justement à propos de l’engagement fondamental de l’intellectuel en le distinguant du militant politique :
C’est (…) surtout, à mon sens, par le livre, la conférence, les œuvres d’éducation populaire que doit s’exercer notre action. Nous devons être avant tout des conseilleurs, des éducateurs. Nous sommes faits pour aider nos contemporains à se reconnaître dans leurs idées et dans leurs sentiments beaucoup plutôt que pour les gouverner ; et dans l’état de confusion mentale où nous vivons, quel rôle plus utile à jouer ? D’autre part, nous nous en acquitterons d’autant mieux que nous bornerons là notre ambition. Nous gagnerons d’autant plus facilement la confiance populaire qu’on nous prêtera moins d’arrière-pensées personnelles. Il ne faut pas que dans le conférencier d’aujourd’hui on soupçonne le candidat de demain.
L’engagement des universitaires avec leurs sociétés et leurs communautés du point de vue social est de deux types. Le premier type d’engagement procède de l’existence même de l’université. L’une des principales fonctions des établissements universitaires consiste à former des diplômés. De plus, les universités sont les dépositaires de trésors (réels et virtuels), conservés dans leurs musées, leurs galeries et leurs centres d’archives. Elles constituent un lieu où l’on peut sans danger s’interroger sur des questions délicates ou des idées audacieuses. Elles fournissent également un matériau utilisé pour une branche de la culture populaire. Toutes ces caractéristiques confirment le statut d’institution sociale à part entière de l’université. Le second type d’engagement passe généralement par des contrats qui le structurent. En vertu de cet engagement, l’université produit des diplômés dans les disciplines et domaines professionnels voulus. Elle répond aux besoins qui ont été constatés, qu’il s’agisse d’inculquer ou d’actualiser des compétences particulières et, d’une façon plus générale, à la demande de formations dans telle ou telle discipline, qui émane des consommateurs. Elle fournit des services, des travaux de recherche et développement, des conseils, dans le cadre d’activités subventionnées ou à but lucratif.
1.2. La mission des universitaires africains : l’engagement politique
Dans le cadre de l’engagement pratique, les universitaires privilégient un engagement politique direct. Les types d’universitaires qui épousent l’engagement politique choisissent d’associer leur implication à celle d’acteurs généralement proches de mouvements sociaux, politiques et de leurs organisations. Ils explorent l’univers complexe du rapprochement entre l’université et la société selon une démarche unissant étroitement la recherche à l’action. Par l’innovation, ils sont à la recherche de moyens de combler les différents besoins exprimés par les acteurs sociaux et politiques. Cette démarche, de la praxie à la théorie, implique la plupart du temps de travailler en synergie avec les politiques et les acteurs de la société civile. L’intellectuel universitaire devient un élément visible d’un processus de mobilisation de ressources axé sur le changement social et la transformation positive de la société et des réseaux institutionnels de l’État.
Les universités africaines sont à l’image de leurs sociétés et de la dynamique politique qui les motive. Pris dans la double dynamique de restructuration globale des États africains, redéfinition de l’éducation au plan international, reconfiguration socio-économique au plan local, l’université et ses agents ont activement pris part aux processus politiques des années 1990. En effet, les mutations politiques qui se sont cristallisées sur l’université l’ont constituée en un enjeu de luttes et l’ont instituée comme arène entre politiciens et entre groupes en compétition pour la gestion du pouvoir. Les universitaires se sont alors investis dans ces mutations comme acteurs incontournables, en y jouant différents rôles.
Les étudiants dont les revendications sont taxées de refléter celles des politiques, et quelques fois soutenus par des enseignants de par leurs opinions, se sont avérés des agents importants de l’amplification des revendications politiques et de mobilisation des autres catégories sociales. Les enseignants se sont davantage engagés dans la formalisation et la gestion directe de l’ordre politique démocratique, continuant ainsi leur stratégie d’investissement dans la structuration, la définition et la gestion de l’État postcolonial. La coïncidence entre le monde universitaire et le monde politique est avérée. On y voit des traces dans les postes de nomination (qui sont plus réservés aux militants) et les postes d’élection où s’agitent plus les réfractaires au pouvoir et qui ont beaucoup plus foi à leur légitimité.
Dans la plupart des États africains, les Universités publiques sont politisées. On y voit la réplication de la bipolarité de la vie politique entre partis au pouvoir et partis d’opposition. Les militants et sympathisants des syndicats sont visiblement repartis dans cette géopolitique. La tentation de l’argent a amené certains universitaires africains à faire de l’expertise politique en dépassant le cadre de la vérité pour verser dans l’idéologie. Nombre d’universitaires en Afrique et au monde ont été taxés de cautions au pouvoir politique et à des régimes totalitaires. E. Saïd (1994) et J.-J. Salomon (2006) ont mis en perspective cette collusion entre le savant ou l’intellectuel et le politique.
L’engagement lie l’université et ses membres à la société. En vertu des principes qui régissent les relations liées à la première mission de l’université de produire du savoir, les universités jouent tout autant un rôle primordial dans la cohésion sociale et la résolution des problèmes que rencontrent les décideurs publics et les professionnels de tous horizons. A. Touraine (1972) a fait, dans le contexte américain, une contribution capitale au problème de la place du système d’éducation dans la société qu’on peut rapprocher au contexte africain. Avec la popularisation de l’université, le progrès de la connaissance scientifique et de son rôle dans le développement social a remplacé les crises de socialisation par des conflits sociaux de portée générale, à travers lesquels commencent à se dessiner les rapports et les conflits de classes propres aux sociétés technocratiques.
L’université, parce qu’elle est un centre de production et de diffusion de la connaissance scientifique, devient de plus en plus un lieu central des conflits sociaux de notre temps. L’université a eu successivement une fonction d’adaptation au changement économique et à l’intégration nationale, de consolidation d’une élite dirigeante, enfin, de production scientifique et technique. Cette dernière place l’université au cœur des forces et des rapports de production et lui donne un rôle politique. À l’ère du savoir, science, société et pouvoir ont nécessairement un lien intrinsèque (J.-M., Ella 2007).
2. Le dilemme de la neutralité et de l’engagement chez les universitaires africains
Les universitaires africains sont écartelés entre la mission de faire la recherche théorique et celle de faire appliquer leur théorie dans l’arène politique ou de les appliquer eux-mêmes. Seulement, la neutralité pour la science ne doit pas les éloigner du champ social et politique et leur engagement doit aussi être responsable pour qu’ils ne soient pas taxés de militants ou bien de caution à des politiques peu orthodoxes. Quel type d’engagement les universitaires africains doivent privilégier aujourd’hui ?
2.1. Les responsabilités des universitaires africains dans la diffusion du savoir
Les universitaires africains ont bien évidemment des responsabilités dans la diffusion du savoir dans le maintien de la distance épistémologique pour qu’ils ne se versent pas eux-mêmes dans les résultats de leurs recherches du moins qu’ils maintiennent la neutralité axiologique. Ces responsabilités sont la recherche de la vérité et la nécessité pour eux de faire que les savoirs qu’ils distillent au sein des sociétés les amènent à les émanciper. M. Weber (2005) avertit que le discours scientifique doit être autonome au regard des valeurs du chercheur, même s’il n’ignore pas en amont une relation aux valeurs qui orientent le choix de ce dernier sur l’objet de sa recherche et les méthodes mises en œuvre.
En revanche, il récuse dans le corps de l’analyste un point de vue normatif amenant le chercheur à encenser ou à dénoncer, à imposer sa hiérarchie du bien et du mal. Même si L. Brière, M. Lieutenant-Gosselin, F. Piron (2019) doutent de la neutralité de la recherche scientifique, pour Max Weber (2005, p. 41), il importe de « reconnaître que l’observation de faits (…), la description de la structure interne de biens culturels, d’une part, et d’autre part la formulation d’une réponse à la question de savoir quel type d’action on doit adopter au sein de la communauté culturelle et des groupements politiques, constituent deux ordres de problème absolument hétérogènes ». Il convient de laisser le lecteur ou l’auditeur déterminer « le point à partir duquel lui-même pourra prendre position sur la question en fonction de ses propres idéaux ultimes ». Il ajoute que « le prophète et le démagogue n’ont pas leur place à la chaire d’un amphithéâtre » (M. Weber, 2005, p. 40-41).
Le penseur de la société n’est pas un homme politique ou un directeur de conscience, sa tâche est de comprendre et d’analyser un domaine de la vie sociale, mais non de parler en son nom. Il dénonce « cette dangereuse illusion qui se figure qu’il est possible de parvenir à des normes pratiques ayant une validité scientifique à la faveur d’une synthèse ou d’une moyenne de plusieurs points de vue partisans » (Weber, 1992, p. 129). Le refus de la neutralité axiologique au nom de la critique sociale et de l’adhésion à une cause en faveur de populations dominées ou malmenées est un refus de la confusion des rôles entre les sciences sociales et le politique. Certes, le chercheur entretient toujours un rapport particulier aux valeurs mais cette relation affective marquée demeure en amont de la recherche. L’analyse ne confond pas jugement de fait et jugement de valeur. Et son engagement demeure hors de son existence de scientifique.
Telle était également la position d’Émile Durkheim (1978, p. 38-39) :
Mais de ce que nous nous proposons d’étudier la réalité, il ne s’ensuit pas que nous renoncions à l’améliorer (…) Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces derniers : c’est au contraire pour nous mettre en état de mieux les résoudre.
La qualité d’une recherche ne tient pas à sa force de profération ou à l’ampleur de son indignation, mais à la valeur de ses analyses pour mieux comprendre les faits qu’elle analyse et laisser les acteurs trouver éventuellement les solutions qui s’imposent.
Les membres de la communauté universitaire doivent, eux aussi, remplir un certain nombre d’obligations qui découlent de ce que l’on peut appeler la citoyenneté universitaire. En effet, pour être membre d’une université, il ne faut pas se contenter d’accomplir les tâches les plus évidentes qui se présentent. Cette citoyenneté supposait d’accomplir certaines tâches collectives : procéder aux contrôles des connaissances, faire partie de diverses commissions et définir les grandes lignes des stratégies. Ces pratiques font d’ailleurs l’objet de publications sans cesse plus nombreuses.
Aujourd’hui, on a constaté que ces pratiques n’étaient plus exclusivement réservées aux membres du personnel enseignant. Nul ne conteste en effet le soutien et la valorisation qu’apportent dans le domaine de l’enseignement, de la recherche et des services les membres de la communauté universitaire. Qualifié dans différents types de secteurs, chacun d’entre eux a sa propre sphère de compétences professionnelles, ses propres responsabilités et voyant son rôle reconnu à travers les services à la communauté.
La citoyenneté universitaire repose au fond sur la notion d’appartenance. Ces responsabilités sont notamment : un certain type d’intégrité universitaire, qui repose précisément sur le recours à des procédures scientifiques. La reconnaissance d’autrui et l’honnêteté dans les écrits, par exemple en faisant toujours référence avec exactitude et sérieux aux travaux des autres dans ses propres travaux. Un certain savoir-vivre académique, qui consiste par exemple à écouter les autres et à tenir compte de leur opinion, une aspiration à l’auto motivation et à l’aptitude à apprendre de manière autonome, la soumission aux règles de discipline, le respect de l’environnement de travail des membres de la communauté universitaire, l’adhésion à un ensemble d’engagements et de pratiques collectivement obtenus.
Le souci épistémologique vise à élaguer autant que possible le supplément affectif qui risque de compromettre une recherche. L’évidence première est rarement le meilleur ancrage pour la qualité du travail, le cheminement avec les acteurs, une meilleure connaissance de leur parcours, des méthodologies employées de manière judicieuse, visent justement à éloigner toute subordination de l’analyse à l’émotion, voire à la sentimentalité. L’affectivité doit rester à sa juste place, celle d’une amorce, d’une aide à la compréhension, mais par un contrôle personnel, le chercheur s’efforce de la maintenir hors de ses analyses.
2.2. La responsabilité des universitaires africains dans leur engagement politique
L’université en arrive à être un des moteurs du développement de la modernité et de la mondialité. L’enjeu ou la question universitaire renvoie à sa capacité de se doter d’une bonne marge d’autonomie et de liberté en matière scientifique et technologique par rapport à l’emprise du pouvoir politique. Sinon, la fonction civilisationnelle de l’institution universitaire disparaît au profit d’une fonction purement utilitariste. J. Dewey (1975) plaide pour une université pragmatique, conscient des dangers qui guettent l’institution universitaire, particulièrement ceux qui sont associés à un trop grand assujettissement de la science aux besoins et aux intérêts du pouvoir politique ou du capital.
Concrètement, ce repositionnement des rôles de l’université n’est pas sans profiter au monde universitaire. D’une part, les universités se multiplient ; d’autre part, les clientèles augmentant et se diversifiant, les champs d’études se fragmentent et les programmes se multiplient. L’université renouvelle sa programmation au profit d’une spécialisation de l’enseignement et de la recherche en un corps élargi de disciplines et de sous-disciplines. La taylorisation de l’université fait voler en éclats les dispositifs classiques de formation et de recherche. Le mode de fonctionnement adopté par les sciences naturelles se diffuse, contaminant les autres domaines, éliminant le chercheur individuel pour favoriser les groupes de recherche formés de spécialistes qui travaillent sur des fragments de la chaîne de connaissance. Cette colonisation du champ universitaire se construit sur la segmentation des tâches, un véritable marché économique émerge. Il offre une variété de produits et de services relevant du savoir.
Le rôle de l’universitaire se conforme à ce nouvel environnement. Division du travail oblige, l’universitaire devient un spécialiste d’un champ précis du développement des connaissances. L’érudit généraliste philosophe de l’époque des Lumières, travaillant seul ou en petit groupe, laisse la place au spécialiste membre d’une et préférablement de plusieurs équipes de recherche qui se penchent sur des questions soulevées par une modernité assoiffée de progrès social, culturel, économique ou politique. La condition de salarié confère à l’universitaire une autonomie d’action ; sa syndicalisation lui donne une marge de manœuvre supplémentaire.
Les contraintes économiques qui pèsent désormais sur l’univers de l’université sont abondamment décrites par A. B. Cabal (1995). La nouvelle matrice permet à l’universitaire de lier sa réflexion et sa production intellectuelle ainsi que son rôle de pédagogue et de formateur à une rationalité indépendante des aspirations et des intérêts portés par l’aristocratie et les politiques. D’un autre côté, elle l’enferme dans la contrainte du carriérisme. À l’ancien type d’attachement succède une nouvelle affiliation, économiciste cette fois. De façon pratique, le contrat professionnel donne à l’universitaire une plus grande autonomie. Pour cheminer dans le champ des places et des positions disponibles, les règles formelles et informelles régissant la mobilité au sein de la structure universitaire constituent soit des occasions à saisir, soit des contraintes à respecter. L’autonomie gagnée se trouve rapidement enfermée dans un nouveau carcan. Les chaînes ne sont plus imposées de l’extérieur, mais de l’intérieur. S’il doit accomplir trois tâches complémentaires, la recherche, l’enseignement et les services à la communauté, l’universitaire le fait en fonction d’objectifs carriéristes, professionnels ou de vocation.
La fonction universitaire qui s’oriente de plus en plus vers la productivité. Aujourd’hui, la pensée unique de la technoscience règne sur un paysage intellectuel désertique. Aucune des civilisations non occidentales n’est en mesure, ni ne semble pas avoir le désir de le faire, de proposer une solution de rechange contre la rationalité économique, ce qui fait de la science une condition gagnante pour faciliter la reproduction de la civilisation capitaliste. Il découle de cette analyse que l’exercice d’une science critique, en ce qui concerne tant l’actualisation des anciens paradigmes ou l’émergence de nouveaux que leur transposition dans la pratique, demeure difficile, parce que peu valorisé et non soutenu financièrement.
De nos jours, bien installés au pouvoir, les discours libéraux et néolibéraux renouvellent constamment leur base, consolidant le processus de complexification d’une pensée mondialisée et sans véritables oppositions. Dans un tel contexte, l’antithèse hégélienne est marginalisée et en voie de disparition. Fait exceptionnel dans l’histoire de l’humanité, nous en sommes arrivés à un point où la rationalité et la nécessité économiques sont devenues hégémoniques et traversent l’ensemble des différents espaces culturels de la planète.
Comme le rappelait R. Aron (1955) à propos de la responsabilité des intellectuels vis-à-vis de la société française à propos de l’évolution des mots gauche, révolution et prolétariat, les universitaires africains ont bien évidement le devoir de mesurer leur engagement dans la réalisation de leurs missions en rapports aux mutations sociales. Bien des savants ont été tentés puis dévoyés par la politique. Bien des penseurs ont souillé leurs noms en se compromettant avec des idéologies peu orthodoxes. Mais, il en existe d’autres qui, forts d’une éthique inébranlable et d’une sagesse inaltérable, ont su éclairer leurs sociétés et orienter leurs politiques vers le bien commun et la justice. L’engagement de l’universitaire en politique n’est donc pas, par définition même, un acte de trahison ou une entreprise vouée à l’échec mais un engagement privé qui peut le lier quant à sa liberté réelle de dire le droit aux côtés des faits. Il convient cependant de dépasser la neutralité devant des projets politiques antidémocratiques et de circonscrire son engagement même en étant appelé à la gestion de la chose publique.
La question de l’autonomie scientifique et pédagogique et de la liberté académique des universitaires demeure. Au-delà du recours à la décentralisation et à l’autonomie financière en vue d’améliorer l’encadrement universitaire, il convient de garder à l’esprit que les questions des libertés académiques et de la franchise universitaire ne peuvent se penser indépendamment de celles des libertés publiques et qu’il est utopique de croire que les universitaires retrouveraient une marge de liberté là où, en tant que citoyens, ils y auraient renoncé. L’engagement de l’universitaire en politique ne doit pas du reste s’assimiler au militantisme, mais il s’agit plutôt d’un engagement fondamental au sens où l’entend M. Savadogo (2018) comme une éthique de l’engagement.
Conclusion
En posant le problème de la mission des universitaires africains, nous avons adopté une argumentation en deux moment pour présenter l’alternative binaire de la mission des universitaires africains entre le savoir et le pouvoir, et situer leur responsabilité face au dilemme de la neutralité axiologique et de l’engagement politique. La prospective d’universitaires pour l’Afrique correspond à un type d’intellectuels en clin aux problèmes de l’Afrique. Il s’agit d’intellectuels universitaires qui s’attellent à la tâche qui lui incombe pour approcher la réalité, afin de mieux la comprendre et, surtout, pour renouveler les pratiques sociales émancipatrices. Ce type d’engagement permet à l’intellectuel de se mettre au diapason de la neutralité et de la position, c’est-à-dire de se situer entre l’engagement théorique et l’engagement pratique.
Il existe des familles de valeurs qui sont caractéristiques de l’Université et qui, dans un contexte plus large, déterminent la contribution de ce secteur à tous les projets que la société entreprend. Ces familles de valeurs représentent les deux types de neutralité ou d’engagement fondamentaux pour les universitaires. Au nom de la neutralité axiologique, les universitaires sont tenus à la production efficace et responsable des connaissances ainsi qu’aux modalités de leur utilisation dans la vérité : les universitaires doivent faire montre de valeurs de l’éthique professionnelle étant modèles et leaders dont les actions sont suivies socialement. Au nom de la neutralité politique, les universitaires doivent être conscients de la place de l’université en tant qu’institution publique au sein de la société en préservant leur ascèse de savant, même dans leur engagement politique.
Références bibliographiques
ARON Raymond, 1955, L’Opium des intellectuels, Paris, Calmann-Lévy.
BRIERE Laurence, LIEUTENANT-GOSSELIN Mélissa, PIRON Florence (dir.), 2019, Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre ? Québec, Éditions sciences et bien commun.
CABAL Alfonso Borrero, 1995, L’université aujourd’hui. Éléments de réflexion, Ottawa / Paris, CRDI / UNESCO.
DEWEY John, 1975, Démocratie et Éducation, Paris, Armand Colin.
DURKHEIM Émile, 2002, L’individualisme et les intellectuels, Paris, Éditions Mille et une nuits.
ELA Jean-Marc, 2007, L’Afrique à l’ère du savoir : science, société et pouvoir, Paris, L’Harmattan.
KAYOMBO Chrysostome Cijika, 2017, L’enseignement supérieur et universitaire en Afrique. Contextes, débats, critiques, enjeux et perspectives, Paris, L’Harmattan.
SAÏD Edward, 1994, Des intellectuels et du pouvoir, Paris, Le Seuil.
SALOMON Jean-Jacques, 2006, Les Scientifiques : entre pouvoir et savoir, Paris, Albin Michel.
SAVADOGO Mahamadé, 2008, Pour une éthique de l’engagement, Namur, Presses de l’Université de Namur.
TOURAINE Alain, 1972, Université et société aux États-Unis, Paris, Seuil.
WEBER Max, 1992, Essais sur la théorie de la science, Paris, Presses Pocket, Agora.
WEBER Max, 2017, Le Savant et le Politique, Paris, La Découverte.
L’ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE : UN MODÈLE D’ÉTUDE EXÉGÉTIQUE POUR UNE UNIVERSITÉ EN CRISE
Chantal PALÉ-KOUTOUAN
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’université a pour finalité d’instruire, c’est-à-dire de former les étudiants à la connaissance dans les différentes disciplines qu’elle propose comme offres de formation. Et, la philosophie, discipline intégrante des sciences humaines, participe pertinemment à l’atteinte de cet objectif. Elle est même, la matière par excellence, pour inculquer les valeurs cardinales qui s’avèrent fondamentales, aujourd’hui, plus qu’hier, dans nos universités où le jugement sain et l’appréciation des valeurs sont en branle. L’université devrait trouver dans la philosophie, un repère puisqu’elle est l’accomplissement dans lequel se forme le jugement. Elle fortifie en l’homme les valeurs qui l’élèvent à l’humanité et l’éloignent de toutes ces formes et conséquences du principe mal apprécié d’autorité conforté dans la loi du plus fort. Au demeurant, si la philosophie se veut comme la discipline garante, à la fois d’une éthique de l’éducation et de la responsabilité, n’est-il pas nécessaire que l’université s’en approprie les valeurs ? Comment comprendre alors que les gestionnaires de cet espace en veuillent la suppression, au moment où, paradoxalement, les valeurs périclitent ? Cet article s’attachera à montrer que la philosophie est essentielle dans la vocation de l’université comme institution d’instruction par excellence et moyen de libération de la crise.
Mots clés : Étudiants, Philosophie, Repère, Responsabilité éthique, Université, Valeurs cardinales.
Abstract:
The purpose of the university is to instruct, that is to say, to train students in the culture of truth, in the various disciplines that it offers as training offers. And philosophy, an integral discipline of the humanities, contributes royally to the achievement of this goal. It is even, the subject par excellence, to inculcate the cardinal values that are fundamental, today more than yesterday in our universities where sound judgment and the appreciation of values is underway. The university should find in philosophy, a benchmark since it is the fulfillment in which judgment is formed. It strengthens in man the values that elevate him to humanity and distance him from all these forms and consequences of the poorly appreciated principle of authority reinforced in the law of the strongest. Moreover, if philosophy is intended as the discipline that guarantees both an ethic of education and responsibility, is it not necessary for the university to take ownership of its values? How then to understand that the managers of this space want it removed, at a time when, paradoxically, the values are declining? This article will endeavour to show that philosophy is essential in the vocation of the university as an institution of instruction par excellence and a means of liberation from the crisis.
Keywords : Students, Philosophy, Landmark, Ethical Responsibility, University, Cardinal Values.
Introduction
La crise à l’université est désormais le fait de tous les acteurs présents dans ce milieu, à savoir, les étudiants, les enseignants et le personnel administratif et technique. Les réformes lancées par le ministère de l’enseignement supérieur sur la réorganisation des cursus, l’instauration du système Licence Master Doctorat, « LMD » constituent des voies de résolution de cette crise. Toutefois, il existe bel et bien un dysfonctionnement de l’institution universitaire, les étudiants n’ont plus de penchant pour l’université, les enseignants-chercheurs eux-mêmes manifestent de plus en plus clairement leur insatisfaction sur l’évolution des choses à l’université.
Nous avons la présence de maux endémiques tels que la mauvaise qualité des formations universitaires, le peu d’appétit des étudiants pour le savoir et l’impéritie administrative des universitaires. Et, on se renvoie des accusations. Nous nous rendons compte de la faiblesse des moyens accordés aux universités par l’État, de la démission du corps enseignant, de son ignorance de l’entreprise, de la mauvaise qualité des étudiants qui en sont issus. Nous constatons de part et d’autre, avec stupéfaction des réactions négatives de la communauté universitaire vis-à-vis de certains projets de réformes administrative et académique de l’université. Les jugeant contre-productifs et inadaptés ; ils sont frappés du soupçon d’être politiquement dirigés contre eux. Cette attitude les conduit à rejeter dans une même condamnation aussi bien la maladie et les remèdes qu’on propose à leur université malade de sa nature et de son fonctionnement : à vrai dire, nous sommes dans une situation où les universitaires, considèrent à tort ou à raison, que de tels remèdes ne peuvent qu’empirer le mal.
Cependant, l’enseignement de la philosophie à l’université devrait constituer le palladium en raison du fait qu’elle est réputée être l’accomplissement de la rationalité et du jugement éthique. Sans vouloir être alarmiste, nous nous interrogeons comme suit : en quoi l’enseignement philosophique peut-il constituer un modèle d’étude exégétique pour une université en crise ?
L’université en Afrique traverse une situation de crise toute spécifique. Dans notre étude historique et sociocritique, nous nous attacherons d’abord, à produire analytiquement, une herméneutique des dimensions fondatrices de la crise universitaire. Ensuite, nous ferons une exégèse de notre époque au regard de la crise dans les universités africaines. Cela nous permettra enfin et en dernier ressort, de montrer que l’enseignement de la philosophie est, pour le moins qu’on dise, une solution aux crises universitaires.
1. Pour une herméneutique des dimensions fondatrices de la crise universitaire
L’université a hérité d’institutions d’enseignement philosophique et de recherches issues de l’Antiquité. Mais, c’est, précisément, dans le contexte de la scolastique (Moyen-âge), où les religions, chrétienne et islamique se déployaient respectivement en Occident et en Orient, que l’université est instituée comme structure sociale d’enseignement. Elle s’assigne pour mission, d’œuvrer à la diffusion de la culture scientifique, technique, en instruisant par l’enseignement et ce à partir des connaissances médiévales, constituant généralement un ensemble théorico-pratique bien structuré.
De ce rôle central que l’université joue, R. Bodin et S. Orange, (2013, p. 53), considèrent l’université comme une sorte de « carrefour autour duquel s’organise et grâce auquel se régule, l’espace de l’enseignement supérieur dans son ensemble ». Autant dire que l’université s’est d’abord constituée comme une structure complexe de la culture, parce qu’elle a préalablement cumulé les rôles de la formation et de la culture. L’université est une institution initialement commise à l’instruction et à l’éducation des apprenants. Elle s’intéressait moins aux questions de spécialisation du savoir, à plus forte raison à son utilisation pratique, telle que procèdent les écoles professionnelles ou de spécialisation.
Mais, en raison de certaines nécessités de son évolution, elle adopte les types et surtout des modes de formation dans des domaines spécialisés au sein d’unités scientifiques appelées Facultés. Associées et structurées, ces dernières donnent à l’université d’être une véritable institution d’enseignements et de formation de toutes natures. Ces enseignements et ces formations universitaires, s’opèrent sans discontinuer dans le temps. Il existe de ce fait, des offres de formation ouvertes suivant des profils qui tiennent compte du statut des différents types d’étudiants, sans oublier les travailleurs qui aspirent à se perfectionner ou simplement à poursuivre leur formation. C’est tout le sens de l’existence à l’université des Centres de Formation Continue (CFC), des universités de vacances (UNIVAC), et bien d’autres. Ce lieu du savoir par excellence, accueille toutes les personnes désireuses d’acquérir une formation initiale ou continue dans des domaines d’enseignement précis. En ce sens-là, on peut dire que l’université joue son rôle d’institution sociale.
Dès son origine, l’université s’est déjà établie comme un lieu fréquenté à la fois par une communauté de savants et d’étudiants visant l’objectif de la recherche de la vérité. Comme objectif, ainsi que Karl Jaspers (2008, p. 17) le reconnaît, « la tâche de l’université est de permettre la recherche de la vérité à la communauté des chercheurs et des étudiants ». Elle admet une administration personnelle indépendante de l’influence de quelque gouvernance venant d’une entité extérieure à son système. Fondée à transmettre et expliquer, tout au plus, un patrimoine de vérité constituée, l’université mettait moins l’accent sur la recherche. Elle cherchait à transmettre le savoir tel quel, dans son caractère universel et culturel.
Apparue d’abord comme une entité autonome, quasiment étrangère à la notion d’appartenance territoriale, l’université ne se faisait, par conséquent, aucune fixation sur sa place dans la société, ni sa contribution à son devenir. À ce titre, elle se présente comme la création des plus spécifiques et prestigieuse de la société. Elle est de surcroit, le dispositif fondamental de la formation des cadres, de l’élite politique, voire de la crème intellectuelle, de façon générale. Fort de son expérience en tant que Recteur d’université, Martin Heidegger reconnait à l’université, son élégance dans la transmission des valeurs éthiques à travers la vulgarisation de la scientificité.
Dans L’auto-affirmation de l’université allemande, M. Heidegger (1987, p. 11) écrit que « l’université vaut pour nous comme cette haute école qui, à partir de la science et à travers la science, éduque et élève les guides et gardiens du destin du peuple ». L’université en tant qu’elle est une haute sphère de l’éducation et certainement d’accomplissement de l’ensemble des principaux acteurs de la Nation, assure le renouvellement d’idées et contribue essentiellement aux avancées de la science. Aussi K. Jaspers, (2008, p. 21) a-t-il pu écrire que « si l’université sert la science et que la science a du sens du fait qu’elle fait partie de la vie de l’esprit englobant, alors cette vie de l’esprit est le véritable mouvement à l’université ». Autrement dit, l’aptitude de l’université à la production du savoir et à sa vulgarisation, lui donne sa valeur intrinsèque. Aujourd’hui, ce rôle si noble, qui vaut à l’université la prestigieuse place qu’elle occupait dans la dynamique sociétale, lui échappe progressivement. Il nous faut en faire l’exégèse pour mieux saisir ce changement de donne.
2. L’exégèse de notre époque au regard de la crise dans les universités africaines
En Afrique, les universités semblent subir un genre de délabrement spirituel graduel. Ce lieu de mérite, de la formation qui, selon J. Banner et H. Cannon, (2009, p. 22) « doit être un lieu protégé où rien ne doit venir menacer » personne, se détériore. En effet, l’université assume ses fonctions avec de moins en moins de responsabilité, car désormais, elle est confrontée aussi à des problèmes, politiques et de bien d’autres ordres qu’elle doit assumer. L’université africaine est de plus en plus instable, du fait de sa restructuration qui contribue principalement à sa désagrégation, au point où l’on doute finalement de son appropriation. Augustin Diby Kouadio s’inquiète de cette situation universitaire désespérante ; lui qui pense que celle-ci devrait être la rescousse de l’État dans les situations sociopolitiques conjoncturelles et non le contraire. Ainsi écrit-il (2016, p. 47) : « la division subtilement gagne notre université qui se laisse envahir par les courbures et les aspérités de la société, alors que c’est vers elle, en bonne logique, que les regards devraient s’orienter lorsque tout semble obscur et que l’on cherche une étincelle de lumière !». Le déclin des universités africaines est une réalité avec laquelle il faut compter depuis l’incursion du politique de qui dépend désormais, la gestion des universités. L’un des effets pervers de cette situation est la crise éthique que les universités traversent.
En effet, les valeurs cardinales qu’elles ont vocation d’inculquer ou du moins, d’entretenir y sont désormais contestées au profit d’autres contenus d’intérêt divers. L’autorité de l’enseignant, très essentielle dans la formation des apprenants, est tronquée. Ils sont finalement exposés aux vices de tout genre. C’est dans ce sens qu’Hannah Arendt (2012, p. 251) a affirmé ceci : « affranchi de l’autorité des adultes, l’enfant n’a pas donc été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique : la tyrannie de la majorité. En tout cas, […] plus tyrannique et effrayante que celles des adultes ». En plus de cela et désormais, l’université est amenée à se disputer ce rôle de production des savoirs et de diffusion scientifique avec d’autres établissements ou représentations sociales alternatives. Tout cela fait que l’université est devenue une institution apparaissant comme dégénérée et inutile. Et, il ne faut pas se l’occulter, cela produit et attise les braises de sa consomption. L’université africaine est ainsi frappée en plein cœur par une menace de décadence.
Cela ne fait l’ombre d’aucun doute, les premières universités d’Afrique, à l’instar de celles de la Côte-d’Ivoire sont de création récente. Elles sont ‘‘importées’’, pour utiliser un terme cher à Jean François Bayart parlant de l’État au Cameroun. Évidemment, le concept d’université, tout comme celui de l’État, sont des termes inspirés par la colonisation occidentale. Et comme tels, même si on peut leur trouver un répondant dans les rationalités tribales africaines, la question de leur appropriation demeure. Le sentiment d’une crise de l’université semble bien être le lieu le plus commun de notre époque.
Une des raisons justificatives de la crise de / et à l’université est le fait que la décolonisation a entraîné un démarrage tardif de l’enseignement supérieur en Afrique. Très illustratif, est l’exemple du système colonial dans lequel les enseignements universitaires étaient très centralisés et rattachés étroitement à la métropole à travers des instituts spécialisés qui avaient des activités géographiquement étendues jusqu’aux colonies africaines. Dans la plupart des cas, les activités des universités ont continué dans le cadre d’accords de coopération passés avec les nouveaux États indépendants.
En outre, au fur et à mesure que s’est affirmée la politique universitaire des États, des « correspondances horizontales », c’est-à-dire des coopérations inter-universitaires, ont pu se développer entre les différentes universités africaines. Ces correspondances se sont substituées ou ajoutées aux seules relations « verticales » de coopération qui existaient auparavant entre ces universités et les centres de décision situés dans les métropoles. La situation que connaît l’université semble bien répondre au succinct tableau clinique mentionné plus haut.
De nos jours, l‘université traverse une crise profonde, c’est-à-dire un blocage généralisé provenant, d’un faisceau complexe de causes parmi lesquelles, celles qui sont liées au facteur humain sont déterminantes. Est-il permis dans ces conditions, de penser que l’université demeure un cadre institutionnel si profondément éprouvé qu’elle ne se reconnaît plus elle-même comme telle ? Dans ces conditions, la crise est un repère à partir duquel, il est possible de lire le tableau d’une société africaine en général, de l’université en particulier, afin de mieux saisir les enjeux qui en découlent. Dans cet univers de sens, est-il possible de distinguer deux ordres de perception opposés tentant d’appréhender la crise actuelle de l’université. Le premier ordre de pensée propose une explication, affirmant qu’il s’agit d’un phénomène inhérent à toute société en pleine mutation. La crise annoncerait un changement, vu qu’elle n’est qu’une période d’apprentissage ou d’adaptation. La seconde vision est beaucoup plus pessimiste. Il est question, en parlant de la crise à l’université, de signes annonciateurs d’une institution universitaire incapable de se prendre en charge.
Entre ces deux tendances se situe l’idée de plus en plus admise que la crise est socio-culturelle. Pour pouvoir la résorber, l’on devrait procéder à des restructurations sociales et culturelles ; serait-ce, certainement inciter à la pensée. Celle qui permettrait la reconversion des mentalités à la culture de l’excellence dans ce milieu. H. Arendt (2012, quatrième de couverture) considère que « l’homme se tient sur une brèche, dans l’intervalle entre le passé révolu et l’avenir infigurable. Il ne peut s’y tenir que dans la mesure où il pense, brisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux du temps indifférent ». Mais quand on se penche sur ses manifestations et le sens de la crise, on peut remarquer qu’elle a un statut particulier. Cette remarque nous paraît vraisemblablement apodictique. En fait, la crise que traverse aujourd’hui, l’université est « une crise ontologique » : il n’y a probablement pas de pire illusion que celle qui consiste à s’imaginer que tel ou tel aménagement social ou institutionnel pourrait suffire à apaiser une inquiétude qui vient du tréfonds même de l’université elle-même.
À la lumière de ce qui précède, l’horizon de notre analyse s’éclaircit mieux encore. Celle-ci doit s’intéresser d’abord aux manifestations de la crise. La raison est toute simple. En effet, aussi inquiétante soit-elle, voire angoissante, la crise a plus souvent sa source dans les profondeurs de l’être que dans des causes extérieures. Elle est une enflure de nos tares intérieures qui se déploient à l’extérieur. D’où sa manifestation dans nos manières de faire qu’il importe de dénoncer.
En effet, une autre dimension du problème existe, qui permet de comprendre que la crise est inéluctable. Curieusement, la source ici, c’est l’incorporation de tous les bacheliers à l’université. Rappelons que le premier examen universitaire est le baccalauréat, dont les jurys sont toujours présidés par des universitaires. Or, que constatons-nous ? Nous constatons que le baccalauréat donne droit systématiquement à une entrée à l’université. Les universités sont dans l’obligation d’accueillir tous les bacheliers, car elles leur donnent ce premier titre universitaire. Voilà une des causes de la crise qui, à la limite, est semblable à une fiction. Or cette dernière, n’a jamais été mise en cause alors même qu’elle crée un type d’étudiants qui n’est peut-être pas à la hauteur des études universitaires. Une des manifestations de la crise trouve indiscutablement sa source au sein même de la communauté universitaire. La gestion corporatiste des carrières enseignantes, a conduit à une confusion inextricable entre disciplines académiques et cursus universitaire des étudiants. On a multiplié à l’infini les disciplines, notamment en sciences sociales. Cette manière de faire a pour but de satisfaire les groupes professionnels organisés autour des différentes filières d’enseignement.
En conséquence, on assiste à la création de nombre de nouveaux cursus qui auraient dû dynamiser les disciplines académiques en leur donnant de nouveaux objets et en attirant à elles, de nouveaux étudiants. Tout ceci conduit à une expansion des effectifs universitaires qui s’accompagnent du développement de nombreuses disciplines nouvelles liées à des champs professionnels en développement. Ceci nous pousse à dire que le développement au sein de l’espace universitaire de formations pluridisciplinaires orientées par des champs professionnels, conduit à un nombre pléthorique. À ce titre, l’accent est mis sur la quantité de l’effectif que sur la qualité. L’université, tout en s’appuyant sur sa tradition académique, se met ainsi, dans la capacité de concurrencer, sur leurs propres terrains, les nombreuses écoles professionnelles supérieures qui ne cessent de se développer depuis un certain temps.
Tout compte fait, la communauté universitaire s’est largement faite complice de cette politique passablement à courte vue des pouvoirs publics. Certes, l’État assure tant que mal sa fonction régalienne, mais toujours est-il la croissance des effectifs des étudiants qui croit de façon exponentielle grève dans le temps, et davantage l’effort gouvernemental. On voit-là, une inadéquation entre le peu de moyens disponibles et l’afflux des étudiants dans ces « universités de masse » (N. Oblin, P. Vassort, 2005, p. 10). De l’avis de M. Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la Commission Économique pour l’Afrique (CEA), « dans de nombreux pays, les politiques nationales de promotion de la science et de la technologie sont périmées. La qualité de l’enseignement à l’université est également en baisse, en partie à cause du manque d’argent et d’infrastructures tels que laboratoires et centres technologiques modernes » (A. Janneh, 2010).
De tout ce qui précède, on peut inférer que l’université est soumise par le bas, à un afflux d’étudiants dont une très large part est éliminée dès le premier cycle. La surcharge de l’université en termes d’effectifs étudiants « de base », conduit à une exacerbation tous azimuts de sa crise endogène. Or, l’enseignement philosophique peut être un recours en termes de solution à cette dernière par son enseignement et surtout l’implémentation de ses principes théorico-existentiels et éthiques. La philosophie a besoin d’une université conforme à la rationalité qui est sa nature et l’éthicisation pour ainsi dire l’humanisation, sa fin dernière. Et une philosophie pour l’université, est en réalité, l’enseignement de la philosophie elle-même.
3. L’enseignement philosophique comme une solution à la crise universitaire
La philosophie pour l’université est celle qui répond à l’idée philosophique de l’université, qui dit sa nature et sa fin. L’université est le lieu où l’on va s’instruire de ce qu’on ignore, et non pas de ce qu’on sait déjà ou que l’on croit savoir. L’enseignement philosophique a réalisé sa fin quand l’étudiant, sachant bien ce qu’il sait, et donc aussi bien que le maître, peut se passer du maître. En effet,
tout enseignement suppose de transmettre du savoir, comme on se passe de la flamme olympique. De même que celle-ci doit rester allumée tandis que la torche passe de main en main, de même le savoir doit rester bien vivant si l’on veut que quelque chose soit effectivement transférée du professeur à l’élève. Quand le professeur n’a pas ou plus le ‘‘feu sacré’’, le meilleur élève du monde aura du mal à le rallumer afin de le transmettre à son tour. (Banner, Cannon, 2009, p. 4).
L’acte d’enseigner trouve son essence dans la dispensation du savoir. Il est dynamique et interactif, contrairement à l’exercice du pouvoir (dont la corruption) se mue en pouvoir d’assujettir. Parce que l’université a pour finalité d’instruire, c’est-à-dire d’inviter l’esprit au vrai, elle trouve dans la philosophie, non pas, son unique objet, mais l’accomplissement du cycle des études par lesquelles se forme et se structure le jugement. Il n’y a pas d’université véritable qui ne soit destinée à fortifier en l’homme ce qui l’élève à l’humanité, c’est-à-dire, contre toutes les formes et conséquences du principe d’autorité, le libre usage individuel de la raison, par quoi n’est jugé bon ou vrai que ce qui est reconnu comme tel. Dans la mesure où la philosophie se définit par la reconnaissance de la place éminente en droit de la raison dans l’homme, il est nécessaire que l’université fasse sienne cette reconnaissance. L’université qui se méfie de la philosophie ou la rejette, manque à sa vocation et renie sa nature.
En tout état de cause, la philosophie pour l’université est pour l’université dans sa vocation d’instruire. Celle-ci ce n’est pas celle d’une université adaptée aux circonstances sociales et professionnelles, qui par-là, manquerait à sa mission. Il n’y a pas de place pour la philosophie dans une université qui ne serait plus l’université, mais qui se disperserait au fil de l’événement qu’elle prétendrait épouser. Il est question cette université qui s’épuiserait dans la vaine entreprise d’égaler la division accélérée du travail et dans la futile obsession de la mode.
La philosophie tomberait au-dessous d’elle-même si elle tente, pour satisfaire à une université préoccupée de spécialisation et entièrement dévouée à la demande sociale du moment, de se subdiviser en parties dont chacune serait censée convenir plus particulièrement à telle orientation universitaire ou professionnelle. C’est le meilleur moyen de ne jamais rien savoir selon les règles et les méthodes requises par ce qui est à apprendre. L’on ne pourrait jamais rien savoir vraiment, mesurant ce qu’on croit devoir savoir à ce qui est supposé utile. On voit bien par-là, que l’empirisme utilitariste est ruineux pour l’instruction, et est d’ailleurs ruineux pour les professions. Cela, parce que l’obsession de l’adaptation à la vie obtient la raideur de l’étroite spécialisation, contraire à la souplesse qu’elle prétend viser.
Au demeurant, il faut rappeler que tout enseignement est disciplinaire. En fait, savoir quelque chose, c’est le faire selon sa nature qui commande une méthodologie précise nos superposable à celles d’un autre objet. C’est par un abus de langage et par une confusion du savoir avec le comportement vécu, qu’on pourrait prétendre que telle pratique courante, faisant intervenir plusieurs sciences, réalise une convergence interdisciplinaire. Les fondements théoriques d’une pratique ne sont pas nécessairement connus du praticien, et tout cas, ne peuvent être connus par leur seule mise en pratique. L’interdisciplinarité n’est pas dans la globalité d’un comportement. En son sens savant, ce terme désigne les relations théoriques entre plusieurs disciplines suffisamment avancées pour que puisse apparaître, sur des points particuliers, eux-mêmes strictement définis au plan théorique, une convergence ou un échange de principes ou de lois. L’interdisciplinarité est alors, l’affaire de spécialistes. On ne s’instruit pas au moyen de l’interdisciplinarité. Elle ne prend sens et contenu positif que pour quelques-uns de ceux qui sont déjà instruits.
En conséquence, il est clair que le mot ‘‘interdisciplinarité’’, tel qu’il apparaît dans le discours pédagogique aujourd’hui dominant, ne désigne rien qui ait quelque rapport avec les autres disciplines ni avec l’instruction. L’enseignement philosophique, autant qu’on puisse le supposer, tire son inspiration, non dans les exigences du savoir et dans la volonté d’instruire. Elle se ressource à la fois dans les postulats d’une psychologie comportementaliste, elle-même inductrice d’une pédagogie par objectifs, et dans le modèle clinique de l’équipe convergeant ses regards sur le cas de la crise à l’université.
L’enseignement philosophique peut être un complément ou un supplément au perfectionnement de l’enseignement à l’université. Conçue comme une discipline rigoureuse dont René Descartes, a d’ailleurs, donné les fondements dans ses Principes de la philosophie, la philosophie, telle que l’admettent Gilles Deleuze et Félix Guattari, crée des connaissances par des concepts. Elle permet, de surcroit, de rassembler les connaissances importantes dans diverses disciplines. Celles-ci, ajoutées pour l’occasion, à l’ordre des éléments, condition de l’intelligibilité et de l’acquisition du savoir, s’accumulent en une globalité syncrétique qu’elle aide à éclairer. « Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir, la médecine, la mécanique et la morale » (R. Descartes, 2002, p. 36). Cette image présente l’arbre philosophique comme la source principale des disciplines distinctes qui en constituent les parties.
On voit par-là les raisons pour lesquelles la philosophie ne saurait entrer, comme une discipline parmi d’autres, dans un projet interdisciplinaire auquel elle serait subordonnée et dont elle serait censée tirer la légitimité de son enseignement. En réalité, la philosophie n’est pas une discipline comme les autres. Elle n’est pas un savoir qui s’ajouterait, au même rang et au même niveau qu’eux, aux autres savoirs. Mais, la philosophie n’est pas, pour autant une connaissance d’objets. « […] tandis que le procès scientifique tourné vers le monde des objets, consiste en une méthode constructive, le procès philosophique, converti vers le sujet relève d’une méthode réflexive. La philosophie est une intention, une intention vers le sujet » (J. Vialatoux, 1973, pp. 63-64). Elle ne se confond avec aucune science et non pas comme une science se distingue d’une autre, parce que la somme des connaissances de tous ordres, démonstratives, expérimentales ou historiques, n’égale pas la philosophie. La connaissance des premiers principes n’est contenue dans aucune science, d’ombres des opinions et des images, ni dans une philosophie défigurée même dans la plus certaine, ni dans l’addition de toutes.
Les autres disciplines doivent entrer dans un projet d’interdisciplinarité avec l’enseignement philosophique qui, en réalité, doit pouvoir les intégrer à sa fonction de synthèse. En vérité, c’est la philosophie qui est l’interdisciplinarité elle-même, parce qu’elle fournit un faisceau d’informations sur un sujet, parce qu’elle permet au final, une véritable réappropriation des savoirs acquis. Sa manière de se tenir entre les disciplines est tout le contraire d’un prélèvement hétéroclite sur chacune d’elles.
Dans leurs efforts de définir la philosophie, G. Deleuze et F. Guattari (2011, p. 11) citent Nietzsche en ces termes : « les philosophes ne doivent plus se contenter d’accepter les concepts qu’on leur donne, pour seulement les nettoyer et les faire reluire, mais il faut qu’ils commencent par les fabriquer, les créer, les poser et persuader les hommes d’y recourir ». Le rôle de la philosophie est fondamentalement de générer les concepts. La fonction de l’enseignement philosophique est bien de produire la prise de conscience des problèmes posés par les autres savoirs, et de les rendre possible à l’intelligence. « Ce qui définit la pensée humaine, c’est d’être une pensée en activité de travail, une pensée comme disait Socrate, en effort de parution » (J. Vialatoux, 1973, p. 101). La fonction universitaire de la philosophie est de développer librement, et aussi loin qu’elle se peut, l’exercice de la raison. Elle ne saurait s’accommoder d’une université uniquement préoccupée aux circonstances, sans considération des lumières et du jugement qui font les esprits libres, et, en fin de compte, les meilleurs professionnels.
La philosophie est par excellence, une discipline de l’université parce qu’elle apprend à penser vigoureusement. Elle « n’est pas un simple art de former, d’inventer ou de fabriquer des concepts, car les concepts ne sont pas nécessairement des formes, des trouvailles ou des produits. Elle est, « plus rigoureusement, […] la discipline qui consiste à créer des concepts » (G. Deleuze, F. Guattari, 2011, p. 10). L’enseignement de la philosophie dont le déploiement sera le point nodal de la solution à la crise à l’université, est celui qui s’attèle fondamentalement à l’exercice de la pensée éthicisante et fruitive.
Conclusion
Au regard des causes à l’origine de la crise universitaire, on s’aperçoit que la trajectoire de cette prestigieuse institution est biaisée à force de compromissions. Pour y résoudre, la contribution de l’enseignement, fondamentalement axé sur une méthode universelle et polyvalente s’inspirant, en réalité du modèle philosophique, qui sait réemployer ses outils et les adapter à des tâches diverses, est essentielle. Par conséquent, l’enseignement philosophique n’est pas dénué de sens philosophique.
Sans doute, les questions de méthode, et de la méthode philosophique, sont-elles des questions philosophiques et des questions majeures, qui s’inscrivent, sans qu’il soit possible de les en séparer, dans la démarche philosophique elle-même. La méthode d’une démarche philosophique n’entretient pas avec celle-ci, le rapport de moyen à la fin. Il s’agit d’instruire de manière philosophique, en apprenant la méthode philosophique universelle. C’est de cette façon que l’enseignement philosophique libérera l’université de la crise.
Références bibliographiques
ABDOULIE Janneh, 2010, Allocution de bienvenue à la Deuxième Conférence sur le Partenariat scientifique avec l’Afrique, Addis-Abeba, Ethiopie, (Nations Unies, Commissions économique pour l’Afrique), https://www.uneca.org, consulté le 02 Juin 2022.
ARENDT Hannah, 2012, La crise de la culture, traduction de Patrick Lévy, Gallimard.
BANNER M. James, CANNON C. Harold, 2009, L’art d’enseigner, traduit de l’Anglais (États-Unis) par Marie-France Pavillet, Paris, Nouveaux Horizons.
BODIN Romuald et ORANGE Sophie, 2013, L’Université n’est pas en crise. Les transformations de l’enseignement supérieur : enjeux et idées reçues, Éditions du Croquant, coll. « Savoir/Agir », Revue européenne des sciences sociales [en ligne], 53-1, https://journals.openedition.org, consulté le 02 Juin 2022.
DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, 2011, Qu’est-ce que la philosophie ?, Normandie, les Éditions de Minuit.
DESCARTES René, 2002, Les Principes de la philosophie, Introduction et notes de Guy Durandin, Paris, Vrin.
DIBY Kouadio Augustin, 2016, « Programme de l’université citoyenne. Pour le rayonnement académique de l’UFR SHS », (Décanat), in L’exigence de qualité dans nos Universités, La palabre, Revue scientifique Numéro 1, tome 1, coordonné par Jean Patrice AKÉ, Abidjan, L’Harmattan.
HEIDEGGER Martin, 1987, L’auto-affirmation de l’université allemande, traduction Gérard Granel, Paris, TER.
JASPERS Karl, 2008, De l’université, Traduction de Lachaussée, Lyon, Parangon/ VS.
OBLIN Nicolas, VASSORT Patrick, 2005, La crise de l’université française : Traité critique contre une politique de l’anéantissement, Paris, L’Harmattan.
VIALATOUX Joseph, 1973, L’intention philosophique, Paris, PUF.
L’ENSEIGNEMENT DIALECTIQUE PLATONICIEN : UN GUIDE D’ÉDUCATION POUR L’EXCELLENCE UNIVERSITAIRE
Ange Allassane KONÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’éducation universitaire, notamment en Afrique, est en crise. Cette crise, apparemment scolaire, révèle un fondement éthique. Vouloir donc la résorber demande le dépassement de la question académique pour la prise en compte de sa dimension sociale. Ainsi, dans une analyse platonicienne, notre contribution vise, ici, à justifier comment, par l’enseignement dialectique, l’on pourrait potentialiser nos universités d’un intérêt à la fois scientifique et sociétal. S’inscrivant dans une réflexion métaphysique qui ouvre des perspectives éthiques, l’excellence éducative platonicienne, que nous proposons, se fixe un télos, une fin duale : elle prend pour finalité l’accès au principe anhypothétique de l’existence ; mais elle poursuit conjointement l’objectif d’éclairer et de construire la vie sociale par l’intelligence acquise par ce principe, c’est-à-dire le Bien.
Mots clés : Afrique, Crise universitaire, Éducation, Enseignement dialectique, Humanité, Idée de Bien, Vertu.
Abstract:
University education, especially in Africa, is in crisis. This apparently academic crisis reveals an ethical basis. Wanting to reduce it therefore requires going beyond the academic question to take into account its social dimension. Thus, in a Platonic analysis, our contribution aims here to justify how, through dialectical teaching, we could potentiate our universities with both scientific and societal interest. As part of a metaphysical reflection that opens up ethical perspectives, the Platonic educational excellence that we are proposing sets itself a telos, a dual end : its purpose is access to the anhypothetical principle of existence ; but it jointly pursues the objective of enlightening and building social life through the intelligence acquired by this principle, that is to say, the Good.
Keywords : Africa, Education, Dialectical teaching, Humanity, Idea of good, University crisis, Virtue.
Introduction
La crise multiforme que connaît l’université africaine, ces deux dernières décennies, et qui concerne à la fois la pertinence, la qualité, la gestion et le financement de l’enseignement supérieur, suscite des solutions à opinions politique, académique ou économique. Mais ces opinions, souvent déjà expérimentées, satisfont difficilement à la jugulation de cette crise. Raison pour laquelle nous prônons l’option d’une relecture plus éthique des divers problèmes de nos universités. Nous pensons que si nos universités ont perdu l’éclat de leur excellence académique et post-académique, c’est parce que la dimension éthique de leurs enseignements et de leur fonctionnement est légère. Aussi, abordée dans un raisonnement platonicien, cette question éthique s’explique-t-elle par la dialectique.
Les rapports entre les études universitaires et la société peuvent être comparés au raisonnement dialectique. Par la dialectique, en effet, les philosophes peuvent tourner leur regard vers le Bien pour le comprendre de la façon la plus rigoureuse possible, de manière à établir ensuite, ici-bas, les règles déjà établies. « En plus d’être spéculateur, le dialecticien est aussi praticien », diront L. Brisson et F. Francesco (2006, p. 182). Similairement, les études nous conduisent à un savoir acquis pour nous mettre ensuite au service de la société. Et si chez Platon la science dialectique était réservée aux philosophes, donc à une élite intellectuelle, notons qu’aujourd’hui l’Université pourrait être considérée comme ce creuset d’excellence scientifique. Alors comment promouvoir ou couronner cette excellence par une conduite morale exemplaire ? En d’autres mots, quel peut être l’apport de la dialectique platonicienne à la résolution de la crise universitaire ? Telle est la préoccupation centrale de notre argumentaire, qui suscite le questionnement suivant : comment justifier les raisons fondamentalement éthiques de cette crise ? Aussi, quel enseignement éthique la dialectique platonicienne peut-elle proposer à la résolution de ladite crise ?
Dans un raisonnement critico-analytique, il est question, ici, de proposer, selon la dialectique platonicienne, l’enseignement d’une conduite morale exemplaire, dans l’accomplissement de la vie universitaire. Telle est notre contribution au problème posé. Pour mener à bien une telle analyse, notre réflexion se fera suivant deux idées fondamentales : il convient de prime abord de réfléchir sur les causes morales de la déliquescence de nos universités ; puis d’analyser la finalité éthique de la pensée dialectique platonicienne qui pourrait contribuer à résorber la crise.
1. L’Université contemporaine africaine à l’école des sophistes
L’Université est un milieu académique où l’on travaille de manière systématique à la préservation, la recherche et la transmission de la connaissance au service de l’humanité. Mais cette vocation traditionnelle qu’elle s’est assignée révèle une actualité troublante, surtout en Afrique. Sur le modèle occidental, les universités africaines, de façon générale, vont connaître momentanément un essor pour présenter, aujourd’hui, une image critique. Dit plus simplement, nos universités sont en crise. Cette crise, nous la fondons sur le mépris de l’éthique sociale, comme les sophistes, au temps de Socrate, privilégiaient la connaissance dans son émergence pragmatique au détriment de son assise morale. Pour justifier ce fait, notre argumentaire, ici, va consister à démontrer, premièrement, comment nos universités se soucient plus des compétences pratiques des étudiants que de leur conduite morale ; puis montrer que la formation dans nos universités, sous le diktat de l’État et du marché professionnel, produit des automates sans se préoccuper de leur conscience morale ; la formation qui y est développée tend à marchandiser les étudiants plutôt qu’à les humaniser.
1.1. La professionnalisation de l’école universitaire africaine dans l’oubli de l’éducation sociale
Dans la continuité de l’objectif classique des universités occidentales, les premières universités africaines se sont consacrées à la conversation, à l’explication et à l’enseignement des connaissances théoriques en les embrassant comme une totalité. Ainsi, à l’époque coloniale, le fonctionnement de nos écoles supérieures réclamait, certes, beaucoup d’amélioration, mais la formation et la compétence des étudiants témoignaient d’une éducation à la fois professionnelle et morale. Des indépendances jusqu’en 1990, cette double éducation marquait encore de son empreinte nos institutions universitaires. Mais, depuis lors, un passage à vide se fait constater par la dégradation de la conduite morale des étudiants ; ce qui joue inéluctablement sur leur rendement universitaire.
Cette déchéance morale qui affecte nos écoles supérieures n’est pas nouvelle. Au temps de Platon, une déchéance similaire, par l’entremise des sophistes, menaçait l’enseignement reçu par la jeunesse athénienne. À travers plusieurs ouvrages tels que le Protagoras, le Gorgias ou le Sophiste, le disciple de Socrate fustige la conduite de ces rhéteurs malveillants. Présenté comme un professeur itinérant de l’enseignement supérieur, le sophiste loue, en effet, des salles et y donne des cours contre rémunération aux fils des aristocrates qui, à l’âge d’environ seize ans, ont terminé leurs études élémentaires. La qualité rhétorique des leçons de ce dernier n’est pas vraiment à plaindre ; le problème, c’est plutôt l’objectif visé : il est peu soucieux de la formation morale de ses étudiants. Il pousse ses disciples à la curiosité intellectuelle sans tenir compte du bien de la société tout entière. Aussi, à travers l’ouvrage qui porte son nom, le sophiste est-il identifié par Platon comme « celui qui possède une sorte de science de l’apparence sur toutes choses, mais non la vérité » (2011, 233d).
Comparables à l’école des sophistes, les universités africaines semblent tomber dans l’oubli de l’essentiel éducatif, c’est-à-dire l’éducation morale ; car confondre la fonction propre à l’école, qui est d’apprendre, et ses effets sociaux, conduit nécessairement à l’oubli ou au refus d’éduquer. L’éducation a, en elle-même, une signification sociale et politique essentielle : elle donne, à chacun, les moyens de se construire intellectuellement, pour ses intérêts propres, mais aussi de contribuer à la réalisation de la société à partir de la connaissance reçue. Rechercher le savoir, seulement pour soi, c’est prendre le risque d’oublier le devoir moral qui nous incombe dans l’essence de notre éducation.
Par ailleurs, à un niveau plus profond, la racine morale de cette crise de l’éducation apparaît révélatrice « d’une crise beaucoup plus générale et de l’instabilité de la société moderne » (H. Arendt, 1972, p. 238). Cette dernière a trait aux conditions mêmes de l’éducation dans une société démocratique de masse habitée par un processus d’égalisation et d’émancipation qui tend à penser ses membres, y compris les élèves et les étudiants, comme des individus autonomes et égaux. Désormais, il est interdit de voir les étudiants comme des élèves face au maître. Le maître peut réprimander, corriger ou même punir l’élève dans l’optique d’aiguillonner objectivement son savoir, mais l’enseignant ne peut pas se le permettre face à l’étudiant, parce que celui-ci est doté de droits inaliénables qui doivent être respectés. Ce respect ou cette reconnaissance de droits entre dans un rapport de contradiction à l’égard de la nécessité, sur le plan moral et sur le plan social, d’éduquer et d’instruire les étudiants pour qu’ils puissent devenir des personnes autonomes et vertueuses.
Pis, la dialectique hegelienne du maître et de l’esclave prend ici un sens nouveau. Dans les universités africaines, nos étudiants ont des syndicats qui ont un pouvoir de maître et d’autorité : ils ont le droit de faire des grèves, peuvent suspendre des cours en pleine séance sans être inquiétés, violenter leurs condisciples et même des enseignants au nom de leur liberté. L’État et les sections disciplinaires de nos écoles supérieures sont bien instruits de cette triste réalité, mais comment réagissent-ils ? Personne ne bronche. Le constat qui se fait est que nos étudiants ont pris goût de ce laisser-faire et n’hésitent pas à se forger une identité de guerrier, oubliant désolément leurs études. Désormais déconnectés de cette priorité estudiantine, l’on découvre que ces derniers, moralement, n’ont pas grandi et se comportent comme des enfants « gâtés ». Or, selon Hegel, toute authentique éducation « nous sépare d’avec nous-mêmes » (1990, p. 85) en nous arrachant au confort facile de l’enfance. Cet arrachement ne saurait se faire sans quelques redressements, pas pour faire mal, mais pour aiguillonner ou stimuler l’effort de recherche qui, souvent, fait défaut à nos apprenants.
En somme, retenons que la crise qui sombre nos universités révèle des raisons foncièrement morales. L’obsession du politique à former au nom de la compétence intellectuelle nous a fait oublier combien de fois le volet moral de l’éducation était essentiel. Ce constat, à caractère matérialiste, se justifie également à travers une formation universitaire à la solde du capitalisme marchand.
1.2. La formation universitaire à la solde du capitalisme marchand
L’université africaine, dans une vision capitaliste, se fait aliénante en se rendant dépendante de systèmes socio-professionnels, hors de ses prises de contrôle normatif scientifique. Elle se fait aliénante en privant ses apprenants des conditions permettant l’épanouissement de leur humanité, et en nuisant considérablement, par les monopoles de contrainte nouvelles qu’elle instaure, à leur capacité de développer une relation riche et réflexive au monde. De fait, nos universités entreprennent d’adopter des mécanismes de marché qui vont redéfinir pratiquement tous les aspects de la vie universitaire. L’étudiant n’est plus formé en tant qu’individu humain, c’est-à-dire un animal rationnel, mais il est plutôt construit ou fabriqué comme un outil, une marchandise pour la satisfaction des intérêts capitalistes du politique. Cette manière d’appréhender l’Université, dans une vision technocratique, suscite quelques inquiétudes : « Le technocrate de l’éducation n’est-il pas atteint de gestionite, cette maladie de notre époque matérialiste caractérisée par l’atrophie des idéaux ? Tout fonctionne, certes, tout tourne…dans le vide de tout projet humaniste » (L. Marion, 2015, p. 22).
L’Université, notamment en Afrique, a perdu ses repères éthiques. La formation, dans ses programmes éducatifs, semble privilégier l’avoir au détriment de l’être. Elle ne forme plus pour le bien-être moral de la société mais pour produire des instruments de production économiques. L’homme, intrinsèquement défini par la rationalité, se voit chosifié parce que mesuré en fonction des intérêts économiques et non humanistes. Or « évacuer toute vision de l’homme (des intérêts universitaires) reviendrait à consacrer la victoire totale de l’hédonisme marchand et à faire de nos écoles de simples boîtes à bachot dans un strict souci utilitaire » (L. Marion, 2015, p. 28). En d’autres termes, nos universités font fausse route quand elles interrogent la valeur de nos étudiants à travers leur seule contribution à la production économique. En empruntant ce chemin mirifique, elles prennent là le risque d’oublier l’essentiel de leur vocation : former la personne humaine de l’étudiant.
Le sens que l’on donne au mot « étudiant »’ est aujourd’hui problématique parce que les décideurs de la politique universitaire sont obsédés par le développement économique. Ainsi, les exigences de planification prennent trop souvent le pas sur l’humanité de l’étudiant. La technocratisation de nos universités contemporaines africaines semble faire l’apologie de l’éducation capitaliste au détriment de l’éducation humaniste. Dans l’élaboration des différents projets universitaires, l’on croit espérer l’humanisation de nos étudiants. Mais à y voir de près, ces projets ont un objectif plus capitaliste qu’éducatif. Le problème, ici, c’est que « le gouvernement veut que son investissement produise des résultats tandis que l’Université souhaite préserver son autonomie » (R. K. Auala, 1991, p. 6). Aussi, cette crise éthique se fait cruciale lorsque les étudiants eux-mêmes se laissent entraîner par ces projets capitalistes.
On constate, en effet, que ces derniers accordent la plus grande importance à l’obtention des diplômes et négligent de ce fait l’intérêt scientifique des modules d’enseignement choisis. L’objectif à atteindre ici n’est pas forcément le savoir, comme au temps de l’Académie ou du Lycée, mais plutôt l’accumulation des diplômes, peu importe les moyens (la facilité, la corruption, la tricherie ou la commercialisation des notes). Chaque étudiant veut réussir, a priori, non ses études, mais sa vie. Et réussir sa vie signifie avoir du travail. Vraisemblablement, on vient à l’université, avec pour objectif premier d’obtenir un emploi, même s’il faille passer par une formation détournée et peu vertueuse. Or, l’Université n’est libératrice qu’à condition qu’on y considère l’instruction comme une fin en soi et non pas simplement comme un moyen. Car, en vérité, l’Université devient un échec lorsqu’on n’y voit plus qu’un ascenseur social, d’autant qu’un ascenseur qui monte sans jamais redescendre n’est pas un idéal mais au mieux une illusion. Alors ne soyons pas étonnés qu’elle ne marche pas. Autrement dit, il ne faudrait pas rêver une société où tout le monde deviendrait fonctionnaire d’État, mais bien au contraire, nous devons espérer que le plus ignorant des hommes puisse s’instruire et vivre dignement, quelque tâche qu’il remplisse dans la société.
Ainsi, nos « universités doivent décider si leur tâche consiste à transmettre aux étudiants l’amour pour ce qui est fondamental et créateur, et s’interroger sur le développement et l’utilité de la science et des diverses manières de remplir leur mission de service » (A. C. Borrero, 1995, p. 205). Il est vrai que le contexte international, caractérisé désormais par la globalisation des marchés, a créé un monde économique de plus en plus compétitif qui confère désormais à la connaissance un rôle hautement stratégique. Cependant, n’empêche que la formation universitaire tienne compte de la dimension éthique pour le salut de nos sociétés, menacées par tout type de conduites immorales. Car l’éducation véritable ne saurait se réduire à la transmission unilatérale d’un esprit du temps, qu’elle contribue en effet toujours librement à former ou à infléchir par ses choix propres, contre toutes les réductions professionnelles, contre toutes les orthodoxies fantasmées. Aussi les injonctions de l’insertion sociale, ou celles des préjugés de l’époque, doivent-elles toujours demeurer sous condition pédagogique. C’est partant d’une telle vision que l’Université pourra se définir comme instance d’accomplissement de l’humain.
2. L’université comme instance d’accomplissement de l’humain
Dans le premier argumentaire de notre analyse, nous avons tenté de dévoiler les fondements éthiques de la crise qui secoue les universités africaines. Dans ce second argumentaire, nous proposerons la vision espérée des universités africaines, à partir des pensées dialectique et civique platoniciennes. Plus précisément, il s’agira premièrement de montrer que la condition nécessaire et suffisante de toute éducation est la visée du bien pour, ensuite, justifier son intérêt civique ; s’il est vrai que Platon statue « sur la vie pratique des citoyens en insistant sur l’éducation qui constitue l’essentiel de l’édifice (de la cité idéale) » (H. Soumet, 2020, p. 210).
2.1. De l’objectivation de l’éducation par l’enseignement dialectique platonicien
La formation éducative, chez Platon, vise un dessein à la fois singulier et pluriel ; singulier parce qu’il concerne l’individu ; pluriel en ce sens qu’il s’intéresse à la société tout entière, et parce qu’une société est vertueuse lorsque les individus qui la composent sont correctement éduqués. C’est pour cette raison que l’Université africaine doit s’interroger sur les valeurs humaines qui devront orienter son action éducatrice, car l’éducation universitaire, comme au temps de Platon, n’est pas en panne de régulation mais d’orientation. Chez le Maître de l’Académie, cette orientation devra se faire en direction de l’idée du Bien, d’où l’importance de l’exercice dialectique.
Dans le Sophiste, Platon (2011, 253c 4-5) souligne que « l’expression la plus parfaite de la connaissance humaine se réalise dans la science dialectique comme science suprême ». Aussi, l’enseignement dialectique, développé à travers la pensée platonicienne, consiste-t-il à transcender les données empiriques pour parvenir, dans la recherche de la vérité, à quelque chose d’absolu, d’ultime et de fondateur. À la fin du livre VI de la République, cet enseignement conduit à la contemplation des êtres ou Idées au sommet desquelles l’on aperçoit l’Idée du Bien qui est la plus haute des connaissances, celle par qui « les choses justes et les autres choses vertueuses sont utiles et bénéfiques (Platon, 2011, 505a). Et c’est justement par l’appréhension de la connaissance du Bien que l’on devra penser l’éducation dans nos universités. On comprend ainsi que, selon Platon, l’éducation n’a d’autre objectif que de bien orienter le regard de l’âme des apprenants ; c’est-à-dire de la détourner des perspectives fugaces du devenir vers les formes immuables du Bien.
Incontestablement, on dira que le Bien est la chose ou l’intérêt premier que doit viser la formation universitaire, pour le bien de nos étudiants et pour le bien de nos sociétés. Par la recherche du Bien, nos établissements universitaires pourront transmettre aux étudiants un idéal de savoir et de vie. Sinon à quoi sert-il d’être savant si c’est pour se révéler, par la suite, être un monstre pour sa société ? Quelque soit le domaine d’étude ou de recherche de nos apprenants, il faudrait qu’ils comprennent que le savoir, limité à l’appréhension sensible ou théorique, ne se suffit pas. Il faudrait plutôt qu’il s’enracine en eux et pour faire un avec leurs âmes. Dit autrement, « si nous ne connaissons pas la forme du bien, dussions-nous connaître au suprême degré toutes les choses qui existent en dehors d’elle, (…) cette connaissance ne nous servirait à rien, de même que nous ne possédons rien sans la possession du bien » (Platon, 2011, 505 a). Il ne sert absolument donc à rien d’avoir une connaissance d’expert en toute chose et ne pas avoir la connaissance du bien que révèlent les choses. Il n’y a absolument aucun avantage à posséder toute autre chose dans le monde, excepté ce qui représente pour l’homme l’essentiel existentiel, c’est-à-dire le bien.
Cependant, si la dialectique est recommandée pour accomplir l’éducation de nos étudiants, notons que sa finalité est de mettre à la disposition de la société des personnes scientifiquement et moralement bien formées. À en croire Platon, celui qui a contemplé les Idées au sortir de la Caverne « saura tout à la fois mieux voir et mieux juger. L’Idée lui sert en effet de point fixe – qui, en tant que tel, n’est pas soumis aux vicissitudes des choses humaines et au pouvoir défaisant du temps – pour évaluer les actes et les hommes, les occupations et les habitudes, les discours et les opinions » (Luc B. et Francesco F., 2006, p. 8). Ceux qui sont éduqués dans l’éclairage de ce savoir sont, par conséquent, en mesure de transposer aux habitudes humaines, publiques ou privées ce normatif que leur offre leur vision théorique des êtres noétiques, couronnés par l’Idée du Bien. Ainsi, « l’éducation d’un étudiant ne devrait pas consister en des projets conçus uniquement en vue de l’exécution de certaines tâches, sans égard au développement spirituel, intellectuel et moral de la personne » (A. B. Cabal, 1995, p. 111). L’enseignement universitaire a aussi une fonction éthique : la finalité des études n’est pas seulement l’orientation du regard vers le Bien, mais aussi la constance de cette orientation, c’est-à-dire l’acquisition par l’étudiant d’une certaine assiduité et régularité à l’image du Bien qu’il étudie. En cela, la posture de l’étudiant doit être adéquate à l’objet même de son étude.
Enfin, notons qu’avec Platon, le bénéfice réel de l’étude du monde physique n’est pas de s’en tenir à la vision extérieure, mais bien de s’éveiller à la réalité du Bien qui se situe au-delà de toute exigence individualiste ou matérialiste. Et s’il faille comparer l’étudiant à l’amoureux du savoir, alors l’on dira que « le savoir ne suffit pas en quelque sorte à faire le philosophe, mais il se présente toujours accompagné d’une disposition affective orientée vers l’action et la vie » (Luc B. et Francesco F., 2006, p. 101). Aussi, retenons-nous que nos étudiants doivent être instruits selon le Bien pour que la société soit juste. Car, si la dialectique ascendante conduit à la connaissance du Bien, la dialectique descendante, elle, appelle à se mettre au service de la société, puisque notre réflexion désormais est gouvernée par une exigence éthique, celle de la justice.
2.2. L’éducation civique ou le couronnement de la formation universitaire
Le désir d’éduquer les étudiants selon une formation dialectique ne saurait être une fin. L’éducation scientifique doit servir de fondement à l’éducation civique. En effet, à travers les Lois de Platon, L. Brisson (2006, p. 17), dans son introduction, relève un code civil construit à la manière d’une organisation totale : « Le souci de former les citoyens à la vertu, de privilégier une vie amicale faite de paix et de réflexion, (…) de favoriser encore cette vie commune et heureuse qui n’est accessible qu’à des citoyens formés à la fois à la santé du corps et aux exercices de l’âme ». Sans aucun doute, la question de l’instruction devient désormais une affaire sociale et donc politique.
Dans la perspective de l’éducation civique platonicienne, la réflexion pédagogique laisse entrevoir deux idées essentielles : les fondements anthropologique et politique de l’éducation. Anthropologique parce que fondée sur une conception objective de la nature humaine ; et politique parce qu’elle vise au final la bonne organisation de la société. Partant de cette analyse, l’on comprend que l’éducation civique consiste, d’une part, à rendre l’homme vertueux, et d’autre part, à l’humaniser en tant que citoyen. Dans cette vision, la formation éducative de l’étudiant, chez Platon, ne consiste pas forcément à le rendre rationnel, mais à faire en sorte que son instruction, dans l’objectivation de ses désirs les plus divers, soit en accord avec ce qu’exige la vertu, qui se décline, en vérité, en la justice interpersonnelle et en la justice sociale. Ainsi, on dira qu’éduquer, c’est rationaliser ou c’est tendre « à introduire la raison dans les affects » (Luc B. et Francesco F., 2006, p. 204). Et pour atteindre ce but, l’enseignement, à l’Université, doit donner à la vertu une force législative.
L’enseignant, chez Platon, doit se faire législateur. En ce sens, « légiférer, c’est donc éduquer, c’est-à-dire façonner l’âme des citoyens » (Luc B. et Francesco F., 2006, p. 206). Le principe de la citoyenneté établit explicitement un rapprochement entre l’éducation et la législation, car une bonne éducation doit prendre la forme d’une loi, c’est-à-dire avoir une validité absolue et à vie. Le respect d’un tel principe est ce qui donne à l’éducation sa valeur civique. C’est elle la véritable base de l’ordre social ; par elle, chaque citoyen apprend à connaître, à aimer, et à accomplir ses devoirs pour le bien de la société. Et nous estimons que c’est cette éducation qu’il faut transmettre aux étudiants.
Vu le niveau d’agressivité des étudiants (justifiée par des conflits entre différentes factions syndicales), leur penchant pour le gain facile ou encore leur esprit matérialiste, si la formation universitaire ne tient pas compte de leur instruction civique, il y a là le risque que nous formions des automates sans conscience morale véritable. C’est pourquoi, les universités africaines doivent évaluer avec un esprit critique les valeurs éthiques fondamentales de leur culture pédagogique, en les rapportant aux intérêts de la justice sociale. C’est ainsi qu’elles sortiront de la crise dont elles souffrent actuellement. Aussi, devront-elles développer une pensée théorique, qui tient compte des valeurs épistémiques essentielles pour l’exercice de la raison et de l’épanouissement moral, afin d’espérer de nos étudiants une intelligence à la fois scientifique et civique.
Par ailleurs, outre sa fonction traditionnelle et ses obligations d’enseigner et de faire progresser le savoir par l’entremise de la recherche, l’Université africaine doit « former l’Homme ‘’intégral’’ pour l’édification de la nation ; faire apparaître au fil des ans un véritable modèle africain d’enseignement supérieur voué au progrès de l’Afrique et de ses habitants, tout en favorisant un lien de parenté avec la société humaine au sens le plus large » (A. A. Taiwo, 1991, p. 2). Car si la transmission du savoir peut bien apparaître comme une nécessité de nature, notons que l’éducation universitaire implique pour sa part de concevoir que cette transmission vise une finalité morale. Que cette transmission concerne les sciences, les techniques, les mœurs ou les coutumes, il convient qu’elle s’inscrive dans l’horizon d’une délibération morale sur le bien de l’ordre social, hors de laquelle il n’est point d’éducation.
En conclusion de ce point argumentatif, l’on retient que, chez Platon, la « priorité n’est pas que le savoir émancipe les individus, mais qu’il permette de les intégrer dans le tout de la Cité » (R-P Droit, 2018, p. 88). Il s’agit ici d’une pensée centrée sur l’homme, notamment sur les problèmes éthiques auxquels celui-ci doit faire face. Les questions de justice et de la place de l’individu dans la société font partie de cette problématique éthique qui préoccupe Platon au plus haut point. Ainsi, la fonction rectrice de l’éducation universitaire doit conduire l’étudiant de son émergence scientifique à des styles de vie qui concourent aux exigences de la justice sociale. « Ces styles de vie doivent s’inspirer de la sobriété, de la tempérance, de l’autodiscipline, sur le plan personnel et social (Conseil Pontifical Justice et Paix, 2007, p.256).
Conclusion
Plusieurs réformes ont été initiées pour tenter de faire face aux multiples problèmes qui minent le secteur de la formation universitaire, mais cette crise persiste au point où la situation éducative est communément décrite comme un univers de désolation. Au-delà des propositions pédagogiques, politiques ou encore technocratiques, nous pensons qu’il faudra aussi revoir la dimension morale de la formation universitaire de nos apprenants pour rendre effective la refondation de l’Université africaine dans un contexte mondial où le savoir est devenu l’enjeu majeur du développement.
Et si B. Fauconnier pense que « l’éducation est l’affaire de tous, et (que) c’est à l’État de s’en charger » (2019, p. 224), notons que la mission existentielle de nos universités doit, au-delà de l’intelligence scientifique, viser l’intelligence éducative et humaniste. Elles doivent ainsi élever les apprenants à l’appréhension du Bien afin de les disposer à les rapporter aux habitudes sociales. Par la formation dialectique platonicienne, l’éducation universitaire, en Afrique, doit se faire scientifique mais aussi sociétale ; c’est-à-dire apprendre à connaître le Bien pour le reproduire dans nos habitudes interhumaines ; car si « le but immédiat [de l’éducation] est la réforme des esprits, par la purification intellectuelle, la recherche scientifique, et l’ascension progressive vers la vérité totale » (A. Diès, 1930, p. 106), son accomplissement, lui, implique « une aptitude à connaître le monde et à pouvoir s’y situer, une aptitude à gouverner la cité et ses concitoyens, fondée sur la connaissance du juste, et une aptitude enfin à bien vivre, en prenant soin de soi-même de telle sorte que ce que nous sommes en propre, une âme susceptible d’intellection, trouve à s’épanouir » (L. Brisson et Francesco F., 2006, p. 103).
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 1972, La crise de la culture, Paris, Gallimard.
AUALA R. K., 1991, « Current Main Trends and Issues Facing Higher Education in Africa », exposé présenté lors de la Consultation d’experts sur les tendances futures et les défis de l’enseignement supérieur en Afrique (28 février-1er mars 1991, Dakar, Sénégal), Paris (France), Unesco.
BRISSON Luc, FRANCESCO Fronterotta, 2006, Lire Platon, Paris, PUF.
CABAL Alfonso Borrero, 1995, L’Université aujourd’hui, Paris, Editions Unesco.
Conseil Pontifical Justice et Paix, 2007, Compendium de la doctrine sociale de l’Église, Abidjan, Paulines Éditions.
DIES A., 1930, Platon, Paris, Flammarion.
DROIT Roger-Pol, 2018, Et si Platon revenait…, Paris, Albin Michel.
FAUCONNIER Bernard, 2019, Platon, Paris, Gallimard.
HEGEL Friedrich, 1990, Textes pédagogiques, Paris, Vrin.
GIOL F., 2009, Lectures contemporaines de la crise de l’éducation, Paris, L’Harmattan.
KI-ZERBO Joseph, 1990, Eduquer ou périr, Paris, L’Harmattan.
MARION Louis, 2015, Comment exister encore ?, Montréal, Les Éditions Ecosociété.
PLATON, 2011, La République, in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Georges Leroux, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Le politique,in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Luc BRISSON et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion.
PLATON, 1969, Le Sophiste, Trad. Émile Chambry, Paris, Édition Flammarion.
PLATON, 2006, Les Lois, in Œuvres complètes, Trad. Luc BRISSON et Jean-François PRADEAU, Paris, Édition Flammarion.
SOUMET Hélène, 2020, Platon à la plage, Malakoff, Dunod.
TAIWO, A. A., 1991, « Innovations and Reforms in Higher Education in Africa : An Overview », exposé présenté lors de la Consultation d’experts sur les tendances futures et les défis de l’enseignement supérieur en Afrique (28 février-1er mars 1991) Dakar, Paris, Unesco.
AUTODÉTERMINATION DES PEUPLES ET CENSURE : LA FONCTION DE L’UNIVERSITÉ SELON KANT
Amidou KONÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Kant est un philosophe réputé pour la défense des droits et libertés. Mais si Kant défend tant la liberté, ce n’est jamais que pour la voir au service de l’émancipation et du progrès de l’humanité conformément à la dimension éthique et culturelle des Lumières. Dans ces conditions, il est inconcevable que l’autodétermination des peuples, qui passe pour le versant collectif de l’autonomie individuelle chère à Kant, se mette au service de la censure et de l’auto asservissement. Cette situation contrarie l’esprit des Lumières dont la mise en œuvre devra s’appuyer sur le rayonnement de la culture à travers l’institution universitaire et sur la sagacité de la philosophie. Il appartient dès lors, au philosophe, dans un contexte d’absolu désintéressement, favorable à la liberté d’opinion et d’expression, de veiller et de surveiller l’autodétermination du peuple tout en l’invitant à la responsabilité.
Mots clés : Autodétermination, autonomie, censure, culture, liberté, Lumières, philosophie, université.
Abstract:
Kant is a philosopher known for defending rights and freedoms. But if Kant defends freedom so much, it is only to see it at the service of the emancipation and progress of humanity in accordance with the ethical and cultural dimension of the spirit of Enlightenment. Under these conditions, it is inconceivable that the self-determination of peoples, which is considered to be the collective aspect of the individual autonomy dear to Kant, should serve censorship and self-serving. This situation contradicts the Enlightenment, whose implementation should be based on the influence of culture through the university institution and on the sagacity of philosophy. It is therefore for the philosopher, in a context of absolute disinterestedness, in favour of freedom of opinion and expression, to watch over and monitor the self-determination of the people while inviting them to responsibility.
Keywords : autonomy, censorship, culture, enlightenment, philosophy, freedom, self-determination, university.
Introduction
À la fois attitude de pensée et période renvoyant à l’histoire de la culture européenne correspondant au XVIIIè siècle, le Siècle des Lumières est marqué par un ensemble de courants philosophiques, scientifiques et littéraires, ainsi que par la critique de l’ordre social et de la hiérarchie religieuse. Il privilégie les rôles de la raison, de la réflexion personnelle et du progrès scientifique comme sources d’accès à la vérité et à la liberté dans un espace d’expression publique. Conformément aux idéaux des Lumières dont il est un des dignes défenseurs, Kant prône l’affranchissement de l’individu de toute forme d’asservissement par l’inculcation et l’appropriation du concept clé de l’« autonomie ». Cependant, nous savons, depuis Aristote, que l’homme ne vit pas seul et doit nécessairement compter sur la présence de congénères avec qui il fait société. Partant de là, que vaut l’autonomie reconnue à l’individu si elle était niée au peuple et à la collectivité qui l’englobe ?
Pour J. Gibelin (1948, p. IX-XV) qui se prononce sur l’œuvre de Kant relativement à l’autonomie de la conscience morale, « il était facile de constater l’insuffisance de cette philosophie purement individualiste ; le système exigeait nécessairement comme complément une doctrine politique » consistant dans l’examen des conditions suivant lesquelles les États pourraient vivre en paix entre eux en évitant toute annexion ou toute domination confiscatoire des libertés individuelles et publiques. Ainsi, « aucun État ne doit s’immiscer (…) de force dans la constitution et le gouvernement d’un autre État » (Kant, 1948, p. 8). Ce cinquième article préliminaire de la paix perpétuelle fonde le principe de l’autodétermination des peuples. Ramenée au contexte des Lumières, Kant imprime à l’autodétermination une signification particulière qui est la capacité d’un peuple à s’éclairer davantage, à aspirer à plus de lumières, en s’éloignant constamment de l’obscurantisme. L’autodétermination postule, en effet, la prise en main d’un peuple par lui-même et sa capacité à s’administrer librement.
Cependant, peut-on admettre que la liberté soit au service de l’autocensure entendue comme le renoncement aux Lumières ainsi que de l’asservissement au moment où l’asservissement doit justement aiguiser la conscience de la liberté et de l’autodétermination ? Tel est le problème central de la présente contribution. Nous pensons ici à bon nombre de pays du tiers-monde, notamment africains, qui ont subi le joug de la colonisation, et qui, une fois après avoir accédé aux indépendances chargées d’espoirs pour leurs peuples respectifs, n’ont pas toujours eu des gouvernants à la mesure des leurs aspirations. Ils ont donc déchanté et continuent de claudiquer sur le chemin du développement et de l’émancipation. L’intention fondatrice consiste à soutenir avec Kant qu’un peuple ne saurait, à bon droit, faire mauvais usage de sa liberté et décider de rester dans l’obscurantisme en faisant obstacle à l’émergence de nouvelles lumières. Il appartient donc à l’intellectuel, au savant éclairé, à l’universitaire et notamment au philosophe, jouissant de sa liberté d’opinion et d’expression, de veiller et de surveiller la liberté du peuple conformément à la conscience éthique et culturelle des Lumières. Comment dès lors, appréhender le droit à l’autodétermination ? Comment à partir de là et de l’esprit des Lumières, parvenir à réconcilier les peuples décolonisés et désillusionnés avec la liberté et le développement ? En ayant recours à la méthode exégétique appliquée au texte kantien « Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ? », ainsi qu’à la méthode analytique, nous commencerons par présenter le droit à l’autodétermination avant de nous intéresser à la mise en œuvre des Lumières au regard d’un tel contexte.
1. Présentation du droit à l’autodétermination
Le droit à l’autodétermination s’articule autour de deux points nodaux qui mettent en évidence son caractère fondamental d’une part et son caractère inaliénable d’autre part.
1.1. L’autodétermination, un droit fondamental
Le droit à l’autodétermination des peuples, loin d’être accidentel dans la philosophie kantienne, est une conséquence logique et rigoureuse du principe de l’autonomie reconnue à l’individu dans la philosophie morale de Kant. Celle-ci prend appui sur la conscience humaine qui demeure essentiellement rationnelle. Contrairement à la philosophie théorique, dans la philosophie pratique et en ce qui concerne la morale notamment, la raison se trouve être à la fois sujet et objet de l’action. C’est le sens de l’autonomie de la volonté qui légifère à partir des principes rationnels, pour ordonner au sujet de faire ce qu’il doit, en faisant taire ses penchants sensibles. Autrement dit, l’obligation morale, chez Kant, invite le sujet à agir par devoir en se conformant à l’impératif catégorique qui ordonne sans condition. Kant (1994, p. 156-157) énonce le principe de l’autonomie au cœur de sa philosophie morale comme suit :
Il n’est maintenant plus surprenant, si nous jetons un regard en arrière sur toutes les tentatives qui ont pu être faites pour découvrir le principe de la moralité, que toutes aient nécessairement échoué. (…). J’appellerai donc ce principe, principe de l’AUTONOMIE de la volonté, en opposition avec tous les autres principes, que pour cela je mets au compte de l’HÉTÉRONOMIE.
Si l’individu, au regard de l’autonomie reste fidèle à lui-même en se laissant conduire par la raison, il en va différemment de l’hétéronomie qui aboutit à le disqualifier d’un tel statut et à le mettre sous la domination des mobiles sensibles. Il en résulte alors une sorte d’assujettissement que cherche à prévenir à juste titre le principe de l’autodétermination des peuples. « Or [fait remarquer A. Lagarde], l’individu n’est pas une chose mais une personne dont la dignité passe par le respect des choix qu’il entend assigner à sa vie. Ce qui vaut également pour les peuples et frappe par conséquent d’illégitimité leur annexion possible par un autre État » (A. Lagarde, 1988, p. 15). Cependant, il suffit de se référer à l’article 5 des conditions préliminaires de la paix perpétuelle pour présumer cette dimension émancipatrice de l’autodétermination. En effet, celui-ci dispose qu’« aucun État ne doit (…) s’immiscer de force dans la constitution et le gouvernement d’un autre État ». (Kant, 1948, p. 8). Poursuivant, Kant (1948, p. 8) estime que « cette ingérence de puissances étrangères serait une lésion des droits d’un peuple luttant seulement contre son mal intérieur, et ne dépendant d’aucun autre ; ce serait bien là donner lieu à un scandale et rendre incertaine l’autonomie de tous les États ». Fort d’une telle précision, J. Lefebvre (1985, pp. 5-46) peut nous faire partager ce qui suit :
Le cinquième article a une portée d’avenir considérable. Il énonce clairement le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, et par voie de conséquence implicite, celui de l’autodétermination des peuples, principes qui sont devenus, du moins théoriquement, la ligne de conduite des diplomaties au XXe siècle.
Comme on peut l’apercevoir, la teneur du concept de l’autodétermination des peuples, qui fonctionne comme une sorte de réplique collective de l’autonomie individuelle, postule la prise en main d’un peuple par lui-même et sa capacité à ne dépendre d’aucune autre entité politique. Ainsi, un peuple autodéterminé, à l’instar des individus, se voit érigé en sujet autonome se donnant à lui-même ses propres règles suivant des exigences exclusivement rationnelles. Kant (1993, p. 232) qui nous donne des indications en s’inspirant de l’exemple des peuples colonisés, fait habilement la distinction entre « la métropole [et] l’État qui est pour ainsi dire la fille de la métropole <Tochterstaat>, la colonie, est soumis à la souveraineté de celle-ci, bien qu’il se gouverne par lui-même (…). Telles furent diverses îles par rapport à Athènes et telle est actuellement l’Irlande par rapport à la Grande-Bretagne ».
Cette situation qui met en cause la domination étrangère fait écho à l’actualité sur le continent africain marquée par des revendications populaires de plus en plus hostiles à l’ancienne métropole française et tendant à dénoncer, plusieurs décennies après les indépendances, son ingérence dans la gestion interne des États concernés. Il en va ainsi des rapports entre la France et des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée pour s’en tenir à l’Afrique de l’ouest. Ces illustrations mettent l’accent sur le fait que des peuples donnés se trouvent amputés d’une partie de leur souveraineté en raison de la mainmise exercée par la métropole. Or la souveraineté est soit exclusive soit elle ne l’est pas. En conséquence, une telle souveraineté pour ainsi dire partagée ou sous surveillance affecte immanquablement le droit à l’autodétermination des peuples concernés. D. Losurdo (1993, p. 127), pour sa part, tout en livrant son jugement sur l’exemple irlandais, fait observer ce qui suit :
Les termes qu’utilise Kant, « État-fille » (Tochterstaat) et « État mère » (Mutterstaat) soulignent la dureté de la condamnation de l’Angleterre à propos de la question irlandaise. Kant [renchérit-il], ne déclare-t-il pas que le « gouvernement paternel » qui traite ses sujets en « enfants mineurs » constitue « le plus grand despotisme concevable » ? En ce cas, c’est toute une nation, et une nation européenne, qui est privée de ses droits. Un acte absolument dénué de justification.
S’il en est ainsi, c’est que le droit à l’autodétermination, loin d’autoriser toutes les turpitudes, doit être dans l’entendement de Kant, un droit exigeant et éthiquement marqué par l’esprit des Lumières.
1.2. L’autodétermination, un droit inaliénable
Le droit à l’autodétermination postulé par Kant est un droit inaliénable et éthiquement marqué par l’esprit des Lumières que Kant (1947, p. 46) définit comme suit : « (…) La sortie de l’homme de sa Minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui (…) ». En tant que tel, le droit à l’autodétermination conjure sans cesse l’obscurantisme et tend résolument à plus de liberté. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un peuple dispose du droit de se déterminer soi-même et de définir souverainement le contenu de cette “autodétermination” qu’il lui serait loisible pour autant de s’asservir. Ici encore, l’analogie avec l’individu, sujet autonome qui ne saurait délibérément renoncer à sa dignité, reste valable. Aussi, Kant (1993, p. 213) pouvait-il dénoncer les clauses de service indéterminées par lesquelles les Africains servaient dans les plantations d’Amérique à la manière d’un homme qui « s’est réellement livré à son maître comme propriété ».
Aussi, un homme ne saurait-il délibérément renoncer à sa liberté et continuer de revendiquer un tel statut alors même qu’il s’est renié. Il en va strictement de même pour les communautés aux termes du deuxième article préliminaire de la paix perpétuelle qui dispose que « Nul État indépendant (petit ou grand, peu importe ici) ne pourra être acquis par un autre État, par héritage, échange, achat ou domination ». (Kant, 1948, p. 4). Au-delà des variables que reflètent les différents modes d’acquisition caractéristiques d’un assujettissement par un État tiers et qui pourraient éventuellement prendre la forme d’un auto asservissement du fait ou des turpitudes d’un peuple donné, ce que l’article semble plaindre par-dessus tout, c’est la constante relative à la perte de la dignité dudit peuple ou de l’État en question. Pour Kant (1948, pp. 4-5) en effet, « un État, (…), n’est pas (comme par exemple le sol où il est établi) un avoir (patrimonium). C’est une société humaine et nul autre que lui n’a le droit de lui imposer des ordres et d’en disposer. »
Aussi apparait-il clairement qu’un peuple, au nom de la dignité qui est le sien, ne saurait légitimement être conquis par un autre et encore moins s’auto-asservir d’autant que « pour ces lumières, il n’est rien requis d’autre que la liberté ; et à vrai dire la liberté la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines ». (Kant, 1947, p. 48). Partant de là, l’autodétermination surtout dans le contexte des Lumières, ne saurait admettre ce qui s’assimile à une véritable aberration, à une suprême turpitude consistant pour un peuple à opter pour la minorité en mettant sa liberté au service de son auto-assujettissement. Pour Kant (1947, p. 51) en effet,
Un siècle ne peut pas se confédérer et jurer de mettre le suivant dans une situation qui lui rendra impossible d’étendre ses connaissances (particulièrement celles qui sont d’un si haut intérêt), de se débarrasser des erreurs, et en général de progresser dans les lumières. Ce serait un crime contre la nature humaine, dont la destination originelle consiste justement en ce progrès.
Tout contrat de ce genre portant autocensure ne peut être que frappé de nullité : « Je dis que c’est totalement impossible. Un tel contrat qui déciderait d’écarter pour toujours toute lumière nouvelle du genre humain, est radicalement nul et non avenu ; quand bien même serait-il entériné par l’autorité suprême, par des Parlements, et par les traités de paix les plus solennels ». (Kant, 1947, p. 51). Parlant justement de contrat et d’auto asservissement, comment ne pas penser ici aux accords intervenus entre les anciennes puissances coloniales et les États qui les ont succédés concernant des concessions de diverses natures et dont les termes paraissaient manifestement désavantageux pour lesdits États. L’exemple récent de la junte malienne, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta menaçant de dénoncer lesdits contrats et de se tourner vers des partenaires russes en lieu et place des français, est assez évocateur.
Logiquement dérangeant, un tel contrat est à la foi éthiquement maladroit et donc absurde. Il est logiquement dérangeant pour la simple et bonne raison qu’il fait un mauvais usage de l’autodétermination en le mettant au service de l’auto-asservissement et de la régression. Il est éthiquement maladroit parce que les Lumières postulent indéfiniment le recul de l’obscurantisme et l’accroissement ininterrompu du savoir et du progrès. L’autodétermination en tant que droit inaliénable, devrait normalement et spontanément aller dans le sens des Lumières qui ne sont pas moins exigeantes. Toute distorsion entre les deux en appelle donc à la nécessité d’une mise en œuvre des Lumières.
2. Liberté et mise en œuvre des Lumières
L’autodétermination, livrée à elle-même, plutôt que de promouvoir la régression, doit être conforme à l’esprit des Lumières en visant résolument le progrès. Cette aspiration à la liberté et à l’émancipation passe nécessairement par la lutte contre l’ignorance et l’obscurantisme. L’institution universitaire et le rayonnement de la culture, d’une part, ainsi que la philosophie et la promotion de la pensée critique autonome d’autre part, s’inscrivent dans cette tendance.
2.1. Kant et la place de l’institution universitaire dans le rayonnement de la culture
Ramenée au XVIIIè siècle et à la conscience éthique des Lumières telle qu’envisagée par Kant, l’autodétermination ne saurait avoir un contenu arbitraire. Autant parler d’autodétermination positive ou constructive qui postule, par opposition à l’autodétermination que nous appellerons nihiliste ou négative, l’éloignement vis-à-vis de la minorité, de l’obscurantisme et par conséquent de l’asservissement. En effet, pour Kant, l’autodétermination et la liberté subséquente qu’elle renferme invitent à la responsabilité et à la lucidité et non à la légèreté et à l’insouciance. Pour l’auteur du criticisme, aucun peuple ne saurait légitimement renoncer à aspirer à l’émancipation ainsi qu’au progrès et décider de rester dans la minorité en s’abandonnant par la même occasion à l’obscurantisme. Une telle attitude ne s’inscrit pas dans la droite ligne des Lumières dont le mot d’ordre est : « Aie le courage de te servir de ton propre entendement » (Kant, 1947, p. 46). Toute attitude ou démarche contraire ne peut que se voir opposer une fin de non-recevoir. Pour l’auteur des trois critiques, en effet, « Un homme peut bien, en ce qui le concerne, ajourner l’acquisition d’un savoir qu’il devrait posséder. Mais y renoncer, que ce soit pour sa propre personne, et bien plus encore pour la postérité, cela s’appelle voiler les droits sacrés de l’humanité et les fouler aux pieds ». (Kant, 1947, p. 52).
Avec les Lumières, le besoin de connaître et l’aspiration au savoir sont hissés au rang d’impératifs éthiques et juridiques devant lesquels tout doit céder y compris une politique mal éclairée allant dans le sens contraire. Il s’agit d’un mouvement à la fois irréversible et irrésistible qui entraine tout dans son sillage : « Si donc maintenant on nous demande : « Vivons-nous actuellement dans un siècle éclairé ? », voici la réponse : « Non, mais bien dans un siècle en marche vers les Lumières ». (Kant, 1947, p. 53). Kant peut aisément prophétiser cet avènement à partir du moment où « les obstacles deviennent insensiblement moins nombreux, qui s’opposaient à l’avènement d’une ère générale des Lumières et à une sortie de cet état de minorité dont les hommes sont eux-mêmes responsables » (1947, p. 53). Ce, à travers des indices probants qu’il fait consister pour l’essentiel dans le règne de Fréderic II, despote éclairé, à la fois partisan du progrès en général et de la culture en particulier.
Or, Kant voyait le véritable progrès de l’humanité dans « le perfectionnement de l’homme par une culture progressive, quoiqu’ au prix de beaucoup de jouissance de la vie » (2017-A, p. 2566). Kant arrive à énoncer la loi universelle qui transcende les cultures particulières, à savoir que « l’homme est destiné par sa raison à vivre en société avec l’homme, à se cultiver, à se civiliser et se moraliser par les arts et les sciences dans le commerce de ses semblables (…) » (2017-A, p. 2568). Justement, c’est à ce niveau précis du bien-fondé de l’éducation que les attentes vis-à-vis de l’université et des universitaires se posent avec le plus d’acuité. De l’avis de J. Barni (2017-B, p. 1788), « (…) le réformateur de la philosophie allemande (…) Kant (…) en sa qualité de professeur de philosophie à l’université de Kœnigsberg, (…), était tenu de faire à certaines époques des leçons de pédagogie ». Ceci, pour mettre l’accent sur l’immense intérêt qu’il accorde à l’éducation et partant, au rayonnement de la culture.
Mais au-delà, il faut surtout avoir en vue le libre exercice de la pensée et la quête de la rationalité que l’institution universitaire promeut dans un contexte dominé autant que faire se peut, par le recul de l’obscurantisme. G Bourgeault (2003, pp. 237-252) s’en fait l’écho en ces termes :
Depuis la naissance en Europe, il y a environ 800 ans, de ce qu’on a convenu d’appeler l’université, on s’est plu à voir en elle un lieu, le lieu privilégié de l’exercice de la liberté de penser et de “parler” – liberté de chercher, de professer ou d’enseigner, de discuter : lieu, par conséquent, du refus de tous les enfermements et de l’accueil de la diversité ; lieu de la distance autorisée et de la critique des sociétés et de leurs aménagements ; lieu de la contestation de l’ordre établi et de propositions alternatives.
Dans la mesure où l’ignorance et l’obscurantisme, qui sont en eux-mêmes une forme d’asservissement et qui prédisposent les peuples à l’assujettissement, il appartient à la mission édificatrice de l’université en général et des universités africaines en particulier, de promouvoir et de dispenser le savoir libérateur. Il revient donc à l’institution universitaire africaine de relever le défi de l’innovation scientifique et technologique. C’est à une telle condition que les États africains pourront se hisser dans le cercle restreint des grandes puissances et discuter d’égal à égal dans des partenariats gagnants-gagnants et non plus déséquilibrés et spoliatifs. C’est d’ailleurs à la lumière de telles exigences qui laissent entrevoir la soif de la connaissance rationnelle et la quête de la vérité sans compromission que l’on peut comprendre cette pensée de Kant (1980, p. 33) :
Notre siècle est le siècle propre de la critique, à laquelle tout doit se soumettre. La religion, par sa sainteté, et la législation, par sa majesté, veulent ordinairement s’y soustraire. Mais alors elles excitent contre elles un juste soupçon, et ne peuvent prétendre à ce respect sincère que la raison accorde seulement à ce qui a pu soutenir son libre et public examen.
Si l’argument d’autorité, la dissimulation ou encore le secret ont prévalu par le passé, les Lumières, rompent avec ces procédés mal éclairés pour ne considérer comme telles que les connaissances issues de l’activité critique de la raison et tendant à assurer, selon une expression kantienne, « le bon état de la république scientifique ». Cette république scientifique, aujourd’hui plus qu’hier dans le contexte africain, doit être en même temps une république libératrice en promouvant la culture en générale et la science en particulier. C’est en effet, par ces leviers que, dans une perspective comtienne, les États africains se libéreront du joug de l’obscurantisme pour la connaissance positive et libératrice. La science, quelle qu’elle soit d’ailleurs, apparait de ce fait comme un pouvoir que les États africains ont tout intérêt à maitriser en permettant tout simplement à l’institution universitaire qui l’incarne et la promeut de faire son travail en toute franchise. Ce libre examen public constitue, en dernier ressort, la vocation de l’université et des universitaires comme on peut l’apercevoir à travers la définition récapitulative que M. Crevoisier (2018) nous en donne :
Le concept d’université vient du terme juridique latin universitas (…) et qui désigne le regroupement de l’ensemble des corporations d’enseignement. (…). En ce sens, l’universitas peut être compris comme l’institution de l’ensemble de ceux qui savent et dont le savoir est universel, c’est-à-dire absolument vrai. Cet héritage métaphysique du concept d’universalité impliqué dans le nom de l’institution universitaire est au cœur du concept d’université élaboré par Kant dans Le conflit des facultés. (…). Ainsi, lorsque Kant affirme que l’universitaire est celui qui dit inconditionnellement la vérité, (…) il entend déterminer le concept pur a priori d’université à partir de ce que doit idéalement être un sujet rationnel ayant été capable de concevoir l’idée de l’université comme institution de la raison.
Or, pour pasticher Kant, qu’est-ce-que les Lumières, si ce n’est la raison en marche vers le progrès ? On comprend alors D. Ion (2015, p. 49) quand elle fait observer ceci : « Universities might therefore represent, for Kant, a minimum safeguard of enlightenment »[102]. Mais cette garantie ne pourrait être pleine et entière qu’avec l’intervention du philosophe. Disons tout simplement que pour incarner cette institution de la raison, nul ne saurait déroger au philosophe et à la philosophie en raison de la spécificité de cette discipline.
2.2. Kant et la place de la philosophie dans la conquête de la liberté : la promotion de la pensée critique autonome
Si comme nous venons de le voir, le savoir doit être au service de la liberté, il n’en demeure pas moins que la liberté doive, pareillement, se mettre au service du savoir. Elle doit permettre notamment dans la situation de l’Afrique, appelée à pérenniser les Lumières en avivant la sienne propre, à aspirer à toujours plus de savoir et à se détourner de toute forme d’autocensure encourageant l’obscurantisme. Autrement dit, les peuples ne doivent pas mésuser de leur droit à se déterminer eux-mêmes en optant pour la censure inhibitrice de l’esprit des Lumières. Au demeurant, une des intentions clairement affichées par Kant dans Réponse à la question : Qu’est-ce que « les Lumières » ?, consiste à postuler que les Lumières constituent l’esprit critique des peuples mettant fin au « mauvais usage des dons naturels » (Kant, 1947, p. 47). Pour y parvenir, Kant procède à l’examen du statut de la connaissance philosophique en rapport avec d’autres domaines du savoir. Tel est exactement l’objet du Conflit des facultés au sujet duquel P. Macherey (2009) pouvait nous enseigner ceci :
Le conflit des Facultés (…) est le tout dernier texte publié par Kant, en 1798. Il est intéressant que Kant ait donné pour point final à son immense œuvre philosophique une réflexion sur la position institutionnelle de la philosophie, qui établit quels sont les rapports que celle-ci entretient en droit avec les autres disciplines enseignées dans les facultés, dans le contexte historique propre à une certaine conjoncture universitaire.
Selon Kant, l’usage en vigueur dans les universités consistait à diviser les facultés en deux classes : la classe des trois facultés supérieures que sont la théologie, le droit et la médecine et la classe de la faculté inférieure regroupant diverses disciplines des lettres et des sciences au nombre desquelles figure en bonne place la philosophie.
La ligne de démarcation entre ces deux types de facultés que nous qualifierons d’abusive, tient à la volonté arbitraire de l’État de valoriser la première et de diaboliser la seconde. Un tel choix se ressent sur l’intérêt de la science et de la vérité, pour ainsi dire relégué au second plan et abandonné à la sagacité des seuls intellectuels. « Alors que les facultés supérieures tirent leur autorité de l’écrit et de statuts arbitraires – [fait remarquer Dekens], le théologien de la bible, le juriste du droit civil, le médecin du règlement médical – la philosophie est la voix libre de l’homme, la seule faculté qui n’a d’autre guide que la raison ». (O. Dekens 2013, p. 173). Or, comme le reconnaît Kant (1955, pp. 16-17),
Il faut absolument qu’à l’Université l’institution scientifique publique comprenne encore une Faculté qui, indépendamment des ordres du gouvernement par rapport à ses doctrines, ait la liberté, sinon de donner des ordres, du moins de porter un jugement sur eux tous, dont l’affaire soit l’intérêt scientifique, c’est-à-dire celui de la vérité, et où la raison soit autorisée à parler ouvertement.
Ce défi est de taille au regard du contexte africain notamment marqué par la mainmise du pouvoir politique préoccupé avant tout par son maintien et cherchant à tout contrôler. En matière de contentieux électoral, par exemple, que ce soit en amont en ce qui concerne les préparatifs des élections ou en aval en ce qui concerne les résultats, les juridictions suprêmes telles que les conseils constitutionnels revendiquent rarement une telle liberté sur le continent de sorte que les décisions rendues sont pour la plupart, favorables au régime en place. Notre propos n’est pas de dire que le droit est forcément violé chaque fois que la décision rendue est favorable au pouvoir. Mais en raison de la forte présomption d’inféodation desdites juridictions au régime en place et d’un certain sentiment de redevabilité des magistrats au détenteur du pouvoir de nomination, nous voulons tout simplement insister sur la nécessité pour les praticiens qui siègent dans les diverses juridictions de ne dire que le droit en toute indépendance. Il appartient aux philosophes africains en particulier et d’une façon générale à tous les intellectuels universitaires de s’approprier cet appel de Denkens et d’impulser cette dynamique de la pensée libre et désintéressée à l’ensemble du corps social. C’est au prix d’une telle hardiesse que les États africains se mettront résolument, sans faux-fuyants et sans faux-semblants, dans la voie du développement véritable qui rime avec la vérité, la sincérité et la transparence dans la conduite des affaires publiques.
La philosophie et le philosophe en sa qualité d’administrateur privilégié de la raison, jaloux de son autonomie ne peuvent qu’être en pôle-position de ce combat. La philosophie apparait dans ces conditions comme l’étalon par rapport auquel la sincérité des autres disciplines prétendant au désintéressement doit être appréciée. Ce, d’autant qu’elle pourrait incarner à elle seule, la vocation de l’université. C’est du moins ce que pense M. Crevoisier (2018) quand il affirme :
En vertu de la définition selon laquelle la Philosophie est la seule Faculté « qui n’a qu’à veiller à l’intérêt de la science », c’est-à-dire à « la vérité » Kant situe le fondement de l’université en celle-ci. En effet, la discipline philosophique vise l’auto-détermination de la raison dans la perspective critique d’une théorie de la connaissance garantissant la véracité du jugement scientifique. La Faculté de philosophie doit donc être au fondement de l’université, et car c’est au philosophe seul que peut revenir le privilège de penser ce que doit être l’université afin qu’elle puisse assurer qu’elle remplit bien sa fonction institutionnelle, à savoir, d’être le lieu de la science, là où se dit la vérité.
Si donc la philosophie préside au fondement de l’université en tant qu’entité ou institution, on voit mal comment d’autres disciplines que cette institution renferme, pourraient la surclasser. Aussi faut-il voir dans cette critique de Kant, une délégitimation de l’ordre arbitraire établi entre les facultés ainsi qu’un désaveu des pouvoirs publics calculateurs invités à faire la part des choses entre l’usage public et l’usage privé de la raison. À l’inverse, évacuant toute influence étrangère, le philosophe, de par la spécificité de son statut, n’a pour seul guide que la voix de la raison qu’il suit dans une démarche entièrement autonome et indépendante. Ni Dieu, ni la religion, ni le pouvoir politique ne sauraient l’en détourner à condition cependant que les gouvernants lui garantissent la liberté d’opinion et d’expression. Cela revient à dire que les gouvernants doivent faire preuve de tolérance en évitant de recourir à la censure vis-à-vis du philosophe.
In part, Kant’s essay on the Enlightenment was a document of the ʻgentlemlen’s agreementʼ between the autocratic ruler and the Enlightenment philosophers. Frederick allowed intellectual freedom, which is considered, together with Kant, as ʻinocuousʼ. The philosophers, for their part, accepted the command that their writings should be abstract general reflections[103]. (G. Cavallar, 2020, p. 29).
Alors celui-ci, à l’instar d’un entraineur, saura non seulement guider et raffermir les pas des citoyens vers la pensée critique autonome, mais aussi conseiller utilement le pouvoir quant à la bonne gestion de la cité.
Conclusion
Le nom de Kant est d’ordinaire attaché à la défense des droits et des libertés pour lesquels il a toujours pris parti. En témoigne sa philosophie politique marquée notamment au plan interne par l’instauration de la constitution républicaine qu’il considère comme le terreau de la liberté. Mais si Kant défend tant la liberté, ce n’est guère que pour la voir au service de l’émancipation et du progrès de l’humanité conformément à la dimension éthique et culturelle des Lumières. Dans ces conditions, il est inconcevable que l’autodétermination des peuples, qui passe pour le versant collectif de l’autonomie individuelle chère à Kant, se mette au service de la censure et de l’auto-asservissement. En effet, pour autant qu’un peuple dispose du droit de déterminer souverainement sa politique, cela ne l’autorise guère à mésuser de ce droit en optant pour l’obscurantisme et en s’y complaisant. Ce qui contrarie les Lumières qui devraient logiquement y trouver un auxiliaire. Avec Kant, la liberté, premier droit naturel de l’homme doit s’assumer en toute responsabilité de sorte à favoriser les Lumières dont la mise en œuvre ne doit souffrir d’aucune désinvolture. C’est pourquoi il incombe au philosophe d’une façon générale, rehaussé par la qualité d’universitaire – ce qui n’est pas sans rappeler la vie de Kant lui-même – de veiller et de surveiller l’autodétermination des peuples africains notamment dans le sens envisagé par les Lumières qui demeurent étonnement actuelles.
Dans une complicité vertueuse, l’institution universitaire et le philosophe, tout en promouvant la culture et la pensée critique désintéressée, mettent à mal tout obscurantisme incongru. Si l’universitaire dans la quête de la vérité universelle procède par le libre examen public du savoir, le philosophe quant à lui, encourage la pensée autonome et strictement rationnelle affranchie des pressions émanant du pouvoir politique et de toute forme d’influence arbitraire. Un tel résultat sera d’autant mieux assumé que le philosophe bénéficiera d’un contexte tolérant et favorable à la liberté d’opinion et d’expression. Assumant ainsi ses positions dans une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir politique, la philosophie en arrive à surclasser les facultés concurrentes qui ne peuvent revendiquer la même autonomie parce que inféodées et manipulées par des pouvoirs politiques, bienveillants et complaisants à leurs égards. Ceci étant, le philosophe qui assume un statut institutionnel plutôt franc et désintéressé de la philosophie, tel un entraineur, pourra formuler ses opinions dans le sens fichtéen de la rectification du jugement du peuple quant aux enjeux véritables de l’autodétermination.
Références bibliographiques
BOURGEAULT Guy, 2003, « L’université aujourd’hui, comme hier ? Le regard d’Emmanuel Kant sur l’université… 200 ans plus tard », in Revue des sciences de l’éducation, 29(2), 237–252.
CAVALLAR Georg, 2020, Kant and the theory and practice of international right, Cardiff, University of Wales Press.
CREVOISIER Michaël, 2018, « Penser l’université à partir de sa déconstruction (1/2). Stiegler lecteur critique de Derida », sous la co-direction d’Arnaud Macé et de Cathérine Malabou, Article consulté le 01/02/2022 sur le http://www.implications-philosophiques.org/penser-luniversite-a-partir-de-sa-deconstruction.
DEKENS Olivier, 2013, Comprendre Kant, Paris, Armand Colin.
ION Dora, 2015, Kant and International Relations Theory : cosmopolitan community building, New York, Routledge.
KANT Emmanuel, Version ebook : 3.2 (05/12/2017-A), Anthropologie, Œuvres complètes, Lci-25, trad. J. Tissot, Paris, Ladrange, 1863.
KANT Emmanuel, 1980, Critique de la raison pure, trad. J.-L. Delamarre et F. Marty, Paris, Gallimard.
KANT Emmanuel, Version ebook : 3.2 (05/12/2017-B), « Introduction analytique et critique du traducteur », Doctrine de la vertu, Œuvres complètes, Lci-25, trad. J. Barni, Paris, Auguste Durand, 1855.
KANT Emmanuel, 1994, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, Paris, Delagrave.
KANT Emmanuel, 1955, Le conflit des Facultés, trad. J. Gibelin, Paris, Vrin.
KANT Emmanuel, 1993, Métaphysique de mœurs, Doctrine du droit, trad. A. Philonenko, Paris, J. Vrin.
KANT Emmanuel, 1948, Projet de paix perpétuelle, trad. J. Gibelin, Paris, J. Vrin.
KANT Emmanuel, 1947, « Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières », La philosophie de l’histoire, trad. S. Piobetta, Paris, Montaigne.
LEFEBVRE Joël, 1985, « Introduction », Emmanuel Kant, Pour la paix perpétuelle, trad J. Lefebvre, Presse Universitaire de Lyon, pp. 5-46.
LAGARDE Alain, 1988, « Introduction », Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle, trad. J. Barni, Paris, Hatier, pp. 3-21.
LOSURDO Domenico, 1993, Autocensure et compromis dans la pensée politique de Kant, Presses Universitaires de Lille.
MACHEREY Pierre, « Kant et le conflit des facultés (1) », (2009), consulté le 04/02/2022 sur le site https://philolarge.hypotheses.org/47.
ÉTHIQUE DE LA DISCUSSION ET CRISE DE L’UNIVERSITÉ EN AFRIQUE
Cyrille SEMDE
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
Résumé :
L’institution universitaire en Afrique est en crise. Parmi les multiples causes de la crise de l’université, figure le défaut de communication. Celui-ci pourrait être comblé par la promotion d’une éthique de la discussion ou de la communication telle que proposée par Apel et Habermas. Mais, une réforme éthique de la communication dans l’espace universitaire implique : la libération de l’université du poids de la politique et du clanisme qui contribuent à faire d’elle un lieu de manipulation de la parole en vue d’atteindre des objectifs relevant plus des priorités politiques, d’intérêts subjectifs que ceux d’un développement institutionnel véritable. « La rationalité éthique propre à la communication consensuelle » (K.-O. Apel, 1996, p. 31) qui, pourtant, devrait définir les interactions dans l’espace universitaire, cède le pas à « la rationalité stratégique instrumentale ». Dans cette perspective, nous entendons opérer d’abord un diagnostic de la crise de l’université afin de mettre en évidence ce qui la caractérise ; ensuite rappeler les principes et la destination d’une éthique de la communication et, enfin, montrer dans quelle mesure la réforme de la communication, inspirée d’une telle éthique, constitue la voie vers la résorption de la crise.
Mots-clés : Clanisme, Crise de l’université, Éthique de la discussion, Liberté, Politique, Rationalité instrumentale, Réforme de la communication.
Abstract :
The university institution in Africa is in crisis. Among the many causes of the university crisis is the lack of real communication. This could be filled by promoting an ethics of discussion as proposed by Apel and Habermas. But an ethical reform of communication in the university space implies the liberation of the university from the weight of politics and clanism which contribute to making it a place of manipulation of speech in order to achieve objectives that are more relevant political priorities, subjective interests than those of genuine institutional development. « The ethical rationality specific to consensual communication » (K.-O. Apel, 1996, p. 31) which, however, should define interactions in the university space, gives way to « instrumental strategic rationality ». In this perspective, we intend to first operate a diagnosis of the crisis of the university in order to highlight what characterizes it; then recall the principles and the destination of a communication ethics and, finally, show to what extent the reform of communication, inspired by such ethics, constitutes the way towards the resolution of the crisis.
Keywords : Clanism, Communication reform, Ethics of discussion, Freedom, Instrumental rationality, Politics, University crisis.
Introduction
Retard et chevauchement des années académiques, effectif pléthorique des étudiants qui contraste avec la capacité d’accueil des établissements en termes d’infrastructures, d’équipement, de personnel enseignant et administratif, remise en question de la fiabilité des diplômes, clanisme ou sectarisme, inadaptation des mesures prises, tels sont entre autres les signes qui attestent la réalité de la crise de l’université en Afrique. Face à une telle situation, qu’est-ce que l’éthique de la discussion telle que pensée par Karl-Otto Apel et Jürgen Habermas a à nous dire ? Autrement dit, quelle peut être la réponse de l’éthique de la discussion à la situation actuelle de nos universités marquée par une crise qui, de plus en plus, semble remettre en question le sens même de l’université ? Telle est la question rectrice de la réflexion qui s’annonce. Dans ce qui suit, il s’agira d’abord d’analyser l’idée de crise, étant donné la complexité du concept, ensuite de décrire avec plus de précision les signes d’une crise de l’université africaine et enfin de montrer ce que l’éthique de la discussion inspire comme solution.
1. De l’idée générale de crise
Dans La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Husserl (1975, p. 10) soutient que par « crise des sciences » il ne faut rien entendre d’autre que l’incapacité des sciences positives à répondre à la question du sens, du fait de leur réductionnisme objectiviste :
De simples sciences de faits, écrit-il, forment une humanité de fait. […] Dans la détresse de notre vie…cette science n’a rien à nous dire. Les questions qu’elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée au destin : ce sont les questions qui portent sur le sens ou sur l’absence de sens de toute cette existence humaine.
Le concept de crise se laisse appréhender comme une perte de sens, l’insuffisance ou la limite des sciences positives en matière de fondation d’une humanité authentique. La crise des sciences ne signifie donc pas aux yeux du philosophe que leur « scientificité authentique – ou encore la façon même dont elle a défini ses tâches et élaboré sa méthodologie en conséquence – est devenue douteuse. » (Ibidem, p. 7) Par transposition, nous pouvons affirmer décidément que les universités africaines sont malades, qu’elles sont en crise. Mais cette fois la crise a priori affecte l’université en son fonctionnement, ses buts, sa pertinence. Afin d’aller plus loin dans cette interprétation du sens de la crise de l’université, il convient de procéder à une analyse de la notion même de crise.
Du point de vue purement conceptuel, l’idée de crise peut s’entendre de plusieurs manières, ce qui en rend la compréhension difficile. De son origine médicale, ses usages se sont diversifiés comme le souligne Edgar Morin (1976, p. 49), dans son article « Pour une crisologie ». Dès le seuil de sa réflexion, il écrit :
Mais cette notion, en se généralisant, s’est comme vidée de l’intérieur. À l’origine, Krisis signifie décision : c’est le moment décisif, dans l’évolution d’un processus incertain, qui permet le diagnostic. Aujourd’hui crise signifie indécision. C’est le moment où, en même temps qu’une perturbation, surgissent les incertitudes.
Le sens initial de décision, d’origine médicale remonterait à Hippocrate chez qui elle désigne le moment critique d’une maladie où il faut prendre une décision. Krinein en grec signifie donc « décision », « jugement ». À propos de la signification originaire, nous pouvons citer les propos suivants de Natacha Ordioni (2011, p. 13) :
Du latin krisis, le mot “crise” est issu du vocabulaire médical où il représente l’étape charnière, le moment paroxystique d’une maladie, qui peut en ce point « critique » évoluer vers la guérison comme vers la mort. Le médecin joue un rôle central : en observant les signes, il doit prendre une décision (krinein) à propos du traitement du malade.
Mais en glissant dans l’usage courant, le concept de crise qui ne gagne pas forcément en clarté quant à sa définition, renvoie a priori à l’idée de perturbation et de rupture, bien que gardant une certaine ambivalence. Edgar Morin (Op. cit., p. 150-153) dans un effort de contribution à l’élucidation du sens du concept dans la perspective de la fondation d’une crisologie, c’est-à-dire une théorie de la crise, procède d’abord à une analyse de la société. La motivation d’une telle perspective se justifie selon lui par le fait que la notion de crise « déploie sa pleine richesse dans le cadre des développements socio-historiques. » (Op. cit., p. 149). Penser la crise par le détour de la théorie de la société recèle un gain en termes d’interprétation de la notion. Elle permet en effet d’« aller au-delà de l’idée de perturbation, d’épreuve, de rupture d’équilibre » (Ibidem), ce qui n’est possible que si l’on conçoit « la société comme système capable d’avoir des crises, c’est-à-dire poser trois ordres de principes, le premier systémique, le second cybernétique, le troisième néguentropique, sans quoi la théorie de la société est insuffisante et la notion de crise inconcevable. »[104] (Ibidem)
Les trois principes qui caractérisent la société se recoupent autour d’un concept central : celui de la complexité. La néguentropie, terme provenant, du point de vue de l’origine, de la science physique, signifierait littéralement « non-entropie » ou entropie négative. Morin, dans son analyse de l’idée de crise l’utilise pour désigner la capacité de la société à se réorganiser, à refouler, en tant que système, les forces antagonistes perturbatrices. Il n’est pas besoin pour notre propos d’entrer dans les détails de l’analyse du philosophe ; il suffit d’en évoquer les conclusions qui permettent d’éclairer le concept de crise. La société est une totalité dynamique d’interrelations entre des parties et entre des parties et le tout dont l’harmonie se tient dans la tension entre complémentarité – solidarité des parties entre elles et entre elles et le tout – et antagonismes, entre organisation et désorganisation (anti-organisation). Les antagonismes sont soit manifestes, soit latents ou virtuels. La situation « normale » serait celle de l’équilibre, et la situation de crise est caractérisée par la rupture ou la perturbation de l’équilibre. Mais en qualifiant de normale la situation d’équilibre on risque de manquer le fait que la crise fait elle-même partie du fonctionnement normal des sociétés même si toute crise est censée s’inscrire dans un horizon temporel limité. Ensuite on risque de réduire l’idée de crise à sa dimension régressive, destructrice alors qu’elle peut receler des opportunités ou révéler des besoins de changements positifs.
L’auteur décrit (p. 155-160), à partir de l’analyse précédente de la société, dix composantes de la crise qui sont : 1) l’idée de perturbation qui posséderait un double visage en fonction de son origine qui peut être externe ou interne. Au point de vue externe la perturbation provient d’un événement ou d’un facteur étranger au système lui-même ; 2) l’accroissement des désordres et des incertitudes. À ce sujet l’auteur écrit (p. 156) :
la crise est toujours une régression des déterminismes, des stabilités, et des contraintes internes au sein d’un système, toujours donc une progression des désordres, des instabilités, et des aléas. Cela entraîne une progression des incertitudes : la régression des déterminismes entraîne une régression de la prédiction ;
3) les actions de blocage/déblocage ; 4) le développement des feed-back positifs ; 5) la transformation des complémentarités en concurrences et antagonismes ; 6) l’accroissement et les manifestations des caractères polémiques ; 7) l’action de déblocage/reblocage ; 8) le déclenchement d’activités de recherches ; 9) les solutions mythiques et imaginaires et enfin (10) la dialectisation de toutes les composantes décrites.
Que retenir de l’analyse précédente ? Que le concept de crise est complexe en son extension, mais que c’est cette complexité qui légitime aujourd’hui l’idée de crise de l’université africaine, tout comme on peut parler de crise de l’humanité, de crise politique, de crise des valeurs, etc. Par quoi la crise de l’université en Afrique se manifeste-t-elle alors ?
2. Les signes d’une crise de l’université africaine
Appliquer l’analyse précédente à l’université revient à l’appréhender comme un système, et d’un point de vue cybernétique et néguocentrique[105]. Ce système qui n’est pas clos s’intègre dans un environnement social, politique, économique national et international. Comme éléments du système-université nous pouvons évoquer : les infrastructures, les équipements, le personnel étudiant, administratif, les enseignants, le service social, culturel et sportif, un ensemble de services : orientation, scolarité, des facultés ou des Unités de Formation et de Recherche (UFR), des départements, un service financier, une présidence constituée elle-même de composantes affectées à des tâches ; mais il y a aussi les dispositifs institutionnels qui font fonctionner l’ensemble. L’université, en tant que système, reçoit son principe vital des textes qui définissent le fonctionnement des structures, mais aussi leurs créations ou innovations. L’université ne se réduit pas à un système clos. Elle doit répondre à des attentes, notamment sociales et économiques, qui vont au-delà de l’intérêt du système, c’est-à-dire de son équilibre ou de sa cohérence internes.
Mais peut-on parler de crise de l’université au regard de la multiplication des établissements d’enseignement supérieur, publics comme privés, du nombre croissant des effectifs des étudiants, du nombre de personnes diplômées, du nombre et de la diversité des offres de formation, qu’elle soit initiale ou continue ? À titre d’illustration, on dénombre, au titre de l’année académique 2019-2020[106], cent dix-huit (118) établissements d’enseignement supérieur privés, universités et instituts confondus, qui proposent trois cent vingt-neuf (329) offres de formation de niveau licence et master professionnel ou général. À ces établissements, il faut ajouter sept (07) universités publiques et six (06) centres universitaires rattachés à des universités telles que l’Université Norbert Zongo de Koudougou, Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou et l’Université Nazi BONI de Bobo Dioulasso. La seule Unité de Formation et de Recherche en Sciences Humaines (UFR/SH) de Ouagadougou compte plus de vingt-un mille (21000) étudiants orientés dont environs seize mille (16 000) effectivement inscrits. Si donc on entend par crise de l’université un déficit d’institutions et établissements d’enseignements supérieurs et d’offres de formation, l’enseignement supérieur au Burkina Faso connaît un très grand essor et suscite de l’enthousiasme.
Toutefois cette multiplication n’est-elle pas déjà le signe d’une crise, justement au sens de la perturbation provoquée par des phénomènes au départ non perturbateurs ? Edgar Morin prend l‘exemple du domaine économique. La croissance économique, pourtant souhaitée par toute société en ce qu’elle peut apaiser les tensions au sein de la société, « suscite de nouveaux besoins, crée de nouvelles tensions, en réveille d’anciennes ; elle crée les conditions des crises et des conflits pour la possession des ressources énergétiques… » (Op. cit., 1976, p. 154). Appliqué à l’université, un exemple de développement déréglant, bien qu’au départ souhaité, consiste dans la multiplication, ces dernières années, des établissements et des institutions d’enseignement supérieur. Ce phénomène est perturbateur en plusieurs sens : d’abord, elle remet en question la qualité de la formation puisque la multiplication des établissements et offres de formation ne signifie pas forcément la disponibilité de ressources humaines compétentes ; ensuite, cette prolifération est symptomatique de l’entrée et de la subordination de l’enseignement supérieur à la logique économique et marchande qui privilégie la rentabilité par rapport à la performance intellectuelle et aux compétences professionnelles à développer, imposant ainsi à la formation et à la recherche scientifiques des buts qui lui sont extérieurs. Dans ce sens, la crise signe la perte de sens de l’université qui, à notre sens, doit se caractériser par l’autonomie. Bien entendu, cette affirmation est sujette à caution et contraste avec le fait que l’université s’insère dans un ensemble, dans un environnement social, économique, politique, culturel, en un mot, dans ce qu’on pourrait appeler « un écosystème » qui, nécessairement l’influence et qu’elle doit influencer également. L’idée d’une autonomie absolue de l’université paraît donc irrecevable. Zaghloul Morsy (1991, p. 337) écrit :
L’université constitue bel et bien et de plus en plus un rouage déterminant de la société à laquelle elle appartient et dont elle doit connaître, anticiper et servir les besoins concrets, entre autres le développement, (…). Bref, elle ne peut plus prétendre ne servir la société que de manière lointaine, «médiatisée». […]. Désormais, donc, autonomie ne peut plus aller sans nécessité de rendre des comptes (et pas seulement en termes d’administration et de gestion) et des services, selon un équilibre à trouver entre l’un et l’autre concept, d’entente entre l’un et l’autre partenaire[107].
Qu’à cela ne tienne, le devoir de rendre compte, de répondre à des attentes sociales, économiques et politiques, justifie le risque de sacrifier la qualité de la formation à la simple logique de la rentabilité. Les établissements d’enseignement supérieurs privés encouragent parfois, pour leur renommée, les évaluations de complaisance, puisqu’un taux élevé d’échec risquerait de leur faire perdre la clientèle. À l’inverse, celui qui a payé s’attend nécessairement à ce que sa formation soit validée. Il faut affranchir l’université africaine de cette forme d’instrumentalisation.
La crise de l’université africaine signifie sa déstabilisation ou sa perturbation par des facteurs extérieurs. Je voudrais pointer du doigt particulièrement le facteur politique en un double sens : d’abord les crises politiques provoquent le dysfonctionnement des universités africaines, entraînant parfois la fermeture temporaire des établissements ; ensuite l’incursion systématique du politique dans l’académique représente un désastre pour nos universités, puisque se trouve remise en cause leur autonomie et même leur efficacité en termes de qualité de la formation et de la recherche. Enfin, des initiatives internes d’innovation et de dynamisation des activités pédagogiques, académiques et administratives sont battues en brèche par des décisions d’origine politiques. Il en est ainsi de l’interdiction par la présidence de l’université joseph KI-ZERBO de l’organisation de rentrée solennelle de l’UFR/SH en Novembre 2021, sous prétexte que la rentrée avait été officiellement lancée par le ministère de tutelle en octobre. Mais la présidence de l’université ne faisait que répercuter les propos d’un enseignant-chercheur de géographie, politiquement influent et dont l’équipe avait échoué aux élections précédentes des directeurs et directeurs adjoints des instituts et UFR. L’objectif réel était de ne pas permettre à l’équipe dirigeante d’avoir des arguments pertinents aux prochaines élections si jamais elle entreprenait de candidater à nouveau. On peut encore citer l’exemple de l’injonction ministérielle adressée aux enseignants-chercheurs qui exercent des responsabilités académiques dans le privé, soit de demander une délégation soit de mettre fin à ces responsabilités, parce que cela porterait atteinte à la qualité de l’enseignement supérieur. Cette incursion de la politique dans la vie des universités produit un autre aspect de la crise de l’université africaine qui se situe du côté de la recherche de solution. Il s’agit de solutions mythiques et imaginaires qui consistent dans la recherche systématique de coupables, dans le brandissement de menaces ou de sanction comme mode de gouvernance de l’université. À ce sujet, Morin (1976, p. 159) écrit :
En même temps que les activités intellectuelles critiques, les processus magiques se déploient. On cherche à isoler, circonscrire la culpabilité, et à immoler, liquider le mal en sacrifiant le ou les « coupables ». La recherche des responsabilités se sépare dès lors en deux branches antagonistes, l’une qui cherche à reconnaître la nature même du mal, l’autre qui cherche le bouc-émissaire à immoler, et bien sûr, il y a multiplication de coupables imaginaires, le plus souvent marginaux ou minoritaires.
Il faut les chasser comme des corps étrangers et /ou les détruire comme des agents infectieux. Ainsi la recherche de solution se déverse et se dévie dans le sacrifice rituel.
Bien entendu l’intervention du politique ou de l’État dans l’enseignement supérieur demeure inévitable et est même décisive : la création, l’ouverture et le financement d’une université relèvent de décisions politiques, de la responsabilité de l’État. Celui-ci garantit par ailleurs les cadres de coopération et de convention qui rendent possibles les partenariats d’une université avec d’autres institutions d’enseignement supérieur d’autres États. De ce point de vue, l’université ne constitue pas un épiphénomène ; elle s’intègre dans un environnement politique et même idéologique qui détermine son fonctionnement et ses orientations. Par ailleurs on pourrait entériner les propos d’Alain Tourraine (1968, p. 47) selon lesquels « la politique est entrée à l’Université et n’en sortira plus jamais. » Cette entrée peut s’interpréter de deux manières. La première façon de la comprendre renvoie au fait que l’université est devenue un espace de formation de l’opinion, de formation politique, un espace de critique et de contestation pouvant conduire à des bouleversement politiques importants. Mais c’est la conscience d’une telle possibilité qui explique la volonté de l’État de soumettre l’université à son contrôle ne serait-ce qu’à travers la nomination de ses premiers responsables. Cette volonté de contrôler conduit à la deuxième implication possible de l’entrée de la politique à l’université : celle-ci devient le terrain des intrigues et des manipulations où les objectifs politiciens, les jeux d’intérêts prennent le dessus sur les enjeux académiques et scientifiques. C’est dans ce dernier cas que l’incursion de la politique à l’université devient pernicieuse.
Les activités intellectuelles critiques dont parle Morin décrivent la neuvième composante du concept de crise d’une manière générale. Toute crise déclenche des activités de recherche de solution, des stratégies de sorties de crise. À titre d’illustration, ce colloque sur la crise de l’université participe de cette composante de la crise. À cette forme d’activité réflexive, on peut en ajouter d’autres telles que l’organisation d’états généraux ou d’assises sur l’enseignement supérieur, ou encore l’élaboration de livres blancs, etc. Elles ont l’avantage de s’inscrire dans une dynamique d’appréhension objective et concertée de la crise, ce qui peut ouvrir la perspective de solutions efficaces.
La dixième composante de la crise, la dialectisation de toutes les autres, signifie que la crise s’interprète comme l’ensemble de ces composantes qui la rendent « extrêmement riche (…). Plus riche que l’idée de perturbation ; plus riche que l’idée de désordre (…) ; stimulant en [elle] les forces de vie et de mort (…). » (Op. cit., p. 160). Dans cette perspective, la crise de l’université africaine signale à la fois des risques de destruction ou de décadence et des opportunités de croissance, de réorientations, de restructuration. Dans ce dernier cas elle suppose des choix pertinents et des méthodes adaptées. C’est à ce niveau qu’intervient l’intérêt d’une éthique de la discussion.
3. La réponse de l’éthique de la discussion
Par-delà les différences qui les distinguent, les théories de l’éthique de la discussion se recoupent sur l’idée que le consensus constitue le critère de validité des normes, qu’elles soient théoriques ou qu’elles soient pratiques. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une recherche collective de la vérité et des fondements du juste et de l’injuste. Il est question de sortir du paradigme de la subjectivité ou de la conscience qui a longtemps caractérisé la pensée, pour privilégier l’intersubjectivité, l’intercompréhension ou l’entente mutuelle. Or, qui parle de consensus situe dans le processus communicationnel argumenté la voie vers la solution à des problèmes suscités par la vie concrète. Dans cette perspective, la phénoménologie de la crise de l’université pointe beaucoup plus le défaut de communication, c’est-à-dire précisément un fonctionnement défectueux du réseau de circulation de l’information administrative notamment. Mais les plaintes concernent parfois la non-implication des acteurs ou de certains d’entre eux dans la prise de décision, l’orientation des activités ou la résolution des problèmes. C’est ainsi que des propositions de mesures urgentes pour résorber les retards et les chevauchements des années académiques dans les universités publiques du Burkina Faso, faites par les autorités ministérielles sous le gouvernement Paul-Henri DAMIBA ont été purement et simplement rejetées du fait de leur origine verticale. Ces mesures consistaient entre autres à la suppression des voyages d’études, à l’augmentation des frais de prime de recherche, à l’augmentation des volumes de horaires de 75 heures par grade.
Karl-Otto Appel (1996, p. 131) opère une distinction significative entre une communication stratégique et une communication éthique.
Ces deux formes de rationalité, écrit-il, s’appliquent comme telles à l’interaction et à la communication entre les hommes considérés comme sujets d’action. Mais la rationalité propre à la communication consensuelle présuppose des règles ou des normes qui se situent a priori au-delà de l’intérêt particulier individuel, totalement défini par le calcul ; la rationalité stratégique se fonde, quant à elle, purement à partir de la réciprocité que suppose l’exercice de la rationalité instrumentale et technique dans le commerce entre les hommes.
La communication éthique, celle qui vise l’intercompréhension ou le consensus se défie de toute manipulation du discours pour parvenir à des fins précises mais qui ne sont pas forcément susceptibles de susciter l’adhésion de tous. Au contraire de la communication stratégique, la communication éthique présuppose des principes, des normes transcendantales qui se trouvent impliquées dans toute activité langagière collective qui vise l’accord mutuel. Il s’agit des normes de la justice, de la co-responsabilité – de la responsabilité collective, et « la norme fondamentale de solidaritéentre tous les membres, et au-delà : de tous les membres potentiels de la communauté d’argumentation actuelle, en principe illimitée, étant donné que dans le cadre de l’entreprise commune de la résolution argumentative de problèmes, ils sont liés et renvoyés l’un à l’autre » (K.-O. Apel, 1994, p. 42). Outre ces principes, on peut ajouter ceux de la liberté, de l’égalité, du devoir de respect mutuel des parties prenantes et la reconnaissance d’un idéal commun.
A priori l’université constitue un terrain propice à l’application de cette rationalité dialogique. En effet, l’un de ses objectifs régaliens n’est-il pas de former à la pensée libre et cohérente, de développer l’esprit critique, de promouvoir la science et la vérité ? Ce qui caractérise cette dernière, n’est-ce pas des valeurs telles que l’objectivité, la rationalité et l’universalité qui implique le devoir de justification de son savoir ? Et pourtant les débats au sein de nos universités autour des problèmes auxquels elles se confrontent sont le plus souvent dominés ou motivés par les intérêts partisans, qu’ils soient syndicaux ou politiques. Il en découle le plus souvent un manque de sincérité dans les discours produits et la perte de vue de l’intérêt commun.
Ce qu’apporte l’éthique de la discussion c’est d’abord l’idée qu’une solution à la crise passe par une entente commune sur sa nature réelle, ses causes et ses conséquences. Elle supplée donc à ce qu’Edgar Morin appelle les « solutions mythiques et imaginaires » qui conduisent à situer les responsabilités d’une manière unilatérale et donc à ignorer leur caractère collectif. Quand ce ne sont pas les étudiants qui sont accusés, ce sont les enseignants ou les autorités administratives qui sont identifiés comme étant les véritables acteurs des blocages. Ensuite, l’idée de justice sous-tendue par l’éthique de la communication constitue une valeur importante dans le traitement de la crise de l’université Africaine. En effet, elle implique le traitement équitable des composantes du système universitaire, qu’il s’agisse d’individus ou de structures telles que les UFR, les services, les organisations syndicales, etc. Enfin, choisir la voie de la discussion argumentée, la voie du consensus signifie que l’on a par-là même renoncé à la politique de deux poids, deux mesures qui conduit à des frustrations profondes et à des mécanismes de résistance ouverte ou passive. Ceci pourrait réduire les tensions et établir un climat de confiance et de respect mutuel. Recommander la discussion comme procédure de résolution des conflits ou de la crise revient à dire qu’elle doit s’expérimenter dans les sphères différentes de la vie universitaire : dans le cercle des organisations des étudiants, à l’échelle des UFR et instituts, dans le cercle des mouvements syndicaux, dans l’interface étudiants-enseignants, enseignants-administration, entre administration universitaire et administration centrale, entre monde universitaire et monde politique ou les partenaires financiers, etc. À titre d’illustration – sans volonté de stigmatisation – l’expérience montre que les incompréhensions entre les étudiants et les enseignants et/ou l’administration résultent le plus souvent du type de communication utilisée par les premiers : la tendance à l’irrespect, à la menace, à la suspicion systématique de l’autre de vouloir compromettre leurs intérêts, comme si ceux-ci étaient radicalement différents de ceux de l’administration et des enseignants.
Conclusion
Il convient de retenir que non seulement la notion de crise est complexe, qu’elle renferme en elle le paradoxe de ce qui perturbe et de ce qui ouvre la voie au progrès, mais aussi que la crise de l’université en Afrique constitue une réalité à travers les signes qui le manifestent. Considérer l’éthique de la discussion comme réponse à la crise de l’université en Afrique revient à recommander une voie démocratique sérieuse de la gouvernance des institutions universitaires en Afrique. Peut-il en être autrement si l’on envisage l’université comme étant avant tout un espace d’usage public et critique de la raison, un espace dans lequel les parties prenantes sont capables d’argumentations, sont attentifs à la liberté de penser et ont un fort sens de la justice ? Bien entendu, l’idée d’autonomie de l’université est problématique en raison de l’évolution de sa vocation qui n’est pas seulement la production du savoir, mais aussi de répondre aux attentes en matière de développement social, économique, politique, d’insertion professionnelle, donc de transformation sociale positive. Mais, elle demeure cruciale pour la stabilité des institutions universitaires, et justement le contenu qu’il convient d’en donner doit faire l’objet d’un accord mutuel entre toutes parties prenantes internes ou externes.
Références bibliographiques
APEL Karl-Otto, 1994,Éthique de la discussion, trad. par Mark Hunyadi, Paris, éd. du Cerf.
APEL Karl Otto,1996, Discussion et responsabilité. Tome 1. L’éthique après Kant, trad. par Christian Bouchindhomme, Marianne Charrière et Rainer Rochlitz, Paris, éd. du Cerf.
APEL Karl-Otto,1998, Discussion et responsabilité, Tome 2. Contribution à une éthique de la responsabilité, trad. par Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, Paris, éd. du Cerf.
APEL Karl-Otto, 2001,La réponse de l’éthique de la discussion au défi moral de la situation humaine comme telle et spécialement aujourd’hui, trad. Michel Canivet, Louvain, Paris, éd. Peters.
BASTIT Michel, 2007, Qu’est-ce que l’université ?, Paris, L’Harmattan.
BRITO Emilio, 2004, « Théologie et Université selon Fichte », in Revue théologique de Louvain, 35ᵉ année, fasc. 1, pp. 3-21, in https://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_2004_num_35_1_3342.
HABERMAS Jürgen, 1986, Morale et communication, Conscience morale et activité communicationnelle, trad. par C. Bouchindhomme, Paris, éd. du Cerf.
HABERMAS Jürgen, 1992, De l’éthique de la discussion, trad. par Mark Hunyadi, Paris, éd. du Cerf.
HABERMAS Jürgen, 2003, L’éthique de la discussion et la question de la vérité, trad. par Patrick Savidan, Paris, éd. Grasset.
HUSSERL Edmund, 1975, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. Par Gérard Granel, Paris Gallimard.
KANT Emmanuel, 1993, Critique de la raison pratique, trad. par François Picavet, Paris, éd. P.U.F.
KANT Emmanuel, 1994, Métaphysique des mœurs I. Fondation, trad. par Alain Renaut, Paris, éd. Gallimard.
LANDENNE Q., 2020, « La fonction formatrice de l’université pour une société apprenante : le legs de la philosophie fichtéenne de la Bildung », [en ligne], in Philosophiques, 47(1), 79–98, https://doi.org/10.7202/1070251ar.
Morin, Edgar, 1976, « Pour une crisologie » [en ligne], In Communications, 25, La notion de crise. pp. 149-163; URL : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1976_num_25_1_1388.
MORSY Zaghloul, 1991, « Jalons », in Perspectives, Revue trimestrielle de l’Education, UNESCO, vol XX1, n°3.
Ordioni Natacha, 2011, « Le concept de crise : un paradigme explicatif obsolète ? Une approche sexospécifique », [en ligne], in De Boeck Supérieur (coll. « Mondes en développement »), N°154, pages 137 à 150 URL : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2011-2-page-137.htm.
TOURRAINE Alain, 1968, Ce n’est qu’un début, entretien reproduit par Ph. Labro Editions et Publications Premières, N°2.
SEPTIÈME AXE : INFRASTRUCTURES, TICE ET INNOVATION PÉDAGOGIQUE
TICE, DÉCONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION TECHNOSCIENTIFIQUE DE LA CRISE DES UNIVERSITÉS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ?
Kouadio Victorien EKPO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La crise des Universités de l’Afrique subsaharienne qui s’exprime, entre autres, par la massification, l’insuffisance d’infrastructures et d’enseignants dans certaines spécialités est loin de trouver une solution globale. L’une des solutions proposées pour juguler ce malaise réside dans le recours aux TICE. Ces techniques s’accommodent d’une série de ruptures relatives au temps et à l’espace de l’organisation de l’enseignement. Mais l’implémentation des TICE dans nos universités, suivant des règles et contraintes, dans le but de résoudre la crise qu’elles traversent est génératrice d’une autre crise liée, notamment, à la fracture numérique. Grâce à une intellection constructive et évaluative, ce texte a pour objectif de proposer des paradigmes pour comprendre les enjeux des TICE dans le dénouement de la crise des universités. Le temps est venu d’amorcer le processus de renouvellement de l’enseignement conforme à la révolution technoscientifique comme la nouvelle architecture de la relation au savoir dans les sociétés contemporaines. Cette idée constituera le fil d’ariane de notre réflexion sur le bien-fondé des innovations technologiques dans l’espace universitaire.
Mots clés : Afrique subsaharienne, Crise, Déconstruction, Reconstruction, TICE, Université.
Abstract:
The university crises in sub-Saharan Africa, which is expressed, among other things, by massification, the lack of infrastructure and of teachers in certain specialities, is far from finding a comprehensive solution. One of the suggested solutions to overcome this university problem is the use of ICT. These techniques accommodate a series of breaks in the organisation of teaching in terms of time and space. But the implementation of ICTE in our universities, according to rules and constraints, with the aim of resolving the crisis they are going through, is generating another linked crisis, in particular, to the digital divide. Through a constructive and evaluative intellection, this paper aims at proposing paradigms to understand the stakes of ICTE in the resolution of the university crisis. The time has come to start the process of renewing education in line with the techno-scientific revolution as the new architecture of the relationship to knowledge in contemporary societies. This idea will be the thread of our focus on the appropriateness of technological innovations in the university space.
Keywords : Crisis, Deconstruction, Reconstruction, Sub-Saharan Africa, TICE, University.
Introduction
La crise des universités de l’Afrique subsaharienne se situe à la confluence de plusieurs facteurs qui s’enchevêtrent. Elle est en partie déterminée par la rationalité technique qui a investi et déstructuré presque toutes les activités humaines. La quête de solutions vitales au malaise des universités se mue en réquisitoire des acteurs pour accroître leur compétitivité et visibilité. Pour réussir cela, les parties prenantes sont tiraillées entre des attitudes conservatrices à élan technophobes et des postures progressistes ouvertes aux nouvelles technologies. Malgré tout, les solutions au malaise des universités ne peuvent être éclairées et productives en marginalisant la dynamique technoscientifique. L’évolution technoscientifique des sociétés, censée déconstruire la crise traditionnelle des universités avec les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation) crée de nouveaux malaises en s’inscrivant dans la logique de la déconstruction/reconstruction des maux de ce monde du savoir : les solutions techniques suscitent parfois la méfiance parce qu’elles génèrent de nouveaux maux. Peut-on, alors, envisager la déconstruction de la crise des universités avec les TICE ?
L’intellection de cette question principale conduira à cheminer vers notre objectif qui est de proposer des éléments essentiels pour comprendre les grands enjeux des TICE dans le dénouement de la crise des universités. Il s’agira, à cet effet, de vérifier l’hypothèse suivante : malgré le malaise qui accompagne l’usage des TICE, elles contribuent à juguler la crise des universités. Il est question d’amorcer le processus de renouvellement de l’enseignement conforme à la révolution technoscientifique qui constitue la nouvelle architecture de la relation au savoir dans les sociétés contemporaines. Pour vérifier notre hypothèse, nous combinerons les méthodes analytiques et comparatives pour répondre aux questions subsidiaires ci-dessous. Quels sont les caractéristiques du sol originel et les prodromes de la crise des universités ? Comment les mutations technoscientifiques de la société renouvèlent-elles des gènes du malaise des universités ? Quelle évaluation de l’usage des TICE dans la déconstruction de ladite crise ? Comment cheminer vers une dialectique de la déconstruction et de la reconstruction des maux des universités à l’ère des TICE ?
1. Sol originel et prodromes de la crise des universités de l’Afrique subsaharienne
Les crises contemporaines que traversent les universités de l’Afrique subsaharienne ont une origine et des signes avant-coureurs qui exigent une mise en lumière pour mieux les juguler. Elles s’enracinent dans le choc entre l’éducation traditionnelle et l’éducation moderne, occidentale, avec des cadres cognitifs et des espaces de structuration de l’apprentissage différents. L’acquisition du savoir en Afrique traditionnelle, souvent structuré par des histoires, se faisait dans de multiples conditions : autour de grands feux, sous des arbres ou espaces dédiés. En effet, « dès sa prime jeunesse, l’enfant accède à la culture africaine par les contes, les légendes, les fables, les devinettes ou les proverbes qui lui sont racontés » (P. Mérand, 1984, p. 43-44). Les éléments qui constituent l’architecture de l’éducation relevaient, dans une large mesure, de l’oralité qui avait ses forces.
Malgré ses imperfections (manque d’écriture, manque de structure formelle d’apprentissage comme les écoles et les classes, manque de programmes, etc.), l’éducation traditionnelle africaine a des valeurs réelles qui formatent la manière d’être, de penser et l’intégration du sujet dans des activités sociales. Sans vouloir forcément faire allégeance à une société statique, à une quête originelle et primitive de l’accès à la formation et au savoir, nous ne devons pas perdre de vue que toute ouverture ou évolution est source de crise. C’est le lieu de souligner que « l’Afrique est le seul continent qui ne dispose pas d’un système contrôlé d’auto-reproduction collective. L’éducation scolaire apparaît comme un kyste exogène, une tumeur maligne dans le corps social » (J. Ki-zerbo, 1990, p. 16). L’éducation scolaire et les transformations de la vie quotidiennes qui lui sont inhérentes déstructurent des modes et des cadres traditionnels de l’apprentissage. Il va sans dire que les profondes mutations des sociétés traditionnelles africaines contribuent à un naufrage de la majeure partie de ce qui constitue le sol originel de la formation de la personnalité et de la psychologie de l’homme africain. En réalité, « l’Afrique après la colonisation n’a presque jamais eu une école véritablement africaine, mais seulement une école formelle en Afrique dans laquelle la culture et les valeurs africaines n’imprégnaient ni l’enseignement ni la pédagogie » (S. Gandolfi, 2022, p. 11). Le socle originel des maux des universités doit être recherché dans la rencontre entre les modes d’acquisition des savoirs traditionnels et modernes.
En outre, le fondement de la crise est lié souvent à des déficiences en ressources humaines et en infrastructures. Les capacités d’accueil de nombreuses universités sont aujourd’hui dépassées : « le manque d’infrastructures et de personnel qualifié reste souvent criant. Le Mali compte en moyenne un enseignant pour 60 à 90 étudiants ; dans les universités nigérianes d’Abuja et de l’État de Lagos, le ratio enseignant-étudiants s’élève à 1 pour 122 dans la première et 1 pour 114 dans la seconde » (Campus France, 2019, p. 6). Les indicateurs des crises sont : l’insuffisance d’infrastructures (salles de cours, bureaux pour les enseignants, logement des étudiants) et l’insuffisance d’enseignants dans certaines spécialités. À cela, il faut ajouter l’instrumentalisation des syndicats d’étudiants et d’enseignants par les politiques[108].
La crise des universités s’exprime aussi par la gouvernance confligène de celles-ci aussi bien par l’État que ses acteurs. Ces malaises qu’on pourrait qualifier de classiques prennent des orientations inédites avec les techniques contemporaines qui créent une distorsion entre les mondes traditionnel et moderne en colportant de multiples aspects de la culture occidentale : « les élèves [et étudiants] qui sont immergés dans un monde où règnent la télévision, les jeux vidéo et les réseaux sociaux vivent comme une perte de temps et une épreuve difficile le fait de rester assis à leur place les yeux fixés sur une craie qui court sur le tableau noir » (A. Gore , 2013, p. 99). L’éducation subit l’assaut de la technicisation-numérisation du monde et inscrit la crise des universités dans de nouveaux horizons cognitifs. Les mutations technoscientifiques de la société perturbent les différentes activités humaines, notamment la relation au savoir et ses modes d’acquisition. Nous sommes tentés de poser la question suivante : le malaise des universités est-il celui du savoir, des modes d’apprentissages, des infrastructures ou de l’innovation ? Quoi qu’on dise, la crise se situe dans un réseau de relations et d’interactions dynamiques qui peut trouver son nœud dans la misère de l’innovation où les conditions d’acquisition du savoir peuvent parfois déstructurer sa qualité. C’est le lieu de rappeler que la quête de réformes pour parer aux crises peut être une autre source de maux. Dans cette logique, l’appropriation des innovations technoscientifiques n’est pas neutre. Elle est susceptible de renouveler les gènes du malaise des universités.
2. Mutations technoscientifiques de la société et renouvellement des gènes de la crise des universités
La crise des universités s’inscrit dans un contexte global caractérisé par des bouleversements de la société liés aux innovations technoscientifiques qui déconstruisent des manières traditionnelles de penser et d’agir. Les modes d’appropriation et de transmission du savoir qui constituent le noyau fédérateur des acteurs de la relation pédagogique à l’université s’inscrivent dans de nouvelles constellations cognitives avec la révolution technoscientifique dans le domaine des TICE. Les techniques modernes revendiquent ou déstabilisent des anciens pouvoirs ou organisations qui orientaient les acteurs de l’enseignement. L’accès à l’information et à la formation est renouvelé ou brouillé par l’évolution technoscientifique qui est l’un des principaux médiateurs de la communication dans les sociétés contemporaines.
En effet, les TICE sont porteuses d’une série de ruptures, rupture technologique avec internet qui démocratise davantage l’accès au savoir, rupture dans les modes d’apprentissage avec l’enseignement à distance qui consacre une scission temporelle et spatiale dans l’organisation de l’enseignement. Ces différentes dissociations comportent leurs règles et contraintes qui ne sont pas toujours maitrisées par les acteurs. « Le e-learning, qui abolit aussi bien le temps que la distance, constitue à l’évidence un accélérateur pour tout dispositif d’éducation, mais il serait réducteur de ne voir les NTIC que comme de simples « médiatiseurs » techniques » (J. Wallet, 2004, p. 95). Le e-learning n’est pas culturellement neutre. Il est porteur de valeurs inédites susceptibles de mettre en crise des repères traditionnels relatifs à l’enseignement dans les universités. Nous sommes tentés de dire que l’usage des TICE comporte des gènes de renouvellement de la crise des universités. Le terrain fragile des Universités avec les germes conflictuels liés aux infrastructures est déstabilisé par les TICE.
Nous assistons à une mutation dans l’appropriation du savoir. L’accès à l’information est démocratisé grâce aux médias et principalement internet. Cependant, l’accès à l’information est-il une formation ? Grâce aux médias, les apprenants reçoivent les informations, même si elles ne sont pas toujours ordonnées de façon logique. Le rôle de l’enseignant rentre partiellement en crise et doit se déplacer et se concentrer sur l’organisation et la présentation cohérente et logique du savoir. Il doit être le gardien de la diffusion et de l’utilisation productive du savoir. Cela a un impact sur son image et son autorité traditionnelle qui étaient presque sans partage.
Il y a, à des degrés divers, des difficultés d’accès et de manipulation des TICE par des étudiants et des enseignants. Comment l’enseignant peut-il utiliser les TICE pour compenser la crise des infrastructures quand il est lui-même un analphabète du numérique ? Ou un réfractaire au changement ? La crise des universités est en partie liée aux mésusages des TIC doublé d’une paresse, d’un manque de volonté ou de motivation des étudiants : ils sont toujours connectés mais ils ne s’intéressent pas à l’essentiel, c’est-à-dire aux études. Une enquête que nous avons réalisé du 22 au 24 mai 2022 auprès d’une centaine d’étudiants de divers niveaux à l’Université Alassane Ouattara démontre que 67% des enquêtés se connectent au moins une fois par jour, 13% trois fois par semaine et 20% en moyenne trois fois par mois. Les temps de connexion sont à 83% consacrés aux réseaux sociaux sans aucun lien avec les activités de formations universitaires et 17% aux activités de recherches académiques.
La plupart des solutions envisagées pour juguler la crise des universités exigent une contrepartie, il y a un prix à payer par les acteurs, au-delà de l’aspect économique, le prix concerne les efforts de recyclage, la création de cadres ou de conditions favorables à l’usage des TICE, l’investissement intellectuel individuel et collectif. La couverture insuffisante des moyens de télécommunication crée une crise dans l’accès à internet qui est un élément essentiel pour la mise en œuvre satisfaisante des TICE qui, en favorisant la gestion de la crise des salles de cours, par exemple, génèrent de nouveaux maux. En effet, les disparités socioéconomiques se renouvellent avec les TICE. La fracture numérique et l’accès non permanent à internet sur des campus couplés à des « coûts de fonctionnement encore élevés, [fait que] le système d’enseignement à distance exclut une frange très importante des potentiels étudiants en Afrique » (M. Coulibaly, 2014, p. 4). La facture du numérique augmente la fracture numérique entre les villes et les régions d’un même pays avec un débit de la connexion inégalement réparti. Les TICE exigent un investissement économique ; comment les rentabiliser en évitant les discriminations ? Les TICE créent de nouveaux problèmes dans le système universitaire :
Donner des ordinateurs dans le cadre d’une aide internationale, c’est bien, mais payer les abonnements et les dépenses de fonctionnement, c’est indispensable. L’approche économique n’est pas la seule. Les dispositifs méritent d’être interrogés dans leurs principes fondateurs : certaines collaborations nord-sud sont à sens unique, lorsque la formation à distance repose uniquement sur des visioconférences reçues dans des amphithéâtres ou sur des technologies descendantes, du type poste de radio numérique… Où favorise-t-on la production de contenus endogènes ? Le risque existe de voir broyer, par cette fausse proximité, les compétences locales et les institutions » (J. Wallet, 2004, p. 95).
Le recours aux TICE pour juguler le malaise des universités a des impacts négatifs sur les compétences locales. Il est source de nouveaux désordres. Toutefois, la crise n’est pas absolument négative, elle favorise des stratégies de résilience source d’innovation ou de renouvellement/amélioration sur les ruines des anciens systèmes ou à partir de leur restructuration. Elle est positive quand elle favorise le progrès. Il devient alors impératif de procéder à une évaluation de l’usage des TICE dans la crise universitaire.
3. Pour une évaluation de l’usage des TICE dans la déconstruction de la crise des universités
La technique est une source de crise, elle introduit des changements profonds dans l’organisation des activités sociales. L’université, si elle ne veut pas être inadaptée à son époque, doit intégrer l’évolution technoscientifique qui déstructure des manières traditionnelles de penser, d’agir, de communiquer et d’enseigner. « L’intégration des TIC en contexte scolaire est porteuse d’un fort potentiel de transformation des pratiques d’enseignement et d’apprentissage et laisse poindre une définition nouvelle des rapports entre enseignants et élèves » (Mbodj Mar, 2010, p. 39). La réponse à cette redéfinition de la relation pédagogique n’a pas toujours été holistique. Ainsi, la réflexion sur les usages pédagogiques des TICE ne sont pas intégrées à l’acquisition du matériel informatique. Les États ou structures partenaires se contentent de créer des salles multimédias sans mettre en œuvre une véritable politique d’usage pédagogique des TIC. Les formations relatives aux cours en ligne à l’Université Alassane Ouattara, par exemple, se limitent à l’aspect technique, à l’usage du site et non à la pédagogie. L’opération « un étudiant un ordinateur » initiée par le gouvernement ivoirien a permis à de nombreux étudiants d’avoir un ordinateur.
[Mais] le fait de mettre des outils comme l’ordinateur et internet entre les mains des apprenants ne change pas grand-chose à leurs pratiques habituelles si ces outils ne s’intègrent pas dans une démarche pédagogique bien définie. Lorsque l’outil est utilisé comme objet d’enseignement ou qu’il sert de ressources d’enseignement, les apprenants le réutilisent pour leurs activités d’apprentissage. Mais si tel n’est pas le cas, ils s’en servent pour des activités non pédagogiques (K. Awokou, 2010, p. 15).
L’outil informatique n’a de sens dans la relation pédagogique que lorsqu’il est une partie intégrante de cette relation. Dans certains contextes,
La réflexion sur les TIC dans l’éducation a longtemps porté sur les équipements, les enseignants, les processus d’enseignement-apprentissage et les impacts. Elle n’a pas assez intégré les autres acteurs autour des enseignants dont la mobilisation est primordiale pour la réussite de l’intégration des TICE. Il s’agit entre autres des chefs d’établissements appelés également administrateurs. En effet, selon quelques conclusions de recherches qui ont été menées sur le sujet, le leadership des administrateurs se révèle payant pour impulser le développement des TIC et des compétences que les enseignants doivent acquérir (M. Mbodj, 2010, p. 41).
L’intégration progressive des TIC dans l’enseignement n’a pas été holistique, cela explique en partie ses nombreux écueils. Pour une meilleure gestion des TIC dans les systèmes éducatifs africains, les efforts doivent être orientés sur l’accès aux TIC, la formation des enseignants à l’usage pédagogique des TIC. Il est question de prendre en compte la nouvelle dimension de diffusion et d’enseignement du savoir qui semble être plus facilement accessible et qui voyage partout dans le monde grâce au numérique. La prise de conscience du rôle des TIC justifie
La mise en place de l’Initiative des E-Ecoles du NEPAD dont l’objectif est d’assurer aux jeunes africains les compétences qui leur permettront de participer efficacement à la société de l’information. C’est un projet très ambitieux qui voudrait toucher à terme plus de 600 000 établissements du continent. Trois grandes phases sont prévues dans le déploiement global du projet, chaque phase prévoyant 15 à 20 pays. Une école NEPAD est une école disposant : d’ordinateurs fixes, d’un tableau blanc interactif (TBI), d’un vidéoprojecteur et d’un téléviseur connecté au réseau satellitaire. L’importance donnée aux TIC, dans ce projet, repose sur un certain nombre de constats liés à la place de plus en plus prépondérante des TIC dans presque tous les secteurs d’activités. Il semble que l’on s’achemine vers une société où les TIC seraient au cœur d’une transformation profonde et globale (M. Mbodj, 2010, p. 37).
Il y a des efforts avérés d’appropriation des TICE dans la relation pédagogique en Afrique avec le NEPAD. L’Université virtuelle Africaine (UVA) qui est un dispositif de formation à distance s’inscrit dans cette logique.
Différentes méthodes et différents supports sont utilisés pour organiser les enseignements : il y a des possibilités de participation à des sessions interactives qui utilisent des possibilités synchrones (communication directe avec un instructeur par vidéo conférence) ou asynchrones (communication via e-mail par exemple). Des vidéocassettes, des CD-ROM, le Web et l’imprimerie constituent un ensemble de technologies avec lequel l’UVA organise ses formations. Des tuteurs africains organisent localement les séances de travaux pratiques, s’occupent des centres, donnent des instructions aux étudiants et entretiennent le contact avec les professeurs éloignés et rapportent à ceux-ci les progrès réalisés par les étudiants (M. Sokhna et J. Sarr, p. 2).
Les efforts de l’UVA ont été renforcés par le Covid-19 qui a renouvelé le rapport des universités de l’Afrique subsaharienne aux TIC, à l’enseignement, à l’apprentissage et à la recherche. « Certes, les technologies de l’information et de la communication, et surtout celles employées dans l’éducation (TICE), existaient déjà et leur utilisation était en hausse, mais leur utilité a redoublé en temps pandémique » (R. Moussavou et al., 2021, p. 164). Le Covid a favorisé la prise de conscience de ressources numériques inexploitées. Au total les TICE, convoquées pour résoudre les questions relatives à la misère des universités de l’Afrique subsaharienne génèrent de nouveaux soucis qui doivent être pris en charge de façon adéquate. Comment faire alors pour trouver une logique dialectique entre les problèmes consécutifs à leur usage pour déconstruire la crise des universités ?
4. Vers une dialectique de la déconstruction et de la reconstruction de la crise des universités par les TICE
La gestion honorable de la crise des universités exige une intégration pacifique des TICE dans les universités de l’Afrique subsaharienne pour qu’elles ne soient pas en marge de l’actualité des modes d’apprentissage qui se mondialisent avec les TICE. Les TICE, loin d’être un simple effet de mode dans le système académique, se révèlent fondamentales pour une meilleure intégration des universités dans l’univers socio-technicien qui a ses exigences. Il est nécessaire pour les États de faire des concertations préalables avec les différents acteurs des universités pour une meilleure appropriation des enjeux des TICE. Cela éviterait les échecs ou le renouvellement des crises censées être déconstruites par celles-ci. En fait, la dynamique technoscientifique exige une réorganisation de l’enseignement pour qu’il soit compétitif.
La posture dialectique susceptible de faire co-évoluer la déconstruction et la reconstruction de la crise des universités de l’Afrique subsaharienne doit se méfier du fondamentalisme caractéristique de la phobie du changement. En effet, les sociétés et avec elles les universités, sont engagées dans une dynamique quasi irrésistible avec la technique contemporaine qui créée des problèmes inédits qui débordent parfois le cadre de pensé et d’agir traditionnelle en imposant une ouverture à l’innovation. De ce point de vue, le pessimisme défensif qui se réfugie dans l’immobilisme doit céder la place à l’optimisme offensif ouvert au changement. Pour un meilleur ancrage de cet optimisme les cultures de la prospective sociale, éthique et technologique doivent servir de viatique aux universités africaines pour une meilleure anticipation des solutions aux maux des universités. Cela permettra de maintenir en éveil l’esprit d’anticipation pour cheminer de façon éclairée vers un nouveau contrat éthico-technique avec les universités.
Les repères de ce contrat doivent se situer dans la logique de l’UNESCO qui considère le droit à l’éducation comme essentiel à l’épanouissement de l’individu à cet effet, l’Unesco et d’autres organisations internationales recommandent que le système éducatif soit doté d’enseignants qui « appliquent des méthodes pédagogiques adaptées et s’appuient sur des technologies de l’information et de la communication (TIC) adéquates, et que soit instauré un environnement éducatif sûr, salubre, sensible aux disparités entre les sexes, inclusif et doté de ressources adéquates, qui facilite l’apprentissage » (Unesco et al., 2015, p. 30). La gouvernance des universités intégrant les TICE doit avoir pour fondement la lutte contre les inégalités source de discriminations dans l’apprentissage. Une politique d’identification et de lutte contre les diverses vulnérabilités doit être mise en place pour réduire, compenser et si possible déconstruire les nouvelles formes d’inégalités consécutives à l’intégration progressive des TICE dans les Universités de l’Afrique subsaharienne.
L’inclusion et l’équité, dans l’éducation (…) constituent la pierre angulaire d’un agenda pour l’éducation transformateur. C’est pourquoi, nous nous engageons à lutter contre toutes les formes d’exclusion et de marginalisation, ainsi que contre les disparités et inégalités en matière d’accès, de participation et de résultats de l’apprentissage (Unesco et al., 2015, p. 7).
La vision traditionnelle de l’enseignement doit faire sa mue et s’articuler de façon pacifique aux nouveaux modes de diffusion du savoir et d’enseignement qui pourraient frapper d’obsolescence des aspects de l’enseignement traditionnel. Sans être nécessairement des chantres de la médiation, sans condition, des TIC dans l’enseignement, nous devons nous rendre à l’évidence que pour une meilleure visibilité de nos universités l’alternative salutaire ne réside pas dans le repli sur la tradition pédagogique qui était celle d’une époque. Les temps ont changé, y compris les mentalités et la société qui est désormais un univers sociotechnique qui a ses contraintes. Pour ne pas être des exclus de la nouvelle dynamique de l’enseignement impulsée par les TIC, les stratégies de leur appropriation doivent être renforcées. Le respect de l’orthodoxie de la formation traditionnelle doit désormais s’ouvrir aux MOOCs qui proposent des formations interactives en ligne en offrant le choix aux individus de se former à distance, hors du cadre ou des bâtiments dédiés à la formation académique.
Conclusion
La révolution technoscientifique et numérique bouleverse les réquisits traditionnels constitutifs de la société et, avec eux, ceux qui forment l’architecture de l’enseignement dans les Universités. Faire marcher de front la crise des universités et les TICE est la marche pédagogique qui s’impose dans les universités de l’Afrique subsaharienne dans un contexte mondial où la relation au savoir et à l’enseignement est de plus en plus phagocytée par les TICE. Le malaise des universités ne saurait trouver son dénouement dans des attitudes conservatrices, réfractaires à l’usage de la technique qui a phagocyté presque toutes les activités humaines. Il est question d’amorcer le processus de renouvellement de l’enseignement conforme à la révolution technoscientifique qui constitue la nouvelle structure de la relation au savoir dans les sociétés contemporaines. Le niveau d’appropriation des TICE déterminera la qualité des stratégies honorables de déconstruction de la crise des universités. Les universités sont vitales pour les États. Leurs crises ne sauraient être abandonnées seulement aux mains des enseignants, d’autant qu’elles ont des ressorts qui transcendent l’espace universitaire. Il est question d’aller au-delà du commencement de la crise pour questionner ses origines pour mieux juguler ses effets.
Références bibliographiques
AWOKOU Kokou, 2010, Les utilisations d’Internet et des TIC chez les étudiants. Étude de cas des étudiants de l’Unité Technologique de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) de Lomé au Togo, in frantice.net, numéro 2, www.frantice.net.
CAMPUS FRANCE, 2019, « Mobilités et coopérations universitaires en Afrique subsaharienne » in Dynamiques régionales N°01.
COULIBALY Mélama, 2014, TICE en Afrique : aide à la démocratisation de l’éducation ou accentuation des inégalités ? Adjectif.net [En ligne], mis en ligne le 21 octobre 2014. URL : http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article31.
GANDOLFI Stefania, 2022, « Introduction » in Abdeljalil Akkari, Stefania Gandolfi, Moussa Mohamed Sagayar (Eds.), Repenser l’éducation et la pédagogie dans une perspective africaine Manuel pratique à destination des enseignants et des formateurs d’enseignants, Geneva, Globethics.net Co-Publications & Others.
GORE Al, 2013, Le futur. Six logiciels pour changer le monde, Paris, Nouveaux Horizons.
JELEV Jeliou, 2004 « Education et citoyenneté au XXIe siècle » in BINDE Jérome (dir.) Où vont les valeurs, Paris ? Unesco/Albin Michel.
KI-ZERBO Joseph, 1990, Eduquer ou périr, Paris, L’Harmattan.
MBODJ Mar, 2010, Typologie des référentiels de compétences TICE en matière de formation des personnels de l’éducation. Une étude de cas : les E‐Ecoles du NEPAD, in frantice.net, numéro 2, www.frantice.net.
MERAND Patrick, 1984, La vie quotidienne en Afrique noire, Paris, L’Harmttan.
MOUSSAVOU Raymonde et al., 2021, « TICE Afrique ou comment compléter les formations des enseignants en Afrique ? », in Revue Multilinguales, Volume: 9 / N° Spécial.
SOKHNA et Joseph SARR, L’Université Virtuelle Africaine : passage d’une formation d’enseignants aux mathématiques à une formation d’enseignants de mathématiques au Sénégal, in http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/ressources/actes-en-ligne/emfgt6/sokhna-sarr.pdf.
UNESCO et al., 2015, Éducation 2030 Déclaration d’Incheon,
WALLET Jacques, 2004, La perspective de la coopération internationale. Développement et formation des cadres intermédiaires : le cas de l’Afrique sub-saharienne, in Revue Savoir, N°5, https://www.cairn.info/revue-savoirs-2004-2-page-91.htm.
LE RÔLE DE L’INSUFFISANCE DES INFRASTRUCTURES DANS LA CRISE UNIVERSITAIRE AU NIGER
Institut Universitaire de Technologie -Université André Salifou de Zinder (Niger)
Résumé :
Par cette contribution nous nous proposons d’analyser la relation entre l’insuffisance des infrastructures et les différentes crises universitaires au Niger. Le Niger est un pays de l’Afrique de l’Ouest dans lequel le secteur de l’enseignement supérieur fait face à une crise depuis les années 1971. L’objectif de cette contribution est de décrire les déterminants de l’insuffisance des infrastructures et équipements avant d’analyser le lien entre celle-ci et les grèves répétitives dans les universités nigériennes. Ce travail est basé sur une démarche à la fois quantitative à travers l’administration d’un questionnaire et qualitative avec des entretiens semi-directifs. Les résultats indiquent que, sur 22 plates-formes revendicatives des différents syndicats de l’enseignement supérieur entre 2000 et 2020 au Niger, 17 ont des liens avec l’insuffisance des infrastructures, soit 77,27 %. Aussi le mode de financement des infrastructures universitaires au Niger est-il inefficace et est basé sur le budget national avec un taux d’exécution annuel moyen d’environ 48 %. En outre, les facteurs politiques et la corruption concourent à l’inefficacité de l’exécution des budgets d’investissement en général et la construction des ouvrages en particulier.
Mots clés : Budget d’investissement, Corruption, Grève universitaire, Insuffisance d’infrastructures, Niger, Relation.
Abstract:
Through this contribution, we propose to analyze the relationship between the insufficiency of infrastructures and the various university crises in Niger. Niger is a West African country in which the higher education sector has been facing a crisis since 1971. The objective of this contribution is to describe the determinants of the inadequacy of infrastructure and equipment before analyzing the link between it and the repetitive strikes in Nigerien universities. This work is based on an approach that is both quantitative through the administration of a questionnaire and qualitative with semi-structured interviews. The results indicate that, out of 22 protest platforms of the various higher education unions between 2000 and 2020 in Niger, 17 have links with the lack of infrastructure, i.e. 77.27%. Also, the method of financing university infrastructure in Niger is inefficient and is based on the national budget with an average annual execution rate of about 48%. In addition, political factors and corruption contribute to the inefficiency of the execution of investment budgets in general and the construction of works in particular.
Keywords : Corruption, Infrastructure deficiency, Investment budget, Niger, Relationship, University strike.
Introduction
La plupart des pays d’Afrique subsaharienne sont passés d’un système de gouvernance basé sur un parti unique au multipartisme vers les années 1990, suite aux mouvements démocratiques. Cette période a été également le début d’une crise universitaire qui, malheureusement, continue à ce jour dans plusieurs pays. En effet, après un développement relativement rayonnant dans les années 1960, les universités africaines sont engagées depuis la décennie 90, dans une phase de recul rapide et surprenant (Y. B. D. Feudjio, 2009, p. 143). Les analyses sur cette crise universitaire ont concerné ses caractéristiques ainsi que ses causes. Les auteurs se sont questionnés sur le manque de moyens financiers consécutivement à la crise économique des années 1980 (A. Abdelkader, 2002, p. 1 ; B. Makosso, 2006, p. 70 ; etc.), sur les libertés intellectuelles et académiques (Y. B. D. Feudjio, 2009, p. 142 ; Diouf et al. 1994) et sur la gouvernance et l’inadéquation de l’enseignement supérieur aux réalités socio-économiques des pays (A. Vinokur, 1994, p. 77).
Le Niger est un pays de l’Afrique de l’Ouest, où l’évolution des institutions de l’enseignement supérieur est caractérisée par deux grands moments qui coïncident avec l’histoire politique du Pays. La période postcoloniale de 1970, une décennie après l’indépendance du Pays au cours de laquelle l’université de Niamey est créée et les années 2000 qui consacrent la décentralisation effective avec les élections municipales de 2004. Le tout premier centre d’enseignement supérieur, devenu plus tard en 1992 Université Abdou Moumouni de Niamey, censée affirmer la souveraineté nationale après l’indépendance du Niger, a vu le jour en 1971. Quant aux autres universités de l’intérieur du pays, elles ont été créées en 2010 et 2014 pour répondre aux exigences de la décentralisation. L’avènement de ces nouvelles universités implantées dans les chefs-lieux des 7 régions du Niger devrait répondre à la fois au flux démographique en rapprochant les étudiants des centres de formation, ainsi qu’à l’évolution économique du Pays. Ce sont donc ces huit (8) universités et l’École des Mines et de la Géologie (EMIG) qui assurent l’enseignement supérieur public au Niger.
Avec ces institutions, le nombre d’étudiants inscrits a augmenté, notamment de 2010 à 2020. Leur nombre a passé de 11 500 en 2010 à près de 54 000 étudiants en 2020 sans que les infrastructures ne suivent. La couverture théorique de l’enseignement supérieur est passée de 135 étudiants pour 100 000 habitants en 2010 à 281 en 2015 et 313 en 2017 et à 245 en 2020 (Cerise, 2019, p. 4). Ce ratio, l’un des plus faibles d’Afrique de l’Ouest avec une moyenne de 600 étudiants pour 100 000 (PSEF, 2013, p. 9), trouble tout de même la quiétude des autorités en charge de l’enseignement supérieur nigérien. En effet, en dépit des engagements pris dans le cadre du nouveau Plan Sectoriel pour l’Éducation et la Formation (PSEF 2014-2024), l’État du Niger peine à satisfaire les besoins des universités, notamment la mise en place des infrastructures.
Au-delà du Niger, il faut dire que les défis pour l’enseignement supérieur en Afrique sont immenses. Hormis la massification due à l’augmentation des effectifs des bacheliers, il faut noter l’insuffisance des ressources humaines en l’occurrence les professeurs de qualité. En effet, les auteurs (Tidjani Alou, 1992 ; B. Makosso, 2006, p. 71) ont bien montré que la croissance rapide des effectifs des étudiants et l’insuffisance des ressources allouées à l’enseignement supérieur concourent à une crise universitaire. Cependant, nous pensons que d’autres facteurs relatifs à la gestion des universités et leurs ressources doivent être pris en compte. Cette situation nous inspire la question suivante : Quel lien existe entre l’insuffisance des infrastructures et équipements et la crise universitaire au Niger ?
Dans l’optique de répondre à ce problème central, l’hypothèse principale que nous émettons est que l’insuffisance des infrastructures engendre des retards académiques dans les universités publiques du Niger.
La présente contribution comporte deux sections. La première s’intéressera à la mise en contexte et à la méthodologie utilisée et la seconde présentera les résultats obtenus. Ainsi, après une présentation des universités publiques du Niger, nous allons procéder à l’historique de la crise universitaire au Niger avant de décrire notre méthodologie. Dans la seconde section, nous allons voir l’état des lieux des universités publiques du Niger avant d’analyser les budgets et les modes de financement des universités qui sont des déterminants de l’insuffisance des infrastructures universitaires au Niger pour finir avec les conséquences de l’insuffisance des infrastructures sur l’enseignement supérieur.
1. Cadre contextuel et méthodologique
1.1. Brève cartographie des universités publiques du Niger
Le Niger est bordé par l’Algérie et la Libye au Nord, le Nigeria et le Bénin au Sud, le Tchad à l’Est, le Mali et le Burkina Faso à l’Ouest. De par cette position, le Niger est à cheval entre l’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est. Cela explique en partie la présence des étudiants de nationalité tchadienne, camerounaise, béninoise et togolaise dans les universités nigériennes. Avec une superficie de 1 267 000 Km et une population estimée à 24,2 millions d’habitants en 2020, le Niger reste l’un des pays très faiblement densifiés avec 19 habitants/km². Sur le plan éducatif, les indicateurs sont de 20 % pour les personnes qui ont le niveau primaire, 5,4 % pour ceux qui ont le niveau secondaire et 0,67 % pour le supérieur (INS, 2012).
Le paysage actuel des universités publiques comprend huit (8) universités implantées dans les chefs-lieux des huit (8) régions du Niger (carte1). Une neuvième dénommée l’Université islamique de Say, un établissement relevant de la coopération multinationale située à 50 km de la capitale Niamey, existe aussi. Toutes ces huit (8) Universités sont placées sous le régime général des Établissements Publics à Caractère Scientifique Culturel et Technique. En ce sens, toutes ces universités ont pour missions de promouvoir l’enseignement supérieur, les formations initiales et continues, de promouvoir la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de diffuser ses résultats notamment dans les domaines en rapport avec les besoins du pays, de contribuer à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique et de former une identité culturelle et une conscience nationale et africaine. Placées sous la tutelle du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, elles sont dirigées par un Recteur et un Vice-recteur nommés par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, après leur élection par la communauté universitaire (enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique et étudiants).
Carte 1 : Les Universités publiques du Niger
Source : données shapfiles IGNN, 2016
1.2. Histoire de la crise universitaire au Niger
Au Niger, l’enseignement supérieur fait face à des difficultés variées depuis son début. En effet, l’État a « sous-traité » l’enseignement supérieur dès son début en 1970 en l’inscrivant dans le prolongement d’un projet colonial avec beaucoup de coopérants français suite à la signature de l’accord de coopération entre le Niger et la France en 1961 (T. Smirnova, 2018, p. 88). Or cette politique a été contestée par les étudiants dans le contexte de mouvement anti-impérialiste. Plusieurs grèves, dont les plus significatives sont celles des années de 1971 à 1977, ont eu lieu à cette période caractérisée par une sécheresse dans pratiquement tout le Sahel. Alors qu’à ce moment, les étudiants nigériens étaient dans des mouvements pour un changement de paradigme pour l’enseignement supérieur, la crise mondiale frappa toutes les économies des pays du monde. C’était l’occasion pour la France de retirer tactiquement l’essentiel de ses coopérants en poste à l’université de Niamey laissant le Niger seul à faire face aux revendications des étudiants. Dès lors, l’État nigérien devient l’unique bailleur de fonds de l’université. Dans le même temps, le pays s’est engagé dans le Programme d’Ajustement Structurel (PAS), imposé par les institutions du Breton Woods. Ce PAS oblige les pays sous-développés à limiter leurs priorités et donc leurs dépenses. En conséquence, la décennie 1980-1990 a été émaillée des difficultés suivies des grèves répétitives dans le milieu scolaire qui malheureusement a atteint son paroxysme avec la mort d’un étudiant, Amadou Boubacar en 1983 (T. Smirnova, C. Noûs, 2020, p. 226).
En outre, il faut signaler que les étudiants ont été à l’avant-garde dans le changement du paradigme pour la gouvernance du Niger. En ce sens, ils se sont engagés dans des mouvements de grèves au début des années 1990 pour l’instauration de la démocratie. Le Syndicat des Scolaires Nigériens (USN) a été l’un des pionniers pour l’instauration de la démocratie au Niger. Les étudiants ont presque oublié les études pour se consacrer à une lutte syndicale en 1990 pour contraindre le parti unique à la démocratie. S’ensuivirent des grèves souvent très violentes occasionnant parfois des pertes en vies humaines, comme ce fut le cas le 9 février 1990 avec la tuerie de 3 écoliers lors d’une gigantesque marche de protestation suivie d’un grand meeting à la place de l’Unité de Niamey. Hormis l’implication des étudiants dans des mouvements démocratiques et politiques, la décennie de 1990 à 2010 a été marquée par une insuffisance des universités et une incapacité de l’État à honorer ses engagements vis-à-vis de la communauté universitaire (E. Grégoire, K. Marou Sama, 2018, p. 429). À ces difficultés se sont ajoutées d’autres, notamment les contraintes budgétaires après la création des 7 autres universités entre 2010 et 2016 et l’ingérence de l’État dans le choix des dirigeants des universités, selon plusieurs plates-formes syndicales des enseignants chercheurs du Niger.
1.3. Cadre méthodologique
Notre méthodologie est basée sur la démarche qualitative et quantitative en vue de collecter les informations sur le terrain. Nous avons utilisé, entre autres, l’observation directe, les entretiens, l’interview et la recherche documentaire, pour la collecte des données. L’observation directe du terrain d’étude a été une étape préliminaire aux enquêtes. Nous avons utilisé une grille de lecture des infrastructures universitaires qui nous a permis de relever l’état des lieux des ouvrages existants des universités publiques. Cette fiche nous a permis de décrire l’état physique, l’exploitation, la pérennisation, la qualité du suivi technique pendant la réalisation, la fonctionnalité et l’efficience des infrastructures.
Il ressort des visites, un dysfonctionnement de certains ouvrages dans les universités. Certaines infrastructures sont soit, mal utilisées soit, surexploitées. Le problème d’hygiène et de promiscuité est visible partout, comme on le voit sur les photos 1 et 2. Au cours de toutes ces sorties qui ont lieu entre le 12 et le 30 avril 2022, nous avons photographié des scènes ou des aspects qui ont servi à illustrer notre travail.
Après l’observation, nous avons interviewé certaines des personnes pour savoir, selon eux, les déterminants de la crise des universités en lien avec l’insuffisance des infrastructures. Ainsi, 10 enseignants chercheurs, 10 personnels administratifs, 50 étudiants, 2 décideurs politiques, 2 responsables syndicaux et 2 parents d’élèves ont été notre cible d’enquête. Ces enquêtés ont été choisis de manière aléatoire. Les interrogations ont porté essentiellement sur l’appréciation des enquêtés relativement à l’état actuel des universités publiques du Niger, aux difficultés liées à la gestion de ces dernières de façon générale. Nous leur avons également soumis des questions pour savoir les causes et les conséquences de l’insuffisance des infrastructures selon eux, avant de leur demander de faire des suggestions dans le sens de l’amélioration de la situation.
La collecte des données statistiques complémentaires s’est effectuée sur internet, au niveau des services techniques nationaux, déconcentrés ainsi qu’auprès des personnes ressources. En ce sens, les rapports de l’Institut National des Statistiques, de la Banque Mondiale, de l’UNESCO, des ministères en charge de l’éducation, des projets et structures syndicales ont été d’une grande utilité. D’autres sources proviennent des documents officiels, de la presse nigérienne et des universités et des centres des œuvres universitaires qui s’occupent des questions sociales dans les universités publiques du Niger.
2. Résultats
2.1. État des lieux des universités publiques du Niger
L’enseignement supérieur au Niger connaît depuis 2010, une certaine expansion avec la création d’universités publiques dans les sept autres régions du pays. En effet, le nombre total des étudiants inscrits dans les UPN est passé comme nous l’avons dit plus haut, de 11 500 en 2010 à près de 54 000 étudiants en 2020, soit une augmentation de plus de 460 % en 10 ans. L’université Abdou Moumouni de Niamey est la plus ancienne et la plus peuplée avec environ, un effectif passé de 10 950 à plus 28 000 étudiants entre 2010 et 2020. Celles de Zinder, Tahoua et Maradi sont passées respectivement de 71 à 7500, 130 à 7400 et de 96 à 6400 sur la même période. Les quatre autres, à savoir Diffa, Agadez, Dosso et Tillabéry créées en 2014 sont également en pleine évolution. Cette forte progression s’explique par la forte croissance démographique du pays (3,9 % par an) et par la volonté des autorités du pays à faciliter l’accès de la jeunesse nigérienne à l’enseignement supérieur (Curie Xplore, 2016, p. 1).
En dépit de la création de ces nouvelles universités, l’enseignement supérieur au Niger reste peu développé par rapport à celui de certains pays de la sous-région, tels que la Côte-d’Ivoire, le Sénégal et le Togo. Cette croissance démographique des universités n’a pas été accompagnée d’une augmentation conséquente en infrastructures. En effet, sur la période 2010-2020, rares sont les universités qui ont bénéficié d’un budget d’investissement. Cette inadaptation entre croissance du nombre d’étudiants et les infrastructures, est due à une insuffisance de vision d’ensemble en termes de nouvelles politiques publiques d’enseignement supérieur. Au-delà, il s’agit d’une « absence d’un plan national de développement de l’enseignement supérieur qui aurait permis une meilleure gestion des flux et d’instaurer une véritable continuité entre enseignement secondaire et supérieur en permettant une orientation plus performante des étudiants » (E. Grégoire et K. Marou Sama, 2018, p. 432 ; A. Yenikoye, 2007).
Les UPN de Tahoua, Maradi et Zinder ont été installées en région sur les sites des Instituts Universitaires de Technologies (IUT) qui existaient deux années avant. Celles de Dosso, Tillabery, Diffa et Agadez ont à peine des sites non encore aménagés. Comme toute jeune institution d’enseignement supérieur, elles font face à de nombreux défis dont les plus urgents sont liés aux besoins d’infrastructures, notamment la construction d’amphithéâtres, de salles de cours et de laboratoires. Les quelques ouvrages exécutés dans certaines universités sont souvent, l’œuvre des partenaires privés qui viennent en appui, ou de certains recteurs qui, malgré l’absence de budget d’investissement, arrivent à faire des réalisations avec leurs maigres subventions de fonctionnement. En conséquence, on assiste à une situation irréelle de promiscuité avec des amphithéâtres, bibliothèques, salles de cours et restaurants bondés d’étudiants. Il y a environ 54 000 étudiants pour à peine, 14 000 places assises pour toutes les UPN.
À titre illustratif la faculté des sciences économiques et de gestion de Niamey compte en première année (tronc commun) plus de 6 000 étudiants pour un amphithéâtre de 1000 places avec beaucoup de problèmes d’étanchéité. Celle des lettres et des sciences humaines (FLSH) de Zinder en a 2 000 pour un amphithéâtre de 500 places. Cette situation amène les autorités académiques à utiliser des infrastructures inadaptées pour les cours et conçues pour des spectacles comme le palais de sport de Niamey (Photo 1). Même les enseignants et le personnel administratif manquent d’espace de travail adéquat. Il faut aussi souligner le problème d’assainissement et d’hygiène dû à l’insuffisance des blocs sanitaires. On en compte 18 latrines pour les 7500 étudiants à Zinder. À la FLSH de Niamey, il y a moins de 15 compartiments de latrine et 3 fosses pour plus de 12 000 étudiants. Cela fait un ratio de 800 étudiants par latrine qui est très loin du standard national de 40 apprenants par sanitaire (République du Niger, 2000). Il est encore plus loin des normes internationales de l’Unicef par exemple qui préconise une latrine pour 25 femmes (Unicef, 2012, p. 16).
Photo 1 : Palais des sports transformé en salle de cours à Niamey
Source : notre enquête, 2021
Hormis l’insuffisance, le niveau d’insalubrité des sanitaires est très critique (Photo 2). Beaucoup d’étudiants surtout les femmes ont du mal à fréquenter les latrines pour satisfaire leurs besoins naturels. Les toilettes sont perçues comme un lieu malpropre incubateur de pathologies infectieuses constituant un enjeu de santé publique (A. C. Nonnote, 2016, p. 1). Une étudiante de l’Université de Maradi explique qu’elle n’a jamais utilisé les toilettes publiques qu’elle trouve très sales pendant 5 ans passés sur le site. Pour elle, les responsabilités sont partagées
Non seulement le nombre est insuffisant, mais aussi les étudiants les utilisent très mal de telle sorte que les manœuvres n’arrivent pas assurer un bon entretien. Et pourtant, les gens sortent directement de ce lieu pour aller directement à la mosquée pour prier, c’est malheureux vraiment. Ces toilettes devraient être nettoyées, irréprochables.
Photo 2 : Insalubrité des sanitaires dans un établissement d’enseignement supérieur à Niamey
Source : notre enquête, 2021
2.2. Les déterminants de l’insuffisance des infrastructures dans les UPN
2.2.1. Les facteurs économiques
Comme nous l’avons plus haut, les UPN sont mal équipées. Certaines sont encore logées de façon éparse, selon le cas, dans différentes maisons privées et établissements publics des villes. Les différents acteurs se plaignent des difficultés liées au sous-financement et à l’abandon inconcevable. En effet, l’État reste quasiment le principal bailleur de fonds des UPN. Si l’effort de l’État est loin d’être négligeable compte tenu des urgences sociales, il reste globalement insuffisant par rapport aux besoins de l’enseignement supérieur. De 2010 à 2020, la part pour les universités dans les budgets n’a jamais dépassé les 4 % du budget général en dépit de l’augmentation des universités. L’essentiel de ce budget alloué au UPN sert au fonctionnement. Les investissements sont donc rarissimes dans les UPN et ne représentent qu’environ 9 % des budgets de l’enseignement supérieur. Toutefois, il faut signaler qu’en 2010 et 2014 compte tenu de la création des nouvelles universités l’État a légèrement augmenté ces budgets d’investissement respectivement à 13 % et 15 %. Mais, les budgets sont faiblement exécutés, officiellement compte tenu de la tension de trésorerie, liée à l’insécurité causée par Boko Haram dans l’Est du pays. En effet, le Niger est confronté à un sérieux problème d’insécurité depuis 2014 qui vient s’ajouter à d’autres difficultés comme la chute du prix de l’uranium et du pétrole. Or, depuis toujours, c’est grâce au boom de l’uranium que les investissements sont réalisés pour développer les UPN (E. Grégoire, K. Marou Sama, 2018, p. 432). Ce furent les cas en 1973, 1985 malgré la crise mondiale de 1980 et en 2007 pour la construction des instituts universitaires de technologie qui abritent présentement les universités de Zinder, Tahoua et Maradi.
Tableau 1 : Évolution du budget de l’enseignement supérieur par rapport au budget général de 2010 à 2020 en milliards de FCA
| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Budget général de l’État | 734,73 | 1006,65 | 1262,76 | 1331,24 | 1867 | 1785,87 | 1785,13 | 1 910,11 | 1 979,97 | 2 274,36 | 2514,4 |
| Budget alloué à Enseignement Supérieur | 36,68 | 44,81 | 46,14 | 52, 18 | 60,23 | 68,29 | 58,96 | 40,85 | 52,36 | 50,81 | 53,2 |
| Part budget Enseignement Supérieur en % | 4,9 % | 4,45 % | 3,65 % | 3,9 % | 3,22 % | 3,82 % | 3,30 % | 2,14 % | 2,64 % | 2,23 % | 2,11 % |
| Investissement exécuté par l’état | 384,16 | 457,49 | 578,31 | 869, 33 | 1 149, 51 | 1013,44 | 1043,11 | 1 052,26 | 1 048,76 | 1164,34 | 1322,24 |
| Investissement prévu pour l’Enseignement Supérieur | 5,32 | 3,53 | 3,83 | 6,6 | 9,36 | 1,19 | 1,19 | 2,59 | 2,86 | 3,78 | 2,4 |
| Part investissement Enseignement supérieur en % | 1,38 % | 0,7 % | 0,66 % | 0,75 % | 0,81 % | 0,88 % | 1,14 % | 2,4 % | 2,72 % | 3,24 % | 1,81 % |
Source : Ministère des Finances
Entre 2010 et 2015, on remarque une progression en termes numériques du budget alloué au secteur de l’enseignement supérieur. Une diminution est constatée en 2016 compte tenu du détachement de l’enseignement secondaire au supérieur. L’évolution du budget se fait en dents de scie entre 2016 et 2020. 58 960 000 000 en 2016, 40 850 000 000 en 2017, 52 360 000 000 en 2018, 50 800 000 000 en 2019 et 53 200 000 000 en 2020. En termes de pourcentage, le budget alloué à l’enseignement supérieur représente environ 2,5 % du budget général.
Cela est très loin de satisfaire les engagements pris par le Niger au forum mondial sur l’éducation pour tous de 2000. Ces engagements pour garantir un accès de tous à l’éducation font obligation au Niger de consacrer un taux minimum de 20 % de son budget au secteur de l’éducation. Or de façon générale, au Niger, ces dernières années, le budget alloué à l’éducation est inférieur au taux minimum de 20 %. Il était de 13 % en 2010, 19 % en 2018. Les ressources allouées au secteur de l’éducation de façon générale, et l’enseignement supérieur en particulier, ne permettent pas à l’État de respecter ses engagements internationaux en occurrence l’objectif 4 des ODD « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ; il s’accompagne de sept cibles et de trois modalités de mise en œuvre » d’ici 2030.
2.2.2. Le mode de financement des infrastructures universitaires au Niger
Le financement de l’enseignement supérieur au Niger repose essentiellement sur les ressources de l’État depuis l’indépendance comme nous l’avons dit plus haut. Cependant, sur le plan juridique et organisationnel, d’autres partenaires comme les collectivités territoriales, les sociétés ou les personnes physiques peuvent contribuer au financement de ce secteur selon la Loi d’Orientation de l’Éducation au Niger (LOSEN) et le Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation (PSEF 2014-2024). Cette stratégie qui consiste à orienter le financement de l’enseignement supérieur vers des partenaires économiques, techniques et sociaux semble être la condition pour développer le secteur au regard de l’insuffisance des ressources publiques.
Mais dans la pratique, les résultats sont mitigés, le budget d’investissement est toujours centralisé au niveau du ministère qui peine à asseoir des politiques publiques et des actions concrètes et stables pour la promotion et l’accès de tous à un enseignement supérieur de qualité. En effet, malgré un cadre législatif et institutionnel favorable, avec des directions techniques comme celles des infrastructures et des équipements, d’études et de programmations, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’a toujours pas un schéma directeur clair pour le financement des ouvrages au sein des universités. Cela explique la modeste part du budget d’investissement et son faible taux d’exécution. De 2010 à 2020, ce taux tourne autour de 66 % malgré la demande pressante des universités. En outre, le Ministère peine à signer des conventions de financements des universités avec les sociétés et les bailleurs sociaux comme la Nigérienne d’Électricité (NIGELEC), la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ), la Société des Produits Pétroliers (SONIDEP), ONG, etc. Ces sociétés sont disposées à financer la construction des infrastructures compte tenu de la responsabilité sociétale à des coopérations avec les universités selon plusieurs voix autorisées.
Avec le ministère de l’équipement et les programmes de modernisation des villes, elles ont financé la réalisation de plusieurs infrastructures dans les grandes villes du Niger à l’occasion des fêtes tournantes de la république et dans le cadre du programme Niamey N’gnala (la coquette). Il faut tout de même reconnaître des vaines tentatives du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Niger de diversifier les partenaires. Ce fut le cas en 2014 quand un vaste projet de construction de 5 amphithéâtres et des dortoirs de plus de 5000 lits dans les UPN a été signé avec une société burkinabée dans le cadre d’un projet de Partenariat Public et Privé. Ce projet n’a jamais vu le jour malgré les implantations des sites qui sont encore visibles sur les campus des universités de Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder.
Sur tout un autre plan, les facteurs politiques, techniques et la corruption sont aussi à prendre en compte pour expliquer l’insuffisance des infrastructures universitaires. En effet, presque tous les marchés de construction dans les UPN sont mal attribués. Ils sont attribués à des entrepreneurs, membres ou affiliés du parti au pouvoir dont certains n’ont pas les qualifications avérées. Très souvent, ils rencontrent des problèmes techniques et organisationnels au cours de l’exécution des chantiers. C’est donc à juste titre qu’un internaute nigérien s’insurge sur la toile en disant que le Niger est : « un pays dans lequel, il suffit simplement d’être du côté du régime, pour avoir les facilités d’accès à la commande publique, et devenir riche en une fraction de seconde ». Aussi faut-il dire qu’un seul agent technique en l’occurrence le Directeur des Infrastructures et des Équipements Universitaires (D. I.E.U) s’occupe des infrastructures au niveau du Ministère en charge de l’enseignement supérieur au Niger. Ce monsieur à lui seul, ne peut être efficace pour s’occuper du Ministère et des huit 8 universités sur le plan technique. Il s’ensuit des retards d’exécution, des malfaçons techniques, des chantiers sans suivi technique et souvent mal intégrés au site, etc.
2.3. Les conséquences de l’insuffisance des infrastructures sur l’enseignement supérieur
2.3.1. Les grèves dues à l’insuffisance des infrastructures
Comme nous l’avons vu au point 3.1., les universités publiques rencontrent plusieurs difficultés. Celles liées à l’insuffisance des infrastructures sont les plus illustratives non solutionnées. Ces difficultés conduisent très souvent, à des grèves répétitives dans les institutions universitaires publiques nigériennes. Les quatre syndicats du secteur de l’enseignement supérieur, notamment le Syndicat National des Enseignants Chercheurs du Supérieur (SNECS), le Syndicat National des Enseignants des Instituts et des Grandes écoles (SNEIGE), le Syndicat National des Personnels Administratifs et Techniques (SYNPAT) et l’Union des Scolaires du Niger (USN) débrayent très souvent au point que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche actuel leur demande de faire l’économie des grèves. Le point de revendication commun à ces quatre syndicats qui revient en leitmotiv dans les plates-formes est l’insuffisance des infrastructures. Celle-ci se traduit par des capacités d’accueil très limitées des amphithéâtres, des salles de cours, des salles de travaux dirigés/publics, des bureaux pour enseignants et personnels et le manque de laboratoires dans plusieurs universités. Les bibliothèques universitaires sont par moment, mal équipées et ne disposent pas de connexion internet adéquate.
Sur 22 plates-formes revendicatives des différents syndicats de l’enseignement supérieur entre 2000 et 2020, 17 ont un lien avec l’insuffisance des infrastructures, soit 77,27 %. En effet, le point de désaccord majeur Gouvernement-Syndicats de l’enseignement supérieur concerne l’insuffisance d’infrastructures et d’équipements. Selon plusieurs enquêtés, cette insuffisance d’infrastructures est réelle et concerne toutes les universités du Niger à des degrés différents. Pour le Secrétaire Général des étudiants de l’université de Zinder de 2020, sa base ne peut qu’entrer en grève quand on ne compte que 32 salles de cours avec plus de soixante-dix (70) niveaux d’étude. Le problème est plus préoccupant pour les étudiants inscrits dans les facultés de sciences de la santé et technique qui ne disposent pas de laboratoire.
S’agissant du volet « hébergement », les étudiants se retrouvent à 8 dans une chambre qui est initialement destinée à accueillir 2 étudiants. Depuis 2010, chaque reprise des cours au mois de septembre, est perturbée par des mouvements de grèves relatifs à l’insuffisance des infrastructures. Selon un parent d’élève de la ville de Maradi, les acteurs de l’enseignement supérieur ont toujours dénoncé l’absence de laboratoires, le besoin énorme en salles de cours, d’amphithéâtres et d’hébergement des étudiants dans toutes les universités, dans pratiquement toutes plates-formes revendicatives. Ces arrêts de travail durent par moment plus de 4 semaines avant que les parties ne s’entendent pour une reprise des activités. En général le problème est toujours reporté mais jamais résolu ramenant les syndicats à débrayer à nouveau.
Pour ces revendications, il arrive que des acteurs syndicaux utilisent des moyens inhabituels pour se faire entendre. Ce fut le cas le 25 avril 2022 quand les étudiants de l’Université de Zinder ont décidé de construire et d’inaugurer en grande pompe, la première salle de cours en paillotes (photo 3). Une construction en matériau sommaire qui n’est pas tolérée sur le campus universitaire juste pour montrer à la face du monde que le gouvernement ne les écoute pas. Par ce geste, les étudiants ont créé un « buzz » pour manifester contre ce qu’ils appellent « l’insouciance du gouvernement » face à leurs revendications.
Photo 3 : Cérémonie d’inauguration d’une salle en paillote par les étudiants en grève à Zinder
Source : David, 2022
Au vu de ce qui précède, on voit bien une inadéquation entre l’augmentation des effectifs des étudiants et le développement des universités au Niger entre 2010 et 2020. L’écart est tel que personne ne peut rester insensible, à commencer par le personnel et les étudiants des UPN, qui très souvent, exigent l’amélioration de leur cadre de vie. En effet, le refrain « nous exigeons la construction des amphithéâtres, bibliothèques, laboratoires, restaurants, etc. » revient en boucle sur les plates-formes revendicatives. Le gouvernement à chaque occasion de dialoguer avec les partenaires sociaux, tente de se justifier par rapport à la modicité des moyens didactiques en général. Il arrive également que le gouvernement fasse des promesses qu’il peine à honorer. C’est le cas par exemple, en 2018 quand les étudiants de l’université de Zinder étaient en grève pour exiger la clôture du campus compte tenu de l’insécurité. Ce projet, quoique modeste de 120 000 000 FCFA (182 900 euros) n’a toujours pas vu le jour.
2.3.2. Des programmes d’enseignements : retards occasionnés par l’insuffisance des infrastructures
L’insuffisance des infrastructures universitaires occasionne des retards dans l’exécution des programmes d’enseignement. En effet, avec 0,50 place assise/étudiant, les cours programmés pour un semestre de 4,5 mois selon les normes s’étalent jusqu’à 9 mois. Cette situation constitue un véritable frein pour normaliser les années universitaires au Niger. C’est dire que le souhait des autorités politiques nigériennes qui consiste à une normalisation des années universitaires, à partir de 2022, ne se réalisera point si les infrastructures restent telles sous le rapport de leur nombre. Tout cela, en dépit de la location de salles inadaptées en ville et la mise en place temporaire par les acteurs de locaux pour certaines universités. Le sureffectif constitue une réalité à laquelle les étudiants nigériens comme ceux d’autres pays africains sont confrontés (B. Makosso, 2006, p. 71).
Dans certaines facultés, les étudiants attendent pendant plus de 7 mois avant même de commencer les cours programmés. Cette situation décourage beaucoup d’entre eux. Certains préfèrent passer un test pour faire le contrat brut en éducation ou un concours de la gendarmerie ou la police plutôt que de poursuivre les études à l’université.
Conclusion
En somme, les Universités Publiques du Niger font face à une insuffisance en infrastructures notamment à Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder, voire une quasi-inexistence des équipements/infrastructures dans les UPN récemment créées en 2014 Dosso, Agadez, Diffa et Tillabéri. Ces dernières ne disposent que des sites non encore aménagés, le plus souvent très loin des villes. Dans toutes ces universités, on constate un sous-équipement, une insuffisance des salles de cours, des bibliothèques et des laboratoires. Plusieurs facteurs économiques, modalités de financement, politiques, techniques concourent à cette insuffisance. Il en résulte des grèves répétitives des différents syndicats, des retards occasionnés par l’insuffisance de ces infrastructures, des problèmes d’hygiène des locaux, la promiscuité dans les cités universitaires et dans les amphithéâtres. Tout cela constitue une crise et une violence à l’égard de la communauté universitaire. Ainsi, notre hypothèse de départ qui stipule que l’insuffisance des infrastructures engendre des retards académiques dans les universités publiques du Niger est confirmée.
Références bibliographiques
ABDELKADER Aghali, 2002, « En Afrique, l’enseignement supérieur sacrifié », in Le Monde Diplomatique, https://www.monde-diplomatique.fr/2002/03/ABDELKADER/8585.
CERISE, 2019, étude sur les stratégies de tutelle des universités publiques et la mise en place d’un contrat de performance entre le ministère et les universités publiques du Niger (UPN). Niamey, rapport d’étude, 98 p.
CURIEXPLORE, 2016, Politique d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation Orientation stratégique, Ministère des Affaires étrangères et du développement international, CurieXplore Fiche Niger, https://curiexplore.enseignementsup recherche.gouv.fr.
FEUDJIO Yves Bertrand Djouda, 2009, « L’adoption du « système LMD » par les universités du Cameroun : enjeux, contraintes et perspectives », in Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique JHEA/RESA,Vol. 7, N°1 & 2, 2009, pp. 141–157.
GREGOIRE Emmanuel et MAROU SAMA Kadijatou, 2018, « Constitution d’une communauté scientifique dans un pays moins avancé : le cas du Niger dans les ancrages nationaux de la science mondiale XVIIIe – XXIe siècles », in Sous la direction de Mina Kleiche Dray, Éditions des archives contemporaines, en coédition avec IRD Éditions pp. 423-448.
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, 2012, Recensement général de la population et de l’habitat 2012, rapport sur alphabétisation, le niveau d’instruction et la fréquentation scolaire, 59 p.
MAKOSSO Bethuel, 2006, « La crise de l’enseignement supérieur en Afrique francophone : une analyse pour les cas du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, et de la Côte d’Ivoire », in Journal of Higher Éducation in Africa/Revue de l’enseignement supérieur en Afrique, 2006, Vol. 4, N 1, pp. 69-86, in https://www.jstor.org/stable/43658260.
NONNOTTE Anne Claire, 2016, Les toilettes scolaires, in https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/medecine/les-toilettes-scolaires
RÉPUBLIQUE DU NIGER, 2013, Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation [2014-2024] ; Document de stratégie, 91 p.
SMIRNOVA Tatiana et NOÛS Camille, 2020 « La violence comme mode de régulation politique : la Caso et les mobilisations étudiantes dans le Niger des années 1990 », in Dans Politique africaine 2020/1, (N°157), pp. 223 à 232.
SMIRNOVA Tatiana, 2018, « L’action publique dans l’enseignement supérieur à travers la contestation des scolaires et des étudiants au Niger [1960-2010] », in État réhabilité en Afrique Réinventer les politiques publiques à l’ère néolibérale,Sous la direction de Emmanuel Grégoire, Jean-François Kobiané et Marie-France Lange, Paris, Édition Karthala, 22-24, pp. 87-103.
TIDJANI ALOU Mahaman, 1992, Les politiques de formation en Afrique francophone : école, et sociétés au Niger, thèse de doctorat en sciences politiques, Université de Bordeaux I.
Unicef, 2012, Eau, Assainissement et Hygiène [WASH] dans les écoles, Rapport complémentaire au Manuel des écoles amies des enfants, p. 58.
VINOKUR Annie, 1994, « Les systèmes éducatifs et leur régulation », in Afrique Contemporaine, 197, p. 77-91.
PROBLÈMES DE LOGEMENTS D’ÉTUDIANTS ET CRISES ACADÉMIQUES À L’UNIVERSITÉ PELEFORO GON COULIBALY, KORHOGO
Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d’Ivoire)
Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
À Korhogo, la construction de logements a du mal à suivre le taux de croissance urbaine. Cela entraine des difficultés d’obtention de logement. Les étudiants n’échappent pas à cette réalité du fait de l’évolution rapide de leur nombre. En dépit des efforts du Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU-K) qui a mis à leur disposition des résidences universitaires, les étudiants sont confrontés aux problèmes de logements. Cette situation influence inéluctablement leurs résultats académiques, les rendant souvent mécontents, si bien que l’on est en droit de se demander si le problème de logement des étudiants de Korhogo n’est pas l’un des principaux facteurs de crises à l’Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC).
Cette étude vise à déterminer le lien entre les crises en milieu universitaire et l’insuffisance de logements décents pour les étudiants. Nous avons procédé à une recherche documentaire et une enquête de terrain à travers un sondage réalisé sur 200 personnes à partir de la technique du choix raisonné. Nous avons aussi échangé avec le responsable de la vie étudiante de l’UPGC, le Directeur adjoint du CROU-K et les responsables syndicaux du campus. Les résultats révèlent que le problème de logement est un problème secondaire et vient en sixième position après l’insuffisance de salle de cours (30%), l’absence de climatisation dans les salles de cours (17,50%), la non délivrance des cartes d’étudiant (14,50%), le manque de matériels didactiques et de laboratoire (13,50%) et les prix exorbitant des livres (6%).
Mots clés : Crises, Étudiants, Korhogo, logement, université, Ville.
Abstract:
In Korhogo, the construction of housing is not following the urban growth rate. That causes problem of obtaining affordable housing. The students are undergoing this situation because of the rapide increase in the number of them. Despite the efforts of the Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU-K) to solve these issues, the students are facing with the problem of accommodation. This situation inevitably impacts their academic performances which make them often dissatisfied. We ask ourselves to know whether the accommodation issues of the students are not the main cause of the multiple crisis in the campus of the University Peleforo GON COULIBALY of Korhogo (UPGC).
This study aims to determine the link between the multiple crisis on the campus and the lack of the decent accommodation for the students. We conducted a literature research and field survey through a survey which involved 200 people according the technique of rational choice. We also spoke with the the chief of the service of student life of the university, with the vice director of the CROU-K and finally, with the officials of the students unions. The results of the study reveal that the problem of student housing is not the main problem of the students, but the 6th in term of classification. The main problems of the students are the lack of classroom (30%), the lack of air conditioning in the classroom (17,50%), the lack of issue of student cards (14,50%), the lack of the teaching materials and laboratory equipments (13,50%) and the excessive price of the books (6%).
Keywords : Crises, Students, Korhogo, housing, university, City.
Introduction
Le logement est un lieu d’habitation. C’est un local, un appartement ou une maison et plus généralement tout endroit où une ou plusieurs personnes peuvent s’abriter, en particulier pour se détendre, dormir et manger en privé (Merlin, Choay, 2000, p. 466). Un Homme a besoin d’un toit, d’un logement pour se construire et participer à la vie collective. Le logement, c’est pour la protection de l’individu contre les intempéries, la protection contre des agressions et offrir une certaine intimité contre les indiscrets. » (Leroux, 1983, p. 25). Le logement est une nécessité absolue pour l’homme et est un facteur d’épanouissement social. Le manque de logement décent crée des situations d’inconfort, de maladie et de violence. Ainsi, on enregistre plus de cas de violence dans les quartiers précaires et surpeuplés que tout autre quartier.
Le logement étudiant est un type de logement spécialement dévolu à la catégorie de la population qui poursuit des études supérieures et englobe principalement les résidences ou cités universitaires et les résidences privées louées par leurs propriétaires exclusivement à des étudiants. Selon une enquête en 2003 de l’Observatoire national de la Vie Étudiante, plus de 60 % des étudiants quittent le domicile de leurs parents pour poursuivre des études. Ceux-ci portent alors le nom « décohabitants ». Parmi ceux-ci, 15 % se dirigent vers des résidences collectives (cités U, foyers, etc.), 20 % dans un appartement seul, 10 % en couple, 5 % en colocation.
Selon Martin Andler et al (2015, p. 1), pendant des décennies, la France a sous-financé l’enseignement supérieur, en particulier, les universités. Une conséquence notable de cet état de fait en est le manque criard de logements pour les étudiants, dont ceux-ci font douloureusement l’expérience au début de chaque année universitaire, en raison d’une forte pénurie et de prix très élevés dans la plupart des villes universitaires. Pour les étudiants « décohabitants », qu’ils le soient par nécessité ou par convenance, le logement est de loin, ce qui pèse significativement sur leur budget. Ainsi, la question du logement occupe une place centrale dans la décision d’entreprendre ou de poursuivre certaines études. Cela amène parfois certains étudiants à renoncer à tel ou tel cursus parce que le logement est trop cher dans la zone recherchée. Le logement se trouve donc au centre des problématiques d’égalité des chances. C’est pourquoi il faut envisager des solutions pour qu’il cesse d’être un instrument de discrimination pesant sur les choix d’orientation des étudiants issus des milieux les moins favorisés.
Le problème de logement est vécu également dans les universités africaines et est souvent la cause de grève des étudiants. Pour Théophile et George (2013, p. 32-33), l’Université Oumar Bongo du Gabon aura vécu en moyenne une grève d’étudiants tous les deux ans de 1971 à 1990. Les origines de ces mouvements selon les revendications des étudiants, indiquent un déficit de structures d’accueil et de travail, les problèmes académiques, la bourse, le restaurant et le logement universitaires.
Par ailleurs, ces auteurs soulignent qu’à partir de l’année académique 1990-1991 jusqu’à nos jours, la moyenne des grèves et autres formes de manifestations de mécontentement est devenue presque annuelle. Selon toute vraisemblance, les revendications signalées par les acteurs et la documentation répertoriée indiquent la saturation des structures d’accueil, le déficit des enseignants, les conditions de travail précaire, l’insuffisance des résidences universitaires, etc. Dans un communiqué levant le mot d’ordre de grève entamée le 12 janvier 2015 à l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, le président national de Renaissance Etudiante et Scolaire (RETS) a indiqué les motifs de la grève qui se résument en onze points dont l’insuffisance des résidences universitaires et la faible attribution des logements au point huit des revendications.
À Korhogo, cette situation entraine généralement des difficultés de logements. Les étudiants de Korhogo n’échappent pas à cette situation où se loger devient une préoccupation majeure. Selon le directeur adjoint du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Korhogo (CROU K) sur 3000 à 4000 demandes d’admission en chambres universitaires, le CROU K ne dispose que 1180 lits. Par la présente étude nous déterminons le lien de causalité entre les crises en milieu universitaire et l’insuffisance de logements décents pour les étudiants de l’Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo.
1. Matériel et Méthodes
1.1. Justification et présentation de la zone d’étude
Située au nord de la Côte d’Ivoire à 632 Km d’Abidjan la capitale économique, la ville de Korhogo est le chef-lieu du District des savanes et de la région du Poro. Depuis la fin de la crise militaro-politique en 2011, cette ville connait une croissance démographique spectaculaire et une extension spatiale rapide et remarquable (figure 1).
Figure 1 : La zone d’étude
La population urbaine de Korhogo est passée de 45.250 habitants en 1975 à 109.655 habitants en 1988 et atteint les 444.000 habitants en 2021 (INS, 1975, 1988,1998, 2021). Cette croissance démographique est due en partie à l’exode rural, aux affectations nombreuses des fonctionnaires, à l’immigration des populations des pays de la sous- région et surtout à l’ouverture de l’Université Peleforo GON COULIBALY.
Plusieurs raisons ont milité en faveur du choix de Korhogo pour cette étude. Au plan géographique, Korhogo est aujourd’hui, une ville en pleine expansion et représente selon l’Institut National de la Statistique (INS, 2021), la plus grande ville du Nord et la 3ème plus grande ville du pays du point de vue géographique, démographique et économique, grâce au dynamisme de ses habitants dans diverses activités. La ville de Korhogo regroupe plusieurs services à savoir l’université, le CAFOP, l’INFAS, des lycées, le Conseil Régional et le Tribunal et apparait ainsi comme la « capitale » du Nord de la Côte d’Ivoire.
1.2. Les méthodes
La démarche adoptée pour la conduite de cette étude a consisté d’abord à définir une hypothèse. Elle stipule que les crises universitaires ont de multiples facteurs dont les problèmes de logement. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons entrepris une enquête documentaire et une enquête de terrain. Ces deux techniques ont permis la collecte des données primaires et secondaires. Concernant la recherche documentaire, elle a permis de faire un inventaire des ouvrages qui ont abordé la thématique urbaine des logements.
Ces ouvrages consultés pour certains, à la Bibliothèque de l’Université Peleforo GON COULIBALY et pour d’autres, sur internet ont permis d’avoir des données textuelles. Quant à l’enquête de terrain, elle s’est effectuée par l’observation directe et par les entretiens. L’observation de terrain a permis de recueillir des données primaires relatives aux logements des étudiants (observation du cadre de vie) et aux moyens de déplacement. Pour ce qui est de l’enquête par entretien, des questions ont été adressées au Directeur Adjoint du CROU K, au responsable de la pédagogie et de la vie universitaire de l’université, aux responsables syndicaux et aux étudiants afin de mieux comprendre le lien entre les crises universitaires et l’insuffisance de logement décent pour les étudiants de l’UPGC. Au total, 200 étudiants sélectionnés selon la technique du choix raisonné ont été interrogés.
2. Résultats et discussion
2.1. Résultats
2.1.1. Les types de résidence des Étudiants de Korhogo
Les étudiants de l’université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo habitent pour la majeure partie dans les différents quartiers de Korhogo. D’autres par contre, habitent dans les périphéries, voire dans les communes environnantes telles qu’à Tioroniaradougou, Napiéledougou. Seulement 12,5% habitent dans les résidences universitaires sur le campus (figure 2).
Figure 2 : Répartition des étudiants selon leurs lieux de résidence à Korhogo
La figure 2 montre la répartition des résidences des étudiants dans la ville de Korhogo. À l’analyse de la figure, on note 35 lieux d’habitation des étudiants. 12,5 % des étudiants enquêtés habitent sur le campus dans les résidences universitaires. Au moins 30% des étudiants habitent à plus de 5 Km de l’Université. Plusieurs raisons expliquent la diversité de ces lieux d’habitation.
2.1.2. Les raisons du choix du lieu d’habitation
Plusieurs raisons expliquent le choix des lieux d’habitation des étudiants dans la ville de Korhogo (tableau 1).
Tableau 1 : Raison du choix du lieu d’habitation
| DESIGNATION | Pourcentage (%) |
| Proximité avec les salles de cours | 17,5 |
| Maison disponible à coût abordable | 8 |
| Convenance personnelle | 1 |
| Manque de tuteur | 22,5 |
| Exigences familiales | 19 |
| Contraintes financières | 21 |
| Tuteurs | 11 |
| TOTAL | 100 |
Source : Nos enquêtes, 2022
Le tableau n°1 montre les raisons du choix du lieu d’habitation des étudiants de la ville de Korhogo. Ainsi, 22, 5 % des étudiants enquêtés habitent des logements indécents par manque de tuteur. Ce sont des étudiants qui n’ont pas suffisamment de moyen et qui veulent habiter chez un bienfaiteur pour pouvoir poursuivre leurs études. A défaut d’avoir un tuteur, ils cohabitent par groupes sous le rapport de certaines affinités pour pouvoir faire face aux frais mensuels de loyer. Les économiquement faibles (21%), n’ont pas exprimé de désir d’habiter chez un tuteur, mais vivent tout de même dans des conditions difficiles. 17,5% des étudiants enquêtés vivent sur le campus en résidences universitaires ou dans des habitations proches du campus. Ce sont des étudiants qui vivent dans un confort relativement acceptable avec des aires de jeux pour pratiquer tout type de sport, avec des buanderies, un restaurant et des préaux. Ces étudiants, pour la plupart boursiers, ont des résultats scolaires satisfaisants, car ils valident pratiquement toutes leurs unités de valeurs en fin d’année. Il faut aussi ajouter qu’il existe au CROU, 1.100 lits pour presque 4.000 demandeurs sur 8.000 étudiants que compte l’université. Par ailleurs, 19 % des étudiants enquêtés vivent en famille parce qu’étant natifs ou originaires de Korhogo. A ce niveau, il s’avère que 46% des enquêtés vivent très éloignés du campus universitaire, ce qui peut impacter leurs résultats académiques.
2.1.3. Les raisons principales des crises à l’université
Les problèmes, motifs de grève à l’université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo sont énumérés dans le tableau (2) suivant.
Tableau 2 : Les problèmes majeurs à l’université
| Désignation | Effectif | Pourcentage (%) |
| Insuffisance de salle de cours | 60 | 30 |
| Problème de climatisation des salles de cours | 35 | 17,50 |
| Non délivrance des cartes d’étudiant | 29 | 14,50 |
| Manque de matériels didactiques dans les salles et laboratoires | 27 | 13,50 |
| Prix exorbitant des livres | 12 | 6 |
| Manque de logement | 10 | 5 |
| Manque d’électricité dans les salles de cours | 6 | 3 |
| Quantité et qualité des plats au restaurant de l’université | 5 | 2,5 |
| Problème de bus de transport | 5 | 2,5 |
| Non exprimé | 5 | 2,5 |
| Bourses impayées | 4 | 2 |
| Non prise en compte des réclamations | 2 | 1 |
| TOTAL | 200 | 100 |
Source : Nos enquêtes, 2022
À l’analyse de ce tableau, on constate que le problème majeur comme motif de grève à l’université est le manque de salle de cours selon 30% des étudiants enquêtés. Ce problème est suivi par celui de la chaleur dans les salles tels que l’indique 17.50 % des enquêtés. Cela s’explique par la défaillance des climatiseurs qui ne sont pas réparés depuis des années. Sur 5 amphithéâtres, la climatisation est défaillante dans 2, sur les 30 salles de cours de Travaux Dirigés (TD), la climatisation est défaillante dans 26 salles. On retient donc que les problèmes majeurs sont d’ordre infrastructurel et structurel, en admettant que celui de la délivrance des cartes d’étudiant relève du structurel. Seulement moins de 1 tiers des étudiants possède la carte d’étudiant. En conséquence, plusieurs étudiants en fin de cycle n’ont jamais possédé de carte d’étudiant.
Après analyse des préavis de grève déposés auprès de l’administration de l’université, force est de constater que les problèmes majeurs soulevés par les syndicats des étudiants et des enseignants chercheurs pouvant être des motifs de grève sont liés au manque ou à l’insuffisance des infrastructures académiques, des bus de transport d’étudiants. Or ceux-ci sont très rares alors même que la fourniture du service s’arrête à 18h alors que la fin des cours à l’université est prévue pour 18h30. Il y a également le problème de la qualité et de la quantité des repas servis dans le restaurant de la cité universitaire et enfin le problème des bourses. Quant au problème de logement, les étudiants l’évoquent, et soulignent qu’ils sont pour la plupart démunis et ne peuvent ni louer une chambre en cité ni louer une chambre décente en ville. Concernant la bourse, il y a eu des efforts. En effet, de nombreux étudiants de l’université sont boursiers, mais ils décrient le non-paiement des bourses à la période indiquée.
2-1-4. Le manque de logement : motif de grève ?
À Korhogo, le problème de logement ne constitue pas un motif de grève. Les étudiants en parlent mais pas au même degré que les problèmes de salle de cours, et autres problèmes soulevés. Les résultats de l’enquête à travers le graphique (3), confirment cette thèse.
Figure 3 : Lien entre les problèmes de logement et les grèves
À l’analyse du graphique 3, on constate que 65% d’étudiants enquêtés affirment que les problèmes de logement ne peuvent en soi et en aucun cas, expliquer les grèves et autres manifestations d’humeurs sur le campus. Par conséquent, le problème de logement devient secondaire comme le montre d’ailleurs le tableau n°3. On y voit que le problème de logement vient en sixième position après ceux de l’insuffisance de salle de cours (30%), l’absence de climatisation des salles de cours (17,50), la non-délivrance des cartes d’étudiant (14,50), le manque de matériels didactiques dans les salles (13,50) et laboratoires et les prix exorbitant des livres (6%). Ce manque d’exigence des étudiants en ce qui concerne l’insuffisance des résidences universitaires, s’explique sans doute, par le manque de moyens des étudiants qui n’ont généralement pas le minimum pour payer les frais de loyer des chambres en résidences universitaires.
Pour faire face à ce problème, le service social de l’université essaie de venir en aide aux étudiants les plus démunis en leur trouvant des logements au prix abordables en ville, et discuter des conditions de paiement. Pour l’année académique 2020-2021, le service social a traité deux (2) cas sociaux en facilitant leur logement et le paiement des loyers.
2.2. Analyse et Discussion
Au regard des résultats de la présente étude, nous pouvons affirmer que les crises universitaires ont de multiples facteurs dont les problèmes majeurs sont d’ordre infrastructurel et structurel. Le manque de logement ne constitue pas, à lui seul, un motif de grève.
Les motifs de grève à l’Université Péleforo Gon Coulibaly, sont nombreux. Ces motifs de grève, selon l’ordre d’importance, sont : l’insuffisance de salle de cours, le problème de climatisation dans les chambres, la difficulté d’obtention de cartes d’étudiants, le manque de matériels de laboratoire, l’insuffisance de logements décents, la quantité et la qualité insuffisantes des plats de restaurant et la question cruciale des bourses non payées. Cette situation s’explique selon S.K Koffi et al (2014, p. 2), cité par B Makosso (2006), par le fait que depuis les années 1980, on assiste dans la plupart des pays africains, à une réduction d’environ 19,1%, de la part moyenne du budget alloué à l’enseignement supérieur du fait de la persistance de la crise économique, du poids de la dette et de la poursuite des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) (Banque Mondiale, 1995).
Selon ces auteurs, pendant ce temps, le nombre d’étudiants a considérablement augmenté alors que le rythme de recrutement des enseignants et de création d’infrastructures n’a pas été suffisant pour assurer des conditions d’encadrement satisfaisantes. L’enseignement supérieur en Afrique entre alors, dans une phase de crise de fonctionnement en raison de la forte croissance démographique et de l’instabilité politique en 1990 (Makosso, 2006, pp. 69-86). En Côte d’Ivoire, l’Université d’Abidjan qui ne comptait que 48 étudiants en 1959, est passée en 1977 à 7 587 étudiants pour atteindre 44 000 en 1992 (Sato, 2003), puis à 58.076 en année académique 2020-2021 (https://univ-fhb.edu.ci).
Les infrastructures deviennent de ce point de vue, insuffisantes et inadaptées, entachant la qualité de l’enseignement et suscitant de nombreuses crises dans les espaces universitaires partant des arrêts de cours à des violences. Cependant, au-delà des résultats de l’étude qui montrent que les causes des crises à l’Université Peleforo GON COULIBALY sont majoritairement des revendications infrastructurelles et financières, il faut noter tout de même que la satisfaction des conditions de logement des étudiants participera à l’amélioration des résultats scolaires des étudiants. Tout cela, parce qu’on sait qu’un bon cadre de vie conditionne la vie et la bonne condition de vie est un gage de tranquillité, et de succès. Dans ce sens, selon Marie Gouyon (2006, p. 1), disposer de sa propre chambre apparaît associé à la réussite scolaire, soit parce que sont ainsi créées les conditions propices au travail, soit parce qu’attribuer une chambre individuelle témoigne d’un fort intérêt des parents pour les études de leurs enfants.
Conclusion
Les crises en milieu universitaire n’ont pas un véritable lien avec le manque de logement à l’université de Korhogo et aussi dans d’autres universités du pays. Les véritables facteurs de revendication sont liés au manque d’infrastructures académiques, et de matériels didactiques et de laboratoire. Mais force est de constater aussi que l’insuffisance des logements estudiantins est toujours inscrite sur les préavis de grève des différents syndicats. Beaucoup d’efforts ont été faits par la direction du CROU KORHOGO pour permettre aux étudiants d’être mieux logés, mais d’autres efforts doivent encore être faits pour résoudre définitivement le problème en tant que cause de l’échec des étudiants. L’amélioration du cadre de vie des étudiants participera sans doute, à pacifier davantage le campus universitaire, car il est démontré qu’un bon cadre de vie conditionne la vie et une bonne condition de vie est un gage de tranquillité et de succès.
Références bibliographiques
BANQUE MONDIALE, 2003, Enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : Quels leviers pour des politiques financièrement soutenables ?, 52 p.
KOFFI Sosthène Konan, KOUADIO Brou Justin, KOMENAN Beugré Raphael et ZERBO Awa Christelle Anne, 2014, « Quelle stratégie pour le maintien des enseignements à l’université de Bouaké pendant la période de crise socio-politique de 2002 en Côte d’Ivoire », in Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°1, 201496 97, EDUCI, IREEP/Université Alassane Ouattara.
MAKOSSO Bethuel, 2006, « La crise de l’enseignement supérieur en Afrique francophone : une analyse pour les cas du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, et de la Côte d’Ivoire », in JHEA/RESA Vol. 4, N°1, pp. 69-86.
MARIE Gouyon, 2006, Une chambre à soi : un atout dans la scolarité ?, Données sociales, La société française, Education-Formation 2.
MARTIN Andler, ANNE Crenn, ETIENNE Farnoux, JEAN-Yves Mano, XAVIER Ousset, MARC Prévot, ALAIN Weber et le Pôle ESR de Terra Nova, Faire du logement une stratégie universitaire, Terra nova, la fondation progressive, www.tnova.fr., consulté le 30 septembre 2015, p. 1.
PIERRE Merlin, CHOAY Françoise, 2000, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, PUF, p. 466.
PATERNE Gbocho, 2015, Communiqué de la Renaissance Etudiante et Scolaire, Le Président National, point 8.
THEOPHILE Mangaga, MOUSSAVOU George, 2013, Gouvernance des universités gabonaises. Quels défis à relever pour leur performance ?, Edition Publibook Université (EPU), Collection géopolitique et sciences politiques, pp 32-33, https://univ-fhb.edu.ci, Quelques Chiffres | Site Officiel de l’Université Félix … – UFHB
HUITIÈME AXE : LIBERTÉS ET FRANCHISES UNIVERSITAIRES
ONTOLOGIE AUGUSTINIENNE ET RÉSOLUTION DES CRISES UNIVERSITAIRES
N’gouan Yah Pauline ANGORA épse ASSAMOI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
À partir de l’ontologie augustinienne, il est question de comprendre que la résolution des crises universitaires ne peut se limiter strictement aux causes sociales, culturelles, économiques et politiques ; ces dernières n’étant que ses effets. Cela est d’autant justifié que dans l’entendement augustinien, c’est dans l’intériorité de l’homme que réside la vérité et que naissent les crises liées à l’usage pernicieux de sa liberté. Notre analyse vise à présenter la cause ontologique comme la raison fondamentale et essentielle des crises socio-universitaires. Ce qui, en conséquence nous conduit à établir dans notre réflexion un lien scientifique étroit entre les franchises universitaires et le respect du prochain dans l’expression de la liberté humaine en vue de proposer l’ontologie augustinienne comme réponse aux crises universitaires.
Mots clés : Anthropologie, Crise universitaire, Éthique, Liberté, Ontologie, Théologie, Violence.
Abstract:
From the Augustinian ontology, it is a question of understanding that the resolution of university crises cannot be strictly limited to social, cultural, economic and political causes; the latter being only its effects. This is all the more justified since in the Augustinian understanding it is in the interiority of man that the truth resides and that the crises linked to the pernicious use of his freedom arise. Our analysis aims to present the ontological cause as the fundamental and essential reason for socio-academic crises. This, therefore, leads us to establish in our reflection a close scientific link between university franchises and respect for one’s neighbour in the expression of human freedom in order to propose Augustinian ontology as a response to academic crises.
Keywords : Anthropology, Academic Crisis, Ethics, Freedom, Ontology, Theology, Violence.
Introduction
La crise dans son sens le plus large est une rupture liée à l’indiscipline et à l’infidélité de l’être humain face à son identité ontologique. Dans l’ontologie augustinienne, ladite indiscipline fait naître ontologiquement en l’être humain le désordre qui est cause de son infidélité vis-à-vis de son Créateur et de la conformité de sa vie avec celle de ce dernier. Il faut, au demeurant, comprendre que l’ontologie augustinienne est une ontologie théologale qui a la particularité de mettre Dieu au centre du bonheur de l’homme. Mais cela n’exclut nullement la liberté et la responsabilité de l’homme quant au mal qui gangrène nos institutions, dans la mesure où « une personne est un univers de nature spirituelle douée de la liberté de choix (…) » (J. Maritain, 1968, p. 18). Cela suppose que c’est à partir de l’intériorité de l’homme qu’on peut trouver la solution aux crises au sein de l’humanité et particulièrement, et ce à titre d’hypothèse, aux dites crises universitaires.
En fait, une crise, du point de vue augustinien, est une rupture d’équilibre s’exprimant en termes de conflit de l’âme avec elle-même. Ce conflit, quoi qu’on dise, est en réalité à l’origine pour ainsi dire au fondement de toutes les autres formes de crises. Toutes choses par ailleurs égales, les crises affectant en profondeur les institutions sociales et celles de nature universitaires n’en sont nullement épargnées. Les crises sociales sont, dans le système universitaire, caractérisées par la recrudescence et surtout la permanence de la violence résultant d’un point de vue augustinien d’un mauvais usage de la liberté individuelle dont le péché commis par Adam et Êve en est l’illustration originelle parfaite. Comment alors impulser aux universités africaines, par-delà les pays africains, une dynamique de paix perpétuelle à partir de ce point d’ancrage scientifique augustinien ? L’exploitation de piste anthropo-ontologique augustinienne ne pourrait-elle pas permettre de mettre en lumière à la fois, la cause ontologique des crises, le rapport entre franchises universitaires et le respect du prochain ? En ce sens, l’ontologie augustinienne ne se présente-t-elle pas comme réponse originale aux crises que connaissent la plupart des universités africaines et singulièrement celles de la Côte d’Ivoire ?
1. Fondements ontologiques des crises universitaires
Toute crise est une rupture, une cassure sociale comme cause et effet. Elle apparaît comme un « changement brusque et décisif dans le cours d’un processus » (R. Kaes, 1979, p. 12). Ce changement brusque et décisif est parfois dynamique et évolutif selon les circonstances dans lesquelles l’homme se situe à savoir la sphère politique ou sociétale. Mais cette rupture n’est pas seulement liée à la politique, à la société ou à l’économie. Pour nous, elle peut être principalement liée à une cause profonde ou fondamentale. Et cette cause des crises sociales ou politiques inhérentes aux États et universités africains, dès lors qu’elle est essentielle pour ainsi dire fondamentale ne peut être qu’ontologique. Elle est alors liée intrinsèquement à l’être ou à la nature de l’homme.
En effet, les crises dans nos universités ont un fondement ontologique en raison d’une crise dans l’être de l’homme lui-même. En fait, toutes les crises que connaissent les sociétés actuelles et surtout nos institutions universitaires sont liées, du point de vue de saint Augustin, aux divisions à l’intérieur de l’être humain. Saint Augustin, promoteur et maître de l’intériorité, nous dit qu’il y a de la cassure en l’homme, une béance spirituelle dans l’âme de l’homme depuis le péché originel commis par Adam. C’est pourquoi, il demande que l’homme retourne à Dieu pour retrouver son unité ontologique. Et cette béance dans l’âme qui induit une cassure ontologique en l’homme dont il a fait lui-même l’expérience métaphysique singulière et surtout existentielle lui donne de dire ce qui suit : « Je me trouvais ainsi aux prises avec moi, mon être même disloqué » (S. Augustin, 1982, p. 209). Cette dislocation de l’homme, en son être intérieur ou âme est, pour lui, et par extension, la source de toutes les autres formes de crises dans la société ; car de façon générale, l’homme, indiscipliné et infidèle à Dieu et à la voie de vie intérieure propre à son âme, se trouve extrêmement dispersé sans référence spirituelle directionnelle. Or, l’âme dispersée ne produit que des conflits dès lors que par ce fait, elle est en conflit avec elle-même. Alors que, dans son essence ou originellement, l’homme est caractérisé par son unité ontologique.
En conséquence de ce qui précède, il faut comprendre que du point de vue augustinien, la paix dans nos institutions dépend de la paix à l’intérieur de l’homme lui-même quant à celle de son âme avec elle-même. L’homme déchiré en son âme ne peut que produire de la violence autour de lui. De ce fait, nous disons que les crises universitaires ont une cause ontologique liée à l’être même de l’homme. Car l’âme dispersée est une âme blessée détachée de sa source nourricière qui est Dieu. On parlera alors de blessure intérieure. L’homme qui a une blessure intérieure ne fait que la propager dans et par ses actes autour de lui et en conséquence à tous ceux de son entourage social immédiat et de son environnement existentiel. En réalité, on ne se propage en formes d’effets ou d’impact que ce qu’on a à l’intérieur de soi. Si nous avons de l’amour en nous, nous manifesterons l’amour autour de nous. Toutefois, si nous avons de la haine parce que blessé depuis notre vie intérieure ou la petite enfance, nous devenons agressifs, et ne produisons que de la violence, qu’elle soit verbale ou physique.
Or, les crises naissent à partir des agressions sous quelques formes qu’elles soient. Nous disons de ce fait que, c’est l’âme dispersée, disloquée et blessée qui peut être, sous cette forme, à l’origine de toutes sortes de crises universitaires. C’est pourquoi, nous pouvons affirmer avec Tanoh Jean-Gobert que « l’unité ontologique du sujet humain est la vérité de l’institution » (2021, p. 18) universitaire dans la mesure où une âme qui ne rassemble pas en soi l’unité de son être ne peut produire la paix sociale et de responsabilité éthique, c’est-à-dire à laquelle on peut imputer l’acte de bienfaisance. Pour que nos institutions universitaires connaissent la paix, la tranquillité et promouvoir les franchises universitaires, il faut bien que ceux qui assurent la direction soient en paix avec eux-mêmes. Car, « le modèle essentiel, qui garantit la paix et la prospérité de la cité, est l’âme unie à elle-même » (Idem, p. 40). C’est ce que l’homme vit à l’intérieur de lui-même qui se déteint sur son environnement familial, social et par conséquent dans son lieu de travail tel que l’institution universitaire.
En effet, le problème de l’équilibre existentiel, de la paix, de la bonne concorde transcendant le mal, le mauvais, la mauvaise cohabitation avec autrui est le péché. Dans le penser augustinien, le libre arbitre accordé à l’homme dès sa création dans la proximité du divin fut détourné de sa vocation première à savoir le bien. Détourné parce que dans une auto-indépendance à l’égard de soi et de son créateur, l’homme a transformé l’harmonie première ou ontologique en un désastre dont les répercussions foisonnent jusqu’au siècle actuel. Ce qui prouve que « ce n’est point la chair corruptible qui a rendu l’âme pécheresse, mais l’âme pécheresse qui a rendu la chair corruptible » (S. Augustin, 1994, p. 149). Il a donc troqué sa bonne foi en soi, son sens du bien en posant des actes allant à l’encontre de l’harmonie établie en lui par Dieu qui est amour. Cette crise favorisera une rupture, la venue du mal dans le monde, le goût de la haine et de l’orgueil justifiant ainsi le mal-être des sociétés humaines. C’est pourquoi, pour Augustin, les maux que connaissent nos sociétés viennent de l’orgueil de l’homme. L’homme orgueilleux veut vivre sans Dieu et même sans son semblable. Il se pose comme centre de tout et finit par mépriser son frère qui, avec lui, constituent la communauté.
De ce constat, nous pouvons inférer que la volonté est cause de crise quand elle est pervertie. Pour nous, quand la volonté est dirigée vers et dans le mal, il y a déréglément de nos mouvements, de nos actes qui manquent alors de coïncider avec le bien. C’est pourquoi, Saint Augustin écrit que (1994, p. 153) « ce qui importe, c’est le caractère de la volonté de l’homme. Si elle est déréglée, ses mouvements seront déréglés » et si ses mouvements sont déréglés, il va sans dire que les actes qu’il va poser seront désordonnés et généreront des crises, car le désordre est une anomalie de fonctionnement, un manque de discipline, une débauche et une anarchie. En effet, les répercussions ontologiques sont phénoménologiques dans la mesure où le dysfonctionnement de la structure de l’âme impactera du coup sur celui du corps dans les actes humains. Cette crise interne est le nerf et l’enjeu du bien-vivre des sociétés humaines. Et même, dans le domaine du savoir qui n’est pas étranger au processus que nous venons de décrire, les causes similaires produiront les mêmes effets.
Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que les crises universitaires ont un fondement ontologique qui n’impacte pas moins leur identité. L’identité ontologique ainsi détruite, l’être d’amour, de justice et de paix devient un être de haine, d’injustice, de conflit intérieur et de portée sociale. Il s’est mué en être de violence, de cette violence incarnée qui devient comme son ombre sociétale. C’est pourquoi, pour nous, l’unité de l’âme humaine est une exigence ontologique du vivre ensemble dont la paix est la finalité existentielle.
Au demeurant, les crises universitaires sont profondes et leur profondeur est liée à une crise ontologique pour ainsi dire à l’être humain. Ainsi, du dysfonctionnement interne en l’être humain, il est induit un dysfonctionnement hors de l’être humain, impactant les réalités qui l’entourent. C’est dire qu’il ne faut plus avoir un regard superficiel, mais plutôt se laisser convier à l’odyssée des profondeurs de l’homme pour le comprendre et penser ce qui détériore son environnement immédiat. Ce fondement ontologique de la crise universitaire nous permet de voir le lien entre franchises universitaires et respect du prochain, entre sens profond de l’enseignement et extériorité du savoir, du rapport entre l’enseignant et l’enseigné afin de percevoir en vérité ce qui pose problème et est source de déchirement et le favorise. Mais, déchiré, quelle franchise l’homme peut-il respecter, s’il est incapable en raison de sa nature disloquée, d’aimer et de respecter son semblable ?
2. Du rapport entre franchises universitaires et respect du prochain
Comment parler de franchises universitaires dans un monde où il n’y a plus de respect ? En effet, pour parler de franchises universitaires, il faut d’abord, qu’il y ait respect du prochain, car pour respecter le droit ou la liberté de quelqu’un, il va falloir considérer cette personne en dignité et en humanité. Et c’est ce que Proudhon nous dit en ces mots : « Ce qui fait que je respecte mon prochain, ce ne sont pas les dons de la nature ou les avantages de la fortune, c’est sa qualité d’homme » (1974, p. 195). Si nous nous référons à cette thèse de Proudhon, nous dirions que les libertés et les franchises universitaires posent en soi problème. Elles posent problème parce que l’homme, lui-même, a perdu son originalité. Il a échangé sa gloire contre les choses de ce monde. Il a perdu sa liberté originelle pour la limiter à une liberté conditionnée limitée elle-même aux réalités périssables. La société actuelle lie le respect au « qu’as-tu en échange ? » et au « que produis-tu ? » en terme du quantifiable.
Étonnement, cette perte de valeur laisse appréhender en substance, le problème de la saisie véritable de l’être humain dans toute sa splendeur qui, malencontreusement semble avoir sacrifié sa dignité d’être dans le dynamisme de la science, de la technique et des données évanescentes qui structurent son quotidien. Si nous jetons un regard sur le progrès technique et scientifique, c’est parce que l’évolution des données depuis les lumières auraient relégué le contenu substantiel et spirituel de l’homme au contenu matériel et physique. Ainsi, l’homme s’est vu être instrumentalisé dans une dérive de la rationalité parce qu’il pense avoir tout maîtrisé dans l’univers. Malheureusement, ce réductionnisme instrumental s’est propagé dans tout domaine du savoir si bien que le substantiel, l’essentiel a laissé place à l’inessentiel et à l’éphémère dont le résultat est l’intérêt personnel au détriment de l’intérêt collectif. N’est-ce pas de cela qu’il est à nouveau question dans le mal qui est le lot quotidien dans la vie des universités ?
Les universitaires qui ne produisent que des idées pour la plupart de nos concitoyens, ils ne sont que de beaux parleurs comme des sophistes. Alors, pour que les libertés et franchises universitaires soient respectées, il faut d’abord que celui qui est censé appliquer cette loi, apprenne ou re-apprenne à respecter son prochain. En fait, si nous respectons l’être humain comme le veut Proudhon, c’est-à-dire respecter l’homme en sa qualité d’homme et non parce qu’il a quelque chose à me donner, nous réfléchirons par deux fois avant de piétiner la liberté de l’autre. Cette réflexion en double est un signal d’alarme sur le sens véritable du statut de l’université autrement dit, qu’est-ce qu’être véritablement universitaire ?
La réponse à cette préoccupation d’envergure ontologique ou fondamentale est une ouverture sur la déontologie universitaire qui n’a véritablement d’existence et de consistance que par le biais de l’intérêt éthique du prochain, qui est le collègue de l’université, l’étudiant et l’acteur social participant de la vie et du bon fonctionnement de l’université. Cette prescription prise en compte, sinon faite, nous reviendrons à cette pensée valorisant le prochain non pas comme un moyen, mais comme une partie intégrante de nous et participant de notre bien-être dans l’affinité et l’amour du respect de l’autre en droit et dignité. N’est-ce pas en ce sens que l’amour du prochain garantit un bon avenir universitaire ?
Aussi, faut-il qu’il y ait amour du prochain pour parler de franchise universitaire, car si l’Afrique va mal selon J. Makaya, (2018, 4è de couverture) à cause de « la perversion éthique de ses dirigeants » qui provoque « l’ethnocentrisme, et la crise des valeurs morales et sociales », nous pouvons alors soutenir que c’est l’amour qui nous fait respecter le prochain. S’il n’y a pas d’amour nous agissons avec haine et violence. C’est pourquoi, l’amour doit être le poids qui me porte selon saint Augustin. L’amour vrai est inséparable de la notion de morale et de respect. Il existe un lien infrangible entre liberté et respect ; car la loi morale oblige tout homme et tout groupe à tenir compte, dans l’exercice de ses propres droits, des droits d’autrui. Les droits d’autrui ; droits inviolables sont au cœur d’une stabilité intellectuelle, sociale et politique dans la fondation d’une société relevant des principes de l’éthique.
Cette norme de droit de l’autre dans une stabilité sociale ne relève-t-elle pas de la valeur de la transcendance comme dépassement de soi vers autrui ? C’est justement cette exigence qui prévaut dans le penser lévinassien étant donné que « autrui est le lieu même de la vérité métaphysique et indispensable à mon rapport avec Dieu. […]. Autrui n’est pas l’incarnation de Dieu, mais précisément par son visage où il est désincarné, la manifestation de la hauteur où Dieu se révèle » (E. Levinas, 1980, p. 51). Autrui incarne la théorie du visage manifestant la présence de Dieu dans le monde, dans nos sociétés, dans nos institutions universitaires et lieux d’habitation. Avec Levinas le statut du prochain, de l’autre est à concevoir avec respect, amour, paix et dignité parce qu’il est un canal extériorisant la présence de Dieu.
Par conséquent, c’est le respect qui nous aide à ne pas sous-estimer les autres. Cependant, aimer et respecter l’autre, tel qu’il est, n’est pas évident pour des hommes voués à la commission de l’injustice et par conséquent au mal. Ainsi, proposons-nous l’ontologie augustinienne comme voie de sortie des crises propres à nos universités et par ricochet, dans nos états. Vu que les hommes, en toute liberté choisissent le mensonge comme plan et structure intérieure de leurs actions et dans cette situation, « (…) autant que le mensonge politiquement organisé, la perversion monstrueuse de la moralité est l’un des ressorts du système » (M. R. D’Allonnes, 1995, p. 51). Il faut surpasser le mensonge pour aboutir à la vérité constructive qui apparaîtra comme le siège ou le fondement éthique des universités. Cette perspective évoquée par Allonnes est une réalité qui, fort cruellement discrédite certains systèmes de gouvernance. En lieu et place à cela, un retour à l’ontologie augustinienne est salvateur. En fait, et en droit, cela permettra de définir de nouvelles bases de fonctionnement pour pallier les crises universitaires et politiques.
3. Ontologie augustinienne comme réponse palliative aux crises universitaires
En tant que science des substances et des causes, l’ontologie est l’étude des choses dans leur nature intime et profonde. Et celle de saint Augustin, prescrit le bon usage du libre arbitre qui est l’association de la volonté divine et de la volonté humaine vu que la nature de l’homme est en Dieu et par Dieu. L’ontologie augustinienne attribue une grande liberté et responsabilité de l’homme dans sa correspondance avec Dieu. L’homme incarne l’image de Dieu et Dieu vit en l’homme au quotidien tout en lui laissant le libre arbitre et la volonté de choisir entre le bien et le mal. Ainsi, l’être de « l’homme que son origine même exhorte à la concorde » (S. Augustin, 1994, p. 95) est dispersé et en errance tant qu’il ne retrouve pas le centre de son unicité qui est Dieu et en Dieu. C’est pourquoi, pour Augustin, l’amour du prochain et le respect de l’autre dépendent de notre relation au transcendant, à Dieu. Ce qui sous-entend que la paix dans nos États et donc dans nos institutions universitaires dépend de cette relation anthropo-ontologique. C’est l’image de Dieu en l’autre qui nous pousse à l’aimer et à le respecter. Le respect devient une exigence fondamentale dans nos sociétés et institutions parce qu’elles sont créées par Dieu et reflètent a priori son image dans le jeu des relations humaines.
En réalité, le sens des relations humaines répond d’une dialectique de l’amour entre l’homme et Dieu, dans la mesure où « l’homme est par essence uni à Dieu, du fait qu’il vient de Dieu (…) » (H. Arendt, 1999, p. 160). Dans cette relation dialectique, il y a l’homme et Dieu qui sont reliés ontologiquement par l’amour. Ainsi, l’homme ne s’aime que parce qu’il aime Dieu. Et il ne peut aimer l’autre que parce qu’il s’aime en aimant Dieu. L’amour n’existe que parce que l’homme est lié à Dieu. De ce point de vue, pour que l’homme s’affirme ontologiquement ou affirme son statut d’homme, il doit aimer nécessairement Dieu. Dieu devient le sens intime de l’amour de soi parce que dépendant de lui. L’homme pourra, au sortir de cette relation dialectique, aimer les autres en raison de cette filiation qui fait d’eux et ontologiquement, créatures de Dieu et sa représentation physique dans le monde, dans la matière et dans la société. Par l’acte d’amour de Dieu, l’homme s’aimera davantage tout en aimant davantage les autres. De plus, il pourra transmettre l’authenticité de cet amour dans sa profession ou son institution, dans sa famille et son environnement immédiat.
Au demeurant, pour résoudre les crises universitaires et réaliser une paix durable, l’homme doit se réconcilier avec Dieu et pour que cela soit possible avec lui-même. Sur cette base, il pourra retrouver son unité ontologique originelle. Car, pour nous reconnaître et nous respecter en tant que frère, nous avons besoin de nous référer au visage d’un même père spirituel qui nous aime tous malgré nos limites et en dépit de nos erreurs en termes de péché. En effet, sans la reconnaissance de son être spirituel, sans l’ouverture au transcendant, la personne humaine se replie sur elle-même et n’arrive pas à conquérir des valeurs et les principes éthiques. Dans l’ontologie de Saint Augustin, la dignité de l’homme est une vocation, car il est digne du fait de la valeur infinie qu’il pressent au fond de lui-même et pour laquelle il est interpelé en vue de manifester en lui et la vivre en chaque être. Il est donc nécessaire que l’homme fasse l’expérience de Dieu dans la mesure où, la paix tant recherchée dépend de son unité et par conséquent de sa relation à ce Dieu qui authentifie ou régénère tout en lui.
Aussi, la paix est un don de Dieu et en même temps un projet à mettre en œuvre, qui, cependant n’est jamais achevé. Seule une société reconciliée avec le transcendant ou Dieu est plus proche de la paix ; car, l’engagement envers autrui reste précaire, s’il n’est en même temps un engagement devant et envers Dieu, vu que l’homme sans Dieu est un égoïste radical. C’est ainsi qu’il cherche toujours à rendre le coup qu’il subit en tant qu’animal appelé à combattre pour sa survie. De ce fait, le pardon et la miséricorde doivent être pratiqués dans un monde où la violence semble être le maître mot avec son cortège de crimes organisés, car la « …société, voulue par Dieu, est bonne : elle est utile au bien de l’âme, quand celle-ci ordonne tout à Dieu, aimant le prochain comme soi-même, aimant donc en lui ce par quoi il est fait à l’image et à la ressemblance de Dieu. » (R. Jolivet, 1932, p. 248-249). Il faut donc, comme Jolivet le suggère, apprendre à aimer Dieu, à Le reconnaître dans tous nos actes et ce pour agir avec amour, joie, paix et bonté qui sont ontologiquement de Dieu !
Ainsi, en aimant le prochain, l’homme se purifie l’œil pour voir son plus grand bien : Dieu. Dès lors, nous pouvons dire avec Marrou : « Aime donc le prochain : Et considère en toi la source de cet amour du prochain ; là, autant qu’il est possible, tu verras Dieu. » (H.-I. Marrou, 1955, p. 120). Aimer son prochain esquisse le préalable d’un amour de Dieu et conduit à la joie éternelle pour une société réussie et une université rayonnante. En d’autres termes, en aimant le prochain à l’intérieur de soi, il est possible de voir Dieu. Nous pouvons alors dire que notre expérience de Dieu donne consistance et valeur à l’humanisme. Partant de cela, nous sommes en droit de proposer l’ontologie augustinienne comme réponse aux crises universitaires, dans la mesure où chaque être fini atteste la nécessité d’une source ontologique commune qui est un Être infini. L’homme ne peut donc contester la nécessité du transcendant dans sa relation avec autrui, car « le secret de l’homme se cache en Dieu » (M. Neusch, 1986, p. 272). L’homme ayant son secret en Dieu, il est dans l’obligation de retourner à lui pour pratiquer les valeurs humaines. Telle est l’ontologie que propose le philosophe-théologien pour la résolution des crises universitaires. Il est donc question que l’être humain revienne à son fondement. Car, éloigné du lieu où il doit être pour se connaître et connaître son Créateur par la mauvaise conception de la liberté, « l’homme est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir trouver » (J. N. Dumont, 1996, p. 62). L’ontologie augustinienne est cette fameuse conversion qui servira de fondement et de mesure ontologique pour une résolution des crises universitaires à partir de la responsabilité humaine et de la bonté de la divine providence : Dieu.
Conclusion
Avec l’ontologie augustinienne comme réponses aux crises universitaires, nous retenons que si les hommes acceptaient leur nature spirituelle en aimant Dieu et le prochain, les différences, au lieu de servir de prétexte à la violence, seraient magnifiées et les hommes seraient plus proches les uns des autres grâce à la reconnaissance de leur racine ontologique commune qui est le divin. Il y a donc nécessité et même urgence à ce que l’homme revienne à Dieu et donc à son unité ontologique ; étant donné que l’essence de l’homme est d’être en relation avec son Créateur. Car, l’amour de Dieu permet de transfigurer toutes les contingences ou composantes matérielles et contraintes de la vie et de l’existence humaine pour l’avènement de l’harmonie et l’unité sociales.
Références Bibliographiques
ARENDT Hannah, 1999, Le Concept d’amour chez Augustin, Trad. A. S. Astrup, Paris, Rivages.
AUGUSTIN Saint, 1994, Cité de Dieu, Trad. Louis Moreau, Paris, Éditions Seuil.
AUGUSTIN Saint, 1982, Confessions, Trad. Louis de Mondadon, Paris, Éditions Pierre Horay.
D’ALLONNES Myriam Revault, 1995, Ce Que L’homme Fait à L’homme, Paris, Flammarion.
DUMONT Jean Noël, 1996, Premières Leçons sur les pensées de blaise Pascal, Paris, P.U.F.
JOLIVET Régis, 1932, Saint Augustin et le Néo-platonisme Chrétien, Paris, Denoël et Steele.
KAES René, 1979, Crise rupture et dépassement, Paris, Dunod.
LEVINAS Emmanuel, 1980, Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, La Haye, Martinus Nijhoff.
MAKAYA Julien, 2018, Crise et décadence de l’Afrique noire : Les versets nègres, Congo, Harmattan.
MARITAIN Jacques, 1968, Humanisme Intégral, Paris, Nouvelle Édition Montaigne.
MAROU Henri-Irénée, 1955, Saint Augustin et l’augustinisme, Trad. La Bonnardière, coll. Maîtres spirituels, Paris, Seuil.
NEUSCH Marcel, 1986, Un chemin de conversion, Paris, Desclée de Brouwer
PROUDHON, 1974, Justice et Liberté, Paris, P.U.F.
TANOH Jean-Gobert, 2021, L’Adultère et l’État dans son concept : Éloge de l’unité ontologique, Paris, France Libris.
NEUVIÈME AXE : UNIVERSITÉ ET DYNAMIQUE DES SOCIÉTÉS
LA VOCATION DE L’UNIVERSITÉ EN AFRIQUE À LA LUMIÈRE DU CONFLIT DES FACULTÉS D’EMMANUEL KANT
Éric Inespéré KOFFI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Dans les universités africaines, les rapports académiques entre les Unités de Formation et de Recherche (UFR) dégénèrent souvent en conflits d’autant plus inquiétants que leurs différences sont amplifiées par l’action discriminatoire des pouvoirs politiques africains. Ces conflits entravent le dynamisme du système universitaire qui devrait être un outil de développement équilibré au profit des États. En partant du conflit des facultés, conceptualisé par Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, nous examinerons, à nouveaux frais, la question de la vocation de l’université, en général, et plus éloquemment, celle des universités africaines. Plus précisément, il s’agira d’examiner, dans le contexte national de traitement inégalitaire des facultés par les pouvoirs publics, l’aptitude de ces universités à assumer leurs charges de laboratoires de conception de programmes de développement intégral et intégré.
Mots clés : Démocratie, Développement intégral, États africains, Facultés universitaires, Gouvernance universitaire, Recherche scientifique, Universités africaines, Sciences humaines, sociales et politiques.
Abstract:
In African universities, academic relations between Training and Research Units often degenerate into conflicts that are all the more worrying as their differences are amplified by the discriminatory action of African political powers. These conflicts hamper the dynamism of the university system, which should be a balanced development tool for the benefit of States. Starting from the conflict of faculties, conceptualized by Emmanuel Kant in the 18th century, we will examine, afresh, the question of the vocation of the university in general, and more particularly, that of African universities. More precisely, it will be a question of examining, in the national context of unequal treatment of the faculties by the public powers, the aptitude of these universities to assume their loads of laboratories of design of programs of integral and integrated development.
Keywords : African Universities, African States, Democracy, Human Social and Political Sciences, Integral Development, University Faculties, University Governance, Scientific Research.
Introduction
Les indicateurs économiques et sociaux des États d’Afrique révèlent leur sous-développement. Or, les universités africaines sont confrontées à un conflit des Facultés (Unités de Formation et de Recherche, UFR) qui ne leur permet pas d’assumer leur vocation de conception et d’évaluation des projets de développement. Pire, il y a lieu de penser que les États, eux-mêmes, ont leur part de responsabilité dans les inconvénients de ce conflit. D’où l’intérêt d’examiner, à nouveaux frais, le rapport entre le sous-développement et le conflit des facultés en Afrique. En ce sens, les universités africaines arrivent-elles à assumer leur vocation de théorisation du développement dans un environnement dominé par ce que Kant a conceptualisé comme le conflit des facultés ? Ou encore, quelle attitude les pouvoirs publics africains doivent-ils avoir dans ce conflit des facultés pour permettre aux universités d’assumer leur vocation de théorisation du développement ? À partir d’une démarche analytique, critique et analogique, nous défendrons la thèse selon laquelle, les États africains, dans leur fonction régalienne de justice et d’équité, doivent préserver la tension critique et facteur de saine émulation entre les facultés, plutôt qu’entretenir le conflit stérile de leur hiérarchisation, pour redonner à l’Université sa fonction d’actrice de premier rang du développement intégral et intégré des sociétés africaines. En ce sens, l’analyse des inconvénients d’un conflit illégal des facultés sur le développement (1) permettra d’en déduire les avantages d’un conflit légal des facultés (2).
1. L’impact du conflit illégal des facultés sur le développement national
L’Université est le reflet de la société dont elle est chargée de théoriser les valeurs, les projets de développement et le fonctionnement institutionnel, aussi la crise de celle-ci déteint-elle sur celle-là. Comprendre la crise du développement des États africains nécessite, alors, de comprendre la spécificité du conflit des facultés qui mine les universités africaines.
1.1. Le conflit illégal des facultés et la crise actuelle de l’Université en Afrique
Emmanuel Kant est le premier philosophe à diagnostiquer le conflit des facultés dans un ouvrage éponyme (1798) au terme de sa carrière d’enseignant-chercheur à l’Université de Königsberg. Pour lui, l’Université est « une communauté savante » (E. Kant, 2015, p. 55) instituée par l’État et organisée sur le principe de la division du travail intellectuel à l’image d’une entreprise. Elle est constituée, à cet effet, de « petites sociétés savantes, les Facultés, » caractérisées par « la diversité des principaux domaines du savoir à enseigner ». Toutefois, précise-t-il, l’État hiérarchise les facultés. Ainsi, à l’Université de Königsberg, les « facultés supérieures (Théologie, Droit et Médecine) » sont soutenues et contrôlées par l’État de Prusse orientale, et lui procurent « l’influence la plus durable et la plus forte sur le peuple », en permettant d’assurer respectivement les biens spirituel, social et corporel des personnes. Leurs enseignements sont fondés sur des Écrits reconnus par l’État : la Bible, le Droit civil et le Règlement médical. À l’inverse, la « faculté inférieure » ou Faculté de philosophie est caractérisée par le libre usage de la raison dans la recherche de la vérité, du savoir théorique. Dans la mesure où cette Faculté n’a en vue que l’intérêt scientifique de la vérité et du savoir, elle jouit d’une entière liberté devant le gouvernement prussien, à condition que ses travaux restent dans le cadre universitaire. Elle y est, alors, le lieu par excellence de l’usage critique de la raison. Kant tourne en dérision cette hiérarchisation des facultés par l’État : « qu’une telle Faculté (de philosophie), abstraction faite du grand avantage (la liberté), soit pourtant appelée inférieure, la cause en est à chercher dans la nature humaine : bien qu’il soit l’humble serviteur d’un autre, celui qui peut donner des ordres se vante en effet d’être supérieur à un autre qui est certes libre, mais sans avoir personne à qui donner des ordres » (E. Kant, 2015, p. 58). Cette ironie permet de percevoir l’enjeu kantien de rétablir la justice dans l’administration de toute Université afin de lui permettre d’assumer sa fonction académique et sociale.
Le rôle de l’État dans cette hiérarchisation des facultés, révèle ce conflit comme l’expression des rapports de pouvoir (P. Bourdieu, 1984, p. 103) multidirectionnels entre le gouvernement, les enseignants-chercheurs, les étudiants, et les forces sociales. En effet, les facultés elles-mêmes entretiennent, déjà, des rapports critiques, voire d’opposition, en raison de leur rivalité dans la recherche de la vérité. Ce « conflit légal » (Kant, 2015, P. 69), entre elles, est récupéré par l’État pour consolider son pouvoir, en privilégiant certaines facultés, le convertissant en « conflit illégal » (E. Kant, 2015, p. 67). La raison en est que le savoir universitaire est une source de pouvoir que le pouvoir politique préfère s’assujettir. Il en a été ainsi depuis les premières universités européennes jusqu’aux modernes et africaines. Les universités modernes sont alors confrontées à une complexification des deux facteurs principaux du conflit des facultés : la rivalité académique légale et l’intervention illégale des pouvoirs politiques dans cette rivalité.
La rivalité académique, universelle, est complexifiée par la démultiplication des facultés pour répondre aux besoins des États. En raison des découvertes scientifiques et des progrès technologiques des siècles antérieurs, la science connait un triomphe qui lui confère une exclusivité totalitaire sur le champ universitaire. En ce sens, « toutes les facultés tentèrent de se donner un statut scientifique et durent faire reconnaître ce statut pour pouvoir simplement survivre, subsister » (G. Bourgeault, 2003, p. 241). Par ailleurs, en plus des facultés traditionnellement en conflit, consacrées aux sciences positives, juridiques et économiques, humaines, sociales et politiques, l’Université moderne ouvre également des facultés de technologies et d’entrepreneuriat avec la délivrance des diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et d’ingénieur. Les partisans de l’entrepreneuriat font la promotion de « l’Université entrepreneuriale » (Clark, 1998), ou « capitalisme universitaire » (S. Slaughter et L. Leslie, 1997), ou encore « l’Université du marché » (G. Bourgeault, 2003, p. 243). Il s’agit des universités soumises aux lois du marché capitaliste mondial avec ses principes de productivité, de compétitivité et d’employabilité. N’ont alors droit au chapitre que les universités, les facultés et les départements productifs au sens où ils procurent des biens consommables et des diplômes procurant directement des emplois. La distinction entre formations diplômante et qualifiante devient déterminante dans la reconnaissance et la classification des facultés et des universités. Le pouvoir économique tend à s’imposer au pouvoir du savoir théorique, avec la caution du pouvoir politique. Dès lors, se pose le problème de l’intervention du pouvoir politique dans le conflit académique des facultés.
Second facteur de la complexification du conflit des facultés, l’intervention du pouvoir politique dans l’organisation interne de l’Université est plus problématique dans les États africains. Alors que l’intervention illégale de l’État dans le conflit des facultés a régressé en Occident, elle reste très forte en Afrique. Tout se passe comme si les gouvernements africains accordaient aux sciences positives, l’exclusivité de contribuer au développement économique et social. En conséquence, les facultés attachées à la connaissance théorique et à l’érudition se retrouvent en mauvaise posture dans les projets gouvernementaux de l’enseignement supérieur. À la suite du slogan, « l’avenir appartient à la science et à la technique » des années 80, certains gouvernements (Rwanda, Côte d’Ivoire…) ont aujourd’hui, des programmes de réduction ou de suppression de certaines filières universitaires (Lettres, Arts et Sciences sociales) jugées inadaptées au marché de l’emploi au profit des filières spécialisées en sciences et technologies.
Il apparait que la configuration actuelle du conflit des facultés, en Afrique particulièrement, est dominée par la collaboration entre les pouvoirs politique et économique pour jauger toutes les pratiques universitaires à l’aune de l’utilité et de l’efficacité, soumettant ainsi, prioritairement, le savoir à la logique de la productivité au détriment de la recherche théorique. Il y a alors lieu de craindre un déséquilibre dans la recherche scientifique universitaire qui impactera le développement économique et social des États africains.
1.2. Le déséquilibre du développement national : conséquence du conflit des facultés
Une relation nécessaire existe entre l’Université et le développement des États modernes : « les établissements de recherche et d’enseignement supérieur sont considérés comme des piliers du développement et de la prospérité des pays du monde moderne » (L. Engwall, 2007, p. 98). La raison en est que le développement, loin de s’improviser, se conçoit et se programme. Mais, plus en Occident qu’en Afrique, l’Université, en tant que lieu de production des savoirs, des techniques et des valeurs, est un acteur déterminant dans la conception et la mise en œuvre des programmes de développement des États, car la gestion déséquilibrée du conflit des facultés en Afrique, conduit à un déséquilibre du développement.
La difficulté fondamentale du développement en Afrique est relative au choix d’un modèle de développement. S’il est indéniable que tous les États aspirent à se développer, il faut déplorer que, sous nos cieux, le développement soit décidé, conçu et mis en œuvre de l’Occident. Mais, après plusieurs décennies d’aide conceptuelle et financière au développement, les pays africains bénéficiaires de ces programmes importés, ne sont pas encore sortis de la pauvreté ; pis, l’aide financière s’est muée en dette du développement.
Ces efforts de développement ont été infructueux parce que les universités africaines n’ont pas été entièrement associées à leur conception et à l’évaluation de leurs impacts sociaux parce que les États africains privilégient l’enseignement supérieur à la recherche universitaire. L’enseignement supérieur assure, en effet, la formation des ressources humaines et fournit les cadres de l’administration des services publics et privés. Par ailleurs, la recherche universitaire en sciences positives est, plus ou moins, sollicitée pour la mise en œuvre technique des différents projets de développement. Par contre, la recherche universitaire en sciences humaines, sociales et politiques est moins sollicitée car jugée sans intérêt. Il n’y a donc pas d’enracinement sociologique et culturel des projets de développement importés et mis en œuvre. Ils se révèlent alors, bien souvent, inadaptés aux réalités locales. Le mépris réservé aux travaux des facultés des Lettres, Arts et Sciences sociales, considérées comme inférieures, dessert ainsi, les projets de développement en Afrique.
Tout développement suppose un modèle à partir duquel les objectifs et les étapes de sa mise en œuvre sont définis. Ces objectifs doivent être spécifiques aux valeurs des populations. Le progrès économique peut être universel à l’instar des sciences positives qui les portent. Cependant, l’utilisation du progrès économique doit être spécifique à chaque peuple, mis en adéquation avec ses valeurs. C’est ainsi que les États asiatiques (Japon, Corée du sud, Chine, Etc.) ont réussi à adapter le progrès économique à leurs traditions avec la contribution de leurs sciences sociales. Les États africains, au contraire, ont simplement transféré la technologie occidentale pour la greffer, telle quelle, à leurs milieux. Il s’en est suivi plus d’échecs que de succès. La question fondamentale que soulèvent ces échecs est celle des véritables enjeux de ces programmes importés et imposés.
Pour déceler ces enjeux entre les lignes des bonnes intentions affichées par les Occidentaux, il convient de décrypter les expressions ‘‘sous développé’’, ‘‘en voie de développement’’ et ‘‘développé’’ dont usent les Occidentaux pour désigner les États africains. Se considérant eux-mêmes comme les pays développés au regard de leurs technologies et du bien-être qui en résulte, ils sont aussi les pays dits riches. Les pays dits pauvres sont les pays sous-développés qui sont alors traités sans distinction dans le processus d’importation de leur développement. Les réalités sociales et culturelles sont masquées par l’étiquette[109] de pays sous-développés, pauvres.
Mais, les termes de richesse et de pauvreté sont dans ce contexte, idéologiques. En réalité, aucun pays n’est pauvre en soi, mais les pays ont des richesses différentes. Ceux d’Afrique ont plus de richesses naturelles alors que ceux d’Occident ont plus de richesses artificielles, manufacturées à partir, généralement, des ressources naturelles d’Afrique. Grâce à un système économique mondial qui favorise les produits manufacturés, les pays dits pauvres et sous-développés sont maintenus au niveau des richesses naturelles. Prenant eux-mêmes conscience de la relativité de cette hiérarchisation tronquée des richesses, les Occidentaux substitueront l’expression « pays en voie de développement » à celle de « pays sous-développé ».
Mais l’ambigüité de cette nouvelle expression parle d’elle-même : en voie, vers quel développement ? À quel niveau se trouve chaque État africain sur cette voie du développement ? En quoi un pays en voie de développement est-il différent d’un sous- développé ? En quoi le développement visé est-il celui auquel doit aspirer chaque État ? Le développement doit-il être uniforme ? Autant de questions qui relèvent des sciences humaines et sociales et dont les États africains font l’économie pour se contenter de modèles de développement importés. Il se révèle alors, l’enjeu selon lequel « le développement (apparait) comme une construction occidentale, une idée invasive, subordonnant le Sud au Nord, l’Est à l’Ouest, où une société se dit meilleure qu’une autre, considérant qu’elle n’a rien à apprendre de l’autre et au contraire, tout à lui enseigner » (R. Munck et D. O’Hearn, 1999, p. 11).
Si en économie, le développement renvoie à la croissance de la production du Produit Intérieur Brut (PIB), en sciences sociales, le développement est plus ouvert et prend en compte la redistribution des richesses nationales. Il faut encore reconnaitre que les États africains ont plus de problèmes de redistribution que les occidentaux. Or, les philosophes et les sociologues, qui traitent de la justice sociale, sont plus préoccupés par les questions de redistribution des richesses nationales que les économistes et les technocrates. Force est de constater, pourtant, que les philosophes et les sociologues ne sont pas partie prenante dans la gestion des richesses économiques nationales en Afrique. Le capitalisme, sous ses formes nationale et internationale, et le néocolonialisme sont alors, les critères d’une croissance économique qui, pourtant, contribue à creuser le fossé, déjà large, entre riches et pauvres nationaux et internationaux. Il est perceptible ici, que l’économie du développement, parce qu’elle se réduit à la croissance économique sans recourir à la justice sociale, a paradoxalement produit « plus de pauvreté que de bien-être individuel et social » (W. Sachs, 2010, p. 14).
À l’image des pays occidentaux et orientaux, les pays africains doivent donner leur place aux sciences humaines et sociales, ainsi qu’aux arts, dans la quête du développement économique, social et humain. Quel rapport entre les facultés est-il favorable à cette quête ? Quel sens constructif donner au conflit des facultés ?
2. L’impact de la nécessaire tension critique entre les facultés sur le développement national
Un des enjeux du Conflit des Facultés est de montrer que la tension critique entre les facultés est un conflit légal dont le juste arbitrage par le doute philosophique est un atout pour le développement.
2.1. La critique universitaire par le doute philosophique
Dans le Conflit des Facultés, Kant présente à deux niveaux, un contrat entre l’Université et l’État dont les acteurs sont le souverain, les savants et le peuple. D’abord, ce contrat est un fait historique parce que l’Université est créée par l’État qui lui assigne un cahier de charges ; ensuite, il est un « principe transcendantal » par lequel la Raison pure institue l’Université comme « un produit de la métaphysique et de la technique » (J. Derrida, 1984, p. 11). L’objet de ce contrat est l’articulation entre la vérité, le savoir universitaire et l’action politique pour la gouvernance politique et le développement de l’État. Le rapport de l’Université à l’action politique et sociale, exécutive ou législative, en vue du développement, est donc médiatisé par le savoir. L’historicité de ce contrat de développement entre l’État et l’Université est également reconnue depuis l’Afrique postcoloniale, au moins par les universitaires. Et pour cause,
l’université apparait comme un des symboles de la souveraineté et de l’indépendance nationales – au même titre que le drapeau, la représentation à l’ONU et l’armée – comme l’un des signes de l’émancipation vis-à-vis du colonisateur ; à ce titre, elle était aussi investie d’une fonction essentielle dans la construction de la société nouvelle, dans la production d’une élite intellectuelle vouée à assumer l’avenir du pays[110]. (G. Dauch, 1983, p. 80)
Dire, avec Derrida, que selon Kant, l’Université est le produit de la métaphysique et de la technique, c’est affirmer que la philosophie occupe une place prépondérante dans le fonctionnement de l’Université : « la philosophie est l’esprit de l’Université » au point qu’il ne saurait y avoir « d’Université sans Département de philosophie » (E. Kant, 2015, p. 71). L’idée que la science est au principe même de l’Université est constitutive de la confiance placée dans l’Université pour la construction du développement national.
Or, la philosophie, en tant que ‘‘Mère des sciences’’, et au nom de l’Université, reste garante de leur exercice et de leurs vérités pour contribuer au développement. Elle assume ce rôle grâce au doute philosophique dit méthodique, et non sceptique, qu’elle partage congénitalement avec les sciences (l’esprit scientifique), et qui implique, d’un point de vue fonctionnel, le conflit légal des facultés, la tension critique réciproque entre elles. Le doute philosophique est donc, constitutif des rapports académiques entre les facultés. Il favorise une saine émulation, bénéfique au savoir et au développement, tant que l’État ne privilégie pas abusivement les facultés dites supérieures. La Faculté de Philosophie doit, en ce sens, bénéficier, d’une totale liberté de jugement concernant la vérité des sciences. Cette liberté de jugement, garantie par l’État, est pour Kant, la condition inconditionnée d’une autonomie universitaire qui n’est autre que l’autonomie de la raison philosophique en tant qu’elle se donne sa propre loi, à savoir la vérité. Cette vocation de la philosophie au sein de l’Université, est du premier ordre, car elle concerne la vérité et les savoirs théoriques.
La vocation de second ordre de la philosophie est déclinée par Jacques Derrida (1984, p. 37) en ces termes : « L’Université est là pour dire le vrai,pour juger, pour critiquer au sens le plus rigoureux du terme ; (…) En fait, Kant présente cette exigence comme la condition d’une lutte contre tous les ʺdespotismesʺ ». Kant limite la critique universitaire du politique à des « conseils des savants » aux gouvernants. Il ne fait donc pas du philosophe un roi comme Platon, il en fait un conseiller éclairé. De ce point de vue, solliciter le jugement des universitaires sur les projets de développement et sur la gouvernance de l’État est une pratique courante dans les démocraties occidentales. Quand la sollicitation des universitaires n’est pas faite, le conseil discret devient une critique publique. Elle relève de la publicité des opinions qui peuvent être ignorées par le politique qui en assumera, toutefois, les conséquences par une alternance prématurée du pouvoir.
Cependant, dans les États africains, généralement, les jugements, les conseils et les critiques universitaires sont condamnés par les gouvernants comme le rapporte G. Dauch (1983, p. 80) en ces propos :
L’université demeurait l’héritière des institutions métropolitaines à l’ombre desquelles elle avait crû et dont elle entendait conserver certains privilèges : l’indépendance et le droit – sinon le devoir – de critique. Cette contradiction entre la place occupée par l’université dans les sociétés politiques de l’indépendance et leur aspiration à l’autonomie, particulièrement sensible où avait soufflé le vent d’Oxbridge, dans l’ancien empire britannique, devait rapidement se traduire par une série de crises et d’affrontements qui se soldèrent rarement au profit des institutions d’enseignement supérieur.
Bien souvent, il en est encore au XXIe siècle comme au début des indépendances, mais avec plus de discrétion à travers la volonté politique de réduire et/ou supprimer les filières de sciences humaines et sociales et de censurer les universitaires. Toutes choses qui sont préjudiciables à la construction du développement. La critique universitaire, aussi rigoureuse soit-elle, est toujours une contribution de l’Université aux politiques de développement des États africains. Leur prise en compte peut favoriser le développement intégral.
2.2. Le développement national intégral et intégré par l’équilibre des facultés
En lieu et place des projets de développement importés, déséquilibrés et inadaptés, les universités africaines peuvent contribuer à construire le développement intégral que Kant identifie comme le progrès. En effet, Kant limite le sens du mot ʺdéveloppementʺ au processus naturel par lequel s’opère la transformation dans les deux directions (bonne et mauvaise[111]) des vivants et des phénomènes naturels et sociaux (E. Kant, 1984, p. 80). Par contre, s’agissant de l’amélioration de l’état physique, moral et des conditions socio-économiques de l’homme, Kant parle plutôt de « progrès » (E. Kant, 2015, p. 119) en tant que processus par lequel le sujet libre choisit et met en œuvre les conditions physiques, intellectuelles, morales, juridiques, sociales, politiques et économiques qui améliorent l’existence de la personne et du genre humains. Ce sens kantien du progrès correspond à celui du développement intégral et intégré. Kant présente l’État comme l’institution garante, pour une très grande part, du progrès social et économique par deux leviers majeurs : l’éducation et la Constitution républicaine.
L’éducation est le moyen étatique et culturel pour « la culture de l’entendement et de la volonté » des citoyens afin de transformer leur insociabilité (égoïsme) en sociabilité (solidarité républicaine) (E. Kant, 2004, p. 94). Le levier de l’éducation concerne principalement l’Université en Afrique, couronnement de l’éducation nationale, en tant qu’institution publique dont la vocation est de contribuer au progrès de sa société par trois fonctions.
D’abord, l’Université doit assurer la formation des ressources humaines par des programmes d’enseignement théoriques et pratiques adaptés à l’environnement national. Ignacio Ramonet soutient ainsi que « la nouvelle richesse des nations repose sur la matière grise, le savoir, la recherche, la capacité à innover et non plus sur la production de matières premières » (1999, p. 15). La jeunesse de la population africaine sera une plus grande richesse lorsqu’elle bénéficiera d’une formation efficiente. Les bonnes conditions d’existence et de travail des universités doivent alors, être une priorité pour les États africains sous-développés.
Ensuite, l’Université doit contribuer à concevoir et à mettre en œuvre le modèle et le plan de développement adaptés à chaque État. En ce sens, en vue du développement économique, les États africains gagneraient à développer leurs facultés de sciences positives et à les associer davantage à la recherche économique, technologique, monétaire et industrielle. En vue du développement social, l’amélioration du bien-être de chaque citoyen afin qu’il réalise pleinement son potentiel, les sciences sociales doivent être impliquées dans les actions de l’État au bénéfice de la santé, de l’éducation, des valeurs citoyennes et des infrastructures publiques. Thandika Mkandawire[112] précise, à cet effet, que « le Forum international sur les interfaces entre politiques et sciences sociales (IFSP) a pour but de rappeler l’importance de la contribution des sciences sociales à la résolution de certains grands problèmes qui concernent les pays en développement » (2006, p. 427).
Enfin, l’Université doit contribuer à créer un environnement politique apaisé et respectueux des droits des personnes en veillant au respect exponentiel de la Constitution républicaine. Celle-ci est, selon Kant, le fondement juridique et politique dont le respect permet l’amélioration de la démocratie. À ce titre, elle est une condition du progrès, ou du développement intégral de l’État. Contre l’idée discutable et répandue auprès des gouvernants africains selon laquelle, il faut sacrifier la démocratie au pouvoir autoritaire pour développer sereinement les États, il convient plutôt de penser que le développement intégral va de pair avec la démocratie, l’équité et l’inclusion sociale. Par le doute philosophique, les universitaires ont le devoir moral de veiller à ce que la qualité de la démocratie soit tributaire de la juste redistribution des richesses nationales. À cet effet, les États africains ne doivent pas hésiter « à faire appel à des sociologues, des anthropologues ou encore des spécialistes de la géographie humaine et des sciences politiques » (T. Mkandawire, 2006, p. 432) pour concevoir et mettre en œuvre à la fois leurs programmes économiques et politiques.
Deux idées fortes sont alors à souligner de ce rapport entre développement et progrès. L’une est que, pour faire coïncider le sens contemporain du développement avec le sens kantien du progrès, le développement doit être endogène, conçu et mis en œuvre par chaque État en fonction de ses priorités et de ses valeurs. Il est observable, en ce sens, que le développement de chaque pays occidental comporte des traits culturels spécifiques. Chaque État africain doit, également, s’approprier son développement. L’autre idée est que, pour que le développement national ne soit pas déséquilibré, la recherche universitaire, dans son ensemble, doit être prise en compte par l’État, sans distinction de Facultés prétendues supérieures et inférieures.
Conclusion
Le conflit des facultés est un effort rationnel pour comprendre le statut, les responsabilités et les enjeux de l’Université au sein de l’État. À cette fin, Kant adopte une démarche juridique par laquelle il entend distinguer les conflits légaux des illégaux après avoir circonscrit l’unité du système universitaire. À juste titre, J. Derrida présente cet opus comme « une sorte de dictionnaire et de grammaire (structurale, générative et dialectique) … qui tente d’atteindre à la légitimation pure, à la pureté du droit et à la raison comme tribunal de dernière instance » (1984, p. 27) dans la gestion de l’Université. Fondation parmi d’autres de l’architectonique de l’Université moderne, Le conflit reste encore une ressource pour dégager des éléments de stratégies transversales pour juguler la crise qui mine la plupart des universités africaines.
En ce sens, le statut des universités africaines dans les États est d’être, au nom de la raison pure, un des symboles de la souveraineté et de l’indépendance nationale par le contrat transcendantal qui lie l’État, l’Université et le peuple. À ce titre, elles sont parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre des projets de développement et du modèle de société à construire. Il s’ensuit leurs responsabilités théoriques et pratiques. Les théoriques consistent à assurer la recherche de la vérité dans les sciences positives et humaines par le conflit légal du doute philosophique. Les responsabilités pratiques consistent à juger et critiquer le pouvoir politique pour veiller à la bonne gouvernance qui doit conduire chaque État africain vers l’Idée de l’État par la mise en œuvre du républicanisme. Il en résulte les enjeux sociopolitiques irrévocables des universités africaines en ce que leurs fins dernières sont la liberté et la justice, le bien-être des citoyens et la paix nationale. Il apparaît alors, que les États africains doivent renoncer à tout conflit illégal, respecter l’égalité des facultés et les associer toutes, à la construction du développement national.
Références bibliographiques
BERGSON Henri, 1959, Le rire, Paris, PUF.
BOURDIEU Pierre, 1984, Homo Academicus, Paris., Les Éditions de Minuit
BOURGEAULT Guy, 2003, « L’université aujourd’hui, comme hier ? Le regard d’Emmanuel Kant sur l’université… 200 ans plus tard », in Revue des sciences de l’éducation, 29(2), 237–252. https://doi.org/10.7202/011031ar.
CLARK Burton, 1998, Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, New York, IAU Press.
DERRIDA Jacques, 1984, « Mochlos – ou le conflit des facultés », in Philosophie, N°2.
DAUCH Gene, 1983, « L’université et le pouvoir au Kenya : L’Université détruite, Moi couronne 10 ans de terreur gouvernementale au Kenya », Politique africaine, N°12, pp. 80-98.
ENGWALL Lars, 2007, « Les universités entre l’État et le marché : évolution des modes de gouvernance universitaire en Suède et ailleurs », in Politique et gestion de l’enseignement supérieur, Éditions de l’OCDE, N°19, pp. 97-117.
KANT Emmanuel, 1984, Histoire générale de la nature et Théorie du ciel, Paris, Vrin.
KANT Emmanuel, 2015, Le conflit des facultés et autres textes sur la révolution, Paris, Payot et Rivages.
KANT Emmanuel, 2004, Réflexions sur l’éducation, Paris, Vrin.
MKANDAWIRE Thandika, 2006, « Les politiques de développement social : un nouveau défi pour les sciences sociales », in Érès Revue internationale des sciences sociales, N°189, pp. 427-438.
MUNCK Ronaldo, O’HEARN Denis, 1999, Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm, London, Zed Books Development Studies.
RAMONET Ignacio, 1999, « Nouveau siècle », in Le Monde diplomatique, janvier 1999.
SACHS Wolfgang, 2010, The Development dictionary: a guide to knowledge as power, London, Zed Books Ltd.
DE LA DÉCADENCE ÉTHICO-RELIGIEUSE À LA DÉCONFITURE INSTITUTIONNELLE DES UNIVERSITÉS EN AFRIQUE : UNE ANALYSE PROSPECTIVE
Kouassi Honoré ELLA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Grèves intempestives d’enseignants et d’étudiants, violence allant jusqu’au délogement et à la séquestration d’enseignants par des étudiants, rétropédalage de la performance d’étudiants instrumentalisés par des champs politiques opposés, niveaux d’étudiants si bas que l’on est en droit de s’inquiéter pour l’Afrique sur le marché concurrentiel mondialisé, des années académiques aux contours indécis, les balbutiements du système LMD que le devoir de reconnaissance impose impérativement d’appliquer, voilà autant d’expressions de la crise des universités en Afrique. Qu’est-ce qui est la cause de cette déconfiture de plus en plus prononcée et comment endiguer cette menace constante d’une décroissance programmée et ce désenchantement des lendemains de l’Afrique ? Là est l’interrogation qui fonde la démarche critique et prospective dans laquelle nous engage cet article. Il pose que les crises convulsives et institutionnelles de nos universités ont pour fondement la décadence axiologique et religieuse, marque d’une perte de référence fiable et viable. Il importe donc – et tel est le telos de cette contribution – de soigner le mal à la racine par ce que Bergson appelle “un supplément d’âme” pour nos institutions universitaires.
Mots-clés : Décadence axiologique, Déconfiture, Décroissance, Prospective, Système LMD, Supplément d’âme, Universités en Afrique.
Abstract :
Untimely strikes by teachers and students, violence going so far as the dislodging and kidnapping of teachers by students, backpedaling of the performance of students exploited by opposing political fields, student levels so low that the we have the right to worry about Africa in the competitive globalized market, academic years with undecided contours, the beginnings of the LMD system that the duty of recognition imperatively imposes to apply, these are all expressions of the crisis of universities in Africa. What is the cause of this increasingly pronounced discomfiture and how to stem this constant threat of a programmed decline and this disenchantment with the future of Africa? This is the question that underlies the critical and prospective approach to which this article engages us. It posits that the convulsive and institutional crises of our universities are based on axiological and religious decadence, a mark of a reliable and viable loss of reference. It is therefore important – and such is the telos of this contribution – to treat the evil at the root by what Bergson calls “a soul supplement” for our universities institutions.
Keywords : Axiological decadence, Discomfiture, Degrowth, Prospective, LMD system, Soul supplement, University in Africa.
Introduction
Avec les indépendances, les universités en Afrique naissent et fleurissent avec un grand espoir : promouvoir l’instruction dans les Arts et les Sciences et percer les arcanes du savoir pour les besoins des États. Cet espoir, selon Alfonso Borrero Cabal[113] qui reprenait le Rapport de l’UNESCO de 1991, est nourri par les pays africains nouvellement indépendants dont la volonté est de former une élite intellectuelle capable d’assurer le développement par le rayonnement scientifique. Trois phases vont, toutefois, caractériser l’évolution des universités africaines : se donnant comme un symbole de souveraineté nationale et gardiennes des traditions, les universités africaines[114] connaissent d’abord une expansion rapide ; ensuite le souci sera de former en quantité, des cadres capables de relever les défis nouveaux de développement socio-économique enfin intervient malheureusement la crise qui les minent en profondeur. Elle survient, avec la réduction drastique des moyens financiers alloués par les États aux universités. Partant de cet état de fait, Borrero admet que les crises économiques sont fondamentalement à l’origine des crises des universités en Afrique.
Mais, les raisons économiques expliquant moins ladite crise dont les inquiétudes qu’elle suscite contre les espoirs des indépendances, invite à une analyse plus profonde de ses causes. Le fait est que l’état des lieux laisse entrevoir une sorte de déconfiture convulsive de plus en plus prononcée. Elle s’écrit et se lit en termes de : Grèves intempestives d’enseignants et d’étudiants, de violence ponctuée de séquestration d’enseignants par des étudiants, de contre-performance d’étudiants de niveau intellectuel et académique bas et idéologiquement instrumentalisés donnent, de s’inquiéter pour les universités d’Afrique à l’échelle mondiale. Elles sont, à n’en point douter en crises fonctionnelle et structurelle multiformes se traduisant par les balbutiements de la lettre et de l’esprit d’un système LMD inadapté aux réalités africaines.
Mais, si tels sont les effets de ladite crise, qu’elle est la véritable cause de cette déconfiture convulsive qui, d’une année académique à une autre se complexifie en s’accentuant ? Comment endiguer cette constante menace d’une décroissance et d’un désenchantement de l’Afrique universitaire ? Ces interrogations sont sous-jacentes à la question de savoir comment à partir de la compréhension des causes profondes de la crise des universités en Afrique, on puisse envisager et réinventer des universités africaines et surtout performantes ?
Le projet d’un recours à la méthode prospective pour prendre en charge ce questionnement, conduira à une analyse composée des pôles suivants : une approche historique pour mieux comprendre le présent. En deux axes fondamentaux, nous regrouperons ces étapes de la démarche prospective : d’abord, par une étude rétrospective, nous entendons exposer la déconfiture de nos universités du fait d’une décadence éthico-religieuse ; ensuite nous envisageons la perspective d’un réenchantement des universités sur le fondement des futuribles.
1. Étude rétrospective des universités africaines : la décadence éthico-religieuse comme cause de la déconfiture des universités
1.1. L’éthique et le religieux, socles de l’organisation sociale et institutionnelle
Les universités modernes étaient à la fois une filiation continue remontant aux institutions d’enseignement arabo-islamiques et une invention sociale de la scolastique. La religion et l’éthique religieuse dès les origines moyenâgeuses et abstraction sont portées l’institution universitaire et engendré de grandes figures de la philosophie. Ainsi, Descartes est le produit tout fait de l’institution religieuse du Collège Jésuite de la Flèche. Hegel dont la philosophie systématique est une reprise laïcisée du dogme religieux de la trinité et du piétisme protestant sont-là quelques indices de la qualité de l’enseignement et de la rigueur disciplinaire discipline de la faculté de théologie des universités de Pforta et de Bonn Il faut admettre qu’il existe de nombreux philosophes dont la personnalité intellectuelle atteste qu’ils ont été nourris à la mamelle se des institutions universitaires du XIIe au XVIIe siècle.
Au demeurant, de la nef aux salles de cours des universités l’ombre de cette injonction augustinienne et scolastique : « Il faut comprendre pour croire et croire pour comprendre » (St Augustin, 1986, p. 184). On ne se doutera pas que l’injonction-ci a impacté toute l’institution universitaire guidée par une théologie morale semblable à une maison avec deux clefs. Comme disent C-J. Pinto et A. Holderegger (1988, p. 5-9) ces dernières sont la double clé de voute des Études d’éthique chrétienne de l’Université de Fribourg/Suisse. Il s’agit de celle de l’obligation greffée sur l’Évangile et le Décalogue et celle du bonheur greffé quant à elle, sur la sagesse de l’Évangile des Béatitudes. Cependant, faut-il le souligner, la deuxième clef, celle du bonheur, ouvre dans les universités sur une troisième salle à laquelle est pendante une troisième clef tout aussi importante que les autres. Il s’agit de la clef de la science pure. La science pure dénuée des exigences des « Humanitas » affranchie de toutes pesanteurs éthico-religieuses. Disons-le autrement : la salle de la science-technique de la maison universitaire soumise aux exigences des obligations et du bonheur à relent religieux, devient, avec les Lumières avec son athéisme, au XIXe siècle, la salle principale des universités. S’ouvre alors un monde nouveau aux orientations nouvelles et aux institutions universitaires nouvelles. La foi et l’éthique religieuses ne font plus recette, malgré l’omniprésence des préceptes religieux.
Au demeurant, la transformation sociale par le biais d’un changement de paradigme est le fait de l’université travailler désormais à l’éclosion d’une science sans structure et conscience religieuse et morale. L. King (1964, p. 152) observait avec justesse que « l’homme s’est égaré dans les régions lointaines du sécularisme, du matérialisme, de la sexualité, de l’injustice raciale. Son voyage a provoqué dans la civilisation occidentale une famine morale et spirituelle. Mais il n’est pas trop tard pour retourner à la maison. ». Les ouvertures socioreligieuses faites par le Concile Vatican II, ne semblent pas renforcer la discipline ainsi que l’écrivent C-J. Pinto et A. Holderegger (1988, p. 7) en ces termes :
Ajoutons qu’à la suite du Concile précisément, il s’est produit beaucoup de remue-ménage parmi les moralistes. Certains ont voulu tout bouleverser pour faire moderne et créer l’aujourd’hui ; on a beaucoup démoli, mais très peu construit. On a notamment délaissé la loi naturelle pour lui substituer des normes rationnelles extraites des sciences humaines, en laissant à la conscience personnelle le soin de tirer les conclusions pratiques. Beaucoup de lézardes se sont produites dans le pavement et les murailles à la suite de ces projets de transformation (…) Le problème n’a donc fait que s’aggraver.
C’est dans le contexte de cet aujourd’hui de remue-ménage, de bouleversements socio-religieux affectant les universités occidentales que naissent les universités africaines. Ces dernières portent alors les germes d’une turbulence programmée du fait de l’affaissement des structures éthiques et des réalités politiques génératrices de troubles dans une Afrique en quête d’elle-même.
1.2. La déconfiture des institutions universitaires en Afrique
Les universités africaines qui dépendent des politiques des universités occidentales, portent, dès leurs origines, les stigmates éthiques en turbulence sans repère et enracinement anthropologique. Ces mots de L. Pereydt (1997, p. 8) sont plein de sens pour l’Afrique. C’est qu’en réalité : « la crise vient du dedans ».
Faut-il alors se rendre à cette évidence que les universités africaines, au moment des indépendances, sont ouvertes dans un contexte où la science en Occident laisse peu de place à une conscience éthique et religieuse et où les fondements religieux sont perçus comme liberticides. L’Afrique, religieuse dans l’âme et ayant accueilli les religions occidentales pour se situer dans un élan syncrétique, se trouve alors, à un lieu où elle est invitée à déspiritualiser le savoir. Ce changement de paradigme est déséquilibrant tant pour l’enseignant africain que pour l’étudiant confronté à un double repère de la rationalité cartésienne qui devra cohabiter avec des élans religieux de nature mystique et surtout spiritiste avec des bagues et mixtures protectrices. Tout cela rime avec une absence de repère éthique, car comme dit Bergson, la religion, même statique, consolide l’obligation morale et réfute l’égocentrisme.
Mais, on sait qu’est condamnée à une traversée certaine d’un désert spirituel, toute institution humaine à laquelle manque la rigueur éthique. Tout porte à croire que les institutions universitaires au sein desquelles la science pure reléguée au second plan et perd de son intérêt, le savoir est réduit à une valeur quantitative : il n’est qu’un tremplin pour gagner son pain. Prises dans les nasses d’un spirituel en recul ou mort ; tricherie, diplômes sans contenu consistant, droit de cuissage, absentéisme d’enseignants sont les mots par lesquels on peut qualifier le quotidien de la plupart des universités subsahariennes.
Mais, ce manque de repère éthico-religieux s’enracine aussi dans les blessures infligées au continent africain dans l’histoire par le fait de la Traite négrière, de la colonisation culturelle et politique, La plaie béante est que l’Afrique a perdu ses valeurs ancestrales et repères éthiques authentiques sans réussir à intégrer les cultures occidentales qu’on lui impose contrainte à épouser un universel culturellement étranger à ses propres réalités. En effet, poussées à une ouverture matérialistique, les sociétés africaines ont été arrachées à leur histoire et contraintes à emprunter un chemin qu’elles n’ont pu éprouver. R. Caillois (1988, p. 143) observait que « s’il doit quitter son paysage natal ou si la colonisation bouleverse celui-ci, [l’homme] se croit voué à la mort et se sent dépérir ; il ne peut plus reprendre contact avec les sources qui périodiquement vivifient son être ». De là, l’implosion des sociétés africaines dont les signes sontse lisent en termes de profonds dysfonctionnements, troubles sociaux, crises politiques, mauvaise compréhension des règles de jeu démocratique, crises identitaires, guerres fratricides. Des systèmes d’éducation inadaptés, crises universitaires et malheureusement une dégénérescence accrue du niveau intellectuel et académiques des élèves et étudiants qui impactent profondément la formation professionnelle.
Les universités en général, et celles d’Africaine en particulier sont la chambre à échos et le reflet de la société, cette dernière en retour, attend d’elles la planification de son développement. Mais, aujourd’hui, étant décadentes et sans efficacité pratique les institutions universitaires en Afrique peinent à se valoir le nom qu’elles portent. Les faits qui dénotent de l’état de décadence des universités africaines se dévoilent en termes d’infrastructures dépassées, des grèves violentes d’étudiants, des parades de formes et d’esprit militaires des étudiants à l’intérieur ou dehors des campus, de maquettes pédagogiques inadaptées aux besoins sociaux, des programmes de cours exécutés sans visibilité réelle avec des années académiques qui se chevauchent , des pratiques humiliantes à l’encontre de l’intelligentsia et des acteurs (ressources humaines) du développement de l’Afrique, etc.
Les solutions trouvées ne semblent guérir ou même circonscrire le mal ou le malaise : l’adoption du système LMD uniformisant et l’introduction des techniques de télécommunication comme moyens pédagogique dans l’enseignement universitaire. Mais, ce qu’il y a lieu de mentionner comme une plaie principale qui est le mal profond qui gangrène les universités africaines, c’est que les étudiants et enseignants africains qui en sont les locataires et acteurs, sont à l’image des sociétés africaines dites modernes. Or ces dernières, selon T. Koffi (2011, p.70) qui « se caractérisent par (…) le non-respect de cette valeur qu’est le travail » (Ibidem), comment peut-il en être autrement quand, étant sans véritable repère éthique, « les Africains [modernes] n’ont de respect que pour ceux qui ont de l’argent ou qui détiennent le pouvoir » (Op. cit., p. 82) ? Lorsque le savoir réduit au matériel n’est plus sacré le maître même n’y voit plus d’intérêt scientifique et intellectuel vu que c’est l’artiste -chanteur qui, fier et tirant orgueil de ses biens matériels les exhibe avec arrogance sur les réseaux sociaux. Il va jusqu’à narguer et se moquer des doctes dès lors qu’il a l’image sociale de lui-même qu’il fait envie et inspire l’admiration des étudiants.
Dans les universités, force est malheureusement de constater des enseignants sont voués aux gémonies par des syndicats d’étudiants, sans réaction de sanction de la hiérarchie, tandis que des enseignants sont en posture de rivaux syndicaux instrumentalisés par le politique livrant l’institution universitaire aux forces politiciennes aux intérêts antagoniques et incubateurs de conflits. En outre, dans un contexte où c’est l’État qui nomme et démet les présidents des universités et chefs de départements et deviennent pour ainsi dire l’antichambre du politique et de la politique politicienne, la science cesse d’être la vocation première des universitaires étudiants et enseignants. Devant cette situation délétère des universités africaines, le recours et le retour à la religion pour ainsi dire à la prière ne sont-ils pas la voie conseillée ?
Des structures socioreligieuses sont mises en place aux fins, dira-t-on de spiritualiser l’espace universitaire. Mais, le spectacle spirituel qui est offert n’est pas de nature promouvoir un retour ou un recours à un enracinement religieux des universités africaines : des luttes de prosélytisme ; des prières de délivrance dont les allants ésotériques et élans fétichistes sont patents sont sans impacts réels sur la vie estudiantine.
En somme, le regard rétrospectif aux fins de comprendre la crise des universités africaines donne de voir qu’il y a bel et bien un déclin de l’éthique et du religieux ou une falsification-décadence du spirituel. À vrai dire, il y a un déclin éthico-religieux qui explique en bonne partie, la déconfiture continue tant infrastructurelle qu’intellectuelle des institutions universitaires en Afrique et ce dans l’espace et le temps. C’est sans nul doute cela qui justifie le fait que les universités africaines, n’occupent pas de rangs honorables dans le classement des universités[115]. Quelle peut être la conséquence à court et long d’une telle déconvenue des universités africaines quand on la met en rapport avec leur avenir, leur futur ? C’est ici que la démarche prospective adoptée nous invite à son deuxième pan : les futuribles des universités en Afrique.
2. Futuribles des institutions universitaires africaines et perspectives d’un réenchantement
Les futuribles sont une démarche de projection consistant à dégager un ensemble de futurs possibles desquels il importe de tirer le meilleur pour l’individu, les institutions et surtout pour l’humanité tout entière. La prospective comme science et mode d’action se distingue des prévisions de type prophétique : elles sont fondées sur l’idée que l’avenir est ouvert à plusieurs possibles.
Le premier futur possible pour nos universités étant de fait de nature négative est de droit pessimiste. Mais, parce que tout possible est une porte ouverte à un autre possible, le futurible négatif ne ferme pas la porte à une perspective positive pour ainsi dire souhaitable. Ce que dit H. Bergson (1994, p. 326) de l’avenir de l’humanité, vaut pour l’avenir de nos universités africaines quand il s’exprime en ces termes : « tout le monde sent que l’avenir immédiat va dépendre en grande partie de l’organisation de l’industrie, des conditions qu’elle imposera ou qu’elle acceptera ». Nous entendons, par conséquent, envisager cette autre dimension du possible avec l’idée certaine que notre avenir dépend essentiellement de nous et ce dans une perspective en lien avec l’existentialisme proprement sartrien. Allons plus loin avec l’exigence d’un supplément d’âme dans la démarche technique et administrative d’un recadrage de l’univers des universités africaines délétère.
2.1. L’hypothèse négative et la nécessité d’un « supplément d’âme » et d’un recadrage
Les universités africaines sont en crise éthico-religieuse quant aux ressources humaines institutionnelle et managériale quant à leur (dys)fonctionnement. Mais, les solutions matérielles et politiques envisagées, ne semblent pas parvenir résorber la crise en ses formes multiples et diverses. Certes, toutes les universités africaines ne sont sur une pente descendante à l’issue incertaine, mais sont, de façon générale, sur une pente qui suscite l’inquiétude[116].
La première réalité qui guette le futur de l’Afrique est la dégénérescence qualitative de ses universités. Cette involution qui ne rime pas forcément avec un déficit intellectuel qu’on dirait congénital, est l’expression en général, d’un travail scientifico-académique exécuté par le biais des voies et moyens en rupture avec l’éthique de la recherche. On fait l’expérience des diplômes et notes acquis par des voies et moyens éthiquement indécents, par l’argent et le droit de cuissage pour le dire tout net, en fait. La situation de crise en Côte d’Ivoire de 2002 à 2011, a donné à la jeunesse ivoirienne de produire un nouveau modèle de personnalité sans carrure intellectuelle qui a des accointances, des affinités idéologiques avec le pouvoir politique en place et du monde des affaires. Elle n’a pas songé à se faire, à force d’études sérieuses, un niveau intellectuel et a préféré l’enrichissement matériel douteux. Il devient alors clair que
chez nous, la valeur d’un homme ne s’apprécie que par rapport à son aisance financière. La richesse subite du voisin d’à côté (hier encore farouchement fauché) ne suscite guère de soupçons ; bien au contraire, elle provoque envie et respect ; et le manant d’hier devient aussitôt la référence dans le quartier ! » (T. Koffi, 2011, p. 104).
Au demeurant, le sachant en tant que maître du savoir n’est plus admiré comme « l’influenceur » qui qui exhibe ostentatoirement les billets de banques, voitures et maisons de luxe en tant que son avoir.
L’autre réalité possible à redouter, est la conséquence négative de l’infécondité des universités africaines en regard des sociétés africaines. Des médecins mal formés, c’est la transformation des hôpitaux du en salles de mort programmée en raison de maltraitance médicale. Des administrateurs formés au rabais sans avoir franchi le seuil de l’enseignement primaire ou secondaire, ont des richesses colossales illicites. Des magistrats hissés leurs fonctions par la puissance parentale et les relations sociales faisant de la justice une illusion au préjudice des justiciables. Qu’espérer de techniciens issus d’universités et grandes écoles avec des diplômes sans substance intellectuelle quand on sait que la preuve de leur compétence scientifique et académique n’est pas objectivement établie ? Quel enseignement attendre d’un enseignant qui n’a aucun amour du savoir et qui est lui-même le malheureux fruit d’un enseignement bâclé ?
La contre-productivité de l’université africaine ne peut donc conduire qu’à une accentuation de la migration clandestine au mépris des risques ou de la transformation de la méditerranée en un cimetière sans trace. Cette contre-productivité des universités africaines ajoutée à un horizon de l’emploi en raison de formations non compétitives pousse à l’exil la minorité des jeunes croyant en la valeur des études et/ou ayant un parent même de les conduire par l’immigration légale ou clandestine, au prétendu Eldorado occidental.
Lévy-Bruhl disait, dans sa Mentalité primitive, que l’homme africain était incapable de franchir l’âge mental de sept ans. Cette affirmation erronée hier parce que fondée sur une observation anthropologique superficielle, est aujourd’hui en passe de se réaliser. Tout se passe effectivement comme si intellectuellement, les africains, par la contre-performance de leurs universités sont absents dans le processus de développement économique et social. La non-compétitivité des productions universitaires africaines sur le marché du monde global, atteste amplement de ce refus du développement, de cette marche régressive des universités africaines marche à reculons. Alors qu’aujourd’hui les TIC donnent la possibilité de faire des études dans le temps et l’espace est donnée aux étudiants par le biais des TIC, on constate une non motivation des étudiants. Ces dernières ne sont pas mises à profit intellectuel aux fins de recherche scientifique par une jeunesse universitaire intellectuellement paresseuse et soucieux exclusivement d’enrichissement matériel, de la promotion de l’avoir.
H. Bergson (1990, p. 330) écrivant que « le corps agrandi attend un supplément d’âme » a perçu l’état d’esprit de notre société moderne et celui de la jeunesse estudiantine et par extension celui des universités africaines dans leur ensemble. Ce que ce penseur percevait de notre société moderne agrandi matériellement par les prouesses scientifico-techniques, est ce que l’on peut aussi noter de nos universités africaines où cet agrandissement est, d’un point de vue positif, infrastructurel (matériel) dans la sphère de la quantité [117] et négatif en termes de dysfonctionnement lié à la mauvaise gestion et au manque d’éthique et de déontologie. L’accroissement quantitatif, est à dire vrai et du point de vue de Bergson quand on sait que dans le corps de l’humanité ; corps,
(…) démesurément grossi, l’âme reste ce qu’elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger. D’où le vide entre et elle. D’où les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de définitions de ce vide et qui, pour le combler, provoquent aujourd’hui tant d’efforts désordonnés et inefficaces : il faudrait de nouvelles réserves d’énergie potentielle, cette fois morale (H. Bergson, 1990, p. 330).
En effet, sans un potentiel d’énergie spirituelle à même de prendre en charge l’homme dans ses nouvelles conditions matérielle d’existence, l’humanité s’épuise en raison d’efforts contre-productifs, vains intellectuellement, existentiellement et spirituellement désenchantants. Les inconduites anéthiques de notre modernité est la marque spirituelle d’une rupture d’équilibre entre le corps et l’esprit quand ce dernier, par la force des choses matérielles est devenu trop petit ou étroit pour diriger le corps capitonné de diverses scories. De même, l’institution universitaire en Afrique sans des infrastructures adéquates et sans âme en plus d’étudiants sans volonté et sans repère scientifique adéquat, elle ne pourrait que muer sa crise fonctionnelle en crise structurelle. Mais touchant aux questions éthiques liées à la personnalité ou à l’être des acteurs, la crise des universités au-delà de sa dimension factuelle, devient profondément ontologique. C’est alors qu’il faut aux institutions universitaires africaines ce que Bergson appelle, « un supplément d’âme ». Cela, parce qu’il y a plus qu’une nécessité, mais urgence scientifique et existentielle qu’induit la crise qui minent les universités africaines ; crise qui plombe leur finalité développementaliste et de formation de la personne humaine. Ce supplément d’âme se donne comme un supplément d’éthique et de religiosité ou une mystique nécessaire au surcroit mécanique de notre modernité. À juste raison, Bergson écrivait que « la mécanique exigerait une mystique ».
Que suggère cette idée que la mécanique exige une mystique ? Dire que la mécanique exige une mystique, c’est affirmer que l’homme ne s’élèvera au-dessus des contingences matérielles, des dérives morales et socio-politiques qu’en se constituant un socle spirituel à même de porter le poids de la matérialité et se conformer à la nouvelle donne communication, à savoir celle des TIC. Dire que la mécanique exige une mystique, c’est aussi indiquer que l’accroissement des potentialités physiologiques et matérielles exige un accroissement spirituel conséquent pour que l’homme soit équilibré. Autrement formulé, l’homme ne peut accéder à ce à quoi l’appelle son essence qu’en s’ouvrant ses dimensions spirituelle et matérielle.
Dire que la mécanique exige une mystique, c’est affirmer que la mécanique convoque comme son incontournable autre un supplément spirituel, comme inversement, le surcroît spirituel a besoin d’un support mécanique et matériel. L’homme ne réussirait qu’à se laisser écraser par le poids des réalisations techniques si la place n’est pas faite à l’élan mystique qui sommeille chez la quasi-totalité des hommes de notre siècle. Quoiqu’il en soit, cette hypothèse de la disparition des universités africaines par dégénérescence graduelle ainsi que le présage des signes effectivement ou factuellement présents n’est pas le futur à souhaiter. Il s’agit de se nourrir de l’espoir d’un futur possible en forme de perspective positive annonciatrice de lendemain meilleur des universités africaines en crise. L’épisode présent envisagé sous ce rapport ne doit être considéré que comme une simple crise de croissance des universités africaines. Il s’agit alors et de ce point de vue optimiste, penser ou croire collectivement à l’avènement d’une université nouvelle. Ainsi dit, le futurible positif est le choix de nos sociétés africaines si tant est qu’elles veulent encore croire en leur futur et en leur jeunesse estudiantine. Mais, par quels moyens parvenir à transformer en une réalité cette hypothèse favorable ? Là se pose le problème des stratégies pour des lendemains heureux pour nos universités.
2.2. L’hypothèse positive et la nécessité de la proactivité pour une université nouvelle en Afrique
Déjà dans l’Antiquité, Sénèque disait dans son ouvrage, La vie heureuse que seul celui qui sait où il va peut connaître un vent favorable. Bertrand Jouvenel, dans son Art de la conjecture, indiquait que l’avenir, pour l’homme, est à bâtir par sa volonté anticipatrice ou projective. Or, face aux événements et à l’avenir, quatre attitudes possibles sont adoptées par l’homme : l’attitude passive (consistant en une résignation ou en une indifférence) ; l’attitude réactive (qui est une réponse à une situation immédiate) ; l’attitude préactive (consistant à prévenir des situations immédiates) et l’attitude proactive (qui est prise d’initiatives par anticipation des situations sur le long terme). L’attitude proactive, par sa nature, est au cœur de la démarche prospective. Ainsi, c’est en adoptant une philosophie proactive d’anticipation dans le temps et l’espace que nos sociétés africaines pourraient s’ouvrir à un avenir favorable à la fois pour elles et pour leurs universités.
L’hypothèse d’une université africaine prometteuse prend forme dans l’hypothèse d’une double action : il s’agit, programmatiquement d’un éveil de conscience et d’une action socio-politique de restructuration en profondeur des universités et de ses acteurs. La psychanalyse freudienne et jungienne montre que la censure de la structure psychique, même dans le sommeil, n’accepte pas que soit franchie certaines barrières qui relèvent de la survie ou de l’éthique familiale, comme le fait d’assister à sa propre mort ou commettre un inceste avec sa mère. Dans un tel cas, la conscience est comme secouée par la censure pour rentrer en possession d’elle-même et assurer la conservation de la personnalité : c’est le brusque réveil qui accompagne certains rêves. De même, face à la débâcle de la jeunesse et des universités africaines, il faut que prenne forme un réveil de la conscience sous la poussée d’une censure spirituelle et intellectuelle cathartique à dose éthico-scientifique homéopathique. En effet, la conscience universitaire peut se réveiller et promouvoir le savoir par son être et son faire et se laisser aller à une formation de qualité. Toutefois, il doit s’accompagner d’une vigoureuse action politique et pédagogique citoyenne de recadrage pour surmonter les dysfonctionnements endogènes des universités africaines.
En réalité, à la condition de cette double hypothèse, les dimensions éthiques et religieuses constitueront le socle de ce réveil des universités africaines. Parallèlement aux règles d’éthique et de déontologie édictées et appliquées rigoureusement, les pratiques religieuses ou confessionnelles diverses seront encouragées dans la mesure de la décence propre à l’institution et au respect de la personne humaine. Seront particulièrement encouragés des groupes d’éthique religieuse qui allient l’action à l’élan spirituel. Ils contribueront ainsi, à l’équilibre intérieur des acteurs et à la stabilité de l’institution universitaire. S’opérerait ainsi, un retour souhaité à la maison de l’institution universitaire des origines où foi et raison convergeaient en vue de l’équilibre et de la rigueur qu’exige sa gestion scientifique
Dans l’hypothèse de cette université nouvelle, une discipline rigoureuse tant pour l’apprenant et l’enseignant ainsi que pour l’administratif deviendra une réalité. L’étudiant aura alors, tout autant la possibilité d’évaluer l’enseignant conformément à une exigence docimologique. L’histoire nous enseigne d’ailleurs que Schopenhauer, faute d’étudiants ayant opté pour ses cours, a dû « abandonner ses leçons » (A. Schopenhauer, 2010, p. 81) à la prestigieuse université de Berlin, là où trônait au contraire Hegel. En ce sens, étudiants et enseignants soumis à un contexte concurrentiel et à des exigences de résultats, n’auront d’autres choix que de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Sur le plan pédagogique, des choix rigoureux sont à opérer : ou l’on opte pour un système LMD rigoureusement appliqué ou l’on revient aux méthodes anciennes qui ont formé les élites, car, le « LMD aux couleurs africaines » actuellement appliqué ne produit pas les résultats escomptés. Le recadrage fonctionnel, exigera alors des maquettes pédagogiques scientifiquement et pédagogiquement revisitées. De même, les cours en ligne, exigeant des cadres appropriés et du matériel technique adéquat, seront réexaminés et adaptés à l’environnement technologique actuel. Il faut comprendre une fois pour toutes que les pratiques éthiquement malsaines et scientifiquement contre-productives en tant qu’elles sont naturellement contre-productives, ne conduisent qu’à des résultats approximatifs, voire nocifs pour la société. Lesdites pratiques, à dire vrai, sont de véritables freins au développement des sociétés en Afrique et ce par-delà la recherche scientifique et l’ethnicisation des universités africaines. C’est qu’à la vérité, les pratiques en question les rendent programmatiquement incompétentes dans le temps et l’espace et surtout non compétitives sur l’échiquier mondial.
Nos universités se donneront donc des objectifs et des systèmes clairement définis pour répondre à des finalités avec des moyens conséquents, que si elles prennent rendez-vous avec un système et une pédagogie précis et efficients. C’est pourquoi, dans cette université redéfinie, le découpage rigoureux de l’année académique sera fondamental et un classement annuel des universités publiques et privées dans chacun des pays sera rendu public par la tutelle. En cas de non élection ou d’un rang peu honorable occupé par telle ou telle université des restructurations du personnel administratif et d’encadrement doit s’opérer de façon impérative, catégorique ou contraignante. Car, autant nul n’est juste volontairement, sinon par contrainte, comme dit Platon, autant nul, s’il n’est contraint par une puissance hiérarchique, ne donne le meilleur de lui-même sur le long terme : là est toute la différence entre les institutions publiques et structures privées.
Par ailleurs, il s’agira d’opérer une rupture avec l’exploitation politicienne de l’institution universitaire. Il s’agirait, pour cela, de revoir le mode qui préside au choix des responsables des universités afin d’éviter de mettre à des postes de simples bras séculiers du pouvoir politique ou des hommes d’affaire, mais des universitaires de moralité prouvée capable de concevoir un programme ou une politique administrative de redressement et un plan d’actions sur la base desquels ils seront élus.
Quant aux syndicats d’étudiants et d’enseignants du milieu universitaire, ses animateurs devront être formés aux règles républicaines d’usage des droits syndicaux. Pacifier l’espace universitaire pour laisser la place au domaine de prédilection de l’université, la science, telle est l’ambition qui transparaît dans cette batterie de mesures qui pourrait effectivement à booster qualitativement et à l’avenir, les universités africaines aujourd’hui en crise.
En somme, le réenchantement des institutions universitaires nous semble passer par un ressourcement dans les valeurs spirituelles – comme un supplément d’âme – dans lesquelles s’enracinent toute société, toute institution et particulièrement l’université. Ce supplément d’âme rendu effectif, conduira à une proactivité pour qu’advienne en Afrique, des universités productrices de savoirs efficients et compétitives avec des ressources humaines moralement et éthiquement de qualité. Et cela ne relève pas du rêve, car comme dit S. Diakité (2016, p. 69), « une révolution est en puissance cachée dans le corps profond de l’Afrique ».
Conclusion
Rétrospectivement dans la première phase de notre démarche, de notre élan heuristique, nous notons que nos universités connaissent une déchéance graduelle, liée à leur histoire et au dévalement éthique et religieux, signe réel d’une absence de fondement. La déconstruction continue de nos universités, malgré l’accroissement infrastructurel, n’est qu’une fâcheuse conséquence d’une rupture d’équilibre dont la frénésie matérialiste est la marque. L’analyse des futuribles, – deuxième phase, nous met en face de deux futurs possibles : le premier en tant que conséquence de la pente des réalités, nous indique un déclin certain de nos universités. Le deuxième, souhaité et envisageable à la condition d’un supplément d’âme qui pousserait à une vigoureuse action pour le salut des sociétés africaines, est une université nouvelle dont l’assise essentielle est celle d’une énergie spirituelle qui allie élan éthico-moral et rigueur intellectuelle.
L’évidence du choix de la futurible de la troisième phase de notre analyse de cette université renouvelée, non pas le plus plausible mais le plus souhaité, nous a, en dernier ressort, conduit à quêter des stratégies et en sa quatrième phase notre analyse, s’inscrit dans l’impératif scientifico-académique d’un vent favorable, suscité, à force de volonté par le biais des politiques et des universitaires en vue de l’éveil intellectuel et social de l’Afrique. Nous indiquons alors des pistes pour la remontée de la pente de cette université revisitée.
Notons, ensuite, avec T. Koffi (2011, p. 93) cette thèse : « C’est bien connu : un peuple privé de sa spiritualité devient fragile et manque de confiance en soi ; il devient un peuple dont l’imaginaire est étouffé, un peuple stérile donc, car presque tout, ici-bas, est régi par les lois de la spiritualité ».
Nous n’irons pas jusqu’à conclure comme lui que c’est le christianisme et l’islam qui ont privé l’Afrique de sa spiritualité et rendu inféconde. Mais, nous pensons, comme lui, que sans une dose de spiritualité faite de réel potentiel religieux et éthique, nos universités africaines s’achemineront d’une année à l’autre vers l’infécondité et la déconfiture. Peut-être, l’Afrique « ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle » et que c’est « à elle de voir » (H. Bergson, 1990, p. 338), si elle aspire vraiment au renouveau de ses universités.
Références bibliographiques
AUGUSTIN Saint, 1986, Les plus beaux sermons, trad. Georges Humeau, Paris, Études augustiniennes.
BORRERO Alfonso Cabal (Père), 1995, L’Université aujourd’hui – Éléments de réflexion, Paris, Éditions UNESCO-CRDI.
BERGSON Henri, 1990, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF/Quadrige.
BERGSON Henri, 1994, L’Évolution créatrice, Paris, PUF/Quadrige.
CAILLOIS Roger, 1988, L’Homme et le sacré, Paris, Gallimard.
DIAKITÉ Samba, 2016, Révolutions et développement – Pour une philosophie de l’émergence en Afrique, Québec/Canada, Différence Perenne
JOHNSTON William, 1986, La Mystique retrouvée, Trad. Mari- Elyx Revellat (Paris, Desclée de Brouwer.
JOUVENEL Bertrand, 1972, Art de la conjecture, Paris, Hachette.
LÉVY-BRUHL Lucien, 2013, La mentalité primitive, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42043352c.
LUTHER KING Martin, 1964, La Force d’aimer, Trad. de l’Anglais par Jean
Bruls, Paris, Caterman.
KOFFI Tiburce, 2011, Le mal-être africain, Abidjan, NEI-CEDA.
PEREYDT Luc, 1997, « La crise vient du dedans », in Revue Croire aujourd’hui, N°28 de mai 1997, Ed. Assa.
PINTO Carlos-Josaphat et HOLDEREGGER Adrian, 1988, L’Évangile et la morale, Éditions du Cerf – Éditions Universitaires Fribourg/Suisse
SCHOPENHAUER Arthur, 2010, Sur le besoin métaphysique de l’humanité, trad. Auguste Burdeau, Paris, Mille et une nuits.
SÉNÈQUE, 2005, La vie heureuse, trad. Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion.
COMMUNICATION DE CRISE ET CRISES DE FONCTIONNEMENT DANS LES UNIVERSITÉS SUBSAHARIENNES
Faloukou DOSSO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Les défauts de fonctionnement des universités subsahariennes découlent des stratégies de communication de crise téléologiquement intégrées aux divers programmes de gouvernement des États. Ce sont les crises économiques des années quatre-vingt-dix et les mouvements de démocratisation impulsés par le discours de la Baule qui vont entamer leur déstructuration. Il revient à la communication, selon Habermas, d’opérer une synergie entre le temple du savoir et l’instance du pouvoir en affermissant les piliers de sociabilisation, en n’omettant pas de normaliser le rapport politique-économie en Afrique subsaharienne. De la communication de crise à l’activité communicationnelle pour résoudre les crises universitaires (1), il faut fiabiliser le triptyque politique-éthique-économie où ce qui est prôné par Habermas crédibilise la formation via la dynamisation des universités subsahariennes (2). Le pouvoir, à l’écoute du savoir, favorisera une intégration républicaine réussie ouvrant le champ d’insertion sociale (3).
Mots clés : Afrique subsaharienne, Communication, Crise, Développement, Économie, Éthique, Politique, Université.
Abstract:
The malfunctioning of sub-Saharan universities stems from crisis communication strategies teleologically embedded in various state government programs. It was the economic crises of the 1990s and the democratization movements driven by the discourse of La Baule that began their destructuring. It is up to communication, according to Habermas, to operate a synergy between the temple of knowledge and the authority of power by strengthening the pillars of sociabilisation, while not omitting to normalize the political-economic relationship in sub-Saharan Africa. From crisis communication to communication activity to resolve university crises (1), the political-ethical-economy triptych must be made reliable, where what is advocated by Habermas lends credibility to training via the revitalization of sub-Saharan universities (2). Power, attentive to knowledge, will promote successful republican integration, opening up the field of social integration (3).
Keywords : Sub-Saharan Africa, Communication, Crisis, Development, Economy, Ethics, Politics, University.
Introduction
« La crise économique des années 80 et l’ajustement économique qui en est le corollaire » (A. A. Verspoor, 1991, p. 346) vont occasionner la réduction du budget de fonctionnement des universités subsahariennes et les confronter « à de sérieux défis liés à la progression de la demande et, parallèlement, à l’obligation de contenir ou de réduire leurs dépenses » (A. Susan, 2005, p. 16). C’est ainsi que les universités subsahariennes vont subir le manque de matériels didactiques, la quasi-inexistence des bibliothèques sans omettre le poids de l’absorption annuelle de l’effectif ahurissant d’étudiants dans les départements. Les universités deviennent ici, des espaces de formation de diplômés sans emploi là où la crise économique persistante « entraîne une dégradation des budgets et une détérioration des perspectives d’emploi pour les diplômes, la croissance du nombre d’étudiants reste forte » (F. Orivel, 1991, p. 377).
Le système Licence – Master – Doctorat (L.M.D.) et l’homologation des salaires et des primes dans le Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest (REESAO) sans omettre les efforts des États subsahariens pour résoudre les questions universitaires, n’ont pu atténuer les crises de fonctionnement et de formation des universités laissant persister d’incessantes grèves des syndicats d’enseignants et d’étudiants. Le manque de cellules de crise et la priorisation des questions économiques sur les questions académiques occasionnent un défaut de fonctionnement, de formation des universités. Les universités, bien que jouant un rôle majeur dans le développement de tout pays, vivent une réalité différente dans les États subsahariens.
Il se pose le problème de la communication de crise et/ou de la restructuration des universités subsahariennes. Ce qui suscite les préoccupations suivantes : Comment peut-on déconstruire les crises dans les universités subsahariennes ? La posture de la communication, selon Habermas, n’est-elle pas appropriée face aux crises universitaires ? De la communication de crise à l’activité communicationnelle selon Habermas (1), il est primordial de promouvoir le triptyque politique-éthique-économie prôné par Habermas. Il s’agit de consolider l’espace intégrationnel des États subsahariens dans le concert des nations via la dynamique des universités (2). Le pouvoir doit être à l’écoute du savoir pour réussir l’intégration républicaine étendant l’insertion sociale (3).
1. Communication de crise et activité communicationnelle
1.1. Des crises dans les universités subsahariennes
Les Universités souffrent des mêmes plaies qui gangrènent leur épanouissement, entravent leur fonctionnement. Ce sont les crises économiques des années 80 et les grands mouvements de démocratisation impulsés par le Vent de l’Est pour sortir l’Afrique noire des griffes du parti unique qui vont étiqueter les universités subsahariennes comme des temples de déstabilisation, des lieux d’absorption inutile du budget de l’État. Elles sont considérées comme « un Tonneau des Danaïdes ». Des pressions étatiques sont exercées sur les universités subsahariennes en leur imposant un fonctionnement qui n’est pas toujours en adéquation avec leurs prérogatives. La mésentente va naître de cette logique de la politique qui est imposée dans une posture de corrélation entre les partenaires et leur volonté d’être élucidés par la lumière de la rationalité communicative. En effet, la logique politique ne doit pas perdre de vue la spécificité du dialogue politique oscillant entre les lumières de la rationalité communicative et les ténèbres de la violence originaire ou de la différence irréductible. C’est ainsi que,
[pour J. Rancière (1995, p. 71),] il y a bien une logique de la politique. Mais cette logique doit être fondée sur la dualité même du logos, parole et compte de la parole, et elle doit être rapportée à la fonction spécifique de cette logique : rendre manifeste (deloun) une aisthesis dont l’apologue ballanchien nous a montré qu’elle était le lieu d’un partage, d’une communauté et d’une division. Perdre de vue cette double spécificité du « dialogue » politique, c’est s’enfermer dans les fausses alternatives qui demandent de choisir entre les lumières de la rationalité communicative et les ténèbres de la violence originaire ou de la différence irréductible. La rationalité politique n’est précisément pensable qu’à la condition d’être dégagée de l’alternative où un certain rationalisme veut l’enfermer : ou bien l’échange entre partenaires mettant en discussion leurs intérêts ou leurs normes, ou bien la violence de l’irrationnel.
À vrai dire, la posture politique prônée par J. Rancière va se déployer autrement dans l’espace subsaharien où la rationalité politique, en promouvant l’échange entre le pouvoir et le temple du savoir, opte pour la téléologisation des actions étatiques :
Sous l’effet de la crise économique des années 80 et de la mise en œuvre de politiques d’ajustement structurel accordant la priorité à l’éducation de base, les ressources destinées à l’enseignement supérieur ont diminué, entraînant une détérioration de la qualité de l’enseignement supérieur et des études universitaires supérieures. (G.B.A.D. (Groupe de la Banque africaine de développement), 2007, p. 1).
Il ressort que s’occuper des universités, c’est sûrement promouvoir la science et la technologie, intégrer les sources de financement et sauvegarder le financement public. Le G.B.A.D, (2007, p. III) « [aidera l’Afrique] à renforcer les aptitudes nécessaires pour promouvoir l’innovation et contribuera à la production des connaissances scientifiques et technologiques nécessaires pour renforcer la compétitivité des économies ». Cette approche de résolution de la crise absorbera les universités en leur proposant des recettes technocratiques.
Dans les universités subsahariennes, il faut « identifier la crise, en expliquant son origine, sa nature et ses caractéristiques » (O. G. Gogoua et S. Le M. de Gouville, 2011, p. 89), aux fins d’intégrer les personnes ressources aux réalités universitaires, en se gardant de promouvoir la volonté d’en découdre avec les « fouteurs » de trouble en temps de crise. L’inexistence des cellules de crise pour éviter de diluer l’information pose le problème de la communication des crises, qui étouffe le service de communication des universités et obstrue toute capacité de gérer les relations entre les acteurs.
Au lieu d’anticiper sur les effets boomerang de l’information puisqu’« informer, c’est faire passer un message, faire accepter une idée, rendre évident un fait [, c’est la violence policière qui est mise en exergue]. Il faut persuader ses interlocuteurs, ne serait-ce que de la validité et de l’intérêt de l’information qu’on leur donne » (O. G. Gogoua et S. Le Monnier de Gouville, 2011, p. 90) et ne pas étouffer ce qui vient des universités.
Cette posture capitalistique leur est encore imposée dans la mesure où dans
les institutions d’enseignement supérieur ne pourront désormais rester compétitives que si elles s’intéressent à l’économie et aux réseaux centrés sur le savoir, et si leurs stratégies sont fondées sur l’innovation. La croissance économique ne peut donc que bénéficier de l’acquisition et de l’utilisation efficaces du savoir. (Groupe de la Banque africaine de développement, 2007, p. 1).
Les universités sont invitées à ne s’intéresser qu’aux questions économiques et aux réseaux centrés sur le savoir avec, en toile de fond, les stratégies fondées sur l’innovation de la science et de la technologie. Elles sont techniquement invitées à se mettre à jour, favorisant l’acquisition et l’utilisation efficaces du savoir et aidant l’État à assurer sa croissance économique. N’est-ce pas ce qu’elles font en formant en Droit, en Médecine, en Sciences Sociales et Humaines où des départements naissants tiennent compte des réalités qui se présentent aux universités ? En promouvant le savoir au service de la croissance, les questions de fonctionnalité vont demeurer là où la crise économique persiste. Les crises universitaires perdurent dans une atmosphère où la crise économique, le manque de cellules de crises, la proposition des recettes technocratiques, constituent ce qui étouffe la communication dans les universités. De quelle communication s’agit-il dans la résolution des crises universitaires ?
1.2. De l’activité communicationnelle habermassienne dans les crises universitaires
La conception habermassienne de l’activité communicationnelle est la passerelle de résolution des dissensus dans les rapports interhumains. Il faut recourir aux principes de Discussion, principe « D » et d’Universalisation, principe « U », pour faire reculer l’entropie. La communication, entente en acte, est une activité structurante permettant à l’homme de s’ouvrir à lui-même et à son cadre de vie. C’est sans doute pourquoi,
l’orientation fondamentale de la pensée de Habermas repose sur l’opposition entre deux rapports au monde, celui qui est défini par la science et la technique, rapport cognitif et instrumental, et celui qui est défini par l’interaction entre sujets, rapport constitutif de la communication, y compris sur son versant cognitif, plus particulièrement des rapports moraux, juridiques, éthiques et politiques (R. Rochlitz, 2002, 9).
Parler de communication chez Habermas, c’est opposer deux rapports au monde. Le premier, cognitif et instrumental, nait du déploiement de la science et de la technique. Il est téléologique, promouvant une résolution biaisée des crises en ne les résolvant que téléologiquement. Quant au second, rapport constitutif de la communication favorable à l’interaction entre les sujets, il est, non seulement cognitif, mais surtout constitutif parce qu’il arrive à intégrer les dimensions morale, juridique, éthique et politique de résolution des crises. L’activité communicationnelle permet d’obtenir un consensus mettant la cité à l’abri des crises graves puisque tout doit se résoudre sur la base de solidification des rapports interhumains, en arrivant à osciller entre solidité et solidarité, entre interaction et intersubjectivation dans la sociabilisation de la société. Alors que le mal des universités de l’ère des crises économiques va résider dans sa nouvelle posture où il leur est demandé des retours sur investissements. Et pour cause, :
l’analyse classique des retours sur investissements ne s’intéresse qu’aux gains financiers des individus et aux recettes fiscales qu’ils produisent. Elle néglige les bienfaits plus larges de l’enseignement supérieur sur l’esprit d’entreprise, la création d’emplois, la qualité de la gouvernance économique et politique ainsi que les effets positifs de travailleurs éduqués sur la santé d’un pays et son tissu social. Elle ignore également les contributions de la recherche à la croissance économique (W. Saint, 2005, p. 4).
L’enseignement supérieur exerce des bienfaits sur l’esprit d’entreprise, la création d’emplois, sans omettre la qualité de la gouvernance économique et politique en formant une main d’œuvre de qualité. Le rayonnement des travailleurs permet à l’État de s’engager dans un développement durable. Avec l’université, l’on parle plus de contribution de la recherche à la croissance économique que de probables retours sur investissements, de gains financiers, de recettes fiscales.
L’université est loin d’être une entreprise qui attend des rendements financiers, techniques, des retombées calculantes après-vente. Les universités subsahariennes, en se déployant dans divers domaines de savoir, doivent aider les autorités politiques à faire attention, à ne pas leur attribuer ce qui n’est pas de leur ressort. Il faut faire la part des choses entre le management scientifique et la pratique de la recherche en tablant sur la qualité des enseignements, la formation et le recrutement du corps des enseignants-chercheurs et chercheurs, un personnel administratif performant. Il est mieux de structurer l’espace universitaire en imposant aux apprenants, une tenue à adopter lorsqu’ils y entrent.
Les crises peuvent naître de la méconnaissance du fonctionnement des universités, thématiques ou non. Quatre rôles principaux leur sont alloués pour « desserrer l’emprise de la pauvreté sur notre planète » (W. Saint, 2005, p. 3).
Primo, les universités atténuent « la pauvreté par [leur] contribution directe à la croissance économique, car [elles renforcent] la productivité d’un pays et sa compétitivité internationale » (W. Saint, 2005, p. 3). Elles sont des points focaux de formation d’une main d’œuvre qualifiée permettant d’accéder « à de nouveaux savoirs et à en produire – via la recherche – mais aussi en adaptant les savoirs mondiaux à leur utilisation locale. Ce faisant, [les universités contribuent] à déterminer les niveaux de vie au niveau local » (W. Saint, 2005, p. 3).
Secundo, les universités réduisent la pauvreté par leur action d’habilitation et de redistribution en participant à la construction de la société, faisant passer le capital-social en capital-confiance. Elles consolident les piliers de développement et contribuent à la redistribution en élargissant les opportunités d’emploi, de revenus et de mobilité sociale. Bien qu’elles ne soient pas des entreprises, les universités subsahariennes offrent des opportunités d’emploi et de revenus.
Tertio, elles consolident « l’ensemble du secteur de l’éducation et [améliorent] sa performance » (W. Saint, 2005, p. 4) en formant le corps enseignant et autres. En Afrique noire, il subsiste une instance d’évaluation et de promotion des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Ici, c’est le CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur) qui les évalue et promeut leur recherche. Les universités sont au premier plan du développement des curricula en contrôlant la qualité et en évaluant l’enseignement depuis les années primaires. Elles « analysent les performances de l’éducation, identifient les difficultés, proposent des solutions et guident les politiques » (W. Saint, 2005, p. 4).
Quarto, à l’ère des Objectifs du Millénaire pour le Développement (O.M.D.), les universités assurent leur succès et contribuent « au développement de capacités dans les domaines de la recherche, de la technologie appliquée et des services aux communautés, essentielles pour améliorer la production alimentaire, les revenus des ruraux et le bien-être des familles démunies » (W. Saint, 2005, p. 4).
Vu cette palette de qualificatifs, comment les universités subsahariennes sont-elles parvenues à être mal perçues, à décliner de la sorte ? Pourtant, elles desserrent l’emprise de la pauvreté. Pourquoi les crises persistent-elles dans les universités ? À quelle communication faut-il recourir à l’ère de la recrudescence des crises ?
Si les universités subsahariennes sont en crise, la source est loin d’être un défaut de fonctionnement et de formation. Les crises internes sont faciles à circonscrire et à éradiquer. Le problème réside dans la pression externe que subissent les universités. En exerçant des pressions sur les universités pour leur demander des résultats dans une atmosphère de satisfaction progressive des conditions salariales et/ou de travail, l’État leur permettra de faire des exploits. Les crises universitaires sont les défauts de résolution de la crise économique. Les universités souhaitent travailler dans de meilleures conditions et ne demandent que leurs efforts soient reconnus et récompensés. Quant aux étudiants, un cadre normatif de travail leur imposera une tenue et/ou une retenue.
Pourtant, tout semble être mis en place pour désorganiser l’Afrique subsaharienne, son système éducatif et l’enseignement supérieur, en lui imposant des mesures biaisées de résolution des crises laissant libre cours à son endettement, à sa déstructuration. Il faut se passer du rapport cogito-instrumental, inefficace et recourir à la communication au sens d’Habermas.
L’activité communicationnelle, en étant de l’ordre du discours argumentatif, se rapporte aux prétentions à la validité où l’intelligibilité, la vérité, la sincérité ; et la justesse normative sont sollicitées dans la résolution des crises. La discussion, en vulgarisant les fondements éthiques et juridico-démocratiques de son principe, s’approprie la dimension biologique de la communication, le langage qui favorise l’intelligibilité. Le recours au langage n’est que la satisfaction de la communication sans heurt qui booste la résolution de crises dans une interaction où chacun opte pour la préservation du consensus et actionne son rétablissement. Ayant un fondement empirique immédiat, l’intelligibilité permettra de disposer d’une compétence relative à des règles.
Quant à la vérité, elle est invitée dans la résolution des crises universitaires en se découvrant dans l’intersubjectivité, participant à l’universalité du logos. L’accent est mis sur la quête des valeurs où l’interaction nourrit le communiquer sur la base de préservation du consensus. Le pouvoir et le savoir s’accordent sur la pacification de la société et évitent de faire des questions économiques, le pilier dorsal de stabilisation de la société. Toutefois, le pouvoir économique doit comprendre le social en s’appropriant les recommandations politiques.
La sincérité, l’autre nom de la véracité subjective, une prétention à la validité non discursive, doit animer les mondes politique et universitaire en établissant une interaction communicationnelle préservant la société des sauts d’humeur des résolutions biaisées qui créent des crises en Afrique subsaharienne. Sous la sincérité, « le locuteur revendique pour l’énonciation des expériences vécues auxquelles il a un accès privilégié » (J. Habermas, 1987, p. 439). La sincérité va se charger d’entretenir un “fanatisme” communicationnel qui va aboutir sans doute au patriotisme constitutionnel. La résolution de la crise s’accompagne de la véracité subjective chargée de satisfaire les actions interactionnelles.
La justesse normative est une qualité permettant d’exécuter très exactement une chose donnée. Il s’agit de recourir à la dimension biologisante de l’homme où « les mots sont les étiquettes des choses et les énoncés sont les images des faits » (G. Hottois, 2002, p. 352). Normativement, les questions dissensuelles sont abordées dans le sens de ne rechercher que le consensus en vulgarisant le caractère communautaire et sociable de l’homme. La manière de s’exécuter sans la moindre erreur, a un rapport au social, définit et améliore la qualité de sa vie. Inviter la justesse normative pour résoudre les crises universitaires, c’est établir des normes intersubjectives, les règles d’action où les acteurs ne tiennent compte que de la quête de consensus.
La vérité se réfère au monde objectif, la justesse normative au monde social et la sincérité au monde subjectif. La justesse normative, l’exactitude (la vérité) et la sincérité sont le trépied sur lequel se fixe l’éthique communicationnelle. Il faut donc recourir aux universités pour faire face à la crise économique, leur demander leur avis, profiter de leur savoir-faire dans ce contexte de sociabilisation sur la base de la vulgarisation des principes de Discussion, « D », et d’Universalisation, « U », tenant compte du regard au monde, objectif, social et subjectif.
Ce qui importe ici, c’est la vulgarisation d’une atmosphère communicationnelle laissant prospérer la liberté communicationnelle qui « n’existe qu’entre des acteurs qui, se trouvant dans une attitude performative les uns avec les autres, veulent s’entendre sur quelque chose et attendent l’un de l’autre des prises de position sur les prétentions à la validité réciproquement émises » (J. Habermas, 2012, p. 136). Il ressort que la liberté communicationnelle dans un espace universitaire soumet les universités à des obligations illocutoires pour une bonne tenue du rapport politique-économie dans un triptyque politique-éthique-économie. N’est-ce pas le nécessaire recours au triptyque politique-éthique-économie qui consolidera la société via les universités ?
2. Triptyque politique-éthique-économie et résolution des crises universitaires
La situation de la Zone Euro doit attirer l’attention de tous pour se faire une idée précise de la posture à adopter aux fins d’affronter les crises. C’est aux États subsahariens évoluant majoritairement dans une union économique commune d’éviter de copier les erreurs de la Zone Euro. Il faut « prendre conscience d’un problème longtemps refoulé » (J. Habermas, 2012, p. 42) où l’espace économique achevé dans « un marché commun partiellement doté d’une monnaie commune [fait face à] une union politique inachevée, abandonnée au milieu du gué » (J. Habermas, 2012, p. 42).
La Zone Euro semble résoudre les crises économiques sur la base de sanctions. Pourtant, le « renforcement des sanctions ne suffira pas à contrebalancer les conséquences non voulues qu’engendre une asymétrie voulue entre une union économique complète et une union politique incomplète » (J. Habermas, 2012, p. 43). Les sanctions économiques, en étant incapables d’aider à résoudre les problèmes sociaux, font « imaginer une politique économique qui compense les niveaux de développement » (J. Habermas, 2012, p. 43).
C’est politiquement que l’économie doit être régulée et non par la batterie de sanctions pour redresser une situation économique déjà désastreuse dans un État. La résolution des crises économiques sur la base de sanctions, engendre des problèmes sociaux échappant aux compétences économiques. Le défaut de résolution des crises économiques jusqu’à nos jours, a manqué d’implémenter la politique économique pour compenser les niveaux de développement.
Les crises universitaires étant la résultante des crises économiques, leur résolution doit s’approprier la politique économique. Réduire le budget des universités en ne tenant pas compte de leur réalité, engendrera des préoccupations sociales que l’économie ne peut résoudre. Pour consolider la société, il faut suivre l’ordre préétabli. Tout doit commencer par la politique, se poursuivre par l’éthique et se terminer par l’économie. La politique devient le pilier de l’ordonnancement de la société, l’éthique, le pivot-catalyseur et l’économie, le moyen de satisfaction des besoins. Il faut dès lors comprendre que,
les Européens, en cherchant à compenser les conséquences sociales non désirées qu’entraîne l’accroissement des injustices distributives et à obtenir une certaine “régulation” de l’économie mondiale, doivent également témoigner d’un intérêt pour la politique comme pouvoir de mise en forme de la société, ce qui permettrait qu’une Union européenne capable d’action politique accède au cercle global players. (J. Habermas, 2005, p. 238).
La crise économique constitue la source privilégiée de la naissance/vulgarisation des crises sociales. Le capital-pouvoir fait s’effriter le capital-confiance où tout fonctionne de façon capitalistique. Le “prêt-à-porter” occidental est imposé par “le monde libre“. Il faut éviter les défauts d’appréciation croyant que « l’économie avait une stabilité et des lois contraignantes alors que la politique était plus incertaine soumise aux instabilités liées à la démocratie » (Y. Zarka, 2012, p. 8).
Au lieu de dynamiser la coopération en Afrique où « coopérer, c’est travailler ou faire ensemble une œuvre utile pour toutes les parties » (N. Agbohou, 2008, p. 236), l’on souffre des retombées d’une gestion calquée sur l’Occident hégémonique où la politique du marché est son œuvre. Se référer à Habermas, c’est intervenir dans une logique de normalisation communicationnelle de la société.
Les acteurs rationnels d’une interaction motivée font de la délibération le pivot harmonisateur des échanges et des discussions. En effet, « la délibération se fait au moyen d’un échange de vues sur la base d’une bonne foi – y compris l’exposé, par les participants, de la façon dont ils comprennent eux-mêmes leurs intérêts vitaux respectifs -, où le scrutin, si l’on y procède, représente la confrontation des jugements » (J. Habermas, 2003, p. 265). Une éthicisation sur la base délibérative aide à tout harmoniser où les participants-acteurs comprennent leurs intérêts et optent pour la confrontation des jugements.
Une éthicisation communicationnelle naîtra de la délibération afin d’acquérir une démocratisation des formes de communication participant à la formation de la volonté commune. La justesse normative, l’exactitude (la vérité) et la sincérité sont le trépied sur lequel se fixera l’éthique communicationnelle où la politique et l’économie graviteront autour d’elle dans une logique coopérative. La politique ordonne et invite l’économie à participer à l’ordonnancement sociétal. Les universités subsahariennes doivent participer à l’insertion socio-professionnelle de leurs citoyens en élargissant les secteurs d’activités pour une intégration républicaine réussie.
3. Universités subsahariennes : entre insertion socio-professionnelle et intégration républicaine
« Le repositionnement de la souveraineté populaire tenté par Habermas en tant qu’il vise l’intégration sociale met en évidence, en plus des ressources du système économique et du pouvoir administratif, [la] troisième ressource fournie par la solidarité » (Y. E. Kouassi, 2010, p. 101). Ainsi, la lutte contre le chômage doit se faire dans un esprit de solidarité élargissant le champ d’insertion des citoyens. Il faut donc être solidaire des efforts des universités africaines formant les élites et répondant aux besoins de l’État en desserrant « l’emprise de la pauvreté ».
Les universités ne doivent pas être les seules à lutter contre le chômage en restant le pôle qui absorbera la main d’œuvre. L’histoire des “Docteurs non-recrutés” en Côte d’Ivoire est préoccupante. Il faut se réjouir de la qualité des ressources humaines puisque ces intellectuels ont beaucoup à donner dans le développement du pays. Ceux du domaine de l’enseignement doivent être intégrés directement au secondaire en entendant l’ouverture des universités évitant d’être frappés par la limite d’âge. Les centres de recherche doivent ouvrir ainsi que les cabinets ministériels pour en absorber. Il faut éviter la fuite des cerveaux, ces intellectuels chèrement formés par le biais des ressources de l’État. Les universités subsahariennes, en répondant au besoin de la main d’œuvre du pays, doivent se moderniser et s’actualiser.
La formation commençant depuis le cycle primaire, c’est à partir de la première marche de l’éducation-formation qu’il faut trouver des pôles d’absorption de ceux que le système ne peut prendre en compte. L’industrialisation produisant les usines, les secteurs de la boulangerie, la pâtisserie, la maçonnerie, la menuiserie, la tapisserie, l’ébénisterie, les chauffeurs, la couture, la coiffure et les caissières feront office d’espace de promotion des centres de formation de qualité absorbant une main d’œuvre de qualité, aux sociétés de construction de maisons, des routes et des supermarchés…
L’armée doit être pourvoyeuse d’emplois en accompagnant la promotion du génie civil où les BTP (Bâtiments-Travaux-Publics) intégreront le monde du travail dans une atmosphère disciplinée. Il faut donc limiter la privatisation des sociétés et des secteurs clés faisant de l’État l’actionnaire majoritaire. La maîtrise de la démographie en contrôlant les naissances, les entrées et les sorties du territoire, mettra à la disposition du pays, un effectif impressionnant de douaniers aux frontières.
Le secteur agricole doit être motorisé et les acteurs doivent prendre conscience de leur part dans le développement de la Nation sans omettre d’accroitre l’effectif des agents des Eaux et Forêts pour contrôler les parcs et réserves de l’État. L’autosuffisance alimentaire doit se régler avec l’aménagement des bas-fonds pour la culture du riz et les cours d’eau pour la pisciculture pour les États pourvus de ressources naturelles à utiliser à bon escient. Les pays ouvrant sur les océans doivent accroitre l’effectif des marins pour les contrôler et les préserver de l’exploitation abusive. L’informatique doit couvrir les secteurs d’activité en produisant et intégrant la main d’œuvre disponible.
Conclusion
Les universités, en desserrant l’emprise de la pauvreté en Afrique, doivent être accompagnées. Il faut leur éviter l’étiquette de temples de déstabilisation, lieu d’absorption inutile du budget de l’État. La synergie communicationnelle entre le temple du savoir et l’instance du pouvoir naîtra autour du triptyque politique-éthique-économique.
La communication devient le moyen de résolution des crises universitaires faisant des universités africaines, l’épicentre de la lutte contre le chômage ; puisqu’elles agissent dans tous les domaines d’activités. Les Facultés ont leur raison d’être en sachant que les universités sont loin de couvrir à elles seules l’insertion de la main d’œuvre du pays. Les universités subsahariennes doivent accompagner les secteurs pourvoyeurs d’emplois tels que l’agriculture, l’élevage, la riziculture, l’armée, la douane, la marine, les eaux et forêts, les usines, les travaux publics, les supermarchés, les boulangeries, l’élevage, etc.
Il faut consolider les fondements de la société permettant à l’Afrique de s’assumer. L’intégration républicaine n’est un succès que lorsque le pouvoir est à l’écoute du savoir pour répondre de façon synergique à l’insertion de la main d’œuvre. En conséquence,
l’enseignement supérieur doit bénéficier d’un financement adéquat et durable. Étant donné la difficulté des États membres à assurer un financement complet de l’enseignement supérieur, le forum recommande aux établissements d’enseignement supérieur de mobiliser des ressources complémentaires à travers des activités génératrices de revenus et des contributions minimales et raisonnables des étudiants. (Unesco, 1998a, p. 9).
Références bibliographiques
AGBOHOU Nicolas, 2008, Le franc CFA et l’Euro contre l’Afrique. Pour une monnaie africaine et une coopération sud-sud, Paris, Solidarité mondiale.
BOUCHINDHOMME Christian, 2002, Le vocabulaire de Habermas, Paris, Ellipses.
GOGOUA Ozoua Georgette et SYBILLE Le Monnier de Gouville, 2011, « Université : Crise et communication », in https://www.cairn.info/revue-specificites-2011-1-page-85.htm.
Groupe de la Banque africaine de développement, 2007, « Stratégie pour l’enseignement supérieur, la science et la technologie » in Département des politiques opérationnelles et des normes (ORPC) Département du développement humain (OSHD), p. 1-36.
HABERMAS Jürgen, 1987, Logique des sciences sociales et autres essais, trad.fr Rainer Rochlitz, Paris, P.U.F.
HABERMAS Jürgen, 2003, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, trad.fr Rainer Rochlitz, Paris, Fayard.
HABERMAS Jürgen, 2005, De l’usage public des idées. Écrits politiques 1990-2000, trad.fr Christian Bouchindhomme, Paris, Fayard.
HABERMAS Jürgen, 2012, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. fr Rainer Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard.
HABERMAS Jürgen, 2012, La constitution de l’Europe, trad.fr C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard.
HOTTOIS Gilbert, 2002, De la renaissance à la postmodernité. Une histoire de la philosophie moderne et contemporaine, Bruxelles, De Boeck Université.
KOUASSI Yao Edmond, 2010, Habermas et la solidarité en Afrique, Paris, L’Harmattan.
La lettre de l’ADEA (Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique), 2005, « Quel enseignement supérieur pour l’Afrique ? », Vol. 17, numéro 3/4, Juil.-Déc.
ORIVEL François, 1991, « La crise des universités francophones en Afrique subsaharienne » in Perspectives, Revue trimestrielle de l’éducation, Vol. XXI, N°3, 79, p. 377-385.
RANCIÈRE Jacques, 1995, La mésentente, Paris, Galilée.
ROCHLITZ Rainer, 2002, Habermas. L’usage public de la raison, Paris, P.U.F.
SAINT William, 2005, « Enseignement supérieur et développement » in La lettre de l’ADEA (Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique), Vol. 17, n° 3/4, Juillet-Décembre.
SUSAN Antoni, 2005, « Ressources éducatives en libre accès : une solution pour le supérieur ? » in La lettre de l’ADEA (Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique), Vol. 17, n° 3/4, juillet-décembre, p. 1-27.
VERSPOOR A. Adriaan, 1991, « Vingt années de la Banque mondiale à l’éducation fondamentale : Présentation et évaluation » in Perspectives, Revue trimestrielle de l’éducation, Vol. XXI, N°3, 79, p. 344-362.
ZARKA Yves, 2012, Refaire l’Europe avec Jürgen Habermas, Paris, P.U.F.
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Autant l’université en Afrique est à l’image de la société actuelle, autant la société elle-même est le reflet de l’université. Ainsi, les crises de l’une entravent le bon fonctionnement de l’autre et vice-versa. L’université et la société actuelle traversent une crise de valeur éducationnelle. En partant de la dialectique crise de l’université et crise de la société actuelle, nous entendons, dans l’optique hountondjienne, préconiser le recours aux cultures africaines, par le canal des langues. C’est à travers une appropriation critique des savoirs endogènes, voire une réforme profonde de la culture que l’université et la société africaines pourront connaître un développement certain et radieux.
Mots clés : Crise de l’université, Crise des valeurs, Cultures africaines, Mondialisation, Savoirs endogènes.
Abstract:
As much as the university in Africa is a reflection of current society, so much society itself is a reflection of the university. Thus, the crises of one hinder the proper functioning of the other and vice versa. The university and the current society are going through a crisis of educational values. Starting from the dialectical crisis of the university and that of current society, we intend, from the Hountondjian perspective, to advocate the use of African cultures, through the channel of languages. This means that it is only through a critical appropriation of endogenous knowledge, or even a profound reform of culture that the university and African society will be able to experience a certain and radiant development.
Keywords : African cultures, Endogenous knowledge, Globalization, University crisis, Values crisis.
Introduction
Dans sa lettre à son ami Friedrich Immanuel Niethammer, en date du 28 octobre 1808, G. W. F. Hegel (1962, p. 229) écrit : « Le travail théorique – je m’en convaincs chaque jour davantage – apporte au monde que le travail pratique ; si le domaine des idées est révolutionné, la réalité ne peut demeurer telle qu’elle est ». Cette insistance sur le rôle actif des idées en général et sur celui de la philosophie en particulier, dans la marche du monde, met en relief la puissance politique de la philosophie. Comprenons par-là que la philosophie, contrairement à une certaine image véhiculée depuis des lustres, n’est pas que pure spéculation.
S’il est vrai que les idées constituent le moteur de l’histoire des sociétés, il va sans dire qu’on ne saurait occulter, dans ces conditions, la place de l’université, ce haut lieu de la formation et de la recherche, où foisonnent en permanence les idées, dans la marche de toute société. L’université est, d’abord et avant tout, un produit de la société. Elle est à la fois le stade ultime de l’instruction et le creuset de la recherche au service de la société dont elle traduit les aspirations. De même, elle module, à travers les idées qu’elle féconde, l’existence collective, la marche de la société. À l’image de l’éducation dans son ensemble, l’université peut alors être perçue comme « le logiciel de l’ordinateur central qui provoque l’avenir des sociétés » (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 16). En outre, en tant que produit de la société, l’université ne peut qu’être à son image. En somme, conçue par et pour la société, l’université n’en est pas moins son reflet.
Les sociétés africaines d’après les indépendances sont secouées par des crises multiformes. S’il est vrai que ces crises sont pour la plupart des crises socio-politiques, elles se présentent fondamentalement comme des crises de valeurs. Celles-ci ne manquent pas d’affecter l’université, tout comme les sociétés elles-mêmes subissent le contrecoup de la crise de l’université.
Face à cette réalité, il est plus qu’impérieux de permettre à l’université de remplir la mission à elle assignée. Il convient de résorber la crise de l’université, à travers des initiatives de nature à agir sur l’environnement au sein duquel elle évolue. Dans cette perspective, Paulin Hountondji préconise le recours aux cultures africaines, avec un accent particulier sur les langues.
Dans ces conditions, le recours à la culture contribue-t-il à la résorption de la crise de l’université en Afrique ? Les crises de sociétés ne conduisent-elles pas à la crise de l’université ? Par ailleurs, la crise de l’université n’affecte-elle pas à son tour les sociétés elles-mêmes ? N’y a-t-il pas lieu, dès cet instant, de procéder à une réforme du système universitaire, à travers la démarginalisation des cultures africaines, en vue de résoudre la crise de l’université en Afrique ? Les réponses à ces interrogations constitueront les axes majeurs de cette analyse. Pour ce faire, nous montrerons d’abord que les crises de sociétés engendrent la crise de l’université. Il s’agira, par la suite, de mettre l’accent sur les implications sociales de la crise de l’université. Enfin, nous présenterons la nécessité d’une révolution culturelle en Afrique pour la résolution de la crise de l’université. Notre démarche analytico-critique et empirique vise à présenter la place de la culture dans la redynamisation de l’université en Afrique.
1. Des crises de sociétés à la crise de l’université
Les sociétés africaines sont, de tout temps, affectées par des crises multiformes. L’aspect le plus visible de ces crises se situe au niveau socio-politique, même s’il est vrai que ces tensions socio-politiques ne sont que l’expression de « la crise des valeurs » (G. Mendel, 2004, p. 11), des crises identitaires au sein des sociétés africaines. Celles-ci entravent, à leur tour, le fonctionnement normal de l’université, conduisant à des ruptures, à des tensions, à des crises.
La déliquescence des valeurs morales rejaillit négativement sur le fonctionnement normal de l’université. J.-P. Ngoupandé (1995, p. 1) fait le constat, au sein des universités d’Afrique francophone, d’« une dérive morale inquiétante » :
Dans de nombreux pays d’Afrique francophone, les universités ont été le lieu, ces dernières années, d’actes de violence : agressions, enlèvements, lynchages, « braisages ». Beaucoup d’entre elles sont devenues le champ clos d’affrontements, de guérilla quasi permanente. Pour illustrer le désarroi dans lequel a plongé la jeunesse africaine scolarisée, il faut évoquer les grèves à répétition conduisant, souvent, à des années entières sans scolarité, que l’on appelle désormais, partout, des années « blanches ».
L’atmosphère de violence dans laquelle baignent les universités africaines n’est que l’expression de la violence qui s’est emparée des communautés africaines dans leur ensemble. La paupérisation exacerbée des masses africaines, qui a créé une classe de laissés-pour-compte, a contribué à un regain de violence de la part de ceux-ci qui y trouvent le moyen de leur survie. On ne saurait, dans ce contexte, dédouaner les élites dirigeantes qui ont fait de la question sociale une question de moindre importance.
En outre, la lutte pour le pouvoir se détourne, à certains moments, des voies légales, pour emprunter celle de la violence. Les trois premières décennies des indépendances africaines, notamment en Afrique subsaharienne, ont été émaillées de coups d’État militaires. L’histoire nous apprend qu’en Novembre 1938, lors d’une réunion d’urgence du Parti Communiste Chinois, à Hankou[118], le leader communiste Mao Tsé-Toung a cru bon de déclarer : « Le pouvoir est au bout du fusil ». Une interprétation simpliste de cette assertion tendrait à faire croire que le leader chinois invitait les militaires et autres hommes en armes à s’emparer du pouvoir. Bien au contraire, il entend « inviter les révolutionnaires à prendre eux-mêmes les armes ». (P. J. Hountondji, 1973, p. 18).
Mais l’Afrique, « gourmande d’idées nouvelles », (E. Fottorino et al, 1992, p. 346), ne tarda pas à faire sienne cette formule sitôt les indépendances acquises. Ayant opté pour une interprétation au premier degré, les militaires africains se l’approprient. La récurrence des coups d’État militaires et autres rébellions armées, sur le continent, n’est donc plus à démontrer.
La violence, omniprésente au sein des communautés africaines, ne peut qu’affecter, et même infecter, la perception de la jeunesse qui, faute de modèle, préfère composer avec l’existant. Cet existant-là renvoie, dans bien des cas, à l’image de ces chefs rebelles et de ces putschistes, exhibant fièrement leur réussite sociale imputable aux armes. Nous sommes désormais coutumiers de ces « réussites » sans effort, de ces « élites » au curriculum vitae tenant à peine sur la moitié d’une feuille de papier au format A4.
Que faut-il alors attendre de nos étudiants ? Bien évidemment, c’est par la voie de la violence qu’ils expriment, pour la majorité d’entre eux, leurs revendications, quoique légitimes. Mais cette légitimité finit par s’éclipser du fait de la violence qui accompagne ces revendications. La lutte pour le leadership des mouvements estudiantins se mue, dans plupart des cas, en affrontements armés, en batailles rangées. Faut-il en vouloir aux étudiants ? En réalité, derrière chacun des clans en lutte, ne faut-il pas voir la main du politique ? En fait, la bataille politique a vite fait de se déporter au sein de l’université où chaque clan est parrainé, soit par le pouvoir, soit par l’opposition. Reconnaissons, en tout état de cause, que les luttes estudiantines au sein des universités ne sont que l’expression des querelles politiques au sein de la société.
Pour comprendre la crise de l’université en Afrique, Paulin Hountondji nous convie à la saisie et à la compréhension globale des crises des sociétés africaines. Et pour y parvenir, nous ne saurions faire abstraction du contexte de la colonisation et de ses séquelles dans les composantes desdites sociétés. La subordination des cultures africaines à ce qu’il est convenu d’appeler la « civilisation occidentale » – subordination induite par le colonialisme – a eu pour effet d’engendrer dans les sociétés africaines, le phénomène de l’extraversion. Pour comprendre le sens et la portée de ce terme, lisons ces propos :
Le terme d’extraversion semble avoir été introduit dans la littérature économique actuelle par F. Perroux et popularisé par son disciple marxiste le plus connu Samir Amin. Il s’inscrit donc dans une vision critique du phénomène et s’oppose, de ce fait, aux théories de la spécialisation internationale (qui estiment généralement que l’intensification des relations internationales rapproche de l’optimum) de même qu’il s’oppose aux théories de la diffusion du développement par le commerce international, les capitaux étrangers ou l’aide extérieure. Le terme d’extraversion est, par contre, facilement intégrable aux théories latino-américaines de la dépendance et à celles, plus radicales, du développement du sous-développement (J. Coussy, 1978, p. 859).
Le terme d’extraversion prendra par la suite un sens plus large pour s’appliquer à la fois à la science, à la philosophie, disons à la pensée en général, ainsi qu’à la culture et même à la politique. Hountondji constate, à cet effet, qu’à l’image de l’économie, la production scientifique et théorique africaine, tout comme la production philosophique, fonctionne comme un produit d’exportation. Ce faisant, la tendance est à la satisfaction des besoins du public occidental, au lieu de se tourner vers les réalités africaines. De même, tout en dénonçant l’extraversion de l’économie béninoise, au sens où « elle reste tournée vers l’extérieur, subordonnée aux besoins des métropoles industrielles du Nord », (P. J. Hountondji, 2000, p. 182), il fait remarquer : « La critique de l’ethnophilosophie a permis d’articuler une critique de l’extraversion intellectuelle en général. Ce n’est pas seulement la production philosophique, c’est toute la production scientifique et théorique africaine qui est davantage lue hors d’Afrique qu’en Afrique » (P. J. Hountondji, 1997, p. 229).
Une telle attitude est loin d’être neutre, car elle procède du rapport global de l’Afrique à l’Occident où, pendant longtemps, l’Africain a attendu de l’Occident qu’il lui délivre son certificat d’humanité. Du coup, ses productions, partant, sa culture même, n’ont de sens et de valeur que par l’approbation de l’Occident.
Le système de formation et d’enseignement en général, et l’université, en particulier, ne sauraient, par conséquent, échapper à cette politique de l’extraversion. La formation universitaire, au lieu de répondre aux besoins et aux réalités des sociétés africaines, se préoccupe constamment de pérenniser la tradition universitaire des puissances occidentales. Toute chose qui ne peut que déboucher sur une sorte de décalage entre les contenus des programmes d’enseignement et les préoccupations spécifiquement africaines.
La valeur, la qualité de notre formation, se juge à l’aune de notre plus ou moins parfaite assimilation et maîtrise des contenus occidentaux d’enseignement, stigmatisant les spécialisations essentiellement centrées sur les préoccupations africaines. C’est ainsi qu’au sein même de nos universités, et de nos départements respectifs, les études africaines ont bien souvent été tournées en dérision par une frange d’enseignants, toujours préoccupés par le sempiternel débat sur l’existence ou non d’une philosophie africaine, et la légitimité même des cours de philosophie africaine, quand ils arborent fièrement leurs spécialisations en tel ou tel aspect de la philosophie occidentale.
L’université, dans ce contexte, n’est ni plus ni moins, que l’otage de la politique de définition des contenus des programmes d’enseignement, soucieuse de les conformer à une certaine vision occidentale, dans le sens de la perpétuation de la subordination des sociétés et des cultures africaines à celles de l’Occident. La crise de l’université est, à ce titre, d’abord et avant tout, la crise des sociétés africaines. Toutefois, les sociétés africaines elles-mêmes ne subissent-elles pas le contrecoup de la crise de l’université ?
2. De la crise de l’université aux crises des sociétés
Les crises qui affectent les universités africaines, notamment celles au Sud du Sahara, se répercutent, à leur tour, sur les sociétés, toute chose qui met en évidence la place de l’université au sein de la société.
L’université, à travers les syndicats d’Enseignants-Chercheurs et de Chercheurs, et les syndicats estudiantins, est loin d’être étrangère aux luttes socio-politiques. Les Enseignants-Chercheurs et les Chercheurs, tout comme les étudiants ont, à cet effet, joué un rôle prépondérant dans les différentes mutations socio-politiques, tant pendant la période coloniale, au moment des indépendances qu’à l’ère de l’ouverture démocratique.
Au nombre des « catalyseurs de la démocratie » identifiés par P. J. M. Tedga, (1991, p. 51), figurent en bonne place les étudiants. La jeunesse estudiantine aura joué un rôle prépondérant dans l’avènement de la démocratie, dans des pays comme la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Zimbabwé, en 1990. Ses propos nous édifient amplement : « Les étudiants auront joué un rôle majeur dans le démantèlement du système du parti unique en Afrique. Ils ont donné l’espoir et redynamisé les autres catégories socio-professionnelles (avocats, travailleurs, etc.) que la somnolence des partis uniques avait fini par aussi alanguir. » (P. J. M. Tedga, 1991, p. 54).
L’insistance sur l’activisme politique des étudiants, et leur implication dans l’avènement de la démocratie, est également mise en relief, sous la plume de Y. Konaté (2002, p. 780) :
Les programmes d’ajustement structurel se rectifièrent les uns après les autres puis, en 1990, la coupe fut pleine. Et déferla sur l’Afrique des pères fondateurs, l’ouragan des libertés. Les exigences des jeunes et des travailleurs tonnèrent et développèrent un tourbillon sociopolitique qui enfla. Les dictateurs plièrent, certains se cassèrent et furent emportés par la colère des foules. Quelques pays s’offrirent des conférences nationales, mais tous écopèrent du pluralisme politique. Une nouvelle génération de politiciens émergea. En Côte d’Ivoire, comme partout en Afrique, les étudiants furent le fer de lance de cette contestation.
Dans un tel cas de figure, on ne peut que constater l’incidence négative de la crise de l’université sur la société. Il est certes fait état d’une sorte d’embellie les premières décennies des indépendances, autour des années 60-80. Il n’en demeure pas moins cependant que les décennies 80-90, période au cours de laquelle se manifestent ouvertement les aspirations démocratiques au sein des États d’Afrique subsaharienne, conjuguées à la conjoncture économique, engendrent de profondes crises au sein des universités. Ce mal-être de l’université en Afrique ne peut qu’entraver le fonctionnement normal des sociétés. Trois aspects retiennent notre attention : les ressources humaines, le social et le politique.
Concernant les ressources humaines, il apparaît que les crises que traversent les universités africaines, et ce, depuis 1990, ne sont pas de nature à favoriser une formation académique de qualité. S’il est vrai que « l’enseignement supérieur sert de système de sélection qui sépare les étudiants selon leurs aptitudes ; il joue un rôle de filtre en détectant a priori les individus les plus capables », (M. Jaoul, 2004, p. 41), il faut cependant noter que le niveau des diplômés, sortis des universités, laisse tout de même à désirer. L’épineux problème de l’adéquation formation-emploi se pose alors avec acuité. Soit le marché de l’emploi n’est pas pourvu, soit l’insertion dans le milieu professionnel des diplômés ne s’accompagne pas toujours d’un rendement à la hauteur des attentes. P. J. Hountondji (2000, p. 226) dépeint éloquemment cette situation :
L’université en particulier, cette crème du système, est désormais dans un état de désarticulation totale par rapport à l’économie et à la société. L’État continue à la financer à grands frais sans se rendre compte, ou sans oser dire qu’il se rend compte que, ce faisant, il ne finance qu’une chose : la production accélérée de ceux qu’on appelle pudiquement, au Bénin, les « diplômés sans emploi ».
Du social, il faut souligner d’une part que la culture de la violence, exacerbée en milieu universitaire par certains syndicats estudiantins, se déporte au sein de la société, fragilisant de ce fait le tissu social. Des revendications légitimes aux plus fantaisistes, certains syndicats d’étudiants sont passés maîtres dans l’art de vouloir tout obtenir de la part des Administrations ou de l’État. Sous le prétexte de revendiquer de meilleures conditions d’étude, ils n’ont de cesse de recourir à la violence. Abandonnant les amphithéâtres et autres salles de travaux dirigés ou de travaux pratiques, des leaders syndicaux, soutenus en cela par leurs affidés, ne doivent leur statut d’étudiants qu’à leur capacité à instaurer sur les campus universitaires un climat de terreur qui n’épargne personne : Administration, personnel enseignant, personnel administratif et technique, étudiants.
Ce recours permanent à la violence, par des syndicats d’étudiants, ne peut qu’accoucher de citoyens qui auront fait de la violence la seule voie de recours lorsqu’ils estiment que leurs exigences ne sont pas satisfaites. Les négociations pacifiques, la voix du dialogue, ne sont plus pour eux l’option privilégiée. Tout désormais doit s’obtenir par la violence.
Pour le politique, nous constatons que la crise de l’université peut, d’une manière ou d’une autre, conduire à la déstructuration de l’écosystème politique. C’est ce qu’il nous est donné de constater, de façon concrète, dans le cas de la Côte d’Ivoire. Sous l’impulsion de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), le principal syndicat d’étudiants dès 1990, la violence investit le milieu universitaire, à partir de décembre 1998, avec l’élection au poste de Secrétaire général de Charles Blé Goudé, qui succède à Guillaume Kigbafori Soro, dirigeant du mouvement estudiantin de 1995 à 1998. Un concept nouveau verra le jour au cours du congrès électif de Blé Goudé : le machettage ou recours à la machette. Laissons le soin à Y. Konaté (2003, p. 59), de nous édifier à ce sujet :
Charles Blé Goudé a été élu secrétaire général de la Fesci à l’issue du congrès de décembre 1998, et c’est lors de ses affrontements avec les adversaires du congrès que la machette sera déclinée en verbe. Le machettage intègre alors officiellement une nomenclature de l’horreur dont les hauts faits consistent à « zébier » et à « braiser ».
« Zébier », c’est tuer quelqu’un à la manière de Thierry Zébié Zirignon, cet étudiant de 24 ans, inscrit à la Faculté de Sciences et Techniques (FAST) de l’Université d’Abidjan – devenue Université Félix Houphouët-Boigny – mort des suites d’un massacre collectif par projectiles, accusé d’exercer, avec ses camarades, une terreur sur la cité universitaire de Mermoz, dans la commune de Cocody. C’était le lundi 17 juin 1991. « Braiser », c’est tuer par le feu. Il s’agit de jeter la victime dans un feu allumé et attisé par des pneus.
Cette culture de la violence, qui a investi l’université, dès 1990, est loin d’être étrangère à la rébellion armée de 2002 et à ses métastases, jusqu’à la crise post-électorale de 2010. En somme, elle « apparaît comme l’un des fondements de la guerre d’une part, et de l’ultranationalisme qui lui répond, d’autre part » (Y. Konaté, 2003, p. 49). C’est que l’épisode du machettage, a mis dos à dos deux tendances, au sein de la FESCI, qui continuent de s’affronter par sympathisants interposés : celle de Blé Goudé, Secrétaire général, et celle de Soumaïla Doumbia dit « Major », membre de son bureau, et même son intérimaire quand il était en prison, mais qui finit par rentrer dans la dissidence. Doumbia Major était à l’époque soupçonné d’être un proche de Guillaume Soro.
Ainsi, lorsqu’éclate la rébellion armée du 19 septembre 2002 contre le pouvoir de Laurent Gbagbo, et après que Guillaume Soro s’est déclaré leader de cette rébellion, Blé Goudé, proche du Chef d’État ivoirien, crée, avec certains de ses camarades, le Mouvement des Jeunes Patriotes, en vue de faire barrage à la rébellion et de sauver le pouvoir en place. La vie politique ivoirienne, de 2002 à 2010, sera donc rythmée par ces affrontements à distance entre le camp Soro et le camp Blé Goudé. Aux armes de Soro Guillaume et de sa branche armée – les Forces Nouvelles – répond un discours patriotique, populiste et même ultranationaliste qui ne fait pas toujours l’économie de la violence. De même, la crise post-électorale de 2010 qui oppose Alassane Ouattara – déclaré vainqueur des élections présidentielles – à Laurent Gbagbo, et qui conduit à l’arrestation de celui-ci le 11 avril 2011, peut être présentée comme le prolongement de la guerre fratricide entre les anciens leaders du mouvement estudiantin par parrains interposés.
La crise de l’université engendre, à bien des égards, des crises de sociétés. Mais, comment parvenir à une résolution efficace de la crise de l’université ?
3. De la nécessité d’un « renversement copernicien » pour la résolution de la crise de l’université
Le poète et philosophe allemand, J. C. F. Hölderlin (1967, p. 867), écrit, à travers « Patmos », l’un de ses plus grands hymnes, les deux premiers vers que voici :
Tout proche
et si difficile à saisir, le dieu !
Mais au lieu du péril croît
aussi ce qui sauve.
Ramenée au contexte de notre analyse, cette conception nous incline à mentionner que chez Hountondji, la crise de l’université ne peut être résolue que par et dans les sociétés africaines dont les multiples crises en constituent le fondement. Dès lors, c’est à l’Africain lui-même qu’il appartient de se prendre en charge. C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’assumer son existence, d’infléchir le cours de cette existence-là, en un mot d’être maître de son destin. Car, en réalité, « le développement ne se parachute pas, et ne peut venir de l’extérieur. Il ne s’affirme que lorsqu’il est autocentré et puissamment piloté par une volonté nationale forte, éclairée et légitime ». (M. Rocard, 2003, pp. 21-22). Et de souligner qu’en Afrique, « le seul exemple connu d’un décollage réussi ayant pris appui sur l’aide occidentale est l’Île Maurice ». (M. Rocard, 2003, p. 22). Comme quoi, les autres pays du continent n’ont qu’à compter sur eux-mêmes.
Il est donc plus qu’impérieux de se tourner vers les réalités africaines pour répondre aux attentes des universités africaines. En effet, si l’université en Afrique va mal, c’est parce que les sociétés africaines vont mal. De façon concrète, c’est parce qu’en Afrique, on fait peu de cas de l’appropriation et de la pratique des cultures africaines. L’université a le mérite de poser, de plus en plus, le problème de l’africanisation des programmes. Mais loin d’être un appendice des débats occidentaux, celle-ci doit pouvoir conduire à une prise en compte effective des cultures africaines.
Hountondji en appelle à un ‟renversement copernicien”. Celui-ci consiste à substituer à l’étude des cultures africaines leur pratique dans l’optique de leur transformation. S’appuyant sur les langues africaines, conçues comme des vecteurs de culture, d’autant plus que « parler, (…) c’est surtout assumer une culture, supporter le poids d’une civilisation » (F. Fanon, 1952, p. 14), il estime que le plus important n’est pas d’enseigner les langues africaines, mais d’enseigner « dans les langues africaines ». (P. J. Hountondji, 1980, p. 237).
Il y a lieu d’insister sur la nécessité pour l’Africain de s’approprier ses langues et de les utiliser comme canal pour la transmission du savoir. La langue, l’avons-nous relevé avec Fanon, est le véhicule de la culture. L’enseignement dans les langues africaines permet à l’Africain de vivre pleinement sa culture, d’en maîtriser toute la complexité. En fait, l’instruction reçue dans les langues coloniales soumet les consciences africaines à la saisie et à la compréhension des cultures occidentales. Il y a comme un décalage entre le savoir acquis et l’être même de l’Africain.
Dès lors, l’enseignement dans les langues africaines permet de comprendre les cultures africaines dans leur essence même. Il permet d’accéder à un niveau de compréhension auquel les langues occidentales ne sauraient nous conduire. Car, il y a l’épineux problème de la traduction. Certains concepts ne se saisissent mieux que lorsqu’ils sont émis dans leur langue d’origine. Le fait est que tout ne peut être traduit. La traduction échoue, dans bien des cas, à restituer l’idée dans son originalité, dans son authenticité. En lieu et place de la traduction, on se retrouve souvent face à une interprétation. Hountondji en est bien conscient lorsqu’il reconnaît que
le passage d’une langue à une autre ne va pas de soi. Le bel optimisme des philosophes (…), l’assurance de pouvoir échanger, dialoguer, fraterniser sous l’horizon de l’universel, la certitude de viser un même univers du sens par-delà nos particularités culturelles et linguistiques, tout cela est mis en cause par la multitude d’expressions intraduisibles ou difficilement traduisibles, l’obligation d’expliquer, de contourner, de recourir à des périphrases pour faire comprendre, tant bien que mal, ce qu’on a voulu dire dans la langue de départ. (P. J. Hountondji, 2006, p. 7).
L’université, en Afrique, se doit d’œuvrer dans le sens d’une démarginalisation des langues africaines longtemps restées à la périphérie, c’est-dire en marge du système d’élaboration du savoir. Démarginaliser les langues africaines, c’est en faire des véhicules de la science, au lieu de se contenter de les traiter comme des objets de science. De façon précise, l’étude dans les langues occidentales (français, anglais, allemand, espagnol, etc…) des structures linguistiques des langues africaines doit faire place à l’étude dans les langues africaines des structures linguistiques des langues occidentales. L’université, en Afrique, retrouvera, par ce biais, son être même.
En pratiquant les langues africaines, en les assumant comme des véhicules de la science, l’université s’inscrit dans la perspective globale d’« un effort de réappropriation, non moins critique et responsable, des savoirs et du savoir-faire endogènes ». (P. J. Hountondji, 1994, p. 15). Les savoirs endogènes, faut-il le souligner, sont des connaissances vécues « par la société comme partie intégrante de son héritage, par opposition aux savoirs exogènes qui sont encore perçus, à ce stade au moins, comme des éléments d’un autre système de valeurs ». (P. J. Hountondji, 1994, p. 11). Les savoirs endogènes doivent être pris en compte et intégrés au système mondial de production du savoir.
Conclusion
Les crises, inhérentes à la vie des sociétés, n’en finissent pas de marquer les institutions sociales, l’université y compris. Les crises de sociétés conduisent immanquablement à la crise de l’université en Afrique. C’est peu donc de dire que les universités africaines vont mal parce que les sociétés africaines elles-mêmes sont, à certains égards, dans un état de déliquescence.
N’allons tout de même pas penser que les crises des universités ne sont que des réalités internes aux universités. Elles débordent en fait le cadre universitaire pour entraver le fonctionnement normal des sociétés. Comme quoi, les crises de l’université, engendrées en partie par les sociétés qui les ont fécondées, et qui les abritent, influencent négativement le tissu social.
C’est au sein des sociétés elles-mêmes qu’il convient de trouver les solutions idoines, à même de remédier à la crise. La crise de l’université en Afrique ne peut être résolue que par, et à travers les sociétés africaines, qui doivent, en priorité, s’appuyer sur leurs cultures. Il s’agit, de manière concrète, de réhabiliter les langues africaines en en faisant des véhicules de la science, les médias de l’enseignement. Mais, pour y parvenir, une réelle volonté politique et un « énorme travail préparatoire », (P. J. Hountondji, 1980, p. 237) s’imposent.
Il y a lieu, dans ces conditions, de repenser l’université en Afrique. C’est une exigence de souveraineté nationale. À y voir de près, les universités africaines ne sont que des démembrements des universités occidentales. Car, plus de soixante ans après les indépendances, les pays africains peinent à se doter d’un système d’enseignement en général et d’un système universitaire en particulier déconnectés du système occidental.
Il est temps d’africaniser le système universitaire et, au-delà, tout le système de formation et de recherche. L’indépendance politique, proclamée au début de la décennie 60 par la plupart des États africains, ne peut avoir de signification réelle qu’à travers une emprise réelle sur le système de formation et de recherche. La perpétuation du système colonial ne peut que contribuer au conditionnement de l’Africain qui ne saurait se prévaloir d’une réelle indépendance, d’autant plus qu’il ne peut prendre ses distances à l’égard de l’Occident. De même, continuer à enseigner dans les langues occidentales, c’est confesser sa soumission aux cultures occidentales. Repenser l’université, en Afrique, c’est, en fin de compte, retrouver la voie de la véritable indépendance.
Références bibliographiques
COUSSY Jean, 1978, « Extraversion économique et inégalité de puissance. Essai de bilan théorique », in Revue française de science politique, 28ᵉ année, N°5, pp. 859-898.
FANON Frantz, 1952, Peau noire masques blancs, Paris, Éditions du Seuil.
FOTTORINO Eric et al, 1992, Besoin d’Afrique, Abidjan, Fayard / Nouvelles Éditions Ivoiriennes.
HEGEL Georg Wilhem Friedrich, 1962, « Lettre à Niethammer, du 28 octobre 1808 », in Correspondance, traduit de l’allemand par Jean Carrère, Paris, Gallimard.
HÖLDERLIN Johann Christian Friedrich, 1967, Œuvres, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Paris, Éditions Gallimard.
HOUNTONDJI Paulin Jidenu, 1997, Combats pour le sens – Un itinéraire africain, Cotonou, Les Éditions du Flamboyant.
HOUNTONDJI Paulin Jidenu (dir.), 2000, Économie et société au Bénin, Paris, L’Harmattan.
HOUNTONDJI Paulin Jidenu (dir.), 1994, Les savoirs endogènes : pistes pour une recherche, Dakar, CODESRIA.
HOUNTONDJI Paulin Jidenu, 2006, « L’impartageable : sur quelques défis de la communication dans l’espace francophone », conférence d’ouverture du Colloque de l’A.U.F. : sur Expériences et mémoire : partager en français la diversité du monde, [En ligne], http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Hountondji.pdf, consulté le 13 Août à 4h53 mn.
HOUNTONDJI Paulin Jidenu, 1973, Libertés – Contribution à la Révolution Dahoméenne, Cotonou, Éditions Renaissance.
HOUNTONDJI Paulin Jidenu, 1980, Sur la « philosophie africaine » – Critique de l’ethnophilosophie, Yaoundé, Éditions CLÉ.
JAOUL Magali, 2004, « Enseignement supérieur et marchés du travail – Analyse économétrique de la théorie de l’engorgement », Économie et prévision, vol. 5, N°166, pp. 39-57.
KI-ZERBO Joseph, 1990, Éduquer ou périr, Paris, L’Harmattan.
KONATÉ Yacouba, 2002, « Génération zouglou », in Cahiers d’études africaines, N°168, pp. 777-796.
KONATÉ Yacouba, 2003, « Les enfants de la balle. De la FESCI aux mouvements de patriotes », in Politique africaine, vol. 1, N°89, pp. 49-70.
MENDEL Gérard, 2004, Construire le sens de sa vie – Une anthropologie des valeurs, Paris, La Découverte.
NGOUPANDÉ Jean-Paul, 1995, « Crise morale et crise éducative en Afrique subsaharienne », in Revue internationale d’éducation de Sèvres, N°5, [En ligne], URL : http://journals.openedition.org/ries/4170 ; DOI : 10.4000/ries.4170, consulté le 14 juillet 2022 à 3h2 6mn.
ROCARD Michel, 2003, « Le développement de l’Afrique, affaire de volonté politique », in Études, Vol. 1, Tome 398, pp. 21-31.
TEDGA Paul John Marc, 1991, Ouverture démocratique en Afrique noire ? Paris, L’Harmattan.
LA CRISE DES UNIVERSITÉS AFRICAINES : LE PÉRIL DE L’ÉDUCATION PARENTALE
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La crise que traversent les Universités africaines, au lendemain des indépendances jusqu’à ce jour, traduit un malaise et un mal-être profonds de nos sociétés en déliquescence. Cette crise révèle celle plus profonde de l’éducation parentale qui doit pourtant modeler l’enseignement. En effet, à la faveur de l’instruction, l’éducation parentale perd, de plus en plus, sa place alors qu’elle est censée être la base de la formation de tout citoyen. La recrudescence de la violence sur les campus, le déni de l’autorité, l’infériorisation et la frustration de certains enseignants, les conflits de générations et des cultures etc., pourraient être minimisés, si l’éducation parentale jouait pleinement son rôle de socialisation des enfants et de la transmission des valeurs africaines. Il faut peut-être comprendre que des actes répréhensibles posés par certains apprenants face à leurs enseignants n’expriment rien d’autre que leur ras-le-bol, une déception doublée d’une désillusion relativement à leurs attentes légitimes dans le cadre de leur formation. Sans doute, c’est en accordant à l’éducation parentale, toute son importance que les Universités africaines reprendront leur bâton de pèlerin dans le concert des nations.
Mots clés : Afrique, Culture, Éducation, Enfant, Étudiants, Parents, Université, Tradition.
Abstract:
The crisis that African Universities are going through, in the aftermath of independence to this day, reflects a deep malaise and malaise in our failing societies. This crisis reveals the deeper crisis of parental education, which must nevertheless shape teaching. Indeed, thanks to education, parental education is increasingly losing its place when it is supposed to be the basis of the training of any citizen. The resurgence of violence on campuses, the denial of authority, the inferiorization and frustration of certain teachers, conflicts between generations and cultures…could be minimized if parental education fully played its role of socializing children and the transmission of African values It should perhaps be understood that reprehensible acts committed by certain learners vis-à-vis their teachers express nothing other than their fed up, a disappointment coupled with a disillusion with regard to their legitimate expectations in the context of their training. Undoubtedly, it is by granting parental education all its importance that African Universities will resume their pilgrim’s staff in the concert of nations.
Keywords : Africa, Culture, Education, Children, Students, Parents, University, Tradition.
Introduction
Le rapprochement entre la crise de l’Université et celle de l’éducation parentale ne doit pas surprendre. En effet, le rôle de l’Université est d’instruire, c’est-à-dire transmettre la science ou la connaissance en vue de valoriser le capital humain pour le mettre au service du développement économique et social. Il s’agit donc de donner, aux individus, un savoir-faire qui puisse leur permettre de se frayer un chemin en vue de leur insertion professionnelle. Quant à l’éducation parentale, elle permet aux parents de veiller au mieux sur leur progéniture en lui offrant les outils nécessaires à son développement pour le préparer « à exploiter et à valoriser son potentiel et à jouer un rôle utile à l’âge adulte dans la société » (M. Koné et N. Kouamé, 2005, p. 167). L’éducation parentale permet en ce sens, d’offrir aux individus, un savoir-être, indispensable à la cohésion sociale. Ainsi, la relation entre les Universités et les parents apparait au niveau de la formation de l’humain qu’ils ont en commun. Un individu accompli est celui-là qui allie le trivium éducatif savoir, savoir-être et savoir-faire. Aussi, s’il est vrai que les deux domaines de formation sont complémentaires, il est bon de reconnaitre la primauté de l’éducation parentale qui est la formation de base de tout homme et dont l’impact est indéniable dans la formation universitaire. Ce qui veut dire que le savoir-être est déterminant dans le savoir-faire en le conditionnant.
C’est pourquoi, dans la crise qui secoue les Universités africaines, l’on peut percevoir l’impact de la crise qui secoue l’éducation parentale qu’on peut assimiler à un grand malade au sein des sociétés africaines en quête d’elles-mêmes dans le vaste processus de modernisation et de globalisation auquel elles se trouvent confrontées depuis des années. En effet, hormis les questions d’infrastructure, le véritable problème est celui lié aux comportements et attitudes entre les acteurs de l’espace universitaire dont l’interaction devient parfois impossible au regard des manquements et des frustrations commis les uns sur les autres. Dans un espace académique, qui plus est le temple du savoir, il y a un certain nombre de comportements qui ne peuvent être tolérés sans mettre à mal l’idéal de formation, la qualité de la science ainsi désacralisée. Le respect du maître foulé aux pieds des campus universitaires transformés en champ de bataille pour ne citer que ceux-là, sont autant d’attitudes qui ont achevé de désacraliser le temple du savoir.
Dès lors, au moment où nous faisons le diagnostic de la crise des Universités africaines, nous sommes en droit de nous demander s’il n’est pas légitime de voir en la crise de l’éducation parentale un vecteur du mal. En d’autres termes, la crise des Universités africaines n’est-elle pas la manifestation du malaise de l’éducation parentale ? Quels sont les fondements de l’éducation parentale ? Comment se manifeste la négligence de l’éducation parentale dans la crise des universités africaines ? Quelles solutions pour sortir de cette crise ?
Telles sont les questions que les approches analytique, déductive et prospective nous aideront à élucider. Elles conduiront à démontrer que la crise de l’éducation parentale est au fondement de la crise des Universités africaines. Aussi, la résolution du malaise de l’éducation parentale est-il primordial dans la quête de solutions à la crise des Universités africaines. L’explicitation de cette thèse consistera à mettre, en exergue, les fondements de l’éducation parentale. Cette approche nous permettra, ensuite, de mettre, en lumière, la négligence de l’éducation parentale et son impact sur les acteurs des Universités africaines. Il s’agira, enfin, d’envisager un nouveau contenu de l’éducation dont la culture des valeurs africaines occupe une place de choix.
1. Du fondement de l’éducation parentale
1.1. Définition et importance de l’éducation parentale
On peut définir l’éducation parentale comme l’éducation basique inculquée aux enfants par les parents. C’est ce que S. Diakité (2016, p. 13) affirme en ces termes : « L’éducation de base émane des parents ». L’éducation parentale est désignée sous le nom d’éducation de base, parce que c’est l’éducation que tout homme reçoit en premier lieu, c’est-à-dire dès la naissance. Elle débute au berceau, car, selon J.-J. Rousseau (2009, p. 52), « nous commençons à nous instruire en commençant à vivre ; notre éducation commence avec nous ; notre premier précepteur est notre nourrice ». En ce sens, l’éducation est l’ensemble des soins, c’est-à-dire de l’entretien, de l’allaitement et tout autre rapport avec l’enfant jusqu’à sa maturité. Elle se pratique singulièrement à l’abri du monde extérieur, dans la sphère privée du cadre familial répondant à un certain nombre d’exigences de confort, d’hygiène et de tout ce qui est susceptible de favoriser l’épanouissement des enfants. Dans cette configuration, l’éducation parentale est aussi désignée sous le nom d’éducation familiale.
En Afrique, les parents ne sont pas uniquement les géniteurs, ce sont aussi les oncles, les tantes, les cousins, les grands parents ou tout autre adulte faisant partie de la grande famille ou de la communauté. D’ailleurs, dans la famille traditionnelle africaine élargie, tous les adultes ont un droit de regard sur le développement de l’enfant ; ils peuvent donc participer à l’éducation de n’importe quel enfant. Ainsi, toute autre personne en dehors des parents pouvait punir les enfants s’il considère qu’ils se comportent mal. Cela contribuait à une éducation efficiente des enfants, tout en renforçant l’autorité des adultes. C’est pourquoi, M. Koné et K. N’Guessan (2005, p. 174) affirment que « dans la société traditionnelle l’efficacité de l’autorité et de l’éducation était en rapport avec la solidité du noyau familial et la cohésion de la communauté ». Sous cet angle, parler de l’éducation parentale revient à parler de l’éducation basique familiale ou domestique. À travers ces définitions, l’on peut s’apercevoir de l’importance de l’éducation parentale.
Pour H. Arendt (2016, p. 239), cette importance se révèle à double titre lorsqu’elle affirme qu’« en éduquant, les parents assument la responsabilité de la vie et du développement de l’enfant, mais aussi celle de la continuité du monde». En effet, cela semble se justifier dans la mesure où la venue d’un enfant au monde se fait dans des conditions d’extrême vulnérabilité et de dénuement total. Le nouveau venu, pour abonder dans la terminologie arendtienne, nécessite alors l’assistance, la protection, l’affection et la sollicitude de ses parents. Mais, la responsabilité parentale consiste également à veiller sur le monde et à le protéger en éduquant les enfants afin qu’ils soient respectueux des autres. Tel un arbitre, le parent doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit entre l’enfant et les autres mais plutôt une collaboration en vue de consolider la cohésion sociale. Les hommes doivent pouvoir éduquer leurs enfants dans la solidarité et vivre en parfaite harmonie dans la société. L’éducation inculquée aux enfants par les parents est importante pour leur survie. Mais en quoi cette éducation parentale consiste-t-elle réellement ?
1.2. Le rôle de l’éducation parentale
L’éducation parentale consiste en la transmission, aux enfants, des valeurs propres à une communauté ou une société donnée. S. Diakité (2016, p. 11) ne dit pas autre chose, lui qui la différencie de l’instruction pour mieux expliquer son rôle : « On comprend bien que l’éducation n’est pas l’instruction ; on réalise facilement que l’instruction relève de la transmission des connaissances et que l’éducation, quant à elle, relève de la transmission des valeurs et ou des comportements adoptés par la famille, le milieu de vie et la société ». Pour lui, l’éducation, en se démarquant de l’instruction, ne s’intéresse qu’à la question des valeurs. Elle œuvre à offrir à l’individu une identité capable de le définir par son appartenance à une communauté donnée en mettant, en exergue, les valeurs reçues de cette communauté. Si les valeurs peuvent se définir, se comprendre ou s’interpréter selon chaque peuple et sa culture, on remarque bien, avec B. Fadiga (2022, p. 42), que « …la gratitude, la reconnaissance, le respect, la politesse, le travail, l’empathie, la gentillesse, la dignité, l’humilité, l’honnêteté, l’intégrité, la vérité, la générosité, l’hospitalité, la loyauté, la solidarité, la sagesse » sont des valeurs de l’humanité qui témoignent de l’universalité. Ces valeurs, on les retrouve partout, dans toutes les communautés. En insistant sur l’inculcation des valeurs, l’éducation peut s’en prévaloir comme son apanage selon les propos de B. Fadiga (2022, p. 42) : « Les valeurs sont les éléments consécutifs de l’éducation. Elles ne peuvent pas être omises. La transmission de celles-ci est le principe de l’éducation. Sans transmission des valeurs, on ne peut parler d’éducation ».
En effet, l’éducation parentale permet de donner les outils nécessaires à l’intégration sociale des individus et de les préparer comme le souligne A. Naouri (2008, p. 17) : « à rencontrer l’autre et les autres sans crainte avec un minimum de bagage parmi lesquels s’inscrirait le rapport à l’effort ». En Afrique, l’un des efforts à fournir et qui fait partie intégrante du bagage culturel est le respect des ainés. Cela se perçoit dans l’existence de sociétés initiatiques en Côte d’Ivoire comme le poro qui est destiné au genre masculin chez les Sénofos. Chez certains groupes Baoulés, il existe le bain initiatique destiné aux jeunes filles. Chez les Ébriés et Adjoukrou, on parle de fête de génération.
Ces pratiques culturelles, pour ne citer que celles-là, sont révélatrices de l’importance de l’âge et de l’existence d’une relation entre enfants et adultes qui vivent ensemble mais pas simultanément. Ces moments d’initiation traduisent le passage à l’âge adulte ; lequel confère certaines responsabilités aux initiés à l’égard de la communauté. La soumission à ces pratiques initiatiques permet de se reconnaitre comme faisant partie d’une société qui a ses exigences et ses règles de fonctionnement et de s’y conformer. Dès lors, les initiés deviennent un modèle à suivre pour les plus jeunes. C’est dans ce contexte qu’on peut comprendre les propos de J.-J. Rousseau (2009, p. 249-250) à l’endroit des ainés, lorsqu’il dit ceci : « Puisque vous vivez ensemble comme le plus âgé, vous lui devez vos soins, vos conseils ; votre expérience est l’autorité et celui qui doit le conduire. En se reprochant étant grand, les torts de sa jeunesse, il vous reprochera sans doute ceux dont vous ne l’aurez pas averti ». En ce sens, l’éducation des enfants se présente comme une responsabilité des parents mais aussi de tous les adultes d’une communauté. Cette implication de la communauté a non seulement le but de faciliter la tâche aux parents mais aussi et surtout de créer une harmonie et une cohésion sociales. Comment explique-t-on alors le relâchement des valeurs, de nos jours, dans les sociétés africaines ? Comment est-on arrivé à une situation de non-respect des jeunes à l’égard des ainés ? Comment peut-on expliquer l’animosité et le comportement violent de nombreux enfants et jeunes en Afrique, et surtout dans les Universités ?
2. De la crise de l’éducation parentale comme fondement de la crise de l’Université
2.1. De la crise de l’éducation parentale
L’évocation de la crise au niveau de l’éducation parentale n’est rien d’autre que l’allusion faite à la mauvaise éducation ou encore à la négligence de l’éducation. En effet, parler de crise, c’est parler de dysfonctionnement, de perturbation ; c’est dénoncer une mauvaise manière de voir et de pratiquer l’éducation. L’éducation, dans les sociétés africaines en pleine mutation, se porte mal mais ne semble pas attirer l’attention des autorités qui semblent s’inquiéter plus pour les questions d’économie sans savoir que l’éducation est au fondement de tout développement. Dans la société africaine actuelle, un seul constat : la crise de l’éducation parentale. Cette crise qui semble ne pas émouvoir les uns et les autres a pourtant un effet dévastateur sur la vie des individus. C’est ce que traduit B. Fadiga (2022, p. 9) lorsqu’elle dit ceci : « Dans le siècle présent, nous sommes face à une « pandémie » qui, si nous ne prenons garde, décimera nos communautés. Elle est sournoise, pernicieuse et se propage à une vitesse exponentielle : « la mauvaise éducation ».
La mauvaise éducation est décrite ici comme le mal du 21ème siècle. Ce mal est insidieux et invisible ; on ne lui prête pas assez d’attention et pourtant, combien il ravage la jeunesse et tue l’économie des pays africains. Tel un cancer, la mauvaise éducation ronge les pays africains. La mauvaise éducation est souvent un manque d’éducation. S. Diakité le souligne clairement « La mauvaise éducation se rapproche d’une absence d’éducation surtout lorsque cette mauvaise éducation est diamétralement opposée aux valeurs de la société dans laquelle elle a pris forme » (S. Diakité, 2016, p. 33). Cette absence d’éducation se perçoit partout dans nos sociétés capitalistes qui n’accordent aucun répit aux parents. La cherté de la vie amène les uns et les autres à se concentrer sur l’avoir qui semble être l’essentiel dans la vie de l’homme. Tout est basé sur l’argent de nos jours. Le travail dévoreur de temps ne facilite pas non plus l’éducation. À force de s’éloigner des enfants pour leur assurer la subsistance, les parents se sont rabattus sur l’école, en confiant l’éducation de leurs enfants aux enseignants.
L’école est devenue la seule voie pour éduquer les enfants. Certes, l’instruction d’un peuple est très importante « dans un monde compétitif et dominé par l’économie du savoir (où) le capital humain apparait comme un des leviers essentiels de la croissance et du développement économique et social » (K. R. Oussou, 2017, p. 17). Et dans un tel contexte, la valeur de l’homme se mesure, de plus en plus, à ses compétences intellectuelles et professionnelles. Cependant, l’instruction, quoi qu’il en soit, dépend pour une grande part de l’éducation entendue comme ce qui fonde éthiquement et moralement le vivre-ensemble. La prostitution, les grossesses en milieu scolaire et les nombreux cas d’avortements clandestins, le viol, la consommation de la drogue et de l’alcool, la délinquance, etc. sont autant de comportements à risque auxquels sont exposées de nombreux jeunes dont les parents ont failli à leur devoir d’éducation. À bien des égards, l’école constitue une source de perdition pour les enfants quand ils n’ont pas été suffisamment préparés, par leurs parents, à faire face aux fléaux de la jeunesse. Car, quand l’éducation de base fait défaut, l’enfant devient perméable à toutes sortes d’influences, et le plus souvent, négatives.
Selon H. Arendt (2016, p. 244), la crise de l’éducation tire sa source dans l’abolition de l’autorité des parents. Ainsi qu’elle le dit : « L’autorité a été abolie par les adultes et cela ne peut que signifier une chose : que les adultes refusent d’assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé les enfants ». Cette abolition de l’autorité se perçoit dans l’octroi de droits aux enfants sans toutefois proposer des alternatives adéquates. L’équilibre, entre droits et devoirs, difficile à trouver, laisse, parfois, les parents dans une impuissance qui culmine très vite dans un laxisme notoire ; d’où la démission des parents.
De nos jours, le rôle protecteur des parents n’est plus assuré que par des aides familiales dont plusieurs ont vite fait de créer des désordres en maltraitant les enfants qu’on leur a confiés. Le recours à ces aides, très souvent, inexpérimentées et d’une moralité douteuse, témoigne, quelques fois, du désespoir des parents devant l’inexistence de crèches au travail ou à proximité des habitations. L’éducation des enfants, dans ces conditions, est mal assurée. Aussi, le recours au village comme espace d’initiation aux valeurs traditionnelles pendant les vacances se raréfie-t-il face à la montée en puissance des églises qui n’encouragent pas la fréquentation des villages jugés comme la source intarissable de la sorcellerie. En définitive, la modernisation des sociétés africaines et son implication dans la mutation des mentalités et des comportements ont conduit inéluctablement à paralyser l’éducation basique africaine. Face à ce triste constat, on peut se demander quelles sont les conséquences de la mauvaise éducation de la jeunesse et son implication dans la crise des Universités ?
2.2. L’impact de la mauvaise éducation sur la jeunesse et son implication dans la crise des Universités.
Toute société est à l’image de l’importance qu’elle accorde à l’éducation. C’est pourquoi, on peut se demander avec S. Diakité (2016, p. 10), si « les comportements belliqueux et corrompus des acteurs sociaux, la mauvaise gouvernance des sociétés n’est-elle pas la plaie que nous avons refusé de soigner en nos enfants lorsqu’ils étaient tout-petits, plaie béante que nous avons laissé pourrir » ? En Afrique, la perte des valeurs profondes dues au manque d’éducation basique a créé un climat délétère au sein des familles et de la société, en général, avec l’accroissement de la violence infanto-juvénile. Pour J. P. Assamoi (2016, p. 5), nul doute que « tous ces délinquants et voyous qui jalonnent nos rues et quartiers constituent le témoignage tragique de graves erreurs d’éducation familiale ».
Si l’éducation doit consister en la transmission des valeurs africaines, lesquelles appartiennent au patrimoine culturel à véhiculer, on peut s’étonner de voir que « nos comportements et nos habitudes ne font pas un avec nos cultures » (Q. N’Dri, 2016, p. 36). Puisque la culture reflète la particularité de chaque société, un Africain où qu’il se trouve devrait pouvoir être identifié à travers son comportement. Malheureusement, cela n’est pas le cas, aujourd’hui, dans nos sociétés où la plupart des hommes, femmes et enfants vivent sans repères. Il n’est pas surprenant de voir des adultes se mêler aux jeunes gens dans les cabarets et autres espaces appelés maquis en se livrant à toutes sortes de débauches, l’alcool, la drogue, le sexe sont devenus des phénomènes qui touchent toutes les couches sociales.
L’éducation ayant perdu sa noblesse, les adultes ne sont plus les modèles qu’ils devraient être et les jeunes sans repères sont devenus amis de la violence. Cette violence est manifestée sur les campus, où des étudiants syndicalistes s’en donnent à cœur joie au détriment de leurs condisciples qu’ils sont censés représenter et même de leurs enseignants. Cette situation désespérante a fini par donner une certaine liberté à certains étudiants qui viennent assister aux cours sans un minimum de bienséance. Les tenues, les coiffures et les chaussures qu’ils abhorrent traduisent un malaise qui tire sa source dans la négligence de l’éducation parentale. Quand des étudiants se comportent ainsi, on ne peut que s’interroger sur l’éducation de base qu’ils ont reçue de leurs parents. Pire, la brutalité avec laquelle ces derniers s’expriment en s’adossant à leur syndicat ne manque pas de choquer les enseignants qui sont parfois sommés de quitter leur amphi ou leur salle de travaux dirigés en pleine séance de cours. La vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle l’on a vu des étudiants de l’Université Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire, pénétrer les bureaux des enseignants et leur intimer l’ordre de quitter les lieux est la preuve de la désacralisation des espaces académiques, des enseignants et même du savoir. Cela dénote de la perte des valeurs africaines qui doivent, pourtant, fonder le respect de l’ordre, la relation entre les ainés et les jeunes, en l’occurrence celle de l’enseignant et de l’étudiant dans les Universités. Mais, comment ces jeunes étudiants peuvent-ils respecter leurs maitres s’ils ne l’ont pas appris avec leurs propres parents ? Lorsqu’on se plaint du manque d’engouement chez les enseignants-chercheurs et la répercussion de cette attitude sur la qualité de l’enseignement, on devrait aussi mener une réflexion sur leur condition de travail qui laisse, très souvent, à désirer. Comment alors revaloriser et redynamiser l’éducation parentale pour sortir de la crise de l’Université africaine ?
3. Vers une redynamisation de l’éducation parentale
3.1. De l’exigence d’une relation d’amitié entre parents et enfants
Dans un monde extraverti, il est essentiel d’interpeler les parents sur le rôle qui leur est dévolu dans l’éducation de leurs enfants. Ce rôle est fondamental dans la croissance morale des enfants et dans la formation de leur personnalité. Il importe, donc, de redorer l’image de la famille qui « n’est plus un refuge, un havre de paix » (J. P. Assamoi, 2016, p. 5). Et cela passe par la reprise en main de l’éducation des enfants par leurs parents.
L’éducation parentale qui consiste à enseigner les valeurs aux enfants doit reprendre toute sa place dans la formation des individus. Il ne s’agit pas seulement, pour les parents, comme on le voit dans leur empressement à scolariser leurs enfants, de préparer leur insertion professionnelle ; mais il s’agit aussi et surtout de garantir leur vie en tant qu’êtres humains, membres d’une société et d’un État. J.-J. Rousseau (2009, p. 64) l’exprime clairement : « un père, quand il engendre et nourrit ses enfants ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il doit des hommes à son espèce, il doit à la société, des hommes sociables ; il doit des citoyens à l’État ». Ce triple devoir d’éducation laisse entrevoir les valeurs axiologiques de l’humain en tant qu’individu, animal politique et citoyen d’un État. Ces valeurs méritent d’être rappelées aux candidats à la parentalité qui ignorent, le plus souvent, leurs devoirs, en ne regardant qu’à leur droit d’être parent. Mais le plaisir d’être parent doit s’arrimer au devoir d’éduquer pour éviter d’être un danger pour son propre enfant. Les étudiants imbus de leur personne, sans foi ni loi qui n’ont aucun respect pour leurs enseignants, leur administration encore moins pour leurs condisciples n’ont, visiblement, rien reçu de ces valeurs.
Si la vie des sociétés est à l’image de l’éducation donnée aux enfants comme l’a bien vu S. Diakité, et qu’il est du devoir des parents de protéger le monde des nouveaux venus ainsi que le signifiait Arendt, il va sans dire que le redressement de l’éducation est fondamental dans la gestion des crises de l’Université. Les crises de l’éducation liées à la modernisation et à la démocratisation des sociétés n’échappent à aucune sphère de la société ni même aux Universités. C’est pourquoi, pour continuer avec S. Diakité (2016, p. 18), disons qu’« il faut donc opérer un choix entre le laisser-aller de l’homme et la remise en question de son faire et de son être ». Et cela passe nécessairement par le développement d’un lien d’amour qui puisse aboutir à la culture d’une relation d’amitié entre parents et enfants.
C’est là où les propos de Rousseau font écho pour dire qu’il faut être ami de son enfant. Être parent, aujourd’hui, exige d’être ami de son enfant ; un ami intime dans le sens où l’enfant peut en toute confiance parler de tout avec son père ou sa mère. Le temps des réprimandes, de la chicote, de la violence étant révolu, c’est par l’amitié qu’il faudra désormais gagner le respect, l’amour et la confiance de ses enfants. Cette amitié doit nous amener à raconter à nos enfants, notre propre enfance, nos expériences de la vie pour leur montrer les dangers de tel ou tel comportement. Dans cette relation d’amitié, il ne doit exister aucun sujet tabou. Les questions liées au sexe doivent, plus que jamais, être débattues entre parents et enfants pour mieux les éclairer par rapports aux autres sources d’informations mises à leur disposition, en l’occurrence internet et les médias. Beaucoup d’informations parviennent aux adolescents sur les relations sexuelles et sur la sexualité qui sont très souvent erronées. Il faut pouvoir s’intéresser à ce qu’ils vivent et ce qu’ils voient autour d’eux pour mieux les orienter sur la conduite à tenir dans telles ou telles situations. L’amitié qu’il faut cultiver avec son enfant permet de les mettre à l’abri des dérives sexuelles qui ont court dans nos sociétés actuelles telles que les rapports entre plusieurs partenaires à la fois, l’alcool, la drogue et d’autres vices encore.
L’amitié doit permettre surtout de connaitre son enfant, ses attentes, ses craintes afin de lui donner les armes nécessaires pour affronter la vie. Créer les conditions d’une amitié sincère entre son enfant et soi est l’une des meilleures voies pour réussir sa mission en tant que guide, éducateur et parent. Dans ce métier de parent, il ne faut pas oublier ce que représente la culture dans la vie d’un enfant africain.
3.2. De l’exigence de la culture africaine dans l’éducation
« La culture valorise les peuples, sa négligence les déchoit » (S. Diakité, 2018, p. 87). Cela est clair et bien dit. La misère de l’Afrique tient beaucoup à ce fait que les Africains ont tourné le dos à leurs propres cultures. La modernité qui devrait être « une conséquence de l’évolution de la tradition » (M. Koné et K. N’Guessan, 2005, p. 183) est plutôt subie parce qu’importée. Elle n’est pas le fruit d’un ajustement structurel conditionné par l’exigence d’un nouveau contexte, comme cela devrait être, mais en rupture avec les traditions. Il faut impérativement renouer avec la culture africaine en essayant de l’intégrer dans le contexte actuel de la globalisation qui commande que l’Afrique, aussi, ait quelque chose à présenter au monde.
Par ailleurs, les proverbes, les contes qui reflètent le bagage culturel et qui constituent une source de sagesse pour les Africains doivent être restaurés pour permettre à la jeunesse d’apprendre à connaitre leur culture. Les contes ont ceci de bon qu’ils ont un fondement moral qui permet de conscientiser les individus sur tel ou tel aspect de la vie. En relatant une histoire, le conte a pour objectif de dénoncer des comportements et des tares de la société. Ils parlent souvent de la maltraitance d’enfants orphelins, de la cupidité, de l’égoïsme, de la méchanceté et les conséquences qui en découlent sont autant d’occasions d’apprentissage, une école de la vie. Les contes doivent servir de prétexte à une réunion de famille pour échanger autour d’un sujet qui intéresse la jeunesse. Les proverbes, quant à eux, permettent de mesurer le degré de connaissance et de sagesse d’un africain. Un africain qui utilise beaucoup de proverbes dans ses discours fait montre de son appartenance et son attachement à sa culture. Si « l’attitude africaine doit laisser transparaître la culture à laquelle elle appartient » (Q. N’Dri, 2016, p. 36), il importe d’introduire dans nos valeurs africaines, les proverbes pour rehausser le niveau culturel et intellectuel des jeunes. Mais c’est aussi « une volonté de contestation de la thèse coloniale, contre l’européocentrisme qui niait toute rationalité à la pensée africaine enfermée dans la primitivité, mais surtout une réaction contre nous-même, contre l’Africain qui refuse que son esprit habite ce corps noir, cette beauté que Dieu a pris le soin de façonner » (Q. N’Dri, 2016, p. 31). Il faut amener la jeunesse africaine à être fière d’elle-même et de ses origines en l’aidant à se construire une véritable identité et en forgeant son caractère par son rapport à l’effort, au travail bien fait, au respect des choses sacrées dont la science, l’espace académique, les ainés et les valeurs traditionnelles culturelles.
Dans cette redynamisation de l’éducation, l’implication de toute la communauté est à réinventer. Cela permettra aux adultes de revoir leur comportement, car les maux de nos sociétés trouvent significativement leurs racines chez eux. Le proxénétisme et le harcèlement sexuel, par exemple, sont des fléaux qui permettent de jeter un regard sur la moralité des adultes dans nos sociétés gagnées par le capitalisme et l’individualisme. En ce sens, l’éducation communautaire peut contribuer à amener les uns et les autres à une synergie d’actions pour le bien des enfants en ouvrant sur la perspective que « le milieu social dans lequel vit l’individu (soit) de nouveau contraignant pour l’orienter vers des actions socialement admises » (M. Koné et K. N’Guessan, 2005, p. 232). Cela implique que les enseignants fassent montre d’une certaine exemplarité. S’il est de notoriété africaine que les ainés occupent une grande place dans la vie des jeunes en étant des mentors, ceux-ci doivent le prouver en corrigeant leur image. Nous vivons dans un monde très pragmatique où les jeunes veulent surtout du concret.
Dans les Universités, les ainés, c’est-à-dire, les personnels enseignants et administratifs pour ne citer que ceux-là doivent faire beaucoup attention aux actes qu’ils posent afin d’impacter positivement les plus jeunes, les étudiants. Les syndicats d’enseignants doivent montrer le chemin aux syndicats d’étudiants en leur inculquant les bonnes manières de faire les grèves. Quand on est à un certain niveau de responsabilité dans le système éducatif, il faut éviter de traiter ses collègues comme des moins que rien en les faisant sortir brutalement des Amphis-théâtres et des salles de travaux dirigés sous les yeux des étudiants. En tant qu’intellectuels et ainés, notre devoir est de donner le bon exemple à la jeunesse et non pas se servir de sa position d’enseignant pour intimider les étudiants ou encore de sa position d’administratif pour créer des disfonctionnements au sein des départements. Tous ces facteurs qui créent des frustrations mettent à mal la cohésion et l’harmonie dans les Universités et leur source se trouve certainement dans une mauvaise éducation. Car, c’est en famille qu’on apprend l’honnêteté, la loyauté et toutes les autres vertus qui impactent la vie en société.
Conclusion
La présente analyse ne vise pas à banaliser la crise des Universités en détournant le regard sur la crise de l’éducation parentale. Bien au contraire, celle-ci nous plonge au cœur du vécu des acteurs dans l’espace académique où les normes et les mœurs conçus pour guider le vivre-ensemble en Afrique ne réchauffent plus les cœurs. C’est à raison que l’éducation parentale censée réguler les comportements des individus, dans la société, est convoquée au banc des accusés. Vu les difficultés d’interaction et la violence qui commence à s’institutionnaliser sur les campus, il devient urgent de redonner du dynamise à l’éducation basique, car, certainement, elle est indispensable à la construction de l’individu et à son insertion sociale. À cet effet, la redéfinition des valeurs culturelles qui commandent à la cohésion sociale s’impose. Mais, plus fondamentalement, il est impérieux que les parents occupent le premier rang dans l’éducation de leurs enfants dans une société ouverte sur le monde afin de les protéger des mauvaises mœurs. Quoi qu’il en soit, il nous faut impérativement revenir à cette belle époque où « élever un enfant passait pour être une entreprise noble comme le laisserait entendre le sens strict du mot – élever, c’est tout de même l’action de porter plus haut ce qui se trouve à un certain niveau » (A. Naouri, 2009, p. 30).
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 2016, La crise de la culture, Traduction, Patric Levy, Paris, Folio.
ASSAMOI Jean-Pierre, 2016, Gestion familiale, Abidjan, VIE.
DIAKITE Samba, 2016, Les larmes de l’éducation, contribution à l’éthique professionnelle en enseignement, Québec, Différance Pérenne.
DIAKITE Samba, 2018, WAATI SERAA, la voix temps ou l’appel des incompris, Québec, Différance Pérenne.
FADIGA Barbe, 2022, De mes enfants à vos enfants, Abidjan, Les David-Soro.
KONE Mariatou et KOUAME N’Guessan, 2005, Socio-anthropologie de la famille en Afrique. Évolution des modèles en Côte d’Ivoire, Abidjan, CERAP.
NAOURI Aldo, 2009, Éduquer ses enfants, l’urgence aujourd’hui, Paris, Odile Jacob.
N’DRI Quadjo, 2016, C’est une question de volonté, Abidjan, Balafon.
OUSSOU Kouamé Rémi, 2017, L’Afrique en développement, Pistes de réflexions, Tome 1, Canada, Éditions pour tous.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 2009, L’Émile ou de l’éducation, Paris, Gallimard.
Université de Lomé (Togo)
Résumé :
La crise de l’université en Afrique est décrite par les politiques et les spécialistes des sciences sociales comme étant une crise conjoncturelle : manque d’infrastructures, de moyens matériels et financiers pour le fonctionnement des universités, problèmes de programmes de formation inadaptés aux besoins réels du milieu, etc. (B. Makosso, 2006; J. Ki-Zerbo, 2013). Cette contribution démontre que la manifestation de la crise dans les universités publiques quant à ses aspects matériels, ne traduit que les conséquences d’une crise idéologique et sociale plus profonde. Elle dévoile une perte de repères axiologiques à partir desquels toute institution de socialisation fonctionne. La compréhension des causes idéologiques de la crise universitaire permet ainsi d’insister sur les valeurs de base de la construction sociale, de l’érection et du fonctionnement des universités, pour que celles-ci soient au cœur du développement du continent.
Mots clés : Crise des universités, Développement, Instrumentalisation des universités, Université en Afrique, Valeurs sociales.
Abstract:
The university crisis in Africa is described by politics and social sciences specialists as being a cyclical crisis: lack of infrastructure, material and financial means for the functioning of universities, problems of training programs unsuited to the real needs of the society, and so on etc. (B. Makosso, 2006; J. Ki-Zerbo, 2013). This contribution aims to show that the manifestation of public universities crisis in its material aspects reveals the consequences of a deeper ideological and social crisis. It illustrates a loss of axiological benchmarks from which any institution of socialization operates. Understanding the ideological causes of the university crisis thus allow to consider the basic values of social construction, the erection and operation of universities so that they can be the heart of the development of the continent.
Keywords : Development, Instrumentalization of universities, University crisis, University in Africa, Social values.
Introduction
Depuis sa création en Afrique noire, l’université publique a connu des fortunes diverses (T. Des Lierres, F.-M. Affa’a, 2002). Après la première période, caractérisée par une certaine euphorie, ont débuté des années de soubresauts et d’incertitudes. Ces années sont marquées par des crises multidimensionnelles. On va assister à une crise d’investissement due, entre autres, au choc et à la dégringolade des prix des matières premières desquelles la plupart des pays africains tiraient leurs ressources. L’exemple le plus illustrateur est le choc pétrolier d’octobre 1973, qui est l’aboutissement d’une série de crises sociopolitiques et économiques, et qui s’est manifesté par la baisse du prix du baril de pétrole jusqu’à 2,59 dollars US. Ce choc va réduire considérablement les possibilités financières des pays africains exportateurs de pétrole ; mais aussi, il réduira les opportunités d’autres pays africains exportateurs d’autres matières premières, faute de débouchés. Tout cela va amenuiser drastiquement les possibilités de financement des jeunes universités publiques d’Afrique noire. La diminution des moyens économiques de ces pays amènera les institutions financières internationales à décourager ceux-ci à financer l’enseignement supérieur considéré comme un gouffre financier inutile pour le continent (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 105-106).
En plus du manque d’investissement, on assistera à une crise de confiance entre les gouvernants et les universitaires ; ce qui sera un des catalyseurs de la crise universitaire. En effet, les premiers établissements universitaires vont être très vite perçus par les élites politiques comme des laboratoires de formation des opposants aux régimes en place à cause de l’esprit critique qui fait partie de l’essence de l’université. Cela fait naître la méfiance des pouvoirs publics et le délaissement matériel des universités publiques.
Délaissées financièrement et surveillées étroitement, les universités « explosent » littéralement, dans les années 1990, avec le vent de la démocratisation et la possibilité d’existence d’espaces de liberté. Dans la plupart des pays de l’Afrique noire, les universités constituent le point de départ des mouvements sociaux et de contestations. De plus, dans ces pays, les mouvements mondiaux, africains et nationaux de facilitation d’accès de tous les citoyens à l’école se soldent, vers la fin de la décennie 1990, par un accroissement important des effectifs des étudiants dans lesdites universités. Cela, à dire vrai, accentue les problèmes matériels qui existaient déjà : manque d’infrastructures, de moyens matériels et financiers pour le fonctionnement des universités. À cela, s’ajoute une absence de repères en matière de formation.
La crise universitaire ainsi décrite à travers ses manifestations matérielles ne cache-t-elle pas, au fond, un problème plus profond ? Cette inquiétude invite à tourner les regards vers les sources réelles de la manifestation de cette crise : Quels sont les fondements idéologiques de cette crise universitaire en Afrique noire ?
Nous émettons l’hypothèse que la naissance et l’accroissement de la crise multiforme de l’université publique en Afrique noire traduit une crise idéologique et axiologique profonde des sociétés postcoloniales qui (cette crise) trouve en l’université, un terreau fertile d’expression.
L’objectif de cette contribution est de comprendre, au plus profond, la crise universitaire en vue d’esquisser des pistes de solutions idoines pour que les universités africaines soient à l’avant-garde des transformations sociales. Pour atteindre cet objectif, nous adopterons une démarche essentiellement analytique et critique qui épouse deux grandes étapes. Il s’agit d’abord, de situer la crise universitaire dans les pays de l’Afrique noire, dans son contexte idéologique ; ensuite, nous esquisserons les repères théoriques pour surmonter cette crise, en sorte que les universités publiques en Afrique noire, constituent le creuset du développement durable du continent.
1. Les fondements et les enjeux de la crise universitaire en Afrique
La crise universitaire dans les pays de l’Afrique noire traduit, à travers ses manifestations conjoncturelles, une profonde désorientation structurelle dont l’origine est idéologique et qu’il importe de comprendre en vue d’y trouver des remèdes appropriés. C’est pourquoi cette première partie sera consacrée d’abord, à l’élucidation du concept et à l’analyse du processus d’une crise ; ensuite et enfin, elle montrera en quoi la crise universitaire en Afrique noire est une crise idéologique et axiologique.
1.1. Clarification de la notion de crise et de crise universitaire
La notion de crise est une notion complexe, surtout lorsqu’elle s’applique à des institutions sociales comme l’université. Edgar Morin (1976, p. 149) estimait que lorsque cette notion se limitait juste au « secteur économique, ou pouvait au moins la reconnaître à certains traits quantifiés (diminution de la production, de la consommation ; accroissement du chômage, des faillites, etc.) » ; mais dès lors qu’elle s’élargit au domaine social, elle « perd ses contours ». L’étymologie grecque du mot (krisis) renvoie à la notion de perturbation, d’incertitude dans un domaine ou dans une situation donnée. La crise indique une perte de repères : on n’a plus la maîtrise d’une situation donnée ; ce qui signifie qu’on n’a plus les moyens intellectuels, matériels et même psychologiques pour maîtriser et orienter la situation dans le sens qu’on voudrait.
La survenue d’une crise dans une société ou dans une institution sociale comme l’université, n’est pas le fruit du hasard. Elle découle d’un processus que décrit Edgar Morin à travers sa communication faite en 1976 : « Pour une crisologie ». Ce processus comporte quatre moments.
1. La perturbation : la crise sous-entend qu’en amont, il existe une situation de base relativement stable. La crise débute par une perturbation de cette stabilité relative qui dénote de l’existence d’un problème qui ne peut plus rester non-résolu ; car cela mettrait en péril tout le système organisationnel et les finalités qu’il vise. Cette perturbation peut être externe et/ou interne. Elle est externe lorsqu’il s’agit des éléments extérieurs au système organisé qui viennent le mettre en péril ; ce qui l’oblige à changer (évoluer) pour sa survie. Elle est interne quand c’est le système organisé lui-même qui rencontre une situation de saturation, de « surcharge : le système devient incapable de résoudre les problèmes qu’il résolvait en deçà de certains seuils. Il faudrait qu’il puisse se transformer » (E. Morin, 1976, p. 155-156).
2. L’accroissement des désordres et des incertitudes : la perturbation fait accroître le désordre et l’incertitude inhérents au système en crise. Car tout système contient en son sein, ordre et désordre. La crise survient lorsque le second prend le pas sur le premier. Ainsi,
tout système vivant, et singulièrement tout système social comporte du désordre en son sein, et il fonctionne malgré le désordre, à cause du désordre, avec le désordre, ce qui signifie qu’une partie du désordre est refoulée, vidangée, corrigée, transmutée, intégrée. Or la crise est toujours une régression des déterminismes, des stabilités, et des contraintes internes au sein d’un système, toujours donc une progression des désordres, des instabilités, et des aléas (E. Morin, Ibid., p. 156).
3. Le blocage : « Le déferlement du désordre » (ibidem) entraîne la « rigidification » et la paralysie du système. Tout se passe comme si la crise entraînait, comme le dit Edgar Morin (Ibid. p. 157), la mort du système : « la dispersion et le retour au désordre des éléments constitutifs ».
4. Le déblocage ou le déclenchement de la recherche : le blocage suscite une recherche de solution pour sortir de cette situation. C’est en cela qu’une crise est positive parce qu’elle instigue l’imagination, l’invention de nouvelles solutions. Elle est donc créatrice de progrès du système et du progrès social. C’est pourquoi,
plus la crise s’approfondit et dure, plus elle suscite une recherche de solutions de plus en plus radicales et fondamentales. La crise a donc toujours un aspect d’éveil. Elle montre que ce qui allait de soi, ce qui semblait fonctionnel, efficace, comporte au moins des carences et des vices. D’où le déclenchement d’un effort de recherche (E. Morin, Ibidem, p. 159).
C’est à partir de ce processus morinien que l’on peut cerner dans son essence, la survenue de la crise universitaire en Afrique noire. Les premières universités étaient créées dans la continuité du service colonial : la formation des clercs pour l’administration coloniale. Cette stabilité de base sera très vite perturbée non seulement par des causes externes aux universités, notamment l’évolution sociale qui rend de facto, inadaptées ces institutions universitaires ; mais aussi et surtout par des causes internes : croissance des effectifs, absence de moyens.
L’évolution sociale s’entend ici, comme l’émancipation des sociétés africaines et leur désir de se prendre en charge, de maîtriser leur destin. Or les universités publiques s’étant ancrées dans la logique coloniale, ne se donnent pas les capacités intellectuelles, matérielles et humaines leur permettant de participer au progrès social et d’être à l’avant-garde d’une telle émancipation. Ces universités se déconnectent donc de leur milieu socioculturel. Aussi la multiplication de ces universités en Afrique, chaque pays voulant avoir son université (ou ses universités), va-t-elle encourager l’accès d’un nombre de plus en plus croissant de citoyens aux études supérieures. Déjà vers les années 1980, le désordre dans la logique morinienne, avait pris le pas sur l’ordre, de telle sorte que l’accroissement progressif du désordre aboutit à une sorte de blocage avec des universités qui n’arrivent plus à s’inventer.
Aujourd’hui, nous sommes au stade de la prise de conscience et du déclenchement de la réflexion en vue d’inventer des universités publiques nouvelles adaptées aux sociétés africaines et aptes à participer au progrès du continent. La crise à laquelle font face les universités de nos jours, est une crise idéologique et axiologique.
1.2. La crise universitaire en Afrique : une crise idéologique et axiologique
De ce qui découle de la section précédente, on peut donc dire que lorsque l’on parle de la crise de l’université en Afrique noire, on voudrait signifier que le système universitaire subit une perturbation, une perte de repères de telle sorte qu’on se pose un certain nombre de questions à son sujet : quelle doit être sa nature dans le contexte de l’Afrique noire ? Quelles finalités faudrait-il lui assigner ? Ces deux préoccupations complémentaires renvoient à la question de l’idéologie principale et des valeurs sur lesquelles l’université devrait être fondée en Afrique noire. C’est à partir des réponses à ce questionnement que l’on pourra trouver des solutions adaptées aux questions conjoncturelles que sont : Comment organiser l’université en Afrique noire ? Quels moyens faut-il mobiliser et où les trouver ? Quels sont les contenus d’enseignement adaptés pour la formation universitaire ? Quelles sont les méthodes d’enseignement indiquées pour relever le défi d’une université africaine qui n’est pas perpétuellement en crise et qui participe au progrès social ?
On ne peut chercher à comprendre aujourd’hui, la crise universitaire sans remonter à son origine idéologique qu’est la colonisation. Celle-ci est une idéologie au sens d’un « système d’opinions qui, en se fondant sur un système de valeurs, détermine les attitudes et les comportements des gens à l’égard des objectifs souhaités du développement de la société » (A. Schaff, 1967, p. 50). En ce sens, la colonisation a déstructuré tous les systèmes sociaux de l’Afrique noire, en l’occurrence, le système éducatif traditionnel. Le système éducatif mis en place par le colon a eu pour but premier, de participer à une transformation idéologique profonde de la société africaine. Ainsi, à travers ses finalités, son organisation, son fonctionnement et ses contenus d’enseignement, l’école coloniale et postcoloniale a déconnecté les sociétés africaines d’elles-mêmes. Autrement dit, la colonisation a contribué à ce que ces sociétés rompent avec l’éducation et les valeurs traditionnelles : celles qui étaient à la base de l’organisation et de la gestion des sociétés africaines d’avant la colonisation. On peut ici, se référer par exemple, aux rites d’initiation et aux différentes valeurs que ces systèmes étaient censés transmettre (endurance, solidarité, courage, abnégation, etc.). Avec cette déstructuration coloniale, les sociétés traditionnelles africaines n’avaient plus la maîtrise de leurs objectifs précis d’évolution sociale ; et elles ont opté, malheureusement, pour le mimétisme. C’est dans cette rupture d’avec le milieu social traditionnel africain que sont ancrées les universités. C’est dans ce sens que,
nombreux sont les qualificatifs péjoratifs ou alarmants accrochés à notre continent par les africanologues. Mais ces spécialistes ne décrivent souvent que tel ou tel symptôme du mal africain dont le fond véritable réside sans doute dans la déconnection intérieure, par l’absence d’une reproduction autonome grâce à une éducation endogène. L’Afrique est débranchée par rapport à elle-même (J. Ki-Zerbo (1990, p. 15).
Les universités publiques de l’Afrique noire, dès leur création, étaient ancrées dans cette déconnexion avec les réalités socioculturelles de leur milieu. Leur finalité principale était de former une main-d’œuvre qualifiée pour l’administration coloniale ou la fonction publique postcoloniale qui n’est que la continuité de l’administration laissée par le colon. Et l’on peut constater que, jusqu’aujourd’hui, à quelques nuances près, les universités publiques continuent d’évoluer dans cette logique coloniale. C’est qu’on a a créé des universités publiques en Afrique noire qui sont calquées sur les modèles de universités occidentales. Ce faisant, on a occulté le fait les universités publiques africaines sont nées et évoluent dans des contextes socioculturels différents de ceux de l’Europe. On a donc aujourd’hui des universités africaines qui sont basées sur l’histoire et l’idéologie occidentale. Comment de telles universités pourraient-elles être en phase avec les réalités de leur milieu et surtout former une élite intellectuelle africaine capable de contribuer efficacement au développement du continent ? Leur structuration, leur organisation et leur fonctionnement, leurs méthodes et contenus sont orientés vers réalités autres que celles du continent.
Ce sont des universités de déracinement qui forment des clercs pour l’administration publique. Celle-ci n’étant pas extensible à l’infini, très vite, elle est saturée. Or, la formation reçue par ceux qui sortent de ces universités, à cause de la déconnection avec le milieu socio-culturel, ne leur permet pas de faire autre chose, parce qu’ils sont « formatés » pour l’administration publique. Intellectuellement, culturellement, ils n’ont pas de repères sociaux et axiologiques, parce que l’université publique de l’Afrique noire ne repose pas sur des valeurs africaines en vue de former l’Africain. Les universités sont déconnectées du patrimoine de leur milieu ; ainsi, elles sont désorientées et n’ont pas la maîtrise d’elles-mêmes ; l’enseignement qui y est donné ne tient pas compte du contexte matériel et socioculturel.
Inadaptée, l’université publique de l’Afrique noire est en crise de ses fondements idéologiques et axiologiques. Étant elle-même désorientée, elle alimente la crise sociale et celle des États africains en « produisant des inadaptés économiques et sociaux et en dédaignant des pans entiers de la population active » (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 11).
C’est en saisissant cette origine idéologique et axiologique de la crise universitaire que l’on comprend qu’il ne suffit pas de proposer des solutions matérielles pour venir à bout de cette crise. L’on a besoin de repères idéologiques et axiologiques clairs et adaptés aux pays du continent et sur lesquels il faut fonder les universités publiques en Afrique noire pour endiguer la crise.
2. Repères idéologiques pour sortir de la crise universitaire en Afrique noire
Dans les pays de l’Afrique noire, la crise universitaire s’est cristallisée depuis les années 1990. Les États prennent des initiatives pour la résorber avec plus ou moins de succès. L’une des raisons pour lesquelles ces États n’y arrivent pas totalement, est que chez beaucoup de gouvernants et des acteurs de l’enseignement supérieur, la crise n’est perçue que dans son aspect matériel. On n’aborde pas son aspect idéologique de la crise. Ainsi, plusieurs solutions matérielles ont été apportées dans beaucoup de pays (recrutements, investissements matériels et financiers, construction, etc.). Mais elles n’ont pas permis de venir à bout de ladite crise. Il importe d’aller au-delà de la simple question de moyens matériels pour envisager des réponses super-structurelles. Avant de dégager des repères idéologiques pour la maîtrise de cette situation de crise, analysons certains des remèdes apportés par les États africains.
2. 1. Des efforts qui interrogent
Depuis quelques années, la question de la crise universitaire se pose en Afrique comme un défi : comment sortir d’une université publique perpétuellement en crise, pour en faire un puissant moyen de développement ? Dans la plupart des pays de l’Afrique noire, notamment ceux de l’Afrique francophone, des réponses matérielles sont apportées. Ces solutions sont de plusieurs ordres et essentiellement matériels. Dans les pays francophones de l’Afrique de l’ouest et du centre par exemple, on assiste ces dernières décennies, à la multiplication des universités publiques ou à la déconcentration des premières universités publiques devenues de véritables mastodontes difficiles à gérer.
En Côte d’Ivoire, pendant plus de trente ans et ce à partir des années des indépendances, il n’a existé qu’une seule structure publique d’enseignement supérieur qui deviendra l’Université nationale de Côte d’Ivoire. Ce n’est qu’en 1992 que l’on assistera à la création de centres universitaires comme celui de Bouaké (https://univ-ao.edu.ci/decouvrir-luniversite/history), compte tenu des problèmes d’infrastructures et d’effectifs. Mais en 2019, ce pays comptait 7 universités publiques et plusieurs établissements supérieurs publics spécialisés. Il y est prévu à l’horizon 2025, la construction de 14 nouvelles universités publiques (portail internet du gouvernement ivoirien : https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=9728). On voit comment l’on multiple les universités publiques en des temps records, dans le but de résoudre certaines difficultés.
On retrouve le même schéma d’évolution dans beaucoup de pays. De plus, l’investissement plus ou moins massif dans la construction des infrastructures (amphithéâtres, logements, etc.) et dans l’équipement ces dernières années, participe de l’apport de ces solutions matérielles. Dans la plupart des universités publiques, cette dernière décennie a été marquée par l’effort de construction de salles de cours, de laboratoire, d’équipements en connexion internet, etc. Aussi des efforts de recrutement « massif » se font-ils au Niger, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, etc., même si ces recrutements demeurent toujours insuffisants au vu de la forte demande. Enfin, on assiste aussi au renforcement des budgets d’investissement, de fonctionnement et à l’augmentation substantielle des salaires et primes des personnels travaillant à l’université. Au Togo par exemple, entre 2005 et 2010, les dotations de l’État pour les deux universités publiques est passée de 5 milliards de francs CFA à plus de 8 milliards (I. Chitou, 2011, p. 130).
Tous ces efforts matériels et bien d’autres auraient pu permettre de résorber la crise universitaire dans ces pays. Mais l’on constate qu’on a affaire à une sorte de tonneau de Danaïdes sans fond, et qui engloutit tous les efforts, sans que les crises ne cessent. Non seulement la crise dans les universités publiques persiste, mais aussi et surtout les solutions purement matérielles contribuent à la naissance de nouveaux problèmes qui prennent racinent dans les solutions trouvées et énumérées ci-haut.
Parmi ces nouveaux problèmes, il importe d’exposer quelques-uns qui constituent autant de défis. L’un des premiers problèmes est la multiplication du nombre de diplômés universitaires sans emploi, et la naissance d’une nouvelle classe de chômeurs : les docteurs-chômeurs. En effet, la multiplication des universités et la formation de plus en plus poussée, a augmenté le nombre de diplômés des universités publiques dont les formations ne sont pas pertinentes par rapport aux besoins réels des pays. Aujourd’hui, une nouvelle classe de chômeurs dont on n’entendait pas parler en Afrique, il y a quelques années, est née : celles des jeunes docteurs d’université qui sont au chômage. Que ce soit au Cameroun, au Togo, en Côte d’Ivoire, en Tunisie, les actions de ces nouveaux surdiplômés se multiplient pour réclamer l’accès à l’emploi. On pourrait ensuite mentionner le problème du sous-emploi des diplômés des universités publiques qui est très récurrent dans ces pays. Ainsi on rencontre-t-on de nombreux jeunes diplômés d’universités qui sont obligés d’embrasser des carrières qui ne sont pas adaptées pour ainsi dire en déphasage avec leur formation initiale : conducteur de taxi-moto, vendeur à la sauvette, etc.
On constate donc que les solutions matérielles n’arrivent pas à mettre fin à la crise universitaire, pis, elles engendrent de nouveaux problèmes. La raison est que cette crise n’est pas prise à la racine : on traite les conséquences d’une crise sans s’attaquer à ses sources. La racine de la crise est que l’université publique telle qu’elle est, reste inadaptée aux besoins réels des pays africains. En multipliant et en rependant cette université dans son idéologie et dans sa forme actuelle, on ne fait qu’accroître la crise au lieu de la résoudre. Joseph Ki-Zerbo parle de l’incohérence de nos systèmes éducatifs, notamment des universités publiques africaines, qui produisent « des articles non côtés sur le marché » comme un gigantesque abattoir installé dans un pays de végétariens. Dans ce cas, l’accroissement du nombre d’animaux abattus ne fera qu’aggraver l’absurdité de la situation » (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 84).
On comprend donc que plus on multiplie les universités publiques dans leur idéologie et dans leur forme actuelle, plus on contribue à accroître la crise universitaire. « Le paradoxe du chômage » des jeunes diplômés des universités illustre assez bien l’accroissement de cette crise : on forme des jeunes dans des universités « avec des moyens et des méthodes qui n’ont que peu de lien avec la réalité locale et après, on voudrait que ces jeunes agissent sur leur milieu local. Il est clair que ces jeunes déconnectés et désormais inadaptés n’attendront qu’un travail salarié dans l’administration publique » (B. Tonyeme, 2022, p. 151). Au lieu de continuer à accroître les universités existantes dans leur idéologie et dans leur forme actuelle, c’est à ces dernières qu’il faut s’attaquer si l’on veut mettre fin à la crise.
2.2. Penser une autre université pour l’Afrique noire
« Les jeunes Africains partent de quelque part ; les conduire sans s’inquiéter de saisir d’où ils viennent, c’est faire, non point de l’éducation, mais de l’élevage » (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 79). Cette idée de Joseph Ki-Zerbo renvoie à la question cruciale du souci d’adaptation des universités aux réalités locales. Jusqu’alors, dans la plupart des pays, on a des « universités en Afrique ». Ce qui engendre des crises, car ces structures ne sont que des corps étrangers dans les sociétés où elles sont implantées. Il s’agit, aujourd’hui, de passer des « universités en Afrique » aux « universités africaines », ce dont Joseph Ki-Zerbo (1990, p. 101) parle en termes d’« africaniser » l’université.
Cette africanisation devra consister en un certain nombre d’actions à poser. La première de ces actions consistera à sortir du mimétisme : les universités actuelles sont calquées sur celles des métropoles. Elles les imitent dans leur idéologie, dans leur structuration et dans leur fonctionnement. Or, chaque pays a un contexte socioculturel différent. Si l’on veut avoir des universités en phase avec leur milieu, et en conséquence moins crisogènes, il faut les repenser en rapport avec leur contexte. Cela permettra d’avoir des universités publiques réalistes, parce que conçues en tenant compte des moyens, des méthodes de fonctionnement social. En second lieu, il faut concevoir des universités idéologiquement et axiologiquement basées sur les valeurs socioculturelles des sociétés africaines. Olivier Reboul (1999, p. 39) parle des valeurs en éducation comme suit : « Je pense que le postulat de toute éducation est qu’il y a quelque part une perle de grand prix, ou mieux sans prix, qui exige, mais aussi qui vaut la peine qu’on lui consacre son temps, ses efforts, en un mot soi-même ; qui appelle le sacrifice tout en le légitimant ». À partir de là, se posent des questions fondamentales de base pour les pays africains : quelles sont les valeurs que les universités doivent incarner et transmettre, et qui sont le reflet des sociétés africaines ? Comment ces valeurs peuvent-elles être incarnées dans la forme, la structuration et le fonctionnement de nos universités pour que les jeunes africains qui y entrent soient en phase avec leur société, et qu’ils s’y retrouvent culturellement, matériellement et même spirituellement ? En troisième lieu et conséquemment à ce qui précède, il s’agit de penser des universités qui ne soient pas en rupture avec leur société. Telles qu’elles sont et fonctionnent actuellement, les universités publiques sont en rupture avec leur milieu et les jeunes qui y entrent perdent tous les repères sociaux de leur environnement. Ils y perdent leur âme. Il faut penser des universités qui soient la continuité socioculturelle du milieu. Ce qui renvoie à l’idée que les universités doivent s’organiser autour des réalités de leur milieu social (langue, contenu des cours, besoin du milieu, etc.).
La continuité de la langue, du savoir traditionnel, des us et coutumes ancestraux devrait être au cœur de l’université. Cela, en raison du fait que ces éléments culturels constituent les véhicules des valeurs qui constituent l’identité des peuples africains qui sont entre autres le communautarisme et la solidarité inhérente, le courage, l’endurance, l’attachement à la communauté qui est une prémisse indispensable à la citoyenneté nationale. Ce lien entre l’université et son environnement social permettrait la participation active de la société au fonctionnement de « son » université. Cette participation pourrait être le financement social d’une structure (université) par les citoyens qui savent à quoi cette structure leur sert. On doit donc cesser d’avoir des universités qui sont fermées sur elles-mêmes et où se passent des choses que le citoyen ordinaire ne comprend pas. Les universités publiques, pour éviter les crises récurrentes et pour devenir de puissants moyens du progrès des sociétés, doivent être ouvertes sur leur environnement social.
Enfin, une telle université n’est possible que si elle est ancrée dans les besoins réels de son milieu. Les universités publiques doivent être des lieux où les jeunes vont pour mieux comprendre les défis de leur milieu et y trouver des esquisses de solution. Or, on a l’impression que les universités actuelles sont tournées vers ce que l’on appelle des « standards internationaux » dans les contenus et les méthodes de formation. Malheureusement, à y voir de près, ces standards internationaux ne sont que des réalités d’un milieu donné que l’on essaie d’internationaliser. Les universités africaines les adoptent souvent sans y réfléchir et au détriment des jeunes formés qui perdent, non seulement tout repère, mais aussi et surtout, ils ont des diplômes sans disposer des moyens intellectuels et matériels adaptés pour agir sur les particularités de leur environnement. Une réforme profonde de l’université dans les pays de l’Afrique noire, s’impose si on veut résoudre de manière efficiente le problème des crises universitaires perpétuelles. Joseph Ki-Zerbo (1990, p. 101) dit en substance que l’africanisation s’impose pour rendre à l’université son rôle d’organe reproducteur des sociétés africaines ; rôle qu’elle ne remplit presque pas actuellement.
Conclusion
Les universités publiques dans les pays d’Afrique noire sont en crise. Cette crise ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte aux premières décennies d’après leur création. Délaissées, faute de moyens et d’intégration de ces universités dans une vision de construction d’un avenir prospère pour l’Afrique, considérées comme un gouffre financier inutile et surveillées de près parce que perçues comme un lieu de formation des contestataires des régimes en place, les universités publiques de l’Afrique noire d’après les indépendances vont évoluer dans un relatif dénouement matériel (des infrastructures insuffisantes et délabrées, des enseignants mal payés, des contenus et des méthodes d’enseignements désuets, etc.).
La démocratisation de l’éducation primaire enclenchée à partir des années 1990, à travers le slogan « école pour tous », va contribuer à l’accroissement rapide des effectifs des étudiants dans ces universités. C’est ce qui va accentuer la crise jusqu’à un niveau où il était impératif de trouver des solutions audit accroissement des effectifs. En plus, les problèmes matériels que rencontrent ces universités seront les catalyseurs des mouvements de grèves et de revendications à répétition, rendant presqu’impossible la gestion des universités en question. En conséquence de tout cela, les universités africaines en crise, et parce qu’elles le sont effectivement, sont incapables de contribuer au développement économique et social. Les solutions préconisées par la plupart des États africains, ne permettent pas jusqu’ici, d’endiguer définitivement les crises dans l’espace universitaire. La persistante et la multiplication des formes que cette crise des universités revêt, peuvent s’expliquer par le fait que les solutions matérielles envisagées jusque-là par les pouvoirs publics, ne traitent que de ses effets et non ses causes. Il faudrait retrouver la cause structurelle de la crise qui est idéologique et axiologique. L’université en Afrique noire est fondée sur des principes et des valeurs qui sont déconnectés des sociétés africaines.
Pour mettre fin à ladite crise, il ne suffit donc pas de panser les plaies d’une université quelconque – de celle-ci ou de celle-là, mais de penser une autre université. Il s’agit en fait et en droit de celle qui est adaptée et qui s’enracine dans les sociétés africaines pour permettre que celles-ci prennent en main leurs institutions supérieures d’enseignement afin que ces dernières soient le moteur de leur développement.
Références bibliographiques
BECK Ulrich, 2008, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion.
CHITOU Ibrahim, 2011, « L’enseignement supérieur et la recherche dans la problématique du développement du Togo : une orientation vers la gestion entrepreneuriale », Management et avenir, vol. 5, numéro 45, p. 126-143.
DES LIERRES Thérèse, AFFA’A Félix-Marie, 2002, L’Afrique noire face à sa laborieuse appropriation de l’université. Les cas du Sénégal et du Cameroun, Paris, L’Harmattan.
KI-ZERBO Joseph, 2013, À quand l’Afrique, Paris, édition d’en bas.
KI-ZERBO Joseph, 1990, Éduquer ou périr, Paris, éditions de l’UNESCO.
MAKOSSO Béthuel, 2006, « La crise de l’enseignement supérieur en Afrique francophone : une analyse pour le cas du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo et de la Côte d’Ivoire », JHEA/RESA, vol. 4, n° 1, p. 69-86.
MORIN Edgar, 1976, « Pour une crisologie », Communications, « La notion de crise », N°25, p. 149-163.
MORIN Edgar, 2000, Sur la crise, Paris, Flammarion.
ORIVEL François, 1991, « La crise des universités francophones », in Perspective, Vol. XXI, N°3, p. 377-385.
REBOUL Olivier, 1999, Les valeurs en éducation, Paris, PUF.
SCHAFF Adam, 1967, « La définition fonctionnelle de l’idéologie et le problème de la fin du siècle de l’idéologie », in L’homme et la société, N°4, p. 49-59.
SENGA Jean-François, 1987, « La crise de l’université en Afrique noire », in revue Présence africaine, vol. 4, N°144, p. 153-155.
TONYEME Bilakani, 2022, « Éducation et citoyenneté chez Joseph Ki-Zerbo : quelques repères pour le développement de l’Afrique », in Chrysippe, N°16, janvier, p. 143-160.
UNIVERSITÉ ET CULTURE DES VALEURS MORALES CHEZ LES ÉTUDIANTS AU BURKINA FASO
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
Résumé :
La présente réflexion est une contribution à la compréhension du déclin des valeurs morales en milieu universitaire au Burkina Faso. Ce phénomène constitue une menace à la réalisation des objectifs de l’institution universitaire. À partir de points de vue théoriques déclinés par les auteurs, nous avons donné un aperçu de la manifestation de ce phénomène en milieu universitaire au Burkina Faso. Nous avons proposé des pistes de solutions pour contenir ce phénomène dans son expansion et dans son expression.
Mots clés : Burkina Faso, Culture, Déclin, Université, Valeurs.
Abstract:
The present reflection is a contribution to the understanding of the decline of moral values in the university environment in Burkina Faso. This phenomenon constitutes a threat to the achievement of the objectives of the university institution. Based on the theoretical points of view expressed by the authors, we have given an overview of the manifestation of this phenomenon in the university environment in Burkina Faso. We have proposed solutions to contain this phenomenon in its expansion and expression.
Keywords : Burkina Faso, Culture, Decline, University, Values.
Introduction
Une valeur est « une conception, explicite ou implicite, distinctive d’un individu ou caractéristique d’un groupe, une conception de ce qui est désirable et influence le choix des modes, moyens, et fins disponibles de l’action » (C. Kluckhohn, 1962, p. 395). La notion de valeur combine de manière singulière, objectivité et subjectivité. D’un côté, une valeur s’impose à quelqu’un avec une certaine autorité, comme un élément hérité d’une tradition. En ce sens, elle n’est pas dépourvue d’objectivité. D’un autre côté, elle n’existe véritablement que si l’on y adhère (J. Catalogne, 2004).
Une valeur est dite morale quand elle sert à orienter le comportement d’un individu placé dans une situation de choix, et quand, par ce choix, l’individu doit s’intégrer davantage dans le système culturel où il vit. Produit de la vie en groupe, la valeur morale est perçue comme possédant un caractère d’obligation et assure ainsi le contrôle social dans des situations spécifiques (D. Szabo, F. Goyer et D. Pilote, 1964). La morale possède un versant négatif qui en fait une instance supérieure nous obligeant à respecter des règles contraignantes. Elle possède également un versant positif où ses exigences prennent la forme de grands buts, d’idéaux à atteindre, de modèles de bonne conduite à imiter. Sous cet angle, ainsi que le dit en substance, Métayer (2008), la morale priorise les biens en tant qu’ils ont une grande valeur existentielle reconnue comme telle. C’est en ce sens qu’on s’y attache, on s’attèle à leur réalisation et on fait leur promotion et mobilise les moyens pour les sauvegarder. Le bonheur et le courage sont des exemples de valeurs positives. Les valeurs morales s’imposent plutôt par l’attrait qu’elles exercent sur nous. Nous les trouvons admirables et désirables. Elles inspirent, suscitent une adhésion, un attachement et un engagement affectif ou émotionnel.
Il apparaît ainsi que les valeurs morales sont l’ensemble des règles, principes, normes et coutumes transmis par la société à l’individu, dès la petite enfance par les parents ou les figures d’autorité, qui édictent rigoureusement la conduite et les mœurs appropriées pour être bon, faire le bien et vivre ensemble dans le respect fondamental de l’autre (M. Blais, 1980). Plus tard, avec l’entrée de l’enfant à l’école, ces valeurs connaissent un renforcement apporté par les enseignants. Elles sont connues comme représentant la bonne ou la juste manière d’agir. Elles permettent ainsi de faire la différence entre le bien et le mal, le juste et l’injuste, le correct et l’incorrect. On y retrouve, par exemple, l’honnêteté, le respect, la gratitude, la loyauté, la tolérance, la solidarité, la générosité, l’amitié, la gentillesse et l’humilité. A. Mucchielli (1994), parle de valeur sociale, considérée comme un principe de référence partagé par un ensemble d’individus. Elle se trouve à la source d’une conduite reconnue idéale et estimable par le groupe et guide le comportement des individus qui appartiennent à ce groupe. Pour M. Blais (1980, p. 85) :
Les valeurs morales (au sens où nous entendons le mot valeur), ce sont des qualités, acquises par la répétition d’actes appropriés et qui assurent le correct usage de tout ce dont on use dans une vie humaine : bon usage de sa science, bon usage de son art, bon usage de sa langue, bon usage de son sexe, bon usage de ses convictions religieuses, bon usage de son pouvoir, etc.
Pour M. Blais, l’importance des valeurs morales, c’est l’importance de la justice, de l’équité, du courage, de la modération. Il s’agit-là, de vertus d’autant plus importantes que les humains sont de mieux en mieux équipés pour le bien comme pour le mal. En appui à cette vision, M. Blais rappelle l’ultime objectif formulé par l’écrivain Russe Soljenitsyne : « Offrir au monde une société dans laquelle toutes les relations, dont tous les fondements et toutes les lois découlent de considérations morales et d’elles seules » (M. Blais, 1980, p. 87).
Le sujet du déclin de la morale et des valeurs est un sujet sur lequel l’inquiétude, voire le pessimisme, sont sensibles, y compris dans certains textes à caractère scientifique. Nous avons quitté un état des sociétés où le système d’éducation et la famille transmettaient à l’enfant puis à l’adolescent des valeurs qui faisaient plus ou moins, l’objet d’un consensus. Ces valeurs étaient ensuite appliquées dans les différents contextes professionnels, et plus généralement, dans les divers contextes de vie que traversaient les individus. En passant de la société industrielle à la société postindustrielle, de la modernité à la postmodernité, nous avons abandonné un monde où ces contraintes de rôles étant connues et acceptées, elles permettaient une adaptation facile de l’individu aux différents milieux dans lesquels il s’insérait (R. Boudon, 2002 ; B. Wilson, 1985). Même si les valeurs ne commandent pas directement l’action en prescrivant des gestes, elles constituent néanmoins, le fondement de tout projet éducatif. Il n’y a aucune forme d’éducation sans valeurs, car toute éducation découle d’une conception que l’on cultive sur le bien et une certaine foi en l’amélioration de l’homme, c’est-à-dire à l’éducabilité de l’apprenant. Parce qu’imprégnée des valeurs, l’éducation peut établir des règles, abstraites et négatives, et non prescriptives, car il serait inconcevable d’envisager l’éducation comme une quelconque forme de conditionnement (S. Lüdecke-Plümer, 2007 ; O. Reboul, 1992).
Le milieu universitaire n’échappe pas à ces constats. L’université, en tant qu’espace social, reproduit les relations de pouvoir, les pratiques de domination et de discrimination (P. Boumard, 2006, P. Dubet, 1998). L’emprise du thème du déclin des valeurs morales est révélatrice d’une profonde mutation de l’université que ses acteurs ont du mal à percevoir autrement que sous l’angle de la crise. Selon M. Seymour (2013), en plus d’assurer des services d’éducation et de culture, l’université joue un rôle économique important. « Elle est de plus en plus un rouage essentiel dans ce qu’il est convenu d’appeler l’« économie du savoir» » (M. Seymour, 2013, p. 53). Pour lui, l’université doit être comprise comme une institution servant d’abord et avant tout le bien commun. En effet, le système d’éducation universitaire incarne le principe de juste égalité des chances, assure la transmission de la culture, donne accès à des emplois de qualité, constitue un service public essentiel et joue un rôle de premier plan dans le développement économique d’un peuple. « L’Université a pour mission essentielle la formation des cadres qui auront à conduire le développement, les changements en réponse aux besoins de la société » (A.-R. Ndiaye, 2013, p. 91).
Selon A. S. Sall (2017), l’université n’est pas une administration classique, située au bout de l’échelle de formation. Elle a plusieurs responsabilités pour le bon fonctionnement de la société. Dans ce sens, en plus de la promotion de l’économie, l’enseignement supérieur doit promouvoir la culture et le social, c’est-à-dire l’être. De ce point de vue,
la responsabilité incombe à l’enseignement supérieur de veiller à l’amélioration de la société, d’y vulgariser les meilleures pratiques, d’aider au développement économique, social et culturel. Les étudiants sont les meilleurs vecteurs de la transformation positive de la société sur tous les plans. Il est dès lors fondamental de leur donner des savoirs et compétences au cours de leur transit à l’université et de leur faire partager les valeurs que cherche à promouvoir l’université. Encore faut-il que l’université s’accorde de façon explicite sur ces valeurs et sur la stratégie à mettre en œuvre pour les promouvoir (A. S. Sall, Op. cit., p. 118).
Plus généralement, J.-C. Torres (2015) soutient que l’école institue la République en éduquant chaque futur citoyen aux exigences d’un intérêt général et aux valeurs partagées.
La formation des cadres qui auront à conduire le développement, les changements en réponse aux besoins sociétaux, constitue une des missions essentielles de l’Université (A.-R. Ndiaye, 2013). La responsabilité lui incombe de veiller à l’amélioration de la société, de vulgariser en son sein, les meilleures pratiques, d’aider au développement au triple plan économique, social et culturel (A. S. Sall, 2017). Les étudiants y arrivent entre 18 et 21 ans et en sortent entre 23 et 26 ans. Ils y terminent ainsi, leur adolescence et y commencent leur vie d’adultes (A. S. Sall, Op. cit.). C’est une étape de la vie au cours de laquelle, la question de l’identité personnelle est cruciale (E.H. Erikson, 1972). La présente réflexion s’intéresse à la culture des valeurs morales à instituer pour un comportement citoyen et responsable chez les étudiants en contexte burkinabé. Ce champ de réflexion est encore peu investigué dans le contexte étudié, d’où l’intérêt de la présente réflexion.
L’université est aujourd’hui confrontée à une profusion des contre-valeurs :
– absentéisme des étudiants et/ou des enseignants aux cours ;
– utilisation de la violence par les étudiants pour imposer leur volonté sur le campus ;
– tricherie aux examens universitaires…
Cela fait dire à A. S. Sall (2017) que nous sommes dans un milieu où « Tout le monde se prévaut de ses droits et personne n’a de devoirs » (p. 122). L’auteur se dresse contre une certaine tendance à considérer l’université comme un endroit de non-droit, en insistant sur la nécessité pour les universités d’expliciter leurs règles et procédures, leurs principes et autres codes de déontologie. Elles devraient vulgariser ces valeurs et se doter de moyens de défense et de coercition. En fait,
les valeurs de l’université ne doivent pas être implicites, mais bien explicitées, au fronton de l’université, avec une stratégie très claire pour les vulgariser à travers toute l’institution auprès des enseignants, des étudiants en passant par le personnel administratif, technique et de service (A. S. Sall, op cit, p. 122).
1. Références théoriques
En psychologie développementale, et d’un point de vue fondamental, J. Piaget (1957) a proposé de comprendre le stade de développement de l’enfant et le type de jugement moral associé à chaque étape afin de déterminer quelle éducation devra être encouragée. Selon J. Piaget, la morale est un système de règles dont l’essence est à chercher dans le respect que l’individu acquiert pour ces règles. Celui-ci est lié au développement de la justice, du sens de la réciprocité et de l’égalité.
L. Kohlberg (1963, 1969) a proposé un modèle de développement moral organisé en stades. C’est un modèle d’évolution en six stades regroupés, par deux, en trois grands niveaux de développement. Le premier niveau correspond à la moralité préconventionnelle. Elle est caractérisée par une perception des règles limitée par l’égocentrisme. Les règles sont extérieures à l’enfant qui les perçoit à travers la punition et la récompense.
Au stade 1, l’enfant est centré sur les conséquences directes de ses actions sur lui-même. Il cherche à éviter la punition et obéit à l’autorité. Au stade 2, l’enfant intègre les récompenses et les avantages, mais dans une logique dominée par un manque de perspective sociétale ou relationnelle (égocentrisme). Le deuxième niveau correspond à la moralité conventionnelle. Elle est typique des adolescents et des adultes. L’adolescent raisonne d’une façon conventionnelle en jugeant de la moralité des actions par comparaison aux opinions et aux attentes de la société. Cette morale est caractérisée par une acceptation des conventions de la société concernant le bien et le mal. Le stade 3 est orienté vers le maintien des bonnes relations et l’approbation des autres. La personne est réceptive à l’approbation et à la désapprobation comme indices des vues de la société. Elle essaie d’être un « bon garçon » ou « bonne fille » à la hauteur des attentes. Le stade 4 est orienté vers le respect de la loi et des conventions sociales qui sont jugées importantes pour le maintien de l’ordre social. Violer une loi est moralement répréhensible. Selon L. Kohlberg, les membres les plus actifs de la société demeurent au stade 4 dans lequel la morale est principalement dictée par une force extérieure.
Le niveau 3 correspond à la moralité post-conventionnelle. Cette moralité est orientée vers des principes qui se situent au-delà des balises d’une société en particulier. 20 à 25 % seulement des adultes atteindraient ces stades. Les personnes qui se situent à ce stade, peuvent désobéir aux règles qui ne sont pas compatibles avec leurs propres principes. Au stade 4 se produit l’adhésion conformiste aux règles de la société, au système légal et à la justice dans son ensemble. Le bien-être des individus dépend du bon fonctionnement de la société. Le stade 5 est orienté vers le contrat social. Le monde est considéré comme incluant des opinions différentes, des droits et des valeurs. Les lois sont considérées comme des contrats sociaux plutôt que des dictats rigides. Celles qui ne favorisent pas le bien-être général doivent être remplacées lorsque cela nécessaire pour promouvoir le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes. Le stade 6 est orienté vers des principes moraux universels. Le raisonnement moral est basé sur une pensée abstraite qui utilise des principes éthiques. Les lois ne sont valables que dans la mesure où elles sont fondées sur la justice. Des lois injustes ne méritent pas que l’on les respecte. Selon Kohlberg, 13 % de la population adulte atteindrait le stade 6.
Un des reproches faits au modèle de Kohlberg, et formulé par C. Gilligan (1982), est qu’il mettrait trop l’emphase sur la valeur de justice à l’exclusion d’autres valeurs morales telle que le « prendre soin » et qu’il sous-évaluerait ainsi la moralité des femmes. Un autre reproche est que le raisonnement moral n’est souvent qu’une rationalisation a posteriori de décisions essentiellement intuitives. En dépit de ces critiques, ce modèle a l’avantage d’indiquer que le développement moral se déroule suivant une série d’étapes successives, séquentiellement rattachées l’une à l’autre. Il indique la spécificité du comportement moral suivant l’étape de développement à laquelle se situe l’individu.
2. Quelques illustrations de la déliquescence morale en milieu universitaire burkinabè
Une des formes que revêt la crise des valeurs morales en milieu éducatif burkinabè est la violence. Quelques exemples suffisent à le montrer. En 2012, à l’université de Koudougou, des étudiants en furie s’en sont pris à un de leurs enseignants, chef de département d’Histoire, en le brutalisant. Le 18 mars 2013, une visite du chef du gouvernement burkinabè à l’Université de Ouagadougou s’est terminée en « queue de poisson », à cause des huées des étudiants. En juillet 2013, des étudiants enjoints de quitter les cités universitaires, ont incendié des véhicules appartenant à l’État, à des particuliers ou à des organisations non gouvernementales.
D’autres formes que revêt le déclin des valeurs morales en milieu universitaire au Burkina Faso concernent :
– la tricherie aux évaluations : il n’existe malheureusement pas de statistiques à jour concernant ce phénomène dans les scolarités des Unités de Formation et de Recherches ;
– le non-respect des enseignants. Par exemple, un étudiant de 1ère année de Psychologie à l’Université Joseph KI-ZERBO a utilisé l’expression « wowo le cours » pour signifier à ses camarades que tel enseignant devrait venir dispenser son cours le lendemain à 15 heures.
Les fondements explicatifs de ces dérives morales et comportementales sont variés. S. Legleye (2011), note l’existence d’un lien de co-occurrence entre les difficultés socio-familiales et la violence des jeunes. La violence peut se lire et se comprendre en rapport avec le contexte familial (conditions de réalité et conditions fantasmatiques et émotionnelles). Il (le contexte) porte sur « des relations familiales dites pauvres, des séparations parentales, le divorce, la pauvreté économique, le manque de surveillance des parents, l’absence de l’un des parents pour raison professionnelle, les conditions d’habitat telles que l’habitat à l’étroit, les nuisances sonores dans les immeubles » (B. Gaillard, 2010, p. 200). La carence de l’autorité parentale, les dislocations conjugales et le manque de compréhension du milieu familial, vécu comme persécuteur par renversement d’agressivité, contribuent grandement à la recherche extra-familiale d’intérêts différents, de nouvelles formes de vie, avec violence dans la contestation, l’opposition et la révolte.
Ces dynamiques familiales créent une absence de structures parentales stables et régulières dont le jeune enfant a besoin pour parcourir avec bonheur, les stades psychosexuels définis par Freud (J.-L. Lorrain, 1999). C’est un parcours dont la réussite est une condition majeure pour atteindre la maturité psychologique. C’est dans le giron familial que l’enfant apprend les premières règles de la vie en communauté en suivant l’orientation et l’exemple des parents. Le déficit de structuration psychique attache certains individus à un stade de développement archaïque, avec une faible intériorisation des normes, des frontières et des limites (A. Cawood, 2013 a & b). La faillite de l’éducation familiale que symbolise la perte de l’autorité parentale assume pour sa part, les comportements antisociaux et le délitement de la citoyenneté chez les jeunes.
À ces différents facteurs, on peut adjoindre l’effet des médias (J.-F. Bach, O. Houdé, P. Lena & S. Tisseron, 2013). Des liens positifs ont été repérés entre le visionnement de films d’action ou d’horreur et la violence à l’école. Les films augmentent le comportement de mensonge, injure, bagarre et vandalisme (B. Gaillard, 2010).
La violence présentée à la télévision est acceptée et traduite dans les comportements quotidiens des jeunes. C. Marsan (2006, p. 285) dépeint la « réalité morcelée, superposée, rapide et toujours en évolution» des jeunes « nés sur Internet et avec une télécommande à la main ». Ils n’ont ni la concentration facile ni la propension naturelle à une attitude studieuse (M. Seymour, 2013). C. Marsan (Op. cit.), relève que les Short Messenger System (SMS), en réduisant la part de la communication interpersonnelle, réduisent du même coup, l’accès au symbolique. Peu habitués à construire une langue finalisée, les jeunes développent une atrophie significative de leur mode d’expression. En l’absence d’une aide familiale pour compenser par une contre-culture, ces réductionnismes, il y a le risque que le jeune ne puisse s’exprimer qu’avec un vocabulaire pauvre et restreint. Il aura du mal à exprimer, avec détails, ses idées et/ou ses sentiments. La réduction de l’accès au symbolisme va de pair avec l’augmentation possible de la violence (C. Marsan, 2006).
Enfin, dans un contexte de promotion des droits de l’enfant, l’autorité de l’enseignant est mise à rude épreuve. L’enseignant aujourd’hui, est dépourvu de tout moyen de pression pour instaurer l’ordre et la discipline en classe à cause des dispositions de loi relatives aux droits de l’enfant. Les apprenants, depuis l’école primaire jusqu’au post-primaire, sont initiés à la connaissance de leurs droits sans ouverture, hélas, sur leurs devoirs. C’est dans ces conditions qu’ils arrivent à l’université. Convaincus qu’ils sont intouchables grâce à leurs droits, ils se livrent, à chaque fois qu’ils se sentent lésés, à des actes « d’incivisme et d’indiscipline » dont les résultats sont les agressions des enseignants, des autres apprenants, du personnel de l’administration scolaire, la destruction des biens publics et/ou privés.
P. Judet (1992, p. 41) a utilisé l’expression « crise matérielle »pour décrire les difficultés matérielles graves auxquelles l’enseignement supérieur en Afrique Noire est confronté. Il s’agit, entre autres de,
locaux exigus et inachevés ; équipements insuffisants, à bout de souffle ou défaillants, téléphone coupé pour non-paiement de factures entre les locaux universitaires dispersés dans la ville ; postes de secrétariat non pourvus et pénurie de fournitures, y compris de papier ; impossibilité d’acheter des livres ou de régler des abonnements aux revues indispensables.
Cette crise matérielle rend la vie quotidienne difficile pour les enseignants et pour les étudiants, retentit sur leur moral et la qualité des formations.
3. Culture des valeurs et inversion du déclin moral
N. V. Long (2019, p. 243) : « Dans les sociétés primitives, les aînés des tribus transmettent des valeurs morales aux jeunes par divers moyens, tels que des histoires révélatrices, l’organisation de théâtres de moralité, etc. ». La mutation de la famille traditionnelle en famille moderne moins conservatrice des valeurs morales, l’effet permissif des Technologies de l’Information et de la Communication, l’affaissement de l’autorité parentale expliquent le déclin des valeurs morales constaté chez les citoyens en général et chez les jeunes apprenants en particulier. Pour A.S. Sall (2017), pour s’en sortir, les établissements d’enseignement supérieur devraient se doter de :
- charte éthique des enseignants ;
- trois valeurs à promouvoir ;
- contrat de travail à signer par les enseignants ;
- code de déontologie pour les enseignements et les évaluations ;
- charte éthique pour la recherche ;
- code d’honneur pour les étudiants ;
- pétition pour la citoyenneté des étudiants ;
- charte de l’environnement…
Un code de déontologie devrait définir des engagements éthiques clairs et indiquer les bonnes conduites à tenir vis-à-vis de toutes les parties prenantes : étudiants, enseignants, collaborateurs, gouvernements, donneurs d’ordre. Ce support serait un formidable vecteur de promotion des valeurs du système éducatif autant qu’un outil fédérateur interne pour améliorer et valoriser les bonnes pratiques. Selon J.-C. Torres (2015), l’enseignant institue le citoyen dans l’apprenant qu’il « élève » à un rang de dignité civile. C’est pourquoi, les enseignants du supérieur « devraient avoir une éthique très élevée, et ce, d’autant que les étudiants les prennent comme références et essaient de reproduire leurs comportements. Ils doivent être les premiers à promouvoir, entre autres, le respect de l’heure, la rigueur, l’assiduité, le travail bien fait, la disponibilité, l’ouverture, l’érudition, etc. » (A.S. Sall, 2017, p. 119). Ces préconisations devraient faire écho aux actions entreprises dans les familles et dans la société pour une éducation morale des jeunes.
En indiquant que la transmission et l’éducation aux valeurs morales incombent graduellement aux familles, aux éducateurs et à la société, il s’ensuit que les personnes formées sont le reflet des convictions et traditions incarnées par les formateurs eux-mêmes. C’est pourquoi, il incombe à ces différents acteurs d’être le modèle du futur citoyen que l’on veut former. Ainsi que le relève J.-C. Torres (2015, p. 80) : « la morale ne peut s’enseigner, elle ne peut que se transmettre – elle n’est donc pas à ce titre un “enseignement” ». Il invite dès lors, l’enseignant à être un reflet des valeurs, un modèle pour ses formés, le garant des valeurs que promeut la société. Il doit s’appliquer à guider les apprenants vers des valeurs humaines.
Si les jeunes d’aujourd’hui, appelés à être les formateurs de demain, ne sont pas initiés aux valeurs d’honnêteté, de respect, de gratitude, de loyauté, de tolérance, de solidarité, de générosité, d’amitié, de gentillesse et d’humilité, les générations à venir seront sans repère (J.-C. Torres, 2015). Dans ce lien intime entre les valeurs et l’école, F. Careau (2003) indique trois écueils à éviter:
– la tentation du positivisme, qui amène à ne reconnaître aux valeurs aucune place, car elles se rapportent au devoir-être, tandis que seule la science, portant sur l’être, alimenterait un discours imprégné du réel ;
– la tentation du relativisme ou du règne de la contingence absolue. En éducation, certains voient dans le relativisme une conséquence du pluralisme de nos sociétés. O. Reboul, admet pour sa part, que les valeurs peuvent varier d’une société à l’autre ou même dans une société donnée. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes les valeurs se valent, ni qu’elles partagent toutes la même noblesse, et surtout cela ne veut pas dire que toute action puisse s’inscrire dans le champ des valeurs. Le relativisme abolit toute prétention à l’universalité. Or, ce qu’il y a d’universel dans une culture, c’est la rencontre, l’ouverture communicationnelle instaurée par le langage et
– la tentation de l’indifférence représente une menace pour toute éducation, car cela laisse se perpétrer des comportements inacceptables. Ainsi, la valeur fondamentale de la tolérance doit amener le sujet à s’indigner devant l’intolérable, car le contraire pourrait détruire ce qu’il y a d’universel dans la culture. À ce titre, l’enseignant doit, en tant que représentant d’un système de valeurs, faire bon usage de son autorité afin de transmettre ses valeurs sans endoctriner. Toute mobilisation pédagogique doit être mise en œuvre afin que les valeurs soient comprises et évaluées par les apprenants.
Conclusion
Le déficit des valeurs morales dans les structures familiales, sociales et éducatives, fait le lit de toutes les formes d’indisciplines constatées dans les comportements des étudiants au Burkina Faso. Le comportement d’indiscipline impacte négativement l’activité éducative et constitue une menace pour l’atteinte des objectifs assignés à l’institution universitaire. Ses causes sont multiples et variées, engendrant des conséquences sur le bon déroulement des activités universitaires. Pour contenir ce phénomène aujourd’hui constaté, et qui caractérise la société burkinabè de façon générale et le milieu universitaire de façon singulière, il importe de replacer l’institution familiale au cœur du processus de socialisation des enfants et des adolescents. La famille est au centre de toute transformation sociale de l’individu. C’est le lieu où sont véhiculées les valeurs et les normes souhaitées par la société. Les valeurs d’une société transparaissent à travers des normes. Au-delà de la famille nucléaire, il faut privilégier l’éducation communautaire. Elle consiste à impliquer la communauté entière dans l’éducation des enfants et des adolescents. Cela n’est possible que si les parents et autres adultes épousent des valeurs de solidarité, de responsabilité, d’honneur, de respect et de dignité.
L’université, quant à elle, mettra l’accent sur le comportement responsable des enseignants et des autres acteurs (personnel administratif, technique, managers) pour offrir aux jeunes des modèles dont ils devraient s’inspirer au quotidien au cours de leur cursus universitaire et, plus tard, dans leur vie sociale et professionnelle. Parallèlement, l’État devrait instituer des textes relatifs à l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication, assortis d’un système de contrôle impliquant l’État lui-même, les parents et les enseignants. Une priorité devrait être accordée aux programmes qui promeuvent l’éducation aux normes et valeurs morales.
On pourrait de même, penser à réintroduire au sein des différents ordres d’enseignements, des modules d’instruction, d’éducation civique et morale. Ils serviraient de creuset de la promotion des valeurs traditionnelles par le biais des rites d’initiation en vue de restaurer le sens socio-moral et éthique. L’éducation traditionnelle a ses méthodes et ses pratiques qu’il faut prendre en compte pour améliorer la qualité de l’éducation moderne. L’initiation est un moment de séparation du jeune d’avec sa famille et pendant lequel, il est formé à l’endurance physique et morale. Enfin, il est indispensable de sensibiliser les jeunes sur leurs devoirs, compléments nécessaires de leurs droits.
Références bibliographiques
BACH Jean-François, HOUDE Olivier, LENA Pierre &TISSERON Serge, 2013, L’enfant et les écrans. Un avis de l’Académie des sciences, Paris, Éditions le Pommier.
BLAIS Martin,1980, L’échelle des valeurs humaines, Montréal, Fides.
BOUDON Raymond, 2002, Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? Cairn.info/Commentaire,1(97), 89-98.
BOUMARD Patrick, 2006, De la violence à l’école comme objet social non identifié à la reconnaissance des comportements déviants comme expression de la conscience multiple. In M.T. Estrela & L. Marmoz (Eds), Indiscipline et violence à l’école : études européennes, 35-48, Paris, L’Harmattan.
CAREAU Francis, 2003, Les valeurs et le sacré dans l’éducation d’aujourd’hui, Horizons philosophiques, 13(2), 115-129. https://doi.org/10.7202/801240ar.
CATALOGNE Jacqueline, 2004, Valeurs et transmission, Agora débats/jeunesses, 35, 58-72.
CAWOOD Anne, 2013 b, Les ados ont besoin de limites : discipline efficace sans punition, Ottawa, Broquet.
CAWOOD Anne, 2013 a, Les enfants ont besoin de limites : discipline efficace sans punition, Ottawa, Broquet.
ERIKSON Eric Homburger, 1972, Adolescence et crise : la quête de l’identité, Paris, Flammarion.
GAILLARD Bernard, 2010, Psychologie clinique des difficultés à l’école, In A. Lieury (dir). Psychologie pour l’enseignant, Paris, Dunod, 177-205.
GILLIGAN Carol, 1982, In a Different Voice Psychological Theory and Women’s Development, Harvard University Press.
JUDET Pierre,1992, Les missions des universités du Sud dans la crise : Situations et perspective, In Démocratie, économie et développement : la place de l’enseignement supérieur, vol 2 (37-46), Montréal : UREF/AUPELF.
KLUCKHOHN Clyde,1962, Values and value-orientations in the theory of action, in PARSONS T. and SHILS E. A., éd., Toward a general theory of action (388-433), New York, Harper & Row.
KOHLBERG Lawrence, 1969, Stage and sequence : the cognitive-developmental approach to socialization, In D. A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and research, 347-480, Chicago, Rand McNally College Publishing Company.
KOHLBERG Lawrence, 1963, The development of children’s orientations toward a moral order I. Sequence in the development of moral thought. Vita Humana, 6, 11-33.
LEGLEYE Stéphane, 2011, Violence et milieu social à l’adolescence, Economie et Statistique, 448-449, 159-175.
LONG Ngo Van, 2019, Atténuation de la tragédie des biens communs : la transmission intergénérationnelle des valeurs morales. L’Actualité économique, 95(2-3), 241-268. https://doi.org/10.7202/1076259ar.
LORRAIN Jean-Louis, 1999, Les violences scolaires, Paris, PUF.
LÜDECKE-PLÜMER Sigrid, 2007, Enseignement des valeurs et éducation morale dans les écoles d’enseignement professionnel, Revue européenne de formation professionnelle, 41 (2), 116-129.
MARSAN Christine, 2006, Violences en entreprise : comment s’en sortir ?, Bruxelles, De Boeck.
METAYER Michel, 2008, La Philosophie éthique : enjeux et débats actuels, Québec, ERPI.
MUCCHIELLI Alex, 1994, La psychologie sociale, Paris, Hachette.
NDIAYE Aloyse-Raymond, 2013, L’université de développement : une nouvelle approche des politiques universitaires en Afrique francophone, Politiques universitaires, politiques de développement, (87-112), Québec, ERPI.
PIAGET Jean, 1957, Le jugement moral chez l’enfant, Paris, PUF.
REBOUL Olivier, 1992, Les valeurs de l’éducation, Paris, PUF.
SALL Abdou Salam, 2017, La gouvernance universitaire : une expérience africaine, Dakar, CODESRIA.
SEYMOUR Michel, 2013, Une idée de l’université, Québec, Boréal.
TORRES Jean-Christophe, 2015, Enseigner les valeurs : conditions pour une éducation morale dans les EPLE, Administration & Éducation, 4 (148), 77-84.
SZABO Denis, GOYER Francyne et PILOTE Denis,1964, Valeurs morales et délinquance juvénile : résultats d’une enquête pilote, L’Année sociologique, 3e série, 75-110.
WILSON Bryan, 1985, Morality in the Evolution of the Modern Social System, British Journal of Sociology, 36, 3, 315-332.
UNIVERSITÉS, ENSEIGNANTS-CHERCHEURS : OBJECTIFS ET IMPLICATIONS SOCIO-POLITIQUES EN AFRIQUE
Cyrille MICKALA
Université Omar Bongo (Gabon)
Résumé :
Cet article traite de manière non intégrale de la situation de crise dans les universités africaines. Il s’intéresse aux rapports entre les universités, les enseignants-chercheurs et le développement structuré des pays. L’idée fondamentale consiste à se demander si aujourd’hui en Afrique, par opposition à l’Antiquité, les universités, et partant l’universitaire, participent encore réellement à l’essor multiforme des sociétés. En identifiant les orientations et difficultés actuelles qui traduisent l’idée de cette crise dans les universités africaines, on propose de considérer la création, l’innovation dans toutes les disciplines, soient-elles techno-industrielles, comme des perspectives pragmatiques pour replacer l’université corrélativement aux besoins du marché professionnel en vue du bien-être de tous.
Mots clés : Développement, Economies, Formation, Politiques, Société, Transformations, Universitaire.
Abstract:
This article deals in a non-integral way with the crisis situation in African universities. He is interested in the relationship between universities, teacher-researchers and the structured development of countries. The fundamental idea is to ask whether today in Africa, as opposed to Antiquity, universities, and therefore the university, still really participate in the multifaceted development of societies. By identifying the current orientations and difficulties that translate the idea of this crisis in African universities, we propose to consider creation, innovation in all disciplines, be they techno-industrial, as pragmatic perspectives to replace the university correlatively with the needs of the professional market with a view to the well-being of all.
Keywords : Development, Economies, Politics, Societies, Training-Transformations, University.
Introduction
Plusieurs études montrent que dans un tel environnement de l’évolution des technologies et des communications ainsi que de mondialisation du commerce et des marchés de l’emploi « l’éducation et plus particulièrement l’enseignement supérieur, est un vecteur majeur de croissance et de compétitivité des économies ». Face à ce constat sérieux, indiscutable, que faire pour changer la réalité de l’université comme institution devant favoriser l’accès et la réussite du plus grand nombre ? Cette dernière assertion quant à l’impact possible de l’éducation nous amène à la question suivante : quelle université le pays a-t-il besoin pour faire face à une demande de plus en plus grande et pour freiner l’exode des étudiants vers les pays voisins. (P. TOUSSAINT, 2013, p. 36.)
« La crise de l’Université française est aujourd’hui patente pour toutes les parties concernées ». (F. Vatin et A. Vernet, 2009, p. 47) Cette affirmation qui indique que les crises concernent aussi l’éducation et la formation au niveau de l’enseignement supérieur, n’est pas d’un africain mais plutôt de François Vatin et Antoine Vernet. Ceux-ci examinent de façon multiforme, les dysfonctionnements manifestes des universités de la France, leur patrie.
La crise, fondée sur des causes internes ou externes, est une situation de perturbations et dérèglements touchant une société et un secteur de la société ou un organisme. Dire que l’université en Afrique est en crise, amène à penser qu’elle connaît des difficultés. Pour en parler, on peut considérer par exemple, son fonctionnement, le désengagement de l’État, le financement ou autofinancement, les relations entre politique et université, la qualité des infrastructures et l’augmentation du nombre d’étudiants, les conditions de travail des membres de l’université et l’inefficacité sociale des activités professionnelles de l’institution à répondre aux besoins réels des sociétés ou ses objectifs relativement au développement des territoires.
Conformément à la société, l’université représente habituellement un enjeu social en ce qu’elle favorise l’essor humain, économique, social et culturel des États. Elle démontre cette importance pour la société par l’ensemble des activités de recherche et d’innovation touchant toutes les disciplines. « Dans les sociétés dites avancées, l’université joue un rôle de promotion de la culture, du savoir au sens large, mais aussi de moteur de développement sur tous les plans ». (P. Toussaint, 2013, p. 35) Mais l’université en Afrique semble être un lieu où les individus sont condamnés par l’observation marxienne, c’est-à-dire qu’ils se contentent avec leur science d’interpréter le monde. Or, l’important c’est de le transformer, d’impacter favorablement les conditions politiques et socio-économiques de la société. En agissant matériellement sur la société, l’universitaire africain repositionne l’université dans l’intérêt qui est le sien. L’écart possible actuel entre activités d’enseignement, de recherche et besoins réels de la société serait-il symptomatique de sa crise ?
Ainsi, réfléchir sur Universités, enseignants-chercheurs : objectifs et implications socio-politiques en Afrique donne à penser les missions et responsabilités de l’université et ses membres au regard de la société. Ce qui revient d’abord, sans prétention à l’exhaustivité et en s’appuyant sur l’exemple gabonais, d’identifier et analyser les réalités propres aux universités d’Afrique. Celles-ci sont-elles explicatives des possibles crises pour comprendre en quoi l’épanouissement des Etats en Afrique semble se soustraire des activités de l’enseignement et de la recherche ? Il ne faut cependant pas se satisfaire d’un constat qui esquiverait le dépassement de cette situation de dérèglement ; ce qui serait d’ailleurs stérile, puisque l’intérêt fondamental est d’indiquer comment dynamiser de façon nouvelle, le système des universités africaines en fonction des besoins des sociétés et de leur épanouissement.
Ne fonctionnent pas fermées sur elles-mêmes, les universités font spécialement partie du développement culturel, économique et social. La question est alors comment repenser la relation université, universitaire et devenir de la société en Afrique. L’absence d’impacts de l’université dans la société serait-elle relative à l’enseignant-chercheur ? Quels politiques et usages, l’universitaire africain doit-il déterminer de son institution pour favoriser le mieux-être de tous ? Il s’agira dans ce qui suit, d’initialement présenter l’université dans ce qu’elle a autrefois été et son rôle dans l’émancipation des sociétés, sa crise corrélativement au vécu et portée actuels et ensuite déterminer son renouveau pour un développement multiforme des sociétés africaines.
1. L’université en Afrique : Une histoire avec des histoires
1.1. Une existence toujours théorique et pratique ?
Il paraît au regard de l’histoire que l’existence des universités en Afrique ne date pas d’aujourd’hui. Elles ont dans l’ensemble, plus d’un demi-siècle d’existence dont les plus anciennes sont celles dites islamiques d’Afrique occidentale, auxquelles s’ajoute au XIIè siècle l’Université Sankolé à Tombouctou (Mali). Les premières et anciennes universités non islamiques d’Afrique créées respectivement en 1826, 1829 et 1841 sont : Collège de Fourah Bay (Sierra Leone), South African College au Cap devenu plus tard université du Cap (Afrique du Sud), Institut de Loverdale réservé aux Noirs (Afrique du Sud, au moment de l’Apartheid). Mais la plus ancienne université du monde est identifiée sur le continent africain, notamment au Maroc.
Quoique son ancienneté ne fasse pas l’unanimité, elle demeure incontestablement la plus vieille d’Afrique. Connue sous le nom d’Al-Qarawiyyin et reconnue comme la plus ancienne université du monde par le Livre Guinness des records, l’UNESCO et plusieurs historiens, cette université a été fondée en 859 après Jésus-Christ, par une jeune princesse de Tunisie, Fatima al-Fihri. Cette référence scientifique historique montre pourquoi l’Afrique fut considérée dans l’Antiquité comme un espace florissant de sciences et techniques, un fleuron de développement économique et social. Ainsi,
pendant les quatrièmes et troisièmes millénaires avant J.-C., on assista à une série de développements technologiques d’une extraordinaire importance dans la vallée du Nil (…). On peut apprécier l’habileté des tisserands de l’Egypte ancienne à partir des vestiges de leur travail qui ont été conservés. (G. E. R. Lloyd, 1974, p. 12).
Dans le Timée, Platon indique pour sa part que les Grecs anciens avaient un profond respect des gens du Nil en Egypte. Car ils disposaient à divers niveaux d’une connaissance scientifique tellement remarquable que même Solon, considéré comme le plus sage de toute l’Antiquité grecque, fut fort étonné de leurs valeurs intrinsèques. En interrogeant les prêtres sur certaines choses, Platon (2008, 22a-b) écrit : Soloncomprit que « ni lui ni aucun autre Grec ne savait pour ainsi dire presque rien». Mais la science des prêtres n’était pas un savoir exclusivement théorique, elle était également pratique et appliquée au devenir concret de la société égyptienne. C’est elle qui en déterminait l’organisation esthétisante et concourait aux nécessités et besoins pratiques de la vie quotidienne des hommes du Nil. Cette science pratique voire pragmatique Platon (2008, 22a-b-c) en souligne l’utilité depuis des connaissances élevées touchant les choses divines jusqu’aux considérations les plus immédiates concernant par exemple, le judiciaire ou la santé.
Clairement, le développement d’une activité scientifique et technique en Egypte s’attachait au monde de la vie, participait à l’émancipation de l’agriculture. En effet, au sujet de l’agriculture, les égyptiens, grâce aux connaissances touchant les techniques d’irrigation, savaient tirer profit du Nil : « Nous, c’est le Nil, notre sauveur » rapporte Platon (2008, 22d). Le Nil a pour fonctions de purifier la terre, la rendre fertile que prospère. La prospérité africaine en général et égyptienne en particulier, n’est pas absente des écritures sacrées. Abraham et ses descendants y ont séjourné et bénéficié des grâces d’une science dont l’impact sur la société contribuait, à en faire dans l’Antiquité, un espace diversement attractif. Reste à savoir si cette alliance entre savoir théorique et milieu de vie, université et développement de la société demeure actuelle en Afrique.
Soulignons que la récupération et réappropriation par l’Occident de l’idée de la formation universitaire des individus qui était en vogue en Afrique, n’a pas consisté à en faire un outil pour orner les temples et plébisciter les valeurs intrinsèques de quelques érudits. Bien au contraire, l’érudition a été mise au service du devenir puissant des sociétés. Et leurs universités sont jusqu’à maintenant, des véritables laboratoires qui participent à leur éclosion ainsi qu’au renversement des rapports de forces. Par la science, l’Occident s’est proposé depuis des siècles de maîtriser la nature et le monde. Aujourd’hui, il illumine et attire par la qualité de ses universités dont les formations sont en effet orientées vers l’utilité pratique. Ainsi, au lieu de ces « philosophies » spéculatives qu’« on enseigne dans les écoles » et universités africaines dont on a du mal à voir les implications matérielles pour l’épanouissement des sociétés, la science occidentale est résolument faite pour répondre aux besoins de la vie.
Elle est, selon un de leurs maîtres à penser R. Descartes (2008, p. 168), un ensemble « des connaissances qui soient fort utiles à la vie » au moyen desquelles,
connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. (Idem., p. 168).
Or, les performances des universités africaines au regard de la société sont peu appréciées. Non pas qu’il n’y ait pas des hommes formés ou que les citoyens n’aient pas suffisamment de culture pour en juger, mais que la production des savoirs ne montre pas concrètement leur nécessité et réussite matérielle pour la transformation multisectorielle des villes et territoires. L’université africaine aujourd’hui, n’est réellement pas encore ce qu’elle devrait être. L’Université, on a toujours du mal à se l’approprier et réapproprier pour la transformation concrète des Etats. Le mot ‘‘université’’ convient à nos institutions supérieures pour une respectabilité apparemment voisine des universités occidentales. Celles-ci, réputées pour leur sérieux en matière de gouvernance, gestion qu’en celle de formation avec des structures sans cesse revisitées et réadaptées aux réalités du temps, montrent des écarts qualitatifs avec les universités d’Afrique.
C’est ici le cas du Gabon où en effet, ses universités, à cause des situations vécues et les réalités structurelles semblent n’avoir d’existence que théorique, car les réalités et critères qui font qu’elles soient dignes de cette appellation ne sont pas remplis et leur performance au regard de la société reste encore à prouver. Peut-être à la renommée qu’elles se sont faites, nombreuses sont les expressions moins sympathiques utilisées pour les nommer : « grand portail », « grand village », « grande poubelle » et bien d’autres. Certainement, cela traduit un sentiment de désapprobation de ce qu’on en a fait par rapport à ce qu’elles devraient être quant aux attentes sociales multiformes.
La contribution actuelle des universités africaines ne permet pas des louanges, elle est tellement faible voire inexistante pour le rayonnement scientifique et technique du continent. Même les quelques savants dont dispose l’Afrique sont souvent ignorés et méprisés pendant qu’elles font la fierté des universités, grandes firmes ou entreprises occidentales qui les tiennent en honneur à la reconnaissance de leur apport social et économique. En Afrique, l’Enseignant-Chercheur est victime de railleries et de mépris, son métier par opposition à ceux qui s’adonnent à la politique n’inspire pas. C’est le cas dans les pays francophones, notamment le Gabon, ou encore de la Côte-d’Ivoire où les docteurs incendient leur thèse parce que la société leur rend l’image d’être inutiles, d’avoir réalisé un parcours pour finalement ne servir à rien. Pour faire court, la crise de l’université en Afrique procède des politiques mises en place pour déterminer l’importance de l’Enseignant-Chercheur et ses enjeux relativement à la société. Or,
définir le rôle de l’université dans un pays (….), c’est faire le pari du bien commun. Car dans le contexte actuel (…), l’université doit jouer un rôle de réflexion, mais doit aussi proposer des modèles pour un développement durable sur les plans social, culturel et économique. (P. Toussaint, 2013, p. 36).
Cette perspective semble réduire la crise de l’université africaine aux causes extérieures ; mais il y a en effet des aspects internes propres à l’institution qui y participent.
1.2. Des difficultés d’existence et de fonctionnement intra-muros
Les universités africaines, notamment celles dites subsahariennes, connaissent dans leur fonctionnement structurel qu’organisationnel, des réalités qui indiquent qu’elles ne sont pas des lieux de formation qualitativement établis. Interrogeant leur performance, on constate qu’elles sont confrontées aux difficultés variées, en l’occurrence les crises, les structures d’accueil, contraintes d’accès à l’internet, les limites au niveau de leur gouvernance et gestion, des financements toujours problématiques et des acteurs peu enthousiastes entrainant la fuite des compétences. En fait, « la crise multiforme que connaît l’université africaine et qui concerne à la fois la pertinence, la qualité, la gestion et le financement de l’enseignement supérieur a engendré (…) la dégradation des infrastructures et du milieu d’apprentissage ». (B. Makosso, 2006, p. 69).
Des grèves à répétition des étudiants, enseignants et autres personnels « témoignent de la nature du rapport entre les acteurs de l’Enseignement Supérieur et le système qu’ils doivent servir » qui en fait les ignore. (Papa Gueye, 2005, p. 24). De là rien ne s’obtient sans lutte. Universités et grandes écoles deviennent des espaces où se développent des violences pour réclamer les meilleures conditions d’être et de travail, obtenir ce qui leur revient de droit notamment les vacations pour ne citer que ça pour le cas du Gabon. Des violences physiques sont manifestées par les confrontations constantes avec les forces de l’ordre qu’on y mêle toujours. Les violences de type psychologiques se caractérisent au plan des conséquences par des sentiments de désintérêt à l’exercice du métier qu’ils ont librement choisi. Les systèmes d’enseignement supérieur d’Afrique se sont construits et se construisent « dans la violence politique, symbolique, morale, universitaire et policière. » (G. Moussavou, 2022, cf. postface).
Des liens parfois faits de compromissions entre l’État, la politique et les autorités de l’université sont souvent responsables de cet état des faits, qui se solde quelquefois par l’incarcération arbitraire des leaders syndicaux de l’enseignement et de la recherche, lesquels pourtant posent des problèmes légitimes. En fait, l’espace public africain et particulièrement celui du Gabon,
reste marqué par la domination totale et hégémonique du pouvoir en place, par la répression systématique et systémique de ceux qui osent revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail ou contredire cette domination dont la caractéristique essentielle est l’exercice de la violence légitime et symbolique. (G. Moussavou, 2022, p. 99).
Cela indique la place malheureuse de l’université et de l’universitaire dans certains États africains, et fait aussi en conséquence, que l’université ne soit plus « jamais le lieu de production de la connaissance et de modèles culturels nouveaux », puisqu’elle devient un espace de violence de tout genre. (F. Dumont, 1974, p. 176). Des discours méprisant l’université et effritant sa renommée et son importance dans la société confirment ainsi sa position désuète. Des sentiments d’émulation et des vocations disparaissent au vu des conditions de vie de l’universitaire. La majorité des étudiants ne désirent pas devenir enseignants ou chercheurs par opposition à leur engagement dans les milieux politiques. Prendre un jour, le relais en vue de poursuivre les ambitions de cette institution en redéfinissant toujours sa place et ses enjeux dans la société, n’est pas leur première ambition. Là, on « constate la dégradation des objectifs de l’enseignement universitaire à un point tel que la relation professeur-étudiant sur laquelle l’université est centrée s’en trouve déformée et paralysée », si bien que, « la crise de l’Université (…) prend toute sa signification. » (A. Turmel, 1982, p. 5-6. ; F. Dumont, 1974, p. 176).
Les structures d’accueil ainsi que le niveau d’organisation qui caractérisent les universités africaines, en dépit de la prétention de s’arrimer aux standards universitaires mondiaux, sont encore pour la plupart, embryonnaires. Certaines universités comme celles du Gabon ne permettent pas en conséquence aux étudiants d’être dans des conditions optimales. Touchant le Gabon, G. Moussavou (2022, p. 107) indique que « les structures d’accueil et de travail dans l’ensemble des établissements d’enseignement et de recherche, demeurent tout aussi statiques, contrairement à la massification étudiante et à la croissance des effectifs de ces professionnels. » Aux structures en inadéquation avec l’augmentation du nombre toujours croissant des bacheliers et autres professionnels désirant approfondir leur niveau de formation, s’ajoute l’absence des bibliothèques physiques ou numériques capables de favoriser l’accès à l’information scientifique.
Les quelques bibliothèques existantes sont au Gabon de façon large décevantes. En matière de la documentation rien n’est actualisé. Ainsi, on s’efforce de former et éduquer la future élite du pays dans un chaos déjà identifié dans la crise étendue de l’enseignement et de la formation en général. Pourtant, à l’université, les bibliothèques sont des espaces nécessaires pour animer, apprendre et approfondir des connaissances, ceux où en effet on se laisse également emporter et convaincre par la motivation des autres qu’on y trouve.
Dans les universités, les bureaux ou espaces de travail pour les universitaires sont pour la majorité, inexistants ainsi que le souligne G. Moussavou (2022, p. 107) en ces mots : « Les conditions de vie et de travail des chercheurs et enseignants-chercheurs sont extrêmement difficiles ». C’est pourquoi, les universitaires ne sont pas en permanence présents sur les lieux de travail, au risque d’inutilement errer et vagabonder. Leur présence est souvent relative à une activité professionnelle ponctuelle. Le cadre professionnel de travail préféré, c’est le domicile privé où, bien que mal, on a pu aménager un espace servant de bureau. L’accès à l’internet, mieux aux nouvelles techniques de l’information et de la communication (NTIC) est inexistant pour l’ensemble des acteurs de l’institution. D’où l’impossibilité de formation à distance, audiovisuelle et assistée par ordinateur alors que les technologies nouvelles sont aussi des puissants moyens qui contribuent à améliorer et intensifier la qualité de l’éducation et le développement de l’université.
Concernant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, des milieux de l’enseignement supérieur n’en disposent pas pour permettre aux universitaires, étudiants et l’administration de se connecter et travailler. Ce qui peut parfois expliquer la difficulté pour l’université, de pouvoir fonctionner normalement et efficacement dans la communication, le traitement et l’impression des actes administratifs.
Pendant la crise sanitaire de la Covid-19, malgré les discours officiels sur l’enseignement à distance, nombreuses sont les universités qui n’ont pas pu normalement fonctionner pour absence de NTIC. Dans les milieux universitaires « la science et la haute technologie ne sont plus (…) neutres, car leur progrès produit des effets aussi (…) bienfaisants » comme participer à l’essor de l’université (A. Borroro Cabal, 1995, p. 107). Elles doivent « être accessibles à toute la population en tant que nouvel élément culturel et faire partie du registre pédagogique et préparatoire des universités » (Idem, p. 109). Cependant, l’université et la société dans son ensemble doivent avoir conscience de la complexité des sciences et des technologies nouvelles pour toujours estimer les incidences parfois morales qui les accompagnent.
Aussi en Afrique les universitaires demeurent-ils un problème pour l’université. Ils sont parfois responsables des difficultés internes qu’elle connaît. Souvent, lorsqu’un universitaire accède aux postes de responsabilité dans l’administration centrale du pays, la tendance générale est pour s’assurer peut-être de la longévité et ainsi toujours bénéficier des avantages multiformes, de promouvoir des décisions impopulaires contre sa propre institution d’origine. Il en va parfois de même avec certains collègues, qui portés à la tête de l’université établissent des modes d’administration et de gestion qui deviennent encore des rouleaux d’étranglement d’une institution qui a déjà du mal à fonctionner.
Quand les financements des projets en faveur de l’institution n’ont pas été exécutés, on assiste pour réaliser des travaux dans l’université, à la création des entreprises adjudicataires fictives dans l’unique but de capturer de façon intelligente les devises. Le financement des missions des universitaires s’il n’est pas ignoré ou quasi inexistant, se fait suivant l’alignement volontaire de l’individu aux caprices des autorités du moment. Par exemple pour le Gabon, J. Tonda (2022, p. 18)note que, «le seul but poursuivi par le système est la reproduction basée sur la captation aveugle et la redistribution raisonnée, parce que discriminante, de l’argent, le seul miroir du système d’enseignement supérieur et recherche scientifique au Gabon ». Mais aussi, être leader syndical dans l’enseignement supérieur signifie-t-il nécessairement l’être pour la droiture de l’institution et la défense des intérêts de la corporation ? Toutes choses qui freinent le développement progressif et constructif de l’université par les universitaires. Des situations de crise, au lieu d’être prévenues et évitées, sont au contraire provoquées pour qu’elles puissent participer à une certaine gestion non désintéressée.
Il n’est alors pas rare de parler de corruption dans l’enseignement supérieur comme dans les autres milieux institutionnels dont les universitaires n’hésitent pas pourtant à dénoncer les maux aux conséquences socio-économiques irréversibles. Ce phénomène est courant dans l’enseignement supérieur en général, et en particulier dans les milieux universitaires à l’image des autres secteurs de la société. Les examinant, P. Temple et G. Petrov (2004, p. 96) décrivent leur état en ces termes :
l’enseignement supérieur souffre du climat général de corruption, mais les processus de la corruption et l’impact de celle-ci sur ce secteur sont, nous semble-t-il, originaux et peu étudiés. (…) La corruption universitaire est une facette particulière d’une corruption systémique qui s’intègre dans une culture plus large de la corruption.
Le fonctionnement et le traitement de l’université et ses acteurs n’encouragent pas les cadres à demeurer sur le continent. Ils permettent au contraire, « l’exode continu des cerveaux », maintiennent « le déclin de la recherche et l’amplification des conflits entre étudiants, syndicats des personnels et l’administration de l’enseignement supérieur ». (B. Makosso, 2006, p. 69) G. Zue-Nguema (2010, p. 3) parle également, de la fuite des cerveaux et des capitaux ; une fuite qui ne se fait pas hors du temps et de l’espace. Elle s’opère dans ce même monde vers des lieux mieux organisés et plus favorables à l’épanouissement humain, plus propices à l’universitaire qu’au devenir de la société.
2. Université, universitaires et développement multiforme des sociétés
2.1. Universitaires : des acteurs pour la transformation sociale
L’absence d’une politique significative en faveur de l’université dans plusieurs pays africains, à l’exemple du Gabon, montre que l’on n’a pas jusqu’à présent compris son rôle et importance. Si des textes et des décrets portant création, organisation et détermination de ses missions existent, il reste cependant, une application pratique active. Corroborer l’expérience les orientations théoriques de l’université montrerait en quoi cette institution est nécessaire à l’essor d’un pays. La mission de l’université à travers l’Enseignant-Chercheur, n’est pas que théorique au sens de promouvoir l’essor intellectuel des hommes et des femmes, mais également de rendre la formation utile, car les individus formés sont essentiels pour promouvoir et participer à la transformation concrète des sociétés.
L’université n’est pas faite pour une érudition sans incidences politique, sociale et économique. Incidences qui ne doivent pas seulement consister qu’à occuper personnellement des postes de responsabilité dans l’administration, mais surtout à impulser le développement du pays à travers divers domaines, notamment l’entreprenariat, entrainer l’émancipation des secteurs souvent oubliés comme ceux du tertiaire. C’est une institution importante qui permet de mobiliser des ressources intellectuelles en faveur de la transformation significative du territoire. En cela, pour P. Toussaint (2013, p. 35), tout pays «a besoin de cette institution pour se remettre à réfléchir et à agir collectivement en vue de favoriser d’abord le développement humain et ensuite le développement économique, social et culturel» pour le bien-être intégral des communautés politiques.
C’est en considérant ainsi, l’université que les sociétés développées connaissent des transformations évidentes à tous les niveaux. Pour un tel objectif de développement efficace, on a besoin des universitaires compétents conscients de leurs missions et rôles dans le devenir des sociétés. Membres des sociétés qui espèrent en eux, leurs différentes recherches et innovations ne doivent pas être déconnectées de la vie sociale. La connexion vivante entre pouvoir créateur des universités et la société, est historique. Cela, parce que les activités professionnelles des universitaires « ont toujours été partie prenante du milieu dans lequel elles se sont implantées » (Y. Gingras et L. Roy, 2006, p. VIII).
Les universitaires agissent directement dans les milieux sociaux par « des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, tant à contenter les curieux, qu’à faciliter tous les arts et diminuer le travail des hommes » (R. Descartes, 2008, p. 128-129). Avec une science pratique et des recherches utiles, ils font des inventions techniques et industrielles primordiales qui répondent aux nécessités pratiques des hommes. Mais aussi, indirectement au travers des productions intellectuelles qui aident à déterminer des orientations relatives aux préoccupations sociales qu’à performer l’Etat dans ses décisions pour l’émancipation efficace de tous. Dans ce sens, l’utilité de l’universitaire est évidente sous l’angle par exemple, des sciences économiques, politiques, de l’éducation ou de la psychologie au sens large. Cependant, ce pragmatisme ne signifie pas réduire essentiellement la recherche spéculative à l’utilité pratique, car elle consiste dans sa nature fondamentale en la poursuite de l’universalité au sens où, elle « est complètement tournée vers la recherche de la vérité, en dehors de toute autre considération, notamment sociale ou politique ». (A. Turmel, 1982, p. 22.)
Seulement la crise de l’université n’est-elle pas en Afrique correspondante aux écarts entre théories et réalisations matérielles, spéculations intellectuelles et implémentation de la vie concrète ? Cet écart, s’il y en a en effet, ne fonde-t-il pas le désintérêt à l’égard de l’université et son inutilité souvent prononcée ? Cette crise n’est-elle pas également due au rapport entre politiques et cette haute institution porteuse des grandes valeurs humaines et sociales ? Au travers de l’université, les universitaires permettent aux États de disposer des citoyens formés aux valeurs nobles de l’effort, de l’abnégation dans le travail bien fait en vue de la prise en charge cohérente de l’essor des territoires nationaux. Former, c’est donner des capacités opératoires pour agir et transformer son environnement. Pour reprendre A. Turmel (Idem, p. 22),
le travail universitaire produit (et reproduit) un ensemble de biens de diverses natures (…) comme (…), des agents sociaux dotés d’une formation spécifique et aptes à occuper des postes précis dans la division du travail, enfin des biens symboliques comme une formule mathématique inédite, des textes – articles, livres, conférences -, une formalisation plus poussée en biologie moléculaire ou une réorganisation conceptuelle en théorie.
De là, l’université est « l’institution qui accueille en son sein des hommes, des femmes qui fondent la société pour un mieux-être de tous ». Elle « vise à former une citoyenne, un citoyen responsable et qui a à cœur le bien-être collectif de son pays » (P. Toussaint, 2013, p. 35). En assumant l’épanouissement multiforme des sociétés, les universités ne sont donc pas des institutions superficielles. Curbatov Oleg (2012, p. 81), en examinant le rôle des universitaires dans la coopération avec les entreprises, affirme que les universités sont des puissants diffuseurs de connaissances et de compétences, participent en complémentarité aux innovations dans des domaines variés, accompagnent la croissance des entreprises et donnent en conséquence, la possibilité à la création d’emplois ; d’où, la nécessité pour les universités africaines d’« évoluer si elles veulent pouvoir exprimer tout leur potentiel » afin de toujours répondre aux objectifs communautaires.
Si les universités occidentales offrent des formations qualitativement diversifiées et que les universités africaines doivent se mondialiser et répondre aussi aux besoins humains, il devient impératif de rendre celles-ci modernes et capables de montrer leur intelligence et utilité. Il faut pour cela, ouvrir aussi un intérêt aux formations concrètes au travers desquelles les pays peuvent atteindre, au moyen des cadres bien formés, un essor économique et social important, car « dans le contexte actuel d’une économie mondialisée fondée sur l’information et le savoir, les pays peuvent difficilement s’intégrer et entrer en compétition sans une main-d’œuvre suffisamment qualifiée » (P. Toussaint, 2013, p. 36).
2.2. Enseignant-Chercheur et l’approche pragmatique de l’université et de la formation en Afrique
La formation en lettres et sciences humaines a eu en Afrique un succès remarquable de sorte que l’université s’est présentée comme un espace limité à donner une connaissance littéraire. Ainsi, à la période des indépendances, on a vu alors, s’éclore une littérature abondante avec un nombre important d’écrivains autour des thématiques diverses. Cette littérature a servi à la compréhension de certains phénomènes sociaux, en l’occurrence les conflits de générations, le déracinement, la sensibilisation sur la nécessité de l’école, la dénonciation des rapports entre colonisateurs et colonisés.
Cette littérature a certes produit des philosophies, mais celles-ci n’ont pas été déterminantes pour l’essor scientifique, technique et industriel du continent. Elle a plus consisté à interpréter le vécu africain alors que la nécessité portait également sur l’action pratique et l’épanouissement matériel du continent, car la rationalité n’est pas qu’abstraction, elle doit pouvoir passer, pour reprendre en cela M. Merleau-Ponty (2008, p. 53), « du concept au cœur de la praxis interhumaine ». C’est-à-dire la déplacer vers les hommes dans une entreprise qui vise à transformer la nature, les rapports sociaux que leurs diverses conditions d’être et de vivre. Ceci pour dire, que l’activité rationnelle « n’est pas une illusion : elle est l’algèbre de l’histoire » (Ibidem, p. 53).
Mais même actuellement, dans les universités africaines, notamment celles du Gabon avec l’Université Omar Bongo, l’essentiel de la formation a toujours été théorique, c’est-à-dire qu’elle est restée axée sur des formations non spécialisées. Et cela, pendant près d’un demi-siècle d’existence comme si l’université n’était pas partie liée à l’essor concret de la société gabonaise. Les enseignements spécialisés, les formations professionnelles ne sont que d’apparition trop récente. Depuis dix ans seulement, à l’Université Omar Bongo dans quelques départements, on a créé des formations professionnelles et dans d’autres départements et à l’exemple de la philosophie, celles-ci sont en gestation. Or, ces formations remontent très loin dans le temps dans les universités occidentales qui, d’avance, avaient compris que les lettres ne suffisaient pas à l’université pour jouer pleinement son rôle dans le développement local.
Et pour l’essor multiforme efficace des sociétés, les États occidentaux ont projeté la création des études technologiques, industrielles et informatiques. Ceci pour répondre diversement aux besoins pratiques des entreprises, notamment celles du secteur tertiaire qui ne peuvent employer des personnes formées en lettres et sciences humaines. Bien plus, elles permettent au pays de disposer d’une main d’œuvre ciblée et qualifiée capable d’entreprendre et de soutenir l’État dans la création des sociétés nationales. Ainsi pourraient-elles œuvrer souverainement à la production et la transformation locale des matières premières, la construction des infrastructures publiques que privées. Ces études sont importantes pour « tenir à jour la formation des travailleurs et des cadres dans le contexte d’une rapide évolution scientifique et technologique » ou industrielle, aider à la maîtrise du secteur tertiaire qu’à propulser ainsi la croissance économique et sociale en mobilisant les ressources de tous les secteurs (G. W. Bertram, 1975, p. 176).
Au Gabon, en l’occurrence, à l’Université des Sciences de la Santé et l’Université Polytechnique de Masuku plus particulièrement, les formations professionnelles sont en général inexistantes. A. Masuku, si on note l’existence d’une école supérieure spécialisée, il n’en résulte pas une promotion des formations professionnelles suffisantes pour répondre aux innovations scientifiques, technologiques et industrielles. Ainsi, la majorité des bacheliers technologiques ne servent finalement pas, finissent par défaut dans des secteurs qui ne leur sont logiquement pas destinés. Car il n’existe pas des espaces universitaires pour les accueillir et les former. D’où, l’enseignement supérieur doit également s’ouvrir aux formations professionnelles pour satisfaire aux domaines divers nécessaires à l’épanouissement complet des sociétés africaines.
De ce qui précède, on peut dire que l’université est profondément sollicitée « par toutes les forces qui poussent à un changement d’ordre paradigmatique », pour dynamiser «les objectifs de croissance économique selon les principes de politique et des orientations d’action collective » (J.-M. Fontan, P. Freire Vieira, 2012, p. 14-15). Les universitaires sont des moteurs de développement de l’institution qu’ils incarnent, organisent et représentent, bien plus, « constituent « le centre opérationnel » de l’organisation et du fonctionnement » des institutions de l’enseignement supérieur auxquelles ils donnent corps, vie et sens corrélativement aux besoins de la société (G. Moussavou, 2022, p. 195). C’est pourquoi, l’université en Afrique, doit devenir « un producteur important de nouveautés résultant à la fois de la recherche et de l’activité innovatrice qu’elle développe ». Et au regard de la société et du bien-être de tous, c’est une institution à valeur sociale « soumise aux mêmes règles de production et de commercialisation » que toute autre entreprise (D. Zait, 2012, p. 37). «Sa mission de formation reste importante mais doit se plier aux exigences de la concurrence du marché en développant des structures, des mécanismes et des dispositifs appropriés de recherche et d’innovation » (Ibidem., p. 37).
L’université africaine doit se réorganiser, créer et innover en signant des partenariats avec le monde professionnel pour des recherches spécifiquement orientées afin de répondre efficacement aux besoins du marché. Elle doit les identifier, analyser et faire agir le monde de la recherche pour rendre disponibles des compétences et des services ; lesquels non seulement vont satisfaire à des demandes ciblées, mais aussi et surtout favoriser le développement social, économique et politique de la société. L’université doit s’adapter et s’approprier les réalités du marché pour former non pas quantitativement dans tous les domaines, mais qualitativement en fonction des milieux professionnels. L’innovation dans la formation doit donc « être toujours considérée par rapport à la destination des produits, par rapport au marché ». Elle est comme toute « activité de l’entreprise orientée vers la création, la réalisation, l’amélioration ou le développement des nouveaux produits ou services destinés à la couverture d’une demande du marché » (Idem., p. 37).
De cette manière, l’accent n’est plus spécifiquement mis que sur les seules sciences technologiques, industrielles et informatiques, mais prend intégralement en compte les capacités du monde, la recherche en les croisant avec les besoins réels des sociétés. Par exemple, l’établissement des actes d’Etat civil dans les mairies ne doit pas être l’œuvre du premier venu, de celui-là qui a une connexion quelconque avec une personnalité politique, mais réservé aux personnes formées connaissant l’enjeu juridique d’un tel document administratif. Les fonctionnaires dans l’aménagement et le développement du territoire ou l’esthétique urbaine sont ailleurs des citoyens formés uniquement en regard de cette tâche professionnelle. Autrement dit, les universités africaines doivent disposer des offres de formation en interaction avec l’environnement pour accueillir et mettre à disposition des institutions administratives et les entreprises, un personnel capable d’agir et d’apporter des avantages compétitifs essentiels.
Ces considérations peuvent s’étendre au domaine de l’agronomie en vue d’une agriculture prospère et de l’autosuffisance alimentaire. A défaut d’avoir dans les universités des formations spécialisées dans le domaine de l’agriculture, en l’occurrence en faculté de géographie, il est nécessaire pour tout pays africain, d’avoir une école pour former des hommes et des femmes capables, à leur tour, d’étendre leurs acquis et savoir-faire à d’autres. Et le Gabon où la terre est singulièrement fertile devrait y penser. Evoquons le cas des mines : la création et la mise en pratique récente au Gabon d’une école supérieure à Moanda est une vision cohérente avec les nécessités pratiques d’un pays qui souffrait depuis les indépendances des cadres supérieurs dans ce domaine.
La pandémie de Covid-19 aurait été pour l’université en Afrique l’occasion de jouer son rôle face aux enjeux sociaux et ainsi favoriser à l’international l’essor économique par la création des vaccins. Pour cela, il faut des hommes hautement formés capables d’inventer et soutenir le développement du continent même en temps de crise. Ainsi, selon (A. Borroro Cabal, 1995, p. 214), « se sachant au service du public et ayant conscience de leurs rôles spéciaux, de leurs missions et de leurs fonctions, les universités » ont, outre, la mission d’approfondir et de vulgariser des connaissances, celles de créer et développer la recherche scientifique relativement aux besoins réels de l’État, de permettre dans leur intégration globale à la société, l’innovation et l’invention dans tous les domaines. L’Afrique veut d’une « université de qualité, qui ne se contente pas de décerner des titres souvent vides de contenu», mais « vigilante, capable de voir au-delà du présent, vouée à la critique objective et à la quête de nouvelles voies vers un avenir meilleur », en « luttant contre les déséquilibres économiques et sociaux inacceptables et les excès de la société de consommation, œuvrant en somme pour la liberté, la dignité et la démocratie » (M. Antonio Rodriguez, 1995, p. XXII).
Conclusion
La situation essentielle de crise de l’université en Afrique convoque des facteurs multiformes. Cette crise est d’abord inhérente à sa séparation d’avec ce qu’elle a été dans l’Antiquité, c’est-à-dire un lieu important d’acquisition des savoirs pour utilement agir, transformer et développer les environnements sociaux. La formation universitaire a entrainé l’éclosion de certaines sociétés occidentales, en l’occurrence grecque qui est historiquement identifiée comme un haut lieu du savoir, notamment la philosophie. En Afrique, à l’exception des crises internes à l’institution universitaire, la prédominance des enseignements théoriques indique dans l’ensemble, l’augmentation quantitative du nombre d’enseignants-chercheurs, des cadres pour l’essentiel sorti des universités sans formation spécialisée qui, cependant, exercent directement dans l’administration et les directions des entreprises.
Si la formation quantitative des cadres n’est pas en adéquation avec les réalités professionnelles, cela fait entorse au déploiement compétitif des sociétés. C’est pourquoi en Afrique, corrélativement aux nécessités d’épanouissement de la société, le « développement de l’enseignement supérieur, la recherche devrait tendre à combler les écarts entre politiques et pratiques et à améliorer l’efficacité des établissements d’enseignement supérieur dans l’accomplissement de leurs missions et objectifs », car l’université ne fonctionne pas en vase clos, mais œuvre en interaction féconde et bienveillante avec le milieu social. (A. Borroro Cabal, 1995, p. 192).
Selon A. Borroro Cabal (1995, p. 192), c’est suivant cette interaction que s’affirment et s’affinent les objectifs inhérents aux « liens entre la recherche, fondamentale et appliquée, et formulation de politiques aux niveaux gouvernemental et institutionnel ; formation des étudiants des 1er, 2e et 3e cycles universitaires en ayant à l’esprit la conjonction de la recherche et de l’enseignement » avec les besoins réels de l’État et des entreprises afin de garantir dynamiquement la croissance économique et l’émancipation sociale. (Ibidem., p. 192). L’enseignement supérieur et la recherche ne sont pas que pour répondre aux besoins de l’État, de la société, mais c’est en faveur de la performance de l’institution pour ainsi dire des universitaires qui doivent créer et innover pour montrer le rôle essentiel de l’université.
Les formations diplômantes seules ne suffisent pas pour le développement des sociétés, il convient également de prendre en compte des formations spécialisées, valoriser aussi certains secteurs souvent oubliés à tort ou à raison comme les études technologiques, industrielles, informatiques ou celles des sciences de gestion pour implémenter efficacement le devenir de la société. Bref, il faut aujourd’hui, pour résoudre la crise de l’université en Afrique, prendre conscience que,
l’enseignement supérieur est devenu un élément moteur de l’organisation de la société moderne. (…) Plus le développement socio-économique est tributaire du savoir et doit s’appuyer sur des personnels et des cadres hautement qualifiés, plus l’enseignement supérieur joue un rôle de premier plan dans tout programme de développement et d’organisation sociétale. (…), le nouveau contexte de concurrence économique et technologique à l’échelle régionale et mondiale crée des attentes au niveau de la recherche et réclame des services plus adaptés aux réalités d’aujourd’hui. Cette prise de conscience survient à une époque où l’enseignement du niveau tertiaire traverse une crise dans le monde entier. À la suite de la transformation de leur système politique et économique, plusieurs pays d’Europe de l’Est ont résolu, par exemple, d’adapter l’enseignement supérieur à leurs nouveaux besoins. (M. Antonio Rodriguez, 1995, p. IX.).
Références bibliographiques
ANTONIO RODRIGUES DIAS Marco, « Préface », L’Université aujourd’hui. Eléments de réflexion, Alfonso Borrero Cabal, Paris, Unesco, Coll. « Centre de recherches pour le développement international Ottawa ».
BERTRAM W. Gordon, 1975, « L’éducation et la croissance économique », École et société au Québec. Éléments pour une sociologie de l’éducation. Tome I, Textes choisis et présentés par Pierre W. Bélanger et Guy Rocher, Montréal, Hurtubise HMH.
BORRERO CABAL Alfonso, 1995, L’université aujourd’hui. Eléments de réflexion, Paris, Unesco, Coll. « Centre de recherches pour le développement international Ottawa ».
CURBATOV Oleg, 2012, « Quel est le rôle des universitaires et des universités dans la coopération avec les entreprises ? (à l’exemple de quatre scénarios de l’OCDE) », in Le rôle des universités et des universitaires dans l’économie de la connaissance, Valentin RAILEAN, Michel GAY et Oleg CURBATOV (Dir.), Paris, Chisinau.
DESCARTES René, 2008, « Discours de la méthode », in Œuvres complètes et Lettres, Paris, Gallimard.
DUMONT Fernand, 1974, Touraine, Alain, Université et société aux États-Unis, Paris, Seuil, 1972.
FONTAN Jean-Marc et FREIRE VIEIRA Paulo, 2012, « Pour une approche systémique, écologique et « territorisée » », in Le rôle de l’université dans le développement local. Expériences brésiliennes et québécoises, Gaëtan Tremblay et Paulo Freire Vieira (Dir.), Québec, Presses de l’Université du Québec, Coll. « Innovation sociale ».
Gingras Yves et Roy Lyse, 2006 (Dir.), Les transformations des universités du XVIIIe au XXIe siècle, Québec, Presses de l’Université du Québec, Coll. « Enseignement supérieur ».
Gueye Papa, 2005, L’Enseignement Supérieur en Afrique Subsaharienne : des pistes pour une réforme, Unesco-Bureau Régional de Dakar (BREDA).
LLOYD Geoffrey E. R., 1974, Les débuts de la science grecque de Thalès à Aristote, Paris, François Maspero.
Makosso Bethuel, 2006, « La crise de l’enseignement supérieur en Afrique francophone : une analyse pour les cas du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, et de la Côte d’Ivoire », JHEA/RESA Vol. 4, No 1.
MERLEAU-PONY Maurice, 2008, Eloge de la philosophie, Paris, Folio, essais.
Moussavou Georges, 2022, Pouvoir d’Etat, système d’enseignement supérieur et de recherche au Gabon. Sociologie historique de l’action publique, Paris, L’harmattan, Coll. « Etudes africaines ».
PLATON, 2008, « Timée », Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, Paris, Flammarion.
TEMPLE Paul, PETROV Georgy, 2004, « La corruption dans l’enseignement supérieur : enseignements tirés de la situation dans des États de l’ex-Union soviétique », Revue du programme sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, Paris, OCDE, Vol.16, n°1.
TONDA Joseph « Préface », Pouvoir d’Etat, système d’enseignement supérieur et de recherche au Gabon. Sociologie historique de l’action publique, Georges Moussavou, Paris, L’Harmattan, Coll. « Etudes africaines », 2022.
TOUSSAINT Pierre, 2013, « Quelle université pour Haïti dans la perspective de sa reconstruction ? », Cahier thématique– Enseignement supérieur et université, Haïti Perspectives, vol. 2 • no 1 • Printemps 2013.
Turmel André, 1982, « Universitaires et intellectuels », Recherches sociographiques, vol. 23, no 3, septembre-décembre 1982, Québec : Les Presses de l’Université Laval.
Vatin François et Vernet Antoine, 2009, « La crise de l’université française : une perspective historique et socio-démocratique », Revue du MAUSS, Paris, La Découverte, 2009/1 n° 33.
ZAIT Dumitru, 2012, « La création et le développement d’un comportement innovateur de l’organisation », Le rôle des universités et des universitaires dans l’économie de la connaissance, Valentin RAILEAN, Michel GAY et Oleg CURBATOV (Dir.), Paris, Chisinau.
ZUE-NGUEMA Gilbert, 2010, « « Fuite des cerveaux » comme « fuite des capitaux » ? », Annales de l’Université Omar Bongo, Numéro 15-2, Presses Universitaires du Gabon, décembre 2010.
LES UNIVERSITÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS AFRICAINES
Adjoua Marie Jeanne KONAN
Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’université est une institution publique d’enseignement et de recherche. Communément appelée « le Temple du savoir », cette institution forme les ressources humaines nécessaires au développement des États. Au regard de ses attributions, on peut arguer que l’université est le moteur de la dynamique sociale. De ce fait, son utilité et son importance devraient susciter un profond intérêt de la part des gouvernants. Or, tel n’est malheureusement pas le cas sous nos tropiques. La surpopulation estudiantine, la vétusté des infrastructures, l’insuffisance de budget de fonctionnement alloué aux universités, les difficiles conditions d’études et de vie des étudiants sont autant de marqueurs du malaise que vivent les acteurs de l’université. Au regard du visage que nous présentent les universités africaines, peut-on encore croire qu’elles peuvent participer au développement des sociétés? Notre réflexion tente non seulement d’examiner les maux dont souffrent nos universités, mais aussi de suggérer quelques pistes à suivre dans l’optique de les redynamiser et les rendre aptes à répondre, dans la mesure du possible, aux préoccupations sociétales du moment.
Mots clés : Développement, Dynamique sociale, État, Ressources humaines, Sociétés, Universités africaines.
Abstract:
The university is a public teaching and research institution. Commonly called “the Temple of knowledge”, this institution trains the human resources necessary for the development of States. In view of its attributions, it can be argued that the university is the engine of social dynamics. As a result, its usefulness and importance should arouse deep interest on the part of governments. However, this is unfortunately not the case in our tropics. Student overcrowding, dilapidated infrastructure, insufficient operating budget allocated to universities, difficult study and living conditions for students are all markers of the malaise experienced by university actors. In view of the face that African universities present to us, can we still believe that they can participate in the development of societies? Our reflection tries not only to examine the ills from which our universities suffer, but also to suggest some avenues to follow with a view to revitalizing them and making them able to respond, as far as possible, to the societal concerns of the moment.
Keywords : Development, Social Dynamics, State, Human Resources, Societies, African Universities.
Introduction
L’université se définit comme étant une institution publique indépendante d’enseignement et de recherche sans contraintes utilitaires. C’est une autorité administrative établie par l’État, chargée d’assurer la régulation de secteurs considérés comme fondamentaux à la société et pour lesquels le gouvernement entend intervenir indirectement. Cette institution s’apparente donc à une structure d’aide à l’État disposant d’un pouvoir spécifique à elle-même. Sous l’angle de lieu d’enseignement et de recherche, l’université est un cadre de formations des personnes et d’acquisitions de connaissances. Les enseignements universitaires élargissent, approfondissent et renforcent les acquis de l’apprenant de telle sorte que de ses rangs sont censés émerger les élites et penseurs des sociétés. Pour la bonne réalisation de cette mission, les institutions universitaires doivent bénéficier de budgets conséquents et de conditions de travail appropriées. Car contrairement aux secteurs secondaires, les enseignements supérieurs ont la tâche d’éveiller les consciences sur le fonctionnement et la gestion des sociétés par les gouvernements au regard des normes universelles. C’est ainsi que peuvent se faire de véritables questionnements des acquis et les éventuelles aspirations au changement.
En clair, l’université forme les individus à l’autoréflexion qui génère les connaissances appropriées pour l’intégration et la concrète participation au développement de la société. Cela revient à comprendre encore que l’institution universitaire est le creuset de production des forces vives de la société et des ressources humaines nécessaires à la vie et au développement de celle-ci. De cette façon, elle a une vocation de service à la communauté qui lui confère un rôle de catalyseur permettant aux acteurs et décideurs sociaux de s’orienter sur la voie du développement. C’est pourquoi, loin d’un simple lieu de formation et d’acquisition de connaissances, l’université constitue le laboratoire de mise en place de la dynamique sociale. En conséquence, elle devrait être l’organe central des programmes de développement des gouvernements ; et son utilité et son importance devraient susciter un profond intérêt chez les gouvernants.
Or, tel n’est malheureusement pas le cas. On a plutôt à faire à des universités dépassées : dépassées par l’évolution rapide des choses telles que les effectifs de la population estudiantines devenue pléthoriques, la modernisation des infrastructures et de la gestion des institutions. Nombreuses sont les universités mal gérées, aux structures vieilles et vétustes avec des budgets généralement très insuffisants. Les campus universitaires surpeuplés présentent des situations de promiscuité défavorables à de bonnes conditions d’études. Les infrastructures sont non seulement insuffisantes mais elles sont aussi inadéquates. Ce notable retard de modernisation est à l’origine de difficiles conditions de vie et de travail qui favorisent de réguliers mouvements de revendications. Partant, si les universités elles-mêmes sont si en retard, peuvent-elles vraiment participer au développement des sociétés ? La révision du rapport université-société n’apparaît-elle pas impérative ? Les États africains doivent-ils scruter de nouveaux horizons pour leur développement ?
Cet article a pour objectif de montrer que malgré les difficultés, les universités africaines prennent part au développement de leurs pays. Pour parvenir à cet objectif, la méthode sociohistorique nous paraît incontournable. Notre analyse s’effectue en deux parties. La première clarifie le rapport entre Université et Société. La seconde se penche sur les caractéristiques de l’université comme facteur d’émergence.
1. Université et société
La définition de l’université ci-haut permet de voir qu’elle trouve sa nécessité d’exister dans la volonté de la société. Elle est à l’origine un cadre de formation sans but utilitaire et lucratif selon E. Y. M. Zinsou (2009, p. 15) :
Au XVIIIè siècle, l’université en tant qu’institution voire organisation, a été créée en Europe sous la direction de l’église. C’était le lieu de rassemblement des maîtres et des disciples (Universitas Magistrorum Scholarium Parisium). Elle a été appelée à dessein, le temple du savoir où les étudiants venaient se cultiver et recevoir des savoirs à l’image de l’honnête homme ou des connaissances sans aucune finalité professionnelle.
L’université a donc été facultativement instituée en ses débuts sous la direction de l’église pour dispenser des enseignements aux personnes indépendamment de toute finalité utilitaire. Mais, elle représente maintenant une institution de service social, est attentive au maintien et au perfectionnement de la société. L’université est si intégrée aux utilités sociales que la plupart des pays œuvrent à les multiplier. Quelles sont alors les attributions d’une université aujourd’hui ?
1.1. Des attributions de l’université
Avec l’évolution des sociétés au cours des siècles et de leurs besoins concordants, la mission de l’université a changé. Elle demeure une institution des sociétés. Cependant, elle n’est plus un simple cadre d’enseignement et de recherches sans but utilitaire. Présentement, on constate que l’université doit assurer de nouvelles et nombreuses charges. C’est ce que E. Y. M. Zinsou (Ibidem, 2009 p. 16) dit en substance :
C’est à partir du XXè siècle que l’université devient un lieu à la fois central et critique où les problèmes inhérents au développement de la connaissance, comme pratique sociale, sont posés et analysés. En fait, ces universités n’étaient jamais isolées de leur société voire de leur collectivité, de leurs différents niveaux de fonctionnement. En d’autres termes, une université n’est jamais créée en dehors de la société.
Ces indications montrent que l’université évolue et se transforme au rythme des réalités sociales elles-mêmes. Elle fonctionne selon des objectifs déterminés par l’État puisqu’elle lui supplée dans certains secteurs d’activités suivant un programme structuré. De la même manière, les programmes d’enseignements et de formation de l’université sont inspirés de besoins de l’État. En clair, l’université fournit les ressources humaines à l’État pour l’entretien et le bon fonctionnement de la société. Se faisant, elle transmet les aspirations de l’État aux apprenants en formant le prototype de citoyens nécessaire à son fonctionnement. Dans ce sens, l’université implante la politique gouvernementale à tous les niveaux de la société, par ses forces vives et les éduque à produire des biens utiles à la société. S. Martineau et A. A. J. Buysse (2016, p. 11) indiquent que
Nos systèmes d’éducation, soumis entre autres à la pression d’une pensée utilitariste issue du néolibéralisme, sont plutôt obnubilés par le rendement et la vitesse (il faut terminer son parcours scolaire dans les temps). Ils contrôlent par ailleurs étroitement des contenus à apprendre. Ils ont aussi des visées autres que celles proposées par Rousseau (la beauté, la liberté), visées essentiellement tournées vers la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. C’est comme si l’idée fondamentale du « bon à révéler » avait été effacée au profit de la croyance en la possibilité de façonner l’enfant à l’image des besoins de la société de production.
Pour ces auteurs, le système éducatif actuel ne contribue pas à éclore les capacités naturelles des apprenants. Il leur impose des programmes de production matérielle inspirés par la concurrence sur le marché portant ainsi entrave à leur volonté et à leur liberté. Dans l’Émile ou de l’éducation, l’anthropologue de J.-J. Rousseau recommande la liberté comme le cadre de départ de toute perfectibilité. Il y décrie ces paradigmes éducatifs défavorables à la société, en ces mots : « Tout n’est que folie et contradiction dans les institutions humaines » (J.-J. Rousseau, 1969, p. 306).
S’opposant aux systèmes éducatifs utilitaristes en vigueur, J.-J. Rousseau pense à une éducation totalement innovante. Il l’annonce dans la préface de l’Émile ou de l’éducation :
Je parlerai peu de l’importance d’une bonne éducation ; je ne m’arrêterai pas non plus à prouver que celle qui est en usage est mauvaise ; mille autres l’ont fait avant moi, et je n’aime point à remplir un livre de choses que tout le monde sait. Je remarquerai seulement, que depuis des temps infinis il n’y a qu’un cri contre la pratique établie, sans que personne s’avise d’en proposer une de meilleure. La littérature et le savoir de notre siècle tendent beaucoup plus à détruire qu’à édifier (J.-J. Rousseau, 1969, p. 241).
La société pervertit le naturel en l’homme. Donc l’éducation, en tant que formation de la personnalité, doit servir à parfaire son essence humaine, lui inculquer une formation adossée à sa nature d’être libre afin d’éclore la liberté et le beau en lui, puis le préserver de toute forme de soumission. En effet, J.-J. Rousseau (1969, p. 309) pense que
Le seul qui fait sa volonté est celui qui n’a pas besoin, pour le faire, de mettre les bras d’un autre au bout des siens ; d’où il suit que le premier de tous les biens n’est pas l’autorité, mais la liberté. L’homme vraiment libre ne veut que ce qu’il peut, et fait ce qu’il lui plaît. Voilà ma maxime fondamentale. Il ne s’agit que de l’appliquer à l’enfance, et toutes les règles de l’éducation vont en découler.
L’université pourvoit la société en érudits et forces vives pour gérer rigoureusement les plans de développement social et garantit d’une certaine manière la sérénité des gouvernants. En d’autres termes, l’université a pour mission de soutenir et d’accompagner la politique de développement des États à partir de formations adaptées aux réalités internes en tenant compte des problèmes généraux externes liés aux besoins de la société. Cependant, les systèmes universitaires africains exercent-ils réellement cette mission ?
1.2. Les universités africaines dans la perspective du développement
Les universités africaines ne dérobent pas aux attributions originelles de toute université. Aussi, sont-elles constituées selon les critères universels des universités même si les réalités sociopolitique, économique et historique ne semblent pas faciliter leur fonctionnement. Dans les faits, le passé colonial des pays africains continue d’influencer presque toutes les institutions et d’interagir sur les réalisations. Le secteur de l’éducation fait partie de ces institutions profondément affectées par ce passé historique. Dans les actes du cinquantenaire de l’université du Congo-Kinshasa,L. De Saint-Moulin (2007, p. 31) soutient que
Au moment de leur création, la dépendance de l’extérieur, renforcée par le souci d’assurer aux diplômés la possibilité d’intégration dans le monde du travail européen, avait fait des universités congolaises des lieux de formation des cadres d’une société dominée par l’extérieur plutôt que de leaders préoccupés du progrès de la population.
Le rôle joué par les universités, pendant la période coloniale, a convaincu les colonies de leur importance. En effet, grâce aux universités, les métropoles disposaient sur place de diplômés pour leurs administrations coloniales et des relais. La métropole avait ainsi le contrôle. Aux indépendances, les jeunes États africains prirent à leur compte ces avantages de l’université. Ce constat à l’université du Congo-Kinshasa est semblable dans la plupart des universités de l’Afrique de l’ouest. Concernant la Côte d’ivoire, V. C. Diarrassouba (1979, p. 8-9) souligne que
À l’origine, l’enseignement et les diplômes de l’université d’Abidjan se situaient à l’intérieur du système français, conformément à l’accord de coopération franco-ivoirien de 1961. Cependant, même lorsqu’ils relevaient de ce régime qui leur conférait la pleine valeur juridique des diplômes délivrés par les universités françaises, ceux délivrés par notre université correspondaient à des enseignements plus ou moins adaptés à la fois à la réalité africaine et aux besoins ivoiriens.
L’accord de coopération franco-ivoirien, signé au lendemain de l’indépendance, garantit à la France la continuation du programme éducatif colonial existant. Au Congo-Kinshasa comme en Côte d’ivoire, l’accord de coopération a servi à l’adoption et à la reconduite des paradigmes éducatifs coloniaux, certainement pour rester à l’école des précurseurs de l’institution universitaire. Car, un modèle est nécessaire pour se tracer les voies de l’affranchissement des tutelles. Il s’agit pour ces pays de faire une conquête identitaire, de retourner à soi. La perte de certaines valeurs culturelles et la dilution de leur authenticité constituent le combat majeur des guides et meneurs sociaux. C’est vraisemblablement ce qu’entreprendront les intellectuels et les nationalistes kinshasarois selon L. De Saint-Moulin (2007, p. 31) :
Au lendemain de l’indépendance, outre le nationalisme, un courant laïcisant et un vif intérêt pour le marxisme se développèrent dans les milieux intellectuels congolais et particulièrement à l’Université Lovanium. (…) L’Union Générale des Étudiants Congolais voulait extirper de l’Université Lovanium les vestiges du colonialisme. Elle voulait éveiller chez les étudiants une conscience nationale élevée.
Les diverses transformations, l’effort de nationalisation et de changement d’idéologie, opérés au sein des universités après les indépendances, témoignent de cette volonté d’évoluer en se libérant définitivement des tutelles occidentales. La multiplication des universités depuis les indépendances et la création de nombreux instituts nationaux supérieurs spécialisés dénotent bien de l’importance que les pays africains accordent à l’université dans leur développement. V. C. Diarrassouba (1979, p. 38) révèle que « pour les responsables politiques du pays, notamment pour le chef de l’État, la promotion et la formation des hommes en Côte d’ivoire doivent être comprises à la fois comme moyen et comme fin du développement ».
2. De la gouvernance des universités africaines et la nécessité de redynamisation
Les pays africains ont très tôt compris l’importance de l’université dans le procès de développement des sociétés. Pour cela, les structures éducatives laissées par les métropoles ont été reprises et relancées avec quelques réajustements. Mais, cette conviction des débuts qui a entretenu le rêve du développement, semble essoufflée depuis belle lurette avec la détermination du départ. Les universités actuelles ont perdu de leur noblesse, de leur notoriété et de leur considération d’antan aussi bien auprès des acteurs universitaires (étudiants, enseignants et administrateurs) qu’auprès des populations. La gouvernance des universités et les sombres réalités des espaces universitaires alimentent les débats et invitent à une urgente redynamisation.
2.1. De la gouvernance actuelle des universités
Un demi-siècle après leur création, le parcours de la plupart des universités africaines montrent qu’elles partagent des réalités quotidiennes identiques. J. Ki-Zerbo (1975, p. 34) nous dévoile une des raisons lorsqu’il dit :
Dans les pays francophones, la réforme des programmes s’est faite en liaison constante avec l’ancienne métropole. En effet, il s’agissait là d’un des domaines politiques les plus jalousement surveillé. Quand la loi-cadre française de 1956 accorda l’autonomie aux territoires d’outre-mer, la définition des programmes scolaires demeura un secteur réservé à l’autorité métropolitaine en même temps que la diplomatie, la défense nationale et la monnaie. Dans les accords de coopération signés 1960-1961, il est généralement stipulé que la réforme des programmes scolaires ne pourra s’opérer par l’État africain de façon unilatérale.
Cette pensée de J. Ki-Zerbo dévoile un point important des sources des difficultés des institutions universitaires africaines. Malgré les efforts de nationalisation et d’adaptation des programmes aux réalités internes, nos universités continuent vraisemblablement d’être gérées de l’extérieur. Cela constitue un problème crucial dans la gestion des universités et partant pour la société elle-même. Sous tutelle, les programmes d’enseignements sont loin de coïncider avec les véritables sujets de la société africaine. Les études universitaires sont orientées vers les intérêts de la tutelle créant une impossible projection au développement. Pour A. A. Agnissan et K. L. Ehouma (2016, p. 64),
L’université coloniale au service du colonialisme, a pleinement joué son rôle d’instrument politique : produire des discours et des pratiques pour justifier l’impérialisme occidental et surtout légitimer la présence et la domination coloniale, l’imposition de la culture blanche. Dans un tel contexte d’acculturation occidentale et son idéologie rationaliste triomphante et ses utopies sociales, que peut attendre l’Afrique d’une telle université sociologiquement extravertie ?
L’éducation n’a pas formellement été cédée aux États africains à l’indépendance. Pire, la situation de nos académies fait croire à des biens confiés à la garde de nos pays. Or si tel est le cas, il faut dire que les réformes entreprises depuis les indépendances sont restées sans impact sur les sociétés. Par conséquent, les institutions universitaires africaines demeurent coincées entre les programmes métropolitains, les africanités et les véritables projets de réforme de nationalisation. Les pays africains sont donc dans une illusion de gouvernance de leurs universités. Aussi, sont-elles abandonnées avec des budgets dérisoires inaptes à les rendre compétitifs, à fournir l’essentiel pour la formation des apprenants ou le bien-être des acteurs éducatifs.
Dans la grisaille, le domaine de la recherche enchaîné dans des canevas, n’arrive pas à véritablement décoller et à innover. G. Sawadogo fustige cette approche improductive dans les universités africaines. Selon lui,
Les universités africaines n’ont pas su s’adapter aux demandes d’un environnement socio-économique africain en évolution. Après avoir accepté les rôles définis au départ par les puissances coloniales, les Universités s’y sont accrochées et se sont bornées à réagir aux changements sociaux au lieu d’en prendre des initiatives. Elles n’ont pas su participer pleinement aux efforts africains de développement, ce qui explique en partie le désenchantement général à leur égard ainsi que la crise de l’Université en Afrique (G. Sawadogo 1995, p. 6).
Nos institutions sont restées à l’état de simples lieux de formation de cadres destinés à des emplois bien précis. Mais le statut quo des universités dans un monde en mouvement est simplement régression. En effet, au fil des années, les effectifs sur les campus connaissent un accroissement au point où, les infrastructures sont dépassées et les conditions de travail de plus en plus difficiles. Selon E. Y. M. Zinsou (2009, p. 22), « conçue pour 6000 étudiants, aujourd’hui[119] l’Université de Cocody en compte environ 40.000 non compris les effectifs des Universités d’Abobo-Adjamé et de Bouaké ». À ces effectifs pléthoriques s’ajoute l’insuffisance de débouchés, source du désespoir pour les acteurs universitaires et pour toute la société, face au déficit d’implication du politique. Tout cela nourrit les mouvements de revendication et la violence sur les campus mais aussi dans le pays. Or les crises fréquentes et interminables décrédibilisent les diplômes de nos universités dont les années académiques se déroulent en dents de scie au regard de l’extérieur.
L’université, temple du savoir et de tout espoir est maintenant le creuset de nombreuses inquiétudes quant à l’avenir de ces animateurs et le point des interrogations sur le devenir des sociétés. Le retour à soi tant poursuivi se transforme en un retour à l’autre et donc disparition de soi. Alors, comment redynamiser nos institutions universitaires ?
2.2. De la redynamisation des universités africaines
En s’accrochant au système éducatif des anciennes métropoles, les universités africaines s’égarent dans leur mission de contribuer au développement de leurs États en ce sens que l’Afrique est une entité ayant ses réalités propres. La négligence de ces réalités lui coûte jusque-là son émergence. C’est pour quoi, les universités africaines nécessitent une mise à niveau par une redynamisation. Dans cette perspective, la pensée de M. Alliot citée par V. C. Diarrassouba (1979, p. 53) interpelle à plus d’un titre :
Il est banal de constater combien la pédagogie universitaire en France diffère de celle des Grandes Écoles et des classes qui y préparent : l’une est libérale, l’autre active. Dans les pays où le besoin en cadres supérieurs est tel qu’on doit tout faire pour que le maximum d’étudiants et d’élèves obtiennent le diplôme sanctionnant les études, on peut se demander si les Universités ne devraient pas préférer à la méthode libérale, qui est dans leur tradition européenne, la méthode active des Grandes Écoles.
De cette affirmation de M. Alliot, on peut admettre le choix des débuts des universités africaines. Mais cette option est visiblement révolue. En effet, plus du demi-siècle après, de nouveaux défis se présentent au monde et nos universités ne peuvent plus continuer à réduire à la simple formation des cadres. Actuellement, la recherche scientifique est devenue pour tout pays le moyen le plus sûr de son autonomie et de sa souveraineté. C’est à travers la recherche scientifique que se dessine le développement tel que nous présente l’exemple des grandes puissances mondiales.
Si la priorité a été accordée à la formation à une certaine époque pour des besoins précis, la concurrence et les transformations actuelles du monde invitent toute société soucieuse d’exister à agir. Car écrit J.-J. Rousseau (1969, p. 253) : « Vivre, ce n’est pas respirer, c’est agir ; c’est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de notre existence ». Dans le cas des universités et même de la société africaine ici, la répétition des paradigmes coloniaux n’est pas de l’affirmation de soi. C’est plutôt une négation de soi en tant que particularité. Cela veut dire que les universités africaines, et avec elle, la société, sont inconsciemment ou consciemment dans un programme suicidaire au sens de perte de leur liberté. K. Marx (2005, p. 310) indique, quant à lui, que « Acte historique et non pas mental, la « libération » est le fait de conditions historiques, du niveau de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, des transports. ».
Pour atteindre cet objectif, les structures pour la recherche doivent être développées dans les sociétés. Elles doivent connaître un nouvel essor. Celui-ci commencera par la conscience de la totale révision du système éducatif en accordant un point d’honneur à la recherche scientifique et à la gestion managériale. La recherche ouvrira les voies de prospections et offre les moyens pour la renaissance de la société. Elle permet à l’université de cerner l’origine des tares et trouver les moyens et les techniques de leur résolution. Cette orientation des priorités s’appuie aussi sur des acteurs éducatifs avertis et experts. Considérant sa forte influence sur la société, la gestion de l’université pour être rigoureuse, stricte et transparente, nécessite la convergence des synergies, la collaboration entre tous les acteurs et la fédération de tous les réseaux impliqués.
La gestion des universités doit échoir à des managers accrédités et expérimentés. Leur expérience servira à opérer de meilleurs recrutements en ressources humaines, à veiller au parfait exercice des tâches administratives, au respect des lois, statuts et règlement intérieur de l’institution à leur charge. Cette gestion managériale doit comprendre la réelle formation des enseignants à la pédagogie universitaire, le réajustement à temps réel du traitement salarial, les émoluments liés à la recherche tout en prenant à cœur le bien-être de ces acteurs. Car ce sont ces problèmes existentiels qui favorisent la dispersion des enseignants et l’abandon des étudiants à leur propre sort avec des cours commercialisés sous forme de fascicules. Aussi, importe-t-il de revaloriser le budget des universités.
L’augmentation du budget alloué à l’université, et particulièrement au domaine de la recherche scientifique, manifeste d’une attitude responsable et d’une volonté avérée de l’État de sortir de l’ornière tutélaire. Cela signifierait, proprement, la détermination de l’État de se libérer de toute tutelle afin d’œuvrer au bien-être et à l’évolution de la société. Car écrit J.-J. Rousseau (1964, p. 903) :
Quiconque dépend d’autrui et n’a pas ses ressources en lui-même, ne saurait être libre. Des alliances, des traités, la foi des hommes, tout cela peut lier le faible au fort et ne lie jamais le fort au faible. Ainsi, laissez les négociations aux puissances et ne comptez que sur vous.
Pour lui, tout commence par la libération totale des peuples africains de toutes les puissances coloniales. L’émancipation ne se conjugue guère sous tutelle. Car si la soumission n’empêche pas un peuple de savoir ses besoins, elle ne lui laisse cependant pas la possibilité d’agir par lui-même. Face aux puissances coloniales donc, la toute première action, c’est acquérir les moyens de l’indépendance. J.-J. Rousseau (1964, p. 905) pense que :
Le seul moyen de maintenir un État dans l’indépendance des autres est l’agriculture. Eussiez-vous toutes les richesses du monde si vous n’avez de quoi vous nourrir vous dépendez d’autrui. Vos voisins peuvent donner à votre argent le prix qu’il leur plaît parce qu’ils peuvent attendre ; mais le pain qui nous est nécessaire a pour nous un prix dont nous ne saurions disputer et dans toute espèce de commerce c’est toujours le moins pressé qui fait la loi à l’autre.
Autrement dit, tant que les pays africains resteraient sous de quelconques tutelles, les universités demeureront ce qu’elles sont des universités sous tutelle. Les programmes universitaires continueraient à servir les intérêts des puissances par l’intermédiaire de dirigeants manipulés de l’extérieur. Il apparait alors que la recomposition des programmes éducatifs avec les africanités devient une tâche secondaire. Même la répression des acteurs universitaires (enseignants, étudiants et administrateurs) est loin de constituer une solution des crises sur les campus. On pourrait croire avec Saint-Just (1946, p. 294) que « La force ne fait ni raison ni droit ; mais il est peut-être impossible de s’en passer pour faire respecter le droit et la raison. ». Seulement ici, droit et raison ont tous deux les pieds en l’air. Car dans ces présents schémas, l’usage de la force est abusif et le droit n’est nullement respecté.
Conclusion
Au sortir de l’analyse du sujet portant sur les universités dans le développement des sociétés africaines, on note que l’idée de l’université comme facteur de développement n’est pas étrangère aux pays africains. Elle leur est même familière depuis les périodes coloniales et les indépendances l’ont davantage boostée. Cependant, les procédés, pour atteindre cet objectif de développement, ont régulièrement plombé le processus car il demeure visiblement dysfonctionnant jusqu’ici. Après la colonisation, les jeunes États africains indépendants se sont limités aux anciens systèmes éducatifs tutélaires montés sur les réalités métropolitaines au mépris des leurs. Le droit régalien sur les programmes éducatifs accordé à l’ancienne métropole empêche leurs modifications malgré les mutations sociales dans le monde.
Les universités africaines se trouvent alors dépassées à tous les niveaux. Que ce soit dans les programmes d’enseignements, dans les infrastructures d’accueil et d’encadrement en place, l’’état des lieux est désolant dans pratiquement toutes les institutions universitaires africaines. Loin d’être des laboratoires de la dynamique sociale, nos universités servent de bases arrière des clivages politiques où sévissent mal-être et misère partagés par la société. Les causes principales du dysfonctionnement des universités africaines sont la dépendance de l’extérieur, l’inadaptation des programmes et la mauvaise gouvernance. Mais, à l’analyse, toutes ces difficultés sont dues à la responsabilité de nos États encore dépendants des puissances extérieures malgré la proclamation des indépendances.
Aussi, la reconquête totale de l’indépendance par l’autosuffisance s’impose aux États avant même de prétendre à la réforme de l’université africaine. C’est réellement libéré de toute tutelle que l’élan du bien-être de la société dicte aux gouvernements l’honnête recours à l’université. Partant, l’université africaine est bel et bien un moyen du développement de nos sociétés ; toutefois elle est impuissante face à l’orientation des politiques. A. A. Hauhouot (1999, p. 11) pense que
L’université devra, de l’intérieur, s’organiser en des structures articulées entre elles et ordonnées à cette fin. Prises en elles-mêmes, ces structures, exigées par la raison, ne sont que des cadres théoriques et donc formels. Tout le problème est de parvenir à leur donner un contenu pour que vive le tout.
Références bibliographiques
AGNISSAN Assi Aubin, EHOUMA Koffi Ludovic, 2016, « Du paradigme l’université en Afrique au paradigme l’université africaine : enjeux épistémologiques et défi du futur », in Revue Africaine d’Anthropologie, Nyansa-Pô, N°21, p. 56-74.
De SAINT MOULIN Léon, 2007, « L’Université au Congo : hier, aujourd’hui demain », in L’Université dans le devenir de l’Afrique : Un demi-siècle de présence au Congo-Zaïre, Sous la direction de NDAYWEL è Nziem Isidore, Paris, L’Harmattan.
DIARRASSOUBA Valy Charles, 1979, L’université ivoirienne et le développement de la nation, Abidjan-Dakar–Lomé, Les Nouvelles Éditions Africaines.
HAUHOUOT Asseypo Antoine, 1999, Penser et bâtir pour habiter, Abidjan, PUCI.
KI-ZERBO Joseph, 1975, « L’africanisation des programmes dans l’enseignement supérieur » in les problèmes des années 70, publications Association des Universités africaines.
MARTINEAU Stéphane, Alexandre A. J. BUYSSE, 2016, « Rousseau et l’éducation : apports et tensions », Article in Revue Phronesis, Volume 5, numéro 2, Décembre, p. 16-22.
MARX Karl, 2005, Philosophie, Edition établie et annotée par Maximilien Rubel, Coll. Folio/Essais.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1969, Émile ou de l’éducation, O.C. IV, Paris, Gallimard, La Pléiade.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1964, Projet de constitution pour la Corse, O.C III, Paris, Gallimard, Pléiade
SAINT-JUST, 1946, « Institutions républicaines », in Œuvres de Saint-Just, Paris.
SAWADOGO Gerémie, 1994, L’avenir des universités africaines : Mission et rôle, AUA.
ZINSOU Edmé Yambodé Michel, 2009, L’université de Côte d’ivoire et la société, Paris, L’Harmattan.
LE CONSERVATISME PLATONICIEN, UN POSSIBLE REMÈDE À LA CRISE DE L’UNIVERSITÉ
Amed Karamoko SANOGO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’Université, dans de nombreux pays africains, s’accommode la plupart du temps avec des impasses de diverses natures. Ainsi, il ne se passe pas une année académique sans qu’il n’y ait une situation de crise qui perturbe fortement les activités pédagogiques et de recherche. On est tenté de croire que les crises sont une spécificité des universités en Afrique. Toutefois, les grèves à répétition et la prévalence de la violence sur les campus ne sont au fond que les corollaires d’un désenchantement sociétal. L’Université étant perçue comme un microcosme de la société, est victime d’une crise de changement qui la dépasse et à laquelle elle ne saurait se soustraire. La crise dans le milieu universitaire est liée à l’éloignement de ses propres modes de fonctionnement qui jadis ont fait sa renommée. Dans ce cas, à partir du misonéisme platonicien, il est possible de modéliser les conditions d’une sortie de crise de l’Université.
Mots clés : Afrique, Changement, Crise, Désenchantement, Misonéisme, Perturbation, Société, Université.
Abstract:
In many African countries, the university is often associated with the idea of disruption and blockage. Thus, not a single academic year goes by without a crisis situation, which greatly disrupts teaching and research activities. It is tempting to believe that crises are a specificity of universities in Africa. However, repeated strikes and the prevalence of violence on campuses are basically the corollaries of a societal disenchantment. The university, seen as a microcosm of society, is the victim of a crisis of change that goes beyond it and from which it cannot escape. The crisis in the university environment is linked to the move away from its own modes of operation, which once made its reputation. In this case, by focusing on Platonic misonesis, it is possible to model the conditions for the university to emerge from the crisis.
Keywords : Africa, Crisis, Disenchantment, Change, Misonism, Disruption, Society, University.
Introduction
En Afrique subsaharienne, depuis plus de quarante années, les sociétés traversent une période de débats contradictoires, de situations troubles, de blocages et de refus. Ces multiples difficultés qui traduisent la persistance des crises sociétales, réduisent la visibilité des institutions universitaires. L’Université faisant partie intégrante de la société, elle en est la quintessence, l’extrait, le condensé, voire le résumé si bien qu’elle n’échappe pas aux mutations et crises sociales.
Les crises qui l’affectent se manifestent au niveau de « la perte de la culture et celle de la vertu civique » (B. Bernadi, 1999, p. 58), mais elles sont, pour l’essentiel, liées au passage de l’ancien à de nouvelles opportunités supposées corrompre l’essence des choses. Il y a là une réalisation du changement qui rend possible la dégénérescence sociale. Platon voit en celle-ci la remise en cause de la stabilité des cités. C’est dans cette optique que la crise à l’Université apparaît comme un malaise sociétal dont les causes sont à rechercher dans l’éclipse de ce qui rend permanentes les choses, c’est-à-dire leurs valeurs.
Étant donné que l’Université est une île du savoir dans la société, elle est le lieu de l’acquisition de la connaissance comme un moyen, un instrument susceptible de résoudre ou de proposer des solutions aux crises qui se présentent à elle. Dès lors, la question centrale qui va conduire cette réflexion peut être ainsi formulée : comment comprendre la crise dans l’institution universitaire en Afrique ? À partir de ce problème central, les problèmes secondaires se déclinent comme suit : la crise de l’Université ne relève-t-elle pas d’une crise sociétale ? Cette crise de l’Université, en Afrique, n’est-elle pas à comprendre à l’aune des changements sociopolitiques? Quel remède efficient peut-on apporter pour permettre à l’Université de résorber ses crises afin de jouer son rôle de levain intellectuel dans une société pleinement en crise ?
L’intention fondatrice de cette communication est de démontrer que la crise qui secoue le milieu universitaire est la résultante des changements de références sociétales. Par conséquent, en mettant l’accent sur le misonéisme platonicien, l’on peut sortir de l’impasse les universités d’Afrique. Ainsi, on aura compris que le changement, dans la perspective platonicienne, est nuisible à la société. Pour mener à bien cette analyse, nous nous servirons de la méthode sociocritique. Elle propose une lecture sociohistorique des textes en vue d’appréhender les aspects positifs de l’attachement de Platon à la conservation.
La première articulation de ce travail consistera à montrer que la situation de malaise que connaissent certaines universités africaines est imputable à la société elle-même. Dans la seconde articulation, il sera question, dans une perspective platonicienne, de présenter le changement comme la manifestation de la crise de l’Université. La troisième articulation proposera une voie de sortie de l’impasse en mettant l’accent sur le paradigme platonicien d’une université stable, c’est-à-dire celle qui échappe au changement.
1. La démocratie, signe clinique de la crise de l’Université
Avant d’évoquer la démocratie comme signe clinique de la crise de l’Université, il nous semble nécessaire de procéder à une excursion dans le concept de crise. La notion de crise est, aujourd’hui, très répandue et extensive. Il y a, en effet, une pluralité de crises : crise de civilisation, crise économique, crise culturelle, crise politique, crise sociale, crise universitaire, etc. Selon E. Morin (1976, p. 149), « la notion de crise s’est répandue au vingtième siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine ». Le mot crise est ainsi devenu un concept usuel parcourant plusieurs domaines.
Il y a une pluralité d’éléments qui caractérisent ce concept et qui rendent difficile d’en donner une définition précise. Mais, on peut retenir que « la crise est perçue comme une surprise, un élément perturbant dont on ignore comment et par où le saisir » (E. Morin, 1976, p. 152). Ce propos nous fait dire qu’une crise est caractérisée par des circonstances embarrassantes, brusques et inattendues. C’est un processus comportant des éléments de déstabilisation, de trouble d’un certain ordre. L’on dira qu’il y a crise lorsque surgit l’incertitude là où tout semblait assuré, réglé et régulé. La crise se donne à lire comme des modifications qui découlent de l’ordre initialement établi, des résistances et des divergences dans une institution.
La crise que traverse l’Université en Afrique, relève bel et bien d’une crise de la société. Cette crise est perçue sous l’angle de la démocratie qui est source de troubles et d’agitations dans la perspective platonicienne. De son étymologie grecque, demos et cratos, la démocratie est la détention du pouvoir et son exercice par le peuple. Ce dernier, en tant que communauté sociale, s’autodétermine et réalise par lui-même sa propre souveraineté. De l’avis de Platon, le peuple est mû par des sentiments incontrôlés, puisque la psychologie du groupe inhibe l’activité rationnelle.
Pour lui, de manière générale, la démocratie ne définit pas seulement une forme de gouvernement : elle est un type de société où règnent le pluralisme politique, la liberté et l’égalité, et où chacun peut vivre selon sa fantaisie. En réalité, « l’essence de la démocratie est d’accorder aux citoyens une trop grande liberté qui dégénère en licence » (Platon 2011, 572c). Au nom de la liberté démocratique, l’individu fait fi de la tempérance, de la pudeur pour adopter une attitude insolente et décadente. Elle pervertit l’individu, provoque des agitations dans la cité, introduit une déviation sociale sans précédent et nuit dangereusement à la vie communautaire. C’est donc dire que la démocratie qui introduit, selon Platon, le désordre et les troubles dans la communauté est une forme de pathologie sociétale.
La pratique de cette liberté démocratique est perceptible dans le milieu universitaire, notamment au niveau de la massification qui consacre la démocratisation de l’Université. Cette idée trouve sa justification dans l’accroissement du nombre des étudiants inscrits dans les universités. L’Université Alassane Ouattara, initialement Université de Bouaké, est issue de l’un des centres universitaires créés en 1992 par les pouvoirs publics ivoiriens dans le but de décongestionner l’Université nationale de Côte d’Ivoire. Des études montrent qu’en 2018, l’Université Alassane Ouattara avait plus de 17 000 étudiants inscrits et aujourd’hui, elle en a plus de 25 000 qui vivent dans des conditions d’étude peu confortables.
La crise est vécue ici comme une situation de « mauvaise gestion de la massification » (I. Martinache, 2009, p. 54). En d’autres termes, l’Université étant incapable de sélectionner les meilleurs étudiants, reçoit presque tous les nouveaux bacheliers qui en font la demande. Or, l’Université, de façon orthodoxe, est conçue pour une société hiérarchisée et élitaire. La formation des élites passe nécessairement par la sélection. Pourtant, la sélection est incompatible avec l’aspiration légitime des masses à l’enseignement. Ainsi, il y a un ordre de valeur institutionnelle qui se trouve bouleversé, car contraire à l’idéal universitaire.
En raison de l’évolution de ces effectifs du fait de former une société de démocratie de masse, les amphithéâtres sont encombrés, les bourses et les allocations d’études, très insuffisantes ; et pour ceux qui en bénéficient, elles sont payées avec plusieurs mois de retard. En accord avec cette analyse, V. C. Diarrassouba (1979, p. 171) affirme que « les problèmes de l’Université concernent aussi bien l’accroissement des moyens disponibles en personnel, en locaux et en équipement pour faire face à l’afflux continuel des étudiants, (…) ». En clair, la plupart des Universités connaissent un rythme élevé d’accroissement des effectifs d’étudiants. Un tel contexte crée une situation de précarité et d’incertitude chez les étudiants, laquelle se traduit le plus souvent par des avec vandalisme, affectant ainsi l’institution universitaire.
Par ailleurs, la démocratie appréhendée comme le lieu de la liberté et de l’expression plurielle, par excellence, se manifeste à travers l’insubordination et la confusion. Manifestement, « le père prend l’habitude de se comporter comme s’il était semblable à son enfant et se met à craindre ses fils, et réciproquement le fils se fait l’égal de son père et ne manifeste plus aucun respect ni soumission à l’endroit de ses parents » (Platon, 2011, 562a). Cela dénote la crise d’autorité dans la cellule familiale. La liberté démocratique met aux prises parents et enfants en dénaturant les liens sacrés de la famille que sont le respect et la considération des progénitures à l’égard des parents.
Cette atmosphère libertaire s’observe également dans le milieu universitaire et le dessert amplement. Platon (2011, 563a) s’en fait l’écho en dénonçant l’esprit démocratique dans la relation entre enseignants et apprenants. Pour lui, « le maître craint ceux qui sont placés sous sa gouverne et il est complaisant à leur endroit. Les élèves, eux, ont peu de respect pour les maîtres, et pas davantage pour leurs pédagogues ». Il est évident que le maître, en raison de la crainte, n’a plus d’autorité. La conduite de l’homme n’est plus inspirée par la connaissance, mais plutôt est le fruit d’une agressivité mêlée d’effroi qui fait de l’homme objet et source de la violence.
Nos sociétés dites modernes et civilisées sont caractérisées par « la violence permanente, la prévalence de la force, l’anarchie, la misère et la peur universelle » (L. F. Doh, 2007, p. 182). L’on comprend, dès lors, que l’espace d’apprentissage, à savoir l’Université, soit devenue une zone de non-droit, un lieu de la violence permanente, de la peur généralisée et de défiance de l’autorité. Depuis quelques années, le mouvement d’étudiants, CEECI[120], a pris le contrôle de plusieurs constituantes de l’Université Alassane Ouattara. Il impacte négativement la liberté d’association d’autres étudiants ainsi que leur droit à la formation académique.
Des étudiants se réclamant du CEECI délogent constamment et manu militari d’autres étudiants des salles de composition et des amphithéâtres, interdisent parfois aux enseignants l’accès de leur lieu de travail. On se souvient encore que des étudiants ont intimé l’ordre à des enseignants-chercheurs du Département de philosophie, de l’Université Alassane Ouattara, de sortir de leur bureau, le 5 janvier 2022. Nous sommes, en outre, témoins de parades militaires régulièrement effectuées par des étudiants encagoulés à travers l’espace universitaire.
Ce sont donc là, énoncés, des inconvénients de la liberté démocratique qui suscitent le manque d’assiduité des étudiants autant que des professeurs. La raison se trouve dans le manque d’intérêt pour ce qui pourrait servir de repère. « On ne s’intéresse plus à ce qui est posé comme Juste, Vrai, Beau, Bien. Il n’y a plus de critères personnels ou sociaux servant de référence, de principe moral » (L. D. Fié, 2007, p. 79). La tendance à la réussite facile, la propension à la fraude et à la complaisance sont évidentes. Cette crise en milieu universitaire est une crise de valeur pour laquelle la société n’est pas exempte de reproche. Le mal social est perceptible dans les Universités en tant qu’elles sont le microcosme de la société. Par ailleurs, l’une des manifestations de la crise de l’Université est à rechercher au niveau des changements opérés dans la gouvernance et le management.
2. Les changements comme sources de la crise de l’Université
La crise met l’accent prioritairement sur les modifications, les changements intervenus. En règle générale, on entend par changement, la transformation significative du caractère établi d’une chose avec les modifications profondes qui en résultent. « Le changement est ce qu’il y a de plus périlleux » (Platon, 2008, 797c). Il est la source de tous les maux, de toutes les crises qui affectent la société et ses institutions. Le prisme à travers lequel Platon est présenté, le fait apparaître comme un défenseur de l’idée selon laquelle le changement serait source de malaise et de pathologie à cause desquelles, la crise est rendue possible.
Le changement est perceptible au niveau de la gouvernance des universités. En effet, contrairement aux écoles primaires et secondaires, dans la plupart des pays africains où la volonté politique fait de l’école une obligation, l’Université n’est pas obligatoire. Elle est, à la fois, un lieu de formation et de recherche. En effet, de son étymologie latine universitas, le nom Université vient du Moyen Âge et veut dire la guilde des professeurs et des étudiants. Mais, de façon générale, l’Université est une institution autonome, c’est-à-dire qu’elle ne dépend ni des religions ni des gouvernements. Depuis l’origine, l’Université en tant qu’institution, a déterminé ses propres modes de fonctionnement, de gouvernement et de direction, car « pour que l’élan intellectuel ne s’affaiblisse pas, les réalisations doivent être aussitôt marquées du sceau institutionnel » (A. B. Cabal, 1995, p. 42).
Cela signifie que l’institution universitaire définit le contenu de ses enseignements et des recherches qui y ont cours selon les priorités qu’elle se fixe et les champs d’intérêt de son corps professoral. Autrement dit, l’Université, prise comme un ensemble formant un tout, est un corps autogéré. Ainsi, elle s’arroge une liberté face aux confessions religieuses telles que le christianisme et l’islam. Et elle la revendique également vis-à-vis du pouvoir politique en vue de faire avancer les connaissances dans tous les domaines et d’en diffuser les résultats urbi et orbi à l’ensemble des hommes et femmes de la planète. La crise de l’Université se focalise, pour une bonne part, sur le changement de l’autorité introduite au sein de l’institution.
Au regard de l’autonomie reconnue à l’Université dans son fonctionnement, l’autorité civile n’a pas le droit d’envoyer ni la police ni la gendarmerie encore moins l’armée dans son enceinte sauf sur la demande de l’autorité universitaire. C’est dire donc que l’Université tient au respect de ses franchises. Les franchises universitaires sont une notion qui exprime la position dans laquelle l’Université se distingue et dans laquelle les forces de sécurité ne peuvent pas s’y ingérer sans l’approbation préalable de ses responsables.
Ce concept de franchises universitaires exprime le caractère sacré de l’Université et le respect de la science et du savoir qu’elle incarne. Les universitaires sont affranchis d’un certain nombre de contraintes qui s’exercent sur l’ensemble des autres acteurs de la société. Cela dénote le respect accordé à l’Université en raison de son statut particulier. Mais, contre toute attente, l’espace universitaire est violé par la présence des forces de l’ordre et de sécurité. En effet, « dans la nuit du 17 au 18 mai 1991, entre minuit et 02h 00 du matin, le gouvernement ivoirien a ordonné une expédition punitive menée par des para-commandos de la gendarmerie nationale sur la cité universitaire de Yopougon dans la banlieue abidjanaise » (S.-N. N’zi, 1991, p. 3). Une telle attitude dénote du malaise de l’institution universitaire.
En février 2006, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été le théâtre d’affrontements d’une rare violence entre étudiants et forces de l’ordre. À Abidjan et au Sénégal, les forces de l’ordre ont investi le campus social et pédagogique. Ces actes d’invasion ont remis au goût du jour la problématique des franchises universitaires. En somme, ce changement intervenu du fait de l’intervention des forces policières et paramilitaires est considérée comme une nouveauté éloignée des principes de l’Université.
Qui plus est, l’Université est victime d’une crise qui la dépasse, une crise à laquelle elle ne saurait se soustraire. En effet, le pouvoir politique a pris le contrôle des universités. On part du postulat que l’éducation relève des prérogatives de l’État. À ce titre, il lui « incombe de créer un environnement propice au développement scientifique et d’orienter les politiques scientifiques » (A. B. Cabal, 1995, p. 186-187). Cela revient à dire que l’État attend des résultats de son investissement, puisqu’il est partie prenante au gouvernement de l’institution universitaire.
En parlant de l’implication du gouvernement dans le fonctionnement de l’Université en Afrique, le cas de l’Université Alassane Ouattara peut être cité éloquemment en exemple. Les responsables de la gouvernance universitaire sont nommés : le Président de l’institution, les Doyens des Unités de Formations et de Recherches (UFR), les chefs de Départements, les responsables du personnel administratif et technique.
Il en est de même pour toutes les universités publiques ivoiriennes. De la sorte, elles perdent en autonomie par rapport à l’État, alors qu’elles auraient souhaité la préserver. Aussi, il n’est pas surprenant dans un tel contexte que ces institutions soient contestées et critiquées, tant au niveau de leur fonctionnement que de leurs rôles. En parlant des universités en Afrique, A. B. Cabal (1995, p. 187) présente ainsi la complexité des relations gouvernements-universités : « Le gouvernement veut que son investissement produise des résultats tandis que l’Université souhaite préserver son autonomie ». Dans cette relation, l’on assiste à un changement de paradigme à travers la perte de l’autonomie des Universités. À cause de cet éloignement du modèle idéal (institution autonome), il y a quelque chose de fondamental qui s’effondre dans l’espace universitaire.
Qui plus est, les États encouragent les universités à être utiles au développement économique et à l’employabilité des étudiants au détriment de la transmission de connaissances critiques quant à l’évolution du monde contemporain. Les textes trans-étatiques consacrent l’implication des États dans l’orientation des universités. L’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies affirme que « l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ». C’est donc sous la pression des institutions internationales qu’est promue la libéralisation du secteur.
Le discours qui importe dans ces circonstances suggère que les changements dans les universités africaines sont des indices de leur détérioration. Platon (2011, 512a) voit à travers le changement la décrépitude de la cité. Ici, on peut dire avec lui que relativement à l’université, « il n’y a rien de plus périlleux que le changement ». Autrement dit, le changement implique la mélancolie, la décomposition du modèle ancien, d’où la crise. Dans sa Critique de la modernité, A. Touraine (1992, p. 91) estime que le changement est «la destruction de l’ordre ancien et la recherche d’un ordre nouveau ». Pour lui, il y a un état d’esprit dominé par le culte du changement. Ce processus qui fait passer les choses d’un état à un autre, qui fait advenir un monde nouveau entraîne une rupture qui est synonyme de crise.
En bref, il y a nécessité d’une hostilité face au changement pour mettre fin à la crise de l’Université. Tant que nous encouragerons le changement dans nos universités, elles seront toujours en crise. D’où son rejet au profit d’un conservatisme comme remède à la crise de l’Université.
3. Le misonéisme platonicien : un possible remède à la crise de l’Université
Le terme misonéisme vient de deux termes grecs : miso signifiant qui hait et neo qui veut dire nouveau. Le misonéisme désigne l’attitude consistant à rejeter tout nouveau concept, toute nouvelle conception du monde. Il peut être appréhendé comme une tendance hostile à la nouveauté, ou à ce qui favorise le changement.
Par misonéisme platonicien, il faut entendre le refus du changement et l’instinct de conservation dans la cité et de ses institutions. La conception que Platon se fait de la cité idéale interdit tout changement possible de rôle entre un artisan et un gouvernant, d’une part, et entre un guerrier et un artisan, d’autre part. Selon lui, « l’empiètement sur les fonctions des autres entraine toujours l’anarchie dans la cité » (Platon, 2008, 434b). Autrement exprimé, il n’y aura pas d’harmonie, d’épanouissement et de calme dans la cité tant qu’il y aura une quête permanente du nouveau qui corrompt les caractères des citoyens en rendant les mœurs instables. En réalité, chaque classe distincte de citoyens dans la société conservera la place qui lui aura été recommandée en exerçant sa propre compétence.
Platon s’insurge contre le changement suivant les lieux, les époques et les esprits. Il n’admet pas que la vérité appartienne aux sophistes, le pouvoir aux plus rusés et la morale aux hypocrites. Sa vision du monde se résume dans la célèbre allégorie de la caverne, où tout ce que nous percevons ou appréhendons par les sens n’est que pure illusion par rapport à l’essence, c’est-à-dire l’Idée éternelle.
C’est dans la pensée de Parménide qu’il faut situer l’origine de la conception de l’Idée éternelle chez Platon. En effet, J. Volquin (1964, p. 89), l’un des commentateurs des penseurs grecs avant Socrate, révèle, dans l’un des fragments de Parménide ceci : « L’une des routes est que l’Être est et qu’il n’est pas possible qu’il ne soit pas ; c’est le chemin de la certitude, car elle accompagne la vérité ». Autrement dit, l’Être parménidien est une entité qui demeure immobile, c’est-à-dire inchangeable. Cette immobilité a subjugué Platon à telle enseigne qu’il la préconise comme l’ultime remède à ce qui est en perpétuel changement.
Il s’agit de détourner la raison des apparences sensibles pour la tourner vers les réalités intelligibles que Platon appelle les Idées. La base spéculative de cette pensée, qu’on pourrait prêter à Platon, se trouve dans sa théorie des Idées. En effet, la théorie des Idées est la théorie selon laquelle les concepts ou idées abstraites, existent réellement, elles sont immuables, impérissables, universelles et constituent les modèles (archétypes) des choses et formes que nous percevons avec nos organes.
Ce qui est édifié dans cet esprit est l’antidote structurel du changement, empêchant la décrépitude de la société et partant de l’Université. Ainsi, pour le philosophe athénien, il est nécessaire de fonder les institutions dans les Idées. Pour lui, l’Idée du bien permet aux hommes de rechercher constamment la perfection de leur environnement. Il en est de même pour l’Idée de justice qui établit la vérité au détriment du mensonge, et par sa lumière, elle instaure la confiance entre les hommes. C’est dire donc que ce sont les Idées qui doivent refléter nos systèmes politiques, institutionnels pour leur stabilité, car c’est d’elles que la société tire cet avantage.
Les mouvements de réforme, selon Platon, ne doivent pas être calqués sur le monde sensible, c’est-à-dire le monde terrestre qui n’est pas la réalité véritable, ce n’est qu’une apparence, une ombre, une copie des choses intelligibles qui seules sont vraies et réelles. Dans cette perspective, lorsqu’un principe est fondé sur de l’apparence, il est flexible, mobile et changeant. Or, « il n’y a rien de plus périlleux que le changement », dit Platon (2006, 512a). Ces propos indiquent la corruptibilité d’une réalité donnée du fait de son éloignement du modèle idéal. Du coup, la société s’achemine vers l’imperfection qui constitue le stade le plus acerbe du déclin. En d’autres termes, pour mettre fin au cycle de la déliquescence et asseoir des institutions stables et fiables, il est sage d’adosser les principes aux réalités véritables que sont les Idées. L’on peut donc affirmer que toutes les cités en crise ont pour remède l’Idée éternelle.
La manifestation de cet intérêt pour la pensée théorique de Platon qui pose le changement comme menant à la chute, est présente dans sa meilleure expression chez Karl Popper. En effet, même si K. Popper (1979, p. 26) considère la société platonicienne close, puisque fermée à l’ouverture et au changement, il estime que Platon vise l’interruption de tout changement « en fondant un État exempt des maux dont souffrent les autres États en ce qu’il ne connaît ni décadence ni changement. C’est un État parfait, celui de l’âge d’or, l’État définitivement immobile ». L’on ne peut plus s‘étonner d’accepter, chez Platon, l’ordre immuable comme indice de tranquillité, de stabilité et d’absence de crise.
Ce passage est essentiel dans la légitimation de la conservation des valeurs traditionnelles au détriment des nouveautés chez le philosophe. Évoquons à titre d’exemple l’influence des changements introduits à Athènes par les sophistes. Sous l’égide, il y a dans la cité athénienne de forts désirs de possession de la richesse matérielle au détriment de la modération des désirs en cours. La quête des plaisirs des sophistes était orientée non pas vers l’être, mais plutôt vers l’avoir. L’avoir est, par excellence, le monde de l’extérieur, le lieu de la possession éphémère tandis que l’être est du monde intérieur, c’est-à-dire celui des Idées et des essences éternelles. Au lieu de faire fortune en appauvrissant des citoyens athéniens, les sophistes auraient dû modérer ou maîtriser leurs désirs ou passions de possession matérielle.
Fort de cette expérience des sophistes, le philosophe de l’Académie considère que « ce qu’il faut léguer aux (citoyens) ce n’est pas de l’or mais une grande modération » (Platon 2006, 465c-466d). Il dépeint les effets du système éducatif de ses contemporains, les effets de leur système de valeur et de conduite. Dans l’Antiquité grecque, la cité d’Athènes était réputée pour sa vertu de tempérance ou de modération. Malheureusement, les Athéniens ont préféré suivre les nouveaux enseignements des sophistes au lieu de conserver la maîtrise de leurs passions. Cela a contribué probablement à la perte de repère, entraînant, pour ainsi dire, une crise de l’éducation.
À l’analyse de ce qui précède, avec les changements survenus aussi bien dans la société que dans l’appareil universitaire, c’est l’effondrement des repères axiologiques ou institutionnels séculiers. « Les mots d’ordre anciens qui tramaient les missions d’enseignement et de recherche n’ont plus cours » (C. Granger, 2015, p. 9). Parmi ces mots d’ordre anciens, on peut citer : la liberté de recherche et la formation de l’élite. Voilà pourquoi, tout ce qui se rapporte à un minimum de conservation de valeurs, se trouve systématiquement approuvé et crédité en défaveur du dogme du changement. Toutefois, le changement n’efface pas tout. Le changement qui vaille la peine, c’est celui qui n’est pas le renversement ou la négation de toutes choses et qui, souvent, comporte une part de continuité conforme à l’Idée éternelle. Celle-ci est caractérisée chez Platon par le principe du bien. Il veut soustraire le changement à l’empirisme pour le lier à des valeurs éternelles. En somme, le changement se rapporte à une condition générale qui est, en termes platoniciens, une conception du Bien. Celui-ci réalise les possibilités et améliore la qualité de la vie.
Conclusion
Dans cette réflexion, nous avons porté notre attention sur certains moments de l’histoire de l’Université. L’avenir de l’Université faisant problème, nous avons fait une description clinique des pathologies sociales dont souffrent certaines universités africaines, à savoir la liberté démocratique, le manque d’intérêt pour ce qui pourrait servir de repère dans la communauté universitaire, le changement de paradigme qui occasionne l’éloignement du modèle idéal. Ces termes utilisés et les expressions développées affectant la vie de l’institution, n’ont pas été autre chose que des périodes de trouble et de déstabilisation de l’Université.
L’incertitude liée au changement est une source d’instabilité et entraîne des réactions de la part des enseignants-chercheurs et chercheurs. Ceux-ci, à l’instar du rescapé de la caverne ombreuse de Platon, doivent refuser d’en habiter les ruines. Alors, il est temps de faire le rêve d’une organisation nouvelle qui se rapporte à une conception du bien, en termes platoniciens. Dans cette perspective, les universités d’Afrique proposent des offres de formation et leurs sciences sont à même de prendre en charge les intérêts de nos sociétés. À la lumière de l’idée platonicienne du bien, le refus du changement est une condition de la stabilité sociétale. Ce message se doit d’être pris en compte de nos jours, dans toutes les universités africaines.
Références bibliographiques
BRAUD Philippe, 2002, Violences politiques, Paris, Seuil.
CABAL Alfonso Borrero, 1995, L’Université aujourd’hui : éléments de réflexion, Centre de recherche pour le développement international, Paris, Éditions UNESCO.
DIARRASSOUBA Valy Charles, 1979, L’Université ivoirienne et le développement de la nation, Abidjan, Les Nouvelles Éditions Africaines.
DOH Ludovic Fié, 2007, « École et violence : contribution à la critique de la régression vers la barbarie », Le Korè n° 38, p. 38-89.
DOH Ludovic Fié, 2012, Musiques populaires urbaines et stratégies du refus en Côte d’Ivoire, Paris, Édilivre.
GRANGER Christophe, 2015, La destruction de l’Université française, Paris, La Fabrique éditions.
MARTINACHE Igor, 2009, « L’Université en crise. Mort ou résurrection ? », in Mauss, N°8, http://journals.openedition.org/lectures/768, consulté le 23 mars 2022 à 23h 15.
MORIN Edgar, 1976, « Pour une crisologie », in Communication, N°25, p. 149-163.
N’ZI Serge-Nicolas, 2015, « Côte d’Ivoire-crise politico-sociale et la déstabilisation de l’université », in http://www.connectionivoire.net, consulté le 12 mars 2022 à 21h 25mn.
LAGADEC Patrice, 1993, Apprendre à gérer les crises, Paris, Édition d’organisation.
ILLOU Amina, 2019, « Un terrain sensible : l’Université et la crise », Philosopher au Niger, autour de l’humanisme, du développement et de l’éducation, Abidjan, Nouvelles Éditions Balafons, p. 187-203.
PLATON, 2011, La République, in Œuvres complètes, traduction de George Leroux, Paris, Éditions Flammarion, p. 1481-1792.
PLATON, 2006, Les Lois, traduction J.-F. Pradeau et L. Brisson, Paris, Garnier Flammarion.
POPPER Karl, 1979, La société ouverte et ses ennemis, traduction Luc Brisson, Paris, Flammarion.
SALL Abdou Salam, 2012, Les mutations de l’enseignement supérieur en Afrique : le cas de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Sénégal, L’Harmattan.
CRISE DES UNIVERSITÉS AFRICAINES COMME CRISE DE LA RATIONALITÉ
Roland TECHOU
École Normale Supérieure (ENS)/UAC (Bénin)
Résumé :
L’université africaine est à l’aube de sa rationalité. En effet, l’apparente crise des universités africaines que l’on dénote à l’aube du 3ème millénaire, est la crise de la rationalité occidentale dans laquelle les universités africaines ont été jusque-là moulues. Avec l’analyse renouvelée de cette rationalité donnée par Karl Jaspers dans La situation spirituelle de notre époque, on se rend bien compte que le savoir dont l’université est promotrice ne peut éclore que par une certaine endogénéité. D’où les universités africaines pour surmonter la crise actuelle doivent opérer un retour à l’autoréférentialité. Autrement dit, elles doivent repartir de leur propre rationalité afin d’accéder à l’endogénéité du savoir. C’est ce que nous tentons de justifier dans cette communication dont l’intérêt est de montrer que seule la connexion entre la vie de l’esprit et l’action ouvre à l’effectivité de la connaissance. La rupture épistémologique attendue des universités africaines pour surmonter la crise prendra appui sur des auteurs africains dont l’engagement intellectuel aura montré qu’il n’y a de savoir que du savoir être. Tel est l’enjeu de toute université.
Mots-clés : Authenticité, Autoréférentialité, Endogénéité, Savoir, Spirituel, Université.
Abstract :
Rationality movement is still at it’s beginning in African university. Actually, what we consider like the African’s University crisis at the dawn of the third millennium is not one. It is rather the crisis of European rationality in which African’s university were grounded. When we consider Karl Jaspers’ renewed analyse about rationality in The spiritual situation of the age, we notice that, endogeneity is the only means of hatching the knowledge inculcated by the university. It therefore appears that if African’s university desire to overcome the crisis, they must have to take the path back to endogeneity. This is what we want to explain through this communication, and principally, we want to show that only the connexion between spirit life and action can lead to knowledge.In order to overcome the crisis, the African’s University must build the theory of knowledge on African author who understand the connexion between spirit life and action. This is the challenge of any university.
Keywords : Authenticity, Endogeneity, Self-referentiality, Spiritual, Knowledge, University.
Introduction
« La crise n’est dramatique que lorsqu’on l’affronte avec des solutions anciennes » (Hannah Arendt, 1966, Introduction). Ces illustres mots de la philosophe française, Hannah Arendt, peignent admirablement la situation générale de l’Afrique à l’heure où de multiples opportunités s’offrent à elle pour reconquérir l’authenticité de son être. À bien des égards, l’Afrique reste et demeure encore ce continent calqué sur des valeurs exogènes, lesquelles valeurs, en perpétuel conflit avec son essence africaine, créent une sorte de blocage, un barrage de fer, une solide muraille dans le processus de la reconquête de cette authenticité. À y voir de près, nous nous rendons compte que la résolution de cette crise doit partir d’un élément aussi commun qu’intrinsèque à l’humain : la pensée.
C’est dire que cette crise des sociétés africaines est d’abord et avant tout une crise de la rationalité. Cette crise de la rationalité s’origine dans les profonds bouleversements orchestrés par le cogito cartésien depuis la période moderne, mais aussi et surtout par l’instabilité intellectuelle due à l’inadéquation de la spiritualité contemporaine à la rationalité idoine dans l’Afrique d’aujourd’hui. L’Université Africaine comme lieu par excellence de recherche, d’enseignement et de formation de l’esprit, se voit ainsi mise à mal dans son rôle prépondérant de stimulation de la pensée et d’orientation intellectuelle des peuples africains.
Cette série de constats est d’autant plus amère et poignante que dans la tradition philosophique, le chantre de l’existentialisme chrétien, Karl Jaspers s’interrogeait déjà sur le lien entre spiritualité et raison dans la redynamisation de l’université pour chaque société. Dans son ouvrage La crise spirituelle de notre époque, il décrit une méthode triphasée qui servira de base à notre réflexion sur la crise de la rationalité dans les universités africaines. Quelles sont les voies sur lesquelles doivent s’engager les universités africaines pour résoudre cette crise de la rationalité ? En quoi, l’ébauche jaspersienne peut-elle servir de base pour une autoréférentialité plus effective dans les universités africaines ? Mieux, comment refonder la vie de l’esprit des universités africaines pour qu’en accomplissant leurs tâches elles produisent un savoir endogène et autoréférentiel ?
1. Déclin de la vie de l’esprit dans les universités
La spiritualité occidentale nous apprend que l’être humain est tridimensionné, c’est-à-dire qu’il est composé d’un corps visible et physique (grâce auquel, il a une existence matérielle et visible), d’un esprit et d’une âme qui sont deux entités invisibles. Ici, dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à l’esprit, siège des facultés cognitives et intellectuelles.
1.1. La vie intellectuelle, une vie dans l’esprit
Du latin spiritus, esprit se dit du principe de la pensée comme réalité pensante ou de la faculté de penser. Descartes, le maître à penser du cogito, définira comme « la substance, dans laquelle réside immédiatement la pensée »[121]. De fait, parler d’esprit, c’est parler de pensée et qui dit pensée dit inéluctablement raison. Mais, quelle est la motivation de cette inférence ?
L’humain est un être ontologiquement religieux. Sa religiosité quelle qu’elle soit, s’ancre dans une sorte de vie de l’esprit qui se manifeste en spiritualité. La spiritualité est en effet, l’essence même de la vie de l’esprit en tant que siège de la pensée et élan vers l’acte rationnel. En outre, au nombre des besoins fondamentaux, nous dénombrons celui de l’instruction. L’instruction est un volet majeur de la vie humaine. Ce volet majeur tire sa source de la vie de l’esprit ou de la spiritualité qui est, elle-même, façonnée par l’environnement et les aspirations les plus profondes du cœur.
En science, la vie de l’esprit, telle qu’elle est perçue, n’a rien de commun à ce que l’on pense ordinairement. En effet, s’il faut, pour réaliser une bonne recherche scientifique, un esprit avisé, objectif et vif, la vie de l’esprit dès lors ne peut être chose banale. Autrement dit, la vie de l’esprit est une vie possédant ses propres règles. Ces règles sont tributaires d’une connaissance des contenus absolument certains et universellement valables, puisque « la science, voie indispensable conduisant à la pensée, naît de l’approfondissement du processus de connaissance » (G. Bertin, 1942, p. 2). Ainsi, la vie de l’esprit se révèle comme une « lutte avec l’objet dissous pour donner à voir ce qui est derrière lui » (Idem).
C’est dire que l’objet où qu’il soit et quel qu’il soit peut être appréhendé par l’esprit si et seulement s’il s’inscrit dans une démarche méthodique bien définie et adéquate. On comprend alors que l’universalité de la science actuelle ne provient que de « son ouverture à toutes les possibilités de choses insoupçonnées » (Idem). Dans cette ouverture, se laisse voir une certaine créativité conceptuelle. En effet, la pensée sous ce prisme méthodique est déclinée par des concepts qui traduisent donc les diverses données de la science.
Ces éléments préliminaires sont en réalité, les fondamentaux de toute science à l’ère où grâce à la mondialisation, les barrières sont brisées. Mais, en portant un autre regard sur la question, on s’aperçoit que cette universalité dans laquelle s’inscrit aujourd’hui la recherche scientifique a comme limite fondamentale, l’aspect particulier, propre à chaque région et à chaque culture. Dans ce sillage, la connaissance scientifique s’appuie sur trois éléments fondamentaux : – les règles de la logique ; – le choix de l’objet qui se fait à l’aune des idées ; – la recherche de sens.
À ce titre, la spiritualité africaine dans le domaine de la science doit se refonder sur ces éléments en leur donnant une âme purement, ontologiquement et authentiquement, africaine. D’où la nécessité d’un élargissement conceptuel qui en appelle à la logique de l’humain au détriment de celle occidentale. Celle-ci jusque-là est façonnée par les catégories aristotéliciennes entérinées par Descartes pour le compte de la modernité, mais qui ne répondent plus aux exigences culturelles actuelles. C’est dans cet élan que s’inscrit d’ailleurs Paulin Hountondji (1997, p. 250) lorsqu’il invite l’Africain lui-même à « valoriser avant tout sa propre différence culturelle ». On comprend donc que la logique occidentale n’est pas la seule qui a valeur d’universalité. Paul Christian Kiti nous le fait toucher du doigt lorsque, commentant La crise du Muntu de Fabien Eboussi-Boulaga il affirme que « cette erreur consiste en la démission de la pensée en la naïve illusion que l’adoption sans condition de la philosophie telle qu’elle s’est déployée en Occident suffirait à sortir le Muntu de ses contradictions et de son aliénation » (C. Kiti, 2020, p. 43).
1.2. Vie de l’esprit comme lieu d’élaboration de la rationalité universitaire
Face au déclin de la rationalité occidentale, reste posée cette question sensée : que doit faire l’Afrique ? Un essai de réponse nous est fourni par Hountondji (1997, p. 258) lorsqu’il invite l’Afrique à « une réappropriation intelligente, c’est-à-dire méthodique et critique, des savoirs et savoir-faire propres » à elle-même. De fait, la nouvelle vie de l’esprit que nous prônons pour l’Afrique est une vie de l’esprit dont les règles de la logique sont à inventer comme l’a fait Meinrad Hebga dans son ouvrage Rationalité d’un discours africain sur les phénomènes paranormaux et que soutient aujourd’hui toute la jeune classe intellectuelle :
S’assumer en tant qu’être raisonnable, c’est aussi et surtout, dans le contexte africain, prendre de la distance, conquérir son autonomie rationnelle [….] Il faut que nous brisions les chaînes de doctrines, d’idées préconçues dans lesquelles nous avons été les captifs durant des milliers d’années, et dans lesquelles nous nous plaisons(…). Nous devons sortir de cette torpeur, de ce sommeil, et réfléchir par nous-mêmes, car il n’est pas besoin d’errer par-delà les mers pour apprendre à lier le bois au bois, vaincre sans avoir raison. Mais pour cela, il faut une réelle prise de conscience, un véritable retour en soi pour y puiser la force rationnelle nécessaire, mais aussi pour retrouver et faire revivre l’âme africaine blessée. C’est en ce sens que le particulier africain vaudra autant que l’est l’universel ». (Lissagbe Jude, 2019, p. 28).
Ensuite, le choix de l’objet est une tâche assez délicate. En effet, le choix de l’objet doit se faire en toute liberté d’esprit, en toute impartialité de sorte que la démarche scientifique ne soit pas déjà faussée à la base. Il en ressort donc que « les considérations personnelles, partisanes ou utilitaires » (Notes de G. Bertin, p. 2), à l’instar des revendications survenues à l’aune de Philosophie bantoue de Tempels durant la période des indépendances, ne favorisent en rien le développement d’une vie de l’esprit dans les universités africaines. C’est d’ailleurs ce contre quoi Hountondji s’est élevé en critiquant l’ethnophilosophie. Il affirme dans cet élan que « la philosophie africaine contemporaine, dans la mesure où elle reste ethnophilosophie, a été élaborée avant tout pour un public européen. Le discours des ethnophilosophes n’est pas destiné à leurs compatriotes africains » (P. Hountondji 1980, p. 35). Il va encore plus loin en montrant qu’« en Afrique, on ne faisait aucun effort pour formuler des questions nouvelles et originales. Répondre aux questions des autres, tel semblait être notre destin » (Ibid., p. 238). Cette réflexion de Hountondji, nous amène à déduire que le choix de l’objet dans la vie de l’esprit doit être guidé par les idées, lesquelles idées doivent avoir des racines profondément endogènes.
Enfin, la recherche de sens devient la conséquence directe des deux précédentes conditions. Là encore, un travail assez minutieux doit être réalisé afin de relever le défi des savoirs endogènes. Celui-ci est « le pari pour la rationalité » qui nous conduit à « la construction d’un rationalisme élargi qui permette d’intégrer des catégories de faits jusque-là exclues, par le discours scientifique dominant, de l’éventail des faits possibles » (P. Hountondji, 1997, p. 258). À terme, le sens que prendra la connaissance scientifique devra nécessairement être universalisable d’autant plus que tout universel est porté par un particulier.
Par ailleurs, un autre élément de la vie de l’esprit dans la pensée jaspersienne est l’utilité et la finalité en soi de la science. Bien souvent, ces deux aspects de la vie de l’esprit sont occultés pour se calquer sur le modèle occidental qui demeure impropre à nos cultures africaines. Dans cette perspective, il spécifie sa réflexion sur ce sujet autour de deux axes majeurs que sont : l’esprit de recherche en soi et l’esprit de découverte purement utilitaire. Ces deux axes doivent conduire le scientifique africain à produire un savoir qui se déploie dans sa manière d’être, autrement dit un savoir comme savoir-être. Pour y parvenir, un recours inéluctable à l’esprit, l’existence et la raison est nécessaire.
Dans le compte rendu de l’ouvrage De l’université de Karl Jaspers écrit en 1946, Georges Bertin, fait de pertinentes analyses sur le rapport vie spirituelle et créativité à l’université. Selon lui, Jaspers dans sa réflexion se serait permis d’éclairer ces concepts fondamentaux de la vie de l’esprit. Ainsi, pour lui, « l’esprit est puissance de la vision, imagination sans laquelle aucune science n’est créatrice » (K. Jaspers, 1946, p. 18) tandis que « la raison, par la logique, organise la pensée, met les choses en rapport, met en valeur les contradictions, et ne laisse pas à l’état d’isolement telle chose ou telle pensée » (Idem, p. 54). L’esprit est donc ce qui fonde toute créativité et qui de fait, offre de multiples solutions pour surmonter les crises et les difficultés de n’importe quel processus de connaissance. D’un autre côté, la raison vient à son tour pour analyser et mettre en lumière les éléments susceptibles réellement de faire progresser la science. Entre ces deux entités se situent l’existence qui « soutient la vie de l’esprit, par la conscience de soi-même qui donne de la force aux idées » (Idem). De fait, la vie de l’esprit engage le scientifique à saisir le réel à partir d’une méthode rationnelle basée sur la recherche d’une Vérité Une et totalisante. Quelles sont alors les tâches de l’Université Africaine dans la nouvelle spiritualité qui résout cette crise de la rationalité ?
2. Redécouvrir les tâches de l’Université Africaine
Une fois le travail mené au niveau de la spiritualité ou de la vie de l’esprit, nous disposons des armes nécessaires pour relire les tâches majeures et prépondérantes de l’Université Africaine en les inculturant pour penser réellement en Africains. Karl Jaspers estimé à ce niveau que l’ultime tâche de l’université, c’est la recherche en vue de l’enseignement à une éducation adéquate.
2.1. Présupposés de l’existence de l’université
De fait, l’Université à travers la recherche, l’enseignement et la formation ou l’éducation s’engage à construire la personne et à lui donner les armes intellectuelles nécessaires pour devenir réellement un humain dont le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être sont ancrés dans sa culture, son histoire et participent du savoir universel. Au nom de la sacralité de cette mission et de l’Unité de ces tâches, Jaspers affirme « qu’il est impossible d’isoler une seule finalité sans anéantir la substance spirituelle de l’Université » (K. Jaspers, 1946, p. 113), car elles « sont des moments d’un tout vivant. Leur isolement entraînerait la mort de toute spiritualité » (Idem).
À cet effet, la recherche comme première tâche de l’université est fondamentale. Ainsi, la recherche comme un ensemble organisé et méthodique de démarches permettant de constituer des contenus qui répondent aux principes généraux de la science offre de la matière à l’enseignant et permet de produire un savoir scientifique. Ce chemin de recherche nous est tracé par d’illustres philosophes africains à l’instar de Jacob Agossou avec sa thèse Gbèto et Gbèdoto, pour la recherche en théologie africaine contemporaine ; Paulin Hountondji dans son œuvre Les Savoirs endogènes (Pistes pour une recherche) pour la recherche en épistémologie ; ou encore Fabien Eboussi Boulaga, Michel Kouam, Ramsès Boa, en anthropologie africaine…
Si l’Université Africaine faillit, donc à cette tâche première et déterminante déjà entreprise par ses pères, elle ne pourra que demeurer dans une crise perpétuelle qui la maintiendrait en subalterne. En outre, l’acte de la recherche sous un autre angle permet aux étudiants de saisir « l’idée de la totalité de la science » (Karl Jaspers, p. 18). Cela est d’autant plus important que « toute personne qui exerce une profession intellectuelle, dans sa façon de penser et d’aborder les choses, est un chercheur, mais un chercheur qui reste dans le mouvement de la connaissance et qui, par ses idées, vise le tout » (K. Jaspers, 1946, p. 66). Cependant, la recherche manquerait de richesse si elle n’était pas communiquée, transmise, enseignée.
Cette tâche revient à l’enseignant en sa qualité de maître du savoir et devancier de ses étudiants. Il a alors pour responsabilité de mobiliser tout le matériel nécessaire à la transmission de ce savoir comme savoir-faire mais aussi et surtout comme savoir-être. Également, à ce niveau, il devra faire preuve de créativité et d’audace intellectuelle. Les colloques, les études sur le terrain, l’élaboration de documents, etc. sont autant d’armes qui permettent à l’enseignant en particulier et à l’Université en général de remplir sa tâche d’enseignement.
Allant sur le terrain de la formation ou de l’éducation, nous nous rendons compte qu’en tant que suite logique de la recherche et de l’enseignement, est l’image vivante de l’accomplissement des tâches de l’Université. Au regard de ce qu’a été jusque-là cette tâche de l’Université, il ressort que deux écueils majeurs sont désormais à extirper de l’Université Africaine afin d’entrer pleinement dans le renouveau qui fera de l’Afrique un continent véritablement authentique en matière de pensée. Ces deux écueils, héritage de l’esclavage et de la colonisation, sont : la voie scolastique et la soumission à l’autorité d’un maître (la logique de consommation).
2.2. De la réforme de l’université africaine
Toute université doit être bâtie à partir de sa réalité socioculturelle que l’enseignement est appelé à traduire, voire à transmettre. Ce fut le rôle de la scolastique. Au sujet de la voie scolastique, c’est une sorte d’éducation qui ne vise que le clivage de la connaissance en groupes de pensée. En général, ces groupes de pensée nommés en terme plus adéquat écoles desservent les universités puisque fondés sur la transmission d’un savoir qui se limite à « la seule livraison de savoirs que d’aucuns seraient sensés posséder, créant un système inerte et non vivant coupant de fait toute voie à la réalisation personnelle, les contenus s’y résument à des formules toutes faites, à la récitation » (Karl Jaspers). Le mal dans ce type d’éducation ou de formation est qu’il sclérose la pensée des étudiants en réduisant leurs chances de s’ouvrir à un savoir impartial et large. En quelque sorte, « le savoir y est définitivement arrêté à une conception du monde ordonné » (Idem). La contrepartie d’une telle éducation est la sécurité affective, mais aussi et surtout une certaine facilité réflexive qui est au service de l’être humain.
D’un autre côté, nous avons la soumission à l’autorité d’un maître qui conduit inéluctablement à un déni de responsabilité et à terme à un déni de soi. Ce type de formation ou d’éducation très présent dans les sociétés africaines s’origine dans les deux grandes affres de l’histoire africaine et sont la preuve éloquente de cette logique de consommation qui détruit le potentiel réflexif africain (K. Jaspers, 1946, p. 3) :
Il en découle le besoin de se soumettre, de ne pas prendre de responsabilités, la facilité de suivre les autres, le renforcement de la conscience de soi n’y existe que dans le mécanisme d’appartenance, d’allégeance, quand on ne s’autorise plus à « devenir soi-même » son propre.
Pour le renouveau escompté pour résoudre la crise de la rationalité, il faut s’enraciner dans une éducation dite « socratique ». En effet, ce type d’éducation exclut tout dogmatisme puisqu’aucune doctrine n’est éternelle et « seulement le questionnement sans fin et le non savoir dans l’absolu. La responsabilité personnelle y est poussée à l’extrême » (Idem, p. 4). L’étudiant est donc complètement impliqué dans le processus qui lui fait acquérir le savoir. Il doit donc « accoucher des forces qu’il a en lui-même et qu’il met librement en partage » (Ibidem, p. 5). De fait, la liberté de pensée est une base fondamentale et est, selon Karl Jaspers, la tâche de l’université. Par ailleurs, afin de ne pas porter entorse au principe fondamental de l’université, « le professeur doit savoir résister à la tentative de séduction d’étudiants qui voudraient faire de lui une autorité et un maître à penser » (Ibidem).
Rappelons-le, l’université a pour principe d’« offrir tous les outils et toutes les possibilités dans le domaine intellectuel, conduire jusqu’aux limites, dans toutes les décisions liées à l’action, renvoyer l’esprit à lui-même et à sa propre responsabilité » (K. Jaspers, 1946, p. 72). On se rend donc compte que tout ce qui précède n’est possible que grâce à la communication intellectuelle adéquate à l’université. Ainsi, les « discussions et mises en question dans le débat rationnel, la communication intellectuelle fondée sur la clarté, sachant que tout résultat n’est qu’un palier et la discussion sans limites dans l’écoute des autres ». Pour Jaspers donc, tous ces éléments de réflexion doivent être évalués lors du choix des enseignants d’université, car « l’Université est certes, aussi, une institution, mais lorsqu’elle tend à devenir une fin en soi, elle a tendance à se dégrader d’où l’importance d’un contrôle qui doit porter sur les finalités, à savoir sa réalisation de l’Idée plutôt que sur son organisation ». Il en conclut donc que lorsque l’université n’est calquée que son aspect bureaucratique, elle subit un nivellement par le bas qui la mène progressivement à sa perte totale.
3. L’autoréférentialité et l’endogénéité du savoir comme clés pour sortir de la crise : le paradigme de la « Raison sensible »
3.1. L’autoréférentialité et endogénéité du savoir pour sauver l’université africaine
Néologisme mis en œuvre par le professeur Mahougnon Kakpo lors d’un séminaire doctoral (12-13 Avril 2022), l’autoréférentialité annonce l’épistémologie africaine du savoir. L’endogénéité du savoir tel que l’évoque Joseph Ki-Zerbo dans Eduquer ou Périr implique la décision de « penser et de penser par soi-même » pour faire accéder le particulier à l’universel en surmontant le faux universel. Celui-ci jusque-là aura limité le savoir à une rationalité étrangère à celle du sujet pensant. Ce fut la cause de la crise que nous avons jusque-là analysée. L’autoréférentialité sous cet angle est on ne peut plus capitale puisqu’elle ouvre le chemin pour une réelle assomption de notre héritage scientifique culturel. Hountondji l’atteste en affirmant que « pour mettre fin à l’extraversion, il faut commencer par s’assumer pleinement, de manière lucide et responsable » (P. Hountondji, 1997, p. 258). Plus loin, il trace tout le chemin :
Si l’on partage cet idéal, l’on reconnaîtra aisément la nécessité, dans le domaine du savoir et du savoir-faire, de ce double mouvement indispensable à la construction d’une Afrique autocentrée et intellectuellement souveraine : un mouvement d’appropriation scientifique de l’héritage scientifique et technologique internationalement disponible et (…) un effort de réappropriation, non moins critique et responsable des savoirs et du savoir-faire endogène. (P. Hountondji, 1997, p. 260).
Le caractère critique de toute la démarche autoréférentielle ne peut être effectif réellement qu’en incluant la pensée philosophique au cœur de toute l’action universitaire. De fait, par un usage méthodique et idoine des outils philosophiques dans l’élaboration des savoirs endogènes, nous pourrons, comme l’affirme le professeur Désiré Medegnon, « distinguer les savoirs consistants des représentations mythologiques et infondées » (D. Mèdegnon, 2021, p. 88). En clair, l’autoréférentialité permettra de produire un savoir qui s’enracine en l’Africain dans un savoir endogène et qui sert d’abord l’Africain. Cependant, tout particulier devant nécessairement pouvoir être universalisable, cette démarche ouvrira large le champ de la réflexion scientifique en Afrique « pour que soient extirpés sur la planète Terre, les germes d’irrationalité, et progressivement éliminées l’ignorance et la misère » (P. Hountondji, 1997, p. 261).
3.2. La « raison sensible » pour surmonter toute crise de la pensée
À notre époque, la pensée est en crise. L’université en est le vecteur révélateur. La crise de l’université est donc une crise de la pensée. C’est ce que nous avons pu démontrer jusque-là. Mais le paradigme ayant occasionné une telle crise est plus celui de la modernité. En effet, avec la crise de la rationalité dont la modernité est le pôle d’émergence, on a assisté à des conflits d’opposition en Vie-Mort ; Bon-Mauvais ; Riche-Pauvre ; Bien-Mal à telle enseigne que la société s’est maintenue dans un dualisme étriqué. Les crimes contre l’humanité et la crise anthropologique des deux guerres mondiales vont ouvrir à une reprise herméneutique qui caractérise le siècle naissant et ce, dans la logique derridarienne de Reconstruction ou encore de Réappropriation pour rester avec P. Hountondji.
Celle-ci nécessite un nouveau paradigme, cette fois-ci méthodologique et aussi conceptuel. La prise de conscience de la finitude humaine comme fondement de l’être-au-monde, ouvre au principe de « raison sensible » comme paradigme de conciliation du sensible et du rationnel dans l’ordre de la pensée. Dans notre écrit de 2020, « Raison sensible pure » pour comprendre la philosophie de Heidegger (Eme, Bruxelles, 2020), nous avons indiqué, comme le penseur du sens de l’être, comment le retour à notre monisme intégral devra favoriser le commencement de la pensée de l’être humain dans son authenticité. En réalité, c’est là que se situe l’axiome de la métaphysique africaine ou en Afrique. L’humain, mesure et fin de toute chose, est un être à la fois holistique et organique.
Le principe méthodologique de « raison sensible pure » qui s’impose vise à faire comprendre qu’aucune rationalité, jeu d’esprit et d’intelligence, ne peut s’énoncer en dehors d’un corps charnel. Il en résulte la conciliation des contraires comme possibilités de connaissance. C’est à ce prix que tout savoir peut déboucher sur un savoir-faire d’une part et tout savoir-faire sur un savoir-être d’autre part. Les recherches universitaires actuelles, surtout en Afrique, gagneraient à s’inscrire radicalement dans ce nouveau paradigme dont toute l’humanité est en attente. Mieux dit, il urge de sauver l’Université Africaine à l’ère où la mondialisation est à son paroxysme et où les crises se multiplient comme pour éveiller la conscience des Africains sur ce qu’ils sont. C’est pourquoi, tout en proposant la raison sensible pure comme méthode, nous appelons de tous nos désirs un renouveau paradigmatique qui se fera à partir de l’autoréférentialité pour l’endogénéité du savoir. En effet, ces deux concepts qui ne sont pas nouveaux revêtent néanmoins un sens assez profond dans l’âme intellectuelle africaine, car l’Afrique demeure le seul continent où de nobles et belles valeurs sont encore en attente de promotion. C’est d’ailleurs ce pourquoi, Paulin Hountondji lance ce vibrant appel :
Nous devons viser haut et loin, tâcher de nous approprier, à terme, tout l’héritage scientifique disponible dans le monde (…) le développer nous-mêmes de manière sélective et indépendante, en fonction de nos besoins réels et de nos projets » (P. Hountondji 1997 p. 248).
Tout cela milite donc en faveur d’un déplacement de référence afin de donner tout leur sens et leur éminente valeur à nos savoirs endogènes. C’est en réalité l’objectif visé par l’autoréférentialité : nous faire penser par nous-mêmes. Et donc comme nous le fait appréhender Grégoire-Sylvestre Gainsi, « il ne s’agit pas de se borner à la rationalité technoscientifique [mais] à la suite de Meinrad Hebga, nous pouvons essayer d’élaborer un discours rationnel africain sur nos savoir-faire. » (G. Gainsi, 2021, p. 77). Il poursuit d’ailleurs :
C’est ce que Hebga a compris en sortant de l’anthropologie dualiste de l’Occident pour montrer une conception triadique africaine de l’homme : le corps, l’ombre et le souffle. C’est grâce à cette vision africaine de l’homme que Hebga a pu proposer un discours rationnel sur les phénomènes paranormaux. (Idem)
Conclusion
La crise de l’université africaine est une interpellation à rebâtir le savoir en Afrique. Ceci suppose la déconstruction de la logique coloniale au profit de la reconstruction du savoir-faire africain comme savoir-être. C’est ce qui a poussé à une lecture combinée de l’Idée de l’université de Karl Jaspers avec La spiritualité de notre époque du même auteur.
Ainsi avons-nous essayé à travers la réflexion produite par Karl Jaspers sur la crise des Universités allemandes après la seconde guerre mondiale, de définir trois orientations qui peuvent servir de fondement pour dissiper cette crise. Tout d’abord, nous avons orienté la réflexion sur la vie de l’esprit pour voir le lien entre la spiritualité et l’acte intellectuel. Grâce aux apports de plusieurs auteurs africains, nous avons pu toucher du doigt l’urgence d’une réforme de la spiritualité afin d’élaborer une rationalité authentiquement africaine. Ce débat nous a mené ensuite, à la découverte des tâches de l’université pour voir ce en quoi les universités africaines manquent à leur devoir fondamental.
Il en ressort qu’en faisant prendre un nouveau souffle aux universités africaines à partir de la recherche, de l’enseignement et surtout d’une éducation fondée sur des bases socratiques, l’Afrique pourra sortir de l’extraversion qui la rend consommatrice passive de toute la science occidentale. Enfin, nous avons suggéré à l’aune de la raison sensible pure, notre méthode, le tandem autoréférentialité et endogénéité du savoir pour faire prendre conscience à l’Afrique de son potentiel mais aussi lui fournir des approches de solutions pour conjurer cette crise de la rationalité. Et puisque « [cette] rationalité n’est pas donnée d’avance, [qu’] elle est à construire et (…) n’est ni derrière nous, mais devant nous » (P. Hountondji, 1997, p. 261), il nous faut nous armer pour relever ce défi incontournable pour l’Afrique d’aujourd’hui. Car, comme le souligne si fortement l’un des intellectuels de ce beau continent de l’avenir de l’humanité :
En face d’une Afrique ancienne, une Afrique nouvelle est en train de naitre. Quelle sera-t-elle ? Bien malin qui peut déjà la définir. Quoi qu’il en soit, elle sera l’œuvre de nos mains. Voilà pourquoi, il faut se mettre au travail pour que l’Afrique reste elle-même au rendez-vous de l’universel » (J. Agossou, 1971, p. 224).
Références bibliographiques
ABDELKADER A., 2002, « En Afrique, l’enseignement supérieur sacrifié », in Le Monde Diplomatique, mars.
AGOSSOU Jacob, 1971, « Gbεtɔ́ et Gbєɖotó « l’homme et le Dieu créateur », selon les sud-dahoméens. De la dialectique de Participation Vitale à une théologie Anthropocentrique », Paris, ICP.
ARENDT Hannah, 1972, La crie de la culture, Paris, Gallimard.
CHACHAGE Chambi I. S, 2001, « Les transformations de l’enseignement supérieur et l’exterminisme académique », in Bulletin du CODESRIA, N°1 et 2.
DASTUR Françoise, 2011, Heidegger et la pensée à venir, Paris, Vrin.
HOUNTONDJI Paulin, 1997, Combats pour le sens. Cotonou, Flamboyant.
HOUNTONDJI Paulin, 1977, Sur la philosophie africaine. Paris, Présence Africaine.
JASPERS Karl, 1946, La situation spirituelle de notre époque, trad. 1956. Paris, Flammarion.
KAKPO Mahougnon, 2022, « Séminaire sur l’autoréférentialité », LAREFA, UAC.
KITI C. Medegnon D., A-R. Ndiaye, 2020, La quête du sens. Mélanges offerts à Paulin Hountondji à l’occasion de ses 80 ans, Cotonou, Star Editions.
LISSAGBE J. 2019, Philosophie africaines : Des controverses au dépassement, Philosophat de Djimè.
MAKOSSO Bethuel, 2006 « La crise de l’enseignement supérieur en Afrique francophone : une analyse pour les cas du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo et de la Côte d’Ivoire », in Revue JHEA RESA, Vol. 4, N°1.
NEKPO C., 1998, Éducation et Culture, Porto- Novo CNPMS.
TECHOU Roland, 2020, Je suis Je pense, Introduction à la philosophie de la finitude, Cotonou, Philosophat.
TECHOU Roland, 2020, Raison sensible pure. Pour comprendre la phénoménologie de Martin Heidegger, EME, Bruxelles.
WAAST Roland, 2002, L’état des Sciences en Afrique, Rapport d’études, Paris, Ministère des Affaires étrangères.
L’ENGAGEMENT DES UNIVERSITAIRES FACE AUX RÉALITÉS SOCIALES CHEZ MARCUSE
Amara SALIFOU
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Enseignant d’université ayant lui-même eu maille à partir avec plusieurs gouvernants de sa terre d’accueil, les États-Unis d’Amérique, pour ses positions considérées comme étant extrémistes, gauchistes, communistes, Herbert Marcuse demeure un philosophe dont l’engagement allie devoir et action dans la société. C’est sous une telle impulsion que cet article rappelle l’engagement des universitaires en général, et africains en particulier, dans le sens de leur implication face aux réalités de leur statut et rôle dans la société. En nous appuyant sur une méthode, historique, analytique et critique, nous verrons dans un premier sens, la place des universitaires dans les luttes sociales en référence à l’École de Francfort. Dans un second sens, nous porterons notre analyse sur la forme et le sens de leur engagement face aux défis sociaux. Enfin nous aborderons, dans le cas africain, les perspectives de sortie de crises sociales à la lumière des universitaires.
Mots clés : Afrique, Changement, Engagement, Lutte, Société, Université, Théorie critique.
Abstract:
University teacher having himself had trouble with several rulers of his host country, the United States of America, for his positions considered to be extremist, leftist, communist, Herbert Marcuse remains a philosopher whose commitment combines duty and action in society. It is under such an impetus that this article recalls the commitment of academics in general and Africans in particular, in the sense of their involvement in the realities of their status and role in society. Based on a method, historical, analytical and critical, we will see in a first sense, the place of academics in social struggles with reference to the Frankfurt School. In a second sense, we will focus our analysis on the form and meaning of their commitment to social challenges. Finally, we will discuss, in the African case, the prospects for emerging from social crises in the light of academics.
Keywords : Africa, Change, Commitment, Struggle, Society, Critical theory, University.
Introduction
Lorsqu’Herbert Marcuse fuit l’Allemagne nazie en 1933 pour les États-Unis, il est déjà bien ancré dans le milieu universitaire et dans l’engagement social. H. D. Monvallier qui rapporte les écrits de C. Dupuydenus[122], note que Marcuse,
soutient une thèse en 1922 sur le Künstlerroman (« roman d’artiste »), genre littéraire dans lequel le héros de roman est un artiste en rupture avec son environnement social. Husserl fait partie du jury. Ce sujet de thèse montre, d’une part, l’intérêt de Marcuse pour la littérature et l’art qui ne se démentira pas jusqu’à la fin de sa vie.
En 1932 à Fribourg en Allemagne, il soutient une deuxième thèse de Doctorat sous la direction de Martin Heidegger, un philosophe dont la renommée est établie à cette époque. Sauf que cette renommée heideggérienne ne protège pas la vie de Marcuse tout comme celles de nombreux universitaires membres de l’École de Francfort à laquelle ce dernier appartient. L’origine juive de Marcuse et en général des universitaires de l’École de Francfort en gestation, semble d’avance les condamner. Leurs visions de chercheurs, penseurs, enseignants-chercheurs d’universités, face aux réalités sociales, leur engagement contre des faits où l’éthique est constamment foulée aux pieds, constituent certainement, un sacerdoce risqué. Chez Marcuse, cet engagement est particulier et se traduit par des positions claires que tout intellectuel, tout universitaire se doit de ne pas trahir au nom de valeurs universelles reconnues comme essentielles. Aussi bien, dans l’Allemagne inquisitrice tout comme sur les terres américaines qui lui offrent l’asile existentiel, l’universitaire Marcuse est constant dans la dénonciation et dans l’engagement universitaire tout en proposant divers horizons de libération de l’Homme. C’est pour cette raison qu’au-delà de Marcuse, il importe de s’interroger sur les contours de l’engagement des universitaires dans les réalités sociales. Quel sens les universitaires devraient-ils donner à leur statut dans les différentes sociétés face aux réalités de crises sociales qui engagent l’avenir de l’humanité ?
Pour Marcuse, les formes de domination, d’exclusion, d’exploitation injustifiable des minorités et des richesses mondiales ou des violences injustement justifiées, constituent une interpellation pour ceux qui défendent les valeurs universelles. Les universitaires en particulier, ne devraient pas laisser les ténèbres prendre le dessus. Il importe, pour chaque universitaire, de mener une réflexion qui repousse les frontières de l’obscurantisme tout en s’engageant aux côtés de toutes les forces qui promeuvent, l’éthique, l’équité et les voies d’une prospérité harmonieuse.
Dans une étude historique et critique, nous aborderons trois axes de réflexion pour mieux saisir la profondeur de la pensée marcusienne sur ce sujet. Nous porterons notre regard dans un premier temps, sur la particularité de Marcuse et de l’École de Francfort vis-à-vis des réalités sociales actuelles. Dans un second temps, nous examinerons le devoir éthique auquel les universitaires sont appelés face à la domination ambiante. Enfin, nous nous intéresserons aux propositions des universitaires, à la lumière des réflexions de Marcuse en regard des pays industriels et les moins industriellement avancés.
L’objectif que nous visons à travers cette étude est celui d’une meilleure implication des universitaires dans les réalités qui affectent le quotidien et l’avenir des sociétés. En termes de résultats, nous parviendrons à ré-établir d’une part, le lien entre l’université et les besoins de la société. D’autre part, il s’agira pour les universitaires, dans toute situation de crise sociale, locale ou internationale, de ne pas s’enfermer dans un mutisme coupable mais de s’engager à réfléchir sur nos avenirs communs.
1. Marcuse et l’École de Francfort face aux réalités sociales
Herbert Marcuse est un membre influent de l’Institut Social de Recherche devenu École de Francfort. Dans cette école composée d’universitaires allemands en particulier et d’origine juive de façon générale, Marcuse se singularise par une théorie critique, à la fois radicale, dénonciatrice, paradoxalement unificatrice des forces progressistes de la société. Il fait preuve d’un engagement socio-politique qu’il partage avec certains membres influents de cette école.
1.1. Le sens de l’engagement de l’École de Francfort dans la société
« L’expression « École de Francfort » est une étiquette collée de l’extérieur dans les années 60 » nous précise R. Wiggerhauss (1993, p. 4). Une appellation qui va devenir familière et historique vu qu’elle sera adoptée par les continuateurs de ce courant de pensée universitaire où critique, raison, politique, société, économie, art, technique sont des mots à usage courant. C’est, au début de l’année 1923 (que) fut donnée l’autorisation ministérielle pour « l’édification d’un institut de sciences sociales à l’Université de Francfort en tant qu’établissement scientifique, servant également des missions d’enseignement de l’Université (R. Wiggerhauss, 1993, p. 21).
L’institut ne porte pas en débat contradictoire uniquement les questions philosophiques. Il exprime clairement à sa naissance, son engagement universitaire à défendre les causes éthique et sociétale. Le regard des étudiants et particulièrement les enseignants universitaires sur la marche de la société, dans ses différents compartiments, est sollicité. L’Institut Social de Recherche s’inscrit dans une tradition critique à l’encontre de la rationalité techno-exploitante héritée des Lumières, une réappropriation du marxisme, une dénonciation des formes de domination et d’exclusions sociales. C’est en ce sens que H. Marcuse (1968, p. 158) rappelle que « la pensée (…) qui se veut critique est nécessairement transcendante et abstraite ». La théorique critique francfortoise se positionne comme une critique d’universitaires qui visent l’universalité tout en s’élevant au-dessus du conformisme ambiant des sociétés pour y introduire des réflexions critiques de remise en cause qui brisent les tendances non éthiques. L’objectif visé est de donner un sens authentiquement humain à la vie en société.
1.2. Du sens de la théorie critique de l’École de Francfort
Les réflexions des membres de l’École de Francfort ont en commun, la critique des formes déviationnistes des sociétés, leurs tendances dominatrices, une rationalité technicienne dont les conséquences dévastatrices sont légion. L’histoire rappelle en effet, une révolution industrielle au XXVIIIe siècle avec son corolaire de prolétaires, de travailleurs exploités, de terres confisquées, une crise financière mondiale en 1929, une première guerre mondiale en 1914 puis une deuxième en 1939, une colonisation des peuples africains dans les Amériques, en Asie etc. Face à une société qui est constamment dans le bain de crises, de guerres, des exploitations, des destructions de toutes sortes, la doctrine de l’École de Francfort se donne le devoir moral de ne pas être dans un mutisme, complice des drames organisés. C’est en ce sens que la réflexion de l’École de Francfort peut être perçue comme étant :
Le couple analytique-dialectique (qui) s’impose, dans la lettre même des écrits qui la constituent, comme l’accès le plus immédiat à la Théorie critique. À travers la Dialectique de la Raison de Horkheimer ou plus près de nous, dans les essais recueillis par Habermas sous le titre de Théorie et pratique, deux rationalités s’opposent : une rationalité analytique, dite aussi « technique » ou « instrumentale », et une rationalité dialectique, définie dans sa structure et son pouvoir comme une rationalité « critique-pratique » (P.-L. Assoun, G. Raulet, 1978, p. 9).
La théorie critique francfortoise précise son approche analytique, théorique, dialectique et pratique du monde dans lequel nous vivons. Il s’agit d’analyser les catégories qui structurent nos sociétés, d’en saisir les fondements et les orientations possibles, de comprendre les antagonismes qui y sont en œuvre, afin d’en saisir les contradictions qui l’inscrivent dans une régression constante. Ce travail ne sera sur la voie de l’achèvement que par l’implication du penseur aux côtés des forces du changement, pour l’amélioration des conditions d’existence et d’harmonie de vie au sein des populations. Chez Marcuse, cet engagement est manifeste.
1.3. La spécificité de l’engagement social de Marcuse
L’engagement universitaire, chez Marcuse, est constant dans la société. De l’étudiant qu’il était en Allemagne, au chercheur toujours dans ce pays, Marcuse maintient la flamme de l’engagement. Un devoir qui l’oblige à s’intéresser aux crises sociales ou militaires que traversent des pays des Amériques, en Europe, en Asie ou en Afrique.
Marcuse participe à l’âge de vingt ans aux Conseils révolutionnaires d’ouvriers et de soldats. Il se bat les armes à la main sur l’Alexanderplatz et connaît l’épisode tragique des assassinats de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Ces événements forgent sa conscience politique : « La social-démocratie allemande, déclare Marcuse dans un entretien, je dois vous dire que depuis que je suis vraiment né à la conscience politique en 1919, j’ai combattu ce parti. J’en ai été membre en 1917-1918, j’en suis sorti après l’assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht. Non parce que le parti travaille à l’intérieur du système […] mais parce qu’il travaille en collaboration avec les forces réactionnaires, destructrices et répressives. Les forces de gauche dans ce parti finissent toujours depuis 1918 par glisser à droite » (C. Dupuydenus, 2015, consulté le 9 mai 2022 à 9 heures 10 minutes).
Un engagement social aux côtés des travailleurs, des soldats, des politiques, du jeune Marcuse qui s’affirme aux antipodes de l’exploitation et surtout de toutes les formes subversives de la domination. Une valeur morale et éthique à laquelle il tient idéologiquement. C’est pourquoi, il dénonce l’arrivée du national-socialisme au pouvoir avec la politique fasciste d’Hitler. H. Marcuse (1969, p. 41) nous précise que « les discours des fascistes et des nazis furent des incitations au massacre » des populations sur des bases ethnico-sociales, professionnelles et idéologico-politiques.
Aux États-Unis où il est exilé en 1933, Marcuse continue de s’opposer idéologiquement au régime hitlérien en raison de la terreur, du totalitarisme qui le caractérisent et surtout de l’extermination des Juifs. « Il rejoint l’Institut de Recherche sociale, alors déplacé à l’université de Columbia, tout en travaillant pour le gouvernement (services de renseignements chargés de la dénazification) » (J.-L. Metzger, 2018, p. 30).
Un poste au service de l’État qui n’empêche pas l’universitaire Marcuse de conserver, son libre arbitre et son engagement social à la dénonciation, à la critique et à la lutte aux côtés des forces du progrès et du changement. En réponse à un collègue universitaire lors d’une conférence et des débats organisés par le Comité des étudiants de l’Université libre (FU) de Berlin-Ouest du 10 au 13 juillet 1967, H. Marcuse (1968, p. 86) rappelle que « si l’on veut construire une maison à la place d’une prison, il faut d’abord démolir la prison, sinon on ne peut même pas commencer à construire la maison ». Une telle position cadre avec l’idée pratique de la réflexion d’un universitaire qui ne saurait se murer dans la pure théorie spéculative.
2. Du devoir universitaire face à la domination dans la société
Comment pouvons-nous parvenir à rendre agréable nos sociétés par-delà la vie communautaire et notre environnement social si nous ne commençons pas d’abord par éliminer les pesanteurs de la domination ? C’est une préoccupation dans la méthodologie de Marcuse. Un intérêt qui devrait être partagé par les universitaires dans toute société.
2.1. Critique et dénonciation des formes de domination sociales chez Marcuse
La société humaine a cette particularité d’être multidimensionnelle avec des strates qui sont imbriquées. Ignorer cela dans une réflexion qui se veut sérieuse, encore plus au sein des universités, ne peut que participer à transmettre des irréalités. Comme conséquence, nous nous retrouvons en face d’une situation où :
La vision non complexe des sciences humaines, des sciences sociales, est de penser qu’il y a une réalité économique, d’un côté, une réalité psychologique de l’autre, une réalité démographique de l’autre, etc. On croit que ces catégories créées par les universités sont des réalités, mais on oublie que dans l’économique par exemple, il y a les besoins et les désirs humains. Derrière l’argent, il y a tout un monde de passions, il y a la psychologie humaine. Même dans les phénomènes économiques stricto sensu, jouent les phénomènes de foule, les phénomènes dits de panique, comme on l’a vu récemment encore à Wall Street et ailleurs. La dimension économique contient les autres dimensions et on ne peut comprendre nulle réalité de façon unidimensionnelle. (E. Morin, 2005, p. 92-93).
Si l’Université, temple de l’universalité, devrait participer à l’émiettement du monde, à la catégorisation de la connaissance, elle participerait ainsi, à la valorisation ou non, de tel secteur sur tel autre. Cette mutation inappropriée de l’université est aussi une forme de rationalisation de l’irrationnel. Ce serait une appréciation unidimensionnelle du monde, qui engagerait des réflexions supposées être dans un conformisme donné. Des voix pouvant être oubliées « au cachot du désespoir » comme nous le rappelle A. Césaire (1939, p. 40) ; l’université se taisant sur certains sujets sociaux, désacralise la sacralité de l’unité de son savoir. H. Marcuse (1969, p. 118-119) peut en ce sens proposer ceci :
Ce qui apparaît aujourd’hui comme une « politisation » externe de l’Université par des éléments radicaux relève, en réalité-comme si souvent dans le passé-de la dynamique interne, « logique » de l’enseignement : la connaissance se traduit en réalités, les valeurs humanistes en conditions humaines d’existence. Cette dynamique, bloquée par la prétendue neutralité de l’académie, serait rétablie si, par exemple, on incorporait aux programmes des cours qui étudieraient de façon pertinente les grands courants non conformistes de notre civilisation et l’analyse critique des sociétés contemporaines (…). Par le refus de la liberté d’action politique à l’Université, on perpétue la coupure entre la raison théorique et raison pratique, on restreint l’efficience et le champ d’action de l’intelligence.
La transcendance de la connaissance ne saurait être un refuge au-dessus des terres tout en ignorant la vie qui s’y déroule. La neutralité universitaire ne consiste pas à fermer les yeux sur l’univers auquel elle fait aussi partie. Il s’agit, pour l’université, d’être engagée dans la polis comme tout corps qui en fait partie. Les universitaires, avant même de proposer des visions possibles d’autres mondes, ont un devoir d’éviter toutes explosions de ce monde. C’est la leçon que partage avec nous, Marcuse sur le sol américain qui l’accueille.
2.2. De la non compromission chez Marcuse à la critique : le cas américain
L’universitaire ne saurait être le sujet de principes variables, sujets à la corruption et de vérités tronquées selon des circonstances, au mépris des valeurs éthiques. Se confiant à M. Rioux (1973, p. 234), Marcuse, au nom des principes éthiques qu’il défend, lui dit ceci : « Je n’enseigne plus. Depuis 1970 ».
La raison d’une telle réalité vient du fait que Marcuse est interdit d’enseigner. Ses enseignements sont jugés par les autorités américaines d’idéologiquement subversifs. Paradoxalement comme nous le présentent G. Dostaler et L. Racine (1969, p. 39).
Certains le dénoncent comme étant un agent de la C.I.A., d’autres le considèrent comme le nouveau théoricien de la révolution dans les sociétés capitalistes. La presse a beaucoup parlé de lui et l’a présenté comme étant le maître à penser des étudiants contestataires, l’inspirateur des événements de mai 1968 en France.
La réalité est que,
Marcuse (…) porte (…) un regard historique, critique et réaliste sur le dysfonctionnement du système capitaliste des États-Unis à l’encontre des minorités et dit comment réorienter le pouvoir matérialiste afin de faire disparaître la société conflictuelle et malheureuse qu’il ne cesse de nous offrir. (A. Salifou, 2017, p. 139).
Cette société américaine dont il remet le fonctionnement en cause est celle qui continue d’entretenir les vestiges de l’esclavage, de la colonisation, de la domination sur des minorités, de la marchandisation de la femme à travers par exemple, la publicité. Nous sommes dans une société avec une culture de violence par des guerres dans le monde, sans oublier une criminalité urbaine qui s’y enracine chaque jour, dans un pays supposé de bien-être social. H. Marcuse (1968, p. 87) peut s’offusquer du fait que,
nous avons (…) aux États-Unis des libertés, nous avons aujourd’hui un niveau de vie, un confort à peine croyable pour de vastes couches de la population. Mais nous sentons et nous savons (…) que nous avons aussi quelque chose d’autre : non seulement le Vietnam, non seulement une société qui installe partout dans le monde les États policiers et les dictatures les plus répressives ; car nous avons aussi une société qui, en son sein, dans la métropole même, traite les minorités raciales et nationales comme des citoyens de troisième zone, une société qui gaspille sa richesse de manière inouïe.
Ce sont des contradictions d’explosions sociales contre lesquelles Marcuse s’insurge de façon véhémente. Ses luttes par l’entremise des jeunesses estudiantines, les hippies, les ouvriers, lors du mouvement de Mai 68 attestent de son influence à contester les formes de domination. Sa présence aux cotés des minorités à travers les mouvements des droits civiques portés par les minorités raciales à l’exemple des noires, hispaniques, indiennes, confirme son engagement à la dénonciation. Sa bataille contre la criminalité urbaine et internationale des États-Unis est une interpellation radicale à ne jamais se taire contre la dangerosité dans laquelle ne cesse de s’engouffrer la société américaine. C’est dans ce continuum qu’un rapport de 2020 sur la criminalité aux États-Unis publié par les autorités sanitaires confirme la triste réalité dépeinte aux temps où Marcuse écrivait pour dénoncer les mêmes travers sociétaux qui entachent l’image des États-Unis. En voici la trame :
Le nombre de décès par armes à feu aux États-Unis a enregistré une hausse « historique » en 2020, selon un rapport des autorités sanitaires américaines publié (…). Avec 19 350 homicides cette année-là, en hausse de près de 35 % par rapport à 2019, et 24 245 suicides (+ 1,5 %), ces décès « représentent un problème de santé publique persistant et important », indiquent les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans leur rapport. Le taux d’homicide s’est établi à 6,1 pour 100 000 habitants en 2020, un record depuis plus de 25 ans. (2020 par le Parisien avec AFP publié Le 10 mai 2022 à 22h56 consulté le 16 mai 2022 à 14 heures 55 minutes).
Une triste situation qui exige des universitaires, un engagement constant auprès des sociétés afin de les mettre en éveil.
2.3. L’universitaire et la critique universelle chez Marcuse
En tant qu’universitaire, Marcuse considère que c’est un devoir d’aborder l’angle de la critique sociale sous une forme universelle. La critique sociale marcusienne s’intéresse à toutes les sociétés, qu’elles soient américaines, européennes, asiatiques, africaines ou arabes. Une critique qui est loin d’être une source d’opposition, d’affrontement et qui rappelle cet impératif d’E. Kant (1975, p. 150), « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». C’est un engagement dans lequel l’universitaire devrait constamment se situer tout étant loin des formes équilibristes. C’est ce qui explique que juif d’origine, H. Marcuse (1968, p. 129) n’en n’est pas moins critique à l’égard d’Israël dans la guerre qui l’oppose depuis la fin de la deuxième guerre mondiale à la Palestine :
On peut tenir l’établissement de l’État d’Israël pour une injustice, dans la mesure où cet État fut installé sur un sol étranger, en vertu d’un accord international, sans tenir compte vraiment de la population indigène et de son avenir. Mais cette injustice ne saurait être réparée par une seconde injustice encore plus grande. L’État existe, il faut qu’il s’entende avec ses voisins hostiles : c’est la seule solution. (…) Sa politique manifeste des caractères racistes et nationalistes qu’en tant que Juifs nous devrions et que nous devons rejeter. On ne saurait approuver que les Arabes soient traités en Israël comme des citoyens de deuxième ou de troisième zone.
Dire ce qui est, en rappelant le contexte historique et présent des réalités disharmonieuses et conflictuelles pour en rechercher les voies de solutions, est une quête de portée universelle et de pesanteur éthico-idéologique pour Marcuse. Il ne se limite pas à Israël mais s’intéresse aussi à l’autre belligérant, la Palestine,
c’est un fait que des représentants de pays arabes, et non des moindres, ont déclaré ouvertement qu’il fallait mener contre Israël une guerre d’extermination (…) Comment faire pour mettre fin à cet effrayant foyer de conflit ? (…) Nous devons tout faire ce qui est notre pouvoir pour que des représentants d’Israël et des Arabes se rencontrent et cherchent à résoudre en communs leurs problèmes-qui Dieu merci ne sont pas les problèmes des grandes puissances… (H. Marcuse, p. 129-130).
Il y a un esprit de générosité, de partage, de recherche de toutes les voies possibles d’une vie harmonieuse. La belligérance, l’ingérence intentionnelle et constante des intérêts ne peuvent que conduire à une escalade sans fin de violences et de destruction de vies humaines suivies de désolations, d’amertume. Il s’agit pour lui comme chez Kant, de traiter l’autre comme une fin de nos actes et non comme un moyen en vue de notre propre fin. Avoir le courage et l’honnêteté intellectuelle du statut de l’universitaire est une obligation à laquelle il ne faut pas déroger.
Dr Hawa Abdi, médecin-chirurgienne, de nationalité somalienne, ayant terminé ses études en Ukraine en 1971 grâce à une bourse de l’Union soviétique, arrive dans son pays meurtri par des coups d’État, des guerres interminables entre des factions rivales qui contrôlent des parties de la capitale somalienne, Mogadiscio et différentes régions du pays. Son pays ne compte qu’une soixantaine de médecins à cette époque dont une majorité d’étrangers. C’est dans un tel contexte, qu’avec ses collaborateurs elle sauvera des femmes, des enfants, des hommes sans distinction ethnique, religieuse, qui furent victimes des affrontements entre des bandes rivales en belligérance continuelle. Son engagement à sauver des populations victimes directes ou collatérales des guerres entre factions rivales armées a duré jusque dans les années 2000, lui a permis de sauver 90 000 vies. À tous ceux qui désespèrent, elle leur rappelle ceci : « Nous leur devons, à eux et à ceux qui vivent dans la proximité, de nous rappeler que nous n’avons reçu ni violence ni la destruction en héritage (D. H. Abdi avec S. J. Robbins, 2020, p. 12). Les crises sociales constituent pour l’universitaire un levain idéal quant à son implication dans la bonne marche d’un pays.
3. Des propositions d’affranchissement d’universitaires pour les pays industriels et industriellement moins avancés
Dans les pays industriellement avancés ou non, les crises sociales, les problèmes communautaires ou l’insécurité sont légion. En Afrique, les universitaires et leur statut d’élite intellectuelle les implique pour ainsi dire ontologiquement à l’engagement social.
3.1. L’accompagnement des sociétés en voie de développement par des universitaires : le cas des pays africains
L’engagement des universitaires dans la défense des intérêts des populations africaines a permis de relever de nombreux défis pendant les périodes coloniales (avant 1960), postcoloniales (entre 1960 et 1970), néocoloniales (depuis 1980). Pour l’histoire, on a une idée claire des mouvements conduits idéologiquement par les défenseurs de la négritude tels qu’Aimé Césaire (1913-2008), Léopold Sédar Senghor (1906-2001), Bernard Dadié (1916-2019) ou Birago Diop (1906-1989). Ils sont en majorité des universitaires formés dans de prestigieuses universités dont l’implication pour la reconnaissance universelle de la race a marqué l’histoire coloniale de l’Afrique noire. La lutte conduite par ces derniers pour l’émancipation de la race noire à l’échelle mondiale a impacté considérablement la lutte pour l’accession à l’indépendance de plusieurs colonies.
Universitaire engagé pour la cause des Noirs et de l’Algérie en guerre contre le colonisateur français, F. Fanon (2002, p. 203) donne un aperçu de la lutte pour l’émancipation des peuples noirs menée dans le cadre de la négritude et les victoires engrangées sur le continent et ailleurs en ces termes :
Le concept de négritude par exemple était l’antithèse affective sinon logique de cette insulte que l’homme blanc faisait à l’humanité. (..) Les chantres de la négritude n’hésiteront pas à transcender les limites du continent. D’Amérique des voix noires vont reprendre cet hymne avec une ampleur accrue. Le « monde noir » verra le jour et Busia du Ghana, Birago Diop du Sénégal, Hampaté Ba du Soudan, Saint-Clair Drake de Chicago n’hésiteront pas à affirmer l’existence de liens communs, de lignes de force identiques.
C’est une survie pour ces peuples, nous dit H. Marcuse (1973, p. 9) de ne pas laisser « (…) au Congo, au Nigéria, au Soudan (…) d’authentiques massacres qui déciment les populations qualifiées de « communistes » ou en révolte contre des gouvernements asservis aux nations impérialistes ». Les réflexions des universitaires africains participent ainsi à faire tomber les clichés infondés sur le continent et contribuent à une auto affirmation, un engagement des pays à tracer leurs propres voies de développement. Un autre combat des universitaires dans les pays industriellement avancés est sollicité.
3.2. Vision marcusienne pour un monde industriel moins contraignant
Dans la société industrielle établie, Marcuse constate que l’évolution technologique nous conduit à un conformisme. Ce que cette société nous offre, nous dit H. Marcuse (1971, p. 106), c’est que « l’universalité n’entretient plus qu’un rapport négatif avec la volonté rationnelle des individus : elle exige simplement la soumission ». Cette soumission ne saurait être véhiculée par les universitaires dans un monde où la critique semble ne plus être une qualité mais vue comme suspecte. Le rôle des universitaires est de refuser de faire partie du « troupeau » mais d’aider les sociétés industrielles à ne pas s’engouffrer dans un monde de vie où l’universalité est de plus en plus repoussée pour laisser libre cours à l’enfermement. C’est ainsi que F. Charillon (2022, p. 203) a pu soutenir que,
les chercheurs universitaires et think tankists accèdent à des terrains différents où leurs questions, leurs observations, leurs contacts ne seront pas les mêmes que ceux d’un diplomate ou d’un soldat. Ils brassent des idées qui ne sont pas discutées au sein des chancelleries, car elles n’ont ni le même objectif, ni les mêmes sources. Leur apport à l’analyse internationale est important à la fois comme source d’expertise et comme source de renouvellement d’une pensée qui pourra ensuite rayonner.
Il s’agit de se tourner vers les universitaires, défendant une cause qui n’est pas toujours celle des décideurs, mais ayant une vision moins immédiate, plus vaste du monde pour mieux le comprendre, l’accompagner ou améliorer sa gouvernance. Le terme « Think tank » qui se rapporte à la production de pensée nous invite à cela. Il faut produire des pensées plus généreuses et surtout efficientes pour nos sociétés.
3.3. De la générosité marcusienne aux possibilités : vers une société harmonieuse
Les éléments permettant à nos sociétés d’êtres moins angoissantes ou destructrices sont encore possibles. Ceux qui ont fait de la réflexion permanente, de la critique et des idées généreuses de l’universalité, les universitaires en particulier, devraient sans cesse garder ce cap. Si cela ne devait pas l’être, nous nous trouverions nous dit H. Marcuse (1970, p. 316) dans une situation hybride où :
La division entre sciences de la nature, les sciences sociales ou du comportement et les sciences humaines apparaît extrêmement superficielle (…) le malaise universitaire dans ce domaine ne fait que refléter générale (…) L’analyse de la société, du comportement social, voir individuel, à notre époque réclame-t-elle que l’on fasse abstraction de l’humanitas ?
L’humanitas auquel fait allusion Marcuse dans le texte cité ci-dessus, concerne à la fois, les êtres humains, leur cadre de vie et de travail, la nature tout entière, les idées humanitaires. Ainsi doivent-elles être véhiculées dans les canaux les plus importants de diffusion et dans notre environnement immédiat. C’est bien en ce sens que M. Schudson (2015, p. 3) s’étonne de ce que « les médias restent un sujet de second plan pour nos universitaires spécialisés dans l’étude des systèmes de gouvernement, alors même qu’ils sont au centre des préoccupations des professionnels de la politique ». Le canal de diffusion que représentent les médias devrait être une opportunité pour les universitaires dans la communication et la divulgation de leurs pensées. Les sociétés sont attirées ou se laissent attirées par les médias. Un impact pareil doit aussi représenter un intérêt pour les universitaires afin de voir ce qui est pour ou contre l’intérêt supérieur des populations.
Conclusion
Le devoir pour les universitaires est de s’intéresser aux problèmes qui minent les sociétés. Cela cadre parfaitement avec leur rôle d’intellectuels éclaireurs. C’est cette exigence que rappelle Herbert Marcuse dans la plupart de ses écrits. C’est cette dernière qui justifie la place et surtout le rôle des universitaires dans les luttes sociales en référence à l’objectif socio-politique de l’École de Francfort quant aux défis sociaux en rapport avec le cas africain. Une démarche accompagnée des perspectives de sortie des crises sociales à la lumière des universitaires. La validité de la thèse marcusienne tient du fait qu’elle s’inscrit dans les luttes historiques remportées par des universitaires pour des sociétés diverses. Même si la question de la sécurité et de la préservation de la vie d’universitaires qui se prononcent sur des drames que vivent les sociétés semble toujours d’actualité.
Références bibliographiques
ABDI Hawa avec ROBBINS Sarah J., 2020, Docteur de l’espoir. Elle a sauvé 90 000 vies, Paris, Nouveaux Horizons, trad. Marie Boudewyn.
ASSOUN Paul-Laurent et RAULET Gérard, 1978, Marxisme et théorie critique, Paris, Payot.
CESAIRE Aimé, 1939, Cahier d’un retour au pays natal, Présence africaine, Paris, 2ème édition.
CHARILLON Fréderic, 2022, Guerres d’influences. Les États à la conquête des esprits, Paris, Odile Jacob, Janvier.
DOSTALER Gilles et RACINE Luc, 1969 octobre-décembre, « Contre Marcuse. Essai sur la pensée idéologique dans les sociétés industrielles avancées », in Socialisme 69, Revue du socialisme international et québécois, N° 19.
DUPUYDENUS Claude, 2015, Herbert Marcuse. Les vertus de l’obstination, Autrement, « Universités populaires et Cie », in http://www.actu-philosophia.com/Claude-Dupuydenus-Herbert-Marcuse-Les-vertus-de-l’obstination consulté le 30 avril 2022 à 5 heures 25 minutes)
FANON Frantz, 2002, Les damnés de la terre, Paris, Éditions La Découverte & Syros.
HTTPS.LEPARISIEN.FR/faits-divers, etats-unis-les-homicides-par-armes-a-feu-ont-atteint-un-niveau-record-en-2020 par le Parisien avec AFP publié Le 10 mai 2022 à 22h56, consulté le 16 mai 2022 à 14 heures 55 minutes
KANT Emmanuel, 1975, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Delagrave, 2e section, trad. V. Delbos.
MARCUSE Herbert, 1973, Contre-révolution et révolte, trad. Didier Coste, Paris, Seuil.
MARCUSE Herbert 1969, Critique de la tolérance pure, Paris, John-Didier, trad. Liliane Roskopf et Luc Weibel.
MARCUSE Herbert, 1970, Culture et société, trad. Gérard Billy, Daniel Bresson et Jean-Baptiste Grasset, Paris, Minuit.
MARCUSE Herbert, 1968, L’homme unidimensionnel, trad. Monique Wittig, Paris, Minuit.
MARCUSE Herbert, 1968, La fin de l’utopie, trad. Lliliane Roskopf et Luc Weibel Paris, Seuil.
MARCUSE Herbert, 1971, Pour une théorie critique de la société, trad. Cornélius Heim, Paris, Denoël-Gonthier.
MARCUSE Herbert, 1969, Vers la libération. Au-delà de l’homme unidimensionnel, trad. Jean-Baptiste Grasset, Paris, Denoël-Gonthier,
METZGER Jean-Luc 2018 décembre, « Actualité d’Herbert Marcuse : à propos de l’homme unidimensionnel », in Cahiers internationaux de sociologie de la gestion – numéro 19/3.
MORIN Edgard, 2005, Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil.
RIOUX Marcel, Une entrevue avec Herbert Marcuse p. 294-309https://books.openedition.org/pum/21986?lang=fr La culture comme refus de l’économisme consulté le 15 mai 2022 à 11 heures 32 minutes.
SALIFOU Amara, 2017, Domination technologique et perspectives de libération chez Herbert Marcuse, Paris, L’Harmattan.
SCHUDSON Michael, 2015, Le pouvoir des médias. Journalisme et démocratie, trad. Monique Berry, Paris, Nouveaux Horizons,
WIGGERHAUSS Rolf, 1993, L’École de Francfort. Histoire, développement, signification, trad. Liliane Deroche-Ourcel, Paris, PUF.
CRISE UNIVERSITAIRE ET DÉFIS ÉDUCATIONNELS À PARTIR DE LA PENSÉE DE HOBBES
Amenan Madeleine Épouse Ekra KOUASSI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La construction de l’humain répond à des critères et normes ne se consolidant que par l’éducation. L’éducation, l’apprentissage des richesses et des valeurs de la vie pour l’épanouissement des hommes, est indispensable au devenir collectif de l’humanité. À ce titre, elle représente une question majeure, un domaine d’investigation pour plusieurs chercheurs parmi lesquels l’on peut citer Thomas Hobbes. L’auteur anglais développe une philosophie de l’éducation prenant en compte la nature belliqueuse de l’homme, être toujours prompt à la bestialité. Hobbes propose une éducation fortement influencée par la femme, et le pouvoir symbolisé par le Léviathan. Une analyse profonde de sa pensée montrera bien que la théorie de Hobbes a toujours sa raison d’être dans une société en pleine déliquescence. Vu la dégradation de l’environnement éducatif actuel qui dépeint sur les institutions universitaires, l’une des causes majeures des crises universitaires, une prise en compte sérieuse de la pensée politique de Hobbes au sein de laquelle se déploie une théorie éducationnelle serait salutaire.
Mots-clés : Crise, Devenir collectif, Éducation, Léviathan, Université.
Abstract :
The construction of the human responds to criteria and standards that can only be consolidated through education. Education, learning the riches and values of life for human development, is essential to the collective future of humanity. As such, it represents a major question, a field of investigation for several researchers among whom we can cite Thomas Hobbes who, against all odds, developed a philosophy of education taking into account the bellicose nature of man, always be quick to bestiality. Hobbes offers an education strongly influenced by women, and the power symbolized by the Leviathan. A deep analysis of his thought will show that Hobbes’ theory still has its raison d’être in a society in full decline. Given the degradation of the current educational environment which paints academic institutions as one of the major causes of academic crises, a serious consideration of Hobbes’s political theory would be salutary.
Keywords : Crisis, Collective becoming, Education, Leviathan, University.
Introduction
Peut-on penser les crises universitaires, éducatives en référence à la souveraineté et à l’obéissance civile des peuples à partir d’un auteur aussi controversé qu’est Hobbes ? Dans quelle mesure la pensée de Hobbes pourrait-elle permettre de résoudre les crises universitaires actuelles ? Plus concrètement, quelles orientations éducationnelles pourrait-on déduire de la pensée de Hobbes pour résorber les crises universitaires actuelles ? Telles sont les interrogations essentielles qui constituerons les lignes directrices de cette analyse. Nous nous proposons ainsi d’apporter un éclairage différent sur la pensée politique de Hobbes, en analysant la notion d’éducation pour penser les crises universitaires contemporaines. En effet, la question du devenir collectif de l’humanité, de son éducation politique et pédagogique qui s’y rattache a toujours représenté, pour l’auteur du Léviathan, un axe majeur de réflexion.
Notons que la pensée politique de Hobbes a été principalement inspirée de la révolution anglaise de 1640 à 1660. Pour Hobbes, cette crise a été un signal fort, un véritable stimulant dans l’élaboration de ses idées politiques. Dans un tel contexte, l’objectif visé est la résolution, non pas partielle, mais définitive de la crise anglaise et, à travers elle, les crises vécues à cette époque dans le monde. Il s’agit aussi et surtout, pour Hobbes, d’élaborer une théorie politique exempte de toute imperfection, apte à juguler les erreurs qui ont conduit à la crise anglaise, pour une paix durable, voire perpétuelle comme le martèle Emmanuel Kant (2001, p. 46) dans son Projet de paix perpétuelle. C’est ce qui explique, en partie, la rudesse et la brutalité des écrits du philosophe anglais.
Quoi qu’il en soit, Hobbes compte ainsi participer à l’édification d’une humanité saine et prospère. Car, comme le pense Rousseau, en substance, c’est à partir de ce que les hommes sont devenus qu’il importe de réfléchir aux conditions dans lesquelles ils pourraient devenir différents de la misérable image qu’ils offrent d’eux-mêmes. Il est de ce fait, normal et légitime, au regard de ce qui précède, de s’interroger sur ce que pourrait être le vivre-ensemble hobbesien et les conditions de sa réalisation, du point de vue éducationnel.
L’intention fondatrice de cette réflexion est de montrer que l’absolutisme hobbesien n’écarte pas la supposition préalable d’une éducation. La théorie éducationnelle de Hobbes est un élément transversal qui traverse toute sa philosophie et l’éclaire d’une nouvelle lumière. Notre démarche, démonstrative et prospective dans sa visée, s’inscrit dans le champ réflexif de la pensée politique hobbesienne.Cette démarche pourrait suggérer une indication pour pallier la crise contemporaine de l’éducation et partant, celle de la politique. Avant toute investigation, il importe de retenir qu’un regard prospectif sur la pensée éducationnelle hobbesienne ne saurait occulter la véracité de l’absolutisme qui s’en fait l’écho.
1. Conception hobbesienne de l’éducation : condition du bien-être social
Aussi totalitaire que la pensée politique de Hobbes puisse paraître, elle répond à un défi majeur : celui de défendre l’individu dans l’État, par la défense de l’État. À ce titre, elle vise à promouvoir la morale pour la seule et unique raison que celle-ci stimule la vie en communauté. Par ailleurs, pour Hobbes, le citoyen doit bénéficier d’une instruction capable de préserver la paix dans son environnement. Ce qui signifie qu’il est important, pour la conservation de la paix, de veiller à la bonne instruction des sujets, c’est-à-dire que le souverain se doit, d’une part, d’administrer « un enseignement officiel et d’autre part de confectionner et d’appliquer de bonnes lois » (T. Hobbes, 1971, p. 457). Une pédagogie qui prend en compte tous les rouages de la vie politique doit être élaborée. Cette prise en compte politique et pédagogique doit absolument répondre aux normes du contrat social. La clé de voûte de cette instruction est bien entendue le souverain. Hobbes dit en substance que l’éducation civique dépend de la responsabilité pédagogique du souverain. Ce dernier a le devoir, de par le contrat social, d’instruire ses sujets à la nécessité et à l’impératif de l’obéissance civile, par un programme éducationnel suffisamment élaboré. En effet, l’éducation au civisme est le socle de la pensée éducationnelle du hobbisme. Elle fonde, forme, défend cette théorie et la valorise. Pour le philosophe de Malmesbury, l’éducation doit conduire au respect des normes du contrat social ou de la chose commune. En tant que telle, cette éducation ne se sépare véritablement pas de la politique. Les deux s’impliquent, s’imbriquent et sont interdépendantes.
De plus, la moralité hobbesienne dont il est ici question permet de faire la scission systématique entre l’animalité, (source de guerre et d’interminables conflits), et l’humanité pourvoyeuse de paix et de sécurité. On pourrait classer la morale hobbesienne en « trois idiomes (…) premièrement, la morale des liens communautaires ; deuxièmement, la morale de l’individualité ; troisièmement, la morale du bien commun » (O. Michael, 2011, p. 108). Cette moralité est vraisemblablement la conséquence d’une éducation civique, morale et religieuse incrustée par le souverain, en vue de parvenir à l’objectif principal qu’est la paix et partant le bien-être de tous. Cela traduit, de fait, une éthique dynamique cautionnée par les contractants qui donnent ainsi mandat au souverain de veiller au bien-être collectif.
Pour Hobbes, l’une des missions du souverain est de veiller à l’application et à l’effectivité du contrat social. Il doit permettre aux hommes dont il a la responsabilité, d’assumer leur spécificité, sinon, ils subiraient un sort identique à celui des êtres biologiques dépourvus de langage et de raison. En effet, la morale hobbesienne prévaut dans toute son œuvre à travers les activités du souverain. Elle est vraisemblablement le garant de l’évolution positive de la société. Dans la relation entre le souverain et ses sujets, le respect de soi par la parole donnée, fondatrice de la société civile est nécessaire pour un épanouissement tant individuel que collectif. De même, le respect des autres et l’obéissance à la parole donnée et aux normes de la société civile (l’altruisme, la solidarité, l’équité entre les sujets et la probité morale) sont utiles pour le bien-être social. Les principes moraux qui ont prévalu à la création du « comfort of live » ne doivent pas être foulés aux pieds, auquel cas l’on assisterait à une tragédie sociale collective. Pour ThomasHobbes (1987, pp. 233-234), « la sureté et la sécurité publique sont la forme la plus importante du (bien commun) ce qu’il appelait dès 1640 comfort of live ». Si la prééminence éthique est au fondement de la société civile, c’est encore elle qui en constitue le pilier dans l’État. Car, les citoyens sont nourris à la sève de la probité morale pour consolider la société. L’éducation au sein des familles et dans les écoles et universités doit y veiller selon Hobbes.
À ce niveau de la réflexion de Thomas Hobbes sur la question de l’éduction, nous convoquons Platon, car nous estimons qu’il y a une similitude entre la conception hobbesienne de l’éducation et celle de l’auteur l’Antiquité. En effet, chez Platon, un enfant est appelé à devenir Homme et citoyen, c’est-à-dire un membre à part entière de la cité, respectueux des institutions et du bien-être de la cité. Pour ce faire, l’enfant doit être soumis, selon Platon, à des exercices de préparation, à une éducation capable de lui inculquer le civisme nécessaire au bien-être de sa personne et de la cité. Pour cet auteur de l’Antiquité, les commencements représentent tout dans la nature jeune et tendre dont toutes les parties gardent l’empreinte qu’on leur donne : « Les opinions qu’il reçoit à cet âge deviennent d’ordinaire indélébiles et inébranlables » (Platon, 1966, livre II/378b-379b). La foi de Platon dans l’éducation est telle qu’il la croit assez efficace pour maintenir l’homme dans l’habitude de la vertu. À ce titre, la pensée de Hobbes est exemplairement solidaire de celle de Platon. Malgré les siècles qui les séparent, ils bâtissent une même entreprise. Mieux, sur les ruines des évidences platoniciennes, Hobbes construit, sans le savoir ou sans le vouloir un édifice cohérent et stable sur la base d’une éducation rigoureuse dans l’optique d’une consolidation de l’obéissance civile, gage de toute stabilité politique. Hobbes (1982, p. 153) propose « un suivi rigoureux de l’enfant d’une part par ses parents, eux-mêmes acquis à la cause de l’État et d’autres part par les institutions telles que les écoles, l’armée, les universités (…) chargées de l’instruction et de l’éducation à l’obéissance civile ». Cela signifie que l’entretien de la paix et de la défense commune demande que l’on prenne soigneusement garde à ce que ceux qui doivent juger les procès, veiller sur les desseins des voisins, conduire les armées, pouvoir aux nécessités publiques, s’acquittent fidèlement de leurs devoirs.
Il semble fort raisonnable de laisser le choix de telles personnes et de les faire dépendre de celui qui a une souveraine autorité sur les affaires de la paix et de la guerre : le souverain, le Léviathan. L’éducation de l’enfant est d’abord à la charge de ses parents et ensuite l’État, ou le souverain prend le relais. Autrement dit, chez Hobbes, l’individu ne s’appartient à lui-même et à sa famille que hors de la société civile, c’est-à-dire à l’état de nature. Mais cette relation disparaît au profit d’une nouvelle dans le pacte social. Le Léviathan, dans son exercice de la représentation politique a droit à une mainmise sur tous les compartiments de la vie des individus y compris leur vie privée.
La cellule familiale est la toute première institution en charge de l’éducation de l’enfant. « Les enfants ont le droit d’être nourris et élevés avec les ressources du patrimoine familial » (G. Radica, 2013, p. 116). Si, comme nous le rappelle Platon, tout réside dans la nature jeune et tendre de l’enfant, facile à être modelé et façonné, alors la cellule familiale constitue, pour lui, le premier lieu de son éducation. L’autorité implique, pour les deux institutions (État et Famille), une formation à l’obéissance civile par une insistance sur la prééminence éthique et la nécessité de la consolidation de la collectivité, pour une meilleure protection de l’individualité. À ce titre, la communauté des hommes repose sur le principe que les services et les devoirs rendus aux autres retournent à soi : l’existence d’un principe de réciprocité généralisé stimule la co-existence et la famille constitue le point de départ de cette idée fondamentale. La renonciation consciente ou inconsciente aux valeurs morales s’avère être un danger qui détruit, à terme, l’unité et la cohésion sociale. L’éthique doit donc prévaloir sur l’esprit de thanatos, c’est-à-dire l’instinct de destruction, l’esprit de mort tel qu’évoqué par H. Marcuse (1963, p. 21). En effet, Eros et Civilisation de Herbert Marcuse, est une réponse à l’œuvre Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud. Dans cet ouvrage, Marcuse s’interroge sur les relations de l’individu à sa propre société. Pour y répondre, Marcuse fait une analyse et remet en cause la théorie freudienne selon laquelle la réalisation du bonheur individuel est incompatible avec la société civilisée, « ou bien l’individu manque radicalement des conditions de réalisation de ses propres fins ou bien il les trouve dans la soumission de ses forces à un organisme collectif » (C. Schmitt, 2001, p. 39). Marcuse élabore ainsi un modèle d’analyse de la société contemporaine. Éloignée des perspectives totalement abstraites, cette théorie débouche, contrairement au concept freudien, sur une pratique sociale vivante, une utopie réalisable après la transformation nécessaire des institutions sociales. Cet aspect des écrits marcusiens présente une parenté très nette avec celle de Hobbes.
Pour lui, hors des sociétés civilisées et en dehors de toutes les clauses qui les accompagnent, aucune vie sociale n’est possible. Seule la société civile permet une bonne appréciation de la vie individuelle selon Marcuse et Hobbes. Tout cela implique le respect des clauses du contrat social, l’obéissance à la parole donnée qui a permis l’émergence du contrat social, l’obéissance au souverain, gardien du pacte social.
La notion d’éducation ne doit pas se limiter aux simples rapports familiaux. Elle répond à une stratégie dont la famille est le premier relais. C’est en quelque sorte une éducation de base. Dans ces conditions, le Léviathan a pour charge de prendre le second relais pour consolider, à travers ses institutions et particulièrement les écoles et universités, cette éducation au civisme. Le civisme et la morale représentent deux aspects importants de l’éducation des hommes. Ils constituent, de ce point de vue, un ensemble d’aptitudes et d’attitudes nécessaires à la consolidation du vivre-ensemble. Dans Le Citoyen de T. Hobbes (1987, p. 86), l’auteur souligne que l’enfant appartient premièrement à ses parents et après eux, le Léviathan prend le relais dans son instruction dans ses institutions, lieu où il reçoit l’éducation au civisme. Conscient de ce que, loin de la société civile et poussé à l’extrême, l’être humain se sent fragilisé, réduit dans une sorte de brutalité à sa simple expression primitive et naturelle, prêt à commettre l’irréparable, Hobbes met l’accent sur la perversion de la nature humaine pour consolider les bases de l’éducation civique. En effet, si la première partie du Léviathan est consacrée à l’horreur de la guerre et de la barbarie humaine, alors, il faut éviter une cristallisation de l’état de nature, conçu originellement comme une simple hypothèse de travail et l’appréhender, à l’analyse, comme un danger possible pour la société civile. Autrement dit, l’état de nature n’est que l’autre face de la société civile, lorsque la responsabilité du souverain est mise à mal par les élans révolutionnaires des sujets réfractaires à la pédagogie socio-éducative du souverain. Une telle attitude a pour répondant la désobéissance civile et, évidemment, le chaos social. Le poète Pablo Neruda avait raison de prédire que, même en coupant toutes les fleurs, on ne peut empêcher l’arrivée du printemps.
Conscient des effets pervers de la nature vacillante de l’homme, plus prompte au désordre qu’à l’ordre, Hobbes développe un humanisme de type nouveau, totalement pris en charge par le Léviathan. La réalisation de ce nouvel humanisme s’avère nécessaire dans ce monde en proie aux déchirements multiples. En d’autres termes, la ligne de conduite qui répond au civisme hobbesien dépend absolument du type d’éducation reçue. À ce propos, le Léviathan est le premier pédagogue. Il est l’instructeur par excellence. De lui seul dépendent la culture, la connaissance et l’instruction du peuple. Aussi doit-il veiller à l’esprit civique et à la probité morale qui conditionnent l’obéissance civile. Cette obéissance civile doit être cultivée et entretenue car l’absence de civisme est un acte suicidaire pour la République. Les guerres et les tragédies vécues par l’humanité en sont la stricte émanation, mieux elles s’expliquent par cette absence. L’obéissance civique devient, avec Hobbes, une manière d’être, de faire, une philosophie du comportement ou une philosophie de la vie tout court, dans le processus du devenir collectif. Dans la gestion de la chose collective, les citoyens doivent faire preuve de responsabilité et de maturité dans leur relation avec l’autorité morale que représente le souverain. Mais cette prise de conscience du respect de l’autorité morale n’est possible que dans la conception et le mode d’administration des informations relatives à la gestion de la collectivité. Nul ne peut se substituer au souverain dans ce rôle sacré, sauf si cette décision émane de sa seule et unique responsabilité, ce qui permet, ainsi de limiter les troubles.
Pour pallier cet état de fait, Hobbes propose une théorie réaliste en fonction de la nature humaine, toujours en situation naturelle de domination d’autrui et de conflits interminables. Un pouvoir absolu et fort, dans lequel les règles académiques et pédagogiques relèvent uniquement du souverain, serait la solution à cet état de fait pour le bien-être de tous.
En somme, l’éducation chez Hobbes (1982, p. 86.) est fortement influencée par la femme et par ricochet la cellule familiale. L’auteur nous fait comprendre que l’éducation de l’enfant appartient d’abord à sa famille. L’éducation de base de l’enfant revient donc à la cellule familiale. Ensuite, le Léviathan prend le relais à travers ses écoles et institutions pour éduquer l’enfant au civisme et à la moralité. C’est en somme, ces deux types d’éducation qui façonnent le citoyen, capable de diriger une Nation dans la paix. Ainsi, si nous assistons à des crises éducatives dans nos sociétés contemporaines, c’est certainement dû à la démission des parents relativement à leur rôle de conseillers. Cela n’est pas sans conséquence sur les institutions éducationnelles et les Universités.
2. La crise de l’éducation dans nos sociétés contemporaines conséquence sur les institutions éducationnelles et universitaires
Que s’est-il passé pour que nous puissions assister aujourd’hui à une dégénérescence de l’éducation dans nos sociétés, écoles et Universités ? Ces troubles qui se traduisent aujourd’hui par la désobéissance civile, la violence verbale et physique dans les écoles et universités, l’introduction des armes à feu dans les écoles faisant des victimes innocentes, la drogue et la pédophilie sont fortement incrustés dans le quotidien des États contemporains. Cette situation fait de l’insécurité une épée de Damoclès sur la tête des individus et de tous. En plus, de nouveaux rapports naissent entre le maître et l’élève, banalisant toute autorité du maître. Le phénomène des mouvements syndicaux estudiantins et scolaires illustrent bien cet état de fait dans nos sociétés. Ces mouvements sont normalement des mouvements syndicaux estudiantins pour des revendications académiques mais ont pris l’allure de mouvements politiques importants et incontournables. Ainsi, des lieux d’apprentissage ne sont plus des temples du savoir mais plutôt des zones de guerre, des champs de tir et des tombeaux. Nous tenons pour preuve la guerre que les étudiants, membres d’un groupe syndical, se sont ménés le lundi 9 Avril 2018 au campus 1 et 2 de l’Université Alassane Ouattara. Cet affrontement a fait plusieurs blessés et des dégâts matériels.
C’est pourquoi, nous nous posons cette question avec S. Diakité (2016, p. 10) : « Les comportements belliqueux et corrompus des acteurs sociaux, la mauvaise gouvernance des sociétés n’est-elle pas la plaie que nous avons refusée de soigner en nos enfantslorsqu’ils étaient tout-petits, plaie béante que nous avons laissée pourrir » ? Pour l’universitaire ivoirien, les maux qui minent nos sociétés contemporaines, ne sont que les conséquences d’une éducation familiale manquée. En effet, aujourd’hui certains parents sont très flexibles dans l’éducation de leurs enfants. Dans la plupart des familles modernes, il y a du personnel pour l’entretien de la maison. Et les enfants se contentent de leurs travaux scolaires ou académiques. Ils ne se préoccupent pas des services d’entretien de la maison. Au demeurant, ils sont paresseux et face aux vicissitudes de la vie, ils sont toujours en difficulté.
Aussi, il n’est pas rare de voir des parents démissionner dans l’éducation de leurs progénitures en les confiant aux personnels de maison qui, eux-mêmes manquent souvent d’éducation. Par conséquent, les enfants qui leur sont confiés grandissent avec des carences dans leur éducation. Des parents se disent trop occupés au point d’abandonner leurs enfants et l’argent a remplacé les conseils avisés pour la bonne conduite de l’enfant. Or, selon S. Diakité (2016, pp. 9-10), « le temps en famille est très précieux, que ce soit pour des familles traditionnelles, monoparentales ou recomposées ». C’est pourquoi, dans les quartiers, déjà tout petits, les enfants développent des vices tels que le sexe et la drogue, car ils ont de l’argent à portée de mains et pas de parent pour leur enseigner le bon usage de ce bien. Ainsi, nous constatons que les écoles et les Universités en payent de lourds tributs. Par exemple, il existe aujourd’hui dans certaines écoles et Universités le phénomène de « tontine de sexe ». Il s’agit pour des écoliers ou des étudiants de mettre de l’argent ensemble pour le remettre à tour de rôle à un couple parmi eux afin de se payer un hôtel et tout ce qui est nécessaire pour un séjour de « lune de miel » ; ainsi chaque jour ces enfants se livrent à cette pratique dans des institutions éducationnelles.
En plus, avec ces sommes exorbitantes que les parents laissent à leurs enfants pour combler le vide de leur absence, ces enfants s’achètent souvent de la drogue qu’ils font circuler dans l’école au point d’influencer les autres enfants dont les parents sont moins nantis pour leur offrir ce luxe. Par conséquent, le respect de l’enseignant en tant qu’autorité a foutu le camp. Un enfant, sous l’effet de la drogue, ne peut pas distinguer l’enseignant de ses amis de classe donc il manque de respect à tous. De même, malgré la force de l’éducation de base qu’un enfant ait reçu, au contact de ces enfants dont l’éducation est ratées, il est influencé et cette gangrène s’agrandit dans la société. Toujours des affirmations sans illustrations. C’est pourquoi, nous disons avec Cheick Hamidou Kane (1961, p. 88) que « l’extérieur est agressif. Si l’homme ne le vainc pas, il détruit l’homme et fait de lui une victime de tragédie. Une plaie qu’on néglige ne guérit pas, mais s’infecte jusqu’à la gangrène. Un enfant qu’on n’éduque pas régresse. Une société qu’on ne gouverne pas se détruit ».
Par ailleurs, selon Samba Diakité, un autre élément important qui influence l’éducation est celui des valeurs sociales et des modèles familiaux. L’école est l’un des lieux où on apprend les valeurs sociales. La famille s’est beaucoup transformée au cours de ces 3 dernières décennies avec l’augmentation des familles monoparentales. Les familles monoparentales posent problème aujourd’hui à cause de l’individualisme qui règne dans la société. Autrefois, l’éducation d’un enfant appartenait à toute la communauté au point où une personne étrangère pouvait corriger un enfant qui se comportait mal. Mais aujourd’hui si quelqu’un le fait on pourrait porter une plainte contre la personne. Un enfant peut même porter plainte contre ses propres parents s’ils le corrigent avec des coups de poing. Or, l’enfant est le jeune arbre de la famille, il a besoin d’être corrigé, puni, éduqué.
Par ailleurs, chez Hobbes, l’individu ne s’appartient à lui-même et à sa famille que hors de la société civile, c’est-à-dire à l’état de nature. Mais cette relation disparaît au profit d’une nouvelle, dans le pacte social. Le Léviathan, dans son exercice de la représentation politique, a droit à une mainmise sur tous les compartiments de la vie des individus y compris leur vie privée. T. Hobbes (1982, p. 147). Cela signifie que normalement, dans notre société actuelle, toute la chaine de valeur doit jouer un rôle dans l’éducation de l’enfant. Il y a aussi la situation des minorités qui adoptent des enfants. L’enfant voit deux personnes de même sexe et l’une est considérée comme son père et l’autre comme sa mère. Ce qui signifie que la famille a perdu son essence. Ce que Justine Bindedou (2015, 4e de couverture)pourrait nommer : la famille dénaturée au miroir du récit de la création,
Ces situations mises ensemble, infectent l’éducation dans nos sociétés contemporaines et dépeignent sur les institutions éducationnelles et les Universités. Comment faut-il s’y prendre pour palier à ces maux qui minent la société actuelle ? Quel rôle doivent jouer tous les acteurs, c’est-à-dire, les parents, les enseignants et les autorités pour solutionner cette problématique ?
D’abord, les parents doivent discipliner leurs enfants à la maison. L’éducation de leurs enfants doit être primordiale dans leurs multiples occupations. L’argent ne peut pas éduquer. L’éducation est un bien précieux pour la société, car elle constitue la base de l’avenir de ses individus. En effet, chaque enfant a besoin d’éducation pour prendre conscience du monde qui l’entoure. Ensuite, l’enseignant est celui qui prend la relève dans l’éducation des enfants après les parents. Il doit donc être comme un médecin qui détecte les difficultés de l’enfant et l’aide à les corriger. L’enseignant doit observer et repérer les problématiques de l’élève et y apporter de l’aider par l’entremise de solutions pour réussir dans son apprentissage. Enfin, les autorités doivent prendre des mesures appropriées à l’image du Léviathan de Thomas Hobbes pour freiner les apprenants dans leur élan de désobéissance civile, de désobéissance à l’autorité qui est l’enseignant afin que ce dernier donne les meilleurs de lui-même dans l’éducation pour le bien-être de la société.
Conclusion
La formation de la pensée politique moderne a longtemps été banalisée et sous-estimée quand elle n’était pas simplement et purement ignorée. La théorie politique de Hobbes ne saurait pourtant se comprendre sans le concept fondamental de l’éducation à la formation et de l’obéissance civile qui la sous-tend. Si la conception de l’éducation civique définit encore aujourd’hui l’horizon de la philosophie politique, elle le doit à ce que son auteur a su interpréter, réfléchir, modifier ou à tout le moins transformer l’allure de ce concept depuis l’Antiquité et le moyen-âge. Autrement dit, la philosophie de l’éducation qui se dégage des textes hobbesiens prend en compte les acquis de la philosophie antique à travers les écrits de Platon, Aristote et Xénophon.
Elle met en exergue les acquis universels et contemporains de l’évolution des sociétés humaines. En clair, les enseignements tirés de la pensée de Hobbes relativement à la nécessité d’une prise en charge socio-éducative des citoyens, par une pédagogie finement élaborée par le souverain, naissent sur les cendres de la philosophie antique et se consolident dans les plans éducatifs contemporains du point de vue de la finalité du pouvoir politique, c’est-à-dire de la cohésion sociale, faisant de Hobbes un philosophe plein. De ce point de vue, sa théorie de l’éducation à l’image de ses idées politiques constitue un immense laboratoire d’idées pour les théoriciens de notre modernité politique. C’est à l’exploration de ce laboratoire d’idées que les théoriciens de la politique contemporaine de l’éducation trouveront peut-être une solution à la crise contemporaine de l’éducation.
La notion de l’éducation étant exclusivement incontournable pour l’évolution des sociétés contemporaines, reconnaissons à Hobbes le mérite, nonobstant la dureté et la complexité de sa théorie politique, d’avoir souligné son importance et toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Dans cette démarche théorique qui associe la convergence des individualités en une symbiose parfaite conditionnée par un dépassement individuel de soi, Hobbes aide à la création d’un nouveau monde, mais un monde exemplaire qui gère la préservation à la fois, de l’interdépendance des individualités et le mieux-être de tous et de chacun. La leçon qui en ressort se laisse ainsi tirer d’elle-même : il faut penser à tous en se réalisant. La réalisation de soi n’est possible que par l’apprentissage du savoir et du devoir co-devenir. Au vu du délire et de la déclinaison actuelle de l’éducation civique, rendant de plus en plus fragile les grandes puissances, nous pouvons donner raison à Hobbes. En ayant un peu d’égard pour sa théorie de l’éducation. Il ne s’agit surtout pas de battre en brèche les acquis contemporains de l’éducation des citoyens, mais de puiser en l’œuvre de l’anglais, la substance nécessaire de l’éducation civique pour une humanité prospère, plus paisible et donc plus cohérente.
Le message d’espoir de l’auteur est clair et retentit encore au milieu des déchirements et des cris de désespoir qui enveloppent de manière si permanente et si présente notre univers contemporain, faisant de Thomas Hobbes un philosophe plus que jamais d’actualité. Autant l’éducation civique ne peut s’appréhender, chez Hobbes, sans la morale, autant l’épanouissement individuel ne peut se concevoir sans le bien-être collectif. De l’un dépend l’autre et vice versa. Pour Hobbes, l’épanouissement de l’humanité dépend essentiellement de la soumission aux règles qu’on s’est volontairement prescrites pour échapper à la misère humaine.
Références bibliographiques
AGACINSKI Sylviane, 2005, Métaphysique des sexes, Paris, Seuil.
AVANZINI Guy et MOUGNIOTTE Alain, 2012, Penser la philosophie de l’éducation Pourquoi ? Pour quoi ?, Lyon, CHRONIQUE SOCIALE.
BINDEDOU-YOMAN Justine, 2016, Hobbisme et féminisme vers une fluctuation de l’identité féminine, Paris, PAF.
BINDEDOU-YOMAN Justine, 2015, La Famille dénaturée au miroir du récit de la Création, Paris, Edilivre.
COLLIN Françoise et Al., 2000, Les Femmes, de Platon à Dérida, Anthologie critique, Paris, Plon.
DIAKITE Samba, 2016, Les larmes de l’éducation, Québec, Différence Pérenne.
DUBREUCQ Éric, 2004, Une éducation républicaine, Paris, Vrin.
DROUIN-HANS Anne-Marie, 1998, L’éducation une question philosophique, Paris, ED ECONOMICA.
HOBBES Thomas, 1982, Le Citoyen ou les fondements de la politique, Trad. Samuel Sorbière, Paris, GF Flammarion.
HOBBES Thomas, 1971, Léviathan, Trad. François Tricaud, Paris, Sirey.
OAKESHOTT, Michael, 2011, L’Association civile selon Hobbes, Paris, VRIN.
RADICA Gabrielle, 2013, Philosophie de la famille Communauté, normes et pouvoirs, Paris, VRIN.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1969, Émile ou de l’éducation, Paris, Gallimard.
SCHMITT Carl, 2002, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes Sens et échec d’un symbole politique, Paris, SEUIL.
TINLAND Franck, 1988, Droit naturel, loi civile et souveraineté à l’époque classique, Paris, PUF.
ZARKA Yves Charles, 2001, Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, PUF.
ZARKA Yves Charles, 1992, Hobbes et son vocabulaire, Paris, Vrin.
CRISE UNIVERSITAIRE : IMPÉRATIF ÉTHIQUE BERGSONIEN DE LIBÉRATION DE L’INTELLECT
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Les universités sont en crise, et cela est plus qu’une évidence. Dans un tel contexte, le philosopher bergsonien se présente comme une sorte de viatique ou palladium. Ainsi, la référence faite au mystique dans sa capacité d’impulser une régénération spirituelle aux sociétés humaines par-delà la vie intuitive faite d’amour de l’autre, sert de modèle éthique dans un environnement socio-universitaire et académique gagné par l’égoïsme de l’intellect. Dans le philosopher bergsonien, il y a une position anthropologique du penser et surtout de la vie du mystique. Il s’agit de cette pensée en durée et de cette vie du mystique faite d’amour d’autrui qui transcende la vie égoïstique de l’intellect et de ses corollaires, socialement et scientifiquement contre-productifs. Au regard de sa nature et surtout de sa vie éthique et spirituelle, le mystique, personnalité exceptionnelle par excellence, est capable de redorer le blason de l’intellect opérant dans nos universités et surdéterminé par l’intelligence égoïste. Tel est le point d’ancrage de notre réflexion.
Mots-clés : Crise universitaire, Durée, Éthique, Intellect, Intuition, Métaphysique, Réforme, Spatialité.
Abstract :
Universities are in crisis, and this is more than obvious. In such a context, Bergsonian philosophizing presents itself as a sort of viaticum or palladium. Thus, the reference made to the mystical in its capacity to stimulate a spiritual regeneration in human societies beyond the intuitive life made of love for the other, serves as an ethical model in a socio-university and academic environment won by the selfishness of the intellect. In Bergsonian philosophizing, there is an anthropological position of thinking and especially of the life of the mystic. It is about this thought in duration and this life of the mystic made of love of others which transcends the egoistic life of the intellect and its corollaries, socially and scientifically counter-productive. Considering his nature and especially his ethical and spiritual life, the mystic, exceptional personality par excellence, is capable of restoring the image of the intellect operating in our universities and overdetermined by selfish intelligence. This is the anchor point of our thinking.
Keywords : University crisis, Duration, Ethics, Intellect, Intuition, Metaphysics, Reform, Spatiality.
Introduction
L’intellect ou – ce qui est le même-, l’intelligence apparaît, chez Bergson, comme source de conflits d’intérêts matériel et idéologique, et parfois, par classes d’individus interposés. C’est ainsi qu’il oppose, entre eux-mêmes, les individus et surtout les intellectuels d’une communauté donnée, en les enchainant dans les rets de son égoïsme natif et séparateur. Ainsi, d’un point de vue de l’histoire de la philosophie, c’est l’intelligence qui, d’une part, en tant que faculté théorique, fait que « les concepts simples n’ont […] pas seulement l’inconvénient de diviser l’unité concrète de l’objet en autant d’expressions symboliques ; [mais] (…) divisent aussi la philosophie en écoles distinctes (…) [et antagoniques] » (H. Bergson, 2013, p. 188). Et d’autre part, dans sa relation avec la société, c’est la même intelligence qui génère et structure « la société close (…) dont les membres se tiennent entre eux, indifférents au reste des hommes, toujours prêts à attaquer ou à se défendre, astreints enfin à une attitude de combat » (H. Bergson, 1995, p. 283).
Toutefois, parce que chez Bergson (1995, p. 62), « entre l’âme close et l’âme ouverte [ou intuitive] il y a l’âme qui s’ouvre », on ne peut envisager une fatalité crisique et conflictuelle destinale des sociétés humaines. Ceci est, dans le philosopher bergsonien, l’aboutissement éthico-socio-anthropologique de l’élan vital, quand il prend la direction de l’intuition sous le mode de l’expérience émotionnelle de la durée créatrice en promotion de soi chez le mystique. C’est pourquoi, selon Bergson (1996, p. 49), « c’est […] là que nous devrons aller chercher des indications pour dilater la forme intellectuelle de notre pensée ; c’est là que nous puiserons l’élan nécessaire pour nous hausser au-dessus de nous-mêmes », c’est-à-dire de notre égoïsme et de ses manifestations sociologiques.
Comment comprendre ou expliciter cela? Pour le dire précisément, la nature égoïste de l’homme, alors amplifiée par l’intellectualité de l’universitaire, ne rend-elle pas impossible une éthique à même de la surmonter ? S’il est impossible à l’intelligence de se surmonter elle-même, comment rendre harmonieux l’environnement universitaire, surdéterminé qu’il est, par une intellectualité naturellement séparatrice, égoïste et confligène ?
Telle est la perspective heuristique qui nous guidera dans cette réflexion. Du reste, nous ferons usage des méthodes sociocritique et phénoménologique dans ladite réflexion. Elles nous permettront une intellection des enjeux des intuitions bergsoniennes de la spatialité et de la durée, et surtout d’évaluer les préoccupations philosophiques, points d’ancrage de notre problématique.
1. Intellection des crises socio-universitaires : du principe bergsonien d’une vie créatrice conflictuelle
Dans la philosophie bergsonienne, là où il y a la vie, il y a mouvement de motricité. Celui-ci en tant qu’il est l’expression effective de la capacité motrice du vivant, est le fait de l’élan vital. En ce qui concerne les êtres vivants végétal, animal et surtout humain, la qualité de leur motricité et de leur locomotivité est fonction de l’épanouissement de l’âme en intellectualité. C’est cette dernière qui la rend capable de choix éclairé et libre. Ainsi pour Aristote (1989, p. 155), « (…) le choix délibéré est ou bien l’esprit animé par la tendance, ou bien la tendance éclairée par la réflexion, et c’est un principe humain. » Chez Bergson, celui-ci prend le nom d’intelligence. Dans l’ordre de l’évolution de la vie, celle-ci se rapporte à la matière qui la structure et à la société dont elle dessine la forme et génère la trame crisique ou conflictuelle. Par ailleurs, et relativement à son intensification dans la vie intérieure en forme de durée, elle est intuition ou esprit.
1.1. À partir du statut dichotomique de l’intelligence et de l’intuition
La vie est une réalité évolutive qui, selon Bergson, se fait à travers les vivants végétal, animal et humain. Étant animée d’un principe métaphysique qu’il appelle « élan vital », la vie est une force génésique et ontogénétique à l’origine des vivants. Ainsi se fait-elle en eux ou à travers eux. La vie est matière dans son extériorité, et esprit dans son intériorité. Dans cette dernière, elle est la durée pure, créatrice de nouveautés imprévisibles par son essence et par sa dynamique. Dans sa matérialité et sa spiritualité, la vie apparaît dualiste et divergente sous ces deux aspects dichotomiques. Ceux-ci lui donneraient la multiplicité différenciante en forme de contrariétés oppositionnelles. C’est que dans le processus de son évolution en rapport avec l’extériorité matérielle, la vie ne se manifestera que sous le mode conflictuel. Celui-ci est le fait de l’opposition entre matière et esprit, entre matérialité et spiritualité. Mais, faut-il souligner et comprendre que cette divergence entre les deux aspects de la vie qui, apparemment, se lient en forme d’oppositions, est moins exclusive qu’inclusive. La vie est un tout harmonique, en termes de dualités surmontées dès lors que matière et esprit sont le recto et le verso de la réalité (vitale). La vie évolutive étant durée créatrice et exigence d’extériorisation, elle se rapporte à la matière. Cette dernière ne freine pas et n’annule pas son élan évolutif. Bien au contraire, elle s’en sert comme principe ontologique à des fins vitales en formes de prédispositions adaptative et épistémique. Ainsi, selon Bergson (1996, p. 183), « la vie, c’est-à-dire la conscience lancée à travers la matière (…), s’orientait ainsi soit dans le sens de l’intuition, soit dans celui de l’intelligence. ». De là, nous voyons qu’elle se manifeste phénoménalement et ce dans son extension socio-anthropologique par le biais de l’intelligence spatialisante et égoïste, à la fois sociomorphe et sociocrisique.
1.2. Des implications sociologiques d’une vie intellectuelle égoïste et confligène
La vie évolutive qui charrie les êtres vivants et les facultés qui les déterminent ontologiquement et assurent leur insertion adaptative dans la matière, s’épanouit dans la vie sociale. Au début des Deux sources, Bergson (2001, p. 986) nous fait comprendre que « chacun de nous appartient à la société autant qu’à lui-même ». Cela est d’autant avéré que chez l’homme, « son intelligence [est] destinée à favoriser la vie individuelle et la vie du groupe » (H. Bergson, 1995, p. 56). Plus qu’elle ne la favorise, l’intelligence est constitutive de la vie sociale elle-même qui, à son tour, la corrobore. C’est elle qui donne à la vie sociale sa trame matérialiste et sa courbure intellectualiste. Mais dans la dynamique des sociétés, on peut passer d’une société structurée par l’intelligence ou intellect à son éclosion en société spirituelle sous l’impulsion des mystiques en tant qu’ils sont animés d’amour. C’est dans ce contexte théorique bergsonien que se pose la problématique de la nature crisique et conflictuelle des sociétés humaines d’une part, et d’autre part, la possibilité de la surmonter.
L’évolution de la vie sur notre planète et du côté de l’intelligence, lui donne d’avoir pour support, la matière ; pour trame, la matérialité, et pour espace d’éclosion, la société qu’elle génère et structure. Sur le plan théorique, l’intelligence a une impulsion naturelle à la spatialisation s’exprimant en forme de connaissance intellectuelle. Bien que celle-ci soit théorique, elle n’en est pas moins pratique pour être le produit de l’intelligence brassée pour l’action. Mais, à y voir de près, c’est sur le plan social que la vie intellectuelle, foncièrement spatialisante, est source de conflictualités. Ainsi génère-t-elle de façon rémanente, les crises socio-professionnelles. Comment cela peut-il se comprendre d’un point de vue bergsonien ?
La vie évolutive retrouve son expression proprement humaine dans la société. Or la spatialisation, qui est l’élan théorique de l’intelligence, se donne à l’échelle de l’individu, comme le point d’enracinement et d’impulsion de son égoïsme. Si tel est le cas, il faut dire que son expression effective est dans la relation sociale de l’individu avec son semblable. C’est en cela qu’est justifiée l’expression d’« alter-égoïsme » de Philip Léon, exactement dans le sens où Nietzsche affirme que l’altruiste n’est qu’un égoïste caché. C’est bien dans ce sens qu’on réalisé avec Bergson (1995, p. 67) que « le respect de soi n’en reste pas moins, au terme de son évolution comme à l’origine, un sentiment social ». Or celui-ci grossit exponentiellement et surtout orgueilleusement, en fonction de l’égoïsme natif de l’individu et de ses expédients matériels liés à sa profession. Et ainsi et très souvent, dans l’espace universitaire du rapport entre disciple et maître, « le prestige [de ce dernier] une fois reconnu risque de se corrompre en une sorte de vénération qui s’attache à l’homme même plutôt qu’à la révélation dont il est le messager » (G. Gusdorf, 1969, p. 83). Cela est si bien réel que « le groupe auquel il appartient se met nécessairement au-dessus des autres, (…) avec toutes les jouissances de l’orgueil » (H. Bergson, 1995, p. 66). Il en est ainsi de l’universitaire (professeur de philosophie) en France[123] qui est valorisé dans la société comme l’image en avait été donnée dans la figure platonicienne du philosophe-roi.
On dit de l’universitaire qu’il est la crème sociétale d’un pays. À dire vrai, il l’est essentiellement dans la sphère de l’intellectualité. Ainsi dans son élan de socialisation-hiérarchisation, ce dernier induit-il souterrainement les classes sociales d’individus qui s’octroient ou exigent des privilèges propres à leur statut. Et pour cause, « si l’on entend ainsi la hiérarchie des classes, charges et avantages sont traités comme une espèce de masse commune qui serait répartie ensuite entre les individus selon leur valeur, et par conséquent selon les services qu’ils rendent » (H. Bergson, 1995, p. 71).
Avec Bergson, l’intelligence est un produit génésique et génétique de la vie évolutive tissée dans la trame de la matérialité et de la spatialité. Au plan théorico-métaphysique, en effet, la spatialité qui lui est ontologiquement constitutive, génère la séparabilité, la divisibilité, la multiplicité quantitative sous le mode de l’opposition idéologique des idées. Si, au plan théorico-pratique, les opérations de l’intelligence humaine sont d’une grande utilité pour l’homme, il n’en est pas de même sur le plan social. À l’échelle de celui-ci, la spatialité qui s’exprime en séparabilité sont autant d’expressions de la nature égoïste de l’individu dont la source onto-vitale est l’intelligence elle-même. Bergson (1995, p. 94) ne dit-il pas qu’elle a une tendance naturelle à aller « droit aux solutions égoïstes » ? La preuve en est que « dans tous les groupes, dans toutes les cités, dans toutes les nations, elle fait surgir un appel pressant et sacré : se fermer, se clôturer, se boucler sur soi-même » (G. Levesque, 1978, p. 61).Cette réalité rend compte d’une pesanteur d’un moi absolutisé innervant un égoïsme effectif dans les cercles socio-professionnels et ethnocentriques.
De ce qui précède, on voit bien qu’en remontant aux causes métaphysiques, Bergson nous montre pourquoi les conflits socio-professionnels sont naturels aux sociétés humaines. Si leur point d’impulsion métaphysique est l’intelligence spatialisante et séparatrice, on comprend pourquoi dans la vie intellectuelle des universitaires, cela est une réalité prégnante. C’est ainsi qu’à mesure que la civilisation s’intellectualise et se technicise sous le rapport de l’élan de l’intelligence, les conflits d’intérêts de tout genre sont prégnants. En effet, en 1927, Julien Benda, publie La Trahison des clercs. Il y dénonce l’attitude idéologiquement haineuse des clercs (on dirait aujourd’hui intellectuels), c’est-à-dire tous ceux dont l’activité, par essence, ne poursuit pas de fin pratique.
Au demeurant, chez Bergson, le rapport d’un point de vue phénoménologique, entre l’individu intelligent et la société avec ses pressions ou obligations, se manifeste en forme d’impulsion égocentrique. Malheureusement, le sentiment social présent dans le repliement sur soi (égocentrisme), tel que le promeut l’âme close, est sans charge émotionnelle. Or les personnalités d’élite, comme les mystiques, chez qui l’âme est ouverte de fait, vivent, pensent et agissent de droit dans la durée créatrice. Ils sont, par un destin ontologique, dans une relation communionnelle avec l’autre et ce à travers l’amour qu’ils ont pour Dieu. En fait, la transitivité ontologique dont les personnalités mystiques jouissent avec transport, et ce du fait de leurs pensées et action dans la durée, se joue dans leur relation communionnelle avec l’autre. De là se fait jour, l’impératif en termes d’une exigence bergsonienne de penser et de vivre intuitivement dans la durée. Il est envisagé comme solution à la conflictualité endogène de l’intelligence ou intellect de l’universitaire.
2. De l’exigence bergsonienne de penser en durée : la vie intuitive ou mystique comme solution à la conflictualité de l’intellect
Chez Bergson, il y a d’une part, une exigence épistémique de penser en durée ou comme le dit Worms, de faire gagner l’intelligence par l’intuition. Et d’autre part, il y a chez lui, une exigence anthropologique qui consiste à entraîner l’homme ordinaire à la mysticité dont il est naturellement capable. C’est que chez lui, sur la ligne onto-anthropologique, il y a la réalité de fait d’un amour divin de l’humanité. Il en est ainsi de l’amour propagé par les mystiques dans un corps social rigidifié par l’intelligence séparatrice et égoïste. Mais, par une sorte de contagion qu’on dirait anthropo-ontologique, le corps social peut renaître à une société spirituelle dégagée des séparations et divisions produites par notre intelligence. Les mystiques ont en effet, la capacité de dilater leur intelligence en réveillant les virtualités d’intuition qui y sommeillent pour surmonter sa pente égoïste telle qu’elle est à l’œuvre chez les intellectuels universitaires.
2.1. De la pente de l’intelligence séparatrice à la naissance de classes d’intellectuels égoïstes dans l’anthropologie bergsonienne
Il n’y a pas une anthropologie de fait et conceptuellement structurée chez Bergson. Suggérée, elle n’y existe que de droit. Elle l’est ontologiquement à l’état germinatif dans le processus et l’accomplissement de la vie qui évolue et a abouti à l’intelligence. C’est par-là que la vie sociale prend forme et surtout se structure pour laisser se manifester la conflictualité qui lui est immanente. C’est cela qui fait qu’on peut dire que la socialité et la sociabilité sont les propriétés ontologiques de la vie évolutive en relation avec l’intelligence spatialisante et séparatrice. Tout compte fait, il s’agit de comprendre avec Bergson que « la vie sociale est immanente […] à l’intelligence » (H. Bergson, 1995, p. 22). Cet état de fait justifie pourquoi « la connaissance de l’homme, à mesure que sa civilisation progresse, est de plus en plus une connaissance intellectuelle » (G. Matisse, 1938, p. 30).
Avec Bergson, l’intelligence est un produit génésique et génétique de la vie évolutive tissée dans la trame de la matérialité et de la spatialité. Au plan théorique, en effet, et d’une part, la spatialité qui lui est ontologiquement constitutive, génère la séparabilité, la divisibilité, la multiplicité quantitative sous le mode dialectique du schéma rigide de thèse-antithèse. Et d’autre part, au plan pratique, elle a une mécanique qui lui donne d’être fabricatrice, inventive d’outils prolongeant, en particulier, la main de l’homme, et son corps en général.
Si au plan théorico-pratique, les opérations de l’intelligence de l’homme sont d’une grande utilité pratique, il n’en est pas de même sur le plan social. À l’échelle de celui-ci, la spatialité qui s’exprime en séparabilité ou divisibilité sont autant d’expressions de l’égoïsme de l’individu dont la source onto-vitale est l’intelligence elle-même. Bergson (1995, p. 94) ne dit-il pas qu’elle a une tendance naturelle à aller « droit aux solutions égoïstes » ? La preuve en est que « dans tous les groupes, dans toutes les cités, dans toutes les nations, elle fait surgir un appel pressant et sacré : se fermer, se clôturer, se boucler sur soi-même »(G. Levesque, 1978, p. 61). Cela est justifié par « la tendance à l’enkystement défensif contre les agressions des autres classes, la protection stérile de ses privilèges » (H. Laborit, 1970, p. 46)En fait, c’est un principe qui ne justifie pas moins une phénoménologie de l’instinct de vie ou de conservation. Ce dernier rend compte de façon effective de la pesanteur d’un moi absolutisé innervant un égoïsme réel dans les cercles de cercles de classes socio-professionnels. Dans ces derniers, il y a des intellectuels que Sartre (1972, p. 13) caractérise et décrit comme il suit : « [ils] constituent une « diversité d’hommes ayant acquis quelque notoriété par des travaux qui relèvent de l’intelligence, sciences exactes, sciences appliquées, médecine, littérature » et qui abusent[124] de cette notoriété ». Ainsi dit, et du point de vue de l’existence des hommes,
il suffit d’observer ce qui se passe sous nos yeux dans les petites sociétés qui se constituent au sein de la grande, quand des hommes se trouvent rapprochés les uns des autres par quelque marque distinctive qui souligne une supériorité réelle ou apparente, et qui les met à part. Au respect de soi que professe tout homme en tant qu’homme se joint alors un respect additionnel, celui du moi qui est simplement homme pour un moi éminent entre les hommes ; tous les membres du groupe « se tiennent » et s’imposent ainsi une « tenue » ; on voit naître un « sentiment de l’honneur » qui ne fait qu’un avec l’esprit de corps » (H. Bergson, 1995, p. 66-67).
De cela, il découle que les crises de croissance ontologique au sein de la vie évolutive, à l’échelle sociale, génère les classes d’individus. Attachés à leurs intérêts personnels et corporatistes, ils n’ont pas conscience qu’ils agissent sous l’impulsion de leur intelligence conceptuelle (intellect) à l’origine de rapports socio-académiques conflictuels.
De ce qui précède, on voit bien qu’en remontant aux causes métaphysiques, Bergson nous montre pourquoi les conflits socio-professionnels sont récurrents dans les sociétés humaines. Si leur point d’impulsion métaphysique est l’intelligence spatialisante et séparatrice, nous comprenons pourquoi dans la vie intellectuelle des universitaires, cela est une réalité bien prégnante. Il faut alors travailler éthiquement à faire gagner l’intellect par une vie intuitive épanouie en élan émotionnel d’amour d’autrui.
2.2. De l’intellect gagné par l’intuition : de la vie de l’universitaire dans la durée à l’amour de l’autre par la connaissance intuitive
L’idée de Worms selon laquelle l’intelligence peut être gagnée par l’intuition est de portée ontologique. L’évolution de la vie qui porte les êtres vivants à la réalité de l’existant, produit des facultés en vue de leur adaptation active ou cognitive à la matière et surtout à la société. Il s’agit de l’instinct, de l’intelligence et de l’intuition qui, bien qu’ayant des propriétés distinctives, sont entremêlés et complémentaires. Chacun contient des lueurs de l’autre si bien que la différence de degré étant effective, c’est la proportion qui diffère entre eux. Ainsi si autour de l’instinct, il y a une frange d’intelligence, sous le même rapport ontologique, il y a des virtualités d’intuition qui entourent cette dernière. C’est ce qui fait dire à Bergson (1995, p. 62) que « l’intuition est en chacun de nous », à l’état latent ; cela justifiant pourquoi « entre l’âme close et l’âme ouverte », il y a « l’âme qui s’ouvre et aux yeux de laquelle les obstacles matériels tombent » (H. Bergson, 1995, p. 57).
La société, affirme Berdiaeff, est le monde de l’objectivation. Il est le domaine naturel du moi superficiel bergsonien, dominé par l’intelligence égoïste et égocentrique. C’est cette dernière qui, dans son élan social, ramène tout à elle en proposant toujours des solutions égoïstes aux problèmes sociaux qu’elle-même crée. Nous sommes dans un contexte de conflit des consciences où chacune, cherchant à dominer l’autre, est saisie par la tentation de sa réification ou de sa mort symbolique. Ainsi, faut-il comprendre que,
tout homme arrivé est un parvenu. Or les gens en place ne sont évidemment pas d’humeur à faciliter la progression d’hommes qui pourraient être pour eux des rivaux dangereux, susceptibles d’éclipser leur propre et légitime gloire (…). Le mérite, l’autorité personnelle interviennent ainsi comme des empêchements et des motifs d’élimination (…). La défense des positions acquises contre les nouveaux venus éventuels n’est qu’un aspect de la polémologie universitaire (…). Les rivalités personnelles se camouflent naturellement en oppositions doctrinales et la concurrence des volontés de puissance affrontées aboutit d’ordinaire à la survivance du plus apte (…). Celui qui occupe une position de contrôleur ou d’arbitre ne connaît pas guère d’autre étalon de valeur que sa propre personnalité (…). On observera que le maître authentique, dont la clairvoyance unanimement reconnue a fait progresser sa spécialité, devient lui-même un obstacle à tout progrès ultérieur. (G. Gusdorf, 1963, p. 131-134).
Ainsi entendu, l’espace socio-universitaire est le lieu où le sujet connaissant, intelligent et en conséquence égocentrique, peut élever l’autre au rang d’objet en se prévalant de certains titres académiques et privilèges matériels. À dire vrai, il existe selon H. Bergson (1995, p. 112) « des dangers de l’activité intellectuelle ». Mais, ils peuvent être résorbés « sans compromettre l’avenir de l’intelligence » et par conséquent, celui de l’homme lui-même, et par extension celui de la société ou de l’humanité tout entière. Mais, faut-il désespérer de l’homme intelligent quant à sa capacité à implémenter l’harmonie dans le corps social ? Bergson (2013, p. 67) n’a-t-il pas souligner que « dès que nous avons aperçu intuitivement le vrai, notre intelligence se redresse, se corrige, formule intellectuellement son erreur. Elle a reçu la suggestion ; elle fournit le contrôle ? »
En effet, chez Bergson, la vie crée les conditions méthodologiques de sa connaissance à la fois dans son extériorité et son intériorité psychologique par la génération de facultés appropriées. C’est pourquoi, elle est capable de surmonter ses contingences liées à l’intelligence spatialisante qu’elle a générée dans son évolution. Sur le plan ontologique, l’intelligence est entourée d’une frange d’intuition à l’état de potentialité ou de virtualité, de même que de l’âme close à l’âme ouverte, il y a celle qui s’ouvre. Il suit delà que les infirmités et contingences de l’intelligence en termes de problèmes induits dus à la matérialité et la spatialité qui lui sont consubstantielles, peuvent trouver leur solution dans et par l’intuition. C’est « (…) donc là que nous devrons aller chercher des indications pour dilater la forme intellectuelle de -notre pensée ; c’est là que nous puiserons l’élan nécessaire pour nous hausser au-dessus de nous-mêmes » (H. Bergson, 1996, p. 49). À l’échelle de la connaissance théorétique, il s’agit d’invertir notre manière intelligente ou intellectuelle de penser. Elle est méthodologiquement, l’exigence épistémologique pour annihiler les propriétés de l’espace en forme de divisibilité, multiplicité quantitative qui nous empêchent d’avoir une connaissance de la durée intérieure à nous-mêmes et aux choses.
Cependant, à l’échelle sociale la connaissance apparaît comme celle d’un moi appliquée à un toi ou inversement. Dans cette dernière, il s’agit d’une communion intra-personnelle des Moi profonds dans la sphère de la spiritualité de la durée. L’intuition qui pro-voque la coïncidence du sujet et de l’objet ou des Moi, n’est-elle pas sympathie en tant que consécration ontologique d’un amour émotionnel et fusionnel ? Or la durée est moins un concept qu’un paramètre métaphysique de fonctionnalité méthodologique. Elle exige l’intuition comme méthode impliquant en conséquence, la connaissance intuitive. Nous introduisant dans la vie évolutive, elle a une portée existentielle qui coïncide avec un moment anthropologique. Il s’agit de comprendre que l’homme intelligent a en lui-même la capacité de surmonter son humaine condition, à savoir les déficiences de l’intelligence elle-même. La preuve en est que selon Bergson (1995, p. 152), « l’homme possède en lui-même de quoi à se dépasser. »
En effet, par la connaissance intuitive qui s’épanouit en amour désintéressé d’autrui, nous dépassons d’une part, les séparations en termes de dualités ontologique et anthropologique présentes dans nos connaissances dualistes. Et d’autre part, par ledit amour de l’autre qu’induit la connaissance intuitive, nous parvenons à surmonter les contingences et pesanteurs sociologiques de notre mode d’être socio-universitaire foncièrement égocentrique et conflictuel. En effet,
la solitude [égoïstique] ne se trouve surmontée que si, dans l’opération de la connaissance, s’accomplit l’union véritable qui est l’union par amour, puisqu’il n’y a pas d’union possible avec le général, qu’il n’y en a qu’avec un autre moi, un toi (…). La connaissance, c’est l’égocentrisme dépassé » (…), et mieux, « une transfiguration créatrice. (N. Berdiaff, 1936, p. 123).
Il suit que l’amour du savoir qui se développe sous le régime épistémique de l’amour de la vérité dans l’espace universitaire, doit se nourrir nécessairement et sur le plan éthique, de l’amour d’autrui. Si tant est que la philosophie est comme le dit Hegel, le service divin de la vérité ; la quête du savoir par les universitaires devrait être structurée par une sorte de religion de l’humanité. Elle sera alors comme un « supplément d’âme » qui scelle leur unité par-delà les grades et les spécialités. Il s’agit de libérer l’intellect des pesanteurs sociales de l’orgueil et l’égoïsme de l’intelligence que les grades universitaires contribuent à exacerber, car « comme le dit une parole de Saint-Exupéry relativement à l’amour, il ne s’agit pas ici de se regarder l’un l’autre, mais de regarder tous les deux dans la même direction, en avant et plus haut »[125].
Tout compte fait, il y a lieu de comprendre que chez Bergson, il y a un parachèvement socio-anthropologique à opérer dans l’ordre de l’évolution de la vie du côté de l’intelligence. Ledit parachèvement est révélateur de la création d’une humanité divine comme celle des personnalités exceptionnelles ou d’élites, que sont les naturels mystiques. Ceux-ci ont surmonté les séparations ontologique et anthropologique dans l’univers social par leur pensée et leur vie dans la durée créatrice et ce par le biais de l’acte d’amour. Les mystiques en donnent l’impulsion originelle par l’amour qui est consubstantiel à leur être et leur faire. Cela est possible pour eux en tant qu’ils sont naturellement dans la direction du divin ; celui-ci leur communiquant ledit amour. C’est pourquoi,
de même qu’il s’est trouvé des hommes de génie pour reculer les bornes de l’intelligence, et qu’il a été concédé par là à des individus, de loin en loin, beaucoup plus qu’il n’avait été possible de donner tout d’un coup à l’espèce, ainsi des âmes privilégiées ont surgi qui se sentaient apparentées à toutes les âmes et qui, au lieu de rester dans les limites du groupe et de s’en tenir à la solidarité établie par la nature, se portaient vers l’humanité en général dans un élan d’amour (H. Bergson, 1995, p. 97).
De ce qui précède et pour partir des propos de Bergson, il existe un modèle éthique d’un point de vue anthropologique, à savoir les mystiques, personnalités créatrices par excellence. Ils ont surmonté les déficiences de l’intelligence égoïste, séparatrice et conflictuelle. Ainsi sont-ils dans l’espace universitaire, des modèles de personnalités spirituelles dont la fonction est éminemment éthique et de portée existentielle. C’est que,
ce qu’ils ont laissé couler à l’intérieur d’eux-mêmes, c’est un flux descendant qui voudrait, à travers eux, gagner les autres hommes : le besoin de répandre autour d’eux ce qu’ils ont reçu, ils le ressentent comme un élan d’amour. Amour auquel chacun d’eux imprime la marque de sa personnalité. Amour qui est alors en chacun d’eux une émotion toute neuve, capable de transposer la vie humaine dans un autre ton. Amour qui fait que chacun d’eux est aimé ainsi pour lui-même, et que par lui, pour lui, d’autres hommes laisseront leur âme s’ouvrir à l’amour de l’humanité (H. Bergson, 1995, p. 102).
Conclusion
Mais, dans l’univers bergsonien, la même intelligence, lieu d’incubation et production intellectuelle, est socialement contre-productive. Elle l’est, justement quand elle n’est pas accompagnée de vie intuitive en forme d’émotion d’amour capable de concilier les postures intellectuelles et idéologiques, et les différences socio-professionnelles. C’est cette dernière qui peut annihiler les différends en formes de conflits d’intérêts structurant les rapports socio-universitaires entre individus et classes d’individus par grades interposés. Ceux-ci, faut-il le souligner, placés sous le prisme de l’intelligence égoïste, défendent leurs intérêts contre ceux des autres, sous couvert d’un élitisme étriqué et étroit, pour ainsi dire spatialisant.
Dans un tel univers universitaire, il faut, au-delà du sujet rationnel ou intelligent, faire en sorte que le mystique occupe le devant de la scène. C’est que, par l’intuition qui l’anime et dont la substantialité éthique se conjugue en amour fusionnel pour autrui, il est capable de régénérer spirituellement l’espace universitaire. En pratique, l’action du mystique décoche une émotion qui, sympathiquement partagée, nous permettra de former une société universitaire spiritualisée, éthicisée pour ainsi dire ouverte dans laquelle « nous seront plus forts, car à la grande œuvre de création qui est à l’origine et qui se poursuit sous nos yeux, nous nous sentirons participer, créateurs de nous-mêmes » (G. Chomienne, 1989, p. 154).
Il y a, dans la métaphysique existentielle bergsonienne, un moment anthropologique qui culmine avec une mutation ontologique de portée éthique et spirituelle. La personne du mystique, individualité exceptionnelle, est dans le philosopher bergsonien, un modèle éthique par sa vie spirituelle épanouie en amour de l’autre. Étant celui qui a dominé le penchant égoïste de son intelligence par la vie intuitive, le mystique par son être et son faire, devra être imité par les intellectuels universitaires d’ici et d’ailleurs. Ils seront alors capables d’amour mutuel ou fusionnel, d’une sorte de sympathie divinatrice. L’amour des uns et des autres devra être au commencement et à la fin de la recherche scientifique comme son point d’ancrage sociocommunautaire et son horizon éthique. Telle est l’utopie bergsonienne qui, pour être une aspiration propre à un monde social réglementé par une intelligence égoïste et séparatrice, a sa valeur éthique et archétypale par sa finalité normative.
De cette réflexion, nous trouvons dans le philosopher bergsonien, la cause profonde des crises socio-universitaires. Si celles-ci sont récurrentes et n’épargnent aucune université, c’est en raison de leur enracinement anthropologique en tant qu’elles sont liées à l’intelligence naturellement spatialisante et égoïste.
Références bibliographiques
ALAIN de Benoist, 2017, Ce que penser veut dire, Penser avec Goethe, Heidegger, Rousseau, Schmitt, Péguy, Arendt…, Monaco, Éditions du Rocher.
ARISTOTE. 1989, Éthique de Nicomaque, trad. de Jean Voilquin-Paris, Flammarion.
BENDA Julien, 1975, La Trahison des clercs, Paris, Grasset.
BERDIAEFF Nicolas, 1936, 5 Méditations sur l’existence, traduit du russe par Irène Vildé-Lot, Paris, Aubier.
BERGSON Henri, 2013, La pensée et le mouvant, Paris, P.U.F.
BERGSON Henri, 1996, L’évolution créatrice, Paris, P.U.F.
BERGSON Henri, 1995, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, P.U.F.
BERGSON Henri, 2001, Œuvres, Paris, P.U.F.
CHÂTELET François, 1970, La philosophie des professeurs, Paris, Éditions Bernard Grasset.
CHOMIENNE Gérard, 1989, Bergson, la conscience et la vie, Le possible et le réel, Paris, Magnard.
LABORIT Henri, 1970, L’homme imaginant, Essai de biologie politique, Paris, Union Générale d’Éditions.
LEVESQUE Georges, 1973, Bergson : vie et mort de l’homme et de Dieu, Paris, Les éditions du Cerf.
MATISSE Georges, 1938, La philosophie de la nature : identité du monde et de la connaissance, Paris, PUF.
GUSDORF Georges, 1963, Pourquoi des professeurs ?, Paris, Petite bibliothèque Payot.
SARTRE Jean-Paul, 1972, Plaidoyer pour les intellectuels, Paris, Gallimard.
[1] Ailleurs, j’ai développé ce point d’un autre angle – cf. Ernst Wolff, 2013, « Reform and crises. Reflexions and questions on the condition of the Human and Social Sciences in South Africa and beyond », in Theoria: A Journal of Social and Political Theory 60 (135), 2013, pp. 62-82.
[2] Pour cette raison, je m’autorise de nombreuses références à mes propres publications.
[3] Paulin Hountondji, 1977, Sur la « philosophie africaine ». Critique de l’ethnophilosophie, Paris, Maspero, pp. 219-238.
[4] Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955, p. 27.
[5] P. Hountondji, Sur la « philosophie africaine », p. 74 (de l’article « L’idée de la philosophie »).
[6] Cf. P. Hountondji, Sur la « philosophie africaine », p. 226.
[7] De même dans in cf. Fabien Eboussi-Boulaga, La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie, Paris, Présence Africaine, 1977, p. 136 (il parle de « concordisme ») et Okolo Okonda, 1986, Pour une philosophie de la culture et du développement. Recherches d’herméneutique et de praxis africaines. Kinshasa, Presses universitaires du Zaïre, p. 66.
[8] Olufémmi Taiwo, 2010, How colonialism pre-empted modernity in Africa, Bloomington: Indiana University, Press.
[9] Mahmood Mamdani, 2012, Define and rule. Native as political identity, Cambridge & Londres, Harvard, U.P.
[10] Cf. « liberté créatrice » ; c’est aussi le sens de la citation de Césaire (238).
[11] Auxquels on peut ajouter aujourd’hui, « l’africanisation » – cf. e. g. Mahmood Mamdani, 2016, « Between the public intellectual and the scholar: decolonization and some post-independence initiatives in African higher education », in Inter-Asia Cultural Studies, N°17/1, 2016, pp. 68-83.
[12] Ce qui n’est pas du tout la même chose que d’embrasser un universalisme supposé neutre et sans culture.
[13] Voir Ernst Wolff, 2021, Lire Ricoeur depuis la périphérie. Décolonisation, modernité, herméneutique. Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, pp. 93-116 (accès libre : https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/48482). Dans ma discussion actuelle, je suis ces idées ricœuriennes.
[14] (accès libre: https://lup.be/collections/category-philosophy/products/172317).
[15] Cf. Ernst Wolff, « Décoloniser la philosophie. Autour des contestations universitaires en Afrique du Sud ». La Vie des Idées 2016 (https://laviedesidees.fr/Decoloniser-la-philosophie.html) et Ernst Wolff, 2016, « Four questions on curriculum development in contemporary South Africa », in South African Journal of Philosophy, 35 (4), pp. 444-459.
[16] Cf. E. Wolff, « Intercontinental philosophy: thinking in and for a plural world » (à paraître dans Symposium. Revue canadienne de philosophie continentale).
[17] De cette manière, j’arrive à nouveau à une conclusion similaire à celle de Ricœur dans les années 1950, à savoir que la colonisation et la politique des superpuissances de la Guerre « froide » ont servi à cacher le pluralisme mondial établi et découvert par la mondialisation (voir référence ci-dessus).
[18] Comme je la définis dans « Intercontinental philosophy », Op. cit.
[19] Cependant, ce que j’entends par philosopher de manière intercontinentale est bien plus que la philosophie interculturelle – comme je le soutiens dans « Intercontinental philosophy », Op. cit.
[20] Ici, mon souci n’est pas seulement les différentes langues naturelles du monde, mais plus proche de nous même la marginalisation de la philosophie africaine francophone par son homologue anglo-américaine.
[21] Voir par exemple mes monographies sur Mabona et Versfeld ci-dessus.
[22] Ma compréhension de la communalité est inspirée de François Jullien, 2008, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Paris, Fayard et la confirmation multiple de l’universalisme latérale est développée dans « Intercontinental philosophy », Op. cit.
[23] Selon la définition de Nancy Fraser de la justice en termes de démocratie – cf. e.g. Nancy Fraser, 2008, Scales of justice. Reimagining political space in a globalizing world, Cambridge, Polity Press.
[24] Cf. Emmanuel Eze, 2010, Race and the Enlightenment. A reader, Cambridge : Blackwell, 1997 et Marcel Merle, « L’anticolonialisme », in Marc Ferro (ed.), Le livre noir du colonialisme. XVIe – XXIe siècle : de l’extermination à la repentance. Paris, Arthème Fayard/Pluriel, pp. 815-862.
[25] À titre d’exemple, il suffit de penser à qui est invité à prononcer des key-notes lors de conférences ou nommé dans des départements, etc.
[26] Dans un exposé plus long, je pourrais approfondir ce point en relation avec les idées de cadrage et de parité de participation de Nancy Fraser, dans son ouvrage évoqué plus haut.
[27] Thiémélé Ramsès Boa, 2010, La sorcellerie n’existe pas, Abidjan, Les Editions du Cerap, 140 p.
[28] Bamenda, Bertoua, Buea, Dschang, Douala, Ebolowa, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Yaoundé I et Yaoundé 2.
[29] Article 22 alinéa 2 de la loi 2001, in Recueil des textes du Ministère de l’Enseignement Supérieur, Op. cit., p. 40.
[30] Articles 40 et suivant du décret n°93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités.
[31] Grèves de 1972, 1973, 1978, 1991, 2002, 2005, 2010…
[32] Voir art. 61 du décret n°93/27.
[33] L’extrait du règlement pédagogique de l’Université de Yaoundé I relève les mêmes cas sur le verso de la page de couverture du cahier d’examen de cette institution.
[34] Voir art. 66 du décret n°93/027.
[35] Voir article 52 du Décret n°93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités.
[36] Voir l’article 67 du décret n°75/805 du 26 décembre 1975.
[37] Voir article 63 Décret № 93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités.
[38] Voir l’article 53 du décret n°93/27 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités.
[39] Voir article 52 du décret n°93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités.
[40] Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France.
[41] Université des Sciences et Techniques de Masuku.
[42] La formule de calcul consacrée ici est : 32 × 100/48 = 66,666%.
[43] DPS =Direction des Etudes, de la Planification et Statistiques 2019-2020.
[44] https://books.openedition.org/pum/14800?lang=fr, consulté le 06/11/2021.
[45] https://web.facebook.com/groups/449137742668729, consulté le 21/06/2021.
[46] https://web.facebook.com/groups/1784029735193699, consulté le 14/07/2021.
[47] https://web.facebook.com/Oreilleducampus-143066116168546, consulté le 21/08/2021.
[48] Il est important de rappeler que le genre est une acquisition parfois inconsciente des caractéristiques sur la base desquelles la société différencie l’homme de la femme. Or, à comprendre S. de Beauvoir (1949), être homme ou femme est une série de constructions sociales. En d’autres mots, poursuit-elle, on ne naît pas femme, on le devient.
[49] Dans la société patriarcale, c’est l’homme qui possède les pleins pouvoirs. Cela s’observe non seulement dans la famille, mais encore dans tous les postes clés de la société. Au fil des siècles, cet état de fait s’est imposé comme une évidence, et la femme a laissé à l’homme les hautes responsabilités, parce que celui-ci est qualifié de sexe fort et elle-même de sexe faible. Désormais, l’homme décide pour la femme (M. Richard, 1977).
[50] Entretien réalisée lors du cinquantenaire sur la proportion des femmes avec une enseignante-chercheure au département de philosophie, le 05/05/2022.
[51] Il importe de souligner que la faible croissance du pourcentage féminin des thèses soutenues est aussi l’une des raisons du faible taux de féminisation aux différents grades universitaires.
[52] Entretien réalisé le 13/05/2022 à la Faculté des Langues, Lettres, Arts et Communication.
[53] Entretien réalisé le 05/05/2022 à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales lors du cinquantenaire de l’Université de N’Djamena.
[54] Or, ceux qui réussissent, sont ceux qui sont soutenus dans leurs recherches et leurs séjours scientifiques par des financements des laboratoires (S. Louvel et A. Valette, 2014) ou des centres de recherche.
[55] Entretien réalisé le 07/05/2022 à la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées.
[56] Entretien réalisé le 12/05/2022 à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.
[57] Ouvrage écrit pendant les évènements de Mai 68 en France, alors que la Sorbonne où enseignait Ricœur était occupée. « Réforme et révolution dans l’Université » à l’origine, a été publié sous la forme de trois articles dans le Monde des 9, 11 et 12 juin 1968. Aujourd’hui, on le retrouve dans l’ouvrage Lectures 1. Autour du politique et publié aux Editions du Seuil, en 1991, précisément de la page 381 à 398.
[58] Au Cameroun par exemple, le système LMD adopté en 2006 (ainsi qu’en Zone CEMAC) est officiellement entré en vigueur par décret ministériel en 2018 mais l’idée de la professionnalisation des enseignements remonte aux Etats généraux de l’éducation de 1995.
[59] Promu par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur, le système d’enseignement Licence-Master-Doctorat répond à des objectifs fondamentaux très ambitieux pour redorer le blason des universités africaines. Réaffirmés dans le cadre du Projet AGURES, autour du thème de la « construction du nouvel espace africain et malgache de l’enseignement supérieur dans le contexte de la mise en place du système LMD dans l’enseignement supérieur de l’espace CAMES », ces objectifs semblent être restés lettre morte, au regard de la situation léthargique des universités concernées (CAMES, 2012, p. 15).
[60] Le fait de respecter et faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi d’avoir conscience de ses droits et devoirs envers la société.
[61] Elle s’oppose à la civilité, qui est une attitude de respect à l’égard des autres citoyens, ainsi qu’à l’égard de l’espace public et de la chose publique.
[62] La distinction, ici, ne s’entend pas comme simple différenciation discriminante, mais comme ce qui confère à l’homme un certain honneur, une certaine élégance, une certaine estime.
[63] L’idéal serait que le gouvernement ou l’État se contente de donner les grandes orientations, en matière de planification et de financement de l’enseignement supérieur. S’immiscer dans la gestion des universités, et surtout des questions d’ordre purement scientifique, c’est empiéter sur la liberté des universitaires.
[64] À propos des quatre causes, voir Métaphysique, livre A, chapitre 3 et Physique, livre II.
[65] En grec, cause et responsable sont synonymes. Le mot féminin grec αιτια ou le neutre substantivé de l’adjectif αιτιος signifie « responsable de », « coupable de ». Chercher donc l’αιτια de quelque chose, c’est rechercher ce qui est responsable de cette chose.
[66] cf. Classement mondial des universités QS World University Rankings 2020-2021 fr.m.wikipedia.org).
[67] Chez les Grecs le kaïros est le petit dieu ailé de l’opportunité qu’il faut saisir quand il passe. C’est le temps métaphysique du basculement décisif, opposé au Chronos, le temps physique.
[68] S’agissant des entités scientifiques qui établissent le classement des palmarès entre toutes les universités et grandes écoles publiques comme privées du monde entier, les trois les plus célèbres et respectées en leur sein sont : Le classement de Shanghai encore connu sous l’appellation d’Academic Ranking of World University, Le classement THE (Times World University Ranking) et Le classement QS (QS World University Ranking).
[69] Nous ne nions point ni ne négligeons l’existence des laboratoires en sciences humaines, en littérature, en mathématiques et dans les autres disciplines qui ne sont pas considérées comme des sciences expérimentales. Par exemple, à Ouagadougou, nous avons le Laboratoire de Philosophie (LAPHI) de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo qui est très actif et efficace.
[70] Des hommes politiques, totalitaristes et sans culture solide, dont Gnamien Konan (D. N’Goran, K. Kloinwhele et É. M. Adjoumani, 2014), l’ex-ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Paul Kagamé (V. N. Atangana, 2021 et La Banque Mondiale, 2014), l’actuel président du Rwanda, jugent que, pour une école de l’excellence, certaines disciplines, principalement les sciences humaines et les lettres, sont à supprimer de l’enseignement supérieur. Pour eux, l’État perd énormément d’argent en payant inutilement les enseignants-chercheurs qui les enseignent et en prenant aussi en charge les étudiants de ces filières alors qu’elles ne sont nullement, d’un point de vue pratique, indispensables, pourvoyeuses de capitaux et d’emplois comme c’est le cas pour les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).
[71] Pour Locke, l’usage irresponsable et arbitraire de la violence psychologique, verbale, écrite, physique, etc., contre un individu, un groupe de personnes ou un pays crée l’état de guerre, aussi bien dans l’état de nature que dans la société politique : « l’exercice illégal de la force contre la personne d’un homme crée l’état de guerre, qu’il existe ou non un juge commun » (J. Locke, 1977, p. 84).
[72] Statistiques données par l’Ecole Nationale Supérieure de statistique et de l’économie Appliquée (ENSEA), www.woroba-ci.net, consulté le 15/04/2022.
[73] Propos de Rudi Dutchke, leader des étudiants grévistes allemands de l’époque de Mai 68.
[74] Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire.
[75] Comité des Élèves et Étudiants de Côte d’Ivoire.
[76] Camille Makosso, pasteur ivoirien, actif sur les réseaux sociaux et qui se proclame « chef de la marmaille ».
[77] Il consiste à arnaquer sur internet.
[78] Préambule de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
[79] Cf. « Gabon – CSI – Rapport des violations des droits syndicaux », in https://survey.ituc-csi.org/Gabon.
[80] Cf. Entretien avec le Pr Marc Louis ROPIVIA, le 04 juin 2022.
[81] Loi 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République gabonaise.
[82] Loi 22/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise.
[83] Loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat.
[84] Il s’agit des lois 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires et 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique.
[85] Ce sont les lois : 21/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de l’enseignement supérieur en République gabonaise ; 22/2000 du déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique en République gabonaise ; 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche et les statuts particuliers : le décret n°866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier du personnel enseignant de l’enseignement supérieur et le décret n° 371/PR/MESRS du 21 mars 1988 fixant le statut particulier des personnels de la recherche scientifique et technologique.
[86] Par exemple, la Recommandation de l’UNESCO concernant le personnel enseignant de l’enseignement supérieur du 11 novembre 1997.
[87] Propos du ministre de la Réforme de l’Etat, Joël PONO OPAPE, le jeudi 27 avril 2017, lors d’une séance de travail avec les partenaires syndicalistes. Cf. Dynamique Unitaire, 2018, Rapport sur les violations des droits humains et les libertés fondamentales au Gabon, Libreville, Document inédit, p. 5.
[88] Ce cas a été vécu en 2019. A l’initiative du SNEC, un préavis de grève, de quatre revendications, est déposé au Cabinet du ministre chargé de l’Enseignement supérieur le 20 mai 2019 pour une entrée en grève prévue le 29 mai. Le préavis est repoussé jusqu’au 6 juin. Devant le mutisme du ministre, l’Assemblée générale du SNEC du 7 juin décide d’entrer en grève. Devant l’effectivité de la grève, le ministre convoque le Bureau national du SNEC pour marquer son indignation de n’avoir pas reçu le préavis. Pourtant l’accusé de réception faisait foi.
[89] Cf. NTOUTOUME Loïc, 2015, « Des enseignants et chercheurs privés de salaire », in https://www.gabonreview.com/ Consulté le 06 avril 2022
[90] « Le SNEC réclame le rétablissement des salaires des enseignants de l’Ecole normale supérieure (ENS) », in https://www.lenouveaugabon.com Consulté le 22 avril 2022
[91] A l’issue de la grève de 2000, les enseignants et chercheurs ont pu obtenir un ordinateur et une imprimante, avec à la clé une formation pour l’utilisation de ces appareils.
[92] ADJO André, 2018, « Jean Rémy YAMA : intellectuel pragmatique aux convictions constantes », in Moutouki, n°127, p. 8.
[93] Environ 150 Euros et 200 dollars. Elle était perçue une fois l’an au mois de juillet, c’est-à-dire 1.200.000 FCFA.
[94] En 2000, cette augmentation fut de 50.000 à 150.000 FCFA selon qu’on était recruté avant ou après 1991, date de changement de la grille indiciaire de la Fonction publique. Effectivement, un écart de 100.000 FCFA distinguait les premiers des seconds.
[95] Les discours à la nation des 16 août et du 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. Cf. Protocole d’accord entre le Gouvernement et les syndicats de l’Enseignement supérieur, 21 avril 2013, p. 3.
[96]La PIR était payée trimestriellement. Après l’augmentation d’avril 2013 qui portait le montant de la PIR à 500.000 FCFA, le gouvernement promit de la mensualiser dès juillet de la même année. Mais il ne respecta pas ses engagements. Ce n’est qu’en juillet 2015, après quatre mois de grève qu’elle sera intégrée au salaire.
[97] L’Union n° 7816 du vendredi 25 janvier 2002, p. 2.
[98] Les personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service (ATOS).
[99] Loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État.
[100] Ce dialogue social longtemps annoncé par le gouvernement n’a pu avoir un début de mise en œuvre que par le forum de la fonction publique organisé en 2020. De ce fait, il devrait être mis progressivement en place dans les administrations.
[101] La Fédération Estudiantine de Côte-d’Ivoire (FESCI) nait en 1990 dans l’ambiance des revendications socio-politiques liées à l’instauration du multipartisme en C.I. À sa naissance, elle avait une force de mobilisation et parvient à se donner les moyens pour la gestion du pouvoir à l’université. Autour des années 2000, elle installe la terreur sur le campus. Elle institue le racket et installe dans les résidences universitaires, qui elle veut.
[102] Littéralement « Les universités pourraient donc représenter, pour Kant, une sauvegarde minimale des Lumières ».
[103] Littéralement « En partie, l’essai de Kant sur les Lumières était un accord entre le souverain autocratique et les philosophes des Lumières. Frederick a autorisé la liberté intellectuelle, que Kant considère comme inoffensive. Les philosophes, pour leur part, ont accepté la stipulation selon laquelle leurs écrits devraient concerner des réflexions générales abstraites ».
[104] Mis en italique par l’auteur.
[105] Cf. supra pour le sens et les implications de ce mot.
[106] Annuaire statistique du Ministère de l’enseignement supérieur, Direction générale de l’enseignement supérieur
[107] Mise en italique par l’auteur.
[108] En Côte d’Ivoire, par exemple, certains syndicats d’enseignants et la totalité des syndicats d’étudiants sont de façon manifeste ou insidieuse le prolongement des partis politiques. Leurs activités sont en veilleuses quand leurs partis politiques sont au pouvoir et elles connaissent une reviviscence quand elles sont dans l’opposition.
[109] Henri Bergson désigne le mot comme une étiquette qui s’insinue entre les choses et nous : « nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent à lire les étiquettes collées sur elles » (1959, p. 460).
[110] Ce texte est à l’origine celui du Comité pour la libération des prisonniers politiques, des enseignants chercheurs et des étudiants du Kenya.
[111] La plante, l’animal, la pauvreté, le banditisme, Etc., se développent.
[112] Thandika Mkandawire a été Directeur de l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) et Secrétaire exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA).
[113] Le Jésuite Alfonso Borrero écrit en 1995 un ouvrage intitulé L’Université aujourd’hui, ouvrage faisant essentiellement écho de la Rencontre sur l’enseignement supérieur initiée par le CRDI (Centre de Recherche pour le Développement International) et l’UNESCO en 1991.
[114] Chaque pays devenu indépendant se dote d’au moins une université nationale alors que l’institution coloniale avait opté pour des universités régionales.
[115] Dans le classement 2022 du QS (Quacquarelli Symonds), University of Cape Town, University of Witwtersrand et University of Johnnesburg, respectivement 1ère, 2e et 3e dans le classement des universités en Afrique, sont dans le classement mondial 226e, 424e et 434e (https://www.bourses-etudes.net)
[116] Comment ne pas s’inquiéter lorsque la meilleure université africaine est classée 226e mondial ? Quel futur attendre donc d’un tel état de fait ?
[117] Le nombre d’universités publiques et privées et celui des étudiants s’est fortement accru en Afrique des années des indépendances à nos jours. Le niveau salarial également.
[118] L’une des trois villes, avec Wuchang et Hanyang, aujourd’hui réunies dans la ville de Wuhan, capitale tentaculaire de la province du Hubei, au centre de la Chine, la ville de Wuhan est un centre commercial dont le marché aux animaux vivants est présenté comme à l’origine du COVID-19, selon de nombreuses études scientifiques.
[119] En 2009, année de parution de son ouvrage.
[120]Le Comité des Élèves et Étudiants de Côte d’Ivoire (CEECI) est le principal syndicat scolaire et estudiantin de l’Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké.
[121] J. RUSS, Dictionnaire de philosophie, Ed. Bordas,
[122] http://www.actu-philosophia.com/Claude-Dupuydenus-Herbert-Marcuse-Les-vertus-de-l’obstination, consulté le 30 avril 2022 à 5 h 25 mn.
[123] En France, la philosophie est une institution dont on s’énorgueillit volontiers (…). Son enseignement y est délivré dans les lycées et collèges ; il est même traditionnellement considéré comme le couronnement des études secondaires littéraires ; les scientifiques eux-mêmes, les futurs médecins n’en sont point dispensés (…). Une telle situation ne peut manquer d’influer sur la place qu’occupe la philosophie dans l’enseignement supérieur et, plus généralement dans l’idéologie française (F. Châtelet, 1970, La philosophie des professeurs, Paris, Bernard Grasset).
[124] Souligné par Jean-Paul Sartre
[125] Cité par Georges Gusdorf, 1963, Pourquoi des professeurs ? Paris, Petite bibliothèque Payot, p. 92.