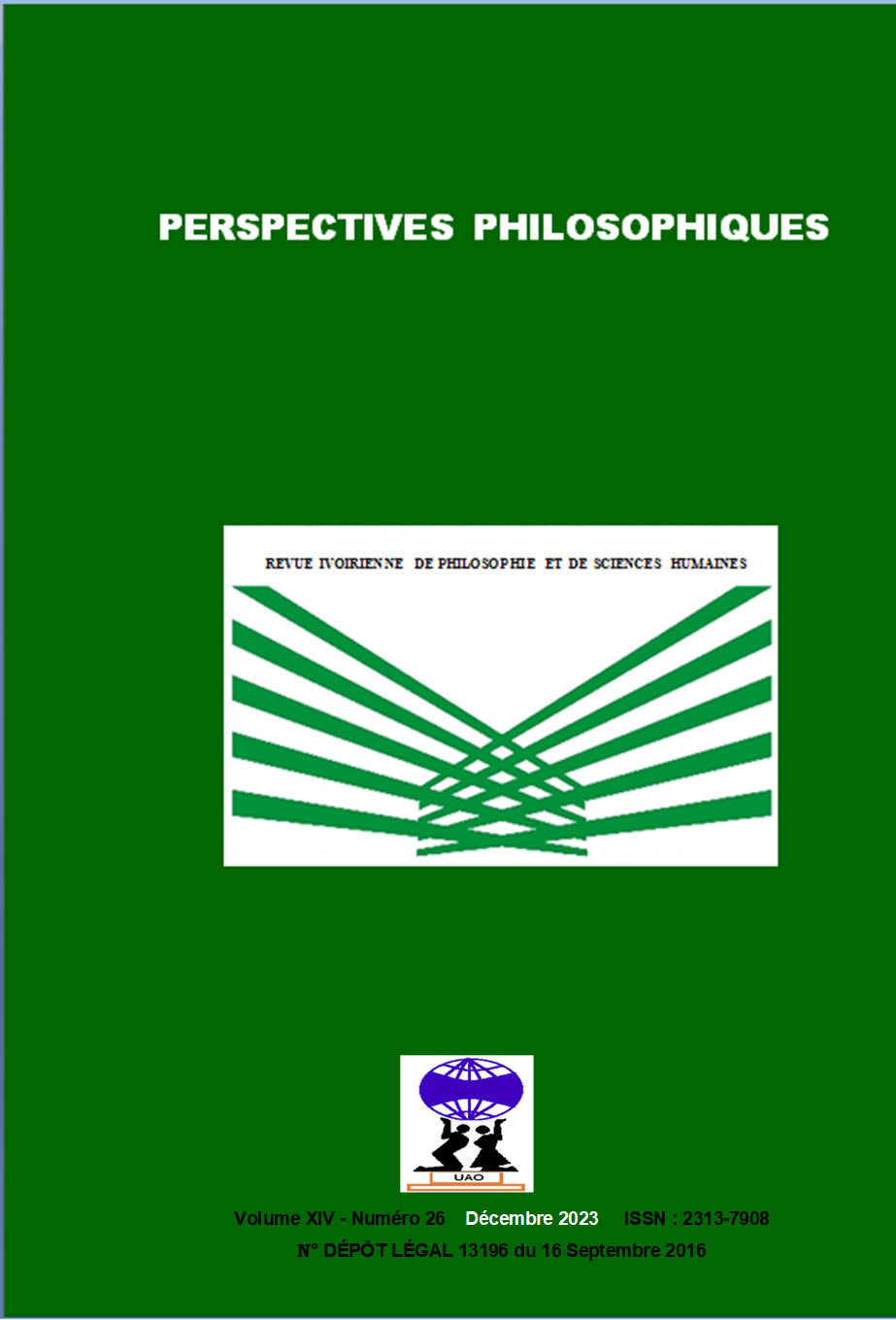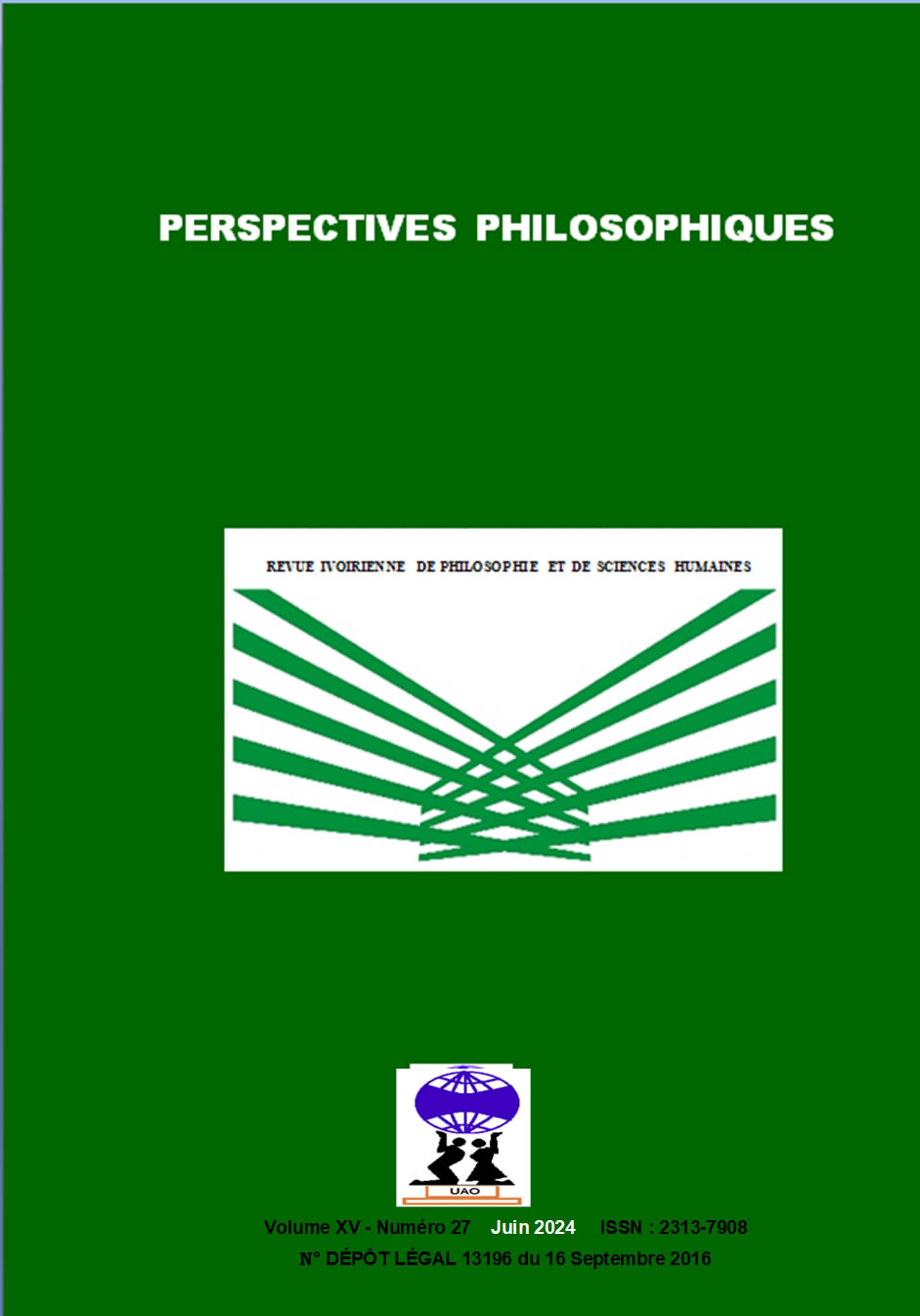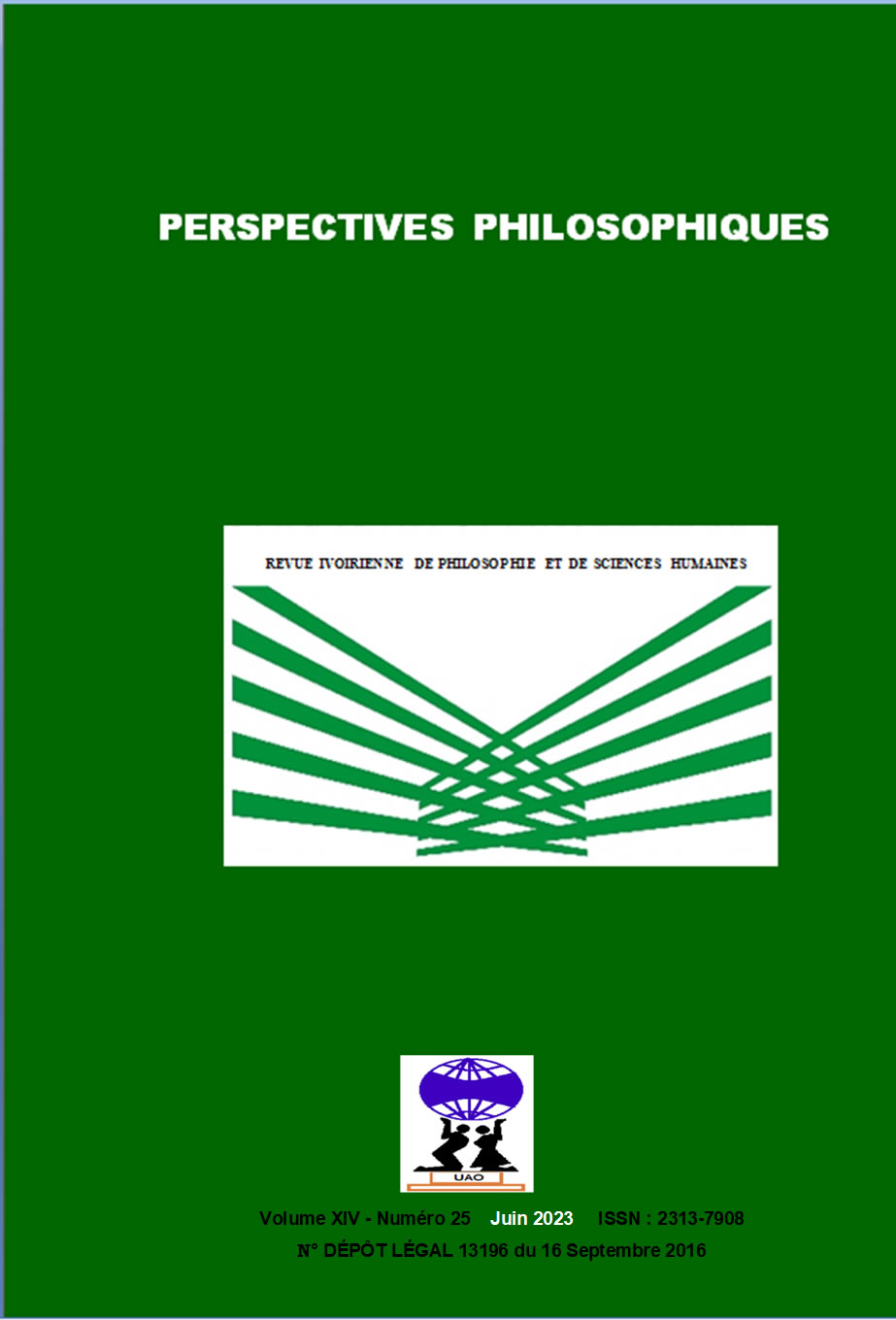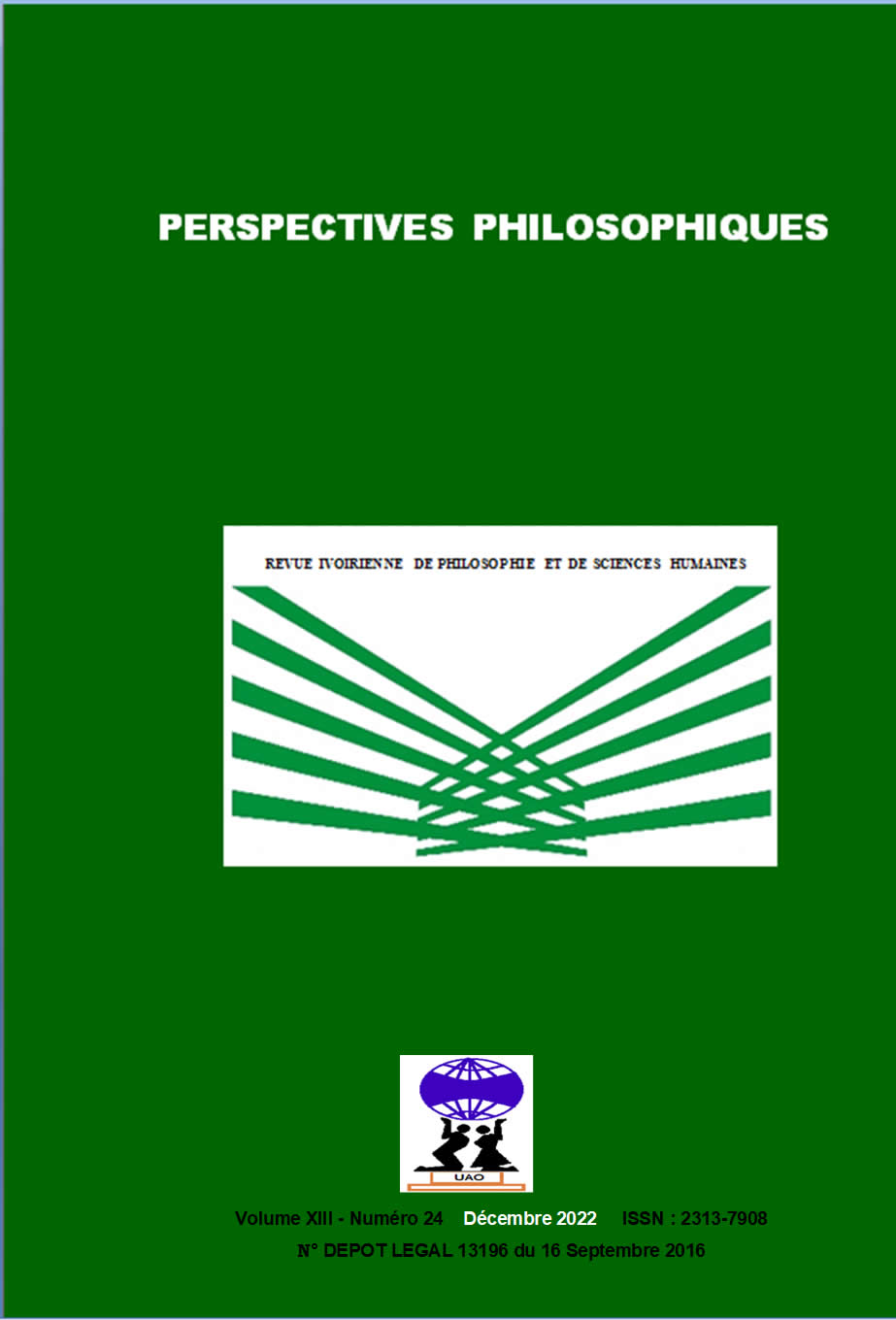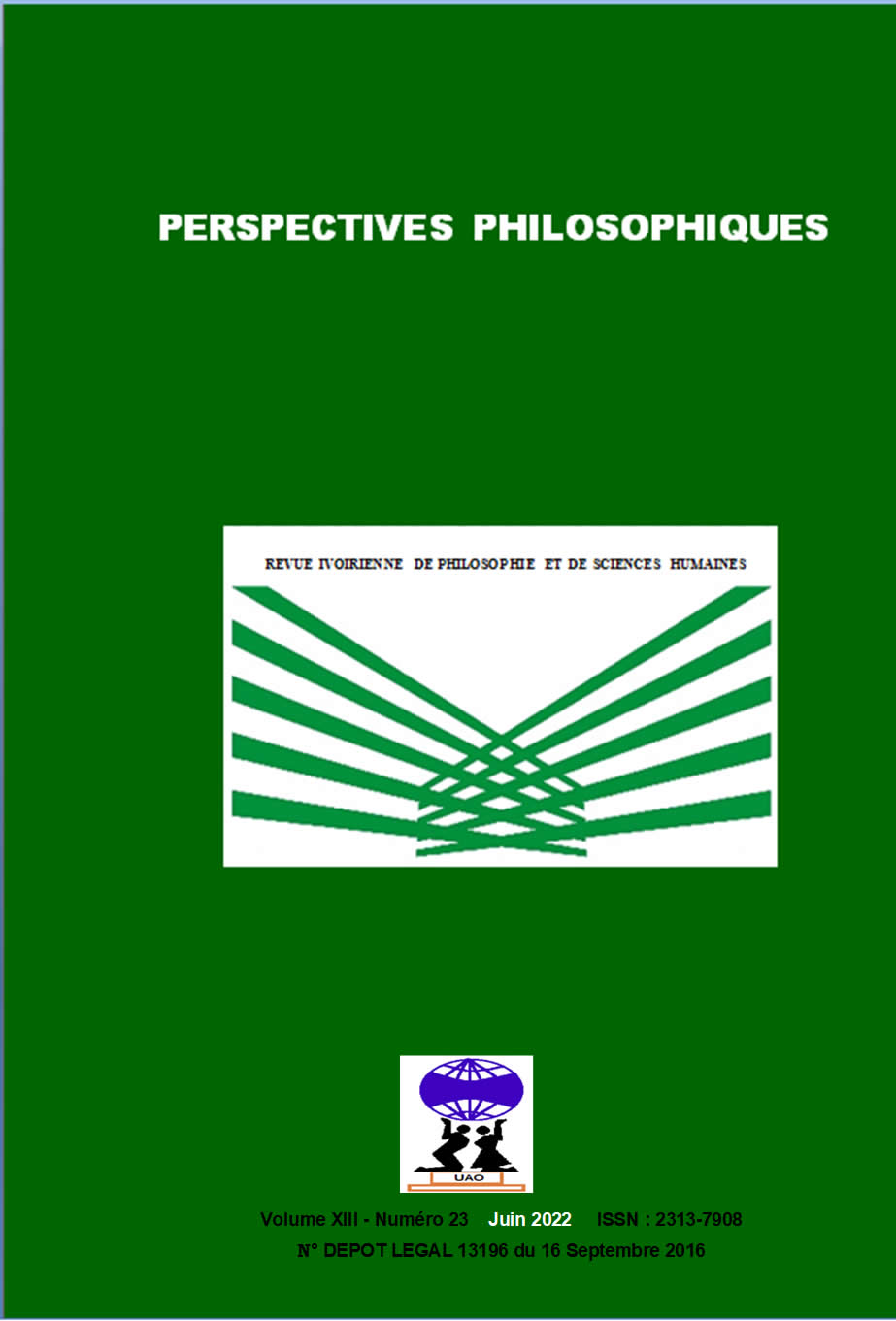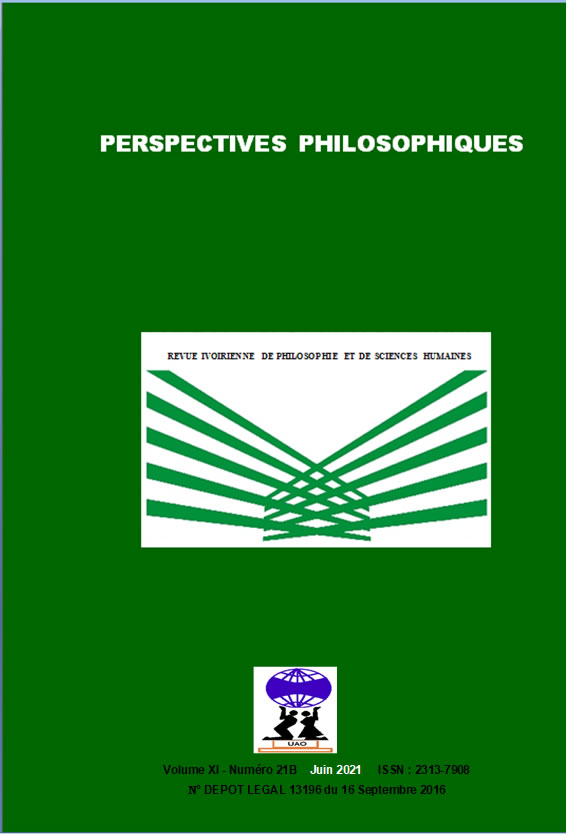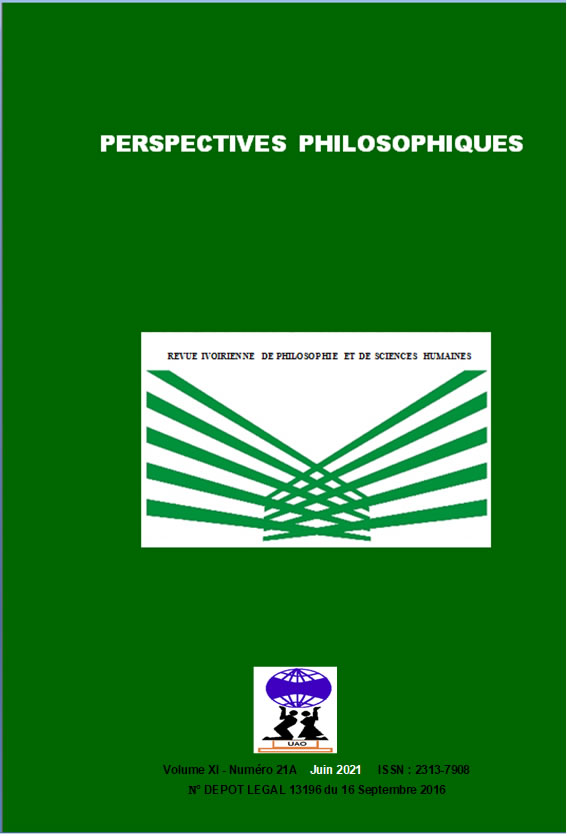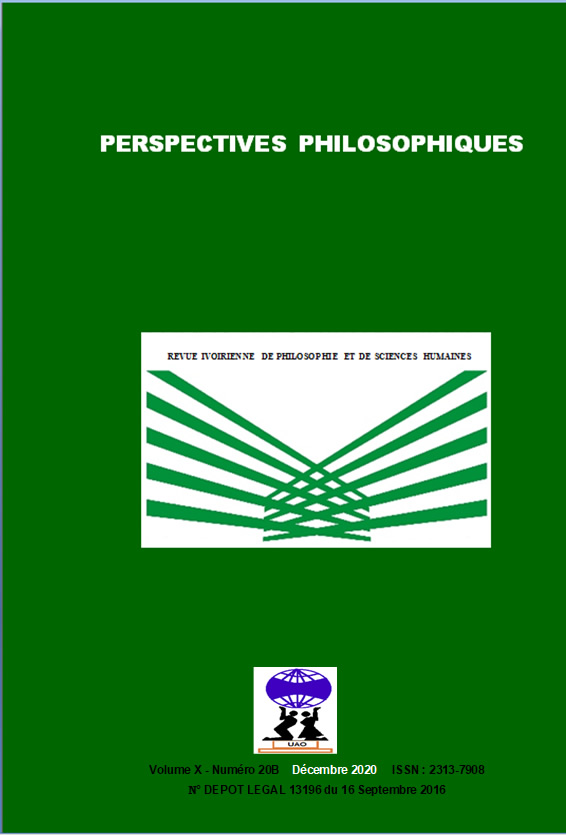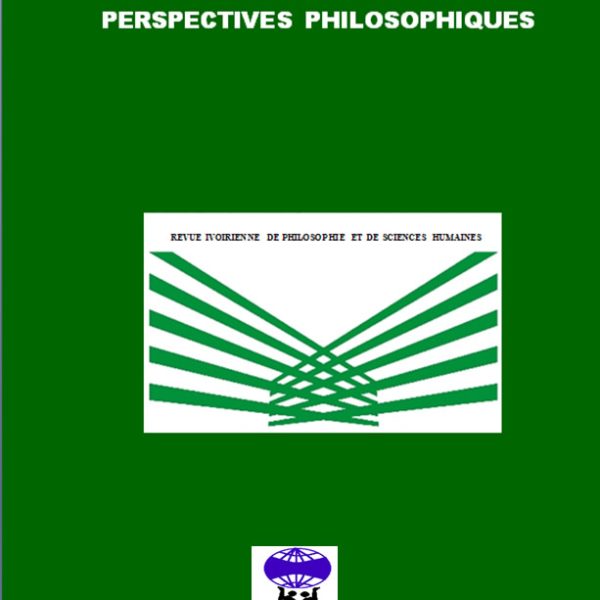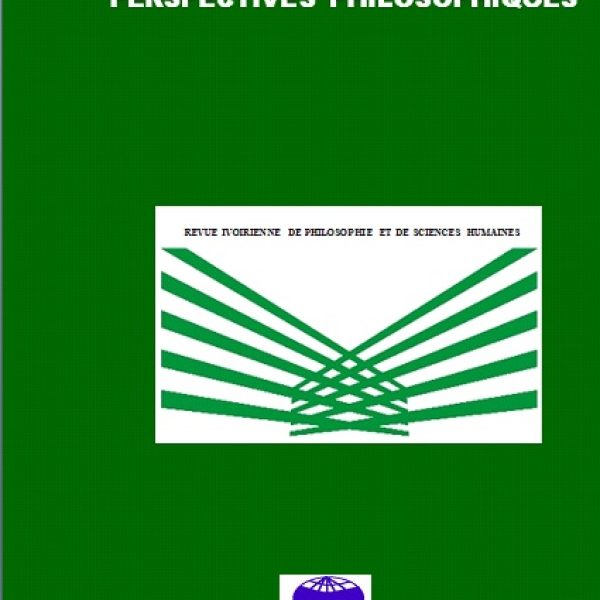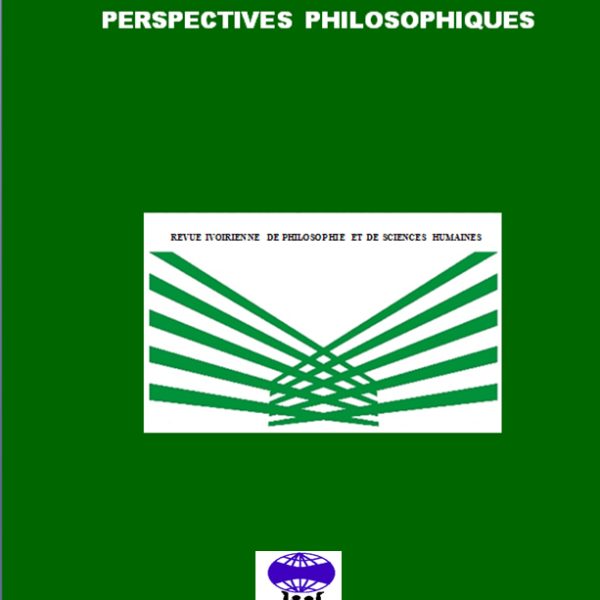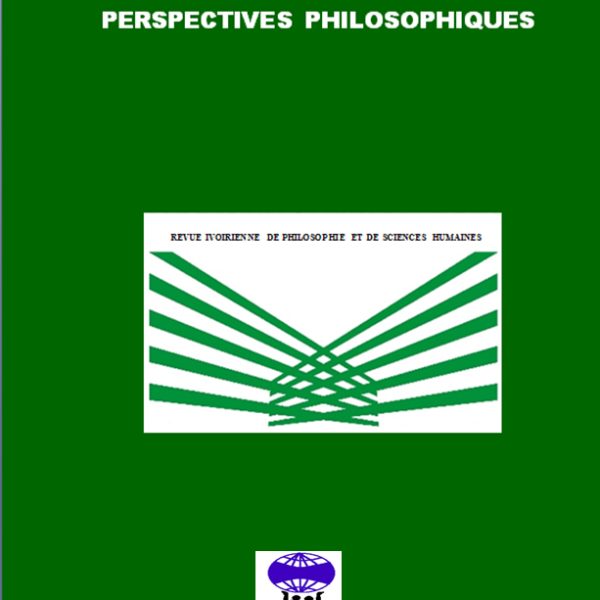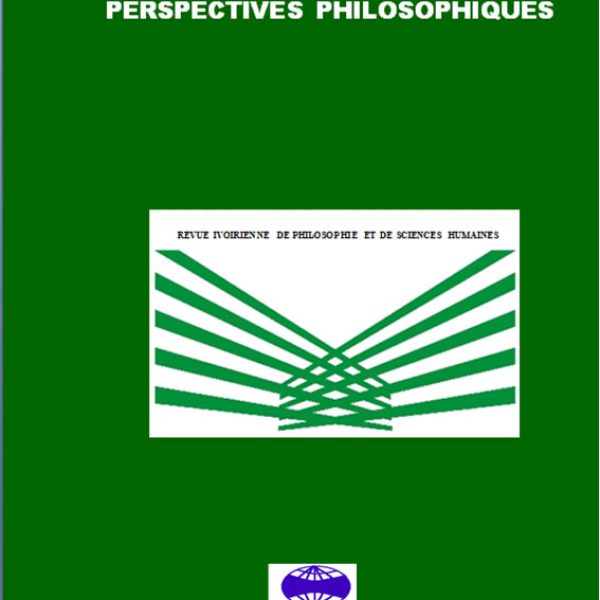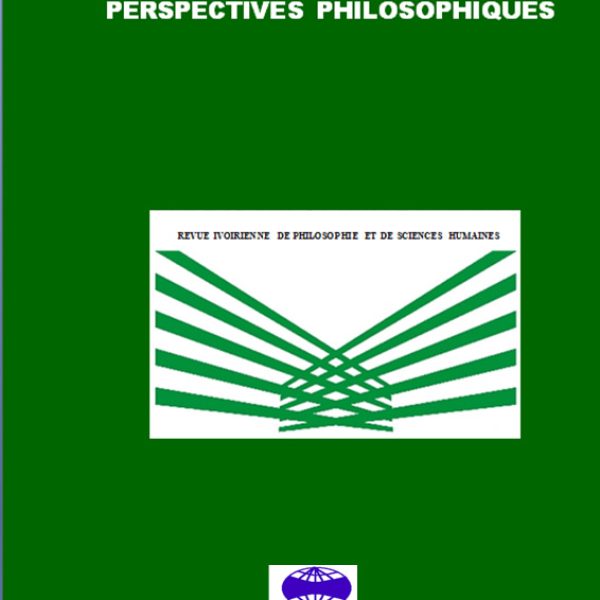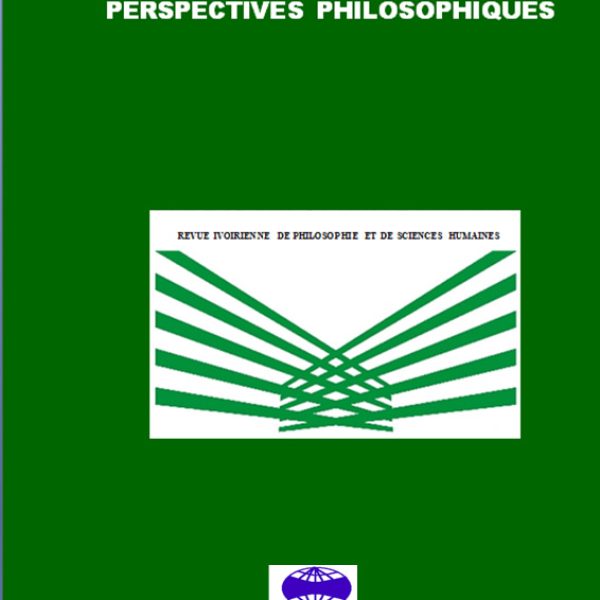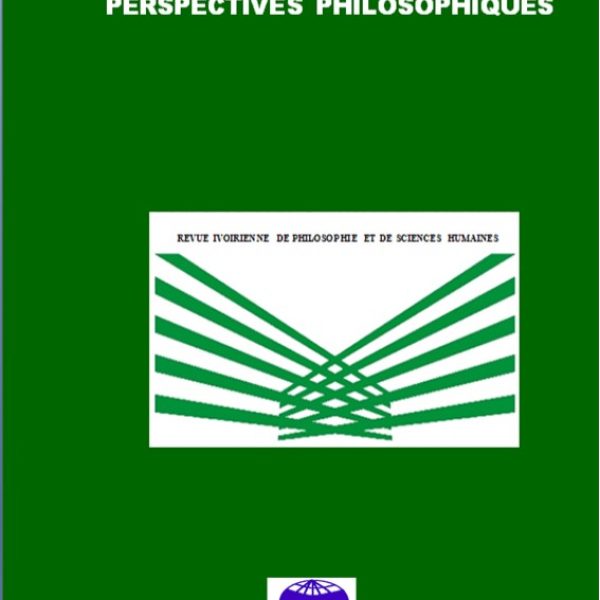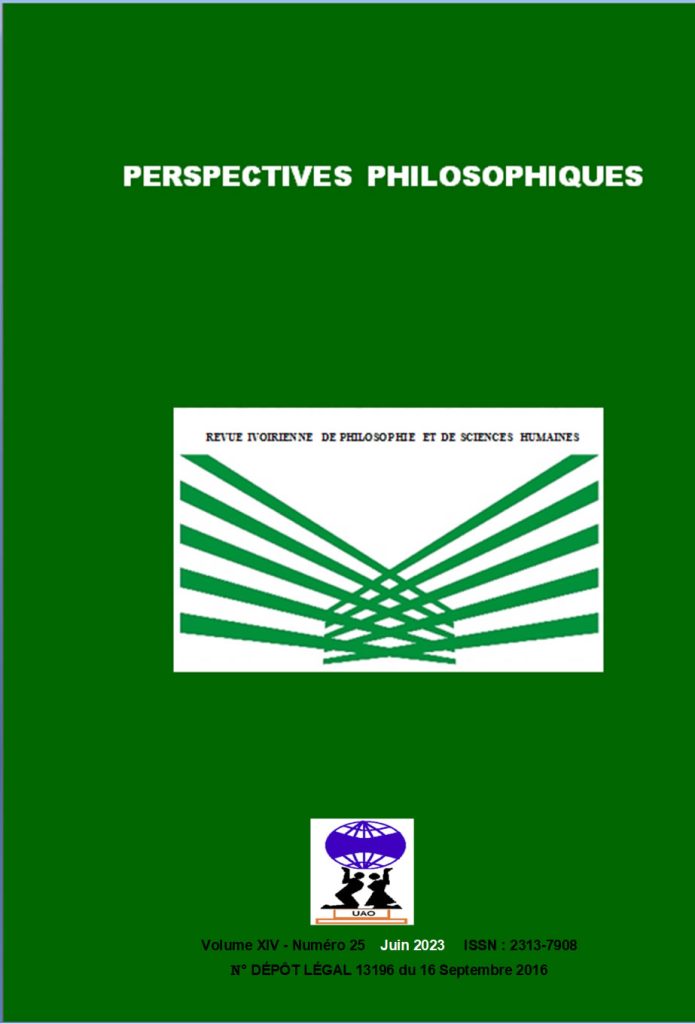
| Volume XIV – Numéro 25 Juin 2023 ISSN : 2313-7908N° DÉPÔT LÉGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Grégoire TRAORÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 01 03 01 08 85
(+225) 01 03 47 11 75
(+225) 01 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : https://www.perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DÉPÔT LÉGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Grégoire TRAORÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Prof. N’dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités
Rédacteur en chef Adjoint : Dr Éric Inespéré KOFFI, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane OUATTARA
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. N’Dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Donissongui SORO, Professeur des Universités, Philosophie antique, Philosophie de l’éducation Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Nicolas Kolotioloma YEO, Professeur des Universités, Philosophie antique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Secrétaire de rédaction : Dr Kouassi Honoré ELLA, Maître de Conférences
Trésorier : Dr Kouadio Victorien EKPO, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Dr Faloukou DOSSO, Maître de Conférences
Dr Kouassi Marcelin AGBRA, Maître de Conférences
Dr Alexis Koffi KOFFI, Maître de Conférences
Dr Chantal PALÉ-KOUTOUAN, Maître-assistant
Dr Amed Karamoko SANOGO,Maître de Conférences
SOMMAIRE
1. Étude sur les ressources mobilisées par des élèves-maîtres dans leur exercice à la réflexivité en formation initiale
Amadou Yoro NIANG ……………………….………………………………..……….1
2. Rousseau et la prévention du terrorisme contemporain
Seydou KONÉ ……………………….……………………………………………..….23
3. Jean-Paul Sartre entre littérature et philosophie
Dimitri OVENANGA-KOUMOU ……………….………………………………..….43
4. Langage fictionnel et dispositif conceptuel chez John SEARLE
Ghislain Thierry MAGUESSA ÉBOMÉ……….………………..………….….….61
5. La Poésie humaniste dans Les Destinées d’Alfred de VIGNY et Les Contemplations de Victor HUGO : une poésie philosophique
Kouakou Bernard AHO……………………….…………………………….………81
6. L’implicite de la thèse marxienne de l’inséparabilité de l’homme et de la nature
Boubakar MAIZOUMBOU ……………..………..……………..……..………….101
7. Liberté et responsabilité chez Jean-Paul SARTRE
Lago II Simplice TAGRO……………………………….……………………….….117
8. Le terrorisme et la révolution de l’engagement politique : Pistes pour une riposte efficace
Ayouba LAWANI ……………………………….………………..………………….133
9. Penser et panser la perte de la biodiversité en Afrique à la lumière des soubassements ontologiques et du savoir-faire des traditions africaines
Roger TAMBANGA ……….………………………………………..……………….149
10. La faillite des partis politiques au Mali
Baba SISSOKO ……….…………………………………………..………..……….169
11. L’élitisme politique de Platon en question
Albert ILBOUDO ……….…………………………………………..……………….187
12. L’action comme révélation du qui chez Hannah ARENDT
Akpé Victor Stéphane AMAN ……….…………………………..…………….….207
13. L’éducation comme priorité de l’investissement dans l’humain
Florent MALANDA-KONZO ……….…………….……………..……………..….223
14. Représentations sociales liées à l’expression des besoins en formation continue des instituteurs au Bénin
Germain ALLADAKAN ……….…………………………………..……………….239
15. Le terrorisme islamiste sur la balance de la philosophie des Lumières
Issoufou COMPAORÉ ……….…………………………………..…………….….257
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
LES RESSOURCES MOBILISÉES PAR DES ÉLÈVES-MAÎTRES DE DAKAR DANS LEUR EXERCICE À LA RÉFLEXIVITÉ EN FORMATION INITIALE
Amadou Yoro NIANG
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Résumé :
Le terrain de cette recherche est le Centre Régional de Formation des Personnels de l’Éducation (CRFPE) de Dakar. Cette étude de la formation initiale des futurs enseignants du 1er degré aborde la lancinante question de cette nécessaire articulation théorie-pratique mise de l’avant dans le référentiel de formation des maîtres établi par la Direction de la Formation et de la Communication (DFC), et dont l’un des objectifs principaux est celui du développement des compétences professionnelles des enseignants. Cet article fait l’analyse des ressources mobilisées par les futurs enseignants du primaire dans leurs pratiques de la réflexivité lors des périodes de stage. Une approche qualitative fondée sur l’Étude de cas a été réalisée dans ce sens à partir de trois types de données issus respectivement des séquences d’intégration en didactique du français, notamment en production d’écrits, des cahiers de stage d’élèves-maîtres, et des séances d’animation pédagogique portant sur la co-construction de connaissances liées à la maîtrise de la classe. L’analyse des travaux de 4 élèves-maîtres a permis d’identifier la nature et la diversité des ressources qu’ils ont mobilisées concomitamment au processus réflexif mis en œuvre dans une perspective de développement professionnel.
Mots-clés : Articulation théorie/pratique, développement professionnel, formation initiale, réflexivité, savoirs.
Abstract:
The field for this research is the Centre Régional de Formation des Personnels de l’Education (CRFPE) in Dakar. This study of the initial training of future primary school teachers addresses the nagging question of the necessary theory-practice articulation put forward in the teacher training referential drawn up by the Direction de la Formation et de la Communication (DFC), one of whose main objectives is to develop teachers’ professional skills. This article analyzes the resources mobilized by future primary school teachers in their reflexivity practices during practicum periods. A qualitative, case-study approach was used, based on three types of data: integration sequences in the didactics of French, particularly in writing production; student-teacher workbooks; and pedagogical facilitation sessions focusing on the co-construction of knowledge related to classroom management. Analysis of the work of four student teachers enabled us to identify the nature and diversity of the resources they mobilized in conjunction with the reflective process implemented in a professional development perspective.
Keywords : Initial training, knowledge, professional development, reflexivity, Theory/practice articulation.
Introduction
Au Sénégal, l’une des visées du référentiel de formation des enseignants du premier degré établi par la Direction de la Formation et de la Communication (DFC, 2014, p. 7), est d’asseoir, chez les futurs maîtres, les bases d’un processus de développement professionnel. Pour réaliser cette ambition, chacun des Centres Régionaux de Formation des Personnels de l’Éducation (CRFPE) propose des dispositifs favorisant l’alternance entre les cours théoriques et les stages pratiques. Les périodes de stage, lieu d’apprentissage et de manifestation de compétences professionnelles, mettent un formateur en jeu : le maître-formateur titulaire de classe qui doit attester de l’acquisition des compétences identifiées dans le référentiel (DFC, 2014, p. 6).
Toutefois, les travaux de Niang (2017, p. 23) sur la formation initiale des maîtres au Sénégal montrent que cette articulation théorie-pratique, développée globalement à partir du référentiel de formation des CRFPE, se réalise difficilement, à cause de la rareté des ressources acquises dans les cours théoriques et de l’analyse superficielle de leur pratique. Or les élèves-maîtres éprouvent, selon Perrenoud (2001, p. 123), beaucoup de difficultés à user de la pratique réflexive en vue d’une meilleure mobilisation et intégration des ressources. Par ailleurs, les savoirs théoriques enseignés au centre de formation peuvent être négligés par les élèves-maîtres lorsqu’ils arrivent en stage, surtout si le maître-formateur s’y réfère peu de manière explicite à travers l’incitation à la réflexivité.
Selon Bocquillon et al. (2017, p. 132), « les savoirs théoriques constituent un ensemble de connaissances basées sur la recherche et la réflexion, qui fournissent des cadres conceptuels pour comprendre et améliorer les processus éducatifs ». D’après Beausaert et al. (2018, p. 87), l’articulation théorie-pratique ne peut être bénéfique pour le stagiaire que si elle repose sur une mobilisation des ressources fondée sur le paradigme du « praticien réflexif ».
Le terme de « praticien réflexif » renvoie au professionnel, qui, dans sa tentative de résolution d’une situation, analyse l’effet de ses propres actions, modifie cet effet, accomplit de nouvelles actions par un jugement critique et personnel de sa propre pratique et une prise de décision responsable renforçant les actions futures et favorisant le développement professionnel. (Schön, 1994, p. 165).
Ce développement professionnel peut être défini dans notre recherche comme un processus visant les transformations individuelles et collectives des compétences et de composantes identitaires mobilisées ou susceptibles d’être mobilisées dans des situations professionnelles. (Barbier et al, 1994, p. 6 ; Beckers, 2007, p. 137).
Mais comment les ressources professionnelles sont-elles mobilisées par les futurs enseignants dans l’éventualité de leur exercice à la réflexivité ? La réponse à cette problématique ne peut pas être immédiate. Elle requiert l’examen de quelques questions subsidiaires qui enrichiront notre réflexion. Ainsi, si la réflexivité pédagogique est un facteur de développement professionnel, quel sens et quelle portée donne-t-elle à la mobilisation des ressources ? Comment gérer les écarts entre théorie et pratique pour faciliter la mobilisation des ressources chez les élèves-maîtres ? Et à quelles finalités doit répondre cette gestion ?
Cette question de recherche nous conduit à émettre une hypothèse centrale : les types de ressource mobilisés par les élèves-maîtres dans leur exercice à la réflexivité sont peu variés et peu fréquents eu égard aux activités proposées en stage. Cela nous conduit à poser trois hypothèses secondaires en lien avec les questions subsidiaires. Premièrement, la réflexivité des stagiaires permet à ces derniers de dépasser un niveau assez faible de pratique réflexive, basé sur une analyse essentiellement intuitive et superficielle. Deuxièmement, la réflexivité pédagogique facilite la gestion des écarts entre théorie et pratique par la mobilisation des ressources appropriées. Troisièmement, cette gestion des écarts entre théorie et pratique favorise la construction progressive de la pratique, l’autonomie de pensée et l’émancipation professionnelle des futurs enseignants.
1. Méthodologie
En nous fondant sur les objectifs de notre étude, nous avons opté pour une approche méthodologique de type qualitatif fondée sur l’Étude de cas. Selon Chevalier et al. (2018, p. 77), l’Étude de cas est une méthodologie de recherche qui permet d’étudier des phénomènes à la fois complexes et nouveaux en situation réelle. La question centrale de notre recherche portant sur les ressources mobilisées par les élèves par la réflexivité, un processus mental difficilement observable, une telle approche méthodologique nous permet de faire une étude approfondie de la dynamique de réflexivité dans la mobilisation des ressources. Les élèves-maîtres de la promotion 2022 du CRFPE de Dakar ont ainsi été invités à participer à la recherche. 4 stagiaires parmi les 25 inscrits ont manifesté leur intérêt. Ils sont identifiés par les prénoms fictifs Rama, Issa, Ami et Marie afin de préserver leur anonymat.
L’Étude de cas a été réalisée à partir de trois types de données issus respectivement du travail d’intégration en didactique du français, notamment en production d’écrits, des cahiers de stage des 4 élèves-maîtres, et des séances d’animation pédagogique portant sur la co-construction de connaissances liées à la maîtrise de la classe. Les travaux de Meirieu (2007, p. 188) et de Buysse (2011, p. 267) ont permis d’identifier, dans les données recueillies, les principales ressources mobilisées par les stagiaires. Quant au modèle de Niang (2017, p. 244), il a permis d’analyser la manière dont s’articulent les différentes étapes de la pratique réflexive des stagiaires en lien avec les ressources mobilisées.
1.1. Instruments de recherche
Pour développer l’articulation théorie-pratique en formation initiale, nous avons identifié les ressources auxquelles les élèves-maîtres ont accès. En nous fondant sur les travaux de Meirieu (2007, p. 188) et de Buysse (2011, p. 267), nous distinguons cinq principaux types de ressources. Il s’agit, premièrement, des ressources scientifiques proposées aux élèves-maîtres comme des références à des données scientifiques. Ces savoirs se fondent sur une littérature spécialisée produite par des chercheurs. Deuxièmement, il y a les ressources techniques enseignées par les formateurs spécialistes de disciplines. Elles proviennent de la recherche et ont été didactisées.
Troisièmement, nous distinguons les ressources normatives qui sont des orientations pour agir en fonction des attentes de la société et de l’institution : par exemple, les instructions officielles, les épreuves nationales ou le Curriculum de l’Éducation de Base sénégalais. Quatrièmement, nous retrouvonsles ressources praxéologiques issues des échanges avec les formateurs, et proposées comme pertinentes. Enfin, il y a les ressources axiologiques relatives aux valeurs donnant des pistes concrètes, des outils, des méthodes et faisant partie d’ouvrages non scientifiques tels que les manuels de classe, des articles de presse, des sites internet d’enseignants et des groupes WhatsApp d’enseignants.
Le cadre retenu pour comprendre l’alternance théorique à travers la pratique réflexive des élèves-maîtres s’appuie sur le modèle ROCE (Niang, 2017, p. 244) basé sur un système spiralaire qui présente 4 phases : Recours à l’expérience ; Observation réfléchie ; Conceptualisation abstraite ; Expérimentation active. Ce modèle commence par la pratique dans laquelle l’enseignant est personnellement et directement impliqué (phase de recours à l’expérience) et dont il déduit un certain nombre d’observations sur lesquelles il réfléchit selon ses propres représentations afin de leur donner un sens (phase d’observation réfléchie). Comme l’affirment Borges et Gervais (2015, p. 87), l’intervention de la réflexion fournit le matériel nécessaire pour élaborer un ou des concepts (principes, règles, etc.) permettant de généraliser à plus d’une situation (phase de conceptualisation abstraite). Des implications pratiques ou des hypothèses peuvent alors être déduites et validées dans l’action (phase d’expérimentation active ou de retour à l’expérience).
1.2. Méthodologie de recueil des données
Les données ont été recueillies à partir de l’analyse faite par les élèves-maîtres sur la construction et la mise en œuvre des activités pédagogiques. Diverses pistes de réflexion définies par les stagiaires et qui correspondent le mieux à la séquence d’enseignement-apprentissage ont été recueillies. En guise d’exemple, les futurs enseignants peuvent identifier et expliquer un décalage entre la planification et l’intervention proprement dite. Il s’agit de relever les données liées aux différences observées sur le plan des contenus, des apprentissages et de leurs interventions, et d’en recueillir les motifs explicatifs. Une consigne plus générale les invite également à revenir, de manière réflexive, sur leurs interventions dans la perspective de la didactique des disciplines. En maîtrise de la classe, des données relatives à la co-construction des connaissances, lors des séances d’animation pédagogique, ont été relevées.
Au cours du stage de responsabilité entière, des cahiers de stage ont également été exploités. Il s’agit de relever dans ces documents, les données liées à la description d’une situation concrète ; à l’analyse de la situation en trouvant les interrelations entre les éléments en cause et les éléments du contexte (déconstruction de la pratique) ; à l’établissement des liens avec des savoirs théoriques susceptibles de favoriser la compréhension de la situation énoncée. Ces savoirs théoriques doivent être issus des contenus de cours suivis au CRFPE, des aspects théoriques des stages, d’ouvrages spécialisés en éducation ainsi que des savoirs et savoir-faire formalisés par le maître-formateur. La synthèse permet d’envisager des hypothèses de solution ou des éléments de savoirs pratiques témoignant de la construction d’un savoir professionnel (reconstruction de la pratique).
1.3. Méthodologie de traitement des données recueillies
Pour viser les ressources de référence au sein des trois tâches ciblées, une analyse de contenu par distinction de catégories (Lejeune, 2019, p. 34) a été menée. Afin de coder les travaux des élèves-maîtres, une grille a été conçue à l’intérieur de laquelle les cinq types de ressource ont été représentés. Il s’agit, par conséquent, d’un plan de codage préétabli en fonction du cadre conceptuel. Les unités de sens peuvent être une phrase, des phrases et même dans une certaine mesure, des paragraphes. L’essentiel est qu’elles respectent la logique de la catégorie des ressources mobilisées : scientifiques, techniques, axiologiques, normatifs et praxéologiques. Par exemple, l’élève-maître Issa a cité un extrait d’un manuel relatif à la didactique du français :
Dans la leçon de conjugaison qui est une discipline-outil au CE1, il faut que j’enseigne aux élèves les raisons pour lesquelles ils apprennent le passé simple et pourquoi ce temps leur sera utile en production d’écrits, sans quoi ces derniers risquent de démontrer peu de motivation et faire peu d’efforts dans l’apprentissage des formes verbales (extrait de manuel cité par Issa).
Cet énoncé a été classé dans la catégorie « ressource technique » puisquele texte que l’élève-maître cite ne présente pas de données de recherche, mais didactise des savoirs.
Dans l’optique d’analyser les étapes déroulées par les élèves-maîtres dans leur pratique réflexive, une seconde analyse de contenu par distinction de catégories a été établie. Après une lecture des travaux, les unités de sens (phrases, paragraphes) ont été relevées. Celles-ci représentent l’une des phases de la pratique réflexive selon le modèle ROCE. Puis, dans chaque tâche, ces unités de sens ont été numérotées afin d’en appréhender le processus chronologique. Comme le recommandent Miles et Huberman (2003, p. 321), deux validations interjuges ont été menées avec un taux de 99 % d’accord entre les deux codeurs.
2. Résultats
Dans cette section, nous présentons, en premier lieu, les ressources mobilisées par les 4 élèves-maîtres dans les 3 activités ciblées : « le travail d’intégration en production d’écrits », « le contenu du cahier de stage » et « les cellules pédagogiques relatives à la co-construction de connaissances pour la maîtrise de la classe ». Pour ce faire, seuls les tableaux les plus expressifs seront présentés et explicités. En second lieu, nous aborderons l’analyse de l’articulation du modèle ROCE dans la pratique de ces futurs enseignants.
2.1. Les ressources de référence mobilisées par les élèves-maîtres
Les ressources mobilisées par les 4 élèves-maîtres ont été observées dans le travail d’intégration en production d’écrits, dans le cahier de stage et à l’occasion des séances d’animation pédagogique portant sur le thème de la maîtrise de la classe.
2.1.1. Les ressources mobilisées en production d’écrits
Le tableau ci-dessous présente les 28 ressources mobilisées par les 4 élèves-maîtres dans leur travail d’intégration en production d’écrits en français :
Tableau 1 : Ressources mobilisées pour le travail d’intégration en production d’écrits
| Nombre de ressources scientifiques | Nombre de ressources techniques | Nombre de ressources d’ordre axiologique | Nombre de ressources de type normatif | Nombre de ressources d’ordre praxéologique | Total ressources | |
| Rama | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 09 |
| Issa | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 07 |
| Ami | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 07 |
| Marie | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 05 |
| Total | 0 | 12 | 10 | 5 | 1 | 28 |
Sources : Enquête de terrain, Juin 2022.
Dans ce tableau, les ressources d’ordre technique et axiologique sont celles qui dominent le plus (78,5 %). Ainsi, les futurs enseignants abordent la motivation des élèves en s’appuyant sur un texte de nature technique distribué lors des cours au CRFPE :
Pour que les élèves soient motivés à s’impliquer, il est essentiel que le sujet d’expression écrite proposé émane de leur vécu quotidien et puisse leur permettre de mobiliser un ensemble de ressources tirées des disciplines-outils (Vocabulaire, conjugaison, grammaire, orthographe, lecture) pour produire un texte bien présenté, pertinent, cohérent sans faute de langue (…). Cela correspond aux principes de la pédagogie de l’intégration. (Rama).
En général, les stagiaires utilisent les ressources d’ordre axiologique en se référant à des contenus tirés des cours du CRFPE, mais ne se fondent guère sur les ouvrages proposés par les formateurs en références bibliographiques.
Ainsi, Rama se réfère au contenu de son cours de maîtrise de la classe dans sa leçon de didactique, mais sa source est absente :
L’enseignant qui passe beaucoup de temps à la maîtrise de sa classe, en consacre moins dans la qualité de son enseignement. Cette attitude du maître constitue un obstacle au développement d’apprentissages significatifs chez les élèves. (Rama).
Le tableau 1 montre nettement que les ressources scientifiques n’apparaissent pas dans son propos de même que celles d’ordre praxéologique. Marie, de son côté, s’est référée aux suggestions de son maître-formateur dans les ressources praxéologiques pour appuyer son choix de stratégie d’enseignement :
J’ai décidé de faire une fiche de critère de réussite et un référentiel en lien avec le sujet proposé, car le maître-formateur me le suggère toujours avant de demander aux élèves de procéder à la rédaction du premier jet. La fiche de critère permet aux élèves de s’auto-évaluer tandis que le référentiel revient sur les ressources nécessaires à la production. (Marie).
Rama a fait ressortir plus de ressources que les 3 autres élèves-maîtres, et elles sont de nature plus variée. Les ressources qu’elle nomme renvoient à la pédagogie de l’intégration qu’elle a utilisée en classe, aux styles d’apprentissage des élèves, à leur degré d’implication dans la leçon face aux différentes activités ainsi qu’à la mobilisation de ses compétences professionnelles. Par ailleurs, elle est la seule à avoir vérifié les prérequis de ses élèves afin d’identifier leurs forces et leurs faiblesses, avant de dérouler la leçon et ainsi faire les « meilleures options » dans les stratégies d’enseignement-apprentissage qu’elle met en place. Cela correspond à la phase 2 du modèle ROCE : observation réfléchie.
Marie, quant à elle, se sert de la situation d’enseignement-apprentissage pour faire un diagnostic des élèves à l’étape postactive : phase 2 du modèle ROCE, conceptualisation abstraite. Après l’identification des atouts et difficultés des élèves, elle n’appuie pas ses choix professionnels sur des ressources acquises et prend ses décisions en fonction de son expérience personnelle. En guise d’illustration, on peut citer certains de ses énoncés ou elle dit « J’estime que… » ; « À mon avis… », « Je crois que… » ; « Je trouve que… ».
L’élève-maître Issa n’a pas, de son côté, étudié les forces et faiblesses d’apprentissage des élèves, que ce soit dans les phases préactive, active ou postactive de la leçon. Les sources qu’il cite sont parfois imprécises. Pour ce qui concerne Ami, elle se réfère surtout aux ressources d’ordre normatif : le référentiel de formation des maîtres (DFC, 2014, p. 7). Elle exploite également les ressources d’ordre axiologique dans ses cours du CRFPE, et étudie les prérequis des élèves avant de dérouler ses leçons afin de conforter ses options pédagogiques.
2.1.2. Les ressources mobilisées dans le cahier de stage
Le tableau 2 présente les 12 ressources relevées dans les contenus du cahier de stage réalisé par les élèves-maîtres.
Tableau 2 : Ressources mobilisées dans le cahier de stage
| Nombre de ressources scientifiques | Nombre de ressources techniques | Nombre de ressources d’ordre axiologique | Nombre de ressources de type normatif | Nombre de ressources d’ordre praxéologique | Total ressources | |
| Rama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issa | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Ami | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Marie | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 |
Sources : Enquête de terrain, Juin 2022.
Comme dans le travail d’intégration réalisé dans le cours de production d’écrits en français, les ressources scientifiques ne sont guère sollicitées dans le cahier de stage. De plus, en comparant ce tableau 2 avec celui de l’activité de production d’écrits, on note nettement moins de ressources dans les cahiers de stage (douze ressources contre 28 pour l’activité de production d’écrits). Par ailleurs, nous n’avons observé aucun échange ou aucune interrelation entre le formateur et le formé dans ce document. Le formateur se contente de l’évaluer de façon sommative. Par exemple, dans la leçon de production d’écrits, Rama a mobilisé diverses ressources, ce que l’on ne retrouve guère dans son cahier de stage.
Quant à Issa, il a sollicité dans la cellule pédagogique beaucoup plus de ressources techniques que les autres élèves-maîtres de notre enquête. Et ces ressources qu’il mobilise sont diverses et enrichies par les interventions de ses pairs dans les rencontres pédagogiques. Les échanges qui y sont effectués sont consignés dans son cahier et ont une incidence positive sur le nombre de ressources mobilisées dans l’analyse. En outre, l’élève-maître Issa aborde, au cours des dialogues, plusieurs approches pédagogiques qui le préoccupent, ce qui lui permet de fonder ses arguments sur diverses ressources exigées par le formateur. Ainsi existe-t-il dans le cahier de stage une nette différence entre Issa et les trois autres élèves-maîtres, qui ont beaucoup moins mobilisé des ressources pour soutenir leur réflexion.
2.1.3. Les ressources mobilisées dans les cellules pédagogiques
Le tableau 3 ci-dessous présente 20 ressources relevées dans la séance d’animation pédagogique portant le thème de la maîtrise de la classe.
Tableau 3 : Ressources mobilisées dans la séance d’animation pédagogique
| Nombre de ressources scientifiques | Nombre de ressources techniques | Nombre de ressources d’ordre axiologique | Nombre de ressources de type normatif | Nombre de ressources d’ordre praxéologique | Total ressources | |
| Rama | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Issa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ami | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Marie | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 20 |
Sources : Enquête de terrain, Juin 2022.
La pédagogie de l’intégration permet selon Coly et al. (2015) de vérifier chez les élèves leur capacité à mobiliser un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-être) pour résoudre une situation problème qui appartient à une classe de situations. (Issa).
Au plan axiologique, Rama, Issa et Marie prétendent que l’utilisation des techniques Freinet et de la pédagogie institutionnelle leur permet de mieux maîtriser leur classe. « Je parviens à avoir une mainmise sur ma classe grâce à la mise sur pied du Conseil, des lois et règles de vie et des métiers dans la classe » (Issa). Les ressources d’ordre axiologique sont donc sollicitées par Issa. Quant à l’élève-maîtresse Marie, elle affirme de son côté :
Je n’ai pas de problèmes de maîtrise de classe car j’utilise des techniques comme les feux de circulation, les ceintures de comportement et les lois dans la classe. Cela me permet de faire travailler les élèves qui n’ont pas le temps de se distraire. (Marie).
Rama fait également usage des techniques Freinet et de la pédagogie institutionnelle dans sa pratique de classe :
J’organise régulièrement des conseils avec les apprenants pour régler les problèmes de discipline…Chaque élève de ma classe a un métier…Ils sont toujours occupés. Les techniques Freinet m’aident beaucoup dans la maîtrise de la classe. Elles me permettent d’avoir des élèves disciplinés et travailleurs » (Rama).
L’unique ressource scientifique citée par Marie est plus ou moins approximative : « Même si la théorie historico-culturelle de Vygotsky stipule que c’est l’apprentissage qui favorise le développement, je n’en dis pas autant quant à la théorie de Piaget » (Marie). Comme elle ne poursuit pas sa réflexion autour du socioconstructivisme, il est alors difficile d’appréhender ce qu’elle voulait exprimer à travers cette ressource. Au niveau praxéologique, une seule ressource est mobilisée par Ami :
L’une des suggestions que m’a faite le maître-formateur est qu’il faut toujours commencer une leçon en posant un problème afin de susciter la motivation et l’intérêt chez les élèves. J’ai décidé alors de présenter en début d’apprentissage une situation problème didactique afin de développer le conflit cognitif chez les apprenants. (Ami).
Pourtant,les interventions des élèves-maîtres portent sur la maîtrise de la classe, un domaine qui permet d’explorer de nombreuses expériences au niveau praxéologique (stages, expériences d’élèves-maîtres, expériences relatéespar les maîtres-formateurs). Malgré l’intérêt de la cellule pédagogique à favoriser des discussions entre stagiaires autour des séquences d’enseignement-apprentissage observées ensemble, cette rencontre entraîne peu les futurs enseignants à développer leur réflexion à l’aidede ressources. Cela peut s’expliquer par le fait que, dans les séances d’animation, les échanges se font plutôt entre élèves-maîtres qu’avec un formateurqui pourrait inviter à d’autres pistes de réflexion appuyées par diverses ressources.
Tout compte fait, l’analyse des ressources mobilisées dansles trois activités mises en place pour favoriser l’articulation théorie/pratique fait ressortir la faible présence des ressources scientifiques et des ressources praxéologiques dans le discours des élèves-maîtres. Quant aux ressources de type normatif, elles sont inexistantes dans les animations pédagogiques. En résumé, les ressources mobilisées dans les interactions formateur/élèves-maître, reposent essentiellement sur les ressources d’ordre technique et axiologique.
2.2. L’appropriation du modèle ROCE chez les élèves-maîtres
Nous avons repris le modèle de Niang (2017, p. 244) pour illustrer l’articulation des différentes phases déroulées par chaque élève-maître de notre enquête. Nous présentons dans cette section un résumé des résultats obtenus.
2.2.1. L’articulation des phases du modèle ROCE chez Rama
L’élève-maîtresse Rama, pour chacune de ses activités, a vécu les phases du modèle ROCE en respectant l’ordre indiqué. Dans la première phase, elle a d’abord repéré des problèmes éventuels en faisant une évaluation diagnostique de ses élèves avant le recours à l’expérience concrète :
J’ai eu l’occasion de travailler avec des élèves ayant un très bon niveau (…). Ainsi, pour que ces derniers soient prompts à s’impliquer activement dans les apprentissages, il était essentiel, comme le dit Claparède (1967), de commencer la leçon en posant un problème afin de susciter leur motivation. (Rama).
Pour ce qui concerne la deuxième phase, après « une observation réfléchie » sur les réactions des apprenants, Rama a proposé des solutions en initiant des stratégies d’enseignement qu’elle a fondées sur des ressources d’ordre technique, normatif ou axiologique : « C’est alors que j’ai pensé à enseigner différentes notions liées aux disciplines-outils (…) par le biais d’unepédagogie active ». (Rama). Elle cite alors un auteur (Pauline Kergomard) dans le domaine de l’enseignement de la langue pour justifier son approche pédagogique.
Comme troisième phase, elle a réfléchi sur les différentes stratégies sélectionnées (Conceptualisation abstraite) avant de les expérimenter en classe, dans une nouvelle leçon, afin d’analyser les résultats obtenus (Retour à l’expérience). Ainsi réinvestit-elle ses observations par rapport aux apprentissages des élèves pour chacune de ses planifications. De ce point de vue, elle réalise les 4 phases du modèle ROCE tout en respectant l’ordre, même si cela importe peu.
2.2.2. L’articulation des phases du modèle ROCE chez Issa
La pratique réflexive de l’élève-maître Issa s’articule différemment selon l’activité déroulée, mais surtout selon l’accompagnement offert par ses formateurs. Dans la leçon relative à la production d’écrits en didactique du français, Issa n’a pas vérifié les prérequis de ses élèves. Il est passé directement à l’action en déroulant la séquence d’enseignement-apprentissage (Recours à l’expérience). Lors de la phase « d’observation réfléchie », réalisée sans l’apport du maître-formateur, il a eu du mal à repérer les difficultés de ses élèves. Issa réfléchit, certes, aux problèmes rencontrés, mais ne propose guère de solution appropriée.
En revanche, lors de la séance d’animation pédagogique animée par un inspecteur-formateur du CRFPE, Issa réalise les 4 phases du modèle ROCE allant même jusqu’à suggérer différentes stratégies qu’il réinvestit dans de nouvelles séquences d’enseignement-apprentissage. S’adressant à ses pairs, il relève d’abord un problème :
Je trouve intéressant que nous discutions sur la manière de susciter l’intérêt des apprenants. En fait, je me suis beaucoup interrogé quant à l’implication et l’engagement des élèves par rapport aux situations d’apprentissage dans lesquelles on les soumet. Dans mes leçons, j’ai l’impression qu’en dépit des situations significatives d’intégration proposées, les élèves éprouvent de sérieuses difficultés à réagir positivement. (Issa)
Pour trouver des solutions, il regarde du côté de ses cours du CRFPE :
On fait référence à nos formateurs du CRFPE qui soutiennent que la motivation est comme une sorte « d’énergétique des conduites ». Pour provoquer la motivation, il faut créer un conflit cognitif qui est un déséquilibre dû à la perception d’une différence entre ce que l’on croit savoir d’une réalité et ce que l’on constate de cette même réalité (…). Autrement dit, un apprenant n’est motivé pour apprendre que s’il perçoit ce déséquilibre généré par l’intérêt… ce conflit entre ce qu’il croit savoir d’une situation, et ce qu’il constate dans la réalité. (Issa).
Il cherche alors des solutions pour les réinvestir dans sa pratique :
Je varierai les situations-problèmes didactiques proposées aux élèves, mais également je veillerai à trouver des situations suffisamment significatives afin de susciter leur activité. Je compte aussi développer la pédagogie différenciée afin d’être plus efficace dans les apprentissages. (Issa).
Cet élève-maître profite également du soutien de son maître-formateur qui lui a posé plusieurs questions lors des entretiens postséances : « Qu’est-ce-qui justifie ton choix de cette méthode pédagogique ? Quel est l’intérêt pédagogique pour les élèves ? Comment développes-tu leur autonomie ? ». La capacité de l’élève-maître à réaliser toutes les phases dumodèle ROCE dans ce travail de réflexion nous conduit à penser que nous devrionsprivilégier les entretiens élève-maître/maître-formateur afin de booster véritablement la réflexion des stagiaires.
2.2.3. L’articulation des phases du modèle ROCE chez Ami
Pour l’élève-maîtresse Ami, les phases du modèle ROCE se limitent au recours à l’action et au retour sur l’action pour la production d’écrits en didactique du français et pour le cahier de stage. Dans la séquence de production d’écrits, elle déroule directement la leçon et ne prend pas le temps de faire une étude des prérequis des élèves. Elle choisit comme stratégie d’enseignement la méthode active, sans la justifier à l’aide de ce qu’elle a appris dans ses cours de didactique et de maîtrise de la classe. Comme avec l’utilisation de la méthode active, les cours se déroulent bien, elle ne prend pas le soin de s’interroger sur ce qu’elle fait et aucun de ses formateurs ne l’amène à réfléchir sur ses actions. Ses choix pédagogiques s’appuient essentiellement sur ses représentations personnelles.
Dans son cahier de stage, Ami explicite une situation de gestion de la discipline problématique. Elle impose ses règles aux élèves et procède à des châtiments corporels contrairement à son maître-formateur. Ami remarque d’ailleurs que cette atteinte à l’intégrité physique des apprenants lui pose beaucoup de problèmes de maîtrise de la classe (climat de classe délétère, non-implication des élèves). Pourtant, elle ne remet nullement en question ce mode de punition, et continue d’en abuser. Elle ne fait aucun lien théorique avec le cours de maîtrise de la classe et les processus de mises en œuvre de règles de vie.
Elle ne semble pas prendre conscience de l’importance de ses choix professionnels comme si son formateur ne l’accompagnait pas dans son analyse. Le fait de respecter les différentes phases de réflexivité lui permet d’obtenir un bon résultat en classe. Au cours de la séance d’animation pédagogique, elle explique plus ou moins clairement les 4 phases du modèle ROCE en prenant conscience de ses actions professionnelles, mais cela, grâce à ses pairs qui l’interpellent et la relancent. Ce fait réaffirme encore l’importance de la réflexion en équipe pour amener les futurs enseignants à mieux assumer leur pratique réflexive, plutôt que d’obtenir un simple feedback en fin de séance.
2.2.4. L’articulation des phases du modèle ROCE chez Marie
L’élève-maîtresse Marie a également exploité dans l’ordre les 4 phases du modèle ROCE dans son cahier de stage et dans les séances d’animation pédagogique auxquelles elle a assisté. Toutefois, pour le travail en production d’écrits, la troisième phase est absente :
J’ai décidé de proposer un sujet de rédaction avant de procéder avec les élèves à l’élaboration de la fiche de critère de réussite et du référentiel (…). Ces deux outils leur permettent de rédiger le premier jet avec plus de clairvoyance (…). Toutefois, les devoirs (1er jet) que j’ai corrigés manquent de cohérence (…). Je ne crois pas que ce manque de cohérence observé dans les copies soit lié à un problème de démarche (…). Je ne crois pas non plus à une incompréhension du sujet, mais il y a quand même des choses à améliorer. (Marie).
Le fait qu’elle ne procède pas à une conceptualisation abstraite (troisième étape du modèle ROCE) est peut-être lié à une absence d’entretien avec le formateur à la fin de la prestation. Il ne lui pose donc pas de questions qui lui permettraient d’avancer dans sa réflexion, telles que : pour quelles raisons les élèves manquent de cohérence dans la rédaction du devoir ? Quelle approche pédagogique aurait pu les aider à comprendre le sujet ? En revanche, le jugement de Marie est bien fondé sur des concepts qui sont quand même en lien avec des référents théoriques.
3. Discussion
Les 3 activités analysées montrent la forte fréquence des ressources d’ordres technique et axiologique, et la rareté de celles dites scientifique et praxéologique. La recherche scientifique occupe donc une place secondaire dans la pratique réflexive de ces stagiaires. Cela se justifie par le fait que les ressources étudiées dans les cours du CRFPE sont davantage de nature axiologique pour répondre aux besoins des élèves-maîtres, sans réel lien avec la recherche scientifique. Quant aux ressources normatives, qui sont essentiellement liées aux attentes de la société et de l’institution de ces futurs enseignants, elles sont inexistantes dans notre recherche. L’articulation avec le modèle ROCE explique, peut-être, ce résultat puisque les élèves-maîtres devaient faire des liens avec les compétences professionnelles. Au demeurant, nos enquêtes montrent bien que les types de ressource auxquels font appel ces futurs enseignants sont assez peu variés dans les trois activités ciblées.
L’élève-maître Issa, dans deux des activités, prend conscience de sa pratique enseignante. Toutefois, sans l’appui de ses formateurs, il n’a pas l’habitude de s’interroger sur ses propres actions. Cette remarque nous a amené à étudier de manière objective les consignes des trois activités de notre recherche. Nous ne pouvons pas être sûr d’un processus réflexif chez les enseignants si un dispositif de formation à la réflexivité n’est pas proposé et conduit par les formateurs eux-mêmes pour la réalisation des tâches liées au stage. L’application d’un cadre théorique pour aider à la rédaction du cahier de stage, ou une consigne comme celle proposée dans les leçons de production d’écrits et consistant à revenir de manière réflexive sur les leçons de production d’écrits réalisées ne suffit point pour amener les enseignants à s’inscrire dans une véritable posture réflexive.
Cette absence d’un dispositif de formation en vue de développer la pratique réflexive entraîne un autre défi. En effet, amener les futurs maîtres à s’appuyer sur des ressources de référence et pas essentiellement sur celles dites d’expérience, pour renforcer leur jugement professionnel, exigera de définir un cadre de réflexion avec l’ensemble des formateurs et des stagiaires du CRFPE, afin de s’entendre sur les exigences d’un nouveau paradigme fondé sur la pratique réflexive.
Les tâches complexes proposées en stage pratique soulèvent une interrogation : ne devons-nous pas chercher à identifier le style réflexif de chaque enseignant afin de différencier les outils de réflexivité plutôt que de nous contenter d’un nombre limité d’instruments ? Nous observons que cette forme d’écrit monologique ne favorise pas l’apport des formateurs et des pairs. En outre, nous remarquons un manque d’approfondissement dans l’analyse des élèves-maîtres, parce qu’ils ne bénéficient pas d’étayage. Ils restent ainsi dans un stade superficiel de compréhension et d’analyse, ne s’appuyant guère sur des savoirs théoriques.
S’ils étaient mieux accompagnés dans ce travail par les formateurs et les collègues, qui s’impliqueraient pour les aider à améliorer leurs réflexions et leurs cultures pédagogiques, cela pourrait considérablement éclairer leur pratique. Nos enquêtes ont montré, de manière générale, l’absence de prise de conscience des 4 stagiaires sur les actions pédagogiques réalisées en classe. Par ailleurs, les interventions des élèves-maîtres dans les séances d’animation pédagogique montrent, comme le soutiennent Donnay et Charlier (2006, p. 253), que ce sont la co-construction des connaissances, et surtout les apports externes des pairs et des formateurs qui leur permettent de progresser dans leurs réflexions en prenant comme objet leur pratique grâce aux ressources construites par la recherche. En définitive, même si les ressources scientifiques sont traitées en parent pauvre dans les trois activités proposées, un dispositif de formation à la pratique réflexive, mis en œuvre par les formateurs constituerait, comme le soutiennent Giguère et Mukamurera (2019, p. 98), une piste pour le renforcement de l’articulation théorie-pratique en formation des maîtres.
Conclusion
Cette étude nous a permis de nous interroger autour de questions essentielles dans le développement de la pratique réflexive des élèves-maîtres : comment les ressources professionnelles sont-elles mobilisées par les futurs enseignants dans l’éventualité de leur exercice à la réflexivité pédagogique ? Si la réflexivité pédagogique est un facteur de développement professionnel, quel sens et quelle portée donne-t-elle à la mobilisation des ressources ? Comment gérer les écarts entre théorie et pratique pour faciliter la mobilisation des ressources chez les élèves-maîtres ? Et à quelles finalités doit répondre cette gestion ?
Au demeurant, nous ne nous inscrivons pas dans une perspective de généralisation des résultats, à cause de la faiblesse de l’échantillon examiné comptant seulement 4 élèves-maîtres. Toutefois, à la lumière des données analysées dans cette étude, nous sommes en droit de penser que la mise en œuvre d’un dispositif de formation initiale fondé sur la pratique réflexive avec des séquences d’enseignement-apprentissage suivies systématiquement d’entretiens en dyade formateur/formé autour des réflexions des stagiaires, sont les plus à même de permettre à ces derniers de dépasser un niveau assez faible de pratique réflexive basé sur une analyse essentiellement intuitive et superficielle. Le grand défi de l’école primaire sénégalaise reste celui du développement d’une culture de la formation à la réflexivité pédagogique (Filâtre, 2018, p. 177). Ce défi est lancé à chaque enseignant mis devant ses responsabilités, certes, mais ce sont surtout les formateurs à ce métier qui peuvent le relever.
Pour y arriver, nous proposons un protocole de construction de la réflexivité pédagogique, fondé sur les travaux de Thiébaud et Vacher (2020, p. 53) et qui concerne, respectivement, l’élaboration d’un cadre de référence des formateurs du « praticien réflexif » sénégalais, la formation des formateurs, l’identification des actions pouvant éradiquer des résistances au changement et le ciblage par le formateur des activités susceptibles d’entraîner à la réflexivité. Nous estimons bien évidemment qu’une analyse comme celle que nous venons de proposer dans le cadre de cette recherche peut valablement jeter les bases d’une réflexion à l’égard des pôles pédagogiques à mobiliser aussi bien auprès des élèves-maîtres que des formateurs.
En définitive, les résultats de nos enquêtes montrent qu’il ne suffit pas de capitaliser un certain nombre d’années d’expérience comme praticien, pour être un formateur efficace. Nous avons surtout observé que dans la formation au métier d’enseignant, la maîtrise de la pratique réflexive est d’un apport considérable dans l’acquisition d’aptitudes et d’attitudes de formateur de formateurs. En effet, la sollicitation réflexive facilite des discussions fructueuses et permanentes entre formateurs et formés. Elle est également un moyen pour le maître-formateur d’estimer la distance entre la théorie et la pratique et d’y apporter les réajustements nécessaires. À force de pratiquer la réflexivité pédagogique, le formateur acquiert, ainsi, progressivement, une certaine autonomie pour aider à réfléchir efficacement sur les pratiques.
Comme le pensent Thiébaud et Vacher (2020, p. 61), la réflexivité, dans la formation des maîtres, permet cette prise de conscience des formateurs que les situations d’apprentissage sont des objets interdisciplinaires. Par ailleurs, c’est dans la confrontation et la controverse entre élève-maître et formateur que l’on comprend mieux la multidimensionnalité des pratiques formatives. Les données que nous avons recueillies nous ont amené à observer que la majorité des formateurs n’ont pas reçu une formation appropriée dans le domaine de l’analyse des pratiques. La prédominance des prescriptions et des recommandations lors des échanges entre formés et formateurs en est une conséquence.
Nous avons néanmoins remarqué que l’adoption sporadique d’une pratique réflexive plus ou moins tâtonnante du maître-formateur à travers des postures d’accompagnement offre une piste de solutions aux problèmes de mobilisation de ressources que rencontrent les futurs maîtres.
Références bibliographiques
BARBIER Jean-Marie, CHAIX Marie-Laure et DÉMAILLY Lise, 1994, « Éditorial Recherche et développement professionnel », in Recherche et Formation, Volume 17, Numéro 6, p. 5-8.
BECKERS Jacqueline, 2007, Compétences et identité professionnelles. L’enseignement et autres métiers de l’interaction humaine, Bruxelles, De Boeck.
BEAUSAERT Simon, COLOGNESI Stéphane et VAN NIEUWENHOVEN Catherine, 2018, L’accompagnement des pratiques professionnelles enseignantes en formation initiale, Belgique, Presses Universitaire de Louvain.
BOCQUILLON Marie, DEROBERTMASURE Antoine et DEMEUSE Marc, 2017, Guide pour interpréter adéquatement les situations vécues en classe et autour de la classe en mobilisant des connaissances en sciences humaines. (2e édition), Belgique, Université de Mons.
BORGES Cécilia et GERVAIS Colette, 2015, « L’analyse des pratiques et l’approche de l’argumentation pratique : un dispositif de formation et de transformation. Accompagnement des transitions professionnelles et dispositifs réflexifs en formation initiale et continue », in Revue de Recherches en éducation, Aix-Marseille Université,Volume 20, Numéro 3, p. 75-92.
BUYSSE Alexandre, 2011, « Une modélisation des régulations et de la médiation dans la construction des savoirs professionnels des enseignants », in Philippe MAUBANT et Stéphane MARTINEAU (dir.), Fondements des pratiques professionnelles des enseignants, Ottawa, Presses universitaires d’Ottawa, p. 243-284.
CHEVALIER Françoise, CLOUTIER Martin et MITEV Nathalie, 2018, Les méthodes de recherche du DBA. EMS
CLAPARÈDE, Édouard, 1967,L’école sur mesure, Suisse, Delachaux et Niestlé.
COLY Gaston-Pierre, DAGOBERT Zaccaria et al., 2015, Guide Pédagogique de l’enseignement élémentaire, Dakar, Éditions Ministère de l’Éducation Nationale.
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DFC), 2014, Référentiel de formation initiale des enseignants dans les CRFPE, Dakar, Éditions Ministère de l’Éducation Nationale.
DONNAY Jean et CHARLIER Évelyne, 2006, Apprendre par l’analyse de pratiques, Initiation au compagnonnage réflexif, Namur, Presses Universitaires de Namur.
FILÂTRE Daniel, 2018, Améliorer la formation initiale des professeurs des écoles, Paris, Éditions CNRFF.
GIGUÈRE Fanny et MUKAMURERA Joséphine, 2019, Les difficultés et les besoins de soutien des enseignants débutants en adaptation scolaire, En ligne, 2novembre 2019, https://journals.openedition.org/edso/8288, DOI : https://doi.org/10.4000/edso.8288.
LEJEUNE Christophe, 2019, Méthodes en sciences humaine. Manuel d’analyse qualitative : Analyser sans compter ni classer, Bruxelles, Éditions De Boeck.
MEIRIEU Philippe, 2007, La pédagogie entre le dire et le faire : ou le courage des commencements, Paris, ESF.
MILES Matthew et HUBERMAN Michael, 2003, Analyse des données qualitatives, Paris, 2ème Éditions De Boeck.
NIANG Amadou Yoro, 2017, Étude sur la pertinence des stratégies de formation des enseignants au Sénégal : Les Conseillers Pédagogiques Itinérants (CPI) peuvent-ils constituer un modèle plausible ? À quelles conditions ?,Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2.
PERRENOUD Philippe, 2001, Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant. Professionnalisation et raison pédagogique, Paris, ESF.
SCHÖN Donald, 1994, Le praticien réflexif : À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Trad. Heynemand, J. et D. Gagnon, Montréal, Éditions Logiques.
THIÉBAUD Marc et Vacher YANN, 2020, « L’analyse de pratiques professionnelles dans une perspective d’accompagnement, d’intelligence collective et de réflexivité », Revue de l’analyse de pratiques professionnelles, Volume 6, Numéro 18, p. 43-69.
ROUSSEAU ET LA PRÉVENTION DU TERRORISME CONTEMPORAIN
Université Peleforo Gon COULIBALY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Les attentats du 11 septembre 2001 contre les Tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone aux États-Unis, constituent, à n’en point douter un moment charnière de notre époque contemporaine, tant par ses bouleversants effets sociaux, économiques, sécuritaires que géostratégiques. Des actes terroristes d’une rare violence, qui ont jeté une lumière crue sur la gangrène du terrorisme international, tout en étant le prélude, aux attentats de masse. Face à cet hyper terrorisme et à leur dissémination dans de nombreuses régions du monde, les pouvoirs publics se sont raidis davantage, en s’engageant à corps perdu dans la voie de l’obsession sécuritaire, avec leur lot de dérives liberticides. Le but du présent article, est de montrer que le tout répressif (la réponse militaire et judiciaire) priorisé aujourd’hui, est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour remédier au fléau du terrorisme. Il faut un prolongement de la riposte sécuritaire, par des mesures préventives, en termes de lutte acharnée contre les fragilités socioéconomiques, le tout assorti d’une solide éducation aux valeurs républicaines. Autant de préconisations sociales, énoncées matinalement par Rousseau (2010, p. 69), « dans le cadre d’une société bien ordonnée », qui méritent encore les feux de l’actualité, dans la perspective d’une prévention efficiente du terrorisme contemporain.
Mots-clés : Fragilités socioéconomiques, Légicentrisme, Réarmement civique, Surenchère sécuritaire, Terrorisme.
Abstract :
The attacks of September 11, 2001 against the twin towers of the World Trade Center and the Pentagon in the United States undoubtedly constitute a pivotal moment in our contempory era, both in tems of its shocking social, economic, security and geostrategic effects terrorist acts of rare violence, which shed a harsh light on the gangrene of international terrorism, while being the prelude to the mass attacks in Paris, Madrid, London, Ouagadougou, Grand-Bassam, etc. Faced with this massification or hyper-terrorism and their dissemination in many regions of the world, the public autorities have stiffened further, committing themselves headlong to the path of security obsession, with their share of libertical excesses. The purpose of this article is to show that the whole repressive (the military and judicial response) prioritized today, is a necessary, but not sufficient condition to remedy the scourage of contempory terrorism. The security response must be extended, through preventive measures, in terms of a relentless fight against social fragility (extreme deprivation and social inequities), all accompanied by a solid education in republican values. So many social recommandations, set out in the morinng by Rousseau (2010, p. 69), in the context of well-ordered society, which still deserve the spotlight, in the perspective of an efficient prevention of contempory terrorism.
Keywords : Civic rearmement, High militarization, Legicentrism, Socioeconomics fragilities, Terrorism.
Introduction
Après l’ère des guerres mondiales, de la décolonisation, de la guerre froide et de l’implosion du communisme, c’est désormais « l’ère du terrorisme » selon la formule d’Yves Jean clos (2011, p. 4). Même si le phénomène du terrorisme n’est pas récent, il faut dire que sous les traits du djihadisme, il a pris ces dernières années une grande ampleur et une dimension nouvelle. Pour transcontinental que soit le phénomène, force est de reconnaître que l’Afrique est devenue la base arrière de divers groupes djihadistes et le théâtre d’opération de nombreuses attaques terroristes ces dernières années.
Du Sahel à la Corne de l’Afrique, en passant par l’Afrique centrale et de l’ouest, la gangrène de l’extrémisme violent se propage, non sans provoquer en retour, une mobilisation considérable des pouvoirs publics. Axée sur le tout répressif, à travers le vocable de « la guerre contre le terrorisme », l’approche ultrasécuritaire des États peine à venir à bout de l’hydre terroriste, qui loin s’en faut, se métastase ou étend ses tentacules. Dans un tel contexte, n’est-il pas opportun, d’entrevoir un prolongement de la riposte sécuritaire, par des mesures sociales d’inspiration rousseauiste ? Quelle pourrait-être leur portée dans le cadre d’une prévention efficiente du fondamentalisme religieux, chaudron du terrorisme international ? À travers une démarche analytique et critique, nous aborderons d’abord, la nature de la riposte des pouvoirs publics face à l’expansion de la gangrène du terrorisme contemporain et les limites de celle-ci (1). Ensuite, nous nous attèlerons à relever que ladite gangrène, est une violation caractérisée des idéaux politiques de Rousseau (2). Nous évaluerons, enfin, certaines préconisations sociales du philosophe genevois, qui peuvent servir de pare-feu dans le cadre d’une lutte efficace contre « ce péril du siècle » (E. Macron, 2O22, p. 7) (3).
1. De la riposte des États contre le terrorisme contemporain
Suite à la multiplication des attentats terroristes de masse, les pouvoirs publics plus que jamais, se sont raidis. Ils ont considérablement renforcé leur appareil sécuritaire interne et leur outil de défense. Cette approche militarisée de la lutte antiterroriste donne lieu à des déploiements massifs d’effectifs sur le plan intérieur, à un accroissement du renseignement, mais aussi, à des opérations extérieures (Barkhane, Takuba, Minusma, G5 Sahel, Amiscom …). Ce recours massif à la force publique se double d’un légicentrisme, c’est-à-dire un phénomène de prolifération de règles juridiques. L’ère terroriste constitue une période éminemment normative, elle marque une réécriture des lois et des coutumes, et justifie de plus en plus l’adoption de régimes juridiques d’exception (état d’urgence, état de siège) par les pouvoirs publics. Une approche, résolument axée sur le tout répressif, qui est loin d’être auréolée de succès.
1.1. La surenchère militaire
Suite aux évènements du 11 septembre 2001, dont l’ampleur touche le monde dans sa globalité, le terrorisme global apparaît. Et avec, une réponse sécuritaire massive, impulsée par les États-Unis. En effet, infligés par Al-Qaïda après des années de préparatifs minutieux, les attentats du World trader center et du Pentagone, que même l’imaginaire d’Hollywood ou les thrillers à succès n’avaient pas encore envisagé, moins d’une vingtaine de terroristes l’ont fait, en portant des coups meurtriers aux symboles de la puissance financière et militaire américaine. La riposte n’en a été que plus brutale. Frappée en son cœur, la superpuissance américaine a répondu par la surenchère sécuritaire et militaire. La perte soudaine et brutale de la conviction de l’invulnérabilité du territoire des États-Unis, a entraîné la détermination à punir les coupables. La Maison Blanche annonçait alors une guerre globale contre le terrorisme global. S’ensuit un déferlement de puissance militaire américaine, visant à punir les Talibans et détruire le sanctuaire d’Al-Qaïdaen Afghanistan et ses ramifications en Irak.
Loin d’être couronné de succès, l’intervention militaire américaine en Afghanistan et en Irak, sur le front de la lutte antiterroriste, a tourné au cauchemar, rappelant la guerre du Vietnam. Il laisse dans son sillage des milliers de morts parmi les GI’S (soldats américains), encore plus parmi les populations civiles (afghanes et irakiennes), des dommages infrastructurels considérables et des milliards de dollars engloutis au titre de l’effort de guerre. Au fond, la défaite des États-Unisparachevée par la débâcle de Kaboul en 2021 (le retrait précipité des troupes américaines d’Afghanistan), ne signale pas seulement l’échec de cette longue guerre pour la plus grande et la mieux équipée des armées du monde : cette fin désordonnée montre aussi les limites du recours à la force dans la lutte antiterroriste. L’échec du tout sécuritaire, dans la lutte contre le terrorisme contemporain, se perçoit également à l’échelle du continent africain. En effet, le terrorisme n’est pas une menace nouvelle en Afrique, car il s’est progressivement implanté sur le continent depuis le début des années 1990. L’Afrique du nord fut la première région à faire face à cette nouvelle menace, d’abord comme victime, mais aussi comme base arrière pour des mouvements qui s’y sont installés pour mener plusieurs activités de recrutement et de formation de combattants. Cependant, c’est avec la destruction des deux ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salam le 07 août 1998 que le terrorisme cesse d’être perçu comme une simple nuisance pour devenir une véritable menace stratégique. Depuis lors, la menace terroriste s’est amplifiée et s’est propagée, tant et si bien qu’aucune région du continent n’est épargnée : du Sahel au bassin du lac Tchad, en passant par le nord-est du Nigéria, le golfe de Guinée, l’est de la République démocratique du Congo, le nord du Mozambique ou la Somalie, l’Afrique est en passe de devenir la plaque tournante du terrorisme transnational. Et ce, en dépit de la militarisation massive de la riposte antiterroriste.
La présence de l’opération Barkhane, Takuba, la mission de l’ONU au Mali (MINUSMA), la mise en place du G5 Sahel (regroupement militaire de 5 États de la bande sahélo-saharienne), l’AMISCOM (mission militaire de l’Union Africaine en Somalie), n’ont pas pu endiguer le terrorisme dans différents pays d’Afrique. Bien plus, le triple phénomène de déterritorialisation, de réticulation – organisation en réseau- et de transnationalisation -dépassement du cadre étatique national – des mouvements terroristes et extrémistes, est de plus en plus prégnant. Ainsi, le Sahel symbolise le terrain par excellence où le terrorisme islamiste travaille à s’implanter durablement. Le Mali, le Burkina-Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections djihadistes et les États voisins, comme le Ghana, le Bénin et la Côte-d’Ivoire, qui observent quelques incursions sur leur territoire, s’inquiètent de débordements à leurs frontières. Cette dégradation confirme l’échec d’une stratégie purement sécuritaire : la lutte contre le terrorisme ne peut pas se gagner uniquement sur le tableau militaire. L’arsenal répressif déployé par les États contre le terrorisme, n’est pas seulement d’ordre militaire, mais aussi juridique. Il se caractérise par un empilement des lois antiterroristes. Jamais autant depuis une vingtaine d’années, l’empilement des strates législatives antiterroristes n’a été aussi massif, chaque attentat terroriste ouvrant la porte à une couche juridique supplémentaire, en droit interne comme international.
1.2. Le légicentrisme
Le terrorisme international a contribué à l’avènement d’une ère éminemment normative. Le terrorisme de ce siècle, plus encore que le terrorisme de tous les siècles précédents, génère des peurs, car il ne choisit pas ses victimes ; le hasard vous fait victime ou non et en conséquence, « une foule innocente, dit Denis Salas, demande justice » (D. Salas, 2018, p. 54). De ces peurs naît une soif de répression telle que même les États de droit peinent à faire triompher le droit. Ils peinent à résister aux régressions par un empilement de réformes qui se révèlent souvent non-respectueuses des libertés et des droits fondamentaux. En effet, la définition du terrorisme ne fait pas l’unanimité en droit international et divise la doctrine. Son appréhension fait l’objet de diverses interprétations. En l’absence de consensus définitionnel dans les textes juridiques internationaux, les États jouissent d’une certaine liberté en matière d’interprétation de la notion de terrorisme.
Mais cette liberté laissée aux États peut avoir des conséquences importantes et entraîner de graves dérives. C’est ainsi que certains États, dans le but d’adapter leur cadre juridique à la nouvelle menace, proposent la définition du terrorisme en des termes très vagues, incluant par exemple, les crimes contre l’État, les contestations des décisions du pouvoir ou encore la participation à des mouvements d’opposition ou insurrectionnels. Un tel scénario aboutit souvent à la mort d’opposants ou de manifestants pour leurs activités et ce, sous couvert de terrorisme. Le choix de l’arme juridique en réponse au terrorisme contemporain, peut charrier d’innombrables entorses en matière de libertés individuelles et collectives. En cela, le tentaculaire Patriot Act américain fait figure d’exemple tristement célèbre. Il est le versant normatif de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis, à partir des attentats de 2001. C’est une loi fleuve (un corpus de 342 pages) ou un train de mesures juridiques résumées par l’acronyme Patriot Act, adopté par le Congrès américain, puis promulguée par George Bush, dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001, au nom de la guerre que les États-Unis entendent désormais mener contre la terreur. Il (le Patriot Act) définit de nouveaux crimes de terrorisme intérieur, investit les forces de l’ordre de pouvoirs élargis de perquisition (y compris à l’insu de l’intéressé), autorise leur intrusion dans les données personnelles et assouplit les conditions légales qui encadrent la mise sur écoute et la surveillance des personnes (l’interception des communications personnelles), entre autres.
Il crée également les statuts de combattant ennemi et combattant illégal, qui permettent au gouvernement des États-Unis de détenir sans limite et sans inculpation toute personne soupçonnée de projet terroriste. Des États-Unis au Royaume-Uni, en passant par la France, et bien d’autres pays occidentaux, les grandes démocraties ont très souvent cédé à cette propension liée à la surproduction normative. Dans une tribune publiée dans Libération le 16 juillet 2022, la juriste Mireille Delmas-Marty met en garde contre un risque d’inflation législative et une dérive sécuritaire sur le front de la lutte antiterroriste en France. Elle (2022, p. 6) précise que « de novembre 2010 à mars 2022, le parlement français n’a eu de cesse de renforcer l’arsenal juridique, à travers l’adoption de neuf lois antiterroristes, dont la dixième est en cours d’examen ». La vague d’attentats terroristes en 2015, dans l’Hexagone – l’attaque du Bataclan, du stade de France, du journal Charlie Hebdo -, a particulièrement contribué à accélérer la cadence de la prolifération normative. Le continent africain n’échappe pas aussi à cette inflation textuelle dans le domaine de l’antiterrorisme. À la percée djihadiste sans précédent, qui malmène les appareils sécuritaires étatiques, l’Union Africaine a adopté un large éventail d’instruments juridiques et organisationnels pour endiguer son expansion sur le continent (près d’une dizaine de conventions en lien avec le financement du terrorisme, la sécurité des aéroports, des aéronefs…). Déjà, en octobre 2001, une Conférence régionale à Dakar, a adopté une Déclaration contre le terrorisme et a lancé l’idée d’un « Pacte africain contre le terrorisme ». L’évènement majeur a été l’entrée en vigueur, le 6 décembre 2002, de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Depuis, de nombreux États ont adopté ou annoncé des mesures pour combattre le terrorisme. Le Nigéria, le Cameroun, le Tchad, le Kenya, le Mali, le Niger et bien d’autres, ont tous créé des parquets antiterroristes, et adopté des lois antiterroristes criminalisant le terrorisme et l’apologie du terrorisme, durcissant ainsi leur arsenal juridique.
Cependant, ce train de lois antiterroristes est-il efficace ? Assurément non ! « La plus grande victoire des terroristes, précise Codaccioni Vanessa, comme ceux de Daech, dont l’idéologie suscite la panique, est de mettre en péril l’État de droit par l’adoption de mesures de plus en plus attentatoires aux droits et libertés fondamentaux » (C. Vanessa, 2022, p. 67). Face à des groupes organisés, fanatisés, faisant l’apologie de la mort, tout porte à croire que les lois antiterroristes n’ont pas de réelle portée dissuasive. Raison pour laquelle, au-delà des refontes de leurs législations, les États ont tout intérêt à mettre en place des politiques de prévention. En plus de créer un climat social fortement anxiogène, le terrorisme a des conséquences politiques indéniables : il attente aux principes de l’État de droit et conséquemment à ceux de l’État laïque, dont le philosophe genevois, a été l’un des promoteurs les plus ardents.
2. Le terrorisme contemporain, une violation caractérisée des idéaux politiques de Rousseau
« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! ». Cette sentence médiévale retrouve une actualité brûlante, à la lumière de la démultiplication des carnages ou des attentats commis par « les fous de Dieu », qui massacrent et égorgent les innocents, à commencer par leurs propres frères. Les mouvements religieux extrémistes qui usent de cette violence partagent trois caractéristiques : ils souhaitent restaurer une religion plus pure, en se référant à un passé idéalisé. Ils rejettent toute idée de compromis ou de tolérance avec d’autres valeurs ; ils refusent de cantonner la religion dans les limites imposées par une société laïque ou en voie de laïcisation. Des agissements qui constituent un vice social rédhibitoire, car contrevenant gravement au principe de la liberté de conscience.
2.1. Une violation de la liberté de conscience
Le terrorisme contemporain sous les traits du djihadisme, s’attaque aux fondements de la liberté de conscience, car il a une visée totalitaire, ses tenants veulent imposer leur idéologie (la charia) à l’ensemble de la société, et ce, par la voie de la terreur. En cela, il porte atteinte à l’un des principes constitutifs de l’État moderne, à savoir la liberté de conscience. La liberté de conscience, et par extension la laïcité, est le rappel que les communautés, en particulier religieuses, ne peuvent étouffer l’État, représentant le bien commun. La laïcité ne considère pas la religion et l’État comme deux entités juridiques semblables. Si tel est le cas, les religions n’auraient aucun compte à rendre à la République et existeraient au sein de l’État comme un État souverain. Elles auraient un statut dérogatoire, et cela les libéreraient de leurs obligations vis-à-vis de la loi commune. Foncièrement opposé à l’édification d’un État théologique, Rousseau (2010, p. 56) a pris très tôt le parti de la liberté de conscience qu’il énonce ainsi « Il importe bien à l’État que chaque citoyen ait une religion (…) mais les dogmes de cette religion n’intéressent ni l’État, ni ses membres ». Les individus, en effet sont libres de choisir telle ou telle religion pour leurs croyances en un au-delà. Ce qui semble indispensable à Rousseau, c’est que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs, mais les dogmes de cette religion n’intéressent ni l’État ni ses membres qu’autant que les dogmes qui se rapportent à la morale et aux devoirs de celui qui la professe ne nuisent pas au vivre ensemble (2010, p. 66) :
Chacun peut avoir au surplus telles opinions qu’il lui plaît, sans qu’il appartienne au souverain d’en connaître. Car comme il n’a point de compétence dans l’autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir ce n’est pas son affaire, pourvu qu’ils soient bons citoyens dans celle-ci.
Au regard de cette assertion, il ne fait pas de doute que les religions devraient agir de telle sorte que leurs croyants aient aussi leurs pieds sur terre, s’intéressent aux affaires publiques, respectent les lois de la République, y compris le respect de la diversité religieuse. L’État laïque ne tolère les convictions religieuses qu’autant qu’elles ne contredisent pas sa volonté car, « nul ne peut, affirme Rousseau, invoquer ses convictions pour se soustraire au droit » (Rousseau, 2010, p. 78). Le genevois exècre l’intolérance tant et si bien que contrairement aux encyclopédistes comme Diderot, il refuse de distinguer intolérance civile et intolérance théologique.
L’intolérance ne se divise pas : elle se joue et se mesure donc nécessairement jusque sur le terrain du dogme. En effet, pour Rousseau (2010, p. 154) « Partout où l’intolérance est admise, il est impossible qu’elle n’ait quelque effet civil ». L’intolérance religieuse est le continuum de l’intolérance civile. Ainsi, (2010, p 154) : « Quiconque, écrit Rousseau, ose dire hors de l’Église, point de salut doit être chassé de l’État ». Sans cette maxime, en effet, on reviendrait inévitablement à l’hypothèse du gouvernement théocratique. Sur ce point, la thèse du citoyen de Genève est que non seulement, aucune religion, pas même le Christianisme des origines (qu’il juge pourtant saint, sublime, véritable, comparé au Christianisme romain ou à la religion des prêtres qu’il fustige) ne peut être élevé au rang de religion d’État. À ce titre, il (2010, p. 154) se fait fort de préciser que « Maintenant qu’il n’y a plus et qu’il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres ». Aucune religion ne doit interférer dans la constitution du corps politique. Le souverain doit au contraire imposer l’exigence civile de la tolérance, et cela jusque dans les dogmes. Toute la préoccupation de Rousseau est dirigée vers l’affermissement du lien social que le terrorisme met à rude épreuve. Tant que la religion exercée, n’affecte pas le vivre ensemble, elle est recevable. D’ailleurs, tous les droits accordés aux citoyens, y compris, la liberté de conscience ne dépassent pas les bornes de l’utilité publique. Et, c’est justement, pour promouvoir la primauté du lien social que Rousseau met en avant la religion civile.
Cependant, cette dernière n’est pas une religion au sens strict du terme, en termes de cultes, de rites, de temples et de mystères. Elle a à avoir uniquement avec les vertus intégratrices ou consolidatrices de la société. L’objectif visé par Rousseau n’est pas de créer artificiellement une religion à laquelle tout le monde devrait adhérer. À travers la religion civile, il ne vise pas une fusion entre l’État et la religion, il ne désire en aucun cas revitaliser, revivifier le rôle politiquement structurant de la religion, mais, elle contient une profession de foi civile, « non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité » (Rousseau, 2010, p. 31). Il apparaît ici que la profession de foi de la religion civile n’a rien de clérical. Le choix de Rousseau pour un unique dogme négatif, en l’occurrence l’intolérance, invite à penser que pour celui-ci, l’enjeu et l’urgence, est de promouvoir la liberté de conscience. Réalisant avant l’heure, les bienfaits de la liberté de conscience et donc de la laïcité, l’auteur Du contrat social est fort convaincu que les religions sont utiles aux sociétés humaines, lorsqu’elles ont un caractère civil et non politique, c’est-à-dire quand elles permettent à leurs adhérents d’assumer pleinement leur citoyenneté, leur réalité concrète, tout en professant leur foi en un au-delà sans tomber dans l’intolérance, le fanatisme et la superstition. En plus de remettre en cause gravement la liberté de conscience, le terrorisme contrarie également le contractualisme politique de Rousseau.
2.2. Une remise en cause de l’artificialisme social
Le terrorisme contemporain, sous son trait islamiste, est porteur d’une idéologie totalitaire : l’instauration de la charia ou de la loi islamique comme seul référent structurant (normatif) de la société. En cela, il contrevient gravement à l’ordre politique énoncé par Rousseau, qui est un ordre temporel, ayant donc un fondement humain. Avec Rousseau, la politique est désormais immanente à l’homme, elle est pensée comme relevant d’une pratique spécifiquement humaine. Elle exprime la condition temporelle des hommes et vise à régler selon le droit civil cette condition temporelle. La souveraineté populaire, parce qu’elle exprime dorénavant le fondement profane de la Res publica moderne ou État, revient à repousser toute référence à Dieu dans la sphère privée. Par l’instauration de « la séparation de la foi et de la loi », la République accorde la primauté au droit civil, tout en affirmant la supériorité de l’universalité civique sur les particularismes religieux. Ainsi, l’acte fondateur de la société politique n’est pas à trouver dans la volonté d’une parole divine, ni encore dans la nature sous quelque forme qu’elle apparaisse, mais dans la volonté humaine sous le symbole d’un contrat. Ce sont les individus qui, originellement, auraient décidé de mettre librement en place (2010, p. 15) :
Une association qui défende et protège la personne et les biens de chaque associé de toute la force commune et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant.
L’artificialisme de Rousseau met en avant que l’ordre politique n’a aucun fondement naturel ou théologique, il ne peut être que le produit d’une décision collective s’incarnant dans le contrat social (2010, p. 32) : « l’autorité politique, purement arbitraire quant à son institution, ne peut être fondé que sur des conventions ». Le pacte social est l’acte inaugural de socialisation, « l’acte par lequel un peuple est un peuple » selon Rousseau (2010, p. 56). Il vise en effet à fonder le droit politique et l’État sur « les vrais principes », sur des bases beaucoup plus légitimes que le référent à Dieu, à la force, à la nature, qui font le lit à la sujétion. Recherchant un fondement du pouvoir moins discutable que la théorie de droit divin et moins arbitraire que la force, Rousseau se tourne vers le concept juridique d’accord contractuel fondé sur le consentement mutuel. Le contractualisme, aussi appelé la théorie du contrat, est un courant qui pense l’origine de la société et de l’État comme un contrat originaire entre les hommes, par lequel ceux-ci acceptent une limitation de leur liberté en échange de lois garantissant la perpétuation du corps social. C’est un acte fictif par lequel les individus vont renoncer ou se dessaisir de leur droit naturel au profit de droits civils.
Comme le remarque Philippe Corcuff (2021, p. 28), avec les philosophes contractualistes, « la naissance de l’ordre politique a bien donc une composante volontaire, mais dans le même temps la volonté est limitée par le caractère quasi-nécessaire du pacte ». La notion de contrat social selon Gérard Mairet (2010, p. 17), ne doit pas s’entendre comme désignant un contrat formel entre individus mais comme l’expression de l’idée selon laquelle : « le pouvoir légitime pour gouverner n’est pas directement fondé sur un titre divin ou sur un titre naturel (…) mais doit être ratifié par le consentement des gouvernés ». L’artificialisme politique de Rousseau, est la prémisse à l’édification d’un État démocratique où l’autorité politique est un pouvoir convenu. L’État démocratique, et donc laïque, est identifié par Rousseau comme le plus conforme à la liberté que la Nature reconnaît à chacun, car l’individu ne s’en remet pas à une volonté transcendante, mais à la majorité de la société dont lui-même fait partie. In concreto (concrètement), quelles sont les préconisations sociales, énoncées matinalement par Rousseau, qui peuvent servir de levain dans le cadre d’une prévention efficiente du terrorisme international ?
3. Des mesures sociales d’inspiration rousseauiste
Le philosophe genevois est homme de son temps, mais il parle aussi au nôtre. Dans le sens d’une approche intégrée (et non seulement sécuritaire) pour endiguer le terrorisme contemporain, certaines mesures sociales d’inspiration rousseauiste, méritent encore les feux de l’actualité, notamment la lutte acharnée contre les vulnérabilités socioéconomiques (l’extrême dénuement, les iniquités sociales) et le réarmement civique.
3.1. La lutte acharnée contre les fragilités socioéconomiques
De nombreuses études relèvent la forte corrélation entre les vulnérabilités sociales et l’expansion du terrorisme contemporain, comme l’explique ce propos de Georges Klutsé (2022, p. 7), secrétaire général du Regroupement des jeunes Africains pour la démocratie et le développement (REJJAD), une ONG œuvrant dans l’humanitaire et implantée dans plusieurs pays de la sous-région :
Nous savons que les communautés sont durement touchées par la pauvreté et le chômage au Mali, au Niger, au Burkina-Faso. Je dis cela parce que nous travaillons sur le terrain pour le développement des jeunes. Tant que les autorités de nos pays, en Afrique de l’ouest, continueront d’ignorer la véritable aspiration de la jeunesse, il sera difficile de gagner cette guerre contre le terrorisme dans cette région. La seule véritable origine du terrorisme est la pauvreté et les frustrations.
Du reste, il n’est pas anodin que les zones nord des pays sahéliens (Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad), en proie à un fort taux de pauvreté et à un manque criant d’infrastructures de base, soient les plus marquées par la poussée terroriste. Rousseau, très tôt, a pris la mesure de la nocuité sociale des fortes dénivellations de richesse. Il s’est présenté comme un pourfendeur de l’extrême dénuement, qu’il considère comme incompatible avec l’édification d’une société vertueuse. Ainsi (1971, p. 67) :
C’est donc une des plus importantes affaires du gouvernement de prévenir l’extrême inégalité des fortunes, non en enlevant des trésors à leurs possesseurs, mais en ôtant à tous les moyens d’en accumuler, ni en bâtissant des hôpitaux pour les pauvres, mais garantissant les citoyens de le devenir.
En effet, le genevois est à l’origine d’une longue tradition dans la pensée politique, qui affirme qu’il ne peut y avoir de véritable stabilité sociale là où les conditions matérielles du point de vue de la richesse et du pouvoir privé sont profondément inégalitaires. Voilà pourquoi il faut empêcher l’extrême inégalité des fortunes entre les citoyens, en rapprochant les degrés extrêmes autant qu’il est possible : « ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux états, naturellement, sont également funestes pour le bien commun » (Jean-Jacques Rousseau, 2010, p. 46). Surtout, ne nous méprenons pas, Rousseau n’est pas partisan d’un égalitarisme grossier, « l’égalité des fortunes, écrit René de Lacharrière, n’est pas prescrite par le Contrat social comme un nivellement absolu et non plus comme une fin en soi » (René de Lacharrière, 1963, p. 97). Il suit de là, que l’auteur Du Contrat social (1971, p. 78) est en faveur d’un entre-deux, d’une voie médiane entre la misère et la surabondance : « un état avantageux aux hommes qu’autant qu’ils ont tous quelque chose ». Il s’agit de créer les conditions d’une vie sociale digne pour tous, où l’avoir des uns ne favorise pas la misère des autres. Il faut à tout prix éviter selon le citoyen de Genève (1971, p. 78) :
Cette étrange et funeste constitution où les richesses accumulées facilitent toujours les moyens d’en accumuler de plus grandes, et où il est impossible à celui qui n’a rien d’acquérir quelque chose.
Rousseau est convaincu que de trop grandes inégalités économiques nuisent inévitablement au bien de la cité et empêchent l’actualisation de la vertu politique chez les individus-citoyens. La politique devrait chercher à préserver la société contre cet état de division entre riches et pauvres, entre « une poignée de puissants et de riches au faîte des grandeurs et de la fortune » et « la foule (…) dans l’obscurité et dans la misère » (Rousseau, 1971, p. 187). On trouve chez Platon la même défiance à l’égard de l’enrichissement et de l’appauvrissement des citoyens, lorsqu’il propose des moyens destinés à prévenir ces deux extrêmes dans le Livre V des Lois : en matière de possession de richesses et de biens, « l’excès (…) engendre inimitiés et séditions pour les cités et les individus ; le défaut, pour l’ordinaire, les asservit » (Platon, 1975, p. 81). Lorsque les inégalités de fortune sont très criantes, avec à la clé une pauvreté ambiante, cela rend audible, aguichant ou réceptif le discours de recrutement des organisations terroristes. Les franchises terroristes de l’État islamique et d’Al-Qaïda, qui opèrent à l’échelle de plusieurs États africains, exploitent une économie parallèle (traite humaine, prise d’otages, contrebande, racket), elles disposent d’une importante surface financière, « donc d’un important pouvoir de séduction » (G. Klutsé, 2022, p. 34).
Le combat de Rousseau contre l’extrême dénuement, doit rentrer en résonance avec celui de la lutte contre le terrorisme, à l’effet de rendre les populations beaucoup plus résilientes face à ce fléau. Les vulnérabilités sociales qui font le lit du terrorisme, ne sont pas seulement de l’ordre de l’extrême pauvreté, elles ont trait également aux iniquités ou injustices sociales. En effet, la persistance et l’accumulation des abus sociaux, servent de terreau fertile à l’expansion terroriste, car elles alimentent la rhétorique et la violence terroristes, d’où cet appel de l’ex-ministre français des affaires étrangères Hubert Védrine (2021, p. 56), à traiter les véritables causes du terrorisme : « Nous devons nous attaquer aux situations de pauvreté, d’injustice, d’humiliation, etc. ». Et justement, en matière de protestation contre les abus sociaux, Rousseau fait une fois de plus figure de précurseur dans la modernité politique. Le genevois (2010, p. 54) évoque le rôle précieux du gouvernement pour protéger le pauvre contre le riche :
Ce qu’il y a de plus nécessaire, et peut-être de plus difficile dans le gouvernement, c’est une intégrité sévère à rendre justice à tous, et surtout à protéger contre la tyrannie du riche.
Son combat contre les iniquités sociales et par voie de conséquence pour l’égale dignité entre les hommes fait dire à Charles Taylor (1994, p. 46) que : « La philosophie de Rousseau signe l’invention de l’idéal moderne d’égale dignité ». Du reste, ses écrits sur la guerre, et sur les lois de la guerre- ce que l’on nomme aujourd’hui le droit international humanitaire, sont portés par l’exigence de la sauvegarde de la dignité humaine. Ils constituent l’une de ses plus importantes contributions au droit, et son legs intellectuel le plus durable, à parité avec ses considérations sur la justice politique, et ses écrits sur la démocratie et le gouvernement dans le Contrat social, avec lesquels ils entretiennent des liens étroits.
Lesdits écrits contribuèrent à forger une tradition républicaine qui s’efforçait de proposer des principes de justice et d’égalité dans l’arène la plus inégale qui soit, celle de la guerre. Rousseau est porteur de la notion de guerre juste, alliée à l’idée de règles et de justice. Une guerre juste n’autorise pas tout. Elle n’est pas faite « par des mercenaires, à la solde des rois, mais par des citoyens, qui viennent à l’aide de leur république lorsqu’il en est besoin » (Rousseau, 2010, p. 66). Le citoyen de Genève (2010, p. 67) évoque ce que l’on nommera plus tard des « crimes de guerre » :
Même en pleine guerre un prince juste s’empare en pays ennemi de tout ce qui appartient au public, mais il respecte la personne et les biens des particuliers ; il respecte les droits sur lesquels sont fondés les siens. (…) La fin de la guerre étant la destruction de l’État ennemi, on a droit d’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se rendent, cessant d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l’on n’a plus droit sur leur vie.
Des spécifications portées par une logique de protection de la dignité humaine, qui pourraient être fort utiles dans le cadre de « la guerre contre le terrorisme », très souvent ponctuée par de graves violations des droits humains. Au-delà de la prise en compte des vulnérabilités socioéconomiques, dans le cadre d’une prévention efficiente du terrorisme, une autre préconisation rousseauiste, fait office d’impératif : la reconversion citoyenne.
3.2. La nécessité du réarmement civique
À l’échelle des pays africains, particulièrement endeuillés par le terrorisme contemporain (Mali, Burkina-Faso, Niger, Nigeria, Somalie), une constante se dégage : l’endogénéisation du terrorisme ou son caractère domestique. Les groupes terroristes recrutent leurs combattants et leurs sympathisants dorénavant dans les communautés locales. Les émirs ou les chefs des katibas (camps de combattants islamistes) comme Amadou Kouffa de la katiba Macina, Iyad Ag Ghaly du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), Abubakar Shekau de Boko Haram ainsi que leurs suppôts, surfent sur la fibre ethnique ou communautariste, pour garnir leurs rangs. Une transmutation des groupes terroristes que corrobore Djibril Bassolé (2023, p. 5), l’ancien ministre des affaires étrangères du Burkina-Faso :
Initialement, il s’agissait exclusivement d’un djihadisme à caractère idéologique et transfrontalier. En d’autres termes, les agresseurs venaient de l’extérieur et décidaient souvent de mourir en kamikaze. (…) De nos jours, le djihadisme prend les formes d’insurrections armées locales ou régionales. Des jeunes nationaux des pays visés se sont massivement enrôlés dans les groupes djihadistes, dans des alliances stratégiques et idéologiques pour mener des luttes armées contre leurs États. Ils s’attaquent aux forces de défense et de sécurité (symboles de l’autorité de l’État) et à leurs concitoyens avec une violence inouïe.
Cet enrôlement massif des jeunes nationaux dans les rangs terroristes, témoigne d’un décrochage citoyen. Il est symptomatique d’une crise abyssale de la citoyenneté, d’un manque de sentiment d’appartenance nationale, qui n’a d’égal que l’étendue des atrocités de ces recrues djihadistes contre les siens. Rousseau (2012, p. 3) avait déjà eu l’intuition majeure de mettre au cœur des enjeux sociétaux, l’éducation citoyenne, qu’il considère comme le réceptacle de toutes les vertus républicaines : « vous aurez tout, si vous formez des citoyens ». L’éducation citoyenne a pour vocation d’infuser et de diffuser dans les esprits et dans les cœurs les valeurs cardinales du patriotisme et de la foi républicaine. Et ce, dès la prime enfance (2012, p. 56) :
Former des citoyens n’est pas l’affaire d’un jour, et pour les avoir hommes, il faut les instruire enfants. Ce n’est pas assez de dire aux citoyens, soyez bons ; il faut les apprendre à l’être. (…) Si, par exemple, on les exerce assez tôt à ne jamais regarder leur individu que par ses relations avec le corps de l’État, et à n’apercevoir, pour ainsi dire, leur propre existence que comme une partie de la sienne, ils pourront parvenir enfin à s’identifier en quelque sorte avec ce plus grand tout, à se sentir membres de la patrie, à l’aimer de ce sentiment exquis que tout homme isolé n’a que pour soi-même, à élever perpétuellement leur âme à ce grand objet.
C’est elle – l’éducation citoyenne – qui va redresser les mœurs, socialiser les volontés individuelles, fabriquer une individualité nationale, à même de prémunir la société des vices rédhibitoires comme le terrorisme. Elle seule peut installer l’État en quelque sorte dans les cœurs, de sorte que le citoyen s’attache à la vie de la cité et ne peut détacher son intérêt de celui-ci. Selon Rousseau, il faut régénérer les mœurs et redécouvrir la vertu antique, orientée vers le bien commun et le zèle patriotique. En effet, l’Antiquité gréco-romaine offre à Rousseau le double modèle de la République et de la citoyenneté. Il part de « cet étalon de mesure » pour en appeler à un attachement viscéral à la cité, qui culmine au sacrifice suprême. Que ma patrie devienne moi et réciproquement. L’identification est la seule issue. Pour rendre compte de la haute idée qu’il a du citoyen, Rousseau se fend de ce descriptif (1971, p. 66) :
Une femme de Sparte avait cinq fils dans l’armée et attendait des nouvelles de la bataille. Une ilote arrive, elle lui demande en tremblant. Vos cinq fils ont été tués, esclave, t’ai-je demandé cela ? Nous avons gagné la victoire. La mère court au temple et rend grâce aux dieux, voilà la citoyenne.
L’auteur Du contrat social fonde sa vision citoyenne sur l’image héroïque de la fierté républicaine qu’il s’est formée dès sa jeunesse, à travers les livres, qu’il avait lus sur l’établi de son père. Il en fixe les principes au livre I de l’Émile. Ils s’énoncent à partir de la distinction entre unité numérique et unité fractionnaire. Le citoyen n’est qu’une unité fractionnaire « dont la valeur est dans son rapport avec l’entier, qui est le corps social » (Rousseau, 2010, p. 45). Une unité numérique, quant à elle, n’a de rapport qu’à elle-même comme l’individu à l’état de nature ; mais une unité fractionnaire, comme l’est le citoyen, passe par la relation au tout. Précisément, c’est cette unité de corps, ce lien organique, fusionnel entre le citoyen et la cité qu’il faut maintenir, vivifier, revitaliser dans le cadre de la résilience des populations face au terrorisme. Et convenons avec le chercheur sénégalais Bakary SAMBE (2020, p. 9) pour reconnaître que les États sahéliens face à la poussée djihadiste, « doivent renforcer le sentiment d’appartenance nationale des citoyens des régions périphériques ».
Conclusion
En dépit de la surenchère sécuritaire, dont font preuve les États, la guerre contre le terrorisme mondial ne pourra pas se conclure sur un bulletin de victoire finale. Le combat antiterroriste ne peut être uniquement militaire. Il faut davantage miser sur les approches sociales (la lutte contre les vulnérabilités socioéconomiques et le délitement du lien social). S’il est évident que l’aspect répressif, est un pendant de la lutte contre le terrorisme, il est aussi sûr qu’elle ne se gagnera pas sans la conquête des cœurs, plus durable que la soumission des corps et le tout sécuritaire, qui n’a réussi à vaincre le terrorisme nulle part.
La question du terrorisme exige une approche intégrée ou holistique, qui prenne en compte à la fois l’aspect militaire, judiciaire que socioéconomique. Aussi faut-il s’atteler avec insistance à mettre « la loi sociale au fond du cœur des hommes » (Rousseau ,2010, p. 46), à travers un réarmement civique et faire du combat contre les fragilités sociales des marqueurs importants de la prévention du terrorisme contemporain. Autant de recommandations sociales, énoncées par Rousseau, dans le cadre « d’une cité vertueuse, animée par la foi républicaine et le sentiment patriotique » (Geraldine Lepan,2008, p. 18), qui doivent encore servir de repère, sinon de remède au terrorisme contemporain. Du reste, rejoignons François Châtelet (2012, p. 45), pour reconnaître que la pensée politique de Rousseau, est loin d’être frappée d’obsolescence, elle mérite toujours les feux de l’actualité. :
Quoiqu’en pense Hegel, le penseur de la modernité classique, ce n’est pas Descartes, c’est Jean- Jacques Rousseau. Apparaît l’écrivain agressif et démuni, qui, sans plan, sans méthode, réunit tous les fils, les tisse pour en faire une étoffe surprenante où s’inscrivent les configurations des problématiques d’alors, dont il faut bien dire qu’elles sont encore les nôtres.
Références bibliographiques
CHÂTELET François, 2012, Histoire des idées politiques, Paris, PUF.
CLOS Jean Yves, 2011, Crises et crispations internationales au XXIe siècle, Paris, Ed. Bruylant.
CODACCIONI Vanessa, 2022, Justice d’exception, Paris, CNRS EDITIONS.
CORCUFF Philippe, 2021, La grande confusion, Paris, Éditions Textuel.
DELMAS-MARTY Mireille, 2022, La refondation des pouvoirs, Paris, SEUIL.
LACHARRIERE René, 1963, Études sur la théorie démocratique : Spinoza, Rousseau, Hegel, Marx, Poitiers, Payot.
LEPAN Geraldine, 2008, « Jean-Jacques Rousseau et le patriotisme », in Annales historiques de la Révolution française, n°47, p. 19.
PLATON, 1975, Les Lois, Paris, Les Belles Lettres.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1971, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, Flammarion.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 2010, Du Contrat Social, Paris, Le livre de poche, Classiques de philosophie.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 2012, Économie politique, Paris, Hachette.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 2010, Émile, Paris, Le livre de poche, Classiques de philosophie.
SALAS Denis, 2018, La foule innocente, Paris, Desclée de Brouwer.
SAMBE Bakary, 2020, BOKO HARAM, Dakar, Presses panafricaines.
TYLOR Charles, 1994, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Trad. Alfred Croiset, Paris, Aubier.
VEDRINE Hubert, 2021, Et après ?,Paris, Pluriel.
JEAN-PAUL SARTRE ENTRE LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
Dimitri OVENANGA-KOUMOU
Université Marien Ngouabi (République du Congo)
Résumé :
Intellectuel, Jean-Paul Sartre l’est dans différents domaines. Ceux qui le prennent plus pour un philosophe devraient revisiter leur position. Il y a, en effet, un déséquilibre criant entre le nombre des œuvres philosophiques et littéraires dont il est auteur. Aussi, sa philosophie n’est-elle connue, si philosophie il y a, que par l’entremise de ses romans et pièces de théâtre. Elle n’est pas trop présente sous sa plume et ne peut pas être prise pour un prétexte, mais demeure à jamais un sous-texte à cette grande et riche littérature. Celle-ci n’est, à cet effet, qu’un palimpseste sous lequel on trouve le texte philosophique. S’il est évident que Sartre est philosophe, il est néanmoins plus littéraire.
Mots-clés : Langue philosophique, Palimpseste, Prétexte, Sous-Plan, Vocation littéraire.
Abstract :
Jean-Paul Sartre is intellectual in several levels. Those who take him more for a philosopher should reconsider their position. There is, in fact, a glaring imbalance between the number of philosophical and literary works of which he is the author. Also, his philosophy is only known, if philosophy there is, through his novels and plays. It is not too present under his pen and cannot be taken for a pretext, but remains forever a subtext to this great and rich literature. This is, for this purpose, only a palimpsest under which we find the philosophical text. If it is obvious that Sartre is a philosopher, he is nevertheless more literary.
Keywords : Philosophical language, Palimpsest, Pretext, Sub plan, Literary vocation.
Introduction
Lorsqu’on remonte dans l’histoire de la science en général et celle de la philosophie en particulier, on constate qu’il y a eu un nombre important d’esprits à compétence double ou diversifiée. La science s’est parfois mêlée, non seulement à l’écriture littéraire, cas de Galilée, et à l’administration, cas de Lavoisier, mais aussi et surtout à la philosophie où les exemples sont légions : par exemple avec Thalès et Pythagore, pour ne citer que ceux-là.
Dans le même registre, se trouvent rangées aussi des situations où la philosophie s’est entremêlée à la littérature. Parmi celles-ci, la plus frappante est celle de Jean-Paul Sartre dont on sait pertinemment qu’il a écrit des œuvres littéraires et philosophiques, mieux, plus d’œuvres littéraires que philosophiques. On sait encore qu’il refusa le prix Nobel de littérature. L’on peut s’interroger sur les raisons de ce refus. L’on se pose, également quelques questions parmi lesquelles, celle de savoir si la littérature de Sartre n’est pas qu’un simple prétexte à sa philosophie, ou sa philosophie un pur prétexte à sa littérature. Sa philosophie n’est-elle qu’un malheureux épiphénomène à sa littérature et n’est-il à ce moment-là qu’un littéraire chevronné ? Ce refus n’est-il qu’une confirmation de ce prétexte ou n’est-il qu’une adoption d’une position stratégique qui lui permettra de ne pas être trop tiré du côté des littéraires. La littérature de Sartre n’est-elle qu’un palimpseste et que sa philosophie n’est- elle, par voie de conséquence, qu’un simple sous-texte qui donne puissamment corps à ce palimpseste ? Sartre n’est-il qu’un éminent littéraire habillé en philosophe ? Ou encore, est-il possible pour lui d’être à la fois grand écrivain et grand philosophe ? Si sa philosophie n’est qu’un prétexte à l’ensemble de ses idées littéraires, faudrait-il dire que tous les textes littéraires de Sartre sont tous des palimpsestes ?
Le choix de ce sujet se justifie par l’étonnement devant l’amer constat de ce que Sartre serait pris pour l’un des plus grands philosophes du 20e siècle au regard du déséquilibre susmentionné, même s’il est vrai que la qualité et la profondeur ne sont pas nécessairement dans la quantité.
La démarche consiste à comparer, non seulement, la masse des œuvres littéraires à celle des productions philosophiques, mais aussi à confronter les différents titres (littéraires et philosophiques) et leurs contenus respectifs, afin de voir si la correspondance établie, à travers le monde de la pensée, se justifie.
1. Jean-Paul Sartre : du destin littéraire à la culture philosophique
Lorsqu’on se réfère, au matin de la pensée de Sartre et à son soir, les justifications de la thèse que la présente réflexion se propose de défendre se dégagent. Cette thèse part de l’hypothèse suivant laquelle, la pensée de Jean-Paul Sartre est dominée, dès la racine, et traversée par plusieurs intuitions littéraires et que le penseur est plus écrivain que philosophe. Il y a, en effet et le plus souvent, un rapport direct entre la pensée d’un penseur, spécifiquement d’un philosophe et sa vie ou l’univers dans lequel il a évolué. Pour ce qui est de Sartre, il suffit de comprendre ses objectifs principaux de départ et surtout, de voir le type d’ouvrages qu’il a très tôt et directement entre ses mains, pour comprendre qu’il fut modulé et malaxé dans le monde de l’imagination, c’est-à-dire celui de la création littéraire. Après s’être posé, dans Les mots, la question : « pourquoi suis-je devenu écrivain ? », Sartre finit lui-même par découvrir que sa vocation littéraire, elle-même, semblait aller de soi.
Hésitant à rejoindre le lycée La Rochelle, comme le voulait bien sa mère, Sartre, déçu au départ, finit par comprendre que cette séparation d’avec elle chute sur un bonheur, celui procuré par la beauté de ses premières lectures : les romans qui tracèrent d’ailleurs son itinéraire. « Pour ma part j’eusse préféré l’internat : les romans scolaires qu’on me permettait de lire m’avaient accoutumé à considérer la vie de pensionnaire comme une suite ininterrompue de joies diverses, surtout comme une vie libre et fantasque qui me changerait de mon existence méthodique et asservie » (J.-P. Sartre, 1990, p. 61).
Tout part, en effet, du point de départ, lui-même. Ce dernier commande et informe l’avenir. Le plus grand nombre de philosophes a été orienté par le premier pas ou par la toute première sollicitation de l’esprit. Heidegger qui rate la voie de la prêtrise à cause des multiples défaillances de son corps physique dues à la maladie, n’embrasse le début d’une carrière philosophique qu’à partir de son premier livre de philosophie qu’il reçoit des mains du père Konrad Gröber qui deviendra plus tard archevêque de Fribourg, est prêtre et ami du père de Martin Heidegger. C’est des mains de ce prêtre que le petit Martin reçut, en 1907, son premier livre de philosophie, une étude consacrée à la philosophie d’Aristote par Franz Brentano, Les diverses acceptions de l’être chez Aristote. Heidegger attribue d’ailleurs à ce livre un rôle éminent dans son évolution philosophique.
En effet, toutes les œuvres de jeunesse écrites par Sartre sont, d’un bout à l’autre, authentiquement, d’inspiration littéraire.
De Jésus la chouette à Er l’Arménien, textes dont on connaissait l’existence, mais que seuls les intimes avaient pu lire, six ans de la vie d’écriture de Sartre, de 1922 à 1927 (de dix-sept à vingt-deux ans), nous sont à présent livrés. Trois romans, une nouvelle, un essai mythologique, un carnet de pensées et de citations, des fragments disparates : il ressort de l’ensemble de ces écrits si divers un portrait de Sartre en candidat écrivain, décidé à s’essayer dans tous les registres d’écriture et avec des styles d’emprunt (M. Contat et M. Rybalka, in Jean-Paul Sartre, 1990, Quatrième de couverture).
Entre le Sartre littéraire et le Sartre philosophe, seul le premier le fit véritablement connaitre et est, non seulement le plus profond, mais aussi celui qui correspond le plus à son inspiration naturelle. Il pense plus facilement en écrivain qu’en philosophe. Son refus du prix Nobel de littérature ne fut qu’un rejet de soi-même et un pur paradoxe. C’est parce qu’il veut être pris plus pour un très grand philosophe que le penseur opte pour le refus du Prix littéraire. On sait que la bonne audience qu’il a pu avoir est celle que lui confèrent effectivement l’ensemble de ses œuvres littéraires. La philosophie, qu’on n’ait pas peur de le dire, n’existe presque qu’en sous-plan. Pour preuve, sa plus grande œuvre philosophique, L’Être et le Néant n’a connu que très peu de succès. Si tel est le cas pour son œuvre d’importance, que peut-on dire de ses œuvres philosophiques secondaires ? Il est fort probable qu’il soit conscient de la faiblesse de sa philosophie, comparativement à sa littérature. Voulant être plutôt tiré du côté de la philosophie, il est obligé de refuser ironiquement ce qu’il mérite. Il n’y a qu’à voir l’itinéraire que prend sa vie intellectuelle quand il quitte l’enseignement en 1945. En ce moment-là, il s’emploiera vraiment à l’écriture, précisément à son imagination créatrice qui l’enracine dans la littérature. Ce refus est, à vrai dire, surprenant, parce qu’il semble exprès. Ce qui domine en effet, en ce penseur, c’est son inventivité. Il est écrivain, faiblement philosophe. La preuve est qu’à travers ses pièces de théâtre (Huis-Clos, 1945 ; Morts sans sépulture, 1946 ; Les Mains sales, 1948), mais aussi ses romans (Les chemins de la liberté, 1945), ainsi que ses essais (Baudelaire, 1947 ; Qu’est-ce la littérature ? 1947 ; Réflexions sur la question juive, 1947), Jean-Paul Sartre acquiert une immense réputation mondiale et provoque parfois le scandale. Sa vie engagée, qui force souvent l’admiration, n’était pas fondée sur sa philosophie.
La création romancière est une forme supérieure de fabrique des idées et des images. L’activité philosophique, quant à elle, est une découverte d’idées et d’images qu’on exposera par les moyens que l’esprit nous donne. Si la littérature est, somme toute, scénique, la philosophie, elle, est forcément l’acte par lequel on assimile le réel qu’on finira par décrire par les procédés langagiers. Elle renvoie à la représentation de l’objet par l’esprit qui l’observe et le contemple et se rapporte à la mise en phrases, plus généralement en textes, de toutes les positions de notre âme face aux réalités extérieures qui nous environnent. Chez Sartre, seule la littérature a plus de place et plus de pouvoir en tant que procédé de montage de scènes. Le philosophe lui, ne monte pas les images, il les trouve dans son esprit en quête de savoir. Voilà le point sur lequel insistait Franz Brentano dans sa définition de la représentation qui résume presque toute l’activité philosophique.
Chez ce philosophe la représentation renvoie non pas seulement à l’objet représenté, mais aussi et surtout à l’acte par lequel on s’approprie cet objet. « Par représentation j’entends ici non pas ce qui est représenté mais l’acte de représenter » (F. Brentano, 2008, p. 92). On ne se représente pas l’objet extérieur à notre conscience de la même manière. En effet, Sartre n’affirme pas que sa philosophie est contenue dans ses romans et pièces de théâtre ou sa littérature mélangée à sa philosophie. Seules les multiples et diverses exégèses dues à sa postérité le disent. Si réellement la littérature de Sartre n’est qu’un prétexte à sa philosophie, comme on l’entend à travers le monde et l’histoire, pourquoi l’avoir titrée en romans et pièces de théâtre ? Est-ce un fait anodin pour lui de pratiquer autrement sa philosophie ? Telle est la question à laquelle le présent propos répond par la négative. Sa philosophie n’est aucunement faite par sa littérature. Il serait d’ailleurs le premier dans l’histoire de cette discipline. On peut commencer par la littérature et on finira par en sortir, si son destin intime est effectivement la philosophie, non pas y rester et parler en termes malheureux de prétexte ou encore de sous-texte. Telles sont les raisons qu’on trouve pour justifier en quelque sorte des échecs réels, mais qu’on voudrait coûte que coûte dissimuler.
N’est-il pas vrai que si l’on dit que la philosophie de ce penseur est faite par ses œuvres littéraires et que sa littérature est une philosophie qui se cache, on le dira de toutes les œuvres de très grands autres romanciers et essayistes. À ce moment-là, la philosophie serait quasiment rabaissée et dégradée au rang de simple pensée.
Pure stratégie, à notre avis, le refus sartrien du prix Nobel de littérature trahit la conscience de sa force et de ses talents dans ce domaine. Il y a deux types de génies qui se disputent la place en Sartre, cela a été déjà souligné : le pouvoir d’invention, source de sa grandeur littéraire incontestable et la disposition à la philosophie, résultat de ses multiples inspirations. S’il est établi qu’il est hautement difficile d’être les deux, écrivain et philosophe, Sartre a néanmoins plus de penchants pour un champ unique, sans le dire volontairement et clairement. Est-il proprement une énigme ? Non. La nature l’a doté des mots qui ont fait de lui un producteur de bons textes littéraires. Mais, nous pensons qu’il ne serait pas heureux d’être pris pour un littéraire et peut-être même, pour un des plus grands. Son bonheur serait d’être pris pour le plus grand philosophe de tous les temps. Malheureusement, la nature domine en lui et on ne réussit jamais véritablement à la modifier complètement et suivant nos préférences.
On s’est beaucoup interrogé, à l’époque, sur les raisons qui l’emmenèrent à refuser le prix Nobel et les quelques vingt-cinq millions d’anciens francs qui accompagnaient cette distinction suprême. Pendant 48 heures, Sartre fut traqué dans Paris par des nuées de journalistes qui allaient jusqu’à ouvrir en marche la porte des taxis où il se refugiait, pour tenter d’obtenir de lui une réponse décisive. J’avais alors fait le compte et je crois bien me rappeler qu’ils parvinrent à obtenir de lui une quinzaine de réponses de cet ordre, toutes aussi suspectes les unes que les autres. Car la seule réponse véritable ne fut retenue par personne (et sans doute était-elle en effet trop simple pour pouvoir être entendue) : c’est qu’il ne pouvait supporter cette « consécration » (F. Jeanson, 1974, p. 222).
Il ne pouvait pas supporter ce prix qui est pourtant de l’ordre de ses compétences naturelles, compétences qui ne ressortissent pas à sa volonté. Il souhaiterait être plutôt couronné en philosophie où, pourtant, il connut, malheureusement, des échecs de plusieurs types, à côté d’un tout petit nombre de réussites, à l’instar de sa conférence sur l’existentialisme.
Le propos suivant lequel Sartre est un littéraire de haut niveau et n’est que faiblement philosophe, est d’ailleurs connu, avoué et justifié par lui-même, consciemment ou non. L’envie de donner un sens à sa vie pousse ce penseur à écrire. Il le fait le plus aisément possible. La philosophie n’occupe qu’une place secondaire chez lui, comparée à sa littérature. C’est d’ailleurs parce qu’il a écrit autant d’œuvres de ce ressort qu’il a versé dans les actions telles que les luttes syndicales, ce qui naturellement est ostensiblement impropre à la philosophie ou presque. Pour toutes ces raisons, la philosophie, chez lui, n’est qu’un sous-texte.
S’il est évident que l’homme n’a pour forme que celle de son milieu de vie immédiat, il est à peu près logique de dire de Sartre qu’il n’est que littéraire, puisqu’il n’a grandi, suivant ses propres mots, que dans un environnement favorable à l’écriture. Si Hegel disait que la philosophie est fille de son temps et si le temps de Sartre n’est pas plus philosophique que littéraire, cela revient à dire que ce temps, aussi paradoxal que cela puisse paraitre, n’est pas philosophique. On ne peut, ni cacher son talent, ni l’étouffer par crainte d’être pris pour ce qu’on ne veut pas. Il voudrait bien être philosophe de nature, mais n’a pas eu la chance de l’être. Sa nature est plutôt un terreau propice à la littérature. Celle-ci s’exprime beaucoup plus facilement que sa philosophie qui n’est que son habit extérieur.
En écrivant cette biographie, je ne m’intéresse pas seulement à la signification particulière d’une vie. Je veux retracer l’évolution assez curieuse d’une génération. Je suis né en 1905 dans un milieu de petits-bourgeois intellectuels. J’ai grandi dans un âge dont les maîtres à penser étaient, après tout, Gide et Proust : un âge, en vérité, de subjectivisme et d’esthétisme… (Sartre cité par F. Jeanson, 1974, p. 23-24).
Disons donc que Sartre est littérairement fort et que cette force domine efficacement l’ensemble de sa vie intellectuelle. Cette dernière porte néanmoins les germes d’une philosophie. Il écrit, avec facilité, ses œuvres littéraires, en se servant du jargon philosophique.
2. La langue philosophique au cœur de la pensée littéraire de Sartre
La complexité de la pensée de Sartre, tant célébrée à travers le monde, est proprement liée aux difficultés rencontrées quand il s’agit de séparer en elle le côté littéraire et sa dimension philosophique spécifique. La littérature de Sartre est malaxée dans sa philosophie ou celle-ci complètement diluée dans celle-là. S’il est vrai que ces deux grandeurs sommeillent bel et bien en cet auteur, il y a néanmoins une qui domine son esprit ou tire celui-ci vers elle. Sartre est écrivain et philosophe, l’histoire l’a reconnu, mais il est plus, soit l’un, soit l’autre. Le point de vue défendu ici est qu’il est plus littéraire. La philosophie, dans cette perspective, est plus un simple moyen d’expression. Si la philosophie est une langue, cette langue est celle qu’il utilise dans l’écriture de ses multiples œuvres littéraires qui, d’ailleurs, datent de sa lointaine et arrière jeunesse. Aussi, si la philosophie est, au fond, la description de toutes les positions de l’esprit face au réel, l’on n’est-il pas en droit de dire que Sartre prête ses positions aux personnages de ses romans et pièces de théâtre ? Cela fait de sa haute et grande littérature, une philosophie à part entière. La pensée de cet auteur n’est qu’une littérature habillée de philosophie.
Pour s’en rendre effectivement compte, il suffit de voir comment dans La Nausée, Roquentin, le héros de ce récit, manipule avec aisance et facilité cette langue de couleur philosophique. Il procède à la présentation de son propre rapport au réel, par la seule et unique observation. Dans cette description, il lie le côté abstrait des choses à leur existence. L’ensemble des écrits de Sartre est une belle littérature qui fait du corpus philosophique ses éléments de langage. L’observation, l’abstraction et le concret, leur interprétation y compris, sont purement et simplement une conceptualité philosophique.
Donc j’étais tout à l’heure au Jardin public. La racine du marronnier s’enfonçait dans la terre, juste au-dessus de mon banc. Je ne me rappelais plus que c’était une racine. Les mots s’étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d’emploi, les faibles repères que les hommes ont tracé à leur surface. J’étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j’ai eu cette illumination (J.-P. Sartre, 1938, p. 181).
La corrélation établie par Sartre, entre les mots et les choses qui sont leur représentation est la manière philosophique d’exprimer les idées. Le récit est exposé par la philosophie dans ce texte. Lorsque le personnage de Sartre, Roquentin, parle du rapport entre le signifiant et le signifié, quand il se réfère au mot et à son sens, la langue qu’il emploie dans son discours appartient au jargon philosophique. On est philosophe par les idées qu’on énonce et que l’on défend avec fermeté et non pas uniquement par la langue qu’on utilise. Si les récits de Sartre se servent du corpus philosophique, l’on n’est pas obligé, pour cette raison, de prendre ces textes, pourtant véritablement littéraires, pour de la haute philosophie. De toutes les façons, le fait pour ce penseur de titrer et de classer ses œuvres dans le registre littéraire ne relève pas du hasard. Il est totalement incompréhensible que ce soit plutôt les lecteurs qui en fassent de la philosophie tout en disant que sa littérature n’est qu’un phénomène. Le phénomène est une chose dans son apparence et une autre dans sa réalité.
Pour un certain lectorat, la littérature de Sartre ne serait donc qu’un simple prétexte à l’expression de ses idées philosophiques. C’est ce qu’il y a de gênant et que le présent propos rejette dans l’exégèse de la pensée de cet auteur. S’il est impossible de certifier qu’il a caché volontairement sa philosophie dans sa littérature, il est également impossible de dire que cette littérature est un prétexte à sa philosophie. Conscients du fait que la production philosophique de Sartre est faible, ses épigones qui veulent le voir avec l’unique posture de grand philosophe, forcent un tout petit peu les choses en affirmant avec véhémence que les œuvres littéraires de ce penseur sont porteuses de philosophie, comme si lui-même n’avait pas les moyens et l’envie de le dire. Un philosophe n’a pas besoin de dire qu’il est philosophe. Les écrits le factualisent.
Si d’après les interprètes de Sartre, ce dernier est philosophe, non seulement à travers son petit nombre d’œuvres philosophiques, mais aussi et surtout grâce à ses œuvres littéraires qui sont le pivot principal de cette philosophie, cela reviendrait à dire que ce penseur ne voulait pas qu’il soit reconnu et exposé en tant que tel. Pourquoi alors cacher sa philosophie dans ses œuvres d’écrivain ? La difficulté est que Sartre lui-même ne l’a jamais dit. Il n’a jamais affirmé que sa philosophie est contenue dans sa littérature ou que sa littérature n’est pas à proprement parler une littérature, mais au contraire une philosophie. Soutenir que sa littérature est une forme supérieure de philosophie, c’est ipso facto défendre l’idée selon laquelle, cet esprit s’est littéralement trompé, quant à classer ses propres œuvres. On ne peut croire en une pareille chose. Tel est le paradoxe. Cette thèse est celle de ses épigones. Il est clair que Sartre est plus un grand écrivain qu’un grand philosophe.
La langue littéraire, dans laquelle il écrit, ressortit bel et bien à la philosophie ; on ne cessera pas de le dire et le défendre. Quand il parle, toujours dans La Nausée, de la description des choses par l’activité du regard, ou lorsqu’il décrit l’existence en termes de vide, il use du lexique de la philosophie.
Ça m’a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n’avais pressenti ce que voulait dire « exister ». J’étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux « la mer est verte ; ce point blanc, là-haut, c’est une mouette », mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une « mouette-existante » ; à l’ordinaire l’existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous, elle est nous, on ne peut pas dire deux mots sans parler d’elle et, finalement, on ne la touche pas(J.-P. Sartre, 1938, p. 181).
Observant rien que les titres de ses œuvres, on fait le constat que les mots utilisés par l’auteur sont philosophiques. À regarder de plus près son roman intitulé Les chemins de la pensée, on ne peut remettre en cause l’idée selon laquelle Sartre est un grand littéraire qui parle la langue du grand philosophe. Ses mots et ses concepts, énoncés tel qu’il le fait, ne sont rien que l’appareillage de la philosophie. La plupart du temps, on ne retrouve pas dans les titres des œuvres, à proprement parler littéraires, des concepts (armes du philosophe), mais plutôt des mots qui ne sont que des représentations. Or des titres comme Les chemins de la liberté, son premier tome L’Age de la raison, ou encore son troisième tome La mort dans l’âme, ne sont constitués que de concepts philosophiques. Ils sont donc tous des titres d’expression philosophique. En philosophie, si on trouve un tel titre La mort dans l’âme, on aura la forte chance de voir à l’intérieur un discours représentant ce que la mort et l’âme ont pour noms. Ce qui conforte efficacement la thèse soutenue ici est qu’à l’intérieur, on rencontre effectivement un roman, pas une représentation de la mort et de l’âme qui serait, elle, fortement philosophique. Cet ouvrage est donc un roman écrit dans la langue philosophique.
3. La littérature chez Sartre entre prétexte philosophique et palimpseste
Quand la philosophie sommeille et s’exprime en un esprit, elle se montre rigoureusement et ne peut aucunement se mélanger à plusieurs autres grandeurs. Un philosophe l’est, le plus souvent, de manière authentique, c’est-à-dire sans être corrompu ou amoindri en quelque sorte, par le poids du talent d’un autre genre. Cela n’empêche, qu’il soit possible, pour un philosophe, de commencer son existence dans un monde étranger à son domaine de prédilection. Le début peut, il est vrai, être défini par un mélange de forces, mais dès que le véritable être prend corps, il s’enracine et se fixe efficacement et de façon pérenne.
Or, en ce qui concerne Sartre, sa carrière intellectuelle est effectivement partagée entre plusieurs champs et de façon réelle. Un philosophe peut être pris par erreur pour un littéraire, parfois pour n’avoir pas été compris. Tel est le cas de l’énigmatique philosophe Nietzsche. Il y a eu dans l’histoire de la philosophie un débat similaire à propos de Nietzsche, celui de savoir s’il est philosophe ou littéraire. C’est l’exégèse de Heidegger qui produira le Nietzsche véritablement philosophe.
L’interprétation de Heidegger est indépassable pour nous aujourd’hui encore. Pourquoi ? Demandez-vous ? Parce qu’il est le seul, qu’on le veuille ou non, qu’on l’estime ou non pour cette lecture, à avoir construit un « système de Nietzsche », et à l’avoir ainsi tiré définitivement des lectures littéraires, comme celle de Gide en France, ou de Musil en Allemagne qui auraient été incapables de dégager fortement ou de seulement pressentir sa stature de philosophe (M. Haar, 2000, p. 275).
Pourtant Sartre, on le voit bien, est écrivain de haute facture. S’interrogeant ainsi, la présente réflexion voudrait faire savoir qu’il n’est pas possible (aucun fait historique ne l’a montré en effet) d’être grand littéraire (comme Sartre) et éminent philosophe en même temps, sauf si on est mésinterprété par ses pairs et son lectorat.
Un discours ne peut être, tel l’affirme Sartre, à la fois philosophique et littéraire. Chacune de ces deux disciplines a non seulement son jargon spécifique, mais aussi et surtout son lexique et sa syntaxe propres. S’il a à se justifier, lui-même, sur sa position de littéraire ou de philosophe, on peut subodorer qu’il y a un problème réel dans son esprit. Il doit se reprocher, secrètement, quelque chose qu’il ne voudrait pas dévoiler au grand jour.
Suis-je philosophe ? ou suis-je littéraire ? Je pense que ce que j’ai apporté depuis mes premières œuvres, c’est une réalité qui soit les deux : tout ce que j’ai écrit est à la fois philosophie et littérature, non pas juxtaposées, mais chaque élément donné est à la fois littéraire et philosophique, aussi bien dans les romans que dans la critique (J.-P. Sartre, cité par Y. Ansel, 1982, p. 31)
Par le simple fait que son œuvre est éparse, il n’est pas possible de soutenir qu’il est grand philosophe, qu’il n’est que philosophe et que sa littérature n’est qu’un prétexte. Le contraire est pensable et serait logiquement compréhensible : le contraire établirait et considèrerait que sa philosophie est un prétexte, c’est-à-dire un simple texte d’essai ou plutôt d’entrainement à sa grande et riche littérature.
Totalité ouverte et inachevée, l’œuvre de Sartre ménage de constants échanges, de perpétuels passages entre le théâtre, la philosophie, le roman, l’essai littéraire ou l’article polémique, et il serait vain de lire aujourd’hui La Nausée en feignant d’ignorer que « contingence » et « liberté » – ces deux idées essentielles dans le roman (…) – sont deux « idées racines » de Sartre, deux idées qui ont été dans toute sa vie et dans son œuvre (Y. Ansel, 1982, p. 31).
Cette thèse défendue dans cette contribution, se fonde aussi sur le fait que les premiers romans de Sartre n’ont pas le sens ou la saveur des exposés abstraits, théoriques et didactiques des thèses philosophiques héritées des Anciens. La Nausée, roman de grande importance et à travers lequel il se fit un nom, plutôt un nom philosophique, n’a été, au fond, qu’un simple récit qui ne s’est entouré que d’un certain nombre de personnages, des histoires, et des événements imagés, aucune différence avec toute autre production littéraire de toutes les façons. Tout tourne autour de la narration de Roquentin, son personnage principal.
Par ailleurs, Sartre est plus un « homme public », donc un non-philosophe. Depuis les présocratiques, la philosophie est ce que le silence, le retrait et la discrétion ont pour noms. Faire de la philosophie dite populaire, celle qui a lieu dans les très grands espaces, ce n’est pas tellement pratiquer la philosophie en tant qu’héritage des Grecs. Tout le contraire de ce que dit F. Jeanson (1974, p. 89) :
Sartre en effet, n’est pas seulement un « homme public » (comme le deviennent, bon gré mal gré, tous ceux qui expriment publiquement leurs propres convictions sur les problèmes de la Cité) : c’est un philosophe, c’est un écrivain, et il a délibérément entrepris de SE publier, -c’est-à-dire de se mettre totalement en question, de s’engager « corps et âme » dans chacune des manifestations de sa pensée comme chacun de ses actes.
Le plus grand nombre des apparitions de Sartre sont simplement opposées à celles auxquelles l’on est habituées dans le monde de la philosophie. Depuis l’Antiquité, la philosophie et la plus grande, est le plus souvent secrète et sacrée. Qu’on se réfère, pour s’en rendre compte, aux différentes formes que revêtaient les apprentissages et les enseignements dans la plupart des écoles philosophiques de la Grèce ancienne. Or Sartre est l’homme public. Il est non seulement dans le théâtre, mais aussi et surtout l’homme qui tente de bousculer le monde politique par ses actions.
En philosophie, quand on a trop de visibilité, on n’est plus trop visible du tout. Pour preuve, même aujourd’hui, ceux qui font la philosophie politique, c’est-à-dire la philosophie dite populaire, bénéficient de plus de visibilité et ont plus de place dans la société que ceux qui pratiquent la philosophie sous le modèle antique. On peut alors tirer la conclusion suivant laquelle Sartre a eu cette célébrité en dehors de la philosophie ou presque. Le roman et le théâtre ont fait de lui ce qu’il a été.
La philosophie chez cet auteur n’est qu’un sous-texte, un écrit secondaire qui n’apparait qu’en filigrane. Si l’on voit bien les choses, on est poussé à dire qu’il ne se sert pas de la littérature pour exprimer ses idées philosophiques. Celles-ci ne sont simplement que la conséquence de la force d’écriture littéraire dont il est doté.
Certes, il projette toujours, en 1935, de faire son salut en écrivant ; mais il travaille à la version définitive de « Melancholia » (La Nausée), où il désigne avec force l’« absurde » fait de la « contingence », qui ne cesse de ressaisir « par-derrière » l’exigence absolue de donner sens à la vie. Et c’est en philosophe qu’il conçoit ce roman : son propos n’a rien de commun avec l’esthétisme de « l’art pour l’art », il ne se soucie pas d’écrire pour le plaisir d’écrire… (F. Jeanson, 1974, p. 91-92).
Ce littéraire qui s’appelle Sartre écrit bien et cette belle écriture produit une autre image de l’homme, image qui fait de lui plus un philosophe. Il n’est pas dit qu’il n’est pas philosophe, mais qu’il est plus littéraire que philosophe. Sa philosophie n’est que le sous-texte qu’on trouve sous tous ses textes littéraires et sa littérature un très grand palimpseste. Rien ne justifie que sa littérature est un prétexte. Il s’agit plutôt d’un texte authentique produit par son inspiration originelle. Au contraire, sa philosophie n’est purement et simplement qu’un épiphénomène s’il est établi qu’un épiphénomène est un phénomène qui s’ajoute à un autre sans manifestement l’influencer. Trouve-t-on dans l’histoire de la philosophie un philosophe de grande figure qui fut en même temps un éminent écrivain ? Si cela est vrai, Sartre serait donc un exemple unique en son genre. En effet, on n’en trouve pas, sinon un petit nombre.
Il suffit de prendre réellement connaissance de l’œuvre du penseur Sartre pour s’apercevoir vite que celle-ci se répartit harmonieusement en deux types de productions : la production littéraire proprement dite et l’angle malheureux des œuvres dites philosophiques. La première impression qui vient à l’esprit et sans une quelconque justification, est que cet auteur a plus produit des œuvres littéraires que philosophiques. Cette remarque a son importance et il faudrait le signaler dès le début. Les petits faits sont le plus souvent révélateurs. Si l’on part du principe suivant lequel, ce qui se conçoit facilement et clairement, s’énonce aussi avec exactitude et aisance, on peut s’opposer à l’idée à laquelle tout le monde est habituée, à savoir celle qui fait de la littérature de Sartre un simple prétexte à sa philosophie. Ce qui est au fond très clair, dans l’esprit de ce penseur est le pouvoir et la finesse de son imagination créatrice bien entendu, celle-là qui l’aide à partir du roman au théâtre en passant par des nouvelles. Sa grandeur philosophique, si grandeur il y a, est le témoin oculaire de sa capacité d’invention littéraire. Ce que cette contribution entend montrer est que, face à sa pensée littéraire, sa philosophie n’existe qu’en sous-plan, contrairement aux exégèses dont sont auteurs ses multiples lecteurs. Sartre écrit ses œuvres littéraires en se servant du jargon de la philosophie, ce qui rend son écriture plus aimable et qui fait prendre toutes ses intuitions ou presque pour des philosophies. Sinon, comment comprendre que Sartre est un grand philosophe et non un très grand écrivain après avoir publié un très grand nombre de livres d’écrivain et peu de livres philosophiques qui ne connurent, à bien voir les choses, aucun succès réel. S’il avait dit quelque part de lui-même, que ses ouvrages d’écrivains n’étaient que des coquilles à l’intérieur desquelles on trouve la philosophie, on aurait pu comprendre. Si cela n’est fortement soutenu que par ses disciples et lecteurs, cela laisse perdurer un doute raisonnable.
Si l’on se réfère aux exigences de la philosophie depuis l’Antiquité jusqu’au temps de Sartre, on peut se poser une question : est-ce possible d’être grand littéraire et éminent philosophe ? Sinon nombreux l’auront été, à commencer par Platon et Aristote, principales sources dans lesquelles la question de l’être elle-même, qu’affectionne d’ailleurs Sartre, a baigné. Suivant ces exigences, il est soit littéraire, soit philosophe, pas les deux parce que ce n’est pas possible d’être les deux et au même niveau. On ne va pas quand même dire qu’il est et demeure le plus grand philosophe de tous les temps pour l’avoir été. Cette position adoptée dans le présent propos lutte contre l’idée selon laquelle la littérature de Sartre est un prétexte. Le problème réel est que lui-même ne parle nullement de prétexte. Il a écrit son œuvre et c’est aux interprètes de dire si en lui le philosophe domine ou pas. S’il a écrit plus de livres littéraires et qu’il est plus pris pour philosophe par la postérité, c’est qu’effectivement il y a problème. Sauf si l’on soutient que ses œuvres ont été mal titrées par lui-même et qu’il a voulu tromper ses lecteurs sur leurs contenus.
L’Être et le Néant, œuvre philosophique de base de Sartre, n’est qu’une œuvre stimulée, non une intuition. Toute vraie philosophie est le produit d’une intuition qui n’est qu’une connaissance de l’objet qui ne passe pas par des détours. L’intuition est proprement un savoir unique parce que sans intermédiaire. Dans le même registre, une œuvre philosophique originale ne peut pas être stimulée par une quelconque cause, quelle qu’elle soit. Or, si l’on s’interroge sur la fondation en raison du plus grand livre de Sartre, à savoir L’Être et le Néant, il est possible de subodorer un problème, ou plutôt une inquiétude. On a l’impression que cette grande œuvre, peut-être même l’unique ouvrage philosophique d’importance, n’a pris vie et corps que pour la raison suivante : son auteur, ayant fait un tour en Allemagne, après la moquerie de son ami Raymond Aron, prit la ferme décision et la résolution de rétablir l’équilibre ou tenter de le rétablir, en pensant ce qui ressortit à la science dominante, c’est-à-dire la phénoménologie. Raymond Aron qui réussit à l’agrégation avant son ami Jean-Paul Sartre fut aussi le premier des deux à faire le voyage qu’on pourrait qualifier d’historique en Allemagne. De son retour, il souhaita que Sartre réactualise sa philosophie par la connaissance de la nouvelle science, la phénoménologie. C’est à partir de cette incitation que celui-ci prit, lui aussi, la décision d’aller au pays de la phénoménologie, rencontrer Heidegger. Curieusement, c’est immédiatement après ce premier voyage que Sartre produisit L’Être et le Néant. En effet, à son retour d’Allemagne, Sartre change mutatis mutandis l’orientation de sa philosophie avec l’heureux mariage avec la phénoménologie et à l’occasion de ce même retour, il écrira L’Être et le Néant. Que ce serait passé s’il n’était pas allé au pays de la phénoménologie sous l’incitation ou peut-être même cette moquerie due à Raymond Aron ? Quelque chose a changé assurément dans son esprit, après sa rencontre avec Heidegger. Est-ce le simple souci de se conformer à l’actualité philosophique en tant que tel, ou a-t-il simplement été fasciné par cette nouvelle philosophie, cette science nouvelle ?
C’est Husserl qui qualifia la phénoménologie de science nouvelle dès l’énoncé inaugural de son traité. « La Phénoménologie pure à laquelle nous voulons ici préparer l’accès, en caractérisant sa situation exceptionnelle par rapport aux autres sciences, et dont nous voulons établir qu’elle est la science fondamentale de la philosophie, est une science essentiellement nouvelle » (E. Husserl, 1989, p. 3). Toutes ces raisons sont avancées pour dire que Sartre écrit plus naturellement et plus simplement ses romans et pièces de théâtre que les œuvres originellement philosophiques. Sa plume est plus littéraire que philosophique. Ce qui conforte encore et davantage l’hypothèse de départ, c’est l’essence générale de ses écrits de jeunesse qui sont presque tous de saveur littéraire. Il y a eu dans l’histoire des philosophes qui ne le sont pas devenus simplement, mais qui l’ont été dès leur jeune âge. Schelling publie un essai philosophique à l’âge de 18 ans, étant étudiant. Les plus grands philosophes sont restés philosophes toute leur vie. Il faudrait même prendre le risque d’ajouter que le cas de Sartre, possible mélange de littérature et de philosophie est très rare. Depuis Platon, la philosophie ne s’associe pas à d’autres types de création, surtout pas au théâtre. Celui-ci jeta au feu sa comédie au soir de sa rencontre avec Socrate, le philosophe.
Conclusion
Ce que l’on a voulu montrer, en travaillant sur le double Sartre, littéraire et philosophe, ce n’est ni sa grandeur littéraire avérée, ni l’aveu sur son éminence philosophique. L’intention était de se poser la question de savoir qu’est-ce qui en ce penseur domine réellement, entre la littérature et la philosophie. Au soir de l’enquête gnoséologique, l’on a compris que l’auteur est plus littéraire que philosophe, contrairement à l’opinion la plus répandue. S’il est vrai qu’il commence proprement son activité intellectuelle par la philosophie, à travers la publication de L’imagination (sa première publication philosophique) et que sa plus grande œuvre philosophique, L’Être et le Néant (1943) n’a connu que très peu de succès, l’on ne se trompe pas en soutenant que la philosophie n’a que peu de place dans l’univers cognitif de ce grand penseur et n’est pas sa plus profonde source d’inspiration. On ne peut pas trop douter du fait qu’il ne s’est fait connaître que par le biais de ses écrits littéraires. Comment soutenir alors qu’il est plus philosophe que littéraire ? Seuls ceux qui veulent le voir philosophe, affaiblissent dans leur propre pensée, la puissance de sa littérature, en la prenant pour un simple prétexte à l’activité philosophique qui serait d’après eux, son activité de base. L’inverse seul est vrai car le nombre important de ses œuvres littéraires et la merveilleuse langue philosophique qu’on y trouve font de sa philosophie un malheureux sous-texte qui ne modifie en rien et ne fait aucunement écran à cette activité littéraire grandiose.S’il a commencé par la philosophie et a échoué par la philosophie, il n’a fait que réussir, tout au long de sa carrière avec ses œuvres littéraires. Les Mouches par exemple connaissent un grand retentissement et Sartre va s’ériger en écrivain célèbre.
Personnellement, nous soupçonnons qu’il quitte l’enseignement pour cette raison qui ne peut qu’être inavouée : échec philosophique. Il se consacre plus facilement à l’écriture de ses romans et pièces de théâtre qu’à la production d’œuvres philosophiques. C’est normal que sa célébrité soit acquise par la seule voie de la littérature. Pourtant, on sent en lui la ferme volonté de n’être qu’un philosophe de grand nom. Mais, la nature a, en réalité, décidé autrement. Disposé à l’écriture littéraire, Sartre est plus écrivain que philosophe.
Références bibliographiques
ANSEL Yves, 1982, La Nausée de Jean-Paul Sartre, Paris, Éditions Pédagogie Moderne.
BRENTANO Franz, 2008, Psychologie du point de vue empirique, Trad. fr. Jean François Courtine, Paris, Vrin.
HAAR Michel, « La lecture heideggérienne de Nietzsche », in L’Herne Nietzsche, Paris, 2000, p. 263-276.
HUSSERL Edmond, 1989, Idées directrices pour une phénoménologie, tr.fr. Paul Ricœur, Paris, Gallimard.
JEANSON Francis, 1974, Sartre dans sa vie, Paris, Seuil.
SARTRE Jean-Paul, 1990, Écrits de jeunesse, Paris, Gallimard.
SARTRE Jean-Paul, 1938, La Nausée, coll. Folio, Paris, Gallimard.
SARTRE Jean-Paul, 1949, Les chemins de la liberté, tome 3, La mort dans l’âme, Paris, Gallimard.
LANGAGE FICTIONNEL ET DISPOSITIF CONCEPTUEL CHEZ JOHN SEARLE
Ghislain Thierry MAGUESSA ÉBOMÉ
Université Marien Ngouabi (Congo)
Résumé :
La présente réflexion se propose d’analyser la transition à partir de la fiction comme thème reçu de la philosophie de la connaissance. Qui plus est, nous analysons le motif qui préside au choix de notre réflexion, en développant les diverses versions et les multiples visions que l’homme de science peut avoir sur le langage et la réalité autour de la fiction. Cela conduit effectivement à mettre en cause les positions qui tendent à considérer la fiction comme une simple apparence du réel. À la lumière d’une « re-conception » de sa signification philosophique qui se déchiffre au-delà des réductionnismes gnoséologiques, méthodologiques et logiques qui y sont attachés, nous avons choisi de mettre en perspective le concept problématique et controversé de la fiction comme le foyer procédural de la nouvelle philosophie du langage. L’idée directrice de notre travail est la corrélation du langage et de la fiction dans la mise en route inédite du modèle de la découverte du paradigme du langage fictionnel.
Mots-clés : Complexité,Fictionnel, Langage, Métaphore, Monde, Réalisme, Réalité.
Abstract :
This reflection proposes to analyze the transition from fiction as a theme received from the philosophy of knowledge. What’s more, we analyze the reason which presides over the choice of our reflection, by developing the various versions and the multiple visions that the man of science car have on the language and the reality around the fiction. This effectively leads to questioning the positions that tend to consider fiction as a simple appearance of a « re-conception » of its philosophical meaning that can be deciphered beyond the gnosological, methodological and logical reductionisms attached to it, we have chosen to put into perspective the problematic and controversial concept of fiction as the procedural focus of the new philosophy of language. The guiding idea of our work is the correlation of language and fiction in the unprecedented setting in motion of the paradigm discovery model fictional language.
Keywords : Complexity, Fictional, Language, Metaphor, World, Realism, Reality.
Introduction
Le débat d’idées sur la fiction est, en général, traversé par des controverses touchant à la définition du réel. Ce débat dont l’enjeu est la remise en question de l’approche classique du langage en vue de proposer une réflexion philosophique sur le statut logique de la fiction intéresse les travaux de Searle. En effet, Searle se propose d’élucider le sens et la signification de langage fictionnel, considéré comme une forme particulière du niveau de réalité, analogue à la complexité ontologique des faits, inaugurant, par conséquent une nouvelle manière de réfléchir sur la dialogique du fictionnel et du réel. Cette nouvelle manière promeut le nouvel esprit scientifique qui, du point de vue philosophique et logique, reprend la problématique du sens et la signification des concepts usités pour rendre compte de la réalité.
Voulant à travers cette nouvelle approche répondre à la problématique de la signification, Searle, sans dévoyer ou déroger aux discussions classiques, propose un nouveau foyer procédural à partir duquel peut se construire la nouvelle philosophie du langage. Ainsi, sans épuiser les questionnements que suscite ce nouveau tournant de la philosophie du langage, le problème précis de cet article est celui de construire un moment de réflexion sur le concept clé de fiction. L’objectif ici étant à la fois, (i) pédagogique, au sens où cet article s’organise autour des questionnements menés lors de notre séminaire de « Sémantique et pragmatique du discours philosophique » à l’intention des étudiants de Master 1 de philosophie à la Faculté des Lettres, arts et sciences humaines de l’université Marien Ngouabi, (ii) épistémologique, puisqu’à notre sens, cet article reprend sous la forme propédeutique les préoccupations de notre ouvrage (G. T. Maguessa Ébomé et C. G. Biandouono, 2023) qui ouvre une réflexion sur le pragmatisme de Searle à partir du concept d’intentionnalité.
Ainsi, cette enquête conceptuelle conduit à nous interroger sur l’esquisse philosophique de la transition vers les niveaux de réalité. Notre propos tend à interroger comment J. Searle aborde la question de la relation entre le langage et le monde de la fiction, c’est-à-dire le fait de passer d’un niveau de langage de la réalité empirique à la réalité fictionnelle. Explicitement, notre problématique s’articule autour des interrogations suivantes : peut-on articuler le langage fictionnel et le dispositif conceptuel chez John Searle ? Comment penser la problématique du langage fictionnel au cœur de la philosophie de John Searle ? Dans quelle mesure langage fictionnel permet-il une dynamique de l’esprit humain donnant lieu à l’art d’inventer, de découvrir et d’imaginer ? C’est à partir de cet ensemble de questions que notre essai prendra du sens en suivant trois mouvements. Le premier mouvement consiste à montrer comment la problématique de la fiction participe à l’émergence de la philosophie contemporaine du langage. Le deuxième mouvement vise à comprendre la place du langage fictionnel dans le dispositif conceptuel de Searle. Le troisième moment est une perspective critique qui montre que le langage fictionnel déploie la dynamique de l’esprit humain. Nous avons choisi d’appliquer la méthodologie analytique en vue d’analyser de façon structurale la thématique de la fiction au cœur de la pensée de Searle. Les différents moments seront analysés de manière graduelle en allant du simple au complexe en vue d’aboutir à l’idée que l’approche searlienne de la fiction est dynamique.
1. La problématique de la fiction dans l’élaboration de la philosophie contemporaine du langage
La fiction enrichit l’imaginaire social, l’imagination scientifique et altère les jugements classiques ainsi que les expériences empiriques sur la connaissance des faits. Des philosophes contemporains ont posé en termes explicites le problème du langage fictionnel. L’étude de cette notion la rattache à la problématique de la transition philosophique en cours, qui nous fournit de nouveaux cadres de pensée et de systématisation de la connaissance du réel.
Qu’on y croit ou pas, la transition de la réalité visible vers la réalité fictionnelle est une certaine manière d’étudier la dynamique de l’esprit humain dans l’art d’inventer, de découvrir ou d’imaginer. Cette étude dessine les voies d’accès au nouveau monde pour rendre explicite ce processus de transition et réévaluer la fiction en tant que nouvel univers de sens, articulant, entre autres, imagination, métaphore, prédiction.
Chaque niveau de la réalité a un sens et peut donner lieu à une interprétation, puisque la totalité ne se montre pas qu’empiriquement. Elle se montre partiellement dans la médiation effectuable du système complexe, mais toujours ouvert, des connexions et des transformations que la complexité rend intelligible et permet de penser. Penser la fiction, c’est critiquer les imperfections du réalisme scientifique pur en insistant sur la portée épistémologique de la transition dite philosophique, évolutionnaire et révolutionnaire, de la philosophie du langage. Dans ce jeu, Searle (1998, p. 121) s’attache à la métaphore et à la fiction, « à la fois en raison de leur intérêt intrinsèque et parce qu’il (…) semble qu’on ne peut pas répondre aux autres questions tant que cette question fondamentale n’aura pas reçu de réponse ».
Ce moment de la complexité du réel consiste à penser la portée heuristique de la fiction, à partir des « fictions utiles » dont la densité et l’intensité théorique ont été justifiées par la philosophie de la logique. Dans le fond, il s’agit de l’idée d’une séparation ontologique et méthodologique de principe entre le réel et le fictionnel. En tant que produit des philosophies de l’analyse par lesquelles la tradition analytique s’est illustrée, la fiction n’a pas toujours été portée à la réflexion, certains philosophes du langage, à l’instar de de Wittgenstein, ayant préféré réduire ce type d’entité au silence.
Pourtant, dans sa réitération philosophique, le combat pour le dévoilement du réel ne vise nullement à détruire l’activité de philosopher sur la fiction. Ainsi, Searle (1998, p. 115) se pose quelques questions : « quel est le critère de ce qui relève et ce qui ne relève pas de la fiction ? », ou encore y’a-t-il une différence de nature ou de degré entre une énonciation de fiction et une énonciation de réalité ? Comment peut-on passer d’une catégorie d’énoncés d’observation à l’autre ?
La prise en considération d’un de ces niveaux de réalité conduit à un réexamen de l’un des dogmes fondamentaux du réalisme scientifique : la disjonction exhaustive entre le réel et la fiction. L’intervention du concept de fiction est constante chez J. Searle (1982, p. 101-119). C’est du côté de la théorie des relations « entre le sens des mots et des phrases que nous énonçons et les actes illocutoires » qu’il faut regarder pour voir si la transition philosophique, à la lumière de la fiction, peut faire sens, et permettre de scruter la signification et la valeur du « statut logique du discours de la fiction » (Searle, 1998, p. 101).
Searle oriente sa réflexion, non pas vers un traitement littéraire de la fiction, mais vers son approche logique et philosophique, en lui accordant un statut entre fiction et littérature. Ce statut épistémologique fait surgir l’idée de la complexité du réel, puisqu’il permet « la distinction entre discours de fiction et discours figural » (Searle, 1998, p. 103). La fiction peut se révéler au sein du « discours figural » comme au sein des figures du discours, faisant place à une forme de métaphore. Le but de cette comparaison est celui de mettre en avant le caractère des œuvres de fiction.
L’être et la fiction sont une même chose. C’est à partir de là que le réalisme ontologique rime avec la « linguistification » de la réalité. Voilà pourquoi, « la quête inachevée » (K. R. Popper, 1973, p. 45) de sens, suscite le progrès du savoir scientifique. Cette recherche permanente et passionnante de la vérité restaure dans ses droits l’impulsion métaphysique. En fait, elle ne fait que revaloriser davantage la fiction contre la tradition philosophique qui déploie l’être en dehors du néant, du flou ou du vague, entre autres.
La pensée de Searle est opposée à cette tradition classique, puisqu’elle relève du nouvel esprit épistémologique auquel appartient le rationalisme ouvert. Penser et théoriser la fiction deviennent les deux tâches de la philosophie contemporaine du langage et de la connaissance. Le grand choix opéré par J. Searle (1982, p. 101-102), est de se placer dans le prolongement d’Héraclite, qui réévalue le non-être, donnant la possibilité de penser l’être sans exclure la fiction ou la métaphore. C’est proprement dans Sens et expression. Études de théorie des actes de langage de Searle (1982, p. 101), que l’on s’avise de la complexité de l’entreprise de transition philosophique par la reconnaissance de la réalité et ses niveaux, en présentant le problème sous la forme d’un paradoxe d’énonciation :
Or, si l’on adopte une telle perspective, l’existence du discours de la fiction pose un problème délicat. Nous pourrons présenter ce problème sous forme d’un paradoxe : comment peut-il se faire que les mots et autres éléments d’un récit de fiction aient leur sens habituel lors même que les règles qui gouvernent ces mots et ces autres éléments et en déterminant le sens n’est pas observé ?
Comment peut-on sortir de ce paradoxe ? On le voit, la problématique des actes de langage que l’auteur met en avant n’induit pas une solution simple. Plutôt, sa complexité tient dans la pluralité de sens qu’il suggère en rapport avec le sens littéral de la fiction. La vérité est inscrite dans la catégorie de l’imagination à laquelle renvoie le rôle essentiel qu’elle est sensée jouer dans la vie humaine. Pour Searle (1982, p. 119), la fiction fait partie intégrante des actes du langage sérieux : « Presque toutes les œuvres de fiction marquantes transmettent un message ou des messages qui sont transmis par le texte, mais ne sont pas dans le texte ».
Se pose alors l’exigence légendaire de la représentation explicite des « actes de langage sérieux » que le texte de fiction a pour but de transmettre. Ainsi, la fiction devient sérieuse et permet de relativiser la portée absolue du langage en acte, même si chez Searle (1982, p. 119),
quand il s’agit de rendre compte, de la manière dont l’auteur transmet un acte de langage sérieux en accomplissant les actes de langage simulés qui constituent l’œuvre de fiction, les critiques littéraires ont recours à des principes ad hoc et ponctuels ; mais il n’y a encore aucune théorie générale des mécanismes par lesquels de telles intentions illocutoires sérieuses sont transmises par des illocutions simulées.
Explicitement, faute de théorie générale de transmissions des intentions illocutoires, il est lieu d’imaginer des niveaux de conceptualisation à la fois d’une œuvre de fiction et d’un discours de la fiction.
Selon C. Castoriadis (1972, p. 144), « le visible de la chose est par son invisible d’une façon, et d’une autre, celui-ci par celui-là. Ma perception est reliée à la fois au visible et à l’invisible de la chose ». Cette affirmation invite à étudier la réalité et la fiction de la même et d’une autre façon, en raison de leur complémentarité. Si le sens de la réalité est coextensif à la fiction qui est l’infinité de l’être dont on parle, il prend en compte le réel et la fiction en œuvre chez Searle et chez Goodman entre autres.
L’accès à un autre niveau de réalité peut être rendu possible moyennant « l’action intelligente », c’est-à-dire l’acte de concevoir et l’acte de comprendre, sans exclure le droit au raisonnement plausible. Dans ce que l’esprit humain possède se trouvent aussi les formes symboliques qu’il construit. La fiction revêt aussi un caractère intuitif qui aide à construire et à organiser le monde imaginaire et logique.
E. Cassirer (1972, p. 85) pense que « la fiction et la connaissance scientifique ne se différencient pas par la nature, la qualité des catégories qu’elles emploient mais leur modalité ». Il montre comment la question de l’origine du langage est indissociablement liée à celle de l’origine du mythe et de la fiction. L’étude cassirerienne de cette interaction révèle l’idée selon laquelle la connaissance humaine n’a pas la maîtrise effective des entités qui échappent à la perception sensible. Dans cette quête des niveaux de réalité, Cassirer estime qu’il ne s’agit pas d’une exigence de la systématicité philosophique, mais la connaissance elle-même qui exige qu’on effectue cette recherche. Cela pour dire que la connaissance ne va pas sans mystère et sans explication limitée.
Les philosophes contemporains s’efforcent de montrer qu’il existe des entités fictionnelles qui se prêtent à notre explication rationnelle comme tentative pour comprendre la réalité, malgré ses niveaux d’intelligibilité. D’ailleurs, ce n’est pas parce que la connaissance des objets fictionnels paraît inaccessible à notre entendement que l’on devrait conclure à leur inexistence. Il faut découvrir d’autres niveaux de la réalité pour croire que l’esprit humain a la capacité d’imaginer ou de postuler l’existence des choses essentiellement abstraites, mythologiques, mystiques et mystérieuses.
Notre position est que la réalité à comprendre est plus que réelle et complexe. La complexité de la réalité se comprend comme « complexus : ce qui est tissé ensemble » (E. Morin, 2000, p. 21), par de constituants hétérogènes inséparablement associés et donc complémentairement pensés. Cette hétérogénéité a pour conséquence d’introduire une dimension irrationnelle au cœur de notre démarche de connaître le monde.
2. La problématique du langage fictionnel chez John Searle
Ce moment de notre réflexion s’attache à soulever la problématique du langage fictionnel chez Searle avec comme finalité de montrer les perspectives métathéoriques de la fiction. Au regard de la problématique de transition philosophique que ce moment introduit, il y a nécessité de (re)-poser la question fondamentale de la nature de la philosophie à partir de la question du sens complexe de la fiction.
Notons que la pensée du philosophe J. Searle (2004, p. 75) s’affine dans le contexte du développement philosophique du langage et de l’esprit. Cette philosophie intègre les acquis et l’actualité singulière de la recherche en philosophie contemporaine des sciences, particulièrement celle des sciences cognitives et de la neurobiologie. Par ce biais, la pensée searléenne fait corps avec l’hypothèse mesurée du déterminisme biophysique, posant ainsi la nouvelle question de la nature de l’esprit comme fait physique afin que la liberté soit rendue possible. De l’extérieur, d’autres approches sont en perspective voire en discussion autour de la problématique de la fiction comme expression transitoire d’un niveau de réalité à l’autre, ouvrant à quelques occurrences à l’approche philosophique de l’herméneutique de Ricœur (1986, p. 220) où la fiction et l’imagination ont véritablement droit de cité. On peut donc parler d’une philosophie de la fiction qui reste encore à sonder sous la modalité existentielle de la métaphore comme point d’ancrage de toutes ces analyses et ces regards sur l’empirisme ou le réalisme au XXI è siècle.
Pour toutes ces raisons, cette réflexion met en avant la portée heuristique de la métaphore ou de la fiction à partir de Searle. Dans le fond c’est la question des niveaux de réalité qui se pose à nouveaux frais, comme problème fondamental de la philosophie contemporaine de la connaissance. Cette philosophie s’est imposée comme exigence épistémologique et méthodologique parce que la « transition » du réel vers le fictionnel trouve sa légitimation et sa teneur théorique à partir du principe « dialogique », c’est-à-dire par la capacité dévolue à l’esprit humain d’articuler des entités de façon à la fois complémentaire, antagonique et associée.
Ce double rapport qui relie la réalité et la fiction s’instaure entre ce qui se prête, d’entrée, à notre perception empirique et ce que nous voyons autrement a posteriori. Au final, tout se passe comme si la nature de la relation entre le réel et la fiction était dialogique, c’est-à-dire la réalité et son double, en yin-yang pour ainsi dire. Dans le fond méthodologique et dans le fond ontologique, les deux niveaux de réalité, bien que distincts par transition, sont inintelligibles l’un sans l’autre, parce qu’ils s’entre-complètent en contexte de transition dynamique, s’entre-parasitent dans leur expression évolutive et s’entre-conjuguent à partir de leur association.
À tout bien prendre, pour accéder à la réalité par la prise de conscience de ses niveaux, une culture de « l’itinérance » (E. Morin, 2006, p. 7) se dessine. Elle consiste en un « touche-à-tout », pour lequel philosophes, littéraires, essayistes etc., devraient pouvoir se hisser au-dessus de ce qu’ils voient même de l’intérieur de leurs disciplines respectives. Ce dépassement vécu sous la modalité de la transcendance permet d’effectuer une réflexion à la fois fondamentale et générale. L’image éclatée de la réalité ne fait plus l’économie de la fiction ; un niveau de réalité ignorée, minorée et dévoilée dans l’univers du savoir scientifique et par le spécialisme méthodologique triomphant et persistant. Plus explicitement, la transition philosophique conduit inexorablement à l’ouverture, puisque la fiction est une « fenêtre », ou un « trou dans le mur » de la réalité : la fiction « ouverture : œuvre de l’ouvrir, inauguration toujours recommencée, opération de l’esprit sauvage, esprit de praxis. Ou encore : le sujet est l’ouvrant. » (J. Searle, Op. cit., p. 146).
La transition philosophique, qui débouche sur la science ouverte, ne peut pas faire abstraction de l’état de fusion des niveaux de la réalité et à son interprétation. Peut-être que la logique disjonctive n’a-t-elle pas compris que les philosophes et les littéraires du passé, dans leurs moments créatifs, étaient confrontés à des situations où la métaphore, la fiction, l’imagination étaient considérées comme des simples apparences du réel. Peut-être quelque chose d’essentiel a échappé à la philosophie classique visant à fonder la connaissance sur l’observation des faits. Renvoyant dos à dos dogmatisme et réductionnisme, J. Searle explore l’alternative déductive à travers l’entité paradigmatique de la fiction, sous l’impulsion de la théorie des « reliances » (E. Morin, 2000, p. 53).
Telles sont donc les raisons qui ont conduit à entreprendre l’étude, non exhaustive, du moins discutable et donc approfondie, d’un fictionnalisme que Searle et bien d’autres ont envisagé. La doctrine en question, qui constitue le maillon manquant entre la formation des concepts et l’information par la fictionnalité est, selon nous, la logique de la conception dont les figures de sémiotique générale sont repérables chez C. S. Peirce (1978, p. 120). Cette piste ouvre à une « épistémologie de la forme », elle-même un des aspects de ce qu’il nomme, plus généralement, épistémologie postcritique.
Par ailleurs, l’approche philosophique et logique de la fiction que Searle utilise met en œuvre d’exceptionnelles ressources du langage qui tendent vers la réévaluation de l’imagination et de l’invention scientifique, ce que N. Goodman (1992, p. 33) appelle les « langages de l’art ». Ce n’est pas pour autant dire que les philosophes sont des sophistes ; encore moins des simples rhéteurs de formes complexes ou multiples, celles qui seraient adoptées par les tenants de la simplicité comme étant l’expression d’une bonne polyphonie.
Plutôt, il s’agit de la transition philosophique impliquant la dynamique du langage, invitant à changer notre façon de procéder à la lecture du réel. Adopter telle attitude raisonnable en évitant l’habitude serait l’élan nécessaire pour dénoncer les « imperfections des systèmes formels » (J. Ladrière, 1967, p. 312).
En effet, manifestant la fécondité de la recherche en philosophie contemporaine du langage, le mouvement d’élaboration des doctrines de l’universel s’est accompagné, avec une prise en compte de la complexité ontologique, d’un contre-mouvement qui, à l’inverse, a favorisé l’émergence de choix multiples devant notre rapport au monde. Plutôt, cela a conduit à la construction de logiques nouvelles de la connaissance, de nouveaux modèles de la découverte, mais aussi et surtout des représentations différentes et controversées du réel lui-même. La question maintenant est de savoir si la fiction est une représentation dé-notationnelle ou bien si elle ne représente rien. On constate que l’argumentation de fond qui rejette la fiction comme une dimension de la réalité est aussi probante pour la philosophie, l’art, que pour la peinture et le cinéma considéré par E. Morin comme l’art de la complexité du réel. Le plus important est de montrer que les fictions, tout comme les faits, ont un rôle heuristique à jouer dans la construction du monde. N. Goodman (1992, p. 131) montre que les faits ne suffisent pas pour construire la réalité ; ils ne sont pas « l’unique monde réel et seulement lui, et que la connaissance consiste à croire les faits ».
Par contre, c’est au-delà des apparences qu’il faut se placer pour tenter de dévoiler le réel. Goodman s’attache tout au plus à la fabrication des faits : « Fabrication est devenue synonyme de fausseté ou de fiction, par opposition à vérité ou fait. Bien sûr, il faut distinguer la fausseté et la fiction, de la vérité et du fait » (N. Goodman, 1992, p. 132).
Se pose alors le problème de la vérité au cœur du fictionnel. La position de Goodman consiste à ne pas distinguer les valeurs de vérité et les entités qui sont mises en avant. Il estime que la fiction est fabriquée et fait découvrir la fausseté, la vérité et le fait. Dans le fond, le fait fictionnel laisse découvrir ce que l’homme veut réellement connaître. La fiction intègre la vision et la version des mondes que nous avons à refaire ou à reconcevoir. Par contre, « pour savoir exactement quels mondes on doit reconnaître comme réels est tout à fait une autre question » (N. Goodman, 1992, p. 136).
La mise en question du réel, réellement réel, tient dans le fait que la réalité a des niveaux qui ne se prêtent pas toujours à notre perception. Sur les mondes ou les niveaux de réalité, N. Goodman (1992, p. 145) étudie « les faits en provenance de la fiction », du fait que les faits fictionnels sont envisageables, alors que la fiction fait partie intégrante du réel. Mais, il ne suffit pas d’en faire une dimension du réel, et nous avons tout lieu de penser à une transition philosophique selon que les faits peuvent glisser épistémologiquement, tantôt vers les théories, tantôt vers les fictions. Pareilles alternatives intègrent de nombreux paramètres qui sont de nature à faire écho à la diversité des représentations, aux choix des interprétations de la réalité.
La réévaluation du fictionnel au cœur du réel par la philosophie du langage a visiblement préoccupé N. Goodman dont les travaux sur les langages de l’art font signe vers une approche de la théorie des symboles. Ici, le philosophe de la re-conception aborde à sa manière les fictions dans l’optique de refaire la réalité. Les fictions sont le fil conducteur qui traverse de part en part ce qu’il entend par les différentes formes d’aspects de la connaissance du réel : la dénotation, l’imitation, la représentation.
Il essaie d’établir aussi bien la différence que les rapports entre une représentation empirique et une représentation fictionnelle. Ce qui se dit être représenté par une image peut l’être au plan de la fictionnalité. N. Goodman (1992, p. 53) renchérit :
Une image qui représente un homme le dénote ; une image qui représente un homme de fiction est une image- d’un homme ; et une image qui représente un homme en homme est une image-d ’homme le dénotant.
Mais, l’on sait que le lien entre sens et dénotation n’a pas toujours été évident. Il en résulte que le lien entre le représentationalisme, le réalisme physique et le faillibilisme devient justifié. Il devient même difficile voire complexe de « boucher les trous d’intelligibilité » de la « science fondamentale » qui est toujours en quête de la vérité. N. Goodman a donc raison de dire : « un échange fructueux se noue alors entre des secteurs jusque-là différents l’un à l’autre » (N. Goodman, 2011, p. 9).
La corrélation dialogique entre le réel et le fictionnel se révèle indispensable en philosophie contemporaine du langage et en science physique non classique. Aussi novatrice qu’elle paraisse, la fiction s’inscrit en droite ligne du contexte épistémologique du réalisme. N. Goodman et les philosophes qui s’attachent au réalisme scientifique l’ont en partage, parce qu’il s’agit d’un réalisme ouvert, celui où le regard d’un physicien travaille, non seulement à la recherche du réel, mais s’efforce d’analyser la nature de la relation de convergence et de divergence entre mythes et modèles en physique contemporaine. Il y a là une forme de désenchantement de la réalité par l’analyse des concepts quantiques qui donne accès à une incertaine réalité, même à partir de ce que M. Paty et B. Hoffmann appellent « l’étrange histoire des quanta », (M. Paty et B. Hoffmann, 1981, p. 68).
Se trouve mise en question la notion de représentation physique. C’est donc la fiction qui propose une ouverture sur les grands problèmes relatifs à la connaissance de la matière et de la représentation. N. Goodman (2011, p. 51) s’y est penché en précisant : « Lorsqu’une représentation ne représente rien, il ne peut être question qu’elle ressemble à ce qu’elle présente ». Cette idée pose des questions de perception et débouche naturellement sur la complexité représentationnelle qui donne à croire qu’on peut penser les fictions au moyen des représentations à dénotation. Le problème de la référence ne suffit pas. Encore faut-il que la testabilité soit couplée à la signification des objets. Cette complexité de la démarche logique de la connaissance gagne en centralité au cœur de la théorie des symboles depuis Carnap (2015, p. 64) et ne se réduit donc pas à la critique de la représentation des phénomènes.
La représentation devient donc problématique comme cela apparaît sous la plume de N. Goodman et bien d’autres philosophes contemporains. Cela étant, le rôle médiateur de la logique cède le pas à l’aporie de l’univers de la pensée, c’est-à-dire à d’autres types de logiques, notamment celles qui procèdent de l’ouverture des possibles ou à des systèmes alternatifs. Les aspects métathéoriques de la logique révèlent la portée de la question, de l’interrogation et du problème au cœur de la logique de la conception. Une incontestable régionalisation des réalités prend corps là où l’on voit bien que passer de la logique ontique à la logique déontique, c’est transiter de la logique du clair à la logique floue, à la logique vague, à la logique épistémique.
En effet, dans ce foisonnement des logiques où les opérateurs de croyances s’expriment pour tenter de dire le rationnel et le raisonnable, un cadre relativiste de la connaissance se dessine sur fond du déploiement de multiples potentialités logiques et conceptuelles du monde. Elles viennent enrichir significativement notre pouvoir d’analyse et de théorisation de ce qui est, de ce qui n’est pas d’une part, et de l’autre de ce qui dépend de nous, et de ce qui nous dépasse. Au nombre de celles-ci peut compter la représentation et la description de la réalité en rapport avec le problème épistémologique de l’invention au sein du « réalisme ». C’est ce qui ressort de cette affirmation de N. Goodman (2011, p. 58) :
En résumé, la représentation et la description efficaces réclament l’invention. Elles sont créatrices. Elles s’informent l’une l’autre ; elles forment, rattachent et distinguent les objets. Que la nature imite l’art est une maxime trop timide. La nature est un produit de l’art et du discours.
Sans doute, pour relativiser le réalisme ouvert que révèle cette affirmation, nous devons recourir à D. Vernant qui a montré comment le nominalisme du projet cartographique de N. Goodman est d’importance, puisqu’il critique ce qu’il conviendrait d’appeler « le mythe du donné », en rapport avec la crise des fondements des années 30.
C’est dans ce contexte évocateur post-métaphysique, que le concept de carte a été introduit par N. Goodman pour exprimer la portée philosophique de « la structure de l’apparence ». Dans cet ouvrage, l’auteur essaie de nous montrer que l’apparence est plutôt réalité. Voici comment Vernant (2018, p. 244) en dégage l’intelligence :
La perspective n’est plus fondationnelle, ni même explicative, mais purement descriptive. Il s’agit de proposer une manière de représenter systématiquement, de décrire logiquement non plus le monde, mais son apparence.
À l’opposé des philosophes qui estiment que les apparences sont souvent trompeuses ou qu’elles peuvent nous tromper, N. Goodman les réévalue. Il appert que les apparences et la réalité ne sont pas toujours compatibles. Plutôt, elles sont interchangeables ; elles sont susceptibles de produire la connaissance. C’est le réalisme scientifique qui est mis en cause. L’ordre de la systématisation change « l’ordre cartographique ».
En conséquence, le réalisme épistémologique cède le pas au nominalisme de N. Goodman grâce à l’avènement de la « carte ». C’est un outil opérationnel de type logique moyennant lequel le nominalisme méthodologique de Goodman manifeste sa fécondité théorique, son intensité doctrinale et sa densité philosophique au cœur du langage. Il le fait en rapport de complexité avec le problème de la fiction. La lecture de l’œuvre globale de Goodman, permet de comprendre, à la suite de celle de J. Searle, le choix architectonique qu’il opère et qui gouverne l’analyse des couplets épistémiques comme « nominalisme/ platonisme », « phénoménalisme/physicalisme », « réalisme/ particularisme ».
De ce qui précède, remettre au goût du jour la recherche du langage fictionnel à partir de la prise en compte des niveaux de réalité, c’est monter vers un « ailleurs » du réel. Ce que l’on pense être dans le paradigme classique comme étant la constitution d’une image cohérente et unitaire du réel spirituel et matériel, ne peut advenir à notre esprit que si nous arrivons à en saisir tous les contours philosophiques du langage. De ce point de vue, l’intelligibilité du réalisme scientifique de J. Searle est un langage constitutif du monde empirique. Par contre, ce monde est limité face à la dimension plurielle de la réalité qui cache en quelque manière sa réelle signification derrière les choses telles qu’elles sont. C’est finalement à la dialogique du monde réel et du langage fictionnel que cette réflexion aboutit. Relier les deux entités revient à exprimer la philosophie de la propension. En fait, l’accès à la réalité de la tendance n’est rien moins que le dégagement du sens de la complexité dialogique. C’est en jeu dans ce propos d’A. Soulez (2016, p. 233) : « C’est toujours ce défi de pouvoir décrire ce qui se présente à même le symbolisme, le statut « à même » d’un langage des choses dont l’être n’est pas dépassable ».
Jean Paul Sartre (1972) met en scène un personnage qui se surprend à saisir toute la contingence des faits empiriques allant de la racine de l’arbre qui se dresse devant lui jusqu’à l’existence humaine. C’est donc avec raison et en toute logique que l’on cherche continûment à savoir s’il n’y aurait encore aucune finalité à la causalité de l’existence des êtres et des choses à l’instar du « néant », de l’autre, etc.
S’attacher à la transition philosophique, c’est faire figure d’intellectuel sans attaches à ses domaines d’origine et de prédilection. Cette action est de nature à faire valoir l’intellectuel exilique, c’est-à-dire la façon dont étudie le lien entre le déplacement, le détachement et la pensée critique. La voie qui mène à la vérité devient donc incertaine. Dira-t-on mieux que la science est l’asymptote de la vérité. Elle l’approche sans cesse et ne touche jamais. Tout se passe comme si les chercheurs étaient des transfuges. Telle est la figure de l’intellectuel aujourd’hui, celui qui aime les mélanges heureux. C’est en ce sens que nous utilisons les métissages culturels et les branchements disciplinaires.
Pour le dire autrement, la question qui se pose est celle de savoir comment la philosophie peut dépeindre ce qui ne peut être dit, mais seulement vécu ou senti. Tout se passe comme si le mot ne suffisait pas pour dire toute l’expérience du monde vécu. Il peut donc exister des entités contre fictionnelles qui dépassent aussi bien le verbe que la parole. Même le langage peut se révéler inapte à rendre compte de tout. Il existerait d’autres moyens non encore explorés qu’une simple rhétorique d’usage encore souvent limitée. Cette dynamique philosophique induit par un discours scientifique amnésique quant à ses origines fictionnelles nous permettra de mettre en exergue la machine de Turing et son apport dans la croissance du savoir scientifique.Quoi qu’il en coûte, toutes les considérations qui en découlent, débouchent naturellement sur le problème de la connaissance et sur le statut du paradoxe.
3. Langage fictionnel et dynamique de l’esprit humain chez J. Searle
Il s’est dégagé de la réflexion qui précède que le langage fictionnel constitue une problématique essentielle au sein de la philosophie du langage de John Searle. Métaphoriquement, c’est l’idée d’une lecture pyramidale du monde qui se construit par le langage. Mais, pareille unité s’éclaterait en unités diverses et contradictoires, disjointes selon quelques chemins sinueux et ramifiés selon les circonstances, au fur et à mesure que nous contemplons le paysage de la réalité qui est non seulement multidimensionnelle, mais aussi et surtout multi-référentielle.
S. Rahman (2011, p. 15) lie la fiction à la norme, en partant du constat selon lequel la question de la fiction sous l’angle des normes représente un objet d’étude encore peu exploré par des chercheurs autres que les juristes. Or il est aussi question des philosophes. Qu’il nous soit donc permis l’usage d’une fable, collée à la pensée de l’épistémologue J. T. Desanti (1975, p. 217) qui, dans l’élucidation du sens du concept de mathesis au cœur de la théorie moderne des sciences, n’a pas manqué de montrer que la réalité se prête à des niveaux. On voit que Desanti n’a d’autre but que de conclure à l’hypothèse d’une pluralité de la réalité qui n’est pas la plus improbable. Il s’en faut de beaucoup pour dire et penser la transition au sens philosophique du terme.
Lorsqu’on explore l’espace de jeu de la philosophie contemporaine du langage, il apparaît que la recherche entreprise par l’esprit humain oscille entre « la logique de la découverte » (Popper, 1973, p. 76), « les modèles de la découverte » (Hanson, 2001, p. 63) et N. Goodman insiste sur le lien entre les fictions (1990, p. 47). En effet, Goodman montre que le lien entre fictions est de nature à donner la valeur heuristique à l’invention, à l’imagination scientifique et à la découverte. L’objectif de cette invention est de « refaire la réalité » et de « reconcevoir » la philosophie du langage. Pour ce faire, l’invention est déterminante dans la mesure où « l’artiste ou l’écrivain saisit des rapports nouveaux et significatifs, et imagine des moyens pour les rendre manifestes » (N. Goodman, 1990, p. 56). Ce qui remet en perspective le « réalisme » scientifique : « des changements de norme peuvent se produire assez rapidement » (N. Goodman,1990, p. 62). Dans le même sens, Goodman renouvelle l’étude du problème de l’induction que prétendait résoudre définitivement Popper dans son débat avec Hume. Ainsi, le pragmatisme de Goodman et le fictionnalisme de Searle sont de nature à mettre en avant les conditions de possibilité « des conditionnels contrefactuels ». Par conséquent, le langage fictionnel chez Searle a l’avantage de rendre dynamique le processus de découverte et d’explication scientifique. Le monde réel n’étant pas unique, La connaissance que nous en avons consisterait à ne plus croire uniquement aux faits. Il faut encore ajouter les fictions et les prédictions.
Conclusion
Cette réflexion montre que le réel qui se montre n’est pas seul constitutif de la réalité. Ce qui est visible n’est qu’un niveau de réalité. Ainsi, la totalité du réel à comprendre doit donner une place à la fiction qui constitue un niveau de réalité invisible, mais fondamental. On comprend que le travail entrepris par Searle permet de situer la rationalité dans la dynamique de l’esprit porté par un univers irrésolu. Il y a toujours place pour la volonté des hommes et des femmes, en toute conscience et en toute liberté, de transformer les conditions de leur existence pour faire succomber le malheur. Contre la pensée unique qui déclare qu’il n’y a pas d’alternatives, cela s’appelle l’acte de réinventer le langage qui s’ouvre à un autre niveau de réalité, celui de la fiction. Métaphoriquement, on aurait affirmé l’idée d’une lecture pyramidale du monde construit par le langage. Mais, pareille unité s’éclaterait en unités diverses et contradictoires, disjointes selon quelques chemins sinueux et ramifiés selon les circonstances, au fur et à mesure que nous contemplons le paysage de la réalité qui est non seulement multidimensionnelle, mais surtout multi-référentielle.
Références bibliographiques
CARNAP Rudolf, 2011, Construction et réduction. Textes inédits sur le physicalisme 1922-1955, Trad. Bernard ANDRIEU, Paris, L’Age d’Homme.
CASSIRER Ernest, 1972, La Philosophie des formes symboliques, Paris, Edition de Minuit.
CASTORIADIS Cornélius, 1978, Les carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil.
DESANTI Jean-Toussaint, 1975, La philosophie silencieuse ou critique des philosophies de la science, Paris, Seuil.
LADRIÈRE Jean, 1967, « Les limites de la formalisation », in Logique et connaissance (dir.) Jean PIAGET, Paris, Gallimard, pp. 312-333.
GOODMAN Nelson, 2011, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles, Trad. de l’anglais par Jacques MORIZOT, Paris, Pluriel.
GOODMAN Nelson, 1992, Manières de faire des mondes, Trad. de l’anglais par Marie Dominique POPELARD, Paris.
GOODMAN Nelson, 1990, Reconceptions en philosophie, dans d’autres arts et dans d’autres sciences, Trad. de l’anglais par Jean Pierre COMETTI, Paris, PUF.
HANSON Norwood Russell, 2001, Modèles de la découverte, Trad. de l’anglais par Emboussi NYANO, Paris, Dianoia.
MAGUESSA EBOME Ghislain Thierry et BIANDOUONO Cédrik Guelor, 2023, Penser autrement le concept d’intentionnalité. Au cœur du pragmatisme de John Searle, Éditions universitaires européennes, London.
MORIN Edgar, 2006, Itinérance. Entretien avec Marie-Christine Navarro, Paris, Arléa.
MORIN Edgar, 2000, Reliances, Paris, Éditions l’Aube.
PEIRCE Charles Sanders, 1978, Écrits sur le signe, Trad. de l’anglais par Gérard Deledalle, Paris, Seuil.
POPPER Karl R., 1973, La logique de la découverte scientifique, Trad. de l’anglais par Philippe Devaux, Paris, Payot.
RAHMAN Shahid, 2011, Normes et fiction. Cahiers de Logique et d’Épistémologie, vol. 11, Université de Lille, CNRS.
RICŒUR Paul, 1986, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Paris, Seuil.
SARTRE Jean Paul, 1972, La Nausée, Paris, Gallimard.
SEARLE R. John, 1998, La construction de la réalité sociale, Trad. de l’anglais Claudine Tiercelin, Paris, Gallimard.
SEARLE R. John, 2004, Liberté et neurobiologique. Réflexions sur le libre arbitre, le langage et le pouvoir politique, Paris, Grasset.
SEARLE R. John, 1982, Sens et expression. Études de théorie des actes de langage, Trad. de l’anglais (USA) par Joëlle Proust, Paris, Minuit.
SOULEZ Antonia, 2016, Détrôner l’être. Wittgenstein antiphilosophe ? (en réponse à Alain Badiou), Paris, Lambert-Lucas.
VERNANT Denis, 2018, Questions de logique et de philosophie, Paris, Éditions Mimesis.
Kouakou Bernard AHO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La poésie et la philosophie, deux disciplines apparemment incompatibles dans leur enseignement et l’objet de leur discours, se rejoignent dans leur visée. Elles sont, certes, différentes, mais elles possèdent la même démarche qui converge vers l’Homme. La présente analyse porte sur les véritables rapports qui lient ces deux modes de pensée. Elle s’ouvre ainsi sur l’instauration d’une poésie philosophique de l’homme. La stylistique et la sociocritique ont permis de découvrir, en dépit de quelques divergences, une relation intime entre les deux disciplines. En abordant la question de l’homme et de son existence dans le monde sous l’angle poétique et métaphysique dans l’œuvre de Vigny, on situe la quête de la vérité dans la dimension ontologique au niveau de l’être.
Mots-clés : Connaissance, convergences, Être, Métaphysique, Philosophie de l’homme, Poésie humaniste, Poésie philosophique.
Abstract :
Poetry and philosophy, two disciples which seem apparently incompatible by their teaching and by their object of their discourse, meet in aim. They are, of course, different, but they have the same approach that converge towards Man. The present analysis focuses on the true relationships between these two modes of thought. It thus opens on the establishment of a philosophical poetry of man. Stylistics and socio-criticism have revealed, despite some differences, an intimate relationship. In addressing the question of man and his existence in the world from the poetic and metaphysical angle in Vigny’s work, we situate the quest for truth in the ontological dimension at the level of being.
Keywords : Knowledge, Convergences, Being, Metaphysics, Philosophy of man, humanist Poetry, philosophical Poetry.
Introduction
Les relations entre la poésie et la philosophie ont, depuis les époques platonicienne et homérique, alimenté les débats littéraires. Créateurs et penseurs ont souvent montré une antipathie faite d’incompréhensions, de méfiance et même de défiance, croyant en une distinction radicale quant à la forme de leur production et le contenu de leur pensée. La première exprime, certes, une vérité, mais en privilégiant le beau, l’esthétique telle que le conçoit le philosophe, dans une langue symbolique et métaphorique mystifierait le réel ; la seconde exprime la vérité par un langage conceptuel qui aspire à l’universalité. Les deux modes de pensée sont distincts ; la vérité de la poésie et celle de la philosophie s’éclairent dans des perspectives différentes, tout en convergeant vers l’homme. Le réel de l’artiste est celui du commun. Le tout du philosophe penseur est la Nature, selon M. Conche (2003, p. 151-158) ; et pose des questions fondamentales que le poète ne pose pas. Cependant, Platon, philosophe, lui-même poète en puissance, avait orienté ses propos dans un sens humaniste avec un objectif commun : celui de la satisfaction des attentes de l’homme. La métaphysique, avec Martin Heidegger, parvient à réconcilier les deux arts pour le triomphe du logos poétique où il faut de la sagesse pour parvenir à la créativité. Vouloir ainsi dresser une barrière étanche entre ces deux domaines du savoir apparaît comme une erreur. Poésie et philosophie se rencontrent, s’embrassent, indispensable l’une à l’autre dans une relation de cousinage. On peut s’en convaincre en parcourant les œuvres d’Homère, d’Heidegger, de Nietzsche, de Mallarmé, d’Hugo, Lamartine, Vigny ou Perse. Mais, aujourd’hui, certains critiques rejettent encore un tel commerce, alors que d’autres leur contestent un quelconque lien. L’objectif de la présente analyse est donc d’identifier les éventuelles divergences réelles et les liens qui unissent ces modes de réflexion dans Les Destinées d’Alfred de Vigny et dans Les Contemplations de Victor Hugo. À partir de leur visée, il sera possible d’indiquer que la poésie humaniste est une poésie philosophique. L’intérêt de notre analyse, ici, est de briser la barrière entre la poésie et la philosophie en examinant l’œuvre de Vigny. Quel est donc le rapport fondamental que l’on pourrait établir entre la poésie et la philosophie ? N’y a-t-il pas des liens qui justifieraient leur rapprochement ? Comment avec la métaphysique, l’on a pu aboutir à une réconciliation entre le poète et le philosophe, comme le pense Saint-John Perse ? L’originalité du travail relève de ce qu’il fait apparaître un nouvel humanisme au-delà des liens conceptuels. Les méthodes d’analyse telles que la stylistique, la sociocritique et la sémiotique, permettront de saisir, dans un premier temps, le fondement et la différence conceptuelle des deux langages, puis d’évoquer, par la suite, l’autonomie du logos poétique et de son triomphe par le biais de la métaphysique, et enfin, de découvrir leur proximité à travers la quête commune d’une idéologie.
1. Les fondements du langage poétique humaniste et de la pensée philosophique
Toute science, qu’elle soit humaine, sociale ou linguistique, a une démarche et une vision qui lui sont propres. La poésie et la philosophie se distinguent originellement à ce niveau.
1.1. La notion de poésie humaniste
La poésie se définit comme un texte dans lequel l’auteur utilise des métaphores, des images, pour exprimer la pensée en privilégiant la beauté, l’esthétique formelle du vers. Étymologiquement, elle désigne la création, voire une « fabrication », d’où la notion d’art. Elle se fonde sur un code de communication harmonieux en accordant sonorité et rythme.
La poésie est donc un art du langage associé généralement à la versification visant à exprimer une idée à l’aide des combinaisons verbales où le rythme, l’harmonie et l’image ont parfois autant d’importance que le contenu intelligible. Pour J. Maritain (1985, p. 259), le poème s’appréhende comme « l’inconceptualisable éclair de réalité obscurément saisi dans le mystère du monde par l’intuitive émotion du poète ». Cela signifie que la poésie est une invention dont le rôle est d’évoquer la réalité de façon créatrice, d’interpréter le réel ou de faire naître un univers qui lui est propre à travers le langage. Elle dispose des formes spécifiques qui l’éloignent ou la rapproche parfois de la prose. Elle se donne une double vocation qui est celle de transcrire et créer un don divin par lequel s’opère cette transmutation du langage poétique.
Le langage poétique se réalise dans un tissu verbal, conçu comme une transgression de la norme du langage quotidien, en s’arrachant à la banalité de son usage courant pour faire surgir la beauté du texte, tel le montre ce vers d’A. de Vigny (1973, p. 247) : « L’orage est dans ma voix, l’éclair est sur ma bouche ». La création poétique devient alors, comme le traduit O. Paz (1965, p. 98), une « violence faite au langage. Son acte premier est de déraciner les mots », ce que J.-L. Joubert (2015, p. 101) qualifie d’« acte de rébellion et d’invention », dès l’instant où elle refuse l’arbitraire du signe. À ce niveau, la métaphore, en tant que transfert de sens, devient essentielle dans la bonne appréhension du monde dans ses ressemblances et ses dissemblances pour participer à la re-création intime du réel sensible ; Aristote (1990, p. 118) la saisit comme « l’application à une chose d’un nom qui lui est étranger par un glissement du genre à l’espèce, de l’espèce au genre, de l’espèce à l’espèce ou bien selon un rapport d’analogie ». Ainsi, la forme comme le fond font d’elle « un moyen de saisie du monde, global et totalisant » (Aristote, 1990, p. 29). Il y a donc une affinité réelle entre la poésie et ce que le philosophe appelle l’« être », ce qui témoigne de sa vocation métaphysique, puisque l’homme est fait de paroles et de parole poétique que confirme O. Paz (1965, p. 103) en ces termes : « La parole est l’homme même ». L’homme se crée lui-même en créant un langage, celui de la poésie ; de la sorte, la poésie le ramène à sa propre origine ontologique. Cela revient à dire que le poème rappelle l’oubli de l’homme, ce qu’il est réellement, selon ces vers d’A. de Vigny (1973, p. 154) : « Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Homme, /Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes ».
Poésie et Philosophie se distinguent dans leur essence par l’objet qu’elles visent. La première a pour principe fondamental la recherche du beau. La beauté de la poésie est sa capacité à révéler ce que l’homme ignore de lui-même : « L’Homme, humble passager, qui dut vous être un [Roi » (A. de Vigny, 1973, p. 150). À la lecture d’un poème, on est ému, profondément touché par ce que le poète a su dire avec des mots qui ne sont les nôtres, et mieux, comme si on se reconnaît dans ces mots ou comme si on accède à une compréhension nouvelle, avec la certitude qu’elle procure une immense joie. Dans la recherche du beau, la poésie se rapproche du sacré dans tout son mystère : « Et, debout devant Dieu, Moïse ayant pris place, /Dans le nuage obscur lui parlait face à face » ((A. de Vigny, 1973, p. 152). Ce rapprochement ne signifie pas que la poésie détient la vérité. Néanmoins, elle détient sa vérité à elle, la vérité poétique, contrairement à la philosophie qui en fait une quête permanente. La beauté de la poésie est donc d’ouvrir à une vérité qui n’est sans doute pas la vérité universelle et définitive, mais à travers des vers, celle qui plonge dans l’imaginaire et le surréel, voire le surnaturel. Elle a donc pour vocation fondamentale l’esthétique du langage et sa musicalité, tel le refrain de Moïse : « Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre ! » (A. de Vigny, 1973, p. 156).
1.2. L’essence d’une philosophie de l’homme
La philosophie, philosophia, signifie l’amour de la sagesse, cette sagesse qui fonde également la poésie : « Hélas ! vous m’avez fait sage parmi les sages ! » (A. de Vigny, 1973, p. 156). Originellement appelée Sophia, la philosophie est un art de vivre, mieux, une morale qui consiste à se conduire raisonnablement, à accueillir avec sérénité, les épreuves de la vie. Au-delà de cette conception, la philosophie apparaît comme un savoir. Pour R. Descartes (2016, p. 51), le mot « philosophie » signifie « l’étude de la sagesse ; une sagesse où on n’entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l’homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l’invention de tous les arts » ; elle est donc un mode de vie.
Par ce fondement originel, la philosophie se distingue de toutes les formes de savoir et surtout de la poésie. Son essence est la quête systématique de la vérité, sa recherche plutôt que sa possession. Le philosophe est donc le pèlerin de la vérité plutôt que le propriétaire d’une quelconque certitude. Partant de là, la philosophie excelle à développer en chaque homme un esprit critique, contrairement aux dogmatiques comme les sophistes qui prétendent détenir la vérité absolue et tentant de l’imposer aux autres. La vérité n’est pas plus à l’un qu’à l’autre, mais qu’elle est universellement présente en chaque homme. Selon K. Jaspers (2008, p. 18), « faire la philosophie, c’est être en route : les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse est une nouvelle question ». Cette nouvelle méthode par questionnement est une attitude critique qui consiste à remettre en cause les croyances. La sagesse philosophique, contrairement à l’art poétique est de ce fait une attitude critique qui, dans l’ordre du savoir, éloigne des préjugés. Aux yeux de Platon, seul le philosophe sait rompre avec les préjugés de la foule pour contempler la vérité. Or, l’artiste (le poète) ne contemple pas la vérité ; il ne fait qu’admirer le réel. Cette pensée est jugée par J. Maritain (1985, p. 258) en ces termes :
L’intuition poétique ne vise pas les essences, car les essences sont dégagées de la réalité concrète dans un concept, une idée universelle, et scrutées au moyen du raisonnement ; elles font l’objet d’une connaissance spéculative. (…) l’intuition poétique vise l’existence concrète en tant que connaturelle à l’âme transpercée par une émotion donnée, c’est-à-dire qu’elle vise toujours un existant singulier, une réalité individuelle concrète et complexe, prise dans la violence de sa soudaine affirmation-de-soi et dans la totale unicité de son passage dans le temps.
La pensée poétique n’est donc pas une critique mais, une pensée créatrice et admiratrice de la réalité sensible se réduite alors à alors son imitation. Ce qui justifie sa condamnation platonicienne. Or, l’admiration aboutit chez le poète à l’éducation dans le sens humaniste, quand Platon (1966, p. 36) lui-même réalise que « l’éducation doit tourner l’œil de l’âme vers l’Idée du Bien ». Il est donc nécessaire de saisir ce qui les oppose et ce qui les unit dans leur quête de la vérité à propos du réel.
2. La recherche de la vérité dans la poésie et la philosophie
Les liens qui unissent la poésie et la philosophie, dans les débats littéraires, ont souvent été mal appréciés. Au niveau du savoir, leurs convergences supplantent les divergences dans Les Destinées d’Alfred de Vigny.
2.1. Divergences des deux modes de connaissance
L’opposition entre la poésie et la philosophie se situe au niveau de leur mode d’approche où l’on observe une antinomie radicale par la mystification du dire et ladémystification de la connaissance par la philosophie.
Le philosophe se démarque du poète au nom de l’exigence d’une quelconque vérité et de moralité. L’art poétique, dans sa séparation fondamentale avec la philosophie, se caractérise par sa mystification de la connaissance dans la mesure où elle rend, de façon divine, les choses, habille ce qui est déjà connu. Le poète rêve d’un au-delà d’idéalité, d’une perfection universaliste, d’une harmonie salvatrice. C’est à cette prière que nous invite M. Noël (1995, p. 114) : « Donne de quoi rêver à moi dont l’esprit erre/Du songe de l’aube au songe du soir/Donne de quoi chanter à moi pauvre poète ». Pour ce faire, le poète se réfère au domaine de l’irrationnel qu’elle seule peut et sait explorer ; ainsi, S.-J. Perse (1982, p. 445) écrit dans son « Discours de Stockholm » que l’état poétique se montre voisin de l’état mystique « comme une seule grande strophe vivante, qu’elle embrasse au présent tout le passé et l’avenir, l’humain avec le surhumain. ». Mystifier la connaissance, c’est rendre sa gloire. La pensée poétique dit autrement ; elle nous élève dans la pensée mystique et mystifiée. C. Baudelaire (1972, p. 203) se propose alors de « trouver la lumière par la voie des ténèbres, glisser à la lumière par l’obscure sensation », comme le montre l’intervention du défunt père Hugo dans Les Contemplations (V. Hugo, 2008, p. 145) : « qu’est-ce donc, mon père ne vient pas ». La poésie mystifie donc toute chose que la philosophie aura pour ambition de démasquer. Son obscurité à lui reprochée tient, selon S.-J. Perse (1982, p. 446), à la « nuit » qu’elle explore, « celle de l’âme elle-même et du mystère où baigne l’être humain. ».
En abordant ainsi la question de l’être, de Dieu et de l’âme, la philosophie s’intéresse dans son discours aux choses immatérielles. Par cette attitude, elle opère une nette séparation entre le monde des idées, monde des philosophes, et le monde sensible qui est celui des poètes. Philosopher, c’est donc s’éloigner des connaissances réelles pour tenter de démystifier les croyances en enseignant le non-conformisme et la volonté de dépasser dialectiquement les croyances du sens commun ; ce qui justifie l’effort de compréhension, se détachant ainsi radicalement de la poésie qui se limite à l’interprétation de la nature ou de l’homme.
En définitive, l’opposition entre poésie et philosophie se réalise à partir de leur essence, dans ce qui les caractérise, et surtout dans leur manière d’aborder les questions de l’homme et de la vie. Cependant, il existe bien une possibilité de rapprocher ces deux domaines du savoir dans une intime réconciliation. Mais, à la question, qu’est-ce que la poésie ? Quel est son but ?, n’est-on pas en droit de toucher la question de l’être ? et surtout lorsque C. Baudelaire (1972, p. 306) répond que c’est « de la distinction du Bien d’avec le Beau, de la Beauté dans le Mal, que le rythme et la rime répondent dans l’homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise ; de l’adaptation du style au sujet ; de la vanité et du danger de l’inspiration », nous ne pouvons en douter.
2.2. Convergences dans la quête du sens et essence des croyances et des savoirs
Il existe une dialectique de la convergence par la médiation de la métaphysique. Le logos poétique, dans son statut d’autonomie, a amené Aristote à formuler un partage des territoires entre la poésie et la philosophie. Aristote est le fondateur de l’école péripatéticienne. Philosophe empirique, il est avec Platon, une des deux grandes figures de la philosophie antique. Son importance dans la philosophie occidentale est immense. Redécouvert à l’époque féodale, la scolastique s’en inspira. Le système aristotélicien dominera ainsi la pensée occidentale jusqu’au XVIIe siècle, époque où la naissance des sciences expérimentales ruinera sa vision du monde.
Dans ce rapport, il est question de reconnaître l’autonomie relative de la poésie en évitant de la subordonner au vrai de la philosophie. Le poème ne doit pas être jugé par rapport à une vérité qui n’est pas sa finalité, parce qu’il relève d’une fonction autonome d’expressivité qui est simultanément une fonction de purification ou de purgation à visée thérapeutique de la subjectivité humaine. Mais, cela ne veut pas dire qu’il ne dit pas de vérité ; Et nous sommes d’avis avec M. Heidegger (1938, p. 230) qui, en méditant l’expérience poétique d’Hölderlin, conçoit que « l’essence du poème [soit] l’instauration de la vérité ». La réhabilitation du poète dans la Cité platonicienne se fera alors par la médiation du métaphysicien.
Le point d’ancrage de la poésie et de la philosophie se situe au niveau de la recherche de la vérité, qui est pour V. Hugo (2008, p. 333) « notre nuit profonde » dans laquelle la dernière s’appuie sur la première. Schelling est par excellence celui qui, prenant acte de la proximité des deux disciplines, confère à la poésie une dignité commune, quand il insiste sur la nécessaire complémentarité de deux aspects de l’art : l’œuvre d’art relève de l’œuvre du génie ; elle est l’incarnation d’une force divine dont l’instrument est la parole, la pensée. Sous sa forme symbolique, la poésie conserve encore le caractère de l’idéal, de l’essence, de l’universel. Elle a sa fin en elle-même, c’est-à-dire dans l’art lui-même.
Tout comme la philosophie, la poésie est un art de vivre. Sa mission s’opère dans l’indifférenciation de l’absolu et du particulier où s’exprime la liberté comme un mode d’être un pan de l’être. Elle est le germe de la question de l’être à partir de sa vocation, comme l’indique ces interrogations hugoliennes : « A qui donc sommes-nous ? Qui nous a ? qui nous [mène ? » (V. Hugo, 2008, p. 204). De la métaphysique à elle, il n’y a pas d’antinomie indépassable ni de conciliation hâtive, mais plutôt une articulation à promouvoir, soit que l’on considère avec le philosophe allemand F. W. J. von Schelling (1999, p. 195), la poésie comme principe de « l’uniformisation de l’infini dans le fini », soit que l’on soutienne avec Y. Bonnefoy (1987, p. 56) qu’elle a une valeur de « réalisme initiatique », soit que l’on revendique avec J. Maritain (1985, p. 267), l’existence d’une fonction proprement cognitive de l’intuition poétique, soit que l’on admet que la métaphysique renvoie à une fonction abstraite dont elle n’est qu’une expression, et que l’autre expression est la poésie. Ces perspectives se rencontrent dans une possible conciliation de la philosophie et de la poésie. Le rapport sans confusion ni séparation entre les deux domaines du savoir est susceptible de se résoudre en une symphonie de résonances. Dès lors, on peut saisir l’idée de L. Lavelle (1968, p. 178) exprimée en ces termes : « le poète parvient ainsi à réaliser et à nous faire sentir cette rencontre entre l’infini et le fini, entre l’univers et nous, qui est l’objet même de la réflexion philosophique. Tandis que la philosophie cherche seulement à l’expliquer ».
Certes, on est en droit de penser qu’une poésie digne de ce nom est métaphysique qu’il faudrait distinguer de la patiente métaphysique. En se rapprochant des profondeurs de l’âme, en s’ouvrant au mystère des choses et du monde, elle n’accomplit pas sa propre critique ; ce qui fait dire à Platon (1966, p. 143) que « les créations des poètes sont dues à une inspiration divine. Ils disent beaucoup de choses, mais ils n’ont pas la science de ce qu’ils disent ». Il revient finalement au métaphysicien de recueillir toutes les « révélations » du poète et de les confronter à cette expérience métaphysique dont ils dépendent l’un et l’autre. Mais, la plus mauvaise grâce du métaphysicien serait de saisir le sens de la poésie et de devenir insensible à la grâce du chant poétique. C’est cette sagesse qu’il convient au poète et au philosophe, tout comme au métaphysicien, d’admirer et de contempler dans leur activité respective.
2.3. L’art poétique et la pensée philosophique : de l’admiration créatrice à la sagesse contemplative
La prose poétique apparaît comme une philosophie du langage. Le poète est un homme qui s’adresse aux hommes dans le but de leur transmettre sa connaissance particulière du monde dans lequel il vit. Il met en valeur ce qui ne dépend pas d’un acte créatif humain, mais ce que la nature offre spontanément à nos regards, à nos sens. Le processus de création poétique s’apparente aux travaux des savants : l’observation attentive procure une connaissance que le poète est libre de communiquer sous forme de poèmes qui entrainent un processus similaire.
Les poèmes de Vigny fonctionnent comme des stimuli conduisant à d’autres observations et méditations : ils ne sont pas une fin ni même un début mais, une partie. Ils sont un processus ouvert et partagé. C’est une poésie qui cherche à être plus proche de la vie elle-même : « J’ai vu l’amour s’éteindre et l’amitié tarir /Les vierges se voilaient et craignaient de mourir » (A. de Vigny, 1973, p. 247). Le poète va jusqu’aux limites de son art : sa proximité revendiquée avec la nature lui confère le droit d’être pareille à elle, parfois, difficilement déchiffrable. Heidegger soutient que l’œuvre d’art est la mise en œuvre de la vérité. Si l’on se réfère à la vérité, comme à une interprétation correcte de la réalité ou des choses, à l’instar d’une proposition qui dit comment les choses se présentent réellement, cette affirmation ne porte pas une originalité. Alfred de Vigny pense que la vérité est ouverture, celle qui offre la possibilité de dire des phrases vraies ou les possibilités de vérification et de falsification des propositions. Pour articuler l’œuvre d’art avec la vérité en tant qu’ouverture, M. Heidegger (1966, p. 157-235) conçoit que le langage doit être conçu comme « la maison de l’être ». En soutenant que le langage est la maison de l’être, Heidegger veut dire simplement que les choses se donnent comme des étants à l’intérieur d’un horizon rendu concret par les structures grammaticales ou linguistiques. Ce qui revient à dire que, sans l’aide d’un dictionnaire, d’une grammaire ou d’une syntaxe, tout nous semblerait plutôt vague et que nous serions incapables de dire quoi que ce soit sur la vérité et la fausseté. Donc si le langage est la maison de l’être et la vérité cette ouverture qui précède la proposition vraie ou fausse, l’œuvre d’art peut donner lieu à la vérité.Pour le métaphysicien, comme pour Aristote, il n’y a pas de vérité à l’extérieur du jugement linguistique. C’est seulement au moment où l’on articule un jugement à propos de ce que l’on voit dans le monde que ce monde se met à exister véritablement. Autrement dit, l’être des choses dépend du fait qu’il existe un cerveau ou un esprit qui les connaît.
Dans une perspective heideggérienne, l’art qui commande tous les autres est la poésie, en tant qu’art de la parole. Écrire des poèmes signifie aussi créer, inventer. Si la parole est poésie, poétiser est l’art de figurer. On se rappelle que le terme « poésie » vient du grec poiésis qui est la production, au sens du romantisme philosophique, une manifestation esthétique de l’art poétique. La philosophie romantique ou romantisme philosophique, mouvement, à la fois culturel, intellectuel et religieux, valorise la sensibilité et l’imagination, en tant qu’authentiques approches de la vérité. Elle s’appuie essentiellement sur la méthode « analogique » et développe une pensée symbolique, recherchant la signification profonde des choses et des activités humaines dans le fond inconscient et irrationnel de l’esprit. Ce qui participe à la poésie psychanalytique.
Les philosophes romantiques postulent une unité d’essence entre l’esprit de l’homme et la nature, soutenant que l’homme et la nature militent pour une cause commune dans le développement graduel d’une seule et unique réalité : l’Être ou la Vie. Ils tentent de retrouver dans le tréfonds de l’esprit humain les traces de cette unité, fondée sur l’« alliance première » ou l’« union originelle » entre l’homme et la totalité dans laquelle il réside. Il s’agit d’un travail de réintégration de l’humanité dans le « Tout » ou le divin, une pensée à caractère ésotérique. La « révolution romantique » est donc pour F. Schlegel (2012, p. 116) le renouvellement de la réflexion poético-philosophique. Une telle poésie qui intègre en elle la réflexion est ce qu’il nomme la « poésie réflexive ». En plaçant la poésie au cœur même de la philosophie, le romantisme en a fait le paradigme de l’activité intellectuelle et spirituelle, mais il a également étendu leur règne jusqu’aux sciences de la nature. Les romantiques considèrent la nature comme une œuvre d’art à part entière, à l’image d’un poème chargé de significations cachées à décrypter.
Dans la pensée romantique, l’art remplace la philosophie en tant qu’activité qui a pour tâche de réaliser le rapport à l’Être de l’homme ; ce qu’exprime V. Hugo (2008, p. 332) dans ses suivants : « Je ne veux pas de l’Être !/Je soufre ; donc l’Être n’est pas ! ». En supposant une autonomisation de l’art, les romantiques voient la renaissance d’une domination de la poésie dans la philosophie. L’originalité de leur conception de la poésie réside dans le fait qu’elle l’identifie à un genre universel qui englobe tous les genres, constituant ainsi, la véritable philosophie. Dans la pensée de F. Schlegel (2012, p. 208), quatre traits ressortent de cette unité du poétique et du philosophique : l’universalité recherchée, la progressivité infinie du savoir, le mélange des différents genres, la fusion de la poésie et de la vie. Ce dernier trait concerne le rapport de la poésie à la vie ordinaire à laquelle elle doit se mêler. Les expressions « genre romantique » ou « poésie romantique » finissent alors par désigner l’essence de toute activité poétique. Le romantisme se dote donc d’une signification universelle dans laquelle s’abolissent toutes les antinomies : celle de l’Antiquité et de la modernité, celle de la prose et du vers, celle de la science et de la poésie. La poésie romantique est, en définitive, une poésie qu’E. Décultot (2004, p. 1095) qualifie de « poésie universelle progressive », mieux, une poésie humaniste.
En outre, l’élaboration subjective de la poésie est une exploration des territoires de l’imagination. Dans le sens inverse qui va de l’intérieur de l’esprit à la nature extérieure, il est possible de former un monde poétique pour vivre dans la poésie, afin de pénétrer ce qui apparaît d’abord extérieur. Il s’agit de rêver le monde dans la totalité de ses aspects naturels et de le comprendre dans sa correspondance harmonique avec l’esprit.
3. La dimension socio-éthique et humaniste de la poésie et de la philosophie
La dimension sociale et morale de l’art et de la pensée repose sur l’édification de l’être qu’il convient dans les lignes qui suivent d’analyser.
3.1. L’édification de l’être : de l’homme engagé au surhomme
La philosophie et la poésie ont pour fonction essentielle l’édification de l’homme par le fait qu’elles éveillent les consciences et indiquent à ce dernier la responsabilité historique de son temps. Elle est comme investie d’une mission humaniste. Dans celle-ci, la poésie, selon qu’elle raconte, exprime des sentiments, les met en scène ou réfléchit à leur sujet, et selon la forme adoptée, la poésie se divise en plusieurs genres : épique, lyrique ou didactique. Ces différents genres sont liés à la philosophie qui, elle aussi, véhicule des doctrines existentialistes, rationalistes, épistémiques et épistémologiques pour contribuer à l’élaboration du savoir.
D’abord, la dimension épique de la poésie et de la philosophie se rencontrent dans l’épopée qui est un genre héroïque. Son but est de sublimer, de galvaniser les jeunes générations. Elle consiste à enseigner la noblesse et surtout le patriotisme, à l’image de celle d’Homère (1999, p. 130), père de la poésie avec L’Iliade et L’Odyssée. L’œuvre homérique est la célébration des valeurs du héros dans la poésie, à travers le voyage d’Ulysse, fait de péripéties. Cette célébration des héros se retrouve aussi dans la philosophie. Sa mission, depuis l’Antiquité, est de montrer le caractère extraordinaire des dieux afin d’inciter l’homme à se dévouer aux dieux et surtout à être leur semblable. Lorsque Platon explique à travers des mythes la création du monde et l’origine de la connaissance humaine, cela fait comprendre que des personnages héroïques ont énormément contribué à l’évolution de l’humanité.
Ensuite, vient la dimension lyrique de la poésie et de la philosophie. À ce niveau, la poésie philosophique, lyrique, a pour essence, la découverte de l’intériorité de l’homme. Les premiers poètes lyriques racontaient leurs expériences personnelles. Au-delà de l’évocation de la douleur, le poète analyse aussi ses sentiments et réfléchit sur la condition de l’homme, de sorte que le lecteur puisse être profondément touché et ému. En ce sens, l’amour, la nature, la fuite du temps, la mort, la nostalgie deviennent des thèmes d’inspiration majeurs. Le poème « À celle qui est restée en France » de V. Hugo (2008, pp. 384-395) en est un exemple qui, évoquant ses douloureux pèlerinages sur la tombe de sa fille, se rend compte qu’en réalité, « (…), tout cela, c’était donc du bonheur ! » (2008, p. 387). Dans la philosophie, la tonalité lyrique est évoquée lorsque le philosophe analyse la mort, la souffrance et l’angoisse humaine. L’exemple d’Héraclite d’Éphèse, ce penseur présocratique enseignant le mobilisme sous une forme poétique, est édifiant dans l’œuvre dans C. Axelos (1992, p. 225) : « tout coule, rien ne demeure, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve car c’est une nouvelle eau qui coule sur nous ». Il pense le monde non moins que comme mouvement et changement perpétuel.
Cependant, la dimension didactique de la poésie et de la philosophie réside essentiellement dans l’enseignement des hommes à travers deux formes : la fable et le satyre social. Si la fable est un récit plaisant en vers, caractérisé par des personnages anthropomorphisés bien définis (hommes, animaux) correspondant à des types humains, avec une moralité orientée vers l’expression du bon sens ou d’une sagesse sans prétention, le satyre critique, dénonce les tares de la société, parfois avec ironie et métaphore. Ce même procédé de Jean de La Fontaine est utilisé par F. Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra (1971, p. 312). En utilisant la métaphore du lion, le philosophe montre que l’homme est maître de son temps. De ce fait, il n’a pas d’excuse et ne doit pas se laisser dicter par une autre conscience. Autant que la poésie est la musique de l’âme, des âmes grandes et sensibles, autant la philosophie nourrit l’âme, la corrige, la rectifie. Tous deux procurent du plaisir par la musique et la libération de l’esprit, du plaisir de l’imagination dans l’évasion, la fantaisie, le mystère et la rêverie. Poésie et philosophie entretiennent des liens de voisinage ; et c’est cette cohabitation harmonieuse qui se trouve au fondement de l’engagement social, une mission d’engagement sacerdotale et royal de la poésie et de la philosophie selon V. Hugo (1980, p. 201). Toute pensée est dite engagée lorsqu’elle exprime des prises de position et dénonce ce qui est considéré comme atteintes à l’ordre public ou aux droits des humains. En effet, la poésie et la philosophie ont une fonction didactique, parce qu’elles sont porteuses de leçon d’éthique, de morale. Le poète se proclame « mage » ou « prophète » des temps futurs dans ce quatrain d’A. De Vigny (1973, p. 200) :
Peuple, écoutez-le poète
Écoutez le rêveur sacré !
Votre nuit, sans lui incomplète
Lui seul a le front éclairé.
La poésie et la philosophie deviennent incontournables dans les luttes idéalistes et idéologiques ; ce qui a favorisé l’avènement des courants poético-philosophiques, tels que l’Existentialisme et le Surréalisme et que traduit, ici, A. De Vigny, 1973, p. 175). « Ma bouche sera la bouche des malheureux qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s’affaissent au cachot du désespoir », car le temps est venu où tous les penseurs ont le droit et le devoir de soutenir qu’ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune. J.-P. Sartre (2000, p. 18) invitait, de son côté, les hommes à s’engager pour changer les choses, car « l’existence précède l’essence » ; autrement dit, l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. Le poète et le philosophe, par leur façon de voir les choses, de les sentir et de les exprimer, suscitent la puissance de la pensée, la puissance des mots, comme moyen de lutte pour le devenir marquant l’alliance dans l’engagement des disciplines. Il apparaît ainsi, la moralisation pour une société égalitaire et respectueuse de l’environnement. La poésie et la philosophie restent attachées à l’éthique ; l’éthique est la finalité de toute pensée, de toute expression artistique. Enseigner l’éthique à l’homme, c’est lui inculquer l’importance des valeurs sociales et la préservation de la vie et le respect des lois de la nature et de la société.
3.2. La dimension humaniste des discours poétique et philosophique
L’œuvre de Vigny est, à la fois, celle d’un poète et d’un philosophe portant sur les conditions d’existence de l’homme. L’homme est soumis à des forces extérieures du monde qui guident son action. Dès lors, apparaît un pessimisme métaphysique qui marque l’esprit du poète.
Plus tard, il fait l’expérience sociétale qui lui permet de surmonter les difficultés de la vie. Il réalise que la présence de l’Autre dans un monde mimé par ce qui est indépendant de lui. C’est à ce moment que le poète oppose à son pessimisme un optimisme social qui relève de l’aide des semblables. Par le travail et l’esprit d’entraide, les hommes peuvent supporter la vie sur terre. La confiance qui habite le poète, dans Les Grandes étapes de la civilisation française de J. Thoraval et al. (1971, p. 337), est que tôt ou tard, « Un jour, triomphera l’esprit pur ». Cette réalité bien que poétique, est une révélation, un dévoilement et même une ouverture sur l’être comme le soutient O. Paz (1965, p. 157) : « Le poème révèle ce que nous sommes et nous invite à être ce que nous sommes ». La poésie figure la relation de l’homme au monde, car le poème, comme une « imagination transcendantale kantienne » selon la perception de J. Garelli (1966, p. 25), « fait voir le monde, parce qu’il est lui-même un monde qui se fait voir ». L’humanisme du poète débouche ainsi sur une dimension ontologique et métaphysique que traduisent ces vers d’A. De Vigny (1973, p. 254) : « Fais énergiquement ta longue et lourde tâche /Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler, /Puis après, comme moi, souffre et meurs sans [parler. » ; sa poésie est ce que Raoul Piron définit comme un « exercice continuel de métaphysique concrète », tel que repris par J.-L. Joubert (2015, p. 103).
Dans l’activité poétique, le poète poursuit sa quête d’unité ; son drame, c’est l’abîme de l’homme, cette ambiguïté suprême de l’être, son obscurité. Ce qui fait la pluralité du poète comme le soutient S.-J. Perse (1982, 454) : « Au fond de cette éternité, je vis que l’amour unissait toutes choses, comme pour lier, en un seul Livre, tous les feuillets épars d’un même ouvrage universel ». La dimension esthétique du discours poético-philosophique d’Alfred de Vigny provient de la richesse abondante des images qui parcourt son œuvre. Au-delà, l’emploi des symboles et leur beauté participent à une esthétisation nouvelle de l’écriture du poète.
Conclusion
La relation entre l’activité poétique et la pensée philosophique a toujours animé les débats littéraires dans une posture conflictuelle. Mais, malgré les dissensions observées entre les deux formes de savoirs et ce à partir de leur essence, leur caractéristique et leur affinité respective, poésie et philosophie coopèrent dans la recherche de la vérité, de la créativité transcendantale et dans l’édification de l’homme. Partant de leur conception, elles convergent cependant du fait de leur objet en termes de visée commune qui est la question de l’homme. Dès lors, le mystère est commun. L’homme, « cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles-nés » tel l’écrit S.-J. Perse (1982, p. 444), est le phare vers lequel naviguent poète et philosophe. Toutefois, force est de constater que les divergences supposées se trouvent au niveau de leurs méthodes. Dans la pensée poétique, par la médiation analogique et symbolique, par le jeu des correspondances, s’investit une réalité, voire une surréalité. Il existe chez l’homme une dialectique qui fait appel à la pensée poétique. Les questions métaphysiques qui échappent au philosophe trouvent réponses dans l’activité du poète. La philosophie est un mode de connaissance ; selon S.-J. Perse (1982, p. 444), la poésie est « plus qu’un mode de connaissance » : elle est « d’abord mode de vie – et de vie intégrale ».
Références bibliographiques
AQUIEN Michèle, 1993, Dictionnaire de poétique, Paris, Librairie Générale Française.
ARISTOTE, 1990, Poétique, traduction de Michel Magnien, Paris, Librairie Générale Française.
AXELOS Kostats, 1992, Héraclite et la philosophie. La Première Saisie de l’être en devenir de la totalité, Paris, Minuit.
BAUDELAIRE Charles, 1972, Les Fleurs du mal, Paris, Librairie Générale Française.
BONNEFOY Yves, 1987, Ce qui fut sans lumière, Paris, Gallimard.
CONCHE Marcel, 2003, Confession d’un philosophe, Paris, Gallimard.
DÉCULTOT Élisabeth, 2004, Vocabulaire européen des philosophies, Paris, Seuil.
DESCARTES René, 2016, Principes de la philosophie, Paris, PUF.
DUMONT Jean-Paul (dir.) et al., 1988, Les Présocratiques, Paris, Gallimard.
GARELLI Jacques, 1966, La Gravitation poétique, Paris, Mercure de France.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1979, Introduction à l’esthétique : le beau, traduit par S. JANKELEVITCH, Paris, Flammarion.
HEIDEGGER Martin, 1938, Hölderlin et l’essence de la poésie, repris dans Qu’est-ce que la métaphysique ?, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1966, Lettre sur l’humanisme, repris dans Questions III, Paris, Gallimard.
HUGO Victor, 2008, Les Contemplations, Paris, Flammarion.
HUGO Victor, 1980, Les Rayons et les Ombres, Paris, Gallimard.
JASPERS Karl, 2008, Introduction à la philosophie, Paris, Gallimard.
JOUBERT Jean-Louis, 2015, La Poésie, Paris, Armand Colin.
LAVELLE Louis, 1968, « Philosophie et poésie », in Chroniques philosophiques : science, esthétique, métaphysique, Paris, L’Harmattan.
PAZ Octavio, 1965, L’Arc et la Lyre, Paris, Gallimard.
PERSE Saint-John, 1982, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard.
PLATON, 1966, La République, Trad. Robert Baccou, Paris, Flammarion.
MARITAIN Jacques, 1985, Œuvres Complètes, volume X, Paris, Éditions Saint-Paul.
NIETZSCHE Friedrich, 1971, Ainsi parlait Zarathoustra. Paris, Gallimard.
NOËL Marie, 1995, Les Chansons et les Heures et Le Rosaire des joies, Paris, Gallimard.
SARTRE Jean-Paul, 2000, L’Existentialisme est un humanisme, Paris, P.U.F.
SCHELLING Friedrich Wilhelm Joseph von, 1999, Philosophie de l’art, Paris, Jérôme Million.
SCHLEGEL Friedrich von, 2012, Sur l’étude de la poésie grecque [Über das Studium der griechischen Poesie, 1797], Paris, L’Éclat.
SPINOZA Baruch, 2005, Éthique, traduit par Robert Misrahi, Paris-Tel-Aviv, Éditions de l’Éclat.
THORAVAL Jean et al., 1971, Les Grandes étapes de la civilisation française, Paris, Bordas-Monréal.
VIGNY Alfred de, 1973, Poèmes antiques et modernes. Les Destinées, Paris, Gallimard.
L’IMPLICITE DE LA THÈSE MARXIENNE DE L’INSÉPARABILITÉ DE L’HOMME ET DE LA NATURE
Boubakar MAIZOUMBOU
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
Résumé :
La thèse marxienne de l’inséparabilité de l’homme et de la nature consiste à définir l’homme comme être de la nature. Par cette thèse, Marx veut montrer que l’homme perd sa naturalité dans les rapports de production capitalistes. Ce texte met en exergue le sens caché de la thèse marxienne sur la naturalité de l’homme. Pour ce faire, notre réflexion se penche, dans un premier moment, sur la définition de l’homme comme être de la nature. Ce qui permet de dégager, dans un deuxième moment, la vraie signification de cette définition. Et, dans le troisième moment, il s’agit de montrer que même identique à la nature, l’homme y fait face comme un être à la fois passif et actif.
Mots-clés : Dénaturation, Désobjectivation, Homme, Nature, Production capitaliste.
Abstract :
The Marxian thesis of the inseparability of man and nature consists in defining man as a being of nature. With this thesis, Marx wants to show that man loses his naturalness in the capitalist relations of production. This text attempts to highlight this implicit aspect of the Marxian thesis on man’s naturalness. In order to do so, our reflection first looks at the definition of man as a being of nature. This allows us to identify, in a second moment, the true meaning of this definition. In the third part, we show that even though man is identical to nature, he faces it as both a passive and an active being.
Keywords : Denaturation, Deobjectification, Man, Nature, capitalist Production.
Introduction
La thèse de l’inséparabilité de l’homme et de la nature n’a pas fait l’objet d’un commentaire particulier chez les penseurs marxistes. D’où la réaction de Serge Cantin qui suggère qu’on revienne sur la conception marxienne de l’homme pour définir l’humanité de l’homme d’aujourd’hui :
Je voudrais m’élever contre un tel traitement que l’on est en passe d’infliger à l’œuvre de Marx, et tenter de montrer, à travers la reprise de la question du statut de l’homme marxien, qu’en dépit de son apparente éclipse de notre champ intellectuel, cette œuvre appartient toujours, qu’on le veuille ou non, à notre horizon politique et qu’elle mérite par conséquent d’être discutée, non seulement sur le plan de sa cohérence interne, mais également à partir de ce qui, dans notre présent postmarxiste, nous place à nouveau devant la tâche impérieuse de définir l’humanité de l’homme. (S. Cantin, 1991, p. 27)
Peut-on dire alors que cette thèse marxienne de l’inséparabilité de l’homme et de la nature n’a pas fait l’objet d’une véritable préoccupation philosophique chez les marxistes ? Pourtant cette thèse traverse presque tous les ouvrages fondamentaux de Marx comme les Manuscrits de 1844, L’Idéologie allemande et Le Capital.
Nous revenons sur cette thèse, dans le cadre de cet article, pour poser la question principale de ce qu’elle implique véritablement chez Marx. De façon précise, que signifie chez Marx la définition de l’homme comme être de la nature ? L’inséparabilité de l’homme et de la nature empêche-t-elle celui-ci d’y faire face en tant qu’être actif ?
Pour analyser ces questions, nous dégageons trois axes de réflexion. Le premier axe traite de la définition chez Marx de l’homme comme être de la nature. Le deuxième analyse l’implication philosophique de cette définition, et le troisième montre que dans l’inséparabilité avec la nature, l’homme se pose face à elle comme un être plus actif que passif.
1. L’homme comme être de la nature
S’il y a une question philosophique qui lie les œuvres de Marx, c’est véritablement celle du rapport de l’homme à la nature. Comme dans les Manuscrits de 1844, L’Idéologie allemande, dans Le Capital, danssa dernière œuvre, Marx défend sa position en ce qui concerne le rapport de l’homme à la nature. Dans ce rapport, il soutient l’inséparabilité de l’homme et de la nature. Pour justifier notre propos, nous partons d’une approximation entre des phrases de Marx dans des ouvrages différents, mais qui, en fin de compte, dévoilent toute la thèse marxienne de l’inséparabilité de l’homme et de la nature.
Ainsi, dans les Manuscrits de 1844 K. Marx (1972, p. 63) écrit : « Dire que la vie physique et intellectuelle de l’homme est indissolublement liée à la nature ne signifie pas autre chose sinon que la nature est indissolublement liée avec elle-même, car l’homme est une partie de la nature ». Dans L’Idéologie allemande K. Marx (1968, p. 70) soutient que « la première présupposition de toute histoire humaine est naturellement l’existence d’êtres humains vivants » ; ou bien encore qu’« aussi longtemps qu’existent des hommes, leur histoire et celle de la nature se conditionnent réciproquement » (K. Marx, 1968, p. 45).
Qu’est-ce que ces phrases de Marx dans les Manuscrits de 1844 et dans L’Idéologie allemande veulent dire sinon, comme il le réaffirme dans Le Capital, que « l’homme ne peut procéder autrement que la nature elle-même » (K. Marx, 1976, p. 47). Dans Le Capital, comme dans les ouvrages qui lui sont antérieurs, Marx n’a cessé de soutenir sa thèse de l’inséparabilité de l’homme et de la nature qui consiste à considérer l’homme comme la nature. C’est à partir de cette approche de l’homme comme faisant partie intégrante de la nature, qu’il aborde la question de son être. En somme chez Marx, « l’homme est immédiatement être de la nature » (K. Marx, 1972, p. 136).
C’est une thèse que Gérard Raulet (1982, p. 124) reprend et réaffirme dans son interprétation de la démarche blochienne qui consiste elle-même à expliquer le matérialisme marxiste. Il part de l’idée selon laquelle chez Bloch et chez Marx, l’homme et la nature n’existent que l’un par l’autre, qu’ils se réalisent dans la dialectique de leurs rapports et non dans une dualité où l’homme s’oppose à la nature pour se réaliser. Ainsi qu’il le dit :
Le refus d’une séparation entre Matérialisme historique et Matérialisme dialectique, histoire et nature, le refus aussi d’une démarche qui conduit à ne plus envisager la question de la nature interdit d’envisager le projet humain et le projet naturel autrement que par leur indissociabilité. (G. Raulet, 1982, p. 124).
La continuité de cette thèse dans les ouvrages de Marx fait dire à Franck Fischbach qu’elle
est centrale chez Marx et elle n’a rien d’option d’une jeunesse sur laquelle les écrits de la maturité seraient revenus. Au contraire, Marx devait la maintenir encore et la reprendre telle qu’elle dans l’un des derniers écrits qu’il devait rédiger, ses Notes marginales sur le « Traité d’économie politique » d’Adolph Wagner. (F. Fischbach, 2005, p. 33).
Ces notes marginales sur le « Traité d’économie politique » d’Adolph Wagner », sont aussi présentes dans Livre deuxième du Capital in K. Marx, Le Capital, Op. cit., p. 459-484.Serge Cantin (1991, p. 47) pense la même chose en laissant comprendre qu’il n’y a qu’un seul Marx dont la position philosophique est partie de son naturalisme dans les Manuscrits de 1844. À ce propos, il affirme ceci : « (…) je ne crois pas, dit-il, qu’il y ait deux Marx ; il n’y en a qu’un, dont le geste philosophique, pour complexe qu’il soit, trouve néanmoins son principe d’intelligibilité dans le naturalisme des Manuscrits de 1844 ».
Comme Spinoza avant lui, Marx veut ainsi partir de la nature pour comprendre l’homme. En tant qu’être de la nature, en tant qu’une partie de la nature, l’homme, selon Marx, ne peut être appréhendé autrement que par la nature. Pour défendre cette idée, il part du fait que le premier acte qui nous permet de définir l’homme, comme tout être vivant dans la nature d’ailleurs, est celui de la recherche de la garantie immédiate de sa subsistance. D’où est-ce que l’homme peut obtenir cette garantie si ce n’est que dans et par la nature ? C’est pourquoi dans Le Capital Marx considère le travail comme le principal médiateur entre l’homme et la nature. Ainsi, il souligne :
en tant qu’il produit des valeurs d’usage, qu’il est utile, le travail, indépendamment de toute forme de société, est la condition indispensable de l’existence de l’homme, une nécessité éternelle, le médiateur de la circulation matérielle entre la nature et l’homme (K. Marx, 1976, p. 46-47).
Il se dégage de cette phrase de Marx deux implications qui font toutes de l’homme un être inséparable de la nature. Par le travail, il doit être nécessairement en contact permanent avec la nature pour garantir sa subsistance, seule condition de sa survie. L’homme doit, par la nature, produire les conditions de son existence. Produire les conditions de son existence c’est, en d’autres termes, travailler en vue d’obtenir des produits de consommation qui constituent ses moyens de subsistance.
En outre, le résultat du travail de l’homme laisse toujours apparaître quelque part la marque de la nature. L’homme ne peut, ainsi, rien produire qui ne soit teinté du naturel. C’est pourquoi K. Marx (1976, p. 47) dit en ce sens que « si l’on en soustrait la somme totale des divers travaux utiles qu’ils recèlent (les valeurs d’usages), il reste toujours un résidu matériel, un quelque chose fourni par la nature et qui ne doit rien à l’homme ».
Ce qui revient à dire que dans l’acte de produire même où l’on pense que l’homme fait seulement usage de sa raison, il y a toujours l’empreinte de la nature. Le produit du travail de l’homme n’est pas que rationnel, il est aussi et avant tout naturel. L’usage de la raison dans l’activité productrice de l’homme est toujours accompagné de quelque chose venant de la nature, ce qui fait que dans Le Capital Marx refuse d’admettre le travail comme l’unique source des valeurs d’usage qu’il produit ou de la richesse qu’il permet d’obtenir. En effet, dans la production des valeurs d’usages, que Marx considère d’ailleurs comme simple transformation ou simple changement de la forme de la matière, l’homme, le travailleur, « est encore constamment soutenu par des forces naturelles » (K. Marx, 1976, p. 47). Citant William Petty en ce sens, Marx dit que l’homme « est le père » de la richesse, et « la terre, la mère » (K. Marx, 1976, p. 47).
Pour Marx, en dehors même de l’objet de travail, un élément purement naturel et fondamental dans le procès de travail, le seul fait que l’homme fasse usage de sa force physique de travail dans le procès de production explique la naturalité de ses actes, donc de son être. Ainsi, selon Marx, les premiers rapports, ou le rapport originel, de l’homme à la nature sont des rapports non pas de connaissance ou de contemplation, non pas théoriques, mais « d’emblée pratiques, donc fondés par l’action » (K. Marx, 1976, p. 466).
Les premiers rapports de l’homme à la nature sont donc des rapports naturels définissant l’homme comme un être non pas pensant mais de besoin, non pas réfléchissant sur telle ou telle chose, mais préoccupé par les conditions de la garantie de la satisfaction de ses besoins vitaux. C’est ce que souligne K. Marx (1976, p. 406) en disant que « les hommes commencent, comme tout animal, par manger, boire, etc., donc non par être en rapport, mais par se comporter activement, par s’emparer par l’action de certaines choses du monde extérieur et par satisfaire leur besoin de cette façon ». Marx conclut tout simplement qu’« ils commencent donc par la production » (K. Marx, 1976, p. 406).
Dans un article consacré à l’interprétation dumontienne (L. Dumont, 1977) de Marx, Serge Cantin (1991, p. 38) a bien rappelé la portée philosophique de cette thèse marxienne sur le rapport de l’homme à la nature. Pour lui, « ce qui est anthropologiquement et ontologiquement premier pour Marx, c’est la nécessité vitale, la vie et les moyens de la conserver, donc le travail ». Ce qui signifie qu’en tant qu’être de besoin, l’homme commence d’abord et avant tout par être affecté par la nature et les autres êtres naturels, à travers la production de sa vie. Or en l’homme, comme peut le témoigner F. Fischbach (2005, p. 34), « l’affection et la passivité sont premières », et ce sont elles qui impulsent l’activité humaine ; d’où un rapport pratique de l’homme à la nature qui fait de lui immédiatement une partie de la nature, un être de la nature.
Cela revient à dire qu’en tant que partie de la nature, l’homme ne peut pas s’empêcher de subir les effets produits sur lui par les autres parties de la nature. Ce qui rappelle d’ailleurs le mode fini spinoziste : « Nous pâtissons en tant que nous sommes une partie de la nature, qui ne peut se concevoir par soi sans les autres » (B. Spinoza, 1992, p. 349). C’est sans doute en ce sens que K. Marx (1972, p. 119) est amené à affirmer que « les sensations, les passions, etc., de l’homme ne sont pas seulement des déterminations anthropologiques au sens étroit, mais sont vraiment des affirmations ontologiques essentielles ».
Fischbach est parti de cette affirmation pour soutenir que c’est uniquement en tant que spinoziste que Marx peut soutenir le sens proprement ontologique des passions humaines dont la portée ontologique est qu’elles révèlent l’inscription de l’homme au sein de l’ordre commun de la nature auquel il ne peut aucunement faire exception. En conséquence, il donne une conclusion influencée par Spinoza, à l’approche marxienne de l’homme et de la nature :
Prendre les passions humaines au sérieux, les comprendre comme les effets produits sur une partie de la nature par les autres parties de la nature, et ainsi reconnaître la native servitude passionnelle des hommes en tant qu’êtres naturels et vivants, c’est en même temps admettre qu’une anthropologie véritable, c’est-à-dire naturaliste, conduit à une ontologie de la finitude essentielle (F. Fischbach, 2005, p. 594).
Seulement, on peut par ailleurs chercher à savoir ce que signifie véritablement chez Marx l’homme défini comme être de la nature ou comme une partie de la nature.
2. La signification chez Marx de la définition de l’homme comme être de la nature
L’homme comme être de la nature ne veut rien dire que ce que K. Marx (1972, p. 137) avait déjà dit de l’homme dès les Manuscrits de 1844, où il le définissait comme « un être objectif, naturel et sensible ». La définition de l’homme comme un être objectif se retrouve dans Le Capital où K. Marx (1993, p. 227) qui montre clairement que « l’être humain lui-même, considéré comme pure existence de force de travail, est un objet naturel, une chose, certes vivante et consciente de soi, mais une chose – et le travail proprement dit est la réification de cette force ».
Considérer l’homme comme un objet naturel revient à le considérer comme une chose dans la nature au même titre que les autres choses naturelles, comme un être dans la nature au même titre que les autres êtres naturels. C’est ce qui a amené Fischbach, en partant de Spinoza, à considérer l’homme marxien comme un mode fini parmi d’autres modes finis de la nature, de sorte qu’on peut dire de lui comme de l’homme spinoziste que « nous sentons qu’un certain corps est affecté de beaucoup de manières » (F. Fischbach, 1999, p. 95).
Cette situation de co-naissance, comme dit F. Fischbach (2009, p. 27), de « coappartenance » avec d’autres êtres naturels, avec la nature tout simplement, affecte l’homme. Il est affecté, souligne K. Marx (1972, p. 136), « en sa qualité d’être naturel, en chair et en os, sensible, objectif, pareillement aux animaux et aux plantes ». Ce qui, selon K. Marx (1972, p. 136) fait de l’homme d’emblée un « être passif, dépendant et limité » vis-à-vis d’autres objets naturels ?
L’homme de Marx est donc un être objectif parce qu’il vit dans un rapport, précise F. Fischbach (2005, p. 87), « essentiel et nécessaire » à d’autres objets. Comme tout être vivant, l’homme marxien dépend, pour la garantie de sa subsistance ou de sa vie, d’autres objets qui existent réellement et objectivement autour de lui, extérieurs à lui. Ces objets naturels, l’homme marxien peut les trouver posés dans la nature comme il est posé lui-même ou se les approprier en les produisant pour se maintenir en vie.
Ainsi, ces objets naturels sont, comme dit K. Marx (1972, p. 136), « des objets indispensables, essentiels pour la mise en jeu et à la confirmation de ses forces essentielles ». Dans Le capital, K. Marx (1976, p. 136) reprend autrement cette affirmation en laissant comprendre que « les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et main, il les met en mouvement, afin de s’assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa vie ».
En d’autres mots, Marx veut dire qu’être objectif, c’est être naturellement. Or dire que l’homme est ou vit naturellement, revient à affirmer sa nécessaire participation ou appartenance à l’être de la nature elle-même. Car comme K. Marx (1972, p. 137) l’affirme : « dire que l’homme est un être en chair et en os, doué de forces naturelles, vivant, réel, sensible, objectif, c’est dire qu’il a pour objet de son être, de la manifestation de sa vie, des objets réels, sensibles, et qu’il ne peut manifester sa vie qu’à l’aide d’objets réels, sensibles ».
Autant dire que l’homme et la nature se confondent. Ils le sont d’autant plus que l’homme ne peut rien entreprendre qui ne soit d’abord et avant tout conditionné par la nature en tant qu’elle est la garantie de sa vie productive, c’est-à-dire son être générique, celle de son espèce. C’est en ce sens que F. Fischbach (2005, p. 62) pense que l’activité productrice de l’homme qui n’est que vitale doit être considérée comme « l’attestation de l’unité de l’homme et de la nature en tant qu’unité processuelle médiatisée par l’homme ». K. Marx (1972, p. 62) défendait déjà cette idée dès les Manuscrit de 1844 en stipulant : « dire que la vie physique et intellectuelle de l’homme est indissolublement liée à la nature ne signifie pas autre chose sinon que la nature est indissolublement liée avec elle-même ».
Cette naturalisation de l’homme qui a retenu l’attention de Marx a bien été exprimée avant lui par celui qu’on tient généralement pour son plus proche précurseur philosophique, c’est-à-dire Feuerbach. Pour ce dernier en effet, cité par K. Marx (1972, p. 137), « l’objet auquel un sujet se rapporte par essence et par nécessité n’est rien d’autre que l’essence propre de ce sujet, mais objectivée ».
De ce point de vue, toute situation de remise en cause de cette dépendance de l’homme des autres objets de la nature est synonyme d’une perte pour lui de ces objets. Or toute l’analyse de Marx dans Le Capital s’emploie à montrer, voire à démontrer comment l’homme assiste impuissamment à la perte de ces objets dans le mode de production capitaliste.
Alors que par son premier acte, celui de produire les moyens de sa subsistance, l’homme est immédiatement connecté aux objets naturels, la production capitaliste, selon Marx, vient le séparer de ces objets. De ce fait, on assiste, comme le souligne F. Fischbach (2009, p. 151), à « la privation d’objectivité », à la « perte de l’objectivité, privation de la passivité » (2009, p. 156), qui n’est que l’équivalent de l’expression deleuzienne d’« une perte du monde » (1985, p. 224) ou la « rupture du lien de l’homme et du monde » (1985, p. 220).
Les concepts de fétichisme et d’exploitation, dans Le Capital, sont chargés de multiples formes de perte de l’objet auxquelles l’homme est soumis dans le mode de production capitaliste. Toutes les formes de perte de l’objet que produit et reproduit le mode de production capitaliste peuvent être traduites ou même regroupées en concept de « désobjectivation » employé par F. Fischbach (2009, p. 156) pour expliquer le concept marxien d’« aliénation » qui trouve son ample signification dans ce que dit A. Gorz (2008, p. 62) du mode capitaliste de production en soulignant que nos besoins « ne sont plus des besoins naturels, spontanément éprouvés, ce sont des besoins produits en fonction des besoins de rentabilité du capital ».
L’aliénation désigne chez Marx le fait que le moyen de subsistance d’un homme est celui d’un autre homme, que l’objet de besoin d’un homme est la possession inaccessible d’un autre homme, c’est-à-dire que l’homme assiste impuissamment à la dépossession de la dimension d’objectivité de son être. Chez Marx, en effet, le mode capitaliste de production est un processus de désobjectivation de l’homme, de rupture de l’unité de l’homme et de la nature, de privation de l’homme de ses besoins naturels, de dénaturation de l’homme. C’est sans doute cette thèse marxienne de l’unité de l’homme et de la nature qui fait dire à Jacques Aumètre (1988, p. 141-167) que « de toute façon, on ne saurait, dans le marxisme, analyser les processus sociaux, et notamment idéologiques, en ignorant l’action des hommes sur la nature et dans la société, en la traitant comme si elle était réductible au mouvement des choses C’est cette dénaturation de l’homme provoquée par les rapports sociaux de production dans le mode de production capitaliste, qu’il faut comprendre la thèse marxienne de l’inséparabilité de l’homme et de la nature.
3. L’homme face à la nature
Ce n’est pas parce qu’il est une partie de la nature, un être de la nature, que l’homme s’assimile totalement à la nature. Il n’est pas complètement et exclusivement dépendant et passif au même titre que les autres êtres vivants. L’analyse du concept de travail dans Le Capital nous permet de comprendre cela. Marx y définit, en effet, le travail comme exclusivement humain :
Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il opère seulement un changement dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté (K. Marx, 1976, p. 136-137).
Marx veut souligner ici la capacité qu’a l’homme, contrairement à l’animal, de s’approprier la nature en prédéfinissant son action sur elle. L’idée est déjà présente chez K. Marx (1968, p. 70) dès L’Idéologie allemande où il pensait qu’« on peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l’on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à produire leurs moyens d’existence ».
Par l’acte de produire, l’homme n’est donc pas simplement un être passif comme les autres êtres de la nature. Par l’acte de produire que Marx tient pour exclusivement humain, l’homme atteste activement ses preuves d’être « un être générique » (K. Marx, 1972, p. 64). Être générique, c’est pour l’homme être capable de se reconnaître en tant qu’homme par le dédoublement de soi-même à travers l’objet produit, et donc de façon active et réelle dans un monde qu’il a lui-même créé.
Ce n’est donc pas seulement par la conscience ou de façon intellectuelle, comme l’ont toujours soutenu les philosophies du sujet, que l’homme peut reconnaître son essence d’être homme. « C’est là, note Fischbach, une différence de taille relativement aux théories idéalistes de la conscience, une différence sur laquelle Marx ne manque d’ailleurs pas d’insister dès les Manuscrits de 1844 » (F. Fischbach, 2005, p. 58). K. Marx l’affirme sans ambiguïté :
Grâce à cette production, la nature apparaît comme son œuvre et sa réalité. L’objet du travail est donc l’objectivation de la vie générique de l’homme : car celui-ci ne se double pas lui-même d’une façon seulement intellectuelle, comme c’est le cas dans la conscience, dans un monde qu’il a créé (K. Marx, 1968, p. 70).
Marx pense que l’homme, contrairement aux autres êtres vivants de la nature, ne se contente pas seulement des données de la nature, mais « façonne aussi d’après les lois de la beauté » (K. Marx, 1968, p. 70). Cette affirmation de Marx dans les Manuscrits de 1844 s’apparente à ce qu’il dit des moyens de travail dans Le Capital.
En effet, nous pensons que la beauté dont parle Marx dans la transformation humaine de la nature dans les Manuscrits de 1844 ne veut rien dire d’autre que les différences de manière dans la fabrication des moyens de travail d’une époque économique à l’autre qu’il évoque dans Le Capital. K. Marx (1976, p. 138) souligne clairement dans cet ouvrage que « ce qui distingue une époque économique d’une autre, c’est moins ce que l’on fabrique, que la manière de fabriquer les moyens de travail par lesquels on fabrique. » Mieux encore, K. Marx (1976, p. 138) pense que « les moyens de travail sont les gradimètres du développement du travailleur, et les exposants des rapports sociaux dans lesquels il travaille ».
En d’autres mots, Marx veut dire qu’en fonction des moyens de travail on peut comprendre non seulement l’état du développement intellectuel de l’individu travailleur, mais aussi et surtout la nature des rapports sociaux dans lesquels il se trouve. C’est en ce sens qu’il considère, dans Le Capital, toute production comme immédiatement de l’autoproduction. De sorte qu’en agissant sur la nature en vue de la production de sa vie, l’homme s’autoproduit. « En même temps (…) qu’il agit, dit Marx, sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature, et développe les facultés qui y sommeillent » (K. Marx,1976, p. 136).
L’idée d’autoproduction dans Le Capital est l’équivalente de celle d’« activation de soi » (1968, p. 98) dont parlent Marx et Engels dans L’Idéologie allemande. Mais dans Le Capital comme dans L’Idéologie allemande, l’autoproduction ou l’activation de soi se trouvent être entravées par les rapports de production qu’entretiennent les hommes entre eux à un certain stade de leur développement. C’est ce que Marx s’emploie à démontrer dans sa critique du mode capitaliste de production dans Le Capital. Il y analyse et révèle les contradictions du monde capitaliste de production par rapport à la nature de l’homme qui fait de lui au départ un être agissant, de par son activité. Le Capital tout entier est le lieu où Marx a longuement analysé et critiqué le développement contradictoire des forces productives dont l’activité de l’homme n’est que la forme achevée. Ce sont en effet, selon Marx, les rapports de production et les modes d’échange capitalistes qui correspondent, sinon qui conditionnent toujours les forces productives qui sont à la base de la contradiction, de la remise en cause de la nature active des hommes, de leur activation de soi. Ainsi, pour K. Marx :
tant que la contradiction n’est pas apparue, les conditions dans lesquelles les individus entrent en relation entre eux sont des conditions inhérentes à leur individualité ; elles ne leur sont nullement extérieures et, seules, elles permettent à ces individus […] de produire leur vie matérielle et tout ce qui en découle (K. Marx (1968, p. 98).
En d’autres mots, dans la production naturelle de leur vie les hommes entrent en rapport entre eux, et les conditions de ces rapports sont les conditions de leur activation de soi, de l’autoproduction. C’est le « procès de travail » qui constitue pratiquement l’opération de production par laquelle l’homme se met en contact directe avec la nature. « Voici les éléments simples dans lesquels le procès de travail se décompose : 1. activité personnelle de l’homme, ou le travail proprement dit ; 2. objet sur lequel le travail agit ; 3. moyen par lequel il agit » (K. Marx, 1968, p. 137). K. Marx (1968, p. 138) le considère comme le lieu où « l’activité de l’homme effectue (…) à l’aide de moyens de travail une modification voulue de son objet ».
Autrement dit, par son activité de production l’homme ajoute quelque chose de soi à la nature. Pour Marx, c’est là où réside « l’avantage que l’homme a sur l’animal » (1968, p. 138), celui de pouvoir transformer à sa guise la nature, celui d’être capable de reproduire toute la nature. « L’animal, précise Marx, ne se produit que lui-même, tandis que l’homme reproduit toute la nature » (K. Marx, 1968, p. 138).
L’expression « toute la nature » a ici la signification de la totalité de la nature ou de la nature entière et laisse comprendre que l’homme, par son activité, est capable d’atteindre le tout de la nature. Ce qui est une marque de spécificité de la production humaine dans et par la nature relativement aux autres espèces de la nature.
C’est en ce sens que F. Fischbach (2005, p. 61) pense qu’« il n’y a (…) rien dans la nature que le travail humain ne puisse transformer et qu’il ne puisse s’approprier, dont il ne puisse faire le matériau d’une production jusqu’ici inédite ». D. Schmidt (1994, p. 44) dit la même chose en pensant que chez Marx toute la nature est « un moment de la praxis humaine ». En ce sens où l’homme est capable de s’approprier la nature dans sa totalité, ces auteurs ne disent pas autre chose que ce que Marx dit déjà dans Le Capital lorsqu’il pense que la nature entière devient un organe de l’activité de l’homme, un organe qui s’ajoute donc à ceux de son propre corps biologique. Pour F. Fischbach (2005, p. 14),
On objectera certainement, dit que si l’aliénation est la perte d’objectivité d’un être objectif, elle n’a rien de proprement humain, puisque tous les êtres de la nature sont des êtres objectifs et que tous peuvent se voir soustraits leurs objets propres. Sauf que les hommes sont, pour Marx, des êtres plus objectifs que les autres (ce qui introduit une différence de degré et non de nature) : 1. Parce que, en raison de leur conformation corporelle spécifique, ils peuvent nouer davantage des rapports à l’objectivité ; 2. Parce qu’ils ne se contentent pas de trouver les objets de leurs besoins, mais les produisent ; 3. Parce qu’ils produisent des objets essentiels même et surtout en dehors de tout besoin immédiat ; 4. Parce qu’ils sont les seuls (par la connaissance) à pouvoir entrer en relation avec le tout de la nature objective.
Cette idée est présente dans la pensée de Marx dès les Manuscrits de 1844 où il dit que « la nature, c’est-à-dire la nature qui n’est pas elle-même le corps humain, est le corps non-organique de l’homme » (K. Marx, 1972, p. 62).
Aussi, c’est ce que Marx voudrait dire lorsqu’il écrit dans L’Idéologie allemande que « les communistes traitent-ils les conditions créées par la production et le commerce avant eux comme des facteurs inorganiques » (K. Marx, 1968, p. 97) ; tout comme quand il pense dans les Grundrisse, d’ailleurs plus proches du Capital, que, « de même que le sujet qui travaille est individu naturel, existence naturelle, [de même] la première condition objective de son travail apparaît comme nature, comme terre, comme son corps non-organique » (K. Marx, 1980, p. 425).
« Inorganique » ou « non-organique » est, pour Marx, quelque chose qui constitue un prolongement du corps organique de l’homme, ce avec quoi l’homme fait en quelque sorte corps dans le déploiement même de son activité propre. Ainsi, traiter les conditions engendrées par la production humaine antérieure à nous comme des conditions inorganiques de notre propre existence, c’est les considérer comme des conditions que notre existence prolonge ou qui trouvent leur prolongement en elle. C’est donc les traiter comme quelque chose que nous avons la capacité de maîtriser, comme des conditions dont nous pouvons disposer. Ces conditions s’imposent à nous comme un donné naturel radicalement indépendant de nous et extérieur à nous.
L’appropriation par l’homme de la nature concourt à expliquer que la naturalité de l’homme n’est pas à confondre avec celle des autres êtres vivants. Être naturel pour l’homme ne veut pas dire absence de choix dans l’activité de production de sa vie. L’activité productrice de l’homme porte l’empreinte d’un être vivant certes naturel, mais capable de manipuler la nature selon sa convenance.
L’homme marxienne se contente donc pas comme l’animal de sa situation d’être naturel pour ne rien entreprendre qui ne puisse changer quelque chose à son être générique, à sa nature d’être homme. Pour comprendre la situation à la fois de passiveté et d’action de l’homme dans son rapport à la nature, il faut savoir, comme souligne M. Savadogo (2012, p. 20), qu’« originairement, l’homme se heurte d’abord aux êtres qu’il trouve devant lui et s’emploie à les soumettre pour parvenir à assurer sa conservation ».
Conclusion
Il s’est agi, à travers ce texte, d’actualiser la thèse marxienne de l’inséparabilité de l’homme et de la nature. On retient que cette thèse est l’occasion non seulement pour Marx de montrer toute la valeur de la définition de l’homme comme être de la nature, mais aussi et surtout de la remise en cause de celle-ci par le mode de production capitaliste. Dans ce contexte, l’homme perd ce statut avec la perte des objets censés lui garantir son lien avec la nature, avec soi-même. Par cette thèse donc, Marx veut que l’on mesure la gravité de la contradiction qui caractérise les rapports sociaux de production dans le mode de production capitaliste. Ce sont des rapports qui engendrent chez l’homme la perte pour soi de la nature, de son être.
Références bibliographiques
AUMETRE Jacques, « Habermas et Althusser : critique de l’idéologie scientiste et critique de l’humanisme idéologique », in Philosophiques, vol. 15, n° 1, 1988, p. 141-167, http://id.erudit.org/iderudit/027040ar, (consulté le 24/05/2023).
CANTIN Serge, 1991, « L’homme de Marx est-il un sujet individuel ou un être social ? À propos de l’interprétation de Marx par Louis Dumont », in Philosophiques, vol. 18, n° 1, p. 27, http://id.erudit.org/iderudit/027140ar (consulté le 24/05/2023).
DUMONT Louis, 1977, Homo qualis. Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Paris, Gallimard.
DELEUZE Gilles, 1985, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit.
FISCHBACH Franck, 2009, Sans objet. Capitalisme, subjectivité et aliénation, Paris, J. Vrin.
FISCHBACH Franck, 2005, La production des hommes. Marx avec Spinoza, Paris, PUF.
GORZ André, 2008, Ecologica, Paris, Galilée.
MARX Karl, 1976, Le Capital. Critique de l’économie politique, 3 vol., Livre premier, Trad. Joseph Roy, Livre deuxième, Trad. Erna Cogniot, Cohen-Solal et Gilbert Badia, Livre troisième, Trad. Cohen-Solal et Gilbert BADIA, Paris, Éditions Sociales.
MARX Karl, 1993, Le Capital, Livre I, Trad. J.-P. LEFEVRE, Paris, PUF.
MARX Karl, 1972, Manuscrits de 1844, Trad. Émile BOTTIGELI, Paris, Éditions Sociales.
MARX Karl, 1980, Manuscrits de 1857-58 – « Grundrisse », tome 1, Trad. collective sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Éditions sociales.
MARX Karl, ENGELS Friedrich, 1968, L’Idéologie allemande, Trad. H AUGIER, G. BADIA, J. BAUDRILLARD, R. CARTELLE, Paris, Éditions Sociales.
RAULET Gérard, 1982, Humanisation de la nature-naturalisation de l’homme. Ernst Bloch ou le projet d’une autre rationalité, Paris, Klincksieck.
SAVADOGO Mahamadé, 2012, Penser l’engagement, Paris, L’Harmattan.
SCHMIDT Dont, 1994, Le concept de nature chez Marx, Trad. Jacqueline BOIS, Paris, PUF.
SPINOZA Baruch, 1999, Éthique II, Trad. B. PAUTRA, Paris, Seuil.
LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ CHEZ JEAN-PAUL SARTRE
Lago II Simplice TAGRO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La philosophie de Jean-Paul Sartre est qualifiée d’existentialisme athée. Ce qualificatif vient du fait qu’elle nie, au départ, l’existence d’un Dieu pourvoyeur d’essence. Il faut, cependant, aller au-delà de cette simple négation de Dieu pour y voir, en réalité, le désir du philosophe français d’asseoir une philosophie de la responsabilité, enjeu ou prolongement de la liberté qui est consubstantielle à l’homme. La liberté sartrienne n’est donc pas à voir comme une vie de licence, comme on pourrait l’alléguer mais elle est, au contraire, une pensée qui fait de l’homme l’auteur exclusif de ses choix qui l’engagent, mais qui doivent également prendre en compte le choix des autres : la liberté de l’homme donc sa responsabilité vis-à-vis de lui-même et à l’égard des autres.
Mots-clés : Choix, Dieu, Liberté, Responsabilité, Universalité.
Abstract :
Jean-Paul Sartre’s philosophy is described as atheistic existentialism. This qualifier comes from the fact that it denies, initially, the existence of a God purveyor of essence. It is necessary, however, to go beyond this simple negation of God to see, in reality, the desire of the French philosopher to establish a philosophy of responsibility, stake or extension of freedom that is consubstantial with man. Sartrian freedom is therefore not to be seen as a life of absence of license, as one might allege, but it is, on the contrary, a thought that makes man the exclusive author of his choices that engage him but which must also take into account the choice of others: the philosophy of Sartre combines, so to speak, human subjectivity and universality of social life.
Keywords : Freedom, Responsibility, Choice, God, Universality.
Introduction
Jean-Paul Sartre est particulièrement connu pour sa philosophie existentialiste, selon laquelle les choses sont (qu’elles soient naturelles ou fabriquées, elles ont une essence) tandis que l’homme existe. Cette idée célèbre est résumée par la formule « L’existence précède l’essence » chez l’homme. En effet, pour le philosophe français, l’homme est essentiellement libre et ne se définit que par ses actes. Aussi pour J.-P Sartre (1970, pp. 36-37), « l’homme est liberté ». Cette définition de l’homme par la liberté met en relief la consubstantialité entre la liberté et l’existence humaine. Ainsi, contrairement à l’existentialisme chrétien qui suggère une existence certes éprouvante mais toutefois conduite par la foi, l’existentialisme athée dont se réclame Sartre conçoit l’existence d’une manière plus radicale. Pour ce courant existentialiste qui nie l’existence de Dieu, l’homme est totalement libre et ne subit aucun déterminisme. Il est délaissé et se trouve seul, face à son destin avec l’obligation d’être entièrement responsable de sa vie. Ainsi, aux yeux de Sartre, la liberté induit la responsabilité comme son corollaire indissociable. J.-P. Sartre (1943, p. 612) lui-même définissait la responsabilité comme « la conscience d’être l’auteur incontestable d’un événement ou d’un objet ». Être l’auteur incontestable d’un événement implique qu’il faut non seulement le revendiquer, mais aussi en assumer la responsabilité. Mais alors, qu’est-ce qui fonde la liberté chez Sartre et pourquoi la responsabilité en est-elle l’enjeu majeur ou son horizon incontournable ?
Ces questions visent à montrer le fondement de la liberté chez Sartre et à indiquer que la responsabilité est sa vérité. Avant de répondre à ces deux questions majeures, nous commencerons par un bref historique de la notion de responsabilité, corollaire de la liberté
1. Aperçu de la responsabilité et de la liberté avant Sartre
Jean-Paul Sartre n’est pas pionnier dans l’évocation de la liberté et de la responsabilité dans l’histoire de la philosophie. Avant lui, des penseurs ont éloquemment abordé la question, certes en des termes différents, mais avec le même objectif, celui de donner à l’homme la conscience d’une liberté solidaire de la responsabilité qui la sous-tend. La métaphore de l’allégorie de la caverne de Platon illustre bien ce sens de la liberté partagée du philosophe.
1.1. Liberté et responsabilité chez Platon
Platon utilise régulièrement les mythes ou les allégories comme moyens d’expression de sa pensée. Dans l’allégorie de la caverne exposé en tout début du Livre VII de La République, il décrit la condition humaine comme une prison où les hommes sont enchaînés et incapables de tourner leur tête pour se rendre compte qu’en réalité, ce qu’ils voient n’est que l’ombre des réalités projetées.
Représente-toi des hommes dans une sorte d’habitation souterraine en forme de caverne…Les hommes sont dans cette situation depuis l’enfance, les jambes et le cou ligotés de telle sorte qu’ils restent sur place et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux, incapables de tourner leur tête à cause de leurs liens (Platon, 2016, 514a-514b).
En effet, dans cette situation de prisonniers, ces hommes enchaînés ne peuvent voir, derrière eux, les Réalités du monde intelligible qui est le monde de la vérité alors que le monde des prisonniers est celui des illusions appelé aussi monde sensible. Le monde intelligible abrite l’Idée du Bien dont la vue procure sagesse et bien-être. En effet, pour Platon (2016, 517 c), « l’Idée du Bien, il faut la voir pour se conduire avec sagesse soit dans la vie privée, soit dans la vie publique. »
Voir l’Idée du Bien n’est cependant pas une fin en soi pour le prisonnier. Après avoir séjourné dans le monde intelligible et y avoir observé l’Essence des choses dont le monde sensible constitue la photocopie affaiblie, il redescend dans ce dernier pour y partager, avec ses congénères, son expérience d’homme libre. Cette étape du retour du prisonnier-philosophe dans la caverne est symptomatique de l’idée de solidarité et de responsabilité qui caractérise le philosophe. En effet, ce dernier, contrairement à l’opinion répandue, n’est pas un marginal peu soucieux du bien-être de ses semblables. Bien au contraire, comme l’illustre la philosophie de Platon, la valeur de la philosophie réside dans la prise en compte du destin collectif et de la conduite de la cité. Le retour du prisonnier dans la caverne est révélateur de l’idée de la responsabilité sociale du philosophe. Il faut y voir un devoir d’éducation libératrice d’illusions et d’ignorance. Mettant ainsi en relief le rôle du philosophe dans sa tâche éducative, Platon (2016, 520c) écrit :
Il vous faut donc redescendre, chacun à son tour, vers l’habitation commune des autres, chacun à son tour et vous habituer à voir les choses qui sont dans l’obscurité. Quand vous y serez habitués, en effet, vous verrez dix mille fois mieux que ceux de là-bas… De cette manière, la cité sera administrée en état de vigilance par vous, et non en rêve, comme à présent alors que la plupart sont administrés par des gens qui se combattent les uns les autres pour des ombres et qui deviennent factieux afin de prendre le pouvoir, comme s’il y avait là un bien de quelque importance.
L’allégorie de la caverne est donc une métaphore qui met en relief la mission sociale du philosophe. Ce dernier doit amener la société à quitter les apparences des choses pour une vision plus claire et authentique du monde. Elle doit inculquer aux hommes la culture du bien et de la richesse dont ils disposent. Platon (2016, 521a) indique le sens qu’il donne au terme de richesse : « Riches non pas d’or, mais de cette richesse qui est nécessaire à l’homme heureux, c’est-à-dire une vie bonne et remplie de sagesse. » La philosophie est avant tout une exigence de bonne conduite, de responsabilité et de morale ainsi que le montrera, plus tard, la morale kantienne.
1.2. La morale kantienne et la question de la responsabilité humaine
Emmanuel Kant a insisté, dans sa philosophie morale, sur le respect de la personne humaine. Il vise à donner à l’action humaine une portée qui dépasse la réalisation des intérêts individuels et égoïstes. Ce qui est essentiel et qui en rajoute à la valeur de l’homme, c’est l’universalité de ses actes qu’E. Kant (1976, p. 150) traduit en termes d’impératifs catégoriques :
Agis selon la maxime qui peut en même temps s’ériger elle-même en loi universelle.
Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme moyen
Agis selon les maximes d’un membre qui légifère universellement en vue d’un règne des fins simplement possible.
Ainsi formulés, ces impératifs kantiens mettent l’accent sur la responsabilité du sujet agissant qui doit s’émanciper de son existence spécifique pour s’ériger en un sujet universel. C’est donc dans son fondement ou intention qu’il faut chercher la valeur d’un acte moral. Le terme « universel » qui revient dans les trois formulations de l’impératif est, en effet, révélateur du désir du philosophe allemand de donner à sa morale une valeur universelle, indépendante de toutes contingences immédiates. Ainsi, contrairement à la morale chrétienne fondée sur le respect des lois transcendantes, Kant donne, au sujet, la responsabilité absolue de poser des actes dont il assume et assure la légalité. Bien que subjectives, c’est-à-dire émanant d’un sujet, ces lois doivent avoir une portée générale de telle sorte que chaque personne s’y retrouve et y trouve son intérêt. La responsabilité est pour ainsi dire chez Kant inconditionnelle ou pure : c’est dans la raison humaine même qu’il faut chercher les bases de la vie morale et non pas a posteriori, dans une existence motivée et soumise à des lois de fonctionnement extérieures. Aussi, responsabilité rime-t-elle avec liberté tant et si bien qu’une action n’est responsable que quand elle est posée sans contraintes. La morale kantienne qui insiste sur l’autonomie du sujet dans ce qu’il pose comme action affirme également sa liberté. En effet, l’acte moral est celui qui s’accomplit non pas conformément au devoir, mais par devoir. La conformité au devoir n’est pas un acte d’autonomie mais obéit à un principe extérieur qui lui donne une signification ou une orientation. Ainsi, le commerçant qui sert loyalement ses clients agit conformément au devoir, mais ses motivations sont celles de l’intérêt, et non du devoir. On peut dire que son action est légale et non morale car la morale désigne une action faite par devoir. En effet, une action accomplie par devoir tire sa valeur morale non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d’après laquelle elle est décidée. Ainsi, l’action est morale quand elle n’est motivée par aucun motif extérieur à son exécution. Le commerçant qui agit conformément à son devoir mais aussi visant la prospérité de ses affaires est motivé par autre chose que l’accomplissement du devoir pur. Comme le dit si bien E. Kant (1976, p. 79),
lorsqu’il s’agit de ce qui doit être moralement bon, ce n’est pas assez qu’il y ait conformité à la loi morale ; il faut encore que ce soit pour la loi morale que la chose se fasse ; sinon, cette conformité n’est que très accidentelle et très incertaine, parce que le principe qui est étranger à la morale produira sans doute de temps à autre ces actions conformes, mais souvent aussi des actions contraires à la loi.
Une action soumise à des conditions ne résiste ni au temps, ni aux tentations de la corruption parce que son fondement manque de pureté.
La responsabilité est une valeur coextensive à la vie humaine. En effet, répondre de ses actes confère à l’homme la dignité et l’éloigne de la vie purement animale. Sartre le sait si bien qu’il définit l’homme par la liberté et la responsabilité qui la sous-tend.
2. Fondements de la liberté chez Sartre
Jean-Paul Sartre fonde sa philosophie de la liberté sur la contingence, qui donne à l’homme la possibilité de se prendre totalement en charge, et sur la conscience, dont la nature dynamique justifie son existence comme absence d’une essence fixe.
2.1. Contingence et liberté
Selon le Dictionnaire Universel (1995, p. 271), est contingent « ce qui peut arriver ou ne pas arriver. » Ainsi défini, le contingent s’oppose à ce qui est nécessaire, à ce qui est prévisible. Selon H. Arendt (2015, p. 194), « l’impossibilité de dissoudre le réel en quelque chose de pensable constitue le triomphe de la possible liberté. » Ainsi, à ses yeux, la liberté humaine devient possible du fait même de l’impossibilité du réel d’être soumis à un rigorisme rationnel a priori.
Aussi Sartre fonde-t-il la liberté de l’homme sur la contingence de son existence qui n’a aucune explication, ni justification. À l’opposé de la pensée judéo-chrétienne qui recourt à un Dieu créateur de l’univers, le philosophe français pense que l’homme est comme jeté dans le monde. De ce fait, il doit se tracer un chemin par lui-même et mener une vie dont il est le seul auteur et promoteur. N’ayant ni repère ni appui naturels, il porte le poids de sa liberté qu’il vit désormais comme une condamnation. Ainsi que J.-P Sartre le dit (1970, p. 37), « l’homme est condamné à être libre ; condamné parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre parce qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait. » Ainsi, la liberté est indissociable de la responsabilité qui en est le corollaire. En effet, étant condamné à être libre, l’homme porte non seulement l’entière responsabilité de ses propres actes, mais aussi celle de toute l’humanité que ses actes engagent. Il existe donc, chez lui, deux types de fardeau : le premier est le fardeau de la liberté elle-même, le second est celui de la responsabilité que le sujet a vis-à-vis de l’humanité.
S’agissant du fardeau de la liberté, J.-P Sartre (1943, p. 543) écrit : « La liberté n’est pas libre de ne pas être libre et […] elle n’est pas libre de ne pas exister. » En effet, pour lui, l’homme est engagé, dès sa naissance, dans une existence libre qui pèse sur lui. Cet engagement participe de la contingence de son existence et de l’absence d’un Dieu créateur. En l’absence d’un créateur et livré pour ainsi dire à lui-même, l’homme doit pouvoir se prendre pour assumer pleinement son existence. Comme le dit J.-P. Sartre (1970, p. 36),
si Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n’avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des valeurs.
Ainsi, chez le philosophe français, la contingence de l’existence n’autorise pas une existence insensée. Bien au contraire, c’est l’homme lui-même qui, dans son délaissement, doit créer les conditions d’une vie originale et responsable. Comme le dit si bien J.-P. Sartre (1970, p. 89), « la vie n’a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez, la vie, elle, n’est rien, mais c’est à vous de lui donner un sens, et la valeur n’est pas autre chose que le sens que vous lui choisissez ».
La contingence permet donc à la l’homme de se prendre en charge et de donner un sens à sa vie. C’est elle qui le stimule et l’engage vers une existence de son choix. En effet, rien n’est donné au départ et c’est par son travail, sa résilience et son esprit de créativité que tout homme doit construire sa vie. Les termes de facticité et de transcendance utilisés par Sartre permettent de bien comprendre la différence entre la manière d’être des choses et l’existence de l’homme. La facticité est le mode d’être des choses enfermés dans leur caractère de fait que rien ne peut justifier. L’homme a aussi ce caractère qui le range parmi les choses puisqu’il n’a pas choisi d’être et que certains aspects de son être sont déterminés. Ces aspects sont des situations dans lesquelles il se trouve. Mais à la différence des choses, l’homme peut modifier ce qu’il est par sa conscience. C’est cette dernière qui le définit ontologiquement et le prédispose à la transcendance et à la liberté.
2.2. La conscience comme fondement ontologique de la liberté
Sartre fonde la liberté de l’homme sur le caractère dynamique de sa conscience. En effet, pour lui, celle-ci est en perpétuel mouvement et ne coïncide jamais avec elle-même. De ce fait, elle pousse l’homme à vouloir toujours aller au-delà de lui-même et à remettre en question l’être immédiat des choses. Ce questionnement inhérent à la nature de la conscience est ce que Sartre appelle la néantisation qu’il définit foncièrement comme liberté. Ainsi, la néantisation est le pouvoir de la conscience humaine à vouloir toujours repousser les choses et l’existence de l’homme au-delà d’elles-mêmes, en faisant de ce qu’elles sont un néant d’être. En d’autres mots, la conscience est en perpétuel mouvement et n’existe que dans son rapport à autre chose qu’elle-même. Mettant en relief ce dynamisme de la conscience, J.-P. Sartre (1943, p. 28) écrit : « L’être de la conscience, en tant que conscience, c’est d’exister à distance de soi comme à présence à soi et cette distance nulle que l’être porte dans son être, c’est le Néant. » Ce dynamisme naturel de la conscience est ce qui fonde et justifie la liberté de l’homme.
En effet, la liberté humaine est liée au dynamisme naturel de la conscience. Si l’homme se définit par la conscience, il est, de ce fait-même, inscrit dans la logique de celle-ci, à savoir la mobilité ou liberté qui la caractérise. Aussi, la liberté a-t-elle un fondement ontologique puisqu’elle émane de la nature profonde de l’homme, à savoir sa conscience qui n’est pas simplement en-soi car, comme le souligne J.-P. Sartre (1943, p. 33), « l’être-en-soi n’a point de dedans qui s’opposerait à un dehors et qui serait analogue, à un jugement, à une loi, à une conscience de soi. L’en-soi n’a pas de secret : il est massif. (…) L’être-en-soi n’est jamais ni possible, ni impossible, il est. » L’être-en-soi désigne le mode d’être des choses du monde qui sont dépourvues de conscience et qui sont par conséquent incapables de réflexion. Quant au pour-soi, il est le mode d’être de la conscience qui va toujours au-delà d’elle-même et se caractérise par son pouvoir de questionnement permanent ou néantisation. La liberté apparaît ainsi dans l’expérience de cette puissance néantisante de la conscience. Celle-ci est, en effet, ce qui empêche l’homme d’être sur le mode d’être des choses. La conscience est ce qui fait éclater l’être en le transformant en néant. Aussi pour J.-P. Sartre (1943, p. 58), « l’homme se présente donc, au moins dans ce cas, comme un être qui fait éclore le néant dans le monde, en tant qu’il s’affecte lui-même de non-être à cette fin : l’homme est l’être par qui le néant vient au monde ». L’homme est alors placé face aux choses et face à lui-même, avec la charge de les faire être par sa liberté : il lui incombe entièrement de décider de ce qu’il veut être et de ce qu’il veut que les choses soient. Tel est le poids de la responsabilité qui se profile à l’horizon de sa liberté.
3. La responsabilité comme horizon de la liberté
L’existentialisme sartrien est dit athée car il nie l’existence d’un Dieu créateur du monde. Cette négation de Dieu et de toute transcendance conduit le sujet sartrien à mener une existence libre.
3.1. Le sujet sartrien et la phénoménologie de la liberté
Face au monde, l’homme est, chez Sartre, en réalité, face à lui-même. En effet, libre de toute détermination, le sujet sartrien ne se définit que par l’ensemble de ses actes. Contrairement à B. Spinoza (1983, p. 56) qui affirme que « rien ne peut être ni être conçu sans Dieu, mais que tout est en lui », J.-P. Sartre (1943, p. 187) soutient que « l’essentiel, c’est la contingence. » Sartre utilise le terme « contingent » pour affirmer l’absurdité de l’existence de l’homme mais aussi son absolue liberté. En effet, l’affirmation de cette contingence induit l’inexistence d’un Dieu pourvoyeur d’essence. Reprenant à son compte la pensée de Dostoïevski avant d’en faire le point de départ de sa philosophie, J.-P. Sartre (1946, p. 36) écrit : « Dostoïevski avait écrit : « Si Dieu n’existait pas, tout serait permis » C’est là, le point de départ de l’existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n’existe pas et par conséquent l’homme est délaissé, parce qu’il ne trouve ni en lui, ni hors de lui une possibilité de s’accrocher. » Délaissé, l’homme est face à lui-même et confronté au monde qu’il doit s’approprier en lui imprimant ses propres marques. Sa liberté commence donc par la contingence du monde qui le place dans l’implacable nécessité de se réaliser lui-même et d’orienter sa vie en fonction des circonstances ou situations qui se présentent à lui. Pour montrer que la vie est une libre entreprise et une création spontanée, J.-P. Sartre (1946, p. 77) la compare à une œuvre d’art, en l’occurrence à un tableau :
A-t-on jamais reproché à un artiste qui fait un tableau de ne pas s’inspirer des règles établies a priori ? A-t-on jamais dit quel est le tableau qu’il doit faire ? Il est bien entendu qu’il n’y a pas de tableau défini à faire, que l’artiste s’engage dans la construction de son tableau, et que le tableau à faire c’est précisément le tableau qu’il aura fait ; il est bien entendu qu’il n’y a pas de valeurs esthétiques a priori. […] Personne ne peut dire ce que sera la peinture de demain ; on ne peut juger la peinture qu’une fois faite.
L’absence d’un point d’ancrage originel met l’homme face à l’étendue de sa liberté qu’il doit désormais assumer comme une tâche.
La tâche se définit comme le travail que l’homme doit accomplir dans un temps donné. Dans la perspective sartrienne, le temps de l’homme, c’est celui de son existence dont il est le seul artisan et qu’il doit construire par ses propres moyens et capacités. Il doit se faire en se donnant les moyens de résistance et de résilience face aux vicissitudes de la vie. J.-J. Rousseau (1973, p. 60) disait que « l’homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Sartre ne partage pas ce point de vue rousseauiste, même s’il ne le réfute pas explicitement. Pour l’existentialiste athée, la liberté n’est pas innée chez l’homme. Ce qui est au départ de toute existence, c’est la contingence, c’est-à-dire le rien ou le néant qui pousse l’homme à se faire et à s’orienter dans le monde. La phénoménologie de la liberté est dans ce sens le parcours qui mène l’homme du néant d’être à la réalisation de soi. Elle est la manifestation de la liberté à travers l’existence humaine qui lui est consubstantielle. Celle-ci s’accomplit par le travail soutenu par l’idée selon laquelle l’homme est le seul auteur de sa vie et celle-ci se présente à lui comme un défi à relever. Au départ, il n’a pas d’essence, à savoir une nature qui l’inciterait à agir dans tel ou tel sens. Ce sont ses actes et le sens qu’il leur donne qui le définissent comme être libre. Pour mettre en relief cette liberté qui caractérise l’homme, J.-P. Sartre (1946, p. 22) dit : « L’homme est non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il se conçoit après l’existence, comme il se veut après cet élan vers l’existence ; l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. » Tout homme est donc placé devant ses possibilités et ses capacités de se faire. Son existence est dans ce sens le résultat de son travail librement effectué, sans orientation préalable. Sa vie est un dessin dont il est le seul auteur comme le dit J.-P. Sartre (1946, p. 57) : « Un homme s’engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure il n’y a rien. » Il ne suffit pas, cependant d’être libre, encore faut-il assumer la responsabilité qu’entraîne la liberté.
3.2. La responsabilité comme prolongement de la liberté.
Il convient de retenir, chez Sartre, deux types de responsabilité : la responsabilité du sujet qui doit pouvoir répondre de ses actes puisqu’il en est l’auteur exclusif et sa responsabilité envers les autres ou l’humanité dont il a la charge. Au premier niveau de la responsabilité, il faut dire que l’homme doit pouvoir assumer tous les actes qu’il pose. De ce fait, il doit éviter d’être de mauvaise foi, ce comportement qui consiste à fuir ses responsabilités. Pour J.-P. Sartre (1945, p. 136), « la liberté consiste à regarder en face les situations où l’on s’est mise de plein gré et accepter toutes ses responsabilités ». En effet, le sujet qui a pris conscience de sa responsabilité doit pouvoir dire, en toutes circonstances, selon J.-P. Sartre (1943, p. 612), que « ce qui m’arrive, m’arrive par moi et je ne saurais ni m’en affecter ni me révolter, ni m’y résigner. D’ailleurs tout ce qui m’arrive est mien ; il faut entendre par là, tout d’abord, que je suis à la hauteur de ce qui m’arrive, en tant qu’homme ». Un homme est à la hauteur de ce qui lui arrive lorsqu’il refuse l’idée de toute influence extérieure comme cause probable de son comportement.
L’existentialiste athée refuse tout déterminisme qu’il considère comme une mauvaise foi pour s’exempter de la responsabilité. Sartre dénonce cette excuse en montrant qu’un motif d’action n’est pas une force physique de propulsion qui nous contraindrait à agir de façon nécessaire. C’est au contraire nous qui, par notre conscience et nos préférences personnelles, décidons de donner à tel motif le poids suffisant pour expliquer notre acte. Comme pour insister sur le caractère nécessaire et incontournable de la responsabilité du sujet, J.-P. Sartre (1943, p. 25) écrit : « Je suis responsable de tout, en effet, sauf de ma responsabilité même car je ne suis pas le fondement de mon être. Tout se passe comme si j’étais contraint d’être responsable. »
Pour J.-P. Sartre, l’homme ne peut se soustraire à sa responsabilité de même qu’il ne peut le faire pour son existence. Celle-ci appelle la responsabilité comme son corollaire inévitable. Cette responsabilité du sujet prend en compte celle de l’humanité dont il a la charge.
À ce niveau de responsabilité, qu’on pourrait appeler sociale ou collective, l’homme doit pouvoir, dans ses choix, tenir compte des valeurs universelles. À ce propos, J.-P. Sartre (1943, p. 25) écrit : « Quand nous disons que l’homme se choisit, nous entendons que chacun d’entre nous se choisit, mais par là nous voulons dire aussi qu’en se choisissant il choisit tous les hommes. » En effet, le choix n’est pas égoïste et la subjectivité que prône l’existentialisme ne doit pas aboutir à un subjectivisme qui empêche une ouverture aux autres. Le sujet sartrien n’est pas seulement responsable de sa propre subjectivité, il l’est également pour tous les hommes. Cette responsabilité est comme un fardeau qui pèse sur la conscience de l’homme dont les actes engagent l’humanité toute entière : l’homme doit pouvoir s’assurer de l’universalité de ses actes et surtout de leur valeur éthique. Aussi J.-P. Sartre (1970, p. 25-26) fait-il cette précision : « choisir d’être ceci ou cela, c’est affirmer en même temps choisir la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal ; ce que nous choisissons, c’est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l’être pour tous. »
Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait penser, Jean-Paul Sartre a une vision élargie de la responsabilité qui s’étend à toute l’humanité dont elle porte la charge. Elle interpelle l’homme sur son rôle d’agent social et sur le modèle qu’il doit être aux yeux des autres. Le souci d’être présent dans l’histoire du monde et d’en orienter le sens, la volonté de faire entendre sa voix et de participer à la construction d’un monde meilleur sont la préoccupation majeure du philosophe français. Tels sont le sens de l’engagement et de la responsabilité de l’existentialiste athée que traduit F. Noudelmann (2020, p. 20) en ces termes :
Peser sur le cours des choses, orienter l’Histoire, faire entendre sa voix… Sartre, en quelques articles, par des émissions de radio et grâce au lancement, en 1945, de la Revue Les temps modernes, devient l’intellectuel phare de l’après-guerre. Théoricien et praticien de la « littérature engagée », il décrit des textes à valeur de manifeste, regroupés dans Qu’est-ce que la littérature ?, adoptant un ton comminatoire qui responsabilise, voire culpabilise les écrivains leur enjoignant d’inscrire leur langue dans le réel social et politique.
La responsabilité de l’homme consiste à être un acteur de la vie sociale et à peser sur le cours du monde. Peser sur le cours du monde, c’est participer à sa construction au travers de ses idées et ses actions. Ainsi, tout ce qui arrive dans le monde nous regarde car notre responsabilité y est engagée. Le monde nous appartient et l’indifférence est une attitude condamnable. La deuxième guerre mondiale renforça chez le philosophe français l’idée de la responsabilité comme un devoir communautaire qui doit pousser tout citoyen à s’engager dans la lutte contre toute attitude liberticide. Ainsi, comme le dit F. Noudelmann (2020, p. 20),
après la Seconde guerre mondiale, il (Sartre) a opéré une conversion radicale de sa vie et de ses écrits, en faveur d’une implication totale dans les luttes sociales et les conflits internationaux. Les guerres de Corée, d’Algérie, du Vietnam, la révolution cubaine, l’insurrection de Budapest, le conflit israélo-palestinien, mai 68, le maoïsme… tout le regarde.
La responsabilité de l’homme est ainsi coextensive à sa nature d’être social et cette dernière lui impose une éthique nécessaire au maintien du tissu social. Aujourd’hui, plus qu’hier, face à la dérive de l’Anthropocène, une nouvelle époque géologique où l’homme s’érige en principale force de changement sur terre, ce dernier doit prendre à-bras-le-corps la question de l’étendue de sa responsabilité. Ainsi, la question de l’élargissement de la question de l’éthique à tous les domaines s’impose, comme le dit A.F.-Largeault (2021, p. 292) reprenant les propos du forestier américain Aldo Leopold (Bourg et Fragnière, p. 611) :
Cette extension de l’éthique, qui n’a été étudiée jusqu’à présent que par les philosophes est en réalité un processus d’évolution écologique. Ses séquences peuvent être décrites en termes écologiques aussi bien que philosophiques. Une éthique, écologiquement parlant, est une limite imposée à la liberté d’agir dans la lutte pour l’existence.
Ainsi définie, la liberté humaine associe indissociablement action et préservation de l’existence. Elle a toujours pour horizon ou prolongement la responsabilité qui l’oriente dans le sens de l’humainement correct.
Conclusion
La liberté humaine est un fardeau car elle fait peser sur l’homme le poids de sa double responsabilité. Sa première responsabilité consiste à passer de la contingence de sa naissance à une existence assumée. Ainsi, pour J.-P. Sartre (1985, p. 454-455),
tout homme est accidentel pour lui-même. Il naît ici plutôt que là. Et c’est ainsi qu’il naît (par exemple) juif. Mais il ne peut plus considérer son être-juif comme un hasard puisqu’il n’est que pour être juif (la naissance n’est pas l’apparition d’une âme attendant dans les limbes). Le hasard aussitôt posé est nié.
La responsabilité de l’homme, à ce niveau, consiste donc à décider librement du sens à donner à sa vie, de prime abord, contingente. C’est l’étape de la négation du hasard par la liberté qui est son véritable contraire et non la nécessité renchérit Sartre (1983, p. 455) : « le contraire du hasard n’est pas la nécessité mais la liberté. » Ainsi, l’homme n’est pas mécaniquement ce qu’il est, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui car pour J.-P. Sartre (2020, p. 143), « un être qui n’est pas dégagé de son hérédité, des influences sociales, de sa nature, de son destin et de son caractère est un prisonnier ».
Ensuite, l’homme doit pouvoir agir en tenant compte des autres. C’est la phase de l’universalisation de son être au travers de ses actes et qui en rajoute à l’étendue de sa responsabilité. Ainsi, l’homme n’est pas seulement responsable de sa seule personne, il a à porter le poids de l’humanité. Aussi, pour J.-P. Sartre (1943, p. 612), « l’homme étant condamné à être libre, porte le poids du monde tout entier sur ses épaules : il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d’être. » La responsabilité est donc l’horizon ou la vérité de la liberté chez Sartre.
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 2015, La philosophie de l’existence, Paris, Livre de poche.
FAGOT-LARGEAU Anne, 2021, Ontologie du devenir, Paris, Odile Jacob.
KANT Emmanuel, 1976, Fondements de la Métaphysique des mœurs, Trad. Victor DELBOS,Paris, Delagrave.
LOUETTE Jean-François, 2020, Études sartriennes : Sartre et Beauvoir : lecture en miroir, Paris, Classiques Garnier.
NOUDELMANN François, 2020, Un tout autre Sartre, Paris, Gallimard.
PLATON, 2016, La République, Trad. Georges LEROUX, Paris, GF Flammarion.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1973, Du contrat social, Paris, Union Générale d’Éditions.
SARTRE Jean-Paul, 1983, Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard.
SARTRE Jean-Paul, 1985, Critique de la Raison dialectique, Tome II, Paris, Gallimard.
SARTRE Jean-Paul, 1943, L’être et le néant, Paris, Gallimard.
SARTRE Jean-Paul, 1970, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel.
SARTRE Jean-Paul, 1945, Les chemins de la liberté, Paris, Gallimard.
SPINOZA Baruch, 1983, Éthique, Trad. Charles APPUHN, Paris, Librairie philosophique J. Vrin.
LE TERRORISME ET LA RÉVOLUTION DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE : PISTES POUR UNE RIPOSTE EFFICACE
Ayouba LAWANI
Université de Parakou (Bénin)
Résumé :
La passion du crime mobilise le terroriste et l’oblige à frapper la totalité du réel de la plus effroyable des manières. Face à cette ivresse assassine, il faut compléter la riposte sur le champ policier par l’engagement total du citoyen. Cette détermination, pour être efficace, doit s’accompagner d’une révolution de l’engagement politique. Cet engagement de l’homme, pour être plénier, doit être porté par la puissance entremetteuse de l’État. Le traitement politique de ce problème radical exige une implication universelle des autres États. Et, l’urgence de ce traitement désigne toujours l’État national comme le lieu politique de son examen total et de la décision à prendre à son sujet. Cette unité des engagements, devenue unité proprement engagée, a désormais un contenu qui exige une valeur et une norme stimulant les citoyens de ces États, comme citoyens, comme hommes. Un tel objectif détermine la disposition morale de l’homme qui ne peut être ce qu’il doit être que s’il s’incorpore le mépris du terrorisme. Ce mépris sera désormais inscrit dans la nature humaine, il sera constitutif de son humanité. Ce faisant, l’essentiel de la lutte contre le terrorisme ne sera pas délégué seulement à l’intervention militaire, encore moins à la détermination des citoyens, des États mais à l’engagement intensifié de l’humain en l’homme. Pour aboutir à ce résultat, nous avons utilisé la méthode d’analyse directe.
Mots-clés : Citoyen, Engagement, Homme, Politique, Terrorisme.
Abstract :
The passion for crime mobilizes the terrorist and obliges him to strike the totality of reality in the most appalling of ways. Faced with this murderous intoxication, the response on the police must be supplemented by the total commitment of the citizen. This determination to be effective must be accompanied by a revolution in political commitment. This commitment of man to be full must be carried by the intermediary power of the State. The effective political treatment of this radical problem in its novelty requires the universal involvement of other States. And, the urgency of this treatment always designates the national state as the political place of its total examination and of the decision to be taken about it. This unity of commitments, which has become a properly committed unity, now has a content that requires a value and a standard that stimulates the citizens of these States, as citizens, as men. Such an objective determines the moral disposition of man, which can only be what it should be if it incorporates contempt for terrorism. This contempt will henceforth be inscribed in human nature, it will be constitutive of his humanity. In doing so, most of the fight against terrorism will not be delegated solely to military intervention, even less to the determination of citizens and States, but to the intensified commitment of the human in the human. To achieve this result, we used the direct analysis method.
Keywords : Citizen, Commitment, Man, Politics, Terrorism.
Introduction
L’économie profonde de la dynamique de l’histoire mondiale la fait évoluer dans le temps long de la vie alors que l’institution politique censée fixer et assurer celle-ci est régulièrement confrontée au conflit de sa propre détermination et accomplissement. Cette position se nourrit de la conviction que le politique est le moteur du devenir historique. D’autant que l’intensification d’un problème tendant à changer qualitativement son traitement en vient à faire s’inquiéter ou se questionner sur l’institution politique elle-même. Ce problème est celui que pose la négation du fanatisme religieux qui inquiète radicalement la pensée et l’action politique. Cela nous oblige à formuler l’hypothèse selon laquelle la préparation d’une riposte efficace impose une mutation de la réaction politique, une révolution de l’engagement politique et citoyen. Dès lors, comment, par une pratique politique et civique renouvelée, affronter la puissance omni-conditionnante incommensurable du terrorisme ? La démarche heuristique adoptée pour traiter la question, est organisée autour de quatre moments. Dans un premier moment, nous envisageons de partir du nihilisme pour montrer la nécessité de prendre en compte les éléments immatériels comme l’engagement dans la riposte au terrorisme dont le dynamisme est saisissant. Dans un deuxième moment de notre réflexion, nous allons montrer que le terrorisme pose aujourd’hui un problème de nature post-historique dont le traitement exige de repenser l’engagement citoyen. Dans un troisième moment de notre exposé, nous allons chercher à savoir si la réponse au danger que constitue le terrorisme n’exige pas une révolution de l’engagement politique. Dans un quatrième moment de notre réflexion, nous démonterons que l’exercice de la responsabilité civique de laquelle le citoyen doit puiser son engagement politique pour combattre ce phénomène doit-être assuré par l’État. Pour finir, nous allons montrer que l’universalisme humaniste, en niant le mal terroriste, non comme une simple pratique criminelle mais comme une contre-valeur, exige que la vie s’emploie à le combattre sans cesse.
1. Terrorisme, nihilisme et engagement
Depuis la fin de la guerre froide et du monde bipolaire, le terrorisme fait prévaloir sur la scène internationale une violence insaisissable, organisée en réseaux. Si bien que « l’humanité a [désormais] l’impression de vivre dans un état d’insécurité permanente où domine la peur de la mort violente et celle d’une vie qui – pour reprendre Hobbes- serait solitary, poor, nasty, brutish and short (solitaire, pauvre, pénible, brutale et brève » (P. Hassner, 2002, p. 155). Dorénavant, la peur de l’autre domine les rapports entre les hommes. Il fait prédominer une nouvelle vision du monde : celle d’un monde menaçant et imprévisible, celle d’une insécurité permanente, insaisissable et d’une menace protéiforme. C’est notre vision de l’histoire qui est remise en cause. Face à un tel danger, les démocraties engagées dans la riposte contre « l’axe du mal », sont enclins à rompre avec leurs propres principes en se montrant moins regardant sur les questions de liberté civiques. Les USA républicains de George W. Bush ont été les premiers à s’engager sur cette voie. Conséquence : le mal rôde partout. Ce n’est pas l’occasion d’un débat moral rétrospectif sur la légitimité des frappes, de l’Amérique démocratique en Irak mais ce qui nous intéresse, c’est ce qui fonde la conscience de ceux qui entretiennent la prolifération des massacres spécifiques.
De l’aveu des terroristes eux-mêmes, la violence qu’ils infligent sans état d’âme à la totalité du réel s’appuie sur leur croyance. Mais, quelle religion se satisfait d’offrir un culte agréable à Dieu en organisant des exécutions de masse, en égorgeant une population innocente dont le seul péché est – bien que partageant la même foi – de se retrouver dans l’espace géostratégique du terroriste ? La foi dévoyée de ces preneurs d’otage et poseurs de bombes est une pathologie de la croyance. Mais, on ferait fausse route d’y voir une sorte de nihilisme ainsi que le pense A. Glucksmann (2002, p. 15). Cela est repris par A. Glucksmann dans la même année dans un entretien qu’il a accordé à Galia Ackerman et publié dans, Politique internationale : « les citoyens lucides et les démocrates doivent se préparer à affronter non plus un adversaire supposé absolu, mais une adversité redoutable et polymorphe, pas moins implacable. Je la nomme avec Dostoïevski « nihilisme » ». On ne peut pas les considérer comme des gens qui ne croient en rien bien au contraire, ils croient trop. Leurs croyances sont compactes, absolues, folles. Ils sont certes des assassins qui menacent la paix du monde mais ils ne peuvent pas être considérés comme de simples criminels sans foi ni loi. Les considérer comme tels reviendrait à reprendre les mêmes erreurs que celles qui furent faites à l’égard du régime nazi. Les nazis croyaient fortement à quelque chose de fou, la force de leur croyance était démentielle et c’est d’ailleurs cela qui assurait un succès à leurs entreprises. P. Burrin (2004, p. 57-58) nous rappelle ceci : « loin d’être un « nihilisme », comme aimaient à le présenter dès l’époque, des conservateurs déçus, [le nihilisme] incorporait un ensemble de valeurs qu’il tenait pour « positives » et qui orientait sa politique ».
C’est en s’appuyant sur ces valeurs que les nazis “développèrent une puissance qui leur permit de conquérir des peuples bien plus nombreux et de les utiliser pour construire des empires fondateurs de grandes cultures”. Il en est de même des terroristes. Le danger qu’ils représentent ne vient pas de leurs croyances creuses, mais de l’hallucinante compacité de celles-ci. La bombe humaine qui se fait sauter, est incontestablement une criminelle, mais un pas incroyant. Un enfant gâté de pétrodollars qui s’ennuie dans son paradis et décide de rompre avec les siens en vue de devenir un criminel combattant pour sa religion, n’obéit à aucun penchant nihiliste mais à une foi aussi outrancière que détraquée. La question qu’on est en droit de se poser est la suivante : comment peut-on riposter efficacement contre une menace aussi tenace sans être soi-même mobilisé par des convictions robustes ? Peut-on affronter le mal radical – pour reprendre Kant, sans revitaliser son engagement, sa détermination ? Peut-on déléguer l’essentiel de la lutte aux chars et nous complaire dans un déficit de détermination ? La force militaire et technologique n’est rien sans l’esprit qui doit l’organiser. Et, nous manquons d’énergie intérieure. Ce qu’il faut savoir est que la menace terroriste ne défie pas que notre artillerie technique et militaire mais elle ruine aussi et d’abord nos convictions communes, nos idées, nos concepts. Le danger terroriste exige de nous une mobilisation mentale, un engagement total pour des valeurs démocratiques.
La lutte contre le terrorisme ne peut se faire seulement avec la technologie militaire. Son objectif de « zéro mort » réclame de la volonté, de l’engagement, des convictions raffermies. Le relativisme né du dépérissement des convictions démocratiques est suicidaire pour l’activisme. G. Orwel repris par C. Lasch (1991, p. 75) notait, parlant du nazisme, qu’hormis ses aspects monstrueux, était « psychologiquement bien plus solide qu’aucune autre conception hédoniste de la vie ». La solution militaire, si elle n’est pas accompagnée de fermeté et de résolution court le risque inévitable d’être inopérante ainsi que l’ont montré les évènements actuels. Divisés et sans engagement, les États seront irrémédiablement vulnérables face aux coups de boutoirs du terrorisme dont le dynamisme est saisissant. La nécessité de prise en compte des éléments immatériels comme l’engagement, l’énergie disponible en matière de mobilisation devient impérieuse. Les normes communes minimales et l’esprit civique ont été trop souvent négligés dans cette lutte que les États rationnels sont tous exposés à la menace terroriste. Sans risque de gonfler l’hyperbole, on peut dire que ces États ne souffrent pas du terrorisme, ils paient au prix fort les conséquences de leur impossibilité de se mobiliser autour des problèmes politiques. L’incapacité pour ces États de rassembler l’énergie requise pour faire face au terrorisme achève de ruiner leur capacité de résilience, et c’est cela qui les conduit à la capitulation.
L’absence d’esprit civique, d’« enveloppe communautaire » en vue de reprendre J.-M. Apostolidès (2003, p. 165), transforme rapidement l’État en une proie sans défense. Les aigres fureurs du terrorisme qui se lèvent sur le promontoire africain en sont autant de symptômes. L’existence d’un corps social mobilisé crée le sentiment d’appartenance, d’adhésion à une totalité qui dépasse tout, l’individu s’en trouve protégé. L’État mourrait si « le parti des incroyants y devient majoritaire » (P. Michel, 1994). Les enfermements religieux deviennent minoritaires. Même quand une foi particulière est vécue comme une identité refuge en tendant à se durcir en se clôturant, elle est désarmée face à l’enveloppe nationale. La foi peut se crisper, voire s’enfermer. Elle peut même cesser d’être disposée au dialogue mais elle restera moins dangereuse faute de s’être corporifiée. Des entités batailleuses et « meurtrières », pour parler comme A. Maalouf (2001, p. 7), peuvent proliférer mais leurs actions ne signifieront rien dans la marche de l’histoire humaine. Il est peu de dire aujourd’hui que nous sommes loin d’un tel état. Face à cela, il faut que le politique retrouve le « goût de l’avenir » (J.-C. Guillebaud, 2012, p.12) pour disloquer la forteresse terroriste où prévaut une mentalité d’assiégés et redonner à la dynamique du projet humain son vrai sens.
2. Le terrorisme et la structuration politique actuelle
On s’accorde aujourd’hui, sur le fait que l’histoire se fait dans le politique en tant que lieu de libération de l’homme où s’accomplissent la réunion, l’identification des différences singulières et de l’identité ou unité universelle. Cette uniformisation de ce genre de vie consacrée par l’État rationnel semble être la vérité achevée du politique. A priori, la négativité historique ne saurait remettre en cause le modèle d’un État à la fois fort et libéral au motif qu’elle relancerait l’histoire comme histoire politique universelle. Sans doute, favorisée par un tel contexte politique, l’émergence d’un sujet politique semble rabaisser l’idée de l’État rationnel – où s’épuise la politique et, avec elle, l’histoire -, à une rhétorique sur le bon régime politique national ou international. L’intrusion de nouveaux éléments s’est accélérée à un rythme tel que l’on ne peut s’empêcher de mettre en question l’institution politique elle-même. La question qu’on est en droit de se poser est de savoir si l’intensification et la prolifération du terrorisme – problème politique – doivent avoir pour conséquence une révolution politique.
Nous avons maintes fois répété dans nos écrits antérieurs que l’histoire a fini par livrer son sens universel et cela culmine dans l’État rationnel saisi en son idée et réalisé pratiquement. Aujourd’hui, la question politique en sa forme traditionnelle, celle du bon régime semble pour l’essentiel, théoriquement réglée. Désormais, cette fin consacre la reconnaissance mutuelle universelle à travers laquelle l’homme s’accomplit en s’affirmant libre. Cette liberté fait que l’homme se satisfait pleinement et devrait arrêter sa quête historique de lui-même. Mais, cette satisfaction totale ne signifie pas l’arrêt de l’action sur soi libératrice et son renversement dans le repos déshumanisant de l’être. Elle consacre même une plus grande activité de l’homme parce que désormais chez soi. Des exutoires peuvent être ménagés aux individus qui ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes dans cette exigence mégalothymique devenue pourtant libératrice. Les actions de ces individus ne peuvent pas produire des événements mais des avènements, de simples coups explosant simplement en surface sans toucher la structure fondamentale déjà atteinte : l’État rationnel.
Il peut être en proie à des vicissitudes mais celles-ci ne peuvent pas créer des institutions nouvelles et fondamentales capables d’influencer le genre humain. Des soubresauts telluriques ponctueront certes le cours des États nationaux mais leur fin n’ébranlera pas significativement la structure fondamentale de l’organisation politique de l’État rationnel. Concomitamment, l’amplification de la menace terroriste ne saurait varier qualitativement, même si elle le complique, leur traitement optimal par des États rationnels. Même si ces problèmes politiques sont liés aux variations de la subjectivité civique ou aux bouleversements de l’histoire objective du monde, l’État rationnel est le lieu de leur traitement en tant que chevalier de l’universel qui dépasse ces problèmes très radicaux et vitaux en leur nouveauté. L’alchimie humaine continuera d’exciter le réveil de l’histoire humaine à une échelle dépassant parfois le niveau humain mais, cette pause passera : les Cieux et la terre passeront. Le terrorisme peut varier en nature et en degré dans sa détermination mais son traitement semble ne pouvoir relever que de l’instance politique réelle : l’État.
L’État se considère comme la seule entité capable de se charger de ce problème. À travers cet exercice accru de sa responsabilité, il réalise la vérité du politique. Il doit se conserver fort dans la réalisation de ce sens vrai déjà clairement fixé en ne perdant pas de vue sa tâche réconciliatrice. Les problèmes politiques assassins ont beau aiguiser leur tranchant, ils n’imposent aucun changement de la réaction politique. Pas plus que l’emballement des problèmes ordinaires de la politique n’impose aucune mutation de celle-ci, non seulement en son sens connu mais aussi en son activité usuelle. Les ressorts du politique en son agent fondamental comme en sa forme, ne changent pas. Cela ne veut pas dire qu’une activité nouvelle, extra-politique en son objet, ne peut plus s’ouvrir aux États. Le terrorisme pose aujourd’hui un problème d’un ordre tout différent dont la nature post-historique s’impose avec une telle urgence à l’humanité que son traitement qui devient problématique semble échapper à toutes les catégories. Quiconque pense à la réplique appropriée pour venir à bout du terrorisme, s’interroge sur le type de politique qu’il faut pratiquer, c’est-à-dire sur l’engagement au sens laïc du terme.
Il ne s’agit pas ici d’un engagement transformateur du monde mais de celui qui refuse d’abandonner la vie dans la main des méchants. L’engagement vise ici, la dose minimale de détermination dont l’individu a besoin pour se maintenir en vie, pour vivre dans la paix et la concorde sociale. Le citoyen doit se sentir coresponsable de la construction de cette vie qu’il convient d’arracher aux fatalités assassines. Il ne s’agit pas à proprement parler de l’engagement politique qui, lui, vise à transformer le monde ainsi que l’a énoncé D. Bensaïd (2004, p. 26) : « si ce monde n’est pas acceptable, il faut entreprendre de le changer ». Il s’agit d’une détermination à vivre vaille que vaille contre les processus prisonniers et criminels. Il s’agit simplement de ne pas renoncer à l’Histoire. Le caractère problématique de l’engagement qui a accompagné jusque-là la lutte contre le terrorisme exige de repenser cet engagement en prenant garde d’absolutiser la croyance qui le fonde. L’inaction de la « belle âme » qui attend le politique avant de consentir à l’action est capitulard. C’est pourquoi, le politique réclame un accompagnement citoyen qui facilite la lutte et aide à en porter le poids. Il n’est pas question de se demander jusqu’où il portera le poids, une révolution de l’engagement politique suffira.
3. Le terrorisme et la révolution de l’engagement politique
Ces derniers temps, une intériorité passionnelle s’est manifestée avec plus d’acuité, rapportant tout à sa seule absoluité, voit dans l’État une altérité menaçante. Cette absolutisation d’un idéal autre que l’idéal principiel de l’État rationnel suscite dans celle-ci la haine coléreuse de celui-ci, et sa colère en acte, c’est l’ivresse assassine. Le terrorisme est « un crime passionnel » (E. Chartier, 1988, p. 114). C’est donc la passion abritant potentiellement la haine de l’État rationnel qui se développe dans le terrorisme en utilisant les circonstances de l’extermination : « la vraie cause de la haine, c’est la haine… la haine, elle s’accroît de son propre mouvement » (E. Chartier, 1988, p. 26). Le terrorisme égorgeur procède alors d’une conversion de la conscience, d’un arrachement de l’âme à son mouvement naturel, dans la libre actualisation de la liberté jugeant toutes choses en se référant à ses seuls référents fondateurs. Voilà pourquoi le terrorisme, en tant que mouvement affectif de la conscience, ne peut qu’être affirmé de façon passionnelle, c’est-à-dire dans une simple auto-négation de la passion tueuse, sous la forme d’une guerre faite à l’État rationnel constitué et institué à travers le droit et la loi. C’est justement ce qui inquiète car il cherche à remettre en cause la vérité achevée du politique, c’est-à-dire le sens universel de l’histoire humaine.
Quoi qu’il en soit de l’irruption du terrorisme, au sein de l’histoire universelle alors ébranlée par un tel acteur doté d’une puissance incommensurable, il ne nous apparaît pas comme pouvant remettre en cause le sens de cette histoire. Assurément, le caractère massif de la foudre exterminatrice opérant dans une société de droit impose une réponse elle-même totale des hommes agissant à travers leur pouvoir le plus fort, qui est celui de l’État, pour défendre une cause qui les rabaisse et qui est prioritaire entre toutes et pour tous puisqu’elle concerne l’humaine survie de l’humain. Il convient que l’État se renforce en intensifiant son action à la mesure de l’objectif qui conditionne la subsistance de tout ce qui est humain et que, à travers le maintien de la structuration socio-politique actuelle, il mette en œuvre cette structure pour remplir une tâche plus élémentaire, visant à conserver le rapport humain de l’homme à l’homme.
Aujourd’hui, le terrorisme est apparu et s’augmente aux problèmes humains, par son sens, absolument nouveau, mais dont l’économie extensive ou intensive menace la subsistance même des États rationnels existants et, par conséquent, de la pratique politique habituelle de leurs citoyens. Le terrorisme constitue ainsi un risque vital pour les États rationnels. Cette négation en cours de la part du fanatisme-terrorisant, à travers des installations trans et intra-nationales, de l’État rationnel inquiète radicalement aussi bien la pensée que l’action politique. Face à la ponctualité exterminatrice de ce mal, la préparation d’une réaction efficace susceptible de mettre en jeu des principes fondamentalement juridiques inclus dans le contrat national, mais aussi des engagements moraux ou spirituels, exige du citoyen, qu’il mobilise en lui, en tant que citoyen, la totalité de l’homme qu’il est. L’engagement proprement politique est ainsi révolutionné. La lutte contre le terrorisme n’est donc pas sur le seul champ militaire ou policier, il est aussi sur le champ de l’engagement individuel ou collectif. C’est la révolution de l’engagement qui permet de mieux accéder à la compréhension et à l’explication de la réalité complexe du terrorisme, parce qu’il permet, en le démarquant, de mieux lutter contre lui. Dans l’appropriation de la rationalité propre au comportement terroriste « nous devons mieux [les] comprendre pour mieux devenir vigilants à l’égard de nous-mêmes » (E. Morin, 1994, p. 9). Ce faisant la totalité du réel que le terroriste frappe de la plus effroyable des manières est préparée pour faire face à sa terreur. L’engagement augmente donc la capacité de résilience du citoyen engagé pour la seule chose qui vaille : la préservation de sa vie.
Affronter la puissance incommensurable du terrorisme est l’objectif politique prioritaire car la puissance humaine de riposte n’est pleinement réelle que dans les États-nations. Ceux-ci doivent répondre au danger commun, qui rassemble objectivement l’humanité, par la mise en commun, subjectivement résolue, de leurs moyens par une collaboration renforcée de leurs citoyens. C’est ce qu’il faut s’efforcer de faire dans le cadre maintenu du politique engageant ainsi à l’intérieur de celui-ci une pratique politique collective renouvelée. Dans l’affrontement radical des conditions de sa survie, l’exercice de la responsabilité civique requiert l’intervention de tout l’homme surtout qu’il s’agit de la relation plus basique de l’humanité à elle-même, à son maintien. Il ne peut en être autrement car il y va de la condition humaine prise en toute sa complexité, matérielle et spirituelle. C’est pourquoi, la décision attendue du politique doit se préparer dans la rencontre de toutes les dimensions et de tous les ressorts intellectuels de l’homme. En faisant ainsi s’exprimer en lui l’homme entier, le citoyen engage son être plénier dans la riposte contre ce problème. Il n’y a pas d’issue favorable pour un mal combattu avec la force et la détermination de l’humanité.
L’imposition politique de l’éradication du terrorisme pour la préservation de la vie oblige les hommes présents à s’engager pour eux-mêmes et pour les hommes à venir, et par là, à réaliser concrètement l’idéal abstrait de l’homme universel et de ses droits comme humanité trans-générationnelle sans cesse déjà là. Le terrorisme est hors norme et exige de mobiliser l’humanité tout entière seule détentrice du pouvoir absolu universel. Le renouvellement de l’engagement politique – pour lutter contre le terrorisme – rendu possible par l’affirmation d’une humanité universelle est bien une belle idée mais l’exigence de sa réalisation oblige d’aller au-delà d’une telle affirmation pour ne pas faire nier sa vraie réalisation. Car, une humanité trans-générationnelle, en sa totalité, n’existe pas physiquement et ne peut, en son statut métaphysique s’auto-réaliser. C’est l’État qui a la puissance physique de se conserver et de faire exister tout ce qui déborde le champ de l’esprit pour investir le domaine du métaphysique.
4. Terrorisme, État et engagement politique
Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que c’est la passion du crime qui mobilise le terroriste qui frappe la totalité du réel de la plus effroyable des manières. Face à cette ivresse assassine, il faut compléter la riposte sur le champ policier par l’engagement du citoyen. Cet engagement, pour être efficace, doit se subsumer en réalisant l’idéal concret de l’homme en lui-même. Cet idéal par trop métaphysique doit être porté par l’État qui sait faire être tout ce qui n’est pas là. L’homme ne peut donc s’exprimer dans le citoyen que par la puissance entremetteuse de l’État. Car c’est par celui-ci que la totale expression humaine se réalise d’autant que l’homme est la raison d’être du citoyen et le citoyen, l’être, le se-faire-être de l’homme. Or, la réalité charnelle de l’État, son être concret, c’est la réalité naturalisée de la nation, dans la vie une, de laquelle le citoyen puise la puissance de son engagement politique. L’État est donc l’élément et l’agent de l’engagement politique. C’est donc par la conjonction de l’affirmation de la totalité de l’humanité et de la totalité de la nation que la pratique politique engagée contre le terrorisme pourra être bien stimulée, vivifiée.
Le problème du terrorisme, très complexe dans sa détermination, pour ne rien dire de la solution militaire, semble échapper au pouvoir de traitement par l’instance politique réelle, nationale. D’ailleurs, la solution d’élever le citoyen au rang d’homme universel pour mieux vivifier cette lutte prend en compte le caractère universel de cette lutte : elle concerne tout l’homme, tout État et dépasse ainsi sa dimension seulement politique. La seule compétence de l’État ainsi que l’engagement de ses citoyens doivent être supplées par la même détermination des organisations non gouvernementales et d’autres États. Le traitement politique efficace de ce problème radical en sa nouveauté exige donc une implication universelle de ces instances. Mais, l’urgence de ce traitement désigne toujours l’État national comme le lieu politique de son examen total et de la décision à prendre à son sujet. L’État national est l’axe radiant qui, à travers la libre discussion des engagements alors réunis par ses soins, tranche. La conjonction des déterminations exigée par le sens universel du problème terroriste rabaisse les barrières dans cette lutte et fait du terrorisme un problème de tous. C’est donc la communauté humaine une, résolument engagée qui lutte contre la terrifiante compacité des croyances absolues, durcies jusqu’à la déraison.
Ce qui peut justifier cette unité des engagements, ce n’est pas une unité au motif que celle-ci donne de la puissance, une puissance que les États individuellement pris, n’ont pas, et dont l’obtention, non assurée, exigerait des sacrifices réels peut-être dissuasifs dans cette perspective de puissance. C’est que cette unité soit une unité proprement engagée dont le contenu mériterait et exigerait les sacrifices à faire pour le triomphe de sa cause, une valeur et une norme stimulant les citoyens de ces États, comme citoyens – ce qui est relatif – mais comme hommes, ce qui est absolu. Un tel objectif idéal définit les hommes dans ce qu’ils ont de meilleur, et cela, de manière spécifique, en sorte qu’assumer un tel objectif serait la vocation humaine profonde d’une politique combattant le terrorisme. Un tel objectif fondamental hisse l’homme comme une valeur ou une norme, au-dessus de ce qu’il est : on est déjà là, dans la tendance, habitude, disposition, ce qu’on doit être. G. Thibon (1975, p. 79) rappelant la nécessité pour l’homme de parier sur sa propre chance d’exister en tant qu’homme dit ceci : « tous les êtres sont ce qu’ils sont, seul l’homme devient ce qu’il est. Il doit conquérir son essence ». Or, cette essence, c’est celle que nous a déjà livrée la vérité achevée du politique : l’État qui manifeste sa force politique par le libéralisme social. C’est cette forme d’État que le terrorisme nie en s’éclatant dans les mesures d’exception.
Cette reconquête de l’essence de l’homme appelle, en fait, un projet d’hominisation auquel le citoyen doit adhérer activement par l’apprentissage éducatif. L’homme est certes, subjectivement ce qu’il est mais il doit être culturellement construit dans le mépris du terrorisme pour retrouver son essence qui pourra être transmise de génération en génération. Ce faisant, l’homme tendra sans cesse vers son essence. Il sera, en tant qu’homme, rivé à cette nécessité. L’être humain a ceci de grand qu’il se choisit d’être ce qu’il est. Tous les hommes doivent être ce qu’ils doivent être : des êtres qui tiennent naturellement la terreur en horreur. En joignant ainsi l’être et le devoir-être, nous faisons glisser la lutte contre le terrorisme dans une anthropologie pragmatique. La lutte contre le terrorisme devient universelle en l’homme. Elle devient tout simplement humaine. Elle est inscrite désormais dans la nature humaine comme la mort. Le mépris du terrorisme devient constitutif de cette nature humaine.
À ce niveau de la réflexion, la question qu’il convient de se poser est de savoir : quelle chance a le terrorisme de prospérer quand la disposition de la nature humaine est de le combattre ? Nous connaissons déjà la réponse à cette question. Le niveau objectif commandant la lutte serait l’humain. L’universalisme humaniste en niant le mal terroriste, non comme une simple pratique criminelle mais comme une contre-valeur, exigerait que l’existence s’emploie à le combattre sans cesse. Ce ne sont plus les liens entre les citoyens, entre les États qui contraindront à un engagement intensifié contre la pratique terroriste mais l’humain en l’homme. Mais, la force conservée des États rationnels les désigne toujours, comme les seuls agents effectifs de l’engagement humain en l’homme, en tant qu’ils sont seuls capables de puiser la force dans l’énergie civique de leurs hommes coopérant, en leurs volontés singulières, au sein de la volonté générale résolument mobilisée contre tout enfermement idéologique. La maîtrise politique du terrorisme exige, comme nous l’avons déjà dit, la collaboration maximale des autres États, mais libérée de la préoccupation essentielle de faire porter cette lutte par un État mondial, et de la sorte, tout entier disponible pour capter la détermination de ses sujets. Étant assurée de sa base, l’activité politique pourra se concentrer sur le traitement du mal radical devenu agent négateur qui fragilise la substance de l’humanité.
Parallélisme des formes oblige, il faut opposer au terrorisme l’humanité, car, il faut le savoir, il cherche à rompre avec une humanité qui, selon lui, n’est pas ce qu’elle doit être, mais qui pour nous, est vraiment elle-même, dans son essence divine ou humaine. La riposte que nous lui opposons est sans doute restauratrice, bonne, car pleinement humaine. La conscience la plus commune de l’humanité contredit absolument la conscience terroriste qui vit sa conscience dans la négativité, dans la différence. La différence à soi étant ici sans identité, la conscience terroriste est alors dépourvue de raison. Grande leçon de Hegel : la raison est l’identité de l’identité et de la différence. Le terrorisme peut s’enivrer de sa puissance négatrice mais l’humanité en l’homme ne doit qu’affirmer son pouvoir absolu face à cette ivresse assassine sanctifiée, qui n’est que la violence arbitraire exercée par les privilégiés contre l’État, le peuple et à laquelle le volontarisme révolutionnaire doit opposer sa violence. Une riposte citoyenne et humaine repose sur le conditionnement en profondeur des citoyens. Cela suppose que le citoyen est travaillé patiemment dans la prise en compte des bonnes manières d’agir et dans le mépris radical de la foudre exterminatrice.
Conclusion
Nous avons montré que c’est la passion du crime qui mobilise le terroriste qui frappe la totalité du réel de la plus effroyable des manières et que, face à cette ivresse assassine, il faut compléter la riposte sur le champ policier par l’engagement total du citoyen. L’engagement, pour être efficace, doit se subsumer en réalisant l’idéal concret de l’homme en lui-même. L’urgence de la riposte exige un accompagnement citoyen qui facilite la lutte et aide le politique à en porter le poids. Pour ce faire, une révolution de l’engagement politique s’impose. La réalisation du renouvellement de l’engagement politique pour lutter contre le terrorisme rendu possible par l’affirmation d’une humanité universelle n’est possible que par l’État. L’homme ne peut donc s’exprimer dans le citoyen que par la puissance entremetteuse de l’État. L’État, en tant qu’élément et agent de l’engagement politique, enjoint l’affirmation de la totalité de l’humanité et de la totalité de la nation pour vivifier son engagement contre le terrorisme.
Le traitement politique efficace de ce problème radical en sa nouveauté exige une implication universelle des autres États. Mais, l’urgence de ce traitement désigne toujours l’État national comme le lieu politique de son examen total et de la décision à prendre à son sujet. Cette unité des engagements est en réalité une unité proprement engagée dont le contenu mérite et exige les sacrifices à faire pour le triomphe de la cause, une valeur et une norme stimulant les citoyens de ces États, comme citoyens, comme hommes. Un tel objectif détermine la disposition morale de l’homme qui sera ce qu’il est mais qui doit être ce qu’il doit être de sorte qu’il s’incorpore le mépris du terrorisme. Ce mépris sera désormais inscrit dans la nature humaine, il sera constitutif de son humanité. Ce faisant, nous n’allons plus « déléguer aux machines le fardeau du sacrifice et du courage » (J.-C. Guillebaud, 2005), encore moins à la détermination des citoyens, des États, l’essentiel de la lutte contre le terrorisme, mais à l’engagement intensifié de l’humain en l’homme.
Références bibliographiques
ALAIN (CHARTIER Émile-Auguste), 2017, Mars ou la guerre jugée/De quelques-unes des causes réelles de la guerre entre nations civilisées, Paris, Gallimard.
APOSTOLIDES Jean-Marie, 2003, Héroïsme et Victimisation. Une histoire de la sensibilité, Paris, Exils.
BENSAÏD Daniel, 2004, Une lente impatience, Paris, Stock.
BOURGEOIS Bernard, 1998, Sur l’histoire ou la politique, Paris, Vrin.
BURRIN Philippe, 2004, Ressentiment et Apocalypse. Essai sur l’antisémitisme nazi, Paris, Seuil.
GLUCKSMANN André, 2002, Dostoïevski à Manhattan, Paris, Robert Laffont.
GUILLEBAUD Jean-Claude, 2005, La force de conviction, Paris, Seuil.
GUILLEBAUD Jean-Claude, 2012, Le goût de l’avenir, Paris, Seuil.
HASSNER Pierre, 2002, « La signification du 11 septembre. Divagation politico-philosophique sur l’évènement », in Esprit, p. 153-169.
KANT Emmanuel, 2001, Sur le mal radical dans la nature humaine, Éditions bilingues, Rue d’Ulm-Presses de l’École normale supérieure.
LASCH Christopher, 1991, Le Seul et Vrai Paradis. Une histoire de l’idéologie du progrès et de ses critiques, Paris, Climats.
MAALOUF Amin, 2001, Les identités meurtrières, Paris, Grasset.
MICHEL Patrick, 1994, Politique et Religion. La grande mutation, Paris, Albin Michel.
MORIN Egard, 1994, Autocritique, Paris, Seuil.
THIBON Gustave, 1975, L’Échelle de Jacob, Paris, Fayard.
PENSER ET PANSER LA PERTE DE LA BIODIVERSITÉ EN AFRIQUE À LA LUMIÈRE DES SOUBASSEMENTS ONTOLOGIQUES ET DU SAVOIR-FAIRE DES TRADITIONS AFRICAINES
Roger TAMBANGA
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
roger.tambanga@ujkz.bf /rogertambanga@gmail.com
Résumé :
Aujourd’hui, tous les continents, sont impactés, mais à des degrés divers, par la crise environnementale. Si la recherche de solution à cette crise conduit à interroger notre agir pratique dans le monde naturel, il convient de noter qu’un changement significatif dans notre rapport à la nature ne peut s’observer que si nos paradigmes intellectuels, nos principes moraux à l’égard de la nature sont aussi questionnés. Pour une protection de la biodiversité en Afrique, il convient de réinterroger à nouveau frais la spiritualité, les systèmes de valeurs et le savoir-faire des traditions africaines. Dégagez le substrat onto-anthropo-éthique qui régit le rapport des sociétés traditionnelles africaines à la nature et revaloriser les savoir-faire des peuples dits indigènes pourraient participer à changer aujourd’hui notre rapport mercantile, mécanique et d’assujettissement du donné naturel. La protection de la biodiversité pourrait passer par un réexamen de la cosmologie des sociétés africaines et de leur savoir-faire.
Mots-clés : Africain traditionnel, Biodiversité, Crise environnementale, Ontologie, Savoir-faire et technique.
Abstract :
Today, all the continents are impacted at diverse levels by the environmental crisis; and this according to the western conception of nature and its conquest nature. If the quest of solutions to this crisis leads us to question ourselves concerning our behavior towards nature, we also have to notice that an important change in our way to deal with nature cannot be possible if we do not make use of our moral values and intellectual paradigms in our relation with nature. For protecting the African biodiversity we should question once more the spirituality, the system of values and the know-how of the African traditions. Show the onto-anthropo-ethical substrate that constitutes the basis of the link between the traditional black man and the nature. Then, revalue the know-how of peoples said to be indigenous can contribute to change today our relation of exploitation towards nature transmitted to us by western tradition. Otherwise, the biodiversity protection can be done by the examination of the African societies cosmology and their know-how. Therefore, this work will be a contribution that will consist in questioning the ingenuity of African peoples regarding the different stakes of the protection of the nature.
Keywords : Biodiversity, environmental Crisis, Know how, Ontology, technic and traditional African.
Introduction
La crise environnementale constitue l’un des défis majeurs du monde contemporain. La particularité de cette crise est sa dimension globale, planétaire et transgénérationnelle. Elle frappera, peut-être plus durement les générations futures. Cette crise s’exprime entre autres, par le changement climatique, la perte de la diversité biologique et génétique, la déplétion des ressources naturelles, la pollution de l’atmosphère, de l’eau etc. Par diversité biologique, on entend par là la richesse, en termes de variétés diverses et multiples, des espèces vivantes. Et la diversité génétique renvoie à la diversité du patrimoine génétique d’une espèce donnée. La crise environnementale à laquelle les sociétés actuelles doivent faire face est, selon D. Bourg (2022), D. Bazin (2022) et C. Semdé (2015), sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Face à cette crise qui menace la survie de notre planète, mais surtout celle de l’homme et des autres espèces vivantes, des initiatives aussi bien sur le plan national qu’international sont prises en vue de la juguler. Ce sont, entre autres, les sommets sur le climat, sur la terre, la création des fonds verts pour l’environnement, la création des ministères dédiés aux questions environnementales, la naissance des partis politiques dits des verts, la promotion d’économie verte, des éco-villages, et l’élaboration des éthiques environnementales.
Mais le constat peu reluisant est que depuis que l’homme contemporain a pris conscience de la crise écologique d’origine anthropique, et ce à partir des années 70 avec le premier sommet mondial sur le climat à Stockholm (1972), la situation ne s’est guère améliorée, ne serait-ce que sur le domaine de la biodiversité et du réchauffement climatique. Les espèces et leurs habitats continuent à être dévastés. En Afrique contemporaine, tout porte à penser que la conscience écologique peine à naître, et ce notamment à travers les incursions destructrices au sein des parcs nationaux, la déforestation, le rejet des déchets plastiques dans la nature et d’autres comportements « écocide ». Le défi écologique, à en croire certains, reste un défi insurmontable en Afrique.
Pour une protection efficace de la biodiversité, il sied d’examiner aujourd’hui, la cosmologie et le savoir-faire des traditions africaines. L’Afrique traditionnelle pourra avoir quelque chose à proposer pour juguler certains aspects de la crise environnementale, en l’occurrence la disparition de certaines espèces vivantes. Notre question directrice est la suivante : quelle peut être la fécondité de l’ontologie et du savoir technique des civilisations africaines dans la protection de la biodiversité ? Il faut indiquer que l’objectif principal de la réflexion en cours est de rechercher des ressources intellectuelles et pratiques dans l’Afrique traditionnelle capables de contribuer à la protection de la nature et à la diversité biologique. La réponse à la question directrice qui est ici une préoccupation théorique, nous conduira dans un premier temps à nous intéresser aux origines de la crise environnementale. Après s’être acquitté de cette tâche, nous nous pencherons, dans un deuxième temps, sur la contribution de la cosmologie et du savoir-faire des traditions africaines dans la protection de la biodiversité. Et en dernière instance, il s’agira de faire dialoguer la tradition africaine et la rationalité scientifique pour une meilleure prise en charge des questions relatives à la protection de la diversité biologique.
1. Aux origines de la crise environnementale : l’Occident au banc des accusés
Il n’est pas excessif de dire que l’Occident à travers sa représentation de la nature et sa technique agressive et conquérante est au fondement de la crise environnementale dont pâtit l’humanité aujourd’hui. Puisque les êtres vivants dépendent de la nature qui constitue leur biotope, leur habitat, sa destruction entraîne de facto le déclin de leurs populations. Espèces vivantes et nature/milieu de vie entretiennent des relations d’interdépendance. Il faut indiquer que la notion de nature revêt plusieurs sens. R. Lenoble (1969) et C. et R. Larrère (2009), reviennent sur les différentes conceptions de la nature. Dans ce présent travail, nous parlerons de la nature en faisant allusion au monde bio-géo-physique. Il s’agit d’indiquer dans la réflexion en cours que le dualisme occidental Homme-nature, sujet-objet, selon (D. Bourg, 2022), a contribué à la surexploitation de la nature, une exploitation démesurée rendue possible grâce aux progrès vertigineux des sciences et des techniques. En détruisant les autres modes d’être dans la nature, la vision occidentale du monde et la rationalité technicienne qui en découlent seront à l’origine des bouleversements écologiques. Quelle est la nouvelle représentation de la nature et ses implications technoscientifiques et écologiques ?
1.1. La représentation mécanique de la nature dans la civilisation occidentale
L’appauvrissement de la bio-géosphère, selon (C. Semdé, 2015), s’explique tout d’abord par le changement de rapport entre l’homme et la nature, de la représentation que l’homme se fait de cette dernière et de l’implication économico-industrielle que celle-ci a engendrée.
Il faut noter succinctement que les penseurs de la modernité, en l’occurrence Bacon (1986) et (1991) et Descartes (1963) et (1992), pour ne citer que ces deux grandes figures, se sont représentés la nature comme une gigantesque machine dont l’âme est le mouvement local. Avec ces illustres figures de la modernité, l’on se démarque de la cosmologie des Anciens grecs et de celle des autres civilisations. La conception de la nature comme un tout vivant sera substituée par l’approche mécanique.
La modernité occidentale représentera la nature comme un ensemble de matières inertes liées entre elles par la cause efficiente, c’est-à-dire par la loi mécanique. H. Jonas (2001, p. 21) fait observer à cet effet que « l’univers extraordinairement élargi de la cosmologie moderne est conçu comme un champ de masses et de forces inanimées qui opèrent selon les lois de l’inertie et de la distribution quantitative dans l’espace ». Dans cette nouvelle représentation de la nature, on a dépouillé la vie de ses visées téléologiques. Se dégage dans cette conception ce que M. Gauchet (2004) et E. Morin (1977) qualifient de désenchantement de la nature. D’une ontologie de la vie avec les Anciens, on passe, avec la modernité européenne, à une ontologie de la mort, puisque la nature, l’organique, est réduit à un simple objet d’étude. Résumant en quelques mots la conception moderne de la nature ou de la vie, le philosophe de la responsabilité fait observer avec désolation que
c’est seulement devenu cadavre que le corps est franchement intelligible (…) effacer en ce sens les frontières entre la vie et la mort, est l’orientation de la pensée moderne de la vie en tant que fait physique. Notre pensée est aujourd’hui sous la domination ontologique de la mort (H. Jonas, 2001, p. 21).
Ces propos de Jonas expriment l’attitude des sciences biologiques qui ramènent le phénomène de la vie à un phénomène de la matière inerte, sans vie, objet d’intellection surtout de la physique moderne. La mort dont parle Jonas doit être comprise ici dans le cas d’un corps vivant soumis à l’impératif des lois physiques de la réification, et non la mort dans le sens de la « néantisation » de la vie.
La perfection n’est plus domiciliée dans le ciel ou dans la nature, et G. P. Nakoulima (2010, p. 18) d’indiquer que : « l’on impute généralement à la cassure galiléo-cartésienne la perte par le ciel de sa dignité ontologique et le relèvement de la terre de son indignité métaphysique, intelligibilité du monde que nous avait léguée Aristote ». La nature, dans la représentation moderne, ne serait qu’un ensemble de matières inertes données dans l’espace et dans le temps. Elle devient intelligible non pas par les qualités sensibles, mais par les lois mathématiques. C’est dans cette optique que Galilée a soutenu que le livre de la nature est écrit en langage mathématique.
Les idées essentielles que nous retenons dans cette représentation de la nature, est qu’à partir de l’époque moderne, on assiste à une nouvelle conception de la nature se situant aux antipodes de celle des Anciens. Le fond commun dans cette représentation avec les différentes figures, est le mécanisme naturel. Comme le panvitalisme réunissait en majeure partie la conception traditionnelle, le panmécanisme réunit aussi la plupart des penseurs modernes. Du Tout-vivant, on passe au Tout-machine. La conception de la nature qui convenait à cette époque était celle d’une nature dépouillée de charge spirituelle, de tout enchantement. « La physique cartésienne s’est attelée à cette tâche : en finir avec l’idée que l’univers serait un « grand vivant », avec cet animisme ou cet « hylozoïsme » qui domine encore la pensée » (L. Ferry, 1992, p. 60). La nature, devenue une gigantesque machine, est soumise à une manipulation et à une exploitation sans mesure. La nature est réductible à une figure étendue et régie par le mouvement local. G. P. Nakoulima (2010, p. 54) observe que « le mécanisme en général posait l’homme comme l’inébranlable veritas et la réalité [nature] qu’il devait entreprendre de soumettre à ses normes. Il faisait ainsi son deuil à l’idée d’une communication entre l’homme et la réalité [nature] dont, naguère, il était partie prenante ». Réduite à sa seule dimension matérielle, il est hors de question de parler de vie et d’âme dans la nature comme le concevaient les Anciens. Selon le mécanisme cartésien (R. Descartes, 2009), les espèces vivantes, animales ou végétales, sont identiques à l’horloge ; seulement que les roues et les ressorts qui sont la cause de son mouvement sont invisibles à l’œil nu, contrairement à ceux de l’horloge qui sont visibles.
Le but de cette interprétation mécanique de la nature est sa domination et son exploitation. Le grand partage étant établi entre l’homme et la nature, il revient à l’homme de soumettre cette dernière à sa volonté. Pour y parvenir, il faut que soient révolutionnées la science et la technique. D’une science contemplative, d’une technique respectueuse du donné naturel à l’œuvre dans les civilisations anciennes, on passe à une technoscience manipulatrice, transformatrice et « dominatrice » de la nature.
1.2. L’assujettissement technique de la nature : l’épée de Damoclès
La nature étant maintenant réduite à une matière sans vie, à une super-machine, ou encore à une super-automate, pour emprunter la terminologie morinienne, la science moderne s’arrogerait le droit de la manipuler, de la transformer et de l’assujettir suivant la volonté de l’homme. En clair, les âmes, les dieux, les génies s’étant retirés de la nature, celle-ci ne devient qu’un ensemble de ressources, d’énergies à exploiter à souhait. « En éliminant de la nature, esprits, génies, âmes, la science avait, du coup, éliminé tout ce qui est animateur, tout ce qui est génératif, tout ce qui est producteur (…) », écrit très justement E. Morin (1977, p. 277). La technoscience, solidaire de la nouvelle conception du monde, ne vise plus à aménager, à ordonnancer le monde pour le bien-être de l’homme ; elle vise plutôt à régler la nature suivant la boulimie de l’homme. Le nouvel esprit de la rationalité technoscientifique, c’est de devenir « comme maîtres et possesseurs de la nature » selon le vœu de (R. Descartes, 1966, p. 141). La technique entend sommer la nature de livrer à l’homme tout ce dont il a besoin. Contrairement à la technique traditionnelle qui visait à achever ce que la nature à laisser inachevé, à s’intégrer dans la nature sans la faire subir des préjudices, la technique moderne se veut mutilatrice, colonisatrice, conquérante. Quelles sont les implications écologiques d’une technique dominatrice, conquérante ?
La grande dérive d’une technique dominatrice, est bien évidemment la démesure, l’hybris technologique. Par la bénédiction des technosciences, l’homme intervient dans la nature sans vergogne. La crise environnementale sans précédent est l’une des graves conséquences de la finalité du nouvel esprit technique. G. Hess (2013, p. 20) fait observer que « les effets de l’orientation d’une technique au service de l’artificialisation et de la maîtrise de l’environnement ont engendré des problèmes nouveaux par rapport à ceux que les sociétés du passé ont connu ».En effet, les espèces fauniques sont détruites à cause, non seulement, de l’usage des produits chimiques toxiques, mais aussi et surtout à cause de l’approche mercantile de la nature développée par la science occidentale. Le monde biologique est en perte de vitesse sans oublier la déplétion irréversible des « ressources » du sous-sol. La destruction des forêts, la démolition des montagnes, l’exploitation pétrolière qui est une première étape de la destruction de la bio/écosphère, auront pour effets – et là se situe le deuxième niveau pas le moindre de la crise – la hausse de la température, puisque les forêts, les montagnes et les océans considérés comme des puits de carbone se trouvent dévastés. Une fois les puits de carbone détruits, nous ne pouvons qu’assister à la libération du CO2 (principal gaz responsable du réchauffement climatique, sans négliger pour autant les effets des gaz méthanes et des CFC) dans l’atmosphère.
Aujourd’hui, selon certaines estimations, en particulier, celles que publie le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), des millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sont enregistrés chaque année et ces chiffres vont croissant. À moins d’être un climato-sceptique, la hausse de la température, due à l’éjection des gaz tel que le méthane et le CO2 est sans commune mesure. Par-delà l’exactitude des chiffres qui restera une bataille interminable, les faits sont têtus, car
plusieurs espèces de plantes et d’animaux migrent pour tenter de conserver un habitat adapté à leurs caractéristiques ; les glaciers et les surfaces enneigées reculent nettement et, parfois, spectaculairement, dans presque toutes les régions du monde ; la température des océans s’élève, de sorte que leur masse se dilate et que le niveau de la mer augmente (de dix à vingt centimètres au XXe siècle) ; la violence des cyclones s’accroît et on enregistre davantage d’événements météorologiques extrêmes, etc. (…) Il ne fait plus aucun doute qu’ils ont pour moteur principal l’augmentation de la concentration atmosphérique en carbone, donc de la température de surface de la Terre (D. Tanuro, 2012, p. 31).
Tout ce lot de « pathologies environnementales » établit par Tanuro est la cause aujourd’hui de l’extinction de certaines espèces végétales et animales qui n’ont pas pu s’adapter à la nouvelle donne d’autant plus que la destruction de la nature s’est opérée avec une vitesse extraordinaire.
En résumé, du sous-sol à l’atmosphère en passant par la croûte terrestre, le constat est désolant car nous faisons face, d’une part, à l’épuisement, et d’autre part, à la concentration des déchets toxiques. Il en découle logiquement que la destruction de l’écosphère entraîne nécessairement la destruction de la biosphère, donc la perte de la biodiversité. Face à l’appauvrissement de la biosphère, plus exactement l’extinction des espèces à laquelle nous ont conduits la cosmologie et la technoscience occidentale, une conscience écologique est née en vue d’apporter des réponses durables à la crise. Dans le monde occidental, on assiste à l’élaboration des éthiques environnementales, une nouvelle conception de l’univers et un questionnement de l’agir technique. L’Occident veut de nouveau universaliser son approche écologique comme si les autres peuples n’ont aucune conscience et attitude écologique. Le savoir-être dans la nature et le savoir-agir des traditions africaines, ne peuvent-ils pas contribuer à trouver des solutions endogènes à la perte de la biodiversité ? La crise est certes globale, planétaire, mais une approche différenciée pourra mieux répondre à certains enjeux de cette crise, en particulier la protection de la biodiversité en Afrique.
2. La contribution de la cosmologie et du savoir-faire des traditions africaines à la protection de la biodiversité
La formulation de notre titre se fonde sur des présupposés qu’il convient de discuter. Parler de l’apport du savoir, du savoir-être et du savoir-faire des sociétés traditionnelles africaines dans la protection de la biodiversité, c’est estimer que les savoirs traditionnels sont féconds dans la protection de la nature.
La plupart des sociétés traditionnelles africaines ont eu pour principale activité, l’agriculture, l’élevage et la chasse. La déforestation, en fin de tailler des champs, a été à l’origine de la disparition de certains types d’arbres (nous avons en vue ici les arbres non-fruitiers et d’autres espèces jugées non ou peu utiles), et des espèces animales qui en dépendaient. Les sociétés traditionnelles africaines, de par leurs croyances et leurs activités socio-économiques, ont porté atteinte à la survie de certaines espèces. La plupart des pratiques techniques non-prospectives d’agriculture, de chasse et de pêche, bien qu’elles soient soucieuses du respect de la nature, avaient un impact négatif sur certaines espèces. Pour autant, la biodiversité, dans son ensemble, n’était pas profondément menacée comme elle l’est aujourd’hui. En effet, cet impact est si insignifiant de sorte que la nature pouvait se régénérer. La destruction de la nature, en revanche, suscitée par la civilisation occidentale est d’une telle ampleur que la nature est incapable de se reconstituer. Au-delà des connaissances des écologues occidentaux, il est question de savoir si les savoir-faire ou connaissances endogènes des sociétés traditionnelles africaines peuvent être fiables dans le cadre de la préservation de la biodiversité.
2.1. La fécondité écologique d’une conception de vie unifiée dans les traditions africaines
Il s’agit ici de dégager l’arrière-fond métaphysique ou ontologique commun aux traditions africaines. Une telle tâche permettra d’interroger la pertinence de cette métaphysique, mieux de cette ontologie dans la protection de la diversité biologique. Nous précisons d’emblée que nous ne nous intéresserons pas aux expressions culturelles particulières des sociétés africaines. Notre réflexion se veut transversale. S’orientant dans une perspective ontologique, on parlera des traditions africaines comme si l’on avait affaire à une culture homogène. Par-delà leur diversité culturelle, les sociétés africaines traditionnelles se rencontrent dans leur conception de la vie. Quelle est la particularité d’une telle conception ? Et quelle est son implication écologique ?
S’il est vrai que d’un point de vue ontologique, il n’y a pas de différence fondamentale entre l’homme et les êtres vivants, notamment les animaux, cependant il est inconcevable que la différence, s’il en existe, se situe seulement au niveau morphologique ou factuel. Dans la conception animiste de la vie, il est reconnu que des entités naturelles et surnaturelles non humaines telles que les animaux, les plantes ou d’autres objets possèdent une âme et des intentions comparables à celles de l’homme. L’Africain traditionnel a tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. C’est cette conception anthropomorphique du monde qui l’amène à adopter une attitude respectueuse à l’égard de la nature et de la biodiversité. Il y a également chez l’Africain traditionnel l’idée que certains phénomènes naturels abritent l’âme ou l’esprit des ancêtres. Se sentant proche de la vie des autres êtres vivants, l’Africain traditionnel développe un comportement respectueux à leur égard. La différence entre l’homme et les autres vivants n’est donc pas de nature, mais de degré.
Si les Occidentaux voient la nature comme une matière sans vie, des vivants sans vie, le Noir traditionnel voit de la vie partout à travers sa conception anthropomorphique de la nature et des espèces qui la composent. La forêt, les rivières, les montagnes, les aires sont des lieux d’incarnation des esprits qui méritent respect ou adoration. Il en est de même des animaux qui méritent respect et vénération. Toutes ces vies ne sont pas disjointes les unes des autres, mais liées les unes aux autres. L’Africain pense la vie et vit la vie en tout lieu et en tout temps. P. E. A. Elungu (1987, p. 31), parlant de la représentation cosmologique des sociétés africaines traditionnelles, fait observer :
La pensée n’est pas indépendante de la vie, elle n’est même pas autonome ; elle est la vie qui constamment s’élargit pour s’unir et participer à tout ce qui est vie dans l’univers. La vie n’a point de fin, dans le double sens où elle n’a ni limite ni finalité hors d’elle-même.
Ce « Monde-Vie » verticalement et horizontalement hiérarchisé ne conduit pas l’homme Africain à se considérer comme un être au centre du monde. P. Descola (2005, p. 444) fait remarquer que « l’animisme est donc anthropogénique plutôt qu’anthropocentrique, dans la mesure où il fait procéder des humains tout ce qui est nécessaire pour que des non-humains puissent être traités comme des humains ».
Participant à la vie des autres vivants, développant une raison sympathisante, l’Africain traditionnel, à travers son système totémique, voit certaines espèces animales, végétales, comme des parents proches ou éloignés. Á titre d’exemple, les « yaana » voient le varan, comme leur animal totem, un ancêtre. Les yaana est un groupe ethnique du Burkina se trouvant au centre-est du pays. Il faut surtout souligner que c’est la famille Tambanga qui développe cette posture particulière à l’égard de cet animal.
Le monde non-humain est vu comme un monde humain. Le lien de continuité qui lie tous les êtres de la nature, c’est sans doute la vie. Dans « le monde animique, les relations entre non-humains comme les relations entre humains et non humains sont caractérisées comme des relations entre humains, et non l’inverse » (P. Descola, 2005, p. 433). La vie est célébrée partout à travers des rituels.
P. Tempels (1945), s’intéressant à la philosophie bantoue, parvient à la conclusion que l’ontologie bantoue est dynamique, vitale, de sorte que le comportement du Bantou consiste à développer et à entretenir cette force vitale. « Il est dans la bouche des noirs, des mots qui reviennent sans cesse. Ce sont ceux qui expriment les suprêmes valeurs, les suprêmes aspirations (…). Cette valeur suprême est la vie, la force, vivre fort ou force vitale » (P. Tempels, 1945, p. 30). Le Bantou s’interdit de tuer telle ou telle espèce animale, de violer tel ou tel espace géographique de crainte de voir sa force vitale diminuée. D’un monde éclaté, atomisé, d’une ontologie de la mort, pour emprunter les termes de Jonas, dans la modernité occidentale, les traditions africaines nous enseignent une ontologie de la vie, un « monisme intégral » (Jonas, dans son Phénomène de la vie. Vers une biologie philosophique, utilise l’expression « monisme intégral » pour indiquer que l’Être est non duel, mais unique avec cependant des ramifications) qui insiste sur le faitque « l’origine et la fin de l’homme, c’est l’eau, le trou, le marais, le serpent, le ver, l’arbre sacré, l’oiseau » (P. E. A. Elungu, 1987, p. 24). Quelle pourrait être la fécondité d’une telle ontologie, cosmologie, dans la préservation de la biodiversité ?
Comme nous l’avons déjà indiqué, l’unité des différentes formes de vie, conduit l’homme à adopter une attitude respectueuse à l’égard de la nature vivante. Une dignité ontologique est reconnue à certaines espèces et à leur habitat. Si la mise en péril, pire l’extinction de certaines espèces vivantes s’explique par le fait que la civilisation occidentale, à un moment donné, n’a pas eu de respect à leur égard en les considérant comme des êtres sans dignité ou valeur intrinsèque et, par conséquent exploitable à souhait, une ontologie de vie des civilisations africaines contribue ipso facto à protéger les espèces naturelles. L’Africain traditionnel, pour parodier les expressions de L. Aldo (2000), pense comme la montagne. F.-X. Damiba note que le « Moaga croit, en effet, que tous les niveaux du réel offrent une porosité grâce à laquelle il se trouve intégré dans un absolu et ne constitue pas un accident réduit à une existence fragmentaire ». Et cette prédisposition intellectuelle l’amène à ne pas développer une attitude egocentrique destructrice de « l’altérité vivante ». Une telle conscience du lien ontologique avec le monde du vivant le conduit à respecter la vie en général et en particulier l’espèce, le lieu avec lequel il se sent très proche. Toutes les traditions africaines, toutes les ethnies, les catégories sociales n’ont pas les mêmes tabous, le même animal ou arbre de totem. Sacralisant diverses formes de vies, ces traditions protègent la biodiversité. Éviter de détruire ces croyances qui, loin d’être irrationnelles, et rationaliser certaines d’entre elles, contribueront à la préservation de la biodiversité.
En résumé, si l’Occident respectait les systèmes de croyances, de représentation, de savoir-être des traditions africaines, ou si l’Afrique contemporaine entreprenait une revalorisation de son mode d’être dans le monde, il est sans conteste que cela permettrait de sauver certaines espèces en voie de disparition – une disparition qui s’explique par la prédominance de la rationalité technique. Revisiter aujourd’hui la cosmologie africaine pourrait contribuer à préserver le monde de la vie. Aussi, la revalorisation du savoir-faire de ces traditions pourrait être une alternative prometteuse dans la conservation et la protection de la biosphère qui agonise de plus en plus sous la menace de l’action anthropique. Les lignes qui suivent s’intéresseront aux savoir-faire des sociétés africaines traditionnelles.
2.2. La « techno-ontologie » dans la tradition africaine et l’intérêt de protéger les espèces vivantes
De la même manière que la technoscience occidentale est la résultante de la représentation mécanique de la nature, de même les savoir-faire des sociétés traditionnelles africaines sont solidaires de la représentation que ces sociétés se font de la nature. D’une technologie d’un côté, de l’autre, nous avons affaire à une techno-ontologie, c’est-à-dire un agir technique qui s’adosse à une ontologie prédéfinie. Nous forgeons le concept afin d’indiquer un savoir-faire dont la pertinence tient de son lien avec une vision particulière d’être au monde. Contrairement à la technologie occidentale dont la valeur se repose sur l’efficacité opératoire et la rentabilité, la techno-ontologie tire sa valeur dans le respect d’un ordre onto-éthique prédéfini. Comment intervenir dans le monde de la vie sans mettre en péril ce monde, est l’essentialité préoccupante de l’homme Africain. L’agriculteur, l’éleveur, le chasseur, le pêcheur, veille à ce que son action ne bouleverse pas l’équilibre ou l’ordre de la biosphère, mère nourricière des différentes populations animales et/ou végétales. P.E.A. Elungu (1987, p. 12), à ce propos, note que :
quelles que soient les productions matérielles, caractéristiques d’un milieu donné et définissant dans leur spécificité des cultures considérées, quelles que soient les modalités concrètes de ces productions, une chose alors saute aux yeux : leur caractère général et générique est de ne point s’approprier la nature en la dominant mais de se la rendre favorable en lui obéissant.
On sera tenté de penser que si les sociétés traditionnelles n’ont pas bouleversé de façon irréversible la biosphère, cela s’expliquerait par le fait qu’elles avaient recours à des outils rudimentaires, archaïques, en un mot à des techniques primitives. Mais il faut souligner que le caractère destructeur de la technique ne réside pas seulement dans l’outil utilisé, mais fondamentalement dans l’esprit de son utilisateur. La finalité de l’agir dans les différentes activités socio-économiques de l’Africain traditionnel n’est pas de soumettre la nature ou les êtres qui la composent, mais de participer à entretenir la vie. Si l’objectif était d’assujettir la nature et les espèces qui la composent, avec la simple daba, pioche, machette, flèche, il pouvait en causer d’énormes dégâts. Pour preuve, en imposant aux sociétés africaines le diktat de la rationalité conquérante, mutilante, l’Afrique contemporaine n’a pas eu besoin de faire intervenir une technologie de pointe pour mettre aujourd’hui la survie de nombreuses espèces et leur biosphère en péril. La monoculture, la culture intensive et la valeur marchande des espèces, imposées aux sociétés africaines, ont conduit ces dernières, et ce au moyen des outils rudimentaires, à menacer les espèces fauniques. Le danger, nous le rappelons derechef, ne réside pas que dans les outils technologiques mobilisées, mais dans l’esprit qui les mobilise. La remarque de P.E.A. Elungu (1987, p. 11-12) s’inscrit dans cette perspective lorsqu’il écrit que
si les différents milieux imposent différents types d’activités, de production matérielle, ce qui est frappant, c’est que partout, en forêt comme en savane, en montagne comme dans la cuvette centrale, l’emprise de l’homme sur le milieu ne paraît nulle part déterminante ; le milieu naturel ne semble pas avoir porté la marque indélébile d’une quelconque supériorité de l’homme sur la nature.
Le chasseur-cueilleur traditionnel peut bien aller au-delà de ce dont il a besoin pour sa pitance, car ses pouvoirs le lui permettent, mais l’éthique de suffisance accompagnant ses actions l’amène à utiliser d’une manière raisonnable ses pouvoirs techniques ou magiques. La finalité de l’action n’est pas de devenir maître et possesseur de la nature, mais de communier avec elle. L’esprit du savoir-agir des sociétés africaines traditionnelles peut aujourd’hui nous indiquer la voie à suivre pour protéger la biodiversité.
Les sociétés traditionnelles doivent leur survie à leur capacité d’adaptation aux différentes dynamiques saisonnières. Elles ont su apporter des réponses adéquates aux conditions métrologiques extrêmes, à la pénurie de l’abondance, en un mot face à la disgrâce de la nature. Les savoirs locaux qu’elles ont mobilisés pour contrer l’érosion des sols, pour protéger leurs cheptels, leurs espèces totem, pour protéger leurs multicultures peuvent être aujourd’hui revalorisés en vue d’apporter, de façon générale, une réponse à la crise environnementale d’ordre anthropique cette fois-ci, et particulièrement sauver la perte de la diversité biologique.L’agriculteur traditionnel est foncièrement un promoteur de la biodiversité. En effet, dans son champ, on trouve plusieurs variétés de cultures, (on a du mil, du haricot, du gombo, des arachides dans le même champ), plusieurs techniques culturales (le sarclage, le cordon pierreux, le zaï en fonction des zones) qui lui permettent de répondre aux aléas climatiques. On trouve chez l’éleveur traditionnel plusieurs spécimens (des grands et petits ruminants, de la volaille, etc.) et plusieurs techniques d’élevage. L’expression et la valorisation de ces savoirs et initiatives locaux permettront de sauver les espèces qu’elles soient sauvages ou domestiques en voie de disparition. Il faut souligner au passage que l’accent est mis sur l’esprit qui accompagne le savoir-faire endogène. Donner aujourd’hui la parole à nos traditions, écouter et impliquer ceux d’en-bas, pourraient nous aider à parer certaines expressions de la crise environnementale, en l’occurrence la perte de la biodiversité.
En résumé, de façon sélective, critique et rationnelle, on peut trouver dans la représentation cosmologique et dans le savoir-faire des traditions africaines des réponses pour contrer la disparition de nombreuses espèces vivantes aujourd’hui. Si tant est que la cosmologie, les systèmes de valeurs et les savoirs locaux des sociétés africaines traditionnelles peuvent aider l’Afrique contemporaine à faire face à la perte de la biodiversité, d’énormes défis restent cependant à relever.
3. Dialogue entre la tradition et la rationalité scientifique face à la disparition de la biodiversité
S’il convient de ne pas sous-estimer, de ne point méconnaître l’apport des savoirs locaux dans la réponse à apporter à la perte de la biodiversité, il ne faut pas non plus les surestimer. Nous faisons aujourd’hui face à une crise écologique globale couplée à un défi de sécurité alimentaire, économique, de développement de l’Afrique. Comment satisfaire les exigences, sinon la nécessité du développement du continent tout en respectant l’exigence de protection et de sauvegarde de la biodiversité ?
Puisque nous indiquons qu’il faut se débarrasser de la conception mécanique et de la technique conquérante de l’Occident – origine de la crise écologique dont nous pâtissons, d’une part, et d’autre part, éviter l’imposition des réponses exogènes pour protéger les espèces sur le continent africain, il s’avère nécessaire de rationaliser, d’innover les savoirs locaux en présence pour répondre à la fois aux besoins des populations et à la nécessité de protéger la biodiversité. E. O. Wilson (2003, p. 236) note avec réalisme que
le problème central de ce nouveau siècle est de donner aux pauvres du monde entier un niveau de vie décent tout en préservant au maximum le reste de la vie. Les pauvres dans le besoin et la diversité biologique déclinante sont pareillement concentrés dans les pays en développement. (…) les environnements naturels où se cramponne la majeure partie de la biodiversité ne peuvent survivre à la pression territoriale de gens affamés qui n’ont aucun ailleurs où aller.
Il faut surtout arriver à abstraire le rationnel dans le sacré pour qu’une autre communauté qui ne reconnaît pas le même animal, le même arbre, comme relevant du sacré chez elle puisque comprendre la nécessité de sa protection pour le bien-être de l’espèce en question, de la culture qui la protège et pour son propre intérêt. Par-delà d’indiquer que tel ou tel animal serait « l’ancêtre », l’animal totem de telle ou telle ethnie ou famille, il faut montrer le service écologique bénéfique à toutes les communautés qu’apporte telle ou telle espèce animale ou végétale.
Par ailleurs, l’État, en plus des parcs nationaux, doit apporter son expertise aux différentes traditions pour protéger leurs espèces totem, puisque la crise environnementale relève d’un phénomène global et non localement circonscrit. Impliquer toujours la population locale dans la préservation des espèces reste la posture la plus prometteuse. Mieux, « il faut rendre la conservation localement rentable. (…) Faire naître en [elle] un sentiment de propriétaires envers l’environnement naturel et les engager à faire métier de sa protection » (E. O. Wilson, 2003, p. 206).
Enfin les centres de recherches pourront s’inspirer des initiatives locales, des savoir-faire locaux pour proposer des savoirs innovants afin de juguler l’insécurité alimentaire et préserver la biodiversité. L’agroécologie, l’agroforesterie, en un mot, l’agriculture intelligente, pourrait être un apport aux savoir-faire endogène en matière d’agriculture et de protection des forêts. Venir au secours des savoirs locaux et non les mettre entre parenthèses, reste la voie idéale pour aider les populations à répondre non seulement à leurs besoins, aspirations proprement humaines, mais aussi préserver l’équilibre écologique. Comme le souligne avec perspicacité J. M. Ela (1982, p. 181), « l’Afrique des paysans n’est qu’en apparence fermée aux innovations technologiques. Ce qui éclaire son comportement devant les apports extérieurs, c’est la volonté d’échapper à toutes les formes de domination qui prennent le masque de la « modernisation » ». Reconnaissance, respect, apport, restent les maîtres mots pour apporter des solutions globales et différenciées à la perte de la biodiversité.
Conclusion
Que retenir de cette contribution théorique et fondamentale ? Nous estimons que pour une protection efficace de la biodiversité en Afrique contemporaine, il sied de réinterroger nos systèmes cosmologiques, éthiques et nos savoir-faire locaux. Une approche raisonnée, une revalorisation et une innovation des pratiques traditionnelles pourraient être une alternative prometteuse pour contrer aujourd’hui la perte de la biodiversité. L’écoute, le dialogue et le respect de ceux d’en-bas, et surtout la co-construction des savoirs, des savoir-faire dans ce monde de rencontre et de grands défis éco-sociaux, reste et demeure la sagesse à entretenir pour être à la hauteur des différents défis de notre époque, dont la protection de la diversité biologique.
Références bibliographiques
ALDO Léopold, 2000, Almanach d’un comté des sables, Trad. Anna GIBSON, Paris, Flammarion.
BACON Francis, 1986, Novum Organum, Trad. M. MALHERBE & J.-M. POUSSEUR, Paris, P.U.F.
BACONFrancis, 1991, Du progrès et de la promotion des savoirs, Trad. M. LE DOEUFF, Paris, Gallimard.
BAZIN Damien, 2022, Sauvegarder la nature. Une introduction au Principe Responsabilité de Hans Jonas, Paris, Ellipses Éditions.
BOURG Dominique, 2022, Une nouvelle Terre, Paris, PUF/Humensis.
DAMIBA François-Xavier, 2016, Typologie des interdits Moossé, Lomé, Éditions Saint-Augustin Afrique.
DESCARTES René,1963, Œuvres philosophiques, T1 (1618-1637), Textes réunis et présentés par F. Alquié, Paris, Garnier et Frères.
DESCARTES René, 1966, Discours de la méthode, Paris, Garnier-Flammarion.
DESCARTES René, 2009, Principe de la philosophie, Trad. Denis MOREAU, Paris, J. Vrin.
DESCOLA Philippe, 2005, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard.
ELA Jean-Marc, 1998, Innovations sociale et renaissance de l’Afrique noire. Les défis du « monde d’en-bas », Paris, L’Harmattan.
ELA Jean-Marc, 1982, L’Afrique des villages, Paris, Karthala.
ELUNGU Pene Elungu A., 1987, Tradition africaine et rationalité moderne, Paris, L’Harmattan.
FERRY Luc, 1992, Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Grasset & Fasquelle.
GAUCHET Marcel, 2005, Le désenchantement du monde, Paris, Folio Essai.
JONAS Hans, 2001, Le phénomène de la vie. Vers une biologie philosophique, Trad. Danielle LORIES, Paris, De Boeck Université.
LARRÈRE Catherine et Raphaël LARRÈRE, 2009, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Éditions Flammarion.
LENOBLE Robert, 1969, Histoire de l’idée de nature, Paris, Albin Michel.
MORIN Edgar, 1977, Méthode 1 : La nature de la nature, Paris, Seuil.
NAKOULIMA, Gomdaogo Pierre, 2010, La préservation de la planète : défis contemporains de la modernité, Paris, L’Harmattan.
SEMDE Cyrille, 2015, Éthique et politique chez Hans Jonas. Pour une philosophie politique de l’environnement, Paris, L’Harmattan.
TEMPELS Placide, 1945, La philosophie bantoue, Trad. A. RUBBENS,Paris, L’Harmattan.
WILSON Edward O., 2003, L’avenir de la vie, Trad. Christian JEANMOUGIN, Paris, Seuil.
LA FAILLITE DES PARTIS POLITIQUES AU MALI
Baba SISSOKO
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (Mali)
Résumé :
Lors de la 16ème conférence des chefs d’États de France et d’Afrique tenue à la Baule du 19 au 21 juin 1990, le Président français de l’époque, Monsieur François Mitterrand a invité les pays d’Afrique à organiser des élections véritablement libres et instituer le multipartisme. Ainsi, à l’instar des autres pays de la sous-région, le Mali dans sa Constitution du 25 février 1992 a opté pour une démocratie basée sur le multipartisme intégral. Aujourd’hui, force est de constater que la démocratie malienne est en crise. Cette crise démocratique au Mali s’explique en grande partie par la faillite des partis politiques qui n’ont pas su jouer le rôle pour lequel ils ont été créés. Ce qui a eu comme conséquence de nombreux bouleversements sur le plan politique conduisant à des renversements de régimes politiques et à l’arrivée des militaires sur la scène politique.
Mots-clés : Comportement politiques, Démocratie, Élection, Faillite, Mali, Multipartisme, Partis politiques, Pléthore.
Abstract :
During the 16th Conference of Heads of State of France and Africa held in La Baule from 19 to 21 June 1990, the French President of the time, Mr François Mitterrand, invited African countries to organise truly free elections and institute a multi-party system. Thus, following the example of other countries in the sub-region, Mali, in its constitution of 25 February 1992, opted for a democracy based on an integral multi-party system. Today, it is clear that Mali’s democracy is in crisis. This democratic crisis in Mali can be explained in large part by the failure of political parties to play the role for which they were created. This has resulted in numerous political upheavals leading to the overthrow of political regimes and the arrival of the military on the political scene.
Keywords : Political behaviour, Democracy, Election, Bankruptcy, Mali, Multiparty system, Political parties, Plethora.
Introduction
Une démocratie forte et durable dépend de l’existence de partis politiques bien opérationnels (V. Helgesen, 2007, p. 5). Les partis politiques ont été longtemps considérés comme la dimension organisationnelle la plus importante, comme la clef de la santé et de la survie de la démocratie. En 1942, Schattsneider, déclarait que la « démocratie est impensable sauf en termes de partis » (N. V. de Walle, K. Smiddy, 2000, p. 41).
À côté des définitions générales des partis politiques, il existe une définition particulière qui caractérise suffisamment les partis politiques maliens. Les partis sont les instruments pour l’action humaine collective de l’élite politique, soit des politiciens tentant de contrôler un gouvernement, soit des cadres gouvernementaux ou publics qui tentent de contrôler les masses. Dans les systèmes compétitifs, les partis sont organisés pour gagner les élections. Dans les régimes autoritaires, ils sont établis pour contrôler les comportements et actions des populations. Dans tous les cas, il faut une organisation structurelle, des moyens financiers, des cadres compétents, des militants et un règlement intérieur pour le fonctionnement du parti (I. K. Souaré, 2018, p. 8). Les partis politiques partout dans le monde, sont en crise, sont impopulaires et sont de plus en plus discrédités. Le nombre de leurs membres est en chute, les pratiques internes de gestion sont souvent faibles et peu démocratiques (V. Helgesen, 2007, p. 5).
Aujourd’hui l’insuccès des partis politiques est patent au Mali. Cette énième crise que connaît le pays vient de prouver à suffisance que les partis politiques ont montré leur limite dans la gestion des affaires publiques. Et pourtant l’avènement de la démocratie et la naissance de plusieurs partis après la chute du régime du général Moussa Traoré avaient suscité un certain espoir chez les Maliens fatigués de vivre sous un pouvoir de répression.
Actuellement, au niveau du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, plus de deux cents partis ont reçu leur récépissé pour mener leurs activités politiques. Le désordre qui s’est installé sur le champ politique du fait de la multiplicité anarchique des partis entraine à coup sûr une certaine confusion dans la conduite des affaires politiques. Depuis quelque temps, l’on assiste à un rejet des partis politiques par les populations qui se trouvent abusées par les positions changeantes des leaders politiques selon la direction du vent.
La faillite autrement dit l’insuccès patent, largement reconnue des partis politiques a conduit à la déliquescence de l’État malien et à la dégradation des valeurs sociétales dans le cadre du régime démocratique instauré par la Constitution du 25 février 1992.
La réflexion que nous souhaitons mener ici se situe dans le cadre du renouveau démocratique tant souhaité par les populations maliennes. L’intérêt de cette démarche est d’amener les partis politiques à se remettre en cause afin de pouvoir jouer pleinement le rôle qui leur revient de droit dans la construction d’un État républicain dont le fonctionnement sera essentiellement basé sur les principes démocratiques. Qu’est-ce qui explique cette faillite des partis politiques maliens qui, au début de l’instauration de la démocratie dans le pays ont contribué à l’animation de la vie politique ?
La méthodologie utilisée dans cet article s’appuiera, sur une approche pluridisciplinaire, basée sur la collecte des documents que nous entrevoyons d’analyser. Les sources principales utilisées sont d’origines législatives, des revues, des rapports, des articles de journaux et des sites internet. Au Mali, l’insuccès des partis politiques, auquel on assiste aujourd’hui est dû d’une part, à la pléthore des partis politiques (1), d’autre part aux comportements politiques irrationnels des acteurs politiques (2).
1. La pléthore des partis politiques
Avec l’introduction de la démocratie au Mali, plusieurs partis politiques ont été créés. Pour rapidement meubler le champ politique, des associations s’érigent en parti politique. C’est le cas de l’ADEMA-PASJ (Alliance pour la démocratie au Mali-parti africain pour la solidarité et la justice) et du CNID (Congrès national pour l’initiative démocratique) (M. Camara, K. Y Keita, A. Diawara, 2011, p. 15). Malgré la faiblesse de leur capacité programmatique (M. Traoré, A. Sogodogo, 2018, p. 13), les partis politiques continuent d’être créés pour occuper le paysage politique du Mali. Il est même difficile de dénombrer avec exactitude le nombre de partis (M. Camara, K.Y Keita, A. Diawara, 2011, p. 17).
Ce caractère pléthorique des partis politiques a été surtout favorisé par la liberté qu’octroie la Constitution dans le domaine de la formation des partis politiques (1.1) mais également par le fait que les partis politiques dévient souvent de leurs principaux objectifs (1.2.).
1.1. La liberté de formation des partis consacrée par la Constitution malienne du 25 février 1992
À la suite de la seconde guerre mondiale, avec l’organisation des premières consultations électorales, l’Afrique débute une nouvelle ère de son histoire politique qui marque la « fin » du colonialisme et l’avènement d’un jeu politique progressiste (I. Datidjo, V. D. Yotedje, A. Tchinenba, 2012, p. 97). Tenu dans un contexte international de démocratisation et d’aspiration à la liberté de peuples africains subsahariens, la décision phare du sommet de La Baule de juin 1990 fut la résolution de la France de conditionner son Aide Publique au Développement (APD) aux efforts démocratiques des pays d’Afrique subsaharienne. Avec cette décision Paris entend encourager l’ouverture démocratique des États africains et promouvoir des valeurs de la démocratie libérale qu’il estime universelles (A. Sadio, 2019, p. 5). Il s’est agi de tourner la page à la dictature militaire dans certains États et des régimes civils autoritaires dans d’autres afin de parvenir à l’instauration des systèmes favorables à la création des partis porteurs d’opinions et d’idéologies nouvelles (I. Datidjo, V. D. Yotedje, A. Tchinenba, 2012, p. 97).
Après la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et des certitudes communistes, les pays africains ont été contraints (afin de continuer de profiter des aides, et des rééchelonnements de la dette) d’instaurer le multipartisme après plus de cinquante années de parti unique ou de dictature militaire (N.E Harmouzi, 2008). Les systèmes de partis uniques gangrenés par la corruption, contestés pacifiquement ou violemment par la rue, laissent partout la place à un multipartisme exacerbé (S. Bollé, 2021, p. 5-6).
Certaines Constitutions africaines consacrent la liberté de créer des partis politiques et le multipartisme intégral. Cette reconnaissance du multipartisme s’est immédiatement traduite par une explosion du nombre des partis, une prolifération sans précédent des partis politiques en Afrique (B. Guèye, 2009, p. 8). Le Mali n’a pas échappé à cette tendance qui a marqué le constitutionnalisme africain des années 1990. La consécration du multipartisme dans la Loi fondamentale du 25 février 1992 a structuré le jeu, faisant désormais dépendre l’accession aux responsabilités politiques de l’onction électorale. Rapidement le nombre de partis politiques a explosé (V. Baudais, G. Chauzal, 2006, p. 62). La question de création de partis politiques a été soulevée dans la nouvelle charte des partis politiques, établie par une ordonnance du Comité de Transition pour le Salut du Peuple (CTSP) le 10 octobre 1991. Des modifications sont apportées à cette charte par la loi n°00-45 /du 07 juillet 2000, et la loi n°05-047/du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques au Mali. Dans son premier article, cette dernière dispose : « La charte des partis est un ensemble de principes qui régissent la vie des partis politiques. Elle a pour objet de définir les règles relatives à la formation, à l’organisation, au fonctionnement et au financement des partis politiques ». La Constitution malienne du 25 février 1992 n’a pas manqué de clarifier la place qu’occupent les partis dans la vie politique du pays.
Les partis politiques qui sont actuellement au nombre de 287 (source : ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation), apparaissent fondamentalement dans le cadre de la démocratie pluraliste, comme le lieu où s’opère la médiation politique. Ils sont les lieux de l’expression des pensées politiques des différents citoyens. Leurs rôles classiques consistent dans la formation de l’opinion, la sélection des candidats et l’encadrement des élus (S. Kécir, 2017, p. 3). Aussi, les partis politiques en tant qu’espaces principaux de cristallisation des attentes des citoyens, en tant que médiateurs entre les citoyens et l’État et en tant que principaux acteurs du jeu démocratique doivent être à la fois en mesure de prendre part à la compétition et à la coopération (K. M. Bondevik, H. Bruning, V. Helgesen, 2013, p. 13).
La faible structuration des partis politiques au Mali met à mal leur discipline et leur indépendance. Ceci peut conduire les partis à dévier de leurs principaux objectifs qui sont entre autres la mobilisation et l’éducation de leurs adhérents, la participation à la formation de l’opinion, la conquête et l’exercice du pouvoir et l’encadrement des élus (art. 2 Charte des partis politiques, 2005).
1.2. La déviation des partis politiques de leurs principaux objectifs
Comme signaler plus haut, la possibilité de créer plusieurs partis politiques est certes consacrée par la Constitution en vigueur, cependant leur nombre exceptionnellement élevé, éloigne beaucoup d’entre eux de leur objectif initial qui est la conquête et l’exercice du pouvoir. Pour cela, ils élaborent et défendent un programme politique, participent de la formation de l’opinion politique publique et de la sélection des élites politiques. Ils sont à la fois des entreprises de médiation de par leur rôle idéologique, mais aussi des entreprises électorales par leur capacité à mobiliser des ressources pour conquérir le pouvoir. Le pluralisme politique qui en résulte constitue une nécessité démocratique.
La multiplication démesurée des partis, a engendré des conséquences néfastes qui se traduisent en une faiblesse des formations politiques (N. K. Keita, 2003). Compte tenu de leur importance dans la politique de l’Afrique contemporaine, les partis n’ont malheureusement pas fonctionné particulièrement bien. Ils sont caractérisés par la faiblesse de leur organisation, par de bas niveaux d’institutionnalisation et par des liens faibles avec la société qu’ils sont censés représenter (N. V. de Walle, K. Smiddy, 2000, p. 42).
La situation politique que vit le Mali aujourd’hui prouve à suffisance qu’il y a une rupture entre les partis politiques et les populations. Dans son analyse, le politiste G. A. Togo (Le Pélican, 2021) a mis l’accent sur l’échec des partis politiques malgré l’effort fourni par l’État en leur octroyant 0,25% des recettes fiscales. Pour reprendre les propos de Monsieur LahouariAddi sur les partis politiques algériens, il y a lieu de croire que les partis politiques maliens n’ont pas joué leur rôle (L. Addi, 2006, p. 5). Parlant de l’échec des partis politiques maliens Monsieur Togo (Le Pélican, 2021) affirme : « les partis politiques n’encadrent pas les élus, ne forment pas leurs adhérents, n’ont plus de projet de société et pire, les réunions électorales ne sont que de la liturgie politique (…) ».
Le pays se caractérise encore aujourd’hui par une grande fragmentation et il n’existe pas de clivages idéologiques ou programmatiques nets entre les forces politiques concurrentes, ce qui favorise les compromis (V. Baudais, G. Chauzal, 2006, p. 62-63). Le mécontentement général, que trahissent l’incivilité et l’apathie politique indiquent que le fossé entre l’État et la population n’a pas été comblé par les partis (L. Addi, 2006, p. 5). Ils se révèlent incapables de répondre aux nouvelles demandes, de combattre l’extrême pauvreté des couches chaque fois plus nombreuses de la population, de faire face à la montée de la délinquance, d’incorporer les nouveaux acteurs (G. Couffignal, 2001, p. 106-107). Cette situation apparait comme une raison de plus pour remettre en cause la fameuse question du financement public des partis politiques (art. 29, charte des partis politiques, 2005).
2. Les comportements politiques irrationnels des acteurs politiques
Les comportements politiques désignent l’ensemble des pratiques sociales liées à la vie politique. Ils renvoient notamment aux comportements électoraux des individus, mais aussi de façon plus large à leur participation à des manifestations ou mouvements sociaux, implication dans un parti politique (N. Marion, 2001, p. 211). À la base de ces comportements tant décriés par les populations, on trouve la corruption des acteurs politiques représentant les partis politiques (2.1). Ce qui entraine souvent leur transhumance vers d’autres formations politiques en abandonnant le parti qui leur a permis d’accéder aux responsabilités politiques (2.2).
2.1. La corruption des acteurs politiques
Réfléchissant sur l’état de la politique actuelle, Paul Valadier laisse entendre : « Bien fou qui prétendrait que le cours des choses dans la politique actuelle répond aux impératifs de la morale (…) ». C’est l’état de désagrégation de la politique actuelle ou, pour être plus précis, l’état de la corruption politique des États modernes que ces propos mettent en exergue (O. R. Binda, E. R. K. Andanhounme, 2022, p. 311). La corruption politique peut être considérée comme l’un des moyens par lesquels l’argent influence la politique (D. D. Porta, 1995, p. 61). La corruption politique telle que Machiavel l’a conçue est polysémique. Elle désigne à la fois l’incivilité, l’altération du corps politique et la perte des libertés collectives ou de l’autonomie politique (O. R. Binda, E. R. K. Andanhounme, 2022, p. 312).
Elle peut être aussi considérée comme un détournement de l’utilisation du pouvoir public dans le but d’en tirer des avantages illégaux, cela intéresse le monde politique c’est-à-dire hommes politiques, partis politiques, élus, membres du gouvernement. La corruption du monde politique s’étend en tout point du monde jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Les nombreux scandales récents illustrent bien l’ampleur de ce phénomène (M. de. Wallon, 2020). Parmi les dimensions de ce que l’on nomme un peu globalement « crise du politique » ou « crise de la représentation politique », celle liée aux interpellations et aux mises en cause des élus et des gouvernants sur « leurs atteintes à la probité publique » constitue un des événements marquants des années 1990 (P. Bezes, P. Lascoumes, 2005, p. 757).
Il y a en Afrique aujourd’hui un système de corruption généralisé enchâssé dans un système de dysfonctionnement généralisé (G. Blundo, J.-P. de Sardan, 2001, p. 10) de l’environnement politique. Ce phénomène de corruption politique est devenu une question majeure dans nos États et le Mali n’échappe pas à ce mouvement. Dans un élan d’unanimisme suspect, on observe la multiplication des dénonciations de « scandales politiques » et la stigmatisation de la « corruption » au nom de la morale et de la bonne démocratie. La médiatisation des « scandales » impliquant des élus et des ministres a atteint depuis quelques années un niveau inégalé et des responsables politiques majeurs continuent d’être régulièrement mis en cause (P. Bezes, P. Lascoumes, 2005, p. 757). En 2010, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a suspendu le financement de deux projets au Mali et mis un terme à un troisième avec effet immédiat, après avoir prouvé des détournements de fonds et de dépenses injustifiées (communiqué du Fonds mondial, 2010). Des hommes politiques avaient été mis en cause dans ces détournements. Pourtant, les impacts politiques et sociaux de ces accusations ne semblent avoir d’effets radicaux ni sur l’image des acteurs politiques, ni même sur leurs résultats électoraux. Il parait possible de crier au scandale du « Tous pourris ! », tout en accordant des mandats électifs à des candidats accusés de corruption (P. Bezes, P. Lascoumes, 2005, p. 758).
Le recours à la corruption politique permet l’entretien des clientèles politiques nécessaires à la survie politique des dirigeants (J.-F. Médard, 2000, p. 85). Les citoyens, en effet, ont largement profité de la libéralisation politique pour bouffer l’argent proposé par les dizaines de partis en compétition et ont su, en monnayant leur vote, faire des élections un vecteur non négligeable d’accumulation (R. Banegas, 1998, p. 75). Georg Simmel synthétise la question de la façon suivante : « Rien ne facilite et ne développe davantage les comportements corruptibles et la réalité de la corruption dans son ensemble que la forme argent de celle-ci (…) » (P. Lascoumes, V. Le Hay, 2013, p. 226).
Le couple argent et politique fait souvent écho (É. Phélippeau, P. Ragouet, 2007, p. 520) dans la gestion politique de nos États. Les rapports observables entre argent et politique ne sont qu’une déclinaison particulière des effets du développement d’une économie monétaire. L’argent autorise une des conditions essentielles des rapports corrompus : la dissimulation, propriété qui est contraire aux exigences de transparence démocratique (P. Lascoumes, V. Le Hay, 2013, p. 3). Le rapport entre l’argent et la politique conduit aux scandales à répétition (H. Moadi, 2009) d’achat des votes lors des compétitions électorales. L’achat des votes dans les pays pauvres peut altérer le choix démocratique en faveur des membres les plus riches de la société (M. Bouzahzah, F. Docquier, E. Tarbalouti, 2001, p. 49). Ces figures politiques, que l’on peut définir comme étant des hommes politiques d’affaires (D. D. Porta, 1995, p. 64), sont pressés de se servir de la politique comme d’un moyen rapide de mobilité sociale à travers notamment l’enrichissement (Y. Mény, 1995, p. 16). En plus de l’argent, ils utilisent d’autres moyens comme les dons surtout en période électorale pour atteindre leurs objectifs. Cette pratique du « don électoral » est devenue une réalité massive des développements politiques et elle gouverne désormais les rapports entre marchands politiques et clientèle électorale, voire ethnique. Les institutions et les pratiques démocratiques révélant leurs limites, la transhumance appelée également nomadisme politique (B. Boumakani, 2008, p. 499), se verra toujours dans les comportements politiques.
2.2. La transhumance des acteurs politiques
« Le terme transhumance du point de vue étymologique relève du domaine agricole et renvoie au comportement des peuples pasteurs partant d’une contrée à une autre au rythme des saisons, en quête de verdoyants pâturages pour leurs troupeaux (…) » (I. Datidjo, V. D. Yotedje, A. Tchinenba, 2021, p. 103). La transhumance en politique est devenue en Afrique une réalité quotidienne de la vie politique. Perçue comme le signe de la non maturité politique du continent noir, la marque du mauvais fonctionnement des démocraties africaines, elle est comprise comme une question alimentaire (P. Hounsounon-Tolin, 2013, p. 1). Le phénomène du changement d’allégeance partisane en cours de mandat électoral est devenu une question très importante. En effet, la transhumance politique appelé le « nomadisme » préoccupe aujourd’hui l’ensemble des politistes qui s’intéressent aux questions électorales. Ce sujet a fait l’objet de rapport, mais aussi de débat au sein des assemblées parlementaires (C. Poirier, B. L. Kyelem, 2012, p. 38). Pratique ancienne, elle s’apparente aux relations de clientèle dans le monde politique et s’associe à la corruption, mais elle ne dérange pas vraiment grand monde dans la mesure où les populations s’intéressent surtout à l’expérience politique d’un candidat, son charisme ou encore les promesses clientélistes potentielles qu’elles supposent (L. Marfaing, D. Konhert, 2019, p. 357-358).
D’une manière générale, dans les pays de la Francophonie, le nomadisme politique a mauvaise presse et il occasionne une perte de confiance envers les dirigeants politiques, en plus de donner l’impression d’une certaine instabilité politique et d’un manque de discipline au sein des partis (C. Poirier, B. L. Kyelem, 2012, p. 38). Il est souvent occasionné par des conflits politiques personnels, des conflits de proximité (au sein d’un même parti, voire parfois d’une même faction). Tout camarade de parti est ainsi susceptible de devenir un ennemi politique, tout camarade de lutte peut se métamorphoser en rival acharné. Toute alliance est réversible à tout moment, ou presque. Le proverbe a plus raison encore pour la politique que pour la vie courante : « Partout où tu as un ami, tu as aussi un ennemi ». L’un peut à tout moment devenir l’autre (J. O. de. Sardan, 2019, p. 417). Aussi, l’absence d’une véritable idéologie autrement appelée « projet de société convainquant » porté par les partis politiques et leurs membres, favorise le départ des militants d’un parti politique pour un autre (I. Datidjo, V. D. Yotedje, A. Tchinenba, 2012, p. 104). De même, l’absence de démocratie interne aux partis, les promesses des partis non tenues peuvent être des causes qui conduisent à la transhumance politique, au mépris de toute morale politique, même si l’on peut penser qu’il est étrange de parler « éthique » dans le monde de la politique (L. Marfaing, D. Konhert, 2019, p. 358).
Comprise comme une question alimentaire, la transhumance politique fait penser aux déplacements des troupeaux en quête de nourritures. Elle apparaît ainsi comme une pratique peu recommandable et moralement et politiquement non correcte (P. Hounsounon-Tolin, 2013, p. 2). Elle est appréhendée comme un fléau pour la démocratie en Afrique, en ce qu’elle instrumentalise les élus en quête de quelques avantages matériels et de promotion politique, affaiblit les oppositions dont les élus sont à la merci des majorités au pouvoir, fragilise les équilibres et les contrepoids nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie, cultive et entretient l’immoralisme en politique (B. Boumakani, 2008, p. 500). Au Mali, c’est l’attitude des partis (scission) et de certains de leurs membres (transhumances) qui a engendré une crise de légitimité et une incompréhension des citoyens (V. Baudais, G. Chauzal, 2006, p. 71).
La transhumance étant un phénomène assez répandu, certaines Constitutions tentent d’y apporter une solution juridique, en prévoyant, par exemple, une déchéance automatique pour tout élu qui démissionne ou même qui est exclu, en cours de législature, du parti dont il a reçu l’investiture pour un autre parti (B. Boumakani, 2008, p. 500). C’est ainsi que le Sénégal a eu le courage politique d’insérer dans ses textes des dispositions interdisant la pratique du nomadisme politique. Au Sénégal, l’article 60 al. 4 de la Constitution de la République (Constitution du 22 janvier 2001 du Sénégal), ainsi que l’article 7 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale disposent : « tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat » (C. Poirier, B. L. Kyelem, 2012, p. 37).
L’impact de ce phénomène sur la vie politique de nos pays est que la transhumance politique constitue une valeur ajoutée pour les formations politiques qui accueillent les membres et sympathisants d’autres organisations d’opinions. Dans ce sens, quand il est arrimé aux jeux de coalitions, il limite les possibilités d’alternance au pouvoir « suprême » (I. Datidjo, V. D. Yotedje, A. Tchinenba, 2012, p. 115). Ce qui est inquiétant aujourd’hui, pour toutes sortes de raisons, dans plusieurs de nos pays, il semble que le cynisme ne cesse de croitre envers l’exercice de la politique et envers la classe politique. Ce cynisme est très néfaste pour la démocratie. En effet, lorsque la population perd toute confiance et tout respect envers ses dirigeants politiques, le spectre de l’anarchie, de la désobéissance civile, du désordre et du chaos nous guette. Or, lorsque les citoyens constatent que des élus qui se sont présentés sous les couleurs d’un parti et en défendant les principes et les programmes de ce parti, rompent en quelque sorte ce « contrat moral » et renient leurs présumées convictions d’hier pour adhérer à un parti qu’ils dénigraient auparavant, on peut comprendre que cela alimente leur cynisme (C. Poirier, B. L. Kyelem, 2012, p. 5). De ce fait, de nombreux partis africains peuvent être décrits comme des coquilles vides, faiblement institutionnalisées, aux structures organisationnelles souvent inexistantes : il peut parfois s’agir d’un parti simplement regroupé autour d’un leader, fruit d’une énième scission et voué à disparaître à la prochaine élection ou à la prochaine coalition (V. Darracq, V. Magnani, 2011, p. 844).
Conclusion
Ces dernières années au Mali, les partis politiques n’ont pas bonne presse. La plupart de ces partis qui sont créés à longueur de journée n’existent que de nom. Souvent, ils ne sont animés que par leurs directoires qui ont du mal à mobiliser leurs militants. Les alliances contre nature mises en place par les partis politiques lors des élections législatives de 2020 ont servi de déclic pour marquer le désamour entre les populations et les partis politiques qui à leurs yeux ont failli. Cette faillite des partis politiques a fortement contribué au recul démocratique dans notre pays. Il faut reconnaitre que, la descente aux enfers des partis politiques a commencé avec l’élection d’un indépendant à la tête du pays en 2002. En effet, lors de l’élection présidentielle organisée au Mali en 2002, la victoire est revenue au général Amadou Toumani Touré (ATT), un candidat indépendant qui a su profiter des dissensions au sein des partis politiques sur la succession du Président sortant, pour se faire élire. C’est pourquoi, à l’occasion de la fête marquant le soixantième anniversaire de l’indépendance de la République malienne, il a dans une interview accordée à l’Office des Radio et Télévision du Mali (ORTM) dénoncé la faiblesse et la faillite des partis politiques dans notre pays. Ce qui devrait être perçu comme une alerte pour les partis politiques. Aujourd’hui, ils doivent faire leur autocritique pour pouvoir renouveler le bail qui les lie à leurs militants et éviter ainsi leur suppression comme l’avait demandé Simone Veil en France, en son temps (S. Weil, 1940, p. 17).
Références bibliographiques
ADDI Lahouari, 2006, « Les partis politiques en Algérie », in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 111-112, (en ligne), in https://journals.openedition.org/, (consulté le 08 mars 2022), 50 paragraphes.
BANEGAS Richard, 1998, « Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin (1) », in Politique africaine, Kartala, hal-01010655, (en ligne), in https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/, (consulté le 11 avril 2022), pp. 75-88.
BAUDAIS Virginie, CHAUZAL Grégory, 2006, « Les Partis Politiques et L’Indépendance Partisane » d’Amadou Toumani Touré, in Karthala Politique africaine/4, n°104, (en ligne), in https://www.cairn.info/ revue-politique-africaine-2006-4-page-61.htm, (consulté le 24 février 2022), p. 61-80.
BEZES Philippe, LASCOUMES Pierre, 2005, « Percevoir et juger la « corruption politique ». Enjeux et usages des enquêtes sur les représentations des atteintes à la probité publique », in Revue française de science politique/5-6 (Vol. 55), (en ligne), in https://www.cairn.info/revue-française-de-science-politique-2005-5-page-757.htm, (consulté le 04 avril 2022), pp. 757-786.
BINDA Oualoufeye Razack, ANDANHOUNME Eustache Roger Koffi, 2022, « La corruption politique : contribution et actualité de Machiavel », in European Journal of Social Sciences Studies, Vol 8, Issue 1, (en ligne), in www.oapub.org/soc, (consulté le 05 juin 2023), pp. 310-318.
BLUNDO Giorgio, DE SARDAN Jean-Pierre Olivier, 2001, « La corruption quotidienne en Afrique de l’Ouest », in Politique africaine/3 (n°83), (en ligne), in https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2001-3-pages-8.htm, (consulté le 04 avril 2022), pp. 8-37.
BOLLÉ Stéphane, 2001, « La Coordination démocratique dans la politique africaine de la France », in Revue d’étude et de Recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique, n°2, (en ligne), in afrilex.u-bordeaux.fr, (consulté le 2 mars 2022), 23 p.
BONDEVIK Kjell Magne, BRUNING Hans, HELGESEN Vidar, Préface, « Dialogue entre partis politiques : Guide du Facilitateur », (en ligne), in https://www.idea.int, (consulté le 04 mars 2022), 176 p.
BOUMAKANI Benjamin, 2008, « La prohibition de la transhumance politique » des parlementaires, Études des cas africains », in Revue Française de Droit Constitutionnel/3, n°75, (en ligne), in https://www.cairn.info/revue-française-de-droit-constitutionnel-2008-3, (consulté le 12 avril 2022), pp. 499-512.
BOUZAHZAH Mohamed, DOCQUIER Frédéric, TARBALOUTI Essaid, 2001, « Manipulations électorales, éducation publique et développement économique », in Revue d’économie du développement, n°9-4, (en ligne), in https://www.persee.fr/, (consulté le 07 avril 2022), pp. 47-64.
CAMARA Moussa, KEITA Kadiatou Yacouba, DIAWARA Alou, « L’évolution des partis et leurs apports à la démocratie au Mali » in Partis et idéologies politiques, élections et bonne gouvernance en Afrique : document final de la rencontre des boursiers de la Fondation Konrad Adenauer, 27-30 mars 2011 à St-Louis, (en ligne), in https://WWW.kas.de/, (consulté le 1er mars 2022), 29 p.
Communiqué du « fonds mondial pour la suspension des opérations au Mali » après des soupçons de corruption, in ONU Info du 07 décembr 2010, (en ligne), in https://news.un.org/fr.
COUFFIGNAL Georges, 2001, « Crise, transformation et restructuration des systèmes de partis », in Pouvoirs/3, n°98, (en ligne), in https : www.cairn.inf/revue-pouvoirs-2001-3-page-103.htm, (consulté le 05 juin 2023), pp. 103-115.
DARRACQ Vincent, MAGNANI Victor, 2011, « Les élections en Afrique : un mirage démocratique ? », in Revue Politique Étrangère, n°4, (en ligne), in https://www.cairn.info/, (consulté le15 avril 2022), pp. 839-850.
DATIDJO Ismaila, YOTEDJE Valeri Duplexe, TCHINENBA Armand, 2021, « La survie des partis politiques et le militantisme transhumant et errant au Cameroun », in European Scientific Journal (ESJ), Vol 17, n°16, (en ligne), in https://eujournal.org/, (consulté le 14 avril 2022), pp. 95-118.
DE SARDAN Jean Pierre Olivier, 2019, « Les conflits de proximité et la crise de la démocratie au Niger : de la famille à la classe politique », in Cahiers d’études africaines 234, (en ligne), in https://journals.openedition.org/, (consulté le 13 avril 2022), pp. 405-425.
DE WALLE Nicolas Van, SMIDDY Kimberly, 2000, « Partis politiques et systèmes de partis dans les démocraties non libérales africaines », in L’Afrique politique, édition Karthala : Démocratie Plurale et Démocratie non libérale Guerre et Paix de la Corne à Pretoria, (en ligne), in https://books.google.ml/, (consulté le 24 février 2022), pp. 41-58.
DE WALLON Martin, 2020, « Les effets et manifestations de la corruption politique dans un pays », (en ligne), in https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article, (consulté le 07 avril 2022).
EL HARMOUZI Nouh, 2008, « Ethnisme, multipartisme et violences en Afrique », in Un Monde Libre, (en ligne), in Le Nouvel AFRIK.COM, (consulté le 1er mars 2022).
GUÈYE Babacar, 2009, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », in Pouvoirs/2, n°129, (en ligne), in https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-2-page-5.htm, (consulté le 14 février 2022), pp. 5-26.
HELGESEN Vidar, 2007, « Avant-propos : Le défi de la démocratisation dans les États fragiles » in Rapport sur les Partis Politiques en Afrique de l’Ouest, (en ligne), in https://www.idea.int, (consulté le 23 février 2022), 62 p.
HOUNSOUNON-TOLIN Paulin, 2013, « Parallélisme possible entre « la désertion intellectuelle et politique » chez Sénèque et pratiques africaines de la transhumance politique », in Perspectives Philosophiques, Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines, Vol 3, n°5, (en ligne), in https://perspectivesphilosophiques.net/, (consulté le 13 avril 2022), pp. 1-19.
KÉCIR Salim, 2017, « Le rôle des partis politiques en démocratie : Perspectives théoriques et pratiques », in Annales des Sciences Sociales et Humaines de l’Université de Guelma, N°22, (en ligne), in https://www.asjp.cerist.dz, (consulté le 03 mars 2022), 23 p.
KEITA Namory K., 2003, « La multiplication des partis politiques vue comme source de leurs faiblesses », (en ligne), in https://www.afrique-gouvernance.net, (consulté le 04 mars 2022).
L’achat des votes dans la rubrique « Intégrité électorale : études de cas», Réseau du Savoir Électoral, (en ligne), in https://aceproject.org/.
La Constitution malienne du 25 février 1992.
La Constitution sénégalaise révisée du 22 janvier 2001.
Loi n°00-45 /du 07 juillet 2000 portant charte des partis politiques.
Loi n°05-047/du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques au Mali.
LASCOUMES Pierre, LE HAY Viviane, 2013, « Rapport à l’argent et conception de la corruption politique, in Revue L’Année Sociologique, vol.63, (en ligne), in https://cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2013-1-vol.63-page-225.htm, (consulté le 11 avril 2022), pp. 225-260.
MARFAING Laurence, KOHNERT, Dirk, 2019, « Les élections présidentielles de 2019 au Sénégal ou la lente ascension des nouvelles générations », in Revue canadienne des études africaines, Vol 53, n°2, (en ligne), in https://www.tandfonline.com/, pp. 355-366.
MÉDARD Jean-François, 2000, « Clientélisme politique et corruption », in Revue Tiers-Monde, n°161, (en ligne), in https://www.researchgate.net, (consulté le 07 avril 2022), pp. 75-87.
MÉNY Yves, 1995, « Corruption, politique et démocratie », Confluences, n°15 (en ligne), in https://iremmo.org/, (consulté le 12 avril 2022), pp. 11-21.
MOALI Hassan, 2009, « Symbole de la corruption politique, le Senat dans toute sa splendeur », in Le Matin d’Algérie, (en ligne), in https://www.lematindz.net/news, (consulté le 07 avril 2022).
NAVARRO Marion, 2010, « Les comportements politiques : continuité ou opposition entre les générations », in Regards croisés sur l’économie/1 (n°7), (en ligne), in https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-1-page-211.htm, (consulté le 10 mars 2022), pp. 211-215.
Ordonnance du Comité de Transition pour le Salut du Peuple (CTSP) du 10 octobre 1991.
PHÉLIPPEAU Éric, RAGOUET Pascal, 2007, « Argent et politique » in Revue française de sociologie/3 (Vol.48), (en ligne), in https://www.cairn.info/, (consulté le 11 avril 2022), pp. 519-554.
POIRIER Carole, KYELEM Blaise Lambert, 2012, « Le Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone », (en ligne), in https://assemblee.bi/IMG/pdf, (consulté le 12 avril 2022), 53 p.
PORTA Donatella Della, 1995, « Les hommes politiques d’affaires. Partis politiques et corruption », in Politix/2, (n°30), (en ligne), in https://www.cairn.info/revue-politix-1995-2-page-61.htm, (consulté le 04 avril 2022), pp. 61-75.
SADIO Adama, 2019, Conditionnalité politique de l’aide publique au développement des partenaires occidentaux à l’Afrique : analyse des actions françaises en Afrique subsaharienne, (en ligne), in https://theses.hal.science/tel-02279173, 501 p.
SOCPA Antoine, 2000, « Les dons dans le jeu électoral au Cameroun », in Cahiers d’études africaines, 157, XL-1, (en ligne), in https://journals.openedition.org, (consulté le 12 avril 2022), pp. 91-108.
SOUARÉ Issaka K, 2018, Chapitre I, « L’avènement et l’évolution des partis politiques en Afrique », in Les partis politiques de l’opposition en Afrique : La quête du pouvoir, (en ligne), in https://books.openedition.org/, (consulté le 18 septembre 2020), 104 paragraphes.
TOGO Gabriel Annaye, 2021, « Le Recul de la démocratie malienne : les partis politiques, les principaux responsables », in le journal Le Pélican, (en ligne), in https://fasomali.com/.
TRAORÉ Mohamed, SOGODOGO Abdoul, « Défis et enjeux des partis politiques au Mali », (en ligne), in Library.fes.de, (consulté le 1er mars 2022), 31 p.
WEIL Simone, 1940, « Note sur la suppression générale des partis politique », (en ligne), in https://kerloar.com/, (consulté le 12 avril 2022), 17 p.
L’ÉLITISTISME POLITIQUE DE PLATON EN QUESTION
Albert ILBOUDO
Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)
Résumé :
L’échec de la gouvernance politique dans certaines parties du monde, ramène au centre de la réflexion philosophique la question des doctrines et des régimes politiques. Désillusionnés par l’incompétence des dirigeants, nombreux sont les citoyens qui, aujourd’hui implorent l’avènement d’hommes providentiels. Ce phénomène est loin d’être nouveau. Les cités de l’époque de Platon avaient été le théâtre de défis presque similaires. Confier l’exercice du pouvoir à l’élite, particulièrement aux philosophes, cette classe excellente et minoritaire, avait été la solution à laquelle a abouti la réflexion politique de Platon contenue essentiellement dans ses ouvrages politiques, notamment la République, le Politique et Les Lois. Cependant, à la lumière d’une critique adossée aux principes de la démocratie moderne, l’élitisme politique tel que prôné par Platon, nous apparaîtra parfois moins pertinent, souvent en déphasage avec les principes universels des droits de l’homme et du citoyen.
Mots-clés : Aristocratie, Démocratie, Égalité, Élite, Justice.
Abstract :
The failure of political governance in certain parts of the world brings the question of doctrines and political regimes back to the center of philosophical reflection. Disillusioned by the incompetence of the leaders, many are the citizens who, today, implore the advent of providential men. This phenomenon is far from new. The cities of Plato’s time had faced almost similar challenges. Entrusting the exercise of power to the elite, particularly to the philosophers, this excellent and minority class, had been the solution to which Plato’s political reflections contained in his political works, in particular the Republic, the Politics and The Laws, led. However, in the light of a critique based on the principles of modern democracy, political elitism as advocated by Plato will sometimes appear less relevant to us, often out of phase with the universal principles of human and citizen rights.
Keywords : Aristocracy, Democracy, Equality, Elite, Justice.
Introduction
L’organisation politique et sociale d’un État tire sa légitimité du fait que les gouvernés ou les citoyens reconnaissent la valeur et le bien-fondé des lois qui les gouvernent. C’est, généralement, de la légitimité des lois que résulte la stabilité des cités, condition de l’épanouissement des citoyens. À la suite d’une analyse minutieuse des causes de l’instabilité politique qui rongeait les cités grecques de son temps, Platon, soucieux de justice et de gouvernance vertueuse, recommande de confier la gestion de la cité à l’élite savante, représentée essentiellement par les philosophes. Chez Platon, fait observer Jean Wahl (1969, p. 597), « la science de la direction de la cité et la science en général sont unies dans la même personne ». En effet, dotés d’un savoir étendu et d’une probité morale irréprochable, les philosophes sont les seuls capables de conduire tous les membres du corps social à s’épanouir pleinement. Le modèle d’organisation ici préconisé est sans ambiguïté l’aristocratie, le pouvoir des meilleurs ou des bien nés.
La présente réflexion entend interroger les présupposés, les finalités et les limites de la doctrine politique de Platon. En effet, il y a chez ce philosophe une justification ontologique des attributs des citoyens tendant à légitimer non seulement le statut et le leadership des hommes d’État, mais également la place de tous les autres membres de la société, appelés à obéir et à suivre les prescriptions de ces derniers, pour que puisse advenir le bonheur collectif. Cette position suscite les questions suivantes : sur quels principes ontologiques et moraux repose l’élitisme politique platonicien ? Quelles sont les étapes de l’éducation auxquelles se soumettent les futurs dirigeants, dont les attributs sont compris par Platon comme les clefs d’un possible avènement de la Callipolis, cette cité parfaite, où sont censés régner la justice, l’ordre, l’harmonie et le bien-être de tous.
Cependant lorsqu’une catégorie de personnes est désignée comme naturellement destinée à occuper les hautes fonctions et à veiller, à travers un système rigide de sélection, à ce que ce principe devienne règle de droit, n’assiste-t-on pas à un déni évident des droits de l’homme, pouvant amener certains à se juger comme des sous-hommes ou des citoyens marginalisés ?
La réflexion qui suit, interroge en premier lieu les fondements ontologique et moral de l’élitisme politique platonicien. Dans le deuxième moment, il sera question des étapes de la formation des futurs dirigeants. Dans la dernière partie, nous proposons une approche critique de l’élitisme politique de Platon, en le confrontant aux valeurs prônées par la démocratie, dans son contexte moderne.
1. Les fondements ontologique et moral de l’aristocratie chez Platon
La réflexion politique de Platon trouve sa justification non seulement dans la situation politique grecque dont il est contemporain mais également dans ses propres expériences politique et philosophique. Ses idées politiques témoignent de sa volonté de réformer la cité, de la redresser des dérives vers lesquelles elle était entraînée du fait de l’incurie, de l’impéritie et de la prévarication des acteurs politiques. À ces dirigeant, il manquait essentiellement le souci du bien-être du citoyen en tant que celui-ci demeure le principal bénéficiaire de l’action politique. Les cités grecques contemporaines de Platon étaient en proie à des crises dont la principale cause remonte aux mœurs et aux tares des gouvernants. Platon a vécu la guerre civile et la succession des divers régimes politiques qui, chacun selon ses convictions, se proposaient de redresser la barque de la cité et de la maintenir à flot parce qu’elle coulait manifestement. À ce sujet, É. Bréhier (2005, p. 70) rapporte :
L’œuvre de Platon porte la marque de ces événements : instabilité politique des gouvernements, danger d’un impérialisme fondé sur le commerce maritime, tels sont les thèmes constants de son œuvre ; aussi hostile à la tyrannie d’un Critias qu’à la démocratie de Périclès, il devait chercher ailleurs que dans le milieu athénien la possibilité d’un renouveau politique.
À la fin, je compris que, en ce qui concerne toutes les cités qui existent à l’heure actuelle, absolument toutes ont un mauvais régime politique ; car ce qui en elles se rapporte aux lois se trouve dans un état pratiquement incurable, faute d’avoir été l’objet de soins extraordinaires aidés par la chance. Et je fus nécessairement amené à dire, en un éloge à la droite philosophie que c’est grâce à elle qu’on peut reconnaître tout ce qui est juste aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers ; que donc le genre humain ne mettra pas fin à ses maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité s’adonnent à la philosophie n’ait accédé à l’autorité politique ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s’adonnent véritablement à la philosophie, en vertu de quelques dispensation divine.
De ces propos de Platon, il se dégage l’idée de réformer la cité en la faisant reposer désormais sur des lois rigoureuses et des personnes de vertu que sont les philosophes ; leur position de dirigeants serait ainsi le gage de sa stabilité et de sa prospérité. Cette confession de Platon, bien qu’elle perçoit la philosophie comme la meilleure thérapeutique contre les maux de la cité, semble tout de même traduire une volonté d’instaurer dans la cité une communauté purement inégalitaire, faisant naturellement des bien-nés le sommet d’une société bâtie selon une configuration pyramidale immuable. Quant aux autres, disons, le bas-peuple, il leur est demandé de consentir à exercer les professions subalternes de la cité.
Toutefois bien comprise dans ses fondements et présupposés, cette société n’a rien d’arbitraire car, dans l’entendement de Platon, la société est conçue sur le modèle de l’âme individuelle, dont les parties inférieures obéissent à la partie supérieure ; à l’agencement des parties de l’âme, correspond l’ordonnancement des classes d’individus dans la cité. Pour Platon, l’âme se comprend comme une micro-cité qui représente l’individu, qui réside dans une macro-cité configurée ici sous la forme de la société. C’est pour cette raison que de la bonne santé des individus, disons de leur vertu, dépend la bonne santé de la cité ou de l’État, caractérisée par le règne de la justice, source de l’ordre. Platon (1964, 246a-246e), pressentait déjà les difficultés structurelles auxquelles pouvait se confronter la volonté d’ériger dans les faits la cité idéale. Ces difficultés dévoilent leur secret dans le mouvement intérieur de l’âme dont les parties sont tiraillées par des intérêts antagoniques. L’âme, en effet, « ressemble à une force composée d’un attelage et d’un cocher ailé » ; le cocher qui figure la raison « gouverne l’attelage, mais l’un des chevaux est excellent et d’excellente race, l’autre est tout le contraire et par lui-même et son origine ». La direction de l’âme n’est donc pas aisée, car elle demande de chacun un effort consistant à faire violence sur soi-même afin de contenir le déchaînement des passions assimilables, ici, à un cheval rétif dont les appétits aveugles pourraient l’entrainer ainsi que le cocher qui le conduit dans le précipice.
L’équilibre et l’harmonie, censés régner dans la cité parfaite, résident dans la justice dont une analyse des différents rôles des parties distinctes de l’âme dans la cité aboutit à en découvrir l’essence. Le règne de la justice exige donc plusieurs médiations car la justice présuppose des sacrifices dont doit s’acquitter chaque membre de la cité. La persuasion et la contrainte sont les voies formellement indiquées par Platon, pour y parvenir. En effet, la cité platonicienne est parfaite en ceci qu’elle possède les quatre excellences fondamentales que sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice.
Dans l’introduction aux Œuvres Complètes de Platon, A. Diès (1943, p. 37), fait observer que la « sagesse ou bon conseil en vue de conserver la cité réside naturellement dans les magistrats » qui sont les philosophes à qui il est à juste titre confié la charge de la direction de la cité ; la disposition suivante qui est le « courage ou opinion droite et disciplinée sur ce qu’on doit craindre ou ne pas craindre, appartient aux guerriers », chargés de la défense de la cité contre les agressions extérieures ; à la suite du courage vient la « tempérance, harmonie et symphonie volontaire entre les parties supérieures et inférieures de l’âme ne peut être, dans l’âme collective ou cité, qu’un mutuel et complet accord entre gouvernants et gouvernés ». De ce qui précède, en quoi consiste la justice chez Platon ? Elle consiste en ceci :
Que chacun reste à sa place et remplisse la fonction pour laquelle il est né. Or, c’est bien ce principe qui fonde les autres vertus, qui maintient le gouvernement à son poste de prévoyance, le soldat à sa faction, le cordonnier à son échoppe, et nous pouvons déclarer : du seul fait que mercenaires, auxiliaire et gardien demeurent chacun à son poste et font chacun son œuvre propre, la justice est réalisée dans la cité. (A. Diès 1943, p. 37).
Ainsi, il nous apparait clairement, que dans la cité platonicienne, les classes des artisans et des soldats sont subordonnées à la classe supérieure, où figurent les gardiens, parmi lesquels se recrutent les plus sages, c’est-à-dire ceux qui détiennent pleinement la compétence technique et l’excellence morale. Dans un tel État où la finalité suprême se profile comme la justice, condition du bonheur individuel et collectif, chacun doit renoncer à ses ambitions individuelle et sociale, ce que Platon (1969, p. 493) appelle la « pléonexie », pour que puisse éclore le bonheur de la communauté. Les possessions individuelles n’ont pas droit de cité dans ces conditions. Le rôle dévolu à l’éducation dans une telle structure sociale est central car si elle demande aux artisans une discipline, condition de l’ordre social, elle est nettement plus exigeante pour les gardiens ou philosophes qui sont dotés par la providence d’un naturel prédisposé à la science. C’est sur leurs épaules que reposeront l’unité et la sauvegarde des institutions de la République. De la manière que les appétits des parties subalternes de l’âme ne doivent se soulever et submerger la raison, qui tient toute l’âme en équilibre, de même, les artisans et les guerriers doivent éviter toute sédition, pour se soumettre aux gardiens, détenteurs de la sagesse, afin que règnent l’ordre et l’harmonie.
Cette approche de la cité heurte certainement la conscience et la tendance démocratique actuelle qui fait de l’égalité des personnes et de la liberté les finalités essentielles de l’action politique et des principes sur lesquels repose la dignité de tout être humain.
C’est tout à fait d’une façon autre que se justifie le bien-fondé de l’action politique chez Platon, qui procède avant tout de la métaphysique. Pour les Anciens, notamment Platon et Aristote, l’univers est conçu comme un tout bien ordonné où chacun est prédisposé par la nature à occuper la position qui est la sienne. Il est impératif de s’accorder avec la hiérarchisation des individus dans l’univers sous peine de se retrouver dans le malheur, pour avoir refusé de se soumettre aux injonctions de l’Être suprême. Sur ce point, M. Savadogo (2008, p. 93) précise que : « l’ordre du monde est fixé pour l’éternité et il est seulement attendu de l’homme qu’il apprenne à le connaître et à orienter son comportement en conséquence ». Ici, c’est de la Callipolis qu’il est question et son inscription dans le cours historique suppose de la part de chacun des membres de la cité un sacrifice, duquel découlerait naturellement le désir de jouer le rôle qui lui est dévolu dans l’organigramme politique, au risque de voir la cité péricliter.
De cette analyse, il ressort que la meilleure cité est celle qui accorde les plus hautes fonctions de direction à ceux qui se singularisent par leur savoir. Le savoir dans l’esprit de Platon présuppose nécessairement la morale. Cela étant admis, en quoi consiste l’éducation des personnes appelées à gouverner la cité ?
2. La Formation des gouvernants de la cité
Dansla cité telle qu’elle s’élabore dans la réflexion de Platon, la justice est posée comme la condition du bonheur général. Dans cette cité, les gardiens composés des philosophes, assument le rôle de chefs d’État car en leur être se réalise la jonction parfaite de la science et de la morale. Ces individus qui se distinguent des masses, par leurs dons spirituels et natifs, recevront une éducation complète d’une rare rigueur, destinée à les parfaire pour leur mission. Dans ses notes introductives à La République de Platon, R. Baccou (1966, p. 33) résume de fort belle manière les qualités du dirigeant philosophe en ces termes : « Il est à la fois libéral et tempérant, enthousiaste et désintéressé. Son esprit vif est servi par une mémoire sûre, et sa force embellie de mesure et de grâce. Ami et comme allié de la vérité, comblé des dons les plus rares ». Cet homme exceptionnel ne se maintient longtemps sans que ces derniers n’habitent un environnement sain, où peuvent germer les graines qu’ensemence l’éducation. Comment s’effectue alors cette éducation ?
Les citoyens pressentis pour la tâche de gardien seront, tout d’abord éprouvés par des exercices d’ordre spirituel visant à tourner leurs âmes à contempler et à vouloir le Bien. Ils devront ainsi fuir les plaisirs de la chair qui retiennent l’âme prisonnière du monde sensible. Dans la théorie platonicienne de la connaissance, le Bien est, par analogie, identifié au soleil sensible. De la même manière que le soleil favorise la vision des choses sensibles et déclenche la croissance des êtres comme les plantes et autres êtres vivants, de même, le Bien rend possible la vision des essences ou vérités intemporelles, favorise la croissance de l’homme et le rapproche de la perfection. Les gardiens en herbe, pour réussir dans leur mission de voir le vrai, doivent éviter toute influence venant des sophistes, ces prisonniers de l’opinion, dont l’enseignement est relatif à la culture générale, qui mesurent la valeur de toute proposition à sa capacité à se rendre profitable à l’homme, peu importe qu’elle soit vraie ou fausse, juste ou injuste. Au sujet de l’enseignement des sophistes, A. Diès (1943, p. 57) traduit la critique platonicienne, à travers ce propos :
Cette culture générale n’est supérieure que de nom : elle reste volontairement dans le domaine de l’opinion et s’y complait, parce qu’elle ne croit pas à la vérité et ne conçoit rien au-delà des multiples contingences. Faisons-lui donc sa part et donnons-lui son juste nom : elle n’est qu’une philodoxie. Nous, qui croyons au vrai et voulons que nos gouvernants se règlent sur les réalités profondes et permanentes, nous formerons des philosophes.
Dans le livre VII de La République, la formation des philosophes y est amplement expliquée sous les propos imagés de l’allégorie de la caverne. Il y est question d’une caverne où des individus se retrouvent enchainés depuis leur enfance. De l’ouverture de la caverne située au-dessus d’eux, provient une lumière qui éclaire une scène du dehors, dont les ombres se projettent sur la paroi vers laquelle les yeux des prisonniers sont dirigés. Enchaînés dans cet univers à l’apparence étrange, ces captifs ne voient rien donc en dehors des ombres qui s’offrent à eux. Comme ils ne perçoivent d’autres réalités depuis leur naissance que les ombres qui se reflètent dans la caverne, il va de soi que ces prisonniers prennent naturellement les ombres projetées pour la réalité.
Par analogie, la condition des hommes ici-bas est semblable à celle des prisonniers dont nous venons de décrire la situation. Le philosophe habite au départ comme les autres hommes dans ce monde faux ; mais à travers ses efforts, il parviendra à dénouer ses chaînes, afin d’accéder au monde vrai où il percevra le réel tel qu’il est à la lumière du soleil. La libération du philosophe qui rend possible son accès au monde supérieur, monde intelligible, domaine des vérités immuables et intemporelles, est conditionnée par l’éduction. En effet, Platon (1966, 518c-519c) souligne :
L’éducation est donc l’art qui se propose ce but, la conversion de l’âme, et qui recherche les moyens les plus aisés et les plus efficaces de l’opérer ; elle ne consiste pas à donner la vue à l’âme, puisqu’il l’a déjà ; mais il est mal tourné et ne regarde pas où il faudrait, elle s’efforce de l’amener dans la bonne direction.
Ainsi, il ressort de ces précisions que la position de supériorité dont jouit le philosophe par rapport à la masse est amplement justifiée pour la simple raison qu’il est le seul qui connait le vrai. Ce qui lui confère un rôle politique et social auquel il ne saurait se dérober si tant est que la philosophie comme l’enseignait Socrate, est souci de soi et souci des autres. P. Hadot (1995, p. 68) ajoute à cette idée l’affirmation selon laquelle : « le souci de soi est donc indissolublement souci de la cité et souci des autres, comme on le voit par l’exemple de Socrate lui-même, dont toute la raison de vivre est de s’occuper des autres ». En tant que fondateur de la Callipolis, Platon présente la mission politique du philosophe comme une obligation, car celle-ci est, à tout point de vue, la condition du redressement de la cité.
D’ailleurs, les jeunes sélectionnés dans la population pour recevoir cette éducation qui est autant spirituelle que physique, devraient être retirés très tôt de leurs familles, afin de les amener à grandir dans un environnent sain qui les préparerait à se consacrer entièrement au service de l’État. C’est en effet, à leur plus jeune âge que les hommes peuvent être facilement modelés parce que, tels des jeunes plants auxquels on fixe une direction verticale à l’aide de supports appropriés, on pourra corriger leurs imperfections et les redresser de sorte qu’ils servent la cité dans le sens de la justice. Dans cette optique, Platon (II, 1966, 376c-377b) soutient ceci : « Le commencement, en toute chose, est ce qu’il y a de plus important, particulièrement pour un être jeune et tendre ».
Le service rendu à la cité, s’avère ainsi un véritable sacerdoce dans lequel les dirigeants sont obsédés par le souci du bonheur du collectif. C’est cette idée qui ressort clairement de cette mise au point de Platon (1943, p. 34) : « Le gouvernement que nous instituons ne profite qu’aux gouvernés. Il est non une exploitation mais un service ». L’allégorie dont il est question fait découvrir autant les différentes étapes de l’éducation des philosophes que leur rôle social et attributs dans la cité.
La formation du philosophe obéit en fait à une double dialectique, à savoir une dialectique ascendante et une dialectique descendante. Par la dialectique ascendante, le philosophe quitte le monde des ombres et des apparences, pour aller contempler dans le monde intelligible l’essence véritable des choses. Par la dialectique descendante, il retourne dans la caverne ou le monde sensible, pour faire découvrir à ses concitoyens la vraie nature des choses, notamment le Bien, d’où procèdent comme ses émanations la justice, le beau, la tempérance.
Il convient d’ajouter que cette formation intellectuelle est consolidée par l’apprentissage des mathématiques, qui participent du développement de l’entendement. Des mathématiques, notamment de l’arithmétique et la logistique, Platon (1966, 525a-526a) fait observer : « L’étude en est nécessaire aux guerriers pour ranger une armée, et au philosophe pour sortir de la sphère du devenir et atteindre l’essence, sans quoi il ne se sentira jamais arithméticien ».
Aux formations intellectuelles seront jointes les formations gymnique et artistique. La gymnastique contribue à offrir au corps de bonnes dispositions psychiques et une santé parfaite de sorte que le corps se laisse dompter et conduire par l’âme dans la bonne direction, tel un cavalier enfourchant son cheval pour aller dans une destination souhaitée et voulue. Quant à l’art, tout comme la science, il peut élever l’âme à la hauteur de la vérité sous certaines conditions. Platon pense ici à la musique, l’art du rythme et de la mélodie ; elle est dotée de la capacité de modeler l’âme dans le sens de l’harmonie et de la douceur. Il existe même chez Platon, une forte tendance à assimiler la musique authentique à la philosophie. À ce propos, A. C. Zongo (2017, p. 117) précise :
L’identité platonicienne de la musique authentique avec la philosophie signifie en fin de compte que le son musical n’est pas son propre but, que le beau musical ne vaut pas pour lui-même et qu’il est en étroite relation avec le Vrai et le Bien.
Toutefois, Platon récuse la valeur pédagogique de certains arts, particulièrement la poésie et la peinture respectivement pour leurs connotations ludique et mimétique. Si la poésie nous déforme la réalité à travers sa narration de l’épopée des hommes et des dieux, la peinture nous détourne du vrai en ceci qu’elle se réduit à l’imitation du sensible. Dans le livre X de La République, il déclare que l’art produit des simulacres, l’art imite les produits fabriqués par les artisans, or ces produits ne sont que des copies des idées du monde intelligible. Étant alors l’imitateur d’un copieur, Platon (1966, 597d-598c) affirme que l’artiste est « l’auteur d’une production éloignée de la nature de trois degrés ». Platon recommande, en conséquence, une purification de l’art qui l’asservirait à la philosophie. Ainsi l’art pourra participer de l’éducation et de l’émergence de dirigeants vertueux et sages.
Parmi les philosophes ayant reçu cette formation hautement sélective, ceux qui se seront les mieux distingués seront élevés au rang de magistrats dont le premier parmi les plus âgés, rodé en expérience, assumera la fonction de philosophe-roi. Ainsi nous comprenons mieux que chez Platon, le pouvoir revient aux plus éclairés des hommes, qui ne sont autres que les philosophes, car ces derniers savent mieux que quiconque la Vérité. C’est en raison de leur savoir qu’il faut les considérer comme les gardiens de la cité. Semblables à des bergers chargés de la garde du troupeau humain, ils doivent conduire les autres membres de la cité, chacun selon ses aptitudes natives, vers la réalisation de la justice comme vertu dans la cité des hommes. Mais outre la compétence des personnes et de leurs efforts, la cité idéale ne peut s’édifier dans la réalité sans le concours du surnaturel ou des dieux. Platon dira que son émergence dépend d’une contingence heureuse.
Il se déduit de cette partie de la réflexion que chez Platon, la gestion du pouvoir revient à l’élite qui dispose, par la médiation de la formation reçue, des compétences techniques et d’une probité morale à même de réunir les conditions censées favoriser l’épanouissement des habitants de la cité. Néanmoins, de cette organisation politique et sociale découle nécessairement l’exclusion des autres couches sociales de la gestion du pouvoir d’État. Ce qui pourrait alimenter des contestations et des révoltes. C’est autour de ce point d’ailleurs que s’articule la critique de la démocratie moderne contre l’élitisme politique platonicien. C’est de cette problématique qu’il sera question dans le propos suivant.
3. L’élitisme politique de Platon face la démocratie moderne
Dans le système politique de Platon, il y a ceux qui sont destinés par leur nature à commander et ceux que leurs natures destinent à obéir. Sur quoi peut-on se fonder en raison pour justifier une telle position ?
L’élitisme politique de Platon, rappelons-le, repose sur une hiérarchisation de la société fondée sur l’inégalité naturelle des hommes qui, elle-même, a son fondement dans la conception d’une différence ontologique entre les hommes. La société est juste quand chacun de ses membres se retrouve à sa place et consent à remplir la mission qui est la sienne. Ne peuvent réussir dans la direction des affaires de l’État que ceux qui disposent de dons spécifiques, assortis d’une formation philosophique complète, d’où sortent des hommes auxquels on peut attribuer le statut de guides. En effet, le bonheur collectif n’exige-t-il pas que chacun reconnaisse ses limites et laissent la place aux plus capables des hommes d’assumer les rôles de direction ?
La crainte de Platon, c’est de voir dans l’avènement des régimes corrompus, notamment la timarchie, l’oligarchie, la démocratie et la tyrannie, les plus hautes fonctions de la république confisquées par des ignorants ou des personnes assoiffées du pouvoir et de ses honneurs et qui ne se soucient, in fine, que de leurs intérêts égoïstes. Il reçoit sur ce point l’assentiment d’Aristote (IV, 11), pour qui « les gens de condition moyenne sont les moins enclins à se dérober aux emplois publics ou à les solliciter avec trop d’ardeur, deux tendances également préjudiciables aux cités ». Des décisions hasardeuses de tels individus, pour lesquels la politique est comprise comme un moyen d’ascension sociale et de gloire, résultera inéluctablement la ruine de la cité.
La légitimation de l’aristocratie a pour but de figer dans le marbre de la réalité historique la cité idéelle ou parfaite, dont la durée dans le temps demeure problématique, concède Platon, et cela dans un souci de réalisme qui contraste parfois avec son idéalisme légendaire. Par la voix de Socrate, Platon (VIII, 545a-546b) avoue en effet cette vérité : « Tout ce qui naît est sujet à la corruption, ce système de gouvernement ne durera pas toujours, mais il se dissoudra ». La cité idéale, du fait de l’imperfection de certains de ses citoyens, est menacée sur ses assises et de son déclin resurgiront les formes dérivées et déviées de l’organisation étatique.
Parmi ces formes, on compte l’oligarchie où l’exercice du pouvoir est l’apanage d’un groupe de puissants qui s’attachent à la défense de leurs intérêts, la démocratie où le pouvoir est exercé par le peuple, disons, la plèbe, la tyrannie où le pouvoir est détenu par un autocrate, qui règne par la terreur et la violence. Il y a chez Platon une volonté ferme de faire régner dans le temps la justice, de même que le bonheur individuel et collectif dans la cité. La finalité qu’il assigne à la politique est sans conteste fort louable. La critique qu’il formule contre la démocratie, en dépit de ses avantages, mérite une attention sérieuse. Mais que reproche vraiment Platon à la démocratie dont l’application des principes place pourtant le citoyen dans une position centrale de l’animation de l’action politique ?
La démocratie, écrit F. Châtelet (1979, p. 21), « c’est le pouvoir du petit peuple, du démos, qui, lassé de la sujétion où la tiennent les propriétaires fonciers, les aristoï, les « bien-nés », se révolte et se partage les biens de ceux qu’ils viennent de vaincre ». Eu égard à cette pensée, il est tout à fait légitime de s’inquiéter avec Platon en ceci que la démocratie consacre l’arrivée aux affaires de la masse, les moins éclairés, ceux qui voient les hautes fonctions politique, économique et militaire, comme un butin à se partager. Comprise comme « gouvernement du plus grand nombre, de la majorité ou des pauvres », souligne N. Bobbio (1996, p. 37), le régime démocratique qui fait la part belle à la liberté et à l’égalité, serait la porte ouverte à la dictature de la doxa, à la concupiscence, au désir sans frein des honneurs et de la gloire personnelle. A. Diès (1943, p. 97) résume fort clairement la désapprobation platonicienne de la démocratie, en ces termes :
Régime de liberté et de bon plaisir, le tout est synonyme à son sens : la démocratie est faite pour tout comprendre, tout permettre, tout désirer. Chacun y fait ce qu’il veut, s’y montre tel qu’il lui plaît d’être. Elle est souple et riche de tons. Ce n’est pas un régime, mais tous les régimes possibles à votre choix, comme en un bazar.
Platon impute, clairement, à la démocratie sa pernicieuse tendance à encourager, sans discernement, le libertinage et l’égalitarisme, toute chose préjudiciable à la pérennisation d’institutions dont la gestion revient sans contexte à des hommes éminents. Que la démocratie vire parfois à la démagogie ou au populisme, ce sont là quelques-unes de ses pathologies courantes dont l’époque actuelle pourrait témoigner. Dans certains régimes qui se réclament de la démocratie, les dirigeants ou les prétendants à direction de la cité peuvent fort bien user de tous les subterfuges, notamment l’achat des consciences et des suffrages, les promesses mirobolantes, afin de parvenir à la haute magistrature. Le manque de rigueur des dirigeants, leurs abus d’autorité qu’on peut observer dans la démocratie, peuvent engendrer le laxisme, voire l’anarchie.
Néanmoins, reconnaissons que l’attachement de Platon à l’aristocratie dont il livre une analyse systématique, semble l’empêcher d’approfondir certains principes cardinaux de cette forme d’organisation politique telle que la liberté, l’égalité et la justice. La conception platonicienne de la démocratie est quelquefois réductrice, voire caricaturale. En effet, les principes démocratiques rendent possible, de façon réaliste, la réalisation de la finalité principale de l’État, à savoir le bonheur des citoyens. La démocratie, à Athènes, portait certaines valeurs que Platon a feint d’ignorer en raison de sa conception ontologique de la nature humaine, qui aboutit à une hiérarchisation radicale des citoyens. Auguste Diès note, à ce propos, que Platon parodie avec perfection le fameux discours de Périclès, qui s’évertue à relever les vertus libérales et égalitaires de la démocratie. F. Châtelet (1979, p. 21) fait observer encore, à ce sujet ceci : « La démocratie, ce n’est pas la force du peuple, c’est l’extension de la citoyenneté à tout homme libre, c’est l’égalisation de la condition de citoyen à tous ». Le principe d’égalité apparaît comme le principe fondamental de l’État démocratique.
Mais dans les faits, la démocratie athénienne marginalisait les femmes, les enfants, les esclaves et les métèques, car elle leur refusait le plein droit à la citoyenneté. Cette démocratie à l’époque antique trainait, en fait, les mêmes préjugés que les régimes concurrents de l’époque comme le laisse découvrir la remarque de M. Savadogo (2002, pp. 120-121) :
La démocratie antique, tout comme les autres régimes politiques de l’époque, s’édifient sur la conviction que les hommes sont inégaux par nature. La direction de la collectivité est un privilège réservé à une catégorie sociale particulière à l’exclusion de toute autre. La naissance de l’individu détermine sa position dans la société, sa fonction dans la collectivité. Son destin est scellé avant même qu’il ne vienne au monde indépendamment du talent, de l’intelligence, dont il est susceptible de faire preuve.
La croyance antique en une société inégalitaire dans ses racines est abandonnée dans le cadre du fonctionnement de la démocratie moderne. Le principe d’égalité des citoyens abolit le statut d’hyper citoyen que Platon attachait, par exemple, au philosophe du fait de ses dispositions innées à commander aux autres. Ici tout homme ou toute femme est citoyen et est éligible en droit et en fait aux hautes fonctions de l’État à moins qu’il ou elle ait posé des actions répréhensibles qui l’en disqualifient momentanément ou perpétuellement. En réalité, les différences observées ici et là entre les hommes sont si mimines au point qu’il serait exagéré de les ériger comme des principes ontologiques devant prévaloir dans les faits. À ce propos, T. Hobbes (1999, p. 121), l’un des fondateurs de la pensée politique moderne écrit :
La nature a fait les hommes si égaux quant aux facultés du corps et de l’esprit, que, bien qu’on puisse parfois trouver un homme manifestement plus fort, corporellement, ou d’un esprit plus prompt qu’un autre, néanmoins, tout bien considéré, la différence d’un homme à un autre n’est pas si considérable qu’un homme puisse de ce chef réclamer pour lui-même un avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui.
De ce propos, il apparaît que l’idée de ramener la compétence à une catégorie restreinte de personnes, fussent-elles philosophes, est bien discutable car elle traduit un préjugé relatif à une époque historique dans une zone géographique précise. Cette idée platonicienne déchoit en fait les autres catégories sociales, principalement les artisans, les laboureurs et les guerriers, de leur statut de citoyens actifs en ce sens que leurs voix sont ignorées dans les prises de décisions relatives à la vie de la nation. La conception platonicienne de la justice fondée sur la conviction que chacun doit se confiner à exercer la fonction pour laquelle il est né et en faire une mission de vie, se découvre comme arbitraire et surannée. Dans le contexte de la démocratie moderne, c’est le peuple qui exerce le pouvoir, par la médiation de ses représentants, et toutes décisions et actions politiques ne sont légitimes que lorsqu’elles satisfont les intérêts de la collectivité. C’est cette idée que clarifie davantage M. Savadogo (2006, p. 7) dans le propos suivant :
La relation entre le représentant de l’État et le sujet, sur lequel s’exerce son autorité, s’avère être, en démocratie, horizontale et non verticale. (…) Il n’existe pas d’hommes que la nature prédisposerait à connaître ce qui est bien pour leurs semblables. Ce qui est bien pour les hommes dépend de leur volonté et non d’un ordre naturel transcendant.
Ainsi, nous comprenons mieux maintenant que c’est la justification de l’inégalité naturelle des hommes qui empêche les penseurs antiques, comme Platon et Aristote, de parvenir à une conceptualisation véritablement pertinente de la notion de justice. En effet, si la justice vise la correction des imperfections de ce qui existe de fait comme illégitime, elle ne saurait atteindre ses objectifs que si elle pose comme condition de son but l’égalité de droit des citoyens. C’est pourquoi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789, qui stipule en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » doit demeurer le fondement d’où se construit toute véritable démocratie. À propos de la déclaration des droits de l’homme, A. Soboul (1962, p. 205) rappelle que « ce sont des droits naturels et imprescriptibles dont la conservation est le but de toute association politique ».
Ces droits qui consacrent l’égalité des hommes apparaissent comme une exigence de la raison car leur légitimité transcende les préjugés culturels et historiques dont peuvent être prisonnières certaines pensées, fussent-elles philosophiques, qui prennent parfois naissance dans l’expérience personnelle et dans les conditions historiques de leurs auteurs. L’égalité dont nous faisons cas, convient-t-il de le souligner, ne saurait être un prétexte pour niveler la société par le bas. Il s’agit bien plutôt d’accorder la possibilité à chacun d’exceller selon ses prédispositions, ses choix et ses capacités. Dans cette perspective, la démocratie réalise, et cela sur le respect de la dignité humaine, une société meilleure, où les plus compétents peuvent se recruter dans les couches les moins aisées.
Le régime démocratique rappelle aux dirigeants et aux citoyens que la gestion du pouvoir n’incombe pas aux seuls dirigeants, mais qu’elle est l’affaire de tous. Le principe de la séparation des pouvoirs : pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, codifié dans les principes fondamentaux dans la gouvernance moderne, traduit la volonté de la démocratie à prévenir l’abus d’autorité à laquelle succombent facilement ceux qui sont placés à la tête des organes de direction. Cela offre le pouvoir au législatif de contrôler l’action de l’exécutif, et au judiciaire de veiller à ce que tous, sans distinction, se conforment aux règles de droit et de justice.
Par ailleurs, dans un système politique de ce genre où le peuple incarne la réalité du pouvoir, il est autorisé l’existence d’organisations citoyennes faisant office de contre- pouvoir comme les organisations de la société civile qui regroupent les syndicats, les organisations non gouvernementales qui, à travers des discours et des actions, dénoncent souvent les dérives et les manquements de l’État. M. Savadogo (2006, p. 8) dira que « le gouvernant n’est pas supérieur aux citoyens, il se doit de prêter attention à toutes les formes de manifestation de leur jugement ». Ici, l’intérêt du citoyen est véritablement la mesure de la valeur de l’action politique. Ainsi la démocratie moderne se démarque de l’élitisme de Platon où les chefs justifient, avant tout, leur légitimité à partir leurs compétences exceptionnelles. Ce qui les gratifie ipso facto d’un droit incontestable de légiférer dans tous les domaines relatifs à la vie publique, souvent au mépris de l’opinion des masses, considérées naturellement comme médiocres.
Conclusion
La pensée politique de Platon se révèle, à l’issue de notre réflexion, comme un effort de résoudre de manière définitive les problèmes de gouvernance, en élevant au rang de gouvernants les citoyens les plus compétents de la cité. Dotés d’une science adossée à une morale rigoriste, ces hommes renoncent à tous les honneurs et à tous les avantages matériels attachés habituellement à la fonction de celui qui dirige, pour servir la cité dans un souci sacerdotal. Nonobstant, l’idée platonicienne d’après laquelle les inégalités naturelles constatées entre les hommes, seraient de nature ontologique nous paraît, aujourd’hui, périlleuse et obsolète.
La démocratie moderne corrige dans ce sens le système aristocratique d’obédience platonicienne en ramenant au centre de la préoccupation politique la question de la dignité humaine, de laquelle résulte le principe fondamental des droits de l’homme et du citoyen selon lequel les hommes naissent libres et égaux en droit. L’action des gouvernants est juste quand elle est orientée par la volonté générale. Platon, en dépit de son attachement à l’aristocratie, a reconnu dans les Lois (708b) qu’« on ne tolère pas aisément des lois et des régime politiques différents de ceux qui sont en vigueur chez soi ». Cela suffit pour comprendre que, dans un souci de réalisme, Platon admet parfois la légitimité de certains régimes non aristocratiques car ils conviennent mieux parfois à l’esprit de certains peuples. De toutes les constitutions de fait, jugées corrompues par Platon, celle démocratique apparaît, à ses yeux, comme un pis-aller. Dans Le Politique (302d-303b), comparant le gouvernement démocratique aux autres régimes, il se montre explicite : « De tous ces gouvernements, quand ils sont soumis aux lois, celui-ci est le pire, mais, quand ils s’y dérobent, c’est le meilleur de tous ». À y voir de près, les principes démocratiques, qui reposent sur l’égalité des citoyens et sur le respect de leur liberté, sont les mieux à même d’atteindre les finalités que Platon assignait à l’État sous sa forme uniquement aristocratique. Nulle crainte de voir dans la démocratie véritable, l’irruption au pouvoir d’individus médiocres et sans scrupules. Dans ses fondements théoriques, le système démocratique favorise l’ascension au pouvoir d’hommes compétents et soucieux de l’intérêt général. Ces derniers gouvernent, non en raison de leur supériorité naturelle sur les autres, mais parce qu’ils sont désignés par des scrutins, pour veiller à ce que les lois émanant de la volonté générale profitent au peuple sans distinction de naissance.
Références bibliographiques
ARISTOTE, 1995, La Politique, Trad. J. Tricot, Paris, Vrin.
BOBBIO Norberto, 1996, Libéralisme et démocratie, Paris, Cerf.
BRÉHIER Émile, 2005, Histoire de la Philosophie, Tome premier. L’Antiquité et le Moyen Âge, Québec, http://bibliothèque.uqac.ca.
CHÂTELET François, 1979, Platon, in La Philosophie de Platon à St Thomas, Verviers, Les Nouvelles Éditions.
HADOT Pierre, 1995, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard.
HOBBES Thomas, 1999, Leviathan, Trad. F. Tricaud, Paris, Dalloz.
PLATON, 1964, Le Phèdre, Trad. É. Chambry, Paris, Flammarion.
PLATON, 1969, Le Politique, Trad. É. Chambry, Paris, Garnier Flammarion.
PLATON, 1997, Les Lois, Trad. A. Castel-Bouchouchi, Paris, Gallimard.
PLATON, 1987, Lettres, Trad. L. Brisson, Paris, Flammarion.
PLATON, 1966, La République, Trad. R. Baccou, Paris, Garnier- Flammarion.
PLATON, 1943, La République, Livres I. III, in Œuvres complètes, Tome VII, Trad. É. Chambry, avec Introduction d’A. Diès, Paris, Les Belles Lettres.
SAVADOGO Mahamadé, 2006, Citoyenneté et démocratie, in Le Cahier Philosophique d’Afrique, pp. 1-13.
SAVADOGO Mahamadé, 2002, La Parole et la Cité, Paris, L’Harmattan.
SAVADOGO Mahamadé, 2008, Pour une éthique de l’engagement, Namur, Presses Universitaire de Namur.
SOBOUL Albert, 1962, Histoire de la Révolution française, Paris, Sociales.
ZONGO Alain Casimir, 2017, « Esthétique musicale et éthique chez Platon », in Le Cahier Philosophique d’Afrique, pp. 109-127.
WAHL Jean et BRUN Jean, 1969, « Platon », in Histoire de la Philosophie, Paris, Gallimard.
L’ACTION COMME RÉVÉLATION DU QUI CHEZ HANNAH ARENDT
Akpé Victor Stéphane AMAN
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’action occupe une place centrale dans la philosophie d’Arendt. Elle est le mouvement par lequel l’homme s’insère dans la vie publique. Ainsi, sa conception de la liberté acquiert sa plus haute signification comme étant la liberté éprouvée par la révélation du « qui ». Ici, le « qui » est une question fondamentale pour qui veut trouver sa place dans l’action collective. En vérité, « qui » est le symbole de toute activité capable de faire advenir l’espace commun, socle du vivre-ensemble et de la liberté.
Mots-clés : Action, Espace public, Liberté, Sujet.
Abstract :
Action is central to Arendt’s philosophy. Action is the movement by which man inserts himself into public life. Thus, his conception of freedom acquires its highest meaning as being a freedom experienced by the revelation of the “who”. The “who” is a fundamental question for anyone who wants to find their place in collective action. In truth, “who” is the symbol of any activity capable of bringing about the common space, the basis of living together and freedom.
Keywords : Action, Freedom, public Space, Subject.
Introduction
Dans Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt se propose de reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Parmi celles-ci, l’action, incluse dans la vita activa, la vie active, est constituée du travail et de l’œuvre. Dans le présent travail, la condition de l’action retiendra notre attention parce que, pour Arendt, elle est l’activité particulièrement politique qui met directement les hommes en rapport. Dans sa philosophie, l’action est décisive puisqu’elle est liée à la question de l’espace publique. C’est l’action qui permet à l’homme d’exprimer sa liberté et de manifester son potentiel créatif. L’action est le fond de la présence publique base de la communauté politique. La liberté étant identifiée à la capacité d’agir, la présence publique est une manifestation de notre existence.
Cependant, il existe un mystère caché dans l’action qui transparait dans le fait que le résultat de l’action est indéterminé. En d’autres termes, les conséquences de l’action ne sont jamais sues avant et après l’action étant donné que ce qui arrive est de l’ordre de la nouveauté. En plus de cette indétermination liée à l’action, celle-ci révèle quelqu’un de tout à fait inattendu, improbable et imprévisible : un qui. Il s’agit d’un phénomène ancré dans l’être humain qui est lié à la nature même de l’action. Le qui apparait comme un phénomène mystérieux, inconnaissable de celui qui agit. Dès lors, que recouvre le concept de qui dans la philosophie de l’action chez Arendt ? Ce problème exige les interrogations subsidiaires suivantes : quel est le sens de l’action dans la pensée d’Arendt ? Que révèle le qui de l’action ? Dans une approche analytico-critique, nous tenterons de mettre en lumière la nature du qui dans la philosophie de l’action d’Arendt.
1. Le sens de l’action
1.1. L’action comme unité d’intégration dans la vie publique
La vita activa est constituée de trois activités humaines fondamentales du travail, de l’œuvre et de l’action. Dans Condition de l’homme moderne, Arendt se propose de décrire les aspects de la vita activa en distinguant son mode d’exécution et son sens dans l’existence humaine. Elle écrit :
Je propose le terme de vita activa pour designer trois activités humaines fondamentales : le travail, l’œuvre et l’action. Elles sont fondamentales parce que chacune d’elles correspond aux conditions de base dans lesquelles la vie sur terre est donnée à l’homme (H. Arendt, 1983, p. 42).
La vie humaine est soumise à des conditions fondamentales qu’Arendt a distinguées en trois composantes hiérarchiquesqui sont : le travail, l’œuvre et l’action. Elles sont fondamentales « parce que chacune d’elles correspond aux conditions de base dans lesquelles la vie sur terre est donnée à l’homme » (H. Arendt, 1983, p. 42). Le travail est ainsi lié aux fonctions élémentaires de la vie. Il est l’ensemble des activités que l’homme exerce en vue de produire des biens utiles pour sa survie. Par conséquent, le travail apparait comme une activité indispensable à la survie de l’espèce humaine. Il en assure sa pérennité.
Si l’homme s’arrête de travailler, la société tombera, non seulement en ruine, mais surtout l’espèce humaine s’éteindra étant donné qu’aucune providence ne volera à son secours dans l’optique de produire, pour lui, des éléments indispensables à sa survie. Pour H. Arendt (1983, p. 3), « le travail n’assure pas seulement la survie de l’individu mais aussi de l’espèce ». La condition du travail est fondamentale, car elle est garant de la vie, et elle participe à sa préservation et sa pérennisation. « La condition humaine du travail est la vie elle-même » (H. Arendt, 1983, p. 41). Les produits du travail sont destinés à être consommés continuellement pour assurer les besoins biologiques du corps.
[Le travail représente] l’activité qui correspond au processus biologique du corps humain, dont la croissance spontanée, le métabolisme et éventuellement la corruption, sont liés aux productions élémentaires dont le travail nourrit ce processus vital. (H. Arendt, 1983, p. 41).
Le travail manifeste notre soumission indélébile à la nécessité. Par le travail l’homme affirme son humanité. Pour H. Arendt (1989, p. 34), « ce n’est pas la raison, jusqu’alors le plus haut attribut de l’homme, mais le travail, activité humaine traditionnellement la plus méprisée, qui contient l’humanité de l’homme.
Quant à l’œuvre, elle est une construction symbolique qui porte la marque de l’esprit et qui témoigne de son inscription historique dans la matière. Si le travail enferme l’homme dans la circularité de la production-consommation, l’œuvre nous arrache à l’écoulement du temps et prend possession des choses, tout en nous délivrant de l’empire de la nécessité. « L’œuvre est l’activité qui correspond à la non-naturalité de l’existence humaine, qui n’est pas incrustée dans l’espace et dont la mortalité n’est pas compensée par l’éternel retour cyclique de l’espèce » (H. Arendt, 1983, p. 41). L’œuvre manifeste la créativité de l’homme à travers l’artificiel.
L’œuvre « correspond à la Poiesis des Grecs et renvoie aux activités de création ou de fabrication » (J.-C. Poizat, 2003). L’œuvre recouvre le principe par lequel l’homme devient fabricant d’objets. Dans ce sens, elle crée un monde plus humain débarrassé de l’hostilité naturelle, s’installant dans la durabilité. « C’est cette durabilité qui donne aux objets du monde une relative indépendance par rapport aux hommes qui les ont produits et qui s’en servent » (H. Arendt, 1983, p. 188). Même si les objets fabriqués sont soumis à la consommation, et parfois à une disparition certaine, ils existent à un moment donné dans le monde.
L’usage, en effet, contient certainement un élément de consommation, dans la mesure où le processus d’usure a lieu par contact entre l’objet et l’organisme vivant qui consomme (…). Utilisés ou non, ils demeureront un certain temps dans le monde à moins qu’on les détruise délibérément (H. Arendt, 1983, p. 189).
L’œuvre représente, en elle-même, la fin et le moyen par lesquels l’homme exprime sa créativité à travers la fabrication des choses. La fin de la fabrication ne consiste pas en une réification de l’objet. Mais elle est plutôt une forme de mise au monde d’un objet dans la permanence du monde. « Dans le processus du faire, au contraire, la fin n’est pas douteuse : elle arrive dès qu’un objet entièrement nouveau, assez durable pour demeurer dans le monde comme entité indépendante, a été ajouté à l’artifice humain » (H. Arendt, 1983, p. 195). Parmi les objets qui donnent à l’artifice humain la stabilité sans laquelle la vie humaine n’aurait aucune consistance, il faut nommer l’œuvre d’art.
L’œuvre d’art n’a pas de prix car elle ne peut qu’être soumise abusivement à la consommation. « En raison de leur éminente permanence, les œuvres d’art sont de tous les objets tangibles les plus intenses du-monde ; leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels » (H. Arendt, 1983, p. 223). Si l’œuvre d’art est autant élevée, c’est justement parce qu’elle est « source de penser » (H. Arendt, 1983, p. 223) et prélude à l’action.
L’action est la catégorie par laquelle l’homme s’humanise, car c’est en agissant qu’il apparait aux autres et vice versa. Dans ce sens, la condition fondamentale de l’action est « la pluralité humaine », (H. Arendt, 1983, p. 232) socle du vivre-ensemble et surtout du monde commun. Pour J.-C. Eslin (1996, p. 77), interprétant la condition de la pluralité, affirme que « les hommes, au pluriel, habitent la terre ». C’est justement l’action qui insère les individus dans la pluralité de sorte que ceux-ci ne soient pas atomisés, isolés et par conséquent, incapables de maintenir un certain équilibre métaphysique. Par l’action, les hommes sont distincts et se distinguent. « Si les hommes n’étaient pas distincts, chaque être humain se distinguant de tout autre être présent, passé ou futur » (H. Arendt, 1983, p. 232), le monde serait un amas d’individus incomplets. Il est clair que dans ce cas, le sens de l’agir se dit de la façon dont chaque individu constitue une ouverture sur l’avènement d’un monde commun créant ainsi un espace dans lequel on nait soi-même tout en permettant la naissance d’autre individualité, et par là, nous formons le monde, un monde commun partagé avec d’autres. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la pensée d’Etienne Tassin quand il affirme :
Élucider le sens de l’agir revient à montrer comment dans l’action la pluralité des êtres noue entre eux un lien qu’on peut dire proprement politique puisqu’il se confond avec l’institution d’un domaine public par lequel chacun s’ouvre aux autres en ouvrant pour eux communément l’espace d’un même monde (E. Tassin, 1999, p. 270).
L’intégration dans le monde commun est une condition de l’humanité dans le fait d’apparaitre à autrui mais aussi pour autrui. Sans cette apparition, la capacité pour l’homme d’exprimer son ouverture au monde serait du coup supprimée. Il perdrait ainsi son sens politique, ainsi que son humanité.
L’action est par définition humaine : par définition, elle est politique. Elle est humaine parce que seuls agissent ces êtres qu’on dit humains, ou plutôt, seuls peuvent être dits humains les êtres agissants (E. Tassin, 1999, p. 271).
Il apparait que l’action est consubstantielle à la liberté et il ne peut avoir de liberté sans action.
1.2. L’action comme expression de la liberté
La liberté fait partie de l’homme qui est liberté si bien que « renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme » (J.-J. Rousseau, 1972, p. 233). Le sens de la liberté est défini par le sens que lui donne l’homme agissant, devenant initiateur d’une chose nouvelle et inédite. La liberté ne s’entend pas comme une qualité psychologique étreinte dans les profondeurs de l’âme. Elle est une condition politique attachée à l’individu comme possibilité d’une infinie probabilité. Arendt pose la liberté comme le début de l’homme. Pour elle, « le principe de liberté fut créé en même temps que l’homme, mais pas avant » (H. Arendt, 1983, p. 234). Ce qui transparait, c’est le lien indélébile entre la liberté et l’homme. Pareil lien marque le commencement d’un substrat nouveau, commencement de quelqu’un plutôt que de quelque chose. En effet, « ce commencement est autre chose que le commencement du monde ; ce n’est pas le début de quelque chose mais de quelqu’un, qui est lui-même novateur. » (H. Arendt, 1983, p. 234).
La liberté n’est pas un état fini pour de bon. Elle ne peut qu’être une possibilité qu’il faudra actualiser. Elle est une possibilité de commencement qui se dit de ce qui est à l’origine, à partir de cette origine, sont générés des évènements nouveaux par rapport à leur provenance, mais aussi par rapport à leur impact direct dans le monde. Le commencement fait advenir le nouveau tout à fait improbable, inattendu et unique.
Il est dans la nature du commencement que débute quelque chose de neuf auquel on ne peut pas s’attendre d’après ce qui s’est passé auparavant. Ce caractère d’inattendu, de surprise, est inhérent à tous les commencements, à toutes les origines. Ainsi l’origine de la vie dans la matière est une probabilité infinie de processus inorganiques, comme l’origine de la terre au point de vue des processus de l’univers ou l’évolution de l’homme à partir de l’animal. Le nouveau a toujours contre lui les chances écrasantes des lois statistiques et de leur probabilité qui, pratiquement dans les circonstances ordinaires, équivaut à une certitude ; le nouveau apparait donc toujours comme un miracle (H. Arendt, 1983, p. 234).
L’action est l’initiation d’une nouveauté. Agir, c’est être capable de créer du neuf de sa propre initiative. Or, chaque homme étant un nouveau venu, est capable, par le fait même qu’il soit un nouvel acteur par la naissance, de prendre des initiatives, d’agir. Arendt revient à l’usage augustinien du concept de commencement, qui fait une différence entre initium et principium, deux types de commencement. Pour Augustin, l’homme est initium car avant qu’il ne soit il n’y avait personne, et le principium est le commencement du monde. « Afin donc qu’il fût, l’homme a été créé avant que nul autre ne fût » (Saint Augustin, Livre XII). Cette pensée suppose, en effet, qu’avant la création du monde, il y avait autre chose, en l’occurrence, les anges, mais il n’y avait personne avant l’homme. Pour Arendt, l’homme est commencement, capable d’être à l’origine. Mais, il tient à sa condition, à la possibilité de créer du neuf par son être-là, c’est-à-dire sa naissance.
Le fait que l’homme est capable d’action signifie que de sa part on peut s’attendre à l’inattendu, qu’il est en mesure d’accomplir ce qui est improbable. Et cela à son tour n’est possible que parce que chaque homme est unique, de sorte qu’à chaque naissance quelque chose d’uniquement neuf arrive au monde. Par rapport à quelqu’un qui est unique, on peut vraiment dire qu’il n’y avait personne auparavant (H. Arendt, 1983, p. 234).
La nouveauté tient à la qualité même de l’action dans le sens où celui qui agit ne sait pas ce qui pourra advenir. « L’action est d’une part liée à l’imprévisibilité qui caractérise le commencement de quelque chose de nouveau. D’autre part, l’action est irréversible, car, une fois qu’on l’a entreprise, on ne peut plus contrôler ses effets » (J.-C. Poizat, 2003, p. 128). L’action suppose la multiplicité indéfinie d’hommes capables d’interpréter l’acte selon des perspectives diverses entrainant une variété de résultats. Cette diversité des possibilités n’est réalisable que parce qu’il existe un fond commun qui permette aux hommes d’apparaitre les uns aux autres de façon réciproque. Dans la pluralité, il existe une singularité. En fait, si les hommes se ressemblent, ils sont capables d’être distincts du fait de leur naissance. Le principe de natalité préside à la différence, à l’accomplissement du neuf.
Si l’action en tant que commencement correspond au fait de la naissance, si elle est l’actualisation de la condition humaine de la natalité, la parole correspond au fait de l’individualité, elle est l’actualisation de la condition humaine de la pluralité, qui est de vivre en être distinct et unique parmi de égaux (H. Arendt, 1983, p. 234-235).
Le commencement se dit également dans la parole. Nous pouvons situer cette position d’Arendt à partir de références bibliques : « Au commencement était la parole » (La bible, Jean1-1). Le terme de parole, non moins que celui de commencement, sert à rappeler le récit génésiaque. Il fait allusion à la création comme recréation. Il s’agit de la parole unique et parlante en dehors du temps, dans son éternelle préexistence. La parole est à l’origine de toute chose. Ce verset rappelle les premiers mots de la genèse et il ne s’agit point d’un simple rapprochement dans les termes, mais d’une analogie profonde.
Si la genèse raconte la création, la parole du commencement retrace la création d’un monde commun. Si les mots « au commencement » ne reportent pas la pensée au-delà de la première création, l’évangile ne dit pas que la parole elle-même fut alors créée, mais qu’elle était au moment où toute chose fut créée, qu’elle est antérieure à toute la création, par conséquent, au temps lui-même. La parole est donc parole de l’éternité. La pensée de l’éternité, dans les termes dont se sert l’évangéliste, se présente alors comme la nature divine de la parole. La parole est créatrice, elle révèle la puissance et la nature de ce qui est appelé à l’existence.
En tout cas, dans l’accompagnement du langage, l’action ne perdait pas seulement son caractère révélatoire, elle perdrait aussi son sujet, pour ainsi dire ; il n’y aurait pas d’hommes mais des robots exécutant des actes qui, humainement parlant resteraient incompréhensibles (H. Arendt, 1983, p. 235).
La parole accompagne l’action comme une parole de quelqu’un. Elle dit, en extériorisant, ce qui se tenait dans le secret de la personne. Dans la parole réside l’action et dans l’action réside la parole.
Une action muette ne serait plus action parce qu’il n’y aurait plus d’acteur et l’acteur, le faiseur d’actes, n’est possible que s’il est en même temps diseur de parole. L’action qu’il commence est révélée humainement par le verbe, et bien que l’on puisse percevoir son acte dans son apparence physique brute sans accompagnement verbal, l’acte ne prend un sens que par la parole dans laquelle l’agent s’identifie comme acteur, annonçant ce qu’il fait, ce qu’il a fait, ce qu’il veut faire (H. Arendt, 1983, p. 235).
Par la parole et l’action, les hommes se révèlent, se disent et se lient. De cette manière, ils édifient une communauté, la condition de l’action étant la pluralité. L’action révèle distinctement celui qui agit dans sa particularité plurielle, elle établit un monde commun d’apparence à travers le domaine public ou l’espace politique.
« L’action doit se comprendre dans ses trois dimensions : elle est révélante, elle est instituante, elle est liante » (E. Tassin, 1999, p. 270). L’action ne révèle pas des qualités ou des dons purement accidentels. L’action révèle l’agent : le qui, celui dont on n’a pas conscience avant qu’il ne soit déjà là. Le qui est le sujet et la fin de l’action ; il se révèle en même temps que l’on agit, pas avant, car ce qui est fondamental dans l’action, c’est de déterminer le qui, qui est qui ?
2. La révélation du qui
2.1. De la révélation du qui comme sujet pluriel
Le qui doit être différencié du « ce que » dès l’abord. En effet « on ne saurait saisir l’originalité de la conception arendtienne de l’action politique sans tenir compte du fait qu’elle est pensée comme l’actualisation d’un « qui » » (J. Kristeva, 1999, p. 275).
Ce point de départ de la différenciation entre le qui et le ce qu’apparaît comme un point focal de l’action arendtienne. Ce que se réduit aux attributs, aux dons naturels et se fond dans la nébuleuse de la vie biologique, ce que n’a rien de concret et ne dépasse pas la simple expression de soi. Il exprime des qualités spécifiques implicites cachées à l’apparence. « Ce que » ne révèle jamais quoi que ce soit. C’est nos « identités physiques » qui « apparaissent, sans la moindre activité, dans l’unicité de la forme du corps et du son de la voix » (H. Arendt, 1983, p. 236). Aucun effort n’est nécessaire pour faire naitre le ce que, puisqu’il est toujours là, perdu dans la profusion des êtres. J. Kristeva (1999, p. 277) conçoit justement le ce que comme « spécimen qui se perd dans l’anonymat de l’espèce, ou dans la vie au sens naturel du terme, une vie biologique dont l’être humain doit s’extraire pour conquérir sa spécificité ».
Le « ce que » est donc anonyme, mort à la vie et particulièrement banal puisqu’il n’agit pas. Or, sans action, il est hypostasié dans la fixité et ne peut qu’être condamné à la vanité. Du coup, « ce que » n’est pas encore tant qu’il ne transcende pas sa condition pour devenir un qui. Le ce que porte le porteur de l’action. En d’autres termes, « ce que » n’est que le corps attaché à l’existence par son aspect physique, mais mort à la vie par l’anonymat dont il est la référence indéniable. Le « ce que » n’est que le pressentiment du « qui » qui attend de se manifester. Qui est révélé par l’action.
Cependant, qui a une spécificité : il n’est pas connu par la personne qui agit. Il est caché et se révèle aux autres et à soi sans que l’on ne soit préparé au préalable aux conséquences de l’action. « Qui » est comme « le daimôn de la religion grecque qui accompagne chaque homme tout au long de sa vie, mais se tient toujours derrière lui en regardant par-dessus son épaule, visible seulement aux gens que l’homme rencontre » (Hannah Arendt, 1983, p. 236). Le « qui » est voilé à la personne pour se révéler à la multitude. Il se révèle pour les autres et s’actualise dans les rapports intersubjectifs. « « Qui » est un soi caché, mais caché davantage à la personne qu’à la multitude humaine, ou plutôt à la temporalité de la mémoire d’autrui » (J. Kristeva, 1999, p. 278).
Le « qui » se manifeste dans la dynamique de l’action qui ne peut surgir que dans la pluralité. Les différents « qui » qui naissent sont le produit d’une question principielle adressée à chaque nouveau venu : qui est tu ? Cette question est au fond la raison de notre présence au monde. Si l’apparaissant n’apparait pas à lui-même et aux autres, son apparition serait en réalité une disparition car coupé de l’espace-monde. Espace-monde se dit de la charnière spatio-temporelle réalisée par l’espace publique, le monde des hommes. « Qui es-tu ? » ne signifie pas seulement la particularité de la personne qui advient, ses références physiologiques et sociologiques. Cette question est le substrat de toute nouvelle naissance, de toute action.
Dans cette situation, il apparaît que le « qui » serait « une source du processus créateur » (J. Kristeva, 1999, p. 279) de l’homme, contradiction de la recherche d’une essence indélébile. Autrement dit, les hommes ne sont pas simplement des hommes par essence, mais ils le deviennent à partir de conditions fondamentales, en l’occurrence la condition de l’action. « La condition humaine ne s’identifie pas à la nature humaine, et la somme des activités et des facultés humaines qui correspondent à la condition humaine ne constitue rien de ce qu’on peut appeler la nature humaine » (H. Arendt, 1983, p. 44). « Qui » ne se révèle que dans l’action et non dans sa simple présence au monde. Être présent au monde sans y être inséré par son action est une existence morte à la vie, déviance à l’être de l’homme, c’est-à-dire sa condition humaine.
L’excès du « qui » remplace, dans sa théorie, l’énigmatique « essence ». De plus, cet excès n’est ni pure pensée ni pur langage révélant l’être. Le « qui » advient au sein des conditions de vie, qui sont des conditions d’activités avec les autres, mais qui ne le déterminent cependant pas de manière absolue (J. Kristeva, 1999, p. 279).
On pourra noter que le « qui » est avec les autres, pour les autres, parmi les autres. Dans ce sens, « qui » est « qui » que dans son rapport aux autres et jamais en dehors. Autrement dit, aucun « qui » ne pourrait exister s’il n’y avait personne pour interpréter et se remémorer l’action ou la parole professée. « Cette qualité de révélation de la parole et de l’action est en évidence lorsqu’on est avec autrui, ni pour ni contre, c’est-à-dire l’unité humaine pure et simple » (H. Arendt, 1983, p. 236). Ce qui se donne à voir dans cette théorie arendtienne du qui, c’est l’émergence d’un sujet pluriel.
Le concept de sujet pluriel peut être contradictoire dans les termes, mais ce n’est qu’une apparence de contradiction. Dans l’action, le moi agissant n’a aucune idée du résultat de son initiative puisque toute action ne peut produire que du neuf. Bien que l’homme puisse apparaitre comme le moteur de l’action, le « qui » ne nait qu’après coup et s’analyse seulement lorsque « qui » n’est plus. Cette situation apparemment paradoxale n’est en fait que l’expression de la singularité plurielle de l’individu qui s’extériorise et par conséquent se liquéfie dans l’espace public. La singularité n’est pas une antithèse de la pluralité, mais elle est la pluralité qui, en se déliant, se raccroche au multiple, par-là, se multiplie en se reliant à la singularité tels les termes d’une boucle d’action. Ainsi, le sujet pluriel est le résultat de la condition de l’action. Mais, tout en étant le résultat, il est aussi le point de départ. Il y a comme une « enigmaticité » de l’action qui en fait la condition même de la pluralité.
Il y a dans l’action une énigme : l’action qui a pour condition la pluralité est elle-même condition de la communauté. Mais loin d’unifier ou de réduire la pluralité qui est sa propre condition, elle l’élève à la dimension d’un monde en révélant d’abord la singularité des agents, en instituant ensuite un espace de visibilité qui, donnant apparence aux dokei moi, les ouvre à une communauté de monde, en reliant enfin les individus au travers du polémos qui commande les rapports, de sorte que la pluralité se trouve intégralement maintenue comme telle dans le moment même où, depuis l’espace public érigé en scène d’action et de jugement, s’ouvre pour elle un monde commun (E. Tassin, 1999, p. 271).
Le sujet pluriel est celui qui fait naître le monde commun par le courage de l’action. Il est à la fois unique et semblable aux autres. Étant étranger à l’anonymat, ce sujet révèle ce qui fait de l’homme un homme, c’est-à-dire exister dans l’espace public et surtout revivre dans « la lumière éclatante que l’on nommait jadis la gloire et qui n’est possible que dans le domaine public » (H. Arendt, 1983, p. 237). La gloire qui est en fait ce qui appartient à l’histoire.
2.2. De la révélation du qui comme référent historial
Si « qui » s’est exposé dans le domaine public, cela ne va pas pour autant de soi. Sortir de la tranquillité du privé, du foyer nécessite du courage. Le courage n’est pas un acte d’héroïsme, mais un acte de foi. N’ayant aucune idée de ce qui adviendra de mon acte ni de la référence historiale que cet acte engendrera, il m’est difficile d’agir, car quand j’agis, j’agis à l’aveugle. Pourtant, si je n’agis pas, ma liberté sera remise en cause, par-là, mon humanité sera questionnable. Agir nécessite le courage.
« Le courage originel, sans lequel ne seraient possibles ni l’action, ni la parole, ni par conséquent, la liberté » (H. Arendt, 1983, p. 245), le courage de l’action s’inscrit dans ce qu’on appelle, au sens propre, le héros. Le héros n’est pas une personne hors norme avec des qualités inédites. Le héros, c’est celui qui, avec courage, laisse dans l’histoire une inscription simple de son apparition dans l’espace public, sans peur ni arrière-pensée. Le héros, c’est l’homme d’action, ce que devrait être tout homme. Dans la théorie d’Arendt, action et liberté coïncident si bien que le héros n’est rien d’autre que l’homme d’action.
Le héros que dévoile l’histoire n’a pas besoin de qualités héroïques ; le mot héros à l’origine, c’est-à-dire dans Homère, n’était qu’un nom donné à chacun des hommes libres qui avait pris part à l’épopée troyenne et de qui l’on pouvait conter une histoire. L’idée de courage, qualité qu’aujourd’hui nous jugeons indispensable au héros, se trouve déjà dans le consentement à agir et à parler, à s’insérer dans le monde et à commencer une histoire à soi (H. Arendt, 1983, p. 244).
Devenir héros est un acte de mémoire. Cela signifie que mémoire et espace public sont liés. La mémoire est une opération de la conscience. Elle est la conscience du passé. C’est elle qui établit une liaison entre nos divers états de conscience passés et nous fait assumer chaque moment de notre existence comme étant nôtre. Elle suppose la conscience comme possibilité de conserver et de rappeler les faits et les évènements vécus. C’est dire que le souvenir est un acte de conscience. La mémoire est la faculté de souvenir. Elle apparaît comme un regard sur ce qui a été, exprime la présence d’une absence, c’est-à-dire ce qui a été, qui n’est plus et qui réapparaît de nouveau à notre conscience. Par elle, le passé vient au présent sous forme de rappel ayant existé pour nous et qui avait disparu de notre champ de perception. La mémoire implique une prise de conscience du passé en tant que passé et du passé en tant qu’avenir. C’est par elle que tous nos états de conscience sont enregistrés les uns à la suite des autres. La reconnaissance du passé lui est donc réfléchie puisqu’elle suppose un jugement d’antériorité.
L’importance de la mémoire, pour chaque individu et pour toute la collectivité, est le substrat de la vie du héros. Sans mémoire, toute connaissance intersubjective serait impossible. C’est grâce à elle que l’homme peut se fixer dans le présent par les acquis du passé, dans le même temps, envisager des perspectives d’avenir. De même, c’est par la mémoire collective qu’un groupe se saisit comme l’unité dans la pluralité des apparitions. De ce point de vue, un peuple amnésique, c’est-à-dire qui a perdu la mémoire, qui ignore tout du passé, est un peuple sans histoire, sans fondement, sans racine, donc sans capacité d’actions nouvelles. La mémoire est ainsi la garantie de l’agir humain à travers le temps et la succession des générations. De la sorte, elle s’impose à nous comme un devoir, c’est-à-dire une obligation morale à laquelle nul ne saurait se soustraire. En tant qu’être d’histoire et de projet, il nous incombe un devoir de mémoire, une obligation de nous souvenir. Pourquoi donc cette injonction de souvenir s’impose-t-elle à nous ?
Nous devons nous souvenir parce que nous sommes responsables devant l’histoire de notre présent et de notre avenir. L’obligation de souvenir est multiforme. Ce rappel de souvenir s’impose à nous comme un devoir civique à l’égard des autres. À ce titre, la mémoire est essentielle dans la constitution de l’unité. La mémoire s’entend aussi comme ce qui rend possible l’engagement ou la promesse. Il s’agit précisément de l’engagement que l’on prend lorsqu’on fait une promesse d’honorer sa parole présente, d’en assurer la responsabilité à travers le temps.
Il n’est pas question de fuir sa responsabilité en se réfugiant dans l’oubli pour feindre l’amnésie. Au contraire, la mémoire fait de nous des êtres de confiance constants et loyaux. Vertu cardinale qui conditionne toute transaction marchande, tout contrat entre les hommes. Cette obligation concerne tout homme à qui incombe la responsabilité de tenir sa promesse d’hier et d’assumer ce qu’il a fait dans le passé. Elle est la source de la vie du héros et le socle d’un monde commun.
Conclusion
La possibilité de s’ouvrir afin de changer de point de vue fait que l’irréductible pluralité des perspectives, loin de fragmenter et de séparer les hommes dans des visions incommunicables, confère un fondement au monde commun. L’existence du commun ne doit rien à une commune mesure qui serait préalablement donnée et qui permettrait de relativiser ou de subsumer la variété des perspectives, car cela reviendrait à établir un point de vue totalitariste qui le détruirait. Le commun naît de l’impossible privatisation du monde : aucun point de vue n’est indépassable.
Le monde est commun parce qu’il n’y a pas de classification des points de vue selon le statut social, et parce qu’il n’y a pas de point de vue qui surplomberait tous les autres dans une vision transcendante et absolue de l’ordre du monde, l’ordre humain n’est plus soumis à celui de l’essence. La perspective arendtienne correspond à la sécularisation de l’espace introduite par la vision conditionnée par la pluralité. Ce modèle perspectif correspond à l’avènement du sujet pluriel, pour qui le monde est le spectacle des apparences.
« Pour nous l’apparence, ce qui est vu et entendu par autrui comme par nous-mêmes, constitue la réalité » (H. Arendt, 1983, p. 89). De même que les apparences, il n’y a de perspectives qu’au pluriel. Le terme souvent associé est celui de variété. La variété des conceptions qui transparait dans le monde traduit le fait que le monde est celui des hommes et non le monde de l’homme. La pluralité est une condition fondamentale de monde du « qui ». Au contraire, le monde, le monde commun prend fin lorsqu’il n’y a plus de perspective différente, quand il existe une vision unitaire de la vie, voire un monde totalitaire.
« Le monde commun, au contraire, prend fin lorsqu’on ne le voit que sous un seul aspect, lorsqu’il n’a le droit de se présenter que dans une seule perspective » (J.-C. Eslin, 1996, p. 84). Le monde résulte de l’effort de chacun de se présenter et donc d’agir. L’action crée la communauté et la communauté crée le monde de l’action. Sans cette corrélation, il est impossible de définir un espace politique viable, socle du vivre-ensemble.
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 1989, Condition de l’homme moderne, Trad. Georges Fradier, Calmann-Lévy, Paris.
ARENDT Hannah, 1972, La crise de la culture, Trad. Patrick Lévy, Paris, Gallimard.
ESLIN Jean-Claude, 1996, Hannah Arendt, L’obligée du monde, Paris, Éditions Michalon.
KRISTEVA Julia, 1999, Le Génie féminin, tome 1 : Hannah Arendt, Paris, Fayard.
La Bible, 2010, Trad. Traduction œcuménique de la Bible, Paris, Cerf/Biblio.
POIZAT Jean-Claude, 2003, Hannah Arendt, une introduction, Paris, Presses-Pocket.
TAMINIAUX Jacques, 1992, La fille de Thrace et le penseur professionnel. Arendt et Heidegger, Payot.
TASSIN Etienne, 1999, Le trésor perdu. Hannah Arendt. L’intelligence de l’action politique, Paris, Payot.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1973, Du contrat social, Paris, Bordas.
SAINT AUGUSTIN, 1994, La cité de Dieu, Trad. Louis Moreau, Paris, Seuil.
L’ÉDUCATION COMME PRIORITÉ DE L’INVESTISSEMENT DANS L’HUMAIN
Florent MALANDA-KONZO
Université Marien NGOUABI (Congo)
Résumé :
Dans la société d’aujourd’hui en transformation constante, l’on parle de crise de l’éducation. Cette crise a pour conséquence la détérioration de la qualité de la vie humaine, l’effondrement de l’école, la démotivation des apprenants, etc. Remédier à cette crise nécessite de faire de l’éducation une priorité de l’investissement dans l’humain, afin de retrouver le sens de l’humanité. L’éducation doit donc constituer, aujourd’hui, la priorité de l’investissement humain. Investir dans l’homme, c’est, avant tout, l’éduquer et même restaurer tout une nation. Notre travail consistera à montrer que l’éducation constitue un fondement capital du développement et du devenir de l’humain. À travers une approche analytique, il est question d’indiquer que l’éducation est une vaste entreprise qui engage le destin et le devenir d’une nation.
Mots-clés : Développement,Éducation, Formation, Humain, Investissement.
Abstract :
In today’s constantly changing society, the education crisis is at stake. The consequences of this crisis are a deterioration in the quality of human life, the collapse of schools, demotivated learners, and so on. To remedy this crisis, we need to make education a priority for investment in people, in order to regain a sense of humanity. Education must therefore be the priority for human investment today. Investing in people means, above all, educating people and restoring an entire nation. Our task will be to show that education is a vital foundation for human development and the future. Using an analytical approach, we will show that education is a vast undertaking that affects the destiny and future of a nation.
Keywords : Development, Education, Training, Human, Investment.
Introduction
Les sociétés modernes connaissent une profonde crise de l’éducation. Les mutations multisectorielles de la technoscience et la crise des valeurs sont des signes qui montrent que l’éducation est en crise. Cette notion semble devenir caduque. Les maux dont souffrent les sociétés modernes ont pour cause l’effondrement du système éducatif. Il va s’en dire que la condition du redressement desdites sociétés passe par le primat à accorder à l’éducation. Cette dernière se présente aujourd’hui comme la priorité de l’investissement dans l’humain. Qui plus est « l’éducation est un moyen susceptible d’intégration de l’homme naturel dans la vie » (M. Mankessi, 2020, p. 77). La communauté internationale fait de la formation une priorité absolue et s’est pleinement engagée en faveur de cette priorité en incluant un système de qualité parmi les objectifs de développement durable (ODD). L’éducation peut être de plusieurs natures : familiale, religieuse, scolaire, etc. F. Morandi (2000, p. 13) la « désigne comme le processus qui relie un sujet à son environnement proche, à un système de société, de culture et de valeurs et lui permet de s’y intégrer ». L’éducation est donc inséparable de l’évolution sociale, elle constitue une des forces qui la déterminent. Dans cette même perspective, J. Beillerot (2006, p. 6) rappelle pertinemment « qu’elle est ce processus par lequel un être humain s’humanise, devient humain et plus humain ».
Comme on peut le constater, il est plausible de dire que la détérioration de l’éducation, dans un pays ou dans une société donnée, constitue un véritable handicap, nous voulons dire, un véritable mal. Car ce qui fait la valeur d’un homme ou d’une société, c’est l’éducation. Dans la perspective kantienne, on est homme que par l’éducation ». Ainsi, un peuple sans éducation est un peuple qui est à la merci de la barbarie, c’est un monde où les instincts inhumains sont comme déchaînés. Dans un contexte de crise axiologique, pour qu’une société puisse retrouver son sens de l’humanité, il lui faut repenser l’éducation sur tous les plans. Dès lors, la sortie de cette crise de l’éducation, reconnaît Thomas De Koninck (2010, p. 13), « obéit à une seule condition qu’on favorise une meilleure éducation ». L’éducation doit donc constituer, aujourd’hui, la priorité de l’investissement humain. Investir dans l’homme, c’est, avant tout, éduquer l’homme. L’urgence ici est de
concevoir des contenus éducatifs fondamentaux aptes à promouvoir les connaissances, les aptitudes, les valeurs, les attitudes dont l’être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et continuer à apprendre (H. Sall, 2002, p. 4).
Comment alors l’éducation peut-elle constituer la priorité de l’investissement dans l’humain ? Que faire pour que celle-ci retrouve ses lettres de noblesse ? Ne constitue-t-elle pas la priorité pour le développement ? N’est-elle pas le fondement du changement des mentalités ? À travers une démarche analytique, nous ferons une analyse tripartite de la question : la part du capital humain dans la formation, la priorité de l’éducation pour le développement, l’éducation comme fondement du changement et de la transformation des mentalités.
1. Du levier des nations : la part du capital humain dans la formation
Dans le monde contemporain, chaque nation est confrontée à des défis tels que l’augmentation de la démographie, les aspirations croissantes des différentes couches sociales, la demande d’une éducation de haute qualité, les déséquilibres écologiques, les mutations multisectorielles de la technoscience et la crise des valeurs. La culture contemporaine est marquée par une tendance anthropocentrique. C’est l’homme qui se trouve en son centre en vue de relever certains défis éducationnels. Afin de relever ces défis, les gouvernants doivent mettre l’accent sur la formation du capital humain. Ce dernier se définit comme l’ensemble des savoirs et le savoir-faire acquis d’une part par l’instruction, la formation et d’autre part, par l’expérience existentielle. Le capital humain englobe donc les connaissances, les qualifications et les caractéristiques personnelles ou individuelles. L’objectif visé est de promouvoir les connaissances, les aptitudes, les valeurs, les attitudes dont l’être humain a besoin. Cela a pour point de départ l’éducation de base qui prendrait en compte tout être humain et tout l’homme en tant qu’acteur et objet de formation de tout individu ou citoyen à partir de qu’on a appelé, éducation ou formation de base.
L’éducation de base peut être définie comme
celle qui fait acquérir à l’individu dans un contexte historique, social et linguistique déterminé, un minimum de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes lui permettant de comprendre son environnement, d’interagir avec lui, de poursuivre son éducation et sa formation au sein de la société et de participer plus efficacement au développement économique, social et culturel (H. Sall, 2002, p. 5).
De ce point de vue, cette éducation de base a pour finalité de former des individus autonomes, des jeunes et adultes capables de s’insérer véritablement dans leur milieu et de participer au développement de la société dans laquelle ils vivent. Il est donc évident que le rôle régalien d’un État est de garantir l’éducation de base pour tous les enfants et réduire le taux d’analphabétisme. Dans un tel contexte, le pays le moins armé, au double plan de l’éducation et de la formation, serait le plus fragile. Il est clair que l’éducation, aujourd’hui, est plus nécessaire que jamais.
L’éducation de base permet de faire acquérir à tous les citoyens, sans distinction d’âge, de sexe, de groupe social, le respect des droits et devoirs des citoyens, l’initiation aux connaissances de base et aux comportements liés à la santé, l’hygiène, la vie familiale, la population, la paix, la démocratie et la solidarité. Elle permet aussi de faire acquérir des connaissances pour la protection et le développement de l’environnement.
L’école, qui constitue l’une des institutions de l’éducation de base, est un lieu d’apprentissage multiforme et de découverte mutuelle de l’homme et ce d’un point de vue holistique. Elle doit donc permettre aux enfants de se libérer du cadre trop étroit de leur famille, de développer des intérêts communs par exemple, parmi les élèves. Le rôle de l’école est très complexe. Sur cet aspect, Leclerc (1996, p. 7) soutient que :
l’école se doit de prendre l’élève là où il se trouve dans son développement lors de son arrivée à l’école, ce qui l’oblige en outre à tenir compte du cheminement propre à chacun ; elle doit aussi le conduire, dans toute la mesure du possible, là où il peut et où il veut aller, ce qui l’oblige également à diversifier ses voies et à varier ses méthodes. Parallèlement à l’institution scolaire, la famille et la société en général participent en effet à sa formation et exercent sur lui des influences déterminantes que l’institution scolaire ne contrôle pas.
L’enfant ou l’apprenant est sujet ou objet de la formation, c’est-à-dire qu’en se formant, il participe lui-même à sa propre formation. C’est ici l’importance de l’auto-formation sous le regard, l’appui, l’accompagnement et la responsabilité de l’enseignant. Le formateur est appelé à accompagner les apprenants dans l’assimilation des savoirs et au respect strict des programmes d’enseignement. Cela permettrait aux apprenants non seulement d’acquérir des savoirs mais d’obtenir leurs diplômes. C’est ainsi que Mankessi (2020, p. 25) pense qu’« il faut développer l’autonomie créatrice des apprenants en procédant à un renversement des méthodes : créer une pédagogie capable de mettre l’enfant en rapport avec son environnement physique et lui donner les ressources matérielles propres lui permettant de créer le savoir ». En clair, l’éducation doit être le lieu de la culture ou de la promotion de l’autonomie créatrice dans la perspective de l’épanouissement de l’enfant ou de l’élève. Au fond, celui-ci doit être capable d’adopter un comportement, d’apprendre à être.
Pour aider l’apprenant à être acteur de sa formation et surtout de son auto-formation, il incombe à l’État d’assurer une meilleure formation des enseignants en mettant en place un système éducatif compétitif, conçu et adapté aux nécessités réelles du pays, en matière de compétences ou des aptitudes professionnelles. C’est le cas, en République du Congo, du projet sur la réadaptation des programmes scolaires. Ce programme a permis la mise à niveau des enseignants à travers une formation efficiente et surtout adéquate. C’est ici le lieu de montrer l’importance du renforcement des capacités du corps enseignant.
Cette initiative se situe dans la perspective de visées nettement novatrices qui permette le changement de paradigme. Pour J. Leclerc (1996, p. 33), « la gestion de la mission éducative ne peut fonctionner en vase clos. Elle doit s’ajuster en tenant compte des tendances lourdes qui s’expriment et des besoins qu’elles mettent en relief ». Ce changement de paradigme exige la formation des enseignants pour une meilleure efficacité dans l’enseignement et une compétitivité des écoles. Cela permettrait aussi aux personnels enseignants non seulement de renouveler leurs pratiques mais aussi et surtout d’adopter de nouvelles approches. De même, la formation à l’enseignement doit nécessairement se greffer à une pratique professionnelle. Pour la gestion administrative, par exemple, il est exigé aux enseignants une formation adéquate. Il serait aussi important de procéder à la mise en place de stages pratiques de préparation à la gestion administrative. Aujourd’hui, le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) procède à la mise en place de dispositifs d’assurance qualité dans les différentes universités. L’objectif visé est d’assurer la plus-value de la formation. Pour M. Behrens (2007, p. 13) « le recours à la qualité introduit donc indéniablement dans le champ éducatif une dimension économique. La formation, même scolaire, est devenue un objet économique ». Cette dimension de l’éducation et de la formation académique ou scientifique constitue un point focal pour le développement d’une nation.
2. La priorité de l’éducation pour le développement intégral d’une nation
Quel rapport existe-t-il entre l’éducation et le développement d’une nation ? L’urgence ici, est de concevoir des contenus éducatifs fondamentaux en vue d’amorcer pleinement le développement, améliorer la qualité de existence de l’homme, pour prendre des décisions éclairées. Une éducation offerte dans quelque cadre que ce soit ne constitue nullement une solution magique permettant aux peuples de réaliser leurs idéaux sociétaux, culturels, économiques et politiques. Mais, la prestation de services d’une éducation de qualité, d’une manière efficace, demeure un des principaux moyens menant à un développement national harmonieux.
Le développement, quant à lui, a pour finalité l’humain et pour fondement le choix. En effet, le développement réel d’une nation doit être centré sur l’humain par la réalisation de son potentiel et l’amélioration du bien-être économique et social de la collectivité. Il doit être conçu pour apporter aux individus ce qu’ils estiment comme répondant à leurs besoins économiques et sociaux. Les êtres humains sont à la fois des personnes et des membres d’une société ; ils doivent être à même d’exprimer leurs intérêts et être des êtres sociaux libres.
Dans cette perspective, l’État doit repenser son développement socio-économique en investissant considérablement dans l’éducation. Il s’agit de focaliser ses efforts sur l’humain et d’investir, en priorité, dans l’éducation et la recherche comme base pour créer une nouvelle société. Leclerc (1996, p. 6) dit en substance que :
le but même de l’éducation concerne la formation de l’être humain. Il s’agit plus fondamentalement de contribuer à la ‘production’ d’un sujet autonome et responsable, à la formation d’un individu capable de penser et de créer, ce dernier participant lui-même à son développement et à son évolution. Mais ce développement n’est jamais achevé, à vrai dire.
L’acte d’éduquer doit conduire l’homme à l’autonomie par le choix des programmes bien définis et adaptés. D’où le développement a pour fondement le choix. De cette façon, « le but de ces programmes est d’indiquer à chaque apprenant ou à chaque citoyen qu’il doit acquérir son indépendance économique en comptant non pas sur les autres, mais sur lui-même et sur ses propres forces » (Mankessi, 2017, p. 137).
Aussi est-il important d’accorder une place prépondérante aux programmes de formation professionnelle des jeunes tant en milieu rural qu’urbain. Les métiers d’aujourd’hui ne nécessitent pas obligatoirement que le postulant soit détenteur d’un doctorat ou d’une licence. Ce qui est important, ce sont des formations professionnelles d’une durée donnée (six à vingt mois selon les experts). Les universitaires et les encadreurs chargés de la formation pratique des professionnels doivent se tourner vers des praticiens d’expérience. L’objectif sera « d’identifier chez ces praticiens les habilités et le savoir-faire que les futurs professionnels doivent acquérir et maîtriser » (Y. Poisson, 1992, p. 110). Ces enseignants professionnels sont ceux-là qui savent « cadrer et recadrer » les problèmes complexes qu’ils affrontent et capables de s’adapter à des situations nouvelles.
C. Perrin (2011, p. 32) présente la formation comme « la compétence que l’apprenant, devra avoir acquise à l’issue de la formation et mettre en œuvre en situation de travail ». Cette compétence est la plus-value apportée par la formation. Dans ce sens, l’apprenant sera capable de mettre en œuvre une procédure ou une méthode. Ici, le résultat sera clairement observable ou perceptible. Il en est capable. Cependant, cela n’est possible que si la qualité en éducation et en formation est assurée.
En effet, la qualité dans le monde de l’éducation se décrit avant tout en termes de performances de compétences de l’apprenant en général et d’élève ou de l’étudiant en particulier. Mais, cette « qualité est d’abord l’affaire du monde pédagogique, de ses enseignants et formateurs, des didacticiens, des chercheurs et des évaluateurs » (M. Behrens, 2007, p. 5). La qualité de la formation ne peut donc pas être conçue indépendamment des apprenants ni des enseignants ou formateurs.
Il s’agirait aussi de proposer les programmes d’alphabétisation aux jeunes et adultes non scolarisés. Cela permettrait d’assurer la pérennité des résultats au moyen de divers types d’éducation non formelle. Il s’agit, par exemple, de la prise en charge de la formation professionnelle des adultes et des nombreux enfants n’ayant pas fréquenté l’école ou l’ayant quittée trop tôt :il s’agit en fait et en droit des jeunes déscolarisés. Cela pourrait permettre à chacun de construire sa destinée, en prenant en compte « la visée d’éducation globale, le développement personnel, social, professionnel, citoyen, etc. » (L. Paquay, 2007, p. 74).
La place de l’éducation dans le développement d’une Nation pose aussi la problématique de l’employabilité des jeunes et des adultes. Il s’agit, à ce niveau, de dégager les outils concrets pour une employabilité efficiente. Ce mécanisme exige de nos universités et de nos instituts d’enseignement secondaire ou supérieur de dispenser une formation axée sur les compétences. Il s’agit de savoir comment agir et intervenir sur les individus, sur les humains pour les rendre mobiles. Il faut proposer des leviers nécessaires aux apprenants dans l’appropriation des comportements et compétences à l’employabilité. Sur ce, le formateur doit accompagner les apprenants dans l’appropriation de ces comportements et compétences nécessaires sur le terrain de l’emploi.
Par ailleurs, la dimension éthique se donne comme un levier fondamental dans la formation des apprenants. En effet, l’éthique exige la prise de conscience effective des valeurs liées à l’employabilité. Le formateur devra choisir, selon des valeurs librement adoptées, ce qu’il estime éthiquement utile de faire. Il oriente à la prise de conscience des exigences du monde de l’emploi, comme par exemple et en ce cas le savoir-être et le savoir-faire. L’intention pragmatique qui l’anime est de former les individus, les apprenants au savoir-être professionnel, en vue de développer ou de rendre efficient leur employabilité. C’est ainsi que, pense E. Vidal « le formateur devra faire preuve de vigilance éthique » (E. Vidal, 2019, p. 169). Dans la conception vidalienne, le formateur doit éviter toute intervention à caractère dictatorial. Il doit éviter d’intervenir sur l’« être » sans le consentement ou l’adhésion du sujet. Ceci permettrait de prévenir toutes dérives comportementalistes. Pour rendre le sujet employable, l’éthique devra mettre l’accent sur les normes « qui relèvent du « comportement », de la « mentalité », des bonnes dispositions et intentions » (E. Vidal, 2019, p. 169). L’apprenant en fin de formation doit prendre conscience et reconnaître ses talents potentiels, les exploiter et mesurer ce qu’on peut y ajouter pour répondre mieux aux exigences de l’emploi. Avec cette prise de conscience, s’ouvrent des possibilités de changement de l’être de l’apprenant et de conversion de sa mentalité dont la portée éducationnelle est avérée.
3. L’éducation comme fondement du changement et de la conversion des mentalités
La gestion de l’éducation exige de lier la qualité de la formation dispensée à l’efficacité de la mise en œuvre même des services. En clair, elle exige la mise en pratique de la formation reçue. La question, à partir de ce moment, est de savoir dans quel contexte l’éducation peut-elle permettre la conversion des mentalités ? Il faut d’abord comprendre que la vraie éducation est celle qui transmet des éléments, des choses utiles à l’homme. Le système éducatif moderne tel qu’il est conçu n’est pas de nature à faciliter l’adaptation de l’individu à la réalité parce qu’il s’est totalement dilué dans l’universel. Il faut donc tenir compte de la rencontre du particulier et de l’universel, de l’endogène et de l’exogène. Cela signifie que l’éducation exige l’harmonie dans la conciliation de ces deux réalités. Elle constitue le lieu par excellence où l’humain prend en compte les notions de développement, d’amour, d’entraide, de coopération, de liberté, d’intérêt, de valeur, de politique, d’économie et d’éthique. Ce sont ces valeurs qui doivent engager l’homme dans la prise de conscience effective de bien faire et de faire bien les choses. De cette façon, ces valeurs permettraient inéluctablement à l’homme d’assumer ses responsabilités et de faire des choix. Cela n’est possible qu’avec le changement de mentalités. En effet, pour P. Mabiala (2012, p. 17), pour bien faire les choses,
le changement de personnes ne suffit pas, ce sont les mentalités qu’il va falloir convertir…Lorsqu’un changement n’intègre pas la conversion du cœur, c’est comme si on balayait une chambre toutes fenêtres fermées. Il va de soi que la poussière, au lieu d’être évacuée, retombera dans la pièce.
Il est clair que pour lui, le changement de mentalités passe impérativement par la conversion du cœur, d’où il faut une éducation du cœur. Le cœur, dira Blaise Pascal, est le centre de tout.
Écouter son cœur est un puissant facteur dans l’évolution positive des mentalités. Changer de mentalité, c’est accepter de dire non à la paresse, à la trahison, au repli identitaire. Le changement de mentalité doit caractériser le corps éducatif, qu’il s’agisse de l’enseignant ou de l’administrateur, dans la gestion de la chose publique et dans les entreprises privées pour un développement intégral. Ainsi donc, l’éducation reste l’outil scientifique de valeur qui permettra à chacun de modifier sa manière d’être et de vivre au mieux. L’absence d’une éducation responsable conduirait le système éducatif à la dérive.
Prenons l’exemple de l’éducation scolaire et de l’éducation religieuse : Nous remarquons qu’elles sont complémentaires puisque ni l’école ni l’église ne mettent l’accent sur l’instruction, mais sur l’éducation. Si l’instruction met l’accent sur l’accumulation du savoir, l’éducation quant à elle se focalise sur le savoir pratique. Ainsi, on apprend non pas pour apprendre mais pour mettre en pratique ce qu’on aura appris. L’école est devenue un simple canal de transmission des savoirs, et les apprenants de véritables terreaux du savoir. L’école a perdu sa vocation première : celle qui consiste à montrer à l’apprenant le chemin du savoir. L’école doit pouvoir aider l’apprenant à traduire le savoir en comportement. Mankessi (2012, p. 139) soutient dans ce sens que « l’école éduque autant qu’elle instruit et l’élève s’éduque en fonction des connaissances qu’il acquiert ».
C’est finalement en cela qu’un nouveau langage, de nouveaux paradigmes, de nouveaux symboles et de nouvelles valeurs pourront voir le jour. Ce dynamisme pourrait occasionner la production et par suite l’avènement de nouvelles normes et de nouveaux repères d’action. D’où la naissance d’une nouvelle façon d’être au monde, l’éthique de la responsabilité, qui a pour fondement la conversion des mentalités. De ce point de vue, l’humain est plus orienté vers une nouvelle mentalité qui prend ses distances avec l’ancienne. Cela nécessite une nouvelle façon d’être, de penser, de faire et de vivre.
Cette nouvelle mentalité nous renvoie à une nouvelle réalité, celle qui consiste à l’amélioration des services éducatifs. De la sorte,
le nouveau modèle de gestion devra passer par le renouvellement de la façon de diriger, la mobilisation des troupes et la redistribution des pouvoirs, administratifs et pédagogiques, si l’on souhaite enrayer les effets pervers du système que sont l’échec, le décrochage, la démotivation, la morosité qu’engendre trop souvent l’approche technobureaucratique dominante. (Leclerc, 1996, Avant-propos)
Ce renouvellement exige une évaluation. Il faut la création d’un système qui permette une évaluation critique des actions posées et de rendre compte de la qualité des services d’éducation. Ainsi, « l’évaluation est, en quelque sorte, la conscience vigilante, éclairée et agissante du système d’éducation lui-même, des établissements d’enseignement et des individus » (Leclerc, 1996, p. 56). Ladite évaluation prend en compte l’aspect critique. Dans cette perspective,
elle vise, par un regard critique sur l’ensemble des activités réalisées, à juger des résultats atteints et de la pertinence de maintenir ou d’ajuster certaines pratiques. Elle concerne autant le fonctionnement général du système et des établissements que les pratiques des personnels et les apprentissages des élèves. Les activités réalisées permettent-elles à l’établissement scolaire de remplir sa mission ? Répondent-elles aux besoins des clients, qu’ils soient élèves, parents ou employeurs ? L’action éducative est-elle efficace, c’est-à-dire atteint-elle les objectifs visés ? Est-elle efficiente, c’est-à-dire obtient-elle les résultats escomptés à des coûts raisonnables ? (Leclerc, 1996, p. 56).
Par ailleurs, l’éducation permet à l’homme de prendre conscience de soi dans sa vie. En effet, la prise de conscience de soi se comprend comme le fait d’être capable de réfléchir sur ce que l’on est, en tant que sujet pensant et en tant qu’objet dans l’environnement. Chez Nietzsche, elle se comprend, non comme une réalité naturelle, mais comme une nécessité pour survivre. L’homme doit se sentir capable de maîtriser les conditions de l’existence humaine et d’agir comme puissance de créativité spirituelle et culturelle. Un homme éduqué est capable d’assumer les évènements de l’histoire, du temps passé, du présent voire du futur.
La prise de conscience de soi renvoie alors à la métamorphose de la mentalité de chaque individu. Il s’agit d’orienter sa vision du monde vers une nouvelle perspective ; ce qui appelle un moment de dépassement perpétuel. Cela signifie que le nouvel homme politique et l’acteur économique sont ceux qui prennent conscience de l’effondrement non seulement des vieilles valeurs, mais aussi, des vieilles institutions de la société. Ils doivent, par exemple, être capables d’assurer la prévention, la sensibilisation et la lutte contre les antivaleurs. Il est évident que les antivaleurs s’enracinent et s’étendent dangereusement dans tous les secteurs de la vie à cause de la culture de l’impunité. Pour cela, il faut changer les mentalités des citoyens et ouvrir la voie à la sanction quand les principes éthiques sont consciemment mis en cause ou violé.
De ce point, on comprend que le changement de mentalités exige une certaine initiation à une citoyenneté nouvelle. Cette dernière n’est rien d’autre qu’un apprentissage introductif aux savoirs du civisme, du patriotisme ou d’une vie citoyenne responsable. Ces savoirs sont cognitifs ou théoriques, affectifs ou comportementaux, conatifs ou psychomoteurs, directifs ou managériaux, etc. Ils ont le rôle d’orienter dignement les citoyens dans la société pour leur propre bien et de cette dernière. L’initiation à la nouvelle citoyenneté devient une pratique éducative par laquelle l’État prépare les citoyens à intérioriser et à vivre les fondamentaux de la Nation. La citoyenneté se définit comme étant un lien de rattachement d’un individu à un État, à ses lois et aux membres qui constituent cet État, par le truchement de la nationalité que celui-ci lui accorde. Le changement de mentalités demande au citoyen de mettre en pratique les valeurs citoyennes de liberté, de fraternité, de civisme, d’égalité, de solidarité, de tolérance, de conscience, de l’intérêt collectif. Ces valeurs traduisent la volonté des citoyens à vivre ensemble. La force véritable de la citoyenneté réside, avant tout, dans la compréhension de ce qu’elle représente pour chaque individu dans le corps social. La société ou la cité est le lieu où vivent les citoyens. C’est la communauté des individus qui vivent ensemble, en un même lieu. Vivre dans la cité, c’est impérativement s’engager à vivre ensemble avec d’autres citoyens. Par conséquent, la citoyenneté est un contrat social. Ce dernier exige de tous les citoyens une certaine prise de conscience.
La responsabilité de l’homme doit être orientée vers la prise de conscience de la domination de certaines idéologies tant politiques, économiques que religieuses, qui ne sont pas, ou si elles sont, de façon partielle, au service de la société. Bien plus, l’éducation de l’homme doit s’inscrire dans la perspective dégagée par H. Arendt (1961, p. 41), relative aux trois activités humaines fondamentales qui constituent la base de la vie sur terre, à savoir « le travail, l’œuvre et l’action ». Considéré comme l’exercice d’une activité donnée, l’accomplissement d’une tâche, le travail est un processus de réponse aux nécessités essentielles de la vie. C’est le travail qui donne sens à l’existence humaine. Dans son élan de créativité, le travail se comprend comme processus tendu vers un pouvoir de créativité. Cette créativité donne le pouvoir d’émergence de la nouveauté. Chaque travail, quel qu’il soit, physique ou intellectuel, donne lieu à quelque chose, qui se traduit comme produit du travail.
L’œuvre est la matérialité du travail effectué. C’est « la non naturalité de l’existence humaine. Elle fournit un monde artificiel d’objets, nettement différent de tout milieu naturel » (H. Arendt, 1961, p. 41). L’œuvre ne peut venir au monde que par l’action pour ainsi dire par le travail de l’individu dans sa relation avec la nature et surtout l’autre dans un cadre sociétal. En effet, le travail est l’activité qui met l’homme en rapport avec l’autre. L’action permet à l’homme d’agir, de produire du nouveau et de changer de mentalités. Joseph de Finance (1965, p. 1) soutient dans la même perspective que « l’action est la suite nécessaire, la justification de l’existence. Un être qui n’agit pas ou qui agit peu apparaît sans valeur, insignifiant. Agir, c’est pour l’être, se réaliser jusqu’au bout, devenir pleinement soi, conquérir sa vérité dernière ».
La prise de conscience de soi signifie, en réalité, donner une place de choix à la science, à la recherche scientifique, c’est-à-dire à la créativité et à l’inventivité : « Le savoir nécessaire au développement est un savoir de type scientifique » (E. Njoh Mouelle 1975, p. 51). En clair, rechercher le nouveau, c’est donc changer de mentalité et changer de mentalité, c’est toujours chercher le nouveau.
Conclusion
En conclusion, l’éducation est gage du développement, elle constitue le point de départ de tout développement dans tous les secteurs d’activité d’une nation. De cette façon, elle participe à la formation du citoyen responsable. Toute forme d’éducation vise à transformer l’enfant en adulte compétent, efficace. L’éducation est une vaste entreprise qui engage le destin et le devenir des hommes, d’une nation…Et, l’école constitue, à tout point de vue, un facteur clé de socialisation et de développement humain. Mais ce développement nécessite une conversion des mentalités. Le changement des mentalités constitue le premier pilier pour la bonne gouvernance et le développement d’un pays. Ce changement des mentalités provient d’une bonne éducation. Dans cette perspective, un système éducatif doit toujours être revisité afin d’intégrer les valeurs éthico-morales et civiques nécessaires au développement. Ces dernières constituent un préalable à l’organisation d’une éducation pertinente. Il s’agit entre autres de la fidélité et l’honnêteté dans tout engagement, la conscience et la compétence professionnelles, le respect de droit de l’homme et la dignité humaine, le respect des biens communs, l’esprit critique, la responsabilité, etc. Il faut ajouter à cela certaines valeurs éthiques comme le respect de la vie, le droit à la différence.
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 1961, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy.
BEILLEROT Jacky, 2006, Traité des sciences et des pratiques de l’éducation, Paris, Dunod.
DE FINANCE Joseph, 1965, Être et Agir dans la philosophie de Saint Thomas, Rome, Presses de l’Université Grégorienne.
DE KONINCK Thomas, 2004, Philosophie de l’éducation : Essai sur le devenir humain, Paris, PUF
DE KONINCK Thomas, 2010, Philosophie de l’éducation pour l’avenir, Québec, Presse Universitaire de Laval.
LECLERC Jean, 1996,En éducation, la nécessité d’une autre gestion : la qualité totale des processus pour l’amélioration des résultats, Québec, PUC.
MABIALA Philippe, 2012, Le Congo-Brazzaville et son église : le défi de la démission, Paris, L’Harmattan.
MANKESSI Michel Émile, 2017, Comment éduquer aujourd’hui, Saint Denis, Publibook.
PAQUAY Léopold, 2007, « À quoi bon un curriculum de qualité s’il ne change pas les pratiques enseignantes ? », in Matthis BEHRENS (dir.), La qualité en éducation, Québec, PUQ
POISSON Yves, 1991, La recherche qualitative en éducation, Québec, PUQ.
SALL Hamidou Nacuzon, 2002, Les écoles communautaires de base et les technologies de l’information et de la communication, Rapport d’expériences menées au Sénégal, Document inédit.
VIDAL Emeric et MÜLLER Maryel, 2019, « Développer l’employabilité des demandeurs d’emploi : dimensions éthiques d’une telle intervention sociale », in Sociographe, n°68, décembre 2019, Ed. Champs social, pp. 163-172.
REPRÉSENTATIONS SOCIALES LIÉES À L’EXPRESSION DES BESOINS EN FORMATION CONTINUE DES INSTITUTEURS AU BÉNIN
Agbodjinou Germain ALLADAKAN
Université d’Abomey-CalaviBénin)
Résumé :
L’objectif de cet article est d’analyser l’expression des besoins en formation continue des instituteurs en République du Bénin. 611 pratiques enseignantes ont été observées avec une centaine d’entretiens semi-dirigés. L’analyse a permis de comprendre que la manière dont les instituteurs et les membres du corps de contrôle et d’inspection pensent la planification et l’organisation de la classe relève de l’ordre des représentations sociales. Les classes deviennent surchargées du fait de la compression et de la fusion des groupes et des classes. Ces mesures qui sont certainement comprises en termes de contrôle et de maîtrise des dépenses publiques par le gouvernement sont aussi liées à la manière dont les politiques conçoivent le bien public. Ces perceptions de l’expression des besoins en formation continue des différentes catégories d’acteurs, qui du reste sont contradictoires, ne favorisent pas la professionnalisation du métier d’instituteur.
Mots-clés : Expression des besoins, Formation continue, Instituteurs, Représentations sociales.
Abstract:
The objective of this article is to analyze the expression of the continuing education needs of teachers in the Republic of Benin. 611 teaching practices were observed with around a hundred semi-directed interviews. The analysis made it possible to understand that the way in which the teachers and the members of the body of control and inspection think about the planning and the organization of the class fall within the order of social representations. Classes become overloaded due to compression and merging of groups and classes. These measures, which are certainly understood in terms of control and control of public expenditure by the government, are also linked to the way in which politicians conceive of the public good. These perceptions of the expression of the continuing education needs of the different categories of actors, which moreover are contradictory, do not favor the professionalization of the profession of primary school teacher.
Keywords: Expression of needs, continuing Education, Teachers, social Representations.
Introduction
Former les enseignants pour qu’ils soient professionnellement compétents en vue de construire des compétences chez les écoliers est une préoccupation des acteurs de l’école : États, partenaires techniques et financiers, Organisations Non Gouvernementales, etc.). La question occupe nombre de chercheurs qui mettent l’accent sur la professionnalisation du métier. L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) met en évidence 02 modèles d’enseignants adoptés par les pays membres : le modèle à compétence minimale et le modèle à professionnalisme ouvert (Ph. Perrenoud, 1993 b, p. 11). Dans plusieurs géographies du monde, on assiste à un mouvement de balancier : la semi-professionnalisation au sens (A. Etzioni, 1969, p. 23) ; le bricolage ou le métier artisanal (M. Huberman, 1989, p. 215). En formation initiale, les enseignants nouvellement recrutés ou nommés sont admis dans une école normale pour être formés à un programme existant selon les critères de sélection à l’entrée et les diplômes académiques correspondants. Dès leur sortie, ils entrent dans le métier avec beaucoup de difficultés d’adaptation, de tâtonnement, de « survie » (Th. Perez-Roux, X. Lanéelle, 2013, p. 29). Ces difficultés sont prises en compte par la formation continue à travers l’expression des besoins en formation.
En République du Bénin, beaucoup de réformes ont été opérées dans le sous – secteur de l’enseignement primaire. Elles peuvent être catégorisées en trois (03) types. Les objectifs et les enjeux n’étant pas les mêmes, chacune d’elles vient avec son cortège de formations aux enseignants. Elles sont souvent décidées et mises en œuvre selon le rapport au savoir de la « noosphère » (Y. Chevallard, 1991, p. 25). Lorsqu’une innovation intervient, les concepteurs s’associent aux politiques publiques pour décider de comment l’intervention sera pensée. Le corps de contrôle et/ou d’inspection est informé du passage du porteur du message. Les enseignants sont mobilisés à cet effet et puis « ça y est ». Peu importeleur adhésion aux décisions de la hiérarchie supérieure, la réforme est mise en œuvre car on soutient qu’ils sont formés pour la démultiplication en salle de classe.
Au lendemain des États Généraux de l’Éducation, le diagnostic fut posé. La compétence des instituteurs est problématique. Le phénomène s’est accentué ou dégradé avec le départ massif à la retraite chaque année depuis 2010 d’au moins mille « Jeunes Instituteurs Révolutionnaires ». Ces derniers sont nommés maîtres doyens (A. G. Alladakan, 2014, p. 206). À ceux-ci, s’ajoutent d’autres entrants dans le métier sans formation professionnelle. Les instituteurs communautaires massivement reversés, reversables ou en attente de reversement. Il faut aussi prendre en compte les stagiaires qui attendent d’être nourris aux expériences de leurs aînés. Ce sont les jeunes du métier (A. G. Alladakan, 2014, p. 145). Le corps est ainsi traversé par plusieurs catégories d’enseignants dont les rapports à la fonction sont différents. Cette hétérogénéité dans la profession oblige à questionner les savoirs sur lesquels se fonderait la formation continue des enseignants. En 2019, le gouvernement béninois a organisé une évaluation diagnostique des compétences académiques et professionnelles des instituteurs pour ceux qui sont reversés dans le métier sans une pré – professionnalisation. Les épreuves étaient la culture générale et les mathématiques pour le sous-secteur de l’enseignement primaire. L’objectif était de les catégoriser suivant leurs besoins en formation exprimés à travers ces disciplines. Des syndicats d’enseignants s’y sont opposés. Les raisons avancées étaient multiples et multiformes. Malgré les sessions de formation qui ont suivi cette évaluation, la qualification des maîtres d’école relève encore de l’ordre de l’incertain. Face à ces constats, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle les besoins en formation des instituteurs sont liés à des représentations sociales.
La population enquêtée est constituée des nouveaux entrants dans le métier d’instituteur aussi bien de la maternelle que du primaire. Ils ne sont pas nantis d’expériences pédagogiques et didactiques nécessaires pour conduire à bien les séquences de classe devant l’hétérogénéité des écoliers.
1. Repères théoriques
Nous abordons l’expression des besoins en formation continue comme une représentation sociale, (E. Durkheim, 1925, p. 102). X. Roegiers (2007, p. 69) distingue deux façons de voir l’expression de besoins, la première, objective, est basée sur les besoins de fonctionnement de l’institution où on considère que les besoins des acteurs sont des besoins objectivables par les dirigeants de l’organisation ou par un expert. La deuxième correspond la mieux à la présente recherche. Là-dessus, l’auteur postule une conception constructiviste basée sur l’expression des besoins par les acteurs, qu’il nomme besoin des acteurs. Il ne peut donc être question de besoin en dehors du discours des individus qui se construit à partir de leur perception (X. Roegiers, P. Wouters et F. M. Géraud, 1992, p. 33). Ce courant considère que le besoin est une représentation de la réalité, une construction de cette réalité par chacun des acteurs, liée aux interactions multiples que la personne entretient avec son environnement. On parle de besoin exprimé et non de besoin réel. Ces approches de J.-M. Barbier, de M. Lesne (1977, p. 95) et d’E. Bourgeois (1991, p. 51) sont situées dans un courant constructiviste selon lequel, il n’existe pas de besoins objectifs, observables mais des expressions de besoins, des représentations de besoins.
En ingénierie de la formation (M. Dennery, 2006 ; G. Le Boterf, 1990, 2005, p. 47), l’analyse des besoins de formation suppose l’existence d’un commanditaire de la formation. Il souhaite transformer une situation réelle actuelle, décrite comme une situation problème, en une situation désirée idéale. Et ceci, dans le cadre d’un projet de changement collectif où la formation n’est qu’un des leviers de l’action. Les besoins de formation n’existent pas en soi, mais constituent des écarts entre la situation problème et la situation désirée que l’ingénieur de formation devrait identifier et analyser en vue de construire son projet de formation (G. Le Boterf, 2005 p. 19).
Pour Th. Ardouin, (2017, p. 79) « il n’y a pas un gisement de « besoins en formation » plus ou moins caché, qui ne demanderait que l’arrivée d’un spécialiste armé de méthodologies pertinentes pour le repérer et procéder à son exploitation. La notion même de besoin est ambiguë ». Dans ce cadre, l’étude va s’intéresser aux discours des instituteurs de la maternelle et du primaire nouvellement venus dans le métier ainsi qu’à l’observation de leurs pratiques enseignantes.
2. Repères méthodologiques
Une enquête par observation directe, intégrant les différentes interventions verbales ou non verbales de l’instituteur en salle de classe a été réalisée en janvier-février 2021 auprès de 301 enseignants de la maternelle et du primaire dans toutes les régions pédagogiques en République du Bénin. Au-delà des données relatives au champ de formation (français, mathématique), à la matière, au titre de la séquence, aux objets d’apprentissage/contenu de formation prévu(s), aux compétence(s), aux connaissances, aux stratégies, aux sections, aux effectifs, aux cours tenus par l’enseignant, à sa catégorie et à son ancienneté, à la gestion du temps d’enseignement-apprentissage, la grille portait sur les volets de la planification et de la préparation de la séquence, de la gestion et de l’animation de la séquence au regard de la didactique et de la pédagogie de la matière, de l’évaluation prédictive, de l’évaluation formative, de l’objectivation et de l’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves. 20 critères composant ces volets permettaient d’observer et d’apprécier les séquences de classe. Le premier avec ses 05 critères nous intéresse pour le présent article de par le modèle d’analyse choisi. En prenant les bornes supérieures, on retient que 250 enseignants du primaire ont été approchés contre 51 instituteurs de la maternelle dont les pratiques enseignantes ont été observées par 36 enquêteurs qui sont des membres des Commissions Techniques d’Interventions Spécialisées. Ils sont pour la plupart des instituteurs, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs de l’enseignement du premier degré titulaires d’une licence ou non en sciences de l’éducation ou en sociologie en fonction ou à la retraite. Ils étaient partis pour faire 648 observations de classe mais 611 ont pu être effectuées. Les informations recueillies ont été traitées avec le logiciel Excel. Toutes les données de terrain ne sont pas utilisées dans ce travail. L’étude statistique des actes pédagogiques permettant de comprendre l’analyse du contenu intellectuel et affectif des fonctions du maître d’école nous a orienté vers la quantification des données.
Enfin, un certain nombre de représentations étaient investiguées, renvoyant aux besoins en matière d’accompagnement pédagogique, didactique et disciplinaire. Il a été aussi demandé d’indiquer les disciplines dans lesquelles ces enseignants bénéficient des conseils et/ou des interventions réguliers de la part du corps d’encadrement. L’analyse des différents discours qui ont accompagné l’observation des gestes professionnels nous a permis de saisir les différentes représentations des besoins en formation des instituteurs et laisse entrevoir une recherche de type descriptif et analytique prenant appui sur la démarche qualitative empruntée aux sciences sociales et humaines. Sur ce, l’étude est à la fois quantitative et qualitative.
3. Résultats
3. 1. Du discours des enseignants enquêtés
La trame des propos des instituteurs approchés dans les 12 départements du Bénin fait référence aux obstacles qui entravent un enseignement – apprentissage efficace. Ces enseignants les désignent comme difficultés quand on les aborde pour savoir de quoi ont-ils besoin en matière d’accompagnements pédagogique et didactique pour rendre efficace leur enseignement. Dans le cycle primaire, la question de la lecture a été soulevée par la plupart des enseignants. Le programme d’étude en cours est constamment pointé ou cité comme étant la principale cause. À l’intérieur du document, ils soulignent la complexité des contenus notionnels et préconisent leur découpage en des contenus simples afin de les rendre intelligibles et accessibles à tous. Une formation à cet effet s’avère indispensable pour les y familiariser. À tout ceci s’ajoute le report répété des séquences de classes lié à la non maîtrise des contenus qui sont péniblement saisissables par les maîtres d’écoles interviewés. Du coup, ces notions sont mises en veilleuse et ne font plus objet d’enseignement/apprentissage au cours de l’année scolaire. Le programme d’étude en cours est ainsi bâclé et non achevé.
Si ces besoins exprimés restent relativement mineurs, il reste que la tendance majeure se trouve au niveau de la gestion des grands groupes d’écoliers, c’est-à-dire les classes surchargées. La plus grande difficulté évoquée et qui a prévalu dans la plupart des discours tout le long de l’enquête est relative à la gestion des classes à effectifs pléthoriques. Au cours de cette année scolaire 2018-2019, le manque d’enseignants a conduit le gouvernement à la fusion de plusieurs classes, augmentant du fait le nombre d’apprenants par salles. Le tableau ci-dessous présente la situation de pléthore d’effectifs dans les classes. Les tailles sont au-delà de 45 élèves exigés par les normes de l’École de Qualité Fondamentale (EQF, 2009). Les données présentées à l’intérieur de ce tableau, montrent qu’il y a 257 salles de classes dont les effectifs sont au – dessus des exigences.
Tableau 1 : Fréquences des effectifs des classes
| Classes ayant des effectifs compris entre | Effectifs | Pourcentage | Effectifs cumulés | Pourcentage des effectifs cumulés |
| ] 15-30] | 69 | 14,87% | 69 | 14,87 % |
| ] 30-45] | 138 | 29,74% | 207 | 44,61 % |
| ] 45-60] | 112 | 24,14% | 319 | 68,75 % |
| ] 60-75] | 57 | 12,28% | 376 | 81,03 % |
| ] 75-90] | 27 | 5,82% | 403 | 86,85 % |
| ] 90-110] | 23 | 4,96% | 426 | 91,81 % |
| Au- delà | 38 | 8,19% | 464 | 100 % |
| Total | 464 | 100,00% | ||
Source : Données de terrain, 2019.
3.2. Disciplines et domaines d’observation des enseignants
Les disciplines et les domaines sont les matières d’enseignement à la maternelle et au primaire en République du Bénin. À l’enseignement maternel, les apprentissages sont structurés en cinq domaines de développement de la petite enfance. Le domaine 3 compte les activités telles que la pré-écriture, la pré-lecture, la pré-mathématique et l’initiation aux activités d’éveil scientifique et technologique. Au niveau du cycle du primaire, les disciplines d’enseignement sont regroupées en 06 champs de formation. Les observations de classes ont été faites de la manière suivante : 216 observations en mathématique soit 35,40 % ; 250 observations en français soit 40,92 % ; 94 observations en pré-mathématique soit 15,38 % et 51 enseignants en pré-lecture, soit 8,31 %. Les proportions par sous-secteur sont illustrées par les graphiques ci-dessous.
Graphique n°1 : Répartition de la proportion des enseignants de la maternelle en fonction des disciplines observées
À la maternelle, 28,28% des enseignants observés en pré-mathématique ont une ancienneté comprise entre 0 et 5 ans, contre 14,48% de la même ancienneté en pré-lecture.
À l’enseignement primaire, les enseignants ayant une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans constituent la moitié de la base comme l’indique le graphique suivant.
Graphique n° 2 : Répartition de la proportion des enseignants du primaire en fonction des disciplines observées
Ce graphique montre que la catégorie des enseignants se trouvant dans la tranche d’ancienneté de 10 à 15 ans est la plus observée en mathématique et en français. En effet, 52,42 % des enseignants du primaire sont observés en français contre 51,39 % en mathématique. En deuxième position, il y a les enseignants qui ont entre 5 et 10 ans d’ancienneté. Cet effectif est constitué de 20,56 % d’enseignants observés en français et de 29,91 % d’enseignants observés en mathématiques. À partir de ce graphique, on peut conclure que la population observée est relativement jeune en termes d’ancienneté dans la fonction et que les enseignants de 15 ans et plus sont faiblement représentés. Les résultats des observations de classe à travers la première dimension se présentent ainsi qu’il suit.
3.3. Planifier et préparer sa séquence de classe
On a désigné la dimension par volet dans cette recherche. Il est décliné en 5 critères où l’observateur doit focaliser son attention sur la maîtrise du contenu de formation par le maître qui a déroulé la situation d’apprentissage. Il doit être attentif à la planification des activités d’enseignement-apprentissage, les préparations écrite et matérielle de la séquence. Pour chaque critère, l’enquêteur doit porter ses appréciations avec les lettres D qui signifie « insatisfaisant ou pas du tout satisfait », C « peu satisfaisant », B « satisfaisant », A « très satisfaisant », Z « ne s’applique pas ». Les appréciations C et D sont choisies ici dans un souci d’analyse et d’allègement du texte.
Le tableau suivant répartit les proportions des cotes des critères obtenues selon la catégorie des enseignants dans les deux disciplines.
Tableau 2 : Proportion d’enseignants des écoles maternelles n’ayant pas réussi les trois critères du premier volet en pré-lecture et en pré-mathématique
| Pré-lecture | Pré-mathématique | |||||||
| ACE | APE | ACE | APE | |||||
| Peu satisfait | Pas du tout satisfaisant | Peu satisfait | Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait | |
| Critère 1 | 9,80% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 7,45% | 1,06% | 0,00% | 0,00% |
| Critère 2 | 7,84% | 11,76% | 1,96% | 0,40% | 5,32% | 4,26% | 1,06% | 1,06% |
| Critère 3 | 0,00% | 15,69% | 0,00% | 0,00% | 3,19% | 4,26% | 1,06% | 1,06% |
Source : Données de terrain, 2019.
Dans le sous-secteur de l’enseignement primaire, les mêmes critères ont été observés
Tableau 3 : Proportion d’enseignants des écoles primaires de l’échantillon n’ayant pas réussi les trois critères du premier volet en français et en mathématique
| Français | Mathématique | |||||||
| ACE | APE | ACE | APE | |||||
| Peu satisfait | Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait | |
| Critère 1 | 13,20% | 1,60% | 1,20% | 0,40% | 15,28% | 0,93% | 3,70% | 0,46% |
| Critère 2 | 6,94% | 3,24% | 2,78% | 0,93% | 8,00% | 2,80% | 2,00% | 1,20% |
| Critère 3 | 6,80% | 2,00% | 2,80% | 2,80% | 6,94% | 1,39% | 3,70% | 0,46% |
Source : Données de terrain, 2019.
4. Discussion
4.1. Planifier et préparer la classe n’est qu’une affaire de représentation sociale
Cette dimension relative à la planification et à la préparation de la séquence de classe est le premier volet qui nous occupe dans les trois qui constituent la grille d’observation. Parmi les cinq critères, certains enseignants ont de bons scores que d’autres comme c’est le cas du premier et du troisième. Le critère n°2 est le parent pauvre dans les deux ordres d’enseignement où les Agents Permanents de l’État (APE) lui accordent plus de crédit que les Agents Contractuels de l’État (ACE). Dans l’enseignement primaire environ 10 % d’instituteurs contractuels semble ne pas trouver assez d’intérêt à la planification et à la préparation de la classe.
Les normes pédagogiques prescrites en République du Bénin exigent de l’instituteur, la planification et la préparation des activités d’enseignement-apprentissage. Les éléments constitutifs du contrôle pédagogique exercé en premier lieu par l’inspecteur et le conseiller pédagogique sont logés à ce niveau. Ce sont les fiches de préparation de classe rangées et alignées, la tenue régulière du cahier journal de classe et du registre d’appel. Il y a également le tableau de la répartition mensuelle des activités à mener et visées par le directeur. Il est affiché en compagnie de la répartition des élèves par âge et sexe, la photo du maître titulaire de la classe, les listes des écoliers inscrits au tableau d’honneur, le répertoire des trois (03) ou cinq (05) premiers, la mercuriale des prix… (A. G. Alladakan, 2014, p. 199). Le traitement des données recueillies montre que la plupart des enseignants de cette catégorie ne sont pas arrivés à exhiber ces documents de travail qu’ils sont censés avoir produits avant d’arriver à l’école en l’occurrence les ACE.
Bien que les textes le prescrivent, la qualité des apprentissages T. Lauwerier, M. Brüning et A. Akkari (2013, p. 129) en salle de classe dépend-elle obligatoirement de ces préalables ? Qui sont les enquêteurs ? Comment se présente leur configuration ? Quels sont leurs profils ? Au nombre de 36, ce sont majoritairement des conseillers pédagogiques et des inspecteurs admis à la retraite, des instituteurs en fonction ou à la retraite titulaires ayant des diplômes académiques en sciences de l’éducation et en sociologie. Avant le démarrage de l’enquête, ils ont été formés. Cette formation peut-elle prendre le pas sur leurs trajectoires professionnelles. Les membres du réseau d’animation pédagogique qui ont terminé leur carrière avant d’être sélectionnés comme enquêteurs ont une manière de faire les visites de classe qui est nettement différente des observations de classes en cause. Dans l’exercice de leur fonction, ils se sont toujours mis dans une position asymétrique où le maître écoute les conseils sans trop de discussion avec la hiérarchie. En fonction de l’ancienneté générale dans le métier, des actions et des gestes professionnels sont sous le contrôle de schèmes complexifiés d’encadrement et d’inspection. Ils se situent beaucoup plus dans leur rôle d’inspecteur, de conseiller pédagogique que d’observateur des pratiques enseignantes. C’est pourquoi au niveau des parties commentaires accompagnant la grille d’observation de classe, beaucoup sont revenus sur la tenue des tableaux d’affichage, l’exactitude des renseignements consignés sur les courbes d’âge et de scolarité des enfants et l’actualité des prix mentionnés dans la mercuriale comme des points faibles. Ils sont beaucoup plus attachés à ces détails qui relèvent plus du contrôle pédagogique que de l’observation du travail enseignant (P. Jarroux, 2015 p. 8) Les besoins en formation des enseignants s’expriment largement à travers ce volet selon leur représentation du métier. Elle fonctionne exactement comme une connaissance élaborée au sein de cette communauté professionnelle de pratiques. L’observateur des pratiques enseignantes est une personne qui a une histoire, une carrière professionnelle. Comment peut-il observer dans les menus détails tous ces points énumérés plus haut sans faire référence à son passé, ses émotions et sa formation. Même s’ils ont reçu la même formation professionnelle, la personnalité va influencer sans doute sa représentation de l’expression des besoins en formation continue des maîtres d’école à travers ses observations de classe. La grille d’observation conçue pour que les instituteurs expriment leurs besoins et les observations faites à propos sont révélatrices des tensions et des conflits à propos de l’expression des besoins en formation d’enseignants. Chaque catégorie d’acteurs a sa représentation de l’expression des besoins. D’un côté, les enseignants de la maternelle et du primaire qui n’accordent pas trop de crédit à certains critères constitutifs de la dimension liée à la planification et à la préparation de la classe. Ils voient en ces éléments ce qui relève de l’accessoire. De l’autre, les observateurs qui y tiennent rigueur. Ainsi, on s’inscrit dans les lignes de J.-C. Abric (1987, p.146) qui voit que « la représentation sociale est le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique ». Sont-ils les seuls révélateurs des conflits internes qui traversent l’expression des besoins en formation des enseignants de la maternelle et du primaire ? Certainement pas. La perception qu’ont les enseignants, les parents d’écoliers et les politiques publiques de la gestion des effectifs pléthoriques en est une autre.
4.2. Gérer des classes surchargées, une autre dimension du problème
Avec 464 salles de classes choisies dans les 12 départements du Bénin, on constate avec le tableau n°1 ci-dessus que seulement 207 ont des effectifs compris entre 25 et 40 écoliers soit 44,61% du total de l’échantillon choisi. Ce sont elles qui respectent les normes de l’École de Qualité Fondamentale fixant l’effectif à 45 écoliers. Le reste, plus de la moitié, 257 soit 55,39% sont au – delà des exigences. Quelles démarches et stratégies d’enseignement/apprentissage les instituteurs peuvent-ils mettre en œuvre dans des conditions où la plupart des salles de classes ont des effectifs compris entre 45 et 110 écoliers avec des classes jumelées et multigrades ?
Malgré quelques divergences décelables dans les propos des instituteurs approchés toutes catégories confondues, on peut y détecter une rhétorique très bien construite comportant des thèmes récurrents et un argumentaire assez semblables. L’étude du corpus de ces discours a mis en évidence la gestion des classes surchargées avec des effectifs pléthoriques allant de 45 à 110 écoliers et parfois au-delà. À qui profite cette situation ? En tout cas, les écoliers n’y trouvent pas d’intérêt. Les apprenants du primaire sont des êtres immatures. Leur éducation est assurée aussi par bon nombre d’acteurs : les parents, les adultes, les maîtres d’écoles, les Organisations Non Gouvernementales partenaires de l’éducation… Les institutions comme l’église et l’État, nous ont enseigné que l’enfant n’appartient pas à sa famille mais à la communauté, qui a la charge mais aussi le pouvoir de l’éduquer dans le sens de l’intérêt général et du bien public. Ce bien enmatière scolaire est une construction sociale qui reflète les rapports de force (J.-L. Derouet, 1992, p. 164 ; J.-L. Derouet et Y. Dutercq, 1997, p. 74).
Sous le régime de Yayi Boni en 2008, plus de 8.000 enseignants communautaires étaient reversés en Agents contractuels de l’État pour pallier le problème de la pénurie d’enseignants. Ce sont des ‘’instituteurs’’ avec ou sans le Brevet d’Études du Premier Cycle. Ils sont recrutés par les communautés à la base, en accord avec les directeurs d’école et rémunérés par leurs contributions financières. Dès la prise de pouvoir par le président Patrice Talon en 2016, la gestion de l’explosion démographique scolaire a changé de méthode. Les politiques ont opté pour la compression des classes et des écoles en lieu et place du recrutement d’enseignants.
Selon les dispositions réglementaires en République du Bénin portant création, extensions, scissions, fermetures, compressions, changements de dénominations, transferts et gémination des écoles maternelles et primaires publiques, la compression sera opérée lorsque l’une des conditions ci-dessous est remplie :
– pendant trois ans, le nombre moyen d’élèves par classe est inférieur à quinze (15) dans l’école
– l’effectif total des élèves a été régulièrement décroissant sur trois (ans) malgré la sensibilisation
Toute requête de compression devra être introduite par le Chef de la Circonscription scolaire ou le service de l’organisation scolaire et de la prévision de la Direction Départementale.
À bien observer le tableau n°1, aucune classe n’a un effectif inférieur à 15 écoliers. De plus la deuxième condition est loin d’être satisfaite pour qu’une nécessaire compression soit prononcée. Donc, on peut avancer sans risque d’être démenti par des faits que les normes régissant la fusion ne sont pas respectées. Et, à la faveur des décisions des conseils consultatifs nationaux, des complexes scolaires qui étaient à quatre groupes sont réduits à deux. D’autres n’en sont plus. Les classes deviennent ainsi surchargées. Les effectifs passent de 55 élèves à 105, de 65 à 90 voire 120 selon les départements et les communes.
Ainsi, par rapport à l’école, les deux régimes ont des visions différentes. Les représentations du bien public ne sont pas partagées de la même manière. La dernière ne s’inscrit pas dans la continuité de la seconde et cherche à défaire systématiquement ce que la majorité précédente a commencé. Les Écoles Normales d’Instituteurs sont fermées en attendant leur réouverture pour de nouvelles réformes. Après des années passées sans recrutement, l’aspiranat est devenu le mode d’accès à l’enseignement. De là deux logiques contradictoires s’affrontent : D’un côté il y a la restriction et le contrôle des dépenses budgétaires liées à l’éducation qui procèdent à des compressions et de l’autre, la scolarisation massive avec le recrutement d’enseignants.
Les parents d’élèves et les enseignants peuvent-ils prendre position face à de telle réforme ? La loi sur le droit de grève a été revue. Les enseignants qui par le passé de par leur action collective peuvent mettre à mal le système éducatif sont réduits dans leurs mouvements syndicaux. Les parents et leurs enfants ne font que subir.
Est-ce de mauvaise foi ? Certainement pas. Ne disposant de ressources économiques financières pour recruter de nouveaux maîtres, les politiques se mettent dans la logique de restriction et de contrôle des dépenses budgétaires en procédant à ces compressions compte tenu de leur position. Les écoliers et leurs parents subissent de fait de l’asymétrie du pouvoir.et de contrôle des dépenses budgétaires en procédant à ces compressions compte tenu de leur position. Les écoliers et leurs parents subissent de fait de l’asymétrie du pouvoir.
Conclusion
La formation continue des instituteurs en République du Bénin se fait de plusieurs façons selon les catégories d’instituteurs. Les « sacs au dos », c’est-à-dire ceux qui n’ont jamais fait une école normale de formation sont pris en compte par l’état central pendant les vacances ou les congés avec un programme défini. Les stagiaires communément appelés normaliens sont nourris progressivement aux expériences des aînés à travers les unités pédagogiques. Les visites de classe par le réseau d’animation pédagogique participent de la formation. Les besoins en formation s’expriment à travers ces instances.
L’enquête présentée dans le présent article met en relief un certain nombre d’éléments problématiques. L’expression des besoins en formation exprimée à travers les pratiques de classe et les entretiens relèvent de deux tendances : mineures et majeures. Les instituteurs mettent en avant la lecture. Les écoliers n’arrivent pas à lire. Si une minorité arrive à le faire, la compréhension des textes est très pénible. Cette situation complique les autres enseignements car c’est d’elle que dépendent le déroulement et l’aboutissement des autres champs de formation ainsi que l’acquisition des contenus notionnels y afférent. Ce faisant, des séquences sont reportées voire abandonnées. La réforme curriculaire par l’Approche Par les Compétences de par sa complexité est à la base de cet échec. Les jeunes du métier ne préparent pas la classe mais décrient la pléthore des effectifs. Les classes surchargées occupent la grande partie du corpus des discours des instituteurs approchés. À cet effet, ils demandent un accompagnement pédagogique et didactique. La planification des activités pédagogiques aussi pose problème. Elle fait partie du prescriptif mais les nouveaux entrants foulent aux pieds ces normes en faisant le nécessaire pour pouvoir survivre dans l’organisation.
Les normes de l’École de Qualité Fondamentale fixant le ratio écolier/maître est rarement respecté dans la plupart des salles de classes. Les cas où les compressions, fusions sont prononcées, d’après les textes législatifs, ne sont pas respectés par les politiques publiques. Elles ne se conforment pas à ces exigences mais s’autorisent à faire des jumelages de groupes pédagogiques. Il en ressort que l’expression des besoins en formation continue n’est qu’une affaire de représentation sociale. Les jeunes instituteurs pensent que la planification et la préparation sont à mettre en position subordonnée. Au nom des restrictions budgétaires, les politiques fusionnent les groupes pédagogiques et participent du fait à la pléthore des effectifs dans la classe. Toutes choses qui ne permettent pas d’optimiser les apprentissages scolaires.
Références bibliographiques
ABRIC Jean-Claude, 1987, Coopération, compétition et représentations sociales, Cousset, Delval, 275 p.
ALLADAKAN Agbodjinou Germain, 2014, Dynamiques sociales autour du pilotage des réformes éducatives dans l’enseignement primaire de 1972 à 2014, Thèse de Doctorat Unique, UAC.
ALLADAKAN Agbodjinou Germain, 2015, « La formation des instituteurs à l’APC au Bénin : enjeux et pratiques d’acteurs », in Geste et voix, n°21, Université d’Abomey-Calavi, pp. 253-271.
ALTET Marguérite, 2002, « Une démarche de recherche sur la pratique enseignante : l’analyse plurielle », in Revue française de pédagogie, 138, INRP Paris pp. 85-93.
ARDOUIN Thierry, « Chapitre 5. Les besoins en formation », dans : Ingénierie de formation. Intégrez les nouveaux modes de formation dans votre pédagogie, sous la direction d’Ardouin Thierry. Paris, Dunod, « Formation », 2017, pp. 79-95, in https://www.cairn.info/ingenierie-de-formation–9782100769421-page-79.htm.
ASTOLFI Jean-Pierre et al. 1997, Mots-clés de la didactique des sciences. Repères, définitions, bibliographies, Bruxelles, De Boeck.
BOURGEOIS Éric, 1991, « L’analyse des besoins de formation dans les organisations. Un modèle théorique et méthodologique », in Mesure et évaluation en éducation, 14(1), 17-60, Google Scholar.
CHEVALLARD Yves, 1991, La transposition didactique. Du Savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage, 2ème édition.
DENNERY Marc, 2006, Piloter un projet de formation, Paris, ESF.
DEROUET Jean-Louis, 1992, École et justice. De l’égalité des chances aux compromis locaux ?, Paris, Métaillé.
DEROUET Jean-Louis et DUTERCQ Yves, 1997, L’établissement scolaire, autonomie locale et service public, Paris, ESF.
DURKHEIM Émile, 1925, L’éducation morale,Paris, Presses Universitaires de France.
ETZIONI Amitai, 1969, The Semi-Professions and their Organization: Teachers, Nurses, Social workers, New York, The Free Press.
HUBERMAN Michael, 1989, La vie des enseignants. Évolution et bilan d’une profession,Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé.
GARNIER Maurice, 2008, Les écoles efficaces au Bénin : étude diagnostique de mai 2008, Porto-Novo, INFRE.
JARROUX Pauline, 2015, « Du gendarme au Conseiller ? Le corps d’encadrement et les visites de classe dans l’administration scolaire au Bénin », in Colloque international sur Gouverner l’École aux Suds : Acteurs, Politiques et pratiques, Cotonou, APAD.
LAUWERIER Thibaut, BRÜNING Marie et AKKARI Abdeljalil, 2013, « La qualité de l’éducation de base au Bénin : la voix des acteurs locaux », in Recherches en éducation, Modalités de leadership et indices de variations de climat dans les établissements scolaires, n°15, Université de Nantes, pp. 120-136, in http://journals.openedition.org/ree/7368,
DOI : https://doi.org/10.4000/ree.7368, en ligne, 15 | 2013, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 19 juin 2021.
Le BOTERF Guy, 1990, Ingénierie et évaluation des compétences, Paris : Éditions d’Organisations.
LESNE Marcel, 1977, L’analyse des besoins en formation, Paris, Robert Jauze.
PERRENOUD Philippe, 1993, « Former les maîtres primaires à l’Université : modernisation anodine ou pas décisif vers la professionnalisation ? », in Hensler, H. (dir.), La recherche en formation des maîtres. Détour ou passage obligé sur la voie de la professionnalisation ?, Sherbrooke (Canada), Éditions du CRP, pp. 111-132.
PERRENOUD Philippe, 1993 b, La formation au métier d’enseignant : complexité, professionnalisation et démarche clinique, Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
POSTIC Marcel, 1981, Observation et formation des enseignants, Paris, PUF.
PEREZ-ROUX Thérèse (Tisou), LANEELLE Xavière, 2013, « Entrer dans le métier sans formation professionnelle : quels processus, identitaires pour les enseignants du secondaire ? », in Identités professionnelles en crise, Recherche et Formation n°74, pp. 29-42, en ligne 74/2013, mis en ligne le 28 avril 2016, in http://journals.openedition.org/Rechercheformation/2121,
DOI : 10.4000/rechercheformation2121, consulté le 15 janvier 2022.
ROEGIERS Xavier, WOUTERS Pascale et GERAUD François Marie, 1992, « Du concept d’analyse des besoins en formation à sa mise en œuvre », in Formation et technologies. Revue européenne professionnels de la formation, vol.1, n°2-3, Louvain-la-Neuve, BIEF, pp. 32-42.
ROEGIERS Xavier, 2007, Analyser une action d’éducation ou de formation, Paris, Bruxelles, De Boeck Université.
LE TERRORISME ISLAMISTE SUR LA BALANCE DE LA PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES
Issoufou COMPAORÉ
Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)
Résumé :
Historiquement il semble difficile de dissocier les religions révélées de l’usage de la violence qui les accompagne. Pourtant la violence n’est pas l’essence des religions révélées. Cette affirmation est vraie pour le Judaïsme et le Christianisme, mais elle est aussi vraie pour l’Islam. Toutefois, la violence terroriste tente aujourd’hui d’élire domicile au sein de la religion musulmane. Cette tentative de domiciliation de la violence terroriste au sein d’une religion qui se réclame pacifique dans son essence même, nous rappelle l’histoire de la religion chrétienne durant la période du Moyen-âge. Le Christianisme a aussi connu, durant le Moyen-âge, la violence. Cette violence était utilisée par l’Église soit pour défendre des causes purement religieuses (la chasse aux sorcières, les croisades), soit pour défendre des causes politiques (la nuit de la Saint Barthélémy), ou soit enfin pour défendre des causes scientifiques (le phénomène Galilée). Cependant contre la violence qui sévissait dans la religion chrétienne, la philosophie des Lumières a joué un rôle décisif. Elle s’est constituée comme une véritable thérapie face à la connotation chrétienne de la violence religieuse, étant donné qu’elle a réussi à changer non seulement la représentation que les hommes se faisaient de la religion, mais aussi la place qu’occupait la religion dans la société. Dès lors ce moyen de médication qui avait été utile pour contenir la violence religieuse au sein du Christianisme, pourrait-elle servir encore aujourd’hui contre le terrorisme islamiste ? C’est dans cette logique que s’inscrit ce présent écrit qui ambitionne de critiquer le visage actuel de la violence religieuse, à savoir le terrorisme islamiste, par le truchement de la philosophie des Lumières. Autrement dit, il est question de montrer les vertus qu’offre la philosophie des Lumières face au terrorisme islamiste, ce qui implique en même temps de mesurer l’actualité de la philosophie des Lumières. Tel est le problème central autour duquel s’articule ce présent écrit.
Mots-clés : Islam, Philosophie, Religion, Terrorisme, Violence.
Abstract :
Historically, it seems difficult to dissociate revealed religions from the use of violence that accompanies them. Yet violence is not the essence of revealed religions. This statement is true for Judaism and Christianity, but it is also true for Islam. However, terrorist violence today tries to take up residence within the Muslim religion. This attempt to domiciliate terrorist violence within a religion that claims to be peaceful in its very essence, reminds us of the history of the Christian religion during the period of the Middle Ages. Christianity also experienced violence during the Middle Ages. This violence was used by the Church either to defend purely religious causes (the witch hunt, the crusades), or to defend political causes (the night of Saint Bartholomew), or finally to defend scientific causes (the Galileo phenomenon). However, against the violence that raged in the Christian religion, the philosophy of the Enlightenment played a decisive role. It has constituted itself as a real therapy in the face of the Christian connotation of religious violence, since it has managed to change not only the representation that men have of religion, but also the place occupied by religion. in the society. Could this means of medication, which had been useful in containing religious violence within Christianity, still be used today against Islamist terrorism? It is in this logic that this writing fits, which aims to criticize the current face of religious violence, namely Islamist terrorism, through the philosophy of the Enlightenment. In other words, it is a question of showing the virtues offered by the philosophy of the Enlightenment in the face of Islamist terrorism, which implies at the same time measuring the relevance of the philosophy of the Enlightenment. This is the central problem around which this present work is articulated.
Keywords : Islam, Philosophy, Religion, Terrorism, Violence.
Introduction
« Nous vivons », s’il faut reprendre le mot de Laurent Bibard (2016, p. 9), « dans un monde extrémiste. » Autrement dit, l’humanité semble développer un certain amour pour les extrémités. Cet amour trouve sa manifestation phénoménologique dans les domaines de la politique, de la science et enfin, mais non des moindres, de la religion. Dans le domaine de l’activité politique, nous assistons de plus en plus à l’émergence de l’extrémisme, qui se traduit par le culte exagéré des idéologies et par le développement du messianisme politique. En outre le domaine économique subit, lui aussi, cette tendance extrémiste. Ici elle se traduit par la surexploitation des ressources naturelles et par l’expansion du capitalisme. Par ailleurs les activités scientifique et technique demeurent, elles aussi, sous l’emprise du penchant de l’homme pour les extrémités. La technoscience est portée par le besoin d’accroître l’efficacité de l’homme dans la nature. Mais ce besoin atteint des proportions inquiétantes dès lors que les référentielles axiologiques censées guider les activités des savants sont de plus en plus mises entre parenthèses.
C’est donc dans un contexte d’extrémisme ambiant que le terrorisme islamiste se développe aujourd’hui et atteint des proportions inquiétantes. Or, l’Islam s’est constitué originairement comme une religion du juste milieu comme l’atteste le verset 143 de la sourate 2 du Coran. Dans ce verset on peut lire en substance ce qui suit : « Et nous avons fait de vous une communauté impartiale… ». Au contact de cette vérité révélée il apparaît que l’Islam n’est pas une religion extrémiste. Par conséquent le terrorisme islamiste, conséquence logique et nécessaire de l’extrémisme, n’est pas la vérité de l’être de l’Islam. La relation qui existe entre l’Islam et le terrorisme n’est jamais nécessaire. Elle est plutôt le fruit d’un certain nombre de contradictions nées, pour la plupart, du processus de socialisation de la religion musulmane. Ces contradictions se manifestent à la fois à travers la représentation que des musulmans se font de certaines vérités révélées, mais aussi par la représentation qu’ils se font de la modernité. Si le terrorisme islamiste apparaît comme une imposture au sein de la religion musulmane, il devient tout à fait légitime de mettre en examen cette imposture afin de mieux cerner ses origines mais aussi et surtout les solutions par la médiation desquelles les musulmans pourront s’éloigner de cette forme pernicieuse de représentation de la foi musulmane. L’instrument qui est utilisé ici pour mener la critique du terrorisme islamiste est la philosophie des Lumières qui est justement une philosophie critique par excellence. Ainsi, nous serons amenés à examiner les questions suivantes : d’une part quels sont les modes d’être du terrorisme et qu’est-ce qui spécifie le terrorisme islamiste ? De plus, qu’est-ce qui explique et, a fortiori, justifie le terrorisme islamiste ? Enfin, la philosophie des Lumières peut-elle servir, comme ce fut le cas au XVIIIe siècle, l’humanité actuelle contre l’hydre terroriste ? Les solutions développées par la philosophie des Lumières pour contrer l’extrémisme violent qui avait réussi à s’implanter dans la religion chrétienne, peuvent-elles être reconduites pour vaincre l’hydre terroriste de notre époque ? En termes simples, en quoi la philosophie des Lumières nous parle-t-elle aujourd’hui face à l’expansion du terrorisme islamiste ? Pour résoudre ces questions, nous allons mobiliser un certain nombre d’outils méthodologiques tels que la méthode historique, sociocritique et analytique.
Dès lors l’objet de cette analyse se dessine autour de trois points nodaux. D’une part, il sera question d’analyser la phénoménologie du terrorisme, afin de mieux saisir le sens du terrorisme islamiste. Dans un second temps, nous nous attèlerons à démontrer les raisons qui se situent derrière le terrorisme islamiste. Enfin, notre analyse nourrira l’ambition de démontrer l’actualité de la philosophie des Lumières face au terrorisme islamiste.
1. De la pluralité des formes de terrorismes
Il n’est pas du tout aisé de cerner le sens et les contours exacts du concept de terrorisme. Le terrorisme est un mot protéiforme qui possède plusieurs connotations si bien qu’il serait abusé de le réduire à la simple connotation religieuse.
De prime abord, le terrorisme pourrait désigner la commission d’actes violents par un groupe d’individus non reconnu par l’État de droit. Dès lors la violence terroriste est frappée d’illégalité même si elle peut se réclamer d’une certaine légitimité. Les modalités de cette violence sont diverses : elles vont des attentats aux prises d’otages. David Cumin (2020, p. 13) résume bien cette approche en ces termes : « Factuellement, « terrorisme » désigne la commission d’attentats ou de prises d’otages par des individus, bandes, groupuscules ou réseaux. ». La nature du terrorisme varie en fonction des revendications qui accompagnent ces violences. S’agit-il d’une revendication purement politique ? Ou s’agit-il encore d’une revendication politico-religieuse ? Ou s’agit-il enfin d’une revendication purement religieuse ? En fonction de la nature de la revendication, la violence terroriste peut viser soit l’imposition d’une idéologie politique (c’est les cas de l’IRA irlandaise, l’ETA basque, les FARCS colombiennes, le nazisme), elle peut aussi avoir pour mission de rétablir une justice écologique (l’écologisme et l’écoterrorisme), enfin elle peut avoir comme fonction d’imposer une foi commune ou, à défaut, une certaine vision de la foi (salafisme, djihadisme, « Lohami Cherut Israël » ou « les combattants pour la libération d’Israël »). Au-delà de ces multiples visées, nous pouvons soutenir avec David Cumin que les terroristes « partagent une conviction de base : la « philosophie de la bombe », « de la mitraillette » ou « du couteau », c’est-à-dire la croyance que l’action violente aura un impact psychologique décisif, qu’elle sera un acte de communication plus efficace que la parole ou l’écriture publiques. » (Ibid. 19) Au contact de cette affirmation, il apparaît que le terrorisme conserve, pour l’essentiel, le même moyen d’expression à savoir la violence et surtout une violence qui se veut dans une large mesure létale.
Au regard de ces considérations, il appert que ce qui définit le terrorisme, c’est, pour l’essentiel, à la fois le caractère illégal de la violence et le caractère illégal des groupes qui l’expriment. Cette illégalité en question est fonction du droit positif. Ce qui suppose qu’en dehors du droit positif, il ne serait pas exagéré de dire que les groupes terroristes se réclament d’une certaine forme de légitimité (légitimité religieuse) et que leur violence pourrait, elle aussi, se réclamer de la même légitimité. C’est l’une des raisons, et non des moindres, pour lesquelles l’opinion internationale préfère le mot terrorisme en lieu et place du mot djihadisme. Cette appellation est censée permettre de mieux cerner la différence qui existe entre Islam et terrorisme, même si les usages vulgaires tendent à confondre djihadisme et terrorisme. Il est vrai que le terroriste se définit assez souvent comme un djihadiste mais il est connu historiquement que le djihadisme désigne, dans son essence, le combat contre soi-même, c’est-à-dire contre ses propres penchants, ses propres passions. C’est ce que le Prophète de l’islam a désigné sous le nom plus connu dans certains milieux de « djihad al-Akbar ». Dans la littérature arabe cette expression signifie le « grand djihad »
2. Sur les origines du terrorisme islamistes
Il est incontestable, au regard de l’actualité du terrorisme, que la religion musulmane incarne le visage actuel du terrorisme. Cette relation qui se noue progressivement entre Islam et terrorisme pourrait s’expliquer à la lumière de deux faits : le premier est l’existence au sein de l’Islam de crises internes, ce qui suppose que l’Islam serait en crise avec lui-même, c’est-à-dire avec son être propre. Le second fait réside dans les crises qui existent et qui persistent entre l’Islam et la modernité.
2.1. Les crises internes à l’Islam
Historiquement la première crise qui a secoué l’Islam est le problème du califat. Cette terminologie est forgée à partir du mot calife, mot qui signifie « successeur » ou « représentant ». La question du califat s’est posée justement après la mort du Prophète de l’Islam. Suite à ce décès, le problème de la succession va se poser laissant apparaître deux tendances antagonistes entre les « sahaba » ou les compagnons du Prophète : l’une pour qui la succession devrait revenir à Ali ibn Talib et l’autre avec à sa tête Muawiya qui ne reconnait pas justement le califat de Ali ibn Talib. Ces deux tendances allaient s’affronter lors de la première grande bataille qui a opposé les musulmans entre eux. Il s’agit de la bataille de Siffin qui s’était déroulée vers l’an 657 de notre ère et qui s’est soldée par plusieurs morts (45.000 morts environ dans le camp de Muawiya et 25.000 morts dans le camp de Ali ibn Talib). La guerre de succession qui a éclaté au sujet du califat va engendrer une fissure profonde entre les musulmans désormais repartis en deux idéologies qui s’opposent : l’idéologie sunnite et l’idéologie chiite. Les premiers reconnaissent les quatre califes qui se sont succédés depuis Abou Bakr jusqu’à Ali ibn Talib, tandis que les seconds ne reconnaissent que le califat de Ali ibn Talib. On pourrait retenir en substance que c’est au sein même de l’Islam que s’est exprimé pour la première fois un acte terroriste d’une violence sans précédent.
Si le problème du califat dénote d’une crise interne à l’Islam, crise qui dispose l’Islam à accueillir plus tard la violence terroriste, ce n’est pas du simple fait des guerres de succession qu’il a occasionnées mais aussi du fait que le problème du califat porte, dans une certaine mesure, la paternité lointaine d’une idéologie politique se réclamant de l’Islam. Or, l’Islam ne s’est pas défini au départ comme une religion dont l’ultime visée est de se constituer comme une idéologie politique. Il est vrai que si nous saisissons la politique comme l’art de gouverner les hommes en vue de leur épanouissement, il ne serait pas impossible de conférer une dimension politique à l’Islam. La mission du Prophète Mahomet visait, il est vrai, à construire une foi pure débarrassée du polythéisme ambiant ainsi que de ses avatars. Mais à côté de cette mission régalienne, le Prophète a également gouverné une communauté (la Oumma ou la communauté des musulmans unie autour de la foi commune et indépendamment de leurs clivages ethniques, biologiques, économiques) avec ce que tout cela comporte comme implications à savoir : promouvoir un idéal de justice, fixer des impôts, signé des traités de paix etc. Au regard de ce fait avéré, on peut bien concilier Islam et politique. Cependant, cette dimension politique ne signifie pas nécessairement que le Prophète entendait développer un système politique à proprement parlé, au même titre que la démocratie ou que le totalitarisme par exemples. Le besoin de fonder une idéologie politique au sein de l’islam commence à voir jour avec l’avènement du califat. C’est à partir de ce moment que certains musulmans vont commencer à nourrir l’ambition de s’organiser autour d’un chef et plus tard autour d’un véritable système politique régi par des principes de la foi musulmane. Ainsi, l’idée d’un islamisme entendu comme « une idéologie plutôt récente qui fait de l’islam une politique qui peut être violente » (S. B. Diagne, 2019, p. 138), tire une partie de sa substance dans la question du califat.
En plus du problème du califat, la question d’un mouvement de l’Islam et dans l’Islam, mouvement par lequel la religion musulmane serait appelée à s’adapter aux réalités anthropologiques, sociologiques, économiques et politiques du moment, va se poser comme un problème engendrant à l’occasion une crise interne. Cette crise prend ses origines à partir de la naissance du mouvement de la Nahda. Historiquement la Nahda est un mouvement de renaissance arabo-musulman apparu vers la fin du XVIIIe siècle et qui a pu évoluer au XIXe et au début du XXe siècle. Cette renaissance a concerné d’abord les domaines de la littérature, de l’art, de la politique et ensuite de la religion. Pour ce qui est de cette dernière, le projet de renaissance consiste dans les faits à moderniser l’Islam. En fait il s’était agi de considérer les enseignements issus du Coran et de la Sunna (Livre contenant les enseignements du Prophète Mahomet) comme des objets capables de mouvement mais non simplement comme des vérités statiques et incapables de répondre aux besoins du moment. Il est évident que cette tentative de modernisation de l’Islam est mue par le postulat suivant lequel les enseignements de l’Islam ne devraient pas être purement intemporels ce qui les rendrait inactuels. Il est donc besoin de procéder à une relecture de ces enseignements sans jamais perdre de vue les contextes sociologiques de leur révélation. C’est alors qu’à côté du mouvement de la Nahda et contre ce mouvement que va naitre le fondamentalisme musulman. D’après Rogozinski (2017, p. 105) « le fondamentalisme musulman est apparu au début du XXème siècle comme une réaction contre la Nahda, le mouvement de « renaissance » qui avait essayé de réformer et de moderniser l’islam en l’adaptant à l’époque contemporaine ». Le fondamentalisme est porté par des idéologies plus anciennes telles que le salafisme et le wahabisme. Pour mieux cerner le fondamentalisme, il est donc intéressant de revenir sur les enseignements essentiels de ces deux idéologies.
Le salafisme, beaucoup plus ancien que le wahabisme, est apparu au XIVe siècle de notre ère. La thèse centrale de l’idéologie salafiste se résume à l’affirmation selon laquelle les grands traits de la religion musulmane ont été déjà annoncés par le Prophète et ses compagnons si bien que nous ne pouvons rien légiférer pour ce qui concerne les domaines du culte, du social, de l’économie, en dehors de ce qui a été transmis par le Prophète et ses compagnons. C’est pour cette raison que la littérature arabe utilise le mot salafisme pour désigner les prédécesseurs, les devanciers. Par extension les salafistes sont ceux qui suivent ou qui obéissent aux prédécesseurs. C’est dans la même veine que s’inscrira plus tard le wahhabisme. Fondé au cours du XVIIIe siècle par Mohamed Ben Abd Al Wahhab, le wahhabisme se réclame de l’héritage du salafisme. Il suggère aussi de purifier la foi musulmane en extirpant ce qu’elle aurait accumulé en dehors des enseignements transmis par le Prophète et ses compagnons. On comprend que le salafisme tout comme le wahhabisme se démarquent par leur rigorisme, c’est-à-dire par une sorte de rigidité sévère face au respect des enseignements du Coran et de la Sunna. Ces idéologies ont influencé et continuent d’influencer des branches terroristes telles que Al-Qaïda, le GSIM. Leurs objectifs étant de purifier l’Islam en espérant refonder un Islam d’une autre époque. L’attitude du salafiste qui n’est pas différente de celle du wahhabite consiste à agir comme s’il avait le monopole de la vérité, et en matière de piété, il incarnerait un modèle vers lequel devrait tendre tout homme. Il en découle donc un rejet, voire une haine de la différence. Bachir Diagne (2019, p. 151) résume très bien cette attitude en ces termes :
Si vous pensez en salafiste, vous pourriez excommunier tout le monde, puisque toute manière de faire autre que la vôtre vous semblera une infidélité. La conséquence en sera une posture d’exil intérieur au sein d’une société dont vous estimez qu’elle a perdu les bons repères et s’est éloignée de l’exemple premier.
On l’aurait sans doute compris, le besoin de moderniser l’Islam a induit une tendance au contact de laquelle se nourrit le terrorisme islamiste.
Pour finir, il serait légitime d’ajouter que les crises internes à l’Islam sont aussi l’expression de son rapport avec son passé. L’Islam est en crise car il ne parvient pas jusque-là à faire le deuil de son passé. S’il est vrai, comme le soutien Abdenour Bidar (2004, p. 34), qu’il existe « chez tout musulman, une répugnance, culturellement très enracinée, à toucher aux principes traditionnels », alors on pourrait affirmer que l’Islam est une religion encline à préserver scrupuleusement ses valeurs passées. Cette relation avec le passé qui se nomme aussi passéisme, est sous-tendue par la croyance très répandue selon laquelle l’Islam aurait eu un passé très glorieux et que ses moments de gloire représentent son Âge d’or. L’Islam serait, du point de vue de son histoire, marqué par un passé qui célèbre sa noblesse et sa royauté. Ce n’est qu’avec le temps et par le fait de la modernité qu’il a fini par perdre cette noblesse. Cet enracinement dans le passé met le musulman en conflit avec lui-même et avec les autres. Entre son désir, en tant qu’être humain donc en tant qu’être doué de raison, de se projeter vers un avenir et conséquemment de s’ouvrir au changement d’une part, et d’autre part son désir de s’attacher à un passé glorifié, le musulman se trouve tiraillé et son être se trouve fondamentalement déchiré. Il n’est plus en harmonie avec lui-même, son monde intérieur est marqué par un désordre qui tant à croître. Le musulman éprouve un sérieux souci à contenir ce désordre intérieur. Aussi une telle situation laisse-t-elle la possibilité à certains groupes d’individus, au dessein tout autant lugubre que malicieux, de copter ce désordre intérieur au profit d’une violence qui n’est que le reflet d’un tel désordre. La violence terroriste est perçue ici comme l’expression du passéisme et la volonté de restaurer la gloire perdue.
2.2. L’Islam face à la modernité
Aux côtés des crises internes à l’Islam on peut dénoter une autre crise, relativement nouvelle : il s’agit de la révolte contre la modernité. Cette révolte ne relève pas de l’être de l’Islam mais elle est plutôt imputable à la représentation que certains musulmans se font de la modernité. La période moderne s’étend du XVe au XVIIIe siècle. Ce furent trois siècles durant lesquels on a pu observer des changements importants dans les domaines des sciences, des arts, de la religion et de la politique. Mais, si la période moderne dans son ensemble a été marquée par des changements notoires, il faudrait tout de même accorder une mention spéciale au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières a su bien porter les grandes idées qui ont marqué la modernité. Ces idées se résument pour l’essentiel à la consécration de l’homme comme sujet autonome. Dès lors, le souci majeur de la modernité a été d’affirmer le primat du sujet dans les domaines de la politique, des arts, de la science et de la religion.
Durant la période des Lumières, il avait été donné d’observer que l’agir politique devrait désormais accorder une grande place à l’homme entendu comme sujet autonome. C’est cette prise en considération de la liberté intrinsèque et inaliénable de l’homme qui incite Rousseau à définir la démocratie comme l’idéologie politique la plus soucieuse du respect de la dignité de l’homme, laquelle dignité réside justement dans la liberté. Ce qui implique que la démocratie, entendue comme une idéologie politique par et pour la liberté, est un héritage de la modernité.
Conformément à l’esprit dominant dans la modernité, l’activité scientifique va elle aussi tenter de libérer les savoirs de tous les obstacles culturels et cultuels. Si, durant la longue période du Moyen-âge, la science est restée sous la tutelle de la religion, la modernité va se démarquer de cette attitude, il faut l’avouer, dangereuse pour le progrès de la pensée libre. Nous devons alors rendre justice à la modernité en lui accordant la paternité de la science telle que nous la connaissons aujourd’hui.
De même, la religion (il s’agit notamment du Christianisme) porte elle-aussi l’empreinte de la modernité, elle qui, pendant longtemps, n’a cessé d’asservir l’homme et a, pour ainsi dire, développé une approche trop anthropo-pessimiste de l’humanité. Contre cette attitude, la période moderne va ramener la foi à la simple perspective humaine, faisant ainsi de l’homme le criterium de mesure de la foi. Cette nouvelle approche débouchait soit sur une foi rationnelle (Kant), soit sur un déisme (Voltaire), ou soit sur un athéisme (Baron d’Holbach).
Au regard de ces considérations, on peut comprendre déjà en filigrane les raisons pour lesquelles certains musulmans entretiennent des rapports difficiles avec la modernité, rapports qui pourraient justifier la naissance du terrorisme islamiste. D’entrée de jeu on pourrait remarquer que les deux autres religions abrahamiques ont réussi à mieux intégrer les désiderata de la modernité. Dans le Judaïsme aussi bien que dans le Christianisme, la liberté de l’homme se trouve moins asphyxiée que dans l’Islam. « L’islam », insiste Abdennour Bidar « n’a pas dépassé ce tabou fondamental, ni suffisamment fait l’expérience de cette liberté morale typiquement moderne qui permet de tout remettre en question. » (Ibidem, p. 34) Dès lors, la question se pose de savoir en quoi le rejet de la liberté et conséquemment de la modernité dispose l’Islam à accueillir la violence terroriste.
C’est justement parce que le rejet de la modernité, par certains musulmans, s’accompagnent presque toujours du rejet de la démocratie, de la science moderne, et de l’approche moderne de la religion. Ces musulmans ont du mal à se faire à l’idée que la démocratie est de loin la meilleure idéologie politique qui soit. Pour eux, la démocratie représente la cause des malheurs du monde. Il en est ainsi, car elle incarne non seulement le visage de l’Occident chrétien et elle accentue aussi les inégalités et les injustices sociales à travers le libéralisme qu’elle promeut. Quoi de plus normal alors que l’avènement d’une société plus juste passe par la destruction pure et simple de la démocratie et de ses avatars. De ce fait, le terrorisme islamiste se nourrit de ces ressentiments contre la démocratie.
D’autre part, si l’hostilité à la modernité alimente aujourd’hui la violence terroriste c’est aussi du fait que certains musulmans ne sont pas prêts à accepter l’orientation moderne de la science. La libération de la science des chaines de la religion, passe mal au sein de certaines idéologies musulmanes telles que le salafisme et le wahhabisme. Les adeptes de ces idéologies sont restées, pour la plupart, fondamentalement conservateurs. Leur conception de la vérité tient toujours la science en respect vis-à-vis des vérités religieuses. Les vérités révélées dans le Coran et les vérités enseignées par le Prophète de l’Islam doivent toutes demeurer, d’après ces croyants, des archétypes vers lesquels devraient tendre les vérités scientifiques. De plus, si ces musulmans rejettent la conception moderne de la science, c’est parce qu’ils sont angoissés par le pouvoir que l’activité scientifique offre à l’homme. Ils craignent que le pouvoir de la science ne finisse par donner l’illusion à l’homme quant à son statut face au Créateur. Mais ils craignent aussi que la science ne finisse par porter atteinte à des valeurs traditionnelles longtemps enseignées au sein de ces idéologies. D’où le besoin de faire barrière à la science moderne et à ses relais (l’école, les enseignants) à travers le terrorisme islamiste. Dans ce registre on comprend aisément pourquoi le terrorisme islamiste livre un combat acharné contre la science moderne. Il espère transformer la méfiance à l’endroit de la science, rencontrée dans certains milieux, en une véritable haine contre les savoirs et donc en un obscurantisme.
Enfin la société moderne est soupçonnée par certains musulmans d’être celle qui annonce un éloignement de l’homme d’avec la religion du fait de la liberté qu’elle promeut. Ces musulmans opposent une résistance à la modernité à cause des dangers que représente la conception moderne de la liberté pour la religion. Il faut craindre, d’après ces derniers, que la liberté parvienne à altérer la conception traditionnelle de l’Islam et introduise pour ainsi dire toutes sortes d’innovations dans l’activité religieuse. En cultivant la liberté, on développe par la même occasion le goût de la création et de l’innovation. Création et innovation n’ont pas de place dans une approche qui emprisonne la religion dans le passéisme. En fait, ces musulmans ne semblent pas perméables à l’idée d’une religion de la liberté d’où le combat contre la modernité. Cette religion de la liberté pourrait, dans leur entendement, à la longue, susciter des formes de contestations et de révoltes contre certaines pratiques en place dans l’Islam. En somme, le soupçon que certains musulmans font peser sur la modernité est largement suffisant pour justifier leur engagement au profit du terrorisme islamiste. La noblesse de la cause est telle qu’elle légitime le rejet sans concession de la modernité. Il appert alors que, du fait des représentations que certains musulmans se font de l’Islam, cette religion constitue, malgré elle-même, aujourd’hui le principal foyer de résistance à la modernité. Ce qui la rend vulnérable aux séductions des groupes terroristes qui espèrent justement manipuler les crises qui sévissent entre certains musulmans et le monde moderne au service d’une violence mortifère.
3. La philosophie des Lumières ou le salut de l’Islam face au terrorisme islamiste
Nos considérations antérieures ont permis de montrer que même si l’Islam n’est pas une religion terroriste dans son être propre comme le croiraient les islamophobes, il reste qu’elle est aux prises à des crises internes et externes qui rendent favorables la domiciliation de la violence terroriste. Au regard de la nature de ses crises, une réforme profonde s’impose comme un impératif. Cette réforme en question n’entend point s’attaquer aux fondements ultimes de la révélation. La réforme dont il est question ici est réforme des représentations que certains musulmans se font de leur religion d’une part et aussi réforme des représentations qu’ils se font de la modernité. L’instrument de cette réforme est la philosophie des Lumières.
Penser la philosophie des Lumières comme l’instrument d’une réforme dans l’Islam apparaît d’abord comme une entreprise risquée car cela reviendrait à analyser une religion à partir d’un instrument (la philosophie des Lumières) qui semble étranger à cette religion. Mais renoncer à ce projet c’est nier aussi le caractère universel du discours philosophique. Ce que la philosophie des Lumières à représenter pour la religion chrétienne, alors qu’elle était confrontée au fanatisme de certains adeptes, pourrait avoir la même valeur pour la religion musulmane. Or, si la philosophie des Lumières a été d’un grand secours pour le Christianisme c’est du fait de sa dimension critique et de l’humanisme qu’elle développe. La dimension critique trouve un écho favorable à travers ces mots de Monique Castillo (2007, p. 37) :
Le siècle des lumières voit dans la croyance un formidable instrument d’aliénation en même temps que l’un des matériaux dont est fait notre rapport au monde. Ce siècle a également jeté les bases d’une démarche sceptique et positiviste qui condamne la croyance en la rejetant hors de la légalité scientifiquement.
Ces mots de Monique Castillo supposent justement que la philosophie des Lumières se constitue dans une large mesure comme une critique de la religion. C’est à partir de cette critique qu’elle a réussi à barrer la route au dogmatisme qui sévissait dans la religion chrétienne. Et, il semble qu’en empruntant le même chemin par lequel une réforme des représentations que les hommes se faisaient du christianisme durant cette époque a été possible, on pourrait aussi mener à bien le projet de réforme des représentations que certains musulmans se font de l’Islam. Il s’agit dès lors d’une véritable éducation des musulmans qui serait à même de développer une attitude dépassionnée vis-à-vis de la religion musulmane. Si les musulmans veulent protéger leur religion contre les assauts du dogmatisme (dogmatisme et violence terroriste sont intimement liés), il faudrait qu’ils entreprennent une auto-critique. Cette auto-critique qui rappelle justement l’auto-critique de la raison instituée par Kant dans la Critique de la raison pure. L’auto-critique dont il est ici question aurait pour finalité de montrer que l’Islam n’est pas une religion auto-suffisante et passéiste qui, pour ces raisons, serait coupée de toute relation avec l’extérieur, retranchée sur elle-même, et hostile au changement. Autrement dit, cette auto-critique permettrait de trouver au sein de l’Islam des dispositions pour le changement et des dispositions en faveur d’une ouverture à l’altérité. Dans l’architecture du Coran on rencontre cet appel à l’ouverture vers l’extérieur étant donné justement que le Coran est permanemment en dialogue avec les autres religions abrahamiques. Le Coran ne perçoit pas les messages véhiculés par la Thora et par la Bible comme des énoncés d’une foi différente, mais des différents énoncés d’une même foi. Par exemple les sourates 12, 14, et 71 du Coran, pour ne citer que celles-là, relatent respectivement les histoires des Prophètes Abraham, Joseph et Noé. Dans ce sens, le Coran nous enseigne implicitement que l’Islam est une religion ouverte, en dialogue ou en attente de dialoguer avec les autres religions sœurs. Mais pour découvrir cette richesse insoupçonnée, il ne suffit pas d’une lecture littérale des textes qui y sont contenus mais plutôt une véritable lecture critique. C’est donc à partir d’une approche critique de leur religion que les musulmans pourront rompre le cordon qui lie leur religion au terrorisme.
Mais la réforme dans l’Islam ne doit pas seulement emprunter de la philosophie des Lumières leur attitude critique. Elle doit aussi leur emprunter leur devise. Si les Lumières ont bien une devise, elle pourrait se résumer en ces mots : liberté, égalité et tolérance. Ces mots représentent l’ossature des valeurs humanitaires promues par la modernité. Ce qui implique alors que la réforme ici entendue pourrait s’inspirer de l’humanisme des Lumières. Il est attendu des musulmans qu’ils se fassent siens l’humanisme des Lumières. Cette attente implique que certains musulmans pourraient se réapproprier les valeurs de liberté, d’égalité, et de fraternité qui semblaient avoir disparus faute d’une lecture critique des enseignements de l’Islam. L’Islam n’est pas étranger aux valeurs de liberté, d’égalité, et de fraternité comme une certaine lecture littérale le laisserait croire. Dès lors qu’il est possible de lire dans le coran cette vérité suivant laquelle « Nulle contrainte en matière de religion. » (Coran, sourate 2, verset 256) alors, il serait possible d’affirmer que l’Islam n’est pas fondamentalement une religion liberticide. Elle accorde plutôt la liberté de choisir, indépendamment de toute contrainte. L’adhésion à l’Islam et la pratique des cultes doivent, elles aussi, faire l’objet d’un choix libre. De même l’Islam, contrairement à une certaine interprétation, ne prône pas la supériorité des hommes sur la base de leur foi. La parole de Dieu, telle qu’elle se manifeste dans le Coran, espère enseigner aux musulmans que les adeptes du christianisme et du judaïsme, couramment appelés les gens du Livre, ne sont pas et ne sauraient être des mécréants ou des Cafre (Les mécréants). À ce propos on peut lire dans la sourate 28 ce qui suit : « Ceux à qui, avant lui [le Coran], nous avons apporté le Livre, y croient » (Coran, sourate 28, verset 52). Au contact de cette vérité révélée il apparaît que le Coran reconnait les gens du Livre (chrétiens et juifs) comme des croyants mais jamais simplement comme des mécréants. Cette reconnaissance qui se traduit aussi par de nombreux passages du Coran consacrés à la narration de la vie et de la mission de certains Prophètes (Abraham, Noé, Joseph),ambitionne de montrer que l’Islam espère se constituer comme une synthèse des deux religions révélées. L’Islam ne rejette pas la différence, elle l’intègre et tente de la dépasser. Après tout, le propre de toute synthèse n’est point d’exclure ou de rejeter les antinomies, mais plutôt de les concilier. Une telle approche se veut être un véritable appel à l’égalité et partant à la tolérance. Il apparaît alors que la réforme des représentations que certains musulmans se font de l’Islam, dans ses rapports avec lui-même, qu’avec la modernité, à partir de la philosophie des Lumières, demeure une condition par laquelle ces musulmans pourront découvrir ou redécouvrir les notions de liberté, d’égalité et de tolérance comme des valeurs enseignées pendant longtemps par l’Islam mais malheureusement mal comprises ou peu comprises.
Conclusion
Partout où sévit le terrorisme islamiste, que ce soit en Amérique (le 11 septembre 2001 par exemple), ou en Afrique (les attaques terroristes sur l’avenue Kwame Nkrumah au Burkina Faso et de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire), il reste toujours mu par les mêmes causes : réinstaurer un Islam d’une autre époque ; imposer un certain ordre politique ; et combattre les progrès de l’activité scientifique. Peu importe donc la teneur de la violence terroriste, qu’il s’agisse d’une bombe placée dans un métro ou dans un supermarché, ou qu’il s’agisse d’une fusillade dans une école ou dans une salle de cinéma, les causes, elles, demeurent presque toujours invariables. Les causes qui justifient la violence terroriste sont telles, qu’elles nous rappellent une violence d’une autre époque : il s’agit de la violence qui sévissait dans le Christianisme durant le Moyen-âge. Il existe en effet une similarité entre ces violences qui ont élu domicile dans deux religions sœurs que sont le Christianisme et l’Islam. C’est pour cette raison que notre présente réflexion s’est destinée, dès l’entame, à analyser l’antidote par la médiation duquel les adeptes de la foi chrétienne ont réussi à occire la violence qui prenait des propensions dangereuses dans leur religion. Cet antidote est justement la philosophie des Lumières et il nous semblait possible de démontrer que la même médication pourrait permettre aussi aux musulmans de se débarrasser de la violence terroriste.
Au soir de notre réflexion, il est apparu qu’il y a bien un intérêt à revenir sur une philosophie vielle de près de trois siècles. Ce qui confère à la philosophie des Lumières toute son actualité c’est bien l’esprit critique qui la définit et l’humanisme qu’elle promeut. Car c’est au prix d’une critique des représentations que certains musulmans se font de l’Islam, dans son double rapport avec lui-même et avec la modernité, qu’ils pourront exorciser, de leur religion, la violence terroriste. Et l’esprit critique des Lumières est un archétype, et non des moindres, à partir duquel il sera possible de mener au bout la critique ici entendue. De plus, une véritable éducation aux valeurs telles que la liberté, l’égalité et la tolérance, doit accompagner impérativement aujourd’hui les musulmans issus de certains milieux. Or ces valeurs représentent les points nodaux de l’humanisme des Lumières. D’où l’intérêt de revenir sur cet humanisme dans notre combat contre l’hydre terroriste.
Cependant, notre entreprise est tout de même osée si on prend considération le fait que la philosophie des Lumières est tout de même en déphasage avec les fondamentaux de l’Islam et que les critiques qui s’y dégagent concernent surtout la religion Chrétienne. De plus, il faut faire remarquer que l’humanisme des Lumières est trop anthropocentrique. Ce qui pourrait rendre difficile l’éducation aux valeurs que défendent la philosophie des Lumières. Une telle éducation risquerait d’aggraver les contradictions qui existent dans l’Islam. Par conséquent, face au terrorisme islamiste, faudrait-il, peut-être, définir un néo-criticisme et un néo-humanisme qui empruntent de la Philosophie des Lumières son esprit critique et son humanisme mais sans jamais les reproduire intégralement.
Références bibliographiques
BRAGUE Rémi et DIAGNE Bachir Souleymane, 2019, La controverse : Dialogue sur l’islam, Paris, Stock.
BIBARD Laurent, 2016, Terrorisme et féminisme, Paris, l’Aube.
BIDAR Abdennour, 2004, Un islam pour notre temps, Paris, Seuil.
BRÉHIER Émile, 2004, Histoire de la philosophie, Paris, P.U.F.
CASSIRER Ernst, 1966, La philosophie des Lumières, Trad. Pierre QUILLET, Paris, Fayard.
CASTILLO Monique, 2007, La responsabilité des modernes, essai sur l’universalisme kantien, Paris, Krimé.
CUMIN David, 2018, Le terrorisme : 20 points clés, Paris, Ellipses.
DIAGNE Bachir Souleymane, 2013, Comment philosopher en islam ? Paris, Jimsaan & Rey.
FARHAD Khosrokhavar, 2003, Les nouveaux Martyrs d’Allah : champs, Paris, Flammarion.
GIRARD René, 1972, La Violence et le sacré, Paris, Grasset.
IDRISSA Rahmane, 2018, Islam et politique au sahel : Entre persuasion et violence, Niamey, EPGA.
KANT Emmanuel, 1980, Critique de la raison pure, Trad. Alexandre J. L. DELAMARRE et François MARTY, Paris, Gallimard.
La Bible de Jérusalem, 1961, Paris, Éditions du Cerf.
Le Coran, 1980, Trad. Denise MASON, Paris, Folio.
MORGENSZTERN Isy, 2011, L’aventure monothéiste : judaïsme, christianisme, islam : ce qui les rapproche, ce qui les distingue, Paris, La découverte.
ROGOZINSKI Jacob, 2017, Djihadisme : Le retour du sacrifice, Paris, Desclée De Brouwer.
ROY Olivier, 2012, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil.