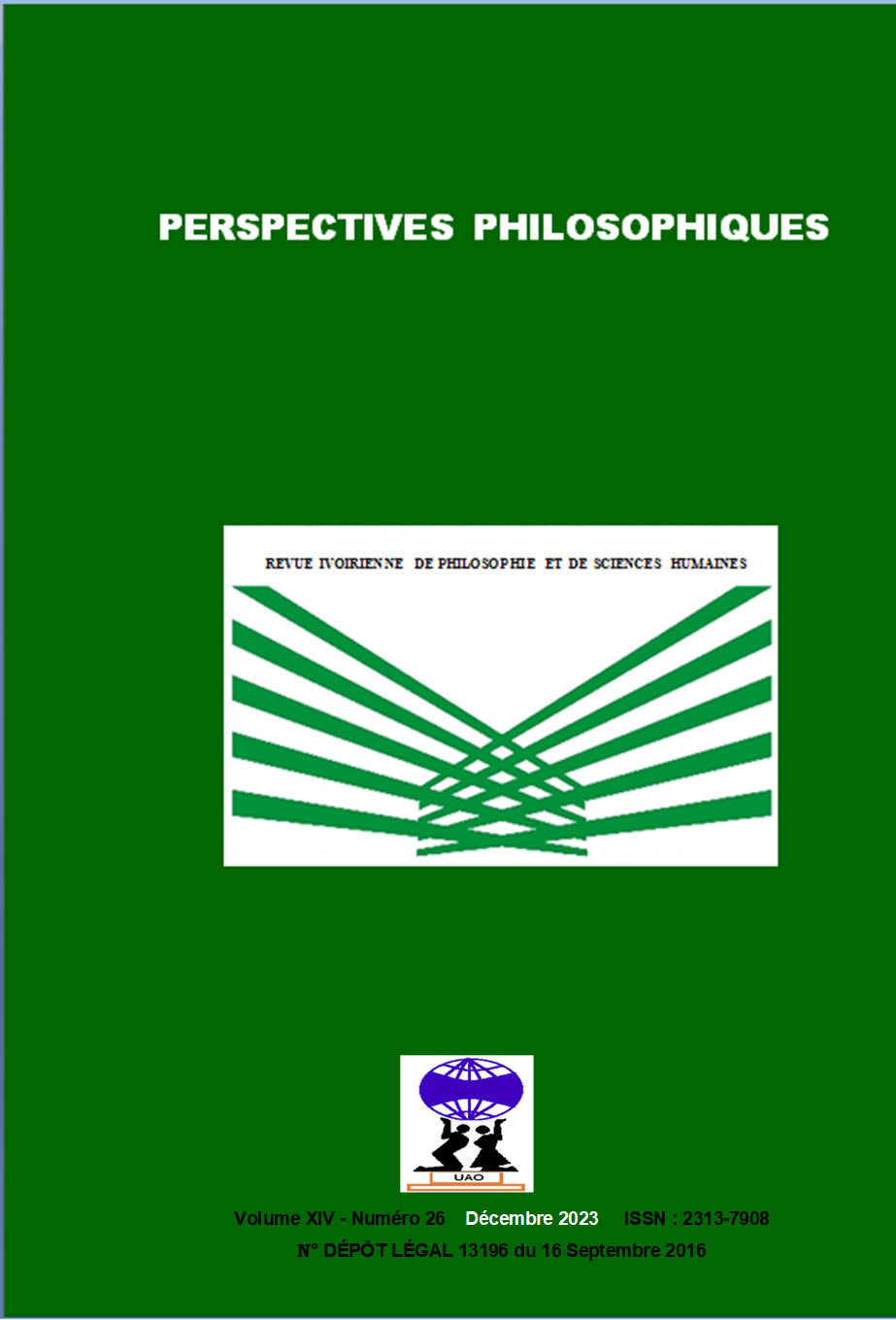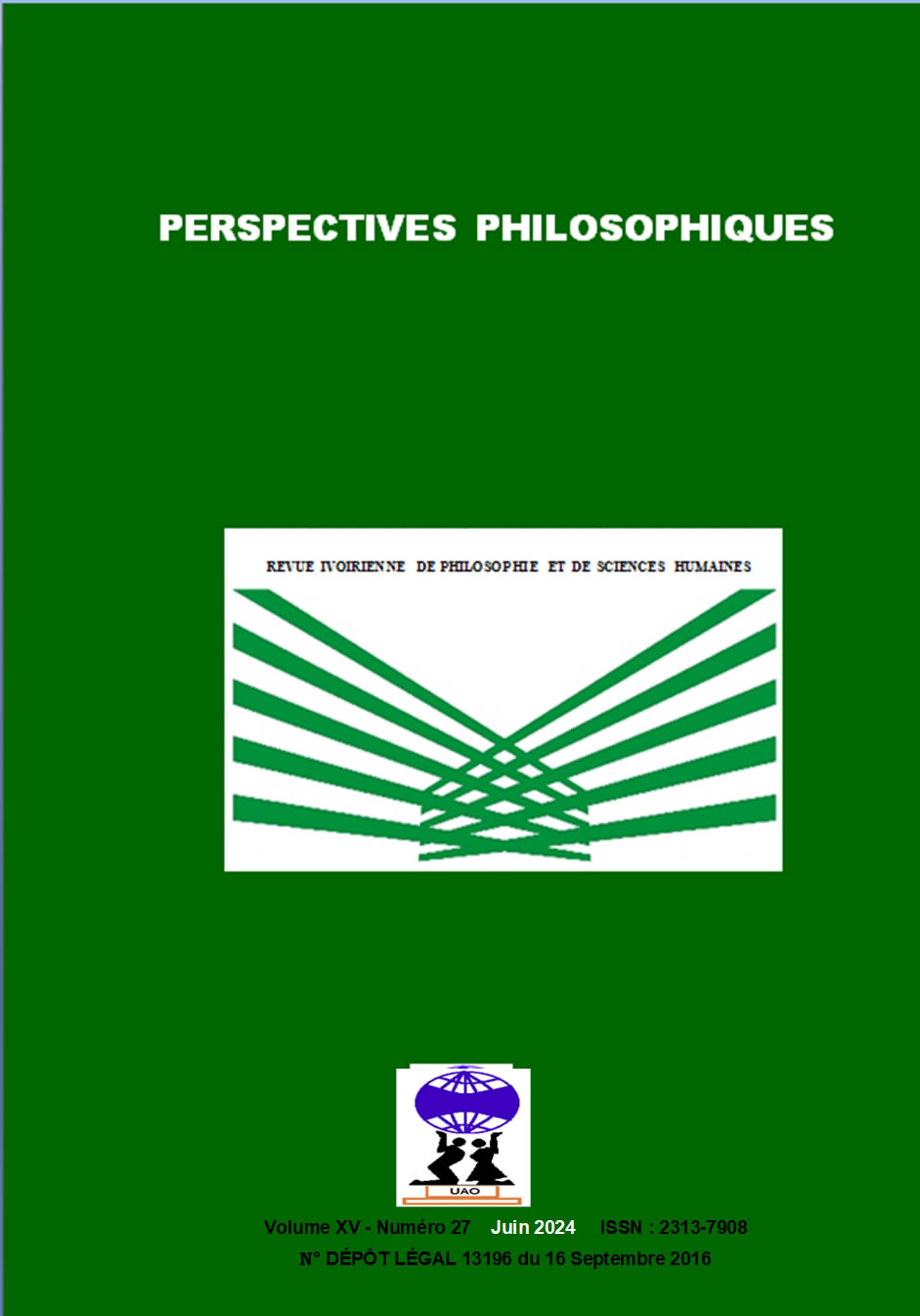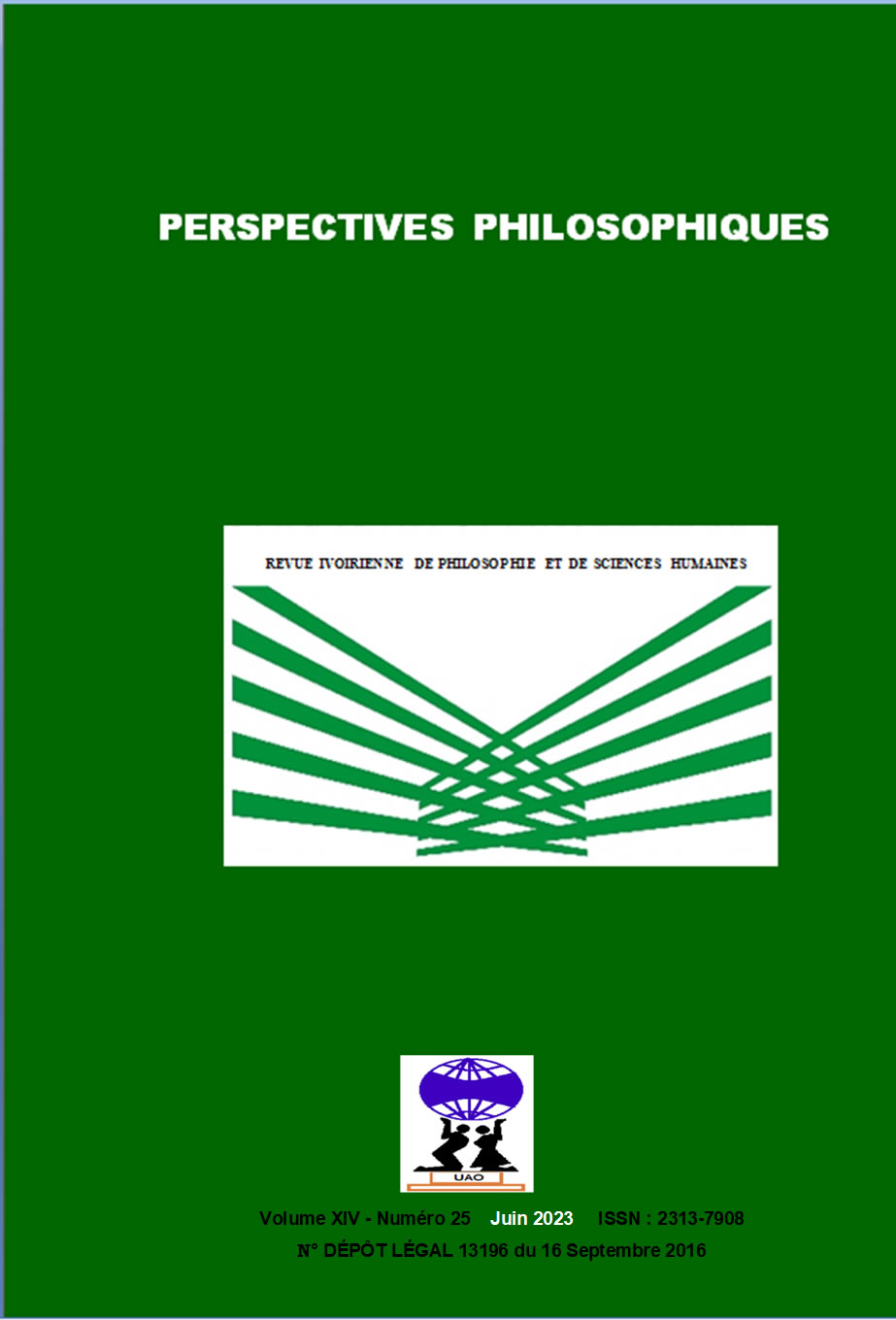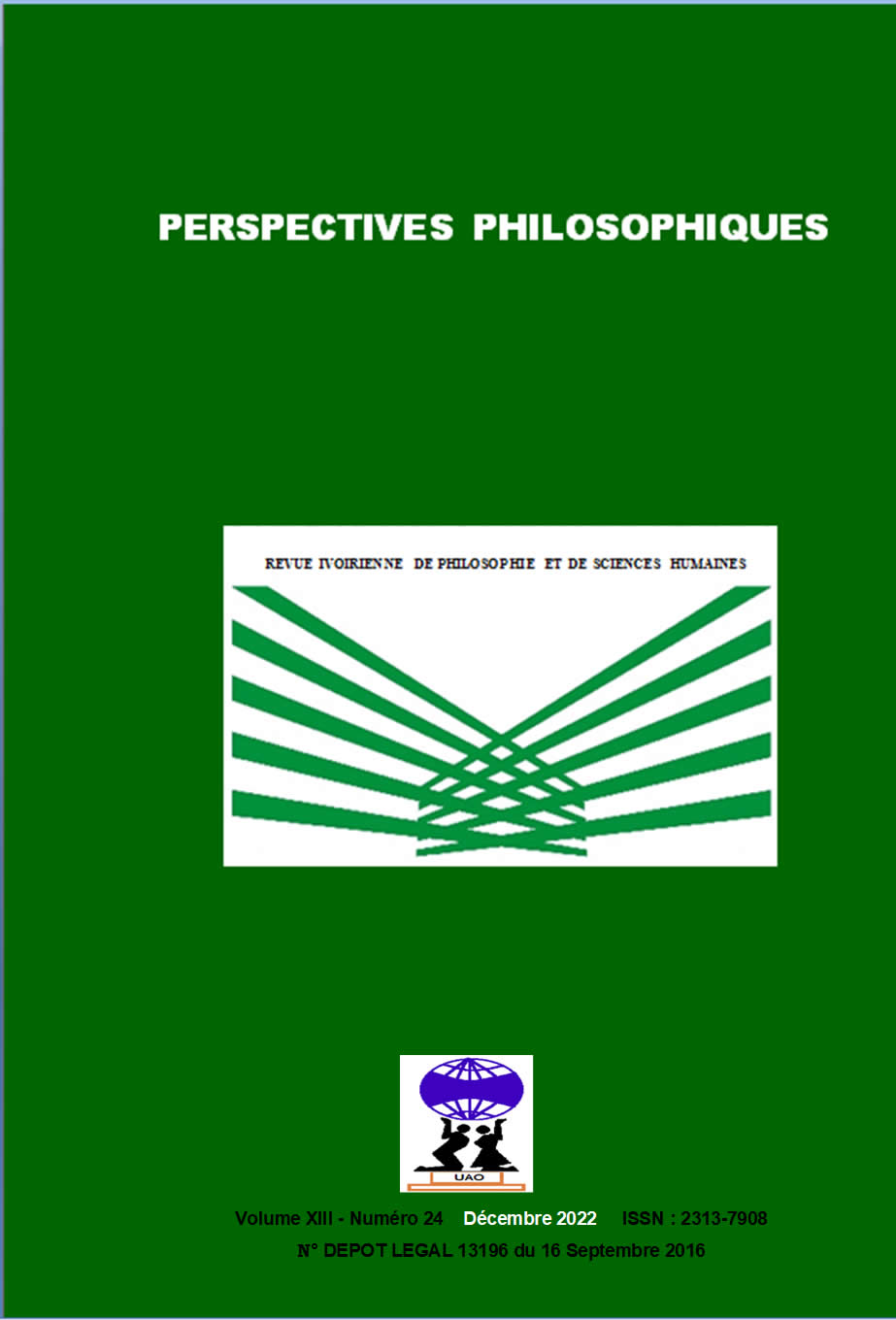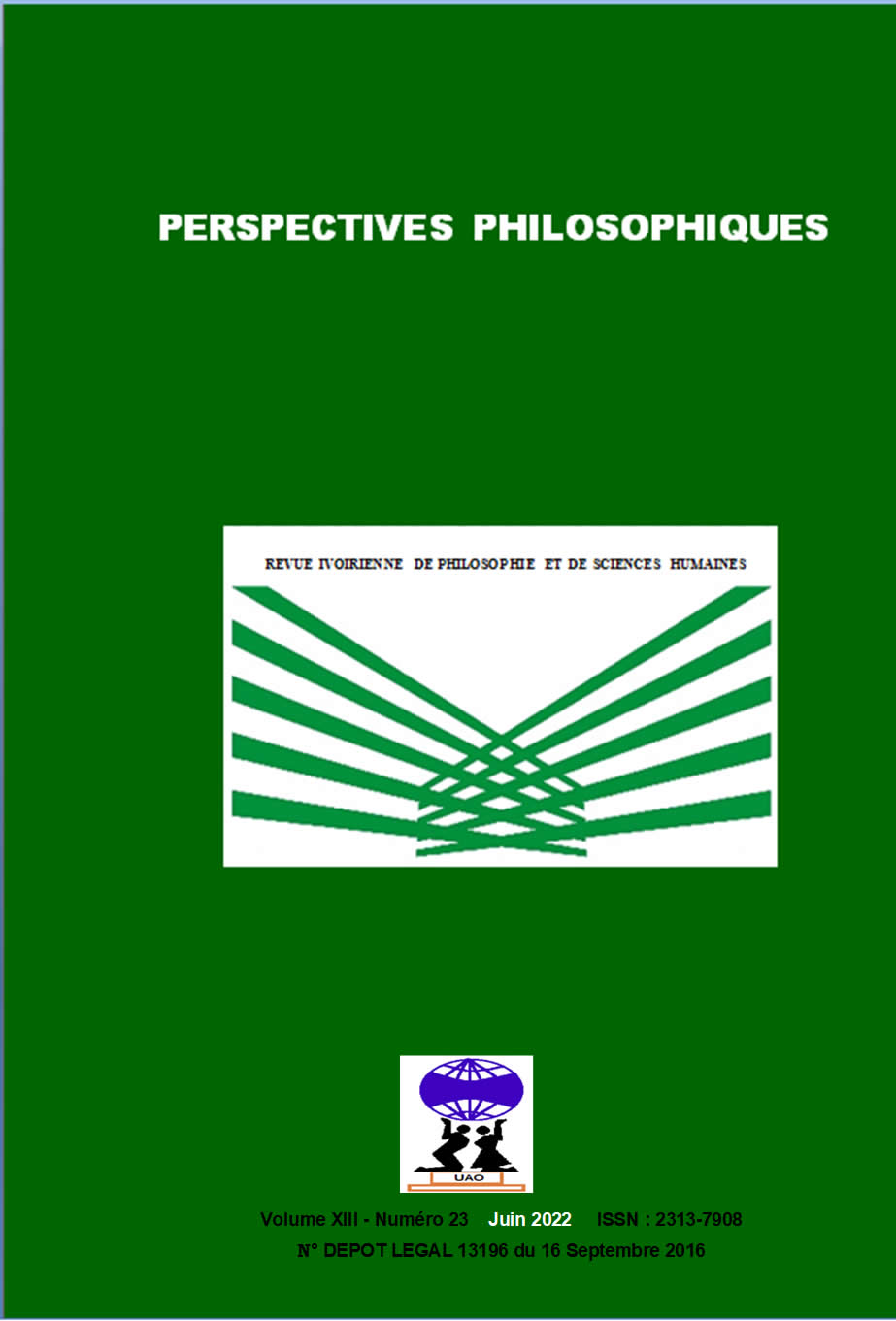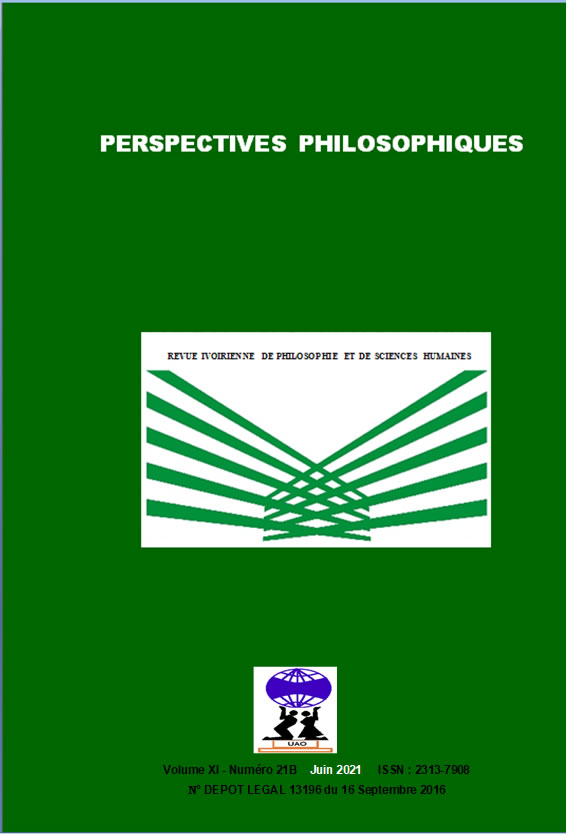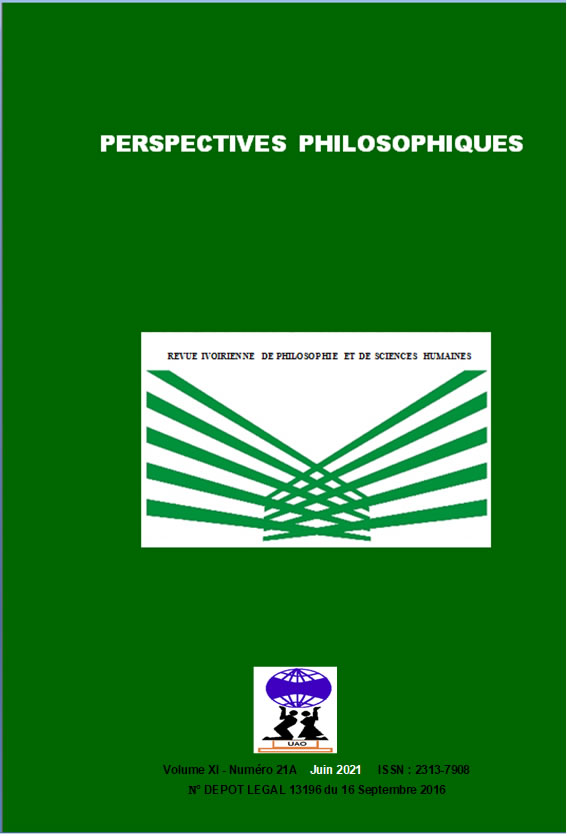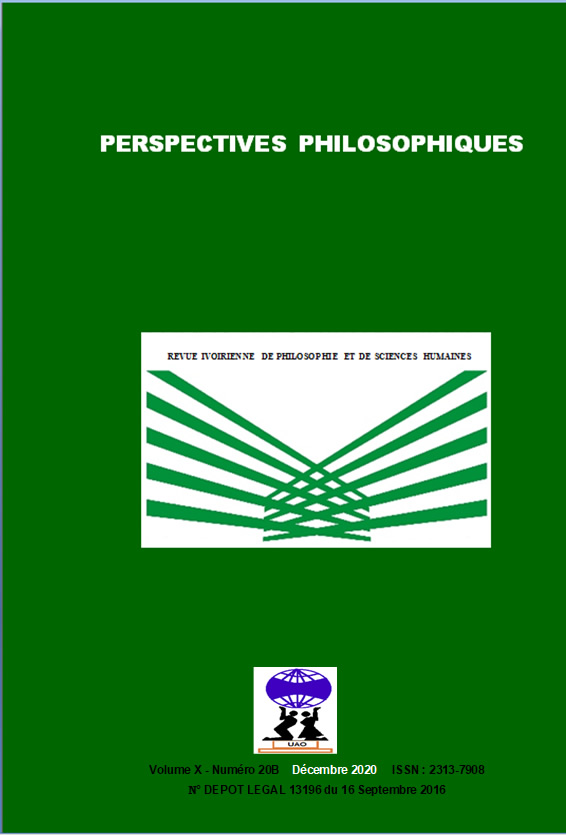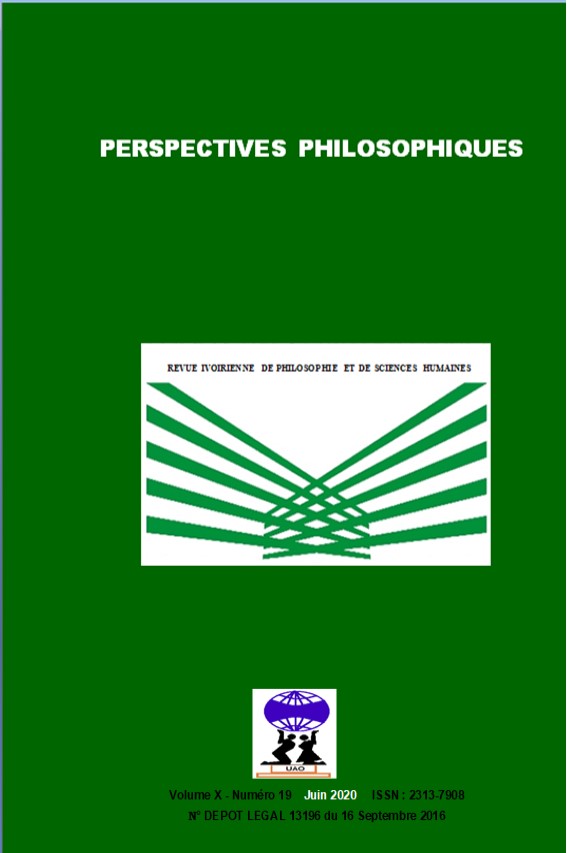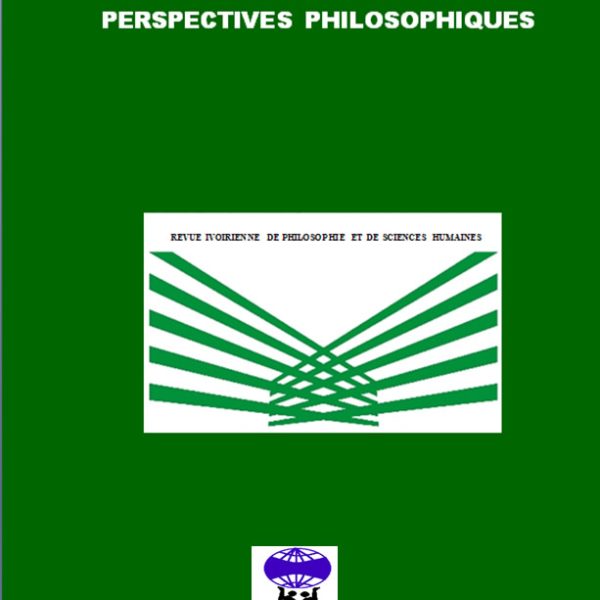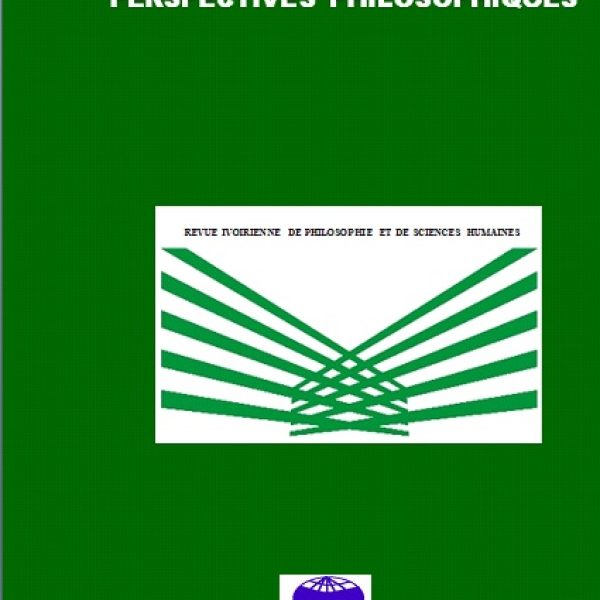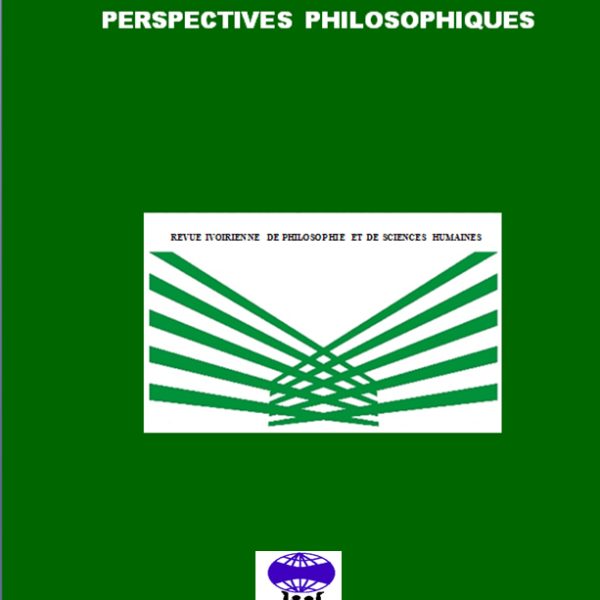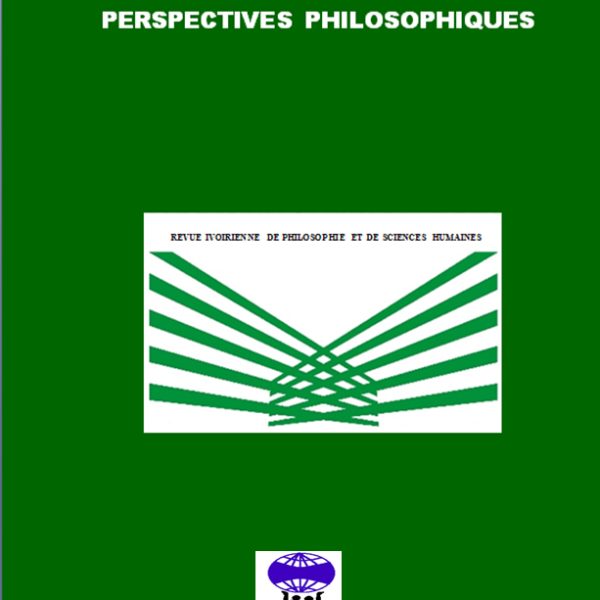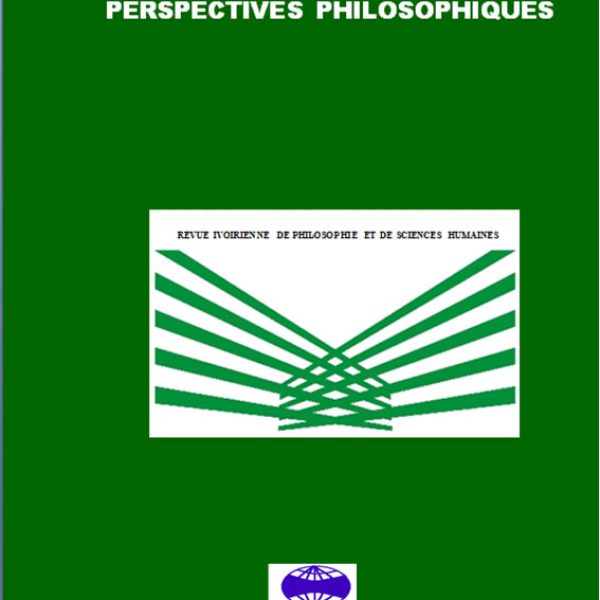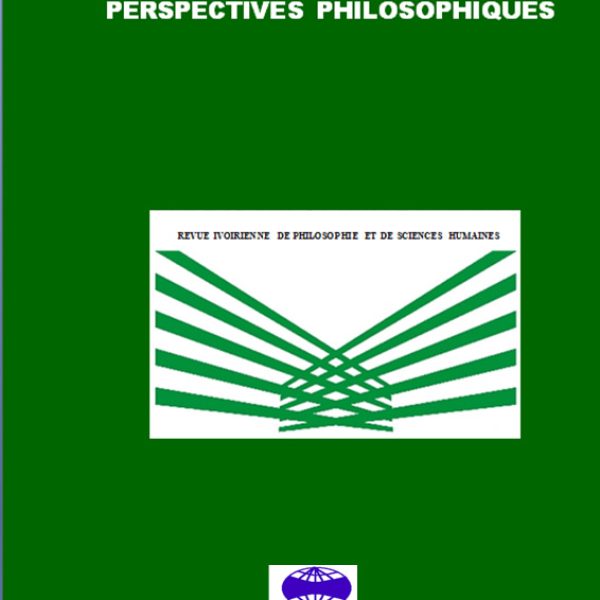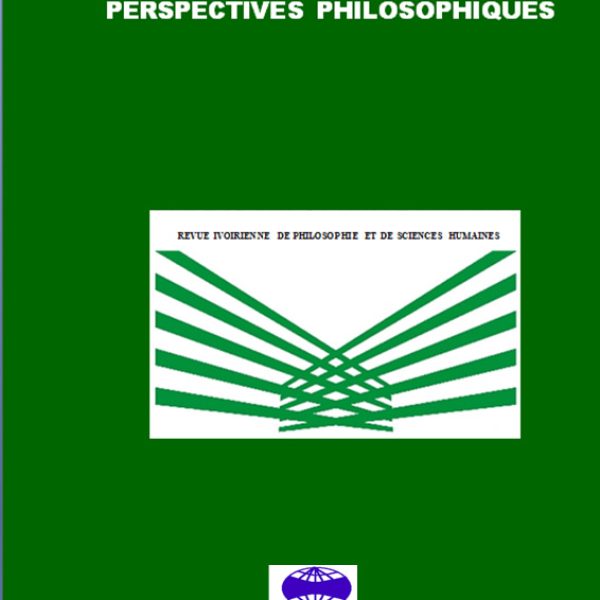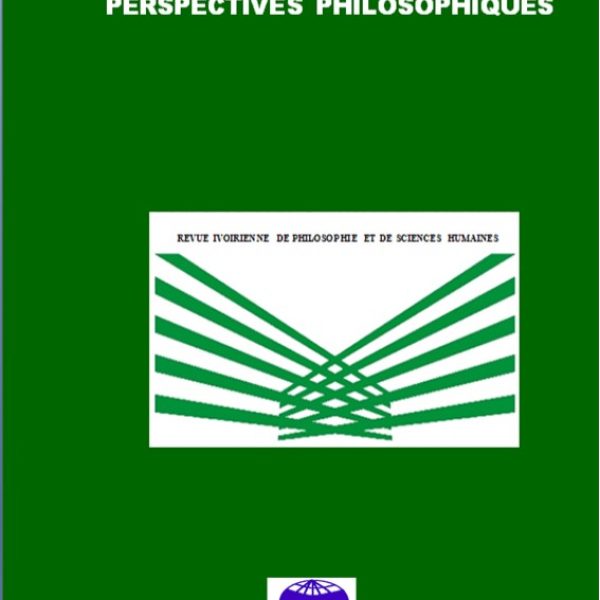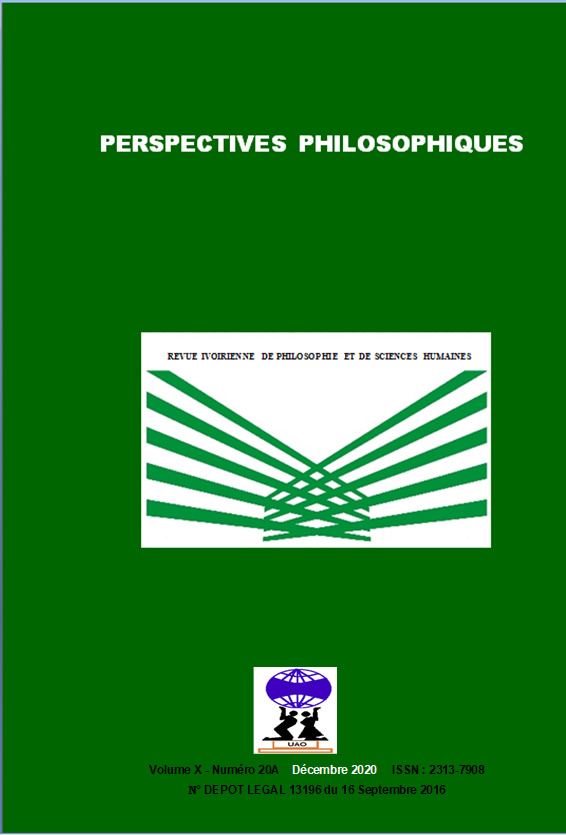
| Volume X – Numéro 20A Décembre 2020 ISSN : 2313-7908N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : https://www.perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Prof. N’dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités
Rédacteur en chef Adjoint : Prof. Assouma BAMBA, Professeur des Universités
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane OUATTARA
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. N’Dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Prof. Abou SANGARÉ, Professeur des Universités
Dr. Donissongui SORO, Maître de Conférences
Dr Alexis KOFFI KOFFI, Maître-Assistant
Dr. Kouma YOUSSOUF, Maître de Conférences
Dr. Lucien BIAGNÉ, Maître de Conférences
Dr. Nicolas Kolotioloma YEO, Maître-Assistant
Secrétaire de rédaction : Dr. Blé Sylvère KOUAHO, Maître de Conférences
Trésorier : Dr. Grégoire TRAORÉ, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités
1. La critique de Sénèque contre la vaine érudition,
Koffi ALLADAKAN …………………………………………………….………..………1
2. Ontologie et politique chez Spinoza,
Assanti Olivier KOUASSI et Koffi Azoumanan YAO …………………………..17
3. Continuité et discontinuité dans la monade leibnizienne,
Mireille AlatheBODO ………………………………………………………………..35
4. Le statut de la morale dans le communisme de Marx et Engels,
Gbotta TAYORO ………………………………………………………..…………….53
5. Les implications sociales de la révolution sexuelle revendiquée par Herbert Marcuse et Wilhelm Reich,
Blédé SAKALOU ……………………………………………….…..….……….…….72
6. Dans l’univers de l’analyse pragmatique du langage,
Franck Viviane BEUGRÉ ……………………………………..………………….…91
7. Féminité, une identité à redéfinir,
Djakaridja KONATÉ …………………………………………………………………..106
8. Ethnies et pratiques constitutionnelles chez les akan matrilinéaires (Le cas des Nzima),
Diamoi Joachim AGBROFFI …………………………………………..……..….125
9. Facteurs explicatifs de l’inappétence intellectuelle des apprenants du Collège Saint Augustin de Cotonou,
Guillaume Abiodoun CHOGOLOU ODOUWO, Serge ArmelATTENOUKON, FlorentineAKOUÉTÉ-HOUNSINOU ………………………………………….….….155
10. Ethnicisation et désethnicisation du débat politique en Côte d’Ivoire,
Frederic Kouassi Touffouo PIRA …………………………………………………182
11. L’écriture engagée dans Tout grand vent est un ouragan de Charles Nokan : pour une analyse stylistique et rhétorique des passions,
Ernest AKPANGNI ……………………………………………………………….….203
12. Pratiques autobiographiques dans La Mémoire amputée de Werewere Liking: une stratégie de subversion générique,
Kouamé Jean-François EHOUMAN …………………………………………….223
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
LA CRITIQUE DE SÉNÈQUE CONTRE LA VAINE ÉRUDITION
Koffi ALLADAKAN
Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Résumé :
Sénèque, après avoir tiré à boulets rouges sur la civilisation de son temps, a condamné les intellectuels dont la vie est en parfaite dysharmonie avec les règles de vie qu’ils prescrivent. Selon lui, toute érudition serait vaine si l’homme ne se prend pas au sérieux sur le plan éthique. Ce qui semble intéressant chez le stoïcien c’est que, avant de rappeler à ceux qui ont appris la philosophie comme un métier mercenaire en quoi consiste véritablement la sagesse, il a montré que nous n’étudions pas réellement pour la vie mais malheureusement pour la salle de conférences. Convaincu que la qualité d’un homme dépend plus de ses mœurs que de ses connaissances, Sénèque a exhorté tout homme à devenir non seulement celui qui sait mais surtout celui qui agit bien. Il accorde, par conséquent, la priorité à l’apprentissage du métier d’homme en vue du progrès moral.
Mots-clés : Érudition, immoralité, rhétorique, stoïcisme, vertu.
Abstract :
Seneca, after firing red bullets at the civilization of his time, condemned the intellectuals whose life is in perfect harmony with the rules of life they prescribe. According to him, any scholarship would be in vain if man did not take himself seriously ethically. What seems interesting to the Stoic is that, before reminding those who have learned philosophy as a mercenary profession of what wisdom really consists, he showed that we are not really studying for life but unfortunately for the conference room. Convinced that the quality of a man depends more on his morals than on his knowledge, Seneca urged him to become not only the one who knows but especially the one who acts well. He therefore gave priority to the apprenticeship of the man’s trade for moral progress.
Keywords : Erudition, immorality, rhetoric, stoicism, virtue.
Introduction
Rome a hérité la culture grecque et malgré sa méfiance à l’adapter à ses réalités, l’éloquence est demeurée l’idéal de vie, comme ce fut exactement le cas avec les sophistes au temps de Socrate qui s’est farouchement opposé à eux, et a institué depuis lors l’éducation philosophique, comme une réponse au problème moral qui se posait à la cité démocratique d’Athènes. L’éducation romaine vise la formation de l’orateur, lequel est considéré comme le seul profil qui donne accès aux fonctions politiques. Mais à l’époque impériale où la crise de la culture et des valeurs battait son plein, Sénèque a réfléchi sur le système éducatif de son temps. Le diagnostic qu’il a fait s’inscrit dans la même perspective socratique qui indique que la dégradation des mœurs relève du privilège accordé à l’art oratoire qui ne fait aucun lien au vrai. Le stoïcien a mis en question la politique éducative de son époque, qui valorise uniquement le discours sans aucun rapport à l’action morale. La préoccupation essentielle du philosophe concerne l’utilité pratique de la pensée, qui doit conduire au progrès éthique de l’humanité. Par conséquent, tout savoir qui ne contribue pas à la perfection humaine est vain et mérité d’être condamné. Tel est l’objet de cette investigation. Cela mène à montrer en quoi a consisté la condamnation de la vaine érudition par Sénèque chez les rhéteurs, les philosophes et les professeurs des arts libéraux. Mais avant cela, quelle est l’importance accordée à l’éloquence dans la Rome impériale ?
1. L’éloquence comme marque par excellence de la civilisation romaine
Parallèlement à Athènes, dans l’Antiquité classique, Rome a connu une crise de la culture et des valeurs sur une période de quatre siècles environ, qui serait due à l’art oratoire selon le stoïcien Sénèque qui a été un grand témoin à l’époque impériale. L’art oratoire était considéré depuis le temps des sophistes comme l’idéal de vie, le but suprême, vers lequel tout était dirigé, notamment la formation humaine. Malheureusement, la vive réaction de Socrate contre l’enseignement sophistique qui foule au pied tout principe moral, n’a pas pu imposer sa conception d’éducation qui a diversement évolué à travers les écoles philosophiques d’Athènes. La grande masse est astreinte à la formation à l’art oratoire au détriment de ce que proposent les philosophes. Faisant partie intégrante de la culture hellénique que Rome a héritée, « la rhétorique a été la principale discipline de l’enseignement » selon J.-L. Garcia-Garrido (2002. p. 67). S’agissant de l’importance qui lui était accordée, on peut se référer à Cicéron (1962. 1, 13) qui donne cette précision :
Et je n’admets pas l’opinion qu’il se trouve plus de gens pour s’adonner aux autres arts, ou qu’un charme plus grand, de plus riches espérances, de plus magnifiques récompenses matérielles les poussent à s’y instruire. Car, sans parler de la Grèce, qui a toujours prétendu à la palme de l’éloquence, ni d’Athènes, ce berceau de tous les arts, où l’art de la parole en particulier prit naissance pour être porté ensuite à sa perfection, dans notre cité même quelle autre étude fut jamais cultivée avec plus d’ardeur ?
La rhétorique s’est développée à Rome en raison de son utilité à la préparation de l’orateur pour la gestion des affaires de l’État. Son enseignement consiste à développer chez l’élève les facultés liées à la connaissance et à la technique du maniement de la langue, de sorte que c’est la perfection du style qui est visée comme le témoigne si bien C. Burnier (1914. p. 14) :
Le maître se préoccupait sans doute de la correction du texte mais son attention se portait essentiellement sur la correction du style. De là des observations du texte à la clarté tout d’abord, puis à l’ornatus, qui signifie proprement la toilette du style, l’art de la parer et de l’élever au-dessus du langage courant. Pour cela il était nécessaire d’étudier les différents genres de tropes, – figures de mots et figures de pensées – qui donnent au style oratoire sa couleur et son originalité, ainsi que la disposition des mots et l’harmonie des phrases.
Le grammairien et le rhéteur s’occupent de la formation de l’orateur ; ils font acquérir à leurs apprenants la facilité d’expression par rapport à n’importe quel sujet auquel on les soumet. Ceux-ci apprennent à avoir toujours leur mot à dire, être capables de persuader, en toute circonstance, non nécessairement par la pertinence des idées développées mais surtout par le charme et l’émotion que produit la musique de la langue. Selon Cicéron, la formation humaine doit aller au-delà de la grammaire et de la rhétorique pour prendre en compte la culture générale ; mais malheureusement sa conception n’a pas pu triompher de l’éducation traditionnelle.
Cette forme d’éducation qui privilégie l’éloquence a évolué jusqu’à l’époque impériale ; Sénèque a reçu cette formation qui a fait de lui un grand orateur de son temps. Mais cela a été éphémère parce qu’il a abandonné la fonction de l’orateur pour se consacrer résolument à la philosophie. Devenu philosophe du stoïcisme qui fait de la vertu l’apanage du bonheur, laquelle relève de la perfection de l’âme à partir de sa bonne disposition, Sénèque a décidé de mener une réflexion critique sur l’éducation qu’il a reçue. Au terme de sa réflexion, il a abouti à la conclusion selon laquelle celle-ci ne fait que former des savants et non des hommes de bien. Il a manifesté son indignation contre tous les acteurs qui participent à la formation humaine et les a rendus en grande partie responsables de la dégradation des mœurs. Son plus grand reproche, c’est que l’ensemble des enseignements que constituent les sciences et les arts ne suffisent pas à perfectionner ses concitoyens, car ils n’apprennent pas à ceux-ci à modérer leurs désirs et à mépriser leurs craintes en vue d’atteindre l’ataraxie, la tranquillité de l’âme, véritable source de la liberté et du bonheur. En dépit des savoirs acquis, l’individu n’est pas en mesure de bien vivre en se conduisant d’une manière vertueuse ; ces savoirs ne permettent pas la promotion des valeurs morales sans lesquelles l’homme ne peut véritablement s’humaniser. Sur ce point, sa critique contre les philosophes a été acerbe, du fait que certains ont détourné la philosophie de son objectif, celui de conduire l’homme à la sagesse, pour la réduire tout simplement à la philologie. Les faux philosophes sont, selon Sénèque, ceux qui ne font pas un bon usage du savoir et du discours philosophiques, parce que leur conduite trahit ceux-ci. Ils ne sont pas capables de prouver par leurs actes les règles de vie qu’ils prescrivent ; en conséquence tous leurs savoirs paraissent vains et perdent tout intérêt. Face à la crise de civilisation qu’engendre le système éducatif de Rome à l’époque impériale, Sénèque a pensé qu’il faut envisager un renversement des valeurs en se fondant sur la philosophie pour former l’être humain en vue du progrès moral. Donc, le stoïcien a opté pour une éducation philosophique qui consiste à apprendre à l’homme à se construire et à s’humaniser. La formation sera l’affaire du philosophe comme Socrate l’a instituée en vue du redressement moral de la jeunesse. J.-L. Garcia-Garrido (2002, p. 67) donne en quelque sorte le condensé de cette idée d’éducation chez Sénèque, laquelle est diamétralement opposée à l’éducation traditionnelle de son époque :
Dans ce contexte, le profil pédagogique de Sénèque est perçu comme réactionnaire. Sénèque a insisté non seulement sur la priorité pédagogique de l’approfondissement, de la rencontre avec soi-même et de la quête de la vertu comme moyen fondamental pour atteindre la vie heureuse et l’amélioration sociale, mais encore il s’est manifesté avec force contre toute perspective plus formaliste, centrée sur l’éloquence ou des habilités professionnelles ou sociales. Pour la plupart des pédagogues de son temps, théoriciens ou praticiens, Sénèque est un fustigeur (sic), un critique incommode, qui dérange d’autant plus qu’il bénéficie d’une position sociale importante et d’un prestige personnel sans réserve.
L’enseignement dont il est question chez Sénèque est précisément la sagesse qui n’a pas seulement pour objet l’acquisition du savoir mais surtout la perfection de l’être humain. En ce sens, elle diffère des autres disciplines et arts qui servent à vivre mais ne renseignent pas sur la manière de vivre. Elle ne s’arrête pas au niveau du discours mais descend jusqu’à l’action. Pour cela, Sénèque s’est insurgé d’une manière radicale contre la culture de son époque, qu’il a considérée comme inutile, parce qu’elle ne forme pas à la vertu. Il s’agit en fait d’une crise de la culture qui est synonyme de relâchement des mœurs, lequel relève de l’influence de la civilisation hellénique :
Quant à ceux qui sont retenus par d’inutiles questions d’érudition, personne ne doutera qu’ils se donnent bien du mal pour ne rien faire ; et ils sont légion maintenant chez les Romains. Ce fut jadis une maladie des Grecs de se demander combien de rameurs avait Ulysse, si c’est l’Iliade ou l’Odyssée qui a été écrite la première, […] Voici que les Romains aussi sont gagnés par cette vaine ardeur de recherches superflues (Sénèque, 2003. XIII, 1-3).
2. Condamnation de la vaine érudition
2.1. Chez les rhéteurs
Avec le cours des évènements, il est extraordinaire d’établir d’une manière intéressante une similitude entre la Grèce classique et la Rome impériale dans l’Antiquité à propos du rapport entre la rhétorique et la philosophie, respectivement chez Socrate et Sénèque. Le combat a été le même, celui de la vertu mais avec une différence près au plan de la conception philosophique. Car, le stoïcisme a innové dans l’histoire et depuis les Pères fondateurs du Portique, la rhétorique est devenue la philosophie du langage, la science du bien dire et fait partie intégrante de la logique, l’une des trois composantes de leur système philosophique, avec la physique et la morale. Pour s’en convaincre on peut se référer à M. Armisen-Marchetti (1989. p. 38) :
Bien qu’il passe, avec l’épicurisme, pour l’un des systèmes les plus critiques à l’égard de la rhétorique, le stoïcisme est aussi, paradoxalement, celui qui lui accorde la plus grande dignité : pour la première fois dans la pensée grecque, la rhétorique est intégrée dans le corps de la philosophie et devient l’une des deux parties de la logique (la seconde étant la dialectique). Cette appartenance à la philosophie confère à la rhétorique le statut de science […].
En dépit de sa réputation avérée en éloquence et son appartenance indiscutable au stoïcisme qui a érigé la rhétorique en une science, Sénèque est apparu pour ses contemporains comme un Socrate tardif, en raison de sa haine contre le vice qu’engendrent les arts (notamment l’art oratoire) qui ne sont pas fondés sur la morale. M. Protopapas-Marneli (2002. p. 15) nous rappelle la condamnation faite par Socrate : « Dans le discours rhétorique, l’absence de la morale conduit au triomphe du vraisemblable, et par conséquent, à l’ébranlement des mœurs de la cité par le pouvoir de l’art oratoire, cet art que Platon a mis en question et condamné à maintes reprises par l’intermédiaire de Socrate. »
A priori, il serait paradoxalement étonnant et inacceptable de parler d’une condamnation de la rhétorique chez Sénèque, qui a été non seulement un fils du rhéteur mais aussi un brillant orateur de son temps, dont les talents lui ont valu la jalousie de Caligula. Mieux, son style à travers ses écrits révèle qu’il a acquis une maîtrise de la rhétorique. Mais J. Barnes (2009. p. 140) précise qu’on ne se saurait parler chez lui de rhétorique au sens technique du terme. Le problème n’est pas alors nettement tranché, il paraît un peu alambiqué et nécessite qu’on l’explicite tout au moins. Mais la raison fondamentale qui justifie l’usage de la rhétorique en philosophie semble toute simple : le philosophe est tenu de persuader le lecteur afin de le conduire à la sagesse, l’unique et véritable moyen pour l’homme d’être heureux. De plus, le peuple romain appartenait à une civilisation qui a évolué et fait l’usage d’un registre de discours dont il faut tenir compte en vue d’une bonne communication. Par là, on voit déjà que le but diffère, ce n’est plus la même chose comme chez Cicéron où c’est la politique qui est hautement visée. L’usage de la rhétorique chez Sénèque s’inscrit alors dans une approche purement pédagogique, en termes du support et de véhicule pour la pensée philosophique. Il faut que le philosophe parvienne à toucher sa cible et faire passer son message, exclusivement dans l’objectif d’amener l’homme au bonheur par la vertu, à la grande différence des sophistes qui foulent aux pieds tout fondement moral. Il ne s’agit pas chez Sénèque, comme on le voit, d’une quelconque réussite littéraire, mais plutôt de l’utilité morale qui pourrait conduire en dernier ressort à celle-ci, grâce à l’intérêt qu’elle aurait suscité chez ses concitoyens. Il est nécessaire aussi de mentionner que la rhétorique des stoïciens a sa caractéristique propre à elle, laquelle est d’ailleurs reconnue et appréciée. Cela étant, on peut déjà commencer par imaginer les vraies raisons pour lesquelles Sénèque a condamné la rhétorique. Pour le stoïcien, la rhétorique est compatible avec la philosophie à la seule condition qu’elle se préoccupe de bien dire et de dire effectivement le vrai. Le seul danger à éviter relève de l’immoralité à laquelle conduit l’art oratoire lorsqu’il n’est pas fondé sur la vérité. C’est dans la perspective socratique que Sénèque a mené son combat contre tout praticien de l’éloquence qui manque à la sagesse. J. Fillion-Lahille (1984. p. 38) donne à ce propos cette précision : « nous connaissons son mépris pour l’érudition souvent stérile à ses yeux et pour tout ce qui ne contribue pas à notre perfectionnement moral. »
Sénèque n’a pas varié dans sa position ; tout ce qui ne grandit pas l’homme sur le plan moral et éthique, est sans intérêt à ses yeux. Car selon lui, la sagesse ne consiste pas à exercer dans de creuses et pauvres disputes un talent dialectique qui est la plus grande des vanités. Le plus important pour un discours, c’est l’intérêt vertuiste qu’il présente. Il aura une valeur s’il participe à la perfection de l’âme, sinon il est considéré comme un verbiage, bavardage inutile. Ce qui fait que Sénèque s’élève contre tout ce qui paraît futile et ne permet pas de savoir bien se conduire dans la vie, comme les sophismes et les syllogismes qu’il n’hésite pas à qualifier de sottises, d’inutiles et de nuisibles. Sa critique n’épargne aucun domaine de formation. Il s’est aussi insurgé contre les grammairiens romains qui, d’après lui, imitent les Grecs en s’attachant aux plaisirs de curiosité, choses superflues. La dénonciation se poursuit de la même manière contre toute production littéraire qui manque de concision et n’a aucune portée éthique. Il ne suffit pas d’avoir une belle écriture ou une maîtrise des figures de style pour prétendre être utile à l’humanité et s’enorgueillir, si elle n’apporte rien à la construction de la personnalité. Le style raffiné est contingent s’il n’apporte rien à la perfection humaine. Il en déduit qu’il reflète l’image de la société qui l’a adopté par négligence des règles de vie, pour rechercher le plaisir. Le véritable but qu’il faut poursuivre est la quête de la sagesse qui est non seulement une connaissance qu’il faut acquérir mais aussi une conduite qu’il faut adopter. Cela étant, la bataille pour la vertu chez Sénèque se dirigera contre les faux philosophes dont la vie est en parfait désaccord avec les discours qu’ils tiennent.
2.2. Chez les philosophes
S’agissant des philosophes, la véritable préoccupation de Sénèque est relative à l’usage de la rhétorique dans l’élaboration du discours philosophique. Elle ne concerne pas la condamnation de l’éloquence tout court, mais le cas où elle ne permet pas à l’homme de se connaître en vue de s’améliorer à partir du soin qu’il faut donner à l’âme ; et de ce fait, elle paraît inutile d’après Sénèque (1993. 75, 5) :
Nos discours doivent tendre non à l’agréable, mais à l’utile. Si toutefois l’éloquence vient sans que l’on s’en mette en peine, si elle s’offre d’elle-même ou coûte peu, admettons-la et qu’elle s’attache à de très belles choses ; qu’elle soit faite pour montrer les choses plutôt que pour se montrer. D’autres arts s’adressent exclusivement à l’ingéniosité ; ici on ne travaille que pour l’âme.
S’il arrivait que tout en étant éloquent l’on parvienne à atteindre la vérité, c’est-à-dire le but du discours philosophique, cela ne poserait aucun problème. Mais l’expérience a montré sans doute que pendant la période classique de la Grèce et parallèlement à celle de la Rome dite la « seconde sophistique », ceux qui travaillent à la finesse du style ne songent guère à la perfection de l’âme. Car leur discours ne se fonde sur aucun principe moral. La réaction de Sénèque intervient pour mettre en garde, contre ce défaut, tout philosophe qui cherche à exceller en art oratoire en défaveur de la recherche du vrai. Il s’agit, pour lui, de considérer la philosophie comme une discipline qui est à la fois théorique et pratique, et qui oblige le philosophe à réaliser une harmonie entre ce qu’il fait et ce qu’il dit. Mais le constat est fait, les philosophes de son temps s’attachent aux mots et négligent la beauté morale de l’idée, en réduisant ainsi la philosophie à la philologie. Sénèque ne dénie pas à ses collègues le droit de faire l’usage de la rhétorique, mais il exige d’eux de faire en sorte que l’on pense ce qu’on dit et que l’on dise ce qu’on pense, afin que les actes qui suivront puissent manifester l’harmonie qui règne en soi et s’accorder à leur tour à la pensée. C’est en quelque sorte l’idée que le précepteur de Néron (1993. 75, 3-4) semble émettre à travers ce passage :
La philosophie ne répudie pas les grâces de l’esprit. Quant à beaucoup peiner sur les mots, c’est ce qu’il ne faut pas. Voici le point essentiel de notre intention : dire ce que l’on pense, penser ce que l’on dit ; faire que le langage soit d’accord avec la conduite. Il a rempli ses engagements celui qui, à le voir et à l’écouter, se trouve le même.
L’obligation, à laquelle le philosophe doit se conformer, est l’adéquation entre la pensée et la parole d’une part, et le discours et l’action d’autre part. Ce qui semble faire défaut chez les contemporains de Sénèque et sur lequel il met un accent particulier, et qui le pousse d’ailleurs à passer au crible tous ces philosophes qui sont incapables de prouver par les actes le discours qu’ils tiennent. C’est surtout en se fondant sur l’utilité pratique de la philosophie qu’il s’est insurgé contre les faux sages.
Une chose est claire et sur laquelle il n’est pas possible de transiger, c’est que le philosophe doit pouvoir mettre en accord son enseignement avec la vie qu’il mène. Sénèque l’a affirmé, la philosophie ne relève pas du domaine des mots mais de l’action qui doit témoigner de la santé de l’âme. L’état de celle-ci doit préoccuper avant toute chose, et pour cela les vaines exhibitions sophistiques ne sont pas admises car elles ne sauraient contribuer à la perfection de l’âme. La qualité de cette dernière détermine celle de l’homme à travers ce qu’il fait, selon qu’elle est bonne ou mauvaise. Et c’est seulement quand l’âme se trouve dans la tranquillité, la paix, que l’homme se porte vertueusement bien. La perfection humaine est alors tributaire de celle de l’âme, et cela oblique que l’on veille sur le soin à apporter à celle-ci. Pour y parvenir on a besoin de pratiquer la philosophie et non la rhétorique qui n’est profitable en rien à l’âme, car elle n’éduque pas à la vertu. En ce sens, il faut combattre, jusqu’au dernier, ceux qui pervertissent les mœurs afin de restaurer les valeurs. Le comportement des faux philosophes fait que Sénèque ne cesse d’exhorter son disciple, Lucilius, à se consacrer à l’essentiel, la vie en accord avec soi-même, pour ne pas céder aux séductions des orateurs qui ne savent que parler pour créer de l’émotion et du charme chez leurs interlocuteurs.
Pour le stoïcien, il est inconcevable et paradoxal qu’un philosophe puisse paraître une entrave au progrès moral de ses semblables qu’il a le devoir d’éduquer aussi bien par son enseignement que par sa conduite. Car celle-ci ne doit pas contraster dangereusement avec le but de la philosophie qu’il poursuit, paraît-il, et malheureusement de travers. Cela semble insupportable pour Sénèque qui n’arrive pas à comprendre comment on peut trahir l’esprit de la philosophie, qui, par le principe de l’harmonie, exige que les actes s’accordent avec les paroles. D’une manière un peu plus claire, Sénèque (1993. 75, 2) précise sa conception de la philosophie :
La philosophie enseigne à agir, non à parler. Elle exige que chacun vive suivant la loi qu’il s’est donnée ; que la vie ne soit pas discordante au langage ou discordante en elle-même, qu’il y ait entre tous les actes unité de couleur. Voilà le principal office de la sagesse, et son principal indice : que les paroles et les œuvres soient à l’unisson, que l’homme soit partout égal et identique à lui-même.
En tant que philosophe et pédagogue, un habitué de la répétition, Sénèque indique une fois de plus ce qu’on peut saisir du concept de la philosophie qui est évidemment une éducation à la vertu, parce qu’elle demande qu’on agisse rigoureusement en fonction de la pratique de l’exercice de la raison. Le discours philosophique n’a d’autre but que d’atteindre la vérité, et par là il doit avoir un impact sur les individus, c’est-à-dire celui d’améliorer leurs attitudes. En ce sens, il n’y a aucun inconvénient en ce qui concerne l’usage de la rhétorique, puisqu’elle contribue directement à la formation de la personne humaine dont la finalité est d’acquérir la vertu, la sagesse et le bonheur. En revanche, tel n’est pas toujours le cas, et c’est ce qui provoque la réaction de Sénèque contre tout enseignement qui ne privilégie pas la transformation de soi en vue du progrès social. Il a paru très sévère dans ses critiques à l’endroit de ces philosophes dont la vie est en parfaite dysharmonie avec les règles de vie qu’ils prescrivent :
Au reste l’humaine engeance n’a pas, que je sache, de pires ennemis que ceux qui ont appris la philosophie comme un métier mercenaire, gens dont la vie est sans rapport avec les règles de vie qu’ils prescrivent. Leur propre personne, qu’ils promènent en tous lieux, est un échantillon de l’inutilité de leur enseignement : ils sont esclaves de tous les vices qu’ils pourchassent. Non, un maître de cette espèce ne saurait pas plus me servir qu’un pilote atteint du mal de mer, en pleine tempête. […] On veut non un parleur, mais un pilote. Rien de ce qu’ils disent, rien de ce qu’ils débitent à la foule attentive ne vient d’eux. Platon l’a dit, Zénon l’a dit, Chrysippe, Posidonius et le grandiose cortège de tant d’illustres noms. Ils ont un moyen, ces gens-là, de prouver que cette morale est la leur, le voici : ce qu’ils diront, qu’ils le fassent (Sénèque, 1993. 108, 36-38).
C’est une nécessité de confirmer par l’action ce qu’on a appris, en montrant par-là qu’on est détenteur d’un savoir ; c’est ce qui est digne d’un vrai philosophe. Sinon à quoi sert, par exemple, d’entretenir de la manière la plus belle une foule sur la mort en démontrant qu’elle n’est rien, et n’être pas pour autant en mesure de se montrer courageux lorsqu’on est atteint d’une maladie chronique, et se mettre à craindre sa disparition prochaine. Une telle attitude ne saurait honorer le philosophe, et dans ce cas celui-ci n’est pas transformé. C’est peut-être la vraie cause de ces pseudo-philosophes qui, incapables d’enseigner ce qu’est véritablement un philosophe en donnant la preuve de leur enseignement par leur conduite quotidienne, se révèlent eux-mêmes inutiles, parce qu’ils s’attachent à des subtilités qui les poussent à l’excès d’études en vue de s’exhiber lors de la tenue des conférences. Ce qui ne saurait passer inaperçu aux yeux de Sénèque qui est déterminé, à jamais, à découdre avec toutes les pratiques d’enseignement, qui ne sont pas propices à la moralité. Voici comment il le dit à son ami Lucilius, dans sa correspondance :
Maintenant que je me suis plié à ce que je désirais, il est temps que je me dise pour ma gouverne ce que je te vois tout prêt à dire : nous jouons aux échecs ! L’on émousse sa finesse sur d’inutiles subtilités. On en devient non honnête homme, mais savant homme. La sagesse est plus accessible ; elle est surtout plus simple. Peu de science permet d’arriver à la sagesse. Mais nous, comme nous éparpillons sans fruit toutes choses, ainsi faisons-nous d’excès de culture, de même qu’en toutes choses nous souffrons d’un excès. Nous n’étudions pas pour la vie réelle mais pour la salle de conférence (Sénèque, 1993. 106, 11-12).
Pour ne pas paraître bon à rien, le pseudo-philosophe semble utile pour les salles de conférence ; mais en réalité ce type d’utilité n’en est pas une. Parce que ce n’est pas le fait de s’adonner à la culture sans mesure, qui rend l’homme honnête, au contraire on en sort seulement savant. Ce faisant, c’est l’esprit, l’intelligence qu’on cultive et non l’âme. Et quand cela se passe de cette façon, c’est qu’on ignore la valeur de celle-ci et l’homme n’y gagne absolument rien. Car selon Sénèque, l’âme est l’essence de l’homme, c’est elle qui fait que l’homme devient ce qu’il est, c’est-à-dire l’humain. C’est pourquoi, il n’y a rien de plus dramatique au monde pour l’homme que de négliger la perfection de son âme. La vie tout entière dépend de cette dernière et il importe beaucoup d’y prendre soin en travaillant constamment sur soi. Ce qu’on ne saurait pas si on n’étudiait pas la philosophie qui façonne l’âme, laquelle en retour façonne la vie.
La connaissance de cette réalité s’avère indispensable pour qu’on en tienne compte dans toute entreprise éducative en vue de ne pas manquer le but de celle-ci. Mais lorsqu’on a fait consciemment ou inconsciemment le choix d’être un savant et non un honnête homme, on ne peut que produire ce qu’on est soi-même. Cela sous-entend que le savant n’est pas indiqué à éduquer à la vertu, son enseignement ne peut rien apporter à l’âme. Il n’est capable que de former de beaux parleurs, des savants comme lui et non des hommes de bien. Sénèque a montré que le comportement des faux philosophes n’est pas sans conséquence sur les jeunes gens qui viennent les écouter. Ceux-ci viennent se faire former auprès d’eux, mais malheureusement ce n’est pas pour devenir des hommes vertueux, parce qu’ils sont à la recherche des mots et non des idées. Il y en a d’autres qui viennent chez le philosophe pour le pédantisme et le divertissement.
C’est l’inconvénient qu’il y a, quand on a détourné la philosophie de son but en la transformant en une discipline qui forme à aimer les mots et non la sagesse. Les élèves ne peuvent qu’être à l’image de leur maître. Lorsque la morale déserte le forum, c’est le vice qui hante les esprits, et tout se transforme en crise et désordre. Les philosophes sont devenus, par l’enseignement qu’ils dispensent, des grammairiens et des rhéteurs. De ce fait, ils paraissent inutiles au genre humain, ils n’enseignent rien sur comment il faut vivre, c’est-à-dire comment calmer les terreurs, réfréner les passions irritantes, dissiper les préjugés, réprimer le penchant à la mollesse, secouer l’avarice. Tant qu’ils ne forment pas à bien vivre, ils s’attachent à du superflu, à des choses futiles. Le temps qu’il faut prendre pour se cultiver à travers la réalisation quotidienne des exercices, ils le gaspillent pour des choses de peu de valeur en se vantant et se montrant savants au lieu d’être des hommes de bien. Ce qui ne saurait laisser Sénèque indifférent sans remettre en cause cette forme d’éducation. Il fustige les comportements des professeurs et de leurs élèves :
Mais bronchons, et c’est en partie la faute de ceux qui enseignent à disputer, non à vivre ; en partie de celle des élèves, qui se présentent à leurs maîtres avec l’intention bien arrêtée de se cultiver l’esprit, sans songer à l’âme ; et cela fait que la philosophie n’est plus que de la philologie (Sénèque, 1993, 108, 23).
L’éloquence traditionnelle est condamnée sans ambages, du fait qu’elle ne vise pas à dire le vrai ; car si elle disait le vrai la conséquence qui en découlerait sera la vertu, laquelle se traduit par une bonne conduite. Or, tel n’est pas le cas, l’immoralité est sa conséquence. Et c’est ce que Sénèque a déploré tout le temps pour insister sur ce que doit être la philosophie. Celle-ci exige que la vie soit en accord avec la doctrine. Avec elle, on ne transmet pas un savoir stérile, car elle apprend à être plus courageux, plus juste et plus modéré dans les désirs. En guise de synthèse, on peut lire ce qu’a écrit J.-J Duhot (2003. p. 39) sur l’inutilité d’une réflexion philosophique chez les stoïciens :
Un travail de pure intelligence serait absolument vain. Épictète insiste sur l’inutilité d’une réflexion philosophique qui n’implique pas la personne totale. La philosophie n’est pas une masse d’informations qu’on accumule, qu’on organise intellectuellement ; elle a à être digérée, et non entassée. Il ne s’agit pas de faire de la philosophie, mais d’être philosophe : quelle absurdité que de méditer sur le bien et le mal si ce n’est pour réaliser le bien ? La philosophie n’est donc pas dans les livres, ils ne sont qu’un moyen. L’érudition pure n’a pas de sens.
En ce sens, la philosophie est une sagesse, un art de vivre et relève de ce fait d’une utilité pratique, qu’aucun autre art ne saurait posséder.
2.3. Chez les professeurs des arts libéraux
En dehors des rhéteurs et des faux philosophes, Sénèque s’est indigné contre les professeurs des arts libéraux dont les enseignements seuls ne suffisent pas à rendre l’homme heureux. Son critère n’a pas changé, il est resté le même : la véritable connaissance digne de considération est celle qui apprend à l’homme comment il faut se conduire dans la vie. En revanche, toute connaissance qui ne lui permet pas au plan éthique de bien agir sera qualifiée d’inutile. Par conséquent, lorsqu’une chose n’est pas utile, elle n’est pas un bien et si elle était utile, un bien, elle engendrerait inévitablement une bonne action. En dehors de la sagesse, les autres sciences n’enseignent pas à l’être humain comment il faut être vertueux, comment il faut se préparer à la vie, mépriser ses désirs et se libérer de l’angoisse de la mort par exemple.
Comme on le voit, le savant ordinaire ne saurait avoir aucune notion fiable de la vertu, la sagesse, la modération, la justice, le courage, la fortune, la mort, etc. Pour Sénèque, il ne s’agit pas de connaître la définition des concepts pour prétendre être savant ; non, le savant stoïcien c’est celui qui tout en sachant, agit aussi bien. C’est pourquoi la vraie définition des concepts chez le philosophe renvoie à une disposition, une manière d’être de l’âme. Ainsi, la vertu est une manière d’être de l’âme, tout comme la sagesse et toutes les autres vertus. Ce qui implique nécessairement la réconciliation de la connaissance et de l’action. En conséquence, le vrai sage ou l’homme heureux est celui qui connaît mieux, agit moralement bien. Donc, le vrai problème ne se situe pas seulement au niveau des savoirs, fussent-ils philosophiques ou non, mais de leur application.
Le plus important chez Sénèque, c’est la question de l’utilité pratique à valeur morale d’une chose, afin qu’elle soit érigée au rang du bien. Et pour qu’il en soit ainsi, il revient seulement à l’homme vertueux, c’est-à-dire le sage de pouvoir lui conférer cette valeur qui découle de l’usage qu’il en fait. Seul le sage sait juger de ce que vaut exactement une chose en vue de son utilisation ; en dehors de lui, tout mène au vice. Pour cela, l’éducation à la sagesse est nécessaire, car les autres sciences qui s’offrent à l’homme ne lui sont d’aucun profit en termes de vertu. Ces sciences ne peuvent rien lui apprendre sur la personnalité, l’altruisme et le vivre-ensemble.
Selon Sénèque, il n’est pas inscrit dans le programme des arts libéraux la promotion des vertus ; seule la science du bien et du mal permet à l’âme de se perfectionner et à partir de celle-ci, l’humanisation de l’homme. Donc, c’est seulement à la sagesse que cette tâche revient; et c’est cela qui fait sa suprématie sur les autres arts et sciences. Mais en quoi consiste exactement la sagesse? L’utilité pratique de la sagesse dont on parle est une conséquence directe de la théorie qui prend en compte la recherche de la vérité à travers la connaissance de la nature et de ses principes. Ce qui, a priori, n’a aucun rapport avec la moralité ; on ne saurait imaginer qu’une telle connaissance pourrait permettre de régler la conduite humaine. De même, on ne se contente pas de cette connaissance de la nature sans chercher à la mettre en pratique au plan moral, pour ainsi parler du bien agir. De la recherche de la vérité on parvient à la vertu qui est une disposition de l’âme grâce à cette vérité à laquelle on a accédé. En revanche, s’agissant des arts libéraux, tel n’est pas le cas. Tout s’arrête au niveau des vérités partielles que l’on a acquises. Les professionnels de ces arts ne songent même pas aux conséquences de leur savoir sur le plan éthique, comme on pourrait le remarquer à travers le texte ci-dessous, qui paraît long mais semble avoir le mérite d’être cité, compte tenu de l’importance qu’on pourrait lui reconnaître :
Je passe au cas du musicien. Tu m’enseignes comment les voix aiguës et les voix graves s’harmonisent, comment des cordes qui rendent chacune un son différent peuvent s’accorder. Ah ! plutôt, fais en sorte que l’harmonie règne dans mon âme, qu’il n’y ait pas dissonance dans mes volontés. Le géomètre m’apprend à mesurer de vastes domaines ; il ferait bien mieux de m’apprendre la juste mesure de ce qui suffit à l’homme. Il m’apprend à compter, il m’assouplit les doigts aux calculs qu’inspire l’avarice ; mieux vaudrait m’apprendre que tous ces comptes-là ne servent à rien ; qu’un homme n’est pas heureux parce que les revenus de son patrimoine lassent une équipe de comptables ; qu’il ne possède au demeurant que du superflu, ce capitaliste qui sera terriblement malheureux, s’il doit faire un jour lui-même le compte de tout ce qui lui revient. Que me sert de savoir diviser en fractions un bout de champ, si je ne sais point partager avec mon frère ? Que me sert de supputer avec précision le nombre de pieds d’un arpent et de saisir d’un coup d’œil jusqu’à une omission de la perche d’arpentage, si je me chagrine, pour peu qu’un voisin trop convoiteux grignote mon avoir ? Il m’enseigne à ne pas perdre tout ce que j’ai. Moi, je voudrais apprendre à le perdre tout entier d’un cœur joyeux. […]Tu sais mesurer un cercle ; tu réduis au carré toutes figures qu’on te présente, tu détermines la distance d’un astre à l’autre ; il n’est rien qui ne tombe sous ton compas. Habile comme tu l’es, mesure l’âme de l’homme ; fais voir sa grandeur, fais voir sa petitesse. Tu sais ce que c’est qu’une ligne droite. A quoi bon cela si, dans la vie morale, tu ignores ce que c’est que la droiture ? […] (Sénèque, 1993. 88, 4-15).
À quoi bon tel savoir, à quoi bon tel art si l’homme n’arrive pas à bien vivre ? La préoccupation fondamentale de Sénèque, à travers ce texte, est de toucher réellement du doigt en quoi consiste l’utilité des sciences et des arts. Il a montré que, tout en contribuant d’une manière ou d’une autre à l’acquisition du savoir et au confort de l’existence, ils ne sont d’aucun profit pour le progrès moral. Ils ne permettent pas à l’homme d’acquérir la vertu ; ils ne peuvent pas l’empêcher de craindre ou de désirer ; en conséquence, ils ne peuvent pas le rendre meilleur, et d’où leur vanité chez le stoïcien. Mais celui-ci reconnaît l’importance des arts libéraux dans la mesure où ils prédisposent l’âme à l’acquisition de la sagesse.
Conclusion
La réflexion de Sénèque sur l’éducation de son temps qui a engendré une crise de la culture et des valeurs, révèle que tout enseignement qui n’a pas pour finalité la sagesse et la vertu, n’est d’aucune utilité pour le genre humain. Pour le philosophe, toute érudition serait vaine si l’homme ne se prend pas au sérieux sur le plan éthique. Car, ce n’est pas la connaissance ou le niveau élevé de culture qui détermine la valeur d’un homme mais plutôt les mœurs qui permettent de construire sa personnalité. D’une manière précise, il indique que l’homme ne peut pas s’humaniser sans la recherche de la vérité qui mène inévitablement à la vertu, l’amour du bien. Et c’est seulement l’étude de la sagesse, la philosophie et l’unique étude libérale, qui forme l’âme à la vertu.
Références bibliographiques
ARMISEN-MARCHETTI Mireille, 1989, Spientiae facies. Etudes sur les images de Sénèque, Paris, Les Belles Lettres.
Barnes Jonathan, 2009, « Grammaire, rhétorique, épistémologie et dialectique », in Gourinat J.-B., et Barnes J., (Dir). Lire les stoïciens, Paris, PUF, pp. 135-149.
BURNIER Charles, 1914, La pédagogie de Sénèque, Paris, Payot.
CICÉRON, 1962, De l’art oratoire, Traduit par Edmond Courbaud, Paris, Les Belles Lettres.
DUHOT Jean-Joël, 2003, Epictète et la sagesse stoïcienne, Paris, Albin Michel.
FILLION-LAHILLE Janine, 1984, Le De ira de Sénèque et la philosophie stoïcienne des passions, Paris, Klincksieck.
GARCIA-GARRIDO José-Luis, 2002, « Sénèque », pp. 60-84, in Houssaye Jean (Dir) Premiers pédagogues : de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, ESF.
PROTOPAPAS-MARNELI Maria, 2002, La rhétorique des stoïciens, Paris, L’Harmattan.
SÉNÈQUE, 1993, Entretiens. Lettres à Lucilius, Paris, R. Laffont.
SÉNÈQUE, 2003, De la vie heureuse. De la Brièveté de la vie, traduit par A. Bourgery, Paris, Les belles Lettres.
ONTOLOGIE ET POLITIQUE CHEZ SPINOZA
1. Assanti Olivier KOUASSI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
2. Koffi Azoumanan YAO
Lycée Moderne Abengourou (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La relation entre l’ontologie et la doctrine politique dans la philosophie de Spinoza est tellement logique et évidente qu’il s’avère absolument impossible de les séparer. Cette relation de consubstantialité permet de comprendre l’ontologie comme instance de construction rationnelle du politique mais aussi de voir le politique comme un appendice de l’ontologie. En effet, la philosophie politique de Spinoza se laisse profondément éclairer par une représentation ontologique à partir de laquelle elle acquiert signification et rationalité. De cette ontologie naît un système politique immanent reposant sur la dynamique de la puissance. D’une ontologie de la puissance, on s’introduit dans un univers politique où la puissance sert de principe de caractérisation de la vie politique. C’est pourquoi, notre étude sera axée sur deux objectifs fondamentaux. Dans le premier, nous ferons ressortir le contenu de l’espace ontologique spinozien. Quant au deuxième, il nous permettra de montrer les manifestions politiques de cette ontologie.
Mots-clés : Conatus, Nature, Ontologie, Politique, Puissance.
Abstract :
The relationship between ontology and political doctrine in Spinoza’s philosophy is so logical and obvious that it is absolutely impossible to separate them. This relationship of consubstantiality allows us to understand ontology as a forum for the rational construction of policy, but also to see politics as an appendix to ontology. Indeed, Spinoza’s political philosophy is deeply enlightened by an ontological representation from which it acquires meaning and rationality. From this ontology comes a permanent political system based on the dynamics of power. From an ontology of power, one enters a political universe where power serves as the principle of characterization of political life. For this reason, our study will focus on two fundamental objectives. In the first, we will highlight the content of the spinozian ontological space. The second will allow us to show the concrete manifestations of this ontology.
Keywords : Conatus, Nature, Ontology, Politics, Power.
Introduction
Toute rationalité politique part d’une certaine représentation de l’univers, de ce qui fait que l’univers est, de ce qui lui donne sens. Cela laisse sous-entendre l’idée que la réflexion sur l’existence individuelle et collective des hommes se présente comme une conséquence logique d’une caractérisation des lois de la Nature qui rend cette existence possible. C’est dire que dans le fond, notre existence n’est légitime que parce qu’elle est légitimée par une certaine conception de la Nature. Chez Spinoza, cette compréhension de la Nature, étant purement immanente nous aide à comprendre la rationalité dynamique de l’espace politique : d’où le titre de cette étude : « Ontologie et politique chez Spinoza ». L’ontologie conduit-elle à la politique chez Spinoza ? L’ontologie et la politique ne sont-elles pas indissolublement liées chez Spinoza ? L’ontologie spinozienne n’est-elle pas une ontologie politique ? Notre hypothèse est que chez Spinoza, pour comprendre la dynamique rationnelle de la vie politique, il semble nécessaire de se référer à son analyse ontologique. À cet effet, l’ontologie serait un critère pertinent pour bien comprendre la réalité politique. Notre objectif en écrivant cet article est de montrer dans un premier temps que l’ontologie conduit à la compréhension de la politique chez Spinoza et ensuite montrer les manifestations politiques de cette ontologie. Notre approche se veut analytique car elle procède de la connaissance de la cause à celle de leur effet. (P. Macherey, 2015, p. 15)
1. L’espace ontologique spinozien
1.1. Une ontologie de la puissance
On peut entendre, par ontologie, le discours qui prend pour objet non pas telle catégorie particulière de l’être mais l’être en tant qu’être. Bien que le concept ontologie ne date que du XVII ème siècle, le principe peut en être trouvé chez Aristote, selon lequel il y a une science qui étudie l’être en tant qu’être opposée aux sciences particulières qui découpent quelque partie de l’être et en étudient les propriétés. L’ontologie serait ainsi l’étude de l’essence de l’être, de ce qui fait que l’être est ; elle serait l’étude du fondement de l’ordre des choses. (É. Clément, C. Demonque, L. Hansen-Love, P. Kahn, 1994, p. 253). Or l’être dont il s’agit c’est Dieu, c’est-à-dire « un être absolument infini, c’est-à-dire une substance constituée par une infinité d’attributs ». (B. Spinoza, 2005, p. 83).
On remarque à travers cette définition une similitude sémantique entre les termes Dieu et substance. L’essence de cette réalité que Spinoza désigne par le terme Dieu s’identifie à la substance. On part donc du concept traditionnel Dieu pour appréhender son essence véritable définie par la substance, c’est-à-dire une infinité d’attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. L’attribut est ce que l’entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. (B. Spinoza, 2005, p. 83). Il y a donc une réciprocité logique et réelle entre la substance et les attributs nous permettant d’expliquer et comprendre l’essence de Dieu. Cependant, ce Dieu ou substance s’identifie aussi à la Nature. (B. Spinoza, 2005, p. 281). Dieu est donc et substance et Nature. La Nature révèle la puissance productrice de Dieu. La puissance définit la dynamique de la philosophie de Spinoza et justifie son inépuisable créativité conceptuelle. « Nature et puissance constituent les séquences d’un unique processus causal et rationnel qui les enchaînent rigoureusement l’une à l’autre. » (P. Macherey, 2015, p. 24). Dieu développe ainsi sa puissance en tant que cause de produire. L’essence divine s’exprime donc dans sa puissance productrice. C’est pourquoi, il est nécessaire de mettre au
clair l’importance de ce statut en éclairant une quadruple fonction que Spinoza lui assigne : 1-Une fonction de différenciation qui permet au concept de puissance de déployer le mécanisme de distinction de la substance et de l’attribut. 2-Une fonction de détermination où la puissance enveloppe l’identité foncière des diverses régions attributives de la nature, chaque détermination exprimée étant à la fois elle-même et la substance, c’est-à-dire exprimant à la fois sa propre structure et celle de tous les autres attributs. 3-Une fonction logique exprimant la réflexivité et la genèse de l’idée, la puissance s’identifiant à une logique de l’implication qui est de l’ordre même de l’univers spinoziste. 4-Une fonction d’expression formée par la relation entre les modes pensants et étendus, considérés dans leur rapport avec l’éternité. (A. Giovannoni, 1999, p. 55).
La réalité politique puise donc sa substance dynamique dans un environnement ontologique où la puissance conditionne le quid de l’être. L’ontologie définit la puissance qui se révèle dans la puissance dynamique de l’espace politique. De ce fait, la puissance de la Nature est cause de la puissance exprimée dans l’espace politique. C’est pourquoi, le droit du souverain étant défini par sa puissance on « accorde dans une Cité quelconque de droit au souverain sur les sujets que dans la mesure où, par la puissance, il l’emporte sur eux ». (B. Spinoza, 1965, p.283). Il résulte que la puissance définie par l’ontologie se présente comme la matrice fondamentale qui permet de mieux comprendre la politique spinozienne. C’est pourquoi, « on s’interdirait toute intelligence de la politique de Spinoza si on ne la rattache pas à sa vision ontologique. » (S. Y. Dion, 2006, p. 59).L’architecture ontologique devient ainsi l’instrument nécessaire pour l’harmonisation de la puissance de l’individu à celle de l’État.
La puissance acquiert une fonction éminemment politique puisqu’elle nous permet de comprendre la matérialité de la vie politique et la réalité de l’État qui est la condition nécessaire de la conservation des institutions politiques garantissant, la paix, la sécurité, et la liberté. (K.-B. Faten, 2010, p. 2). Dans l’univers de l’ontologie de la puissance, la puissance de l’Être est décrite dans une posture strictement immanentiste qui débouche à son tour sur une souveraineté imminente. Toutes les réalités en rapport avec l’existence humaine sont analysées dans cette dynamique ontologique de la puissance qui offre un horizon indépassable de la résistance à l’aliénation politico-religieuse. En niant la transcendance, l’ontologie de la puissance spinoziste pose l’affirmation de l’Être dans l’individu et conduit à son affirmation pleine et entière. Cette conception de la puissance, libérée de toute transcendance, est ancrée dans une conception immanentiste de l’Être qui peut rendre possible le projet de formation d’une nature humaine parfaite ou supérieure. (K.-B. Faten, 2010, p. 2).Il est donc absurde d’espérer séparer la puissance du fondement ontologique qui la caractérise. (F. Hulak, 2007, p. 410). La liberté humaine consiste à cet effet à affirmer pleinement la puissance de l’Être inscrite dans l’être singulier. C’est ainsi que,
cette notion désignera l’orientation propre au projet libératoire par lequel la condition humaine doit être progressivement soustraite à son état originel de servitude ; selon cette orientation, être libre, c’est, pour un être quel qu’il soit, disposer pleinement de la puissance qui définit sa nature. (P. Macherey, 1997, p. 7).
La liberté consiste pour Spinoza à exprimer dans son être singulier la puissance de la Nature dont nous sommes dépositaires en tant que constituant une partie de sa puissance. Cette puissance qui définit la puissance de l’individu est la puissance même de Dieu. Dieu est donc identifié à la Nature en se manifestant comme causalité immanente : « Dieu est cause immanente de toutes choses et non pas cause transitive .» (B. Spinoza, 2005, p. 106). Dieu ne saurait donc être un créateur agissant en dehors de sa créature. Le Dieu de Spinoza n’est pas un Dieu transcendant le monde après l’avoir créé. Ce n’est non plus un Dieu personnel que l’homme peut implorer. Ce n’est ni le Dieu de la Bible ni celui des Évangiles. Pas davantage celui des philosophes qui conçoivent un Premier Moteur. (J. Russ, 1997, p. 74).
En identifiant Dieu à la Nature, Spinoza dépersonnalise Dieu pour l’assimiler à la puissance infinie de la Nature. De ce fait, Dieu n’est rien d’autre que la totalité de la nature, il se confond avec le monde lui-même. On voit que, contrairement à certaines légendes, Spinoza ne nie pas Dieu, il n’est pas athée : bien au contraire, il le retrouve partout dans la Nature. (J. Russ, 1997, p.74). Spinoza construit à travers cette appréhension immanentiste de Dieu, un système ontologique de la puissance à partir duquel la souveraineté politique se comprend comme immanente. Étant au fondement du système, la nouvelle version de Dieu sert à rendre intelligible la réalité politique. En ce sens, sa compréhension de Dieu ne peut manquer d’avoir des implications dans le système politique. Dans ce système théorique exposé dans l’Éthique, la philosophie politique n’est que la conséquence du savoir philosophique total. On aperçoit aisément la transition entre l’ordre ontologique et l’ordre politique. On voit que Spinoza propose une philosophie de la politique qui s’affranchit de toute transcendance. Dans ce système de philosophie politique, c’est l’ontologie qui éclaire tous les aspects de la réalité politique. C’est pourquoi, la pleine compréhension de la philosophie politique de Spinoza nécessite la compréhension de toute sa philosophie découlant de sa conception immanentiste de Dieu. Ainsi, la politique est-elle une affaire d’immanence et non de transcendance. (M. Onfray, 2017, p.357). La puissance admise sur le plan ontologique va s’exprimer également en l’homme sous forme conatus.
1.2. Le conatus, un appendice modal de l’ontologie
Le conatus traduire dans la philosophie de Spinoza l’exercice de la puissance d’exister d’un individu quelconque. C’est une essence qui s’exprime dans sa singularité en affirmant sa nature propre. Le conatus se présente chez notre auteur comme l’affect fondamental, l’effort d’exister d’un être, de persévérer dans son être constituant l’essence intime de chaque chose. « L’effort par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son être n’est rien en dehors de l’essence actuelle de cette chose. » (B. Spinoza, 2005, p.206).Le conatus nous dispose donc à exister, à affirmer notre essence parmi les multiples essences. L’effort pour persévérer dans son être implique l’affirmation de l’essence se déclinant dans l’actualité. Le conatus devient ainsi une puissance qui s’affirme pour déterminer l’existence de l’être singulier comme expression modale de la puissance d’exister de la substance infinie.
De ce fait, la puissance d’exister de l’individu doit être comprise comme expression modale de la puissance infinie d’exister de Dieu. En ce sens, le conatus se précise comme appendice modal de l’ontologie. C’est dire que la puissance d’exister de Dieu ou Nature se manifeste en l’homme en tant que puissance du Désir. Le Désir n’est rien d’autre que le conatus qui s’exprime en l’homme en tant qu’il est conscient de sa puissance d’exister. À cet effet, « un homme qui désire est(…) un homme qui prend conscience de son affirmation. » (D. Pimbé, 1999, p.43). Par le conatus, l’homme est ontologiquement puissance d’exister, un désir d’être soi-même ; il se caractérise par une force d’exister qui le détermine à actualiser indéfiniment son être. La puissance devient ainsi un critère ontologique de conservation de soi, elle conduit simultanément à l’affirmation et à la conservation de l’individu. Cette force qui ne peut manquer de s’exprimer dans l’individu définit la matérialité de la vie politique. Pour Spinoza en effet, la puissance de l’État est détenue par la puissance politique de la multitude agissant comme un seul individu et comme un seul corps. Cependant, cette puissance de la multitude n’est que le produit de la combinaison des conatus des individus. Il suit que notre auteur fonde la dynamique de sa politique sur la puissance constitutive de l’individu qu’est le conatus. De ce fait, Spinoza confère au problème politique une solution ontologique. C’est ainsi que le pouvoir politique, pour espérer maintenir sa stabilité doit tenir compte des conatus des individus singuliers, c’est-à-dire leur Désir ; d’où la négation du contrat au profit de la conservation de l’être, du principe qui définit l’essence de l’individu humain.
On voit que l’usage du concept conatus chez Spinoza n’est pas fortuit, car il a des implications significatives sur le plan anthropologique et politique. D’abord sur le plan anthropologique, avec le conatus, il faut comprendre l’homme comme un être naturel ou comme un élément de la Nature qui ne peut manquer d’exprimer en son être singulier la puissance de cette Nature. Dans cette perspective, l’homme ne peut s’affranchir des lois de la Nature, il se trouve entièrement soumis aux lois de la Nature. Ensuite, avec le conatus, l’homme est vu comme un être autonome cherchant ce qui peut accroître sa puissance d’exister. Il n’y a donc pas de norme transcendante ou supérieure face à laquelle il doit s’incliner. Le conatus conduit donc à l’expression de l’affirmation de la liberté entière de l’individu. Sur le plan politique, cela conduit à concevoir l’homme comme un être entièrement libre ; sa liberté le conduit à agir comme bon lui semble, à tout mettre en œuvre pour affirmer sa puissance d’exister. C’est pourquoi, il est nécessaire de comprendre l’homme comme un être qui « agit d’après les lois de sa nature et sans être contraint par personne. » (B. Spinoza, 2005, p.103). L’homme est de ce fait un être qui déploie sa puissance ontologique et indéfinie de conservation de soi. Il suit qu’ « il n’y a ni rupture entre l’état de nature et l’état civil ni suppression du droit naturel au profit du droit positif, car la volonté de l’État n’est que le prolongement et l’expression naturels de la volonté de tous ». (C. Jaquet, 2005, p. 105).
La Cité assure dès lors sa puissance dans le fait que « les hommes trouvent la garantie de leur statut d’êtres libres dans la réalité d’un monde où ils ont ensemble projeté et objectivé leurs propres désirs » (P. Macherey, 2015, p. 222). Avec le conatus ou désir « se met en place la représentation d’un monde naturellement fait pour l’homme et à sa mesure, qui constitue le cadre dans lequel il pourra réaliser sa liberté. » (Ibidem). Il suit que les individus animés de leur conatus se donnent le pouvoir d’instituer un régime souverain puisque conçu et adapté à leurs aspirations légitimées par leur conatus collectif. La souveraineté qualifie la nature d’une puissance qui n’est aucunement soumise à une puissance extérieure. La puissance souveraine qui ne dépend donc que de soi pour agir est nécessairement absolue. La souveraineté est donc un concept légitimé par la puissance infinie de la substance organisant les choses de l’univers, mais on ne saurait le ( le concept de souveraineté) réduit à un aspect purement ontologique, car ce concept peut trouver son expression dans le domaine politique puisqu’il peut caractériser un pouvoir politique qui se détermine à agir que par soi en dehors de toute injonction d’un pouvoir transcendant. La matérialité de la souveraineté de l’État n’est qu’une conséquence logique de la caractérisation de Dieu comme puissance souveraine, car « qui a la force de se conserver a aussi la force de se créer, c’est-à-dire n’a besoin d’aucune cause extérieure pour exister, sa seule nature étant pour lui cause suffisante d’exister ». (B. Spinoza, 1964, p. 262). La politique souveraine permet donc à l’État de se conserver en tirant de lui-même la puissance nécessaire à sa conservation. L’État souverain existe à cet effet nécessairement, c’est que sa puissance d’exister découle de sa nature propre. La vie politique se décline ainsi en un jeu dynamique d’affrontement des puissances, c’est-à-dire des conatus singuliers. Ce rapport de force permanant nous aide à comprendre le matérialisme qui caractérise la politique de notre auteur. Dès lors, nous sommes à mesure de comprendre les manifestations politiques de ce système ontologique.
2. Les manifestations politiques de l’ontologie
2.1. La puissance de la multitude
Chez Spinoza, la multitude n’est que l’agrégation des puissances des individualités singulières. Ce qui fait que « la force de l’État(…) n’est que l’ensemble des forces individuelles. » (L. Brunschvicg, 1971, p.15). La multitude est la puissance qui détient le pouvoir politique dans la philosophie politique de Spinoza. En tant que puissance politique, elle nous permet de comprendre la matérialité de la vie politique. En ce sens la puissance politique a pour mesure la puissance du peuple lui-même et elle n’a pas d’autre protection que le peuple. (B. Spinoza, 1965, p. 68). La multitude, en tant que concept, est ce qui permet tout à la fois de penser le vide que l’écroulement de l’ordre théologico-politique ou théocratique (dans sa légitimité et sa vision du monde) crée soudain et le nouvel ensemble constitué par, ces individualités en guerre potentielle, trop égales, trop semblables, trop différenciées, trop opposées, surgissant dans ce vide, sans aucun ordre préalable, rien précisément de transcendant ni d’unifié. Entre la multitude et le peuple, les citoyens au moment où fictivement (ou bien par le jeu d’élections démocratiques) ils quittent volontairement l’état de la multitude pour autoriser un souverain à gouverner. Une fois le souverain constitué, la multitude devient son « peuple », son sujet, mais à partir d’une légitimité moderne et sans que les individus puissent être jamais totalement soumis.
Chez Spinoza, la multitude est concept de composition de puissances, de source de pouvoir politique en tant qu’il suppose toujours des puissances en action, un concept qui autorise en même temps de penser la résistance au pouvoir lui-même, pouvoir d’État qui exprime les puissances (les pouvoirs de pensée et d’action des individus) et s’en sépare à la fois. Un pouvoir politique qui peut à tout moment tenter de couper les puissances d’elles-mêmes, affaiblir les individus, les prive de leurs potentialités. Dans le concept spinoziste de multitude, le politique et la politique s’affrontent, mais sur fond d’une ontologie de puissance. Multitude est un concept qui fait le pont entre l’ontologie et le politique. Chez Spinoza, le principal champ de bataille n’est pas celui des dominés contre les dominants, mais celui des individus face à eux-mêmes. La politique ne se joue pas dans le politique. Le choix du politique, du meilleur gouvernement possible, doit se faire en considération de ce qu’il permet dans la politique, dans ce qu’il autorise pour que les individus se libèrent de leurs passions tristes et accèdent pleinement à l’exercice de leur puissance propre. Elle se joue en définitive dans l’émergence difficile d’hommes libres.
Les hommes ne deviennent libres que dans une éthique, dans une manière de vivre. La politique n’est pas au poste de ‘’commandement’’. Elle n’est qu’une transition de l’actualité formidable de Spinoza : voir que l’essentiel se joue, non au sommet d’un État, mais dans les facultés de connaissance, de coopération, de générosité, d’autonomie que les individus parviennent à développer. « Il est utile aux hommes d’avoir des relations sociales entre eux, de s’astreindre et lier de façon qu’ils puissent former un tout bien uni et, absolument, de faire ce qui peut rendre les amitiés plus solides. » (B. Spinoza, 2005, p. 295). »
L’homme n’est qu’une partie de la nature, qui ne peut se concevoir sans les autres ; il faut nécessairement penser l’institution de l’État en se fondant sur l’interdépendance des parties, leurs relations et interaction et non sur leur séparation et leur autonomie illusoire. C’est pourquoi Spinoza ne part pas des individus épars, du sujet singulier, mais de la multitude. « Ce concept, qui met en jeu la pluralité indéfinie des hommes, ne renvoie pas seulement à un nombre indéterminé et à l’addition des particuliers ; il désigne un ensemble d’individus susceptibles de devenir une communauté en raison de leur rapport de convenance et des notions communes qu’ils possèdent » (B. Spinoza, 1965, p. 268). La constitution d’une cité politique est l’organisation d’une multitude qui noue des rapports affectifs de plus en plus complexes et qui par le jeu de l’imitation des affects, le partage des craintes et d’aspiration communes, élabore des règles exprimant la puissance collective.
Pour exister, il ne suffit pas de se monter et de se connaître, il faut encore se construire, exercice que nous faisons tout au long de notre vie, en quelque sorte comme l’homo viatus qui cherche la réponse à la question de son existence, puis donner une suite à ses idées et à ses objectifs, c’est-à-dire s’organiser comme un être humain vivant en harmonie avec son entourage. « Tout être humain naît dans un environnement social qui construit l’individu » (T. Pradeu, 2010, p. 186). La plupart des gens sont façonnés à la forme de leur culture, grâce à l’énorme malléabilité de leur nature. La socialisation est une internalisation d’altérité, c’est-à-dire qu’elle est toujours l’intégration par l’individu, de manières de penser et d’agir qui viennent d’autrui. « L’identité d’un être humain est toujours le produit des influences d’autrui » (T. Pradeu, 2010, p. 186). L’identité est le produit d’un ensemble de comportements.
Cependant la hiérarchisation et la distinction identitaire entraîne des crimes et des génocides. L’identité de la multitude dont nous parlons n’est pas celle des ethnies. Car l’ethnie est une classe d’être d’origine ou de condition commune. Son emploi et son usage sont source de conflits tribaux. L’identité de la multitude devrait aboutir à la création d’une nation solide et prospère. La nature ne crée pas de peuples, elle ne crée que des hommes. Ce qui crée les peuples, ce sont les lois, les mœurs, les langues c’est-à-dire la culture.
Le contrat ne peut, à lui seul, produire l’adhésion des individus à la société. Ce sont les affects qui sont à l’origine de la société, le contrat n’est qu’une fiction. Il produit néanmoins des affects réels : il contribue à atomiser les individus qui cherchent, en retour, à résister à ce processus en se rassemblant. La théorie dont émane le contrat, suppose en effet que les êtres rationnels préexistent et que celui-ci, en retour, fait reposer sur l’engagement de leur volonté, la responsabilité de leur intégration sociale. Or Spinoza a bien montré que cet individu-là est une abstraction : « aussi longtemps que le droit naturel humain est déterminé par la puissance de chacun, ce droit sera en réalité inexistant ou du moins n’aura qu’une existence purement théorique puisqu’on n’a aucun moyen assuré de le conserver » (B. Spinoza, 2005, p. 21). Le lien social est tissé par les passions car l’homme, en général, est un être de désir. Mais la constitution affective du social désagrège l’État en même temps qu’elle prépare sa reconstitution. Le jeu des affects sociaux ne cesse de composer et de recomposer la société.
La nation se définit d’abord par la convergence de croyances collectives et de désirs partagés. Les lois ne tirent pas leur pouvoir de leur nature intrinsèque, mais seulement du fait que les affects de la multitude les acceptent comme telles. Et donc l’État le plus fort est celui qui s’appuie sur la capacité à susciter l’espoir d’obtenir un bien plus grand, ce qui suppose une capacité collective à étayer l’attente positive des individus et à soutenir les passions qui vont dans le sens de la concorde civile. Inversement, l’État est d’autant plus faible qu’il s’appuie sur la crainte et finalement au sein du grand nombre cette passion antisociale qu’est l’indignation.
C’est vrai que la politique est l’art de faire vivre ensemble les hommes ; elle doit aussi gérer les conflits. La grande difficulté de la politique consiste à faire des individus un seul peuple. Les Hébreux sont parvenus à cette unification grâce au monothéisme et l’idée de théocratie. La théocratie était pour ce peuple une idéologie extraordinaire, où l’obéissance de tous à Dieu impliquait que personne ne fût soumis à un autre homme. Bien entendu, le système avait des désavantages : il était rigide, empêchait le développement de relations fortes avec le monde et misait plus sur la crainte religieuse que sur la rationalité ce qui, en outre, avec le plus d’efficacité, non seulement les attachait au sol de la patrie, mais aussi les engageait à éviter les guerres civiles et à écarter les causes de discorde. « C’était que nul n’avait pour maître, son semblable, mais Dieu seul, et que l’amour du concitoyen, la charité envers lui, passaient pour la forme la plus élevée de la piété, la haine qui leur était commune envers les autres nations et celle qu’elles leurs rendaient, entretenaient cet amour » (B. Spinoza, 1965, p. 294). Mais ce système a assuré des siècles de paix et de prospérité au peuple hébreu. Ce lien religieux et culturel a stabilisé et fortifié cet État.
2.2. De la liberté du citoyen
Les droits fondamentaux, communément appelés droits naturels sur lesquels se sont penchés les penseurs du contrat et Spinoza, ont eu une importante influence sur plusieurs constitutions politiques du monde (Angleterre, France, États-Unis). C’est cette influence qui a conduit à la naissance des droits de l’homme : « les idées éclairées du 18e siècle français sont héritières des anglaises mises en avant par Locke.» (J.-M. Becet et D. Colard, 1982, p. 82). Les droits de l’homme sont une reprise des droits naturels inaliénables qu’évoquait Spinoza (la liberté d’expression, la liberté de penser, la liberté religieuse, la propriété, la prise de décision hautement politique). Les droits de l’homme sont le produit de la modernité. Leur apparition est liée à un contexte intellectuel et philosophique de l’Europe au XVIIème et XVIIIème siècle, caractérisé par la croyance dans le progrès, dans les vertus de la science, dans l’universalité de la raison.
En effet, aucun maître ou souverain ne peut parvenir à extorquer sans dommages les droits fondamentaux. Car pour des droits qui relèvent de la raison, il apparaît impossible de les transférer à quiconque. Il serait absurde, parce que totalement impossible, que les gouvernants exigent que leur soit transféré le droit de faire produire à la raison autre chose. C’est pourquoi l’expression libre des croyances et des opinions reste fondamentale chez Spinoza.« La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne constitue pas une rupture avec le passé. Les révolutions n’ont pas fait table rase du passé mais œuvre d’héritiers » (J.-M. Becet et D. Colard, 1982, p. 82).La présente déclaration est l’aboutissement d’une lutte débutée par Spinoza et bien d’autres. Car la déclaration universelle des droits de l’homme dit ceci :
Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. Cf. Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 18.
On peut distinguer deux sortes de droits dans la déclaration des droits de l’homme. On peut rassembler, nous semble-t-il, sous la catégorie des « droits de l’humain », la liberté d’opinion, la liberté d’expression et de presse, la propriété, la sûreté face à la police et à la justice ainsi que l’égalité devant la loi et l’égalité d’accès aux emplois public. On peut considérer que ces droits civils garantissaient l’individu contre le pouvoir, bien que le pouvoir ne constitue pas, par ailleurs, la seule menace pour une liberté individuelle. On peut appeler « droits politiques », l’ensemble constitué par la participation à la formation de la loi, le contrôle de l’impôt et de l’administration. Ce deuxième groupe de droits apparaît comme ayant pour effet indirect de renforcer le pouvoir.
Il est impossible aux gouvernants et à quiconque de modifier les affects par lesquels les hommes jugent de toute chose, mais aussi il leur est impossible de les dissuader de désirer exposer publiquement leurs jugements afin d’imposer leurs croyances aux autres par un affect de glorification. Il faut accorder la liberté qu’il est « impossible de comprimer » (B. Spinoza, 1966, p. 51) non comme un pis-aller, mais comme un élément nécessaire à la reforme et la conservation de l’État. Car « renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs » J.-J. Rousseau, 2012, p. 51). La renonciation à sa liberté est incompatible avec la nature de l’homme.
L’État souverain, État de droit, doit assurer des garanties réelles afin que chaque être humain puisse se développer comme personne libre. L’État doit placer la liberté individuelle au centre des lois. La liberté de conscience ne peut s’exercer que lorsque la raison est vraiment libre. Comprimer ou restreindre la raison, c’est asservir la liberté. La liberté de l’esprit est ce qu’il y a de plus précieux au monde. Aucun dogme ne doit limiter la recherche de l’humanité qui est une commission d’enquête dans l’univers. « La fin de l’État n’est de faire passer les hommes de la condition d’être raisonnable à celle de bêtes brutes ou automate» (B. Spinoza, 1965, p. 329). La fin de l’État comme République, c’est la liberté.
La liberté est la base véritable de la légalité et de la solidarité. La connexion nécessaire entre la liberté et l’égalité définit la laïcité et le droit. La liberté individuelle peut s’exercer pourvu que l’égalité des droits puisse être assurée par l’État dans un régime démocratique. L’égalité favorise la liberté et cette dernière donne l’impulsion morale qui déclenche la réalisation des conditions de l’égalité. « Étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un autre par rapport à sa vie ; à sa santé, à sa liberté, à son bien » (J. Locke, 1994, p. 145).
L’État, ce n’est pas autre chose que l’ensemble de tous les citoyens, ce n’est pas autre chose que la collectivité, c’est nous, c’est vous, c’est nous tous. L’État c’est un bien commun et un bien social : il est social dans la mesure où il exige que les individus agissent collectivement et en vertu de leur qualité de citoyen pour se le procurer ; et il est commun dans la mesure où il ne saurait posséder une réalité pour certains individus sans avoir du même coup une réalité identique pour tous. Seul le citoyen d’un État libre peut jouir de la liberté individuelle. « La fin de l’État est donc en réalité la liberté » (B. Spinoza, 1965, p. 329).
Dans une République les lois sont adéquatement formées et si loin d’être hostiles à la liberté des citoyens. Ces nobles lois sont constitutives de la République. Les véritables droits de l’homme sont les droits du citoyen comme droit politique et de participation au pouvoir, essentiellement par le suffrage universel. « La République Politique est née en 1789 avec la proclamation souveraine des droits fondamentaux qui a donné à tout individu, indépendamment de ses origines sociales, la même dignité et les mêmes droits » (P. Drouin, 1995, p. 82). En tant que forme d’organisation, la République favorise la dignité pour toutes les personnes de la nation, elle est du reste devenue un modèle qui a inspiré les régimes démocratiques. L’État n’est donc pas l’expression des gouvernants même si ceux-ci dominent. La République est une structure institutionnelle qui convient mieux à l’État démocratique parce que dans la République, forme nécessaire du droit, les citoyens peuvent tracer eux-mêmes la règle commune de leurs actions.
Le gouvernement de l’État moderne n’est pas uniquement une organisation de domination. L’Etat aujourd’hui est plutôt l’expression de la démocratie politique au sein de laquelle la puissance des citoyens peut grandir. La République est donc l’organisation politique qui incarne le mieux l’idéal démocratique puisqu’elle repose sur la souveraineté pleine et entière du peuple. La démocratie est avant tout l’égalité des droits et la souveraineté politique du peuple. La démocratie évolue progressivement dans le monde en même temps que la philosophie. Et la démocratie ne peut se développer que par la reconnaissance du droit de la personne à la liberté. Ce droit ne doit être ni relatif ni précaire, mais absolu et définitif, car c’est par l’affirmation de la liberté que tous les êtres humains peuvent devenir égaux entre eux.
La démocratie est le seul régime fondé sur le citoyen et qui appelle son développement perpétuel. C’est vrai qu’à l’origine des critiques de la démocratie la probabilité qu’elle porterait en elle une anarchie contraire à la stabilité indispensable de tout régime politique, était susceptible mais la révolution individuelle fut opérée par Spinoza. La réconciliation spinoziste de la liberté de l’esprit et de l’ordre politique fait de la démocratie le meilleur régime non seulement du point de vue de l’individu singulier, mais aussi de celui de la conversation politique. Ce n’est en tant qu’il est libre que l’individu conçoit la nécessité de son inclusion dans son espace politiquement organisé et accepte de se soumettre au bon gouvernement. Un citoyen exemplaire n’est libre que dans une société peuplée d’autres citoyens. L’existence du citoyen est plurielle : « outre que, dans un État démocratique, l’absurde est moins à craindre car il est presque impossible que la majorité des hommes unis en un tout, si ce tout est considérable, s’accordent en une absurdité». (B. Spinoza, 1965, p. 267). C’est pourquoi il est fondamentalement important que les citoyens obéissent à l’État.
Les droits de l’homme ne peuvent exister que dans une démocratie et, réciproquement, on n’est pas dans une démocratie si l’ensemble des droits fondamentaux ne sont pas respectés. Mais les droit sont voués à l’inachèvement : parce que l’État-nation fait obstacle à une véritable universalité des droits de l’homme ; parce qu’aucun droit ne peut être absolu .Ce qui oblige à imaginer des équilibres instables et précaires entre des impératifs opposés. « Les droits de l’homme sont sans cesse confrontés à de nouveaux défis, qui obligent à repenser les normes juridiques à la lumière des questions inédites qu’ils soulèvent.» (D. Lochak, 2009, p. 6).
Conclusion
La vie politique se décline en un jeu dynamique d’affrontement des puissances, c’est-à-dire des conatus singuliers. Ce rapport de force permanant nous aide à comprendre le matérialisme qui caractérise la politique de Spinoza et de comprendre aussi les manifestations nécessaires de ce système ontologique à travers les modalités concrètes de la vie politique. Car l’individu à l’état de nature devenu citoyen à l’état civil ne sépare pas son être singulier du corps collectif dont l’État est l’expression politique. C’est le rapport entre l’individu, la loi et l’État. La loi n’est pas ce qui limite l’usage de la liberté humaine. En tant que loi rationnelle, elle est l’expression de la liberté : liberté, non pas naturelle, purement égoïste, mais la liberté civique des citoyens conduits par la raison : « ainsi cet État est le plus libre, dont les lois sont fondées en droite raison, car dans cet Etat, chacun dès qu’il le veut, peut-être libre, c’est-à-dire de son entier consentement sous la conduite de la raison » (B. Spinoza, 1965, p. 268). La citoyenneté est la somme de la vie rationnelle et la liberté de vivre en commun. Car la morale ne dépend pas du moi mais de la société tout entière.
Références bibliographiques
BECET Jean-Marie et COLARD Daniel, 1982, Les droits de l’homme et du citoyen Laurent Richer, Paris, Economica.
BRUNSCHVICG Léon, 1971, Spinoza et ses contemporains, 5 ème Édition, Paris, Les presses universitaires de France.
JAQUET Chantal, 2005,Les expressions de la puissance d’agir chez Spinoza, Paris, Publications de la Sorbonne.
CLÉMENT Élisabeth, DÉMONQUE Chantal, HANSEN.-LOVE Laurence, KAHN Pierre, 1997, Pratique de la philosophie de A à Z, Paris, Hatier.
DION Yodé Simplice, 2006, « Sciences et pouvoir dans la philosophie de Spinoza », thèse unique de doctorat de philosophie », sous la direction de Biaka Zasseli Ignace, Thèse présentée et soutenue devant l’Université de Cocody- Abidjan.
DROUIN Paul, 1995, « La pensée politique de Jean Jaurès », in Horizon philosophique, vol.5, n° 2, Paris.
FATEN Karoui-Bouchoucha, 2010, Spinoza et la question de la puissance, Paris, Harmattan.
GIOVANNONI Augustin, 1999, Immanence et finitude chez Spinoza, Paris, Kimé.
LOCHAK Daniel, 2009, Les droits de l’homme, Paris, La Découverte.
LOCKE John, 1994, Traité du gouvernement civil, trad. David Mazel, Paris, Garnier Flammarion.
MACHEREY Pierre, 2015, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La première partie. La nature des choses, 3 ème tirage Paris, P.U.F.
MACHEREY Pierre, 1997, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La cinquième partie, les voies de la libération, 2 ème édition, puf.
ONFRAY Michel, 2017, Décadence. De Jésus à Ben Laden : vie et mort de l’occident, Paris, Flammarion.
PIMBÉ Daniel, 1999, Spinoza, Paris, collections « Philosophes ».
ROUSSEAU Jean-Jacques, 2012, Du contrat social, Paris, Garnier Flammarion.
RUSS Jacqueline, 1997, Histoire de la philosophie, de Socrate à Foucault, Paris, Hatier.
SPINOZA Baruch, 2005, Éthique, trad. Robert Misrahi, Paris, Éditions de l’ÉCLAT.
SPINOZA, Baruch, 1966, Traité politique, trad. Charles Appuhn, Paris, Flammarion.
SPINOZA, Baruch, 1965, Traité théologico-politique, trad. Charles Appuhn, Paris, Flammarion.
CONTINUITÉ ET DISCONTINUITÉ DANS LA MONADE LEIBNIZIENNE
Mireille Alathe BODO
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’infini et le fini sont des termes corrélatifs. Toute interprétation métaphysique du fini, exige de par sa nature même, qu’on fasse appel à une notion variable, objective de l’infini. Les méditations de Leibniz tournent autour de ces deux notions centrales. Leibniz en propose une conciliation élégante par l’idée que les monades sont douées de perception, c’est-à-dire qu’elles se singularisent par leur capacité à unifier des multitudes composées à l’infini. La monade constitue donc la pierre angulaire de la métaphysique leibnizienne. C’est une substance simple sans parties ayant des actions propres qui changent continuellement leurs rapports. Ce changement de dénomination correspond à l’implantation dans la substance d’un principe actif appelé entéléchie. L’entéléchie comme synonyme de la force métaphysique primitive, est la puissance d’agir constitutive de la substance. C’est un opérateur de substantialité en tant qu’elle recèle l’activité qui est la marque essentielle de la substance. La substance se distingue d’un agrégat par un principe d’unité qui lui permet de demeurer la même à travers le changement continuel de ses opérations et ses modifications.
Mots-clés : Agrégat, appétition, entéléchie, monade, perception.
Abstract :
Infinite and finite correlative terms. Any metaphysical interpretation of the finite, by its very nature, requires that we appeal to a variable, objective notion of infinity. Leibniz’s meditations revolve around two central notions, namely unity and infinity. He proposes an elegant conciliation by the idea that the monads are endowed with perception, that is to say, they are distinguished by their ability to unite multitudes composed to infinity. The monad is thus the cornerstone of Leibnizian metaphysics. It is a simple substance without parts having some specific actions that continually change their relationships. This change of name corresponds to the implantation in the substance of an active ingredient called entelechy. Entelechy as synonymous with the primitive metaphysical force is the constitutive power of substance. It is an operator of substantiality insofar as it conceals the activity which is the essential mark of the substance. Substance is distinguished from an aggregate by a principle of unity which enables it to remain the same through the continual change of its operations and modifications.
Keywords : Aggregate, appetite, entelechy, monad, perception.
Introduction
Leibniz fut le premier philosophe à dégager la loi de la continuité. Selon cette loi, il existe un enchaînement des créatures, une échelle d’organisation successive depuis le minéral jusqu’au végétal, à l’animal et à l’humain. Appliquée à l’espace, la loi de continuité fait rejeter toute idée de vide. C’est le continu qui règne désormais dans la nature. Le rapport de continuité qui unit les monades fait place au rapport d’harmonie préétablie entre les substances. La loi de la continuité est un principe d’invention. Elle est considérée comme un instrument heuristique de découverte. Selon cette loi, il existe un enchaînement des créatures, une échelle d’organisation des monades. C’est une continuité dans la hiérarchie et non une juxtaposition. Appliquée aux mathématiques, la loi de la continuité conduit Leibniz à l’invention du calcul infinitésimal. Le calcul infinitésimal a amené des changements fondamentaux non seulement dans toutes les branches des mathématiques, mais aussi dans la plupart des domaines de la science. Cet enchaînement entre les substances, nous permet de comprendre l’articulation entre le flux continu de la connaissance et la rupture de la découverte en sciences, mais aussi la diversité des controverses à leur sujet. D’ailleurs, c’est ce qu’Hegel souligne dans l’histoire de la philosophie, en affirmant que tout ce qui existe, mérite de périr, parce qu’il contient déjà les contradictions qui causeront sa perte. Comment concilier alors continuité et discontinuité dans une même réalité ? Autrement dit, comment subordonner deux termes apparemment contradictoires dans une même réalité telle que la monade ?
1. L’historique de la notion de monade
La monade est une unité d’être. Elle se comprend par son dynamisme interne, sa force qui se répercute de façon identique à tous les niveaux de l’univers. Le problème consiste à savoir comment nous connaissons cette force. Pour mieux comprendre cette idée, nous définirons la monade.
1.1. Définition de la monade
L’idée d’atome avait fait son apparition dans la philosophie grecque avec Démocrite. Mais Démocrite faisait de l’atome, le plus petit élément constitutif de la matière. Leibniz, philosophe allemand à cheval sur le 17ème siècle et le 18ème siècle, laisse de côté l’atome pour s’intéresser à la monade. Ce concept de monade d’origine pythagoricienne, constitue pour Leibniz, une innovation importante pour dépasser le dualisme cartésien. L’idée d’une substance simple, éventuellement appelée monade, s’impose jusqu’à rompre avec les écrits précédents où Leibniz avait défendu l’idée d’une substance corporelle composée d’une forme substantielle unie à un corps constitué d’un agrégat de substances corporelles. M. Fichant (2004, p. 219), affirme : « La monade chez Leibniz, n’est autre chose qu’une substance simple qui entre dans les composés, simple, c’est-à-dire sans parties. » Les monades sont donc de véritables atomes de la nature, en un mot, les éléments des choses. Elles n’ont ni portes ni fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. « La monade est un point, mais un point métaphysique dont l’activité consiste en le dépliement ou le développement continu de ses replis. C’est un miroir vivant représentatif de l’univers suivant son point de vue »,écrit (M. De Gaudemar, 2001, p. 39). Elle renferme une sorte de perception et d’appétition. Elle est le miroir du monde, parce qu’elle est l’image inversée de Dieu, le nombre inverse de l’infini. L’essentiel de la monade, c’est qu’elle a un sombre fond. Elle en tire tout, et rien ne vient du dehors, ni ne va au dehors. C’est une pièce sans porte ni fenêtre, où toutes les actions sont internes. C’est d’une manière métaphysique que les monades agissent les unes sur les autres.
Aux perceptions claires d’une monade, répondent les perceptions confuses d’une autre monade. Toutes les monades sont douées de perception, et chaque monade perçoit l’univers de son point de vue. Chacune des perceptions de la monade, est la représentation du multiple dans l’unité. Dieu pense la monade comme son propre inverse, et la monade n’exprime le monde que parce qu’elle est harmonique. L’harmonie préétablie sera dès lors, une preuve originale de l’existence de Dieu. L’enveloppement est le repli ou les replis de l’univers infini en la monade indivisible et infinitésimale. L’image de l’enveloppement permet de penser que la monade, dans sa simplicité ou dans son unité, contient l’univers infini et infiniment varié. L’univers est donc composé d’éléments infiniment petits. Tout ce que nous percevons n’est que la somme de ces éléments. Toute substance est comme un monde entier et comme un miroir vivant de Dieu. Ainsi, l’univers est en quelque façon multiplié autant de fois qu’il y a de substances, car chacune exprime à sa façon sa représentation de l’univers selon son point de vue. En ce sens, l’enveloppement peut être identifié à la représentation.
Leibniz en développant la notion de monade met un terme à certains paradoxes et inaugure de nouvelles réformes, c’est-à-dire qu’il introduit un principe actif dans la monade appelé entéléchie. Ce principe actif avait déjà fait son apparition sous d’autres appellations. Il est tel que le précise M. De Gaudemar (2001, p. 39) : « une certaine tendance ou force primitive d’agir, qui est la loi inhérente à cette substance et lui a été imprimée par le décret de Dieu ». Leibniz est donc connu pour avoir rangé tous les êtres de nature sous un même concept, la monade. Mot grec qui signifie unité. Composée d’unités vivantes et agissantes, la nature est pleine de vie. Désormais, dans sa philosophie évoluée, une âme se nomme monade, et tout l’univers en est composé. La monade est donc un atome de substance, c’est-à-dire une réalité immatérielle et dynamique qui fonde l’unité et l’identité d’un vivant. Elle est constitutive de l’âme, comme l’atome est constitutif de la matière. M. De Gaudemar note à ce propos (2001, p. 7-8) : « Chaque âme a un corps organique dont elle fait l’unité. Mais il faut un principe interne d’unité pour qu’il y ait un être véritable. Sans ce principe, l’être n’est qu’agrégat. Et ses éléments ne conspirent pas à former son unité. » Ce parallélisme n’exclut pas la progression des corps aux âmes. Les formes substantielles sont des forces qui ont quelque chose d’analogue à l’appétit et à l’âme. Pour Leibniz, tout est force, tout est âme. Il reste ferme sur la continuité des êtres de nature, qui tous représentent l’univers selon leur point de vue comme des miroirs vivants. Une telle continuité n’empêche pas de prendre en considération des degrés de perfection qui pouvaient donner à certains des prérogatives particulières. M. De Gaudemar affirme en ces termes (2003, p. 53) :
Certaines âmes ont en effet un degré d’expression et donc de perfection qui les habilite à remplir des tâches spécifiques dans l’univers créé par Dieu. Telles sont les âmes raisonnables, dont la raison est à la fois un degré supplémentaire de perfection et une possibilité d’accès à un ordre plus sublime que celui de la nature, où il se trouve pourtant à titre de virtualité.
Il y a donc un ordre de justice et de moralité qui coordonne les personnes. D’où la continuité naturelle qui règne dans l’univers leibnizien.
1.2. De la continuité au calcul infinitésimal
Au 17ème siècle, apparaît dans les écrits de Newton et Leibniz la notion d’infiniment petit. Ils sont donc considérés comme les fondateurs du calcul infinitésimal. Le procédé infinitésimal consiste à trouver à l’intérieur du fini l’opération et la présence de l’infini. Il a permis des progrès spectaculaires avec le développement des ordinateurs à partir des années 1950. En mathématique, le calcul infinitésimal permet le passage du discontinu au continu. Il a ouvert aux mathématiques des voies nouvelles aussi vastes que fécondes, et a permis d’aborder l’étude théorique des problèmes fondamentaux de la philosophie naturelle que sont les relations entre corps naturels et substances métaphysiques. C’est donc une partie essentielle des mathématiques, en cela qu’elle intéresse nombre de secteurs, comme la physique ou la mécanique. En physique, G. W. Leibniz estime que (1966, p. 40) :
L’usage de cette loi est très considérable. Elle porte qu’on passe toujours du petit au grand et à rebours par le médiocre, dans les degrés comme dans les parties… et jamais un mouvement ne naît immédiatement du repos ni ne s’y réduit que par un mouvement plus petit comme on n’achève jamais de parcourir aucune ligne ou longueur avant que d’avoir achevé une ligne plus petite.
Les perceptions viennent par degrés de celles qui sont trop petites pour être remarquées. La spécificité de la philosophie de Leibniz concernant le calcul infinitésimal est que Leibniz veut lier l’infini et le fini. Il fait découvrir l’infiniment petit. Le tout pour lui, n’est pas seulement une addition de parties, mais une intégration des parties dans une unité supérieure. Le réel pour Leibniz, est un continu dont on ne peut puiser les parties. On ne pense plus le fini et l’infini séparément, par opposition à Descartes qui pose une rupture entre l’homme fini créé par l’infini qui est Dieu. À cet effet il écrit : « L’homme possède une idée de l’infini. Il est capable de concevoir à sa manière limitée, l’infini. » (R. Descartes, 1992, p. 57).
Le calcul infinitésimal est un passage du discontinu au continu. Il est l’un des plus formidables accomplissements de l’esprit humain. C’est un si puissant instrument de recherche qui a changé la face des mathématiques pures et appliquées. Il nous a permis de comprendre les états changeants dans chaque monade. Et comme tout est question de degré de perfection, Leibniz montre qu’aucune substance n’est absolument méprisable devant Dieu. Il y a un nombre infini de degrés de perfections. Les individus sont tous différents. Chaque être est une composante de la perfection du monde. Comme le souligne G. W. Leibniz (1969, p. 170) en ces termes : « une bonté infinie ayant dirigé le créateur dans la production du monde, tous les caractères de science, d’habileté, de puissance et de grandeur qui éclatent dans son ouvrage, sont destinés au bonheur des créatures intelligentes. » La félicité de toutes les créatures raisonnables est donc un des buts que vise le créateur. C’est pourquoi, le malheur de quelques-unes de ces créatures peut arriver par concomitance, c’est-à-dire lié avec les plus grands biens. Ce mélange de composé montre que tout est lié dans l’univers leibnizien. Rien n’est méprisable. Il n’y a pas de vide, ni même de stérilité. Il y a au contraire, une gradation continuelle des espèces de la nature. La question de l’infini est donc centrale dans la compréhension de la continuité. Tout commence par une certaine progression. G. W. Leibniz écrit (1966, p. 131) : « La gradation des espèces découle du principe métaphysique de continuité. Tout va par degrés dans la nature, et rien par saut. » Cette règle à l’égard des changements est une partie de la loi de continuité. La loi de changement fait l’individualité de chaque substance particulière. Il y a des monades à tous les degrés de clarté et d’obscurité. Tout se distingue par le degré, tout diffère par la manière. Il y a une continuité de toutes les existences. Ce principe de continuité est un principe de philosophie naturelle suggérant que dans la nature, les choses changent graduellement. Cette idée a été énoncée par Aristote, puis elle a été élevée au rang d’axiome en sciences par Leibniz. C’est ce principe de continuité que Darwin développe dans sa théorie de l’évolution de l’espèce formulée en 1859 dans L’origine des espèces, où il démontre qu’il y a des changements graduels des espèces qui peuvent être rapides ou lents, mais qui aboutissent à la formation de nouvelles variétés. Avec lui, on parle donc de sélection naturelle.
Cependant avec Leibniz, on parle de la loi de continuité ou principe de continuité. En vertu de cette loi de continuité, Leibniz soutient qu’il n’y a aucune interruption dans les actes de la conscience, qui pense toujours, comme le sang circule toujours sans que l’homme s’en aperçoive. La loi de continuité montre la liaison qui existe entre les différentes parties du monde. Tout dans le monde de la matière est en action réciproque. Le changement d’une partie du monde s’étend à toutes les autres parties. Toute monade représente plus ou moins clairement l’univers entier, de même que tout point particulier de l’univers physique éprouve tout ce qui se passe dans l’univers entier. Tout l’univers leibnizien est donc hanté par le principe de continuité. Le commencement et la fin, la naissance et la mort n’étaient pour Leibniz, que des phénomènes, les manifestations d’un processus de contraction, de développement, d’obscurcissement ou d’éclaircissement des monades. Les ruptures et les différences absolues disparaissaient, à mesure qu’elles comprenaient plus clairement les nuances individuelles infinies de la vie. En un mot, la différence cesse d’être extrinsèque et sensible, c’est-à-dire qu’elle s’évanouit en ce sens, pour devenir intrinsèque, intelligible ou conceptuelle, conformément au principe des indiscernables. G. Deleuze affirme (1988, p. 88) : « Le principe des indiscernables établit des coupures, mais les coupures ne sont pas des lacunes ou des ruptures de continuité. Elles repartissent au contraire le continu de telle façon qu’il n’y ait pas de lacune. » La continuité ne peut en aucun cas faire évanouir la différence. Ce qui s’évanouit, c’est seulement toute valeur assignable des termes d’un rapport, au profit de sa raison interne qui constitue précisément la différence. La différence entre deux individus doit être interne et irréductible, c’est-à-dire tendre vers 1, tandis qu’elle doit s’évanouir et tendre vers 0, en vertu de la continuité. Il y a un reflux de la continuité sur les âmes dans l’accord des deux instances. Autrement dit, il y a une infinité de degrés dans les monades en continuité. Selon la loi de continuité, les vraies unités ne sont pas matérielles. Elles sont absolument simples et indivisibles. Le principe de continuité est indispensable à la compréhension de la monade. Il consiste à dire que la nature ne fait pas de saut, ni de bond. Cela signifie qu’une chose ne peut passer d’un état à un autre brusquement. De la graine à l’arbre, il y a une infinité d’états intermédiaires. Le réel est un continu dont je ne peux pas faire le tour. Tout ce qui est réel est donc intelligible. Il n’y a pas de vide dans la hiérarchie des êtres, comme dans l’espace. Les vérités de fait sont liées au principe de continuité. Le principe de continuité est le critère ultime du choix de Dieu. La continuité est le prolongement d’un événement remarquable sur une série jusqu’à l’événement singulier remarquable suivant.
Énoncé pour les règles du mouvement, le principe de continuité permet de considérer le repos comme un mouvement infiniment petit, l’égalité comme une inégalité infiniment petite. M. De Gaudemar, explique que (2001, p. 22) : « Chez Leibniz, tout changement implique une transition d’un état à un autre, et l’on peut progresser à l’infini dans l’assignation de ces états successifs. » Nous pouvons de la même manière supposer, au principe des perceptions remarquables ou distinguées, une infinité continue de perceptions insensibles qui font la transition d’une perception à une autre. Le principe de continuité s’applique donc aux petites perceptions. Et c’est ce qui explique le lien entre perception et appétition. Toute perception enveloppe un mouvement de l’être qui est l’embryon de l’action. L’activité perceptive fondamentale peut se prolonger en pensée expresse. Il y a donc continuité entre les petites perceptions et l’aperception. Chaque perception distincte d’une âme, comprend une infinité de perceptions confuses enveloppant tout l’univers. Ces petites perceptions insensibles produisent une inquiétude qui nous oriente dans un sens ou dans un autre. C’est un aiguillon insensible qui nous pousse toujours de l’avant. Le principe de continuité constitue le monde en tant qu’unité rationnelle. Il dirige la théorie du monde avec ses points continus et discontinus que les monades. Les monades sont principes d’unité. . Elles se rapprochent de l’esprit. Être pour Leibniz, c’est donc agir. Les êtres qu’ils soient spirituels ou matériels, sont composés de monades, c’est-à-dire d’unités de forces, d’atomes énergétiques. Dieu choisit le meilleur et l’être étant préférable au non-être, il n’existe que de l’être. Donc pas de vide dans la création. De la loi de continuité, sont sorties les petites perceptions inconscientes.
2. De la perception a l’aperception
Ici il est question du rapport entre perception et aperception. Comment de la perception aboutir à l’aperception ?
2.1. Les petites perceptions inconscientes
La question de la perception est généralement considérée dans la philosophie de la connaissance. Contrairement à la théorie de Descartes qui stipule que l’homme est essentiellement un être de conscience, Leibniz dans la préface des Nouveaux Essais sur l’entendement humain, démontre que la conscience claire ne constitue pas la totalité du psychisme. Pour lui, il existe des petites perceptions dont nous n’avons pas conscience. L’esprit est perpétuellement soumis à des sollicitations imperceptibles qui nous tiennent en haleine. La théorie de Leibniz sur la perception est très originale, car elle démontre que ce n’est pas seulement les substances simples et inferieures qui ont des perceptions inconscientes, mais aussi les esprits humains. Par sa théorie des petites perceptions, Leibniz montre qu’il faut traiter toutes les quantités perçues quoi qu’elles soient illimitement petites, puisque leur somme donne un résultat fini. Et pour mieux juger ces petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, nous allons nous servir du bruit de la mer dont on est frappé quand on est au rivage. Pour mieux entendre ce bruit, comme l’on fait, il faut bien qu’on entende les parties qui composent ce tout, c’est-à-dire les bruits de chaque vague, quoique chacun de ces petits bruits ne se fasse connaître que dans l’assemblage confus de tous les autres ensembles. En un mot, le bruit de la mer est une unité dont les fondements se trouvent dans la multiplicité des petites perceptions dans sa globalité, il fait apparaître ici, qu’il y a non seulement continuité entre les perceptions inconscientes et l’aperception, mais aussi dérivations. L’aperception du tout dérive de la perception des parties. Il y a donc un passage insensible de l’aperception à la perception insensible. Leibniz évoque les petites perceptions pour expliquer la continuité de la conscience. La perception consciente est l’effet de l’agrégat d’innombrables perceptions individuelles dont chacune demeure sous le seuil de la conscience. Chaque âme connaît l’infini, mais confusément. Comme en me promenant sur le rivage de la mer et entendant le grand bruit qu’elle fait, j’entends les bruits particuliers de chaque vague dont le bruit total est composé, mais sans les discerner. Même les esprits supérieurs aux monades nues, n’ont pas toujours des perceptions conscientes, c’est-à-dire des aperceptions. L’aperception n’est pas seulement la perception consciente, mais la perception tournée vers l’intérieur, la perception de soi.
Bien que Leibniz soutienne avec Descartes que l’esprit est toujours actif, il affirme contre lui que « la pensée est souvent inconsciente. »(G. W. Leibniz, 1966, p. 137). A la lumière de cet enseignement, Leibniz voudrait montrer que nous avons toujours une infinité de petites perceptions, sans nous en apercevoir. Mais nous ne sommes jamais sans perceptions. Mais il est nécessaire que nous soyons souvent sans aperceptions, c’est-à-dire sans perceptions distinguées. L’inconscient est inhérent à toute substance créée et l’on trouve dans l’univers tous les degrés de perception en continuité. Ainsi, si toute monade perçoit, toute monade n’aperçoit pas nécessairement. Ces petites perceptions permettent de comprendre que la conscience s’épanouit au-delà des multiplicités sous-jacentes de l’inaperçu. G. W. Leibniz souligne l’importance des perceptions. À ce sujet, il écrit (1966, p. 40) : « Les perceptions insensibles sont aussi importantes pour la science de l’esprit, de l’âme, comme les corpuscules insensibles le sont pour la science naturelle. » Il est donc nécessaire de les considérer, car elles sont véritablement centrales dans la philosophie de Leibniz. Ces petites perceptions insensibles permettent de comprendre que la perception est une propriété de toute substance. Elle est l’expression active de la monade, en fonction de son point de vue. Mais force est de reconnaître que la monade a plusieurs formes d’expressions actives qui sont ses manières, suivant que ses perceptions sont sensibles, affectives ou conceptuelles. La perception qu’elle soit sensible, imaginative ou rationnelle, permet de concevoir les idées qui deviennent alors des contenus de représentation. L’idée est l’objet immédiat de la perception. C’est ce que soutient Descartes dans ses réponses aux secondes objections (2005, p. 204) : « Nous connaissons des choses de notre pensée et non des choses en soi. Notre connaissance porte sur des idées des choses, dont la réalité représentative est justement désignée sous les termes de réalité objective. » Ainsi par le nom d’idée, nous attendons cette forme de chacune de nos pensées par la perception immédiate de laquelle nous avons connaissance de ces mêmes pensées. Par le nom d’idée, j’entends cette forme de chacune de nos pensées par la perception immédiate de laquelle nous avons connaissance de ces mêmes pensées. Il faut donc voir l’idée d’une chose afin de comprendre le ou les mots qu’on emploie pour la designer. Sans la perception préalable de l’idée de la chose, le terme serait un simple son dépourvu de signification. La perception est donc très importante pour la compréhension d’un objet. Ce sont ces petites perceptions qui forment les impressions que les corps environnants font sur nous, et qui enveloppent l’infini. Elles sont aussi à la base de cette liaison que chaque être a avec le reste de l’univers. Ces petites perceptions sont à concevoir en tant que des changements dans l’âme même dont nous ne nous apercevons pas, parce que trop petites ou trop grandes ou trop unies. Les perceptions de nos sens, lors même qu’elles sont claires, doivent nécessairement contenir quelques sentiments confus, car comme tous les corps de l’univers sympathisent, le nôtre reçoit l’impression de tous les autres, et quoique nos sens se rapportent à tout, il n’est pas possible que notre âme puisse s’attendre à tout, c’est-à-dire tout comprendre. C’est pourquoi nos sentiments confus sont le résultat d’une variété de perceptions qui est tout à fait infinie.
En psychologie, les petites perceptions, les perceptions insensibles sont encore une manifestation de la loi de la continuité, car chaque perception consciente implique une infinité de petites perceptions. Or, ces petites perceptions interviennent partout. Elles forment les goûts, les images, les qualités des sens claires dans l’assemblage, mais confuses dans les parties, elles assurent la liaison de chaque être avec le reste de l’univers. Ce sont ces petites perceptions qui sont à l’origine de nos déterminations. Elles donnent même le moyen de retrouver le souvenir au besoin pour des développements périodiques qui peuvent arriver un jour. Elles gardent les semences de sa restitution, si bien qu’il ne saurait disparaître à jamais. La continuité existe encore dans la hiérarchisation des formes substantielles. Si avec Leibniz, on définit la perception, comme la représentation du multiple dans l’un, de la multitude dans l’unité, on peut distinguer différentes catégories de substances simples d’après les qualités de leurs perceptions. Celles-ci sont obscures, dégradées dans les monades simples, elles sont plus distinguées dans les âmes. Et susceptibles de tendre indéfiniment vers la distinction chez les esprits. Dans la seconde catégorie, la perception s’accompagne de mémoire. Dans la troisième catégorie, elle se double d’un pouvoir de connaissance réflexive et d’une présence de la raison. Si toutes les monades ou substances simples sont douées de perception, seuls les esprits possèdent activité réflexive et pensée. La perception de la substance intelligente enveloppe la possibilité d’une connaissance réflexive, tandis que l’animal ne dépasse pas le sentiment ou l’instinct brut. La réflexion en elle-même suppose en nous l’inconscient, car il n’est pas possible que nous réfléchissions toujours expressément sur toutes nos pensées. Autrement l’esprit ferait réflexion sur chaque réflexion à l’infini sans jamais pouvoir passer à une nouvelle pensée. Par exemple, en m’apercevant de quelque sentiment présent, je devrais toujours penser que je pense, et penser encore que je pense d’y penser et ainsi à l’infini. Mais il faut bien que je cesse de réfléchir sur toutes ces réflexions et qu’il y ait enfin quelque pensée qu’on laisse passer sans y penser, autrement on demeure toujours sur la même chose. Malgré l’existence de l’inconscient, G. W. Leibniz (1966, p.p.98-99) précise : « Qu’on peut dire absolument que l’homme pense et pensera toujours. Car, ce qu’on apporte pour tourner notre sentiment en ridicule sert à le confirmer. » La perception de l’homme est toujours perception humaine et sa mémoire d’un autre ordre que simplement l’écho des consécutions empiriques. Entre ces trois catégories d’âmes, il y a une multitude de formes intermédiaires, car tout vient par degré dans la nature et rien par saut. Il y a donc une continuité qui règne dans la nature des choses. Jamais une perception consciente n’arrive si elle n’intégrait un ensemble infini de petites perceptions qui déséquilibrent la macroperception précédente et préparent la suivante. G. W. Leibniz démontre que (1966, p. 98) : « Ce qui est remarquable doit être composé de parties qui ne le sont pas, rien ne saurait naître tout d’un coup. » Autrement dit, une perception consciente se produit lorsque deux parties hétérogènes au moins entrent dans un rapport différentiel qui détermine une singularité. Les petites perceptions constituent donc l’état animal ou animé par excellence. Le macroscopique distingue les perceptions et les appétitions qui sont passage d’une perception à une autre. Cette connaissance des perceptions insensibles sert aussi à expliquer pourquoi et comment deux âmes humaines ou autrement d’une même espèce ne sortent jamais parfaitement semblables des mains du créateur et ont toujours chacune son rapport originaire aux points de vue qu’elles auront dans l’univers. Leur différence est toujours plus que numérique. En un mot, les perceptions insensibles sont d’aussi grand usage dans la pneumatique[1] que les corpuscules insensibles le sont dans la physique. Il est donc déraisonnable selon G. W. Leibniz de (1966, p. 40) : « Rejeter les uns et les autres sous prétexte qu’elles sont hors de la portée de nos sens. Rien ne se fait tout d’un coup. »
C’est une des grandes maximes de Leibniz et des plus vérifiées que la nature ne fait jamais de sauts. D’où la loi de continuité. Cette loi est très considérable dans la physique. La physique au temps de Leibniz implique ce qu’on appelle force vive, appelée aujourd’hui énergie cinétique. C’est une nouvelle forme de la philosophie naturelle.
Elle porte qu’on passe toujours du petit au grand et à rebours par le médiocre, dans les degrés, comme dans les parties, et que jamais un mouvement ne naît immédiatement du repos ni ne s’y réduit que par un mouvement plus petit, comme on n’achève jamais de parcourir aucune ligne ou longueur avant que d’avoir achevé une ligne plus petite. (G. W. Leibniz, 1966, p. 40).
Et tout cela fait bien juger qu’encore les perceptions remarquables viennent par degrés de celles qui sont trop petites pour être remarquées. Toute substance est perception, mais il ne faut pas confondre perception et conscience. Leibniz faisait déjà la distinction entre ces termes avant même l’introduction de la théorie de l’inconscient chez Freud. En effet, Freud fait de l’inconscient le concept majeur de compréhension de l’esprit humain. A ce sujet, il écrit : « le moi n’est pas maître dans sa propre maison. » (1973, p. 6). La vie consciente de l’esprit ne représente qu’une très faible part auprès de la vie inconsciente.
2.2. L’aperception
Généralement définie comme connaissance réflexive, l’perception est une réflexion accompagnée de conscience. Elle est chez Leibniz l’un des termes les plus connus de sa philosophie. Elle est réservée aux âmes raisonnables. Elle est la conscience que les âmes raisonnables ont de leurs perceptions. En clair, l’aperception est une prise de conscience claire d’une perception, ou d’une connaissance. M. De Gaudemar affirme (2001, p. 11) : « L’aperception est la conscience, ou la connaissance réflexive de l’état interne. » Elle succède toujours à la perception. La perception définit la relation entre un sujet et un objet. Elle est un rapport sensible au monde. Elle n’est pas extérieure à son objet, mais elle est continuité, contact sensible avec le monde. Il y a donc un délai qui sépare le perçu et l’aperçu. G. W. Leibniz (2004, p. 225) le démontre en ces termes :
puisque réveillé de l’étourdissement, on s’aperçoit de ses perceptions, il faut bien qu’on en ait eu immédiatement auparavant quoiqu’on ne s’en soit point aperçu ; car une perception ne saurait venir naturellement que d’une autre perception, comme un mouvement ne peut venir naturellement que d’un mouvement.
L’action du principe interne qui fait le changement ou le passage d’une perception à une autre est appelée appétition. Leibniz effectue un parallèle entre les perceptions et l’appétition. L’appétition est la tendance qui nous pousse continuellement d’une perception à une autre. C’est le principe du changement interne. Elle est régie par des lois des appétits, ou des causes finales du bien et du mal. L’appétition exprime la mobilité des âmes, lesquelles ne sont jamais en repos et tendent constamment à une meilleure harmonie intérieure. Inséparables des perceptions, les appétitions nous mènent à la joie présente. Ce sont comme des mouvements de la nature. Il y en a toujours un grand nombre, insensibles comme les perceptions qui ne sont aperçues que lorsqu’elles deviennent présentes par leur conjugaison avec d’autres inclinations. Il est vrai que l’appétit ne saurait toujours parvenir entièrement à la perception où il tend, mais il obtient toujours quelque chose, et parvient à des perceptions nouvelles. Nous expérimentons nous-mêmes une multitude dans la substance simple, lorsque nous trouvons que la moindre pensée dont nous nous apercevons enveloppe une variété dans l’objet. Ce qui nous oblige à confesser que la perception et ce qui en dépend est inexplicable par des raisons mécaniques, c’est-à-dire par des figures et par les mouvements.
Leibniz pour sa part, nomme celle-ci comme conscience et centre d’activités réflexives. La réflexion de l’aperception, à l’origine et au fondement de la temporalité différenciée de la perception, permet ce retour sur soi, ce reflet de la conscience sur elle-même, dont la perception est démunie. G. W. Leibniz affirme (2004, p. 222) : « Le passage qui enveloppe et représente une multitude dans l’unité, ou dans la substance simple, n’est autre chose que ce qu’on appelle la perception, qu’on doit bien distinguer de l’aperception ou de la conscience. »
La conscience est en effet, réflexion sur son action, ou mémoire de son action en tant qu’on la considère comme sienne. Or l’acte réflexif ne peut se maintenir continuellement, et quand nous dormons par exemple nous sommes souvent dans l’état de simples monades, ou de bêtes seulement capables d’associations d’images. Le sommeil n’est d’ailleurs qu’une des formes de cette inattention qui est notre ordinaire et affecte constamment le sentiment de soi. Mais la personne subsiste quel que soit le degré de conscience, car elle repose sur l’ordre objectif des relations. L’enjeu ici, est que Leibniz veut montrer que c’est l’aperception, faculté active et non passive de l’âme humaine qui se charge de rendre les perceptions claires et distinctes. L’aperception accompagne les perceptions distinctes. La capacité d’aperception ou d’acte réflexif distingue les esprits, ou âmes raisonnables, des autres âmes. L’aperception affirme M. De Gaudemar (2001, p. 12) : « Permet de s’apercevoir de ses sentiments passés et fait paraître l’identité réelle que produisent les perceptions insensibles. Elle prouve encore une identité morale que Leibniz appelle personnalité. » Tout sujet souhaitant atteindre la vérité, doit travailler les données de sa conscience afin qu’il ne tombe pas dans les erreurs d’interprétations. L’aperception est la capacité qui permet un réel dédoublement du sens où le sujet devient pour lui-même objet. La personne agissante, comme sujet de la qualité morale, possède donc une puissance d’agir et de pâtir au sein de toute la nature, et chaque action retentit sur l’ensemble organisé, car tout se tient. Ainsi, pour une vie harmonieuse, nous devons prendre en considération les relations entre nos actions et celles des autres êtres de l’univers.
2.3. Le principe de discontinuité
Les atomistes tels que Leucippe et Démocrite, parlent de discontinuité de l’espace, quant aux cartésiens, ils parlent de continuité de l’espace. Mais ni les uns ni les autres n’ont réussi à rattacher les deux termes. Leibniz quant à lui, n’a cessé de méditer sur le problème du continu et du discontinu. S’il avait fallu faire pencher la balance, c’est du côté du continu qu’il l’aurait inclinée, car le discontinu n’était pour lui qu’un moment dans un progrès. Leibniz apercevait dans le calcul infinitésimal la confirmation de cette équivalence que les contraires ont entre eux, quand on pousse chacun d’eux à la limite. Le repos est pour lui un mouvement évanescent. La loi du repos est comme une espèce de la loi du mouvement. Il y a entre le mouvement et le repos, une différence relative. Le mouvement, c’est ce qu’il y a de réel dans l’existence. En quel cas le mouvement infiniment petit devient repos ?
Par repos, il faut entendre une consistance et une présence constante. Le mouvement quant à lui, est un état changeant et une présence passagère. Le repos aussi bien que le mouvement est un état, ou bien une présence. Le père Pardies écrit (1976, p.108) : « Si nous considérons bien la nature du repos et du mouvement, nous trouverons que le mouvement pourrait être aussi bien appelé une cessation de repos, que le repos est appelé une cessation de mouvement. » Le mouvement et le repos procèdent donc par transformation infinitésimale. Le changement qualitatif renvoie à une unité active qui fait passer un état dans l’instant, mais assure aussi l’ensemble du passage perception et appétit.
La substance représente donc la double spontanéité du mouvement comme événement, du changement comme prédicat. Le principe de discontinuité est une théorie sans coefficients différentiels. Le devenir est à la fois processus de continuité et de discontinuité. Tout changement est fondé sur des modifications non seulement quantitatives, mais qualitatives et donc discontinues. Pour avancer, il faut faire un pas. La continuité est donc l’apparence moyenne d’une série à peu près régulière de discontinuités ; de pas en avant. Chaque espèce vivante est apparue, et cette naissance est une discontinuité de l’histoire. La discontinuité est la propriété caractéristique d’une dynamique qui procède par sauts. Les oppositions notionnelles telles qu’entre mouvement et repos, continuité et discontinuité, montrent que la pensée leibnizienne s’engage dans un jeu extraordinairement subtil, dans un exercice d’équilibrisme intellectuel. La constitution d’un monde rationnel est une tâche infinie des monades associées dont le résultat n’est jamais prévu. La notion de monade autour de laquelle s’articule cette coïncidence est le point d’application de toutes les divergences conceptuelles et la pierre de touche de tout l’édifice métaphysique leibnizien.
Conclusion
Le principe de continuité constitue le monde. Toute la philosophie de Leibniz est donc un effort continu pour montrer que d’une notion à l’autre, d’un être à l’autre, on passe par une série de différences infinitésimales, ou de ressemblances infiniment approchées. Le continu et le discontinu n’existent dans la réalité qu’en unité inséparable dans la monade. Leibniz concilie la continuité nécessaire pour qu’il y ait rationalité et que tout ne surgisse de rien, et la discontinuité sans laquelle il n’y aurait qu’actualisation. La monadologie de Leibniz est donc une théorie de la constitution intermonadique qui se réfère à l’accord harmonique des monades. Cette interconnexion des monades fait que rien ne se passe dans l’une sans affecter si peu que ce soit toutes les autres. Ces liaisons naturelles de toutes les actions et perceptions font une conjugaison universelle ou une solidarité de fait. L’être agissant peut ignorer cette solidarité, mais son intérêt est de la prendre en compte, car elle est la condition de la vie en commun. L’action bonne est celle qui contribue à ce dessein, et qui accroît la perfection de l’ensemble sans nuire aux parties. Le concept de vie est donc au cœur de la métaphysique de Leibniz. La nature pour lui, est pleine de vie. Ainsi, il n’y a rien d’inculte, de stérile, de mort dans l’univers leibnizien. Tout est force, pensée et désir.
Références bibliographiques
BOUVERESSE René, 1994, Leibniz, Paris, PUF.
DE GAUDEMAR Martine, 2001, Le Vocabulaire de Leibniz, Paris, Ellipses.
DELEUZE Gilles, 1988, Le Pli, Leibniz et le baroque, Paris, Éditions de Minuit.
DESCARTES René, 1992, Méditations métaphysiques, Trad. Florence K, Paris, PUF.
FUENTES Carlos, « La Notion de personne », in Magazine littéraire, Leibniz, philosophe de l’universel n°416, Janvier 2003, p. 53.
GUITTON Jean, 1951, Pascal et Leibniz, Paris, Aubier.
HAAR Michel, 1973, introduction à la psychanalyse de Freud, Paris, PUF.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 2004, Discours de métaphysique suivi de monadologie et autres textes, Edition établie, présentée et annotée par Michel Fichant, Paris, Gallimard.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1966, Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain, Trad. Jacques Brunschwig, Paris, Garnier-Flammarion.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1714, Des Principes de la Nature et de la Grâce fondés en raison, Paris, PUF Ed. André Robinet,.
NAERT Émilienne, 1964, La Pensée politique de Leibniz, Paris, PUF.
OLIVO Gilles, 2005, Descartes et l’essence de la vérité, Paris, PUF.
Père Pardies, « Discours sur le mouvement local », in Revue d’histoire des sciences, T.29 n°3-Juillet 1976, p.108.
RATEAU Paul, 2019, Lire aujourd’hui les principes de la nature et de la grâce de Leibniz, Paris, Iliesi digitale.
LE STATUT DE LA MORALE DANS LE COMMUNISME DE MARX ET ENGELS
Gbotta TAYORO
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Le communisme de Marx et Engels se veut scientifique et révolutionnaire. Il se fonde sur le matérialisme historique et refuse les considérations religieuses, idéologiques et surtout axiologiques. Loin des rêves des socialistes utopiques et communistes comme Saint-Simon, Fourier, Owen et Cabet, Marx et Engels veulent s’appuyer sur les faits économiques et leurs évolutions pour défendre leurs idées communistes. Dès lors, se pose la question de la place de la morale qui relève du devoir-être et non du fait empirique. Le communisme marxien est-il fondamentalement amoral au motif que la morale est une variante de l’idéologie et pouvant être caractérisée comme une morale de classe ? Contrairement aux apparences, le projet émancipateur du communisme marxien comme abolition de l’aliénation politique, religieuse, économique, morale, etc., constitue un projet éminemment humaniste et éthique.
Mots-clés : Aliénation, Justice, Liberté, Matérialisme, Morale, Socialisme, Vérité.
Abstract :
The Communism of Marx and Engels is scientific and revolutionary. It is based on historical materialism and rejects religions, ideological and above all axiologic considerations. Far for all dreams of socialist utopians like Saint-Simon, Fourier, Owen, and Cabet, Marx and Engels want to rely on economic facts and their developments to defend their communist ideas. Consequently, the questions arises of the place of morality whichis a matter of must be and not of empirical fact. Is Marxian Communism fundamentally abnormal on the grounds that morality ? Contrary to appearances, the emancipatory project of Marxian communism as the abolition of political, religious, economic, moral alienation, etc., constitutes an eminently humanist and ethicalproject.
Keywords : Alienation, Justice, Freedom, Materialism, Morality, Socialism, Truth.
Introduction
L’abolition de la propriété privée des moyens de production, la réduction voire la suppression des inégalités sociales, la juste répartition des richesses, la socialisation du travail, la centralisation et la planification des opérations de production et de consommation des biens et services générés par le travail collectif, bref, l’avènement d’une société sans fossé abyssal entre riches et pauvres ni exploitation économique de l’homme par l’homme, telles sont les images génériques du socialisme et du communisme. Tout comme les théoriciens pré-marxiens comme Fourier, Saint-Simon et Owen qui, selon K. Marx et F. Engels (1998, p. 112-113) « font leur apparition dans la période du développement embryonnaire de la lutte entre prolétariat et bourgeoisie », les socialistes révolutionnaires et leurs contemporains Proudhon, Weitling, Bakounine, Lassalle, etc., partagent le projet d’une cité humaine définitivement débarrassée des injustices aliénant l’homme. Bien que nourrissant ce même rêve émancipateur pour l’humanité, tous les penseurs socialistes n’ont pas toujours les mêmes analyses ni les mêmes méthodes quant aux voies et moyens pour mettre fin aux distorsions sociales et surtout pour faire advenir la nouvelle communauté susceptible d’épanouir pleinement l’homme.
À ce niveau, K. Marx et F. Engels (1998, p. 103-115) qualifiant leur socialisme de ̏socialisme scientifique ̋, estiment que la plupart des autres penseurs du socialisme et du communisme sont soit utopistes soit réactionnaires. Entre autres points de discorde, l’on note la question des valeurs morales dans les luttes ouvrières pour le passage de la société capitaliste à la société communiste. Par exemple, au cours de la vive polémique entre Proudhon, auteur de Philosophie de la misère ou système des contradictions économiques et Marx qui réplique par Misère de la philosophie, se trouve le problème de l’usage de la violence pour le renversement de la classe bourgeoise. Pour K. Marx (1996, p. 199) :
L’antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie est une lutte de classe à classe, lutte qui, portée à sa plus haute expression, est une résolution totale. D’ailleurs, faut-il s’étonner qu’une société, fondée sur l’opposition des classes, aboutisse à la contradiction brutale, à un choc de corps à corps comme dernier dénouement ?
Révoquant en doute cette approche, P. J. Proudhon (1996, p. 40) écrit à Marx depuis Lyon le 17 mai 1846 en ces termes :
Je crois que nous n’avons pas besoin de cela pour réussir, et qu’en conséquence, nous ne devons point poser l’action révolutionnaire comme moyen de réforme sociale parce que ce prétendu moyen serait tout simplement un appel à la force, à l’arbitraire, bref une contradiction (…) Je préfère donc faire brûler la Propriété à petit feu, plutôt que de lui donner une nouvelle forme, en faisant une Saint-Barthélemy des propriétaires.
En utilisant la métaphore de la Saint-Barthélemy, Proudhon fait référence à l’histoire de la guerre des religions qui fit plus de trois mille (3000) morts à Paris dans la nuit du 25 Août 1572 dans le conflit entre Catholiques et Protestants. Il renonce donc à la confrontation brutale recommandée par Marx et préconise la transition pacifique au nom de certaines considérations éthiques. Selon lui, la violence ne peut être porteuse d’un nouveau monde garantissant le respect de la vie humaine dans la mesure où la violence appelle la violence. Cet auteur socialiste défend ainsi des idéaux et croit en des principes moraux justifiant son action en faveur des travailleurs exploités et opprimés. Or, K. Marx et F. Engels (1982, p.1067) affirment clairement leur opposition à l’idéalisme moral dans leur approche de la question sociale: «Pour nous, le communisme n’est pas un état de choses qu’il convient d’établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement qui abolit l’état actuel des choses.»
Dès lors, se pose avec acuité la question de la place des valeurs morales dans la construction de la société communiste: le communisme est-il un état de vie purement amoral, c’est-à-dire dénué de tout idéal moral ? Son avènement signifie-t-il l’abolition de la morale en tant qu’ensemble de valeurs visant idéalement le bien ? Mais la révolution prolétarienne inaugurant la société communiste qui vient mettre fin à toutes formes d’aliénation n’est-elle pas l’accomplissement de l’éthique humaniste visant l’émancipation totale de l’homme ?
1. Le communisme marxien ou le rejet de la morale classique
Selon le philosophe et théologien J.-Y. Calvez (1970, p. 235) :
Marx a critiqué explicitement toute éthique traditionnelle fondée sur une vocation dépassant l’expérience : impératif moral, la loi divine ou même loi naturelle (…) Il critique toute valeur, de même qu’il critique toute vérité éternelle. Pour lui, il ne saurait y avoir de vérité que vérifiée dans le processus historique : de même, il ne peut y avoir de valeur que confirmée dans celui-ci.
Effectivement Marx et Engels se méfient de toutes les théories qui se veulent éternelles. Or, les valeurs morales en tant qu’elles visent le bien et constituent les repères transcendants de l’agit humain sont considérées comme des normes valables pour tous les hommes, pour toutes les sociétés et pour toutes les époques. Chez Emmanuel Kant par exemple, la loi morale résulte de l’impératif catégorique qui est la voix souveraine de la raison en nous. Pour l’auteur de D’un ton grand Seigneur adopté naguère en philosophie : « Chaque homme trouve en sa raison l’idée du devoir et tremble lorsqu’il entend sa voix d’airain pour peu que s’éveillent en lui des penchants qui lui donnent la tentation de l’enfreindre » (E. Kant, 1968, p.104-105).
Cette théorie de la morale pure est jugée abstraite et idéologique par Marx et Engels. D’ailleurs toute morale, à leurs yeux, ressortit au royaume de la superstructure au même titre que la religion, le droit, la politique, la philosophie métaphysique. Dans l’Idéologie allemande où sont jetées les bases essentielles du matérialisme historique, la conscience en général et la conscience morale en particulier, sont qualifiées de représentations émanant de l’infrastructure économique. Celles-ci n’ont pas d’autonomie en soi, même si elles s’en donnent l’apparence. Elles ne possèdent pas non plus une histoire propre malgré le fait que les valeurs morales et les doctrines religieuses peuvent penser surgir ex-nihilo. Aussi K. Marx et F. Engels (1982, p.1056) peuvent-ils écrire :
La production des idées, des représentations de la conscience est, de prime abord, directement mêlée à l’activité et au commerce matériel des hommes : elle est le langage de la vie réelle. Ici, la manière d’imaginer et de penser, le commerce intellectuel des hommes apparaissent encore comme l’émanation directe de leur conduite matérielle. Il en va de même de la production intellectuelle, telle qu’elle se manifeste dans le langage de la politique, des lois, de la morale, de la religion, de la métaphysique, etc., d’un peuple.
Au-delà de la critique de l’idéologie dans sa généralité, le collaborateur de Marx s’attaque spécifiquement à la question de la morale dont les principes sont présentés comme des valeurs éternelles susceptibles de servir la cause de la lutte socialiste et communiste. Dénonçant avec véhémence les idées d’Eugen Dürhing, s’autoproclamant théoricien du vrai communisme, Engels rédige Anti-Dühring pour mettre en lumière le caractère réactionnaire des propos de ce nouveau prophète aux opinions apparemment révolutionnaires. Au plan éthique, Dürhing dans son Cours d’économie politique et de socialisme faisait l’apologie des vertus de l’égalité, de la probité, de la solidarité, etc. comme remèdes efficaces contre les contradictions du système capitaliste sans véritablement remettre en cause la société bourgeoise dans ses fondements. Pour Engels, il est vain de proclamer des vérités dites éternelles dans le domaine moral. Si donc les valeurs morales ont une base essentiellement matérialiste et si le communisme est le dernier stade du développement de l’histoire mettant fin à toute aliénation et domination de classe, l’on peut en inférer que l’avènement de la société communiste signe la fin de toute morale. Tel est le sens de ce passage de Anti-Dühring:
Dès l’instant où la propriété privée des objets mobiliers s’était développée, il fallait bien que toutes les sociétés où cette propriété privée prévalait eussent en commun le commandement moral : tu ne voleras point. Est-ce que par là ce commandement devient un commandement moral éternel ? Nullement. Dans une société où les motifs de vol sont éliminés, où par conséquent, à la longue, les vols ne peuvent être commis que par des aliénés, comme rirait du prédicateur de morale qui voudrait proclamer solennellement la vérité éternelle : tu ne voleras point ! » (F. Engels, 1977, p. 123).
Mais alors comment Marx et Engels expliquent-ils que des penseurs socialistes mêlent encore morale et communisme ?
1.1. Critique de la morale du communisme religieux
Bien que faisant partie des représentations idéologiques qui sont des falsifications du réel, la religion selon Marx et Engels produit elle-même d’autres formes d’idéologie dont la morale qui, à son tour, engendre des projets sociaux drapés de socialisme et de communisme. Les défenseurs du matérialisme historique, dans leur volonté de se démarquer de ces théories moralisantes du communisme grossier, ne peuvent que faire le procès discours religieux. Déjà sa Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel que l’on retrouve dans le recueil de textes choisis Sur la religion, K. Marx (1972, p. 41-42) déclarait :
En ce qui concerne l’Allemagne, la critique de la religion est, pour l’essentiel, terminée, et la critique de la religion est la condition préliminaire de toute critique (…) C’est en premier lieu la tâche de la philosophie, qui est au service de l’histoire, une fois dénoncée la forme sacrée de l’auto-aliénation de l’homme, de démasquer l’auto-aliénation dans ses formes non-sacrées. La critique du ciel se transforme par là en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique.
Dans la religion en général et dans le christianisme en particulier, il est demandé de donner le pain à celui qui a faim, le gîte à celui qui est sans abri, l’habit à celui qui est nu, la protection au faible, l’assistance à l’indigent, au nom de l’éthique divine de l’amour universel du prochain. Mieux, il est donné en exemple la première communauté des chrétiens, dans l’écrit néo-testamentaire des Actes des Apôtres (4, 32-35) :
La multitude des croyants n’avait qu’un seul cœur et qu’une seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun (…) Aussi parmi eux nul n’était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins.
Ici, au nom de la foi commune, de la communion fraternelle et de l’Espérance au salut divin, les croyants acceptent de tout mettre en commun de sorte que personne ne soit dans le besoin. Ce sont les vertus éthico-religieuses du partage, de la solidarité, de la charité, de la fraternité qui justifient que les uns et les autres se dépouillent de leurs biens matériels au profit de la collectivité.
Marx et Engels estiment que ce communisme-là n’est socialiste que de nom. Aussi dans le Manifeste du parti communiste se plaisent-ils à railler les socialistes chrétiens en qualifiant leurs pensées de socialisme clérical :
Prêtres et féodaux ont toujours marché la main dans la main, de même le socialisme clérical et le socialisme féodal. Rien de plus facile que de donner à l’ascétisme chrétien un vernis socialiste. Le christianisme ne s’est-il pas déchainé aussi contre la propriété privée, le mariage, l’État ? N’a-t-il pas prêché à leur place la charité et la mendicité, le célibat et la mortification de la chair, la vie monastique et l’Église ? Le socialisme chrétien n’est que l’eau bénite avec laquelle le prêtre consacre le dépit de l’aristocratie (K. Marx et F. Engels, 1998, p. 105).
Les critiques contre la classe bourgeoise, les exhortations au partage fraternel des biens et à la charité envers les pauvres ne sont, pour Marx et Engels, que les survivances réactionnaires de la société féodale en déconfiture.
Par ailleurs, le socialisme basé sur les croyances est incapable d’être une théorie de la pratique révolutionnaire étant donné que, selon les théoriciens du matérialisme historique, la morale religieuse en général et l’éthique chrétienne en particulier, produisent toujours des principes sociaux légitimant l’ordre social établi. La morale religieuse préconisant l’égalité par la charité et la vie ascétique de mortification est, de ce fait, inapte à transformer en profondeur la société. Par exemple, le 5 septembre 1845, paraît un article dans le numéro 70 du ̏ Deutsche-Brüsseler-Zeitung ̋ dans lequel Rheinischer Beobachter, conseiller d’État prussien défend l’idée d’un communisme fondé sur les valeurs du christianisme : « Qu’est-ce que l’alpha et l’oméga de la foi chrétienne ? Le dogme du péché originel et la rédemption. Et c’est là que réside le lien de solidarité de l’humanité à sa plus haute puissance ; un pour tous et tous pour un » (K. Marx, 1982, p. 739). Réagissant contre cette thèse, Marx dénonce une hypocrisie dangereuse pour le mouvement de la révolution prolétarienne. Aux yeux de K. Marx (1982, p. 740), il ne peut y avoir de relation harmonieuse entre les principes sociaux du christianisme et le communisme :
Les principes sociaux du christianisme ont justifié l’esclavage antique, magnifié le servage médiéval, et ils s’entendent également, en cas de besoin, à plaider l’oppression du prolétariat, fût-ce en ayant l’air quelque peu contrit. Les principes sociaux du christianisme placent dans le ciel la compensation consistoriale de toutes les infamies et justifient de la sorte la permanence de ces infamies sur notre terre. Les principes sociaux du christianisme considèrent toutes les vilenies des oppresseurs envers les opprimés soit comme le juste châtiment du péché originel et des autres péchés, soit comme des épreuves que le Seigneur, dans son infinie sagesse, inflige aux hommes délivrés du péché.
Au regard de cette analyse marxienne de la morale chrétienne, la religion est totalement disqualifiée quant à sa prétention à fonder le communisme tel que le pensent Marx et Engels. Mais, au-delà des principes religieux, la critique marxienne n’épargne point les idéaux du communisme utopique.
1.2. Réfutation de la morale du communisme utopique
Par communisme utopique, Marx et Engels désignent les théories des penseurs des luttes ouvrières qui en appellent à des valeurs éthiques pour l’avènement d’une société juste et égalitaire. Pour eux, ces penseurs-là sont certes généreux dans leurs critiques de la société bourgeoise mais rêveurs dans les solutions proposées pour remédier aux maux de la société. Ce sont des inventeurs de systèmes qui, bien que recherchant l’émancipation des prolétaires, délaissent la pratique et se fient exclusivement à leurs imaginations. Le Manifeste du parti communiste de K. Marx et F. Engels (1998, p. 113) dénonce leur propension à l’abstraction:
À l’activité sociale doit se substituer leur capacité d’invention personnelle, aux conditions historiques de l’émancipation, des conditions purement imaginaires, à l’organisation du prolétariat en classe qui s’opère progressivement, une organisation de la société combinée tout exprès. L’histoire future du monde se résout pour eux en la propagande et la mise à exécution de leurs projets de société.
Parmi les promoteurs du socialisme utopique, K. Marx et F. Engels (1998, p. 112-113) citent nommément les français Saint-Simon et Fourier et le britannique Owen: «Les systèmes socialistes et communistes proprement dits, les systèmes de Saint-Simon, de Fourier d’Owen, etc., font leur apparition dans la période du développement embryonnaire de la lutte entre prolétariat et bourgeoisie ». Le principal grief de Marx et Engels contre ces socialistes utopiques est le caractère moralisateur de leurs théories se rapprochant finalement du communisme religieux eu égard au fait que ceux-ci, en lieu et place d’un véritable communisme, « enseignent un ascétisme général et un égalitarisme grossier » (K. Marx et F. Engels, 1998, p. 112). C’est surtout Engels qui développe les critiques contre le socialisme dit utopique dans Anti-Dürhing et singulièrement dans Socialisme utopique et socialisme scientifique. Parlant de Saint-Simon, Fourier et Owen, le collaborateur de Marx affirme:
Tous les trois ont ceci de commun qu’ils ne se donnent pas comme les représentants des intérêts du prolétariat qui, dans l’intervalle, s’était développé historiquement. Ainsi que les philosophes français du XVIIIe siècle, ils se proposèrent d’affranchir non une classe déterminée, mais l’humanité entière; comme eux, ils voulurent établir le règne de la raison et de la justice éternelles (…) Si la pure raison et la vraie justice n’avaient pas jusqu’ici gouverné le monde, c’était parce qu’elles n’avaient pas été découvertes. L’homme de génie qui devait découvrir cette vérité avait manqué, il surgissait maintenant. (F. Engels, 2019, p. 44)
Le premier reproche fait à ces penseurs est leur idéalisme moral. Les principes et valeurs au nom desquels ils dénoncent les anomalies sociales et œuvrent pour une société égalitaire, sont purement abstraits. Ces penseurs socialistes du XIXe siècle ne sont donc pas différents des philosophes des lumières du XVIIIe siècle qui inspirèrent les révolutionnaires français. Ils croient naïvement en la capacité de la raison universelle transcendante à révéler à l’humanité les repères de son action. Selon F. Engels (2019, p. 45), nos utopistes ignorent que :
Les philosophes français du XVIIIe siècle, les précurseurs de la Révolution avaient fait de la raison le règne suprême de toute chose. L’État, la société devaient être basés sur la raison, tout ce qui était contraire à la raison éternelle devait être foulé aux pieds sans piété, mais cette raison éternelle n’était en réalité rien d’autre que l’intelligence bourgeoise idéalisée.
Autrement dit, les valeurs éternelles dont se réclament Saint-Simon, Fourier, Owen et dans une certaine mesure, Proudhon se ramènent à des illusions idéalistes. Ils n’ont pas compris que les normes de la conscience morale sont intimement liées aux rapports sociaux de production. Le Manifeste du parti communiste ne cesse de le rappeler :
Que prouve l’histoire des idées sinon que la production intellectuelle se métamorphose avec la production matérielle ? (…) On parle d’idées qui révolutionnent une société tout entière, par là on exprime seulement le fait que dans le sein de l’ancienne société se sont formés les éléments d’une société nouvelle et que la dissolution des idées anciennes va de pair avec la dissolution des anciennes conditions de vie (K. Marx et F. Engels, 1998, p. 99).
Par-là, Marx et Engels proclament, une fois de plus, le caractère historique des valeurs morales. Par conséquent, le socialisme utopique se trompe en essentialisant la justice, l’équité, l’égalité, la solidarité, la fraternité comme des valeurs transcendantes de l’éthique socialiste.
La seconde limite de la morale du socialisme non révolutionnaire, selon Marx et Engels, se situe dans son approche philanthropique des rapports entre la bourgeoisie et le prolétariat. Par exemple, Saint-Simon dans ses Lettres de Genèse prône une réforme sociale dans laquelle toutes les couches entretiennent des rapports harmonieux et contribuent au progrès social. Il n’est donc pas question de révolution prolétarienne venant renverser violemment la classe bourgeoise. Sa réforme ménage aussi bien les prolétaires que les bourgeois au nom de la valeur de la paix et de la concorde entre les hommes. F. Engels (2019, p. 48) en parle en ces termes : « Dès lors, qui devait diriger et dominer ? D’après Saint-Simon, la science et l’industrie, qu’unirait entre elles un nouveau lien religieux (…) Mais la science, c’était les hommes d’études, et l’industrie, c’était en première ligne les bourgeois actifs, fabricants, négociants, banquiers ». Voulant émanciper l’humanité tout entière et non la classe dominée et exploitée, les socialistes utopiques font preuve d’un pacifisme moralisateur. Ainsi, la morale philanthropique de ce communiste-là est une véritable entrave à l’action révolutionnaire. Selon K. Marx (1996, p. 152) :
Celle-ci cherche par acquit de conscience, à pallier tant soit peu les contrastes réels; elle déplore sincèrement la détresse du prolétariat, la concurrence effrénée des bourgeois entre eux-mêmes ; elle conseille aux ouvriers d’êtres sobres, de bien travailler et de faire peu d’enfants ; elle recommande aux bourgeois de mettre dans la production une ardeur réfléchie.
N’est-ce pas là un discours moralisateur prêchant, in fine, un mode de vie austère pour les prolétaires et un appel aux sentiments charitables des bourgeois ? Cette morale est donc nécessairement réactionnaire et profite à la classe dominante d’autant plus qu’elle déconseille tout recours à l’épreuve de force et privilégie les voies de conciliation pacifique dans les rapports sociaux.
À ce niveau de notre analyse, nous retenons que pour Marx et Engels la morale est incompatible avec la future société communiste. En effet, le communisme marxien se distingue fondamentalement des autres formes de socialisme et communisme par son caractère scientifique, révolutionnaire et historique. Ce communisme-là tire ses principes, non de la religion ni de la morale, mais de la pratique socio-économique et du mouvement de l’histoire. Il doit sa scientificité au génie particulier de Karl Marx, si l’on s’en tient au témoignage de F. Engels (1977, p. 56) : « Ces deux grandes découvertes : la conception matérialiste de l’histoire et la révélation du mystère de la production capitaliste au moyen de la plus-value, nous les devons à Marx. C’est grâce à elles que le socialisme est devenu une science, qu’il s’agit maintenant d’élaborer dans tous ses détails ». Peut-on et doit-on en inférer que la morale, entendue ici comme forme particulière de l’idéologie, est totalement exclue et abolie de la société communiste ? Le communisme marxien, en tant que moment et espace de réalisation pratique d’un vivre-ensemble des hommes, peut-il évacuer la question des valeurs morales ?
2. Les valeurs morales au cœur du communisme marxien
Parler d’une éthique marxienne peut relever d’un discours révisionniste pour l’orthodoxie marxiste pour qui, chez les fondateurs du matérialisme historique et du communisme révolutionnaire, les jugements de valeur ne sont point distincts des jugements de réalité. Aussi le marxiste et marxologue M. Rubel (1948, p. XXI) peut-il écrire:
L’éthique marxienne se caractérise négativement par son amoralisme, et, positivement, sa démarche est essentiellement pragmatique. Elle rejoint, à travers Feuerbach, la pensée du plus grand amoraliste qui fut : Spinoza (…) Comme Spinoza, Marx fait entrer l’homme dans le cycle éternel de la nature infinie et lui assigne un idéal de perfection : la réalisation de sa totalité humaine.
Ce qui est caractéristique chez Marx et Engels, c’est la méfiance constante envers les idéaux et les idéologies et la quête permanente de la connaissance de la réalité en vue de sa transformation par l’homme et pour l’homme. Déjà dès 1845, dans sa critique du matérialisme spéculatif de Ludwig Feuerbach, Marx invite la pensée humaine à ne point s’éloigner de l’expérience empirique et de la pratique sociale. Le critérium du vrai est placé sur le terrain de la praxis, loin de la pure pensée métaphysique et théorique.
Pour Jean-Yves Calvez, tout porte à croire, à première vue chez Marx et Engels, que l’essentiel réside dans la coïncidence de l’action humaine avec les lois du réel empirique, social, économique et historique. Superposer des idées ou valeurs axiologiques aux faits en demandant à l’agir humain de se conformer à ces idéaux ressortit à l’idéologie qui est une interprétation falsifiée de la réalité. La conscience morale n’est alors que l’expression d’une aliénation à des intérêts de classe masqués qui légitiment généralement l’ordre établi. Ce commentateur classique de Marx note :
La doctrine de Marx, c’est de ne pas quitter le réel, c’est-à-dire l’expérience humano-naturelle. Toute tentative pour y échapper en direction d’un transcendant quelconque, fût-il moral, n’est qu’une expression illusoire de l’aliénation de notre être. Dans ces conditions, il n’y a pas de valeur immuable ou transcendante. Il n’y a pas de valeur du tout au sens où la valeur est posée et affirmée face à la réalité. Il n’y a pas non plus de jugement de valeur que l’on puisse distinguer des jugements de réalité (J.-Y. Calvez, 1970, p. 235-236).
Et pourtant, selon notre lecture des textes des fondateurs du matérialisme historique, la pensée marxienne est porteuse d’une éthique. En effet, le communisme en tant qu’un modèle de société préférable à la société esclavagiste de l’antiquité, à la féodalité du Moyen-Âge et au capitalisme des temps modernes, comporte des valeurs du bien opposées aux contre-valeurs du mal. De plus, la classe prolétarienne dont la mission historique est de capitaliser les acquis révolutionnaires de la grande industrie du capitalisme et de renverser la classe bourgeoise pour l’avènement de la société communiste, ne peut pas ne pas agir dans le sens des valeurs pour le bien commun. Dès lors, nous concevons ces tâches de la société communiste comme des marqueurs indiscutables de la morale.
2.1. Le devoir de vérité comme une valeur de l’éthique communiste
Le matérialisme historique comme théorie d’explication des faits sociaux, politiques, éthiques, culturels, juridiques et de l’évolution de l’humanité par les conditions matérielles de production, se présente comme une quête permanente de la connaissance vraie. Chez Marx et Engels, le savoir vrai est plus qu’une nécessité. La recherche de la vérité des faits contre les spéculations est une grande passion chez les auteurs de l’Idéologie allemande et du Manifeste du parti communiste. En effet, un simple regard synoptique sur leurs écrits montre à quel point ces deux penseurs ont érigé la vérité en valeur absolue. Leurs plumes acérées contre l’idéalisme hégélien et le matérialisme feuerbachien d’une part et d’autre part, leurs réfutations caustiques des idées des socialistes comme Saint-Simon, Fourier, Owen, sans omettre leurs croisades contre les penseurs de l’économie bourgeoise tels Ricardo et Smith, n’ont pour principal enjeu que la manifestation de la vérité entendue comme la lumière salvatrice et émancipatrice éloignant les hommes de l’ignorance captive.
Illustrons nos propos par la critique marxienne de la dialectique hégélienne dans la postface à la seconde édition allemande du Capital :
Ma méthode dialectique, non seulement diffère par la base de la méthode hégélienne, mais elle en est l’exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée, qu’il personnifie sous le nom de l’Idée, est le démiurge de la réalité, laquelle n’est que la forme phénoménale de l’Idée. Pour moi au contraire, le mouvement de la pensée n’est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau de l’homme (…) Chez lui elle marche sur la tête ; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable (K. Marx, 1963, p. 106).
C’est ce processus critique qui explique, aux yeux de Marx et Engels, les luttes des classes et les successions tumultueuses des divers modes de production liées aux inadéquations entre les progrès des forces productives et les conservatismes des rapports sociaux établis.
La connaissance de la vérité des faits est une composante importante du communisme marxien qui se veut être une science. Pourquoi cette passion de la vérité qui explique la nature polémique de leurs écrits à l’endroit des autres penseurs ? Qu’est-ce qui justifie leurs plumes rageuses démolissant bien des fois les doctrines socialistes et communistes qu’ils ne partagent pas ? Pour nous, Marx et Engels sont aussi motivés par l’éthique de la défense de la dignité humaine.
2.2. Le communisme marxien comme une éthique de la restauration de la dignité humaine
Marx et Engels se méfient des valeurs de l’humanisme abstrait. Pour eux, il n’y a pas d’essence humaine innée, éternelle et universelle. Parler de l’homme en général, de l’homme universel, de l’homme dans sa substance idéelle, relève de la pure abstraction. Aussi bien dans La Sainte Famille (1843), dans l’Idéologie allemande (1846) que dans le Manifeste du parti communiste (1848), Marx et Engels clouent au pilori toutes les théories idéalistes, matérialistes et socialistes reconnaissant à l’homme une nature anhistorique et une valeur transcendante inconditionnelle. Parlant du matérialisme de Feuerbach, Marx et Engels lui font le reproche de parler de l’Homme là où il faut désigner les hommes engagés dans des rapports sociaux déterminés. Dans L’Idéologie allemande, ils écrivent à son sujet :
Certes Feuerbach a sur les matérialistes ̏purs ̋ le grand avantage de comprendre que l’homme est, lui aussi, un ̏ objet sensible ̋ ; mais, de même qu’il le conçoit uniquement comme ̏ objet sensible ̋ et non ̏ activité sensible ̋ , car, là encore, il s’en tient à la théorie et ne saisit pas les hommes dans leurs rapports sociaux donnés , dans leurs conditions de vie actuelles qui ont fait d’eux ce qu’ils sont ; de même, jamais il n’arrive à l’homme actif et réellement existant ; il s’en tient à une abstraction : L’̏ Homme ̋, et ne parvient à reconnaître l’ ̏ homme réel, individuel, en chair et en os ̋ que dans le sentiment, c’est-à-dire qu’il ne connaît pas d’autres ̏ rapports humains ̋ ̏ de l’homme à l’homme ̋ que ceux de l’amour et de l’amitié- et idéalisés, avec cela. Il ne fait aucune critique des conditions de vie actuelles (K. Marx et F. Engels, 1982, p. 1080).
Mais, malgré cette critique de l’humanisme abstrait, la pensée matérialiste et communiste de Marx et Engels milite activement en faveur de la restauration de la dignité humaine dénaturée, mutilée par les diverses formes de l’aliénation. En effet, c’est au nom du respect de la valeur humaine qui n’est point une valeur marchande que Marx et Engels dénoncent le travail aliéné. N’est-ce pas, au nom de la dignité de la nature humaine, que le Manifeste du Parti Communiste appelle le prolétariat à s’organiserpour mettre fin à la domination capitaliste en vue de l’avènement de la société communiste où l’homme n’exploitera plus l’homme ? De fait, la société communiste marxienne n’est pas un simple état issu de la causalité historique. Elle est aussi un modèle de vie c’est-à-dire un vivre-ensemble saturé de valeurs éthiques répondant aux aspirations de l’homme en général : abondance matérielle, juste répartition des richesses, humanisation et socialisation du travail. Si l’on s’en tient uniquement au visage de l’acte productif dans la société communiste selon Marx et Engels, nous y découvrons toute la portée morale de la dignité humaine en ce sens que la division du travail et sa pénibilité seront abolies et l’homme y retrouvera toute sa plénitude. Le travail, dans la société communiste, sera définitivement débarrassé de la nécessité, de la plus-value, de la spécialisation mutilante, de l’exploitation économique pour devenir pour l’homme une activité plaisante, épanouissante, libératrice. L’homme ne sera plus chosifié ni traité uniquement comme un moyen pour produire des richesses au profit d’une classe dominante exploiteuse. Il sera traité comme un être humain, un être digne, omnilatéral, profitant pleinement du fruit de son labeur. Découvrons sous les plumes de Marx et Engels dans l’Idéologie allemande toute la grandeur morale de la dignité humaine retrouvée grâce à la révolution communiste :
Du moment où le travail commence à être réparti, chacun entre dans un cercle d’activités déterminé et exclusif, qui lui est imposé et dont il ne peut s’évader ; il est chasseur, pêcheur, berger ou « critique critique », et il doit le rester sous peine de perdre les moyens qui lui permettent de vivre. Dans la société communiste, c’est le contraire : personne n’est enfermé dans un cercle exclusif d’activités et chacun peut se former dans n’importe quelle branche de son choix ; c’est la société qui règle la production générale et qui me permet ainsi de faire aujourd’hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l’après-midi, de m’occuper d’élevage le soir et de m’adonner à la critique après le repas, selon que j’en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique (K. Marx et F. Engels, 1982, p. 1065).
Non seulement le travail transcendera son caractère parcellaire actuel, mais il deviendra pour l’homme une vocation et la réalisation de son premier besoin vital. En faisant de l’homme le maître souverain du travail, le communisme accomplit, sans l’avouer ouvertement, la règle morale de E. Kant (1980, p. 150): « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans celle d’autrui, toujours en même temps comme une fin, et jamais seulement comme un moyen ». C’est parce que l’homme a une valeur inconditionnelle et qu’il est une fin en soi qu’il faut lutter contre le système capitaliste qui spolie le prolétaire du fruit de son travail et construire la société communiste qui abolira la division du travail et la propriété privée des moyens de production. En luttant théoriquement et politiquement pour l’émancipation de la classe prolétarienne en vue de la révolution communiste, Marx et Engels défendent les droits de la dignité humaine, même s’ils estiment dans Question Juive que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Révolution française ne sont que des droits abstraits de l’homme bourgeois. N’est-ce pas encore là, la quête et l’expression d’une autre valeur morale : la justice sociale ?
2.3. Le communisme marxien et l’éthique de la justice sociale
La société communiste telle que pensée et décrite par Marx et Engels est une communauté de vie de grande production liée à la grande industrie de l’ère capitaliste. Cet acquis révolutionnaire de la bourgeoisie est appelé à être récupéré par le prolétariat qui le transformera en une puissance au profit de toute la société Avec la révolution prolétarienne qui vient abolir la propriété privée des moyens de travail, non seulement la classe bourgeoise sera renversée mais aussi et surtout le prolétariat se servira de sa position de force politique pour instaurer la dictature socialiste, prélude à la véritable société communiste dont parle K. Marx (2008, p. 59-60) :
Dans une phase supérieure de la société communiste, quand aura disparu l’asservissante subordination des individus à la division du travail, et avec elle l’opposition entre travail intellectuel et travail manuel ; quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais sera devenu le premier besoin vital ; quand avec le développement des individus à tous égards, leurs forces productrices se seront également accrues et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l’horizon borné du droit bourgeois pourra être entièrement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux :̏ De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !
Dans ce passage, Marx fait un examen critique de la notion du ̏ droit égal ̋ mentionné par les rédacteurs du projet de programme communiste pour le congrès d’unification prévu à Gotha par le mouvement allemand ouvrier. Depuis son exil londonien, Marx s’oppose à l’idéologie juridique. De fait, Marx récuse l’idée de justice et d’équité comme valeurs éthiques et juridiques au sein de la future et imminente société communiste en ce sens que celles-ci relèvent du droit bourgeois dont la maxime s’énonce ̏ À chacun selon ses mérites ̋. Ce droit-là est encore omniprésent aux premières heures du communisme parce que:
Ce à quoi nous avons affaire ici, c’est à une société communiste, non pas telle qu’elle s’est développée à partir de ses propres fondements, mais au contraire telle qu’elle vient de sortir de la société capitaliste, elle porte encore les taches de naissance de la vieille société du sein de laquelle elle est sortie, à tous égards, économiques, moraux, intellectuels (K. Marx, 2008, p. 57).
Dès lors, le sens de la justice sociale comme règle de traitement uniforme proportionnellement au travail fourni n’est pas encore conforme aux rapports sociaux de production et de collaboration dans le communisme marxien. La justice communiste, si l’on peut la nommer ainsi, dépasse très largement la justice de classe et la justice égalitaire, pour désigner une disposition sociale se formulant ainsi « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». En effet, pour le père du matérialisme historique, si l’on veut appliquer strictement le droit égal, l’on risque de produire de l’injustice au regard des inégalités de talents et des conditions individuelles de vie.
L’analyse critique du droit égal considéré comme les stigmates bourgeois « inévitables dans la première phase de la société communiste, telle qu’elle vient de sortir de la société capitaliste après un long et douloureux enfantement » (K. Marx, 2008, p.59), indique en quoi l’éthique de la justice est fortement prégnante dans le communisme marxien. Elle fustige la justice purement distributive pour se muer en un véritable devoir de solidarité. Le communisme marxien se veut dépassement du droit de distribution des biens matériels suivant la règle formelle des efforts de production fournis. Il promulgue implicitement une nouvelle règle morale consistant à mutualiser les capacités individuelles disproportionnées dans le procès de production économique tout en garantissant à chaque membre associé communiste la pleine satisfaction de ses besoins spécifiques.
Conclusion
En somme, chez Marx et Engels, le communisme est une théorie scientifique et non un idéal religieux, politique ou moral. Voilà pourquoi Engels le distingue des autres conceptions (socialisme utopique, féodal, clérical, réactionnaire, etc.) en le baptisant ̏ socialisme scientifique ̋. Il se fonde sur la conception matérialiste de l’histoire suivant laquelle ce sont les conditions matérielles de vie qui déterminent la formation des idées religieuses, politiques, juridiques et morales. Ils estiment que les valeurs morales qui appartiennent au royaume de la superstructure n’ont pas un caractère indépendant et transcendant mais dérivent nécessairement du mode de production. À preuve, F. Engels (1977, p.123) nous fait remarquer que dans une même société et à une même époque, des théories morales contradictoires peuvent cohabiter selon les intérêts des classes:
Quelle morale nous prêche-t-on aujourd’hui ? C’est d’abord la morale féodale chrétienne, héritage de la foi des siècles passés, qui se divise essentiellement à son tour en une morale catholique et une morale protestante, ce qui n’empêche pas derechef des subdivisions allant de la morale catholico-jésuite et de la morale protestante orthodoxe jusqu’à la morale latitudinaire. À côté de cela figure la morale bourgeoise moderne.
En d’autres termes, les devoirs et principes moraux enseignés et inculqués dépendent de la praxis socio-économique de sorte que la morale elle-même n’a point de consistance propre.
Par ailleurs, par-delà sa scientificité, le communisme marxien est aussi un mouvement révolutionnaire ayant pour acteur principal le prolétariat. La mission historique de cette classe exploitée par la bourgeoisie est de renverser radicalement l’ordre de la société capitaliste pour l’enfantement inéluctable de la société communiste présentée comme une société de grande production matérielle, de juste répartition des richesses produites, de cohésion sociale. Dans un tel cadre de vie, quel est l’intérêt des règles morales comme l’interdiction du meurtre, du vol, du mensonge, etc. étant donné que les hommes jouissent déjà abondamment des biens matériels dont la privation justifie les actes immoraux ?
Pour nous, la morale est omniprésente dans le communisme marxien pour la simple raison que les valeurs de vérité, de justice sociale, de libération de l’homme par la révolution communiste, etc. relèvent de l’éthique et non uniquement de la production économique et de la nécessité historique.
Références bibliographiques
BIDET Jacques et KOUVÉLAKIS Eustache (Sous la direction de), Dictionnaire Marx Contemporain, 2001, paris, P.U.F.
CALVEZ Jean-Yves, La pensée de Karl Marx, 1970, Paris, Éditions du Seuil.
ENGELS Friedrich, Anti-Dürhing, 1977, Trad. Émile BOTTIGELLI, Paris, Éditions Sociales
ENGELS Friedrich, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, 1966, Trad. Gilbert BADIA, Paris, Éditions Sociales.
ENGELS Friedrich, Socialisme utopique et socialisme scientifique, 2019, Trad, Paul LAFARGUE, Paris, Edition Science Marxiste.
FEUERBACH Ludwig, L’Essence du Christianisme, 1968, Trad. Jean-Pierre OSIER, Paris, François Maspéro.
FEUERBACH Ludwig, Éthique : l’Eudémonisme, 2012, Trad. Anne-Marie PIN, Paris, HERMANN ÉDITEURS.
KANT Emmanuel, Critique de la raison pratique, 1976, Trad. François PICAVET, Paris, P.U.F.
KANT Emmanuel, D’un ton grand Seigneur adopté naguère en philosophie, 1980, Trad. L. GUILLERMIT, Paris, J. Vrin.
KANT Emmanuel, Fondement de la métaphysique des mœurs, 1980, Trad. Alexis PHILONENKO, Paris, J. Vrin.
LEFEBVRE Henri, Logique formelle et logique dialectique, 1947, Paris, Éditions Sociales.
MARX Karl, Thèses sur Feuerbach, 1982, Trad. Maximilien RUBEL in Œuvres III-Philosophie, Paris, Gallimard, pp. 1029-1033.
MARX Karl et Friedrich ENGELS, L’Idéologie allemande, 1982, Trad. Maximilien RUBEL in Œuvres III-Philosophie, Paris, Gallimard, pp. 1049-1325.
MARX Karl et ENGELS Friedrich, La Sainte Famille, 1982, Trad. Maximilien RUBEL in Œuvres III-Philosophie, Paris, Gallimard, pp. 419-661.
MARX Karl, Critique du programme de Gotha, 2008, Trad. Sonia DAYAN-HERZBRUN, Paris, Les Éditions Sociales.
MARX Karl, Le Capital, livre 1, 1968, Trad. Maximilien RUBEL, Paris, Gallimard.
MARX Karl, Misère de la Philosophie, 1996, Paris, Éditions Payot et Rivages.
MARX Karl et ENGELS Friedrich, Manifeste du Parti Communiste, 1998, Trad. Émile BOTTIGELLI, Paris, GF Flammarion.
MARX Karl et ENGELS Friedrich, Sur la Religion, 1972, Trad. G. BADIA, P. BANGE, et E. BOTTIGELLI, Paris, Éditions Sociales.
NEUSCH Marcel, Aux sources de l’athéisme contemporain, 1993, Paris, Éditions du Centurion.
Rubel Maximilien, Pages choisies pour une éthique socialiste, 1948, Paris, Éditions Rivière.
WEBER Max, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1964, Trad. E. DAMPIERRE, Paris, Plon.
LES IMPLICATIONS SOCIALES DE LA RÉVOLUTION SEXUELLE RÉVENDIQUÉE PAR HERBERT MARCUSE ET WILHELM REICH
Blédé SAKALOU
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Dans une démarche quelque peu contradictoire avec sa propre théorie de la révolution instinctuelle et sexuelle qu’il dépend dans ses tous premiers écrits, Freud estime qu’il y a incompatibilité entre le principe de plaisir ; caractéristique de la nature inconsciente de l’homme et le principe réalité au nom duquel la civilisation exige une répression de plus en plus intense. Reprenant à leur propre compte la théorie freudienne des pulsions et des instincts, Herbert Marcuse et Wilhelm Reich analysent respectivement dans leurs textes Eros et civilisation ; contribution à Freud et La révolution sexuelle’’, toutes les sources de répression qui interdisent le bonheur afin de dégager les voies possibles d’une libération instinctuelle le long de l’histoire génétique et sociale. L’un des aboutissements de cette révolution instinctuelle et sexuelle voulue par ces deux auteurs et effectivement vécue aujourd’hui est incontestablement la question du mariage pour tous dont l’analyse des implications sociales de nos jours est le principal objet du présent article.
Mots-clés : Instincts, Répression, Reproduction, Révolution, Sexualité.
Abstract :
In a somewhat contradictory step with his own theory of the instinctual and sexual revolution that he defends in early writings, Sigmund Freud considers that there is an incompatibility between the principe of pleasure; characteristic of the unconscious nature of man and the principe reality in whose name civilization demands a more and more intense repression. Taking up the Freudian theory of drives and instincts, Herbert Marcuse and Wilhelm Reich respectively analyze in their text Eros and civilization, contribution to Freud and The sexual revolution, all the sources of repression that forbid happiness in order to identify possible avenues of instinctually be rational along genetic and social history. One of the outcomes of this instinctual and sexual revolution made possible by the work of these two authors is the question of marriage for all whose analysis of the social implications of our days is the main purpose of this article.
Keywords : Instincts, Repression, Reproduction, Revolution, Sexuality.
Introduction
Dans le processus de détermination de la nature de l’homme, le rationalisme appréhende de manière classique ce dernier comme un être entièrement raisonnable. Comme tel, ses actes et ses pensées se réaliseraient ou se poseraient sous l’égide exclusive de la raison ; modalité naturelle qui le distingue irrémédiablement de tous les autres êtres de la nature. Cette conception rationaliste rassurante et apaisante de la nature de l’homme a fait son chemin jusqu’à la découverte par Sigmund Freud d’une réalité psychique jusque-là inconnue en l’homme qu’il a identifié sous le nom d’inconscient. Cette instance immatérielle est, selon Freud, le siège de tous les instincts, de toutes sortes de désirs et pulsions primaires en l’homme. Par ailleurs, la satisfaction des exigences de l’inconscient serait même de nature à mettre à mal le fonctionnement harmonieux de la société selon Freud. Aussi, la société ou la civilisation se construit-elle sur la répression des pulsions. Freud S. (1970, p. 31) ne manque cependant pas de faire remarquer que « l’influence nocive de la civilisation se réduit essentiellement à la répression nocive de la vie sexuelle des peuples civilisés par la morale sexuelle ‘’civilisée’’ qui la domine. » Par morale sexuelle ‘’civilisée’’, il convient d’entendre le refoulement systématique des pulsions. Or, il est illusoire voire impossible d’imaginer qu’il soit possible pour un individu de refouler indéfiniment et de sublimer ses pulsions sexuelles dans la vie sociale. La conséquence en est que pour Freud S. (1970, p. 36) « l’expérience nous apprend que pour la plupart des gens il existe une frontière hors de laquelle leur constitution ne peut pas suivre l’exigence de la civilisation. Tous ceux qui veulent être plus nobles que leur permet leur constitution succombent à la névrose. » Au nombre des penseurs contemporains de Freud qui ont repris à nouveau frais la dénonciation de la morale sexuelle ‘’civilisée’’ par l’inventeur de la psychanalyse dans une perspective de lutte contre cette morale répressive, nous pouvons citer Herbert Marcuse et de Wilhelm Reich. Tous deux critiques de l’ordre social de leur époque en proie à une rationalité de domination, Marcuse et Reich convergent vers une même idée de libération des instincts sexuels ou érotiques comme moyen de dépassement de la société répressive. A partir d’une démarche analytique adossée aux travaux critiques de ces deux auteurs, le présent travail structuré en trois parties, a pour principale ambition réfléchir sur la problématique de la révolution sexuelle que prônent Herbert Marcuse et Wilhelm Reich. Les résultats attendus à l’issue de cette démarche se déclinent en deux points essentiels. Le premier point consiste à montrer que la contestation de la morale sexuelle ‘’civilisée’’ par Herbert Marcuse et Wilhelm Reich a eu un impact profond et irréversible sur les choix et les orientations sexuels des uns et des autres à l’époque contemporaine. En second lieu, notre démarche entend indiquer que le respect de l’altérité dans la différence ; laquelle différence qui ne devrait cependant pas causer de préjudice à la communauté, est quelque peu gage de stabilité sociale.
1. La survie de la civilisation comme fondement de la répression selon Freud
Dans son livre Eros et civilisation, contribution à Freud H. Marcuse (1968, p. 23) nous rapporte une pensée empruntée à Freud qui suit : « l’histoire de l’homme est l’histoire de la répression. » Que peut bien signifier une telle affirmation ? Du point de vue de sa nature, l’homme se caractérise par des désirs, des instincts, des pulsions, etc. Par ailleurs, le bonheur qui demeure le but ultime de son existence n’est possible qu’à partir de la satisfaction intégrale de ses désirs, de ses instincts et autres pulsions primaires. Seulement, au nom du principe de réalité, l’humanité tend à réprimer ces modalités de l’homme en vue de sa propre sauvegarde et de son équilibre de sorte que selon H. Marcuse (1968, p. 59) « la personnalité autonome de l’individu apparaît comme la manifestation pétrifiée de la répression générale de l’humanité. » Il convient de rappeler que le principe de réalité est l’ensemble des valeurs et des normes qui régissent le comportement des individus dans une société donnée.
Ces valeurs et normes sont incarnées dans les institutions, dans les relations sociales. En outre, dans l’univers social de l’individu, on peut distinguer deux formes de répression : d’une part, la répression psychique qui fait corps avec le refoulement de la représentation du plaisir que pourrait procurer la satisfaction des désirs ; d’autre part, la répression culturelle ou sociale qui met l’individu au pas, en lui imposant des séries de contraintes et d’inhibitions dans son existence sociale. Du point de vue de Freud, vieillissant il faut le préciser ; les instincts fondamentaux tendent vers une prédominance du plaisir et l’absence de douleur. De ce fait, ils s’opposent à tout ajournement de la satisfaction, à toute limitation ou sublimation du plaisir, à tout travail hors de la libido. Or, par définition, la culture implique la sublimation, la satisfaction différée et le détournement de l’énergie de l’activité sexuelle vers un travail utile, mais sans plaisir.
La répression des pulsions est donc utile, elle est inévitable ; elle est la condition préalable de la civilisation, la condition de la survie de celle-ci. Pour Freud, l’histoire de l’homme est donc inévitablement l’histoire de sa répression, et l’histoire de la civilisation est l’histoire de la domination. Civilisation et domination sont ainsi liées dans la mesure même où la transformation répressive des pulsions sert de fondement psychologique à « une triple domination : sur soi-même et sa nature propre (sur la sensualité des pulsions qui ne cherchent que jouissance et satisfaction), sur le travail que fournissent les individus rendus soumis et disciplinés, sur la nature extérieure par la science et la technique. » H. Marcuse (1970, p. 350) Avec Freud, la répression croît en intensité avec le progrès de la civilisation. L’existence sociale et l’existence biologique de chaque individu sont liées et subissent les contraintes du temps, qui affectent profondément le fonctionnement mental de l’individu en mettant en œuvre une dynamique de domination.
Tout comme Thomas Hobbes qui se sert d’une hypothèse de travail à travers la théorie de ‘’l’état de nature’’ pour donner un éclairage de ce qu’il adviendrait selon lui de l’espèce humaine sans un minimum d’organisation sociale adossée à des lois et règles de conduites, de la même manière, H. Marcuse (1968, p. 41) nous donne les fondements historiques de cette domination à travers l’hypothèse phylogénétique de la Horde Primitive ; hypothèse empruntée à Freud notamment. Notons d’emblée que dans le symbolisme que présente Marcuse pour décrire ou dépeindre la situation de domination de l’homme dans la société où sont réprimés ses pulsions et ses instincts sexuels, on note une superposition d’images. D’un côté on a la civilisation ou la société représentée sous les traits du père ; chef de la horde primitive, de l’autre côté nous avons les fils ; image symbolique de tous les autres membres de la horde qu’on peut aujourd’hui percevoir à travers l’ensemble des membres du corps social. En sa trame inaugurale, l’hypothèse montre que le père est celui qui parvient à dominer les autres membres du clan par la possession exclusive des femmes désirées : « Le Père monopolisait la femme (le plaisir suprême) et soumettait les autres membres de la horde à son pouvoir. » H. Marcuse (1968, p. 62.)
La monopolisation du plaisir exercée par le père met les fils dans une situation d’inconfort et d’abstinence forcée. Le père incarne la domination par sa nature et par sa fonction biologique. De la sorte, « il préfigure toutes les images paternelles qui prédomineront dans le futur et à l’ombre desquelles la civilisation progressera. Dans sa personne et dans sa fonction, il incorpore la logique interne du Principe de Réalité lui-même. » Freud S. (1969, p. 132.) Le père incarne donc, tout à la fois le monopole du sexe qui assure l’ordre, le plaisir et la réalité. Sous ces traits, le père est objet de fascination et de haine. En tant qu’il les fascine, les fils veulent lui ressembler ; mais parce qu’ils éprouvent des ressentiments et de la haine pour le père, les fils se rebellent, ils commettent le parricide et instaurent le nouveau clan des fils. Seulement, le meurtre du père sonne comme un crime contre le clan et contre les fils eux-mêmes et suscite chez ceux-ci un sentiment de culpabilité. C’est à partir de cette hypothèse, selon Marcuse, que commence réellement la civilisation, avec le sentiment de culpabilité qui consiste, au terme d’un contrat social entre frères, dans l’introjection des principaux interdits, des contraintes et de l’ascèse. Mais, du point de vue de Marcuse, le sentiment de culpabilité que développent les fils de la horde primitive présente une ambiguïté qu’il décrit comme suit :
après le meurtre du père, les fils restaurent le Principe de Réalité, ce faisant, ils trahissent la promesse de leur propre action : la promesse de liberté. Coupables d’avoir tué le père, ils sont coupables de maintenir sa domination. Et c’est cette double culpabilité qui explique l’alternance de la domination et de la libération. (H. Marcuse, 1968, p. 67.).
Le processus de domination ne se limite pas seulement à la répression des pulsions et instincts sexuels. La libido elle-même sera également objet de domination ou de restriction. La restriction la plus essentielle qui lui sera infligée par le principe de Réalité est celle qui la destine exclusivement à la génitalité, à la procréation. A partir de là, tout ce qui n’est pas de l’ordre du génital sera considéré comme perversion, comme déviation sociale. Et « Freud pense que cette répression de la libido était nécessaire au maintien de la civilisation, et le sentiment de culpabilité. » Massé P. (1969, p. 77). Autrement dit, la civilisation n’est possible que si l’énergie des instincts est étroitement canalisée et contrôlée. Mieux, la sublimation répressive est indispensable au travail et à la procréation car, « ne possédant pas assez de moyens économiques de subsistance pour permettre à ses membres de vivre sans travailler, la société est obligée de détourner leur énergie de l’activité sexuelle vers le travail ». Freud S. (1974, p. 91) Et, comme pour couronner son pessimisme relatif à l’impossibilité d’une civilisation qui ne serait pas répressive, Freud S. (1971, p. 47) tient les propos suivants :
nous pouvons fort bien imaginer une communauté civilisée qui serait composée de tels ‘’individus doubles’’, lesquels, rassasiant en eux-mêmes leur libido, seraient unis entre eux par le lien du travail et d’intérêts communs. En pareil cas, la civilisation n’aurait plus lieu de soustraire à la sexualité une somme d’énergie quelconque. Mais un état aussi souhaitable n’existe pas et n’a jamais existé.
Cette position de Freud sera le point d’achoppement entre Herbert Marcuse, Wilhelm Reich et lui. La trame commune de leur critique de cette théorie de la répression des instincts chez Freud est dans un premier temps centrée sur l’hypothèse phylogénétique de la Horde Primitive elle-même. Ensuite, cette critique alliera à la fois marxisme et psychanalyse. Ces deux auteurs répugnent à concevoir la répression et la culpabilité comme endogènes et nécessaires. Pour ces derniers, en ce qui concerne spécifiquement la libération de l’homme, il faudra éveiller en lui les virtualités qui ne peuvent se satisfaire d’un quelconque bien-être et dont la manifestation comporte nécessairement et toujours une contestation de ce qui est. Le point suivant de notre démarche sera l’occasion pour nous de rendre compte des termes de leur opposition vis-à-vis de la théorie freudienne de la répression des pulsions et des instincts sexuels.
2. Herbert Marcuse et Wilhelm Reich : précurseurs de la révolution sexuelle des années 1920 à nos jours
2.1. Marcuse ou le refus de la théorie freudienne de la répression instinctuelle et sexuelle
L’hypothèse majeure de Marcuse à propos de la question générique de la liberté humaine est la suivante : faire dépendre des hommes eux-mêmes, et non d’une texture biologique frappée de nécessité et de refoulement inconscient, non seulement les institutions qui structurent de façon variable les sociétés, mais le principe de réalité lui-même. Et c’est à partir d’une déconstruction avec des relents marxisants de la métapsychologie de Freud que Marcuse structure sa critique contre la théorie de la répression des instincts et de pulsions. Marcuse relève dans un premier temps le vif intérêt des travaux de Freud relatifs au conflit inhérent aux instincts. Conflit des instincts de l’individu entre eux et conflits des instincts de l’homme avec le monde extérieur, avec la société. Seulement, selon Marcuse, Freud a omis d’examiner la possibilité d’une civilisation non répressive. Pour n’avoir pas su faire la distinction entre les différentes formes des instincts, Freud a « fait apparaître le conflit entre les instincts sous la forme réifiée d’un conflit naturel et éternel. Il convient d’établir une différence entre la répression nécessaire et la répression historiquement superflue. » H. Marcuse (1968, p. 42)
La répression superflue est ce que Marcuse qualifie de sur-répression caractéristique « des restrictions instinctuelles rendues nécessaires pour servir les intérêts spécifiques de la domination dans un contexte socio-historique particulier. » H. Marcuse (1968, p. 44) Tant que la sur-répression ou répression superflue est instinctuelle, elle demeure dans une dimension biologique donc essentiellement matérielle. Et c’est justement parce qu’elle a une dimension ou un aspect biologique qu’il y a une réelle possibilité pour que la répression superflue connaisse une solution historique selon Marcuse. Donnant plus de profondeur à son idée selon laquelle la société est obligée de limiter le nombre de ses membres et de détourner leur énergie de l’activité sexuelle vers le travail parce que ne possédant pas assez de moyens de subsistance, Freud estime que toute civilisation dépend du travail ; lequel suppose la remise de la satisfaction par la sublimation continuelle.
Contrairement à ce que Freud soutient comme idée relative à la pénurie des ressources qui justifierait la répression, Marcuse pense plutôt que cette rareté des ressources n’est pas une donnée naturelle et immuable. Bien au contraire, l’ampleur et l’inégale répartition de la rareté ou pénurie des ressources découlent d’une organisation sociale spécifique, imposée aux hommes au nom de la rationalité de la domination. La contexture de la société actuelle impulsée par un dynamisme technologique industriel sans précédent, est telle qu’on assiste à une surabondance de productivité. Aussi, l’argument de la rareté des ressources pour justifier la répression instinctuelle est-il erroné. Mais il n’en fut pas ainsi ; et H. Marcuse (1968, p. 88)peut même exprimer une sorte de dépit à travers ce qui suit :
les réalisations mêmes de la civilisation répressive semble créer les conditions préalables de l’abolition progressive de la répression. Or, c’est précisément au moment où les conditions matérielles de l’abolition de la répression sont réunies que celle-ci connaît une brutale accélération. Plutôt que d’utiliser ces conquêtes technologiques pour surmonter la pénurie et libérer les individus, la société multiplie les contrôles relevant de la sur-répression et modernise les contraintes afin que l’ordre établi de la domination ne se dissolve pas.
L’une des contraintes ‘’modernisées’’ par l’ordre établi réside dans la réduction d’Éros à la sexualité monogamique dirigée exclusivement vers la procréation. Cet état de fait qui consacre la défaite du principe de plaisir devant le principe de réalité, coïncide avec la soumission de l’homme au travail aliéné. Dans L’Homme unidimensionnel, Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée, H. Marcuse (1968, p. 43) peut dire alors ce qui suit :
pendant le temps de travail, qui occupe pratiquement toute l’existence de l’individu adulte, le plaisir est en « suspens » et la douleur domine. Puisque les instincts fondamentaux tendent vers la prédominance du plaisir et d’absence de douleur, le principe de plaisir est rendu incompatible avec la réalité et les instincts doivent se soumettre à un enrégimentement répressif.
Il convient de préciser ici que Marcuse distingue deux formes de répressions :
d’une part, la répression psychique comme refoulement de la représentation du plaisir que pourrait procurer la satisfaction des désirs ; d’autre part la répression culturelle ou sociale qui met l’individu au pas, en lui imposant des séries de contraintes et d’inhibitions dans son existence sociale. C. Dupuydenus (2015, p. 154)
Dans cette dynamique répressive, le contenu primaire de la sexualité, c’est-à-dire le facteur qui rend possible l’obtention du plaisir lié au corps est réduite à la portion congrue de la génitalité reproductrice. Dès lors, d’un principe autonome qui avait la vertu de régir tout l’organisme, la sexualité est dorénavant transformée en un moyen pour réaliser un but : celui de la reproduction de l’espèce humaine. Les désirs et pulsions qui se manifestent hors de cet impératif génital et reproducteur passent pour des perversions. Mais Marcuse est pour ce type de ‘’perversions’’ en tant qu’elles sont, selon lui, l’expression d’une révolte légitime contre la sur-répression des instincts. Il précise cette position à travers l’idée suivante : « les ‘’perversions’’ expriment ainsi la rébellion contre la soumission de la sexualité à l’ordre de la procréation et contre les institutions qui défendent cet ordre. » H. Marcuse (1968, p. 54.) L’agressivité n’affronte plus d’objet vivant, mais des institutions, une administration, un système. Par son refus du primat de la génitalité et donc de l’impératif hétérosexuel, il remet implicitement en cause tous les fondements de la sexualité traditionnelle. Ce refus de la sexualité traditionnelle sera du reste repris par le mouvement féministe notamment qui voit en cette sexualité traditionnelle une politisation de la sexualité comme un ordre social à défier. Ce refus est caractéristique chez Marcuse de l’idée selon laquelle
il ne s’agit pas de donner comme perspective celle d’une libération de la sexualité à l’intérieur des structures et institutions sociales existantes, mais au contraire d’une libération rendue possible par la transformation radicale des structures sociales. (D. Collin, S. Barbara, 2017, p. 381).
2.2. Reich et la révolution sexuelle comme condition d’une émancipation sociale
Psychanalyste autrichien né en 1897 ; un an avant la naissance de Marcuse, Wilhelm Reich travaille étroitement sous l’autorité spirituelle de Freud dans les années 1920. Il prend ses distances vis-à-vis de ce dernier sur la base de la théorie freudienne de la répression instinctuelle et sexuelle notamment. Pour Reich, on ne saurait concevoir d’émancipation sociale sans libération préalable de la sexualité. Il récuse chez Freud l’idée selon laquelle la culture doit son existence au refoulement de l’instinct. Ce dernier fonde même l’avènement des névroses au niveau des individus suite au refoulement nécessaire à toute vie collective, des pulsions sexuelles antisociales et destructrices qui habitent l’inconscient sous forme de perversions sexuelles, de fantasmes ou d’inclinaisons au meurtre, à la violence, etc. Aussi, guérir de cette pathologie ne serait-il possible qu’au prix d’efforts fournis par l’individu en libérant la pulsion refoulée par le canal de la sublimation ou en y renonçant consciemment. Reich ne partage pas cette opinion de Freud. Pour lui, le processus de refoulement des instincts sexuels ne saurait être le fondement de toute culture ; mais plutôt celui de la culture patriarcale qui,
pour se maintenir et reproduire par la même occasion la société autoritaire, réprime sexuellement les individus et en premier lieu les enfants. Cette répression des besoins sexuels provoque de ce fait une « anémie intellectuelle et émotionnelle générale, et en particulier le manque d’indépendance, de volonté et d’esprit critique ; l’individu devient par conséquent apeuré par la vie et craintif devant l’autorité. Reich W. (1982, p. 126)
Si la culture doit donc son existence à un renoncement systématique aux instincts, cela reviendrait à éliminer, selon Reich, toute sexualité. Etat de fait qui engendrerait encore davantage de névroses et démultiplierait par la même occasion les pulsions antisociales. Aussi, est-il indispensable d’opérer, du point de vue de Reich, (1982, p. 53)
une distinction entre les pulsions secondaires, pathologiques et antisociales et les pulsions biologiques naturelles. Les premières doivent effectivement faire l’objet d’une renonciation ou être sublimées, car elles empêchent l’adaptation de l’individu à l’existence sociale. Les secondes, au contraire, peuvent s’exprimer librement sans menacer la vie collective.
Les pulsions biologiques naturelles qui visent une satisfaction sexuelle saine doivent donc être libérées et même protégées de toute répression. C’est à cette seule condition, selon Reich, (2012, p. 45) que l’homme saura « réaliser le caractère indispensable de la satisfaction génitale et débarrassé de ses pulsions antisociales. » Dans l’univers conceptuel de Reich à propos de la théorie des pulsions et des instincts sexuels, celui-ci en vient à la position centrale selon laquelle la sexualité est naturellement harmonieuse et pacifiste ; et que seule l’aliénation sociale et la répression autoritaire font déraper cette sexualité vers le pathologique. Contrairement à Freud qui théorise sur l’incompatibilité des instincts et pulsions sexuels des individus avec les exigences de la culture ou de la société, Reich soutient plutôt que l’épanouissement sexuel de la population constitue la meilleure garantie de l’équilibre de l’ensemble de la société. Avec lui,
la régulation morale coercitive fait place à l’autorégulation par l’économie sexuelle : les fantaisies sadiques disparaissent, attendre l’amour comme un droit ou même violer le partenaire devient inconcevable, ainsi que l’idée de séduire des enfants ; les perversions anales, exhibitionnistes ou autres disparaissent. Reich W. (2012, p. 118.)
Cette dernière idée de Reich est lourde de sens et même sujette à caution, vu la tournure que prennent les pratiques sexuelles d’aujourd’hui. Nous y reviendrons. Pour l’heure, il convient de dire que par « économie sexuelle » évoquée plus haut, Reich entend la possibilité que le désir pour d’autres personnes puisse s’exprimer librement, que la relation monogamique n’ait pas pour principal but l’inhibition morale, mais qu’elle facilite plutôt la satisfaction sexuelle. Car, selon Reich, les femmes sont les premières victimes de la morale sexuelle et de l’idéologie monogamique. De l’avis de Reich en effet, l’idéologie monogamique consacre la misère des femmes ; misère caractéristique de la réduction de leur sexualité à la fonction reproductive. Dès lors, l’empêchement au droit à l’avortement et les recours aux méthodes anti conception par exemple, participent de ce processus de négation du plaisir sexuel des femmes.
Au total, pour Reich, lever le tabou qui pèse sur la sexualité est un enjeu fondamental dans le processus de construction d’une société libre. Seule une éducation sexuelle favorable au plaisir, la diffusion de moyens anticonceptionnels peuvent créer, selon lui, les conditions d’une véritable libération sexuelle. Il relève cependant que ce type de solution ne peut prendre place au sein de l’ordre social autoritaire et implique par conséquent un renversement global du système.
De la plongée à l’intérieur des positions de Marcuse et de Wilhelm Reich à propos de la libération sexuelle, que devrait-on retenir ? Une première observation est à faire. Marcuse et Reich ont une approche de la libération sexuelle théoriquement différente d’une approche à une autre. Ayant travaillé avec Freud en qualité de médecin clinicien psychanalyste, Reich suggère des méthodes normatives et pratiques pour l’avènement de la révolution sexuelle. Quant à Marcuse, son statut de philosophe l’amène à proposer des pistes moins concrètes mais beaucoup plus diffuses et subtiles pour une libération des instincts et pulsions sexuels. Chez lui, la libération d’Éros s’effectue par une érotisation étendue non seulement au corps dans son ensemble, mais à toute activité et toute relation pour faire triompher le principe de plaisir dans une société non répressive. Mais en dépit de cette différence dans leur approche de la question de la révolution ou de la libération sexuelle, nous pouvons inférer qu’à partir de leurs différents travaux en totale rupture avec la théorie freudienne de la répression des instincts et pulsions sexuels, Marcuse et Reich apparaissent comme de véritables hérauts ou précurseurs de la remise en cause de la morale sexuelle admise socialement, et adoubée d’un point de vue religieux par la civilisation judéo-chrétienne.
Il est par ailleurs indéniable qu’il existe une abondante littérature relative à la libération sexuelle ; post ou antérieure aux travaux de ces deux auteurs. Cependant, Herbert Marcuse et Wilhelm Reich demeurent des points de repères fondamentaux dans cette littérature. En effet, leurs réflexions sur la question de la répression des instincts et pulsions sexuels sont d’une acuité telle que leurs écrits ont servi de référents et de ressorts théoriques aux activistes de l’insurrection étudiantes de Mai 68, du FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) et du MLF (Mouvement de Libération des Femmes.) Vivre l’expérience du plaisir sexuel sans contrainte liées à la question de la reproduction, entretenir des relations amoureuses ou sexuelles libres et diversifiées comme l’hétérosexualité, l’homosexualité, le mariage pour tous, etc. sont entre autres, quelques implications de la libération sexuelle telle que souhaitée par Marcuse et Reich. L’analyse de ces implications sera l’objet de la troisième et dernière articulation de la présente démarche.
3. Enjeux et perspectives d’une lutte pour la libération sexuelle telle que souhaitée par Herbert Marcuse et Wilhelm Reich
Parler d’une lutte pour une libération sexuelle revient implicitement à présumer de l’existence d’une sexualité qui serait certainement enfermée dans un carcan de contraintes et autres interdits sociaux. Ce sont ces interdits que reproduira du reste Sigmund Freud dans toute sa théorie de la répression des instincts et pulsions sexuels. Aussi, les travaux de Marcuse et ceux de Wilhelm Reich sans oublier tous les autres travaux orientés dans la même perspective, ont-ils le mérite de poser la problématique d’une certaine construction ou reconstruction de la sexualité par l’individu lui-même à partir de l’autonomie dans l’utilisation de son corps principalement. En l’espèce, nous nous intéresserons ici, dans un premier temps, au Mouvement de Libération des Femmes théoriquement impulsé par les réflexions de Marcuse et celles de Reich, ensuite au courant de pensé selon lequel la détermination d’un genre d’individu n’est pas forcément liée à l’appartenance à un sexe donné, et enfin nous nous intéresserons à la question du mariage pour tous et ses implications.
3.1. Le Mouvement de Libération des Femmes et la révolution sexuelle
Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) est une organisation féministe qui s’est véritablement fait connaitre au début des années 70 ; suite à un désenchantement des femmes consécutif aux vagues de protestations populaires liées à l’insurrection étudiante de 1968. De leurs points de vue, les mouvements de protestation de Mai 68, représentaient pour elles un véritable espace de liberté jusqu’alors inespéré face au poids du patriarcat et des normes sociales contraignantes à leur dépend. Seulement, les femmes vont estimer que la révolution sexuelle qui devait être la base de la désaliénation de l’individu et le moteur du projet de libération sociale, s’est transformée en une vaste duperie au service de la domination masculine. La marque manifeste du désappointement des femmes est traduite ici par cette réflexion de l’historienne Picq F. (1993, p. 105). « Pour nombre de femmes, la sexualité libre est apparue surtout comme libérée des sentiments, comme une manière pour les hommes d’éviter tout investissement affectif. » Si elles ne remettent pas en cause les fondements théoriques de la révolution sexuelle, elles récusent néanmoins les interprétations et une mise en pratique de ces fondements qui ne favoriseraient manifestement pas leur émancipation dans cette révolution sexuelle. Elles dénoncent une espèce de chosification de leur corps par l’ordre social d’obédience capitaliste notamment. Jaspar M. (1997, p. 54) dit à cet effet ce qui suit : « la révolution sexuelle s’est traduite par une instrumentalisation sans précédent du corps des femmes à des fins marchandes, en particulier dans la pornographie et la publicité. » Cette critique de l’exploitation des femmes comme objets sexuels dans la société capitaliste trouve sa source dans l’analyse de Marcuse qui dénonce les effets aliénants d’une libération sexuelle dans le cadre du principe de rendement. Dans cette perspective, Marcuse avance l’idée suivante : « Si la société technologique libéralise la sexualité, c’est toujours en fonction de sa structure de domination axée sur le profit et l’accroissement de la productivité. Autrement dit, la libéralisation sexuelle est une valeur marchande. » H. Marcuse (1964, p. 22) Un autre aspect théorique de la pensée de Marcuse repris par les femmes au sein du MLF est l’idée suivante : « le chemin vers la libération doit être défini par les « méprisés et les exclus eux-mêmes », et non par des avant-gardes s’exprimant à leur place. » H. Marcuse (1964, p. 40)
De la précédente idée de Marcuse à celle de Reich mentionnée à la fin du point deux (2) de la deuxième grande articulation de notre étude ; idée selon laquelle ‘’ les fantaisies sadiques disparaissent, attendre l’amour comme un droit devient inconcevable, (…), les perversions anales, exhibitionnistes ou autres disparaissent’’, l’histoire de la révolution sexuelle à l’époque contemporaine aura été rythmée par une déferlante de revendications qui, les unes endossent quelque peu la recommandation de Marcuse, et les autres prenant totalement à contre-pied la pensée de Reich.
3.2. Les idées de Marcuse et celles de Reich au cœur de la question du genre et de la problématique du mariage pour tous
Lorsque Herbert Marcuse admet l’idée reprise par (Claudia Optiz, 2006, p. 360) à savoir que « le chemin vers la libération doit être défini par les méprisés et les exclus eux-mêmes », on peut légitimement soutenir qu’il fait partie des inspirateurs de la visibilité de la question de certains droits que revendiquent les homosexuels ; revendication qui s’inscrit elle-même dans un mouvement plus large de changement de mentalités. Bien plus, Marcuse apparait comme l’un des inspirateurs des auteurs comme la philosophe américaine Butler J. (1990, p. 97) qui dit : « l’on est désormais libre de choisir son identité sexuelle comme on sélectionne un vêtement dans sa penderie. L’état de l’homme ou de la femme que nous croyons naturel est une construction sociale. »
Au demeurant, ce que Reich qualifie de ‘’perversions anales’’ en l’occurrence l’homosexualité et le lesbianisme qui passaient à ses yeux pour inconcevables et que l’on ne devrait pas percevoir comme amour à attendre comme un droit, apparait pour Eribon D. (2012, p. 21) comme « le mouvement qui mène de l’assujettissement à la réinvention de soi. C’est-à-dire de la subjectivité produite à la subjectivité choisie. » Si ‘’la subjectivité produite’’ est caractéristique des contraintes sociales imposées à l’homme dans son individualité, ‘’la subjectivité choisie’’ est le type de vie que souhaite mener l’homme pris dans sa singularité. La sexualité ne renvoie plus à un donné biologique mais définit une condition d’existence. Les existentialistes estiment même que l’homosexualité ne repose pas sur un déterminisme biologique, mais sur un choix. C’est manifestement cette idée que résume la pensée de Butler J. (2014, p. 65) ci-contre : « dire aux autres ce que doit être leur vie pour qu’elle soit belle reviendrait sans doute à nier la pluralité des vies, à dévaloriser certaines vies au profit d’autres. »
Aujourd’hui, l’essentiel de l’argumentaire des partisans d’une autre forme de sexualité qui contraste d’avec la morale sexuelle admise, c’est qu’avec cette morale sexuelle, l’effacement du désir se fait sur la surface même du corps, par la circonscription de son pouvoir érogène à des zones exclusives : la cavité vaginale pour la femme, le phallus pour l’homme. Cette idée n’est pas sans rappeler une idée analogue de Marcuse mais à la différence notable que chez Marcuse, la resexualisation du corps ne saurait aller sans envelopper la sphère spirituelle de l’individu, réprimée par le principe de rendement, au niveau d’une raison sensible. La resexualisation du corps suppose chez H. Marcuse (1968, p. 186) qu’ : « Éros est vraiment la force organisatrice d’unités toujours plus vastes, la pulsion biologique, une impulsion culturelle, dans une société où, grâce à la productivité de l’automation, le travail aliéné serait suspendu au profit d’activités imprégnées par la libido. » Il convient de comprendre avec Marcuse que la satisfaction du besoin de bonheur et de liberté appelle la transformation de la sexualité en Éros, pulsion agrégative et instinct de vie qui lutte pour l’intensification, l’épanouissement et l’unification de la vie.
Les développements théoriques sur la question de la révolution sexuelle dont nous avons rendu compte avec Marcuse et Reich comme auteurs, ont-ils fait l’objet d’interprétation fidèle de la part des différents lobbies qui luttent pour la cause Gay en tous points de vue ? Marcuse et Reich sont-ils comptables de ce qui passe aux yeux du commun des mortels comme dérive sexuelle vécue aujourd’hui à travers le phénomène du mariage pour tous par exemple ? Si la lutte pour la libération sexuelle est une façon pour les activistes et défenseurs de la cause Gay d’opposer un refus aux déterminations matérielles, morales et politico-idéologiques dans lesquelles la sexualité semble enserrée, est-ce pour autant qu’il faille imputer à nos deux auteurs l’exacerbation de cette lutte ? Ces questions sont symptomatiques d’une tentation qui verrait en Marcuse et Reich les inspirateurs lointains de certaines déclinaisons de cette révolution sexuelle ; déclinaisons perçues aujourd’hui comme de véritables problèmes de société.
De 1970, soit deux ans après les mouvements insurrectionnels de Mai 1968, aux années 1980, plusieurs manifestations d’obédience gay ou homosexuelle auront eu lieu pour intensifier la lutte en vue d’une reconnaissance et de l’acceptation des pratiques sexuelles qui sortent du cadre communément admis par la société. Le couronnement de ces luttes est sans conteste la législation et la légalisation du mariage pour tous dans plusieurs pays occidentaux dont la France et les Etats-Unis sont les pionniers.
Pour rappel, à partir de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, le parlement français autorise le mariage des couples de personnes de même sexe, également appelé ‘’mariage homosexuel’’ ou ‘’mariage pour tous. Le premier mariage du genre sera célébré deux semaines plus tard dans la ville de Montpellier. Plusieurs pays occidentaux emboiteront le pas à la France. Et selon l’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique) 62 français sur 100 seraient aujourd’hui favorables à ce type de mariage. Du côté des USA, depuis le 26 juin 2015, la Cour Suprême enjoint chaque État de la fédération à autoriser la célébration du mariage pour tous.
Que dire de cette brusque accélération des évènements relatifs à la lutte pour une libération sexuelle telle que souhaitée par Marcuse et Reich ? Même si la posture antiautoritaire et anticapitaliste impulsée et incarnée par Marcuse et par Wilhelm Reich a eu un impact certain aussi bien dans les positions théoriques que dans le mode d’organisation et d’action du MLF, du FHAR et de toute la galaxie Gay, peut-on légitimement imputer à ces deux auteurs les derniers développements d’une révolution sexuelle cristallisée aujourd’hui par le phénomène du mariage pour tous et de ses diverses implications sociales ? La réponse à cette question majeure réside certainement dans l’approche que chacun de nous pourrait faire des notions d’engagement et de responsabilité personnelles.
Conclusion
Par l’idée de révolution sexuelle, l’on pourrait bien entendre et présumer plusieurs paradigmes sociologiques. Entre autres : l’usage de la pilule chez la femme à l’effet de sortir les rapports sexuels de leur carcan ‘’naturel’’ de la reproduction ou de la procréation, un certain déclin de la morale sexuelle héritée en grande partie de la civilisation judéo-chrétienne qui aura recouvert d’un épais voile pudique les pratiques sexuelles, une libération certaine de la parole sur la sexualité dans l’espace public, etc. Si pendant l’insurrection des étudiants en Mai 68 la question de la libération sexuelle n’était vraiment pas inscrite au nombre des revendications, il est tout de même opportun de noter que cette question s’est épanouie dans l’ombre de ces évènements avec, notamment, le recours aux travaux de Marcuse et de Reich comme ressorts théoriques et idéologiques. Et le principal enseignement que les activistes de la révolution sexuelle tirent des travaux de ces deux auteurs c’est la mise en avant de l’idée de l’individu. Dans son texte ‘’Notes critiques (1949-1969)’’ Horkheimer M. (2009, p. 55) nous dit ce qui suit : « Seul l’individu est quelque chose. » Le développement que fait Horkheimer de sa propre pensée nous introduit au cœur d’une appréciation de la notion d’individu sous le prisme de la dialectique. ‘’Seul l’individu est quelque chose’’ signifie ou pourrait signifier que l’individu est l’unité la plus petite et la plus concrète de la vie sociale, en-deçà de laquelle il n’y a plus rien, unité en tant que telle irremplaçable, au nom de laquelle bonheur et liberté peuvent encore avoir un sens et être promis. Bonheur et liberté sont, pour ainsi dire, les éléments qui fondent l’émancipation de l’individu. Seulement, l’émancipation de l’individu à travers l’affirmation de ses droits fondamentaux dans la société a pour revers son intégration à un ordre social où se dissout son individualité concrète. En outre, poser en filigrane la problématique du droit à la différence dans l’orientation sexuelle des uns et des autres ne saurait signifier que nous souscrivons à une forme de sexualité au détriment d’une autre. En tant que philosophe, nous voulons juste nous inscrire dans la même perspective que M. Horkheimer (2009, p. 55) qui dit que
la philosophie a à se préoccuper avant tout de phénomènes tels qu’ils ne peuvent être compris qu’en rapport avec la vie sociale des hommes : de l’État, du droit, de l’économie, de la religion, bref, des conditions générales matérielles et spirituelles de la culture de l’humanité dans son ensemble.
Références bibliographiques
BUTLER Judith, 2014, Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Traduction Martin Rueff, Paris, Éditions Payot.
BUTLER Judith, 1990, Trouble dans le genre, Routledge Éditions.
COLLIN Denis- BARBARA Sébastien, 2017, Comprendre Marcuse, Philosophie, théorie critique et libération humaine, Paris, Max Milo Éditions.
DUPUYDENUS Claude, 2015, Herbert Marcuse ou les vertus de l’obstination, Préface de Michel Onfray, Paris, Éditions Autrement.
ERIBON Didier, 2012, Réflexions sur la question Gay, Paris, Flammarion.
FREUD Sigmund, 1970, La Vie sexuelle, Paris PUF.
FREUD Sigmund, 1969, Moïse et le Monothéisme, traduction Anne Berman, Paris, Tel Gallimard.
FREUD Sigmund, 1971, Malaise dans la civilisation, Paris, Gallimard.
FREUD Sigmund, 1974, Introduction à la psychanalyse, traduction Evelyne Lenoble, Paris, Payot (Nouvelle édition).
HORKHEIMER Max, 1993, Notes critiques (1949-1969), traduction Stéphane Cornille et Philippe Ivernel, Paris, Payot.
HORKHEIMER Max, 1978, Théorie critique, traduction Charles Maillard, Paris, Éditions Payot.
JASPARD Maryse, 1997, La sexualité en France, Paris, La Découverte.
MARCUSE Herbert, 1970, Culture et société, traduction Gérard Billy et Daniel Bresson, Paris, Éditions de Minuit.
MARCUSE Herbert, 1968, Eros et civilisation, contribution à Freud, traduction Jean-Guy Nény et Boris Fraenkel, Éditions de Minuit.
MARCUSE Herbert, 1968, L’Homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée, traduction Monique Wittig, Paris, Éditions de Minuit.
MARCUSE Herbert, 1964, Vers la Libération. Au-delà de l’Homme unidimensionnel, traduction Jean-Baptiste Grasset, Paris, Éditions de Minuit.
MASSE Pierre, 1969, La Pensée de Herbert Marcuse, Paris, Privat Éditions.
PICQ Françoise, 1993, Libération des femmes. Les années mouvement, Paris, Seuil.
REICH Wilhelm, 1979, Matérialisme dialectique et psychanalyse dans la crise sexuelle, Paris, Tel Gallimard.
REICH Wilhelm, 1982, La révolution sexuelle, Paris, Éditions Christian Bourgeois.
REICH Wilhelm, 2012, Sexualité, marxisme et psychanalyse, Paris, La Découverte.
DANS L’UNIVERS DE L’ANALYSE PRAGMATIQUE DU LANGAGE
Franck Viviane BEUGRÉ
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Le présent Article « Dans l’univers de l’analyse pragmatique du langage » est une contribution à la découverte, ou du moins à la compréhension, de l’étude pragmatique du langage. Il retrace les pensées de trois grands philosophes qui ont vu en la pragmatique le domaine d’étude linguistique dans lequel se révèle le sens réel du langage. Concernant ces philosophes, il s’agit de Ludwig Wittgenstein, John Langshaw Austin et John Searle. Les théories d’acte de langage et de jeux de langage développées par ces auteurs permettent de comprendre que l’étude pragmatique du langage n’aurait jamais dû passer aussi longtemps sous silence. Elle met en lumière des concepts comme ceux d’acte de langage, d’usage de contexte et d’intention ; des concepts qui ont, depuis longtemps, été négligés par les philosophes du langage et qui pourtant ont un lien étroit avec la question du sens des énoncés. La pragmatique est tout aussi importante que la sémantique, cette autre dimension du langage qui fait de la question de la vérité le sens ultime du langage.
Mots clés : Acte de langage, Contexte, Intention, Sens, Usage.
Abstract:
This article « In universe of pragmatic language analysis » is a contribution to the discovery, or a least to the understanding, of the pragmatic study of language. It retraces the thoughts of three great philosophers who saw in pragmatics the area of linguistic study in which the real meaning of language is revealed. Concerning these philosophers, they are Ludwig Wittgenstein, John Langshaw Austin and John Rogers Searle. The theories of language act and language games developed by these authors allow us to understand that the pragmatic study of language should never have been kept silent for so long. They shed ligth on concepts such as the act of language, the use of context and intention, concepts that have long been neglected by philosophers of language and wich nevertheless have a close link with the question of the meaning of stated. Pragmatics are just as important as semantics, this other dimension of language that makes the question of truth the ultimate meaning of language.
Keywords : Act of language, Context, Intention, Meaning, Use.
Introduction
La philosophie du langage est une discipline philosophique dont l’étude porte principalement sur le langage. Si certains philosophes ce sont donnés pour tâche d’élucider les questions traditionnelles à savoir celles portant sur l’existence, la réalité, la connaissance, le bien etc. d’autres par contre ont jugé nécessaire de réfléchir sur le langage. Le choix de la réflexion sur le langage pour ces philosophes s’explique par le fait qu’une analyse du langage, autrement dit une étude sur le langage, pourrait contribuer à la solution ou au moins à l’éclaircissement de ces questions traditionnelles. Il y a donc un enjeu capital en cette étude et celui-ci ne concerne rien d’autre que la connaissance. Par le langage, il est possible d’accéder à la connaissance, celle-là même que vise la philosophie. Toutefois, pour y parvenir il faudra purifier le langage, le débarrasser des imperfections qu’il recèle. Tel est le point de vue de G. Frege (1971, p. 69) qui estime que le langage naturel est inapte à l’expression des connaissances particulièrement celles des mathématiques. Pour lui, ce dont on a besoin c’est d’un langage artificiel, logiquement parfait où chaque signe renvoie à un objet bien précis de la réalité car, seul celui-ci peut résoudre les problèmes d’ambiguïtés, de sens et d’erreur. La quête d’un langage formel, un langage débarrassé des scories du langage ordinaire tel qu’envisagé par Frege marque le point de départ d’une tradition de type analytique. Frege sera soutenu par plusieurs penseurs notamment Bertrand Russel, Ludwig Wittgenstein et les positivistes logiques du Cercle de Vienne. La thèse que défendent ces philosophes dont le courant de pensée est de type philosophico-scientifique est que, un énoncé n’a de sens que lorsqu’il possède un contenu factuel, c’est-à-dire, lorsque l’énoncé dépeint un état de choses. Leur point de vue est motivé par la quête du savoir. Le savoir, la connaissance ne s’acquiert que par l’expérience, le réel. Pour connaitre, pour s’instruire, ainsi que l’estiment ces philosophes, il faut avoir accès au réel et cela par le biais du langage. Les énoncés qui figurent dans le répertoire de ces philosophes ne sont constitués que dénoncés susceptibles de vérité ou de fausseté. Les énoncés qui ne tombent pas sous le coup de la vérité ou de la fausseté ne sont pas pris en compte chez les philosophes logiciens. Ils sont dits dépourvus de sens. Il s’opère donc une classification au sein des énoncés : les énoncés vrais ou faux et pourvus de sens et les énoncés ni vrais ni faux et dépourvus de sens. Mais cette classification est-elle fondée ? Est-ce parce qu’un énoncé ne relève pas de l’expérience sensible qu’il ne traduit rien qui soit sensé ? Devons-nous aussi comprendre que tout énoncé pourvu de sens n’a de fonction que représentative ?
Pour ces questions, l’on retrouve quelques éléments de réponses dans les travaux de Ludwig Wittgenstein, de John Langshaw Austin et de John Rogers Searle. Les différentes analyses menées par ces auteurs permettent de découvrir un autre domaine d’étude de la philosophie du langage, domaine qui depuis la première moitié du XXe siècle avait été délaissé par les philosophes logiciens. Il s’agit de la Pragmatique. Nous commencerons l’exposition de cette étude nouvelle par la théorie des actes de langage d’Austin. Nous aborderons ensuite celle de Searle puis nous terminerons par celle de Wittgenstein.
1. La théorie des actes de langage d’Austin
Austin (1911-1960) est l’initiateur de la théorie dite des actes de langage. C’est en 1955 à Havard lors des conférences dénommées William James Lectures qu’il élabore pour la première fois la théorie des actes de langage. Celle-ci se présente en une série de douze conférences publiées sous le titre How to do things with words (1962) pour la version anglaise et Quand dire, c’est faire (1970) pour la version française. L’élaboration de la théorie des actes de langage par Austin lui vient de son refus de la conception logiciste selon laquelle seules les affirmations vraies ou fausses constituent des énoncés doués de sens. Pour Austin, les philosophes se méprennent en posant une telle conception. Il existe, selon lui, des énoncés qui ne dépeignent pas des états de choses, qui ne sont ni vrais ni faux, mais qui ne sont pas pour autant dépourvus de sens. Ces énoncés selon J. L. Austin (1970, p. 41) concerne ceux du genre ci-dessous :
1) « Oui « je le veux » c’est-à-dire, je prends cette femme comme épouse légitime » ce « oui » étant prononcé au cours de la cérémonie du mariage.
2) « Je baptise ce bateau le Queen Elizabeth. » (Comme on dit lorsqu’on brise une bouteille contre la coque.)
3) « Je donne et lègue ma montre à mon frère Paul. » comme on peut lire dans un testament.
4) « Je parie six pence qu’il pleuvra demain. ».
Ces énoncés contiennent des mots dont le but consiste non pas à décrire des états de choses mais à faire montre des circonstances dans lesquelles l’affirmation est faite ou la façon dont il faut la prendre. Dans ces cas, ils n’assurent pas une fonction descriptive. Ils peuvent avoir pour but soit, de dire ce que l’on ressent à la vue des choses, soit pour exprimer des intentions, ou même pour susciter des effets sur autrui. Leur particularité tient au fait qu’ils servent à accomplir des actions. Pour Austin, près des énoncés descriptifs et pourvus de sens se trouvent également des énoncés appartenant au registre de l’action. Il nomme cette classe d’énoncés « performatif » puis les opposent aux « constatifs » (les énoncés descriptifs).
1.1. La distinction constatifs / performatifs
Le type d’énoncés que l’on retrouve dans la catégorie des énoncés constatifs se présente généralement comme suit J. L. Austin (1962, p. 275) :
1) Les enfants de jean sont chauves.
2) Le chat est sur le tapis.
3) Tous les invités sont français.
Comme nous pouvons le constater, ces énoncés se rapportent à des faits vérifiables. En ce sens, seule l’observation, la confrontation de l’énoncé avec la réalité permet de dire si oui ou non l’état de choses exprimé est réel ou non. C’est ainsi que l’énoncé acquiert une valeur de vérité vraie ou fausse. Les énoncés performatifs sont différents. Ils se caractérisent par le fait que leur production est ou fait partie de l’accomplissement d’une action qui ne serait pas normalement décrite comme l’action de dire quelque chose J.L Austin (1970, p. 41). Produire l’énonciation « Je baptise ce bateau le Queen Elizabeth », ce n’est pas dire que je baptise le bateau, je le baptise réellement. Et cela implique selon Austin que d’autres conditions sont réalisées. Il faut par exemple que je sois la personne indiquée pour le baptême, il faut qu’au moment de la profération des paroles, la bouteille de champagne soit brisée sur la coque du bateau. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, il se dit de l’acte qu’il a été accompli avec succès ou qu’il est réussi. Dans le cas contraire l’acte est un échec. On ne dit pas qu’il est faux mais plutôt qu’il est défectueux.
Si les énoncés constatifs sont vrais ou faux en raison du fait qu’ils décrivent des états de choses, les performatifs, eux, sont heureux ou malheureux en ce sens qu’ils constituent l’accomplissement d’une action. Tel fut le premier critère donné par Austin pour distinguer les deux catégories d’énoncés. Mais dans le cours de ses recherches, Austin sera conduit à rechercher un autre critère de distinction entre l’énoncé constatif et l’énoncé performatif. La raison de ce fait est que les constatifs ne sont pas exempt de la question de bonheur et de malheur que l’on croyait propre aux performatifs, tout comme les énoncés constatifs ne sont, aussi, pas exempt de la question de vérité et de fausseté propre aux constatifs. En d’autres termes, la vérité ou fausseté qui caractérise les constatifs, peut toucher les performatifs, tout comme le bonheur ou malheur qui caractérise les performatifs peut aussi atteindre les constatifs.
Le nouveau critère est d’ordre grammatical. Austin présente la première personne du présent de l’indicatif, voix active comme le critère permettant de reconnaitre un énoncé qui accomplit une action (énoncés performatifs). Exemples (se référer aux exemples d’énoncés performatifs ci-dessus). Tous les énoncés se présentant sous cette forme grammaticale sont dits performatifs vue que le « je » qui effectue l’action entre en scène. Cependant à bien regarder, il y a des énoncés qui ne se présentent pas sous cette forme grammaticale mais qui constituent également des énoncés performatifs. Il y a des actions que l’on accomplit en produisant des énonciations telles que celles-ci J. L. Austin, (1970, p. 83) :
1) Tournez à droite !
2) Vous pouvez partir.
3) Vous étiez hors-jeu.
La première énonciation peut être prononcé en lieu et place de « Je vous ordonne de tourner à droite », la seconde peut être prononcé en lieu et place de « Je vous conseille ou recommande de partir ». La troisième, elle, peut être prononcé en lieu et place de « Je déclare que vous êtes hors-jeu. ». Employer les phrases décrites en 1, 2 et 3 dans les contextes tels que décrits, c’est accomplir respectivement les actes suivants : « ordonner », « conseiller » et « déclarer ». Ces phrases, bien que n’étant pas construites à la première personne du présent de l’indicatif, constituent des cas de performatifs au sens plein du terme vu qu’en les employant le locuteur manifeste l’intention de donner un ordre à son interlocuteur, de conseiller celui-ci et aussi de lui faire une déclaration. Ce type d’énoncé conduit Austin à opérer une répartition au sein des énoncés performatifs. Il s’agit de la distinction performatif primaire / performatif explicite.
1.1.1. Les performatifs primaires
Les performatifs primaires représentent chez Austin des énoncés dont la valeur de l’énoncé est imprécise. Ce sont des énoncés primitifs, c’est-à-dire des énoncés que l’on pouvait retrouver à un stade non encore évolué du langage. « Dans les langages primitifs on ne distinguait pas encore clairement les diverses actions que nous étions susceptibles d’accomplir de celles que nous accomplissons effectivement. » (J. L. Austin, 1970, p. 92). « Taureau ! » « Tonnerre ! » en constituent quelque part des exemples. Lorsque le contexte de l’énonciation n’est pas explicité on ne peut savoir avec précision la valeur réelle de l’énonciation. Par leur expression, doit-on entendre un avertissement, une information ou une prédiction ? Les performatifs primaires n’explicitent pas la valeur de l’énonciation et ce faisant le sens de l’énonciation n’est pas rendue clair. On comprend ici que les mots seuls parfois ne servent pas à identifier le vouloir-dire du locuteur.
1.1.2. Les performatifs explicites
Les performatifs explicites sont tout le contraire des performatifs primaires. Ils sont effectués en explicitant la nature de l’acte que le locuteur manifeste d’accomplir lors de l’énonciation de la phrase. En d’autres termes, l’acte de langage accompli par le locuteur au moment de l’énonciation de la phrase se trouve mentionné dans la phrase. Il n’y a pas à aller sous d’autres cieux pour en comprendre le sens. Le sens des performatifs explicites est clair, précis sans équivoque et ambiguïté. Les énoncés « Je t’ordonne de tourner à droite. », « Je te conseille de partir. », « Je vous déclare hors-jeu. », représentent des exemples de performatifs explicites. Les verbes ordonner, conseiller et déclarer qu’ils contiennent constituent des verbes performatifs. Leur usage dans ces phrases met en lumière la valeur réelle de chacune de ces énonciations. On dit dans ce cas que le locuteur accomplit les actes d’ordonner, de conseiller, de déclarer.
La distinction ainsi établie entre les performatifs primaires et les performatifs explicites conduit Austin à renoncer à sa distinction initiale entre énoncés constatifs et énoncés performatifs dans la mesure où il voit une difficulté à faire la distinction entre un performatif primaire et un énoncé constatif. Les énoncés constatifs lui semble être des énoncés performatifs en ce sens qu’en les explicitant à travers des performatifs explicites (verbes performatifs) ils se présentent comme des performatifs à part entière. Austin conclut donc que tous les énoncés servent à accomplir des actions. Il n’existe pas des énoncés qui servent à dire uniquement, et des énoncés qui servent à accomplir uniquement des actions. Tout dire est un faire mais des faires de nature différente. On assiste ainsi à l’introduction de la distinction locution-illocution-perlocution, l’un des points essentiels de la théorie d’Austin.
1.2. La distinction locution-illocution
La distinction locution-illocution-perlocution constitue chez Austin les trois types d’actes distincts que tout locuteur accomplit lors de l’énonciation d’une phrase. Ils sont accomplis simultanément, ce qui signifie que lorsque nous usons de la parole, nous accomplissons trois sortes d’actes à la fois. Ces actes peuvent être aussi appelés actes locutoires, actes illocutoires et actes perlocutoires. Pour les donner à comprendre, Austin les distingue entre eux. Le premier couple : locution-illocution puis le second, illocution-perlocution.
1.2.1. Locution-illocution
La locution consiste en l’acte de simplement dire et comprend à lui seul trois sous autres actes qui sont l’acte phonétique, l’acte phatique puis l’acte rhétique. L’acte phonétique consiste à accomplir certains sons. C’est un type d’acte, ainsi que l’indique D. Laurier (1980, p.98-99), que certains animaux (perroquet, chien) sont capables d’accomplir. L’acte phatique, lui, consiste à accomplir des mots grammaticalement articulés. C’est un type d’acte qu’aucun animal n’est capable d’accomplir et que quelqu’un pourrait accomplir sans comprendre le sens des paroles qu’il prononce. Quant à l’acte rhétique, il consiste à employer certaines expressions dans un certain sens et avec une certaine référence. C’est un type d’acte qu’un locuteur accomplit tout en en sachant le sens. Le discours direct dans le discours sert à rapporter l’acte phatique. Tandis que le discours indirect sert à rapporter l’acte rhétique. Ainsi, « il a dit : Le chat est sur le tapis. » décrit un acte phatique pendant que « Il a dit que le chat était sur le tapis décrit un acte rhétique ». L’accomplissement d’un acte rhétique se fait par la connaissance du sens de la phrase et, son énonciation également en tant qu’elle a, non pas un sens mais, ce sens. Identifier un acte phatique et un acte rhétique, c’est savoir faire la différence entre le discours direct et indirect. Dans le discours indirect l’on attache aux expressions leur sens propre. Accomplir un acte phatique, ce n’est pas accomplir un acte rhétique. L’inverse est pourtant vrai. L’acte rhétique comprend donc l’acte phonétique et l’acte phatique. Austin l’identifie pour ce fait à l’acte locutoire. La réalisation d’un acte rhétique est aussi la réalisation d’un acte locutoire. Mais un acte locutoire n’est pas un acte illocutoire. L’acte illocutoire est distinct de l’acte locutoire en ce que l’acte illocutoire n’est pas l’acte de simplement dire, mais le fait de dire avec une certaine manière qu’on appelle force ou valeur illocutoire. Illustrons avec J.L. Austin (1970, p. 114)
(E.1) Acte (A)-locutoire
Il m’a dit « tire sur elle », voulant dire par « tire » tire, et se référant par elle à elle.
Acte (B)- illocutoire
Il me pressa (ou me conseilla ou m’ordonna etc.) de tirer sur elle.
De façon plus précise l’acte illocutoire constitue l’intention de communication du locuteur.
1.2.2. Illocution-perlocution
L’acte illocutoire et l’acte perlocutoire constituent tout deux des types d’actes dont le but consiste à susciter des effets chez l’auditeur. Cependant, l’effet recherché est différent de part et d’autre. L’effet recherché dans l’acte illocutoire consiste, pour le locuteur, à emmener l’auditeur à comprendre ce qui est dit. Tandis que l’effet se situant au niveau perlocutoire est une pure conséquence des propos proférés par le locuteur. L’acte perlocutoire est un acte provoqué par le fait de dire quelque chose. Afin de montrer ce dont il est question, Austin (1970, p. 114) rajoute à l’exemple précédent deux autres actes : l’Acte (Ca) et l’Acte (Cb). On obtient ainsi ce qui suit :
(E.1) Acte (A)-locutoire
Il m’a dit « tire sur elle », voulant dire par « tire » tire, et se référant par elle à elle.
Acte (B)- illocutoire
Il me pressa (ou me conseilla ou m’ordonna etc.) de tirer sur elle.
Acte (C.a) -perlocutoire
Il me persuada de tirer sur elle.
Acte (C.b)-perlocutoire
Il parvint à me faire (ou me fit, etc.) tirer sur elle.
L’acte (C.a) et l’acte (C.b) représentent tous deux des actes perlocutoires. Par le fait de dire quelque chose, il peut arriver qu’on modifie, parfois, sans le vouloir, le comportement de l’auditoire. L’effet attaché ici à l’acte perlocutoire fait de cet acte, un acte non conventionnel contrairement à l’acte illocutoire qui, lui, est conventionnel. Cela dit, l’acte illocutoire contrairement à l’acte perlocutoire peut être exprimé à travers des marques linguistiques. Par exemple, si on peut dissuader quelqu’un d’effectuer un voyage en lui donnant des arguments convainquant, on ne pourra cependant le faire au moyen d’un performatif explicite à savoir: « Je te dissuade de voyager ».
De ces divers actes ainsi distingués, Austin mettra plus l’accent sur l’acte illocutionnaire car, il estime que c’est dans l’acte illocutoire que se perçoit le mieux le faire de la parole. Il conclut sa théorie par une classification des valeurs illocutoires à savoir: les verdictifs, les exercitifs, les promissifs, les comportatifs, les déclarations. Cette classification sera critiquée par plusieurs auteurs notamment Searle, le disciple d’Austin.
2. La philosophie des actes de langage de Searle
John Rogers Searle est le disciple d’Austin. Comme son maître il cherche à décrire les circonstances dans lesquelles se réalisent les actes de langage. Cependant, les moyens utilisés à cette fin divergent d’un auteur à l’autre et c’est ce qui confère à la théorie de chacun de ces auteurs sa particularité. Le terrain sur lequel Searle conduit sa pensée est celui des règles. L’étude du phénomène linguistique en tant qu’acte de langage ne peut se faire sans une prise en compte réelle de cette notion. Il reproche à Austin de n’avoir pas insisté sur cette notion dans sa théorie ce qui, à son avis, fait de la théorie de ce dernier une analyse incomplète voire imparfaite des actes de discours. Pour parfaire la théorie il y introduit des concepts nouveaux tels que ceux de « Principe d’exprimabilité » et de « Règles sémantiques ». Ceux-ci constituent les concepts clés de sa théorie.
2.1. Le principe d’exprimabilité
Le principe d’exprimabilité est un principe important dans la théorie de Searle car il lui permet de mener à son terme le projet d’Austin, celui de réformer les théories logicistes de la signification. Ce principe stipule que : « tout ce que l’on peut vouloir signifier peut être dit » (J.R. Searle, 1972, p. 55). Autrement dit, tout ce que l’on peut vouloir signifier peut, en principe, être exprimé littéralement. Tel que posé, le principe exprime deux idées majeures. « Tout ce que l’on peut vouloir signifier peut être dit » La première idée est celle selon laquelle dans l’exercice de la parole, le langage peut être rendu toujours explicite. La seconde concerne le fait qu’une synthèse entre les deux principales orientations en philosophie du langage est possible. Ces deux idées peuvent être perçues sans ambiguïté si l’on remarque que le principe d’exprimabilité fait ressortir les deux éléments caractéristiques de la communication que sont : les intentions et les signes linguistiques. Le fait de pouvoir dire tout ce que l’on veut dire signifie qu’une combinaison entre les intentions et les signes linguistiques est toujours possible. Il n’y a pas d’intention qui ne soit pas explicitement exprimable dans le langage. S’il est possible de vouloir dire une chose, alors il existe des expressions dans le langage qui exprime cette chose. Au cas où les expressions ne seraient pas adéquates pour l’intention que nous manifestons d’exprimer, il nous est toujours possible de transformer cette langue de sorte à pouvoir exprimer explicitement le contenu de notre pensée. Comme le précise J. R. Searle, (1972, p. 56) :
Toute langue dispose d’un ensemble fini de mots et de constructions au moyen desquels nous pouvons nous exprimer, mais si une langue donnée ou même toute langue quelle qu’elle soit, oppose à l’exprimable une limite supérieure, s’il y a des pensées qu’elle ne permet pas d’exprimer, c’est là un fait contingent et non une vérité nécessaire.
Toute pensée peut être exprimée explicitement et lorsque c’est le cas, l’auditeur comprend plus facilement l’acte illocutoire que tente d’accomplir son interlocuteur. Afin d’éviter les problèmes d’incompréhension, Searle recommande l’adoption de ce principe. Il permet entre autres de voir qu’une étude de la signification des phrases (sens et référence) n’est pas différente d’une étude des actes de langage (contexte des énoncés). Toutes deux se confondent. Searle, en plus de s’être opposé à la classification des actes illocutoires, s’était vivement opposé à la distinction locution-illocution faite par Austin car celle-ci, plutôt que de ramener à l’unité ces deux études les opposait. Il n’y a pas d’une part une étude qui se préoccuperait du dire des locuteurs et d’autre part une étude qui s’attacherait au faire des énoncés. Tout dire constitue un faire.
2.2. Notion de règles sémantiques
L’hypothèse de base sur laquelle repose les travaux de Searle est que « parler une langue, c’est adopter une forme de comportement régi par des règles ». (J. R. Searle, 1972, p. 52). En d’autres termes, c’est accomplir des actes selon des règles. Par cette hypothèse, Searle pose les règles comme ce qui constitue le fondement même des actes de langage, particulièrement des actes illocutionnaires. Cette hypothèse véhicule l’idée selon laquelle, c’est parce que des règles préexistent à l’usage du discours que telle ou telle expression vaut comme l’accomplissement d’un acte illocutionnaire. En clair, il aurait été impossible de parler d’acte de langage s’il n’existait pas de règles linguistiques. Comme le souligne Daniel Laurier, la caractéristique de la règle est qu’elle nous renvoie au domaine de l’action, ou du comportement intentionnel, et en particulier de l’action ou du comportement humain. Cependant, ce ne sont pas tous les comportements qui sont gouvernés par des règles. Certains comportements sont le fait de simples régularités. Les comportements qui relèvent de cet ordre sont des comportements qui tombent sous le coup de régularités, tandis que ceux dits réglés sont des types de comportements qui obéissent à des règles. Ceux-là, sont ceux que l’on adopte au cours de la communication. Le langage est gouverné par des règles. Parler revient à suivre des règles, mais pas n’importe lesquelles selon Searle. Les règles de l’usage du discours sont d’une nature spécifique à savoir constitutive. Les règles du discours sont constitutives en ceci qu’elles définissent les conditions même de l’usage du discours. Leur forme caractéristique est : « X revient à Y » ou « X revient à Y dans la situation S ». Les actes de langage, reposent sur un système de règles de type, constitutif. L’hypothèse de base des travaux de Searle devra donc être comprise en ce sens-ci : parler une langue c’est accomplir des actes de langage conformément à des systèmes de règles constitutives. Pour la vérification de son hypothèse, Searle donne une formulation de ces règles. Celles-ci visent à donner les conditions d’emploi d’un marqueur de force illocutoire. Pour ce fait, elles sont dites sémantiques. Les règles de l’utilisation du langage, en plus d’être constitutives, sont sémantiques. Dire comme le fait Searle qu’il existe des règles au fondement du langage n’est chose nouvelle. En effet, Wittgenstein en parlait déjà sous une forme assez particulière dans les Investigations philosophiques. Nous pourrions constater cela à travers son analyse des jeux de langage.
3. Les jeux de langage wittgensteiniens
Le jeu de langage est un concept clé de la philosophie des investigations philosophiques de Ludwig Wittgenstein. Il apparaissait pour la première fois dans le Cahier bleu (1934) mais c’est dans les investigations philosophiques que Wittgenstein en donne une véritable explication (non pas une définition). C’est un terme employé métaphoriquement (comparaison entre jeu et langage) pour souligner les multiples usages que nous faisons des mots et expressions du langage. Ces mots et expressions avec lesquels nous jouons lorsque nous parlons peuvent recouvrir plusieurs sens selon les circonstances dans lesquelles ils sont employés. Ainsi le mot jeu de Langage, lui-même, est employé dans plusieurs contextes pour désigner selon J. F Malherbe (1980, p. 22-23) :
1) Certaines formes primitives et simplifiées du langage. Lorsque par exemple les enfants apprennent à parler.
2) Le langage ordinaire de tous les jours avec l’ensemble des activités des opérations qui lui sont inséparablement liées.
3) Certains systèmes linguistiques particuliers qui font partie des activités dans lesquelles les mots prennent des sens particuliers.
Ces diverses circonstances dans lesquelles est employé le terme jeu de langage traduisent l’idée qu’il évoque : le jeu de la diversité. Il n’a pas un sens unique et il en va ainsi de tous les mots et expressions du langage. La signification d’un mot n’est pas figée, elle dépend de l’usage qu’on en fait. Comme peut le dire Wittgenstein la signification c’est l’usage. Il existe plusieurs manières de se servir du langage et toutes sont significatives. Les problèmes philosophiques proviennent d’analogies fortuites entre les usages d’une même expression linguistique dans différents jeux de langage. Ces problèmes pourront être résolus par une analyse adéquate de ces expressions, c’est-à-dire, en tenant compte de leur contexte d’émission.
Après la diversité des jeux de langage sur laquelle Wittgenstein attire l’attention, c’est leur caractère irréductible qui est mis en avant. Pour Wittgenstein, il existe une variété de jeux de langage (le jeu poétique, le jeu scientifique, le jeu économique, etc.) cependant, aucune caractéristique ne leur est commune à tous. Leur communauté provient d’une ressemblance de famille. Comme les membres d’une famille, les jeux de langage peuvent se ressembler mais ne sont jamais identiques. A travers la notion de jeu de langage, l’on peut voir dans le Wittgenstein des Investigations philosophiques un penseur qui se détache de l’auteur du Tractatus logico-philosophicus. Les idées avancées dans cet ouvrage, particulièrement celle selon laquelle « le sens de la proposition est son accord et son désaccord avec les possibilités de l’existence et de la non existence des états de choses » (L.Wittgenstein.1961, aph.4.2, p. 57) est limité. Le langage dans le Tractatus est réduit à la description alors que la description n’est qu’une des façons multiples de se servir du langage. « Commander », « affirmer », « poser une question », « donner un ordre », « critiquer », « accuser », « féliciter », « menacer », « défier », etc. sont également, dans le langage, des modes de signification. Tous ces modes de signification sont mis en exergue à travers la notion de jeu de langage. Par cette notion donc Wittgenstein parvient à l’extension de son analyse du langage.
Conclusion
Les analyses que font Austin, Searle mais aussi le second Wittgenstein, sont des études contextuelles de la signification des phrases. À travers les concepts qui sont mis en avant dans leurs différentes théories (acte de langage, usage, jeux de langage), ils montrent que le sens des phrases dépend des circonstances particulières dans lesquelles les phrases sont proférées. On ne peut saisir le sens réel d’une phrase si l’on ne s’accorde qu’à ne déterminer les conditions de vérités de celle-ci. À côté des conditions de vérités, il y a aussi à déterminer les conditions de satisfaction des phrases qui, elles, font entrer en scène les concepts de locuteur, de contexte, d’intention. Ces concepts sont les concepts phares de la pragmatique. Les concernant, il s’agit de savoir qui parle ? Et avec qui ? Quand et où les propos sont proférés ? Quel est l’intention de celui qui parle ? Et surtout, quelle est le contexte dans lequel s’inscrivent les propos du locuteur ? Ces questions, pour nos trois auteurs, jusque-là présentées, orientent mieux quant à la façon dont une phrase doit être comprise que celles qui se rapportent à sa vérité. Ainsi donc, chaque fois que nous voulons prendre la parole ou même déceler le sens des expressions d’un locuteur quelconque, il est important de se référer à la situation du discours dans laquelle nous nous situons.
Références Bibliographiques
AUSTIN John Langshaw, 1962, « Performatif-constatif », in La philosophie analytique, Paris, Les Éditions de Minuit, Collection « cahiers de Royaumont », pp. 271-304.
AUSTIN John Langshaw, 1970, Quand dire, c’est faire, Traduit de l’anglais par Gilles Lane, Paris, Éditions du Seuil, collection « L’ordre philosophique », 187 p.
FREGE Gottlob, 1971, Écrits logiques et philosophiques, traduit de l’allemand par Claude Imbert, Paris, Éditions du Seuil, Collection l’« ordre philosophique », 237 p.
FREGE Gottlob, 1969, Les fondements de l’arithmétique, Traduit de l’allemand par Claude Imbert, Paris, Éditions du Seuil, Collection «L’ordre philosophique», 235 p.
LAURIER Daniel, 1980, Introduction à la philosophie du langage, Paris, Mardaga, collection « Philosophie et Langage, 317 p.
SEARLE John Rogers, 1972, Les actes de langage essaie de philosophie du langage, traduit de l’anglais par Hélène Pauchard, Paris, Hermann, Collection « Savoir », 261 p.
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractaus logico-philosophicus suivi de Investigagtions philosophiques, traduit de l’anglais par Pierre Klossowski, Gallimard, 364 p.
FÉMINITÉ, UNE IDENTITÉ À REDÉFINIR
Djakaridja KONATÉ
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Longtemps niée et réprimée, l’identité féminine est restée une figure extra-déterminée et confinée à ses ovaires. Face à cette construction, il devient urgent de réfléchir sur la possibilité d’une redéfinition de l’identité féminine afin que sa spécificité trouve place dans un monde considéré comme longtemps mis en forme par les hommes. Mais cela passe par de nouvelles perceptions de leur image en référence à elles-mêmes, à s’approprier de leur identité en dépassant le clivage conflictuel du rapport des deux sexes, par l’affirmation de soi en tant que sujet, par une réappropriation de leur corps en préservant leur dignité et leur honneur, et surtout par la culture de l’excellence.
Mots clés : Affirmation de soi, Corps, Féminité, Identité, Sexe.
Abstract :
For a long time denied and repressed, female identity has remained an extra-determined figure confined to her ovaries. Faced with this construction, it is becoming urgent to reflect on the possibility of redefining female identity so that its specificity can find a place in a world long considered to have been shaped by men. However, this requires new perceptions of their image in reference to themselves, the appropriation of their identity by overcoming the conflictual cleavage in the relationship between the two genders, their self-assertation as subjects, a reappropriation of their bodies while preserving their dignity and honour, and above all a culture of excellence.
Keywords : Self-assertion, Body, Femininity, Identity, Gender.
Introduction
L’identité de la femme a été une construction sociale. Ce qui fait que la femme s’est toujours contentée de l’image et la perception que les hommes leurs ont assignés. C’est pourquoi, des grands penseurs n’ont pas toujours brillé par leur esprit critique lorsqu’ils se sont penchés sur la question de l’identité féminine. Aristote, figure mémorable de l’antiquité grecque, décrète dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, que la femme n’est qu’un vulgaire réceptacle à la substance féconde du mâle. Ce qui l’amène à écrire que les femmes sont des « citoyens incomplets. » (Aristote, 1982, p. 169). De quoi plomber la réflexion philosophique sur la femme.
Deux milles ans et quelques révolutions métaphysiques plus tard, Artur Schopenhauer, autre figure a priori éclairé, se montre tout aussi misogyne lorsqu’il écrit : « Les femmes sont le sexus sequitor, le sexe second à tous égards, fait pour se tenir à l’écart et au second plan. (…) il est ridicule de leur rendre hommage, et cela même nous dégrade à leurs yeux. » (A. Schopenhauer, 1851, p 25). À travers ce passage, l’identité féminine se trouve confinée à la servitude et à la dévalorisation. Ces propos traduisent une perception traditionnelle de la féminité qui considère que la femme est un sexe faible et secondaire. Elle est considérée comme venue après, à ce titre, elle doit obéir au cadre préétablit par les hommes.
À cette figure traditionnelle de l’identité féminine, succède un monde où la question du genre est au centre de tous les débats, dans toutes les sphères de la vie publique ou privée. Les femmes sont de plus en plus présentes sur l’espace publique et ont satisfaction notable à certaines de leurs revendications. Mais, ces victoires ou avancées rappellent seulement que bien de choses restent à faire dans la mesure où des pensées réduisent encore l’identité féminine à son corps c’est-à-dire à un désir sexuel à en croire à ces propos de C. Chartier (2009) : « la femme ne saurait aspirer à d’autres fonctions que celle d’assurer le bien-être de son époux. (…) À la femme le fardeau de la chair et du ménage, les passions bassement terrestre. » Or on aurait cru qu’avec le temps, des livres et des suffragettes, que les beaux esprits considèrent l’identité féminine sous un autre angle que celui de ses ovaires en se penchant sur ses relations avec son alter égo masculin.
Aujourd’hui, la promotion du genre fait partie désormais des principes de bonnes gouvernances dans les sociétés. Cette nouvelle norme sociétale ne nous amène-t-elle pas à juger par nous-mêmes des limites de la perception traditionnelle de l’identité féminine ? Cette question centrale fait appel à d’autres questions subsidiaires : la divergence de vue entre les figures traditionnelles de l’identité féminine et les exigences des sociétés contemporaines marquées par la promotion du genre, ne nous amènent-elles pas à une redéfinition de l’identité féminine ? En d’autres termes, comment redéfinir l’identité féminine pour que la perception de la femme ne soit plus liée à ses ovaires ou la domesticité ? Que valent aujourd’hui, ces perceptions traditionnelles de l’identité féminine à une époque où la promotion de genre est une exigence ?
Notre objectif est de montrer les limites de ces thèses traditionalistes de la perception de la féminité dans un monde dominé par la promotion du genre. Pour atteindre cet objectif, nous utiliserons deux méthodes : la méthode herméneutique et la méthode critique. En effet, la première méthode permettra de mettre en lumière les perceptions traditionnelles de l’identité féminine. Quant à la seconde méthode, elle se consacrera non seulement à l’évaluation des insuffisances de ces thèses traditionalistes de l’identité féminine, mais aussi, elle tentera de rendre plausible les conditions d’une redéfinition de l’identité féminine c’est-à-dire, montrer que l’identité féminine ne se confine pas qu’à son sexe et à l’intérieur.
1. Une identité longtemps réprimée
La féminité est l’ensemble des traits caractéristiques propre à la femme. C’est l’ensemble de ce qui fonde son identité. Mais ce qui fonde l’identité de la femme traduit en même temps la complexité et l’ambivalence des attitudes à son égard. L’infériorité naturelle des femmes, la faiblesse de leur sexe, leur assujettissement devant la loi, est sans doute les conséquences d’une perception erronée et stéréotypée que l’on a projetée et continue de projeter sur leur identité. En effet, la perception erronée vient à partir du moment où l’homme a considéré la femme comme l’autre, c’est-à-dire, le fait de lui nier toute forme de subjectivité. À ce titre, « elles n’avaient donc aucune raison de dire je » (A. Touraine, 2006, p. 133). Dans la perspective cartésienne, le « je » désigne l’affirmation première du moi, de ce qui traduit notre existence. C’est la première vérité chez Descartes qui résiste à toute forme de doute. C’est pourquoi, il doute de tout sauf du « je ». Descartes ramène tout à la subjectivité en tant que vérité première. Dans cette optique, si le « je » viens à être nié, l’homme perd son identité et il est réduit au rang de l’animalité. Les femmes sont dans cette dynamique de l’affirmation de soi qui lui a été niée depuis bien longtemps. Elles n’avaient pas le droit de dire « je » au même titre que l’homme. Le point de départ des attitudes sexistes, misogynes voire tout le champ lexical de l’assujettissement des femmes provient pour notre part, de la négation du « je » chez les femmes. Cette négation a amené les hommes à considérer la femme comme l’autre en qui ils ne confèrent aucune dimension humaine.
Dans la perspective beauvarienne, ce qui a rendu opaque l’image de la femme et qui traduit son assujettissement, c’est qu’elle est considérée par l’homme comme l’autre. Elle écrit : « la femme est une réalité éminemment poétique puisqu’en elle l’homme projette tout ce qu’il ne décide pas d’être » (S. De Beauvoir, t. 2, 1949, p. 1297). La formule beauvarienne nous plonge dans un contexte historique où l’homme projette en la femme tout ce qui n’est pas humain. C’est pourquoi elle est identifiée par le terme « femelle » qui semble à lui seul suffisant à la définir. Or, « dans la bouche de l’homme, l’épithète « femelle » sonne comme une insulte (…). Le terme « femelle » est péjoratif non parce qu’il enracine la femme dans la nature, mais parce qu’il la confine dans son sexe » (S. De Beauvoir, 1949, p. 37). La femme est ramenée ici à son physique. Les variations que suscite cette perception de l’identité féminine contribuent à croire que la femme est un objet sexuel. Aujourd’hui encore cette perception existe dans la mesure où, il est presque impossible de parler de la femme sans que l’on ne pense à la sexualité parce que le regard sur la femme est d’abord le regard sur son sexe. Il arrive même de penser que son sexe précède ou prime sur son intellect. On continue de croire que tout ce que la femme obtient en termes de promotion, succès, emploi, elle le doit à son corps, à son sexe. C’est ce qu’A. De Villaines (2019, p. 59) explique :
Quand elle est élue présidente des « Jeune Pop[2] » en 2011, Marine Brenier entend à de nombreuses reprises : « C’est parce que tu es une femme que tu as été élue. » Même processus dans les rédactions, à la même époque. Je rapporte une information au rédacteur en chef. Regard infantilisant, et cette remarque : « Tu as dû faire un sourire, toi, pour obtenir cette info. » Épuisant. Dans une banque d’affaires parisienne, Laure, 47 ans, obtient l’un des plus gros contrats de l’entreprise. Réponse de son supérieur hiérarchique : « Ah, ils ne peuvent pas résister à tes yeux doux. » La professionnelle est ramenée à son physique, pas à ses compétences. Iris Brey est réalisatrice et journaliste. Elle a été chroniqueuse télé, et a trop entendu : « Elle a eu son job grâce à son physique », pour finalement décider de passer derrière la caméra, en tant que réalisatrice.
En ce XXIe siècle où l’on assiste à l’évolution des sociétés au plan technologique et où les politiques se sont dotés des moyens de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme, la question sur l’identité féminine se présente presque partout comme une équation sans solution. La banalisation de leur corps, sexe, dignité et leur identité, progresse en même temps que les situations d’intolérance à l’endroit des femmes. Du réceptacle chez Aristote à la domesticité chez Schopenhauer, l’identité féminine n’est pas totalement reluisante partout. La femme est perçue encore comme un objet sexuel ou un être créé pour satisfaire l’appétit sexuel de l’homme. M. Foucault (2006, p. 40) relève cette triste réalité en ces termes : « la femme est bonne, sucrée, à croquer, ou elle est une courge, un légume etc. (…) La femme n’est plus seulement canon ou sexy, mais encore bonne, mettable, baisable, prenable, sautable, bref jetable après usage. Pétasse ou Salope ».
On comprend pourquoi chez la plupart des philosophes de l’antiquité à la période contemporaine, il a été imposé la loi du tout masculin. D’Aristote à Rousseau en passant par Spinoza, l’identité de la femme sera définie par ses pénates, par ses ovaires et par l’imperfection. En effet, Aristote part du principe de la procréation pour affirmer l’imperfection de la femme. La perception de l’identité de la femme chez lui découle justement de ce principe. Pour lui l’homme produit le sperme tandis que la femme est un réceptacle et ne produit que l’embryon. Il pense que des deux c’est-à-dire le sperme et l’embryon, l’homme est actif parce qu’il est celui qui apporte le mouvement et la femme est passive parce qu’elle apporte la matière. Ce qui fait d’elle un être incomplet. Ainsi dit-il : « la femme est comme un mâle mutilé, et les règles sont une semence, mais qui n’est pure : une seule chose lui manque, le principe de l’âme » (Aristote, 1961, p. 62). À travers ce passage, Aristote montre l’imperfection de la femme et son handicap par essence. La perception de l’identité de la femme chez Aristote découle de ce handicap parce que c’est à partir de ce constat qu’il dira qu’elles sont « des citoyens incomplets » (Aristote, 1982, p. 169). Cette idée d’Aristote a fortement influencé la civilisation romaine si bien que les Romains avaient nié l’identité féminine en se basant simplement sur la « faiblesse de son sexe » (A. Wenger, 2005, p. 145) ou encore par « la stupidité de son sexe » (A. Wenger, 2005, p. 89). C’est dire que cette mauvaise perception de l’identité de la femme a émergé dans la période antique et a fortement marqué négativement les esprits. C’est qu’explique Sarah Pomeroy en ces termes :
La femme athénienne de la classe des citoyens était transférée dans la maison de celui-ci où elle devait remplir sa fonction : porter et élever des enfants (…). La fonction des épouses étant cependant le soin de la lignée familiale et la tenue du foyer. La femme ne participait pas socialement aux réunions de son mari et de ses amis qui étaient des réunions d’hommes et, même si cela se passait dans sa propre maison, elle n’y était pas admise (1975, p 41-49).
Ce passage confine l’identité de la femme à la domesticité et à la procréation. Cette conception aristotélicienne de la femme a aussi servi de boussole à Spinoza. Il part de l’attirance de la femme, la sensation que sa « belle forme » (B. Spinoza ? 2010, p. 558) créée chez l’homme pour lui nier une identité propre au même titre que l’homme. Ainsi, la perception de l’identité de la femme qui se dégage chez Spinoza est que la femme est un objet de désir sexuel, un être dont la fonction sociale se résume à la reproduction. À cette fonction voluptueuse qu’il assigne à la femme, il affirme son infériorité naturelle : « Il est permis d’affirmer, sans hésitation, que les femmes ne jouissent pas naturellement d’un droit égal à celui des hommes, mais qu’elles leur sont naturellement inférieures » (B. Spinoza, 2010, p. 1044).
Les femmes ont été jusque-là des êtres n’ayant pas de subjectivité si bien qu’il leurs étaient impossible de s’affirmer en tant que des personnes entières. Il fallait donc tout décider en leur nom, ce qui faisait d’elles, des êtres intermédiaires. C’est dire que la femme devient plus un moyen qu’une fin. C’est ce que disaient :
Un certain nombre de philosophes aux alentours de 1800. Pour Fitchet par exemple, la femme n’est que moyen par rapport à la propre fin de l’homme ; elle se met à son service par la procréation, la famille, l’amour, pour que celui-ci puisse se réaliser (G. Fraisse, 2012, p. 126).
Il serait donc arbitraire de parler d’une présence féminine sur l’espace publique en ce XXIe siècle sans avoir observé et analysé ce masque sur la tête des femmes. En effet, ce masque camoufle en réalité, le rabaissement des femmes, à être des esclaves dont la conscience et les conduites ne sont que les effets de la domination et la perception des hommes sur leur identité. Dans ce monde contemporain, la perception sur leur identité n’a pas totalement changé, c’est ce qui nous amène à écrire cet article. Elles continuent d’être ramenées à leur identité traditionnelle. C’est ce qu’affirme A. De Villaines (2019, p. 60) : « Réduire la femme à un objet sexuel. La pratique est malheureusement trop courante et intégrée dans les systèmes de pensée de certains hommes, peu importe leur milieu social ou professionnel. » Cela est d’autant plus vrai qu’à l’image de la femme « bonne » et « prenable » est greffée la double figure de femme épouse-mère.
2. Une double figure d’identité : épouse-mère
La perception de la femme en tant qu’objet érotique destinée à la seule satisfaction du désir sexuel de l’homme a fait naître une double figure de l’identité féminine : épouse-mère. Parallèlement aux nombreuses formes de répressions de son identité, les rares valorisations dont jouissaient encore les femmes étaient liées à la maternité. En effet, la maternité était un statut particulier, un idéal auquel toutes les jeunes filles devraient nécessairement atteindre. Elle était brandie comme un miroir devant les jeunes filles, dans lequel elles étaient condamnées à retrouver leur image idéale. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les femmes ont été réduites à leur aspect physique, à l’aspect reproductif, à un objet érotique et surtout à la maternité.
Ainsi, l’identité féminine se confine à la maternité. C’est ce qui justifie sans doute le fait qu’elles devraient rester au foyer auprès de leur mère afin qu’elle les éduque à atteindre cet idéal. C’est pourquoi la femme, bien que sa domesticité soit irréprochable, si elle ne parvient pas à enfanter, sa féminité n’est pas complète. N. Stryckman (2001, p. 37) relève le caractère intrinsèque de la maternité en ces termes :
Il est nécessaire que la mère investisse le sexe de sa fille comme promesse de désir, de jouissance, d’amour et de maternité (…). La fille, après avoir attendu sa mère (absence – présence), attend que son corps devienne un corps de femme, que ses seins poussent, que ses règles arrivent, qu’un homme la pénètre et la dise femme au féminin.
Pour des théoriciennes comme Stryckman et bien d’autres, la maternité est intimement liée à la nature biologique et physiologique de la femme. On peut comprendre dans leur pensée que les femmes sont des mères prédéterminées par essence et c’est ainsi qu’elles retrouvent leur image idéale.
Cependant, pour des théoriciennes telles que Simone De Beauvoir, Elisabeth Badinter, Edith Vallée et bien d’autres, la maternité est une pure construction sociale. Pour Elisabeth Badinter, être femme ne veut pas dire devenir mère. Ainsi, elle a mis en place ce qu’on appelle la révolution silencieuse qui consiste « ni plus ni moins à remettre la maternité au cœur du destin féminin » (E. Badinter, 2010, p. 10). Cette révolution opérée par Badinter vise à mettre «fin aux anciennes notions de destin et de nécessité naturelle» (E. Badinter, 2010, p. 10). A travers ce passage, Badinter s’insurge contre l’idée selon laquelle la maternité est l’expression naturelle, l’aboutissement même de féminité. Le refus de procréer est considéré comme une incompréhension anomalie. Dans la même perspective, Edith Vallée s’insurge contre ces fausses évidences qui assimilent l’identité féminine à la maternité. Selon elle, les femmes «avaient toute envie de parler de leur refus de maternité. Le mot de passe déclenchait l’adhésion immédiate « pour que quelque part, il soit dit qu’il est possible d’être femme sans être mère. » » (E. Vallée, 1977, p. 15.)
Pour ces dernières, le fait d’être mère, n’est pas liée à la nature réelle de la femme. Pour elles, c’est la société qui a établi une norme selon laquelle la femme n’est considérée que dans son rôle de mère. Leur conception se résume à l’idée que l’instinct maternel si souvent loué n’est pas le propre de la femme, mais c’est la société qui a développé cette image et l’a attribué aux femmes. On voit naître alors deux écoles de pensées, l’une défini l’identité féminine par la maternité et l’autre rejette la conception naturelle de la maternité de la femme. À travers ces deux écoles de pensées, nous voulons faire ressortir la prégnance du double statut de la femme dans l’histoire de l’humanité.
Ce culte de la femme en tant que mère a aussi marqué les écrits romanesques du XIXe siècle et même ce XXIe siècle. Dans les textes d’Amadou Hampâté Bâ par exemple, il y a une sorte de sanctification de la mère. Dans les sociétés traditionnelles africaines en particulier, la mère est une déesse sur terre. Le succès de tout enfant se trouve sous ses pieds. Chaque enfant devra le chercher en baissant pour elle, l’aile de la miséricorde, avec respect et humilité. Hampâté Bâ, connu à travers ses écris en tant qu’un conservateur traditionnaliste, révèle ce fait en ces termes : « lorsque la femme devient mère, deux portes supplémentaires s’ouvrent sur sa poitrine, portes par lesquelles s’écoule la force de vie (…). Selon la tradition, la mère est en effet considérée comme un laboratoire divin visité par Dieu lui-même ». (A. Hampâté Bâ, 2009, p. 144). Dans la perspective hampâtéenne, la question de l’identité de la jeune fille dans les sociétés traditionnelles est simple : il s’agit de savoir comment elle va passer de l’étape de vierge séduisante à l’étape de mère. C’est seulement en tant que mère que la femme avait un statut peu reluisant dans les sociétés corsetées par les tabous, les us et coutumes. Il s’agit là du féminisme différentialiste tel que «Antoinette Fouque, qui insiste sur la maternité comme forme symbolique de l’identité féminine.» (E. Sizoo, 2003, p 33.) En somme, pour ce courant féminisme, l’identité féminine se confine à la maternité.
Cependant, la maternité est considérée par les féministes matérialistes ou encore « féminisme universaliste, dans le sillage de Beauvoir, qui fait de l’identité sexuée un effet des rapports sociaux» (E. Sizoo, 2003, p 33). Ainsi, la maternité est le lieu et le levier de la domination masculine et comme une dévalorisation et servitude de la femme parce que ces féministes considèrent que la maternité se fait par la médiation de l’homme. De la fille à la mère, il y a nécessairement l’homme, une extériorité réelle à laquelle elle livre son corps. La femme « se donne », ce qui fait de la féminité, une figure de don. La jeune fille est dite fille lorsqu’elle porte un sexe féminin, mais cela ne suffit pas. Elle doit parvenir à la phase de symbolisation avec ce sexe, à se reconnaître, à s’identifier comme femme, à atteindre la maternité par la médiation sexuelle de l’homme.
En somme, dans les figures traditionnelles, la construction de la jeune fille se fait nécessairement par la médiation de l’homme. Ce qui réduit l’identité féminine à un double statut : objet érotique et mère.
Tout le regard stéréotypé sur l’identité féminine découle justement de ce double statut parce qu’il enferme la femme dans la subordination. Notre analyse ne vise pas à condamner la maternité en soi, mais c’est le fait de percevoir la femme qu’en tant que mère, c’est-à-dire croire que son identité se confine qu’à faire des enfants, qu’il convient de dénoncer. Pour notre part, nous estimons que tout cela relève des idéologies pernicieuses et des images caricaturales de l’identité féminine. Depuis peu, de nombreuses filles refusent d’épouser les figures de femme-épouse, femme-objet érotique, femme-domestique, femme-mère… La maternité elle-même est devenue un choix dans plusieurs pays avec l’adoption du droit à l’avortement qui de plus en plus devient une exigence en tant qu’un droit fondamental pour l’épanouissement des femmes. Parce que la féminité n’est réductible à rien, la femme a (ou doit avoir), en toute liberté, le choix d’opter pour la maternité ou pas. Les femmes s’émancipent de plus en plus des lourdeurs de ces idées dominantes calquées et perpétuées sur fond d’une phallocratie aussi absurde qu’étrange.
3. De l’identité naturelle à l’identité civile
Selon L. Irigaray (1999, p. 148) : « Pour accéder au statut de personne civile, la femme doit passer de l’identité naturelle, surtout d’une identité naturelle imposée, à l’identité civile. » La perception naturelle de l’identité de la femme se situe dans le cadre du double statut (épouse-mère) imposé à la femme que nous venons de mentionner plus haut. Selon la conception naturelle des choses, le cadre d’exercice et d’épanouissement de la femme serait le foyer. À ce titre, les femmes se sont vues exclues de toutes démarches visant à exprimer leur citoyenneté notamment le droit au vote, la présence sur la scène politique, le monde professionnel voire toutes les sphères publiques, etc. Les arguments qui se dressent contre les femmes tiennent pour l’essentiel dans cette liste non exhaustive dressée par E. Benbassa (2018, p. 10) : « elles (les femmes) sont trop émotives pour faire de la politique, pas assez intelligentes, séductrices (elles troubleraient ces messieurs), de mauvaises mères qu’il faut renvoyer aux foyers qu’elles ont abandonnés, etc. »
Les femmes ont été dépossédées de tout ce qui exprime ou atteste leur citoyenneté. Il faut croire qu’il ne suffit pas de vivre dans une société pour être une citoyenne. De 1848 avec l’empire et le code napoléonien, la situation des femmes était tellement dramatique qu’il devenait urgent pour elles de revendiquer leur droit civil. Le retour à la république a vu naître une lueur d’espoir mais qui très vite a été transformé en déception. Le suffrage reste unisexuel et l’argument contre elles devenaient encore plus délirant. Pour les habitués du domaine politique, il n’était pas rare d’entendre que les femmes sont trop cléricales, trop émotives pour faire de la politique et « si l’on donne le droit de vote aux femmes, bientôt les bœufs voudront votez » écrit le Figaro en 1890. « Les mains des femmes sont faites pour être baisées, pas pour mettre un bulletin dans l’urne »,commente un sénateur à la veille de la guerre. » (E. Benbassa, 2018, p. 11).
On comprend dès lors que la première forme de violence qui a été faite aux femmes est de les avoir exclues de ce droit fondamental pendant plus de cent cinquante ans. Aujourd’hui, ce droit est indéniable à la femme partout avec Arabie Saoudite comme dernier pays à leur avoir accordé ce droit. Elles affirment leur citoyenneté presque partout dans le monde. Même si la parité homme/femme est loin d’être atteint et les injustices salariales demeurent, on assiste à une montée en puissance des femmes dans les hautes sphères de décision : femmes parlementaires, femmes ministres, femmes cheffes d’institutions (nationales ou internationales), femmes présidentes de la république, etc.
Pourtant, les considérations dégradantes de la femme persistent. Sur la scène politique, la femme est constamment ramenée à son identité naturelle. Pour Rodham Clinton, il ne fait aucun doute : le sexisme est encore très largement répandu prenant parfois des figures et des formes très subtiles.
Le sexisme exerce encore son attraction sur notre société et notre vie politique jour après jour, d’une façon à la fois subtile et flagrante. (…) L’instant où une femme s’avance pour prononcer les mots « Je suis candidate », déclenche une avalanche d’analyses ; celles de son visage, de son corps, de sa voix, de son comportement, mais aussi la minimisation de sa stature, de ses idées, de ses accomplissements, de son intégrité. Tout cela peut être incroyablement cruel. (H. Rodham Clinton, 2017, pp. 133-134).
Eu égard à ce tableau très peu reluisant, on pourrait dire que l’identité civile de la femme est loin d’être un acquis. S’il faut se réjouir de la présence des femmes dans les parlements et autres sphères de décision, il faut cependant regretter des comportements sexistes à leur endroit. À en croire à ces propos de Benbassa (2018, p. 6) : « Notre quotidien, au Parlement, c’est cela : être interrompues de manière intempestive, subir en bruit de fond les bavardages et parfois les moqueries, ne pas être écoutées. Notre parole est régulièrement bafouée. »
Sortir des considérations fatalistes pour asseoir l’affirmation complète de la citoyenneté féminine, est sans doute la plus radicale et indispensable révolution en ce XXIe siècle. Cela passe nécessairement par une prise de conscience de soi en tant que femme, en ayant une image positive d’elles-mêmes.
La prise de conscience de soi est le premier pas vers l’affirmation de son identité. Elle consiste pour les femmes de s’affranchir des barrières socio-culturelles pour s’approprier de leur identité originelle en tant que femme. La prise de conscience de soi consiste pour les femmes de sortir de toutes formes de considérations qui font d’elles un être ‘‘autre’’ que l’humain. Il ne s’agit pas pour elles de se re-définir par rapport à l’homme, de le prendre toujours comme un repère ou encore de le considérer comme l’ennemi, mais il s’agit pour elles d’affirmer leur identité, en tant que personne à part en entière et maillon essentiel du développement de la société.
La prise de conscience ne sera pas une sinécure dans la mesure où la perception traditionnelle de l’identité est fortement imprimée dans les esprits. L’identité de la femme est restée niée si longtemps que la prise de conscience de soi, de sa propre nature, d’une orientation positive de leur féminité, ne se réalisera pas du jour au lendemain.
Pour nous, la redéfinition est à deux niveaux, le recours au corps par la prise de conscience de soi et le second passe par le rétablissement de la contribution des femmes dans la construction de l’histoire de l’humanité. Le point de départ est la prise de conscience de soi par le recours au corps, car comme le dit J. Lachance (2012, p. 12) « Le corps est un support de l’identité ». En effet, le corps est le principe suprême sur lequel repose la dignité humaine. C’est pourquoi les moralistes considèrent le corps comme étant un objet sacré et moral en dénonçant les abus et les dérives à son endroit. Le corps est aussi la matière première par laquelle l’on affirme son identité. C’est ce qui appartient à chacun et dont il est le seul à détenir les codes. Le corps obéit à un système de codage qui détermine à la fois son identité et sa dignité. Raison pour laquelle, lorsque le corps échappe au contrôle de cette restriction pour être soumis à la dégradation et aux traitements ignominieux, la dignité humaine n’est plus et par conséquent, il n’y a plus d’identité car l’humain n’est autre chose que son corps. Pout D. Le Breton, le corps est le trait caractéristique par lequel l’individu se défini et se reconnait en tant que tel. Ainsi qu’il le dit :
Matière d’identité au plan individuel et collectif, le corps est l’espace individuel qui se donne à voir et à lire à l’appréciation des autres. C’est par lui que l’individu est sauvé, reconnu, identifié à une appartenance sociale, culturelle, « ethnique », à un sexe, à un âge, à une couleur de peau, à une qualité de présence. (D. Le Breton, 2014, p. 21)
Nous disons que la prise de conscience des femmes passe par le recours à leur propre corps parce qu’il relève du domaine intime et traduit le mieux leur identité. À cet effet, notre démarche s’inscrit aussi dans la perspective de A. Melucci (1989, p. 189) pour qui : « le retour au corps a provoqué une nouvelle recherche de l’identité. Le corps est perçu comme un domaine réservé, dont seul le propriétaire possède la clé, et où celui-ci peut trouver une définition de lui-même libre des normes et des attentes de la société. » Ce qui attire le plus notre attention dans la perspective de Melucci, c’est que le corps est le lieu où sont perceptibles toutes les marques des pressions (sociales, religieuses, culturelles et collectives de toutes sorte), c’est pourtant dans le corps que se niche la définition « réelle » et l’identité propre de chacun. Tout se passe comme si à travers le recours au corps, l’affirmation « je suis une femme » retrouve toute sa légitimité, tout son sens. Comme nous l’avions dit plus haut, il fut un temps, cette affirmation était indéniablement niée aux femmes. Elles n’avaient pas le droit de dire « je ». La plus radicale révolution consiste à récupérer ce « je » perdu depuis des siècles. Avec ce « je » suivi du prédicat « femme », elles retrouvent leur identité originelle.
Jadis caché, enchaîné et soumis à des superstitions, des croyances religieuses, l’on assiste aujourd’hui à une libération des corps de plus en plus exposés au regard du monde pour refléter la personnalité ou l’identité de chacun, mais plus, de chacune. Jamais le corps n’a été aussi soigné, médicalisé, et bien traité avec le développement de la chirurgie esthétique et autre. Cette libération du corps de la femme traduit aussi l’affirmation de son identité.
Nous ne perdons pas de vu les dérives que cette surexposition des corps engendre comme l’indiquent Bertrand Gervais et Mariève Desjardins (2009, p. 9) en ces termes : « le XXe siècle a mis le corps en scène. Il l’a porté à l’écran, il l’a peu à peu dénudé, (…). Il l’a violenté et marqué, il a abusé de ses atours et il a fait de ses transformations, les unes souhaitées, les autres redoutées, un spectacle de tous les instants. » Le recours au corps est le point de départ pour les femmes de sortir de l’aliénation à leur identité longtemps structurée. À ce titre, M. P-A. Miquel (2007, p. 10) abonde dans le même sens : « ce n’est que par et à travers mon corps que je puis être moi-même, à travers ce que fait mon corps ». Pour A. Touraine (2006, p. 31), « se définir comme femme revient à placer au centre de sa vie un certain rapport de soi à soi, la construction d’une image de soi comme femme. » Cela voudrait dire que l’affirmation de soi ne doit pas être perçue comme une simple adhésion dans un groupe ou un parti politique, mais elle se présente comme une évidence, une conviction qu’il convient de clarifier parce que « être femme n’est pas la pure constatation d’un état de fait, mais l’affirmation d’une volonté d’être » (A. Touraine, 2006, p. 31). C’est cette volonté d’être femme qui leur permettra de briser tous les préjugés et stéréotypes qui collent sur leur identité. Les femmes doivent pouvoir prendre le contrôle de leur identité, c’est ainsi qu’elles sortiront de l’image opaque dans laquelle elles ont été reléguées malgré elles. Le plus grand défi réside dans le fait de sortir de ce complexe pour un retour sur soi. C’est ce qu’affirme A. Touraine (2006, p. 225) en ces termes :
Je suis une femme » signifie que je suis moi-même en tant que je suis une femme, en tant que c’est autour de mon identité de femme que se construisent mes conduites et les jugements de valeur que je porte sur elles : positifs quand ils renforcent ma conscience d’être en premier lieu une femme, négatifs quand ils occultent mon affirmation de moi-même comme femme.
À travers ces mots de Touraine, nous pensons que les femmes doivent se construire une image d’elles-mêmes, à s’approprier de leur identité, en dépassant le clivage conflictuel du rapport des deux sexes. Parvenu à ce niveau, nous nous inscrivons dans la perspective de Touraine pour dire que la redéfinition de l’identité féminine part de la prise de conscience de soi. Avec cette dernière, elles ont réussi à dépasser ces vieux schèmes des débats sur le dualisme des deux sexes, pour s’inscrire dans un nouveau paradigme.
Aujourd’hui, les femmes ont plus de capacité que les hommes pour se comporter en sujets. À la fois parce qu’elles portent l’idéal historique qu’est la recomposition du monde et le dépassement des dualismes anciens et parce qu’elles prennent plus directement en charge leur corps, leur rôle de créatrices de vie, leur sexualité. (…) Maintenant, depuis plusieurs décennies déjà et pour une durée indéterminée, peut-être sans fin prévisible, nous sommes dans une société et nous vivons des vies individuelles dont le « sens » est davantage dans les mains, la tête et dans le sexe des femmes que dans les mains, la tête et le sexe des hommes. (A. Touraine, 2006, p. 224).
Le second niveau est de mettre en évidence le triomphe des femmes dans la construction de l’histoire de l’humanité. La contribution des femmes a très souvent été occultée et ce qui est mis en avant, c’est leur malignité. Le rétablissement du parcours de ces héroïnes permettra de donner une perception positive de la féminité. Selon les travaux de l’archéologue Yves Coppens, Lucy, cette jeune femme de type négroïde « demeure l’africaine la plus ancienne et la mère de toute l’humanité » (A. Ly-Tall, 2017, p. 26). Alors que les femmes sont exclues de la liste des personnages principaux. Si la femme en général apparaît comme une figure secondaire, alors imaginons le sort réservé à la femme africaine, la femme noire, dans le récit universel de l’humanité. Selon les mots de A. Thiam (1978, p. 155) « elle est l’objet de la satisfaction sexuelle du mâle et fait partir de son apparat d’aisance. En un mot, elle est potiche et boniche. » L’histoire a été présentée de sorte à faire croire que l’identité féminine se confine à ses ovaires et à la domesticité. La femme africaine à l’instar de ses consœurs dans les autres cultures, a été dépossédée de son identité. Les travaux de Cheikh Anta Diop a « extirpé l’histoire et la culture africaine des profondeurs obscurs dans lesquelles l’idéologie esclavagiste les avait enfuies » (A. Ly-Tall, 2017, p. 11). En effet, ces travaux ont non seulement permis de retracer l’antériorité de la figure féminine, mais aussi et surtout de rétablir leur identité réelle. Pour Cheikh Anta Diop « l’homme a conçu en accord avec la femme pour la plus grande puissance du clan. » (Ch. A. Diop, 1967, p. 72). C’est dire que les femmes ont pris une part active dans la construction sociale, au même titre que les hommes. Elles ont occupé une place honorable si bien que « les premiers pharaons auraient même été des femmes (…) comme le témoigne la vie de la reine-déesse Hatshepsut, 1500 ans avant Jésus-Christ » (A. Ly-Tall, 2017, p. 11).
Le parcours de ces héroïnes remet en cause la perception traditionnelle de l’identité féminine, une perception fataliste et caricaturale, qui peut se résumer en ces termes : « une idéologie qui prétend limiter les femmes à des contraintes biologiques revient à en faire une espèce intermédiaire entre l’humain et l’animal : la femme ne serait qu’instinct, nature, tandis que l’homme serait civilisation, culture. » (G. Moreau, 1982, p. 171). Dans cette ère, où la question du genre fait partie désormais des principes de la bonne gouvernance dans les sociétés démocratiques, où les peuples aspirent à la dignité et à l’égalité, il est indéniable de marquer une rupture avec de telle idéologie et de redéfinir ou encore réhabilité la perception de l’identité féminine car comme l’indique G. Moreau (1982, p. 171) :
Le degré de civilisation dans une société se mesure à l’aune du degré de l’émancipation des femmes qu’elle tolère. La place des femmes témoigne de la manière dont une société a su vaincre son sous-développement matériel et culturel, pour atteindre son humanité profonde.
Dans la perspective de Moreau, nous disons que demeurer dans une telle idéologie traduit une attitude délirante et témoigne du degré très élevé de l’arriération de nos sociétés car l’humanité inclut les femmes en tant que la moitié de l’humanité, mais mieux, l’humanité se construit avec elles.
Conclusion
En posant comme point de départ la perspective de Simone De Beauvoir qui reprend Freud dans le Deuxième Sexe, pour nous rappeler que les femmes ont été définies par les hommes comme objets et elles ont adopté le point de vue masculin parce que leur valeur réside dans la capacité de refléter l’homme, notre analyse nous a permis d’appréhender les perceptions sur l’identité féminine comme étant les conséquences des stéréotypes liés à leur nature dans presque tous les domaines de la vie publique. Dans le miroir rétrospectif de l’identité féminine, les femmes se définissaient toujours par rapport à l’homme posé comme « Le » référentiel. Si le narcissisme est par principe une admiration de soi, une attention exclusive porté à soi-même, on peut dire que la féminité était aux antipodes de celui-ci parce qu’elle était toujours en référence par rapport à la masculinité. Les femmes n’avaient pas de subjectivité, elles cherchaient toujours à travers les hommes, à se construire une identité, à s’aimer et à donner sens à leur existence. Ce qui faisait de l’identité féminine une figure « extra-déterminée» (P. Weil, 1994, p. 60). Mais l’émergence de la promotion de la féminité dans ce monde contemporain montre les limites de ces conceptions traditionnelles de la féminité. Notre analyse sur ce sujet nous amène à nous inscrire dans la démarche des penseurs comme Michel Foucault en passant par Simone De Beauvoir, pour dire que les figures traditionnelles attribuées à la féminité ne relèvent pas d’un ordre naturel c’est-à-dire lié à leur nature biologique, mais c’est une construction caricaturale de la société. Selon ces philosophes du genre notamment Beauvoir, Michel Foucault et les travaux de Cheikh Anta Diop, l’homme et la femme sont de nature biologique différente, mais cette différence biologique ne doit reléguer la femme au second plan ou à confiner son être à son sexe. Il s’agit pour nous de dissoudre cette conception fataliste de l’identité féminine pour l’équilibre de la société car le monde dans lequel nous vivons reste fortement marqué par l’initiative féminine. Le constat est qu’aujourd’hui, le genre féminin influe plus sur la marche du développement de nos sociétés à en croire cette pensée de A. Touraine (2006, p. 106) : « le monde des hommes s’efface aujourd’hui de plus en plus vite et un autre prend sa place : une société de femmes où les hommes agissent de plus en plus en conformité avec le modèle féminin. »
Références bibliographiques
ARISTOTE, 1982, La politique, traduction française de Jean Tricot, Paris, Vrin.
BENBASSA Esther, 2018, Violences sexistes et sexuelles en politique, Paris, Cnrs.
BUTLER Judith, 1990, Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de l’identité, traduction française de Cynthia Kraus, Paris, La Découverte.
CHARTIER Claire, 2009, « Les philosophes et la guerre des sexes », L’Express, (En ligne) in http://www.lexpress.fr consulté le 18/07/2020.
DE BEAUVOIR Simone, 1949, Deuxième sexe II, Paris, Gallimard.
DE VILLAINES Astrid, 2019, Harcelées, Paris, Plon.
DIOP Cheikh Anta Diop, 1967, Antériorité des Civilisations nègres, mythes ou réalités ?, Paris, Présence Africaine, (par Nouvelle Ecole d’Egyptologie Française [Poesner, Sauneron, Leclant, Yoyette dans « Dictionnaire de la civilisation égyptienne »]).
FRAISSE Géneviève, 1998, La différence des sexes, Paris, Minuit, Collection.
GERVAIS Bertrand et DESJARDINS Mariène, 2009, « Le spectacle du corps à l’ère d’internet : entre virtualité et banalité », Protée, vol. 37. n°1, p. 9-23.
HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 2009, Petit Bodiel, Abidjan, NEI-EDICEF.
IRIGARAY Luce, 1999, Entre Orient et Occident, Paris, Grasset.
LACHANCE Jocelyn, 2012, Socio-anthropologie de l’adolescence, lecture de David Le Breton, Québec, Pull.
LE BRETON David, 2014, « Le corps entre significations et informations », Hermès n° 68, p. 21-30. (En ligne) in https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-1-page-21.htm Consulté le 09/09/2019.
LY-TALL Aoua, De la reine de Saba à Michelle Obama, Africaines, heroines d’hier à aujourd’hui, à la lumière de l’oeuvre de Cheikh Anta Diop, Dakar, L’Harmattan.
MELUCCI A., 1989, Nomads of the Present, London, Hutchinson Radius.
MICHEL Franck, 2006, Voyage au bout du sexe, Québec, Pull.
MIQUEL Paul-Antoine, 2007, « Respect et inviolabilité du corps humain », Noesis, p. 1-7. (En ligne), in http://www.noesis.revues.org/1383 consulté le 13/08/2019 à 15h30 consulté le 11/09/2019.
MOREAU Gisèle, 1989, Libres et Egales, Paris, Sociales.
POMEROY Sarah, 1975, « Déesses, femmes, putains, esclaves », Classique de l’Antiquité, New York, n°89, p 41-49.
RODHAM CLINTON Hillary, 2017, Ça s’est passé comme ça, traduction française par Perrine Cambon, Lise Chemla, Odile Demange, Karine Lalechère, Julie Sibony et Samuel Todd, Paris, Fayard.
SCHOPENHAUER Artur, 1900, Essai sur les femmes, traduction française de Jean Boudeau, Paris, Félix Alcan Edition.
SIZOO Edith, 2003, Par-delà le féminisme, Paris, Edition Charles Léopold Mayer.
SLIMANI Léila, Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, Paris, Edition des Arènes.
SPINOZA Baruch De, 2010, Traité politique, traduction française de Charles Appuhn, Paris, G-F.
STRYCKMAN Nicole, 2001, « Féminité sexuelle et féminité maternelle », Freudienne n° 37-38, (En ligne), in http://www.association-freudienne.be consulté le 11/09/2019 à 5h45.
THIAM Awa, 1978, La parole aux régresses, Paris, Donoël/Gonthier.
TOURAINE Alain, 2012, Le Monde des femmes, Paris, Fayard.
VALLE Edith, 1977, « Les femmes qui ne veulent pas d’enfant » Les Cahiers du GRIF n°17-18, p 15-24, (En ligne), in http://www.persee.fr/grif._0770-6081_1977_num_17_1_1177 consulté le 11/07/2020.
WEIL Pascal, 1994, À quoi rêve les années 90 ?, Paris, Points Essais.
WENGER Alexandre, 2005, « Lire l’onanisme. Le discours médical sur la masturbation et la lecture féminine au XVIIIe siècle », Clio. Histoire, femmes et sociétés, n°22, p. 227-243.
ETHNIES ET PRATIQUES CONSTITUTIONNELLES CHEZ LES AKAN MATRILINÉAIRES (LE CAS DES NZIMA)
Diamoi Joachim AGBROFFI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Les noms de population et/ou son espace occupé que sont : la barbarie, l’ethnie, la société : primitive, sans État, ni État de droit, sont des concepts et/ou théories qui opposent les groupes les moins organisés aux plus organisés. La question posée est la suivante : si ces concepts et/ou théories d’opposition sont pertinents dans leur ensemble, le sont-ils cas par cas ? L’hypothèse est que les pratiques constitutionnelles akan matrilinéaires, notamment n’zima infirment la norme fondamentale de l’État de droit qui est la constitution et le constitutionnalisme qui pose comme principe la séparation des pouvoirs qui seraient inexistantes dans les noms dont l’ethnie. Une enquête participante par laquelle des fonctions de dignitaire de la royauté et chefferies ont été assumées par nous et continuent, est menée depuis 2004. Les résultats révèlent par des preuves partagées par d’autres ethnies matrilinéaires que l’ethnie ne doit plus les désigner, mais l’État.
Mots clés : Constitution, État, ethnie, pratiques, société.
Abstract:
The names of the population and / or its occupied space, which are: barbarism, ethnicity, society: primitive, without State, nor the rule of law, are concepts and / or theories which oppose the least organized groups to the most organized. The question asked is as follows: if these concepts and / or theories of opposition are relevant as a whole, are they case by case? The assumption is that akan matrilineal constitutional practices, notably n’zima, invalidate the fundamental norm of the rule of law which is the constitution and constitutionalism which poses as principle the separation of powers which would be nonexistent in names including ethnicity. A participating survey by which the functions of dignitary of royalty and chiefdoms have been assumed by us and continues, has been conducted since 2004. The results reveal by evidence shared by other matrilineal ethnic groups that the ethnic group should no longer designate them, but the State.
Keywords : Constitution, State, ethnicity, practices, society.
Introduction
Le contexte social dans lequel le présent article, intitulé : ethnies et pratiques constitutionnelles, est écrit, est celui qui ne reconnaît, en termes de constitution non écrite ou informelle, que celles de trois États qui sont : le Royaume-Uni, l’Israël et la Nouvelle-Zélande. En dehors de ces trois États, les autres, notamment les sociétés traditionnelles, seraient sans constitution et appelées ethnies.
Or plusieurs constats révèlent des pratiques constitutionnelles qui attestent l’existence de constitutions des temps immémoriaux, et qui ont fait l’objet de très peu de révision dans le temps et dans l’espace. De ce fait, l’article traite de la constitution des N’zima, un sous-groupe akan matrilinéaire du Ghana et de la Côte d’Ivoire.
Il pose le problème de l’ethnie définie ordinairement par les dictionnaires généraux comme « un ensemble de personnes que rapproche un certain nombre de caractères de civilisation» parmi lesquels trois étaient reconnus aux sociétés traditionnelles. Ce sont : la langue, d’ailleurs considérée comme un patois ; les traits somatiques communs qui rapprochent des animaux par la ressemblance et la culture jugée de primitive. Pourtant, l’analyse des fondements constitutionnels dégagés des pratiques culturelles montre que l’ethnie, terme datant de 1927 (celle du Congrès d’Anthropologie d’Amsterdam qui l’a introduit) bien que le terme ethnologie soit apparu en Europe occidentale au XVIIe siècle, est une société à État, organisée sur la base d’une constitution, jamais étudiée. Il s’ensuit que l’ethnie ne résulte pas d’une désignation qui émane d’un approfondissement analytique préalable de chacun de tous les groupements humains dont leurs espaces occupés sont le plus proche possible de celui des animaux. Les pratiques constitutionnelles dégagées par le présent article s’opposent à l’ethnie, sous sa forme de construction spéculative de l’esprit qui n’a pas de fondement pratique. L’articulation de l’ethnie dans sa dimension théorique avec la réalité constitutionnelle pratique conduit à des failles. L’hypothèse est que les pratiques constitutionnelles n’zima infirment la non prise en compte dans l’ethnie d’une part, de la norme fondamentale de l’État de droit qui est la constitution et d’autre part, le constitutionnalisme qui pose le principe de séparation des pouvoirs. Tous les deux ont été de tout temps dans la constitution n’zima. Ils sont un apport nouveau de connaissance de l’Etat n’zima qui ne mérite plus le nom ethnie.
La méthodologie utilisée pour vérifier la pertinence ou l’impertinence pratique de l’ethnie est celle de la collecte et de l’analyse de données qualitative. Elle consiste à explorer et à rechercher en profondeur le vécu constitutionnel des N’zima par enquête de terrain d’haleine gardée, faite par observation participante et à les analyser. L’observation participante a été faite au moyen des fonctions de dignitaire de royautés n’zima (de Grand-Bassam et de Tiapoum) et de chefferies (de Grand-Lahou, de Divo, de Bouaké…) sont encore assumées par nous, auteur de cet article. Ce sont notamment : celles de porte-parole ; constitutionnaliste ; membre de conseil constitutionnel ; personne ressource ; consultant ; formateur ; conférencier : membre des commissions et comités d’intronisation, de destitution, d’organisation de rituels annuels (Abyssa et n’zima avuya), de funérailles et d’obsèques d’autorité traditionnelle et de participant à des émissions radiophoniques et télévisées de diffusion des savoirs et de la civilisation akan matrilinéaire de nature n’zima. Plusieurs études y ont été menées et les résultats reconnus par la communauté scientifique et publiés. Ce sont entre autres : deux thèses (une de 3e cycle et l’autre d’État), des articles, des livres en coauteurs qui constituent d’importantes ressources de la maîtrise de la langue n’zima et de l’acquisition de la culture, du droit et de l’organisation sociale de cette société. Dans le présent article, le plan de progression adopté se subdivise en trois points.
Le premier, porte sur l’ethnie telle qu’elle est vue par les Occidentaux par opposition à leurs sociétés qui doivent servir le seul modèle pour les autres.
Le second point a trait à l’ethnie découverte autrement comme Etat, de façon fortuite : par enquête participante, par fonctions exercées (dignitaire de royautés et de chefferies) et par approfondissement analytique des institutions. L’ethnie n’zima apparaît progressivement comme toute société humaine. Elle était, sans qu’on le sache, détentrice d’une constitution et elle s’organisait conformément à cette constitution, au sens de loi fondamentale, et à toutes les règles qui en découlent. Sa constitution et ses règles mettent en cause certains fondements de l’ethnie qui la faisaient être différente des sociétés européennes et leur contraire.
Le troisième et dernier point présente la société Etat n’zima comme toute société humaine avec ses forces et ses faiblesses. Elle a des avancées constitutionnelles décisives que n’ont pas les ethnies dans lesquelles elle était mise. Elle est égale à celles qui étaient présentées comme supérieures à elle. Le présent article met en exergue des caractères de civilisation non reconnus par les Occidentaux aux ethnies. Il signale des avancées constitutionnelles parmi lesquelles : l’immunité critique bien différente de la liberté d’expression, le référendum, la démocratie. Ces sociétés ont des avancées décisives de connaissances. Elles sont des sociétés ou États tout court.
1. Ethnie
1.1. L’ethnie, une société humaine aux sens défavorables
Le concept d’ « ethnie » du point de vue de sa genèse désignait la société humaine non européenne au sens défavorable. Effectivement, l’ethnie était généralement définie comme « un ensemble de personnes que rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la langue et la culture » (Petit Robert). Cette langue et la culture acquise grâce à elle, n’étaient tout juste bonnes que pour permettre aux populations rapprochées d’être des « sauvages », des « barbares », ayant « la mentalité prélogique », et que la « raison n’a pas fréquenté ». C’est sur la même lancée que de nouveaux termes négatifs, péjoratifs continuent d’être créés pour désigner ces sociétés devenues indépendantes. Entre autres peuvent être cités : « tiers monde » ; « pays sous-développés » ; « pays en voie de développement » ; « pays pauvres très endettés (PPTE) » ; « pays émergents ». L’ethnie dans ses élaborations théoriques diverses se ramène, à l’expérimentation, à la confrontation, à la réalité pratique, à des constructions spéculatives fausses, impertinentes. Dans le présent article cette confrontation a lieu sur le plan constitutionnel, jamais abordé chez les Akan matrilinéaires, en l’occurrence n’zima.
1.2. Nécessité d’un changement
Conformément à la mission civilisatrice de l’Europe et à l’évolution inhérente à tout être, un changement s’impose. La vision monovalente, de type défavorable, négatif demande que la société désignée par le concept d’ethnie soit observée autrement et les caractères de civilisations identiques à celles de l’Europe soient retenus, mentionnés et le concept de société sans arrière-pensée discriminatoire, employé dorénavant, en lieu et place de l’autre.
2. L’ethnie dans sa dimension constitutionnelle
La société prise pour ethnie, disposait, avant l’arrivée des acteurs à l’origine du concept de l’ethnie, des mêmes institutions juridiques que les leurs, faites au plutôt au 18e siècle. Les nôtres : la constitution et les règles qui en découlent ont été découvertes par nous par enquête participante, par fonction exercée (dignitaire de royautés et de chefferies) et par approfondissement analytique chez les Akan matrilinéaires. Ce sont entre autres : l’assemblée constituante (maanlema maamεla nu maamεla mᴐlibεbu nu ayia) ; la constitution (maamεla nu maamεla) ; l’État de droit (maanle) ; le contrôle de constitutionnalité (de conformité, d’inconformité) (maamεla nu maamεla neanea) ; le référendum (aman mèla kon-nimi èlilè woo maanle nyulu) ; la séparation des pouvoirs (tum nu ngbakyeleε) ; le conseil constitutionnel (maamεla nu maamεla ayia) ; les traités (maanle nwiᴐ avinli mεla) ; les lois (maamεla) ; les décrets (maamεla zu εlilε mεla) ; les arrêtés (maamεla zu εlilε anwon mεla wᴐᴐᴐ suazo) ; les ordonnances (maalema maamεla εyεlε adinlin zu elualε mᴐᴐ omaanhyenle duazo bie la a) ; les arrêts (omaanhyenle lo edwεkε mmualε ne) ; les jugements (bilemgbunli lo edwεkε mmualε ne) ; les décisions (debie εyolε εsesebε zu mεla anzee edwekε agualeε, c’est aussi maanlema εyolε ndeε wᴐᴐ εsesebε zu) ; la proposition de loi (maamεla εhyehyεlε gua εdᴐlε wᴐᴐ maanlema afan nu) et le projet de loi (maamεla εhyehyεlε gua εdᴐlε ne anyelazo nee anyelanwo abogualε wᴐᴐ omanhyenle afan nu) ; des possibilités pour tout citoyen et tout esclave d’ester en justice contre le roi et de gagner leurs procès ; les responsabilités liées à la constitution et autres règles découlant de la constitution, en cas de non-respect du droit. Les populations n’zima résidant dans « l’ethnie » ont des institutions juridiques que n’ont pas certains Européens. Un cas mérite d’être cité. Il s’agit de l’immunité critique bien différente de la liberté d’expression et d’opinion, défendue en 1788 au départ pour la liberté de la presse par le poète anglais John Milton (1608-1674). Les N’zima avaient bien d’autres institutions juridiques avant eux, notamment la constitution distincte de coutume ; la dépatrimonialisation ou le patrimoine de tous ou commun au nom duquel ou par lequel un étranger, un esclave peut porter plainte contre un citoyen d’un autre Etat pour non-respect et gagner le procès dans l’intérêt bien compris de tout le monde.
2.1. L’assemblée constituante et la constitution chez les Nzima
2.1.1. L’assemblée constituante et son terme désignatif
Dans les débats sur la constitution (maamεla nu maamεla), le référendum (aman mèla kon-nimi èlilè woo maanle nyulu) et le contrôle de constitutionnalité (maamεla nu maamεla neanea), les gouvernés rappellent un rôle primordial qu’ils ont joué dans l’élaboration de la constitution, et qui leur donne des droits certains et fixes. Il s’agit de l’assemblée constituante (maanlema maamεla nu maamεla mᴐlibεbu nu ayia) qu’ils entendent comme l’assemblée par laquelle l’élaboration de la constitution a été faite et dans laquelle ils ont travaillé et le dernier mot leur a appartenu. Littéralement, les termes désignatifs de cette assemblée, en langue n’zima, signifient : « peuple loi dans loi commencement dans assemblée ». Littérairement, ils signifient : « assemblée de peuple pour le commencement de la loi des lois ». Les lois fondamentales akan matrilinéaires d’aujourd’hui, ont fait l’objet d’une élaboration, précédée par une assemblée constituante. Sans elle, elles n’auraient pas autant de longue durée de vie qui les caractérise. Les Akan matrilinéaires, en général, et les N’zima, en particulier, ont la connaissance et la pratique du pouvoir constituant. C’est ce pouvoir constituant qui a créé leur constitution. Ils en ont encore conscience. Les gouvernés se considèrent comme le ‘père de la constitution’. En tant que grande partie du peuple, ils en sont l’auteur. La conscience de l’assemblée constituante et la base de la constitution que le peuple a jetée font qu’une veille plus grande sur elle et son devenir se constate dans la société n’zima et empêche ses révisions à la va vite. Les gouvernés ont le sentiment que leur constitution est précieuse, fragile et semblable à un bébé qui demande beaucoup de soins de prévenance. La reine mère exerce le pouvoir exécutif avec beaucoup de soins qui évitent de procéder à des révisions incessantes. La constitution est une personne tant pour le peuple que pour la reine. Aussi celle-ci jouit-elle de l’exercice du pouvoir exécutif qu’elle ne l’exerce directement ; celui-là y veille et l’exerce impersonnellement dans une démocratie populaire et semi directe.
2.1.2. La constitution et son terme désignatif
Chaque société akan matrilinéaire dispose d’une constitution dont le terme désignatif, en langue n’zima, est maamεla nu maamεla au sens de « loi des lois ». Pour faire la nuance entre la constitution et la loi fondamentale, les N’zima ajoutent le mot edukpone à maamεla nu maamεla pour faireedukpone maamεla nu maamεla. Ce groupe de mots évoque la dureté, la longévité. C’est dans la même veine qu’un conseil constitutionnel a été institué.
2.1.3. Le conseil constitutionnel
2.1.3.1. La considérations générales du conseil constitutionnel
Les idées de conseil constitutionnel et de pratiques de conseil sont bien connues des Akan matrilinéaires. Les N’zima désignent le conseil constitutionnel par le groupe de mots suivant : (maamεla nu maamεla ayia). Le mot n’zima ayia désigne : une réunion ; une assemblée ; un congrès, un conseil, une rencontre de personnes, organisée pour délibérer, pour donner des avis ou pour exposer et débattre d’une ou de plusieurs questions.
Le conseil constitutionnel a une fonction particulière. Chez les Akan matrilinéaires, constitutionnellement, il n’y a ni candidat qui s’inscrit lui-même sur une liste de candidature à une élection d’une personnalité donnée à un poste vacant ; ni candidature qui émanerait d’un candidat. C’est au peuple et au conseil constitution que reviennent ces tâches. C’est celui qui a sa constitution qui peut objectivement dégager les conditions de candidature, de choix ou d’élection. Pour les Akan matrilinéaires, dès qu’une personne veut accéder à un siège, son objectivité peut être entachée par l’aveuglement dû à sa passion de réussir. La candidature de quelqu’un que l’on propose se fait impersonnellement et dans la stricte objectivité.
2.1.3.2. Les critères de choix
Des critères de choix d’une personne présomptive (maamule sonla εvalεdinle) existent et ils sont connus de tous. Il s’agit des conditions d’accession au trône mâle, entre autres : avoir une bonne moralité, une bonne conduite ; être intègre ; avoir l’intégrité physique ; se remarquer par la probité, l’honnêteté ; avoir la maîtrise de soi ; être respectueux ; avoir des dispositions particulières à faire passer l’intérêt de tous avant le sien ; être rassembleur ; avoir pour habitude de dire la vérité, le droit rien que le droit ; affectionner la critique objective et sincère ; être impartial ; connaître de manière analytiquement approfondie l’histoire du royaume, la gouvernance politique ; se caractériser par le courage et avoir eu des activités qui ont marché et/ou qui marchent ; avoir fait de la bonne gestion financière ; être marié ; ne s’être pas signalé par le vagabondage sexuel, la séduction effrénée ; n’avoir jamais attenté à la vie d’autrui ; être sobre. Toute personne libre ou esclave de père et non de mère pouvant être héritier présomptif potentiel, respecte ces prescriptions.
À l’origine, au premier occupant ou conquérant d’un territoire était dévolu l’exercice du pouvoir exécutif aux femmes de sa lignée utérine et du pouvoir guerrier à l’aîné des frères, des neveux toujours en ligne utérine. Toutefois, en raison des longs et fréquents déplacements de guerre, le premier arrivant n’est plus forcément lié ni à l’occupation de territoire, ni à sa conquête. Aussi les N’zima ont-ils ajouté les considérations démocratiques. Ce sont les deux qui constituent les privilèges de dévolution des pouvoirs. Les N’zima ont dépassé la notion de lieu ou d’espace. De ce fait, l’idée d’Etat, de nation s’est forgée, chez eux, et elle est très forte et elle suscite un engagement ferme à la fonder dans la paix et dans l’espérance de l’exercice impersonnel des pouvoirs.
S’astreindre à mener une vie qui respecte ces critères de désignation des personnalités à des postes vacants, c’est indirectement se constituer en candidat et constituer son dossier de candidature. Aussi importe-t-il d’examiner, par exemple, les modes de désignation d’un roi, en réalité, aide de gouvernance de la reine mère, en matière d’une part, de l’exercice du pouvoir exécutif, en cas d’empêchements et de vacance de pouvoir ; et d’autre part, de l’incompatibilité de la vie dont la femme est source avec la notion de Chef des Armées et de la séparation des pouvoirs, exprimée et attestée par l’incommutabilité des sièges de pouvoir.
2.1.4. Les modes de désignation d’un roi, aide de gouvernance de la reine mère dans les sociétés matrilinéaires
Les modes de désignation d’un roi, aide de gouvernance de la reine mère, dans les sociétés matrilinéaires dont il va s’agir, concernent la société n’zima. Dans cette société, deux modes existent : le mode de désignation de l’aide de gouvernance par primogéniture (omaahyenle εvalε wᴐᴐ bεlan mᴐᴐ akulu alumuama mᴐᴐ anu) et le mode désignation démocratique (omaahyenle εvalε wᴐᴐ maamaamulé adinle zu).
2.1.4.1. Le mode de désignation par primogéniture
Le mode de désignation qui fait l’objet d’exemple, est celui de l’aide de gouvernance de la reine par primogéniture (omaahyenle εvalε wᴐᴐ bεlan mᴐᴐ akulu alumuama mᴐᴐ anu). Ce mode prévaut dans deux cas.
Le premier cas a lieu là où un membre d’une société est allé avant tout le monde sur un territoire donné, s’installer et a été rejoint par les autres après. Dans ce cas, c’est dans sa famille que se fait la désignation d’un roi, aide de gouvernance comme précédemment indiqué ; et en cas de manque, quelqu’un d’autre de son clan, remplissant les critères de choix, est désigné.
Le deuxième cas concerne quelqu’un qui a conquis un territoire par la victoire à la guerre contre les occupants. En ce cas, c’est également dans sa famille que se fait la désignation d’un roi et en cas de manque, quelqu’un d’autre de son clan, remplissant les critères de choix.
Dans l’un comme dans l’autre des cas, le troisième et dernier cas se rapporte à des descendants d’esclave ayant une mère citoyenne, issue de la famille régnante. Cette position de sa mère lui donne des droits civiques, notamment celui qui fait de lui un héritier présomptif de dernier recourt avec pour obligation de changer de nom en prenant un autre du côté de ses ascendants maternels, au cas il est choisi, roi, aide de gouvernance de la reine. Le changement de nom concerne tout citoyen dont le patronyme dénote l’idée d’étranger. Il se fait enfin par modèle et par continuité démocratique. L’ordre dans le choix des héritiers présomptifs, l’obligation de prendre un nom de règne dans l’ascendance parentale de souche féminine régnante que ce soit pour «sang entièrement pur »[3] ou non, sous-tendent l’idée d’Etat. Les Baoulé se sont retrouvés les uns en Côte d’Ivoire, les autres au Togo parce que les Ashanti ont refusé d’appliquer ce principe dans le choix d’un des leurs au trône. Un homme baoulé de père et de mère ashanti issue de la famille régnante, et qui avait toute chance d’être choisi, roi, aide de gouvernance de la reine mère, a été refusé pour cause de son patronyme baoulé. Le non-respect de la constitution qui prévoit un changement de nom patronymique sur ce point a été le motif du départ. Abordons à présent, un autre mode de désignation.
2.1.4.2. Le mode de désignation démocratique, populaire
Le mode de désignation démocratique, populaire concerné, est celui de l’aide de gouvernance (omaahyenle εvalε wᴐᴐ maamaamulé adinle zu) de la reine mère. Il arrive que tout un grand groupe, qu’un peuple tout entier, déplacé pour des raisons de guerre, sans leur roi, ni leur reine, s’installe sur un autre territoire par un accueil chaleureux d’un peuple qui lui concède une partie de son territoire. Ces déplacés de guerre peuvent y rester définitivement. La latitude leur est laissée de s’organiser comme bon leur semble, sans toutefois gêner ceux qui les ont accueillis.
Dans un tel cas, le choix ne se fait pas dans une famille qui serait la première à arriver sur le territoire, ni dans celle d’un conquérant, étant donné qu’il n’y en a pas eu. Le choix se fait plutôt parmi les personnes qui ont été exemplaires dans leur vie quotidienne, en matière des critères énumérés dans le premier mode.
Le mode de désignation démocratique, populaire se pratique aussi dans le cas du mode de désignation par primogéniture. Cela arrive lorsque ni dans la famille du premier arrivant, ni dans celle du conquérant, ni dans celle de leur clan d’appartenance, personne ne remplit les critères de choix. Dans un tel cas, il est permis de choisir quelqu’un dans les autres clans, en attendant qu’au prochain tour, une personne remplissant les critères puisse être trouvée et choisie. Les exemples ne manquent pas. Vous en trouverez à Tiapoum, Côte d’Ivoire pour ne citer qu’un seul.
2.1.5. Les membres du conseil constitutionnel
Deux catégories de membres de conseil constitutionnel existent dans chacun des deux modes de toute désignation.
2.1.5.1. La première catégorie de membres féminins du conseil constitutionnel
La première catégorie demembres féminins du conseil constitutionnel, concerne les femmes issues d’une famille ou d’un clan fixe dans laquelle ou lequel, sont désignés et choisis les héritiers présomptifs du premier mode de désignation de la famille qui est arrivée la première sur un territoire donné, ou celle ayant été conquérante victorieuse. Ce sont des femmes constitutionnalistes, pour avoir été des personnes ayant une bonne connaissance de la constitution et issues de la lignée utérine et aidées par d’autres de l’extérieur qui sont choisies pour cette fonction. Elles sont membres féminins du conseil constitutionnel et elles passent avant les hommes parce que seule la femme sait lequel de ses enfants est légitime ou pas, et connaît mieux l’homme depuis son enfant. Les femmes opèrent un vaste choix parmi tous les potentiels successeurs et en retiennent trois. Ce choix est une présélection. Les présélectionnés sont classés par ordre de satisfaction aux conditions d’accession au trône et présentés par principe démocratique aux hommes pour entérinement ou non de leur choix. Trois sont présentés successivement.
2.1.5.2. La deuxième catégorie de membres de sexe féminin du conseil constitutionnel
La deuxième catégorie demembres féminins du conseil constitutionnel, concerne les femmes dans le deuxième mode de désignation des héritiers présomptifs. Ces femmes sont des constitutionnalistes, également très au fait de la constitution et ayant une bonne connaissance des conditions d’accession au trône. Elles opèrent un vaste choix parmi tous les potentiels successeurs au niveau de la société globale et en retiennent trois. Ce choix est également une présélection. Les présélectionnés sont classés par ordre suivant les conditions d’accession au trône. Les femmes membres du conseil constitutionnel les présentent l’un après l’autre, jusqu’à épuisement de la liste. Si aucun présélectionné, n’a fait l’objet d’un entérinement par les hommes constitutionnalistes, membres du conseil constitutionnel des hommes, c’est le tour des hommes de présenter les leurs un à un.
Il arrive donc que les hommes fassent la proposition des successeurs présomptifs. Vous pouvez dire que tant que les femmes et les hommes ne sont pas d’accord sur un choix, il n’y a pas de choix d’héritier. C’est exact, toutefois, dans le fond, le dernier mot revient démocratiquement, tout compte fait, aux femmes tant dans le mode de désignation par primogéniture que dans celui démocratique. Dans les deux modes qui conduisent à deux régimes politiques, une part belle leur a toujours été faite. En matière de gouvernement, le gouvernement féminin a toujours rimer avec le pouvoir exécutif ; le gouvernement masculin, avec le pouvoir guerrier et effectivement en temps de guerre. Le pouvoir exécutif est en lien avec la vie dont les femmes sont source. Liées à cette vie plus que les hommes, elles exercent le pouvoir exécutif avec beaucoup de souplesse en mettant un accent particulier sur l’équilibre, l’entente pour le triomphe de la vie. Par elles, se fait, comme il se doit, l’ancrage, la fixation solide ou l’enracinement profond, de la démocratie et de l’exercice du pouvoir exécutif dans les hommes et dans l’État.
2.1.5.3. Les membres masculins du conseil constitutionnel
Pour être membres masculins du conseil constitutionnel, les hommes doivent faire preuve d’une envergure constitutionnelle particulière et remplir, eux-mêmes, les conditions de choix des héritiers présomptifs. Ce sont entre autres : avoir une bonne moralité, une bonne conduite ; être intègre ; avoir l’intégrité physique ; se remarquer par la probité, l’honnêteté ; avoir la maîtrise de soi ; être respectueux ; avoir des dispositions particulières à faire passer l’intérêt de tous avant le sien ; être rassembleur ; avoir pour habitude de dire le droit rien que le droit ; affectionner la critique objective et sincère ; être impartial ; connaître de manière analytiquement approfondie l’histoire du royaume, la gouvernance politique ; se caractériser par le courage et avoir eu des activités qui ont marché et/ou qui marchent ; avoir fait de la bonne gestion financière ; être marié ; ne s’être pas signalé par le vagabondage sexuel, la séduction effrénée ; n’avoir jamais attenté à la vie d’autrui ; être sobre. Toute personne voulant être héritière présomptive doit respecter ces prescriptions et s’astreindre à mener une vie qui respecte ces critères de désignation des personnalités à des postes vacants. Quiconque n’a pas ces prérequis ou atouts, ne peut dire aisément le droit. Sur ce point, les femmes en général sont plus avantagées que les hommes. Elles sont plus respectueuses des lois que les hommes. A ce propos, les N’zima donnent à la femme, le nom « ommili mεla » signifiant « qui ne perd pas la loi » et donc « qui s’en souvient et la respecte ». Dans la vie courante moderne, les femmes respectent plus le code de la route que les hommes. Effectivement, « Les femmes sont plus prudentes, plus respectueuses du code de la route ». Marcel Zady Kessé PDG de SODECI : société d’eau et d’électricité de Côte d’Ivoire et de la CIE a constaté que les femmes travaillent honnêtement plus dans les caisses que les hommes. C’est par respect des règles pour tenir les caisses qu’elles ne détournent pas les fonds autant que les hommes[4].
2.2. Les traités et leurs termes désignatifs chez les N’zima
Le traité a pour terme désignatif, en langue N’zima, maanle nwiᴐ avilin mεla anzee maamεla voulant dire mot à mot « mondes gouvernés deux milieu loi ». C’est littérairement, « la loi entre États ». De ce fait, le traité est un terme courant et bien connu des populations Akan matrilinéaires. Ces populations le considèrent comme un accord qui vaut la loi. La procédure pour conclure un tel accord, pour l’accepter et l’appliquer, est vécue au quotidien par les populations. Des personnes connues y ayant pris part se l’approprient vite, la respectent et elle sert de modèle de cohésion des États.
Les traités entre États ne se passent pas en privé, ni entre deux reines mères, ni entre deux rois. Le peuple en est bien informé. C’est par cette large information que se font l’acceptation mutuelle dudit traité et son respect. Il existe un traité entre les Ashanti et les N’zima. De même, un traité existe entre les Agni sanwi d’Aboisso et les Abron de Bondoukou.
Le premier traité a permis de mettre fin à la guerre des N’zima, débutée en 1868 et finie en 1876. Il résulte d’un accord de défense mutuelle entre les Ashanti et les N’zima. Lors de cette guerre, le camp des N’zima d’Adoanebo qui était dominé au début par le camp des N’zima de Benynli, a pris le dessus, aidé par les Fanti. Dès lors, les Ashanti de Kumassi au Ghana se sont vus dans l’obligation d’entrer en guerre contre les N’zima d’Adoanebo, les Fanti et bien d’autres qui les ont aidés. Entre temps, le roi de Benyinli, Ametchi, avait fui et s’était réfugié à Krindjabo, Aboisso, chez les Agni sanwi. Le roi Avo d’Adoanebo a menacé d’entrer en guerre contre les Agni, s’ils ne lui rendaient pas son ennemi roi. Les Ashanti de leur côté, ont menacé aussi d’entrer en guerre contre les Agni, s’ils rendent leur allié Ametchié à Avo.
Les Agni sanwi et les Ashanti se sont coalisés et ont éliminé Avo à Adou, village situé à quelques kilomètres de Tiapoum, sur la rive Est de la rivière Tanoé. C’est par ce traité de non-agression et d’assistance en cas d’attaque que la guerre fratricide de 1868 à 1876 a pris fin.
Le deuxième traité permet aux Agni et aux Abron de Bondoukou d’organiser conjointement les obsèques des rois et de régler les graves affaires concernant le roi, notamment sa destitution. Ces Abron sont également observateurs dans le mode du choix des autorités et de leur intronisation. Ce deuxième traité agni-abron est d’ordre multilatéral.
Effectivement, le traité entre les Agni et les Abron a valeur de loi organique. Elle fait partie des deux constitutions sur un plan qui touche conjointement les deux royaumes contractant ledit traité. Sans la règle de droit à respecter par les contractants, tenant lieu de loi fondamentale ou l’égalant, ni son application stricte, ni les obsèques, ni la destitution d’un roi agni sanwi ne peuvent être régulières.
Le traité entre États Agni et Abron est un accord par lequel, les deux populations se présentent comme des observateurs étrangers pour la crédibilité d’un certain nombre d’actions politiques. Il en va de même en retour. C’est pour le sérieux des actes et des actions que le traité a été signé. Qu’en est-il des autres règles ?
2.3. Lois ; décrets ; arrêtés ; ordonnances ; arrêts ; jugements ; décisions et leurs termes désignatifs chez les Nzima
2.3.1. Les lois (maamεla)
Les Akan matrilinéaires distinguent le caractère de l’habitude qui elle-même se distingue de la loi. Le caractère se dit en n’zima εbla ; l’habitude soubane et la loi, mεla anzεε maamεla. Le premier terme mεla n’est pas précis pour les Akan matrilinéaires, en ce sens qu’il désigne à la fois la loi d’un individu et celle d’un peuple qu’est maamεla. Pour particulariser les lois d’un peuple régulièrement élaborées, votées, adoptées, les N’zima recourent spécialement au terme maamεla.
2.3.2. Les décrets (maamεla zu εlilε mεla)
L’effectivité de l’existence et de l’application des décrets (maamεla zu εlilε mεla: règles pour appliquer les lois) se constate par l’organisation des sociétés akan matrilinéaires qui s’apparente à celle des États d’Amérique du Nord. Du fait de cette organisation particulière, les applications des lois peuvent différer légèrement d’un village à l’autre sur des points particuliers dans un même État. Aussi est-il de règle de dire que chaque village à sa façon particulière de dépecer son crocodile. Par conséquent, il est bienséant de chercher à savoir quelles sont les règles d’application d’une loi pour juger de son applicabilité dans une localité. Partout où un Akan matrilinéaire se trouve, sa préoccupation première est de s’informer sur la particularité des décrets d’application. Il juge les actes et les actions des personnes au vu des décrets d’application. Ce serait une pure aberration de penser que des hommes et des femmes d’un État ne savent pas ce que signifie le mot décret. En exemple, peut être citée l’homologation du titre de fonction exécutive, à savoir Nanan signifiant « grand-mère » tant pour le roi que les chefs de village ; une réalité encore en vigueur dans la plupart des royautés et chefferies akan matrilinéaires, contrairement à bien d’autres. Ainsi, en lieu et place de Nanan ce sont : Omanhyenle à certains endroits et, Awulae ou encore katamaasu (dans l’exercice du pouvoir exécutif ou dans la défense et surveillance du territoire pour le pouvoir guerrier) à d’autres endroits. Ces titres de fonction exécutive émanent d’abord de la constitution. Les lois s’accompagnent de décrets d’application bien connus des N’zima et des autres Akan. Ces décrets sont pris et appliqués par tous. Par la veille des responsabilités liées à la constitution et aux autres lois et règles à assumer par tout fautif, le peuple parvient à faire appliquer toute prescription juridique et constitutionnelle. Les autorités appliquaient elles aussi tout.
2.3.3. Les arrêtés (maamεla zu εlilε anwon mεla wᴐᴐᴐ suazo)
Conformément à l’organisation des sociétés akan matrilinéaires qui s’apparente à celle des États d’Amérique du Nord, des arrêtés sont pris pour un meilleur fonctionnement du système d’organisation étatique, administratif. Des arrêtés, des décisions se prennent par des autorités traditionnelles. Les Akan font la distinction entre ce qui vient de la reine ou du roi et de son conseiller et ce qui vient des chefs traditionnels. Ces données qui viennent de ces derniers, et qui sont des arrêtés, visent les décrets et autres règles. Il suffit d’assister à une séance de travail dans une chefferie pour s’en convaincre de leur recours.
2.3.4. Les ordonnances (maalema maamεla εyεlε adinlin zu elualε mᴐᴐ omaanhyenle duazo bie la a)
Ce n’est pas à tout moment que le peuple se réunit pour élaborer les lois. Dans certains cas d’urgence ou de toute nécessité pressante, il est prévu dans la constitution que le roi prenne une ordonnance pour résoudre un problème. Ce type de règlement ayant valeur de loi, le pouvoir de légiférer par lequel il a lieu s’exerce rarement et avec beaucoup de prudence pour éviter la personnalisation du pouvoir.
2.3.5. Les arrêts (omaanhyenle lo edwεkε mmualε ne)
Les arrêts (omaanhyenle lo edwεkε mmualε ne), sont des décisions de justice rendues à la royauté en cassation. Les affaires dont la décision prise dans une chefferie n’a pas convaincu l’une des parties en conflits et qui sont portées devant la royauté, sont courantes dans les sociétés akan matrilinéaires. Les exemples ne manquent pas.
Un conseiller d’un chef traditionnel, marié à deux femmes, frappe l’une d’entre elles. La coépouse pour ne pas être complice de ce qui adviendra des suites des coups et blessures de l’autre épouse décide de l’aider à mettre en difficulté leur époux. Les deux épouses parviennent à mettre en mal l’homme, autorité traditionnelle. Le renversement subit de la situation a poussé l’époux humilié à demander à divorcer la coépouse venue en aide à sa rivale. Les deux épouses coalisent et refusent non seulement toute idée de divorce mais de frapper non pas leur époux, mais le conseiller du chef du village que celui n’a su mérité. Effectivement, la fonction de conseiller des autorités traditionnelles découlant de l’organisation sociale et politique ayant pour modèle la famille, devrait empêcher l’époux, de frapper l’une des épouses. Les coépouses ont également pris la ferme décision de contrôler toute relation amoureuse extraconjugale dans laquelle il sera engagé et de frapper toute femme qui accepterait ses avances.
La distinction qu’elles ont faite, au sujet de leur époux, entre l’homme époux et l’homme autorité, est d’un niveau si élevé que leur acte a conduit nombre de personnes à avoir des difficultés pour mettre en cause le respect qu’elles avaient pour l’homme. Au départ, les intervenants ont pensé que probablement l’épouse avait exagéré, ce qui a mis l’homme hors de lui-même ; mais avec la nouvelle donne relative à la distinction, ils ont commencé à douter de lui.
Partant de là, l’affaire conjugale a pris une autre allure. Le Conseiller a porté plainte contre ses deux femmes qui l’ont frappé. Les deux épouses vont s’appuyer sur le nom que les N’zima donnent à la femme, à savoir ᴐmmilimε signifiant « qui ne perd pas la loi » et du fait qu’elle est plus respectueuse de la loi que l’homme, et qu’elle vit plus longtemps que lui. Pour tout cela, elle est la mémoire légale du peuple. S’appuyant sur ce prérequis légal, les deux épouses vont dire que si l’affaire s’était passée entre elles et leur époux, autorité traditionnelle, il n’y aurait pas de bagarre d’une telle ampleur. L’affaire s’était envenimée, parce que l’autorité était absente dans la personnalité de l’époux, en raison d’un défaut de maîtrise de soi. La personne à qui elles ont eu affaire était un être mâle qui faisait mal et qui ne pouvait être freiné que par un mal. C’est cet homme, très différent de celui qu’elles ont épousé, qui a été frappé par elles afin de l’amener à retrouver leur mari qu’elles aiment.
Les juges vont pour la circonstance rétorquer en disant que si lui, il a eu un défaut de maîtrise de lui-même, elles, elles devaient s’en souvenir et en faire preuve. Ne l’ayant pas fait, elles ont commis la même faute que leur époux. Les femmes rappellent, à nouveau, la maîtrise de soi, critère de bonne conjugalité et critère de choix des successeurs présomptifs dans le cadre politique et administratif en montrant que leur époux a commis une faute lourde. Pour elles, leur époux a failli à deux engagements majeurs. Elles souhaitent une et une seule chose ; à savoir que le droit soit dit rien que le droit.
La chefferie n’est pas parvenue à une décision qui apaise les parties. L’affaire est arrivée en appel et point par point, les raisons et les torts ont été situés ; la vérité et le droit dits à la fois à l’époux et à la personnalité politique et administrative et l’harmonie a repris.
2.3.6. Les jugements (bilemgbunli lo edwεkε mmualε ne)
Les jugements sont des décisions à l’issue d’un règlement, d’un examen d’affaires dans une chefferie. Ces décisions sont des solutions qui peuvent ne pas être acceptées par les litigants ou autres personnes opposées. Les recours contre ces décisions de justice dans les chefferies sont possibles et bien connus des populations.
2.3.7. Les décisions (debie εyolε εsesebε zu mεla anzee edwekε agualeε C’est aussi maanlema εyolε ndeε wᴐᴐ εsesebε zu)
Plusieurs groupes de mots désignent la décision. Ce sont entre autres : 1- debie εyolε εsesebε zu mεla ; 2- edwekε agualeε ; 3- maanlema εyolε ndeε wᴐᴐ εsesebε zu.La décision est le fait pour toute autorité ou particulier de prendre parti après une délibération ou autre approche. C’est ce qui arrêté au terme des actions menées ou des actes posés. C’est également le résultat des discussions d’une action menée par un groupe, par une assemblée ou par autre.
2.4. Proposition et projet de loi et leurs termes désignatifs chez les Nzima
Chez les N’zima, autant tout citoyen peut faire une proposition de loi, autant le roi peut faire un projet de loi. L’initiative législative appartient concurremment aux autorités constitutionnalisées (reines mères, rois, conseiller du roi, chefs traditionnels au peuple dans sa dimension parlementaire). Afin d’éviter que le roi rejette la proposition de loi des citoyens, les lois fondamentales l’ont prévue et elle y figure. Les citoyens sont également aidés par la démocratie (maamaamule) semi directe, dans laquelle se retrouvent à la fois le peuple et ses représentants. Le dernier principe de droit qui conforte les citoyens dans la proposition de loi par eux, est l’organisation de la royauté et des chefferies comme les États aux États-Unis d’Amérique dans laquelle, chaque État a des lois propres. La constitution commune autorise que se fassent quelques lois suivantes les particularités de chaque chefferie et de ses populations. De ce fait, cette constitution commune est préservée depuis des temps immémoriaux. Le modèle, le plus conservé chez les N’zima, se trouve à Benyinli au Ghana ; chez tous les Agni de Côte d’Ivoire, dans le Moronou à Bongouanou. Autant tous les N’zima[5] ont un respect particulier pour Benyinli, autant tous les Agni[6] en ont pour le Moronou. Ailleurs, le fond commun n’est pas dénaturé. Il existe. Toutefois, un petit aspect y a été ajouté sans qu’il entre en contradiction avec le socle. Le référendum (aman mèla kon-nimi èlilè woo maanle nyulu) a lieu seulement, lorsqu’un élément du socle commun dérange à la fois toutes les chefferies et toutes leurs populations.
2.5. Le contrôle de constitutionnalité ; responsabilités liées à la constitution et possibilité pour le citoyen et l’esclave d’ester en justice contre le roi et leurs termes désignatifs chez les Nzima
2.5.1. Le contrôle de constitutionnalité (maamεla nu maamεla neanea)
Le contrôle de constitutionnalité (maamεla nu maamεla neanea) a trait à la conformité et à l’inconformité de la loi à la constitution. C’est par rapport à la loi fondamentale que tout contrôle se fait. C’est la nouvelle qui a l’obligation d’être conforme à la constitution.
2.5.2. Responsabilités liées à la constitution et possibilité pour le citoyen et l’esclave d’ester en justice contre le roi et de gagner leur procès
2.5.2.1. Les responsabilités liées à la constitution
Chez les Akan matrilinéaires, la notion de faute (εvonlε) des gouvernants existe. Il est admis que ces gouvernants soient faillibles, se trompent, commettent des fautes comme tout être humain. Les sanctions qui sont prévues pour leurs fautes sont les plus sévères qui soient, en ce sens que ce sont eux qui doivent servir d’exemple. Pour les fonctions qu’ils assument et le mandat de gouvernance qu’ils ont, des responsabilités (omanhyenle εvonlε wᴐᴐ maamèla nu maamèla) pour les fautes commises et les engagements pris et non respectés, sont liées à la constitution et prévues par elle. Personne n’est au-dessus ni de la loi, ni de la constitution. Nulle part, les autorités ne sont impunies. L’impunité n’existe pour personne d’entre elles.
2.5.2.2. Possibilités pour tout citoyen et tout esclave d’ester en justice contre le roi et de gagner leur procès
Tout citoyen ou tout esclave peut ester en justice contre un roi et gagner le procès. Toute personne libre ou esclave le peut et le fait sur la base de la constitution et des lois qui en découlent et qui lui donnent le droit d’ester en justice contre toute personne qui lui pose problème. Il ne s’agit donc pas d’une éventualité, mais au contraire d’un droit su et appliqué.
Par exemple, dans le droit relatif au mariage, des sanctions prévues pour adultère commis par les rois et les chefs de villages existent. L’impunité n’existe pas. D’ailleurs, les Akan matrilinéaires sont plus sévères pour les fautes et le non-respect des engagements pris et non respectés par les autorités gouvernantes que les autres personnes, les gouvernés.
Pour avoir changé la capitale politique des N’zima du Ghana sans procéder par référendum (aman mèla kon-nimi èlilè woo maanle nyulu) et pour avoir été tyran, dictateur et créateur d’un centre de torture et d’exécution sommaire des populations, le roi Kakou Aka qui a régné de 1830 à 1849 à Adoanebo et sa famille biologique et son clan ont été rayés définitivement de la liste des héritiers présomptifs. De 1849 à 2019, soit 170 ans et donc près deux siècles, aucun d’eux n’a pu accéder au trône des N’zima à Benyinli, capitale d’État. Beaucoup de chefs sont couramment destitués pour fautes lourdes, commises et/ou pour non-respect des engagements pris.
Ces possibilités légales existent parce que chez les Akan matrilinéaires, il est interdit de porter atteinte à la vie d’autrui pour cause de faute commise ou engagement pris et non respecté. Se faire justice soi-même est formellement interdit et sévèrement punis.
Les populations de Grand-Bassam ont entamé un processus de désapprobation publique de leur roi pour avoir, d’une part, dit que le Président Alassane Ouattara pouvait briguer un troisième mandat, cela sans que les populations le mandatent de le dire, ni que la reine et lui soient d’accord sur le point ; d’autre part, pour avoir demandé à l’un des deux candidats en liste qui n’est pas du même bord politique que lui, (le roi), de retirer sa candidature au profit de l’autre qui serait de son bord. Pour des considérations politiques modernes le problème a trouvé solution.
Ce que ces populations lui reprochent c’est sa partialité, pour un roi akan matrilinéaire. Au regard de cette situation, il apparaît une confusion chez le roi, qui pense être citoyen comme tout autre, et qu’il peut agir comme il l’entend. La constitution akan matrilinéaire notamment n’zima ne lui permet pas une telle liberté. D’ailleurs, les rois n’ont pas le droit d’afficher leur appartenance aux partis politiques. Le neutralisme et l’impartialité sont requis et même exigés. Cela ne semble pas faire l’unanimité. C’est un problème pour les référendums.
2.6. Le référendum (aman mèla kon-nimi èlilè woo maanle nyulu) et son terme désignatif chez les Nzima
Le référendum (aman mèla kon-nimi èlilè woo maanle nyulu) existe chez les Akan matrilinéaire. La constitution, loi fondamentale, est vue par les N’zima comme une entité dont l’intégralité et ses parties ne peuvent faire l’objet d’une révision quelconque sans que le peuple se prononce sur l’idée même de la révision et du point précis qui va être révisé. De ce fait, la constitution est une chose de l’esprit d’un peuple dont ni un citoyen, ni un groupe de citoyens ne peuvent s’approprier, ni réviser. Elle est la propriété du peuple et elle échappe au peuple lui-même. Le peuple se laisse conduire, guider par elle.
De ce fait, aussi bien un citoyen qui fait une proposition de loi ou suggère une révision constitutionnelle qu’un roi qui fait un projet de loi ou de révision de constitution se trouvent tous deux, en situation d’adversité face au peuple et à sa constitution. Les termes n’zima : « di konim (signifiant : battre, gagner, remporter la victoire, vaincre) ; konim (ayant le sens de : victoire, succès, gain, le fait de faire l’unanimité, faire un, rassembler) ; konimlilε (voulant dire : vaincre, battre ; remporter la victoire ; le fait de vaincre, d’être victorieux) et εhomonlε (dont l’acceptation est : dominer) » que les N’zima emploient pour donner les résultats d’un référendum (aman mèla kon-nimi èlilè woo maanle nyulu) sont édifiants.
L’amendement de la constitution fait entrer en compétition, en opposition des personnes ou personnalités avec la constitution et le peuple tranche sans parti pris. Dans l’esprit du N’zima, l’amendement à apporter, met des gens face à l’adversité symbolisée par la constitution et son peuple. La résilience (capacité à résister à un choc, à un obstacle et à le surmonter) à laquelle les N’zima s’attendent et dont leurs schèmes, leurs représentations abstraites se manifestent verbalement par les termes employés et définis plus haut, existe du fait de la constitution.
Ils ne s’imaginent pas qu’un amendement puisse passer, tant la constitution a été méticuleusement élaborée. Aussi s’attendent-ils que la constitution soit : le vainqueur, la victorieuse, la gagnante, la dominante, la rassembleuse de peuple et la source de conformité d’opinion ou d’intention entre tous les membres de la société ; qu’elle fasse l’accord, le consensus des populations, des citoyens, et qu’elle soit le moyen d’expression de la majorité des opinions sur un point donné touchant la loi fondamentale.
Sur cette base, le résultat qui est réservé à l’amendement à apporter est l’échec. Effectivement, pour qu’un amendement à apporter passe, il faut qu’il résulte d’un travail exceptionnel. La raison est que la constitution est très bien connue de tous et quotidiennement respectée par tous, pratiquée par tous et contrôlée par tous. Les responsabilités (en cas de non-respect des engagements pris, de non application de loi, de non-exécution) liées à la constitution et aux règles qui découlent sont sues de tous. Aussi les sanctions également bien connues par tous, sont-elles réclamées par tous et prononcées. Ce sont ces situations qui rendent les amendements de la constitution très difficiles et lui ont donné une longévité exceptionnelle.
Le monde akan matrilinéaire est plein d’incertitudes au sujet de l’acceptation facile d’un amendement. L’amendement est d’avance quasiment voué à l’échec. La constitution gagne en force chaque fois qu’un amendement échoue. Un rejet d’un amendement se fait au détriment de la popularité de son auteur et au bonheur du peuple. Celui-ci se resserre autour de la constitution et la lâche difficilement. Celui-là s’en éloigne. Il est extrêmement important pour toute personne de compter vraiment sur la constance faveur populaire donnée à la constitution. Les actions et les actes des citoyens en accord avec la constitution sont si profonds et si importants qu’un désir qui veut se réaliser doit aller de pair. Cette situation montre bien que les successeurs présomptifs des reines mères et rois sont bien formés dès leur jeune âge à exercer le pouvoir. Toutefois, au nom de la rigueur constitutionnelle, le recoupement des informations les concernant, permet de découvrir des faits cachés, déformés, tronqués. Par conséquent, nul ne peut être assuré de se faire accepter facilement. Tout cela empêche le tripatouillage des constitutions akan matrilinéaires et les possibilités de s’éterniser au pouvoir.
Quelques exemples de l’insuccès des amendements à apporter, méritent d’être donnés afin que l’on se rende bien compte de l’intérêt de bien faire une constitution, de bien la connaître, de l’appliquer à la lettre, de bien la contrôler au quotidien, de ne jamais transiger sur les responsabilités liées à la constitution, en cas de non-respect des engagements pris, de non application des lois, de non-exécution des ordres. En 1831, le roi dictateur n’zima, Kakou Aka a tenté un amendement de la constitution. Il a proposé un projet de déplacement de la capitale politique de Benyinli à Adoanebo. La population a opté pour un non qui n’a pas empêché au roi de faire quand même le déplacement. Sa dictature l’a conduit à la prison en 1848 à Gua, et il est mort dans cette prison, le 29 décembre 1849. Son intérimaire, Ebanyenle respectueux de la constitution a reconnu l’ancienne capitale. Il n’a pas vécu longtemps. Le successeur de Kakou Aka, appelé Avo, est revenu à la charge, en demandant aux populations de Benyinli de se soumettre à lui. Ce fut un échec cuisant. Leur refus catégorique, l’a amené à entrer en guerre de 1868 à 1876, en vue de supprimer définitivement par les armes, la première capitale, consignée dans la constitution. Il a été tué en 1876 à Adou, village situé près de la frontière ivoiro-ghanéenne sud. Le gouverneur anglais du Ghana, Maclean a érigé la décision d’Ebanyenle en loi. La capitale politique de Benyinli est restée. Celle d’Adoanebo, également pour éviter la guerre.
L’amendement n’a pas abouti. La première capitale politique demeure toujours à Benyinli dans la constitution. La famille de Kakou Aka et son clan sont à jamais rayés de la liste des successeurs présomptifs. Toutefois, le royaume est divisé en deux. Le royaume des N’zima de l’Est et le royaume des N’zima de l’Ouest.
En 2005, un descendant de Kakou Aka, Professeur d’université de son état, à la retraite, a tenté d’amender la constitution pour revenir au pouvoir. Le projet consistait à réinscrire la famille Kakou Aka et son clan sur la liste des successeurs présomptifs. L’amendement n’a pas abouti. Pour le moment, il se contente du titre de chef de son village natal d’Ehuase.
En 2004, face aux conflits incessants des Abouré avec les N’zima, au sujet de savoir qui est arrivé le premier sur le territoire et qui doit vendre les terrains ruraux et urbains, les N’zima ayant 29 villages, toujours organisés comme dans un royaume, ont vulgarisé leur organisation royale. Aucun des 29 villages n’a jamais intronisé un chef de village sans en informer Bassam, quartier France, la capitale. Les N’zima ont donc fonctionné de la sorte depuis plus de 2 siècles. La loi n°2014-428 du 14 juillet, portant statuts des rois et chefs traditionnels, ne met en cause ni les modes de désignation des reines, des rois et chefs, ni la reconnaissance de ces autorités traditionnelles par leurs administrés.
Eu égard à ce qui précède, le groupe de mots par lequel les N’zima désignent le référendum est : maamèla nu maamèla konimlilε wᴐᴐ maanlima nyulu. Littéralement, les termes désignatifs du référendum en N’zima signifient : « loi dans loi, le fait de vaincre, d’être victorieuse devant le peuple ». Littérairement, « victoire de la loi fondamentale par le peuple ». De manière plus précise, les groupes de mots désignatifs de l’amendement de la constitution est le suivant en N’zima : maamèla nu maamèla nu kakykakyleε konimlilε wᴐᴐ maanlima nyulu et en français : « victoire de l’amendement de la loi fondamentale par le peuple ». Le résultat c’est soit il demeure, soit il change.
2.7. Pouvoirs et leurs termes désignatifs chez les N’zima
Les pouvoirs et leurs termes désignatifs chez les Akan matrilinéaires sont les suivants : le pouvoir exécutif (maamulé tum anzee maamεla zu εlilε tum), le pouvoir législatif (maamεla εyεlε tum); le pouvoir des représentants du peuple (maalemgbanyima tum); le pouvoir judiciaire (maadwekεlilε tum); le pouvoir guerrier, martial, militaire (maanzielε tum anzee maanle εlone tum). Ces termes désignatifs en général témoignent de la connaissance de ces pouvoirs par les Akan matrilinéaires, en général et par les N’zima, en particulier. Ils ont des sièges incommutables, non interchangeables, qui les symbolisent.
2.8. Séparation des pouvoirs et leurs termes désignatifs chez les Nzima
2.8.1. Situation qui a prévalu avant celle de la séparation des pouvoirs
Avant la présente étude, l’idée qui circulait était celle des pouvoirs confus, concentrés aux mains d’une seule personne, le roi. L’on disait des personnes qui les exerçaient qu’elles avaient le droit de vie et de mort sur leurs sujets.
La question décisive qui a été posée est la suivante. Qu’en est-il dans les faits au quotidien ? Cette interrogation a conduit à une enquête de terrain de longue haleine dont quelques-uns de ces résultats sont présentés dans le présent article.
2.8.2. Les Akan du Ghana et de la Côte d’Ivoire
Les Akan du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont deux types de sociétés. Ce sont : les sociétés patrilinéaires qui ont dans une certaine mesure des pouvoirs non séparés et concentrés aux mains d’une autorité et les sociétés matrilinéaires qui les ont bien séparés. La confusion des pouvoirs est un défaut des Akan patrilinéaires, et qui a été imputé à tous les autres non patrilinéaires.
2.8.3. Les traits distinctifs des pouvoirs séparés
Les pouvoirs : législatif, exécutif, parlementaire, judiciaire, martial, économique et magico-religieux ont des symboles, des attributs qui les représentent et les distinguent les uns des autres. Ces symboles et attributs sont des objets; tels : le siège et sa taille et forme, le couteau, le sabre, la tenue de fonction et les apparats qui sont différenciés de manière à les rendre incommutables et à fonder une séparation régide des pouvoirs. La séparation des pouvoirs dans les sociétés akan matrilinéaires part de là déjà.
La distinction tient compte également : de la manière dont certains pouvoirs sont dévolus aux personnes à charge de les détenir; sans les exercer elles-mêmes, mais plutôt de les faire exercer par le peuple pour le peuple et de se contenter de la simple jouissance. Une personnalité morale du détenteur de chaque pouvoir, distincte de toute personne physique garantit et fonde la séparation des pouvoirs.
L’équilibre entre les pouvoirs est assuré : par un mode d’exercice différent d’un pouvoir à l’autre ; par le sexe; par l’âge ; par la capacité non ambiguë à les exercer et par la latitude laissée aux gouvernés d’empêcher tout renversement de l’ordre séparateur des pouvoirs, établi par la constitution. Le passage, d’un pouvoir à l’autre, est régi par des règles, axées sur des incompatibilités multiples.
L’article offre des possibilités de renforcement de la séparation des pouvoirs, de la diminution des coups d’État, des preuves de constitution, de la démocratie et de la garantie des droits. La séparation des pouvoirs (tum nu mkpakyileε); l’incommutabilité des sièges; l’alternance démocratique (maamaamule nu εleka nwiᴐ ngakyileε) en sont des preuves des possibilités évoquées ci-avant.
2.8.4. Liberté d’expression, d’opinion et immunité critique
L’immunité critique (nohalè nu maanle èzalè bèngan) se caractérise par l’irresponsabilité et l’inviolabilité dans la critique sociale. Toute personne qui fait la critique en bénéficie. Sur ce plan l’immunité critique est bien différente de la liberté de la presse de Milton[7] qui n’a pas encore abouti totalement. Emprisonnements et mort d’opposants le témoignent.
3. L’ethnie comme toute société humaine avec ses faiblesses, ses forces et recommandations
3.1. L’ethnie, une société humaine avec ses forces
Les sociétés akan matrilinéaires ne sont pas des ethnies au sens uniquement défavorables des Européens. Elles sont plus que ces ethnies. Elles sont des sociétés.
La société n’zima, issue du groupe akan matrilinéaire, a une constitution d’une très longue durée. C’est une force remarquable. Du point de vue constitutionnel, de nombreux points communs avec les constitutions européennes existent. Des avancées décisives non encore égalées par les sociétés Européennes existent également. Entre autres peuvent être citées en rappel : l’immunité critique qui n’existe pas pour le moment dans la civilisation européenne et le temps mis pour réviser réellement une constitution, et qui est nettement plus long que celui de certaines constitutions européennes et de celles des leurs, copiées à l’indépendance des États anciennement colonisés.
3.2. L’ethnie, une société humaine avec ses faiblesses
Concernant la constitution n’zima, les faiblesses à noter, sont apparemment, les tentatives certes, moins nombreuses de révision, et qui n’ont d’ailleurs pu aboutir. Dans le fond, elles ne pouvaient l’être parce qu’elles n’ont pas été envisagées dans l’intérêt du peuple. De ce fait, les échecs témoignent de l’efficacité dans l’élaboration de ladite constitution. Le peuple connaît très bien sa constitution et il se l’a si bien appropriée que les tentatives individuelles de révision ne passent pas du tout. Ce n’est pas le cas des sociétés anciennes colonies, devenues indépendantes et ayant pour modèle par transposition et par copie, les sociétés européennes. A chaque nouveau mandat, intervient une révision de la constitution.
3.3. Recommandations
Eu égard à ce qui précède, nous recommandons que le concept d’ethnie aux sens défavorables aux sociétés non européennes soit purement et simplement abandonné. C’est injuste et non scientifique de créer un nom aux sens et significations exclusivement défavorables à un groupement humain. La mission civilisatrice doit rimer avec l’honnêteté.
De ce fait, il importe d’appeler tout État des êtres non européens, société comme les Européens désignent les leurs. La raison en est bien simple. L’approfondissement analytique des caractères de civilisation d’une telle société donne lieu à une société à part entière. Aussi l’ethnie ne peut-elle convenir aux sociétés akan matrilinéaires.
Conclusion
L’aboutissement du développement du présent article est la réponse par la négative à la question de recherche. Effectivement, si Les noms de population et/ou de leur espace occupé que sont : la barbarie, l’ethnie, la société : primitive, sans État, ni État de droit opposant les groupes les moins organisés aux plus organisés sont pertinents dans leur ensemble, ils ne le sont pas cas par cas. En l’occurrence, ce sans quoi, l’espace occupé n’zima et sa population sont appelés ethnie, à savoir : la norme fondamentale de l’État de droit qui est la constitution et le constitutionnalisme qui pose comme principe la séparation des pouvoirs existent. En conséquence, l’ethnie ne mérite plus d’être employée. Le fait de ne plus l’employer met à nu les acquis constitutionnels des sociétés qu’elle désignait[8]. L’État n’zima est comparable à celui de tout autre État européen sur la base de la constitution et du constitutionnalisme. L’hypothèse est confirmée. L’article contribue à l’avancement des connaissances des pratiques constitutionnelles dans les États traditionnels. Il est utile dans la réflexion sur les problèmes des constitutions modernes africaines. Il peut servir de lieu de l’annonce des travaux futurs dont les questions de recherche peuvent être : Comment se fait-il que les sociétés traditionnelles, désignées par le concept d’ethnie aux sens et significations si défavorables, ont eu des constitutions de si longue durée alors que les sociétés modernes, œuvres de colonisateurs européens, ont les leurs qui sont constamment révisées ? Est-ce que la constitution française, transposée dans les États, anciennement colonisés par la France, ne gagnerait-elle pas à s’intéresser aux constitutions anciennes, passées sous silence tant dans les ethnies que dans les Etats modernes ?
Références bibliographiques
AGBROFFI, Diamoi Joachim, « Constitution coutumière n’zima du Ghana et de Côte d’Ivoire, institutions afférentes », In Lettres d’Ivoire, Revue Scientifiques de Lettres, Langues et Sciences Humaines, n°019 (B) deuxième semestre, 2014, pp 105-116; ISSN 1991-8666.
AGBROFFI Diamoi Joachim, « Reines mères akan de Côte d’Ivoire et du Ghana, effectivement régnantes et mieux gouvernantes », Lettres d’Ivoire, 16, 2013, p. 231-244, 231-234.
CANGAH, Guy et EKANZA Simon-Pierre, La Côte d’Ivoire par les textes, De L’aube de la colonisation à nos jours, Abidjan-Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines, 1986, 257p.
CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011, 1095 p.
DAGRI Diabaté, Le Sanvi, un royaume akan (1701-1901), Abidjan, CERAP- IRD, 2013 2013, tome 1 et 2, 621p et 617p.
DAUSCHY, hélène, http://www.leparisien.fr/societe/les-conductrices-ne-font-plus-peur-aux-conducteurs-12-07-2016.
HAMON, Francis et Troper Michel, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, Montchrestien, 2007, 908 p.
MENY Yves, 1989, Textes constitutionnels et documents politiques, Paris, Montchrestien, 570 p.
CHANTEBOUT Bernard, 2005, Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 594 p.
MOUEZY, 2016, Histoire et coutumes du pays d’Assinie et du royaume de Krinjabo, Abidjan, ONG ADAM, 270 p.
NENE BI, 2016, Séraphin, Introduction historique au droit ivoirien, Abidjan, Centre de Documentation Juridique (CNDJ), 595 p.
NYAMKEY Georges Kodjo, NYAMKEY Koffi Robert, AGBROFFI Diamoi Joachim et alii, 2015 2016, Grand-Bassam, Métropole médiévale des N’zima, Abidjan, Les Editions du CERAP, tome 1et 2, 368 p et 650 p.
POUTIGNAT Ph., STREIFF-FENART J., 1995, Théories de l’ethnicité, suivi de Les groupes ethniques et leurs frontières, Paris, F. Barth, P.U.F. 270 p.
1. Guillaume Abiodoun CHOGOLOU ODOUWO
Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
2. Serge Armel ATTENOUKON
Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
3. Florentine AKOUÉTÉ-HOUNSINOU
Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (Bénin)
Résumé :
La présente recherche effectuée dans le Collège Saint Augustin de Cotonou auprès de 395 sujets (élèves, enseignants, parents), s’intéresse au problème de l’inappétence intellectuelle des élèves et sa gestion pédagogique. L’objectif principal est d’analyser les facteurs explicatifs de la perte de l’appétence intellectuelle des apprenants.
Dans une démarche mixte, alliant le quantitatif et le qualitatif, et grâce à l’observation, aux entretiens et aux questionnaires, cette recherche a abouti à des résultats qui montrent clairement que le dégoût des études en classe chez un élève dépend en grande partie de la qualité de ses relations pédagogiques avec ses enseignants. En effet, une relation éducative positive à la maison et surtout à l’école remédie à l’inappétence intellectuelle et à la négligence des activités scolaires chez les élèves. Aussi faudrait-il un renforcement de capacités des enseignants tant par la formation initiale que continue et améliorer le plateau pédagogique pour susciter la motivation et l’appétence chez les apprenants en vue de leur réussite scolaire.
Mots-clés : Bénin, inappétence intellectuelle, motivation, rendement scolaire.
Abstract :
This research, carried out in the College Saint Augustin de Cotonou with 395 subjects (pupils, teachers, parents), is interested in the problem of the intellectual inappetence of the pupils and its pedagogical management. Our main objective is to contribute to improving the quality of psycho-pedagogical methods of teachers in schools so that they stimulate and arouse more the desire and the taste for learning in the pupils.
In a mixed approach, combining the quantitative and the qualitative, and thanks to observation, interviews and questionnaires, this research led to results, which clearly show that the disgust of class studies among students depends largely on the quality of the teacher’s educational relationship. Indeed, a good educational relationship at home and especially at school remedies the intellectual inability and neglect of school activities among students. Therefore, it would be advisable to reinforce the professionalism of teachers both through initial and in-service training and improve the educational platform to stimulate motivation and appetite among learners for their academic success.
Keywords : Benin, intellectual inappetence, motivation, academic performance.
Introduction
L’institution scolaire est, selon F. Gilles (1968), le lieu où se fait la transmission des connaissances et où l’apprenant prend progressivement conscience de ses possibilités, s’intègre à la vie collective et se confronte à des normes et valeurs sociales. Les apprenants sont de plus en plus nombreux et, malgré leurs capacités intellectuelles suffisantes, beaucoup perdent de vue le rôle que l’institution leur attribue. Cette situation agit sur les résultats scolaires et met d’abord en cause l’enseignant, en tant qu’éducateur, puis l’institution scolaire elle-même.
En dépit du sacrifice perpétuel des parents, du dévouement des enseignants et de la volonté des institutions éducatives, certains apprenants n’ont aucun enthousiasme à suivre les situations d’apprentissage et la formation à l’école. Au contraire, ces élèves semblent démotivés et avoir perdu le goût des études. Pourtant, chaque discipline scolaire, rappelle G. Ferry (1968), approfondie jusqu’à ses fondements, permettrait de développer les qualités de rigueur, de discernement, de probité et de persévérance qui sont par excellence celles que l’on attend de l’éducateur.
Ces élèves demeurent imperturbables : exercices de maison et devoirs de classe bâclés quand ils leur arrivent de les faire, distraction quasi-permanente aux cours, et négligence dans l’apprentissage des cours rythment leurs journées. C’est peu convenable que la future élite de la nation cède à la paresse. Même s’ils ne parviennent plus à faire l’école buissonnière[9], les comportements déviants et délinquants sont désormais des faits habituels. Certains élèves s’illustrent plutôt dans la violence gratuite à l’école. Tout cela constitue un énorme défi pour les parents, les enseignants et les institutions éducatives.
Sommes-nous conscients du péril qu’encourt l’Education nationale ? Quelles sont les raisons qui pourraient justifier l’indifférence grandissant des adolescents pour les études ? Les écoles ne sont-elles plus des cadres éducatifs convenables et attrayants pour la jeunesse ? L’école est-elle à l’écoute des besoins de la jeunesse ? L’agir pédagogique est-il adapté aux attentes des jeunes élèves dans les collèges et lycées du Bénin ? En gros, les élèves ne s’ennuieront-ils pas dans les classes où les pratiques pédagogiques sont restées traditionnelles à l’ère de l’information ?
L’élève est un jeune en pleine croissance dont les compétences devront servir, plus tard, au bien collectif et au progrès du milieu social. Que la jeunesse perde le goût de l’effort, la valeur du travail qualifié et l’amour du rendement est sans nul doute préjudiciable au développement de la société. Ainsi, le présent article intervient pour analyser les facteurs explicatifs de la perte de l’appétence des connaissances des apprenants dans les collèges et lycées. Plus spécifiquement, il s’agira d’identifier ces facteurs et de les interpréter. Pour ce faire, l’hypothèse générale est : l’inappétence intellectuelle des élèves dépend en grande partie du contexte éducatif et du manque de professionnalisme des enseignants. En guise d’hypothèses spécifiques : (i) les méthodes d’enseignement favorisent l’inappétence intellectuelle des apprenants ; (ii) la remise en cause des enseignants et des parents quant à leurs rôles respectifs permet de motiver les jeunes apprenants.
1. Cadre théorique
La vie scolaire et tous les problèmes qu’elle comporte a toujours été au cœur des réflexions. De nombreuses recherches ont été entreprises dans ce domaine et particulièrement dans celui de l’apprentissage des jeunes. Certains de ces travaux ont été retenus pour fonder le cadre théorique. Les auteurs retenus pour le travail sont C. Cahen (1987), J.-D. Vincent et al. (2003), F. Roustang (2003) et F. Flahault (2003).
1.1. Les types d’apprenants créés par l’échec scolaire
Il est utile de mentionner que l’apprenant symbolise le premier responsable de sa réussite : pour y parvenir, il a le droit de recevoir un enseignement de qualité et le devoir d’être présent et bien disposé à tous ses cours[10]. C. Cahen (1987) s’est intéressé aux problèmes psychologiques et scolaires des enfants. De ses recherches sur les problèmes de l’échec scolaire des élèves âgés environ de 7 à 18 ans, cet auteur retient que l’échec scolaire est un symptôme presque constant et qu’il est curable à condition que l’élève en difficulté ait un désir minimal d’amélioration. En évitant ce qui mène à l’échec, sont ainsi créées les conditions du succès. Selon C. Cahen (1987), l’échec se présente sous plusieurs formes :
– l’antiscolaire (observable chez les préadolescents ou les adolescents) : le garçon ou la fille (entre 14 et 18 ans) retrouve chez ses pairs l’estime mutuelle que lui refusent la famille et l’école. Tout ce qui vient de l’école est dénigré et les matières n’ont plus d’intérêt pour l’élève. Se renforcent alors en l’apprenant le refus et le mépris de l’effort intellectuel, le dégoût de l’enseignement officiel, mais un goût actif pour ce qui est lié aux sensations et à l’imagination (bandes dessinées, films violents, musique) : il y trouve un monde qui lui parle ;
– l’aboulique est sans volonté, ne travaille pas et ne s’en cache pas. Il traine mais ne se distrait pas comme l’antiscolaire. Il est toujours sur le point de se mettre au travail après telle ou telle activité. Outre son farniente, il se sent coupable et hanté en permanence par le travail, il a même l’intention de le faire mais le pressentiment qu’il n’y parviendra pas prédomine ;
– le parascolaire qui ressent le rejet dédaigneux (antiscolaire) et la convulsion impuissante (aboulique). Il est animé d’un sentiment de supériorité vis-à-vis des études, des enseignants et des camarades. Il aspire à une réussite intellectuelle contredite par l’inaptitude à tout effort méthodique. Battu parfois sur le terrain de la compétition scolaire, il prend sa revanche en s’adonnant à l’étude solitaire d’un domaine ignoré par les programmes officiels ;
– l’oppositionnel, quant à lui, condamne le formalisme scolaire sans regretter le contenu de l’enseignement. Il se voit supérieur à tous et même à l’enseignant et peut se vanter d’avoir réussi à relever des éléments négligés du programme ou d’avoir apporté une correction ou un complément que les autres ne pourraient voir à un texte, par exemple, ou à l’enseignement. C’est le cas d’élèves intelligents mais qui, souvent se fabriquent une culture déséquilibrée, hypertrophiée et lacunaire incompatible avec les exigences des examens nationaux et les études universitaires.
Les traits communs de ces figures d’échec sont le désintérêt pour la scolarité, l’à-peu-près dans les connaissances auquel peut aboutir aussi la déconcentration chronique qui s’exprime par le bavardage, le manque d’attention, les rêveries, l’incompréhension et l’obsession du jeu qui se poursuit même en classe.
L’un des traits distinctifs de l’élève en échec est le désintéressement pour les matières qui peut naitre de l’amertume ou du désappointement ou encore du rejet que l’élève subit de son milieu scolaire. L’enseignement même, le choix des matières et l’esprit dans lequel elles sont enseignées peuvent aussi favoriser ce manque d’intérêt pour les études. « Les jeunes ont besoin de connaitre le pourquoi de ce qu’on leur enseigne. Ils ont besoin de savoir en quoi cela les concerne. Ils veulent évidemment savoir à quoi leur servira pratiquement ce qu’ils apprennent » (C. Cahen, 1987, p. 26).
La fécondité de cette étude de C. Cahen (1987) met à la disposition de tout enseignant un précieux outil qui, d’ailleurs, est digne d’intérêt pour tous les autres acteurs du système éducatif et tous ceux qui veulent comprendre le problème de l’échec scolaire causé par l’ennui en classe.
1.2. La culture scolaire et l’ennui
Face au divertissement qui semble actuellement s’imposer aux jeunes, l’ennui paraît comme une gangrène qui ruine et crée de profondes mutations dans le monde scolaire. Le Conseil national des Programmes (CNP) en France a organisé à la Sorbonne, le 14 janvier 2003, un colloque dont le nom est « Culture scolaire et ennui ». L’objectif principal était d’amener des chercheurs et des acteurs du système éducatif à réfléchir sur le problème de l’ennui. Le livre L’ennui à l’école de J.-D. Vincent et al.(2003) construit à partir des débats et communications de ce colloque, rend compte des approches de l’ennui, de ses manifestations concrètes, de l’attitude adéquate à adopter face au cas d’ennui.
« L’homme est un animal qui s’ennuie plus que tous les autres : c’est une des définitions possibles de l’homme » (J.-D. Vincent et al., 2003, p. 13). J.-D. Vincent (2003) explique que la capacité de s’ennuyer, de désirer, de prendre du plaisir et de souffrir sont les éléments distinctifs des vertébrés. L’homme est le plus frappé par l’ennui qui est le contraire de l’activation, révèle cet auteur. Au centre du cerveau, poursuit-il, se trouvent une substance, la dopamine, un neurotransmetteur qui garantit cette activation du cerveau en lui permettant de supporter l’intention et l’attention.
Le manque de stimulations et d’affects est alors l’un des moteurs du comportement. Il peut, en peu de temps, conduire à des comportements psychotiques et à de l’ennui tout comme le ferait une privation sensorielle. La monotonie est également un autre moyen de sombrer dans l’ennui : répéter régulièrement le même stimulus provoque une désertification des affects et des comportements violents. L’ennui est, en effet, le contraire de l’habituation qui peut conduire au sommeil et à la chute de la vigilance. « L’ennui conduit à une activation inappropriée, à des gestes, de la violence et des comportements désocialisés, non orientés vers quelqu’un d’autre ou vers un but ». (J.-D. Vincent, 2003, p. 16). Toute stimulation devient facteur d’ennui dès qu’elle est monotone : le discours de l’enseignant par exemple, lorsqu’il ne porte plus le goût d’ancrage pouvant éveiller la curiosité et susciter l’intérêt des élèves. Il en est de même pour des situations de la vie affective où la diversité est vivement souhaitable. J.-D. Vincent (2003) préconise que pour éviter que la dopamine manque dans les classes, que les élèves s’ennuient et deviennent agités, il faut d’abord remarquer que ces élèves transportent avec eux en classe ce qu’ils vivent à l’extérieur. Les médias aussi stigmatisent le rôle de l’enseignant : l’ennui s’installe parce que les professeurs ne parviennent plus à susciter la curiosité chez les élèves, l’enseignant même finit par s’ennuyer et, dès ce moment, il devient « mauvais ». J.-D. Vincent (2003) trouve que la lutte contre l’ennui doit aussi bien s’adresser à l’élève qu’au professeur. Une ouverture à l’art de la diversité dans l’enseignement serait salutaire, selon cet auteur.
Pour le philosophe et psychanalyste F. Roustang (2003), l’ennui qui serait une disposition passagère est une forme particulière des relations entretenus avec soi-même, avec son corps et, par ce dernier, avec l’environnement. Pendant l’ennui le temps semble plus long et l’impatience gagne l’individu, l’espace contrairement au temps se rétrécit. Comme moyens pour résoudre le problème de l’ennui à l’école, F. Roustang (2003) propose aux enseignants des exercices pratiques de la présence (être dans le temps et l’espace donnés hic et nunc en portant son attention à son propre corps et à l’environnement), de l’attente (être dans la disposition de celui qui ne se pose aucune question sur le « quand » et le « comment » de sa fin), de la patience (qui transforme l’attention affolée de l’ennui en hyper-vigilance, qui sort de l’ennui instable pour accéder au calme) et de la puissance : l’ennui est reconduit à sa source au cœur de l’instant et du lieu de la possibilité ; il devient force d’agir, il donne accès à la puissance prête à tout et à rien. En particulier la déperdition de l’énergie propre à l’ennui se transforme en une concentration forte.
L’ennui est un fait social qui menace toute la vie humaine et n’épargne donc pas le milieu scolaire et, inéluctablement, les adolescents et autres jeunes. C’est sur cette couche vulnérable de la société que V. Nahoum-Grappe (2003) fit ses analyses. Pour sa part,
L’ennui est une épreuve de la jeunesse qui est caractérisée par l’impatience, la turbulence et le mouvement. Le jeune se retrouve enfermé dans un cadre, tenu au ralentissement, à la modération, obligé d’être là, dans l’enferment scolaire, il ne peut qu’être menacé par l’ennui. L’école apparait alors comme une institution en total déphasage avec la culture excitée dont la société enveloppe le corps des jeunes. (p. 31)
Ce constat est renchéri par C. Henniqueau et D. Thouin (2015). Pour ces auteurs, il y a un diktat du divertissement et du prêt-à-penser, les loisirs et la distraction exercent une concurrence envers les activités plus exigeantes qui requièrent de la concentration ; les élèves ne supportent plus l’effort ni la difficulté, ils
ont été éduqués à la sur-stimulation, et très peu à supporter la frustration. Les conséquences sont graves. Ils éprouvent des difficultés à rester tranquilles, concentrés sur une tâche qui requiert l’usage de leurs capacités intellectuelles : observer, analyser les mots, discerner, raisonner, se souvenir, sélectionner les savoirs en jeu, les appliquer à une nouvelle situation, valider sa réponse… Il faut pour cela être avec soi, en contact direct avec sa pensée et sa vie intérieure (C. Henniqueau et D. Thouin, 2015, p. 32).
L’ennui devient alors signe de conflit entre les passions en ébullition et la raison à asseoir et il s’enclenche fortement dès que s’accentue le décalage entre soi, ses proches, le monde et même la vie. L’ennui est une épreuve de négativité qui porte l’individu à se confronter à la réalité. Pour le jeune, cette épreuve de négativité menace ce qui n’existe pas encore, une réalité à construire. C’est ce qu’explique V. Nahoum-Grappe (2003) :
Lorsqu’un parent pense qu’il suffit de changer la réalité, l’espace vide de l’adolescent, de le remplir d’activités et de divertissements pour tuer l’ennui, c’est une solution d’adulte : parfois, l’ennui éprouvé par le jeune a tout démoli en lui, à bas bruit et à l’insu de lui-même, tout, c’est-à-dire son rapport au temps, au monde, à la vie et à lui-même. L’ennui peut détruire l’espace intérieur (p. 31-32).
Pour V. Nahoum-Grappe (2003), l’introduction de cours passionnant ou de simple sourire, une blague ou une pensée forte comme une information stimulante sont autant de recettes pour déjouer l’ennui et cela sera aussi utile pour les enseignants qui, eux-mêmes, doivent lutter contre leur propre ennui.
A. Vaillant (2003) note deux types d’ennui : celui du surdoué et celui du cancre. Il pense que l’ennui est toutefois créateur : c’est le cas, soutient-il, de l’élève futur écrivain. En effet, selon A. Vaillant (2003), le futur écrivain est un surdoué ou du moins un élève presque toujours assidu que la routine et la mécanique peu attrayante de l’enseignement impatientent. Cela créera en lui une indifférence, un dégoût pour l’école et les savoirs au point de s’associer au groupe des chahuteurs. Comme exemple, A. Vaillant (2003) cite Flaubert et Baudelaire qui ont été renvoyés pour indiscipline de leur lycée et ont passé leur baccalauréat en tant que candidats libres. Cet auteur argumente que les œuvres deviennent pour l’écrivain l’expression des préoccupations, des certitudes, des idées, des désirs et des révoltes nourris pendant sa scolarité. Selon J.-D. Vincent (2003), on distingue trois causes d’ennui scolaire: la claustration (enfermement dans des bâtiments vétustes et incommodes, ces architectures désuètes disposent à l’ennui et ferment au monde); le fossé entre le professeur et ses élèves (les professeurs héritiers de la vieille scolastique, déconnectés du monde des élèves, sont incapables de susciter l’attention ou l’admiration) et les programmes (les cours ne suscitent aucun intérêt, l’instruction semble être fondée sur l’abstrait et les règles qui sont sans réponse au désir de comprendre et de questionner de l’élève). L’ennui se révèle parfois une source d’inspiration forte bien appréciée.
Le bon élève n’échappe pas nécessairement à l’ennui, mais il le supporte. L’élève qui ne le supporte pas, c’est-à-dire qui ne parvient pas à se sentir existé en jouant le rôle que l’école attend de lui, risque fort de s’orienter vers des manières d’être transgressives, par exemple en défiant l’autorité pour se faire valoir aux yeux de ses camarades. (F. Flahault, 2003, p. 60)
A. Comte-Sponville (2003) préconise que le déphasage entre le désir des élèves et la réalité imposée sera surmonté dès qu’on aidera les élèves à transformer ou à élever eux-mêmes leur désir, en leur apprenant à désirer ce qui est, c’est-à-dire ce qu’ils ont ; apprendre à découvrir et à comprendre ce qu’on fait. Mais seul le souhait ne suffit pas, il faut apprendre à mieux désirer, à aimer et à vouloir. Il s’agit d’instruire pour l’enseignant et d’apprendre pour l’élève, cela n’est jamais sans effort et même sans ennui. Il n’est point question de remplacer l’effort par le plaisir ou de supprimer l’ennui, mais d’apprendre aux élèves à prendre plaisir à l’effort, et à accepter l’ennui ou le surmonter parfois. Tout en adaptant l’école au désir des enfants, il faut les éduquer non au plaisir immédiat, au bonheur tout fait, mais à l’effort, à l’exercice, au bonheur à faire. Le jeu ou le plaisir ne suffisent pas ; l’enseignant n’est pas là pour satisfaire une attente, mais susciter une attention, créer un désir, séduire, guider une volonté, instruire. G. Ferry (1968) considère que l’enseignant en tant qu’éducateur se préoccupe essentiellement d’ajuster son intervention aux besoins et aux possibilités de l’élève.
2. Méthodologie
La démarche au plan méthodologique est mixte, qualitative et quantitative. Le travail s’est basé sur des données descriptives, des opinions sur le sujet de recherche à savoir la question de la relation éducative et des problèmes de l’inappétence telle que perçue par la population cible, relativement à leurs avis et opinions ainsi que les comportements en situation de classe.
La population cible ici est l’ensemble des élèves de l’enseignement du second degré, notamment les élèves du premier et second cycle ainsi que les enseignants et les parents d’élèves du Cours Secondaire Saint Augustin (CSSA). Il s’agit d’un collège catholique situé dans le septième arrondissement de Cotonou (Littoral).
Inauguré le 04 octobre 2004, cet établissement est dirigé par l’Institut des Sœurs de Saint Augustin (SSA). Il dispose du premier cycle et du second cycle avec à la fois les régimes d’internat et d’externat. Le choix de ce collège se justifie par sa rigueur au service de la promotion et du développement des qualités intellectuelles des jeunes élèves. Ainsi, il y est mis un point d’honneur à la compétence, à l’accueil, à l’écoute, à l’orientation, à l’enseignement et à l’éducation, au bien-être social, à l’épanouissement spirituel, à l’organisation du personnel et des activités pédagogiques, à la gestion de la discipline et aussi des affaires économiques, à la relation avec les parents d’élèves dans le souci d’assurer aussi, grâce à leur coopération, une éducation efficace et satisfaisante. En 2017, le collège comptait 1094 élèves dont 596 filles et 498 garçons et plus de 80 enseignants.
Ne pouvant joindre tous les élèves compte tenu de leur grand nombre, il a fallu échantillonner. Cette phase consiste, selon G. Landsheere (1976), à « choisir un nombre limité d’individus, d’objets ou d’événements dont l’observation permet de tirer des conclusions (inférences) applicables à la population entière (univers) à l’intérieur de laquelle le choix a été fait», (p. 337). L’échantillon regroupe ainsi 111 élèves (24 en quatrième et 87 en troisième) au premier cycle et 114 élèves (49 en seconde, 35 en première et 30 en terminale) au secondcycle, soit au total 225 élèves toutes séries confondues. Les apprenants de ces classes sont, semble-il, capables de comprendre et de répondre aux questions relatives à leur motivation et à leurs expériences scolaires, qui leur permettent de savoir les causes de l’inappétence intellectuelle et même de l’échec.
Du côté des enseignants, tous les 80 ont été touchés par l’enquête. En ce qui concerne les parents, ils étaient 50 sans distinction d’âge, de sexe ni de profession. Par ailleurs, 40 élèves ont librement participé à l’entretien. Globalement, l’échantillon est donc constitué de 395 enquêtés qui ont été soumis au questionnaire, au guide d’entretien et la grille d’observation.
2.1. Les questionnaires
Pour une fructueuse appréhension du problème de l’inappétence intellectuelle des élèves, trois différents questionnaires ont été élaborés respectivement à l’attention des professeurs, des élèves et des parents d’élèves. Ils ont permis en effet de recueillir des informations sur certains aspects de notre étude. Outil de collecte de données quantitatives, ils comprenaient une série de questions fermées à choix unique ou à choix multiples, des questions ouvertes et des questions fermées dichotomiques formulées en fonction des objectifs de la recherche. Les questions comportent généralement plusieurs parties : identification de l’enquêté (facultative), intérêt pour les études, relation enseignant-élève, relation parents-élève/école, pédagogie et suggestions. Les questions visent à déceler les causes de l’inappétence intellectuelle chez les participants, leur perception de l’éducation et les stratégies déployées pour prévenir et remédier au phénomène.
2.2. La grille d’observation
Afin d’apprécier le déroulement des séances et des activités éducatives dans l’établissement, une grille d’observation a été élaborée et exploitée conformément aux recommandations de G. Mialaret (2004). Elle a permis de regarder de près la situation d’étude des élèves, c’est-à-dire d’apprécier la situation d’apprentissage des élèves de mieux comprendre leurs réactions en classe, d’appréhender comment les professeurs gèrent leurs classes, comment ils interviennent, comment ils répondent aux aspirations de leurs élèves et comment ils les évaluent. Ce fut en outre l’occasion d’observer le mode d’action des différents secteurs d’activité dans l’établissement. Cette démarche qualitative a en définitive appuyé les données quantitatives.
2.3. Le guide d’entretien
L’entretien semi-directif a servi à la collecte d’informations d’une manière complémentaire auprès des élèves. Ils ont été une quarantaine, interviewés individuellement ou en focus group pendant les pauses ou en classe, en l’absence des professeurs, de façon à leur permettre de réagir et de s’exprimer librement et avec sincérité. Le but de ces entretiens est de recueillir les différents points de vue personnels des apprenants sur le problème de l’ennui ou de l’inappétence intellectuelle et sa gestion pédagogique. La diversité de perceptions des répondants constitue une richesse qui a utilement complété les informations recueillies par le questionnaire ainsi que par la grille d’observation.
Le dépouillement s’est fait en regroupant les idées suivant les objectifs fixés et le décompte selon les modalités de réponses proposées dans les questionnaires. Le décompte des réponses de chaque question a permis de calculer les pourcentages et de réaliser des tableaux suivis de commentaire. Les logiciels Excel 2014 et Sphinx 2014 ont été utilisés pour l’analyse des données recueillies.
3. Résultats
3.1. La perception des élèves sur leur enseignement et les sources d’inappétence intellectuelle
Dans le souci d’apprécier le degré d’intérêt pour les études, des questions ont permis de comprendre la valeur que les élèves accordent aux études et s’ils aiment étudier. Le tableau 1 montre le goût des élèves pour les études.
Tableau 1 : Répartition des élèves selon leur amour pour les études
| Amour pour les études | Nombre de réponses | Pourcentage |
| Aucune réponse | 2 | 1,0% |
| Oui | 185 | 95,9% |
| Non | 6 | 3,1% |
| TOTAL | 193 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
Un grand nombre d’élèves affirment qu’ils aiment étudier. Ainsi sur 193 élèves sondés, 185 soit 95,9 % affirment aimer les études contre seulement 6 soit 3,1% qui ont répondu non. Un deuxième tableau montre les causes de leur intérêt ou désintérêt pour les études.
Tableau 2 : Répartition des élèves selon les raisons de leur amour pour les études
| Raisons de l’amour des études | Nombre de réponses | Pourcentage |
| L’étude est source de connaissances | 33 | 19,7% |
| L’étude permet de devenir une grande personnalité ou un haut cadre et d’être autonome | 37 | 22,0% |
| Les études sont une garantie pour l’avenir et la réussite sociale ; elles sont un moyen de richesse et de bonheur | 51 | 30,3% |
| Etudier est passionnant, aide à réfléchir et devenir intelligent. J’étudie pour réussir avoir une bonne note en classe ou à mon examen | 32 | 19,0% |
| J’étudie pour faire la fierté des parents | 9 | 5,3% |
| Je n’aime pas étudier, c’est ennuyeux et exigeant, on mémorise trop de choses et de toute façon sans les études on peut réussir sa vie | 6 | 3,6% |
| TOTAL | 168 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
Le tableau 2 montre que presque tous les élèves accordent une grande valeur aux études. Ainsi, pour 30,3 % de ceux qui ont répondu favorablement, les études sont une garantie pour un avenir meilleur. Certains étudient pour avoir des connaissances 19,7%. Pour d’autres, 22,0 %, étudier assure l’autonomie et aide à devenir une grande personnalité ; 19,05 % ont de la passion pour les études, estiment qu’étudier développe l’intelligence et surtout y trouvent un moyen de succès en classe et aux examens nationaux. En outre, 5,3 % trouvent dans les études un moyen de faire la fierté et l’honneur de leurs parents ; et ce n’est que 3,6 % des élèves qui n’attribuent aucune valeur positive aux études. Le tableau 3 qui suit concerne les difficultés que les élèves ont dans leurs études.
Tableau 3 : Répartition des élèves selon leurs difficultés à comprendre les cours
| Difficultés à comprendre certains cours | Nombre de réponses | Pourcentage |
| Aucune réponse | 2 | 1,0% |
| Oui | 159 | 82,4% |
| Non | 32 | 16,6% |
| TOTAL | 193 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
Le données du tableau 3 indique que 82,4% des élèves affirment avoir des difficultés à comprendre les cours, pendant que 16, 6% disent n’en rencontrer aucune. Est-ce que cette situation induit chez les apprenants de préférer certaines disciplines à d’autres ?
Tableau 4 : Répartition des élèves selon qu’ils préfèrent des disciplines ou non
| Préférence des disciplines | Nombre de réponses | Pourcentage |
| Aucune réponse | 3 | 1,6% |
| Oui | 172 | 89,1% |
| Non | 18 | 9,3% |
| TOTAL | 193 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
L’analyse du tableau 4 montre que 89,1% des élèves enquêtés disent avoir des matières préférées et seulement 9,3% n’en ont point. Cependant, ont-ils des enseignants favoris ? Le tableau 5 nous en donne des informations.
Tableau 5 : Répartition des élèves selon qu’ils préfèrent ou non des enseignants
| Question 17 : Préférez-vous des enseignants à d’autres ? | Nombre de réponses | Pourcentage |
| Oui | 170 | 88,1% |
| Non | 23 | 11,9% |
| TOTAL | 193 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
A la question de savoir s’ils ont des enseignants favoris, la majorité des élèves (88,1%) a répondu positivement, et seulement 11,9% déclarent apprécier tous leurs professeurs.
Il s’est agi à la suite de s’intéresser à la question de l’ennui des élèves, les réponses sont révélées dans le tableau 6 ci-après.
Tableau 6 : Répartition des élèves en fonction de leur ennui ou non en classe
| Ennui en classe | Nombre de réponses | Pourcentage |
| Aucune réponse | 1 | 0,5% |
| Oui | 131 | 67,9% |
| Non | 61 | 31,6% |
| TOTAL | 193 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
Le tableau 6 montre que la majorité des élèves enquêtés, soit 67,9%, déclarent être ennuyés par certains cours, tandis que 31,6% estiment le contraire. Mais alors, quels comportements adoptent les élèves qui s’ennuient en classe pendant les cours qu’ils n’apprécient pas ? Le tableau 17 présente le sentiment qui anime les élèves pendant les cours qu’ils n’aiment pas :
Tableau 7 : Etats des élèves pendant des cours qu’ils n’aiment pas
| Nombre d’enquêtés | Etat créé par les cours que les élèves n’aiment pas | Nombre de réponses | Pourcentage |
| 193 (Réponses multiples : 3 au maximum) | Aucune réponse | 4 | 2,1% |
| Ennui | 140 | 72,5% | |
| Distraction | 91 | 47,2% | |
| Sommeil | 132 | 68,4% |
Source : Données de terrain, 2020
Les élèves indiquent que pendant certains cours qu’ils n’apprécient pas, ils sont animés d’un sentiment d’ennui, ils sont distraits ou ont sommeil. Ainsi, l’ennui domine (72,5%), est suivi du sommeil (68,4%) et la distraction (47,2%). Quelles peuvent-être alors les raisons de l’aversion des élèves pour certains professeurs et leurs matières ?
Tableau 8 : Raisons du désamour pour certaines matières
| Nombre d’enquêtés | Raisons du désamour des élèves pour des matières | Nombre de réponses | Pourcentage |
| 193 (Réponses multiples : 3 au maximum) | Aucune réponse | 2 | 1,0% |
| La sévérité de l’enseignant | 104 | 53,9% | |
| La manière d’enseigner | 104 | 53,9% | |
| Les mauvaises notes | 122 | 63,2% | |
| L’ambiance pendant le cours | 101 | 52,3% | |
| Autre à préciser | 1 | 0,5% |
Source : Données de terrain, 2020
Le tableau 8 donne une idée des causes de la répulsion pour certaines matières par les élèves. Les mauvaises notes sont en tête (63,2%), la sévérité et la manière d’enseigner du professeur sont deuxièmes ex aequo (soit tous les deux 53,9%) et l’ambiance pendant le cours vient en quatrième position (52,3%).
Tableau 9 : Critères d’appréciation des enseignants selon les apprenants
| Nombre d’enquêtés | Critères d’appréciation de l’enseignant | Nombre de réponses | Pourcentage |
| 193 (Réponses multiples : 3 au maximum) | La maîtrise du cours | 175 | 90,7% |
| La gentillesse | 162 | 83,9% | |
| La beauté physique | 4 | 2,1% | |
| Autre à préciser | 1 | 0,5% |
Source : Données de terrain, 2020
Les résultats montrent que 90,7% des élèves privilégient la maîtrise du cours comme critères d’appréciation de leurs enseignants. Ils mettent en deuxième position la gentillesse, soit 83,9%. Ils ont très peu d’attention, soit 2,1%, à la beauté physique de l’enseignant. Dans la relation professeur-élève, outre ces qualités que soulignent les apprenants, y-a-t-il selon eux d’autres facteurs qui rendent encore plus attrayants les cours ?
Tableau 10 : Critères d’un cours intéressant selon les apprenants
| Critères du cours intéressant | Nombre de réponses | Pourcentage |
| Les explications approfondies et la maîtrise du cours par le professeur | 95 | 52,8% |
| Humour, blagues, illustrations et histoires éducatives pour détendre et expliquer le cours | 42 | 23,3% |
| Dialogue, échange et débats sur les sujets de la vie pratique ; collaboration élèves-professeurs, facilité à se fier au professeur | 10 | 5,6% |
| Passion du professeur pour sa matière, son enthousiasme, sa vivacité et sa gentillesse | 19 | 10,6% |
| Pertinence du cours, nouvelles découvertes, désir de l’élève de connaitre et d’imiter le professeur | 14 | 7,8% |
| TOTAL | 180 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
Les résultats du tableau 10 indiquent que pour 52,8%, ce sont les explications approfondies et la maîtrise du cours par le professeur qui rendent plus attrayants les cours; 23,3% apprécient plus l’humour, les blagues et les histoires éducatives qui détendent et illustrent le cours ; pour 10,6%, c’est la passion du professeur pour sa matière, son enthousiasme, sa vivacité et sa gentillesse; pour 7,8%, c’est plutôt la pertinence du cours, les nouvelles découvertes, le désir de connaitre et d’imiter le professeur; enfin pour 5,6%, c’est le dialogue, les échanges et débats sur des sujets de la vie pratique, la collaboration élèves-professeurs et la facilité à se fier au professeur. Les informations qui suivent exposent ce que pensent les enseignants de leurs élèves.
Tableau 11 : Répartition des enseignants selon qu’ils ont des élèves qui aiment apprendre
| Classes avec uniquement des élèves ayant un profond désir d’apprendre | Nombre de réponses | Pourcentage |
| Oui | 2 | 4,8% |
| Non | 40 | 95,2% |
| TOTAL | 42 | 100% |
Source : Données de terrain, 2020
Il ressort du tableau 11 que la majorité des enseignants enquêtés (95%) a déclaré avoir parmi leurs apprenants des élèves qui n’ont pas le goût des études contre seulement 4,8% qui estiment n’avoir que des élèves studieux et motivés. Les enseignants pendant les cours arrivent à distinguer les élèves qui ont l’appétence intellectuelle de ceux qui n’en ont pas. Ce qui suit fait état des caractéristiques que les enseignants enquêtés relèvent chez un apprenant motivé : « Il est attentif, suit le professeur, écoute et participe bien, il est serein, pas distrait ni indifférent, moins bavard, ponctuel au cours ; a le désir ardent d’apprendre, fait régulièrement ses exercices » (données des entretiens avec les enseignants).
Les enseignants pendant les cours arrivent aussi à identifier les comportements des élèves démotivés :
- distraction pour 73,8% d’entre eux ;
- ennui pour 57,1% ;
- sommeil 47,6% ;
- paresse 66,7% ;
- et 11,9% en détectent d’autres.
3.2. Pour un rendement meilleur des apprenants
Au total, 38 parents d’élèves ont été interrogés dans le cadre de cette recherche. Les parents ont relevé les critères suivants pour permettre aux apprenants donc leurs enfants d’avoir un meilleur rendement:
- être soutenu et encouragé (81,6%) ;
- être écouté et accompagné (78,9%) ;
- être aimé (36,8%) ;
- être surveillé et contrôlé (36,8%) ;
- être puni et ramené à la raison (23,7%).
Dans le même schéma, les parents utilisent des moyens pour maintenir chez l’élève le goût des études. Les parents développent divers moyens pour maintenir le goût des études chez leurs enfants :
- conseils (100%) ;
- récompense (81,6%) ;
- promesse de cadeau (42,1%) ;
- menace de punition (5,3%).
Les facteurs de la dynamique motivationnelle selon les apprenants à la suite de ce que relèvent les parents sont contenus dans le tableau suivant.
Tableau 12 : Facteurs relevés par les apprenants comme favorisant ou non leur motivation à apprendre
| Facteurs positifs Bonne ambiance : le professeur fait de temps en temps de blague, de l’humour pour détendreLe professeur maitrise et fait bien son cours Le professeur aborde beaucoup l’actualité et ce qui a trait à la vie pratiqueLe professeur est propre, accueillant et humble | Facteurs négatifs L’ambiance est lourde, il fait chaudLe cours est ennuyeux : tout semble une répétition : le professeur répète les mêmes choses, n’explique pas bien et ne dit pas les choses clairement, le cours fatigue, on écrit seulementOn ne comprend pas bien le coursLe professeur est peu souriant, insulte tout le temps, ne respecte pas les élèves, se voit trop et déverse ses colères et frustrations sur nous |
| Solutions des apprenants Stimuler pendant le coursDialoguer, se rapprocher plus des élèves, chercher à cerner les difficultés de l’élève, le suivre de près et le faire participer au coursEviter les insultes, montrer les avantages et bienfaits des études Faire des séances de renforcement et beaucoup d’exercices, expliquer toujours mieux quand nous ne comprenons pas avec des exemples concrets. | |
Source : Données de terrain, 2020
Le tableau 12 résume les facteurs relevés par les apprenants eux-mêmes comme favorisant ou non leur motivation à apprendre. Les apprenants se disent influencés positivement par plusieurs facteurs qui leur donnent le désir d’étudier. Il s’agit de la bonne ambiance du cours et de la capacité de l’enseignant à susciter leur curiosité. En revanche, des facteurs comme les injures et les longues répétitions sont davantage de source de dégoût. Les élèves ont alors préconisé que leurs enseignants usent d’humour, de blagues, de professionnalisme, de proximité dans la relation enseignant-élève et de respect, d’écoute, d’adaptation du cours avec la vie pratique et l’actualité.
4. Discussion
Les résultats indiquent que tous les élèves accordent une grande valeur aux études surtout pour le fait qu’elles sont une garantie pour leur avenir et une source de développement intellectuel, social et matériel. Cette prise de conscience n’atténue pas cependant l’inappétence intellectuelle de quelques apprenants. Il semble que les méthodes pédagogiques influence l’appétence intellectuelle des élèves. En effet, l’élève, sujet de l’éducation, dans le processus de l’apprentissage doit être au centre des activités. Il devient l’acteur principal et son rôle désormais ne se limite plus à recevoir de l’information, mais de mettre en application les compétences et les connaissances qu’il acquiert ; c’est pourquoi une activité pédagogique, pour accroître la motivation des élèves, doit remplir certaines conditions, notamment être significative aux yeux de l’apprenant et l’impliquer. Les théoriciens, de ce fait, considèrent l’enseignant comme l’un des facteurs-clés qui influencent la dynamique motivationnelle de l’élève (R. Viau, 2009).
Cette réalité aide à repérer davantage le lien entre les méthodes pédagogiques et appétence intellectuelle des élèves, les résultats de la présente recherche le prouvent bien. Il a pu être noté également qu’au cours, l’ennui, les difficultés à comprendre les cours, la préférence pour des matières ou encore pour tel plutôt que tel autre enseignant sont autant de facteurs conduisant au phénomène de dégout pour les études (F. Roustang, 2003 ; F. Flahault, 2003). D’où, il convient de souligner que la personnalité de l’enseignant et surtout ses stratégies d’enseignement importent beaucoup pour motiver les apprenants. Le désintérêt, l’ennui, le dégoût ou les difficultés de compréhension pendant le processus d’apprentissage scolaire non seulement sont révélateurs de la qualité de la pédagogie et de la stratégie de transmission du savoir, mais aussi des aspirations et des besoins des apprenants.
Par ailleurs, les mauvaises notes sont chez les élèves la principale cause de l’inappétence intellectuelle. Et ce qu’ils désapprouvent le plus chez les enseignants est le manque d’explication ou l’explication superficielle des cours. Ce qui confirme fort bien la pensée de F. Dubet (2003) : « Qu’y a-t-il de plus ennuyeux que d’apprendre sans savoir que l’on progresse, d’apprendre sans percevoir les objectifs du travail accumulé, de travailler en ayant le sentiment d’être toujours aussi éloigné d’une norme mal définie, mais toujours hors d’atteinte ? » (p. 77). De même, les élèves reprochent aux professeurs la sévérité et l’énervement mais aussi l’incompétence, le manque de maîtrise de l’enseignement. A contrario, la maîtrise du cours par l’enseignant est mise en exergue comme ce qui attire le plus l’apprenant. Cette qualité est la plus appréciée et rend encore plus attrayants les cours que les élèves aiment suivre. En effet, bénéficier de l’explication approfondie et bien faite des cours est ce que désire tout apprenant. Cette analyse est d’autant plus pertinente que R. Viau (2009) examinant les facteurs qui influent sur la dynamique motivationnelle de l’élève affirmait :
Il ne fait aucun doute que l’enseignant demeure un des principaux facteurs de motivation ou de démotivation pour les élèves. Un enseignant qui désire susciter la motivation de ses élèves se doit d’abord d’être compétent et motivé à enseigner, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas. Chacun d’entre nous connaît des enseignants qui ne maîtrisent pas ce qu’ils enseignent. Ils ont beau profiter de manuels et de cahiers d’exercices, leurs élèves perçoivent rapidement qu’ils ont devant eux un enseignant qui a appris hier ce qu’il enseigne aujourd’hui. Cette situation ne peut que les démotiver (p. 81).
La plupart des élèves ont une prédilection pour certains professeurs et par voie de conséquence pour leurs matières. Cela explique le taux élevé, mais inquiétant d’élèves qui sont ennuyés au moins par une matière. Conséquemment, presque tous les enseignants voient une possibilité de redonner le goût des études à travers l’écoute et le conseil comme moyens les plus cités. Les élèves confirment cela, car selon eux les enseignants, en donnant les moyens de motivation aux élèves démotivés, hissent dans la tête de ces derniers, le conseil suivi de la récompense, l’encouragement, le soutien et l’assurance.
Pour leur part, les parents d’élèves soutiennent dans le même sens que les élèves ont plus besoin d’être soutenus et encouragés, d’être écoutés et accompagnés. C’est pourquoi dans les méthodes de correction de l’inappétence intellectuelle, les parents ont opté plus pour le dialogue.
Les caprices ou les attitudes les plus décevantes des élèves, adolescents ou jeunes en formation sont comme des questions posées que l’éducateur doit entendre; l’action ou la réaction de l’éducateur pour être fructueuse doit être posée en termes de réponse, et la réponse sera adéquate si l’éducateur réussit à décoder le sens profond des gestes et réactions de ses apprenants, ce qu’il ne réussira pas sans le dialogue.
Apprendre à dialoguer… Telle est la première mission de celui qui veut jouer un rôle éducateur (…) Apprendre à dialoguer, c’est d’abord mettre l’autre en confiance, afin qu’il sache puiser la force de se lancer dans le dialogue… C’est apprendre à l’écouter, en se décentrant de sa propre problématique (J.-M. Petitclerc, 1989, p. 106).
De ces considérations, ressort la dimension affective de l’éducation, l’enseignant est appelé à faire preuve d’attention, de proximité, de volonté et de « capacité d’écouter les élèves, de les aider à formuler leur pensée et de tenir compte de leurs propos » (P. Perrenoud, 2013, p. 73). C’est ce que confirme M. Postic (2001) en soulignant que
L’enseignant doit percevoir et accepter autrui comme un être indépendant ayant sa liberté, ses droits personnels, il doit comprendre le point de vue de l’autre (…). Dans la relation pédagogique, la médiation de l’enseignant, au lieu d’être de nature intellectuelle, (…), est d’ordre affectif. Le formateur (…) ne fait pas d’initiation ; il écoute, pour affranchir l’autre, il s’interroge sur le sens de la démarche que suit cet être, il se considère autant que lui comme un être en continuelle évolution et il tente de résoudre avec lui des conflits et de parvenir à une conciliation provisoire (M. Postic, p. 81-82).
Beaucoup d’enseignants, dans le but d’intéresser et de motiver les élèves, adoptent de bonnes stratégies pédagogiques en classe. Le moyen le plus efficace et le plus apprécié est l’humour, la détente, c’est ce que confirment également les résultats. En effet, la majorité des enseignants soutient que détendre par moment l’atmosphère par des blagues, des histoires amusantes, ne pas stresser, encourager, valoriser l’élève suscitent et favorisent davantage l’intérêt pour les études.
L’enseignant doit donc avoir une meilleure préparation du cours avec des supports variés et attrayants, être dynamique, précis et clair. C’est une des qualités que doit avoir tout enseignant. Le professeur en tant qu’éducateur doit être un modèle et doit inspirer ses élèves à travers le grand intérêt et la maîtrise qu’il a pour sa matière. G. Ferry (1968) fait remarquer que la fonction de l’enseignant est éducative parce qu’elle soumet l’enfant à son « ascendant » et parce qu’elle doit provoquer chez l’apprenant le respect du devoir et de la raison auxquels il s’identifie. Le dynamisme, la motivation et la maîtrise de l’enseignant sont des sources de motivation qui donnent à l’élève le désir d’apprendre. L’échec scolaire, le dégoût ou l’inappétence intellectuelle ont en effet leur source dans l’inexpérience de l’enseignant comme l’explique G. Boko (2009) :
Le rôle de l’enseignant consiste à redresser la barre en suscitant chez l’enfant un irrésistible désir d’apprendre. Pour cela, il faut qu’il soit un bon maître, c’est-à-dire, selon les termes d’Alain Baudot, “un bon cuisinier”: celui qui sait provoquer “la faim et l’appétit” pour l’activité scolaire (…) En matière de pédagogie, l’expérience du maître ne se résume pas seulement à son vécu personnel et à la durée dans la profession: c’est tout ce à quoi il a été régulièrement exposé à la fois pendant sa formation et après sa formation (…) Lorsqu’un individu ne reçoit pas une formation solide, il est en lui-même incapable de tirer le meilleur profit des expériences que sa vie professionnelle lui donne à vivre. (p. 182-183).
Les résultats ont fait ressortir des facteurs qui influent sur l’inappétence intellectuelle des apprenants. La recherche met en évidence le lien entre les méthodes pédagogiques des enseignants et l’inappétence intellectuelle des élèves. Le désintérêt, l’ennui, le dégoût ou les difficultés de compréhension sont tributaires de l’incompétence ou de la stratégie de transmission du savoir adoptée par l’enseignant qui ne tient point compte des aspirations et des besoins des apprenants. D’où, un enseignant compétent, attentif qui maîtrise bien son cours, adopte une pédagogie suivant les vrais centres d’intérêt des apprenants, créant une très bonne ambiance favorable aux études intéresse les élèves à son cours et maintient en eux, de façon durable, la motivation. Ce faisant, il assure selon C. Gauthier (2001) à la fois la gestion de la matière et la gestion de la classe. Il est vrai que le problème de l’inappétence intellectuelle ayant d’autres facteurs extrascolaires s’impose parfois aux enseignants malgré leurs efforts, et il faut le souligner très clairement, les effectifs pléthoriques ne favorisent guère les enseignants.
Conclusion
Les enquêtes réalisées auprès des élèves, des professeurs et des parents d’élèves font ressortir qu’il y a un lien qualitatif entre les méthodes pédagogiques des enseignants et l’inappétence intellectuelle des élèves, le dégoût ou le désintérêt pour une matière étant en grande partie dépendant de l’incompétence de l’enseignant ou de l’utilisation de stratégie d’enseignement peu adaptée. La recherche a montré que l’enseignant doit être suffisamment compétent et doit pouvoir se maîtriser en toute situation. D’autres qualités comme l’attention, l’humour, l’ouverture d’esprit, l’écoute et l’adoption d’une pédagogie centrée sur les vrais centres d’intérêt des apprenants sont nécessaires à l’enseignant pour créer un meilleur milieu d’apprentissage, pour gérer correctement la classe et surtout pour accroître l’appétence intellectuelle des élèves. Qualité de la pédagogie et éducation sont donc étroitement liées : il apparaît comme indispensable de promouvoir cette qualité, parce qu’elle est plus que nécessaire pour tout apprentissage et constitue une arme efficace pour susciter l’appétence intellectuelle chez les apprenants et la maintenir. La première hypothèse est donc confirmée.
L’enseignant est dans l’institution scolaire le principal éducateur de l’apprenant, c’est pourquoi il est important d’aider les enseignants à garantir aux élèves un milieu scolaire sain, une ambiance de cours agréable et un cadre d’étude attrayant. L’éducation relevant d’une responsabilité commune, l’élève, jeune en croissance, a donc besoin de personnes plus âgées et expérimentées que lui pour le guider et l’orienter dans ses apprentissages. Dans cette entreprise, tout doit être mis en œuvre pour que l’élève ne s’ennuie jamais. C’est pourquoi, il est important que le renforcement des capacités professionnelles des enseignants aussi bien par la formation initiale que celle continue, l’amélioration du plateau pédagogique et de l’ergonomie scolaire soient une priorité. Un point d’honneur doit être mis sur la lutte contre les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Le cadre familial doit permettre l’écoute de l’apprenant, son soutien et sa motivation au besoin. La deuxième hypothèse de recherche se voit ainsi confirmée. Au surplus, une réflexion future pourrait avantageusement portée sur le phénomène de la parenté recomposée et le rendement scolaire ou académique.
Références bibliographiques
BOKO Comlan Gabriel, 2009, Psychologie et guidance en milieu africain. Introduction à une relation éducative plus réussie entre éducateurs, parents et enfants africains, Cotonou, CAAREC Éditions.
CAHEN Cyril, 1987, La tête ailleurs…Comprendre, maîtriser, prévenir l’échec scolaire, Bourges, Editions Nathan.
COMTE-SPONVILLE André, 2003, « Philosophie de l’ennui », in VINCENT Jean-Didier et al., L’ennui à l’école, Paris, Éditions Albin Michel.
DUBET François, 2003, « Pourquoi les élèves supportent-ils mal l’ennui ? », in VINCENT Jean-Didier et al., L’ennui à l’école, Paris, Editions Albin Michel.
FERRY Gilles, 1968, « L’enseignant éducateur ». in Revue française de pédagogie, volume 3, 1968. pp. 18-30. Récupéré de https://www.persee.fr/docAsPDF/rfp_0556-7807_1968_num_3_1_1758.pdf
FLAHAULT François, 2003, « Sentiment d’exister et rapport au savoir », in VINCENT Jean-Didier et al. L’ennui à l’école, Paris, Editions Albin Michel.
FRÉMY Dominique et FRÉMY Michèle, 2005, QUID 2006, Paris, Editions Robert Laffont.
GAUTHIER Clermont, 2001, « L’effet enseignant », in RUANO-BORBALAN Jean-Claude, Eduquer et former : les connaissances et les débats en éducation et en formation, Auxerre Cedex, Editions Sciences Humaines.
HENNIQUEAU Christine et THOUIN Dominique, 2015, J’n’aime pas lire !,Normandie, Flammarion.
MIALARET Gaston, 2004, Les méthodes de recherche en science de l’éducation, Paris, PUF.
NAHOUM-GRAPPE, Véronique, 2003, L’ennui à l’adolescence. in VINCENT Jean Didier et al., L’ennui à l’école, Paris, Editions Albin Michel.
PERRENOUD Philippe, 2013, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, Issy-les-Moulineaux, ESF Editeur.
PETITCLERC Jean-Marie, 1989, Respecter l’enfant. Réflexion sur les droits de l’enfant, Mulhouse, Salvator.
POSTIC Marcel, 2001, La relation éducative, Paris, PUF.
ROUSTANG François, 2003, « Reconduire l’ennui à sa source », in VINCENT, Jean-Didier et al., L’ennui à l’école, Paris, Editions Albin Michel.
VAILLANT Alain, 2003, L’ennui à l’école au XIXe siècle : l’écrivain ou le sublime potache, in VINCENT Jean-Didier et al., L’ennui à l’école, Paris, Editions Albin Michel.
VIAU Roland, 2009, La motivation en contexte scolaire, Bruxelles, De Boeck.
VINCENT Jean-Didier, 2003, « Les neurones de l’ennui », in VINCENT Jean-Didier et al., L’ennui à l’école, Paris, Editions Albin Michel.
ETHNICISATION ET DÉSETHNICISATION DU DÉBAT POLITIQUE EN CÔTE D’IVOIRE
Frederic Kouassi Touffouo PIRA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
pirafred2000@yahoo.fr et fredericpira@gmail.com
Résumé :
En Côte d’Ivoire, les différents pouvoirs successifs ont mobilisé l’ethnie dans la perspective d’en faire une base partisane et électorale. Avec le retour au multipartisme en 1990, l’espace politique ivoirien s’est sérieusement paré d’étiquettes ethnicopolitiques prégnantes. Ce faisant, la chose ethnique est devenue un enjeu stratégique de pouvoir. Cette ethnicisation que se sont appropriée, par la suite, les partisans des différents leaders a installé la suspicion, nourri l’animosité. Et malheureusement, comme il fallait s’y attendre, l’embranchement ethnicopolitique a fragilisé la cohésion sociale, torpillé la démocratie avant de porter l’estocade à ce pays, jadis havre de paix. Au regard de son histoire récente, corrompue par plusieurs crises politico-militaires meurtrières, il est impérieux de libérer les ivoiriens du monde clos des instrumentalisations ethniques infécondes et nocives. L’article doit pouvoir aider l’ensemble des populations ivoiriennes à se détacher progressivement mais définitivement de ses pratiques encombrantes et meurtrières afin d’apaiser l’espace sociopolitique pour faire triompher la démocratie et la paix.
Mots clés : Côte d’Ivoire, Débat, Désethnicisation, Ethnicisation, Politique.
Abstract :
In Côte d’Ivoire, the successive government authorities have leveraged ethnicity as a growth perspective for their followers and electoral base. With the upcoming of the multi-partyism in 1990, the Ivorian political arena has been dramatically stamped by deep-rooted ethnocentric political attributes. Therefore, the ethnical topic has now become a strategic tool for the government authorities. This ethnicization which is used by the supporters of the different leaders from a cognitive and practical dimension has instilled doubt and feed animosity. Unfortunately, as expected, the ethno-political arm has weakened the social cohesion, destroyed the democracy and eventually dealt the ultimate blow to this country previously recognized as a peaceful land. In the light of its recent history corrupted by several military and political deadly crisis, it is imperative to free the Ivorians from this very confined territory of steril and harmful ethnic manipulations. This article must help the entire Ivorian population to slowly but definitely move away from these deadly and cumbersome activities. This will ultimately ease the socio-political arena and allow democracy and peace to triumph.
Keywords : Côte d’Ivoire, Debate, De-ethnicization, Ethnicization, Political.
Introduction
Adopté par l’Assemblée Territoriale dès 1960, le pluralisme politique fut longtemps gelé par Houphouët Boigny (1960-1993) avant d’être activé en avril 1990. Mais, dans la plupart des pays africains francophones, le nouveau paysage de la politique africaine multipartiste est fortement influencé par l’instrumentalisation du phénomène ethnique. Et la Côte d’Ivoire ne fait pas exception à cette observation. L’avènement du multipartisme s’est accompagné d’une résurgence de l’ethnicisation du discours politique, déjà visible sous le long règne du premier président ivoirien. À compter de cette période, la plupart des partis politiques qui ont vu le jour, quoique s’adressant à l’ensemble des populations, se sont adossés aux régions et aux groupes ethniques de leurs leaders.
Mais, la disparition de Félix Houphouët Boigny (1993) à qui succède un dauphin constitutionnel, Konan Bédié du même groupe ethnique que lui (ethnie Baoulé du groupe ethnique Akan), ouvre une véritable crispation de l’ethnicisation du débat politique en Côte d’Ivoire. La course à la succession qui oppose les héritiers du ʺvieuxʺ, Konan Bédié (Akan) et Alassane Ouattara (Malinké), accélère et achève la construction de deux blocs quasi ethniques issus de l’ex-parti unique, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA). Dans leur stratégie géopolitique locale, tous les leaders politiques, sans exception, instrumentalisent la fibre ethnique. De 1995 (premières élections post-Houphouët) à 2010 (crise postélectorale), les Ivoiriens assistent à l’explosion de l’ethnicisation du discours politique. Á propos de cette situation, F. R. Koné (2011, p. 45). écrit :
Le champ politique ivoirien se configure clairement sous forme d’une arène où l’on peut lire le positionnement des groupes ethniques derrière le combat des partis : les populations de l’ouest (Krou majoritairement) s’alignent derrière le FPI ; les « Nordistes » (Malinké et Sénoufos) prennent fait et cause pour le RDR ; les Akans (surtout les Baoulé) en majorité soutiennent le PDCI.
Débutée sous Houphouët Boigny, l’ethnicisation du champ politique a trouvé, avec le multipartisme, un terreau fertile à son épanouissement. Malheureusement, cette pratique n’a, de toute évidence, pas permis de renforcer la cohésion sociale nationale, de construire une nation, d’asseoir la démocratie et de perpétuer la culture de la paix. L’ethnicisation progressive, par le canal de discours et de faits politiques, a contribué à faire basculer doucement, mais sûrement, la Côte d’Ivoire dans une série de violences meurtrières. Trois décennies plus tard, la politique ivoirienne reste fortement gangrenée par la chose ethnique et son futur passe alors par une nécessaire déconstruction du discours ethnicopolitique. Il est sans doute temps de tourner la page et de scruter de nouveaux paradigmes réunificateurs et pacificateurs au service de la politique et des populations ivoiriennes.
1. Fondements théoriques
Il s’agit ici de revenir sur l’ethnicisation prégnante du champ politique ivoirien, et de s’interroger sur son importance dans un pays au brassage ethnique aussi important. Au fond, quel est le véritable rôle de cette instrumentalisation ethnique ? Est-elle nécessaire ? Peut-elle aider à structurer la société, à l’organiser et à intervenir sur des situations politiques données ? Trois hypothèses sont émises dans le cadre de cet article.
La première avance que l’ethnicisation du discours politique est devenue un enjeu stratégique du pouvoir.
La deuxième dit que l’ethnicisation du débat politique permet aux leaders politiques d’opérer des labellisations partisanes des groupes ethniques, de se constituer une force et d’espérer en disposer lors de joutes électorales et même de conflits armés.
La dernière soutient que l’instrumentalisation ethnique par la politique, met en cause la cohésion sociale, l’unité nationale, la démocratie et la paix.
La dernière crise postélectorale (2010-2011) a laissé entrevoir très nettement une ethnicisation du conflit comme l’attestent nombre de rapports et reportages d’organisations des Droits de l’homme (Amnesty International, Rapport N°AFR 31/002/2011). Ainsi, les différentes crises meurtrières qu’a connues le pays, depuis les indépendances jusqu’à ce jour, ont mis en scène ethnicité et État; autant de préoccupations à solutionner pour la survie de ce pays.
Ce travail appelle plusieurs théories. Tenue par J.-L. Amselle (1992), J.-L. Briquet (1995) la théorie du clientélisme est définie comme l’attitude qu’adoptent les politiques et qui consiste à accroître leur influence, en se créant une clientèle par des procédés démagogiques. Ils la présentent comme une expérience politique officieuse. Toujours selon ces auteurs, le clientélisme tirerait ses origines des sociétés traditionnelles africaines, et serait en marge de la politique moderne et surtout de la démocratie. En outre, il a pour ressorts des réseaux de solidarité ou des références sociales qui peuvent être, entre autres, des groupes d’appartenance ethnique, des groupes d’amis, des groupements d’intérêts économiques.
Un deuxième groupe de chercheurs, P. Mayer (1990), A. Pages (2001) et le CPJMO (2013), parle plutôt de l’ethnocratie qui est la gestion de l’État par l’ethnie au pouvoir, au détriment des autres ethnies du pays. Cette théorie admet que les politiciens s’appuient sur leur appartenance culturelle, voire ethnique, pour obtenir des votes. Ainsi, les membres d’une parenté, voire d’un groupe ethnique prêtent allégeance au politicien de leur contrée ethnique, revendiquent très souvent le parti politique comme un bien de la communauté ethnique.
Les théories instrumentaliste et constructiviste peuvent également aider à mieux appréhender l’instrumentalisation de l’ethnie comme une forme de participation politique. L’approche instrumentaliste borne l’ethnicité comme une idéologie servant non seulement à conquérir, mais aussi à exercer et à conserver le pouvoir. Dans ce sens, l’ethnicité peut être saisie comme l’appartenance à une communauté par rapport à d’autres et intègre de cette manière, la manipulation dans les relations socio-politiques. Quant à l’approche constructiviste, elle met en évidence différents facteurs externes, notamment les discours et faits des leaders politiques qui vont influencer le choix des citoyens. A Desrosières (1993), parle plutôt d’encodage. Il met en évidence des opérations de labellisation et de dénomination effectuées par de nombreuses institutions dont la statistique, la politique, etc.
La théorie du déterminisme social peut être une autre piste de réflexion pour conduire cette étude. Abordant le modèle psychologique de l’analyse des comportements politiques, P. F. Lazarsfeld (1994) soutient que les caractéristiques sociales telles que le statut socio-économique, la religion et le lieu de résidence, sans oublier le rapport historique agissent sur la psychologie des acteurs sociaux. P. F. Lazarsfeld (1944, p. 27) continue pour dire qu’« une personne pense politiquement comme elle est socialement. »
Pour finir, la théorie déconstructiviste de J. Derrida (1989) intervient dans la mise à plat de ces construits ethnicopolitiques. Il explique que la déconstruction est à l’opposé des constructions qui supportent des systèmes philosophiques clos ou des ouvrages achevés. La déconstruction est un espace qui s’ouvre, un état de l’espace ouvert aux réflexions, aux transformations. Dans sa démarche, J. Derrida (Op. cit.) s’emploie à montrer que la déconstruction n’est pas seulement une entreprise critique mais aussi positive. Quant à Pierre Bourdieu, N. Heinich (2007) résume ainsi son approche : « chez Bourdieu puisque ʺtout est socialement construitʺ, des éléments d’analyse peuvent conduire à disqualifier le construit social et à considérer que tout ce qui fut construit d’une certaine manière pourrait être reconstruit autrement ».
Nous pensons que les approches derridienne et bourdieusienne seraient de bons instruments pour déconstruire le fait ethnique et reconstruire la nouvelle cohésion sociale en Côte d’Ivoire.
2. L’ethnicisation du débat politique en Côte d’Ivoire
L’houphouëtisme, une gouvernance sous le prisme de l’ethnocratie et du clientélisme (1), retrace l’histoire de l’ethnicisation du champ politique ivoirien à partir de son indépendance (1960). La Côte d’Ivoire n’étant plus régentée par une autorité suzeraine ou coloniale, l’ethnicisation du champ politique reste avant tout un acte volontaire, fruit de stratégies et de calculs politiciens. De 1990 à 2011, multipartisme et course au pouvoir aux arômes ethniques (2) concentrent toutes les crispations ethnicopolitiques qu’a connues le pays.
2.1. L’houphouëtisme : une gouvernance sous le prisme de l’ethnocratie et du clientélisme
La gouvernance de Félix Houphouët-Boigny telle que vue par A. Dieth (2020) laisse voir ce qui suit :
L’houphouëtisme est avant tout une idéologie portée par un nationalisme modernisateur d’obédience libérale. Elle traduisait en idéologie mobilisatrice et en utopie politique, les besoins et les espérances démocratiques d’une société multiethnique qui aspirait à l’unité, à la liberté, à l’égalité et à la modernisation économique.
Une seconde approche définitionnelle de la même doctrine de l’houphouëtisme proposée par F. R. Koné (2011, p. 45) avance ceci :
Officiellement Houphouët Boigny se montre hostile à la question ethnique dans la gestion du pouvoir politique. Cependant, cette réalité existe bel et bien dans sa stratégie de gouvernance. Elle est dissimulée derrière ce qu’il appelle localement sa ʺgéopolitiqueʺ. Il s’agit d’un subtil clientélisme politique dont la base est ethnique. En clair, pour s’assurer une légitimité populaire, il entreprend une redistribution ethnique des ressources économiques et politiques par l’intermédiaire des ʺfils des régionsʺ ou de ceux qu’on nomme les « cadres des régions ». Loin d’être un espace administratif neutre, la région ramène en réalité à des entités ethniques ».
Mais les vocables « ethnocratie » et « clientélisme », attribués à la période d’Houphouët laissent échapper les premiers faisceaux de l’ethnicisation du champ politique. Ces deux théories, portées par son parti politique, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), un parti-État qu’il adosse si bien à l’ensemble de son groupe ethnique (AKAN) permettent à Houphouët de confisquer le pouvoir par et pour le seul groupe ethnique Akan. À la mort de Felix Houphouët Boigny, sa succession actée par l’article 11 de la Constitution est également ressentie comme un choix ethnocratique, selon les opposants ivoiriens et plusieurs observateurs de la vie politique. Elle est une cause facilement identifiable qui s’enracine dans les modifications constantes de la Constitution jusqu’à la désignation du dauphin constitutionnel en la personne de l’ex-président Henri Konan Bédié (1993-1999). En effet, l’article 40 de la constitution de 1960 énonçait que :
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, empêchement absolu, l’intérim du Président de la République est assuré par le Président de l’Assemblée Nationale. Pour une période de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix jours au cours de laquelle il fait procéder à l’élection du nouveau Président de la République.
Mais c’est en 1963 qu’intervient un nouvel article 11 qui précise : « en cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont dévolues de plein droit au Président de l’Assemblée Nationale ». Et, c’est notamment sur cet article que Bédié, Président de l’Assemblée nationale, issu de la même ethnie que son prédécesseur accède à la présidence de la République, à sa mort en 1993. Opposants et adversaires politiques internes au PDCI-RDA voient, dans cette succession, un choix délibéré d’accentuer les clivages ethniques, non sans avoir pris soin de marginaliser et d’exclure certains groupes ethniques de la gestion du pouvoir politique. A. Blondy (1998) n’avait pas hésité à dénoncer cette succession : « dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir, pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard ce sera la guerre civile ».
Ainsi, pour beaucoup d’observateurs, le modèle houphouëtiste s’est construit insidieusement sur des références ethnicistes et clientélistes. A. Bahi (2013, p. 111) écrit à ce propos : « C’est sous Houphouët-Boigny que commence la justification de la longévité Akan voire Baoulé au pouvoir ». Selon lui, Houphouët-Boigny a raffermi son pouvoir sur le mythe du sens supérieur de l’État propre à son groupe d’appartenance ethnique. Pour Harris Memel-Fotê (1999, p. 23) : « Ce mythe repose sur le double socle de l’idéologie ethnocentrique de l’État et l’idéologie aristocratique de l’ethnie ». Il enfonce le clou lorsqu’il affirme :
À l’avènement de l’indépendance, et en quête de légitimation, la racialisation coloniale plutôt que d’être abandonnée est récupérée, révisée au profit du groupe Akan. Au sommet de la nouvelle hiérarchie sont placés les Akan avec une prééminence explicite des Baulé et des Anyi sur les ethnies lagunaires ; ensuite viennent le groupe Mandé et au bas de l’échelle les Kru ». (H. Memel-Fotê, Op. cit., p. 24.)
Et comme il fallait s’y attendre, dans certaines zones, est véhiculé pendant longtemps un discours tendant à expliquer que l’unique parti politique au pouvoir depuis les indépendances est celui des Akans et principalement des Baoulé. Ce groupe ethnique Akan dont est issu Félix Houphouët-Boigny, le tenant du pouvoir, serait privilégié dans toutes les fonctions étatiques et, de ce fait, a accaparé toutes les richesses du pays.
Cette lecture de la gouvernance de feu Houphouët-Boigny a créé un repli identitaire, favorisé un clivage ethno-régionaliste latent. Et c’est dans ces conditions que le 30 avril 1990, contre toute attente des militants de son parti, il annonce le retour au pluralisme politique.
2.2. 1990-2011 : Multipartisme et course au pouvoir aux arômes ethniques
Le 30 avril 1990, Houphouët Boigny plie face à la rue, et finit par accepter la réinstauration du multipartisme. Le journaliste ivoirien Diégou Bailly (1995) recense, de façon chronologique et thématique, l’histoire de la crise politique ivoirienne de 1990 qui aboutit à l’ouverture démocratique. Dès sa promulgation, plusieurs leaders politiques et syndicaux créent leurs partis. Les plus populaires de ces partis sont le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, l’Union des Sociaux Démocratiques (USD) de Bernard Zadi Zaourou, le Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) de Francis Wodié, le Parti républicain de Côte d’Ivoire (PRCI) de Gbaï Tagro, le Parti pour le progrès et le socialisme (PPS) de Bamba Moriféré et tant d’autres sans faire omission au RDR né en 1994 et conduit par Djéni Kobina. Mais, en Côte d’Ivoire comme partout ailleurs en Afrique, les nouveaux partis politiques sont présentés comme tribaux, ethniques ou régionalistes ne représentant que des entités sociologiques ou géographiques particularistes. (I. K. Souaré, 2017, p. 85.)
K. F. L. Hetcheli (2016) avance que les dirigeants africains ont tribalisé l’action politique en créant ou en réactivant des stéréotypes ethniques et régionalistes. Pour Ketehouli B (2005) les partis politiques se créent sur des bases ethnico-régionales que sur la base de projets de société. Randall. V et L. Svåsand (2002) font le même constat, et pensent que les considérations ethniques sont l’un des facteurs qui expliquent la faiblesse des partis politiques en Afrique, surtout ceux de l’opposition. S. Mozaffar et J. R. Scarritt (2005) opinent que les clivages ethno-régionaux constituent une des principales caractéristiques des systèmes de partis en Afrique subsaharienne.
Dès 1990 donc, avec la naissance du multipartisme, l’ethnicisation du champ politique ivoirien prend des proportions plus importantes, en raison, de la multiplicité des leaders politiques et de leurs origines ethniques. Pour F. R. Koné (Op. cit, p. 45) : « la période allant de 1990 à la fin 1999 constitue la seconde phase de l’enracinement progressif de l’ethnicité dans le champ politique ivoirien. Cela se fait sous l’influence de l’avènement du multipartisme en avril 1990 ». Il corrobore sa démonstration par cette analyse de la première élection présidentielle sous le multipartisme.
Une lecture des premières élections multipartisanes (1990) tend à confirmer cette ethnicisation du champ politique. Laurent Gbagbo obtient ses meilleurs scores chez les Krou dont il est originaire et chez les communautés ethniques (Attié, Abey, Agni Sanwi) qui se sentent victimes de la gestion d’Houphouët. Le PDCI, vainqueur des élections, est majoritairement soutenu par les Akan dont est issu son leader Houphouët Boigny et par les Gur du nord du pays. » (F. R. Koné, Op. cit., p. 45.)
Ce décryptage laisse entrevoir le dynamisme des votes ethniques introduit par la théorie de l’identification partisane avancée par les tenants de l’université de Michigan sous le nom de paradigme de Michigan (1940). Dans le sillage de cette théorie N. Mayer (2007, p. 18) explique que :
Les appartenances de groupe, classe, communauté religieuse, groupe ethnique sont décisives. Le choix électoral est analysé comme mise en conformité avec les normes du groupe et il semble que le sens des convenances soit un trait plus marquant des préférences politiques que la raison ou le calcul.
Il est intéressant de remarquer que les populations adhèrent aux partis politiques ou votent les candidats ayant des liens ethniques avec elles. L’ethnicité est, tour à tour, comprise, selon Ph. Poutignat et J. Streiff-Fenart (1995), comme une extension de la parenté, une revendication d’intérêts communs, un reflet des antagonismes économiques, un système culturel et un système d’interaction sociale. Mais, il faut attendre la mort du Président Houphouët pour prendre la mesure de cette montée en puissance de l’ethnicisation politique. En effet, le conflit successoral entre Bédié et Ouattara fendille le PDCI-RDA en deux groupes appréhendables à travers une fracture ethnique. Les cadres et les populations du nord se retrouvent majoritairement autour d’Alassane Ouattara et créent un nouveau parti en 1994, le Rassemblement des Républicains (RDR) avec à leur tête Djeni Kobina. F. R. Koné (ibidem) écrit qu’à compter de 1994 :
L’espace politique se présente comme suit : les populations de l’ouest (Krou majoritairement) s’alignent derrière le FPI de Laurent Gbagbo, les ʺnordistesʺ (Malinké et Sénoufos) prennent fait et cause pour le RDR d’Alassane Ouattara et les Akans, en majorité, soutiennent le PDCI-RDA de Konan Bédié. » (F. R. Koné, Ibidem.)
Á partir de 1995, l’ivoirité, un concept fourre-tout, mal maîtrisé par ses propres géniteurs, critiqué et combattu par une partie de l’opposition politique est le ferment qui va faire monter les effluves ethniques en Côte d’Ivoire. Cette observation se retrouve chez A. Babo et Y. Droz (2008, p. 752) qui précisent que : « La politique de ʺl’ivoiritéʺ, développée par le président Bédié pour assurer son maintien au pouvoir, a exacerbé les revendications nationalistes ». Mais T. Boa s’oppose à cette interprétation qui retient l’ivoirité comme un instrument de pression politique du pouvoir. Il la propose plutôt comme le fondement de l’identité culturelle ivoirienne, socle de l’intégration africaine :
L’ivoirité doit être défendue autant que l’a été la francité ou la sénégalité. Un pays, c’est aussi une histoire, une culture, un ensemble de valeurs et de tradition constituant de son âme. Il est temps de dissiper les malentendus et les incompréhensions à propos de l’ivoirité ; il est temps de revenir à la forme culturelle initiale qui faisait de la recherche d’une conscience nationale intégrée à l’africanité le fondement de l’ivoirité. (T. Boa, 2009, p. 78).
S’il adoube l’ivoirité en insistant sur ses atouts sus-indiqués, T. Boa (Op. cit., p. 77) lui reconnaît une réception mouvementée relativement au contexte sociopolitique lorsqu’il écrit que :
Malheureusement, le développement politique de l’ivoirité est contemporain de plusieurs débats et de certains événements sociaux politiques qui vont rejaillir sur la nature même du concept. Sa compréhension va s’en trouver piégée par le climat belliqueux de l’antagonisme politique. La réception de la version politique de l’ivoirité a lieu dans un contexte particulièrement idéologique voire démagogique.
C’est dans ce contexte de crise « ivoiritaire » que désormais les affaires politiques vont être enrobées d’épaisses couches ethniques. Exaspéré, A. Blondy (1996), remet une nouvelle couche en chantant : « Ils ont bétéisé le débat. Ils ont baouléisé le débat. Ils ont diouléisé le débat ». Et trois ans plus tard, dans une atmosphère de très vives tensions sociopolitiques, intervient (24 décembre 1999) un coup d’État militaire revendiqué par le Général à la retraite Robert Guéï. Dans certains milieux, il est largement perçu comme la fin de l’hégémonie de la communauté baoulé (Akan) sur la scène politique ivoirienne. Indéniablement, l’ethnicisation du champ politique ivoirien resurgit et poursuit son interminable parcours, aidé par la classe politique, militaire et une presse écrite partisane. Divisée, fragilisée, la transition civilo-militaire réussit tant bien que mal à organiser une ʺchaotiqueʺ élection présidentielle qui voit l’élection toute ʺcalamiteuseʺ de Laurent Gbagbo en octobre 2000. Mais, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, après avoir longtemps dragué la crise armée, la Côte est réveillée par des coups de canon. Le long processus de sortie de crise (huit ans) est couronné par l’élection présidentielle de 2010 que F. R. Koné (Op. cit., p. 45) présente :
La tenue de l’élection présidentielle d’octobre 2010 (1er tour) organise enfin la confrontation, maintes fois ajournée, entre les trois leaders représentatifs des grands groupes ethniques, notamment Alassane (Dioula), Bédié (Akan) et Gbagbo (Krou). Le deuxième tour (novembre 2010) qui oppose Alassane Ouattara (RHDP) et Laurent Gbagbo (LMP) prend les allures d’une vraie velléité ethnique.
T. Berthemet (2010) confirme ces constations quand il écrit sur www.lefigaro.fr : « Gbagbo s’appuie sur sa communauté de l’Ouest. ADO a la faveur des nordistes. Bédié compte sur la clientèle du centre. Il y a une dimension ethnique évidente dans ce vote ». Malheureusement, une énième crise sur fond de diarchie ouvre le lit à un conflit post-électoral sanglant entre novembre 2010 et avril 2011. L’ethnicisation des violences est, en réalité, le résultat de cette ethno-stratégie développée, de longue date, par les leaders politiques ivoiriens. La belligérance s’est fortement nourrie de ces frustrations ethniques accumulées tout le long des périodes de gouvernance des différents présidents. Toutefois, les raccourcis ethnicistes auxquels sont habitués les leaders doivent se désethniciser pour remettre au goût du jour les bonnes pratiques de l’activité politique.
3. Désethnicisation et retour aux fondements idéologiques et programmatiques des partis politiques
Trois décennies de crises politiques aux effluves ethniques ont mis la Côte d’Ivoire sous la menace d’une véritable guerre ethnicotribale. La désethnicisation du débat politique entendue comme un impératif démocratique (1) peut aider la Côte d’Ivoire à sortir de ce cycle infernal de violences politico-militaires meurtrières. Par ailleurs, les partis politiques doivent pouvoir engager un retour aux fondements idéologiques et aux programmes de sociétés pour une reconstruction du débat politique (2).
3.1. La désethnicisation du débat politique : un impératif démocratique
La désethnicisation désigne le processus au terme duquel un produit, préalablement relié à une ethnie particulière (ou groupe ethnique) en est détaché, afin de pouvoir toucher un maximum de personnes issues de différents groupes. En définitive la désethnicisation va au-delà de la microsociété ethnique. Le projet donc de désethnicisation du débat politique en Côte d’Ivoire pour contribuer à poser les jalons de la démocratie n’est pas irréalisable. Selon E. Kienle (2005, p. 49) :
Historiquement les démocraties établies sont nées de conflits profonds, souvent violents. La démocratie n’est pas le produit de démocrates, mais les démocrates sont le produit de la démocratie. Les exemples de l’Angleterre et de la France, mais également celui de la Suisse, montrent combien la démocratie est tributaire de longs et multiples conflits entre des groupes organisés hostiles, les uns aux autres.
La crise politique qui perdure en Côte d’Ivoire et qui affecte la démocratie, la paix et le développement est l’effet d’une ethnicisation du débat politique. La classe politique ivoirienne a fait le choix libre de l’ethnicisation du débat politique. Cependant, l’exigence démocratique au lendemain du multipartisme recommande beaucoup plus d’efforts en termes d’offres politiques, de programmes de sociétés. La question, désormais posée, n’est pas tant celle de l’ethnicisation de la chose politique. C’est un fait identifié, décrié et traité par plusieurs chercheurs (Dozon 2000 (a) et (b), François Roubaud (2003).
Au terme de toutes les expériences douloureuses qu’a vécues la Côte d’Ivoire, c’est le lieu mais plus fondamentalement, l’occasion d’entamer la désethnicisation du débat politique. Les acteurs politiques doivent opérer ce retour aux fondements mêmes de la démocratie pour espérer relégitimer la politique. Pour D. Gérard (1998) : « la démocratie est avant tout un projet humain et socio-politique, une clé d’interprétation de l’agir humain dans le champ socio-politique ». Les enjeux restent réels, énormes et incontournables pour la Côte d’Ivoire. Il y va de sa survie. Ils commandent donc de renverser toutes les « pensées destructrices » qui ont conduit à la situation actuelle. C’est dans cette optique que l’action de la désethnicisation doit être admise. Et, c’est sans doute, à ce prix que la démocratie, rempart fondamental de la paix et du développement, sera possible en Côte d’Ivoire.
Il faut donc désethniciser le paysage politique, pour favoriser la formation de grands partis, de courants de pensée politique, stabiliser et renforcer l’activité politique. Désethniciser le débat politique c’est aussi crédibiliser la parole politique, assainir le processus électoral, etc. Face aux nouvelles dynamiques politiques (changements des systèmes et mécanismes politiques, modification des politiques représentatives, complexification des enjeux politiques et des électeurs, etc.), il faut nourrir de nouveaux réflexes.
M. Gazibo (2006), L. Creevey, P. Ngoma et R. Vengroff (2005) reviennent sur ces nouvelles dynamiques politiques et affirment que la formation successive des alliances politiques à des fins électoralistes depuis 1995 confirme qu’aucun leader politique ne peut s’appuyer sur son groupe ethnique pour remporter une élection présidentielle et gouverner seul.
Ces deux thèses sont suffisantes pour appeler la classe politique ivoirienne à s’émanciper de ses attributs ethniques. La désethnicisation doit pouvoir éloigner l’activité politique de certaines caractéristiques (ethnie, clan, tribu) pour la ramener à des considérations universelles, essentielles et notamment à des enjeux socioéconomiques et démocratiques. Le processus démocratique amorcé au début des années 1990, à défaut de remplir toutes ses promesses, a laissé entrevoir de réelles possibilités d’appropriation d’idéologies et de propositions de programmes de société. Ce qui prévaut nettement aujourd’hui, c’est le défi démocratique, l’impératif démocratique. Pour réussir ce combat, la classe politique ivoirienne doit s’engager à des développements positifs.
À ce stade, un point essentiel mérite d’être rappelé. Comme il ne peut y avoir de société achevée, il ne saurait être question d’une démocratie achevée. Lucide à cet égard, notre article voudrait que la nouvelle pensée politique ivoirienne fasse son autocritique. La désethnicisation du débat politique est d’abord l’affaire des hommes politiques. Ils doivent se donner pour tâche de contribuer, en adoptant la bonne démarche, à l’établissement d’un espace public cognitif et éthique adossé à des valeurs positives.
3. 2. Retour aux fondements idéologiques et aux programmes de sociétés pour une reconstruction du débat politique
Cette sous-section de notre article nous permet d’insister sur l’impératif de la reconstruction du débat politique en Côte d’Ivoire. Neuf ans après la fin de la sanglante crise postélectorale aux allures ethniques, l’évolution politique de la Côte d’Ivoire ne cesse d’alimenter le débat entre les tenants de deux lectures diamétralement opposées.
Les premiers s’inquiètent d’un glissement progressif du pays vers les vieux réflexes hégémoniques du parti unique sur fond d’ethnocratie et de clientélisme. Leurs arguments s’appuient sur ce qu’ils ont qualifié de politique de « rattrapage ethnique »[11] qui perpétue la division, le repli identitaire, voire religieux. Ils évoquent également le délitement du bloc du RHDP (ex-alliance avec le PDCI-RDA) et la détérioration des relations entre le pouvoir et l’ancien Président de l’Assemblée nationale. Accusé de tentative de coup d’État, recel de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux Soro Guillaume est contraint à l’exil. Candidat déclaré à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, jugé par contumace (28 avril 2020) il a été condamné à 20 ans de prison ferme et privé de ses droits civiques. Les adversaires du pouvoir dénoncent les rapports continuellement tumultueux entre les acteurs politiques (gouvernement et opposition), sans oublier de rappeler un processus de réconciliation nationale au point mort. Ils font valoir que cette situation inquiétante n’est pas exhaustive et soulèvent les divergences qui opposent l’ensemble de la classe politique ivoirienne sur le référendum constitutionnel de 2016 et ses modifications de 2020.Quant à la Commission électorale indépendante (CEI), sa composition est jugée irrecevable par l’opposition et notamment par le PDCI-RDA qui a saisi la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP). Pour finir, les difficultés à trouver un code électoral consensuel et la mésentente sur le financement et la confection des nouvelles cartes d’identité nationale sont autant d’écueils qui troublent la fragile stabilité des dernières années.
Contre cette lecture apocalyptique, les tenants du discours inverse rappellent l’émergence d’une Côte d’Ivoire stable, en pleine croissance économique et réhabilitée sur l’échiquier international. Ils mettent surtout l’accent sur la mise en place de nouvelles institutions politiques structurées et représentatives . Ces signaux hautement positifs, amorcés depuis avril 2011, et que présente le régime ivoirien, ne sauraient pourtant définitivement départager les optimistes et les pessimistes. En effet, et pour l’instant, les efforts de reconstruction du pays sont perçus de manières bien divergentes par les Ivoiriens. Si les uns les acceptent et les saluent, les autres les rejettent, pendant que certains restent ambigus ou indécis. La rue ivoirienne a même accouché d’une célèbre « punchline » méprisante en ces termes : « On ne mange pas ponts et goudron » (F. Akindès, 2017).
Pendant ce temps, la question de l’avenir politique de la Côte d’Ivoire reste toujours posée. Elle reste posée par rapport aux réappropriations des vieux péchés héréditaires des régimes successifs. Dans ce contexte, après l’invitation à la désethnicisation du discours politique, il s’agit à présent de proposer une reconstruction de l’activité politique à la lumière des attentes socio démocratiques. En Côte d’Ivoire comme dans la plupart des pays de la sous-région, il y a très objectivement, un manque de points de vue idéologiques alternatifs de la part des partis auxquels la population peut s’identifier comme le disent S. Adejumobi et M. Kehinde (2007, p. 111). Or le débat politique ne gagne en consistance que s’il se répercute sur d’autres domaines comme l’économie, la reconstruction d’infrastructures, l’amélioration du social, la santé, l’éducation, etc. La désethnicisation souhaitée de l’activité politique ne doit donc pas se résumer, en aucun cas, en un simple processus tel que défini plus haut. Le recours aux critères fondamentaux de la démocratie et de la vie des partis politiques participe au changement de l’atmosphère sociopolitique, à l’enrichissement du débat et à la crédibilisation de la politique. A. Dieth (2020) s’interrogeait à juste titre : entre le PDCI RDA, le RDR, l’UDPCI, le MFA, le LIDER et le FPI pour ne citer qu’eux, qui est conservateur ? Qui est libéral ? Qui est socialiste ? Qui est d’extrême droite et d’extrême gauche ? Quels sont les intérêts, les idéologies et les projets de société respectifs qu’ils incarnent ? »
Le débat politique partisan qui devrait concerner certaines valeurs, les projets de société, les visions du monde, manquent cruellement en Côte d’Ivoire.
Au-delà même du cas ivoirien, plusieurs auteurs ont moqué les partis politiques africains de se détourner des questions essentielles et de se focaliser exclusivement sur d’égoïstes sujets politiciens qui ne mobilisent que passions et violences. Parlant des partis politiques maliens E. Le Roy (1992) affirmait qu’ils étaient dépourvus de tout projet de société au début des années 1990. J.-P. Daloz (1992) abonde dans le même sens arguant que :
Les députés béninois constituaient en 1991 une nébuleuse de micro-formations à bases largement ethniques (…) sans programmes véritables, et qui s’alignent plus ou moins derrière quelques grands patrons d’envergure nationale, fortement pourvus en ressources, au gré de leurs intérêts immédiats.
L’amorce de la désethnicisation du débat politique pourrait inévitablement changer la donne. En effet, une fois déshabillés de leur encombrant fardeau, les partis politiques ivoiriens doivent s’approprier un débat sain, vivant, animé par la confrontation des idées et des programmes de sociétés.
Ce retour aux fondements idéologiques arrosés d’intenses et révolutionnaires programmes de société est un cheminement inévitable pour aborder la chose politique telle que requise par la démocratie constitutionnelle pluraliste avec réalisme et lucidité. C’est aussi à ce prix que la classe politique ivoirienne se réconciliera avec elle-même, avec le peuple ivoirien, et se rendre crédible.
Conclusion
« Historiquement les démocraties établies sont nées de conflits profonds, souvent violents ». (E. Kienle, Op. cit., p. 49). Cette pensée de E. Kienle traduit, à elle seule, la complexité des progrès humains et le long cheminement des États vers un consensus politique démocratique, gage de stabilité, de paix et de développement. En Côte d’Ivoire, personne ne doute, à présent, de la puissance du discours politique dans son élévation ainsi que dans son avilissement. La longue traversée du désert de ce pays anciennement stable a été, pour beaucoup, provoquée par l’ethnicisation du débat politique.
Durant ces trois dernières décennies, et avant tout, le débat politique ivoirien s’est situé précisément au niveau du partage du pouvoir. Dans un tel contexte sociétal vidé de tout projet collectif et d’idées novatrices, la classe politique ivoirienne ne pouvait que favoriser la lente mais inévitable décomposition de ce pays. De manière plus générale, les différents pouvoirs qui se sont succédé à la tête de l’État ivoirien ont expérimenté des politiques basées sur des approches ethniques, clientélistes. Ces pratiques dont l’ethnicisation semble être l’un des levains incontournables ont remis en cause la belle harmonie de la mosaïque ivoirienne à dominance multiethnique. Loin d’annoncer la fin du politique ou son évacuation de l’espace public par les citoyens, la nouvelle offre exige sa désethnicisation au profit de sa qualification.
En effet, les obstacles les plus importants à la recherche d’un consensus minimal ne se situent pas en réalité au niveau des populations ivoiriennes, mais plutôt des appareils politiques. Y. Boisvert (2001, p. 181) traduit éloquemment la situation ivoirienne : « l’imaginaire politique est notamment caractérisé par un profond désabusement chez les individus à l’égard de la politique, au fonctionnement de laquelle les citoyens se sentent de plus en plus étrangers ».
Comme nous l’avons dit plus haut, au-delà du principe et du degré de l’ethnicisation du débat politique, la question essentielle doit porter sur l’avenir de la Côte d’Ivoire.
Est-il encore nécessaire d’écrire que les successives crises sociopolitiques meurtrières condamnent les leaders politiques à se remettre en question, à remodeler, à reconstruire le débat politique en fonction des réalités du moment et des aspirations profondes des populations? Pour A. Bernard (1993, p. 27) : « L’État contemporain, démocratiquement fondé, trouve la légitimité de son pouvoir dans le support qu’il reçoit de ses concitoyens ».
Le débat politique doit arpenter les chemins idéologiques, les courants de pensée et accoucher de programmes de sociétés dignes pour éviter le scepticisme illimité des masses. L’abandon des doctrines ethnocratique et clientéliste pourrait, sans doute, faciliter cette exigence démocratique. Et l’un des fondamentaux infaillibles du nouveau deal politique reste la priorisation de la chose commune au détriment des intérêts personnels et partisans. L’ethnicisation doit céder sous le poids de la désethnicisation qui, elle-même, ouvre la voie à la transformation positive du débat politique. Mais les exigences démocratiques ne doivent pas s’arrêter là. Comme le suggère Y. Boisvert (Op. cit., p. 182) :
Il y a également un réel désir de voir la société civile, et certaines de ses composantes, accroître leurs rôles politiques. Cela entraîne une pression supplémentaire sur l’État afin qu’il réduise son influence sur la gestion de la destinée de la communauté. Cette nouvelle culture de la démocratie qui se profile aujourd’hui commande donc qu’il y ait un rapatriement maximal des pouvoirs politiques au sein de la communauté.
Le débat politique est appelé à transcender les anciens clivages ethniques et les vieux affrontements. La désethnicisation corrélative du débat politique et le retour aux fondements idéologiques et programmatiques des partis sont des impératifs en faveur de la démocratie, du développement solidaire et de la paix durable.
Références bibliographiques
ADEJUMOBI Saheed Yinka ; KEHINDE Michael, 2007, « Construire la démocratie sans démocrates? Partis politiques et menaces de renversement démocratique au Nigéria », Journal of African Elections , Vol. 6, n° 2, p. 95-114.
AKINDES Francis, 2017, « On ne mange pas les ponts et le goudron : les sentiers sinueux d’une sortie de crise en Côte d’Ivoire », Paris, Politique africaine, vol. 148, n° 4, p. 5-26.
AMNESTY International, 2011, Rapport N°AFR 31/002/2011, « Côte d’Ivoire. : ʺIls ont regardé sa carte d’identité et l’ont abattuʺ. Retour sur six mois de violences post-électorales en Côte d’Ivoire », mis en ligne le 25 mai, disponible sur www.amnesty.org, consulté le 30 avril 2020.
AMSELLE Jean-Loup, 1992, «La corruption et le clientélisme au Mali et en Europe de l’Est : Quelques points de comparaison », Paris, Cahiers d’études africaines, Vol. 32 n°128, p. 629-642
ANDRÉ Bernard, 1993, Problèmes politiques Canada et Québec, Sainte-Foy Québec, Presses de l’Université du Québec (PUQ).
BABO Alfred, DROZ Yvan, 2008, « Conflits fonciers. De l’ethnie à la nation. Rapports interethniques et ʺivoiritéʺ dans le sud-ouest de la Côte-d’Ivoire », Cahiers d’études africaines, n° 192, Varia, p. 741-764.
BAHI Aghi, 2013, L’Ivoirité mouvementée, Jeunes, Médias et Politique en Côte d’Ivoire, Oxford, African Books Collective.
BAILLY Diégou, 1995, La réinstauration du multipartisme en Côte d’Ivoire ou la double mort d’Houphouët-Boigny, Paris, L’Harmattan.
BOA Thiémélé Ramsès, 2009, Ivoirité, Identité culturelle et intégration africaine : logique de dédramatisation d’un concept, Synergies, Afrique Centrale et de l’Ouest, n° 3, p. 75-83.
BOISVERT Yves, 2001, « Quand l’éthique regarde le politique », Paris, Politique et Sociétés, Vol 20, n°2-3, p. 181-201.
BRIQUET Jean-Louis, 1995, «Les pratiques politiques ʺofficieusesʺ, Clientélisme et dualisme politique en Corse et en Italie du Sud», Paris, Genèses, n° 20, p. 73-94.
CONSTITUTION de la République de Côte d’Ivoire, 1960.
CONSTITUTION de la République de Côte d’Ivoire,1963
CREEVY Lucy et al, 2005, « La politique des partis et les différentes voies vers les transitions démocratiques: une comparaison entre le Bénin et le Sénégal », Party Politics, vol. 11, no 4, p. 471-493.
DIETH Alexis, 2013, « Les partis politiques africains ont-ils des projets de société ? », Médiapart Le Club, mis en ligne le 6 Février, disponible sur www.mediapart.fr , consulté le 14 mai 2020.
DORNA Alexandre, GEORGET Patrice, 2007, « Quand le contexte surdétermine le discours politique », Le Journal des psychologues, vol. 247, no. 4, p. 23-28.
DOZON Jean-Pierre, 2000, « La Côte d’Ivoire au péril de l’ʺivoiritéʺ. Genèse d’un coup d’Etat », Paris, Afrique contemporaine, n°193, janvier-mars, p. 13-23.
DOZON Jean-Pierre, 2000, « La Côte d’Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethnonationalisme », Paris, Politique africaine, vol. 78, n°2, juin, p. 45-62.
GAHA-BI Loukou et al, 2012, Côte d’Ivoire : le rattrapage ethnique sous Alassane Ouattara : fondements, pratiques et conséquences, Paris, L’Harmattan.
GAZIBO Mamadou, 2006, « Pour une réhabilitation de l’analyse des partis politiques », Paris, Politique Africaine, n°104, avril, p. 5 à 17.
GÉRARD David, 1998, La démocratie. Mémoire et perspectives d’un projet politique, Paris, Éditions du temps.
GOLLI Théodore, 2019, « Côte d’Ivoire : une illusion de stabilité », Contribution Paix et Sécurité », mis en ligne le 24 Avril, disponible sur www.wathi.org, consulté le 28 avril 2020.
HAZELL Robert, 2008, Constitutional futures revisited: Britain’s Constitution to 2020, New York, Palgrave Macmillan.
HEINICH Nathalie, 2007, Pourquoi Bourdieu, Paris, Gallimard.
KIENLE Eberhard, 2005, « Entre dangers et promesses : la reconstruction politique de l’Irak », Paris, Les Champs de Mars, vol. 17, n°1 ; p. 37-52.
KONÉ Fahiraman Rodrigue, 2011, « Les racines ethniques de la crise ivoirienne », Propoli, n°6-7, juin-juillet, p. 44-46.
KONÉ Seydou alias Alpha Blondy,1996, « Course au pouvoir », Grand Bassam Zion Rock, Wagram Music/Test.
KONÉ Seydou alias Alpha Blondy, 1998, « Guerre civile », Yitzhak Rabin, Kingston, Une Musique.
LAZARSFELD Paul Félix et al, 1994, The people’s choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, New-York, Columbia University Press.
MAYER Nonna, 2007, « Qui vote pour qui et pourquoi ? Les modèles explicatifs du choix électoral », in Pouvoirs, n° 120/01/, p. 17-27.
REBOUL Olivier, 1980, Langage et idéologie, Paris, PUF.
ROUBAUD François, 2003, La crise vue d’en bas à Abidjan : ethnicité, gouvernance et démocratie, Paris, in Jacquet P. (ed.), Afrique contemporaine, N°206, p. 57-86.
SIB Harkité Hyppolyte, 2015, Ethnicité et Pouvoir Politique en Côte d’Ivoire, Mémoire Master II, Université Générale Lansana Conte/Conakry.
SODJINÉ Agbodjan-Prince, 2012, L’ethnie dans le fonctionnement des partis politiques au Togo. Cas du CAR, de l’ex-RPT et de l’UFC, Maîtrise ès-lettres et sciences humaines , Université de Lomé.
SOUARÉ Issaka Konaté, 2017, « Les partis politiques de l’opposition en Afrique : La quête du pouvoir. Nouvelle édition », mis en ligne en 2017, Montréal, Presses de l’Université de Montréal (PUM), disponible sur www.books.openedition.org , consulté le 14 Mai 2020.
STREIFF-FENART Jocelyne , POUTIGNAT Philippe, 1995, Théories de l’ethnicité, Paris, Presses Universitaires Françaises (PUF).
VALSECCHI Pierluigi, VITI Fabio (dir.), 1999, Mondes akan. Identité et pouvoir en Afrique occidentale, Paris, L’Harmattan.
L’ÉCRITURE ENGAGÉE DANS TOUT GRAND VENT EST UN OURAGAN DE CHARLES NOKAN : POUR UNE ANALYSE STYLISTIQUE ET RHÉTORIQUE DES PASSIONS
Ernest AKPANGNI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Cette étude se propose de traiter de la stylistique et de la rhétorique des passions de l’écriture engagée de Charles Nokan. Si la rhétorique des passions connaît ses contours théoriques et pratiques balisés, c’est le contraire de la stylistique des passions qui, elle, cherche ses voies d’existence afin de remplir pleinement les phases épistémologique et technique dans le fonctionnement du langage. C’est à cet exercice que nous nous soumettons pour mener une analyse expérimentale de la stylistique des passions en vue de décrypter le texte littéraire. Cette analyse heuristique conduit à identifier les faits passionnels, les affects stylistiquement avérés, corrélés à la rhétorique des passions qui, elle aussi, laisse prospérer les affects. Ce qui permet, à terme, de proposer une démarche stylistique des passions. Cette étude s’inscrit dans une perspective stylistique et rhétorique et fonde en théorie comme en pratique une stylistique des passions. Les outils passionnels d’analyse justifient l’écriture engagée de Charles Nokan qui lutte contre l’injustice, l’inégalité et les conflits pour une société de paix.
Mots clés : ethos, passion, pathos, rhétorique des passions, stylistique des passions.
Abstract :
This study intends to deal with the stylistics and rhetoric passions of committed writing by Charles Nokan. If the rhetoric of the passions knows its theoretical and practical outlines marked out, it is the opposite of the stylistics of the passions which, it, seeks its ways of existence in order to fully fill the epistemological and technical phases in the functioning of language. It is this exercise that we submit ourselves to conduct an experimental analysis of the stylistics of the passions in order to decipher the literary text. This heuristic analysis leads to identifying the passionate facts, the stylistically proven affects, correlated to the rhetoric of the passions which also allows the affects to flourish. This allows, ultimately, to offer a stylistic approach to passions. This study is part of a stylistic and rhetorical perspective and founds in theory as in practice a stylistics of the passions. The passionate tools of analysis justify the committed writing of Charles Nokan who fights against injustice, inequality and conflicts for a peaceful society.
Keywords: ethos, passion, pathos, rhetoric of passions, stylistics of passions.
Introduction
À ses origines, le concept de passion était, d’abord, utilisé par la religion chrétienne pour désigner le supplice de Jésus-Christ. Ensuite, sa connotation péjorative dans l’Antiquité lui fait prendre, avec Platon, le sens des désirs et des pulsions avant d’être opposée à la raison par Zénon de Cittium et Emmanuel Kant. Enfin, il se rattache à la rhétorique pour être repris par la sémiotique et irradier la plupart des disciplines des sciences humaines. systématisées par Aristote (1991, p. 19) à travers les quatorze passions « la colère, le calme, l’amitié, la haine, la crainte, la méfiance, la honte, l’impudence, l’obligeance, la pitié, l’indignation, l’envie, l’émulation et le mépris », les passions intéressent les écuries des sciences humaines. Les théories et méthodes des passions en stylistique ne sont pas encore délimitées. C’est pourquoi, ce sujet constitue des prolégomènes à une telle étude. La porosité des disciplines des sciences du langage admet des ouvertures dont celle relative à la rhétorique tout en prospectant la posture concernant les passions en stylistique. La formulation, « pour une stylistique des passions », rend mieux l’idée de prolégomènes à une systématisation des passions en stylistique. Ainsi, tout le matériau stylistique puisé de l’intratexte participe à la manifestation de la littérarité. Or, les passions qui peuvent relever de l’ethos discursif comme du pathos sont indéniablement inscrites au cœur de la matrice textuelle. Il reste évident qu’une esquisse théorique et pratique de la stylistique des passions est innovante. Mais elle ne se désolidarise pas de la vocation de la stylistique littéraire qui décrypte le fonctionnement du langage. De fait, la rhétorique des passions prospère dans le domaine des affects tout comme la stylistique valorise les affects. C’est, au demeurant, ce qui motive le sujet suivant : « L’écriture engagée dans Tout grand vent est un ouragan de Charles Nokan : pour une analyse stylistique et rhétorique des passions ». Comment les passions rendent-elles compte de l’engagement dans le fonctionnement des procédés rhétorique et stylistique ? Quels pourraient-être les enjeux stylistiques littéraires des passions ? L’investissement stylistique des passions et le fonctionnement de la rhétorique des passions comme hypothèse formulée sont caractéristiques des approches méthodologiques suivantes : la rhétorique des passions se construit à travers des dispositifs passionnels liés au pathos et à l’ethos de l’orateur et de l’auditoire, la configuration des sentiments. La stylistique structurale s’appuie sur des indices linguistiques pour analyser les passions issues du fonctionnement structural aux effets de sens indéniables. Elle débouche sur la stylistique herméneutique, porteuse de sens socioculturel et historique. La démarche de la présente réflexion vise une approche théorique des passions pour glisser vers la pratique textuelle afin de parvenir à son traitement dans le dispositif rhétorique pour proposer son fonctionnement stylistique révélateur de faits passionnels.
1. Considérations théoriques des passions
Les conceptions théoriques des passions ont évolué au fil des siècles pour s’incruster dans la rhétorique afin de consteller la majorité des disciplines des sciences du langage. Après la rhétorique des passions, la sémiotique se fait l’écho de ce concept. Bien qu’ayant plusieurs tendances, elle s’est orientée au début des années 80, sous la houlette d’Algirdas Julien Greimas, vers l’étude des états d’âme, des passions. Les conséquences d’une telle démarche sont liées à l’insuffisance des structures actionnelles pour l’analyse de tout discours. Contrairement à la rhétorique et à la sémiotique qui privilégient les passions comme un objet d’étude, la stylistique, jusque-là, n’en a pas encore infléchi véritablement sa démarche vers un tel outil. L’aspect thymique de la substance du contenu survolé par Georges Molinié reste néanmoins une piste. Il est donc possible d’envisager une stylistique des passions en corrélant la stylistique à la rhétorique pour exploiter les dimensions pathémique et tensive scrutant les faits émotionnel et affectif. Cela implique que toute stylisation individuée soit synonyme d’affectivité de l’expression.
1.1. Théorisation des passions en rhétorique
Les passions, en grec, s’appréhendent comme ce qui arrive brusquement en lien avec la souffrance. Cette perception lexicale est d’ailleurs à la racine du mot passion. Passion dérive du verbe patior qui signifie souffrir, éprouver, endurer… et du substantif passio entendu comme la maladie ayant pour conséquences un état de souffrance et de dépendance. Dans son rapport aux passions, la rhétorique comme l’art et la technique de persuader par la parole revêt, pour d’Aristote, une importance capitale. Sa dimension persuasive valorise trois arguments (logos-ethos-pathos). Le logos renvoie aux moyens langagiers qui participent d’un discours persuasif qui tisse des formes de rationalité du discours. Ses composantes formelles sont référées à l’analogie, aux enthymèmes, aux syllogismes et à la logique des valeurs. Quant à l’ethos, il introduit dans les structures intralinguistiques l’image de soi. Il peut être prédiscursif comme discursif. Il trouve sa manifestation dans les discours délibératif, judiciaire et épidictique. Le pathos a une visée argumentative. C’est la part d’émotivité et d’affectivité qui se déploie dans le discours. Il prend forme dans l’expression des affects et influence le récepteur par sa persuasion. À cet effet, Meyer Michel (2008, p. 20) affirme : « la rhétorique réside dans l’égalité accordée pour une fois à des preuves techniques d’Aristote que sont l’ethos, le logos et le pathos et qui ont la même importance.» De même, les arguments émanant de l’ethos et du pathos sont dignes d’intérêt pour la rhétorique des passions. Aristote envisage le pathos plus ou moins comme une qualité agréable. Au sujet de la rhétorique des passions, Gisèle-Mathieu Castellani indique :
La passion dont traite la rhétorique est cette aptitude qu’a l’être humain pour son bonheur comme pour son malheur d’être patible ou passible de recevoir (…) quelques influences propres à le modifier, à changer son état subitement (Castellani G., 2000 p. 50). En d’autres termes, la rhétorique se charge d’émouvoir par le plaisir qu’elle suscite à la réception et qui fait d’elle « une entreprise de séduction. » (Castellani G., 2000 pp. 225)
La variation des jugements et des affects s’inscrit dans les travaux de Condillac que cite Karabétien E. (2000, p. 24) : « La rhétorique est d’ordre affectif et abolit le privilège accordé à certaines formes linguistiques. » De même, Les théoriciens de la nouvelle rhétorique dont Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tytecas, Olivier Reboul, Michel Meyer envisagent les passions au regard des trois arguments pour une visée affectivo-émotionnelle. Dans cette perspective, O.Reboul, (1998, p. 60) définissant le pathos, affirme : « C’est l’ensemble des émotions, passions et sentiments que l’orateur doit susciter dans son auditoire grâce à son discours. » Cette pensée accorde le prisme aux affectivités et émotivités issues des passions.
1.2. La sémiotique des passions
La sémiotique des passions, encore appelée sémiotique tensive, dérive de la théorie sémiotique. Elle est « issue des hypothèses théoriques et méthodologiques de la sémiotique générale » (D. Bertrand, 2000, p. 225). Algirdas Julien Greimas explore les passions en accordant le primat aux lexèmes sous l’angle discursif et narratif. Les passions étant synonyme d’actions même si elles se subissent, elles doivent rendre compte des composantes sensible et somatique. Jacques Fontanille renforce l’idée d’Algirdas Julien Greimas en faisant des passions un langage qui s’exprime aux moyens des états affectifs qui interagissent dans le discours littéraire. C’est la raison pour laquelle J. Fontanille (1999, p. 64) écrit : « tel état affectif de l’auteur expliquerait telles formes ou situations dans le texte. » Il soutient que les passions devraient obéir à un principe théorique afin de produire des textes susceptibles d’éclairer le sens. Pour cette raison, L. Ibo (2001, p. 2), fixe le fait objectal de la sémiotique des passions sur « la description et l’analyse dans un texte, un discours ou dans les différents langages, des phénomènes passionnels qui se manifestent par l’activité sensible du sujet percevant, sentant ou ressentant. » Autrement dit, la pratique textuelle appelle nécessairement des procédés d’analyse qui décryptent les faits passionnels.
1.3. Vers une stylistique des passions
Une stylistique des passions est envisageable, pourvu que le traitement discursif se réalise par les outils stylistiques porteurs de littérarité. Nous émettons le postulat qu’aussi bien les postes que les instruments d’analyse stylistiques participent de l’émergence d’une stylistique des passions. Ce qui sous-tendrait que leurs grilles heuristiques permettent de scruter des relents émotionnels et des investissements affectifs dans le phénomène langagier. C’est pourquoi, une coloration du lexique, de la caractérisation, du système figuré, de l’énonciation empreints de subjectivité et d’affectivité intéressent de près la stylistique. De même, les questions de marquages, de contremarquage, de surdétermination et de surcaractérisation ne peuvent qu’intéresser la stylistique à condition qu’elles aient des traces tensives. Là où les affects, abondent, le sentiment domine. De ce fait, autant l’affectivité que le sentiment émanent de l’émotion qui transparaît éminemment dans l’analyse stylistique. La stylistique, par le caractère spécifique du langage, reste attentive à l’âme de l’auteur, aux faits individués. Dès lors, une analyse stylistique des passions est possible à condition que les faits stylistiques issus du texte révèlent une émotivité et une affectivité. Ces marqueurs affectifs et subjectifs générées par les structures langagières doivent prospérer en stylistique des passions.
De même, l’analyse stylistique se sert également du thymique, l’une des trois composantes de la substance du contenu évoquée par G. Molinié (2005, p. 109). À cet effet, il indique : « La sous-composante thymique, c’est le pulsionnel, l’affectif, le sentimental : la part des sens, depuis le sensible et le sensuel jusqu’au raffinement du cœur […] » Les sémèmes affectif, sentimental et pulsionnel constituent le socle des spasmes du moi. La stylistique ne peut que se focaliser sur ses procédés linguistiques pour rendre compte de l’affectivité dans le discours littéraire.
De ce qui précède, les passions bénéficient d’une approche transversale qui les inscrit au cœur des préoccupations de la rhétorique, de la sémiotique et de la stylistique. Les jugements et les affects, les trois arguments (ethos-logos-pathos), les postes d’analyse et le thymique les traversent de fond en comble.
2. Traitement des passions dans le dispositif rhétorique
Le traitement des passions dans le dispositif rhétorique exploite respectivement l’ethos du personnage de l’orateur-voyant, l’ethos du personnage-justicier et le pathos d’amour/haine. L’exploration de l’ethos et du pathos permet d’examiner la part d’émotion qui colore l’ethos discursif, et le pathos par l’image préalable pour montrer la diversité des passions. G.-M. Castellani, (2000, p. 58) apporte une précision à cet effet : « j’appelle passion, le désir, la colère, la peur, la témérité, l’envie, la joie, l’amitié, la haine, le regret, l’émulation, la pitié, en un mot tout ce qui s’accompagne de plaisir ou de peine » A terme, ce dispositif rhétorique donnera la preuve de l’émergence d’affectivité et d’émotivité dans le fonctionnement de ces types d’argument.
2.1. L’ethos du personnage orateur-voyant
Tout comme le concept de « poète-voyant » qui induit que celui-ci ait le sens prophétique et magique, l’on peut parler également du personnage orateur-voyant. J. L. Joubert (1998, p. 20) écrit donc que le poète est « un mage, un prophète, un voyant […] Il est celui qui a accès à un monde autre. » Toujours selon ce théoricien, un mythe idéaliste du poète se constitue et explore les éthers pour des révélations vertigineuses. Le personnage orateur-voyant, ayant les mêmes fonctions que le poète-voyant se fait le porte-voix d’une parole d’invocation avec le sens aigu de la voyance. Pour Amossy Ruth (2009, p. 70), « L’ethos est l’image de soi que l’orateur projette dans son discours pour contribuer à l’efficacité de son dire. » Son traitement implique certains procédés langagiers dont l’imprécation des spasmes de l’ethos, du moi en tant qu’émanation de la subjectivation ; expression de la singularité de l’écriture. Voici un exemple qui participe de l’ethos du personnage orateur-voyant :
(…) Aussi Nci et ses camarades constituèrent-ils un comité qui avait à discuter avec le gouvernement et les rebelles. Ce comité dirigé par Nci, qui voulait dissiper les nuages de l’horizon, et éclairer l’avenir proche, commença donc la discussion avec les deux parties en conflit. (p. 29)
L’analyse de ce fragment textuel se réalise moins par les subjectivèmes, outils intégratifs de l’ethos que par le matériau verbal lexicalisé, preuve de la singularité scripturale. Dans le préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO, il est écrit « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent élevées les défenses de la paix »[12]. Mieux, si c’est dans l’esprit des hommes que naissent les guerres, c’est aussi dans leurs esprits que des pistes de règlement pacifiques sont conçues. Nci, l’un des personnages principaux de l’œuvre a vite perçu cet enjeu. C’est pourquoi, il permet à son pays de recouvrer la paix, la stabilité politique et économique entamées par les frictions sociales occasionnées par la guerre. En se posant comme personnage orateur-voyant au même titre que le poète-voyant, il a un regard prospectif qui anticipe sur le chaos dans lequel le pays devrait être plongé. Le syntagme verbal « constituèrent un comité » est formé du verbe « constituèrent » au passé simple, temps du récit et d’un syntagme nominal « un comité ». Le verbe « constituer » renferme le lexique d’une situation illégalement établie que Nci veut reconstituer et rétablir. Ce qui atteste un début d’union qui irradie positivement les pourparlers. Le syntagme nominal « un comité » assure une fonction de complément d’objet direct sans se désolidariser de cet élan de communion au sein des fils du même pays. Il impacte donc la formation d’un groupe d’individus pour mener les discussions entre les protagonistes de la crise. De même, le syntagme verbal « voulait dissiper les nuages de l’horizon, et éclairer l’avenir proche » montre cet ethos de romancier-voyant en rendant plausible le message de Nci. Ici, deux syntagmes nominaux lexicalisés par « l’horizon » et « l’avenir » confirmrent la voyance et l’action prophétique de Nci. L’espace visible étendu qu’est l’horizon devient brumeux du fait de la guerre qui l’assombrit. Cependant, la vision prospectiviste de Nci lui accorde toute la visibilité grâce à sa volition de « dissiper les nuages ». Il parvient, par son action prophétique, à une atmosphère de convivialité dialectisant du coup, avec celle maussade de guerre. La lexie « avenir » comme « l’horizon » confirme une fois encore la voyance de ce personnage. À ce niveau, le romancier orateur-voyant s’apprécie par son approche futuriste, sa prospection et son sens de l’anticipation pour éviter que le pays sombre dans le chaos. La lumière qui chasse l’obscurité est traduite textuellement par l’infinitif « éclairer » qui évoque l’idée d’illumination. Celle-ci est un hymne à l’espoir et à l’espérance pour un lendemain radieux.
2.2. L’ethos du personnage justicier
La figure du justicier dans certaines œuvres littéraires est attribuée aux personnages épris de justice et de paix. Ceux-ci consacrent leur vie à lutter contre les injustices subies par certaines franges sociales. Exaspéré et débité par les traitements inhumains infligés aux plus faibles de la société, le personnage justicier s’investit corps et âme pour le règne de la justice. Cette exemplification donne à voir la figure du personnage justicier :
Nci pensait que l’exploitation de certaines personnes par d’autres, l’injustice, l’inégalité ne cesseront qu’après que la révolution aura eu lieu. Malgré cela, lui n’était pas capable de tuer quelqu’un. Voilà pourquoi, il cultive le dialogue, la tolérance, le pardon.
Le drame de Nci, c’était d’aimer profondément ses semblables. Il s’abstenait de blesser une personne, de nuire à autrui. Il voulait voir régner la justice, la solidarité, l’honnêteté, la fraternité, l’amitié, la camaraderie alors que les êtres humains sont généralement méchants, égoïstes… (p. 70).
Nci est porteur d’un idéal de vie qui renforce la cohésion sociale et la paix dépouillées de toute animosité. Le fait qu’il prône les valeurs sociales lui donne une dimension humaniste révélatrice du personnage justicier. Aux antipodes des brimades et des injustices, il s’irrite contre « l’exploitation de certaines personnes par d’autres ». Par la maltraitance, l’assujettissement et la chosification qui sont issus de la lexie « exploitation », il désavoue savamment la barbarie et la cruauté des tortionnaires qui briment leurs semblables. C’est pourquoi, il prend fait et cause pour les personnes bestialisées soumises aux pratiques déshumanisantes et avilissantes. Il invalide les contre-valeurs d’« injustice » et d’ « inégalité » contrastant avec les valeurs de justice et d’égalité qu’il prône et valorise. Celles-ci sont sources d’équité et de conformité aux normes et exigences légales de la société. Incapable de nuire à autrui, toutes ses actions de hautes portées humanistes sont dénuées d’attitude vindicative et punitive. Il donne la preuve à travers cette phrase : « Malgré cela, lui n’était pas capable de tuer quelqu’un ». Nonobstant les antivaleurs d’injustice, d’inégalité et d’inhumanité, Il est incapable d’attenter à la vie d’autrui. Dévoué à la défense des sans voix, il favorise le dialogue, son objectif étant de réconcilier le gouvernant et les rebelles de NFIWA, onomastique diégétique et imaginaire qui signifie « je suis d’ici » en langue Agni et Baoulé ; deux groupes Akan constitués vivant en Côte d’Ivoire. Nci et ses amis placent les discussions sous le sceau de la « tolérance » nourrie de concessions et de compromis mutuels acceptés par les belligérants. Inutile dans cet élan d’omettre « le pardon » fait d’indulgence qui couronne le processus de pacification du pays de NFIWA. Contrairement aux personnages cyniques comme les rebelles qui profitent de la vulnérabilité des petites gens, Nci, par son ethos de personnage justicier, dresse l’autel du salut d’où la coupe de la tolérance, de la justice servie, déborde. A cette table, seuls les partisans de l’amour pour le prochain, comme Nci et ses amis qui savent si bien le prôner y prennent une part active. Les premières entités intégratives du dispositif rhétorique valorisent les passions par les ethè des personnages orateur-voyant et orateur-justicier. La manipulation technique a prisé globalement le matériau langagier et l’orateur par la singularité de l’écriture. La seconde attribution du dispositif rhétorique porte sur le pathos de haine/d’amour.
2.3. Pathos de haine /d’amour
Le pathos d’amour couplé de haine, du pôle de l’auditoire, est marqué par l’expression des désirs forts. Par cet intitulé, le pathos argumente la charge émotionnelle et sentimentale. Il se traduit par des procédés langagiers fondés sur des effets-valeurs variant de l’euphorique au dysphorique. La passion examine une double tendance variant de la haine à l’amour et inversement. L’analyse des outils intralinguistiques qui, de fort belle manière, figurent cette dialectique sentimentale de l’amour/haine se fait à partir de l’extrait ci-après :
Les rebelles saisirent le cou du droit, l’étranglèrent, finirent par l’égorger… Seule la fin de la salle guerre, suivie de l’instauration d’une démocratie populaire, le ressuscitera. Tant que l’être humain ne s’agrippera qu’à ses intérêts égocentriques, tant qu’il ne cherchera qu’à exploiter son semblable, il y aura des conflits, des misères, des souffrances. Exploiter = frustrations = conflits, misères et souffrances
O guerre, ignoble antithèse de la paix ! La nuit qui occupait le monde était épaisse et très longue. Mais bientôt éclora une nouvelle clarté. Alors l’Afrique comme l’Europe aura sa renaissance. Le ciel de l’avenir, tel celui d’aujourd’hui, sera de temps en temps couvert de nuages. Mais un soleil brillera et les extirpera dès leur épanouissement. (p. 70-71)
Le pathos de haine et d’amour se construit sous une caractéristique de dialectisation se déclinant en guerre et en paix. Sous le terme générique de guerre comme acte de violence qui afflige et désole, la lexie « guerre » admet des traits sémiques tels que : conflits + misères + souffrances + nuit + exploiter. La lexie paix, elle, comporte les sèmes : clarté + éclosion + soleil + brille + renaissance. Deux isotopies contrastantes permettent de cerner les véritables motivations d’une telle atmosphère. D’ailleurs, l’isotopie s’appréhende du point de vue de A. J. Greimas et J. Courtès (1979, p. 197) comme l’itérativité, c’est-à-dire « la chaîne syntagmatique de classèmes qui assurent au discours-énoncé son homogénéité » par « la récurrence de catégories sémiques ou figuratives » (A. J. Greimas et J. Courtès, 1979, p. 198). Ces définitions sont renforcées par celle de (Rastier F., 1973, p. 54) pour qui l’isotopie est « constituée par la redondance d’unités linguistiques, manifestes ou non, du plan de l’expression et du contenu.» Grâce aux occurrences lexématiques, les deux isotopies dialectisent la posture des deux protagonistes. D’un côté, des rebelles qui luttent pour rétablir un ordre par la haine et la guerre. De l’autre, le gouvernement qui dit gouverner équitablement. D’un autre côté encore, la médiation conduite par Nci et ses camarades. Malgré la guerre, les sentiments de haine et de frustration, la discussion doit être privilégiée car la guerre exacerbe les « misères », paupérisent et précarisent les individus et les plonge dans des « conflits » interminables. Ils sont contraints dans la souffrance aigue recouvrant la société entière d’une couche épaisse d’obscurantisme d’où la « nuit » qui est synonyme de cessation d’activité, de chaos et de mort. La guerre s’oppose à la paix en tant qu’espérance de vie qui apaise. Elle évoque la « clarté », antithèse de la « nuit » qui donne à voir par la cohésion sociale de meilleures conditions de vie. D’où la « renaissance » qui phagocyte l’espérance de tout ce que la guerre a asséché en vue d’un « avenir » meilleur et radieux où le « soleil » tout illuminant « brillera » permanemment pour tous. Du pathos de haine générant la guerre se succède le pathos d’amour synonyme de paix, de quiétude. Ces deux tendances émotionnelles et sentimentales varient de l’affectivité dysphorique à l’affectivité euphorique. Cependant, la paix doit être privilégiée au détriment de la guerre qui est source de cohésion sociale, de développement durable. C’est ce défi que Nci et ses amis ont relevé en conduisant la médiation entre le gouvernement de NFIWA et les rebelles. Ils obtiennent, par le dialogue, la quiétude définitive entre les citoyens de ce pays. Des deux passions de haine et d’amour, celle relative à l’amour doit être privilégiée au détriment de la haine de sorte que l’amour fasse demeurer la paix pour la stabilité politique, économique et sociale.
La pratique textuelle de la rhétorique des passions brasse l’ethos de romancier orateur-voyant, l’ethos de romancier justicier et le pathos d’amour/haine. Ainsi, l’affectivité, l’émotivité et les effets-valeurs identifiés dans les fragments textuels gouvernent l’image de soi et prouvent une postulation plus ou moins forte. Celle-ci va de l’amour à la haine et de la dysphorie à l’euphorie selon le tempérament tout en traduisant les variations tensives.
3. Analyse stylistique des passions
Trois postes d’analyse stylistique sanctionnent in fine les résultats qui fondent en pratique une analyse stylistique des passions. En focalisant l’attention sur le champ lexical, l’énonciation et la connotation, nous entendons prouver effectivement que ces postes d’analyse et le thymique laissent prospérer l’ensemble des affects fondés dans le domaine du ressentiment, des émotions.
3.1. Le champ lexical de la guerre et les passions
L’ethos passionnel se construit par le truchement du champ lexical issu du lexique vu comme un poste d’analyse stylistique. Ici, certaines lexies portent en elles-mêmes des charges affectives et émotionnelles quand d’autres ne sont qu’évocatrices. La prospection du caractère spécifique du langage permet d’évaluer le degré passionnel inscrit dans les champs lexicaux. Le fragment qui suit est révélateur de champs lexicaux passionnels :
Des oiseaux s’envolèrent. Ils formaient un immense tapis qui avançait vers le ciel qu’ils ne tarderont pas à voiler. Les choses partageaient la tristesse des êtres humains, car la pluie de souffrances, la grêle d’horreurs les battaient tous. (p. 34)
Il y eut des souffrances indicibles, des jambes coupées, des yeux crevés par des rebelles drogués, l’accentuation du sida, le cruel couvre-feu, des tueries, des massacres sauvages, la liberté et la justice écrasée. Ô terreur ignoble ! Ah, horreur insoupçonnable ! (p. 35).
Le texte ci-dessus renferme le champ lexical de la guerre. Pour M. Aquien et G. Molinié, (1996, p. 481), le champ lexical est « […] dans un texte, tous les termes qui concernent un même registre thématique ou conceptuel ». Il se manifeste par les lexies « tristesse » ; « souffrances » ; « horreurs » ; « tueries » ; « terreurs ». Les sèmes afférents aux différentes lexies ci-après trouvent respectivement leurs logiques dans : ennui + mélancolie + affliction; douleur + supplice + passion ; effroyable + épouvantable + effrayant ; boucherie + carnage + massacre. Ces lexies renvoient à l’idée de compassion, de pitié en tant que sentiment issu de la passion. L’ancrage passionnel par la guerre est d’une évidence déconcertante. Les signes de haine passionnelle sont synonymes d’absence et de négation des droits de l’homme. Cette illustration est caractéristique des conséquences désastreuse et funeste occasionnées par les « tueries » massives, signes d’extermination et de barbaries. La déchéance, née des atrocités, renforce cette passion aveuglante de haine. Elle confine douloureusement la population victime de guerre dans une démence psychologique en ce sens que les « horreurs » comme actes affreux et les « terreurs » violentent l’individu en le maintenant dans la douleur physique, morale et psychologique. Ces actes asociaux et contre-natures constituent une véritable violation des droits de l’homme, en l’occurrence, le droit fondamental qu’est la vie. Toute cette barbarie mène à la destruction. Comment des personnes, qui selon Emmanuel Kant, dotées d’une conscience morale comme loi du devoir que nous impose la raison, peuvent-elles s’adonner à de tels actes odieux et chaotique. ? La passion dévastatrice qui les anime est si aveuglante que ces personnes disjonctent en attristant à vie les populations par les actes de guerre destructeurs aux effets irréversiblement désastreux et foncièrement appauvrissants. Cet ethos passionnel s’est bâti autour du champ lexical tout autant passionnel que les rebelles sources de ce malheur qui sont autant passionnés.
3.2. L’énonciation et les passions
L’énonciation est perçue par E. Benveniste (1996, p. 70) comme « la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation. » En d’autres termes, les procédés linguistiques se tissent en fonction du passage d’un terme à l’autre du couple antithétique langue/parole. Ainsi, l’appareil formel qui induit un actant-émetteur et un actant-récepteur, par le biais de l’objet du message, inscrit des indices linguistiques portés par les deux actants. Toutes ces marques qui dégagent la subjectivité se présentent en général, sous le signe de la passion. Ce sont, par exemple, les déictiques personnels, les modalités d’énonciation et les modalités d’énoncé qui déterminent une dichotomie lexicale variant de termes affectifs/évaluatifs, aux termes axiologiques/non-axiologiques. Le traitement de tout ce dispositif énonciatif passe aux cribles de la passion pour révéler la part de subjectivité et d’affectivité inhérentes au caractère spécifique du langage. Interrogeons ce fragment :
Ma fille, les années passent, et tu ne nous présentes pas ton futur époux.
– Maman, je n’ai pas envie de me marier. De nos jours, il n’y a pas de garçons sérieux.
– Des oiseaux rares, on en trouve encore. Cherche bien, et tu en trouveras.
– Nmô Cè, j’ai décidé de demeurer célibataire.
– Mais il faut à ta mère des petits-enfants. Toi-même, tu as besoin de filles et de fils. Ce sont eux et leurs descendants que nous laisserons sur la terre et qui entretiendront la mémoire de notre famille.
– Mère, la femme peut mettre seule des enfants au monde.
– Es-tu la fameuse Marie ?
– Non
– Ma fille, tu es belle. Beaucoup de garçons tournent autour de toi. Si tu en désires un, tu l’auras. (un silence). Je peux t’aider à faire ton choix ; je connais toutes les bonnes familles de Famisso. (p. 14)
Les actants émetteur et récepteur sont incarnés par Sakpa, jeune fille résolue à demeurer célibataire et Cèzè, sa mère, obstinée à convaincre sa fille à convoler en justes noces. Ils sont tous deux tantôt émetteur, tantôt récepteur car il s’agit d’un dialogue dans lequel les rôles actantiels sont dynamiques. Le locuteur se reconnaît par des marqueurs répartis en trois catégories : la première concerne les pronoms personnels sujets [je (3fois), j’, nous] ; la deuxième porte sur les adjectifs possessifs [ma, nos, notre] quand la troisième, elle, caractérise le pronom personnel complément [me]. L’actant émetteur, la fille, en utilisant des indices grammaticaux passionnels tels que le « je » et ses dérivés s’inscrit dans une conviction subjective et affective de demeurer célibataire. La preuve, les doubles négations « n’…pas » et « n’…pas » qui relèvent des propos de la jeune fille corrélées aux déictiques de personnes (je) sont une forme d’insistance passionnelle révélant son refus de se marier. En effet, cette modalité d’énoncé « je n’ai pas envie de me marier » et « il n’y a pas de garçons sérieux », par la forme négative, est synonyme de mépris et de dégoût ; donnant ainsi, un sentiment de répugnance impliquant une affectivité dysphorique. De même, l’on constate un sentiment de dégoût et de répulsion qui est issu de son refus de se marier. Cet état psychologique qui résulte du fait qu’il n’y ait pas « de garçon sérieux » s’empare de Sakpa et constitue ses arguments passionnels pour convaincre sa mère à adhérer à sa cause. La chute de l’argument de la fille, dans le prolongement de son argumentaire enrobe les énoncés précédents dans une insistance négative comme une forme de répétition assumant une conviction par la négative et se présentant dans une attitude psychologique indéboulonnable. D’où cette chute argumentaire « J’ai décidé de demeurer célibataire », modalité assertive qui renferme l’affectivité du sujet « Je » passionné à assumer sa conviction de demeurer célibataire.
L’actant récepteur est représenté par la mère avec des marques tangibles : des pronoms personnels sujets (tu (4fois), nous) ; un adjectif possessif (notre). La réplique de la mère soucieuse de pérenniser sa descendance est rendue manifeste par les pronoms personnels (tu et nous) qui permettent à la génitrice de Sakpa d’avancer des arguments tout comme sa fille, afin de l’aider à comprendre le bien-fondé de son argumentaire. « Mais il faut à ta mère des petits-enfants. Toi-même, tu as besoin de filles et de fils. Ce sont eux et leurs descendants que nous laisserons sur la terre et qui entretiendront la mémoire de notre famille ». Cette forme de rhétorique argumentative utilisée par la mère suppose un sentiment teinté d’amertume (résistance de la fille) et d’espoir (convaincre vaille que vaille sa fille) avec pour seul objectif d’infléchir la position de celle-ci pour l’amener à s’accorder avec elle dans l’optique de réaliser ses vœux. L’insistance de la mère trouve son expression prosopographique dans l’adjectif mélioratif « belle » qui concentre une affectivité appréciative et admirative dédiée à la jeune fille. L’objectif principal de cette appréciation euphorique est de faire en sorte qu’elle s’accepte comme telle dans la confiance en vue d’épouser un homme. La justification, dit sa mère, trouve ici tout son sens : « beaucoup de garçons tournent autour de toi ». Cette prolation de la génitrice de Sakpa donne à voir la resplendissante beauté de sa fille qui ne manque pas de prétendants qui sans cesse « tournent autour » d’elle et n’attendent que son assentiment. A cet effet, étant donné qu’elle connaît les familles de bonne moralité, elle propose à sa fille de lui faciliter la tâche pour qu’elle puisse l’aider à opérer son choix parmi plusieurs prétendants.
3.3. Les connotations et les passions
La lexie comme signe (SI) se présente sous forme antithétique constituée d’un signifiant (Sa) et d’un signifié (Sé). Dans la perspective de M. Georges (1993, p. 59) « le Sé se compose lui-même d’un noyau dénotatif (la valeur S) et en un tout de valeurs ajoutées, les associations sémantiques appelées connotatives, la connotation, la valeur (x). » La connotation est donc l’ensemble des influx de sens suggérés et subjectifs. Elle donne prise à l’affectivité, à l’esthétique, à l’axiologie, à l’échelle et au jugement des valeurs. L’enquête stylistique de la connotation visite tous ces procédés en assignant un fonctionnement langagier digne d’intérêts passionnels. Nous évaluerons les signes tangibles de la passion logés au cœur des connotations identifiées dans le texte. Dans cette optique, cet extrait est révélateur :
Le crépuscule se levait, rosissait, au loin, l’horizon. Bientôt naîtra la prochaine nuit. Nci et les autres membres quittèrent les rebelles ce jour-là en espérant que les vraies négociations débuteront sous peu.
Les négociations débutèrent le surlendemain. Elles piétinaient parce que la première partie voulait dribbler la seconde, et réciproquement. Les rebelles cherchaient à se jouer du gouvernement, et vice-versa. (…). Des balles fauchaient des femmes, des vieillards, des enfants, endeuillaient ainsi maintes familles. (p. 32-33)
Le traitement des connotations, en relation étroite avec les passions, permettent de discerner la part d’affectivité, de subjectivité et de jugement de valeurs à travers les différentes lexies passionnelles dans l’œuvre. Cette articulation du travail s’organise en suivant une double trajectoire. La première se fonde sur les connotations péjoratives. Deux lexies « dribbler » ; « Rebelles » et deux syntagmes verbaux « négociations piétinaient » ; « balles fauchaient » attestent cette péjoration discursive. En effet, « dribbler » est un anglicisme qui dérive de « To dribble » et qui signifie courir en faisant passer le ballon d’un pied à un autre sans perdre le contrôle. Dans ce contexte textuel marqué par les négociations en vue de parvenir à la paix, « dribbler » prend les traits sémiques de « se jouer de » ; « se détourner de ». Ainsi, ce verbe draine une connotation péjorative du fait qu’il s’inscrit dans une affectivité dysphorique qui éloigne, par des subterfuges, les deux camps (gouvernement et rébellion) de l’essentiel : la paix. Le noyau dénotatif « dribbler » est ainsi inondé d’évocations accompagnatrices « de détourner de ; se jouer de ». C’est dans cette perspective que M. Georges (2014, p. 21), au sujet de la connotation écrit : « La connotation est l’ensemble des évocations accompagnatrices du noyau dénotatif, comme un mouvement d’associations qualitatives qui colorent à réception l’émission de la lexie dans le domaine affectif et social. » Mieux, en renvoyant à tout ce que le mot suggère et qui s’ajoute aux sèmes objectifs de la dénotation, la connotation poursuit sa mobilité sémique par les lexies « balles » et « fauchaient » à travers « balles fauchaient ». Pour cette raison, la lexie : « balles » dégage les traits sémiques de plomb, munition, projectile métallique d’armes à feu. « Fauchaient » ; verbe faucher, atteindre mortellement quelqu’un, anéantir, tuer. Les sèmes qui renvoient à ce syntagme verbal relèvent des actes ignobles imputables aux rebelles. Dans leur soif de frénésie déconcertante d’atteindre leurs objectifs, et faisant fi des droits de l’homme, ils déversent leurs balles assassines sur les individus qu’ils soient femmes, vieillards, enfants occasionnant des génocides impitoyables. Cette option négative adoptée conforte une affectivité dysphorique reposant sur des sèmes péjorativement connotés. Face à ce tableau sombre peint par les rebelles, se dresse celui plus reluisant avec des objectifs prometteurs du gouvernement et de la médiation.
Cette seconde option identifie un verbe « rosissait », une lexie « crépuscule » et un groupe nominal « vraies négociations » qui témoigne d’une atmosphère de convivialité et d’apaisement. Ce sont tous des noyaux dénotatifs sur lesquels reposent les microstructures suggérées et affectives dites « informations subsidiaires » dans la droite ligne de ce que C. Kerbrat-Orecchioni (1984, p. 15) énonce : « toutes les informations subsidiaires (à la dénotation) seront dites connotatives ». De ce fait, « Rosissait », noyau dénotatif, dont les sèmes connotés sont rosir, rendre rose, odeur suave correspond à l’amour, à la joie et à la quiétude. Le « crépuscule », de même, par ses traits sémiques d’aube, d’aurore, de lueur précédant le lever du jour, est annonciateur de lumière de prédilection de paix. Il affiche une connotation méliorative. Pour parvenir à cette noble finalité, il faut nécessairement passer par de « vraies négociations ». Ce groupe nominal associe les sèmes de vérité, véridique, certain, sans fioritures à ceux de médiation, pourparlers, diplomatie, régler un litige respectivement attachés aux lexies « vraies » et « négociations ». Toutes ces lexies connotées renferment intrinsèquement des stratifications liées à la passion du fait qu’elles valorisent une axiologie méliorative. À partir de ce moment, la corrélation de la connotation avec la passion vient du fait que ces connotations ont pour assises l’échelle des valeurs qui se traduit par le caractère euphorique doublé d’une axiologie méliorative. L’appel pressant pour l’atteinte de la paix motive ces sèmes de connotations laudatives impliquant une affectivité euphorique.
Conclusion
De ce travail, il ressort que les motivations du sujet ont porté sur le traitement des passions dans le fonctionnement du langage à travers le dispositif rhétorique et l’esquisse d’une étude des passions en stylistique. La première phase du travail, purement théorique, a examiné la rhétorique des passions par la prise en compte des trois arguments ethos-logos-pathos mais en ciblant le pathos par les actions émotionnelles et affectives dévolues aux lexies. La sémiotique des passions argumente que les états affectifs rattachés au tensif sont interactifs dans le caractère spécifique du langage. A ces deux premières passions connues et exploitées, il faut associer celle de la stylistique qui est, en réalité, une perception prospective qui pose les bases d’une stylistique des passions. Celle-ci est envisagée dans la pratique des postes d’analyse stylistique et du thymique dont les dimensions passionnelles instruisent des effets passionnels et de la connotation affective et subjective, en particulier. C’est ainsi que la passion, vue sous l’angle des champs lexicaux, de l’énonciation, du thymique par la subjectivité et l’affectivité, recèle des variances lexicales de l’affectivité dysphorique à l’affectivité euphorique, des spasmes du moi. Les fondements sociologiques déductifs d’une telle démarche inductive trouvent une justification dans la course effrénée pour l’accession au pouvoir d’État. Ce qui est, au demeurant, au centre de plusieurs conflits-armées qui gangrènent la paix, souvent fragile, et plonge la plupart des pays du Sud dans une dépendance et une paupérisation extrêmes. Les rebelles, qui installent la sédition, demeurent inflexibles et intransigeants. Charles Nokan campe cette histoire imaginaire par la construction d’actes passionnels qui animent aussi bien le pouvoir légitimement élu, les rebelles que les potentiels médiateurs. Ces paradigmes motivent le sujet d’étude en aidant à analyser dans le fonctionnement du langage tant le traitement des passions dans le dispositif rhétorique que l’esquisse d’une étude des passions en stylistique.
Références bibliographiques
AMOSSY Ruth, 2009, L’Argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin.
AQUIEN Michel et GEORGES Molinié, 1996, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, Librairie Générale Française.
ARISTOTE, 1991, La Rhétorique, Livre II, 1, Paris. Librairie Générale Française.
BENVENISTE Emile, 1996, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard.
BERTRAND Denis, 2000, Précis de sémiotique littéraire, Paris, Nathan.
CASTELLANI Gisèle-Mathieu, 2000, La Rhétorique des passions, Paris, PUF.
FONTANILLE Jacques, 1999, Sémiotique et littérature. Essai de méthode, Paris, PUF.
GREIMAS Algirdas Julien et COURTES Joseph, 1993, Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette Supérieur.
IBO Lydie, 2001, « De la complexité de la prise en charge du discours perceptif » in Revue du Cames-Série B, Vol. 03-n°0002.
JOUBERT Jean-Louis, 1988, La Poésie, Paris, Armand Colin.
KARABETIAN Etienne, 2000, Histoire des stylistiques, Paris, Armand Colin.
KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1984, La Connotation, Paris, Presses Universitaire de Lyon.
MEYER Michel, 2008, Principia rhetorica. Théorie générale de l’argumentation, Paris, Fayard.
MOLINIE Georges, 1993, La Stylistique, Paris, PUF.
NOKAN Charles, 2012, Tout Grand vent est un ouragan, Abidjan, L’Encre Bleu.
MOLINIE Georges, 2014, Eléments de stylistique française, Paris, PUF, 4è éd.
RASTIER François, 1973, « Pour une théorie des textes poly-isotopiques » in Langages 31.
REBOUL Olivier, 1998, Introduction à la rhétorique, Paris, PUF, 3e édition.
PRATIQUES AUTOBIOGRAPHIQUES DANS LA MÉMOIRE AMPUTÉE DE WEREWERE LIKING : UNE STRATÉGIE DE SUBVERSION GÉNÉRIQUE
Kouamé Jean-François EHOUMAN
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
L’autobiographie est l’une des stratégies par lesquelles l’écrivain africain s’autofictionnalise. L’écriture autobiographique, telle qu’expérimentée dans La Mémoire amputée, est le moteur d’une transgression générique produisant plusieurs effets sur les plans formel et narratif qui fictionnalisent l’histoire et l’identité de l’auteur. Dans ce roman l’auteur, Werewere-Liking, met en scène un personnage dont l’itinéraire rejoint typiquement celui de l’auteure. En considérant l’écriture entre la fiction romanesque et la réalité autobiographique, cet article ambitionne de montrer de quelles manières et par quels procédés narratifs, chez l’écrivaine ivoiro-camerounaise, l’écriture romanesque déstabilise l’autobiographie. Les enjeux de cette pratique scripturale résident, essentiellement, dans l’expression de la pratique intergénérique et transgénérique.
Mots clés : Autofiction, autobiographie, autoreprésentation, fictionnalisation de soi, intergénéricité, transgénéricité, transgression générique.
Abstract :
Autobiography is one of the strategies by which the Africain writer fictionalises himself. In La Mémoire amputée, the autobiographical writing induces a generic transgression that produces several formal and narrative effects that fictionalize the author’s history and identity. In this novel, Werewere-Liking stages a character whose itinerary typically joins hers. By locating her writing between fiction and autobiographical reality, this article aims to show the ways and narrative processes by which, in the ivoiro-camerounaise writer’s novel, fiction writing destabilises autobiography. The stakes ofthis scriptural practice lie, essentially, in the experssion of intergeneric and transgeneric practice.
Keywords : Autofiction, autobiography, autorepresentation, self fictionalization, intergenericity, transgenericity, generic transgression.
Introduction
L’autoreprésentation de l’écrivain est un procédé littéraire qui, dans le roman africain, relève d’une stratégie narrative pouvant conduire à la subversion des genres. Cette stratégie d’écriture qui entremêle réalité biographique et fiction romanesque interroge beaucoup les enjeux de la pratique intergénérique dont les effets se mesurent plus sur les plans formel et sémantique de l’écriture autobiographique.
Dans l’espace romanesque, l’autobiographie est exposée au non-respect des mesures de sa configuration initiale, qui l’introduit pleinement dans le jeu fictionnel voire littéraire. Simon Harel (1998, p. 153), écrit par conséquent que : « la littérature est précisément cet objet dénaturé, ouvert à la démesure des codes ».
L’on peut comprendre dès lors que beaucoup d’écrivains africains ont adopté l’autobiographie dans l’optique de la révolutionner, de la déconstruire en tant que « norme occidentale ». Achille Mbembé (2000, p. 24), précise que chez les penseurs africains, la libération est « de décider de soi de façon autonome.» En réalité, c’est vers ce concept d’autonomie que converge les projets d’écriture de soi africaine. Ainsi, dans la quête d’un mode africain d’écriture de soi ou de la poétique de l’imbrication générique entre l’autobiographie et le roman, le romancier africain élabore avec son Moi, son identité personnelle qu’il saisit comme l’ossature de sa narration, une forme d’écriture considérée comme un anti-genre. Il a non seulement engagé le crépuscule du genre référentiel mais aussi et surtout dévoilé ses faiblesses.
L’autobiographie pose ainsi dans le roman africain, un problème d’authenticité qui fait d’elle, « un des lieux où la littérature africaine trouve son expression la plus vivante ». Aurelie Journo (2013, p. 77).
Dans cette quête de rénovation scripturale et formelle, le roman africain tente de réduire la matière définitionnelle de l’autobiographie aux seules bribes de l’histoire de l’identité de celui qui s’écrit, justifiant l’absorption des contraintes définitionnelles classiques.
La Mémoire amputée est l’un des textes qui, marqué par le vécu réel de son auteure, exprime fortement ce dépassement des codes génériques qui nuit à l’authenticité de son aspect autobiographique.
Dans le roman, Werewere-Liking, en écrivant son parcours professionnel et ses blessures intimes, tente de restituer à travers son vécu, les conditions d’existence de toute la communauté Bassa du sud Cameroun. Cette technique d’expression du moi trouve son sens avec Aline Mura-Brunel (2004, p. 5), qui montre que « dire ou écrire l’intime, c’est le priver assurément de sa qualité, le détruire peut-être ». Ainsi, La Mémoire amputée laisse entrevoir un Moi quasiment dépourvu de sa matérialité. Elle met en relief une forme d’écriture subversive qui laisse échapper le style, les principes et le sens traditionnel de l’autobiographie.
Le présent article part du postulat que l’espace romanesque africain place l’autobiographie dans une mobilité narrative visant à adopter d’autres modes scripturaux qui posent les limites de son autonomie. L’objectif est de montrer, à partir de l’analyse de La Mémoire amputée, les différents dépassements des modes de représentation de l’écrivain qui déconstruisent le genre autobiographique tout en le présentant comme une forme antigénérique.
1. La Mémoire amputée et la problématique de réception de l’autobiographie
Dans la narration romanesque africaine, l’autobiographie engendre, généralement, une hybridité formelle et sémantique qui déstabilise les principes de délimitation posés par Philippe Lejeune. Genre référentiel par excellence, l’autobiographie devient, dans le roman, un espace de confusion générique et évolue avec d’importantes difficultés. Car, au confluent du genre romanesque et autobiographique se forme une entreprise narrative de déconstruction qui noie l’authenticité des genres et met en pièce leurs principes d’écriture tout en adoptant une autre dimension formelle ; celle que Serge Doubrovsky qualifie d’autofiction en 1977 à travers son livre Fils. Cette forme d’écriture qui voit la naissance d’un pacte indirect, dans la production des écritures romanesques autobiographiques prend de plus en plus de l’ampleur. Elle permet donc de faire une distinction entre le genre autobiographique et l’autobiographie romancée.
La technique narrative de La Mémoire amputée, considérée comme un archétype de l’écriture de soi africaine, permet de voir les différents modes de dépassement générique qui compliquent la perception de l’autobiographie. Plusieurs productions romanesques se présentent aujourd’hui comme relevant de l’autobiographie. Par contre, les contraintes déterminantes du genre se trouvent bouleversées par les attributs littéraires du roman et l’idéologie des écrivains africains consistant à exprimer le propre de l’Afrique et de l’Africain.
Ainsi, la relation identitaire entre auteur / narrateur / personnage, les intitulés génériques, le contrat de lecture et le cadre spatio-temporel constituent les éléments privilégiés par lesquels l’écrivain africain pose toute la problématique de l’instabilité du genre. Ce qui justifie parfois l’attitude du « je », matière substantielle de l’autobiographie classique qui, implicitement ou non, assure une fonction collective. Tro Dého Roger (2013, p. 8), écrit justement que « dans ces romans, lorsque le sujet disait « je », (…) il représentait en réalité, un je-nous c’est-à-dire un je qui n’a d’existence, d’essence et de sens que relativement à un nous ». Il convient de souligner que dans le roman, l’écriture autobiographique épuise la substance référentielle du biographique. On peut dès lors comprendre Ehora Effoh Clément (2018, p. 82), qui stipule que « dans le roman autofictionnel, le biographique est travesti jusqu’à se trouver vider de sa substance constitutive ».
Ainsi, l’expression du moi qui, dans la littérature occidentale, se réalise par un « je » cohérent et stable, produit le plus souvent dans le roman un sens connoté. De ce fait, l’on pose que le projet de l’écriture autobiographique associe le rapport d’intériorité du sujet à celui de l’extériorité lié à la communauté pour donner sens à la dimension psychologique du genre. Toutefois, malgré cette posture factieuse qu’exprime l’autobiographie dans le roman africain précisément, les principes théoriques de Philippe Lejeune restent le point de repère, le miroir de tous critiques s’aventurant dans le champ des écritures de soi. C’est donc à la lumière de cette théorie que sera menée la présente étude portée sur la subversion des principes autobiographiques dans La Mémoire amputée.
Werewere-Liking aborde dans l’œuvre, une écriture qui implique le double rapport (réalité /fiction) des écritures de soi pour décloisonner la linéarité objective de l’autobiographie et situer la présente investigation à deux niveaux d’analyse: les niveaux paratextuel et intratextuel.
1.1. La traversée des principes référentiels paratextuels
L’autoreprésentation de l’écrivain dans le roman repose, en partie, sur certains éléments paratextuels. Le paratexte dans les écritures de soi est un lieu déterminant où l’auteur établit les premiers principes de réception de genre, où le lecteur découvre des préludes référentiels qui indiquent la nature biographique du texte. Vincent Jouve (1997, p.12), soutient que « le paratexte est le lieu où se noue clairement le contrat de lecture ». Par ailleurs, la plupart des autobiographies africaines franchissent les principes référentiels paratextuels. Les paratextes peuvent désormais présenter une apparence fictionnelle qui constitue un voile des réalités référentielles.
La Mémoire amputée de Werewere-Liking offre un paratexte hermétique à la réception de la nature autobiographique du texte. De ce fait, l’intitulé nominal se refuse à être une porte ouverte à la lecture référentielle. Il n’entretient aucune relation identitaire entre le texte et le hors texte d’une part et entre l’auteure et la protagoniste d’autre part. La relation sémantique entre le titre « La Mémoire amputée » et l’auteure et son histoire n’étant pas établie, exclut l’œuvre de sa réception référentielle. Ainsi, lorsque l’on se réfère à l’étude sur la classification titulaire de Vincent Jouve (1997, p. 15), et celle de Gérard Genette (1987), « La Mémoire amputée » peut être classée dans la catégorie des titres équivoques. Cette construction énigmatique qui occulte la substance référentielle du texte se voit aussi à travers le sous-titre « Chant-roman ». Néologisme générique de Werewere-Liking, Chant-roman traduit la composition générique du roman. À cette construction, l’intitulé générique ne peut être qu’une impasse à la perception autobiographique du texte. Il traduit deux genres fictionnels qui rompent avec le caractère référentiel du texte : le roman, genre fictionnel par essence, et le chant, genre de création musicale.
De par cette construction énigmatique des titres, Werewere-Linking se livre à un jeu de création littéraire qui heurte la notion de l’autofiction, genre novateur créé par Serge Doubrovsky (1977), qui le définit, à la quatrième de couverture du Fils, en tant qu’une « fiction d’événements et des faits strictement réels ».
L’analyse des intitulés donne plusieurs possibilités d’insinuation qui drainent les ambiguïtés dans la construction des genres. En se référant au « chant-roman », le titre révèle réellement la carrière professionnelle de l’écrivaine. Il ne donne pourtant pas d’entrevoir l’histoire de l’auteure, mais justifie plutôt son identité. Werewere-Liking est, certes, une écrivaine, mais elle est surtout reconnue sous le statut de chanteuse. L’entremêlement de la narration romanesque par des chants est une manière spécifique pour l’auteure de s’autoreprésenter. Cette construction titulaire, métaphorique, révèle quelques enjeux et intentions de la création littéraire de Werewere-Liking.
Le paratexte titulaire révèle une réalité référentielle totalement submergée par la fiction romanesque. Cette technique narrative de la majorité des romanciers africains ayant une propension pour l’écriture de soi crée un nouveau cadre de discours autobiographique qui s’éloigne de la forme canonique. À ce jeu de construction, la narration peut produire diverses orientations sémantiques et formelles. Ce qui pousse Philippe Gasparirini (2004, pp. 69-70), à affirmer que la « fonction indicative est aujourd’hui largement subvertie parce qu’on voit de nombreux textes autobiographiques sous-titrés ‘‘roman’’». Ce double jeu d’écriture qui déconstruit l’autobiographie se joue aussi avec le contrat de lecture.
Le contrat de lecture que signe Werewere-Liking dans sa dédicace vise une double fonction invitant le lecteur à lire la fiction romanesque comme relevant de la réalité. Elle écrit : « Ce qui va suivre, c’est un roman bien sûr, gros bêta ! (…) C’est-à-dire, des bobards ou des histoires. Mais vécues » (p. 5). Le contrat dissimule la nature du récit entre le réel et la fiction. Cet ensemble de construction fait dire à Vanessa Chaves (2009, p. 1), que lesécrivains jouent avec les attentes de leurs lecteurs. Ils usent d’un cache-cache narratif pour délayer la référentialité de leur texte. Ces procédés interviennent aussi au niveau intratextuel et peuvent se percevoir par les jeux du « je ».
1.2. La Mémoire amputée : une écriture du « je » au-delà de l’individualisme
Le champ romanesque autobiographiques d’Afrique noire aborde rarement le « je » sous le prototype du « je-origine ». Sous cet angle, Jean-Cléo Godin (1995, p. 39) soutient que l’« autobiographie semble appeler une définition nouvelle pour rendre compte des caractéristiques propres à la littérature d’Afrique noire ». Tro Dého Roger (2013, p. 7), affirme pour sa part : « “je” même peut porter diverses robes, incarner des rôles, (…) adopter diverses postures où je n’est plus je », puisque le projet du vécu personnel reflète ou engage celui de la collectivité.
Par ailleurs, tous les éléments caractéristiques du genre semblent remis en cause et rangés dans l’ordre de la subversion dans le champ romanesque. Le « je » garant de la triade identitaire auteur / narrateur / protagoniste et de l’individualité se décline le plus souvent en « il » qui met le sujet à distance vis-à-vis de soi et en « nous », symbole de la collectivité.
Le rapport identitaire entre « je » et les instances narratives auteur/narrateur/personnageendigue le réalisme de l’autobiographie. De fait, dansLa Mémoire amputée, lorsque le je-narrateur affirme : « Je suis Halla Njokè (…) Je suis définitivement chanteuse (…) À un moment donné de ma vie, je suis devenue écrivain et pensais le demeurer » (p. 17), il s’identifie au personnage et tente de recentrer l’itinéraire du héros dans une pure construction imaginaire. Effectivement, l’équation je = narrateur = personnage est une construction fictive intratextuelle. Joseph Adje Anoh (2013, p. 178), écrit justement : « Le je-narrateur est une réalité romanesque et imaginaire qui n’a aucune existence extratextuelle ». Cette rupture entre l’intratexte et l’extratexte se matérialise par l’inexistence d’identité nominale. Cela permet à la romancière d’adopter le procédé de la distanciation narrative qui le dissimule derrière le personnage fictif Halla Njokè.
Cependant, les indices biographiques sont fortement représentés dans le texte et tentent toujours de rétablir le caractère référentiel, réel du texte. Bien que le récit marque la présence de l’auteur dans son texte, il entretient des indices permettant de discréditer l’écriture autobiographique.
Ainsi, en reconstruisant l’identité de son « Moi », Werewere Liking aborde la problématique sensible du collectif autour de plusieurs thèmes introduisant le sujet dans une dimension idéologique et psychologique.
La traversée du « Moi » que Werewere-Liking, construit autour de la thématique du silence, s’appréhende par un engagement féministe qu’elle traduit par le caractère androgyne de Halla Njokè. Alors que Halla Njokè est une femme, elle manifeste, instinctivement, le désir de devenir homme quand elle énonce : « je deviens mécontent de n’être pas homme. Un homme c’est celui qui est libre. Il paraît, décide, commande et les femmes et les enfants sont ceux qui obéissent » (p. 36), « Quand donc vais-je devenir un garçon ? » (p. 37). Werewere-Liking mène ainsi une lutte pour la valorisation de la femme africaine en s’attaquant au régime patriarcal de la société. Relativement à cet engagement féministe, la protagoniste pense aux modes d’expression des maux de l’Afrique quand elle se demande : « comment raconter le silence de l’Afrique ? » (p. 21).
L’écriture autobiographique engage une énonciation mixte. Elle met en exergue un « je » à la valeur d’un « nous » exprimant les réalités du ‘’Moi’’ personnel de la narratrice-personnage et les réalités de tout le peuple Bassa.
Dans le récit, l’itinéraire de Liking donne de voir l’image complète et claire des réalités de sa société qu’elle entend décrire. Dès lors, comment fonctionnent les différentes stratégies de fictionnalisation dans la transposition du “Moi”.
2. Jeux de protocole nominal et Fictionnalisation du “Moi”
La question de la fictionnalisation du réel dans la narration des écritures de soi gravite toujours autour de la création d’un « Moi » double dans la transposition du sujet dans l’espace textuel. Ainsi, le sujet assume pleinement une double fonction et se perçoit comme une réalité variable, alternant entre les réalités sociales extratextuelles et celles de l’univers textuel. L’implication de l’auteur dans son œuvre suscite, dès lors, plusieurs transformations au niveau narratif qu’énonciatif.
La fictionnalisation de soi étant une démarche qui consiste à éloigner le moi double de son référent par des attributs littéraires, amène l’écrivain à utiliser son ensemble biographique comme matière première en modifiant quelques éléments pour des raisons génériques, esthétiques, littéraires ou romanesque. Vincent Colonna (1989, p.10), stipule que « la fictionnalisation de soi consiste à s’inventer des aventures que l’on s’attribuera, à donner son nom d’écrivain à un personnage introduit dans des situations imaginaires ». Le roman, dans cette démarche, essaye d’offrir un double espace construit autour du Moi et dans l’univers ambiant de l’auteur.
Cette transposition qui implique généralement la variation des données référentielles, surtout biographiques, influe sur la nature générique du récit. En effet, il est question du passage d’un espace à un autre, d’une vie à une autre et, plus précisément, d’une forme d’écriture à une autre. Ce processus s’inscrit dans une mobilité, produisant des effets subjectifs ou potentiels par des variations des éléments qui forment le cadre de vie et l’identité de l’auteur.
Dans La Mémoire amputée, le nom et la posture mythique de la protagoniste se soumettent à une construction fictionnelle de l’identité de l’auteure. Le nom constitue, dans le roman, un maillon essentiel de la rupture de l’écriture autobiographique. Philippe Lejeune (1975, p. 22), précise que « c’est par rapport au nom propre que l’on doit situer tous les problèmes de l’autobiographie ». Werewere-Liking pose ici le problème de la déconstruction nominale qui tente de présenter la figure de l’auteur sous un aspect fictif. Le type de fictionnalisation nominale qu’exprime La Mémoire amputée est ce que Vincent Colonna (1998, p. 54), a appelé« homonymie par transformation ». Elle permet à l’écrivain d’élaborer le nom de son double fictif à partir de son propre nom. Le nom peut être alors un lieu privilégié où se nouent les premiers germes de la subversion du genre.
Dans le cas de la Mémoire amputée, le patronyme du personnage “Njokè” se rapproche étroitement de celui, à l’état civil, de Werewere-Liking qui est “Njok” et crée une sorte de paronyme. Le mode de fictionnalisation mis en exergue engendre une confusion au niveau de la construction de l’identité phonétique entre les deux patronymes. L’élément de la fictionnalisation se réduit, en effet, au morphème (è) qui, ajouté au nom à l’état civil de Werewere-Liking, désigne la protagoniste qui assume toute la responsabilité de son référent dans l’univers textuel. Ce procédé narratif se manifeste, parfois, par l’usage des initiales ou monogrammes des noms, des paronymes ou d’« une anagramme intégrale ou partielle » selon la formule de Vincent Colonna (1989, p. 55).
Ce jeu de construction nominale distingue l’écrivaine de son personnage et inscrit le récit dans un espace de prolongement fictionnel.
La transformation exercée sur le patronyme de la romancière, dans La Mémoire amputée, engendre un paronyme. Si l’itinéraire de “Njokè” rejoint, quelquefois, celui de “Njok”, les deux mentions nominales restent différentes.
La divergence nominale des noms rompt la similarité identitaire entre l’auteure et l’héroïne puis inscrit le récit dans une autre dimension narrative, celle de l’histoire du protagoniste. La fictionnalisation de soi par procédé homonymique est une démarche beaucoup plus complexe et plus retorse qui permet de passer de l’existence réelle du sujet à son expression littéraire. Le nom de l’écrivain peut être, en effet, considéré comme un objet de double jeu de fictionnalisation. Il peut amener l’écriture à assumer une autre existence : celle du protagoniste.
En abordant la question sous l’angle générique, ce bouleversement au cœur de l’écriture autobiographique conduit à l’autofiction qui, selon Yves Baudelle (2003, p. 11), « consiste à mettre en évidence l’inévitable processus de fictionnalisation de soi ». Ce processus traduit les attentes ou l’idéologie du romancier africain comme une quête d’esthétique romanesque. Werewere-Liking, le montre clairement en faisant entrer pleinement son substitut textuel dans un univers fabuleux.
Dans La Mémoire amputée, en effet, la fictionnalisation du sujet repose sur plusieurs images mythiques. Werewere-Liking habille ses personnages d’une posture de « los ». Ils sont constitués d’une dimension naturelle et surnaturelle. Selon l’auteure, un « los » est une « personne qui, sans préparation particulière, arrache aux forces de la nature assez de pouvoirs et de puissances pour faire changer le cours de la vie (p. 62). Cette forme d’écriture, Vincent Colonna (2004, p. 18), la qualifie d’ « autofiction fantastique ».
Les personnages mythiques créent dans la matrice narrative du roman, un nouveau pôle de discours autobiographique. Lorsque Werewere-Liking évoque les rapports entre Yèrè, le « poisson parlant » et Halla Njokè, elle situe ainsi cette dernière dans un univers de conte où elle ne se reconnait plus dans le monde naturel : « Je suis une autre personne dans un autre monde » (p. 174). Halla Njokè entre désormais en communication avec les êtres surnaturels dans un monde surnaturel :
Yèrè mon ami génie défunt avance vers moi, entouré de tout petits génies qui lui font la courbette en l’appelant Bouara “l’énorme”. Il me sourit avec ironie, comme autrefois alors que ma main passe en travers de son corps. Je sens sa présence immatérielle mais très chaude qui me guide m’indiquant des plantes pour guérir ma mère (p. 174).
La fictionnalisation de soi, dans ce cas de figure, ne porte pas sur le style et le mode d’énonciation du vécu, mais plutôt dans le prolongement de l’histoire du protagoniste. Si le mythe trouve une importance capitale dans l’écriture autobiographique de Werewere-Liking, elle marque, en revanche, une rupture dans l’écriture l’autobiographique. Ce jeu d’esthétisation des écritures de soi montrent que l’écrivaine affiche, en début de son livre, un protocole référentiel qui, au fur et à mesure, est immergé dans la fiction. L’on assiste alors à une sorte de mise en abyme des données référentielles. Cette autoreprésentation fabuleuse de l’écrivain investit beaucoup la narration romanesque et peut être l’un des substrats de l’écriture de soi africaine. Le réalisme autobiographique peut donc être le fruit de l’art puisqu’il s’acquiert par la construction, la déconstruction, l’amélioration des données référentielle. Le procédé fictionnel peut aussi être l’objet de la conception et de l’enrôlement romanesque du temps
3. Tournures temporelles et décloisonnement du genre
L’analyse du temps dans l’écriture autobiographique amène, généralement, à analyser les temporalités du récit, le système verbal et l’existence de l’écrivain.Inhérent à la vie, le temps constitue, par ailleurs, le bâti de la construction de l’identité ou de l’histoire personnelle voire collective du sujet. Muriel Gilbert (2001, p. 35), affirme justement : « c’est dans l’âme que le temps reçoit son statut d’existant ». Il peut ainsi être l’un des critères définitoires de l’autobiographie. Si le temps est indissociable à l’existence, ses différents rapports avec le sujet qui s’écrit peuvent avoir des enjeux littéraires et esthétiques au niveau de l’écriture. Gérard Genette (1975 : 228), précise que le temps est « un élément capital de la signification du texte ».
Dans l’autobiographie romanesque, le récit en général peut cependant poser un problème de la réception de l’autobiographie à cause de la dissemblance des temps de l’histoire, de la narration et celui de l’écrivain qui se produit dans l’aménagement du récit. L’image de soi que l’écrivain tente de construire dans son roman est ainsi perturbée par cette stratégie de la structure du temps.
La Mémoire amputée est représentative de cette créativité portant sur l’organisation du temps qui se joue entre la réalité des indices autobiographiques et la fiction romanesque. La structure narrative du roman révèle différentes fonctions du temps dans l’approche de la matière autobiographique.Elle présente le temps comme un facteur d’hostilité autobiographique, d’une part et, de l’autre, en qualité trait déterminant. Ainsi, à travers l’auto-présentation du narrateur : « Je suis Halla Njokè. Je vis sur ma huitième décennie, je suis définitivement chanteuse (…) à un moment donné de ma vie je suis devenu écrivain » (p. 17), on constate une narration marquée, d’abord, par le présent de l’énonciation qui atteste, clairement, le statut référentiel du narrateur-personnage par l’identité de l’auteur et présente la durée de son existence qui paraît un temps purement fictif parce que différente de celle de son substitut. La narratrice indique ici un temps indéterminé qui déjoue l’acte autobiographique mais qui, dans l’œuvre, atteste la présence de l’auteure par sa fonction d’écrivain. Cette construction du temps qui entremêle la réalité autobiographique et la fiction romanesque situe le texte sous l’étiquette de l’autofiction.
La technique de fictionnalisation du temps et par le temps mise en œuvre par la romancière se distingue à travers le temps de la narration qui s’exprime par l’évocation du retour à l’écriture de la narratrice-personnage : «cela faisait un bon moment que je n’avais plus écrit. Et voilà que le jour de mon soixante-quinzième anniversaire, le désir me prit» (p. 17).
Alors, en rapprochant les soixante-quinze ans de Halla Njokè à la date de naissance de Werewere-Liking qui est « 1950 », il ne se produit aucun rapport de concordance. Ainsi, jusqu’à la date de parution de l’œuvre, l’auteure n’avait pas l’âge indiqué dans le récit. Le temps de la narration est donc hostile à la réalisation du projet autobiographique. Il discrimine, en effet, le « je-narré » et le « je-narrant » du moi tenu à distance dont l’on se donne de raconter le vécu. L’écart temporel marque une distance identitaire entre l’existence réelle de la romancière et celle qu’assume la protagoniste ; complexifiant ainsi la réception du genre référentiel dans sa forme classique.
La technique de l’organisation du temps dans La Mémoire amputée montre un jeu d’écriture qui atteste le caractère autobiographique par les données référentielles et souligne les limites de son authenticité par l’acte de fictionnalisation.
Par ailleurs, le temps de l’histoire est marqué par la résistance coloniale que Njokè l’éléphant annonce après les représailles de Mpôdôl à « l’assemblée nationale qui devait consacrer (le) pays département français d’outre-mer » (p. 65). En tant que temps remémoré, il objective et situe les événements et les faits dans une vérité plus générale ou confuse relevant du réalisme littéraire. Alors que l’autobiographie envisage la réalité, le temps de l’histoire est structuré de manière à dissimuler certaines réalités et à exprimer la fiction romanesque. Dans cette perspective, les événements ne portent aucune précision de temps. L’Assemblée nationale qui devait consacrer (le) pays département français d’outre-mer ne porte aucune précision de lieu et de date. La disposition temporelle mise en place dans le roman est une stratégie de création littéraire spécifique de l’écriture de soi de Werewere-Liking.
Du point de vue grammatical, le récitentremêle le passé et le présent. Alors, si le temps passé reste un principe de l’autobiographie, quel est par contre l’impact du présent sur l’écriture du vécu à caractère rétrospectif ? Regaïeg Najiba (1999, p. 130), précise que l’emploi du présent de la narration est la preuve irréfutable de l’échec de l’écriture autobiographique. Dans l’œuvre, l’emploi du présent ramène les événements du passé au temps du lecteur et annule la distance entre le temps de l’histoire et celui de la narration. Il fait dégénérer l’autobiographie et rend énigmatique sa réception dans le récit. Son emploi rend plus vivantes les actions en donnant l’impression d’un présent d’énonciation alors que les faits appartiennent au passé.
L’inscription du temps dans La Mémoire amputée désaltère l’autobiographie de sa forme classique. On peut selon Claude Le Manchec (2006, p. 158), que l’identité « est mise en dialogue passé /présent pour se reconstruire. » Il s’ensuit que la stratégie de subversion du genre référentiel qui s’exprime à travers la structure du temps compte parmi les habitudes scripturales de la majorité des écrivains africains qui s’intéressent à l’écriture autobiographiques.
Conclusion
L’autoreprésentation de l’écrivaine dans La Mémoire amputée relève d’une stratégie de subversion du genre autobiographique. Les principes référentiels qui authentifient le genre sont mis en pièces. L’espace paratextuel présente un contrat de lecture ambigu prenant en compte une double réalité référentielle et romanesque. La technique scripturale autobiographique de La Mémoire amputée présente une traversée de l’individualisme du procédé énonciatif « je », et crée une distanciation nominale et temporelle entre l’auteur et son substitut textuel. L’ensemble de ces procédés de fictionnalisation, réévalue l’autobiographie traditionnelle pour imposer d’autre forme scripturale. La fiction devient selon Giacomo Bonsignore (1985, p. 19), « un véritable indice formel ».
Ces jeux de construction narrative inscrivent le Soi dans une textualité, dans un mouvement imaginaire qui ne présente pas clairement le récit sous la forme d’une autobiographie. De fait, en même temps qu’ils présentent l’histoire en tant que garant de la fidélité et de l’exactitude des faits, ils incitent le lecteur à penser qu’il s’agit d’une autobiographie tronquée à travers la subversion des protocoles d’écriture référentiels. Le vécu de l’écrivain, en plus d’être un contenu d’énoncé est un effet d’énonciation. De toutes ces démarches, il faut dire que l’autobiographie n’est possible que dans la mesure où l’homme se construit en soi, dans une construction authentique et dans un cadre spatio-temporel autre que celui de la fiction. A ce sujet, Philippe Lejeune (1975, p. 15), affirme : « une identité est ou n’est pas, il n’y a pas de degré possible et tout doute entraine une conclusion négative ». Lejeune n’accorde aucune marge de tolérance au pacte autobiographique. Pour ce faire l’autobiographie n’est possible que dans la mesure où l’homme construit son identité en lui-même, selon l’image qui symbolise l’intégrité de son Moi. Il est, dans ce cas, difficile d’appréhender les œuvres de fiction à saveur autobiographique sous la forme de l’autobiographie classique.
Dans le roman étudié, l’écriture autobiographique affiche une stratégie d’autosubversion générique. Construite, dans bien de cas, à partir de plusieurs techniques scripturales selon le style et la vision idéologique de chaque écrivain, l’autobiographie subit une véritable transgression des protocoles scripturaux qui montre son impossibilité dans quelques romans africains dont La Mémoire amputée.
Références bibliographiques
ADJE Anoh Joseph, 2013, « Les multiples facettes du je narrateur-rapporteur dans l’œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma », Je(ux) narratif(s) dans la roman africain, Paris, L’Harmattan, pp. 177-192.
BAUDELLE Yves, 2003, Du roman autobiographique : problèmes de la transposition fictionnelle, Portée, vol. 31, n°1, p. 7-26.
CHAVES Vanessa, 2009, « Le roman initiatique ou les errances du français congolisé chez Henri Lopes », Les chantiers de la création, Revue pluridisciplinaire en Lettres, Langues, Arts et Civilisations n °2, mis en ligne le 06 décembre 2014, consulté en mars 2019. URL : http//journals.openedition.org/ICC/157.
LE MANCHEC Claude, 2006, « L’écriture de soi dans la littérature de jeunesse : description et enjeux didactiques », Repère, n° 34, pp. 141-164.
COLONNA Vincent, 1989, L’Autofiction (essai sur la fictionnalisation de soi en Littérature), Doctorat de l’E. H.E.S.S.
COLONNA Vincent, 2004, Autofiction et autres mythomanies littéraires, Auch, TRISTAM.
DOUBROVSKY Serge, 1977, Fils, Paris, Galilée.
EHORA Effoh Clément, 2018, « Métafiction et autofiction chez Henri Lopes : l’écrivain au miroir de ses textes », in Horizons Littéraires, N°2, Revue du Centre de Recherches sur la Critique Littéraire Africaine (CERCLA), Université Gaston Berger Saint-Louis, Saint-Louis, Sénégal, Décembre, pp. 174-190.
GASPARINI Philippe, 2004, Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction, Paris, Seuil.
GENETTE Gérard, 1975, Figures III, Paris, Seuil.
GIACOMO Bonsignore, 1985, « Jacques Poulin : une conception de l’écriture », Etude Française, Vol, 31, n° 3, pp. 19-26.
GODIN Jean-Cléo, 1995, « Le « je » narrateur et la meute du « pays », Etudes Françaises, Vol 31, n°1, pp. 39-50.
HAREL Simon, 1998, « Ecriture de soi et traduction dans les œuvres ” jumelles” de Samuel Beckett et Wilfred R. Bion », TTR : Traduction, terminologie, rédaction, Vol, 11, n° 2, pp. 153-184.
JOURNO Aurelie, 2013, « jeux et enjeux de l’écriture du ‘’je’’ dans le champ littéraire kenyan : Ngugi wa thiog’o et Bninyavanga wainaina », Je(ux) narratif(s) dans la roman africain, Paris, L’Harmattan, pp. 77-94.
JOUVE Vincent, 1997, La poétique du roman, Paris, CEDES.
LEJEUNE Philippe, 1975, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil.
MBEMBE Achille, 2000, « À propos des écritures africaines de soi », philosophie et politique en Afrique, n°77, pp.16-43.
MURA-BRUNEL Aline, 2004, L’intime, l’extime, Paris, Rodopoi.
MURIEL, Gilbert, 2001, L’identité Narrative, Une reprise à partir de Freud de la pensée de Paul Ricoeur, Genève, Labort et Fides.
NEGAR Mazari, La « fictionnalisation du réel dans l’écriture danechvarienne » Le cas d’étude : souvachoune et l’île de l’Errance.
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1038045.pdf
REGAÏEG Najiba, 1999, « L’Amour, La fantasia d’Assia Djebar : de l’autobiographie à la fiction », Nouvelles approches des textes littéraires maghrébins ou migrants. (Vol. 27), L’Harmattan, 1er semestre, 1999.
TRO DÉHO Roger, 2013, « D’entrée du je(ux) » Je(ux) narratif(s) dans la roman africain, Paris, L’Harmattan, pp. 7-10.
[1] La pneumatique désignait pour Leibniz, une science que l’on situerait aujourd’hui entre la psychologie et la morale où il développe ses théories de l’entendement et de la volonté. En d’autres termes, c’est une science de l’esprit qui fait usage des perceptions insensibles.
[2] Le mouvement des Jeunes Populaires (UMP devenus Les Républicains).
[3] Par convention discriminatoire, le sang de l’homme libre est dit pur ; celui de l’esclave est dit impur. Il se passe comme si l’avilissement souillait le sang.
[4] Daeschner Stéphane. Dans, En charge des préventions des risques routiers, lire
www.leparisien.fr › societe › les-conductrices-ne-font-plus-peur-aux-cond.
[5] Des 4 royautés, à savoir : de Benyinli, d’Adoanebo, de Tiapou et de Grand-Bassam.
[6] Des 4 royautés, à savoir : de Moronou,d’Abengurou, d’Agnibilekrou, de Tiassalé-amatian.
[7] Milton, John, sur la liberté de la presse.
[8] Agbroffi Joachim, 2013 ; 231-243 et 2014 : 105-116
[9] «Faire l’école buissonnière», selon le Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, c’est jouer, se promener au lieu d’aller en classe ; par extension c’est aussi ne pas aller travailler.
[10]http://www.ecolecamillelavoie.com/donnees/media/2/fichiers/Nathalie%20fortin/Assiduite.pdf
[11] Le rattrapage ethnique est présenté comme étant la promotion quasi exclusive des Ivoiriens originaires du nord de la Côte d’Ivoire aux fonctions de l’administration ivoirienne et de la chaîne de commandement dans les institutions civiles, militaires et de sécurité. Il a été justifié par le chef de l’État ivoirien comme une mesure de justice sociale qu’il a, lui-même, qualifiée de « simple rattrapage », les nordistes, ses frères, ayant été exclus, selon lui, des nominations sous le président Laurent Gbagbo. Lire GAHA-BI Loukou ; KOKOTRÊ, Tata ; SILOUÉ D’Océane, 2012, Côte d’Ivoire : le rattrapage ethnique sous Alassane Ouattara : fondements, pratiques et conséquences, Paris, L’Harmattan.
[12] Extrait du Préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) le 16 Novembre 1945 et ratifié par vingt états membres en 1946.