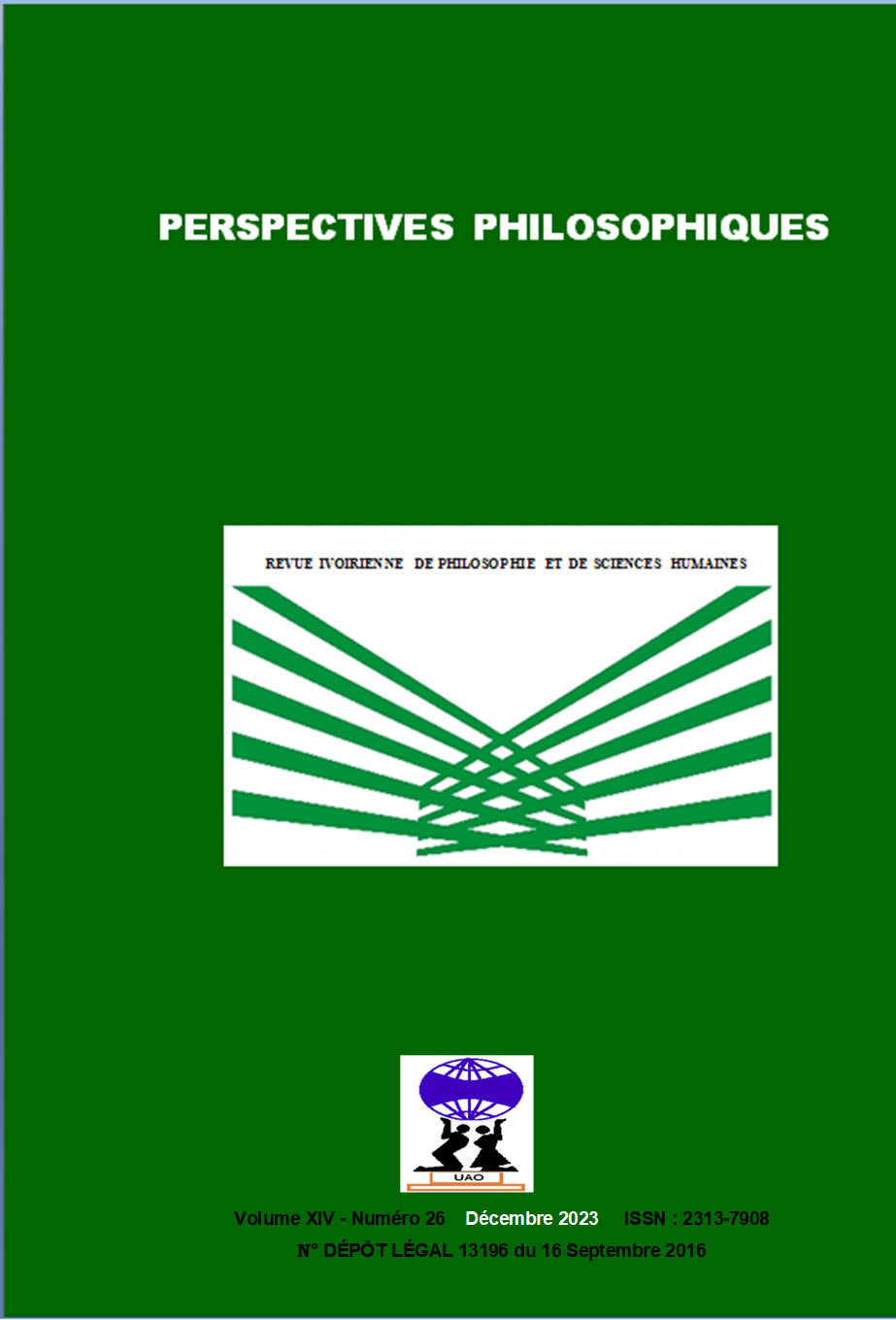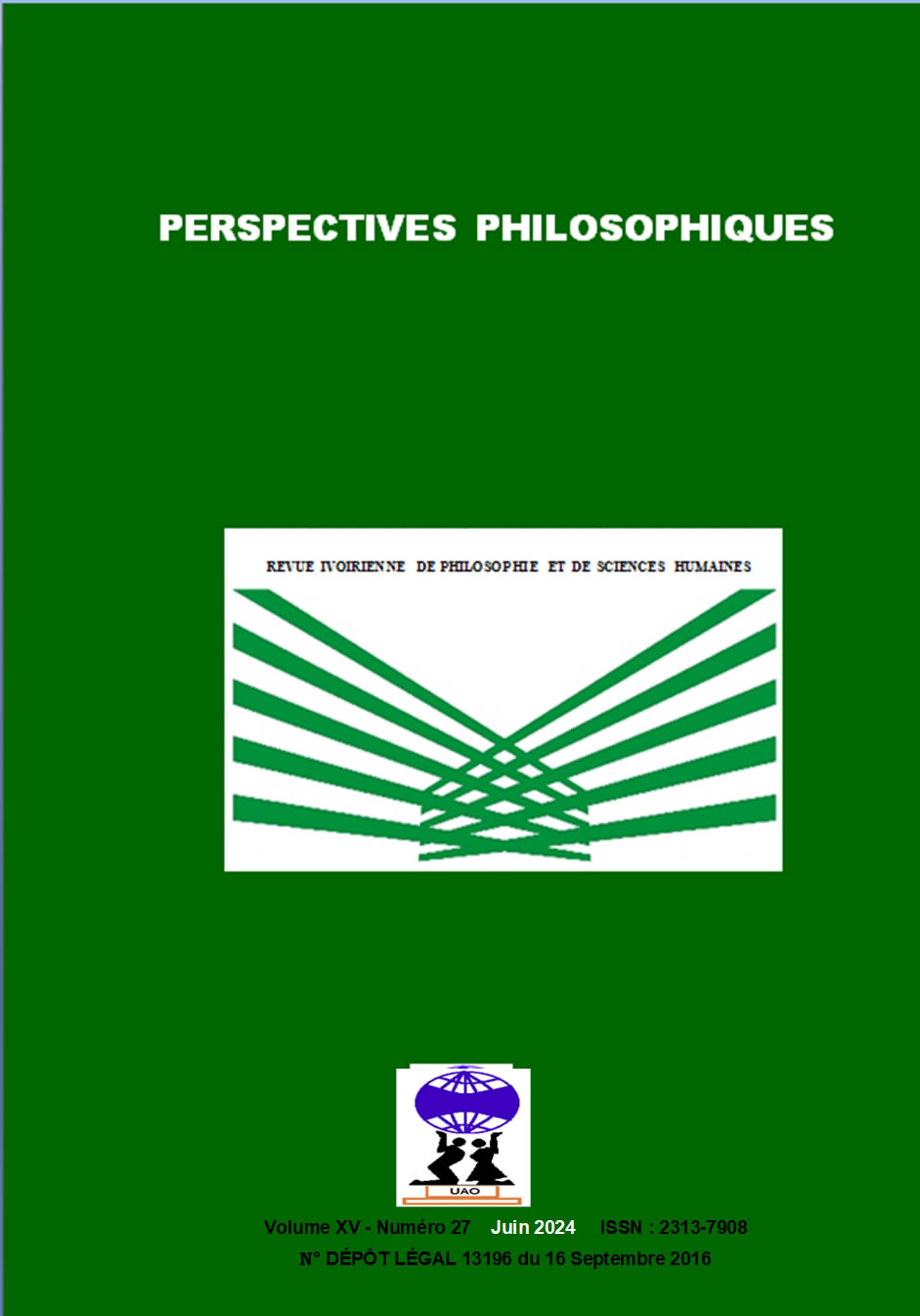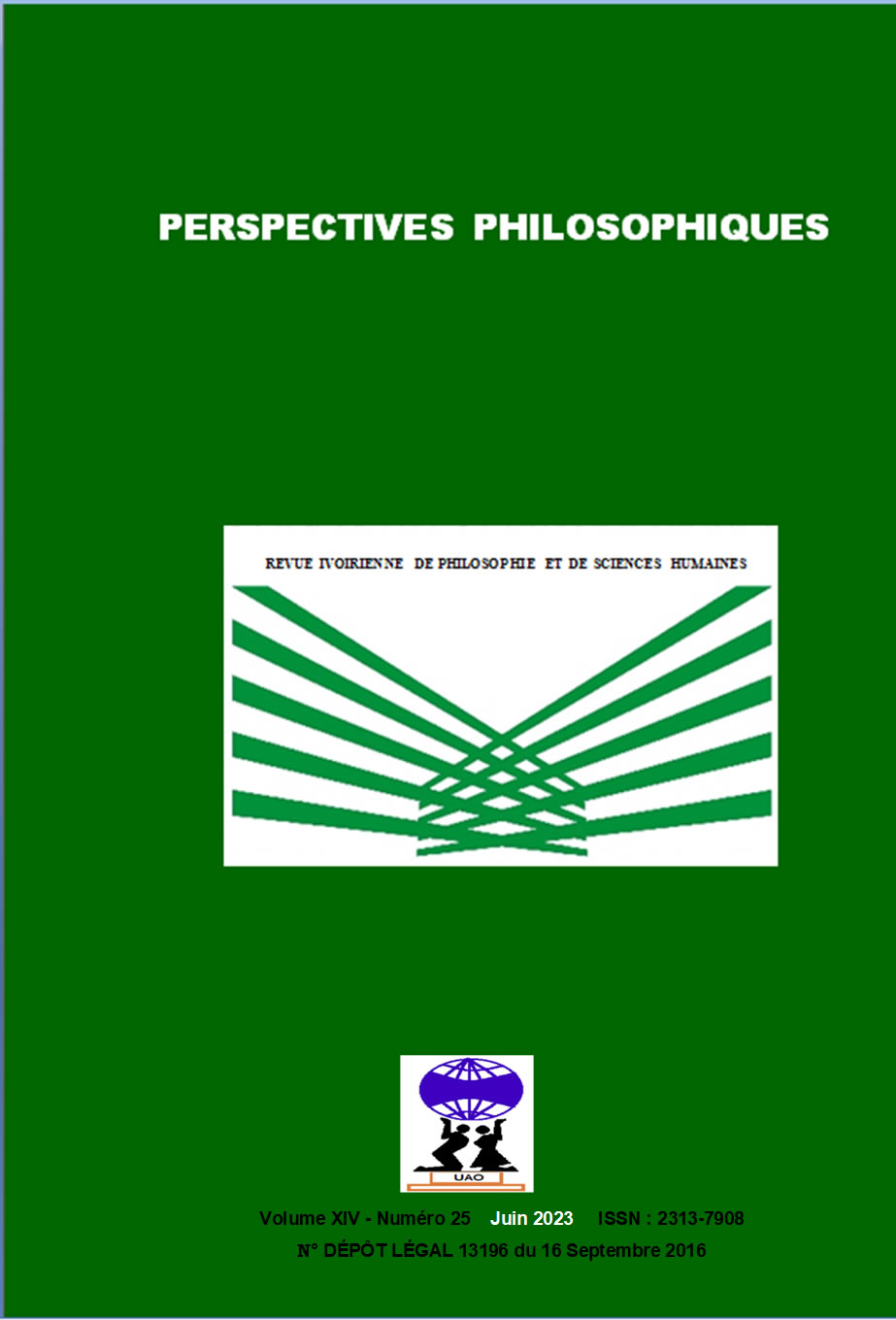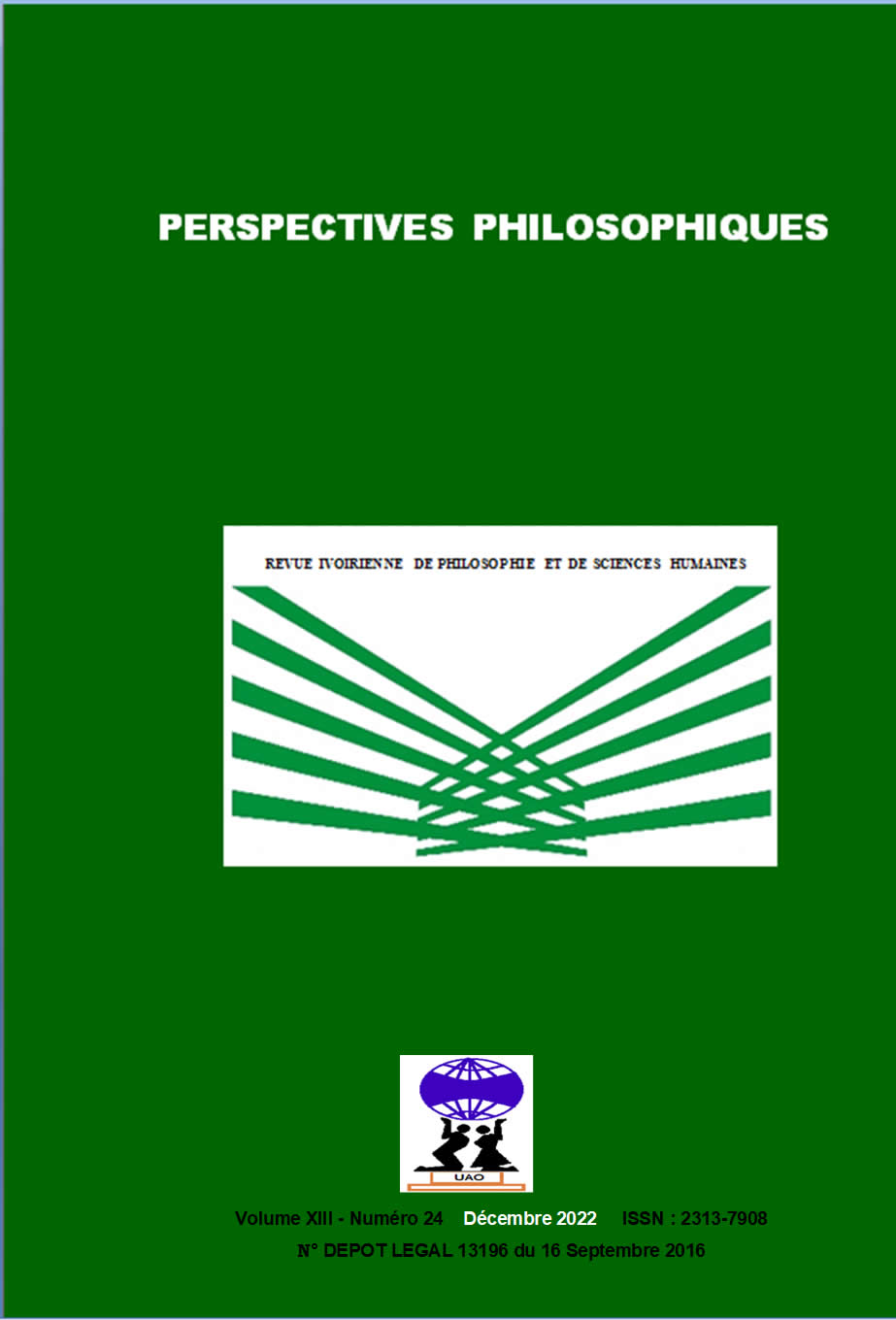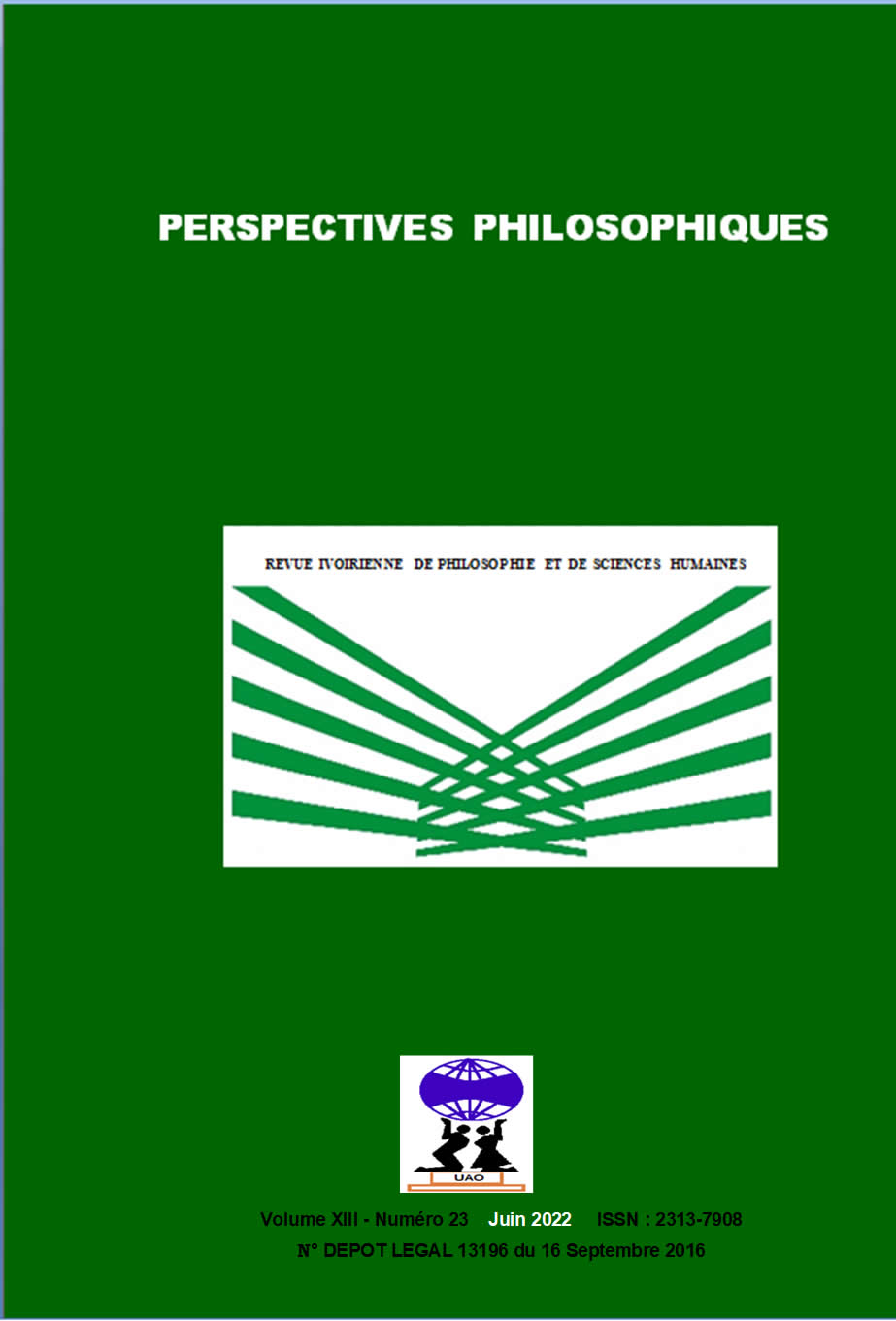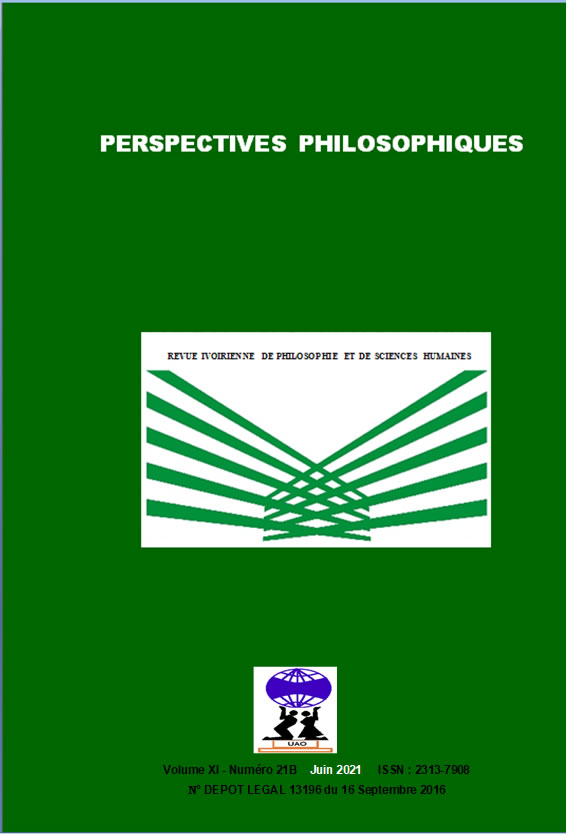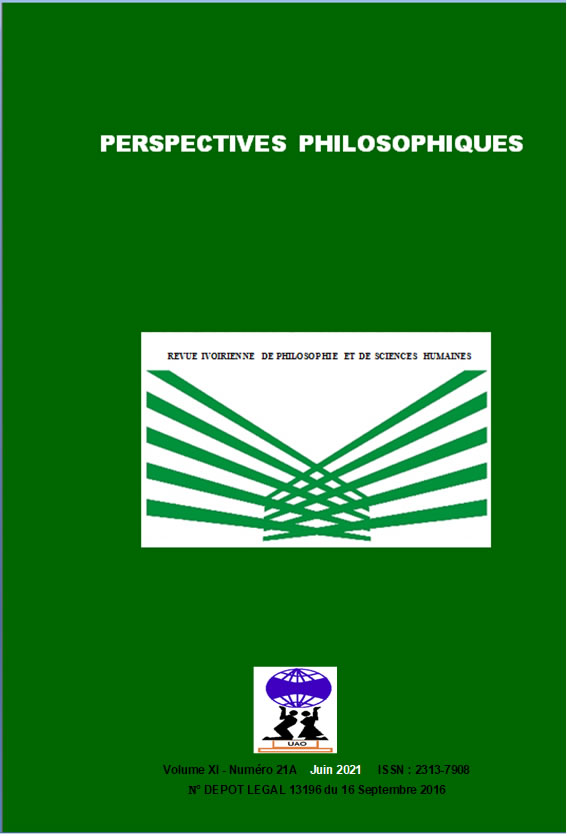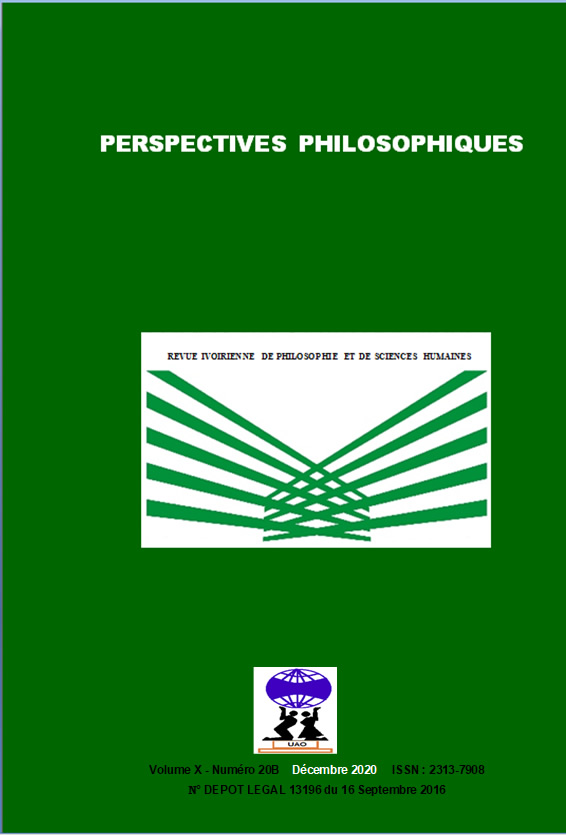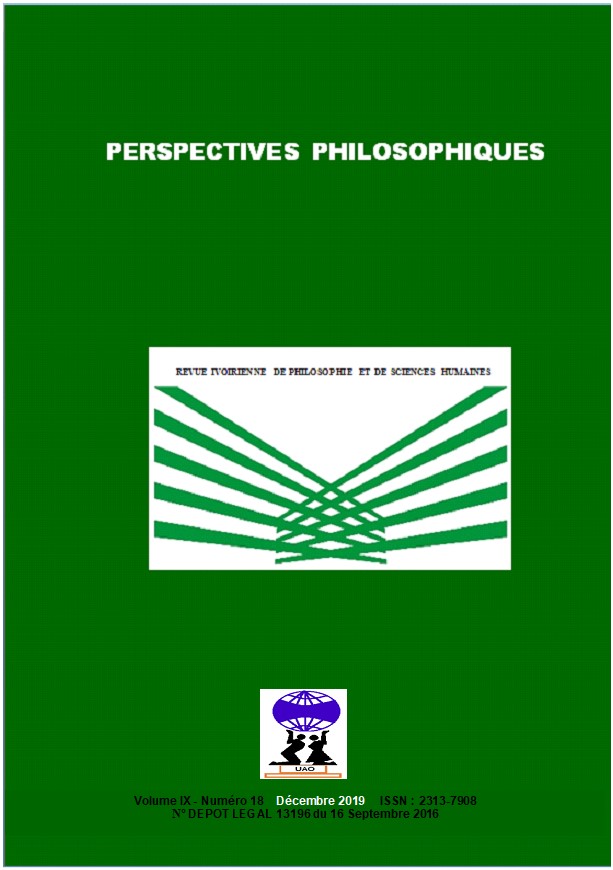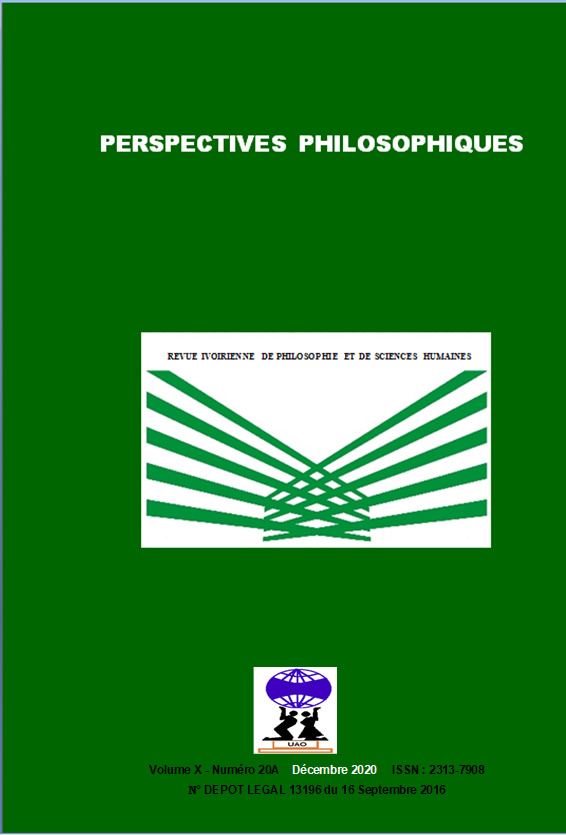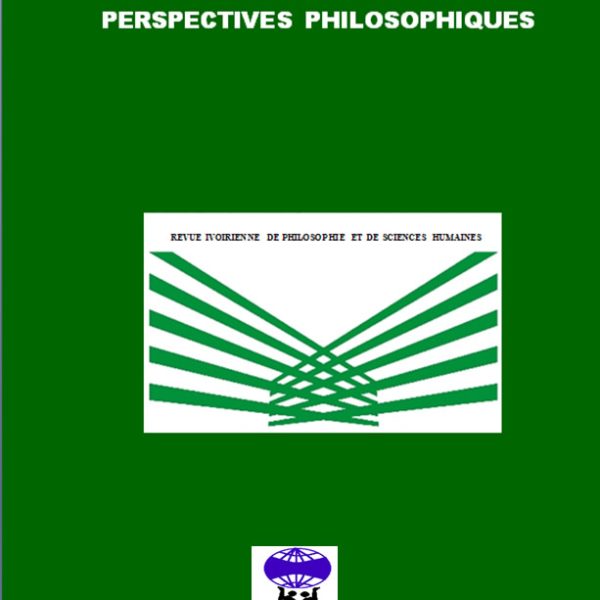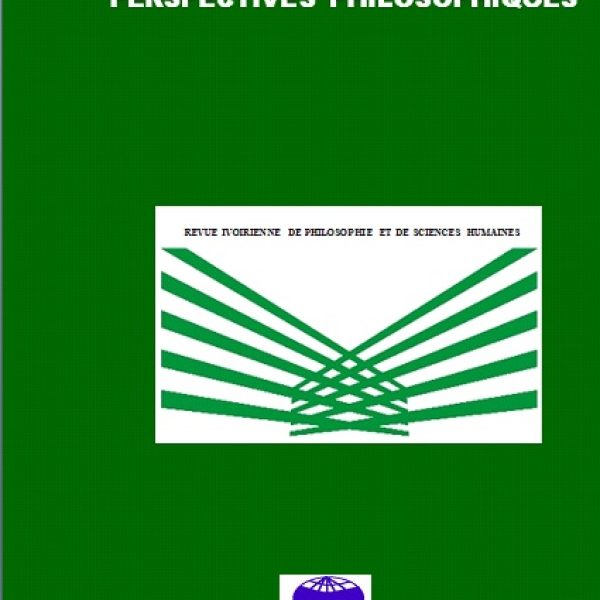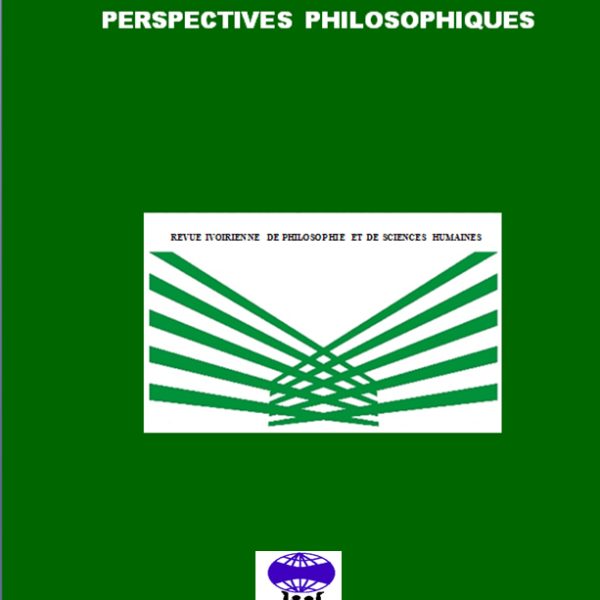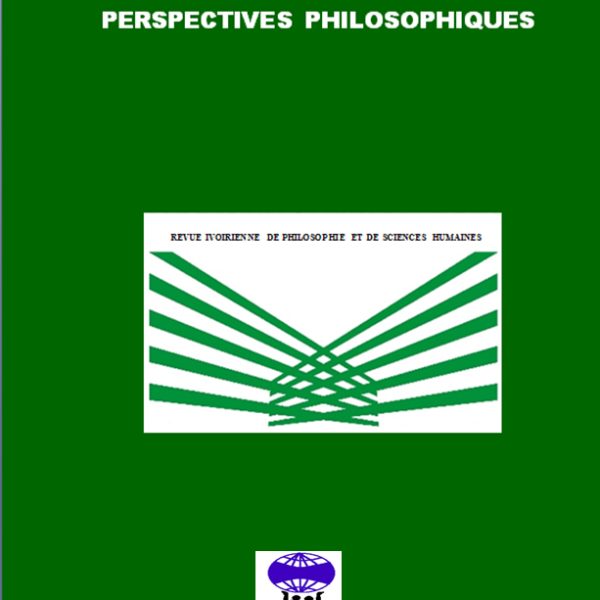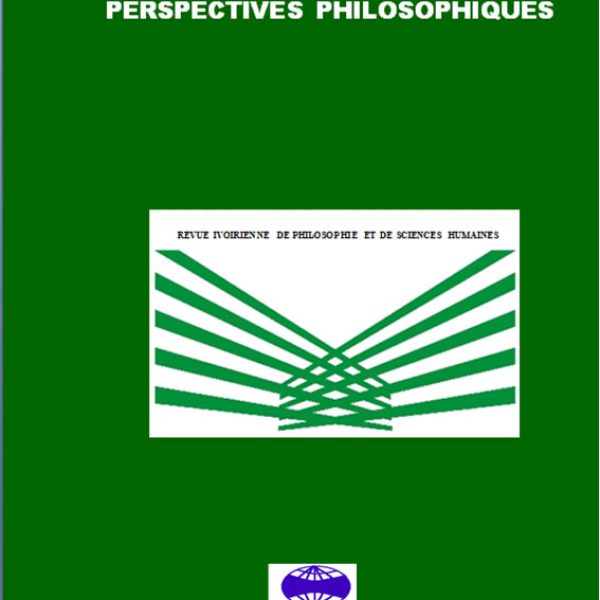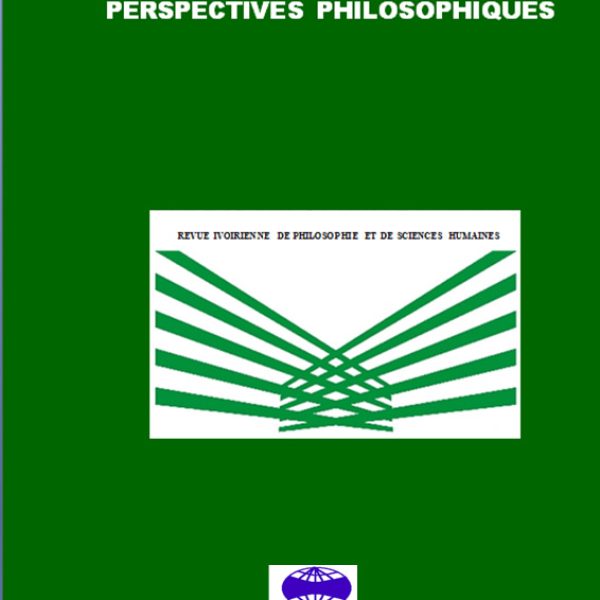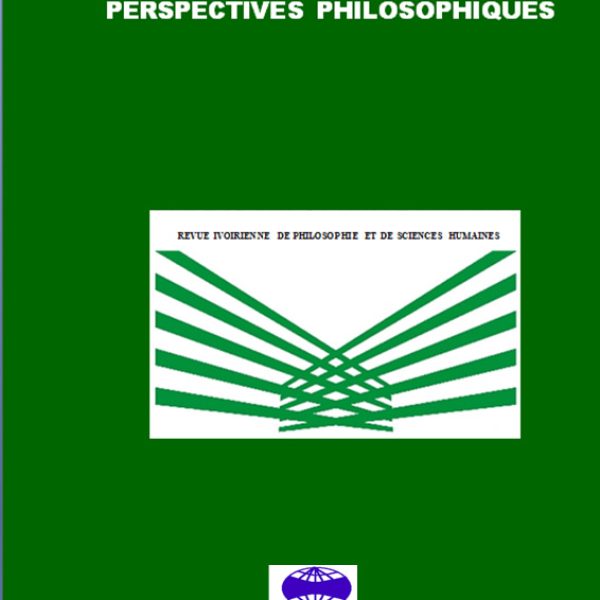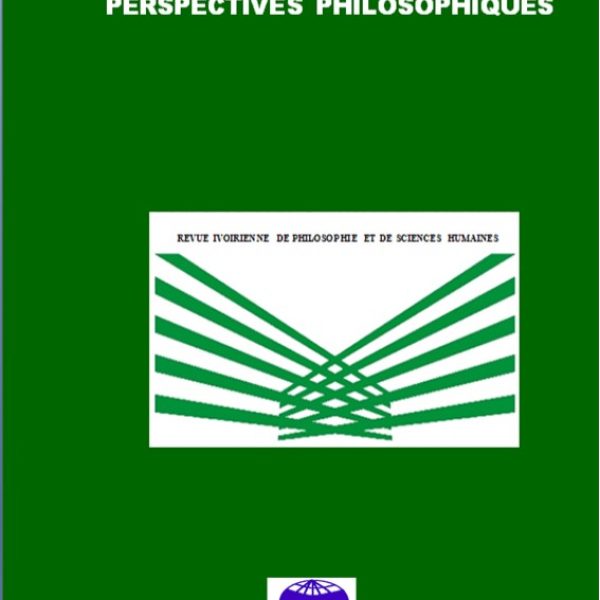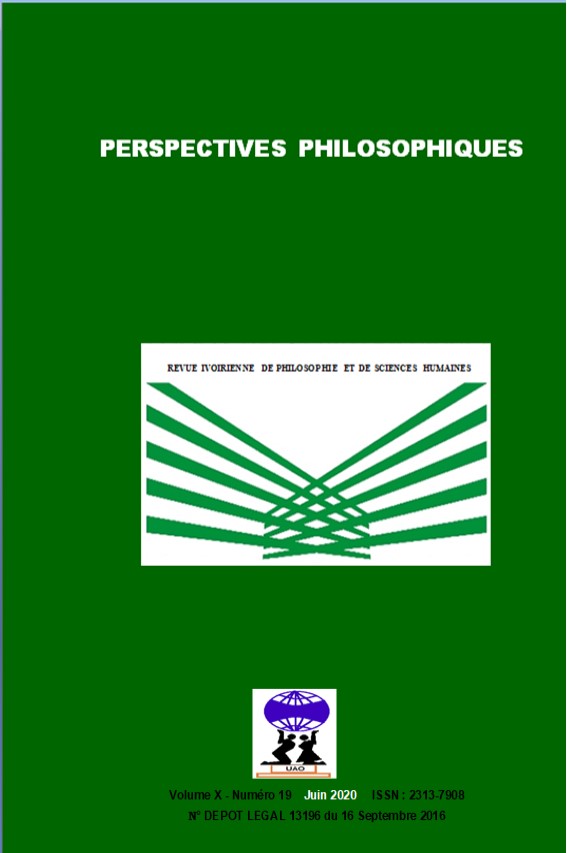
| Volume IX – Numéro 18 Décembre 2019 ISSN : 2313-7908N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : http:// www.perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Prof. N’dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités
Rédacteur en chef Adjoint : Prof. Assouma BAMBA, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane OUATTARA
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. N’Dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Prof. Abou SANGARÉ, Professeur des Universités
Dr. Donissongui SORO, Maître de Conférences
Dr Alexis KOFFI KOFFI, Maître-Assistant
Dr. Kouma YOUSSOUF, Maître de Conférences
Dr. Lucien BIAGNÉ, Maître de Conférences
Dr. Nicolas Kolotioloma YEO, Maître-Assistant
Dr. Steven BROU, Maître de Conférences
Secrétaire de rédaction : Dr. Blé Sylvère KOUAHO, Maître de Conférences
Trésorier : Dr. Grégoire TRAORÉ, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités
1. Au-delà de la table rase de Locke. Leibniz et la plénitude de l’âme,
Dimitri OVENANGA-KOUMOU ……………………………………………..………1
2. La logique, essence des mathématiques chez Leibniz,
Falikou FOFANA ……………………………………………………………….……..18
3. Les enjeux inavoués des guerres de religion et l’élan de tolérance religieuse du mystique bergsonien,
Kouassi Honoré ELLA ………………………………………………………………..38
4. Quelles appréhensions de la modernité à la lueur de la contribution scientifique de Claude Bernard ?,
Tiasvi Yao Raoul AGBAVON ……………………………………………………….57
5. La difficile démocratisation des États africains,
Adamou DILWANI ………………………………………………..…………….…….79
6. Le transhumanisme et le désir d’immortalité,
Christian Kouadio YAO …………………………………………………………..…99
7. Les enfants et la télévision : ce qu’ils regardent, nous regarde,
Kouakou Hilaire KOUAMÉ et Koffi Jacques Anderson BOUADOU …………..114
8. La métafiction ou l’acte de fabrication de la fiction dans Verre cassé d’Alain Mabanckou et Hermina de Sami Tchak,
Yayo Vincent DANHO …………………………………………………………..….130
9. Pratiques sorcellaires et devoir de justice en Afrique noire,
Franck KOUADIO ……………………………………………………………….….152
10. Quête du sens dans l’écriture poétique de Jules Laforgue,
N’guessan Antoine KOUADIO ……………………………………………………171
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
AU-DELÀ DE LA TABLE RASE DE LOCKE. LEIBNIZ ET LA PLÉNITUDE DE L’ÂME
Dimitri OVENANGA-KOUMOU
Université Marien Ngouabi (République du Congo)
Résumé :
Dans l’énoncé inaugural du Discours de la méthode, Descartes a procédé à la répartition équitable de la raison, c’est-à-dire qu’il l’a distribuée à tous sans exception. Sa théorie des idées innées dérivera pratiquement de là. La doctrine de la connaissance, telle que présentée par Locke, ne se construira que contre cette pensée cartésienne d’une raison innée et toute-puissante. L’homme n’acquiert toutes ses connaissances que par l’exercice de ses facultés naturelles empiriques. Par quoi le processus de l’apprentissage se justifierait-il, si tout est fixé en nous par la seule nature ? Inscrit dans la société, l’homme n’est-il pas affecté par son milieu de vie ? Pour lui, une notion innée, c’est-à-dire présente à l’âme dès la naissance, est impossible. Contre cette idée s’élèvera la sévère critique de Leibniz qui va lui opposer la plénitude de l’âme. Si l’âme est vide comme on l’a tant soutenu, faut-il s’interroger sur le lieu bien précis où elle-même se trouve.
Mots-clés : Âme, Aperception, Empirisme, Entendement, Perception, Sens, Table rase.
Abstract :
In the inaugural statement of the Discourse on Method, Descartes proceeded to the equitable distribution of reason, that is to say that he distributed it to all without exception. His theory of innate ideas will practically derive from there. The doctrine of knowledge, as presented by Locke, will only be constructed against this Cartesian thought of an innate and all-powerful reason. The man acquires all his knowledge only through the exercise of his empirical natural faculties. How would the learning process be justified, if everything is fixed in us by nature alone? Registered in society, is not man affected by his living environment? For him, an innate notion, that is to say present to the soul from birth, is impossible. Against this idea will be raised the severe criticism of Leibniz who will oppose him the fullness of the soul. If the soul is empty as it has been argued so much, should we question the very precise place where it is itself.
Keywords : Soul, Aperception, Empiricism, Understanding, Perception, Sense, Clean slate.
Introduction
Au-delà de la table rase de Locke. Leibniz et la plénitude de l’âme.Le choix de ce thème d’article a été motivé par la presque similitude qu’on trouve sur les titres d’ouvrages de base de ces deux philosophes. Si le livre de Locke est titré Essai sur l’entendement humain et celui de Leibniz Nouveaux essais sur l’entendement humain, il s’avère pressant de s’interroger sur le caractère combien innovant du dernier, si tant est qu’innovation il y a. La raison est toute simple, c’est que cette presque ressemblance qui peut être apparente pour l’œil extérieur, ne peut en aucune manière être gratuite. Pourquoi deux grands philosophes de la tradition peuvent-ils produire une même œuvre quasiment, s’il n’y a pas de critique de l’un par l’autre. Nous savons qu’une pensée essentielle traverse intacte la foule de ses contradicteurs, mais il ne peut pas en être le cas ici. En quoi les Nouveaux essais sur l’entendement humain de Leibniz innovent-ils ? Y a-t-il chez ce dernier simple prolongement, ou est-ce en vue de balayer par un revers de la main la pensée lockéenne qui se déploie dans cet ouvrage ? Voilà la piste principale de la présente recherche.
En effet, il est possible que Leibniz construise, s’opposant ostensiblement à la fameuse table rase de Locke, une table dite pleine, remplie dès le commencement par la nature créatrice. Il nous semble que cette pensée pourrait rejoindre celle un peu lointaine de Descartes et de tous les autres défenseurs de l’innéisme. Si chez Leibniz, l’âme est déjà pourvue, il faudrait peut-être penser dans le même mouvement que tout est réglé d’avance. Si tel est bien le cas, c’est qu’un être est cause de ces idées qui sont en notre possession. Est-ce Dieu cette cause ? Mais, cette connaissance qui nous est naturelle est- elle réellement aperçue par notre propre esprit ? Se déploie-t-elle à notre insu ? A ce moment précis, a-t-on droit de mettre en cause la connaissance innée sous prétexte qu’on devrait s’en apercevoir toujours ?
La méthode utilisée pour rechercher les différentes réponses à ces questions somme toute élastiques, est l’herméneutique qui consiste à interpréter les textes. On s’est efforcé, à travers cette méthode, de comprendre les auteurs en lice comme ils se sont compris eux-mêmes. Dans le corps de notre travail, il y a, dans un premier temps, une exposition des idées, partie qui rend visible notre propre compréhension. Nous avons dans un second moment, appuyé ces idées par les citations des auteurs convoqués. C’est cela précisément qui a permis de constituer, dans chaque paragraphe, un ensemble presque logique, formé des idées principales, idées appuyées par des justifications et suivies par des énoncés d’auteurs interprétés.
1. Locke et l’empirisme
1.1. Le sens de la table rase
Les Nouveaux essais sur l’entendement humain de Leibniz paraissent en 1704, l’année où l’auteur de l’Essai sur l’entendement humain tire malheureusement sa révérence. Cette attente de la mort de Locke a peut-être été volontaire. Quelque chose est nouveau, dans l’œuvre de Leibniz, lui qui s’érige naturellement en critique. Ce dialogue entre Locke et Leibniz permet de comprendre que tout texte philosophique est au fond un palimpseste, c’est-à-dire un écrit qui est écrit sur un autre écrit. On pourrait croire en la nouveauté des Nouveaux essais sur l’entendement humain. Sinon, penserait-on, en thématisant cette nouveauté, à ceci précisément qu’il s’agirait d’une succession simplement historique.
Dans la théorie de la connaissance, telle qu’exposée par Locke, l’âme de l’homme ne porte naturellement aucune pensée, ni aucun fondement qui pourrait, dans la mesure du possible, y conduire. Nous sommes nés, nous hommes, dépourvus. C’est pour autant dire que la nature qui nous a fait, n’a eu aucune volonté de remplir notre âme, de faire qu’elle soit déjà dotée dès le départ. Cette âme est rase, c’est-à-dire nue, sans rien, sans aucune essence qui se trouverait être son contenu. Est-ce pour qu’elle reste ainsi ? Est-ce pour qu’elle se pourvoie par la suite ? Elle est pour l’instant vide. Elle ne se remplit, cette table rase, que lorsqu’elle se met en relation avec la seule expérience, quand elle communique réellement avec l’extérieur. Ce qui voudrait dire que l’expérience est dans la théorie lockéenne de la connaissance, la source de cette dernière. L’homme ne connait qu’étant situé dans un espace et dans un temps précis. Il y a comme une sorte de confrontation entre l’âme en quête de savoirs et le monde extérieur massif. Les notions innées ne sont en réalité que les illusions que les hommes se font.
L’une des preuves tant soit peu magnifique de cette essence vide de l’âme est que, si l’on pense aux idées innées, il faudrait objecter que les enfants et les idiots n’en sont pas dotées. Si cette catégorie d’hommes n’en est pas pourvue, c’est qu’elles n’existent pas, en tant qu’elles ne sont pas dites générales. Est innée, une idée naturelle en chaque âme, en chaque homme. Dans son optique, l’enfant est enfant parce qu’il n’est doté de rien et la preuve de l’idiotie de l’idiot est qu’il n’a en lui aucune connaissance, aucune idée, sinon il ne serait pas l’idiot qu’il est. Locke ajoute qu’une idée ne peut en aucune manière être présente en l’âme sans qu’elle –même ne s’en aperçoive. Une idée est naturelle lorsqu’elle est perçue par l’âme qui en contient. On ne peut donc pas dire que l’enfant est doté parce qu’il ne le sait pas lui –même et ne le sent même pas. Pour lui, les promoteurs des idées innées n’ont peut-être pas tort, mais leur argumentation présente quand même une difficulté. Car, comment comprendre qu’il peut y avoir des idées imprimées dans l’âme sans qu’elle-même en connaisse le fonds. L’âme ne peut être pourvue que lorsqu’elle sait ce qui la remplit, pas autrement. J. Locke (2009, p. 136) écrit à ce propos : « Dire qu’une notion est gravée dans l’âme, et soutenir en même temps que l’âme ne la connait point, et qu’elle n’en a eu encore aucune connaissance, c’est faire de cette impression un pur néant ».
Nu au commencement, l’esprit de l’homme ne se remplit que lorsqu’il est frappé par les objets extérieurs. Ces derniers lui fournissent tous les matériaux possibles pour que quelque chose comme la connaissance soit effectif. A cet effet, la connaissance est ce qui résulte du contact entre notre âme et ce que lui apportent, par voie de transmission, les sens extérieurs. Le petit enfant n’apprend que par l’influence des choses exogènes à son esprit. De cette influence se produisent des idées qu’on nomme acquises. Avant cette influence et sans elle, notre esprit est à l’état embryonnaire de table vierge et vide. Elle est ainsi parce que faite de la sorte par le Créateur.
Aussi, les idées qui sont gravées naturellement dans l’âme ont une particularité. C’est qu’elles se montrent avec une facilité exceptionnelle. Elles ne peuvent qu’être retrouvées rapidement par leur possesseur. Or, Locke remarque malheureusement que ce n’en est pas le cas. Parlant de ces principes, on ne devrait en réalité pas faire de différence entre les gens doctes et les enfants ou les imbéciles, c’est-à-dire les idiots. Car ce sont des idées qui ne dépendent pas de notre volonté, nous hommes, mais de celle de la nature. J. Locke (2009, p. 156) est clair à ce sujet :
On peut tirer de là une autre preuve contre le sentiment de ceux qui prétendent que ces maximes sont innées, c’est que, si c’étaient autant d’impressions naturelles et originales, elles devraient paraître avec plus d’éclat dans l’esprit de certaines personnes, ou cependant nous n’en voyons aucune trace. Ce qui est, à mon avis, une présomption que ces caractères ne sont pas innés, puisqu’ils sont moins connus de ceux en qui ils devraient se faire voir avec plus d’éclat, s’ils étaient effectivement innés.
Les idées qui nous remplissent sont simplement celles qui ont rempli ou remplissent notre environnement immédiat. Et, par voie d’influence, nous les captons parfois même sans le savoir et sans peut-être même le vouloir.
Ce rejet des idées innées qui taxe au fond l’âme de table rase, est la pensée d’après laquelle, l’esprit de l’homme ne pense pas toujours. L’âme est faite toute nue et elle n’acquiert un contenu que par la suite, lorsqu’elle se loge dans une expérience. C’est peut-être une façon pour Locke de soutenir qu’il n’y a pas ou qu’il ne peut pas y avoir de connaissance pour un homme solitaire. De toutes les façons, il n’y a presque jamais eu d’homme dans cet état puisque, la solitude elle – même, lorsqu’elle est infinie, se retourne parfois comme la présence la plus manifeste. Le silence infini est d’ailleurs plus qu’une présence animale ou humaine. Nous n’apprenons que sur l’apprentissage des autres. Il y a donc une étroite relation entre notre âme, sans marques, et les objets extérieurs, producteurs de certaines impressions. Le contenu de l’âme est celui de l’expérience.
Supposons donc qu’au commencement l’âme est ce qu’on appelle une table rase, vide de tous caractères, sans aucune idée, quelle qu’elle soit. Comment vient-elle à recevoir ces idées ? Par quel moyen en acquiert-elle cette prodigieuse quantité que l’imagination de l’homme, toujours agissante et sans bonnes, lui présente avec une variété presque infinie ? D’où puise- t- elle tous ces matériaux qui sont comme le fond de tous ses raisonnements et de toutes ses connaissances ? A cela je réponds en un mot, de l’expérience : c’est là le fondement de toutes nos connaissances, et c’est de là qu’elles tirent leur première origine. (J. Locke, 2009, p. 215-216).
Les sens sont pour ainsi dire le moyen de communication entre les idées que nous recevons et l’entendement. La pensée est postérieure à la rencontre entre l’âme et les sens. L’esprit de l’enfant ne se réveille –t-il pas à mesure qu’il s’intègre dans la société ? Le fils des sourds-muets qui ne grandit qu’avec ses parents sans écouter un seul son, ne finit-il pas, s’il n’est pas déplacé et mis dans l’univers des gens qui parlent, par être lui aussi sourd-muet ? L’âme de l’homme ne se forme et ne s’enrichit d’idées que si elle réagit contre ce qui la frappe.
Cette table rase qui s’est constituée sur fonds de la critique de l’innéisme, n’est- elle pas défendue partiellement par Kant qui s’érige en arbitre du débat entre Locke et Leibniz ?
1.2. Les lacunes de l’arbitrage kantien pour l’empirisme
Arbitre du débat entre deux éminentes doctrines de la tradition philosophique, Kant procède à une critique sans équivoque et même sans parti pris. Pour lui en effet, il n’est pas possible de constituer une connaissance réelle, indépendamment du recours à l’expérience. Il établit que la connaissance implique tant l’action de la raison, c’est-à-dire de l’entendement, que celle de l’expérience en tant que telle. Lorsqu’il critique l’innéisme, il pense que la connaissance est un tout, elle n’est pas faite que de pensée seule, d’objet aussi. Or les objets ne nous viennent que de l’expérience. C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle il estime que cette dernière est le point de départ de toute connaissance véritable. C’est de là que viennent les matières indispensables à notre activité cognitive. Car, dans le processus de la connaissance, la base est l’éveil de l’esprit connaissant. Or cet éveil est impossible en l’absence des objets qui frappent notre conscience. L’enfant n’apprend-il pas à marcher parce que, voyant des gens qui marchent dans son milieu de vie immédiat, il voudrait les imiter. Et, il parle parce qu’il entend autour de lui des sons. De telle sorte que celui qui est placé, dès le début de son existence, au milieu des bêtes qui marchent plutôt à quatre pattes, marchera lui aussi ainsi ; celui qui n’entend aucun son, ne parlera jamais et, il faudrait l’ajouter, n’entendra non plus. Sans expérience, aucune connaissance. « Que toute notre connaissance commence avec l’expérience, cela ne soulève aucun doute. » (Kant, 1980, p. 31).
L’œuvre de l’entendement qui est celle de penser, c’est-à-dire de lier à notre esprit précisément, ce qui vient du contact avec les objets extérieurs, n’est pas la seule nécessaire. Car avant de lier les impressions des objets, il faudrait d’abord les avoir. Ces derniers sont fournis par l’expérience seule. Kant (1980, p. 77) écrit : « Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné… Des pensées sans contenu…sont vides ». Cet arbitrage kantien ne vise qu’à établir ce qui peut s’appeler une commune mesure entre l’innéisme et l’empirisme. Ainsi, pour une connaissance digne de ce nom, la sensibilité et l’entendement doivent être tous tenus pour des chemins importants qui y conduisent. L’action d’un de ces deux pouvoirs est comme complétée par l’autre. La sensibilité pourvoie en objets ou en intuitions notre esprit. Négliger l’une de ces deux fonctions essentielles, reviendrait ipso facto, à rendre partielle notre connaissance. Un élève, dans un domaine quelconque, a besoin non seulement de la matière de son apprentissage, mais aussi de la compétence qui lui permet de capter et fixer à sa mémoire tout ce qu’il a appris. La différence entre les élèves intelligents et ceux qui ne le sont pas vient précisément de là. La défense de l’empirisme permet à Kant de se séparer momentanément de l’Ecole rationaliste. Cette position le pousse à faire asseoir l’origine de nos connaissances dans la sensibilité. Dans sa théorie de la connaissance, toute représentation est comme réduite à la sensibilité pour une raison toute simple. C’est que les idées en général sont vues comme des copies des impressions qui se dégagent lorsque notre esprit est au contact avec les objets extérieurs. Si par pur hasard, on ne se trouve qu’en face des concepts, il faudrait les sensibiliser pour que la connaissance puisse s’avérer possible. Cette action est simplement une des manières de mettre en rapport les idées aux objets spécifiques qui les représentent.
Par ailleurs, si la connaissance ne vient que de l’interrelation entre expérience et raison comme l’a su dire Kant, posons-nous une question : où ce philosophe classe-t-il la capacité qu’a notre cerveau à créer un remède à une fonction défaillante ? Nous savons en général que le désir du grand effort est le plus souvent créateur de génie, c’est-à-dire de connaissances. Quand on est véritablement dans une impasse réelle, quand on est dans de difficultés énormes, l’esprit finit par créer des conditions qui lui permettent de s’élever à un stade meilleur. Ces connaissances que peut créer l’esprit en peine sont comme en dehors et de l’expérience et de l’entendement. C’est ce qui ne semble pas avoir été signalé par l’entreprise kantienne. Lorsqu’on est faible par un côté, l’esprit finit par inventer quelque chose qui compense sous un autre côté, cette faiblesse. On sait pertinemment qu’une mutilation quelconque ou une atrophie de n’importe quelle forme ou encore un défaut sensible d’un organe, donne plus de force à un autre organe de développer parfois, à une vitesse non habituelle, des qualités d’un autre ordre. C’est la manière pour notre organisme de se pourvoir des fonctions en plus de celles purement naturelles. Ces compétences sont à vrai dire, extérieurs aux pouvoirs de l’expérience et de l’entendement et donc au-delà du criticisme. L’esprit a donc le pouvoir d’aller bien au-delà de lui-même et de compléter ses propres défaillances. C’est d’ailleurs la thèse beaucoup plus actuelle que soutient Alain Berthoz qui, inventant ce qu’il appelle la vicariance pense à travers elle que le cerveau a la possibilité de créer une suppléance à une fonction détruite. C’est ce qui permet aux aveugles par exemple de voir par l’entendre et aux sourds d’entendre par la vue. Le cerveau est pour ainsi dire armé d’un système d’auto-défense sans pareil, système qui est, disons-le assez clairement, au-dessus du pouvoir de ces deux facultés. Cela permet la fusion pure et simple de la physiologie à la phénoménologie. Signalant ce rapport, Alain Berthoz et Jean-Luc Petit (2006, p. 38) disent :
Si la philosophie peut être utile à quelque chose, c’est bien à aider à formuler des hypothèses générales. Notre collègue au Japon Ideo Sakata, qui a découvert les neurones du cortex pariétal codant la forme des objets, nous disait avoir été inspiré dans la formulation de son expérience par les textes de Merleau-Ponty sur la perception.
Ces compétences particulières de notre activité cérébrale rayonnent bien loin des pouvoirs sus-présentés. Disons donc que, même mis ensemble, l’expérience et la raison ne peuvent en aucune manière finir complètement l’activité de la connaissance. Le criticisme kantien est peut-être lui aussi limité.
2. Leibniz et la pertinence de l’innéisme
2.1. La puissance créatrice de l’âme
En effet, avec l’auteur des Nouveaux essais sur l’entendement humain, la table rase de Locke est revisitée. Cette table ainsi qualifiée, n’est pas complètement nue dans la mesure où elle contient les facultés qui ne sont pas introduites dans l’âme par les objets extérieurs, mais qui sont seulement stimulés par ces objets, parce qu’elles existent en amant. Ce qui revient à dire que les perceptions qui sont contenues dans notre esprit, ne s’originent aucunement dans les sens comme on l’a tant entendu. L’expérience ne donne rien de nouveau ; elle ne fait qu’éveiller ce qui sommeille en nous. Dans la constitution de la connaissance, les sens ne sont pas rien. Mais, ils n’ont pas le pouvoir de finir toute la théorie de la connaissance, de sorte qu’on puisse dire qu’elle ne viendrait que d’eux.
Les sens, quoique nécessaires pour toutes nos connaissances actuelles, ne sont point suffisants pour nous les donner toutes, puisque les sens ne donnent jamais que des exemples, c’est-à-dire des vérités particulières ou individuelles. (G. W. Leibniz, 1990, p. 38)
L’âme de l’homme n’est pas dépourvue complètement. Car, même si l’on accepte que les sens fournissent un petit quelque chose à notre esprit, il faudrait encore se questionner sur la capacité de l’âme à acter ces informations en provenance des sens. Si l’âme réussit à insérer en elle ces impressions, c’est qu’elle n’est pas vide au commencement. Il y a un corps de principes, même minime qui lui permet de se mettre effectivement en communion avec son extérieur. Si elle n’est pas pleine de connaissances, elle est néanmoins dotée du pouvoir d’accéder aux connaissances. L’intelligence n’est fondée que sur un fonds naturel. Ce fonds ne diffère que suivant des degrés.
Entre l’âme et les sens, tout se passe comme si ces derniers activent l’acte de la réminiscence. Tout est gravé en nous et les sens sont une aide ; ils nous permettent de retrouver ce qui est en nous, vite ou lentement. Voilà leur lien. « Il ne nous faut que le commencement d’une chanson pour nous ressouvenir du reste » (G. W. Leibniz, 1990, p. 40).
La critique leibnizienne de Locke est celle de proclamer si haut, le caractère fictif de la table rase. Car il y a en nous une diversité d’idées, de perceptions qui malheureusement, ne sont pas automatiquement constatées par l’âme qui les contient. Tout ce qui est en nous ne peut pas être vu, surtout pas d’un seul coup. Il y a un fonds qui reste tapis dans l’inconscient, mais qui finira par s’exposer ou par être reconnu.
Il y a mille marques qui font juger qu’il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c’est-à-dire des changements dans l’âme même dont nous ne nous apercevons pas, parce que ces impressions sont ou trop petites et en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu’elles n’ont rien d’assez distinguant à part , mais jointes à d’autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l’assemblage. (G. W. Leibniz, 1990, p. 41).
Le problème, poursuit Leibniz, est que ces impressions qui sont naturelles, sont tellement anodines qu’elles ne peuvent en aucune manière être remarquées par notre esprit au plus vite. C’est ce que l’auteur appellera les petites perceptions. On ne peut refuser la plénitude de l’âme que si et seulement si on ne prête attention à ces perceptions, qui parfois, ne sont pas si claires. « Les impressions qui sont dans l’âme et dans le corps, destituées des attraits de la nouveauté, ne sont pas assez fortes pour s’attirer notre attention et notre mémoire, qui ne s’attachent qu’à des objets plus occupants » (G. W. Leibniz, 1990, p. 41). Il suffit de regarder chacun avec beaucoup plus d’attention, on se rendra toujours compte que nous sommes, chacun à sa manière et à son degré, nanti d’un certain nombre de choses .Toute la difficulté est que toute possibilité de faire attention demande plus de mémoire. On ne s’aperçoit pas de toutes les perceptions présentes en nous. Car, l’aperception elle, est lente et ne se réalise pas d’un seul trait.
Par conséquent, la perception n’est aucunement extérieure, mais plutôt intérieure à l’âme d’où elle vient. Les impressions, les connaissances, telles que nous pouvons nous les représenter, ne sont pas les productions de nos sens, mais partent à l’inverse, de l’activité de notre âme. Comment concevoir à ce moment une âme qui serait une tabula rasa ? « Tout ce que nous recevons par les sens sont des impressions qui existent dans l’âme, ou plutôt qui n’ont aucune autre existence que l’existence donnée de l’âme ». (A. Nita, 2008, p. 116). Disons donc que toute perception qui naît de la relation entre l’âme et les sens, part simplement de la première. Elle n’est, à cet effet, qu’intérieure et demeure une représentation des choses extérieures : on ne peut pas parler de table rase à ce moment. Que l’âme soit pleine ou pas, que cette plénitude lui vienne des sens, il faut un pouvoir qui fixe tout cela à la mémoire. Ce pouvoir est comme partagé entre les sens et l’âme. Si la connaissance vient des sens, il aide à lier les impressions qui s’en originent ; au cas où elle serait naturelle, c’est-à-dire ancrée à priori dans l’âme, il facilite la réminiscence. Voilà ce qui est comme au-delà du débat entre Locke et Leibniz et complète comme l’arbitrage de Kant. Car il faut cette force particulière de l’esprit qui, du côté de l’expérience nous y intègre effectivement et qui, de celui de l’entendement, fournisseur principal de concepts combien nécessaires, nous aide à les retenir de façon dynamique. N’y a-t-il pas de ceux qui finissent par perdre leur don par manque d’exercice ?
Dans l’optique de Leibniz, il est vraiment incompréhensible de rejeter les connaissances innées. Car, il est certain qu’il y a en nous des choses que nous même ne connaissons pas, mais que nous finirons par connaître avec le temps. La méthode socratique, la maïeutique, à travers laquelle Socrate aidait l’enfant à savoir ce qu’il savait déjà, en est la preuve plus que tangible. Il y a en nous des choses dont on est immédiatement conscient, d’autres non. Logiquement, on ne peut pas douter de cela. Il ne nous arrive-t-il pas de chercher dans notre mémoire un nom, pendant longtemps, nom qu’on finit par retrouver ? Il nous arrive aussi d’oublier de mettre à exécution un projet, dont on se souvient cependant plus tard et qui, par conséquent n’est oublié que momentanément. C’est la preuve que tout ce que nous savons peut ou ne pas être retrouvé si vite. « Nous avons une infinité de connaissances dont nous ne nous apercevons pas toujours, pas même lorsque nous en avons besoin. » (G. W. Leibniz, 1990, p. 60). Cette connaissance innée qui est comme enfouie dans le tréfonds de notre âme est l’œuvre de ce que Leibniz appelle le doigt de Dieu. Elle provient de l’intelligence suprême. C’est en cela que les connaissances innées sont toutes vraies, contrairement aux idées dites adventices, celles qui proviendraient des organes de sens qui ne sont formées que des mensonges de ces organes. S’il est entendu que Dieu nous a fait à son image, nous avons, nous hommes, une partie de son intelligence infinie. On ne peut donc parler de table rase à propos de l’âme qu’avec la possibilité d’y émettre quelques réserves. « Cette tabula rasa dont on parle tant n’est à mon avis qu’une fiction… » (G. W. Leibniz, 1990, p. 87). Pour Leibniz, la table rase ne l’est que si on l’a dépouillé de force. Elle est effectivement rase parce que l’on vient de la raser. Elle ne l’est aucunement par elle –même, mais par l’action d’une force extérieure.
Si par hasard, on peut admettre la thèse qui établit que les sens produisent un certain nombre d’impressions, il faudrait aussi accepter que celles-ci sont inferieures en quantité et en qualité, comparativement à celles produites par notre âme qui est beaucoup plus rayonnante et extensive. D’ailleurs, l’âme va plus loin que les organes de sens qui ne sont que corporels. Elle s’enfonce dans le passé, parfois de manière harmonieuse et se projette dans le futur. C’est même un non-sens que de soutenir que tout ce qui est dans l’âme ne peut venir que des sens. A ce moment-là, faut-il s’interroger sur la provenance et de l’âme elle-même et de ses affections. L’âme, c’est une intelligence, l’expérience, un simple contact. Elle n’est pas vide, elle est riche de contenu. C’est dans ce sens que G. W. Leibniz (1990, p. 88) écrit : « L’âme renferme l’être, la substance, l’un, le même, la cause, la perception, le raisonnement, et quantité d’autres notions, que les sens ne sauraient donner ». On ne doit pas nier que l’âme pense toujours, sous prétexte que toute perception qui s’y trouve doit être explicite. Car, il y a des perceptions généralement petites qui ne s’éclaircissent qu’au fur à mesure. Lorsqu’on entend quelque bruit clairement, c’est qu’on l’a entendu obscurément depuis un peu plus longtemps, parfois même sans le savoir. Voilà pourquoi chez Leibniz, le bruit de la grande mer n’est, en effet, que le résultat du bruit beaucoup plus fin de petites vagues. Les perceptions, quelles qu’elles soient, ont le plus souvent une antériorité imperceptible. Si l’on ne perçoit pas ainsi ces perceptions qui ne bénéficient pas trop de visibilité, on ne peut aucunement croire en la plénitude de l’âme.
Pourfendeur des idées dites acquises et défenseur de celles dites innées, Carl Gustav Jung pense, soutenant ainsi les positions leibniziennes que l’entendement humain est, à la naissance, déjà pourvu. Il y a, de son point de vue, de nombreuses et immenses connaissances qui sont, à n’en point douter, enfouies dans le tréfonds de notre âme, que celle-ci s’en aperçoive ou pas. En effet, il faut signaler que dans la logique de ce psychiatre, les choses n’ont, en elles-mêmes, aucun sens. Tout ce qu’elles ont comme signification n’en est introduit que par l’âme humaine. Cette âme est naturellement pourvue de la capacité à se représenter le réel. Elle ne peut en aucun cas être prise pour une table rase. Elle est, au contraire, une table dite remplie. La connaissance est présente dans notre âme, qu’elle soit retrouvée ou pas par le sujet qui la possède. C’est cela l’innéisme de type leibnizien, défendu ici par Jung (1976, p. 83) :
Que l’on désigne l’arrière-plan de l’âme du nom que l’on voudra, il n’en reste pas moins que l’existence et la nature même de la conscience sont de façon inouïe sous son emprise, et dans une mesure d’autant plus grande que cela se passe davantage à son insu. Le profane, il est vrai, peut difficilement discerner combien il est influencé dans tous ses penchants, ses humeurs, ses décisions par les données obscures de son âme, puissances dangereuses ou salutaires qui forgent son destin. Notre conscience intellectuelle est comme un acteur qui aurait oublié qu’il joue un rôle.
A ce moment, on peut dire sans craindre de se tromper que toutes les perceptions qui sont dans l’âme viennent de l’âme elle-même. Nous n’en ignorons que quand elles demeurent encore anodines. Parlant concrètement de ces idées, de ces perceptions qui ne sont pas aperçues d’un seul coup, Leibniz fait référence à l’idée de faim qui n’est manifeste que quand on y pense, que quand on y prête réellement attention. Lorsqu’on a faim sans s’en préoccuper véritablement, elle ne s’exprime pas aussitôt. Tout ce qui est dans l’âme ne peut pas se manifester automatiquement. Est-ce là le triomphe de l’idée ?
2.2. Le triomphe de l’idéalisme : arbitrage kantien pour l’innéisme
Interprétant le rationalisme, ce courant qui réduit purement et simplement le champ de la connaissance à la raison seule, Kant établit clairement que l’expérience tant vantée n’est pas l’unique source de la connaissance certaine. Ce philosophe conciliateur estime que la connaissance est un tout ; elle n’est pas faite que d’objet seul, de pensée aussi. Avec les intuitions seules, il n’est absolument pas possible de constituer quelque chose comme la connaissance. L’œuvre de l’entendement qui est celle de penser, c’est-à-dire de lier à notre esprit précisément, ce qui vient du contact avec les objets extérieurs, est aussi nécessaire. C’est la raison pour laquelle Kant (1980, p. 31-32) écrit :
Si toute notre connaissance débute AVEC l’expérience, cela ne prouve pas qu’elle dérive toute de l’expérience, car il se pourrait bien que notre connaissance par expérience fût un composé de ce que nous recevons des impressions sensibles et de ce que notre propre pouvoir de connaître (…) produit de lui-même (…).
Ainsi, même la connaissance par expérience est subrepticement mêlée de l’espèce de force que lui confère le pouvoir de l’entendement. Car il y a un tri imperceptible qui se réalise sur ce que nous recevons de ces impressions sensibles et ce tri est, à n’en point douter, l’œuvre de notre unique entendement. L’importance de ce pouvoir tient en ceci précisément qu’il pense les phénomènes donnés par la sensibilité et par conséquent, complète cette dernière. Combattant l’empirisme à ce niveau, le criticisme qui se rapproche, cela est clair, du rationalisme, ramène la connaissance à l’entendement dans la mesure où et pour autant que les représentations sensibles sont le plus souvent des idées confuses. La pertinence de l’innéisme est prouvée par sa capacité à intellectualiser les phénomènes. Il y a, à cet effet, non seulement chez Leibniz lui-même, mais aussi chez Kant, ne serait-ce qu’au niveau où nous sommes, une sorte de négation de la spécificité de la sensibilité, ceci, au profit de l’entendement. La faiblesse principale de la connaissance sensible est qu’elle n’a pas le pouvoir de fournir, de manière distincte, à notre esprit les choses dans leur essence même, mais seulement de simples reflets. Le rôle plus qu’utile de ce pouvoir se révèle dans sa capacité à faire que les concepts soient comme ajoutés aux objets extérieurs. Il pense ces objets. « …Sans l’entendement nul ne serait pensé » (Kant, 1980, p. 77). Ce qui est certain est qu’il y a en général des connaissances qui ne passent pas par le détour de l’expérience. Pour s’en rendre effectivement compte, il suffit de faire l’exégèse des savoirs que possèdent les surdoués et les génies de toute sorte. Ces derniers n’ont à peu près rien appris et pourtant, ils donnent la preuve de connaissances immenses. Défendant l’innéisme Kant ne fait jusqu’ici que vanter l’idéalisme, la présence et la puissance des idées dans le processus de la connaissance.
Cet arbitrage kantien ne vise qu’à établir ce qui peut s’appeler une commune mesure entre l’innéisme et l’empirisme. La puissance de son propos se révèle en ceci que ce philosophe a su opérer la réconciliation entre ces deux doctrines, la connaissance étant le résultat de la complémentarité entre intuition et concepts. Le criticisme se laisse à entendre comme cette doctrine qui critique effectivement le réductionnisme tant de l’empirisme que de l’innéisme.
Notre connaissance dérive dans l’esprit (…) de deux sources fondamentales ; la première est le pouvoir de recevoir les représentations (la réceptivité des impressions), la seconde, celui de connaître un objet au moyen de ces représentations (spontanéité des concepts). (Kant, 1980, p.76).
Conclusion
Dans le cours de cette confrontation, nous avons découvert qu’en réalité, John Locke, n’a considéré l’âme comme une tablette vierge de tout remplissement qu’en vue de s’opposer manifestement au rationalisme cartésien et peut-être même platonicien. Nos idées ne proviennent, dit-il, que de nos sensations et de la réflexion qui les organise. C’est une autre manière de dire que la connaissance se limite aux phénomènes et ne peut atteindre les essences qui elles, sont cachées. Cette table rase lockéenne est néanmoins discutable. Elle ne peut être ainsi que si on lui enlève ses idées. Nous avons vu à travers cet article que l’âme est pleine d’un pouvoir naturel qui lui permet de rendre véritablement présent tout ce qu’il est possible de recevoir du dehors. Même si l’on s’accorde avec Locke pour dire que la connaissance ne vient que d’une source unique, l’expérience, il faudrait s’interroger sur la fixation à notre esprit de ce qui s’y dégage. Par les facultés de la rétention et d’ailleurs même de la mémoire, c’est-à-dire de cette imagination reproductrice dont l’homme est capable, il est possible de dire que l’âme n’est pas toute nue. Elle est pleine avant même d’être remplie. N’est-ce pas parce qu’il trouvait que les élèves qu’il enseignait étaient tout sauf des tables rases en question, que le sage Socrate refusait ostensiblement de leur faire payer ses enseignements ? Contrairement aux philosophes mercantilistes, c’est-à-dire les Sophistes qui eux pensaient transmettre un savoir réel aux apprenants. La connaissance, depuis Socrate était une réminiscence dans la mesure où et pour autant qu’elle sommeillait en chacun de nous homme. Cette logique est celle que nous tirons de cette confrontation entre Locke d’une part, et Leibniz de l’autre. Ce qui est greffé à notre esprit est, sinon la connaissance en tant que telle, du moins le pouvoir subreptice qui permet à l’homme de capter tout ce qui vient du dehors. Car, le problème est que l’expérience tant vantée, donne des matières, ce ne signifie pas pour autant que les pensées elles, n’existent pas, nonobstant leur quasi invisibilité. D’où vient-il que certains hommes sont plus avertis, plus intelligents que d’autres, même si tous vivent dans le même espace et le même temps ? Quand nous sommes influencés par les mêmes choses, nous n’avons pas tous la même rétention, le même souvenir. Plus haute que l’expérience, s’érige la différence naturelle, différence fondée sur la possession du pouvoir de connaître.
Références bibliographiques
BELAVAL Yvon, 1960, Leibniz critique de Descartes, coll. Bibliothèque des idées, Paris, Gallimard.
BELAVAL Yvon, 1975, Leibniz Initiation à sa philosophie, coll. Bibliothèque d’histoire de la philosophie, Paris, Vrin.
Berthoz Alain et Petit Jean-Luc, 2006, Physiologie de l’action et phénoménologie, Paris, Odile Jacob
BOUTROUX Emile, 1991, La philosophie de Leibnitz, in LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, La monadologie, coll. Livre de poche, Paris, Librairie Générale Française.
BRYKMAN Geneviève, 2001, Locke : idées, langage et connaissance, Paris, Ellipses.
DESCARTES René, 1953, Les principes de la philosophie, in Descartes René, Œuvres et lettres, Textes présentés par André Bridoux, coll. La pléiade, Gallimard.
DESCARTES René, 2010, Discours de la méthode, in Descartes René Œuvres philosophiques, T1-1618-1637, coll. Textes de philosophie ; textes établis, présentés et annotés par Ferdinand Alquié, Paris, Editions Classiques Garnier.
DUPUY Maurice, 1972, La Philosophie allemande, coll. Que sais- je ? Paris, P.U.F.
HAUMESSER Mathieu, 2003, Essai sur l’entendement humain. Locke, Paris, Ellipses.
JUNG Carl Gustav, 1976, L’homme à la découverte de son âme, tr. f. Roland Cahen, Paris, Payot.
KANT Emmanuel, 1980, Critique de la raison pure, coll. Bibliothèque de philosophie contemporaine, tr. f. A.Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, PUF.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1990, Nouveaux essais sur l’entendement humain, coll. GF, Paris, Flammarion.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1991, La Monadologie, coll. Livre de poche, Paris, Librairie Générale Française.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm,2001, Discours de métaphysique, tr. f. Christiane Frémont, coll. G.F, Paris, Flammarion.
LOCKE John, 2009, Essai sur l’entendement humain, tr. f. Pierre COSTE, coll. Livre de poche, Paris, Librairie générale Française.
MICHAUD Yves, 1986, Locke, Paris, Bordas.
NITA Adrian, 2008, La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, coll. Ouverture philosophique, Paris, L’Harmattan.
PARMENTIER Marc, 1999, Introduction à l’Essai concernant l’entendement humain de Locke, Paris, PUF.
RAUZY Jean Batiste, 2001, La doctrine leibnizienne de la vérité, coll. Bibliothèque d’histoire de la philosophie, Paris, Vrin.
RIVELAYGUES Jacques, 1991, La Monadologie de Leibniz, in LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, La monadologie, coll. Livre de poche, Paris, Librairie Générale Française.
SERRES Michel, 1968, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, coll. Epiméthée, Paris, P.U.F.
TADIE Alexis, 2004, Locke, coll. Figures du savoir, Paris, Les Belles Lettres.
LA LOGIQUE, ESSENCE DES MATHÉMATIQUES CHEZ LEIBNIZ
Falikou FOFANA
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Leibniz (1646-1716) est l’une des figures emblématiques du dix-septième siècle (XVIIᵉ siècle). Il pousse ses investigations dans le domaine des mathématiques en passant par celui de la logique. Philosophe allemand, passionné des sciences, Leibniz s’inscrit dans un mouvement plus général annonçant les Lumières où l’on s’efforce de raisonner dans tous les domaines non seulement à la manière des géomètres en s’appuyant sur des démonstrations, des axiomes, des postulats, des définitions et des principes logiques de raisonnement mais aussi à la façon de la plupart des mathématiciens en montrant l’importance de la géométrie, de la combinatoire, des probabilités dans les mathématiques.
Mots-clés : Combinatoire, Géométrie, Logique, Mathématiques, Probabilités.
Abstract :
Leibniz (1646-1716) is one of the emblematic figures of the seventeenth century. He pushes his investigations in field of mathematics through that of logic. German philosopher, passionate about science, Leibniz is part of general more movement announcing the Lights where we are trying to reason in all areas not only in the manner of the geometers based on demonstrations, axioms, postulates, the definitions and logical principles of reasoning but also in the manner of most mathematicians by showing the importance of geometry, combinatorial, probabilities in mathematics.
Keywords : Combinatorial, Geometry, Logic, Mathematics, Probabilities.
Introduction
Leibniz, grand mathématicien, est aussi une des grandes figures de la civilisation européenne. Il a produit une œuvre philosophique de premier plan. De ses diverses découvertes en physique en passant par la construction d’une machine à calculer supérieure à celle de Blaise Pascal, Leibniz s’est intéressé à la numération binaire et à la logique.
En effet, Leibniz a subordonné ses investigations à la recherche d’une science universelle dévoilant éléments et structure, raison et processus, variété et unité, harmonie et beauté. Par la mathesis universalis, il faisait communiquer entre eux les mondes du fini et de l’infini, les sciences et les arts, la philosophie et la religion. Cette mathématique universelle a une importance qui est évidemment beaucoup symbolique que réelle. Pour le sens populaire, les mathématiques sont vues comme une théorie qui fournit le moyen de calculer sur des nombres et la logique comme une théorie qui s’occupe de formuler les règles de la déduction correcte. Mais pour Leibniz, cette distinction, mieux cette dichotomie n’est qu’apparente, car toute déduction est un calcul et inversement, tout calcul, en forme, se présente comme une déduction, comme le montre la démonstration qu’il donne de 2+2=4 dans les Nouveaux essais. De ce constat, Leibniz exige de toutes les propositions mathématiques comme vraies y compris les axiomes de l’espèce usuelle, qu’elles soient réductibles à des identités explicites et le soient par l’intermédiaire de définitions.
Aussi, Leibniz est l’un des deux fondateurs de l’Analyse mathématique. Ainsi, inventeur de calcul infinitésimal, les résultats de ses découvertes sont innombrables et remarquables. L’un des plus important est le Théorème fondamental de l’Analyse à savoir que dérivation et intégration sont des opérations sur les fonctions en quelques sortes inverses l’une de l’autre. Dans ces conditions, on peut dire que le mot même de fonction est dû à Leibniz. Sachons que la même découverte à savoir le calcul infinitésimal avait été faite par Isaac Newton avec un point de vue et des notations différentes. Il semble que les découvertes des deux penseurs aient été indépendantes. Mais le fait que Leibniz et surtout Newton attendaient très longtemps pour publier leurs résultats favorisaient ce genre de controverses.
À la différence de Newton, Leibniz met au point les bases de sa version du calcul des infinitésimaux : le principe du calcul intégral et celui du calcul différentiel. Aussi, les recherches ou les investigations sur lecalcul infinitésimal mettent en jeu le triangle caractéristique. G. W.Leibniz (1903, p. 589) dit en avoir tiré des « considérations fécondes ». C’est dans ce sillage que Leibniz envisage de constituer un alphabet des pensées humaines, des signes ou caractères élémentaires invariables, susceptibles de donner lieu à toutes les combinaisons possibles, c’est-à-dire non contradictoires. Cette science générale est appelée à fournir une symbolique universelle, mieux une caractéristique alphabétique ou numérique qui devrait être à la fois indépendante des langages particuliers et plus riche, plus précise et transposable à toutes disciplines, notamment à la géométrie.
En outre, parmi les travaux leibniziens, on peut citer un Essais d’une nouvelle science des nombres sur le système binaire. Il avait aussi développé tout un travail sur les déterminants mais Leibniz ne le publia pas de son vivant. Dans la même veine, les travaux juridiques sont l’occasion pour Leibniz d’approfondir les questions de preuves et celles de logique, comme l’illustrent ses travaux sur « l’Art combinatoire » d’après L. Couturat (1901, p. 36) et sur « la jurisprudence » comme G. W. Leibniz (1667, p. 36) nous le fait savoir. Dans l’Art combinatoire, Leibniz montre son intérêt pour la logique d’une part et d’autre part le calcul mathématique. Pour lui, un raisonnement juridique ou un jugement rigoureux est une espèce de démonstration qui doit chercher à atteindre la même rigueur que celle des démonstrations géométriques. Par la suite Leibniz développe une conception de l’Analytique divisée en art de tout définir et de tout démontrer proche de celle de Hobbes et de Pascal et opposée à celle de Descartes, dont il rejette la méthode. Voilà pourquoi pour L. Couturat (1901, p. 570), on peut déceler selon Leibniz une influence pascalienne dès 1667 dans la « Nouvelle méthode pour l’analyse de la jurisprudence, qui proviendrait de son célèbre ouvrage, De l’Esprit géométrique ». Louis Couturat a vu juste, car Leibniz est plus proche de Blaise Pascal que de René Descartes.
Par ailleurs, Leibniz est l’un des grands précurseurs du logicisme, autrement dit de la doctrine selon laquelle les mathématiques sont simplement une branche de la logique. Il manifeste comme futile la volonté de faire passer une ligne de démarcation stricte entre la logique et les mathématiques. Dès lors, on comprend G. W. Leibniz (1966, p. 432) en ces termes : « Je commence à me faire une toute autre idée de la logique que je n’en avais autrefois. Je la prenais pour un jeu d’écolier, et je vois maintenant qu’il y a comme une mathématique universelle, de la manière que vous l’entendez ». À ce sujet, « dans toutes les sciences infaillibles, lorsqu’elles sont démontrées exactement, sont pour ainsi dire incorporées des formes logiques supérieures, qui pour ma part découlent des formes aristotéliciennes, pour une autre recourent en plus à autre choser » précise G. W. Leibniz (1965, p. 519).
En se référant à tout ce qui a été dit, Leibniz va mettre au point un outil de calcul et de système de notation dans un domaine qui s’intéressera à l’arithmétique des grandeurs infinies. Dans ce cas, il élabore une méthode d’addition ou d’intégration des quantités infiniment petites, essaie plusieurs notations et indépendamment du calcul des fluxions établi par Newton. Ceci lui permet de parvenir à l’algorithme qui rend alors possible le calcul des infiniments petits dans tous les ordres de grandeurs, ce qui lui permettra d’appliquer son nouveau calcul à la géométrie, à la mécanique, et à la physique. Ces activités multiples ne l’empêchent pas de mener de front des travaux de droit de philosophie religieuse, de créer une Characteristica Universalis, d’élaborer une logique nouvelle et de mûrir les idées philosophiques. Cette caractéristique universelle se trouve aussi dans certaines parties des mathématiques selon Leibniz, car elle donne aux mathématiques une procédure de décision générale qui opère à la façon d’une machine.
Toutefois, les thèses leibniziennes épuisent-elles toutes les préoccupations liées à la problématique des rapports entre la logique et les mathématiques ? En d’autres termes, les mathématiques peuvent-elles se passer de tout apport de la logique sans courir le risque de se confronter à des difficultés dans l’élaboration de la connaissance ? Quelles sont les nouvelles méthodes et la nature de la logique et des mathématiques ? Peut-on parler d’un modèle de la logique en mathématiques ? Pour donner une réponse à toutes ces questions, nous élaborerons un plan qui puisse répondre aux exigences du problème des rapports entre logique et mathématiques.
Pour mener à bien notre analyse sur l’étude du rapport de la logique aux mathématiques chez Leibniz, la nécessité d’une exposition des travaux scientifiques de l’auteur s’impose d’abord dans le domaine de la logique et celui des mathématiques. Ensuite, nous parlerons des probabilités en prenant en compte la géométrie du hasard et la logique du probable d’une part et d’autre part nous ferons ressortir l’importance de la géométrie projective et la combinatoire. Enfin, nous nous focaliserons sur Leibniz en tant qu’historien des sciences et par ailleurs nous nous donnerons la tâche de mettre en lumière les innovations leibniziennes.
Eu égard à toutes ces considérations, des interrogations demeurent : Peut-on être à la fois logicien et mathématicien ? Les mathématiques peuvent-elles véritablement cohabiter avec la logique tout en sauvegardant la connaissance scientifique ? Les mathématiques prise comme ensemble des sciences démonstratives peuvent-elles offrir à l’homme des réponses exactes, objectives à toutes les questions d’ordre épistémologique et d’ordre existentiel ? Peut-on établir une dichotomie, mieux une séparation radicale entre logique et mathématiques ? Enfin, peuvent-elles collaborer ? Autrement dit, la logique est-elle l’origine, le substrat, la source, le fondement, la quintessence ou l’essence même des mathématiques ?
1. Les travaux scientifiques de Leibniz : le domaine de la logique
Déjà en 1666, alors à peine âgé de vingt ans (20 ans), Leibniz publie De Arte combinatoria (De l’Art combinatoire) dans lequel il défend l’idée que la logique doit reposer sur une méthode infaillible de déduction d’idées vraies. Par son talent, Leibniz propose de s’intéresser à la composition des idées. Il propose de décomposer toutes idées complexes en un ensemble d’idées plus simples, et à recommencer le processus jusqu’à atteindre les idées les plus simples, primitives et indémontrables. Il est à la recherche de ce qu’il appelle lui-même un Alphabet général de la pensée humaine, un Alphabet qui recenserait toutes les idées simples qui serviraient de base à la recomposition des idées complexes.
En effet, les signes et symboles de cet Alphabet universeldevraient permettre ensuite de composer les idées comme les lettres permettent de composer des phrases. Leibniz espérait que le nombre d’idées simples soit restreint pour permettre l’apprentissage rapide et naturel de cette langue universelle des concepts.
Ainsi, le Calculs ratiocinator, c’est-à-dire le Calcul logique sous-tend que tout devient une affaire de calcul en logique. Voilà pourquoi pour Leibniz, la logique a des sources mathématiques. Parlant de la logique symbolique, B. Frank (1993, p. 74) écrit que « tout ce que j’ai ajouté à l’invention mathématique, dit Leibniz, est né de cela seul que j’ai amélioré l’usage des symboles qui représentent les quantités ». C’est à ce prix que selon Frank, Leibniz ramenait en quelque sorte la logique à l’arithmétique, à la géométrie au moyen du schématisme linéaire.
Par ailleurs, les principes logiques font également partie de ces éléments extrêmes dont l’évidence suffit. Or, Blaise Pascal critique les ouvrages de logique dont les subtilités ne font qu’introduire l’ineffable, l’irrationnel dans la connaissance. Il critiquait l’intérêt de la logique à la fin de l’Esprit géométrique dans lequel il voit dans logique une activité oiseuse qui donne des noms compliqués à des syllogismes peu maniables. Dès lors, on comprend B. Pascal (1658, p. 358) : « La méthode de ne point errer est recherchée de tout le monde. Les logiciens font profession d’y conduire, les géomètres seuls y arrivent et, hors de leur science et de ce qui l’imite, il n’y a point de véritables démonstrations ». Pour Pascal, les règles du syllogisme sont tellement naturelles qu’on ne peut les ignorer au point qu’elles s’arrêtent et se fondent sur la véritable méthode de conduire le raisonnement en toutes choses sans toutefois le démontrer. Mais cette critique ne s’applique pas à Leibniz qui reprendra d’ailleurs à son compte, certaines critiques apparentées formulées par John Locke sur les syllogismes.
À l’opposé de pascal, la logique que Leibniz développa fut sans doute l’une des plus importantes depuis l’invention du syllogisme aristotélicien. Les deux grandes caractéristiques de la logique de Leibniz consistent d’une part dans le fait qu’il a voulu constituer un langage universel prenant en compte non seulement les connaissances mathématiques mais également la jurisprudence, l’ontologie et d’autre part à côté de ce langage universel, Leibniz a rêvé d’une logique qui serait calcul algorithmique et donc mécaniquement proche du calcul rationnel. À ce stade, Leibniz annonce ainsi la langue artificielle et purement formelle développée plus tard par Gottlob Frege.
À travers sa passion pour la logique, les logiciens modernes ont pu trouver chez Leibniz l’instance sur les argumenta in forma,c’est-à dire les arguments formels qui sont mécaniquement testables, mieux infaillibles. Partant de la caractéristique universelle, G. W. Leibniz (1965, p. 26) écrit :
Les hommes trouveront par là un juge des controverses vraiment infaillible, car ils pourront toujours connaître s’il est possible de décider la question par le moyen des connaissances qui leur sont déjà données, et lorsqu’il n’est pas possible de se satisfaire entièrement, ils pourront toujours déterminer ce qui est plus vraisemblable. Comme dans l’arithmétique on peut toujours juger s’il est possible ou non de deviner exactement le nombre que quelque personne a dans la pensée, sur ce qu’elle nous en a dit, et souvent on peut dire ; cela doit être l’un de deux ou de trois, etc., tels nombres, et prescrire des bornes à la vérité inconnue. En tout cas, il importe au moins de savoir que ce qu’on demande n’est pas trouvable par les moyens que nous avons.
Cette citation montre l’exigence de formalité qui a conduit finalement à la construction de systèmes formels pour différents domaines majeures des mathématiques.
2. Les travaux scientifiques de Leibniz : le domaine des mathématiques
Au XVIIᵉ siècle, le développement des mathématiques est lié à la physique, les probabilités répondent à l’étude des jeux de hasard ; le calcul infinitésimal répond à des problèmes de dynamique et de détermination de centres de gravité. En effet, les mathématiques ont tenu dans la vie de Leibniz un rôle préparatoire voire introductif quoiqu’à des degrés divers. J. Baruzi (1907, p. 222) à travers sa philosophie montre l’amour de Leibniz pour les mathématiques. « Je n’ai (…) pas étudié les sciences mathématiques pour elles-mêmes (…) mais afin d’en faire un jour bon usage (…) en avançant la piété ». Nous constatons ici que Leibniz commence une étude plus approfondie des mathématiques. Même si cette étude aurait permis à Leibniz de construire sa réputation en mathématique, il n’abandonne aucunement la théologie. Voilà pourquoi Leibniz à travers sa propre description écrivait encore selon Y. Belaval (1975, p. 80) en ces termes :
En le faisant passer pour un mathématicien de profession (…) il est sûr qu’on se trompait fort, qu’il avait bien d’autres vues, et que ses méditations principales étaient sur la Théologie, qu’il était appliqué aux Mathématiques comme à la scholastique, c’est-à-dire seulement pour la perfection de son esprit, et pour apprendre l’art d’inventer et de démontrer.
Par ailleurs, si nous remontons à Aristote qui eu le mérite éminent de soumettre les formes syllogistiques à un petit nombre de lois infaillibles, Leibniz ne manque pas de dire de lui, qu’il a de quoi surprendre un lecteur habitué à voir les choses à la façon de Descartes et de ses héritiers modernes, qu’il à été, souligne G. W. Leibniz (1965, p. 519) lui-même de ce fait « le premier qui ait écrit mathématiquement en dehors des mathématiques ». Écrire mathématiquement voudrait dire justement écrire sur des sujets qui ne sont pas mathématiques et peuvent même être quelconques, sous forme d’argumenta in forma. À ce sujet, G. W. Leibniz (1966, p. 425) ajoute pour dire en ces mots dans cette citation.
Il faut savoir que par les arguments en forme, je n’entends pas seulement cette manière scolastique d’argumenter dont on se sert dans les collèges, mais tout raisonnement qui conduit, par la force de la forme, et où l’on n’a besoin de supplier aucun article, de sorte qu’un sorite, un autre tissu de syllogisme qui évite la répétition, même un compte bien dressé, un calcul d’algèbre, une analyse des infinitésimales me seront a peu près des arguments en forme, parce que leur forme de raisonner a été prédémontrée, en sorte qu’on est sûr de ne s’y point tromper.
À travers toujours l’étude des mathématiques, Leibniz fera de nombreuses découvertes comme le calcul de la quadrature arithmétique du cercle au moyen d’une série infinie. Cela montre qu’il se consacre au calcul des séries. Cette phase d’étude lui fait découvrir des infinis de divers ordres, les règles de sommation ou de multiplication des séries et permettent de jeter les bases d’une union entre la discontinuité arithmétique et la continuité géométrique. Ces travaux permettront d’aborder l’étude des courbes et des quadratures (mesures de surfaces).
En plus, Leibniz s’intéresse aux systèmes d’équation et présente l’usage des déterminants. Dans son traité sur l’Art combinatoire, science générale de la forme et des formules, il développe des techniques de substitution pour la résolution d’équation. Il travaille aussi sur la convenance des séries, le développement en série entière de fonctions comme l’exponentielle, le logarithme, les fonctions trigonométriques. Il découvre par la suite, la courbe brachistochrone et s’intéresse à la rectification des courbes, c’est-à-dire le calcul de leur longueur. Poursuivant, il a étudié à la fois non seulement le traité des coniques Pascal et les enveloppes de courbes mais aussi la recherche d’extremum pour une fonction. À travers son génie créateur, il conçoit une machine arithmétique inspirée de la Pascaline, il tente aussi une incursion dans la théorie des graphes et la topologie.
À y voir de près, les mathématiques ont eu un impact majeur sur la manière dont Leibniz conçoit l’Art combinatoire. Il y a une déduction dans cette discipline de sa langue universelle des concepts comme règles mathématiques. Ainsi, le calcul logique devrait être analogue aux calculs arithmétiques ou algébriques. Leibniz y voyait l’ultime méthode de discussion philosophique, une méthode qui aurait la vérité et l’exactitude des mathématiques. Autrement dit, la résolution de toutes les questions théoriques possibles par calcul. Donc les raisonnements seraient devenus de simples calculs mécanisables semblables à ceux de l’arithmétique.
Alors, les mathématiques sont si importantes, si nécessaires que Leibniz donne l’exemple des vérités de raison, qui comprennent toutes les propositions mathématiques : toutes les vérités dérivent, découlent des vérités identiques de type « A = A » ou « A est A », seules indémontrables, qui s’appliquent pour l’infinité des A possibles. Leibniz reconnaît tout à fait clairement que l’on peut proprement calculer sur bien autre chose que les nombres et qu’il peut par conséquent y avoir une mathématique non seulement des nombres, mais également des concepts, des propositions des classes et bien d’autres choses. Aussi, il conçoit les règles de composition et de déduction de sa langue universelle des concepts comme des règles mathématiques par le fait même de leur universalité et leur rigueur. Cela montre qu’il n’y a aucune incompatibilité réelle ente la logique et les mathématiques. Pour lui, ces deux sciences formelles incarnent les mêmes caractéristiques dans leur élaboration.
3. Les probabilités : de la géométrie du hasard à la logique du probable
Leibniz avait déjà eu l’occasion par le passé de réfléchir à l’usage des probabilités dans le cadre des problèmes de justice. Cette connaissance de justice chez Leibniz nous a permis de savoir qu’au sein de la justice non seulement toute forme de procédures est une sorte de logique qui s’applique aux questions de droit mais également aux mathématiques qui donnent une estimation sur les jeux de hasard. Selon lui, il y a une anticipation de la théorie des probabilités dans toute une série de pratiques humaines, dont la justice et la théorie mathématique des probabilités ne seraient que le prélude à une théorie complète qui sortira du simple champ de jeu de hasard. L’intérêt pour la théorie des probabilités conduit G. W. Leibniz (1995, p. 103) à la rédaction d’un manuscrit « sur le calcul des partis » d’une part et d’autre part à la publication d’un mémoire « sur le calcul des probabilités ». Ainsi, ces travaux leibniziens sont suivis d’une série d’autres opuscules comme par exemple la Note sur certains jeux mentionnée dans L’Estime des Apparences.
D’un point de vue strictement mathématique et une référence à son projet d’une logique qui intégrerait les degrés de probabilités, une logique du probable pour former des jugements plus solides, en posant les apparences, c’est-à-dire la probabilité des événements, Leibniz avoue son intérêt pour les jeux du hasard. Il s’est intéressé aux perfectionnements des probabilités mathématiques et leur extension au-delà du champ mathématique, en logique et en métaphysique. Grâce aux probabilités, le raisonnement rigoureux ne se limite pas aux démonstrations parfaites, car la découverte de la vérité est progressive et passe par des degrés de probabilités. Voilà pourquoi, Leibniz les intègre dans l’art de raisonner en général.
De même que le calcul infinitésimal a permis de faire basculer un certain type d’infini dans le champ de la raison, en lieu et place d’un indéfini, en introduisant des ordres d’infinité, de même le calcul des probabilités permet de rendre raison d’événements qui ne sont ni parfaitement clairs ni distinct. Ainsi, le clair peut résulter d’un assemblage de parties confuses comme les perceptions insensibles « que nous ne saurions distinguer dans la foule » disait G. W. Leibniz (1990, p. 41-42) « qui composent le bruit des flots dont nous sommes affectés au bord de la mer ». Ajoutons aussi que la force et la faiblesse des probabilités est de raisonner sur une loi et non sur des expériences. Pour Leibniz, une série d’expériences ne suffit pas à faire une loi, car il faudrait une série d’expériences infinies pour venir à bout de la contingence.
Par ailleurs, s’agissant des démonstrations sur les coniques, Leibniz pense que se seraient à la limite qu’un heureux hasard lié à la géométrie du cône. Ce qu’il souhaite c’est de trouver une méthode d’harmonie beaucoup plus générale. Or, pour Blaise Pascal, le mouvement d’unification des coniques est le signe d’une union beaucoup plus vaste, immense qui est un des objets de la science générale.
4. La géométrie projective et la combinatoire
Au travers du calcul infinitésimal, Leibniz introduit de nouvelles méthodes aux mathématiques telles que la géométrie projective et la combinatoire. L’analyse de la géométrie projective est l’une des tâches à résoudre selon Leibniz. Dans ce cas, il manifeste un esprit positif pour la recherche d’une unité, mais cherche aussi très explicitement à marquer sa différence en proposant à la fois une méthode plus générale et plus efficace que celle de son prédécesseur (Pascal). En effet, les copies effectuées par Leibniz à partir de la géométrie projective permettent d’accéder au Traité de contacts coniques et celui des lieux solides. Ainsi, Leibniz retient l’esprit unitaire pour l’étude des coniques. Pour preuve, on peut démontrer les objets hétérogènes (figures fermées comme le cercle et l’ellipse, figures ouvertes comme la parabole et l’hyperbole) qui sont en fait reliées par une unité plus profonde qui n’apparait qu’à la faveur d’un point de vue supérieur.
Finalement, cet esprit de conciliation entre figures opposées permet à Leibniz d’intégrer dans la géométrie projective l’harmonie des figures pour pouvoir traiter de toutes les figures. La géométrie projective lui sert également à élaborer sa doctrine de l’expression qui semble être commune à toutes les formes, dans laquelle la première étape est à priori et la seconde a posteriori. Voilà pourquoi Michel Serres dans Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques a relevé que cette nouvelle méthode (la géométrie projective) permettait de rendre compte de la correspondance entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.
Par ailleurs, dans son système, il attachera ainsi une place essentielle, capitale à la combinatoire comme science du semblable et du dissemblable, en laquelle il verra une anticipation de la Caractéristique. Pour preuve, dès 1666, Leibniz publie son De Arte combinatoria. Disons-le, la combinatoire est initialement une science de dénombrements.
À travers les réformes appliquées aux mathématiques, elles ne sont pas une simple affaire de logique si bien qu’il faut non seulement d’abord déterminer une loi numérique vraie, mais ensuite appliquer une matrice de raisonnements à différents sujets qui, enfin, trouvent leur unité. Ainsi, il y a un talent spécial du géomètre qui doit consister au-delà de leur vérité formelle à rendre fécondes ses propositions qui auront nécessairement un impact positif sur ses investigations ou recherches.
Cependant, Leibniz manifeste un degré supérieur de formalisation des possibilités de la combinatoire. Lequel prendrait place considérable au sein d’une « logique générale » ou « mathématique universelle » souligne G. W. Leibniz (1990, p. 186). Aussi, les syllogismes ou expressions des « arguments en forme » précise encore G. W. Leibniz (1990, p. 85), qui contiennent un art de l’infaillibilité de même que son procédé d’analyse des infinitésimales en seraient des échantillons où l’on démontre à l’aide des formes universelles de la logique commune. Nous voyons ici que Leibniz fait preuve d’un degré de conscience des problèmes et de radicalité dans l’usage de la combinatoire bien supérieurs et d’une certaine façon téméraires par rapport à ceux de Pascal. Cela montre que Leibniz a formalisé et radicalisé ce que Pascal n’a que pressenti en parlant d’un lien caché entre les propositions.
Aussi, Leibniz utilisera la méthode combinatoire en physique pour aboutir aux lois de conservation d’énergie. Pour lui, il existe des rapports invariants qui mettent en évidence la conservation de l’énergie d’un système. Donc, une loi est générale lorsqu’elle survit à ces variations. En inventant de nouvelles méthodes avec les travaux sur le calcul infinitésimal, les probabilités, la géométrie projective et la combinatoire, Leibniz fait reculer la limite de l’infini irrationnel en faisant entrer de nouveaux infinis dans le champ des mathématiques. En plus, le calcul infinitésimal se donne comme une procédure qui permet de ramener toute grandeur dans le champ de la mesure.
Les travaux sur les coniques permettent de trouver des propriétés nouvelles de différentes figures en les considérant comme des images du cercle, parfois projeté : la géométrie projective. La combinatoire permet de manifester l’usage du raisonnement par récurrence et d’appliquer des règles de dénombrement formelles à l’infinité de cas nouveaux.
5. Leibniz : historien des sciences
Leibniz s’est beaucoup intéressé aux sciences en générale et en particulier aux sciences formelles, dites exactes (logique et mathématiques) qui obéissent à la démarche hypothético-déductive. En effet, ses apports en physique sont considérables à savoir l’invention du concept de l’énergie potentielle comme différentielle de l’énergie cinétique ; la loi de conservation, l’action, le principe de la moindre action du temps et le principe d’indétermination. Aussi, il récuse au nom de la physique et du principe d’inertie qu’il puisse y avoir une matière purement passive. G. W. Leibniz (1994, p. 41) souligne que c’est « une matière sans aucune action ou effort ». À la différence de Leibniz, Pascal pense que les expériences sont le seul principe en physique et que le principe de non contradiction est un principe critique et même les mathématiques semblent être l’antichambre de la logique. Pour Leibniz, le travail des logiciens, des jurisconsultes, des mathématiciens doit servir d’exemple pour établir les principes de métaphysique, de physique, de morale et des éléments de mathématiques.
Aussi, en tant qu’homme de sciences, Leibniz fera de grandes découvertes. D’abord le calcul de la quadrature arithmétique du cercle au moyen d’une série infinie d’une part et d’autre part il déduit que la quadrature (évaluation des aires) des figures, des courbes se ramène d’une certaine manière aux problèmes des tangentes. Il transpose ensuite ces relations démontrées géométriquement dans le champ de l’algèbre et invente enfin un algorithme spécial d’un maniement commode qui généralise le calcul avec ses symboles et ses règles opératoires.
En nous référant à l’histoire des sciences, l’origine géométrique du calcul infinitésimal n’est pas reniée de Leibniz qui utilise des formulations géométriques à des fins de pédagogie. Il nous permet de se faire une idée du fonctionnement du calcul par les images. Ainsi, la bonne utilisation de preuves visuelles permet de repérer les erreurs de calculs et apprend à l’homme « qu’il faut se défier de la raison toute seule » affirme G. W. Leibniz (1989, p. 390).
Par ailleurs, le projet de science générale de Leibniz vise directement l’opération qui n’est autre que l’art d’inventer. Son formalisme le facilite. Ce projet sert donc, comme le dit Leibniz de fil d’Arianne pour la pensée. Voilà pourquoi son calcul infinitésimal ou sa machine à calculer en serait le spécimen de la science. Cet aspect calculatoire, opératoire ou d’invention de la machine à calculer serait donc comme un idéal à transférer à tout raisonnement, idée qui n’est pas présente chez Pascal de façon systématique. Disons que ce projet leibnizien contient l’idée d’une logification complète des mathématiques.
Plus loin, parlant de science générale, notre auteur constate qu’en même temps que les sciences se complexifient et s’étendent par le haut, elles se simplifient et se condensent par le bas. C’est ce qui ressort dans cette citation de G. W. Leibniz (1965, p. 180).
On peut même dire que les sciences s’abrègent en s’augmentant, qui est un paradoxe très véritable, car plus on découvre des vérités et plus on est en état d’y remarquer une suite réglée et de se faire des propositions toujours plus universelles dont les autres ne sont que des exemples ou corollaires, de sorte qu’il se pourra faire qu’un grand volume de ceux qui nous ont précédés se réduira avec le temps à deux ou trois thèses générales. Aussi, plus une science est perfectionnée, et moins a-t-elle besoin de gros volumes, car selon que ses éléments sont suffisamment établis, on y peut tout trouver par le secours de la science générale ou de l’art d’inventer.
Enfin, le projet scientifique de Leibniz s’introduit aussi dans le domaine religieux, car les sciences constituent pour lui un outil de calcul de la gloire de Dieu. « Je considère les sciences comme un puissant instrument pour calculer la gloire de Dieu » souligne G. W. Leibniz (1662, p. 536).
6. Les innovations leibniziennes
Leibniz fait preuve d’innovations dans la mesure où par une analyse rétrospective, il cherche à distinguer ses propres contributions de celles d’autres savants. En effet, dira G. W. Leibniz (1926, p. 555-556) en ces mots : « Et j’oserai un jour donner des défis mais sous des noms couverts, pour vérifier l’étendue des méthodes que j’ai inventées. Ce que fit feu Monsieur Pascal en proposant un prix sous le nom de Dettonville à celui qui résoudrait certains problèmes ».
En outre, Pascal et Huygens ont permis à Leibniz de pénétrer plus profondément dans les mathématiques et de les dépasser en s’appuyant sur leur travail. De là, Leibniz estime que d’autres scientifiques utiliseront ses propres travaux dans l’avenir pour y dégager des résultats enfouis. C’est en cela qu’il compare sa machine à calculer avec celle de Pascal et vante ses propres mérites en indiquant qu’elle effectue non seulement de nouvelles opérations, mais surtout qu’elle fonctionne selon une méthode nouvelle. G. W. Leibniz (1697, p. 195) le montre bien à travers cette citation.
J’ai encore eu le bonheur de produire une machine arithmétique infiniment différente de celle de M. Pascal, puisque la mienne fait des grandes multiplications et divisions en un moment, et sans additions ou soustractions auxiliaires au lieu que celle de M. Pascal (dont on parlait comme d’une chose merveilleuse et non sans raison) n’était propre que pour les additions et soustractions (…). C’est pourquoi Messieurs Arnauld, Huygens et même Messieurs Perrier, neveux de M. Pascal, quand ils eurent vu mon échantillon à Paris, avouèrent qu’il n’y avait point de comparaison entre celle de M. Pascal et la mienne.
Par ailleurs, les innovations proprement leibniziennes consistent à transférer ces méthodes dans le champ du calcul et de l’algèbre et d’introduire les qualités différentielles, qui sont les pendants des côtés infiniment petits des polygones permettant de résoudre les problèmes de quadrature ou des points infiniment proches des problèmes de tangentes. Ainsi, le calcul et ses fondements sont expliqués dans la Nova Methodus pro Maximis et Minimis (Nouvelle Méthode pour calculer les Maxima et les Minima). De ce constat, Leibniz affirme à bon droit que sa machine relève d’une nouvelle méthode. Il veut se distinguer de Pascal principalement du point de vue des méthodes comme il le fait au sujet des démonstrations.
Au-delà de ces remarques, Leibniz est l’auteur d’un nombre considérable d’anticipations et d’innovations conceptuelles et techniques qui font de lui un logicien des temps modernes et qui ont été maintes fois étudiées dans divers domaines de la science. Aussi, concernant l’invention mathématique, Leibniz a certainement rêvé d’une méthode générale qui s’appliquerait à la totalité des mathématiques et même d’une méthode qui permettrait de décider par le simple calcul une multitude de questions qui n’ont à première vue rien de mathématique. C’est pourquoi dans ses écrits sur la Charactéristica universalis, il ne parlait pas d’un projet utopique mais réalisable. Dès lors, on comprend K. Gödel (1944, p. 469) lorsqu’il écrit :
Il n’y a pas de raison d’abandonner tout espoir. Leibniz, dans ses écrits sur la Charactéristica universalis, ne parlait pas d’un projet utopique ; si nous devons croire ce qu’il dit, il avait développé son calcul du raisonnement dans une large mesure, mais attendait le publier que la semence puisse tomber sur un sol fertile. Il est même allé jusqu’à estimer le temps qui serait nécessaire pour que son calcul soit développé par un petit nombre de scientifiques choisis jusqu’à un point tel que l’humanité disposerait d’une nouvelle espèce d’instrument optique quelconque n’a jamais aidé le pouvoir de la vision. Le temps qu’il indique est cinq ans, et il affirme que sa méthode n’est en aucune façon plus difficile à apprendre que les mathématiques ou la philosophie de son époque. De plus, il a dit de façon répétée que, même dans l’état rudimentaire où il avait développé la théorie lui-même, elle était responsable de toutes ses découvertes mathématiques ; chose que, pourrait-on espérer, même Poincaré reconnaîtrait comme une preuve suffisante de sa fécondité.
Dans la même perspective, les innovations leibniziennes montrent que le fonctionnement algorithmique du calcul est un grand point de différence entre Leibniz et ses prédécesseurs. Cela est perceptible dans cette citation de L. Couturat (1901, p. 85) : « C’est là ce qui constitue le mérite essentiel de l’invention de Leibniz, et son principal avantage sur la méthode des fluxions de Newton. On peut dire que le calcul infinitésimal n’est qu’un échantillon le plus illustre et le réussi de la caractéristique universelle ». Sachons que les innovations leibniziennes en générale et en particulier sa caractéristique universelle ne sont pas à l’abri de toutes critiques, car il existe de véritables débats contemporains. Ceci est perceptible par exemple dans certaines notes de Rudolf Carnap. Aussi, en nous référant à Luitzen Egbertus Jan Brouwer, nous constatons qu’il n’a pas de caractéristique universelle et de procédure de décision pour la totalité des mathématiques.
Dans un débat entre H. Wang et K. Gödel, nous constatons que pour Wang, dans le développement de la logique mathématique, il y a une idée de Leibniz qui s’est révélée être d’une importance centrale. Cette idée est la caractérisation des vérités de raison comme vérités vraies dans tous les mondes possibles. Cette conception s’applique aussi bien aux tautologies du calcul propositionnel, telles qu’elles sont comprises et traitées par Ludwig Joseph Wittgenstein dans Tractatus logico-philosophicus qu’ à la notion plus générale de proposition logiquement valide ou logiquement vraie dans le calcul des prédicats du premier ordre. Or, pour Gödel, Leibniz n’a nulle part mentionné littéralement que les vérités de raison pouvaient être définies comme des vérités vraies dans tous les mondes possibles. Ce qui se rapproche le plus de cette idée est sans doute, selon Gödel, les passages dans lesquels Leibniz souligne que Dieu aurait pu assurément créer un monde pourvu de lois physiques, mais pas de lois logiques et mathématiques, différentes. Devant ces divergences de points de vue, les créateurs de la sémantique logique ont présenté spontanément leur définition de la validité logique par la vérité dans toute interprétation du système formel ou du calcul comme équivalent de ce que Leibniz entend par la vérité dans tous les mondes possibles. C’est ce qui est mis en évidence par R. Carnap (1956, p. 9).
Une classe de propositions dans le langage qui contient pour toute proposition atomique ou bien cette proposition, ou bien sa négation, et pas d’autres propositions, est appelée une description d’état (state-description), parce qu’elle donne évidemment une description complète d’un état possible de l’univers des individus relativement è toutes les propriétés et les relations exprimées par les prédicats du système. De ce fait, les descriptions d’état représentent les mondes possibles de Leibniz ou les états de choses possibles de Wittgenstein.
Armé de meilleures méthodes, Leibniz veut monter qu’on peut faire d’aussi grandes découvertes en ménageant davantage son esprit. Ainsi, ses méthodes sont prises comme des méthodes générales d’interprétation de l’univers, dont l’extraordinaire perspicacité nous instruit encore aujourd’hui.
Conclusion
Ce travail portant sur la logique, essence des mathématiques, nous a permis de comprendre que Leibniz ne s’embarrassait d’aucune tradition à inventer de nouvelles méthodes concrètes de notations et de calculs qui allaient connaitre une postérité remarquable dans la tradition analytique du vingtième siècle. Pour preuve, K. Gödel (1944, p. 447) écrira :
La logique mathématique qui n’est rien d’autre qu’une formulation précise et complète de la logique formelle, a deux aspects tout à fait différents. D’un côté, elle est une section des mathématiques traitant de classes, relations, combinaisons de symboles, etc., au lieu de nombres, fonctions, figures géométriques, etc. De l’autre, c’est une science, antérieure à toutes les autres, qui contient les idées et les principes sous-jacents à toutes les sciences. C’est dans ce deuxième sens qu’elle a été conçue en premier lieu par Leibniz dans sa Characteristica universalis, dont elle aurait formé une partie centrale. Mais il a fallu presque deux siècles après la mort de Leibniz pour que cette idée d’un calcul logique réellement suffisant pour le genre de raisonnement qui apparaît dans les sciences exactes soit mise en œuvre (tout au moins sous une certaine forme, sinon sous la forme que Leibniz avait en tête) par Frege et Peano.
Comme nous venons de voir, la caractéristique universelle et le calcul logique sont les premières incarnations de la métaphore de la pensée comme langage mathématique. Concluant sur ce point, G. W. Leibniz (1965, p. 183) précise dans cette pensée :
Les vérités qui ont encore besoin d’être bien établies sont de deux sortes. Les unes ne sont connues que confusément et imparfaitement et les autres ne sont point connues du tout. Pour les premiers, il fait employer la méthode de la certitude ou l’art de démontrer, les autres ont besoin de l’art d’inventer. Quoique ces deux arts ne diffèrent pas tant qu’on croit, comme il paraîtra dans la suite.
Leibniz, en parlant de deux arts, fait allusion respectivement aux mathématiques et à la logique qui sont inséparables, indissociables, car elles entretiennent un rapport de complémentarité et non de dichotomie. Donc, la logique est le fondement, le substrat, l’origine, la quintessence ou même des mathématiques.
Par ailleurs, au sortir de l’entretien de Philalèthe et Ariste, G. W. Leibniz (1996, p. 216) conclut clairement qu’en tant que logicien ou mathématicien, nous « voyons tout en Dieu ». Pour dire qu’aucun domaine de l’existence n’échappe à l’interrogation divine.
Au final, Leibniz mène à bien celle de la reconstruction et de la systématisation logique et celle de la création mathématique proprement dite. Canalisant les extrêmes, son système tend vers l’idéal d’Aristote. Il vise donc le milieu, le point mathématique d’excellence.
Références bibliographiques
BARUZI Jean, 1907, Leibniz et l’organisation religieuse de la terre, Documents inédits, Paris, Félix Alcan.
BELAVAL Yvon, Leibniz, Initiation à sa philosophie, Paris, Librairie philosophique, J. Vrin, 1975.
BURBAGE Frank, 1993, Leibniz et l’infini, par Nathalie Chouchan, Paris, Presses Universitaires de France.
CARNAP Rudolf, 1956, Meaning and necessity: A Study in semantics and modal logic enlarged éd. Chicago: London: The Univ. of Chicago Press, 1956.
COUTURAT Louis, 1901, La logique de Leibniz, Paris, Éditions Félix Alcan, réédité par G. Olms en 1985.
GÕDEL Kurt, 1944, Russell’s mathematical logic, in Philosophy of mathematics, selected readings, éd by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, 2nde éd, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1662, Lettre du 5 Juin 1662 à l’Abbé Nicaise, Gerhardt, tome II, Édition de l’Académie de Berlin.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1667, Nouvelle méthode pour l’analyse de la jurisprudence, Édition de l’Académie de Berlin.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1697, Post scriptum de la Lettre à Burnett, Gerhardt, tome III, Édition de l’Académie de Berlin.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1903, Opuscules et fragments inédits, édité par Louis Couturat, extr. des ms. de la Bibliothèque royale de Hanovre, Paris, Félix Alcan, réédité par G. Olms, New York, 1988.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1926, Lettre au Duc Jean Fréderic, in Philosophischen Briefwechsel, Erster Band, Darmstadt, Édition de l’Académie de Berlin.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1965, Philosophische Schriften, herausgegeben von C. J Gerhardt (Hildesheim Georg Olms, vol. VII.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1989, La Naissance du calcul différentiel, introd. trad. et notes par Marc Parmentier, Paris, Éditions, Vrin.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1990, Nouveaux essais sur l’entendement humain, Paris, J. Vrin.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1994, Système nouveau de la nature et de la communication des substances, Paris, Garnier Flammarion.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1995, L’Estime des apparences : 21 manuscrits de Leibniz sur les probabilités, la théorie des jeux, l’espérance de vie, texte établi, trad., introd. et annoté par Marc Parmentier, Paris, Vrin.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1996, Nouveaux essais sur l’entendement humain, Chronologie et introduction par Jacques Brunschwig, Paris, Garnier Flammarion.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1996, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, Paris, Éditions, Garnier Flammarion.
MESNARD Jean, 1976, Leibniz et les papiers de Pascal, Paris, Chantilly, France.
PASCAL Blaise, 1658, De l’Esprit géométrique, Paris, Seuil, Lafuma.
SERRES Michel, 1968, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, Paris, Presses Universitaires de France, réédité PUF, 1999.
LES ENJEUX INAVOUÉS DES GUERRES DE RELIGION ET L’ÉLAN DE TOLÉRANCE RELIGIEUSE DU MYSTIQUE BERGSONIEN
Kouassi Honoré ELLA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Si tant est que la noble ambition de toute religion est, en dernier ressort, de mettre l’homme au-dessus des contingences de la terre et d’organiser le vivre ensemble autour d’une mobilisation spirituelle, cette ambition se heurte à des réalités dont l’horreur et l’aberration constituent une humiliation pour l’intelligence humaine. Cette déconvenue invite à questionner en direction des enjeux réels des guerres dites de religion. Dans une démarche historique, psychanalytique et critique, cet article analyse la thématique des guerres de religion sous les angles des fondements de la récupération idéologique du religieux, des raisons inavouées de ces guerres et envisage leur déconstruction par une invocation de la religion ouverte et de la tolérance du mystique de Bergson.
Mots-clés : Déconvenue, Guerre de religion, Récupération idéologique, Religion ouverte, Tolérance.
Abstract :
If the noble ambition of any religion is, in the last resort, to put man above the contingencies of the earth and to organize living together around a spiritual mobilization, this ambition comes up against realities. whose horror and aberration constitute a humiliation for human intelligence. This disappointment invites us to question the real issues of the so-called religious wars. In a historical, psychoanalytic and critical approach, this article analyzes the theme of the wars of religion from the angles of the foundations of the ideological recovery of the religious, of the reasons invoked of these wars and envisages their deconstruction by an invocation of the open religion and tolerance of the mystic of Bergson.
Keywords : Disappointment, Ideological recovery, Open religion, Tolerance, War of religion.
Introduction
« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » (E. Barnavi et A. Rowley, 2006, p. 149). Cette terrible injonction dont Arnaud Amaury, le prélat du Pape Innocent III, aurait été l’auteur au siège de Béziers est porteuse de l’idée que « la guerre de religion est celle dont la seule fin concevable est la soumission totale ou la disparition de l’adversaire » (E. Barnavi et A. Rowley, 2006, p. 10). Et les vieux démons d’hier qu’on croyait enterrés par les Lumières semblent, aujourd’hui, revigorés sous les manteaux du djihadisme et du « choc des civilisations » que prophétisait Huntington[1]. S’entremêlent alors, dans notre modernité, les parfums de la poudre et de l’encens présageant ainsi un retour des guerres de religion.
Mais, qu’est-ce qui explique le recours à la religion pour s’affronter de façon meurtrière et comment échapper au terrorisme à visage religieux ? En clair, la question qui se pose ici est double : quels sont les véritables enjeux des guerres de religion ? Quelle peut être la piste d’endiguement de ce mal ? Une triple approche séjourne, alors, dans notre esprit : avec l’approche psychanalytique, nous indiquerons des pistes qui fondent la récupération idéologique du religieux à des fins guerrières (1) ; l’approche historique nous donnera d’appréhender les raisons inavouées des guerres de religion (2) ; la démarche critique nous conduira, à la suite de Bergson, à un effort de déconstruction de la guerre de religion et à une restitution de la religion dans sa réelle vocation (3).
1. Fondements de la récupération idéologique du religieux
Pour Denis Maugenest (2004, p. 7), l’idéologie, en tant que vision systématique de l’homme et de sa société, répond au besoin humain d’adopter quelque chose qui “vaille” la peine qu’on se batte pour elle. De même, dans une perspective marxiste, l’idéologie est la récupération intellectuelle par laquelle l’on justifie une action. Ainsi, les guerres de religion qui pavoisent les parois de l’histoire de l’humanité trouvent souvent l’idée de Dieu comme justification. « Qu’est-ce qu’une guerre de religion donc ? Une guerre pour la religion, une guerre dont la religion est le mobile » (E. Barnavi et A. Rowley, 2006, p. 10-11). Et Barnavi et Rowley (2006, p. 11) d’ajouter : « Non le seul, évidemment ». On est même tenté de dire que ce sont évidemment˝ d’autres mobiles qui justifient essentiellement les guerres de religion. Mais, quels sont les fondements de cette récupération idéologique du religieux ? L’effet levain et l’effet de castration du religieux peuvent justifier cette tendance.
1.1. L’effet levain du religieux
Le levain est une pâte fermentée destinée à faire lever la pâte de farine. Par extension, L’effet levain du religieux donne le religieux comme étant un élément d’entrainement, un catalyseur des tensions existantes. Cet effet levain du religieux se situe à divers niveaux.
Le religieux se donne, d’abord, comme un levain d’unité et de sens communautaire. Dans sa dimension verticale, le sentiment religieux est pouvoir d’unité et de fraternité. Au-delà des conflits interhumains, la religion entretient, dans l’animal politique, l’obligation morale du respect d’autrui et renforce la morale. Bergson (1990, p. 212) affirme que « la religion renforce et discipline ». Ce faisant, la religion entretient, dans certains cas, le patriotisme. Une fois le levain communautariste entretenu, il ne manque plus que la foi en un idéal pour favoriser l’action communautaire. Inversement, la foi en un idéal commun fait lever le sens de l’unité et de la cohésion sociale comme un bien à entretenir par tous les moyens. Notons que l’unité et le communautarisme peuvent donner lieu à une double orientation : une orientation positive sur le fondement de la fraternité constructive ; une orientation négative par l’entrainement de la communauté dans la guerre par un leader malencontreux. Toujours est-il que le religieux constitue, un levain de foi en un idéal et un tremplin pour l’action. Dans De la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville notait que, pour qu’il y ait société et prospérité de la société, il faut que tous les esprits des citoyens soient toujours tenus ensemble par quelques idéaux principaux puisés dans un patrimoine communs d’opinions et de faits les marquant.
Ainsi, parce que la religion conduit à l’action en vue de la réalisation d’un idéal commun, elle peut servir de paravent à des fins mesquines et extra religieuses. Soit, elle sera l’argument-prétexte à l’action commise, soit elle servira de prétexte à la mobilisation populaire. Elle demeure dans tous les cas un prétexte à des actions ou entreprises autres que religieuses. Et ce, d’autant que la religion engendre en outre un sens de devoir et de sacrifice.
Toutes les religions, révélées ou naturelles, entretiennent non seulement le sens du sacrifice à offrir à la divinité, mais aussi le sens du sacrifice de soi et de l’abandon à la divinité. Le Christ ne disait-il pas à ses disciples que « celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s’y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle »[2] ? De là à dire que pour tout noble idéal, il vaut la peine d’un sacrifice et même du sacrifice ultime, il n’y a qu’un pas qui est vite franchi par un esprit préparé aux sacrifices par la pratique religieuse. Au nom de Dieu, de la communauté, de la nation, une population à forte dominance religieuse sera plus prompte à aller au combat qu’une autre qui serait dominée par un idéal de rationalité et de laïcité. Or, la force mobilisatrice et l’exacerbation des passions de l’effet levain du religieux s’installent sur « l’effet de castration ».
1.2. L’effet de castration du religieux
En psychanalyse, le Complexe de castration désigne, selon Sigmund Freud, la symbolisation du processus de découverte de la différence des sexes par le petit enfant et structurant la personnalité de tout sujet[3]. Solidaire du Complexe d’Œdipe, il marque, une remise en cause du désir de l’enfant et l’intégration de la loi paternelle. L’effet de castration religieuse est, par suite, la tendance du croyant à mettre en veilleuse sa dimension rationnelle en rendant inopérante sa faculté critique. Face à la Transcendance religieuse, il sombre dans le nébuleux pour ne percevoir que transcendance irrationnelle dans l’existence. À force de contempler l’irrationnel, il finit par envisager comme irrationnel tout l’exister en lisant le tout de l’existence dans le prisme du transcendant et de l’irrationnel. Il consent, ainsi, à se vider de son potentiel analytique et critique pour se forger des convictions trempées dans des catégories « infra-relationnelles ».
Il ne faut toutefois pas se méprendre sur nos propos en voyant dans le religieux une anti-rationalité, comme c’est le cas chez certains philosophes. Chez Schopenhauer par exemple, dans Sur le besoin métaphysique de l’humanité comme dans Sur la religion, la pensée religieuse est une mauvaise exploitation de la métaphysique par une application de la raison à une catégorie qui n’a nul besoin de rationalité. De même, dans son Traité d’athéologie, M. Onfray (2006, p. 115) traitait la démarche religieuse d’irrationnalisable et d’« autodafés de l’intelligence ». Assez différente est l’approche kantienne qui pose que le religieux se déploie dans un domaine qui n’est pas celui de la raison mais de la foi. Il faut donc savoir suspendre le pouvoir de la raison au seuil du monde nouménal. Ne pas pouvoir faire des choses du religieux des objets de connaissance, n’enlève toutefois rien, dans l’approche kantienne, à l’intérêt de ces choses. Pour Bergson, les catégories religieuses sont à la fois infra et supra-rationnelles, c’est-à-dire qu’elles partent de données en deçà de la rationalité pour s’élever au-delà des capacités intellectuelles. Elles font appel à des données qu’on ne saurait enfermer dans une rationalité rétrécie et sont indépendantes de la rationalité. C’est qu’à côté de l’intelligence, de la rationalité calculatrice, il y a, pour Bergson, l’intuition qui est saisie immédiate et globale des réalités spirituelles.
Toujours est-il que dans la religion, l’homme concède une certaine castration de sa dimension rationnelle en la mettant en veilleuse ou en l’employant au service de la révélation divine. L’habitude conduit tellement à voir Dieu en toute chose qu’on finit par ne plus séparer César de Dieu, les réalités du monde des réalités spirituelles, contrairement à l’injonction christique de séparation entre le temporel et l’atemporel. N’est-ce pas cette castration volontaire qu’exprime Elie Barnavi (2008, p. 62) dans sa cinquième thèse sur « les religions meurtrières » lorsqu’il écrit : « Quoi qu’il en soit, la voie la plus sûre pour atteindre la vérité, et, la tranquillité ici-bas et la félicité dans l’au-delà, est la discipline religieuse, c’est-à-dire la soumission aux autorités ecclésiales et aux règles par elles établies ».
Il se dégage de là deux réalités : l’exploitabilité et la convocation du religieux pour la défense de causes inqualifiables. D’abord, le croyant devient une proie exploitable à des fins non religieuses. C’est le sens de l’observation de Ridha Kéfi (2010, p. 10) : « Au Maghreb, on le sait, les mouvements de libération nationale ont souvent utilisé le sentiment d’appartenance à la communauté musulmane comme ferment pour mobiliser la population contre la colonisation française chrétienne. Conséquence : le nationalisme s’y pare souvent des habits de la religion islamique ».
Ensuite, le religieux devient le prétexte justifiant des causes difficilement défendables ou des convoitises inqualifiables. Barnavi et Rowley (2006, p. 10) donnent, ainsi, une illustration de la récupération idéologique du religieux : «Si je convoite la terre du voisin pour arrondir la mienne, la guerre que je lui ferai pourra bien s’achever par la négociation (…) Mais si sa terre m’a été promise par Dieu, si elle constitue mon patrimoine sacré, la négociation ne servira à rien et le compromis ne sera pas possible ». La religion absolutise donc les conflits, les tensions, en exacerbant la conviction des hommes qu’en faisant la guerre, ils ne font qu’obéir à une volonté qui les dépasse.
Il ne faut, toutefois pas, ici non plus, se méprendre : le Complexe de castration qui consiste en un endormissement volontaire ou involontaire de la raison ne signifie pas que la foi religieuse est en opposition avec la raison et que seule une négation de la raison peut justifier l’être du religieux. Là n’est pas notre propos. Nous concevons à la suite de Hegel que, si foi et raison étaient en état de guerre, les bêtes seraient les seules religieuses et que, le fait que le seul être de raison soit aussi le seul capable de religion, cela montre éloquemment que la foi religieuse ne nie pas la raison. Seulement, il faut aussi dire avec Hegel que ce n’est pas dans toutes les figures de la religion que l’esprit s’offre dans son effectivité. C’est dire que l’individu qui ne s’élève pas à l’absolu du savoir ne peut percevoir le moment où l’esprit s’offre comme concept et non simplement comme représentation. C’est donc dire qu’a priori, le sentiment religieux n’ouvre pas à l’esprit dans sa plénitude, non que l’esprit n’y soit pas, mais que le commun n’y perçoit pas l’esprit dans la pleine conscience de soi.
Sur la base de la très grande plasticité des textes fondamentaux des religions, sur le fondement de la disposition religieuse à être un levain et une énergie cinétique, la récupération idéologique du religieux est faite pour transformer diverses raisons de conflits ordinaires en guerres de religion. À la vérité, dans les guerres dites de religion, sous le manteau des raisons sacrées se cachent des raisons inavouées.
2. Raisons inavouées des guerres de religion
« Les guerres de Religion ne sont pas que de religion » (E. Barnavi et A. Rowley, 2006, p. 62). On peut même être plus radical et dire contre Barnavi et Rowley que, fausse cause plutôt que vrai prétexte, la religion a, sur l’axe du temps, souvent prêté son nom à des guerres aux causes essentiellement politiques, géostratégiques et économiques.
2.1. Les raisons politiques et géostratégiques des guerres
Les guerres de religion auraient mérité cette appellation si les conflits permettaient à un groupe religieux d’imposer sa vérité doctrinale à l’autre en cas de victoire. Or, en règle générale, « « Les guerres de religion » ont évidemment d’autres raisons que tel ou tel point de dogme » (J-C. Carrière, 2015, p. 90).
En effet, entre le XIe et le XIIIe siècle, il eut neuf croisades en Terre Sainte officiellement avec « pour objectif la récupération du tombeau du Christ à Jérusalem, premier lieu saint de la chrétienté » (J. Flori, 2015, p. 23). Mais, les ambitions réelles s’afficheront au fil des croisades : combattre «l’islamité, une entité politique, militaire et religieuse, perçue comme une puissance longtemps envahissante mais devenue vulnérable à la fin du XIe siècle » (Jean Flori, 2015, p. 22). Ainsi, sous le manteau religieux des croisades se cachaient des réalités de conquêtes (ou de reconquêtes) d’influences et d’espaces géostratégiques. Barnavi et Rowley (2006, p. 139) montrent que, dans des interprétations tendancieuses des textes sacrés, l’Occident chrétien et les mouvements terroristes islamiques prolongent, aujourd’hui, ce vieil esprit des Croisades et du Djihad : Al-Qaïda contre la croisade dite démocratique de l’armée américaine en Iraq en 2005, Boko Haram contre les États occidentalisés du Nigéria, du Cameroun et du Niger. Boko Haram signifie d’ailleurs « L’éducation occidentale est un péché »[4]. De même, Aqmi, les Shebab somaliens et Al-Mourabitoune, rejettent l’hégémonie occidentale pour une organisation socio-politique islamique et territoriale indépendante.
En remontant le temps, un autre massacre qui a été lié à la religion mérite l’attention : le massacre de la Saint Barthélémy en France. Le raccourci qui consiste à dire que cette guerre (qui en entrainera d’autres) est une guerre par laquelle, le catholicisme voulait éradiquer le protestantisme naissant est trop réductionniste pour exprimer la motivation inavouée de ce conflit. La réalité sous le vernis est en effet que dans le massacre de la nuit de la Saint Barthélémy, du 23 au 24 Août de l’an 1572, tout est stratégie d’influence politique autour du roi Charles IX. Craignant l’influence grandissant de l’amiral Gaspard de Coligny, la reine Catherine de Médicis ourdit un complot pour l’assassiner. Le complot échoua et pour éviter que les enquêtes exigées par les huguenots ne la mettent en cause, Catherine de Médicis convainquit le roi d’ordonner le meurtre des chefs protestants. Un emballement populaire s’installa et « comme toujours dans ce genre d’emballement populaire, il y eut l’effet de contagion caractéristique des mouvements de foule, le goût du sang et de l’action collective, l’assouvissement de vengeances personnelles, l’ivresse du pillage » (E. Barnavi et A. Rowley, p. 69). Le lourd bilan de plus de treize mille morts aura permis à Catherine de Médicis de réussir à raffermir son autorité en écartant ses adversaires politiques. Voilà qui confirme encore que les guerres dites de religion ne sont pratiquement jamais de religion. Car en ce XVIe siècle où l’adage « une foi, un roi, une loi » faisait force de dogme, la bataille vraiment religieuse entre Catholiques et Réformistes se déroulait ailleurs entre armatures théologiques dans des affrontements de pamphlets et dans les rencontres du Concile de Trente.
Qui nierait par ailleurs que, plutôt qu’une bataille religieuse, des raisons économiques, politiques et identitaires sont les véritables motivations des orages sanglants entre l’Inde et le Pakistan, au moment de la proclamation de leurs indépendances en août 1947 ? Que dire des opérations de Daech ? Sinon qu’ici, nous sommes dans un cas où les frustrations se cristallisent en dangereux « choc des civilisations » pour emprunter l’expression à Huntington. Loin d’être une lutte entre chiites et sunnites[5], l’émergence fulgurante de l’État Islamique (EI) en dit long sur la raison profonde de son existence : « Les djihadistes en rêvaient, l’État islamique l’a fait : un Califat islamique est né » (H. Leblond, 2015, p. 67). Le danger aujourd’hui, est de craindre que le nettoyage de l’EI de la carte n’entraine un EI diffus et démultiplié. Sous le manteau de l’islam, ici aussi, se mène une guerre non pour l’islam comme religion mais pour l’islamisme comme stratégie politique.
À l’infini, on pourrait citer les réalités politiques et géostratégiques qui sont les raisons véritables des guerres dites de religion. Mais, il faut peut-être s’arrêter à celles mentionnées pour porter le regard sur un autre type de raisons couvert par le vernis religieux : les raisons économiques, les biens matériels.
2.2. Le butin sous la bannière de Dieu
« La racine de tous les maux, en effet, c’est l’amour de l’argent. Pour s’y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l’âme de tourments multiples »[6]. Si les orientations politiques et les positionnements géostratégiques sont les motivations des guerres qui se drapent du religieux, le fait est que la politique et les enjeux géostratégiques ont eux-mêmes l’économie ou les biens matériels comme raisons sous-jacentes.
De fait, le butin sous la bannière de Dieu se voit sous trois formes fondamentales. D’abord, il se donne comme guerre de positionnement commercial et géostratégique : « L’expansion arabe des VIIe et VIIIe siècles répond à l’ambition de s’emparer de territoires et de richesses, bien plus qu’à la volonté de répandre la foi islamique, et la conquête de l’Espagne ne fait pas exception » (A. Rucquoi, 2015, p. 27). Ensuite, il se donne comme pillage ou auto-compensation. Dieu est le prétexte et le groupe religieux l’instrument pour parvenir à ses fins. Habiller le pillage de la légitimité spirituelle, donne bonne conscience, surtout quand il se situe en période de conflit. Enfin, le butin sous la bannière de Dieu se donne comme justification de la convoitise et du vol. Les textes de l’Ancien Testament révèlent l’ambiguïté de la valeur des butins de guerre. Tantôt Jéhovah interdit le pillage du peuple vaincu, tantôt il le tolère[7]. Toutefois, le butin de guerre n’est pas une fin en soi ou le but de la guerre. Mais, dans les guerres modernes, le pétrole, les richesses du sous-sol, les terres cultivables, les pôles commerciaux, etc. sont, le plus souvent, les raisons inavouées, mais principales, qui se cachent derrière le rideau embellissant de la religion.
La religion est invoquée dans les guerres parce qu’elle est instrumentalisable et plus disposée à entretenir les passions. Mais cette religion, statique, selon Bergson, diffère de la religion dynamique. L’approche bergsonienne des fondements des guerres et des figures de la religion nous donne une clé de lecture plus critique pour déconstruire théoriquement les guerres dites de religion.
3. La religion ouverte et les guerres dites de religion : l’approche bergsonienne
Dans ses Deux sources, H. Bergson pose deux figures de la religion qui s’enracinent dans deux sources différentes, le besoin vital et la flamme d’amour divin, animées par des âmes différentes et conduisant à des conséquences différentes. De fait, il faut, selon Bergson, distinguer deux types de guerre émanant toutes d’âmes closes motivées par les aspirations à la gloire et la matérialité. Bergson permet de mieux cerner l’exploitation religieuse des guerres aux motivations inavouées pour l’une de ces figures de la religion, et d’ouvrir des horizons de pacification avec l’autre.
3.1. Guerre accidentelle et guerre nécessaire : guerres d’âmes closes
Dans les « Remarques finales » de ses Deux sources de la morale et de la religion, Bergson pose l’instinct guerrier, d’une part, et la propriété, d’autre part, comme les fonds matriciels permettant de comprendre la tendance à la belligérance à l’intérieur et entre les sociétés : « Peu importent la chose que l’on prend et le motif qu’on se donne : l’origine de la guerre est la propriété, individuelle ou collective (…). L’instinct guerrier est si fort qu’il est le premier à apparaître quand on gratte la civilisation pour retrouver la nature » (H. Bergson, 1990, p. 302-303). Il faut, toutefois, selon lui, distinguer deux types de guerre : l’un est dit « accidentel » et l’autre « essentiel ». Cette distinction appelle clarification.
Aux dires de Bergson, les guerres dites accidentelles sont des guerres dont l’enjeu ne relève pas d’une nécessité existentielle. On se bat « par amour-propre blessé, pour le prestige, pour la gloire » (H. Bergson, 1990, p. 305). Il s’agit de guerre pour l’honneur d’un chef ou d’une nation et de guerre préventive. Par pur prestige, le territoire est agrandi comme on collectionne des trophées de chasse. Les pillages ont pour fin d’humilier le vaincu et non de le réduire à néant. De telles guerres ne relèvent pas de la nécessité. Mais, pour Bergson, par ces « guerres accidentelles », la nature préparait les peuples pour les guerres féroces qui se dresseraient sur leur parcours.
Les guerres essentielles répondent à des besoins de matières premières et de positionnements géostratégiques : « On se bat pour n’être pas affamé, dit-on, – en réalité pour se maintenir à un certain niveau de vie au-dessous duquel on croit qu’il ne vaudrait plus la peine de vivre » (H. Bergson, 1990, p. 305). Les guerres d’occupation et de libération actuelles menées par l’Occident en font partie. Même lorsque le combat est engagé au motif des droits de l’homme ou de la dignité humaine, ce noble idéal cache mal le non-dit de l’avoir d’un peuple tiers convoité par une puissance dominatrice imposant la loi du plus fort sous le manteau des lois internationales. Des échanges effectués dans l’équité auraient été la voie civilisée. Mais, la pression du besoin et la cupidité donnent rapidement lieu à une détérioration des termes de l’échange et c’est le nécessiteux qui, par sa puissance de feu, dicte les règles de l’échange. Tout refus a pour conséquence une mise en demeure, des sanctions économiques de la nébuleuse Communauté internationale et, au cas échant, le déclenchement d’une guerre, pour que la raison du plus fort demeure la meilleure. En pastichant Jules Ferry[8], la politique impérialiste et néocolonialiste est fille de la politique matérialiste des grandes puissances. On se souvient de cet aveu débarrassé de toute diplomatie de Lord Palmerston que reprendront certains chefs d’Etat français : « les États n’ont pas d’amis ; ils n’ont que des intérêts »[9]. On aura compris que les interventions en Afrique de l’armée française, en particulier, et celles des grandes puissances, en général, cachent sous des oripeaux légalistes et humanitaires, des intérêts à préserver et à entretenir avec ou contre des régimes de pays sous-développés.
Et H. Bergson (1990, p. 308) de préciser que la nécessité dont il est question ne relève pas vraiment du vital : « Sans être précisément menacé de mourir de faim, on estime que la vie est sans intérêt si l’on n’a pas le confort, l’amusement, le luxe (…) un pays se juge incomplet s’il n’a pas de bons ports, des colonies, etc. De tout cela peut sortir la guerre ». On pourrait objecter, non sans raison, que la qualité de « guerre nécessaire » n’est pas du tout évidente puisqu’il ne s’agit que de guerres nées de besoins artificiels et accidentels érigés en nécessités existentielles. Qu’il nous suffise de répondre, à la suite de Bergson, que le « nécessaire » ici est une nécessité devenue, un accident érigé en nécessité pour l’homme moderne qui ne peut plus se passer de ce qui, par nature, relève de l’accident. Toujours est-il que ce type de guerre, alimenté essentiellement par le souci de conserver des débouchés, la quête de combustible et de matières premières – en un mot l’excroissance des besoins secondaires -, permet de comprendre que H. Bergson (1990, p. 328) invite à une simplicité de vie si l’on veut éviter les troubles tant sociaux qu’individuels : « Il faudrait que l’humanité entreprît de simplifier son existence avec autant de frénésie qu’elle en mit à la compliquer. L’initiative ne peut venir que d’elle ».
Dans tous les cas, toute guerre, qu’elle soit accidentelle ou qu’elle soit nécessaire, relève d’une âme close, du retournement sur soi dans une attitude égocentrique. Par suite, les guerres de religion ne sont que des fruits d’âmes closes se mouvant dans des religiosités statiques. Déployons cette idée.
Le problème qui sous-tend la rédaction du chapitre II des Deux sources est de savoir comment des croyances ou des pratiques aussi peu raisonnables peuvent être acceptées par des êtres intelligents. La réponse semble portée par le fondement et la finalité de la figure de la religion statique : la fonction fabulatrice de l’homme élabore la religion en vue de se défendre contre l’imprévisibilité, la désorganisation sociale et l’angoisse liée à la mort. Alors, par le double effet de l’exagération et de la répétition, l’esprit adhère à l’absurde, à l’étrange et au monstrueux. Dès lors, « l’expérience a beau dire « c’est faux » et le raisonnement « c’est absurde », l’humanité ne s’en cramponne que davantage à l’absurdité et à l’erreur. Encore si elle s’en tenait là ! Mais on a vu la religion prescrire l’immoralité, imposer des crimes » (H. Bergson, 1990, p. 105). Il apparait que la religion statique est prédisposée à l’intolérance. Mais qu’est-ce qu’une religion statique ?
Bergson (1990, p. 223) la définit par son but : «Tel est (…) le rôle, telle est la signification de la religion que nous avons appelée statique ou naturelle. La religion est ce qui doit combler chez des êtres doués de réflexion, un déficit éventuel de l’attachement à la vie ». Sous cet angle, la religion a une fonction pragmatique d’attachement à la vie tant individuelle que sociale. Mais, en réagissant contre les effets dissolvant de l’intelligence (l’angoisse de la mort, l’égocentrisme, l’attachement à l’immédiate matérialité, les errements de la fonction fabulatrice), la religion statique conserve paradoxalement l’égocentricité de cette intelligence. L’intelligence, quand elle n’est pas ouverte sur une intuition supérieure, reste calculatrice et repliée sur soi, sur ses intérêts propres. La religion statique est, donc, à la fois un tremplin de cohésion sociale et de repli sur soi : elle est cohésion à l’intérieur et, donc, repli défensif contre ce qui n’est pas soi. La fratrie se réduit, alors, aux personnes de la chapelle religieuse, de l’obédience politique ou du groupe ethnique et ne saurait s’étendre à l’humanité. H. Bergson (1990, p. 305) dira que « Homo homini deus et homo homini lupus se réconcilient aisément. Quand on formule la première, on pense à quelque compatriote. L’autre concerne les étrangers ». Dès lors que l’autre n’est qu’un étranger, il peut être rejeté ou tué, sans ébranler la foi au Dieu miséricordieux. Un français catholique pouvait donc tuer un français luthérien et un islamiste nigérian peut assassiner un nigérian chrétien ou un « incrédule », quand ils pensent éliminer un être étrange et non un humain comme eux. Ainsi, le pouvoir de castration de la religion sert de paravent à des causes extra-religieuses.
La situation de la religion statique, fondement de déboires divers, n’est pas tellement meilleure à ces cas de figures de religiosités que Bergson qualifierait de religion d’entre-deux. H. Bergson (1990, p. 62) écrit : « Entre l’âme close et l’âme ouverte il y a l’âme qui s’ouvre. (…) Entre le statique et le dynamique on observe en morale une transition ». De même, entre une porte fermée et une porte ouverte, il y a une porte entr’ouverte ou le mouvement d’ouverture. Autant l’ouverture a une conséquence opposée à la fermeture parce que l’une est invitation à entrer et l’autre, interdiction de passage, autant l’entrebâillement est hésitation entre ces deux conséquences. De même, la situation de l’entre deux qu’est l’entrebâillement est possibilité d’ouverture ou, au contraire, risque de fermeture. En morale et en religion, l’état intermédiaire entre le clos et l’ouvert se donne comme un arrêt entre le statique et le dynamique. Or, « qui s’arrête entre les deux est nécessairement dans la région de la pure contemplation, et pratique en tout cas naturellement, ne s’en tenant plus à l’un et n’étant pas allé jusqu’à l’autre, cette demi-vertu qu’est le détachement » (H. Bergson, 1990, p. 63). Cette « demi-vertu » est encore expression de l’intelligence qui reprend les formules des héros et des mystiques sans s’élever vraiment à l’agir de ces porteurs d’humanité que la vie a soin de semer le long de l’histoire pour relancer la machine quand elle se grippe. On comprend, alors, le paradoxe de notre monde : plus il y a d’hommes de Dieu et d’organisations à vocation de charité et de quête de paix, plus les guerres se multiplient et s’arriment à l’évolution scientifique et à la terminologie religieuse. Notre actualité est, ainsi, marquée par des psalmodies qui accompagnent la fusillade ou la ceinture explosive de ceux qui ont la conviction d’agir au nom d’Allah le Miséricordieux.
Cet élan destructeur est-il appelé à suivre son cours pour gonfler en intensité sous la performance des moyens de la science ? On est tenté de le croire tant les religions en servent de lit et donnent des mobiles aux affrontements. Mais, « des hommes que nous n’hésiterons pas à ranger parmi les bienfaiteurs de l’humanité se sont heureusement mis en travers » (H. Bergson, 1990, p. 305-306). Ces hommes, Bergson les nomme des héros et des mystiques. Avec eux, la société et la religion s’ouvrent à des horizons d’espoir en passant des religiosités closes et intermédiaires à une religiosité dynamique ou ouverte.
3.2. L’élévation à la tolérance du mystique par la religion dynamique
La religion dynamique est celle du mystique ou du moins, la religion pénétrée par l’expérience mystique. C’est que, comme l’a vu Worms (2000, p. 49) dans son Vocabulaire de Bergson, « Le mysticisme complet est donc la participation d’un individu à l’action divine, contact avec elle et effort pour la prolonger, dépassement partiel de l’humanité et effort intensif pour la transformer ». Ainsi, la mysticité, loin d’être illusoire, est porteuse du sens métaphysique et historique de l’humanité en précisant la direction morale que devrait prendre l’homme. « Le grand mystique serait (alors) une individualité qui franchirait les limites assignées à l’espèce par sa matérialité, qui continuerait et prolongerait ainsi l’action divine. Telle est notre définition » (H. Bergson, 1990, p. 233). Quand de tels hommes sont semés par l’élan de vie dans les virages de l’histoire, le social et le religieux connaissent une vitalité accrue, une énergie spirituelle et plus d’harmonie. « Qu’on pense à ce qu’accomplirent, dans le domaine de l’action, un saint Paul, une sainte Thérèse, une sainte Catherine de Sienne, un saint François, une Jeanne d’Arc et tant d’autres » (H. Bergson, 1990, p. 233).
La religion dynamique est un élan imprégné du Dieu-amour qui dépasse les frontières érigées par l’âme close. Elle favorise la tolérance par la différence acceptée comme richesse humaine. Dans son Traité sur la tolérance de 1763, Voltaire (2016, p. 13) semblait s’adresser à notre temps en proie au terrorisme religieux : « nous avons assez de religions pour haïr et persécuter, et nous n’en avons pas assez pour aimer et pour secourir ». Bergson dirait qu’effectivement, nous avons assez de religions statiques pour nous haïr et nous persécuter et trop peu de religion dynamique pour porter le flambeau de l’amour divin.
S’en remettant à Dieu au nom de qui beaucoup s’octroient des droits de persécution, Voltaire lui demande, au terme de son Traité, d’imprimer dans le cœur de l’homme cette réalité que les hommes ne viendront pas à lui uniformément, car « ce serait le comble de la folie de prétendre amener tous les hommes à penser d’une manière uniforme sur la métaphysique. On pourrait beaucoup plus aisément subjuguer l’univers entier par les armes que subjuguer tous les esprits d’une seule ville » (Voltaire, 2016, p. 13). À la vérité, les hommes s’entretuent pour d’autres raisons que Dieu. Le mystique le fait comprendre en opposant « le zèle de l’humanité » au zèle dogmatique de la sévérité d’une « religion trompée » et tronquée par des intérêts égocentriques (Voltaire, 2016, p. 6).
John Locke, dans Lettre sur la tolérance, ne disait pas autre chose que d’appeler à cette religion du cœur, de la vertu, que Bergson appelle la religion dynamique. J. Locke (2002, p. 7) écrit : « Le but de la véritable religion est tout autre chose : elle n’est pas instituée pour établir une vaine pompe extérieure, ni pour mettre les hommes en état de parvenir à la domination ecclésiastique, ni pour contraindre par la force ; elle nous est plutôt donnée pour nous engager à vivre suivant les règles de la vertu et de la piété ». En d’autres mots, le véritable zèle religieux ne consiste pas à clouer au pilori le différent de soi ou à enflammer la case des autres, mais à bruler le vice, le désordre et la haine en soi. Bergson peut conclure qu’en chacun de nous résonne l’appel à la mysticité, appel que des héros moraux et spirituels de l’histoire font retentir. Cet appel, « nous ne le suivrons pas tous, mais tous nous sentirons que nous devrions le faire, et nous connaîtrons le chemin, que nous élargirons si nous y passons » (H. Bergson, 1990, p. 333). Si nous y passons, l’espoir de voir les portes des guerres se refermer serait plus net et l’acte de divorce entre religion et guerre serait signé par l’humanité.
À cette fin, « nous ne croyons pas à la fatalité en histoire. Il n’y a pas d’obstacle que des volontés suffisamment tendues ne puissent briser, si elles s’y prennent à temps. Il n’y a donc pas de loi historique inéluctable » (H. Bergson, 1990, p. 312-313). Cette affirmation de Bergson donne à penser deux choses essentielles face aux guerres en général et aux guerres de religion en particulier. D’abord, la guerre n’est pas une fatalité qui s’imposerait à l’homme comme une loi historique dont la réalisation est inéluctable. L’instinct guerrier est le fait donc de l’homme dans la quête de l’assouvissement de ses besoins de natures diverses. Ensuite, en réagissant à temps, ensemble et avec suffisamment de volonté, les hommes peuvent rompre avec le cercle infernal de la violence et des guerres.
Conclusion
Que dire pour conclure nos propos sur les enjeux des guerres dites de religion ? Notons d’abord que la religion est incontournable parce qu’inhérente à la société humaine. « Il est donc de l’intérêt du genre humain d’examiner si la religion doit être charitable ou barbare » (Voltaire, 2016, p. 10). Ce que révèle cet examen, quand on a soin de l’approfondir, c’est que la religion est souvent employée à des fins non religieuses. Des motivations politiques, matérielles et géostratégiques sont, en réalité, au fondement aussi bien des guerres en général que des guerres dites religieuses en particulier. Mais, le religieux est employé comme couverture parce qu’il est un incontestable ferment de mobilisation des hommes et de castration de la rationalité dans le cadre de la religion statique. Ainsi, Dieu est associé à toutes les causes comme le camouflage idéal pour donner de la crédibilité à l’action. Hier, comme aujourd’hui, le référent religieux constitue la chiquenaude idéale pour entraîner avec soi les cœurs vaillants.
En discernant et dissociant, dans la religion, l’essence de l’ivraie, le dynamique du statique, Bergson invite à porter le regard sur ces mystiques qui montrent qu’une existence où est brisé l’arc de la guerre est possible. Encore faut-il aider l’humanité à s’élever à cette mysticité dont la tolérance est le corollaire et l’Amour le socle.
Références bibliographiques
BARNAVI Elie et ROWLEY Anthony, 2006, Tuez-les tous ! La guerre de religion à travers l’histoire VIIe-XIXe siècle, Paris, Editions Perrin.
BERGSON Henri, 1990, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF/Quadrige.
CARRIÈRE Jean-Claude, 2015, « Les religion de la guerre » in L’OBS : Le retour des guerres de religion, Hors-série, Paris, Novembre –Décembre 2015.
COLOSIMO Jean-François, 2015, « Aux sources de la terreur sacrée » in L’OBS : Le retour des guerres de religion, Hors-série, Paris, Novembre –Décembre 2015.
FERRY Jules, 1980, Le Tonkin et la mère patrie, Paris, Ed. Haward.
FLORI Jean, 2015, « A l’assaut de la Terre sainte » in L’OBS : Le retour des guerres de religion, Hors-série, Paris, Novembre –Décembre 2015.
HEGEL Georges Wilhelm Friedrich, 1975, La phénoménologie de l’Esprit, Trad. Jean Hyppolite, Tome II, Paris, Aubier/Editions Montaigne.
HUNTINGTON Samuel Phillips, 2007, Le choc des civilisations, Trad. Jean-Luc Fidel et al., Paris, Odile Jacob.
KÉFI Ridha, 2010, «La liberté religieuse menacée ? », NewAfricann°14 : Guerres des religions en Afrique, Paris, Mai-Juin 2010.
LEBLOND Hubert, 2015, « Daech / État islamique. L’émergence fulgurante d’un État totalitaire » in L’OBS : Le retour des guerres de religion, Hors-série, Paris, Novembre-Décembre 2015.
LOCKE John, 2002, Lettre sur la tolérance, Trad. Jean Le Clerc, Version numérique de J-M. Tremblay, Québec.
MAUGENEST Denis, 2004, L’idéologie et les idéologies, Abidjan, CERAP/Comprendre n°1.
MONTCLOS Marc-Antoine Pérouze de, 2015, « Le retour des djihadismes africains » in L’OBS : Le retour des guerres de religion, Hors-série, Paris, Novembre-Décembre 2015.
ONFRAY Michel, Traité d’athéologie, 2006, Paris, Editions Grasset & Fasquelle.
RUCQUOI Adeline, 2015, « L’Espagne des trois religions » in L’OBS : Le retour des guerres de religion, Hors-série, Paris, Novembre –Décembre 2015.
TOCQUEVILLE Antoine De, 1992, De la démocratie en Amérique, Tomes 1 et 2, Paris, Gallimard.
VOLTAIRE, 2016, Traité sur la tolérance, version numérique BIBEBOOK, www.bibebook.com
WILLAIME Jean-Paul, 2012, Sociologie des religions, Paris, Que sais-je ?/PUF.
WORMS Frederick, 2000, Vocabulaire de Bergson, Paris, Ellipses.
QUELLES APPRÉHENSIONS DE LA MODERNITÉ À LA LUEUR DE LA CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE DE CLAUDE BERNARD ?
Tiasvi Yao Raoul AGBAVON
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La modernité est-elle le rejet systématique de toutes les questions passées qui, semble-t-il, ont été résolues ? La modernité se présente comme l’expression d’une rupture avec l’ancien, or entre l’ancien et le moderne, tout ne tient qu’à des appréciations concourant à les reconnaître comme tels. Ce qui est moderne vaut en fonction des valeurs ou des critériums de pensée qui le sous-tendent. À cet effet, peut-on parler, à bon droit, de modernité sans en contester l’idée ? L’objet de cette contribution est de mettre en relief l’étroite relation entre l’ancien et le nouveau, le passé et le moderne, qui ne tient qu’aux valeurs et aux canons qui les légitiment. L’histoire des sciences est, autant que faire se peut, une lucarne ouverte sur les volte-face de la modernité. À cet effet, l’approche historico-critique, appliquée à la contribution scientifique de Claude Bernard, peut permettre de considérer les perspectives modernes comme un remaniement, une amélioration, un affinement, parfois un abandon de l’ancien sans jamais rompre totalement avec lui.
Mots-clés : Ancien, Canon, Contester, Modernité, Rupture, Sciences.
Abstract :
Modernity is the systematic rejection of all the last questions which apparently were solved? Modernity is presented in the form of an expression of a rupture with the old one, but between the old one and the modern one, all is due only to appreciations contributing to recognizing them like such. What is modern is worth according to the values or of the criteriums of thought which underlie it. For this purpose, can one speak, justifiably, of modernity without disputing the idea of it? The object of this contribution is to highlight the close relation between the old one and the new one, the past and the modern one, which are due only to the values and the canons which legitimate them. The history of sciences is, as far as possible, an attic window open on the volte-face of modernity. For this purpose, the historico-critical approach, applied to the scientific contribution of Claude Bernard, can make it possible to regard the modern prospects as a rehandling, an improvement, a refinement, sometimes an abandonment of the old without never breaking completely with him.
Keywords : Old, Canon, to Dispute, Modernity, Rupture, Sciences.
Introduction
Comme le souligne A. Touraine (1992, p. 21), « la modernité n’est pas davantage changement pur, succession d’événements ; elle est diffusion des produits de l’activité rationnelle, scientifique, technologique, administrative ». Cela sous-entend que la modernité, non seulement implique le changement, mais est plus une diffusion de l’activité rationnelle. Dans le cadre de cette étude, ce qui nous importe tient à son aspect scientifique. Ainsi, l’évolution de l’activité rationnelle scientifique, décrite par l’histoire des sciences, se décline sous une facette où, à n’en point douter, le discontinuisme a trouvé ses lettres de noblesse. En scandant le progrès des sciences, il est vraisemblable qu’il n’obéit pas à une suite linéaire, mais plutôt qu’il est fait de ruptures, de discontinuités. « Le désir d’acquérir une connaissance toujours plus vaste et une compréhension toujours plus profonde du monde dans lequel il se trouve » (C. Hempel, 1972, p. 3), l’un des besoins de l’homme auquel correspond la science, a suivi diverses trajectoires. S’il faut donc parler d’histoire des sciences, c’est sans doute en retraçant ce qui s’est fait dans les périodes antérieures et qui ont contribué à construire l’édifice scientifique. Car, comme le souligne G. Canguilhem (1979, p. 14), l’histoire des sciences
est un effort pour rechercher et faire comprendre dans quelle mesure des notions ou des attitudes ou des méthodes dépassées ont été, à leur époque, un dépassement et par conséquent en quoi le passé dépassé reste le passé d’une activité à laquelle il faut conserver le nom de scientifique.
Cependant, si « l’idée de modernité est donc étroitement associée à celle de rationalisation » (A. Touraine, 1992, p. 22), il faut reconnaître qu’évoquer la modernité contraste avec tout ce qui fait référence au passé, à l’ancien, au traditionnel. De plus, « le degré de modernité se mesure à l’aune de son écart d’avec les formes « traditionnelles » » (G. Benko, 2009, p. 39). À y voir de près, la modernité traduit une rupture avec le mode de pensée traditionnel considéré comme dépassé. Dès lors, que vaut la modernité, lorsque « l’histoire des sciences ne peut être que précaire, appelée à sa rectification » (G. Canguilhem, 1979, p. 20) ? Ce qui est moderne ne tient-il pas comme tel par les canons qui le légitiment ?
Cette contribution vise à examiner la modernité, à partir de l’histoire des sciences, notamment à travers la contribution scientifique de C. Bernard. En effet, par la méthode historico-critique, il s’agira de mettre en évidence le caractère rébarbatif de la modernité qui exprime une sorte d’amorphisme dans le chevauchement du passé et du nouveau, de l’ancien et du moderne.
1. Modernité et nouvelles visions du monde : une fracture entre l’ancien et le nouveau
Le développement de la pensée humaine a connu différents stades successifs. Selon la conception d’Auguste Comte (1934, p. 2),
l’esprit humain, par sa nature, emploie successivement dans chacune de ses recherches trois méthodes de philosopher, dont le caractère est essentiellement différent et même radicalement opposé : d’abord la méthode théologique, ensuite la méthode métaphysique, et enfin la méthode positive.
Cette succession méthodologique, sur laquelle s’est assise l’odyssée cognitive de l’esprit humain, présente une sorte de rupture entre les différents moments qui la compose.
Si la science grecque met en évidence la rationalité, à travers l’interprétation naturelle des phénomènes, c’est parce qu’elle a rompu avec toute forme d’interprétations théologico-magiques du monde. L’effort de rationalisation de la nature s’est inscrit dans des perspectives qui ont connu de profonds bouleversements. Ceux-ci ont instauré une fracture entre les conceptions considérées comme dépassées et celles dites nouvelles. Cette situation s’illustre mieux avec le schisme entre la science aristotélicienne (Antiquité) et la science moderne (traduite par une suite de remises en cause des considérations fondamentales de l’Antiquité).
1.1. Le règne de la science aristotélicienne et son déclin vers une nouvelle cosmologie
Sans conteste, la science aristotélicienne est marquée par le géocentrisme. Comme système qui privilégie la terre au centre de l’univers, le géocentrisme impliquait une vision du monde qui déteignait sur la plupart des considérations scientifiques. L’implication majeure du système géocentrique est la séparation du monde terrestre d’avec celui du ciel et l’immutabilité du cosmos. À partir de cette manière de voir le monde découlent tous les aboutissements de la pensée aristotélicienne par le raisonnement déductif.
Il faut reconnaître que l’une des caractéristiques premières de la science d’Aristote est la déduction. En effet, tout le cheminement rationnel, chez lui, s’inscrit dans une logique déductive. Il suffit de poser des prémisses pour découler tout le reste. Ainsi, dans le traité Du ciel, Aristote (1965, p. 226), au sujet de la finitude de l’univers, affirme que « l’inexistence d’un corps infini est manifeste pour qui fait porter son examen sur chaque corps en particulier ». Le problème de la finitude de l’univers tient à ce que des entités finies ne puissent constituer une infinité. Aussi la thèse des lieux naturels (haut/bas, ciel/terre) et leur antagonisme illustre-t-elle la particularité des réflexions aristotéliciennes, selon lesquelles tout est régi par une hiérarchie fonctionnelle allant de l’imparfait au parfait, du simple au complexe.
Il serait incongru de vouloir saisir toute l’œuvre d’Aristote pour appréhender comment s’est construit son règne sur plusieurs siècles. C’est avec raison que J.-P. Maury (1992, p. 17) souligne qu’« il est évidemment impossible, en une page, de détailler une œuvre qui en occupe des milliers, et à laquelle en ont été consacrés des centaines de milliers ». Toutefois, les idées qui importent, ici, et qui traversent toute la pensée aristotélicienne sont celles de la dichotomie du monde en plus de son aspect clos et de la distinction fondamentale des corps. Dès lors, si la conception aristotélicienne de l’univers et ses diverses classifications (aussi bien physiques que biologiques) ont régné sur plusieurs siècles, cela n’a point été en déphasage avec les idées précitées. Quoi qu’il en soit, Aristote a apporté « une contribution durable à l’astronomie sous la forme d’un modèle à cinquante-cinq sphères (…) disposées concentriquement autour d’une Terre immobile » (J.-P. Maury, 1992, p. 16). À la vérité, l’immobilité de la terre, thèse majeure de son système, illustre la position préférentielle de celle-ci dans le cosmos. De l’Antiquité jusqu’à la période Moderne, en passant par le Moyen-âge, la philosophie et la science aristotélicienne couvrent toutes ces périodes. De plus, la période Moderne en a gardé quelques relents, même si elle a marqué un tournant décisif de l’histoire.
L’époque médiévale, considérée comme la période sombre de l’histoire de l’humanité, n’a pas, considérablement, contribué à l’émergence de la science. Jugée comme une période d’obscurantisme, vers son crépuscule, cette époque n’a été que celle de la redécouverte de l’œuvre d’Aristote. Sans conteste, « le Moyen Âge en fit l’autorité suprême dans tous les champs du savoir (« Aristote l’a dit ») » (F. Stirn, 1999, p. 5). Cette situation exemplifie l’autorité aristotélicienne consolidée par Saint Thomas d’Acquin[10].
Jusqu’au XIIIe siècle, l’autorité d’Aristote s’exerce toujours, mais « s’amorce l’abandon progressif de la scolastique, sous l’impulsion de penseurs originaux : Roger Bacon (1214-1294), Guillaume d’Ockham (mort en 1350), Nicolas de Cuse (1401-1464) qui annonce la Renaissance) » (B. Jarrosson, 1992, pp. 20-21). Jusque-là, la contestation de l’autorité d’Aristote qui est mise en exergue n’a pas grandes incidences sur la manière de voir le monde. Progressivement, la remise en cause des conceptions aristotéliciennes s’illustre, entre autres, avec la substitution de son concept du mouvement par « la théorie de l’impetus, plus conforme aux observations » (B. Jarrosson, 1992, p. 21). Ce n’est pas encore un bouleversement total, mais le début d’une série de remises en cause.
Le postulat héliocentrique, proposé par Nicolas Copernic[11], présente une nette opposition entre le système qui en découle et celui du géocentrisme. Certes, la thèse de Copernic n’est pas en elle-même une grande innovation, mais elle a ouvert des perspectives nouvelles, jamais approchées par le géocentrisme d’Aristote à Ptolémée[12]. La critique d’une thèse qui prévalut plusieurs siècles durant, par Copernic, a soulevé un grand débat scientifique, car elle mettait à mal le géocentrisme qui courait à sa perte. Ainsi, le déclin du système géocentrique, déclenché avec la révolution héliocentrique, a entraîné une série de ruptures scientifiques qui constituent le point de départ de la modernité en général.
1.2. La cosmologie galiléenne, le rationalisme cartésien et le siècle des Lumières : les visages originels de la modernité
Si « on attribue à Copernic et à Galilée le mérite d’avoir imposé la représentation héliocentrique du monde » (B. Jarrosson, 1992, p. 22), c’est plutôt à Galilée que référence est faite en ce qui concerne la confirmation scientifique de l’héliocentrisme. Cette confirmation a vu la prééminence du système héliocentrique sur le géocentrisme, non par pur raisonnement déductif, mais par procédé expérimental. La cosmologie selon Galilée marque une rupture avec la conception aristotélicienne. Non seulement elle récuse l’immobilité de la terre, elle objecte aussi la perfection des corps célestes. Ses implications scientifiques sont nombreuses, néanmoins « on peut résumer en quelques mots le rôle historique sans équivalent joué par Galilée : il a renversé la barrière établie deux mille ans plus tôt, par les Athéniens, entre le ciel et la Terre » (J.-P. Maury, 1992, p. 22). C’est une approche toute nouvelle du cosmos qui, au-delà de déprécier la terre comme centre de l’univers, le conduit à son extensification.
Le monde n’est plus clos. Le passage à un univers infini, où ciel et terre ne sont plus séparés mais unifiés, est effectif. Il ne s’agit pas d’une simple idée ou comme l’avait fait Copernic de remplacer « un axiome par un autre » (I. Asimov, 1986, p. 11). C’est par un processus expérimental que Galileo Galilei dit Galilée (1564-1642) parvient à confirmer la thèse héliocentrique et l’unité du ciel et de la terre. Quoi qu’il en soit, l’œuvre galiléenne constitue le point de départ de la science moderne. En effet, parmi plusieurs images qui décrivent Galilée, l’une d’entre elles « montre un Galilée fondateur de la science moderne. À juste titre, mais pour une raison qualitative qui n’apparaît pas toujours dans sa pleine lumière » (E. Bellone, 2003, p. 4). De plus, la science moderne place l’induction « au-dessus de la déduction comme méthode scientifique. Au lieu de bâtir des conclusions à partir d’un ensemble d’hypothèses générales, la méthode inductive part des observations et en tire des généralisations » (I. Asimov, 1986, p. 12). C’est surtout cette rupture scientifique que Galilée a opérée, afin de donner de nouvelles perspectives méthodologiques issues de la conjonction entre induction et déduction, entre les mathématiques et l’expérimentation.
Pour Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. C’est une affirmation majeure qui aboutit à la mathématisation de la nature. Toutefois, s’il est considéré comme le fondateur de la science moderne, l’époque moderne est marquée par l’empreinte indélébile de René Descartes. Nul ne saurait ignorer la célèbre phrase du Discours de la méthode selon laquelle :
au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. (R. Descartes, 2000, pp. 98-99).
Certes, c’est dans ce passage qu’est contenue l’affirmation majeure de la pensée cartésienne, pourtant l’influence de Descartes tient plus au culte de la raison. En effet, au XVIIe siècle, Descartes, en inaugurant le courant philosophique rationaliste, cherche premièrement à se départir de la scolastique. Ensuite, il prend pour modèle méthodologique le raisonnement mathématique qui doit, selon lui, être l’idéal de toutes les sciences. C’est à partir de ce modèle qu’il élabore les quatre règles de la méthode[13] qui doivent guider la recherche de la vérité dans les sciences.
La contribution de Descartes à la modernité scientifique est remarquable par l’insistance sur l’exercice de la pensée qui doit émaner du sujet lui-même, et non construit à partir d’une quelconque autorité. C’est une rupture fondamentale d’avec la pensée scolastique qui invite à faire usage de sa propre raison, puisque celle-ci « est la chose du monde la mieux partagée » (R. Descartes, 2000, p. 29). La raison constitue, ainsi, la faculté qui nous permet d’accéder à la vérité. La science cartésienne s’illustre avec le rejet des explications occultes (Cf. B. Jarrosson, 1992, p. 26) et la conception de l’univers comme une grande machine[14]. Aussi est-il que la science doit contribuer au bien-être de l’homme.
L’incitation à se servir de la raison est l’une des caractéristiques fondamentales de l’époque moderne. Elle a atteint son point culminant avec le siècle des Lumières qui a commencé « à la fin de XVIIe siècle » (J. Mondot, 2007, p. 9). À la vérité, le siècle des Lumières est l’expression de l’idée cartésienne selon laquelle, il faut se soumettre seulement à la lumière naturelle (la raison) plutôt qu’aux interprétations divines ou surnaturelles. C’est ainsi que ce siècle a initié le mouvement du recours aux lumières de la raison dans toutes les activités humaines. Selon Kant,
les Lumières, c’est pour l’homme sortir d’une minorité qui n’est imputable qu’à lui. La minorité, c’est l’incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d’un autre. (…) Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement : telle est donc la devise des Lumières. (J. Mondot, 2007, p. 79).
Au fond, le siècle des Lumières marque l’apogée du culte de l’autonomie de la raison qui émane de l’audace. Cela peut s’entrevoir dans l’affirmation de J. Mondot (2007, p. 10), « de l’audace, encore de l’audace, et les Lumières vaincront ! ». Le siècle des Lumières, c’est celui de l’autonomie du sujet, c’est celui de la rupture d’avec l’état de tutelle, c’est celui de la nouvelle condition de l’homme en tant qu’être doué de raison et libre. De plus, il a été le lieu de grandes révolutions à l’instar de la révolution industrielle[15], et de la Révolution française de 1789 qui est à l’origine de la Déclaration, le 26 août 1789, des droits de l’homme et du citoyen. Cette révolution a profondément marqué l’histoire de la France en particulier, et celle de l’humanité en général.
L’époque moderne est le théâtre de toutes les grandes révolutions que l’humanité n’a jamais connu. À tous les plans, aussi bien scientifique, industriel, social que politique, la modernité implique une rupture d’avec les approches traditionnelles. Toutefois, s’il faut approcher le concept de modernité, ce n’est pas moins faire ressortir les idéaux qui en découlent, afin d’en juger la valeur et la portée. Dans cette perspective, cette contribution s’en tiendra à l’analyse de la modernité scientifique.
2. La modernité scientifique et la question de l’unité
La modernité, en général, traduit le départ entre les conceptions dites anciennes et celles qui sont nouvelles. Le tableau de la modernité exprime plusieurs visages, celui de la science avec les profondes réformes astronomiques (commencées par Nicolas Copernic et confirmées par Galilée), philosophiques avec Descartes (toujours la continuité des perspectives galiléennes) et socio-politiques (opérées par le siècle des Lumières). Certes, il faut se débarrasser des anciennes visions, mais plus encore il faut mettre en place de nouvelles perspectives. Cette réflexion veut s’appesantir, dans la modernité scientifique, sur la question de l’unité dans les sciences, à partir des perspectives galiléennes et ses ramifications, que ce soit sur le plan de la physique comme sur celui de la biologie.
2.1. Les implications de la révolution copernicienne et les perspectives galiléennes : un univers homogène
La remise en cause de thèses séculaires, jugées dépassées ou incapables de produire avec succès de bons résultats, annonce les débuts de grandes révolutions. Thomas Kuhn (1983, p. 104) souligne que « dès le début du XVIe siècle, un nombre croissant des meilleurs astronomes d’Europe reconnaissaient que le paradigme astronomique ne pouvait être appliqué avec succès à ses problèmes traditionnels ». Il s’agit ici du paradigme traditionnel aristotélico-ptoléméen, à partir duquel certaines prévisions ne concordaient pas avec les observations faites. Le paradigme était donc en échec, il fallait bien se tourner vers de nouvelles perspectives plutôt que de demeurer dans un système qui ne fonctionnait pas correctement. Ainsi, Copernic, au faîte de cette anomalie, a trouvé la condition de la recherche d’un nouveau paradigme.
Copernic a renversé un paradigme fondamental par un autre. Certes, ce renversement paradigmatique implique, a priori, que le paradigme subversif soit nouveau, pourtant cela n’en est pas le cas. La nouvelle vision du monde par Copernic, en analysant l’histoire des sciences, n’a pas été une innovation. Elle était une affirmation des pythagoriciens, précisément, celle d’Aristarque de Samos[16]. Ce qui passe pour une rupture dans la révolution copernicienne, c’est le rejet des thèses astronomiques qui dominaient jusque-là. À cet effet, Copernic a réussi à réhabiliter une théorie aussi vieille que celle qui rendait compte de toute l’astronomie de son temps. Même s’il n’avait pas de moyens pour confirmer expérimentalement sa thèse, il a préparé une voie, non des moindres, qui a conduit au déclin de toute une tradition théorique aristotélico-ptoléméenne à partir de laquelle de nouvelles perspectives ont été ouvertes. Quoi qu’il en soit, dans la contribution de Copernic, il apparaît une crise qui n’est pas forcément la substitution d’un nouveau par un ancien, mais qui révèle le changement d’un ancien par un ancien remodelé, remanié, réhabilité et rendu légitime. Qui plus est, c’est en exploitant la contribution de Copernic que Galilée fut considéré comme le “père” de la science moderne.
La science moderne, au sens trivial du terme, est-elle toute nouvelle ? Qu’est-ce qui lui donne cette connotation ? À dire vrai, la modernité scientifique avec Galilée trouve son fondement dans l’œuvre de Copernic qui a engagé une rupture. Celle-ci tire sa source d’un vieux débat entre pythagoriciens et aristotéliciens. Certes, les perspectives ouvertes par la position de Copernic étaient plus larges que celles des seconds (aristotéliciens), c’est ce que l’histoire nous enseigne, pourtant dans ses premières élaborations, elle n’a pas bénéficié d’une légitimité immédiate. Il était nécessaire de la tester, de la vérifier. En tout état de cause, c’est à des tests, à des vérifications pour corroborer la thèse héliocentrique, que Galilée s’est attelé.
Galilée approuvait les thèses de Copernic qu’il considérait comme son « maître » avec Johannes Kepler (1571-1630), mais ne disposait pas « d’arguments scientifiques décisifs en faveur du système copernicien » (E. Bellone, 2003, p. 11). En effet, l’atmosphère qui régnait était hostile à la réception d’un tel système. La condamnation par l’Inquisition de Giordano Bruno (1548-1600)[17] en est une illustration. Au fond, il était nécessaire de prouver scientifiquement que la thèse géocentrique était fausse, mais il fallait encore détruire une longue tradition de croyances séculaires. Les idées, selon lesquelles les étoiles étaient fixes et qu’il y avait un monde céleste parfait, distinct d’un monde terrestre imparfait, n’étaient pas moins des dogmes qui légitimaient les conceptions de leur temps.
Bien que les thèses héliocentriques aient été postulées, elles ne passaient pas pour un canon scientifique majeur. Même Galilée qui fondait ses conceptions sur des données expérimentales n’a pas reçu, à son époque, le mérite qui lui aurait été dû. Pourtant, la vision de l’univers que nous avons, aujourd’hui, s’inscrit toujours dans les perspectives galiléennes, c’est-à-dire un univers unifié. Certes, plusieurs questions relatives à la liberté du chercheur, à la méthode, etc. sont actives au cœur de la science moderne, mais la question de l’unité demeure, en un certain sens, la plus grande. Plutôt que de concevoir un monde dichotomique, il faut l’entrevoir comme homogène. C’est l’expression du rejet des conceptions fondées uniquement sur les apparences et les considérations métaphysiques. En réalité, il apparaît une double unité qui s’entrevoit dans les perspectives galiléennes. La première est celle du monde, et la seconde, celle des sciences. À preuve, c’est après avoir « recueilli de nombreuses données dans un domaine autre que l’astronomie, la mécanique » (E. Bellone, 2003, p. 19) que Galilée est parvenu à corroborer ses thèses. Aussi, au niveau méthodologique, tout ne découle pas de la déduction, mais de l’association de l’induction et de la déduction, avec la primauté de la première.
Si avec les perspectives galiléennes dans les sciences de la nature, la recherche de l’unité s’entrevoit, surtout avec le cartésianisme qui prônait une mathesis universalis, ce n’est seulement dans les sciences de la nature que cette question d’unité trouve ses lettres de noblesse. La rupture d’avec un monde fragmenté, dichotomique s’est manifestée aussi dans les sciences du vivant, apparemment plus complexes.
2.2. De l’unité dans les sciences de la nature à l’unité dans les sciences du vivant
Vu que les sciences de la nature ont ouvert la voie aux analyses expérimentales, rejetant la suprématie de la déduction au profit du couple induction et déduction et une quelconque autorité scientifique construite autour d’une personne, les sciences du vivant, à l’instar de la biologie ne pouvaient faire autrement que suivre cette démarche. Dans le domaine de la biologie, l’autorité d’Aristote ne s’est pas estompée aussi rapidement que possible. La classification des êtres vivants selon leurs natures est le fruit de son œuvre. De plus, chaque science admet une autonomie qui lui est viscérale et empêche une sorte d’interdisciplinarité entre les sciences, d’autant plus que le propre de la biologie aristotélicienne et de celles qui se sont inscrites dans ses perspectives est la description plutôt que l’expérimentation.
Au fond, d’Aristote à Carl Von Linné (1707-1778), tout ne tient qu’à une description fidèle des distinctions entre les règnes animal et végétal. Linné a organisé le règne vital en classes, en ordres, en genres et en espèces (cf. I. Yapi, 2015, p. 40). Cette taxonomie n’avait rien de contraire à celle d’Aristote, elle était sa nette amélioration. Toutefois, « fixiste et créationniste, Linné affirme que les espèces, en effet, ont été directement créées par Dieu » (I. Yapi, 2015, p. 42), thèse qui exprime tout le schisme entre les différents êtres vivants par leurs natures. Cette vision concordait bien avec les conceptions aristotéliciennes jusqu’à l’affirmation de la thèse évolutionniste de Charles Darwin (1809-1882). « À la vérité, les espèces sont loin d’avoir les configurations aussi bien délimitées et figées que le laisse supposer la taxonomie fixiste de Linné » (I. Yapi, 2015, p. 44). Plutôt que de faire une analyse exhaustive de l’œuvre darwinienne, en tenons-nous à sa thèse majeure qui est le contre-pied de toute une tradition fixiste des espèces, c’est-à-dire que les espèces évoluent et subissent des transformations qui sont susceptibles de produire de nouvelles espèces. Les travaux de Darwin marquent la pensée biologique moderne en général.
Ce qui importe, ici, c’est la rupture entre les conceptions traditionnelles des espèces et celles de Darwin qui impliquent de nouvelles visions. Toutefois, il n’est pas aisé de percevoir la question de l’unité chez Darwin, même s’il pense l’ordre biologique dans une sorte de relativité. La conception qui traduit le plus la quête de l’unité est celle de C. Bernard qui s’inscrit tant soit peu dans la modernité biologique, plus encore, qui fait apparaître le lien entre la modernité dans les sciences de la nature et dans les sciences du vivant.
L’une des plus grandes contributions Bernardine à la philosophie et à la science, qui traduit l’esprit de la modernité, est la thèse de l’unité des règnes végétal et animal sur fond expérimental. Certes, « la science expérimentale au XVIIe siècle englobe aussi bien le monde inanimé que le monde vivant » (P. Vignais, 2006, p. 55), mais C. Bernard peut être considéré comme celui qui accentue l’introduction de la méthode expérimentale en biologie. Comme souligné, la thèse aristotélicienne en vigueur était celle de la dichotomie, de la distinction : distinction des corps terrestres et des corps célestes, distinction du vivant et de l’inerte, distinction entre les êtres vivants eux-mêmes. Les travaux des biologistes comme Linné, des anatomistes comme Xavier Bichat, n’admettaient pas, une unité vitale, encore moins une correspondance entre vivant et inerte, d’autant plus que le second concevait les sciences de la nature et celles du vivant comme des domaines opposés. Pourtant, si la science moderne, d’inspiration galiléenne se fonde sur la méthode expérimentale,
la biologie, en procédant suivant les mêmes principes méthodologiques que les sciences de la nature, admet par-là même, non seulement la possibilité générale d’appliquer l’expérimentation aux êtres vivants, mais aussi la légitimité particulière de les soumettre à des pratiques de dissection et de vivisection expérimentales ainsi qu’à des synthèses réparatrices, voire créatrices. (I. Yapi, 2015, pp. 12-13).
L’idée d’une analogie entre matières vivante et inerte, vu que leurs approches peuvent être soumises aux mêmes critériums de scientificité, peut être soutenue. Cela tient en une croyance paradigmatique qui sous-tend la plausibilité d’un tel acte cognitif. Si par les procédés expérimentaux, la science moderne a établi une homogénéité de l’univers, les sciences du vivant, à l’instar de la physiologie avec C. Bernard, ont fait de même entre règnes animal et végétal. Quand A. Comte (1869, p. 190) postulait que « la prétendue indépendance des corps vivants envers les lois générales (…) n’est plus désormais directement soutenue, en principe, que par les seuls métaphysiciens », c’est sans doute par le caractère métaphysique des thèses qui sous-tendaient la distinction entre vivants et inertes.
La modernité scientifique d’inspiration galiléenne a permis de voir l’unité du monde, à partir de la méthode expérimentale. Cette méthode, en biologie, a conduit à voir dans les apparences distinctes entre les différents règnes (animal et végétal) une unité vitale. En tout état de cause, l’idée d’unité qui traverse la modernité scientifique ne tient qu’en vertu des résultats expérimentaux, jusque-là admis comme tels.
3. Claude Bernard entre perspectives vitalistes et mécanistes : quand l’ancien et le nouveau se chevauchent
À n’en point douter, C. Bernard fait partie des précurseurs qui ont donné à la méthode expérimentale, dans les sciences du vivant, toute sa clarté. Instruit par les succès de la science moderne, il a su percevoir ses implications pour la biologie à travers la physiologie. Rejetant le vitalisme traditionnel, rejetant l’absoluité du mécanisme moderne, C. Bernard a pris ses distances d’avec les systèmes doctrinaires qui ne pouvaient guère guider une attitude scientifique. À en croire G. Canguilhem (1979, pp. 148-149),
jusqu’à Cl. Bernard, les biologistes ne pouvaient que se partager entre l’assimilation, matérialiste et mécaniste, de la biologie à la physique, et la séparation, commune aux vitalistes français et aux philosophes allemands de la nature, de la physique et de la biologie.
L’attitude de Bernard face aux doctrines est empreinte de l’esprit de la modernité qui s’exprime dans la rupture avec les systèmes pour laisser libre cours aux confrontations entre données théoriques et expérimentales, d’où « il faut modifier la théorie pour l’adapter à la nature, et non la nature pour l’adapter à la théorie » (C. Bernard, 1966, p. 73). Toutefois, si l’attitude de Bernard nous laisse entrevoir des perspectives modernes, comment appréhender la modernité lorsqu’elle traduit le rejet, l’abandon ? Que vaut-elle quand elle est susceptible d’avoir commerce avec l’ancien ?
3.1. Le vitalisme physique et le rejet des vitalisme et mécanisme traditionnels
Selon Antoine Danchin, dans la préface de Qu’est-ce que la vie ? de E. Schrödinger (1993, p. 9), « longtemps marquée par le vitalisme, la biologie devait naître, sous sa forme moderne, du contact avec la physique ». Au fond, la modernité de la biologie est née de son contact avec la physique, mieux avec les thèses mécanistes. Cela a marqué une rupture fondamentale entre biologie fondée sur le vitalisme et biologie nouvelle, c’est-à-dire ayant pour base les principes de la physique et de la chimie. L’abandon des explications vitalistes au profit de celles mécanistes était la quiddité de cette modernité en biologie.
« La théorie mécaniste considère que tous les phénomènes de la vie, y compris chez l’homme, peuvent être expliqués, en principe, en termes de physique » (R. Sheldrake, 2003, p. 30). Si tel est le cas, il devient aisé de comprendre le processus par lequel la modernité dans les sciences de la nature a impulsé celui de la biologie. En effet, avec la science moderne, l’univers est gouverné par des lois qui le structurent et qui valent aussi bien pour les corps célestes que terrestres. Ainsi, la biologie d’obédience mécaniste, héritière de la science moderne, pense le vivant comme soumis aux mêmes lois que celles des corps bruts. Une telle conception elle-même n’était pas irréprochable, néanmoins elle rendait compte du vivant scientifiquement par rapport à sa partie adverse. Car, « si le vitalisme est vague et informulé comme une exigence, le mécanisme est strict et impérieux comme une méthode » (G. Canguilhem, p. 86).
Pourtant, cette modernité, qui entend unifier corps bruts et corps vivants et traduite par le mécanisme, n’a fait qu’accentuer la problématique de la vie dans l’approche du vivant. C. Bernard n’est pas contre l’approche matérielle et mécanique du vivant, néanmoins il récuse que celui-ci soit astreint à cette manière de voir. Il ne mise pas sur un vitalisme qui a la réputation d’être métaphysique. Il refuse aussi de verser dans un quelconque système doctrinaire qui l’enfermerait dans une vision bornée. C’est ainsi, écrit G. Canguilhem (1979, p. 149), qu’il
a su apercevoir que les conditions de possibilité de la science expérimentale du vivant ne sont pas à chercher du côté du savant, mais du côté du vivant lui-même, que c’est le vivant qui fournit par sa structure et ses fonctions la clé de son déchiffrement. Cl. Bernard pouvait enfin, renvoyant dos à dos mécanisme et vitalisme, ajuster la technique de l’expérimentation biologique à la spécificité de son objet.
Il apparaît que C. Bernard, loin de suivre la tendance mécaniste, ou de se confiner dans un quelconque vitalisme, repousse ces systèmes, dont la modernité n’a fait que favoriser l’émergence du premier par rapport au deuxième.
Comme l’affirme A. Chalmers (1988, p. 13), « l’époque moderne tient la science en haute estime », et le critérium expérimental suivant les lois de la physique et de la chimie légitimait l’étude du vivant. Bien que le mécanisme présente un ascendant sur le vitalisme, dans le vivant, il ne saurait être la seule perspective d’approche du vivant, encore moins le vitalisme. S’il faut considérer le vitalisme comme une conception traditionnelle et le mécanisme comme une conception moderne en ce qu’elle marque une rupture avec le premier, il a fini par devenir une conception traditionnelle avec C. Bernard. À cet effet, contre l’idée d’appartenir soit au vitalisme, soit au mécanisme, C. Bernard (1879, p. 524) écrit :
Arrivés au terme de nos études, nous voyons qu’elles nous imposent une conclusion très-générale, fruit de l’expérience, c’est, à savoir, qu’entre les deux écoles qui font des phénomènes vitaux quelque chose d’absolument distinct des phénomènes physico-chimiques ou quelque chose de tout à fait identique à eux, il y a place pour une troisième doctrine, celle du vitalisme physique, qui tient compte de ce qu’il y a de conforme à l’action des forces générales : l’élément ultime du phénomène est physique ; l’arrangement est vital.
Bernard réussit donc à concilier, en vertu d’approches expérimentales, vitalisme et mécanisme dans l’étude du vivant, marquant l’obsolescence de chacune de ces doctrines prises individuellement. Toutefois, au regard de l’objection faite à ces doctrines pour en trouver une troisième plus moderne, au sens de nouvelle, la modernité peut-elle tenir lieu selon qu’elle marque une rupture entre ancien et nouveau ? Il semble, à l’analyse, que la modernité ne saurait s’appréhender unilatéralement, et elle est encline à diverses valeurs de rationalité qui lui donnent sens.
3.2. La dialectique de l’ancien et du nouveau : quand la modernité ne tient qu’aux valeurs paradigmatiques
De plusieurs approches qui expriment la rupture, le schisme, l’abandon, le rejet, l’approche bernardienne peut permettre d’appréhender les volte-face de la modernité. De la sorte, en analysant la pensée et les travaux de C. Bernard, ceux-ci laissent entrevoir qu’ils rompent avec les anciennes conceptions. Par exemple, la conception hippocratique de la maladie fait partie des anciennes théories aujourd’hui. À preuve, elle est dépassée par la conception bernardienne qui a inclus l’influence d’un milieu intérieur[18] dans l’explication des phénomènes vitaux. Sans la prise en compte de ce milieu intérieur, l’étude expérimentale des êtres vivants ne pouvait se faire, à bon droit, suivant les principes de la science expérimentale. Or, l’étude des structures macroscopiques du vivant le distinguait fondamentalement, non seulement, de la matière brute, mais insistait sur les différences de nature entre les organismes vivants.
Un autre exemple de rupture avec une ancienne théorie est la découverte de la glycogénie hépatique par Bernard en 1848. G. Messadié (1988, p. 75), à ce propos, écrit :
Vers le milieu du XIXe siècle, on connaît l’existence du glucose, un « sucre » ou, plus exactement, un hydrate de carbone qui ne peut pas être décomposé par l’eau ; on sait qu’il circule dans le sang et qu’il est utilisé par des tissus vivants pour produire la chaleur, phénomène dont Lavoisier et Laplace avaient entrepris l’étude. On suppose, selon leur théorie, que la « combustion du glucose, sur laquelle on ne savait pas grand-chose, se produit au niveau des poumons. C’est alors que le fondateur de la physiologie moderne, Claude Bernard, réalise une expérience très simple sur l’animal : il prélève du sang qui entre dans le foie et du sang qui en sort, il analyse la teneur en glucose de chaque prélèvement et découvre que le premier n’en contient pas tandis que le second en contient. Donc c’est le foie qui fabrique le « sucre » organique. Plus exactement, le foie fabrique une substance qui se transforme en sucre et que Claude Bernard nomme glycogène, c’est-à-dire « qui produit du sucre ».
La théorie qui régnait jusqu’alors n’avait pas prévu ce phénomène nouveau qui a conféré à C. Bernard le titre de « père » de la physiologie moderne comme on peut le constater avec Messadié. De plus, C. Bernard (1966, p. 229), lui-même, affirme ceci :
par suite d’expériences (…), je fus amené non à trouver l’organe destructeur du sucre, mais au contraire je découvris un organe formateur de cette substance, et je trouvai que le sang de tous les animaux contient du sucre, même quand ils n’en mangent pas. Je constatai donc là un fait nouveau, imprévu par la théorie et que l’on n’avait pas remarqué, sans doute, parce que l’on était sous l’empire d’idées théoriques opposées auxquelles on avait accordé trop de confiance.
Cette découverte marque la rupture entre une théorie et un phénomène. À la vérité, le fait d’avoir découvert la fonction glycogénique du foie a rendu obsolète la théorie selon laquelle le sucre qui se trouvait dans l’organisme provenait exclusivement des aliments extérieurs et se détruisait par les phénomènes de combustion, c’est-à-dire la respiration (C. Bernard, 1966, p. 229). D’une manière ou d’une autre, cette théorie est dépassée et constitue une théorie traditionnelle de la présence du sucre dans l’organisme. Elle a été donc abandonnée par la suite. Toutefois, elle a donné naissance à une théorie nouvelle qui l’a supplanté. En outre, entre la nouvelle théorie et l’ancienne, il y a un départ considérable. Dès lors, peut-il être affirmé que la théorie moderne de la glycogénie rompt totalement avec l’ancienne ? N’y a-t-il pas un mouvement dialectique entre l’ancien et le nouveau ?
Si C. Bernard est parvenu à découvrir un phénomène nouveau, c’est bien en rapport avec l’ancienne théorie. D’ailleurs, il n’y serait pas arrivé en prenant pour point de départ une autre théorie. À cet effet, il faut reconnaître que « les théories sont comme des degrés successifs que monte la science en élargissant de plus en plus son horizon (…). La question n’est pas de condamner l’ancienne théorie au profit de celle qui est plus récente » (C. Bernard, 1966, p. 231). Avec C. Bernard (1966, p. 307), il faut comprendre la modernité comme un processus interminable, vu que « le savant monte toujours en cherchant la vérité, et s’il ne la trouve jamais tout entière, il en découvre néanmoins des fragments très importants, et ce sont précisément ces fragments de la vérité généraux qui constituent la science ». À dire vrai, même si l’histoire des sciences est parsemée de ruptures, il demeure quelque chose d’immuable qui ne saurait être expulsé du champ de la science : la quête de la vérité. De la sorte, l’ancien et le nouveau ne sont que des modes dynamiques en vue de poursuivre cette quête. Quoi qu’il en soit, il y a une dialectique entre l’ancien et le nouveau qui fait que ce qui passait pour moderne peut ne plus l’être et jugée dépassée, sans toutefois que le processus ne soit interrompu.
Conclusion
Comme le souligne G. Canguilhem (1979, p. 20), « l’histoire des sciences ne peut être que précaire, appelée à sa rectification ». Si la modernité scientifique, d’inspiration galiléenne a mis fin à une longue tradition de la science aristotélicienne, elle n’a cependant pas détruit tout le contenu de l’œuvre d’Aristote. Certes, elle a rejeté l’autorité d’Aristote, néanmoins elle l’a profondément remanié. Plutôt que de penser seulement en termes de déduction, elle a privilégié l’induction comme point de départ dans la connaissance scientifique, sans tout de même supprimer la déduction. Quoi qu’il en soit, elle a gardé quelque chose de l’ancien, non pas au niveau du système, mais au niveau du raisonnement. De plus, cette manière de voir n’a été que la légitimation, à partir d’expériences, de conceptions pas tout à fait nouvelles.
Le modèle expérimental, adopté par les sciences du vivant sous l’influence du modèle physico-chimique, a lui aussi ouvert de nouvelles perspectives à ces sciences. L’analyse de la pensée et de certains travaux de C. Bernard a permis de comprendre que la modernité scientifique est une fuite en avant, vu que la vérité scientifique n’est pas absolue, c’est une quête perpétuelle. En tout état de cause, ce qui est considéré comme moderne ne tient que par rapport aux valeurs qui le rendent ainsi. Car, jusqu’à ce qu’il soit remis en cause, il constitue toujours une modernité qui est susceptible de passer pour une théorie traditionnelle, même si certaines conceptions, dans le temps, conservent leurs valeurs fondamentales.
La science moderne d’inspiration galiléenne est aujourd’hui considérée comme classique avec l’avènement de la physique quantique[19] (A. Koyré, 1966, p. 12). Pourtant, elle a influencé profondément la biologie. Toutefois, si les conceptions galiléennes marquent le début de la modernité scientifique, elles ne sont que la marque d’une rationalisation du monde sur fond expérimental. Les sciences biologiques qui s’en sont inspirées, avec C. Bernard, n’ont pas pour autant abandonné les perspectives expérimentales et la liberté scientifique de la modernité. Il semble bien que la modernité soit au prisme de l’ancien et du nouveau, car le paradigme des sciences de la nature a changé pour entrer dans l’ère du postmodernisme. De plus, ce qui est moderne n’est que l’expression d’une idée susceptible d’être dépassée, d’être postmoderne sans pour autant détruire tout lien entre traditionnel et moderne, ancien et nouveau, passé et récent.
Références bibliographiques
ARISTOTE, 1965, Du ciel, Traduction de Paul Moraux, Paris, Les Belles Lettres.
ASIMOV Isaac, 1986, L’univers de la science, Traduit par Françoise Balibar et al., Paris, InterÉditions.
BELLONE Enrico, 2003, Galilée, le découvreur du monde, Les Génies de la Science, Paris, Belin.
BENKO Georges, 2009, « Postmodernité, sciences sociales et géographie », in CAULIER Brigitte et ROUSSEAU Yvan (dir.), Temps, espace et modernités, Québec, PUL, pp. 37-53.
BERNARD Claude, 1966, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865), Paris, Garnier-Flammarion.
CANGUILHEM Georges, 1979, Études d’histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin.
CHALMERS Alan, 1988, Qu’est-ce que la science ? Récents développement en philosophie des sciences : Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Traduit par Michel Biezunski, Paris, Éditions La Découverte.
COMTE Auguste, 1869, Cours de Philosophie Positive, Tome 3, Paris, J. B. BAILLIÈRE et FILS.
DESCARTES René, 2000, Discours de la méthode, Paris, Flammarion.
GRANGER Gilles-Gaston, 1995, La science et les sciences, Que sais-je ?, Paris, PUF.
HEMPEL Carl, 1972, Éléments d’épistémologie, Traduction de Bertrand Saint-Sernin, Paris, Armand Colin.
JARROSSON Bruno, 1992, Invitation à la philosophie des sciences, Paris, Éditions du Seuil.
KOYRÉ Alexandre, 1966, Études galiléennes, Paris, Hermann.
KUHN Thomas Samuel, 1983, La Structure des révolutions scientifiques, Traduction de Laure Meyer, Paris, Flammarion.
MAURY Jean-Pierre, 1992, Petite histoire de la physique, Paris, Larousse.
MESSADIÉ Gerald, 1988, Les grandes découvertes de la science, Paris, Bordas.
MEYER Philippe et TRIADOU Patrick, 1996, Leçons d’histoire de la pensée médicale, Paris, Odile Jacob.
MONDOT Jean, 2007, Qu’est-ce que les Lumières ?, Textes choisis, Traduction de Jean Mondot, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux.
NEPVEU Pierre, 1985, « V.6 BJ/NBJ : difficile modernité », in Voix et Images, Vol.10, N° 2, pp. 159-165.
SCHRÖDINGER Erwin, 1993, Qu’est-ce que la vie ? De la physique à la biologie, Paris, Christian Bourgois Éditeur.
SHELDRAKE Rupert, 2003, Une nouvelle science de la vie. L’hypothèse de la causalité formative, Traduction de Paul Couturiau et al., Éditions du Rocher.
STIRN François, 1999, Aristote, Paris, Armand Colin.
TOURAINE Alain, 1992, La critique de la modernité, Paris, Fayard.
VIGNAIS Pierre, 2006, La science expérimentale et connaissance du vivant. Les méthodes et les concepts, Grenoble, EDP Sciences.
YAPI Ignace Ayénon, 2015, Approches du vivant. Études d’épistémologie biologique, Paris, L’Harmattan.
LA DIFFICILE DÉMOCRATISATION DES ÉTATS AFRICAINS
Adamou DILWANI
Université de Zinder
dilwaniadamou@yahoo.fr / dilwaniadamou@gmail.com
Résumé :
Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer que les États africains sont des mauvais élèves à l’école de la démocratie. Parmi ces raisons, l’on note les barrières culturelles et les stigmates du syndrome de la colonisation. Ces raisons ne sont pas toujours recevables. La difficile démocratisation des États africains n’est liée ni à un manque de culture, ni à des syndromes coloniaux. Ce sont plutôt les conditions de son institution même qui ne sont pas encore réunies en Afrique.
Mots-clés : Barrières-culturelles, démocratisation, difficulté, États-africains, syndrome-colonial.
Abstract :
Several reasons have been put forward to explain why African states perform badly on the arena of democracy. These reasons include, but are not limited to, cultural barriers and the stigma of the colonization syndrome. However, these reasons are not always admissible. The difficult democratization of African States results from neither a lack of culture, nor colonial syndromes. It rather stems from the conditions, of the very institution of democracy, which have not yet been met in Africa.
Keywords : Cultural barriers, democratization, difficulty, African States, colonial syndrome.
Introduction
En Afrique, la démocratie a du mal à s’installer confortablement. Rares sont les pays où on peut s’assurer qu’elle est solidement établie. Dans les pays ayant adopté le principe démocratique, la peur de voir s’interrompre, à tout moment, le processus est toujours présente. La communauté internationale ne cesse de déployer tous ses efforts pour voir la démocratie s’implanter solidement, mais c’est peine perdue. Le moindre relâchement de la communauté internationale donne l’occasion aux antidémocrates de reprendre le pouvoir et, chose étonnante, les putschistes sont même applaudis par les populations comme si les Africains avaient horreur de la démocratie. On a le sentiment que n’eût été la volonté de la communauté internationale de voir le continent se démocratiser, la démocratie ne s’y serait jamais installée. Comment donc expliquer cet état de fait ? Cet état de fait n’est-il pas le fait d’un manque d’une vraie souveraineté ?
Des hypothèses sont avancées pour expliquer cette situation. Pour B. Sakpane-Gbati, par exemple, dans son article intitulé « La démocratie à l’africaine », l’Afrique n’a jamais eu une culture démocratique. C’est pourquoi les Africains ne peuvent s’accommoder des principes démocratiques. De même, A. Dieth, pour sa part, prétend, dans son article, « les stigmates du syndrome colonial, obstacles à la démocratie en Afrique », que les Africains ne peuvent être de bons démocrates, dans la mesure où l’Afrique moderne, elle-même, traîne encore des stigmates de la colonisation dont les méthodes de gestion du pouvoir sont loin d’être démocratiques. Donc la colonisation était, elle-même, un obstacle à la démocratisation du continent africain. L’un dans l’autre, nous comprenons que, pour ces auteurs, l’Afrique n’a pas une tradition de démocratie. La difficile démocratisation de l’Afrique trouve là toutes ses raisons.
Cependant ces raisons sont-elles suffisantes, à elles-seules, à justifier le manque d’enthousiasme des Africains vis-à-vis du régime démocratique ? Partant de certains postulats théoriques solides et de certaines réalités plausibles, on peut dire que ce n’est pas le manque de culture, ni les syndromes coloniaux qui rendent les Africains moins réceptifs à la démocratie. Ce sont plutôt les conditions de son institution même qui ne sont pas encore réunies en Afrique. Car la démocratie ne trouve son plein épanouissement que pour un peuple libre, un peuple qui peut décider en toute souveraineté de ce qu’il veut. Or, les États africains ne décident pas toujours de leur sort. Ils sont soumis à des diktats venant des grandes puissances. Cette hypothèse s’avère pertinente dans la mesure où Machiavel, bien qu’il ne soit pas démocrate, a compris les prérequis et l’enjeu pour un États d’être libre. Aussi soutient-il non pas une liberté individuelle, mais celle d’un peuple tout entier. Un États libre implique nécessairement des sujets libres ; ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de démocratie là où le peuple n’est pas souverain. C’est d’ailleurs pourquoi Machiavel se bat pour une Italie libre. Devant l’absence d’une vraie souveraineté, il est évident que les Africains soient de mauvais élèves.
Il s’agira pour nous, dans un premier temps, de réfuter l’idée de l’absence d’une tradition démocratique comme obstacle à la démocratisation de l’Afrique. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons montrer que nos États n’étant pas encore véritablement libres de leurs actions, car soumis aux diktats des grandes puissances, ne peuvent vivre une démocratie confortable.
1. La réfutation des obstacles supposés liés à la démocratisation de l’Afrique
Il n’est pas rare d’entendre dire que l’Afrique n’a pas une tradition démocratique. C’est ce qui explique la réticence de la plupart des Africains face à la démocratie. Mais une telle idée est-elle recevable ? Absolument pas. Certes, elle peut expliquer, en partie, la résistance des Africains vis-à-vis de la démocratie. Mais elle ne peut expliquer, à elle seule, tout le manque d’enthousiasme démocratique de la population africaine.
1.1. Rejet de l’idée d’une absence de culture démocratique comme obstacle à la démocratisation du continent
D’aucuns pensent que l’Afrique n’a pas une tradition de démocratie. Parmi les auteurs qui soutiennent cette thèse, nous pouvons citer Paulin Hountondji (1977, p. 26-27). Celui-ci a estimé, par exemple, que l’Afrique traditionnelle a un déficit de démocratie. Aussi s’en prend-il à la tradition africaine qu’il considère simplement comme le règne d’une dictature, puisqu’il n’y a pas, selon lui, de liberté de discours, c’est-à-dire d’expression ni d’opinion. Pour lui, cette liberté n’a jamais existé, du moins, elle était réservée aux seuls aînés, et eux-mêmes n’y avaient droit qu’en l’absence des parents qui, à leur tour, n’y avaient droit que quand les chefs n’étaient pas là. En outre, le débat sous l’arbre à palabre auquel se réfèrent la majorité de nos auteurs se faisait toujours par classe d’âge, jamais entre des classes d’âge différentes, alors que la vérité ou une proposition sage peut venir d’un plus jeune :
La plupart des sociétés africaines anciennes étaient effectivement des sociétés de délibération mais cette délibération s’effectuait de façon exclusive, dans un contexte de forte hiérarchisation des statuts où seules certaines catégories sociales (notamment les hommes les plus âgés) avaient accès à la parole et à la décision. (J.-F. Bayart, 1990, p. 8)
Réserver la parole à une classe d’âge au détriment d’une autre constituerait, selon les termes de G. Bachelard (1993, p. 56), un obstacle épistémologique. C’est un frein à la recherche de la vérité, à l’avancement de la science, et par conséquent, au progrès lui-même. Dans de telles conditions où tout est hiérarchisé, on ne peut parler de liberté d’expression ni de diversité d’opinions, gage d’une démocratie véritable. En partant de ce postulat, on peut dire que, dans l’Afrique traditionnelle, la démocratie n’existait pas et que l’Afrique manque de culture démocratique.
Aussi, la culture du chef qui caractérise les sociétés africaines ne serait pas un bon réceptacle pour l’incrustation de la démocratie. En Afrique, on le sait, le chef est pétri de sacralité : il est sacré du fait de l’origine de son pouvoir. En effet, pour légitimer l’autorité du chef, selon D. Akwa (1972, p. 261), l’on recourt à une « aura » mystique qui se formalise par des rituels qu’actualise la vie religieuse. La vie religieuse rend le chef un lieutenant des dieux sur terre ou, ce qui signifie la même chose, un dépositaire sacré des ancêtres (H. Deschamps, 1965, p. 35). Le chef, tout naturellement, dans l’Afrique animiste précoloniale, est considéré comme l’intermédiaire entre la société des vivants et celle sacralisée, symbolisée par les ancêtres. Et, « par l’intermédiaire du sacré, la société est saisie en tant qu’unité, ordre et permanence » (A. Bernard, 1976, p. 24). Le culte des ancêtres assure, en général, la sacralisation du chef. « De ce fait, le sacré, source ultime du pouvoir, justifie l’existence du chef » (A. Bernard, 1976, p. 21). Le sacré devient la source du pouvoir, sa justification ultime. Or, dans une véritable démocratie, le pouvoir n’est pas sacré. Il vient des hommes, et est au service de ces derniers. Il tient sa légitimité des hommes. Nous ne pouvons donc pas, dans les conditions de la société africaine traditionnelle, parler d’une démocratie prétendant que le pouvoir tire sa source des hommes.
Mieux, devant ce système de sacralisation, il n’y a pas possibilité de protestation ni de contestation ni même de résistance à l’autorité du chef. Cette attitude, face au chef, renforce l’idée que l’Afrique ne semble pas prête à la démocratie et que l’Afrique traditionnelle, surtout, ne connaît pas de démocratie. Il n’est donc pas surprenant d’évoquer la barrière culturelle pour justifier les difficultés rencontrées par l’Afrique d’aujourd’hui dans son processus de démocratisation.
Et pourtant, Jean-Godefroy Bidima, en admettant que « les Africains assimilent volontiers multipartisme, démocratie et développement technologique » (J.-G. Bidima, 2015, p. 66), reconnaît que l’Afrique traditionnelle connaissait et vivait la démocratie et que la liberté d’expression y était reconnue. Cette liberté se traduit par :
Dans la palabre, nous assistons toujours à un double mouvement : d’une part, on règle les problèmes relatifs à la gestion du pouvoir au sein de la communauté et, d’autre part, on redéfinit les nouveaux garants de la transcendance pour l’usage public de la parole en réactivant certains symboles liés au temps, à l’espace et au sujet » (J.-G. Bidima, 2015, p. 70).
De même, B. Sakpane-Gbati reconnaît que l’Afrique traditionnelle présente un système de démocratie proche de celui de la Grande Bretagne. Il soutient, en effet, que l’organisation de la plupart des nations africaines constituées en royaumes n’était pas éloignée de celle de la monarchie parlementaire britannique. Les affaires de la cité se réglaient avec la participation des populations ou de leurs représentants autour des arbres à palabres. Ainsi, des lois et règlements étaient institués, des décisions étaient prises et des jugements étaient rendus. Nous pouvons, dès lors, établir un parallèle entre la structure des chefs traditionnels et celle des chefs d’État. (B. Sakpane-Gbati, 2011, « La démocratie à l’africaine », Dialogues pour réinventer la démocratie, vol. 13, no2/2011; https://journals.openedition.org).
B. Sakpane-Gbati continue en prétendant que le pouvoir était délégué, les peuples étaient associés à la gestion des royaumes, on assistait déjà à une forme d’élection des chefs où il s’agissait, pour les populations, de s’aligner derrière le candidat de leur choix. Celui qui emportait l’adhésion populaire était intronisé ; et il illustre ses propos par l’exemple des peuples du nord du Togo. Malheureusement, d’après lui, ce modèle d’organisation sera mis à mal par la colonisation et la décolonisation. (B. Sakpane-Gbati, 2011, « La démocratie à l’africaine », Dialogues pour réinventer la démocratie, vol. 13, no2/2011; https://journals.openedition.org).
Cependant, ce qui n’a pas été pris en charge par cet auteur, c’est l’idée que le scrutin n’était pas ouvert à tous les citoyens, puisque c’était seulement les membres de la famille héritière du trône qui étaient candidats (le pouvoir est toujours une affaire de famille dans cette Afrique ; ce qui n’est pas du tout conforme à l’esprit démocratique). Cela dit, il n’en demeure pas moins qu’il existait une forme de démocratie dans l’Afrique traditionnelle. On peut donc dire que l’Afrique a une culture de démocratie bien que celle-ci ne soit pas aussi parfaite que celle occidentale.
Ainsi, on peut avancer l’idée que la difficile démocratisation du continent n’est pas absolument liée à l’absence de culture démocratique. De même, on peut soutenir qu’il ne faut pas davantage considérer que cette difficile démocratisation du continent est liée aux stigmates de la colonisation.
1.2. Refus des stigmates de la colonisation comme obstacle à la démocratisation de l’Afrique
Il est loisible de rappeler que certains auteurs, comme A. Dieth, soutiennent que la démocratie ne peut se développer convenablement en Afrique, parce que les Africains traînent, avec eux encore, des syndromes de la colonisation. Les Africains n’ont de la culture de gestion du pouvoir que des méthodes utilisées par l’ancien maître. Donc, les seules techniques du pouvoir restent l’usage de la force et la dictature ; et tous les Africains s’en accommodent facilement. C’est pourquoi, chaque fois qu’un coup d’État advient aujourd’hui sur leur continent, les Africains acclament et s’en félicitent. Ils n’ont de tradition politique que la dictature sous laquelle ils ont toujours vécu. C’est, du moins, ce qu’A. Dieth souligne en ces termes :
Les principes du modèle colonial d’exercice et de conservation du pouvoir ont été réappropriés par les classes politiques en Afrique Noire (…) ces principes régentent, jusqu’à nos jours, le gouvernement des États postcoloniaux africains. De l’épisode colonial, il est resté une superstructure étatique construite pour perpétuer la domination, une mentalité, un type de conscience, une technique de gestion et d’exercice du pouvoir. (A. Dieth, 2016, « les stigmates du syndrome colonial, obstacles à la démocratie en Afrique », 6 sept. 2016 ; htt://blog.mediapart.fr).
Ce passage nous éclaire sur l’appropriation des principes coloniaux par les démocraties africaines. Ces principes du modèle colonial sont, entre autres, l’usage de la force et de la division. En Afrique, le colon s’est surtout appuyé sur le principe « de diviser pour mieux régner » (C. Christian, 1972, p. 1053). Dans sa politique de diviser pour mieux régner, le colon a fait recours à des moyens extra-démocratiques. Il s’agit, entre autres, de l’ethnocentrisme, du tribalisme, du régionalisme, bref de toutes formes de particularisme. Les colons ont, dans les États conquis, fait en sorte que c’est la minorité, autrefois dominée, qui va désormais régir la majorité : « Les Européens utilisèrent l’existence des ethnies (…), ils les opposèrent les unes aux autres en favorisant sur le plan politique et économique celles qui étaient dominées » (ASSOCIATION Gaston-Berger, 1966, p. 97). Cela exacerbe, du coup, la tension au sein de ces communautés, car c’est un renversement de la situation déjà établie. Le repli identitaire devient la règle du jeu. Ainsi, les ethnies, ne s’entendant plus, la minorité promue par le colonisateur cherche protection et soutien auprès de ce dernier pour sa sécurité et son hégémonie sur les autres. En conséquence, la division s’étant installée et les tensions permanentes, le colonisateur trouve paix et sécurité, et peut donc poursuivre allègrement son œuvre d’exploitation. Cette opposition entre ethnies a permis au colon de rester longtemps maître et d’imposer sa volonté.
Aujourd’hui encore, dans la perspective d’A. Dieth, bien que le colon soit parti, les héritiers du pouvoir continuent de se servir des mêmes méthodes pour assurer la continuité de leur pouvoir, comme pour dire que le monde se gouverne « par imitation », pour parler comme Machiavel (2007, p. 27). Le chef d’États africain doit s’appuyer particulièrement sur la division, sur l’ethnocentrisme pour imposer sa volonté. C’est ce qui explique qu’en Afrique ce sont des moyens antidémocratiques qui prévalent dans la conquête, la gestion et la conservation du pouvoir, même dans un régime dit démocratique. Ces moyens s’appellent l’ethnocentrisme, le tribalisme, le régionalisme, bref toutes les formes de particularisme.
Toutefois, il faut reconnaître, contrairement à ce qu’avance A. Dieth, prétendant que l’édification d’une véritable démocratie est mise à mal par la persistance de considérations tribales, ethniques ou encore claniques, une telle idée n’est pas recevable. En vérité, le tribalisme est le propre de toutes les communautés du monde ; et donc, si les autres communautés qui connaissent le tribalisme aussi ont pu vivre la démocratie, pourquoi pas les sociétés africaines ? Comment donc se fait-il que ces sociétés soient capables de s’adapter à une démocratie et que les Africains n’en soient pas capables ? C’est le cas, par exemple de l’Inde, des États-Unis, du Brésil. Il ne serait pas exagéré d’avancer que c’est un faux problème de prétendre que c’est le tribalisme qui a empêché et qui empêche encore aujourd’hui les sociétés africaines de vivre convenablement la démocratie. C’est, en vérité, une idéologie négativiste consistant à montrer que le Noir n’est capable de rien ; ce qui est insensé.
L’argument d’A. Dieth n’est pas davantage soutenable, dans la mesure où d’autres pays, bien qu’ayant été colonisés, ont pu implanter une solide démocratie et sont cités en exemple, et même sont considérés comme les plus grandes démocraties du monde. C’est le cas des États-Unis d’Amérique et de l’Inde. Ce dernier État présente, d’ailleurs, pratiquement les mêmes réalités que les États africains, avec des tribus, des castes. Mais cela ne l’a pas empêché d’être une grande démocratie. En réalité, il n’y a jamais, comme l’affirme J-F. Bayard (1990, p. 7), « adéquation parfaite entre appartenance ethnique et adhésion politique ».
La capacité et le droit des Africains à adopter la démocratie, au même titre que les autres peuples du monde, ne serait pas compromise par la colonisation. La comparaison avec l’Inde pourrait être utile, comme le suggère Bayart :
Nul ne doute qu’il s’agit d’une démocratie en dépit des violations des Droits de l’homme qui s’y commettent et des dangers qui pèsent sur son avenir, et nul ne doute que cette démocratie consiste en une dérivation créative de la souche britannique, le modèle de Westminster. De la même manière, les régimes africains issus de la souche institutionnelle de la Ve République française auraient pu connaître (et pourraient encore connaître) un processus d’hybridation et de réinvention sur un mode autre qu’autoritaire. (J.-F. Bayart, 1990, p. 11).
Autrement dit, les Africains pouvaient, à l’image de l’Inde, créer leur propre style de démocratie à partir de la souche institutionnelle britannique ou française, mais il n’en est rien.
Donc c’est un argument simpliste de vouloir toujours accuser la colonisation d’être à la base de tous les maux, notamment d’être à l’origine de la culture de la dictature, on oublie pourtant que la même colonisation nous a inculqué les principes qui sous-tendent la démocratie comme nous le rappelle J.-F. Bayart :
Dans sa dernière phase, la colonisation a connu une libéralisation politique indéniable qui s’est traduite par l’introduction au sud du Sahara d’institutions représentatives modernes, de partis politiques multiples, d’une pluralité d’organisations syndicales, d’une presse libre, d’une législation afférente, mais qui s’est aussi distinguée par l’ampleur des manipulations administratives destinées à contenir et à orienter ces transformations. (J.-F. Bayart, 1990, p. 12).
Ce passage de J.-F. Bayart nous montre clairement que la colonisation a mis les États africains sur les rails de la démocratie. Certes, on se contente toujours d’imputer tous les maux à la colonisation. Mais cette accusation contre la colonisation manifeste plus ou moins une fuite de responsabilité ou la recherche d’un bouc émissaire. Il faut que les Africains s’assument par rapport à la déficience de leur système politique. En vérité, l’esprit de dictature rentre dans la stratégie de lutte et de conservation du pouvoir. Car, selon J.-F. Bayart, le chemin de la démocratie libérale sur lequel la colonisation occidentale a mis les États africains, était abandonné au lendemain des indépendances pour embrasser la démocratie à parti unique. C’est, du moins, ce qu’il souligne en ces termes :
par construction de régimes présidentiels de parti unique, différentes procédures de « décompression autoritaire » ont emprunté à la thématique de la démocratie libérale – en recourant notamment à l’exercice concurrentiel du suffrage universel – pour assurer la régulation de la classe politique à l’avantage du chef de l’État, en lui garantissant une autonomisation optimale par rapport à celle-ci et en l’installant dans une position d’arbitre suprême. (J.-F. Bayart, 1990, p. 12).
Ce passage nous donne la preuve que la dictature n’est pas d’inspiration coloniale, mais bien un choix délibéré, peut-être même, une façon de marquer la différence avec l’ancien maître.
Comme on peut le constater, les arguments prétendant que la démocratie trouve des difficultés à s’implanter à cause d’une absence de culture ou à cause des syndromes coloniaux ne sont pas fondés. En vérité, si la démocratie ne semble pas s’enraciner en Afrique, c’est faute d’avoir réuni toutes les conditions, notamment des États libres, autonomes et puissants. Toutes les sociétés du monde peuvent se démocratiser si les conditions sont réunies. Si donc les États africains connaissent des difficultés pour asseoir une véritable démocratie, c’est parce que les conditions de son institution ne sont pas encore remplies.
2. Les conditions d’institution d’une démocratie véritable en Afrique
Dans cette partie, il s’agit, en s’appuyant sur la pensée de Machiavel, de comprendre que la démocratie n’est véritablement viable que dans un État libre. Sans être libre, l’État ne peut conduire une politique de son choix, ni à l’intérieur ni dans ses relations avec les autres États. Par conséquent, un État non-libre ne peut connaître une vraie démocratie. La liberté de l’État est donc une condition indispensable pour asseoir une démocratie.
Or, pour qu’un État vive librement, il doit être puissant. Il n’y a pas de vie libre pour l’État sans puissance. Cela revient à dire que la puissance est une autre condition indispensable pour une démocratie véritable. Malheureusement, de telles conditions ne sont pas encore remplies par les États africains dont la politique est, le plus souvent, dictée par l’extérieur, notamment les grandes puissances (l’Europe, les USA, la Russie, la Chine) ou même par des institutions internationales telles que le FMI ou la Banque Mondiale qui sont, au fond, des instruments de domination au service des grandes puissances. Sans remplir ces conditions il serait difficile à l’Afrique de vivre une réelle démocratie.
2.1. La liberté et l’autonomie comme conditions indispensables à la démocratisation des États africains
Même si Machiavel n’était pas démocrate, il n’empêche qu’il choisisse de vivre dans un État libre et autonome, car il croit que la puissance et la richesse naissent dans un État libre :
L’expérience nous prouve que les cités n’ont accru leur puissance et leurs richesses que pendant qu’elles ont vécu libres. C’est une chose vraiment merveilleuse de voir à quel degré de grandeur Athènes s’éleva, durant l’espace des cent années qui suivirent sa délivrance de la tyrannie de Pisistrate. Mais, ce qui est, bien plus admirable encore, c’est la hauteur à laquelle parvint la république romaine, dès qu’elle se fut délivrée de ses rois » (N. Machiavel, 2007, p. 213).
Ce passage nous montre le désir de Machiavel de vivre dans un État libre et autonome, c’est-à-dire un État qui n’est pas soumis aux diktats d’autres États. C’est en étant libre, en effet, que l’État a la possibilité de conduire la politique de son choix et, par conséquent, de pouvoir instituer le régime politique qu’il veut, une démocratie par exemple. Machiavel a en vue la liberté de l’État tout entier ; c’est la condition indispensable pour vivre libre, pour vivre une démocratie. C’est quand l’État est libre qu’il peut rendre ses citoyens libres. Autrement dit, c’est quand l’État est libre que les citoyens peuvent prétendre à une liberté individuelle, mais pas avant. C’est donc la liberté de l’État qui conditionne la liberté individuelle, autrement dit, la démocratie. Sans la liberté de l’État, il n’y a pas de démocratie, et conséquemment, il n’y a pas de liberté individuelle. Car, comme le dit Machiavel, lui-même « le désir qu’ont les nations d’être libres est rarement nuisible à la liberté, car il naît de l’oppression ou de la crainte d’être opprimé » (N. Machiavel, 2007, p. 156).
Machiavel prône, en vérité, tacitement un régime démocratique, un régime où le peuple est libre, c’est-à-dire capable de faire ce qu’il veut. Or, dans le cas de l’Afrique, celle-ci ne choisit pas toujours sa propre politique. Un choix lui est presque toujours imposé. La preuve, c’est que le choix de la politique, du régime même, qui va gérer les États africains ne relève pas de leur propre choix. La démocratie à l’œuvre dans nos États est le choix des autres puissances, et les États africains se retrouvent dans l’obligation d’exécuter cette volonté.
Il convient, en effet, de souligner avec force que la démocratie, telle que nous la pratiquons aujourd’hui, n’est pas l’œuvre des États africains. Elle nous a été imposée par l’Occident, du moins, dans son sens de multipartisme. Dans son histoire récente, on se réfère particulièrement au sommet franco-africain de La Baule comme facteur déclencheur. Dans son discours du 20 juin 1990, François Mitterrand annonce que « la France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté » (F. Mitterrand, 1990, p. 130). Par cette annonce, François Mitterrand vient d’ouvrir une nouvelle ère dans la politique africaine de la France. Tout soutien français est désormais conditionné par plus de liberté. Autrement dit, l’on doit tourner le dos à toute forme de dictature, à toute forme d’autorité autre que la démocratie.
À partir de cette conférence de la Baule, les États africains se sont progressivement orientés vers la démocratie. Des conférences nationales sont, un peu partout, organisées, particulièrement dans les États francophones. On peut donc dire, que la démocratie « africaine » n’est pas l’œuvre des Africains, contrairement à celles occidentales. Elle ne dépend pas de leur bonne volonté. Il ne suffit, cependant, pas de proclamer la démocratie pour qu’elle soit. Il y a des paramètres fondamentaux à assurer. Le premier, c’est de faire en sorte que l’État puisse décider en toute souveraineté. Or, vivre d’une démocratie imposée et non d’une démocratie voulue par les Africains eux-mêmes, cela atteste sans nul doute que ces derniers ne sont pas libres du choix de la politique qui doit les conduire à la réalisation de leur bonheur. Il revient à un État digne de ce nom de choisir, lui-même, son destin et de savoir le construire. Une situation où un État sera conduit à adopter une politique édictée par un autre État ou d’autres États, voilà ce que redoute, par-dessus tout, Machiavel pour son État, l’Italie. Car, Machiavel est conscient qu’un État ne peut réussir à construire son destin, ne peut se réaliser que s’il a la liberté de choisir, lui-même, sa propre politique, c’est-à-dire s’il peut faire ce qu’il veut. Sans cette possibilité, l’État ne peut connaître une vraie démocratie, ni être en sécurité, ni être prospère :
Quand la tyrannie s’élève au milieu d’un peuple libre, le moindre inconvénient qui doive en résulter pour l’État, c’est que le progrès s’arrête, et qu’il ne puisse plus croître ni en puissance ni en richesse ; mais le plus souvent, ou, pour mieux dire, toujours, il arrive qu’il rétrograde. (N. Machiavel, 2007, p. 213).
Il n’y a ni développement ni progrès sans liberté et autonomie. D’où donc il n’est point étonnant de voir Machiavel défendre la liberté de l’État et, par ricochet, la démocratie. Il précise même que
toutes les cités, tous les États qui vivent sous l’égide de la liberté, en quelque lieu qu’ils existent, obtiennent toujours les plus grands succès : c’est là que la population est la plus nombreuse, parce que les mariages y sont plus libres, et que l’on en recherche davantage les liens ; c’est là que le citoyen voit naître avec joie des fils qu’il croit pouvoir nourrir, et dont il ne craint pas qu’on ravisse le patrimoine ; c’est là, surtout, qu’il est certain d’avoir donné le jour non à des esclaves, mais à des hommes libres, capables de se placer, par leur vertu, à la tête de la république : on y voit les richesses multipliées de toutes parts, et celles que produit l’agriculture, et celles qui naissent de l’industrie ; chacun cherche avec empressement à augmenter et à posséder les biens dont il croit pouvoir jouir après les avoir acquis. Il en résulte que les citoyens se livrent à l’envi à tout ce qui peut tourner à l’avantage de chacun en particulier et de tous en général, et que la prospérité publique s’accroît de jour en jour d’une manière merveilleuse. (N. Machiavel, 2007, p. 216).
Ce passage illustre clairement, contrairement à ce que d’aucuns disent d’habitude de Machiavel, que celui-ci soutient un État démocratique. Car, la démocratie est porteuse de prospérité. Il est donc logique que les peuples se soulèvent contre toute forme de dictature et assurent une démocratie qui est porteuse de développement. C’est conscient de cet état de fait, comme le souligne Machiavel, lui-même, que les Grecs ont été conduits à chasser les tyrans :
Il n’est donc pas étonnant que les peuples de l’antiquité aient poursuivi les tyrans avec tant d’animosité, qu’ils aient tant aimé à vivre libres, et que le nom même de la liberté ait joui auprès d’eux d’une si grande estime. (N. Machiavel, 2007, p. 214).
Mais comment vivre libre ? Voilà à vrai dire l’équation que Machiavel va chercher à résoudre. En effet, un État qui se voit dicter une politique de l’extérieur ne peut réaliser la volonté de son peuple. Comment dans ces conditions le peuple peut-il avoir une aspiration que l’État soit capable de réaliser si ce dernier n’est pas libre ? Comment un tel État peut-il parler de la liberté, de la démocratie à son peuple ? Ce n’est pas possible. Cet État ne peut avoir ni des lois fixes ni des lois au service du bien de son peuple. Même s’il fait de bonnes lois pour son peuple, l’exécution de ces lois devient aléatoire, puisqu’elle dépend du maître extérieur. C’est du reste pourquoi les États africains ont beau faire de bonnes lois, le peuple sera toujours surpris de constater que, malgré l’existence de ces lois, le gouvernement fait autre chose que ce que les lois prévoient ; de sorte que le peuple est presque toujours déçu de ses dirigeants.
Or, un gouvernement démocratique, c’est le règne des lois que le peuple s’est librement données. S’il est impossible de mettre en pratique de telles lois, comment la démocratie, en tant que règne des lois, peut-elle s’implanter convenablement ? Il serait difficile, voire impossible.
C’est pareille situation que Machiavel redoutait. Par-dessus tout, il redoutait une situation où l’État ne fait qu’exécuter ce que lui commandent les autres nations, comme c’est le cas en Afrique, principalement dans les pays francophones.
C’est au regard de cette attitude que Machiavel demande à l’États d’être assez fort, c’est-à-dire puissant pour être libre de décider de ce qu’il veut. Autrement dit, la démocratie elle-même, ne peut être viable que dans un État qui ne se voit pas imposer un diktat par un autre pays ou d’autres États. Pour être libre il faut nécessairement être puissant.
2.2. La puissance, condition incontournable de la démocratisation des États africains
Pour comprendre la logique de Machiavel dans sa volonté de défendre un État libre, il faut savoir que, pour lui, les États vivent une situation d’état de nature où chacun fait ce qu’il veut. Or, dans une situation d’absolue liberté, seuls sont véritablement libres les États les plus puissants. La seule façon de faire ce qu’on veut, c’est d’être assez, sinon le plus fort. Sans être assez fort, on ne peut faire ce qu’on veut : « Pendant une longue suite de siècles Rome et Sparte vécurent libres et armées ; la Suisse, dont tous les habitants sont soldats, vit parfaitement libre » (N. Machiavel, 2007, p. 51). Ce passage illustre bien que seule la puissance nous assure la liberté. Sans la puissance, l’État ne peut pas être pleinement souverain. Seule la puissance nous permet de vivre libres. Nos dirigeants doivent le comprendre et s’activer pour conduire nos États à la puissance.
Toutefois Machiavel précise qu’« une république libre n’est pas souhaitable si elle doit conduire à vivre sous la botte étrangère » (N. Machiavel, 2007, p. 10). Autrement dit, un État doit disposer de sa propre force et ne doit pas compter sur les forces extérieures ou sur des mercenaires comme ce que nous vivons aujourd’hui dans nos États du sahel où nous comptons sur l’extérieur pour nous protéger :
L’expérience a prouvé que les princes et les républiques qui font la guerre par leurs propres forces obtenaient seuls de grands succès, et que les troupes mercenaires ne causaient jamais que du dommage. Elle prouve aussi qu’une république qui emploie ses propres armes court bien moins de risque d’être subjuguée par quelqu’un de ses citoyens, que celle qui se sert d’armes étrangères. (N. Machiavel, 2007, p. 51)
Ainsi, comme le dit Machiavel lui-même, « la défense de l’État contre les étrangers a donc priorité sur le rétablissement de la liberté » (N. Machiavel, 2007, p. 10). Cela signifie donc que la puissance a priorité sur la liberté. C’est elle qui fonde la liberté. En d’autres termes, la liberté est subordonnée à la puissance.
C’est conscient de cet état de fait que Machiavel souhaite que son pays, l’Italie, soit assez fort pour réaliser les rêves de son peuple. Sans quoi, il ne peut qu’être la proie des autres États. Mais Machiavel constate que son État est loin de remplir cette condition indispensable. C’est pourquoi, il va chercher les conditions pouvant conduire l’Italie à la puissance. C’est dire aussi, dans le cas des États africains, que ceux-ci ne peuvent être libres et autonomes et faire la liberté de leurs citoyens s’ils ne peuvent pas décider en toute souveraineté. Or, décider en toute souveraineté, suppose que l’État dispose d’une puissance qui lui permet de se passer des autres États. Car, on le sait, dans les relations internationales, il n’y a pas de sentiment, il n’y a pas de démocratie. Ce sont les intérêts qui guident les relations entre États. Dans une lutte d’intérêt, ce sont bien entendu les plus forts qui tirent le maximum de profits. Ce sont également les seuls à pratiquer la politique de leur choix et le régime qu’ils jugent le mieux approprié à leur peuple. Par la même occasion, ils dictent aux autres la ligne de conduite à suivre, une ligne à même de préserver leur hégémonie. Ils restent les seuls à vivre une réelle démocratie puisque personne ne peut leur imposer une ligne de conduite non décidée par eux.
La puissance étant la condition de la liberté pour l’État, elle est véritablement la possibilité de pouvoir vivre une réelle démocratie dans la mesure où nos États pourront exercer la politique de leur choix. C’est cela que nos dirigeants doivent comprendre. Ils doivent réaliser qu’il n’y a pas de vraie démocratie sans un État libre et qu’un État ne peut être libre que s’il est assez puissant. Un État qui n’est pas libre ne peut prétendre à la démocratie véritable. Or la liberté est un principe cardinal de la démocratie. On peut donc affirmer, avec Machiavel, que notre démocratie africaine, dans des États faibles, n’est qu’illusion.
Comment, en effet, dans les conditions actuelles des États africains, parler de liberté des citoyens de décider de ce qu’ils veulent, étant donné que ceux-ci sont soumis aux diktats des grandes puissances ? Ces États africains sont à l’image de l’Italie de Machiavel, ils subissent toutes formes de diktat de la part des autres puissances. Ce sont, plutôt, ces dernières qui décident à notre place. La démocratie ne peut être viable dans ces conditions et conséquemment les États africains ne peuvent décider de leur destin. D’ailleurs, comme pour attester de cette absence de liberté, et que tout leur est dicté, notamment en matière de politique, l’initiative démocratique, elle-même, n’émane pas à vrai dire de la libre volonté des États africains. Elle leur a été imposée par des puissances extérieures, notamment la France à partir de la conférence de La Baule. Qui sait si nos dirigeants ne sont pas directement nommés de l’extérieur et que les élections que nous effectuons ne sont, peut-être, que pure formalité, car, comme l’avait souligné Pascal Mukonde Musulay rapportant les propos d’une congolaise déçue des élections dans son pays : « Le prochain président du pays est en tout cas décidé à Washington et à Paris et pas par l’électorat ». (P. M. Musulay, 2016, p. 15).
C’est pareille situation que redoutait Machiavel et qui l’inquiétait ; une situation où la politique de l’État sera décidée ailleurs et non par le peuple lui-même. L’ayant comprise, Machiavel cherche alors à la dénoncer. Cela le conduit à faire de la politique extérieure de l’État une préoccupation fondamentale. Sa crainte, légitime d’ailleurs, se dirige surtout, vers les autres États qui peuvent dicter la politique à adopter ou remettre carrément en cause l’existence même de l’État. C’est dire, qu’un État dont la politique intérieure et même extérieure est déterminée par une autre puissance n’est pas du tout en sécurité et ne peut être libre.
S’il est vrai que l’État se doit d’être puissant, qu’est-ce que la puissance chez Machiavel ? La puissance chez Machiavel renvoie à la force armée. C’est elle qui fait la puissance de l’État. Mais si Machiavel désigne la puissance principalement par la force militaire, dans le contexte actuel, le concept de force connaît une large extension. La force est perçue comme tout ce qui élève un État dans ses rapports avec les autres États. On parle, par exemple, de puissance militaire quand l’État dispose d’une armée forte, de puissance économique quand il est fort du point de vue économique. La force d’un État, c’est également la communication, la technologie, les relations internationales, la politique, etc.
La force est donc un concept multidimensionnel aujourd’hui. Un État est fort relativement à un domaine spécifique. Un État fort dans plusieurs domaines est manifestement plus fort que les autres. C’est ainsi qu’on parle de superpuissance pour désigner les États les plus forts tels que les États-Unis d’Amérique ou la Russie. Tous les États disposant de l’une de ces forces, se font écouter et se font respecter dans ce monde. Mieux, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. Car ils sont capables de se prendre en charge, de financer leurs politiques de développement.
Dans le cas précis des États africains, cependant, ils ne sont, malheureusement, spécialisés dans aucune de ces forces. Ils ne sont ni militairement, ni économiquement, ni technologiquement forts. Puisque nous parlons de la démocratie, nous savons que celle-ci exige des dépenses. D’abord, la campagne, elle-même, exige des partis politiques de l’argent. Ensuite, l’organisation du scrutin demande beaucoup de moyens financiers, logistiques, humain, etc. Or, nos États n’ont pas les moyens de faire face à toutes ces dépenses, et sont obligés de se faire aider par d’autres États. La sollicitation d’une aide ouvre la voie à une imposition de conditions.
Comment des États qui ne sont pas financièrement indépendants peuvent-ils organiser des élections libres et transparentes ? Ce n’est pas possible. Il est donc évident que le bailleur impose sa volonté, et au besoin, impose son candidat. Il est donc impossible de vivre une réelle démocratie quand les élections, elles-mêmes, sont financées par l’extérieur. De toute évidence, il n’y a pas de financements gratuits dans un monde capitaliste. Chaque États se doit alors d’être puissant pour pouvoir financer, lui-même, ses élections ; et chaque parti doit pouvoir prendre en charge sa campagne, si les États africains veulent vivre une réelle démocratie.
Ainsi, si des États comme l’Inde, les États-Unis d’Amérique, le Brésil, etc. sont devenus, aujourd’hui, de grandes démocraties, c’est parce qu’ils sont puissants. Ils sont capables de financer, eux-mêmes, leurs élections. Et donc, si les États africains veulent être des démocraties de référence, ils se doivent d’être puissants. C’est dans ces conditions qu’ils peuvent échapper à la manipulation, à la soumission, au chantage d’autres puissances extérieures. Faute d’être puissants économiquement ou financièrement, par exemple, les États africains sont incapables de créer une démocratie solide.
Conclusion
Si la démocratie a pour principe la liberté, il est évident qu’un pays ne peut vivre une réelle démocratie qu’à la condition d’être libre et autonome. Or, pour être libre et autonome dans un monde d’état de nature, il faut être assez fort. Sans être une puissance, l’État ne peut faire ce qu’il veut ; de sorte que c’est quand un État est assez puissant qu’il peut pratiquer une politique, un régime de son choix, une démocratie par exemple. Sinon il se verra toujours imposer un régime taillé sur mesure et qui ne peut lui convenir. C’est la situation que vit aujourd’hui l’Afrique qui n’a plus de politique propre. Tout lui est imposé : du régime à ce que l’État doit faire pour ses citoyens. Un État qui se voit imposer une ligne de conduite ne peut faire régner une démocratie véritable.
L’Afrique n’ayant donc pas rempli les conditions de l’avènement d’une véritable démocratie, toute autre forme de démocratie ne peut être qu’une illusion ; et elle va se confronter à des problèmes d’adaptabilité.
Références bibliographiques
AKWA Dika, 1972, « Religion de Nymbe et civilisation politique africaine », Colloque de Cotonou : les religions africaines comme source de valeurs de civilisation, 16-22 Aout 1970, P.A.F, Paris, pp. 256-286.
ASSOCIATION Gaston-Berger, 1966, L’Afrique en devenir, Prospective13, juin, PUF.
BACHELARD Gaston, 1993, La Formation de l’esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance, Paris, J. Vrin.
BACHELARD Gaston, 2013, Le nouvel esprit scientifique, Paris, Puf.
BAYART Jean-François, 1989, L’État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Librairie Arthème Fayard.
BAYART Jean-François, 1990, La problématique de la démocratie en Afrique noire « La Baule, et puis après ? », juin 1990, CNRS-CERI.
BERNARD Adasso, 1976, Le chef d’État africain : l’expérience des États africains de succession française, Paris, éditions Albatros.
BIDIMA Jean-Godefray, 2015, La palabre, une juridiction de la parole, Paris, Michalon.
CHRISTIAN Coulon, 1972, « Système politique et société dans les États d’Afrique noire », Revue française de science politique, 22ᵉ année, n°5, pp. 1049-1073.
DESCHAMPS Hubert, 1965, Les institutions politiques de l’Afrique noire, Paris, PUF.
DIETH Alexis, 2016, « Les stigmates du syndrome colonial, obstacles à la démocratie en Afrique », 6 sept. 2016 ; htt://blog.mediapart.fr
Discours de François Mitterrand à La Baule, 20 juin 1990, in Politique étrangère de la France, mai-juin 1990, pp. 128-130.
HOUNTONDJI Paulin, 1977, Sur la philosophie africaine, François Maspero 1, Paris.
MACHIAVEL Nicolas, 2007, Le Prince et autres textes, un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt, Édition numérique réalisée le 12 octobre 2007 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Québec, Canada.
MUKONDE Pascal Musulay, 2016, Démocratie électorale en Afrique subsaharienne : Entre droit, pouvoir et argent, Genève, Globethics.net African Law No. 4.
SAKPANE-GBATI Biléou, 2011, « La démocratie à l’africaine », Dialogues pour réinventer la démocratie, vol. 13, no2/2011; https://journals.openedition.org.
LE TRANSHUMANISME ET LE DÉSIR D’IMMORTALITÉ
Christian Kouadio YAO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Les théories évolutionnistes ont convaincu les transhumanistes de prendre à la nature, au moyen des nouvelles technologies, les commandes de la marche de l’évolution de l’espèce humaine. L’enjeu de cette intervention est d’insérer dans les données biologiques, des formes artificielles de vie afin d’augmenter et d’améliorer les capacités biologiques et intellectuelles de l’Homme. Le transhumanisme, en considérant que le vieillissement et la mort sont nuisibles, souhaite l’amélioration de la qualité de vie humaine. L’adversité à laquelle ce mouvement fait face de la part des bioconservateurs, ne ruine aucunement sa ferme volonté de conduire l’humanité vers l’immortalité.
Mots clés : Biotechnologie, Évolution, Humanité augmentée, Nanotechnologie, Transhumanisme.
Abstract:
Evolutionary theories have convinced transhumanists to take control of nature, by means of new technologies, from the evolution of the human race. The challenge of this intervention is to insert into biological data artificial forms of life in order to increase and improve the biological and intellectual capacities of man. Transhumanism, considering that aging and death are harmful, seeks to improve the quality of human life. The adversity that this movement faces on the part of bioconservatives in no way ruins its firm will to lead humanity to immortality.
Keywords : Biotechnology, Evolution, Increased Humanity, Nanotechnology, Transhumanism.
Introduction
Le réalisme cartésien et la volonté de puissance nietzschéenne ont accru le pouvoir de l’Homme sur la nature. Les connaissances qu’il a acquises sur les manifestations déterministes qui conditionnent le fonctionnement de l’ordre physique lui ont permis de comprendre les mystères de la vie et de la création à partir des exploits des biosciences. Ainsi, en passant de la biologie cellulaire à l’ingénierie génétique, l’Homme a franchi, espoir grandissant, un pas important dans la connaissance de son identité biologique, preuve de son acharnement à modifier les trajectoires des ordonnances de la sélection naturelle qu’il juge parfois d’insatisfaisants. Il s’est résolu, lassé des insuffisances de la thérapie des gènes, d’intégrer dans son appareil biologique, des éléments artificiels nanométriques pour renforcer ses capacités physiques et mentales. Il va ainsi apparaître le transhumanisme, cette forme d’humanisme en transition, né en 1987 sous l’impulsion d’Éric Drexler après la création du « Foresight Institute ».
En effet, le transhumanisme est un mouvement qui promeut l’utilisation des découvertes scientifiques et techniques pour l’amélioration des performances humaines. Il a pour objectif, selon M. Nachez (2016, p. 10), de « faire progresser les caractéristiques physiques et mentales de l’Homme pour lui permettre, en tant qu’espèce tout autant qu’en tant qu’individu, de perdurer, de préserver les corpus acquis, de poursuivre l’évolution et même d’opérer un considérable bond évolutif ». Considérant que le vieillissement et la mort sont dommageables, les transhumanistes appellent au dépassement de ces contraintes biologiques au moyen de la maîtrise des artéfacts technoscientifiques et bioscientifiques.
Au regard de cette idéologie bioprogressiste qui commence à prendre de l’ampleur en ce début du XXIe siècle, nous sommes en droit de nous questionner de la manière suivante : le transhumanisme a-t-il les moyens de satisfaire le désir d’immortalité de l’Homme ? En prétendant à l’immortalité, la transhumanité ne serait-elle pas une atteinte aux valeurs identitaires, sociales et ontologique à l’humanité ?Face à ces interrogations, nous montrerons à travers une démarche analytico-critique, les facteurs qui ont milité en faveur du transhumanisme avant d’argumenter au profit du grand espoir qu’il suscite face au besoin de santé de l’Homme. Dans la dernière partie de notre travail, nous exposerons les conséquences sociale et éthique de la révolution transhumaniste.
1. L’Homme biologique : ses imperfections et ses faiblesses
L’Homme a toujours lié sa dignité et la qualité de sa représentativité sociale à sa bonne santé physique et mentale. On a beau mener des campagnes de sensibilisation pour tenter de maintenir les hommes égaux en dignité ; le constat révèle pourtant le contraire : les hommes physiquement et mentalement sains se sentent toujours supérieurs à ceux atteints de troubles psychosomatiques. Ce qui implique, dans les faits, une disparité d’égards qui poussent à se rebeller contre les bricolages parfois grossiers de la sélection naturelle. En plus, les hommes que la nature a doté de corpus biologiques « parfaits » n’échappent ni à la vieillesse ni à la mort. C’est pour ces différentes raisons que la fragilité constitutive de la matière biologique témoigne constamment du refus de l’Homme à voir son enveloppe corporelle comme l’une des marques les plus caractéristiques de sa finitude.
1.1. L’Homme contre sa constitution biologique
L’esprit prométhéen qu’a progressivement développé l’Homme dans sa conquête du monde extérieur lui a permis de comprendre qu’au-delà de la faiblesse qui le caractérise en comparaison au roseau de Blaise Pascal, il pouvait remodeler l’ordre biologique établi en commençant par s’y opposer. En se rebellant contre la nature pour s’opposer à ses ordonnances parfois déstructurées et lui imposer sa vision de ce qu’elle devait être, l’Homme espère « qu’on lui prédise un avenir où (il) pourra expier ses faiblesses et se retrouver remodelé sinon “augmenté” » (J-M. Besnier, 2012, p. 11-12). Dans la logique de cette espérance, il dénie à la nature le contenu divin qui définit son revêtement sacré.
Les plaintes de l’Homme contre sa constitution biologique sont justifiables à plus d’un titre. Sa vulnérabilité tient d’un double jeu de la nature dans lequel il subit les mauvaises contorsions qui résultent des combinaisons déterministes au cœur des manifestations des phénomènes biologiques. Les arrangements aléatoires des composantes génétiques que façonne le croisement des éléments biologiques de reproductions débouchent parfois sur des malformations qui se répercutent sur sa qualité de vie après la naissance. On peut citer entre autres, les trisomies 13 et 18, le syndrome de Crouzon, la schizophrénie, l’autisme, etc. En plus, même quand la naissance donne sur un être sain, doté d’une constitution biologique “parfaite”, l’influence environnementale ne lui garantit pas une espérance de vie plus longue que celles des malformés. Aussi, la nature périssable de la matière vivante affaiblit progressivement l’activité des organes vitaux, favorisant ainsi la vieillesse et la mort. Le cas de Jeanne Calment est assez révélateur. La supercentenaire française qui détient le record de longévité humaine n’a pas vécu au-delà de 122 ans. La vieillesse qui a progressivement ruiné ses forces physique et mentale l’a inexorablement conduit à la mort malgré la qualité des systèmes biologique et physiologique dont la nature lui a dotés. Au final, la vulnérabilité de l’Homme est imputable à l’évolution qui en plus d’opérer à l’aveugle, associe souvent des composantes biologiques incompatibles ou encore influence négativement la croissance de certaines cellules de reproduction. Toutes ces « bizarreries » dont parle F. Jacob (1981, p. 69) prouvent que « l’évolution, au contraire, reste loin de la perfection, comme l’a constamment répété Darwin qui avait à combattre l’argument de la création parfaite ». Les imperfections de l’évolution s’inscrivent-elles dans le plan divin ? Telle se formule la question, qui à l’origine, a favorisé des réponses qui ont motivé l’Homme à se rebeller contre la nature. Dieu, Être parfait, ne peut créer la nature et la doter de composantes imparfaites. C’est le principe de liberté qu’il a intégré en chaque élément de sa création qui favorise l’imperfection. Cela donne une possibilité à l’Homme d’agir sur le déterminisme des phénomènes vivants afin de modifier leurs trajectoires pour aider la nature à faire des choix judicieux en faveur de l’évolution.
La nature, à en croire les plaintes de l’Homme, est un artisan « incompétent » dont la carte de combinaison biologique en faveur de l’évolution n’est qu’un ensemble de structures bricolés qui contrastent avec la logique de la perfection. Dans son fameux jeu du hasard, la sélection naturelle réduit l’enthousiasme de l’Homme, qui selon lui et en vertu de son privilège d’être le plus évolué de la création, devait bénéficier des largesses de la nature. C’est pourquoi, selon L. Ferry, (2016, p. 43) « Nous n’acceptons pas les aspects indésirables de notre condition humaine ». Car, un appareil biologique avec des défauts de constitution limite la marge de manœuvre de son porteur et l’astreint à une qualité de vie limitée.
1.2. Les limites de l’appareil biologique de l’Homme
L’Homme porte par nature, les germes d’une faiblesse qui se matérialise par les limites opérationnelle et fonctionnelle de son appareil biologique. Cette faiblesse est fonction des trois blessures qui ont infligé la plus grande humiliation à l’humanité. Il s’agit, en l’occurrence, de la révolution astronomique : première blessure causée par Nicolas Copernic, qui a détrôné l’Homme et la terre de leur position centrale dans l’univers au profit du soleil. Ce changement de paradigme en contradiction avec le géocentrisme a diminué l’Homme dans sa pleine puissance honorifique dans la configuration organisationnelle du cosmos. La deuxième blessure, celle dont les impacts social et religieux ont été les plus retentissants, est provoquée par Charles Darwin. En effet, le naturaliste et paléontologue anglais a démontré, à travers des études sur l’évolution des espèces, que l’Homme descend du signe. Une affirmation, quoique légitime de par ses preuves scientifiques, a exaspéré l’opinion religieuse et rebellé les bioprogressistes contre les conditions de leur création. Une idée qui continue d’alimenter les débats entre créationnistes et évolutionnistes malgré les arguments réalistes du darwinisme. La troisième blessure est celle qui résulte des études psychanalytiques de Freud. En effet, la révolution psychanalytique freudienne a montré que l’Homme, se croyant un être pleinement conscient, est en réalité déterminé par des forces inconscientes qui piétinent, contre son gré, sa lucidité et sa responsabilité.
Ces trois grandes découvertes, scientifiquement prouvées, ont rappelé à l’Homme sa nature finie et les limites à la fois physiques et mentales que la nature compose avec les principes de la création. Les conséquences idéologique et sociale de ces révolutions scientifiques ont mis en cause la conscience de suffisance des hommes en les réduisant dans les limites de sa condition d’existence. Conscient de cette réalité dont l’évidence se manifeste dans les actions quotidiennes de l’Homme, M. Nachez (2016, p. 16) considère que « l’homme actuel est obsolète ». Une obsolescence qui se caractérise par le vieillissement et de la mort et qui redéfinit la compréhension que l’Homme a de lui-même, quant à la finalité de son existence. Désormais conscient de ses limites, il va tenter de reprendre à la nature, sa “loterie génétique” pour mieux la recomposer en lui enlevant son caractère aléatoire afin de la rendre la plus performante possible. Il convient de sélectionner les meilleurs gènes par la méthode eugénique ou encore les réparer à travers la thérapie génique pour augmenter les possibilités de faire naître des êtres physiologiquement et mentalement sains. C’est d’ailleurs ce que reconnaît L. Alexandre (2011, p. 29) pour qui, « la lutte contre nos faiblesses biologiques et nos souffrances sera prioritaire aux yeux de l’opinion ». Il remet ainsi la destinée de l’Homme à la science dans l’espoir de corriger ses limites biologiques. Le développement des technosciences a motivé la naissance du transhumanisme, mouvement dont la finalité selon B. Claverie (2010, p. 31) est de « rendre résistant, inaltérable, voire immortel l’Homme augmenté ». En effet, l’homme augmenté est celui dont les capacités biologiques et intellectuelles ont été renforcées par les objets technoscientifiques dans l’intime espoir de tendre vers l’immortalité.
2. Le transhumanisme vers l’immortalité
Les vestiges de la préhistoire ont montré qu’à l’origine l’Homme se servait des outils pour imposer sa domination à la nature. Pour cueillir des fruits par exemple, il se servait de morceaux de bois pour prolonger sa main. La rationalité pratique dont il est naturellement doté lui a permis d’inventer l’objet technique pour augmenter ses capacités physiques afin de satisfaire ses besoins existentiels. Cette culture s’est perpétuée jusqu’à nous avec l’affinement des moyens techniques qui sont aujourd’hui capables de renforcer et d’améliorer l’Homme dans sa totalité biologique et mentale. Sous ce rapport, le transhumanisme, va souhaiter que l’Homme confie le tropisme de son évolution, en tant qu’espèce, à la technoscience. Ce qui, d’emblée, va réorienter la vocation de la médecine vers des projets d’amélioration et d’augmentation de l’humain.
2. 1. De la réparation à l’augmentation de l’humain
La longue histoire de la médecine a révélé qu’après l’étendue holistique de la variante médicale naturaliste d’Hippocrate, Claude Bernard est celui, qui au XIXe siècle, a intégré la notion de “déterminisme” dans la médecine afin d’encourager l’étude rationnelle des phénomènes vivants malgré leur complexité idiosyncrasique interne. Le physiologiste français ouvrait ainsi la voie à l’expérimentation dans le domaine médicale, au même titre que la physique et la chimie. La médecine commence alors à s’épanouir, à travers sa base scientifique qu’est la physiologie, en sortant de ses méthodes passive et expectative pour devenir active et conquérante. Elle commence à comprendre les rapports déterministes qui organisent les mouvements vitaux et se met rapidement au jeu de les faire cesser ou de les reproduire à volonté. Le pouvoir de gouverner la trajectoire des phénomènes vivants incite C. Bernard (2008, p. 162) à l’affirmation suivante : « Un physiologiste ne pourraient faire apparaître des êtres nouveaux dans leurs expériences qu’en obéissant à des lois de la nature, qu’ils ne sauraient en aucune façon modifier». La puissance prométhéenne de la science contemporaine plonge cette assertion dans la désuétude au regard des prouesses réalisées par l’ingénierie génétique. Après avoir compris avec les théories évolutionnistes que « l’homme est un produit aléatoire non final de l’Évolution » (G. Hottois, 2017, p. 28), les transhumanistes vont critiquer la sagesse de la nature en dénonçant ses mauvais arrangements pour proposer l’amélioration de l’Homme. Les progrès spectaculaires de la médecine ont permis à l’Homme, à travers l’usage des technologies, de “modifier les lois de la nature” et de redéfinir l’essence du rapport médecin-patient pour déboucher sur la médecine personnalisée qui met l’accent sur des méthodes préventives efficaces. L. Alexandre (2011, p. 173) le souligne avec enthousiasme :
La médecine pratiquée jusqu’au XXe siècle était encore celle d’Hippocrate. Elle reposait sur les notions de santé et de maladie, de normal et de pathologique, de patient, de diagnostic, de symptômes, etc. Les nouvelles technologies NBIC vont rendre obsolète cette médecine classique. Il ne s’agira plus de soigner des malades lorsqu’un problème se sera déclaré, mais de gérer notre capitale santé dans une vision à long terme, en intégrant le projet personnalisé de l’individu. Guérir les individus avant qu’ils ne tombent malades est un changement radical de perspective.
Il ne s’agit plus de réparer le corps vivant suivant le modèle de la médecine classique mais de l’améliorer et de l’augmenter aux moyens des biotechnologies à la fois sur les plans physique, intellectuel, émotionnel et moral. La nouvelle vocation de la médecine marque ainsi le point de départ de la prise en main par l’Homme de l’évolution en justifiant la nécessité de sauver son espèce. M. Nachez (2016, p 17) soutient à cet effet que « pour que l’Homme ne disparaisse pas dans le vaste cimetière des espèces éteintes, l’être humain doit lui-même intervenir pour booster son évolution et ce sont les technologies de pointe qui vont le lui permettre ». Il importe, au regard des inquiétudes de l’anthropologue français, de sauver l’espèce humaine de l’extinction avec « la prise en main par l’homme de sa propre évolution » (L. Ségalat, (2008, p. 77).
Le corps humain, selon l’anatomie, est un ensemble composite d’organes et de tissus qui interagissent, sous l’influence d’organites cellulaires producteurs d’énergie pour le faire fonctionner. Il en résulte alors, avec les disciples de René Descartes tels que Boerhaave et Borelli, une forme de iatromécanisme qui considère le corps humain comme une machine qu’on peut réparer suivant les forces mécaniques qui le déterminent. Une acception biologique qui a plus tard convaincu F. Jacob (1970, p. 10) de soutenir que « l’organisme devient ainsi la réalisation d’un programme prescrit par l’hérédité ». Il convient alors pour le savant de comprendre le mécanisme de fonctionnement des programmes inscrits dans les gènes afin d’agir sur les prédispositions structurelles et fonctionnelles des organes à naître. Cet argument fonde la conviction des transhumanistes qui pensent que si le vivant a été construit comme une machine, utiliser la science pour le réparer ou le rendre plus performant n’est pas contraire aux principes naturels de l’évolution. Avec la révolution biotechnologique, des nanorobots seront capables de parcourir le corps humain à la recherche d’imperfections à corriger en l’occurrence la purification du sang, le nettoyage des organes vitaux, le soutien du système immunitaire dans le traitement des agents pathogènes et du renforcement à apporter à la performance de l’ensemble de l’organisme. Dans ce contexte, « l’homme augmenté, peut alors se définir comme étant celle de l’augmentation artificielle des performances humaines à des fins utilitaires de travail, de sécurité, de santé, de plaisir… » (B. Claverie, 2010, p. 10). L’acharnement de l’application des biotechnologies au corps humain traduit, en partie, le désir de l’Homme de refuser la mort.
2.2. Le désir d’immortalité de l’Homme
L’expérience de la mort est une douloureuse occurrence qui a forgé en l’Homme, une attitude de résignation qui le confine parfois dans des habitudes défaitistes. Il a fini désespérément par comprendre que la réalité de la mort et son lot de souffrances est une autre marque de sa finitude à laquelle il ne peut aucunement rechigné. Parce qu’il naît et vit, il doit donc mourir pour donner sens à la manifestation de la logique de l’ordre naturel. C’est pourquoi, la mort apparaît pour R. Trembley (2009, p. 64.) comme « une odieuse réalité. Elle est une capitulation inévitable aux forces inexorables de la nature ». Une logique naturelle bien que difficilement supportable, qui se donne de la légitimité en s’inscrivant dans l’essence de l’Homme comme la loi la plus incontournable de la vie. La mort est étroitement liée à la naissance ; elle constitue avec la vie, un ensemble harmonieux qui donne sens à l’existence. C’est à juste titre que M. Somerville (2003, p. 155) « propose plutôt une vision réaliste qui consiste à accepter et à respecter la mort (…) car si la mort n’a aucun sens, la vie n’a aucun sens ». Les assurances de quiétude que propose Somerville s’inscrivent dans les traditions philosophiques épicurienne et stoïcienne dans leur tentative de banaliser la mort pour amoindrir l’intérêt que l’Homme y porte et la psychose qui l’accompagne, preuve acceptable pour accepter la mort comme négation de la vie.
La beauté théorique de toutes ces sagesses n’a jamais suffi à apaiser la crainte de l’Homme face à la réalité de la mort. Aujourd’hui encore, l’angoisse de l’Homme face à la mort est plus que persistante. Au refus de mourir s’ajoute désormais le refus de vieillir. L’Homme nourrit intimement le désir de vivre éternellement en conservant la pleine possibilité de ses capacités biologique et mentale pour mieux profiter des douceurs de la vie. C’est pourquoi, dès que la science lui a offert, à travers le séquençage de l’ADN, la possibilité d’intervenir dans le choix des composantes biologiques de la reproduction pour les enfants à naître ou de renforcer ses contenances biologiques pour se rendre plus résistants aux phénomènes de vieillissement et ralentir la mort, il a saisi cette opportunité sans procès. « Moi je veux être cloné parce que je ne veux pas mourir et que je veux me retrouver dans une vie prolongée ». Ironisant sur les propos d’un transhumaniste, l’éthicien A. L. T. Mbani (2007, p. 64) pense que l’Homme a une aversion tellement profonde pour la mort qu’il n’hésiterait pas à “défier” Dieu par tous les prix pour s’en débarrasser. Ce qui, pour les bioéthiciens, démérite le projet des bioprogressistes qui agresse continûment l’ensemble les valeurs chères à l’humanité.
3. La transhumanité et la probable fin de l’humanité
L’avènement des NBIC[20] souhaité par la transhumanité au profit d’une espèce humaine augmenté et améliorée contraste avec les attributs de l’humanité. Les biotechnologies ont intégré le mode opératoire des sciences biomédicales pour sublimer leurs approches thérapeutiques et tenter de déconstruire le schéma classique des programmes biologiques afin de les renforcer par des formes de vie artificielles nanométriques plus performants. En procédant ainsi, et ce, malgré les avantages liés à ces phénomènes qui placent l’Homme dans une position transitoire entre humain et machine, l’humanité plonge dans une crise profonde qui porte atteinte à ses valeurs sociales et ontologiques.
3.1. La crise des valeurs sociales
La vision de l’humanité que défend le transhumanisme tient sa concrétion des possibilités d’amélioration et d’augmentation de l’Homme. Dans cette logique, seule compte la qualité de vie qu’on peut espérer au-delà des contraintes biologiques que sont le vieillissement et la mort. En refusant la mort par le repoussement de la vieillesse au moyen des nouvelles technologies, l’Homme bouleverse, par effet de réflexibilité, le principe du déterminisme biologique et les valeurs sociales. En effet, l’homme augmenté, même s’il n’échappe pas à la mort, il porte atteinte par sa tentative de renversement de l’identité axiologique des forces inexorables de la nature. Repousser la mort par des traitements contre le vieillissement, c’est dénaturer la valeur de la vie, car sans la mort, la vie ne vaut rien. D’ailleurs, les évolutionnistes reconnaissent la nécessité de la mort en lui prêtant le don de renouveler les espèces pour renforcer leur adaptabilité aux flux environnementaux. Ainsi, la négation de la mort aura pour corollaire la modification des caractéristiques initiales de la vie. Cela aura pour implication, une forme d’athéisme qui sonnera l’écroulement des valeurs chères à la société telles que l’obligation morale et la croyance religieuse. C’est ce que reconnait B. Claverie (2010, p. 10) en soupçonnant le projet transhumaniste « de nier l’existence de Dieu et de s’attaquer à sa création ». Les récits bibliques dans leur esprit prémonitoire, avaient déjà averti l’Homme de sa volonté de s’insurger contre sa nature dans le livre de Genèse 1 au verset 31 : « Et Dieu contempla Son œuvre et vit que cela était bon ». Il convient, d’une manière parfaitement plus régulière, de comprendre dans l’esprit de la satisfaction de Dieu face à sa création, une invitation à la contemplation et à l’acceptation de l’Homme par l’Homme en tant que conception architecturée et éprouvée de l’art divin.
L’insatisfaction et la crainte de l’Homme face à ses limites biologiques et mentales ne sont liées qu’à des petits calculs d’intérêts qui n’apporte rien, selon les bioconservateurs, à l’évolution de l’humanité ; c’est plutôt une audace qui mènera l’Homme à sa perte. Si le transhumanisme se donne les moyens d’interférer dans les modalités de la création en y ajoutant ses fantasmes, il va nécessairement se poser le problème de principe d’égalité biologique entre les hommes. Les hommes augmentés se sentiront supérieurs aux hommes naturellement constitués en termes de forces physiques et de capacités intellectuelles. Il va s’en suivre une grande disparité dans le jugement des composantes législatives du contrat social, d’où son écroulement. C’est pourquoi, il va naître des mouvements de contestation du projet transhumaniste afin de sauvegarder les acquis de l’humanité. Le néo-luddisme par exemple, s’inspirant du luddisme du XIXe siècle, apparut au États-Unis au début des années 1990, s’oppose aux nouvelles technologies et leur utilisation dans le domaine médical. Il prône une vie sans technologie qui s’accorde avec les principes naturels et leurs moyens thérapeutiques holistiques et non agressifs. S’inscrivant dans la même logique, le politologue Francis Fukuyama et les philosophes Michael Sandel, Habermas et Léon Kass critiquent le transhumanisme en le considérant comme l’idée la plus dangereuse du monde. Une idée qui plonge les valeurs fondamentales de la société dans une crise profonde en s’attaquant par la suite, à l’identité ontologique de l’Homme.
3.2. Vers un terrorisme ontologique
La révolution héliocentrique, annoncée par les présocratiques[21] et confirmée par Copernic et Galilée, a soutenu les théories évolutionnistes de Lamarck et Charles Darwin pour redéfinir la place de l’Homme dans l’univers. Ainsi, « Avec Lamarck, l’Homme tombe brutalement de son piédestal : cessant d’être la créature privilégiée de Dieu » (A. Kahn, 2000, p. 27). En perdant, dans l’ordre de l’importance, la première place dans l’univers, l’Homme perdait par ricochet, les bases structurelles de sa création pour ne devenir qu’un simple vivant au milieu de tant d’autres. La marque qui le définissait comme la créature majeure de Dieu, s’écroula avec son accompagnement de suffisance et de dignité sous le poids des preuves scientifiques qui expliquent de façon cohérente les mécanismes de l’évolution, aujourd’hui acceptée comme une théorie crédible. Si l’Homme n’est pas une créature achevée et qu’il subit autant que les autres êtres vivants, le flux de l’environnement, cela suppose que sa programmation biologique est tout autant modifiable que celles des autres. Ce caractère modifiable du programme biologique de l’Homme a motivé les bioprogressistes, à l’image des transhumanistes, à s’ingérer dans l’intelligence organisationnelle de la nature pour tenter de prendre en main l’évolution de l’humanité. Un rêve devenu réalité avec les exploits des biotechnologies dans leur projet eugénique de rendre pérenne l’espèce humaine en améliorant ses bases biologiques pour résister à la vieillesse et à la mort. En procédant ainsi, l’Homme pousse son audace au-delà des lignes protectrices de l’identité ontologique de l’humanité. Une réalité à la fois inquiétante et déplaisante qui du point de vue des bioconservateurs, entre en « opposition avec le “respect de la vie” » (L. Alexandre, 2011, p. 340).
La vie est sacrée. Les éléments biologiques qui en constituent le support sont tout autant sacrés que la vie elle-même. En les modifiant sans précaution, par l’intervention dans le patrimoine génétique, sous le prétexte de résoudre les problèmes de santé de l’Homme, on porte atteinte à l’Homme lui-même dans son intégrité ontologique. On bouleverse son identité et sa sacralité en l’exposant à la merci des effets pervers du bio-business. Les organes et les produits du corps humain sont commercialisables au même titre que n’importe quelle marchandise dans les activités de négoce. C’est d’ailleurs l’inquiétude qu’exprime L. Alexandre (2011, p. 31) par ces mots : « Les technologies de manipulations génétiques devenant toujours plus complexes, les bioterroristes ont un boulevard devant eux pour “cuisiner” de nouvelles maladies en laboratoires ».
Conclusion
La conservation de soi que commande le déterminisme biologique, enjoint l’Homme à user de tous les moyens pour se maintenir longtemps en vie. Il va naître, dans cette perspective, le projet d’augmentation de l’humain afin de lui permettre d’être plus apte à résister aux maladies et au vieillissement. Des moyens classiques tels que la consommation de l’élixir de longue vie ont convaincu l’Homme de la véracité des mythes de l’immortalité. La modernité a renforcé ces moyens en y ajoutant de l’hédonisme à travers des boissons énergisantes, des produits psychotropes, des médicaments blokbuster tels que le viagra, le vallium, le prozac, le zoloft ou encore le ritalin, etc. Les compétitions sportives ont, à cet effet, été confrontées aux problèmes de dopage dont se rendent coupables certains athlètes pour augmenter leur performance olympique.
L’augmentation est un projet ancien auquel l’Homme s’est attaché après avoir pris conscience des enjeux de l’évolution de son espèce. Soigner les insuffisances du bricolage naturel pour ajuster au mieux, la marche de son évolution ; telle se définit le rôle de l’Homme dans la destinée de l’humanité que L. Ferry (2016, p. 132) résume comme suit : « Il est possible, c’est en tout cas le pari transhumaniste, que l’humanité modifiée et augmentée soit beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante (…) que l’ancienne ». Une ambition audacieuse mais passionnante qui a mobilisé les grandes intelligences scientifiques pour partir de l’augmentation des capacités par consommation à l’intervention dans le patrimoine génétique. Aujourd’hui, l’eugénisme, le CRIPR cas-9, la thérapie génique et le clonage sont en train de déboucher sur la convergence des révolutions NBIC. Les technologiques dans l’amélioration de l’Homme sont avérées, même si dans les faits, leur application pose des problèmes méthodologique et éthique. C’est d’ailleurs ce qui a amené les bioconservateurs à condamner radicalement les agissements jugés fantaisistes des bioprogressistes. Il convient, pour éviter les tiraillements entre ces deux mouvements, de s’accorder sur des modalités de gestion de l’augmentation de l’humain en recadrant le « laisser aller » des uns et la « condamnation radicale » des autres afin d’accompagner avec précaution, la marche de l’évolution de l’espèce humaine.
Références bibliographiques
ALEXANDRE Laurent, 2011, La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l’humanité, France, JCLattès.
ALEXANDRE Laurent, 2011, Et si nous devenions immortels ? Comment la technomédecine va bouleverser l’humanité, France, JC Lattès.
BERNARD Claude, 2008, Introduction à l’Étude de la Médecine Expérimentale, 2e édition, Paris, Garnier-Flammarion.
BESNIER Jean-Michel, 2012, Demain, les posthumains, le futur a-t-il encore besoin de nous ?, France, Fayard/Pluriel.
CLAVERIE Bernard, 2010, L’homme augmenté, Néotechnologie pour un dépassement du corps et de la pensée, Paris, L’Harmattan.
FERRY Luc, 2016, La révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l’uberisation du monde vont bouleverser nos vies, Paris, Plon.
HOTTOIS Gilbert, 2017, Philosophie et idéologies trans/posthumanistes, Paris, Vrin.
JACOB François, 1970, La logique du vivant, Paris, Gallimard.
JACOB François, 1981, Le jeu des possibles, Paris, Fayard.
KAHN Axel, 2000, Et l’homme dans tout ça ?, Paris, Nil éditions.
NACHEZ Michel, 2016, Transhumanisme et posthumanisme, France, Éditions Uppr.
SÉGALAT Laurent, 2008, La fabrique de l’homme, pourquoi le clonage humain est inévitable, Paris, Bourin Éditeur.
SOMERVILLE Margaret, 2003, Le canaris éthique, Montréal, Liber.
TREMBLAY Rodrigue, 2009, Le code pour une éthique globale, Montréal, Liber.
TSALA MBANI André Liboire, 2007, Biotechnologies et Nature humaine, vers un terrorisme ontologique, Paris, L’Harmattan.
LES ENFANTS ET LA TÉLÉVISION : CE QU’ILS REGARDENT, NOUS REGARDE
1. Kouakou Hilaire KOUAMÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
hilairekouame@uao.edu.ci / caublethilaire@yahoo.fr
2. Koffi Jacques Anderson BOUADOU
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Le développement technologique a consacré la démocratisation de la télévision. En Côte d’Ivoire, en milieu urbain et péri-urbain, la plupart des foyers sont irrigués par ce média. Subjugués par son pouvoir de son et d’image, les foyers ont fait le choix de sa domestication. Si la télévision a intégré le mode vie des adultes, elle fascine tout autant les tout-petits, ces « petits êtres » en construction. La présente contribution ne questionne guère la relation entre ces enfants et la télévision, encore moins les usages réservés à ce média. Toutefois, elle ouvre le débat sur l’intérêt que les parents portent à l’activité télévisuelle de leurs enfants. A l’analyse des résultats, il ressort que la majorité des parents n’exercent aucun contrôle sur les contenus télévisuels consommés par leurs enfants.
Mots clés : Contrôle parental, Contenus télévisuels, Éducation aux médias, Enfant, Exposition, Intérêt, Télévision.
Abstract :
Technological development has consecrated the democratization of television. In Côte d’Ivoire, in urban and peri-urban areas, most households are irrigated by this medium. Captivated by its power of sound and image, homes have chosen its domestication. If television has integrated the lifestyle of adults, it is just as fascinating toddlers, these “little beings” under construction. This contribution hardly questions the relationship between these children and television, much less the uses reserved for this medium. However, it opens the debate on the interest that parents have in their children’s television activity. Analysis of the results shows that the majority of parents have no control over the television content consumed by their children.
Keywords : Exposure, Child, Interest, Media education, Parental control, Television, Television content.
Introduction
La télévision est le média qui a la faculté de projeter à son public, l’image, la couleur, le mouvement, et le son. Cette singularité lui confère un pouvoir presque magique. Par sa combinaison d’image et de son, la télévision fascine ; suscite de l’émotion. Média de la vie moderne, la télévision partage l’intimité des familles, fait partie de leurs rituels quotidiens. Souvent disposé dans un endroit de la maison, commun à tous les membres de la famille, la télévision est accessible à tous. Le contenu de ses programmes s’adresse à toutes les tranches d’âge. Parmi les publics, les plus attentifs de la télévision, on note la présence non moins négligeable des enfants. Dès leur plus jeune âge, ces « Petits-Êtres » sont exposés, parfois surexposés à l’écran télévisuel.
En France, selon une étude réalisée par l’INED et l’INSERM[22] en 2011, à la demande de la Direction générale de la santé, il ressort qu’à 2 ans, 68% des enfants regardent la télévision tous les jours. (P. P. Gomes, 2019). Bien que l’offre télévisuelle s’articule autour de l’éducation et du divertissement, certains observateurs, la soupçonnent de pouvoir de nuisance sur les jeunes enfants qui la regardent. Dans certains pays comme la France, et le Canada, le rapport de l’enfant avec la télévision, « l’expérience télévisuelle »[23] de l’enfant, est mis en débat dans la sphère public. Ce débat se nourrit des nouvelles formes de contenus télévisuels proposées aux téléspectateurs. Eu égard aux enjeux commerciaux et économiques, les contenus à caractère distractif ont une ascendance remarquable sur les contenus éducatifs. Ces nouvelles offres attestent du déclin de la « paléo-télévision », et de l’émergence de la « néo-télévision ». La « paléo-télévision » s’inscrivait dans une visée pédagogique et didactique. (E. Macé, 1993).
Quant à la « néo-télévision », elle est centrée sur l’émotion et le contact qu’elle veut établir avec le public. Pour E. Umberto (1985, p. 148) : « On s’achemine donc vers une situation télévisuelle dans laquelle le rapport entre l’énoncé et les faits perd de plus en plus d’importance à l’avantage du rapport entre la vérité de l’acte d’énonciation et l’expérience de réception du message de la part du spectateur ». Or, l’enfant, ce jeune téléspectateur, est un « Être en construction ». Il n’a pas l’intelligence nécessaire pour discerner la fiction de la réalité. Ainsi, pour l’enfant, les opinions qu’il reçoit de la télévision, portent la marque du monde réel, du vécu quotidien. Ces opinions diffusées par la télévision, pourraient constituer pour le jeune enfant, un référentiel susceptible de déterminer sa personnalité sociale. L’exposition aux contenus violents ou choquants, par exemple, peut entraîner chez l’enfant, des troubles tels que la banalisation de la violence, l’agressivité, les cauchemars, etc. (CSA, 2019)[24]. S’il est vrai que la télévision constitue un moyen extraordinaire de divertissement, un excellent outil de découverte du monde, et un support alléchant d’échanges, de dialogue dans la sphère familiale (S. Tisseron, 2010, p. 73), il n’en demeure pas moins que ses effets nuisibles pourraient freiner le développement de l’enfant. Dès lors, l’Académie Américaine de Pédiatrie demande aux parents d’éviter l’exposition des enfants de moins de 2 ans à la télévision, et de réduire à moins de 2 heures le temps mis par les plus grands devant la télévision. (A. Américaine de Pédiatrie, 1999).
Malheureusement, ces recommandations ne sont pas appliquées par certains parents. Dans la plupart des familles ivoiriennes, les enfants ont toujours regardé la télévision parfois sous le regard bienveillant des parents. Connaissent-ils les risques associés à l’écran de télévision ? Exercent-ils un contrôle sur le contenu des programmes télévisuels visionnés par les enfants ? Discutent-ils des contenus de ces programmes aves les enfants ? La présente contribution a pour objectif d’appréhender l’intérêt que les parents manifestent à l’égard des contenus télévisuels auxquels sont exposés les enfants.
1. Méthode et Matériels
Cette étude s’est déroulée dans la commune d’Adjamé, plus précisément au quartier Paillet. Le choix de ce quartier se justifie par l’émergence d’une classe moyenne susceptible de détenir au moins un écran de télévision. L’unité d’échantillonnage de cette étude est constituée de ménages ayant au moins un écran télévisuel et au moins un enfant en âge préscolaire (2 à 5ans) ou scolaire (6 à 8 ans). Les données ont été collectées auprès de 73 ménages. Cet échantillon a été obtenu par le biais de la technique de « boule neige ». Cette technique a consisté à interroger un premier ménage qui nous a conduit à un deuxième ménage répondant aux critères de départ, puis à un troisième. Progressivement, notre échantillon a été constitué. Cette étude s’inscrit dans la tradition des études mixtes, c’est-à-dire une étude fondée à la fois sur une approche quantitative, et une approche qualitative.
L’approche quantitative a pour finalité de rendre compte de l’intérêt que les parents accordent aux contenus des programmes télévisuels, à travers un questionnaire dont les items portent sur la connaissance des préjudices que pourraient subir les enfants dans leur rapport avec la télévision, et le contrôle de ces contenus par les parents. Quant à l’approche qualitative, elle se présente comme une sorte de maïeutique permettant aux enquêtés (parents des enfants) d’exprimer leurs opinions relatives à la relation entre les enfants et la télévision, approfondissant ainsi les données de l’étude quantitative. Pour réaliser l’étude quantitative, le recours à l’entretien individuel et l’observation incognito s’est avéré nécessaire.
Structuré autour d’un guide d’entretien, la discussion a porté sur la nature des risques encourus par les enfants exposés aux écrans de télévision, et l’éventualité d’une interaction entre les parents et les enfants à propos des contenus diffusés à la télévision. Quant à l’observation incognito, elle a permis d’observer la réaction des parents quand leurs enfants regardent la télévision.
Les résultats de l’étude quantitative ont été analysés grâce au logiciel Excel de Microsoft, puis rangés dans des tableaux. Les résultats de l’étude qualitative découlent de l’analyse des discours recueillis auprès des enquêtés.
2. Résultats
2.1. Cognition des effets de la télévision sur les enfants
Les bienfaits de la télévision sont à la fois multiples et indéniables. Ce médium fournit à ses consommateurs des moyens de divertissement et des informations qui leur permettent de s’ouvrir au monde. Pour les enfants en âge préscolaire et scolaire, la télévision n’est pas seulement bénéfique. Elle génère des effets potentiellement négatifs sur ces jeunes téléspectateurs.
Tableau 1 : Temps passé par les enfants devant la télévision
| Combien de temps votre enfant passe devant la télé par jour ? | N | % |
| 1h | – | – |
| 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h | – 9 – – – – | – 12 – – – – |
| Aucune idée | 64 | 88 |
| Total | 73 | 100 |
La fréquence à laquelle les enfants consomment les contenus télévisuels permet de déceler une surexposition ou non à la télévision. Ce média, pris dans sa dimension exclusivement ludique, récréative pourrait constituer une source de stimulation pour le jeune enfant. Néanmoins, une trop grande accoutumance, et une consommation excessive de la télévision nuiraient gravement au développement mental, psychologique des enfants. Dans le cadre de cette étude, les résultats révèlent que la majorité des parents n’ont aucune idée du temps passé par leurs enfants devant l’écran de télévision. Cette catégorie représente 88% des enquêtés. Dans ces ménages, il n’existe pas de prescription temporelle susceptible d’encadrer la relation entre les enfants et la télévision. De façon tacite ou implicite, ces parents autorisent leurs enfants à passer autant de temps qu’ils souhaiteraient dans la télévision. « Mon principe veut que mes enfants restent à la maison. Dehors, il y a tellement de dangers qui les guettent. La télévision est l’épine dorsale de mon principe. Ils peuvent passer tout le temps devant la télévision pourvu qu’ils ne sortent pas » (A. Diomandé, Cadre de banque, Paillet, 03/11/2019). Dans ce cas, le risque de surexposition ne peut être superflu.
Contrairement à ces parents, il y a une frange de la population enquêtée qui semble s’intéresser à l’activité télévisuelle des enfants par l’instauration d’une règlementation du temps passé devant la télévision. Cette frange ne représente que 12% des ménages enquêtés. Dans ces ménages, le volume horaire maximum accordé à la télévision est de 3 heures par jour. Certains parents auraient voulu interdire catégoriquement la télévision à leurs jeunes enfants, mais eu égard à la prégnance de ce média dans la sphère familiale, ce projet relève de l’utopie. « Je me souviens qu’il fut un moment où j’allais au bureau avec la télécommande de la télévision parce que mon premier fils [4ans] passait tout le temps devant la télévision. Mais, il allait chez les voisins pour regarder la télévision. Donc je me suis résolue à lui accorder 3h de télévision par jour » (N. Koua, Conseillère-client, Paillet, 03/11/2019).
Tableau 2 : Prise de conscience des effets négatifs de la télévision sur les enfants
| Savez-vous que la télévision aurait des effets pervers sur vos enfants ? | N | % |
| Oui Non | 21 48 | 29 66 |
| Non réponse | 4 | 5 |
| Total | 73 | 100 |
Le fait de savoir que la télévision pourrait constituer un facteur de risques pour les enfants en âge préscolaire, attirerait l’attention des parents sur la consommation ou la surconsommation des contenus télévisuels par leurs enfants. Malheureusement, les données de notre enquête attestent que seulement 29% des parents interrogés, savent que la télévision exerce sur les jeunes enfants, une attractivité négative. Une forte proportion des enquêtés, soit 66% ignore que les programmes télévisuels ne sont pas que bénéfiques pour les enfants. « Je ne vois pas comment la télévision pourrait être négative pour mes enfants. La télévision distrait, stimule l’intelligence des enfants. Dans tous les cas, mes enfants sont épanouis grâce à la télévision » (P. Adoubi, Agent au ministère de l’intérieur, 08/12/2019). Par ailleurs, 5% des parents n’ont pas daigné répondre à la question. Certainement que ces parents ne savent pas que la télévision peut nuire au jeune enfant.
Tableau 3 : Connaissance des effets négatifs de la télévision sur les enfants
| Quels peuvent être les effets négatifs de la télévision sur les enfants ? | N | % |
| Représentation de soi Agressivité | – 11 | – 52 |
| Manque d’activités physiques Problèmes de santé Difficultés d’attention Autres | – 4 – | – 19 – |
| Total | 21 | 100 |
À cette question, ont répondu 21 ménages. Ils représentent les parents qui affirment savoir que la télévision comporterait des risques pour les enfants en phase de construction. La majorité de ces ménages a identifié l’agressivité comme principal préjudice subi par les jeunes enfants exposés à la télévision. Cette agressivité peut être physique ou verbale. Elle se développe chez les enfants surexposés aux programmes télévisuels aux contenus violents. L’exposition continuelle des jeunes enfants à ces contenus télévisuels, les pousse à faire de la violence, un fait social banal. « J’ai été surpris d’entendre ma fille de 2 ans dire à son petit frère de 10 mois qu’elle va le tuer parce qu’il a tiré ses cheveux » (C. Zanga, Enseignant, Paillet, 08/12/2019). Soit cette jeune enfant imite une scène d’une fiction télévisée, soit elle utilise les propos violents, récurrents, itératifs diffusés par la télévision. Outre l’agressivité, les problèmes de santé ont été reconnus par les parents comme faisant partie des effets négatifs de la télévision sur les enfants. Les problèmes de santé viennent en deuxième position après l’agressivité. Les problèmes de santé concernent la myopie, la mauvaise alimentation, la fatigue physique due aux postures des jeunes téléspectateurs. Au cours de notre enquête, il nous a été donné d’observer des enfants en âge préscolaire, en position debout, à moins d’un mètre devant l’écran télévisuel. La lumière, la surbrillance de l’écran peut affecter les capacités visuelles de l’enfant. Quant à l’attention, elle occupe la troisième place des effets indésirables de la télévision sur les enfants. La consommation des contenus télévisuels par les jeunes enfants pendant de longues heures les rend indifférents, insensibles à leur environnement immédiat. « Pendant que tu lui parles, ses yeux sont rivés sur la télévision. Pendant qu’il mange, son regard est figé sur l’écran » (B. Mariam, Agent immobilier, 15/12/2019).
2.2. Contrôle des contenus des programmes télévisuels visionnés par les enfants
La télévision est un média fortement ancré dans l’univers des enfants. L’évolution technologique a consacré la multiplication de chaîne numériques, et des chaînes diffusées par satellite. Ces chaînes de télévision offrent à leurs publics, une diversité de contenus. Dans cet environnement télévisuel surchargé, les parents peuvent-ils contrôler les contenus diffusés par la télévision ?
Tableau 4 : Types de programmes regardés par les enfants
| Quel est le type de programme auquel sont exposés vos enfants ? | N | % |
| Documentaire Musique | – 12 | – 16 |
| Jeu télévisé Film Dessins animés Aucune idée | – 15 37 09 | – 21 51 12 |
| Total | 73 | 100 |
Les données relatives à la nature des programmes télévisuels auxquels sont exposés les enfants, des répondants suggèrent que la quasi-totalité des parents sont attentifs aux activités télévisuelles de leurs enfants. La connaissance manifeste des préférences télévisuelles de leurs enfants en est la preuve. Seulement 12% des ménages interrogés sont indifférents à l’égard des programmes télévisuels visionnés par leurs enfants. « … si la télévision arrive à distraire, à divertir mes enfants, c’est l’essentiel » (A. Olga, Travailleur social, 03/11/2019). Pour certains parents, les offres télévisuelles doivent absolument correspondre aux besoins de loisir, de divertissement, éprouvés par les jeunes enfants. Peu importe les supports télévisuels diffusés, la finalité est de satisfaire le jeune téléspectateur. Les dessins animés demeurent la préférence principale des enfants des ménages interrogés. Les dessins animés correspondent à l’âge, et à la personnalité de ces enfants. Ce genre télévisuel est généralement conçu pour ce jeune public. Outre les dessins animés, les enfants semblent s’intéresser aux Films de cinéma, initialement dédiés à un public plus ou moins jeune. Une proportion non négligeable des ménages, soit 21% confirme cette inclinaison des enfants à regarder les films de cinéma. Ce penchant pour ce genre télévisuel reposerait sur l’imitation de l’expérience télévisuelle des adultes. Dans la plupart des ménages, la télévision est un objet familial, un bien commun mais sur lequel les adultes exercent quelque fois, un pouvoir contraignant. Ils soumettent les jeunes enfants à leur préférence quand ils regardent la télévision avec eux. La préférence pour les films de cinéma n’est forcément un choix délibéré, volontaire. Cette situation traduit le non-respect des pictogrammes ou signalétiques apposés devant certains contenus filmiques à destination d’un public adulte. Par ailleurs les résultats de notre enquête montrent que les enfants consomment aussi bien les programmes de musique que les Dessins animés et les films de cinéma. 16% des parents indiquent que l’activité télévisuelle de leurs enfants s’articule autour des programmes musicaux. Les enfants en âge préscolaire se laissent bercer par les tendances musicales en vogue. Ils sont sensibles aux sonorités urbaines et à la musique des Disc-jockeys (DJ). Certaines chaînes de télévision en ont fait leur spécialité. « A la maison on ne regarde que Trace Africa, Ivoire Tv Music à cause de ma fille. Elle veut regarder les clips vidéo de l’artiste Serge Beynaud, de DJ Arafat[25], d’autres artistes du Coupé-décalé » (D. Aka, Informaticien, Paillet, 03/11/2019). Si les données de cette enquête dévoilent l’intérêt que les parents manifestent pour les programmes télévisuels regardés par leurs enfants, qu’en est-il pour le contenu de ces programmes ?
Tableau 5 : Intérêt porté au contenu des programmes télévisuels
| Exercez-vous un contrôle sur le contenu des programmes télévisuels de vos enfants ? | N | % |
| Oui Non | 11 17 | 15 23 |
| Non réponse | 45 | 62 |
| Total | 73 | 100 |
Si les parents connaissent le type de programmes télévisuels que leurs enfants regardent, il en n’est rien pour leurs contenus.
En effet, les statistiques relatives au contenu télévisuel, attestent que seulement 15% des parents interrogés, manifestent un intérêt pour les contenus télévisuels visionnés par leurs enfants. Ils exercent ainsi, un contrôle sur les contenus des programmes de télévision. Dans la pratique, le contrôle des contenus télévisuels consiste à filtrer, à restreindre l’accès à certains contenus susceptibles de porter préjudice au jeune enfant : c’est le contrôle parental. « On a 2 postes téléviseurs. Sur le poste des enfants, on a fait installer un code parental sur tous les programmes destinés aux adultes. On a juste sélectionné une dizaine de programmes pour les enfants » (P. Adoubi, Agent au ministère de l’intérieur, 08/12/2019). Les résultats montrent également que 17% des parents avouent ne pas se préoccupent des contenus télévisuels consommés par leurs enfants. Ils n’exercent aucun contrôle sur les contenus de ces programmes. « Je demande simplement aux enfants de fermer les yeux quand les scènes sont violentes ou sensuelles. Il arrive aussi que je change de chaîne » (B. Zézé, Agent de publicité, Paillet, 07/12/2019).
La grande majorité des ménages (62%) n’ont pas répondu à notre question en rapport avec les contenus des programmes télévisuels. Cela sous-entend que ces parents montrent peu d’intérêt à ce que regardent leurs enfants à la télévision. Pourtant les contenus médiatiques sont des facteurs cardinaux de l’influence des médias sur la société. C’est à travers leurs contenus que les médias peuvent modifier notre vision du monde. Certains contenus télévisuels, par exemples, peuvent heurter la sensibilité du jeune enfant. De ce point de vue, les parents doivent se montrer plus attentifs aux contenus télévisuels auxquels sont exposés leurs enfants. La cognition des programmes télévisuels ne peut constituer, à elle seule, le gage d’une activité télévisuelle dénuée de tous risques pour les enfants en âge préscolaire. Le Dessin animé, bien qu’il soit destiné aux jeunes enfants, peut mettre en scène des personnages grotesques, terrifiants ou une scénarisation de la violence. Il n’est donc pas inoffensif pour les enfants. Quant aux contenus des films de cinéma, ils sont parfois violents.
2.3. Interaction entre les parents et leurs enfants après une session de visionnage télévisuel
Devant la télévision, les enfants sont exposés à un important flux d’images, de sonorités susceptibles d’engendrer chez eux une vision décalée de la réalité. A l’âge préscolaire, l’enfant ne dispose pas d’aptitudes mentales, intellectuelles pour différencier une scénarisation de la fiction de celle de la réalité. La télévision, en tant que dispositif de socialisation peut générer un effet contraire au développement de l’enfant. D’où, la nécessité pour les parents de discuter des contenus télévisuels avec leurs enfants afin de restituer la réalité de la fiction. Combien sont-ils à souscrire à cette démarche éducative ?
Tableau 6 : Discussion à propos des contenus télévisuels visionnés par les enfants
| Échangez-vous avec votre enfant sur les contenus télévisuels ? | N | % |
| Oui Non | 13 55 | 18 75 |
| Non réponse | 05 | 7 |
| Total | 73 | 100 |
L’interaction entre les parents et leurs enfants après le visionnage des contenus télévisuels est le reflet de l’accompagnement de ces enfants dans leurs activités télévisuelles. Cet accompagnement traduit l’intérêt que les parents accordent à la relation entre leurs enfants et la télévision. Il n’est pas rare que les enfants soient exposés à des contenus inadaptés à leur âge, à leursensibilité. De ces contenus inadaptés pourraient naître chez les enfants un sentiment de confusion, et des émotions complexes. De plus, face à la tentation de reproduire ou d’imiter ce qu’ils ont vu à la télévision, l’idéal serait que les parents échangent avec eux sur les contenus télévisuels.
Les résultats de notre enquête montrent qu’en réalité, la majorité (75%) des parents interrogés, ne font pas des contenus télévisuels, le référent de leurs communications avec les enfants. Autrement dit, les contenus télévisuels ne sont pas des sujets mis en débat dans les échanges entre les parents et leurs enfants. « En réalité je ne sais pas ce que mes enfants regardent à la télévision. Je n’ai jamais discuté de télévision avec eux » (A. Olga, Travailleur social, 03/11/2019). Les interactions relatives aux activités télévisuelles ne semblent guère préoccupées ces parents qui s’abstiennent de connaître les émotions engendrées par le contenu d’un programme de télévision chez les jeunes enfants. L’absence de dialogue autour des contenus télévisuels laisse l’exclusivité aux enfants de construire leur propre représentation du monde à partir de leur expérience télévisuelle. De ces résultats, il ressort également que seulement 18% des parents montrent une vigilance particulière à ce que leurs enfants regardent à la télévision. Pour certains parents, cette interaction avec les enfants a pour finalité de réduire l’impact des contenus inappropriés sur les enfants, et de rendre ces contenus conformes à la réalité. C’est aussi le prolongement ou la continuité de la mission éducative des parents.
3. Discussion
La télévision, objet technique, fruit de l’innovation technologique, a su intégrer le cercle familial grâce à son charme enchanteur. La télévision est le centre de l’attention familiale (L. Spigel, 1996, p. 42), c’est l’objet central autour duquel, s’organise le salon. Dans ce groupe social qu’est la famille, la télévision n’a pas uniquement pour fonction de divertir, mais elle se présente aussi comme un excellent moyen de détourner les enfants des mauvaises fréquentations de la rue. (L. Spigel, 1996, Op. cit., p. 40). Cette propriété éducative de la télévision magnifie sa dimension socialisante de l’enfant. Elle aurait les mêmes propriétés que la famille dans le processus de socialisation du jeune enfant. Selon M.-J. Chombard, et C. Bellan (1979, p. 118), « La rencontre enfant-télévision déclenche une intériorisation de représentations, de connaissances et de valeurs… ». Au-delà de sa fonction de socialisation, la télévision remplace quelques fois les parents astreints, assujettis aux activités salariales ou aux tâches domestiques. Elle joue le rôle de « la Baby-sitter occasionnelle ». Vu sous cet angle, la télévision rendrait bien de service aux parents. La grande majorité de ceux-ci, manifeste une tolérance passive face aux enfants qui consacrent de longues heures à la télévision. Selon les informations fournies par les parents, la plupart des parents n’ont pas du tout connaissance ou ont une connaissance approximative des répercussions négatives des contenus télévisuels sur les enfants. Certains ménages réduisent le plus souvent ces effets négatifs à l’agressivité, parce qu’elle serait plus visible que les autres effets. Les nombreuses scènes de violence qui se déroulent dans les films ou dessins animés agressent l’innocence de l’enfant, et occasionnent des comportements violents, agressifs chez les tout-petits téléspectateurs (L. Spigel, 1996, p. 40), voire la banalisation de la violence. Comme le démontre L. Lurçat (1990, p. 171) :
Les enfants s’identifient à ce qu’ils regardent. La situation télévisuelle, par le rapport médiatisé à l’Autre qu’elle impose, favorise l’identification plus encore que le cinéma. La violence véhiculée par le média peut se transformer en initiation à la violence, dans la mesure où le raccord peut se faire entre volontarisme, trait psychologique enfantin, et l’aspect souvent intentionnel, délibéré, de nombreux actes violents montrés dans les informations, les films et les dessins animés.
Les films d’animation destinés aux enfants n’échappent pas non plus à la critique. Pourtant, les données recueillies auprès des parents indiquent que les Dessins animés représentent une préférence télévisuelle pour les enfants. Bien plus, les parents issus des ménages interrogés à Paillet, semblent ne pas savoir que la télévision perturbe la construction de la représentation, de l’image que l’enfant a de lui-même. S. Tisseron (2010, p. 79) explique que l’enfant interagit avec le monde grâce à toutes ses facultés sensorielles. Dans son rapport avec ses jouets, le jeune enfant fait appel à la vue, l’adorât, l’audition, et au toucher. « C’est dans cette intrication permanente que se tisse son image inconsciente du corps et que s’installe son sentiment d’être à la fois dans son corps et au monde ». (S. Tisseron, 2010, Op. cit., p. 79). Or, les travaux du pédiatre P. Winterstein attestent que cette première fonction se trouve altérée chez les enfants qui sont surexposés aux contenus télévisuels. Invités par le pédiatre à réaliser le dessin d’un « bonhomme », les enfants reproduisent des images représentant des corps « déformés », « amputés ». Pour ces enfants surexposés à l’écran télévisuel, les corps étaient aberrants. (P. Winterstein, 2005). Compte tenu de ces répercussions négatives, les parents seraient fondés à contrôler les contenus des programmes télévisuels, ou en discuter avec leurs enfants. Toutefois, la posture des parents interrogés, est tout autre. En effet la majorité des répondants n’accordent pas d’intérêt à l’activité télévisuelle de leurs enfants. Or, les parents tiennent une position privilégiée pour aider leurs enfants à tirer le meilleur profit de la télévision, en contrôlant ce qu’ils regardent, et les accompagnant dans les sessions de visionnage. Ce rôle de médiation s’inscrit dans la dynamique de l’Éducation aux Médias.
L’éducation aux médias se définit comme « l’éducation visant à donner la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes » (C. française, 2008). Sa mise en œuvre peut se faire au moyen de l’enseignement formel, et informel, mais le cercle familial peut y participer. (C. Michels, 2017).
L’éducation aux médias est un thème qui émerge dans la sphère publique européenne, voire, dans les instances de réglementation et de décision des politiques. En Côte d’Ivoire, l’éducation aux médias n’est pas inscrite à l’agenda des politiques publics, des instances de régulation des médias, et encore moins l’agenda des parents. Toutefois, dans son application dans le cercle familial, il est impérieux que les parents s’érigent en modèle quant à l’utilisation de l’écran télévisuel. L’éducation aux médias par les parents revient à montrer, à enseigner aux enfants les bonnes pratiques, les bonnes habitudes face à la télévision. L’efficacité de cette éducation requiert nécessairement un co-visionnement télévisuel afin de repérer, puis de discuter des contenus susceptibles de perturber la personnalité psychologiques, sociale de l’enfant en âge préscolaire.
Conclusion
La relation entre les enfants et la télévision a nourri, et continue de nourrir les travaux de chercheurs scientifiques. Cet intérêt accru à l’égard de l’interaction entre les enfants et la télévision pourrait se justifier non seulement par la prégnance de ce média dans la vie du jeune enfant, mais aussi et surtout, par les revers que pourraient subir ces « petits êtres » en construction. Notre contribution est une étude sur l’intérêt que les parents portent à l’activité télévisuelle de leurs enfants. Cet intérêt s’articule autour de la cognition des répercussions négatives des contenus télévisuels sur les enfants, du contrôle des contenus visionnés, et des échanges entre les parents et leurs enfants à propos des contenus des programmes télévisuels. Adossée à la méthode mixte, cette étude révèle que la plupart des parents interrogés dans la zone d’enquête, ne connaissent pas les éventuels préjudices de la télévision sur les enfants, encore moins le temps d’exposition de leurs enfants à l’écran télévisuels. Par ailleurs, s’il est prouvé que les parents sont attentifs aux programmes suivis par leurs enfants, ils n’ont aucune idée du contenu qu’ils regardent. Les parents sont moins disposés à exercer un contrôle sur les contenus télévisuels. Ainsi les enfants risquent de s’exposer à des contenus violents, inappropriés pour leur personnalité. De plus, la majorité des parents rencontrés à Paillet, sont moins enclins à interagir avec leurs enfants sur les contenus télévisuels afin de les aider à distinguer la réalité de la fiction. L’étude conclut que la majorité des parents interrogés à Paillet, ne prêtent pas une attention particulière à l’activité télévisuelle de leurs enfants. En Côte d’Ivoire, la question de la relation entre les enfants et la télévision est moins ou pas du tout présente dans les débats publics.
Références bibliographiques
BEUSCART Samuel, BEAUVISAGE Thomas, et al., 2012, « La fin de la télévision ? Recomposition et synchronisation des audiences de la télévision de rattrapage », in https://www.cairn.info/revue-reseaux-2012-5-page-43.htm, consulté le 16 mars 2020.
CARMEN Michels, 2017, « L’apport de l’éducation aux médias pour le
développement de l’esprit critique. Quelle importance accorder au choix de la pédagogie ? », Institut des Hautes Etudes des Communication Sociale, Bruxelles.
CHOMBARD De LAUWE Marie-Josée, 1979, Les enfants de l’image : enfants personnages des médias, enfants réels, Paris, Payot.
CSEM, Décret inscription : décret de la commission française du 5 juin 2008, portant la création du Conseil supérieur de l’éducation aux médias et assurant le développement des initiatives et de moyens particuliers en la matière en communauté française, Moniteur belge, 15 octobre 2008.
GOMES Paulo Pinto, 2019, « À deux ans, 68 % des enfants regardent la télévision tous les jours » in, www.la-croix.com/Famille/Enfants/A-deux-ans-68-enfants-regardent-television-tous-jours-2019-01-04-1200993285, consulté le 11 mars 2020.
LURÇAT Liliane, 1990, « Impact de la violence télévisuelle », in Enfance, tome 43, n°1-2.
MACE Eric, 1993, « La télévision du pauvre : Sociologie du ‘’public participant’’ : une relation ‘’enchantée ‘’ à la télévision », in https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-1993-1-page-159.htm, consulté le 16 mars 2020.
SPIGEL Lynn, 1996, « La télévision dans le cercle de famille », in Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 113, La famille dans tous ses états.
TISSERON Serge, 2010, « Les effets de la télévision sur les jeunes enfants : prévention de la violence par le ‘’Jeu des trois figures’’ », in Devenir, volume 22, n°1.
UMBERTO Eco, 1985, La guerre du faux. Paris, Grasset.
WINTERSTEIN Peter, JUNGWIRTH Norbert, 2006, « Enquête faite dans le Service de pédo-psychiatrie du Centre Hospitalier d’Ernstein », in Kinder-und Jugendarzt.
LA MÉTAFICTION OU L’ACTE DE FABRICATION DE LA FICTION DANS VERRE CASSÉ[26] D’ALAIN MABANCKOU ET HERMINA* DE SAMI TCHAK
Yayo Vincent DANHO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
danhoyayovincent@gmail.com / vincent_danho@yahoo.fr
Résumé :
La métafiction s’adosse à ses usages traditionnels, voire à ses modalités réflexives primitives dont la praxis herméneutique est soumise au procès du lecteur. Verre cassé d’Alain Mabanckou et Hermina de Sami Tchak exemplifient, en effet, les intrusions de personnages-narrateurs dans une situation d’invention et d’intervention. Chez Mabanckou et Tchak, la fabrication de la fiction ne se fait pas ex-nihilo. La stratégie consiste à mettre en ordre l’intelligence des faits qui informent la diégèse en recourant à l’intratextualité et à l’intertextualité. Quoique l’autoréférentialité de la fiction puisse sembler étonnante, ce phénomène littéraire se produit de plus en plus régulièrement. La littérature est possible et lisible aussi dans /par la voie de la métafiction.
Mots clés : autoréférentialité, diégèse, métafiction, fabrication de la fiction, lecteur, littérature, personnage-narrateur.
Abstract:
The metafiction leans on its traditional uses and even on its primitive reflexive modalities whose hermeneutic praxis is submitted to the reader’s trial. Alain Mabanckou’s Verre cassé and Sami Tchak’s Hermina exemplify, indeed, the intrusions of character-narrators in a situation of invention and intervention. In Mabanckou and Tchak’s work, the fabrication of fiction does not take place ex-nihilo. The strategy consists in putting in order the intelligence of the facts that inform the diégesis by resorting to intratextuality and intertextuality. Although the self-referentiality of fiction may seem astonishing, this literary phenomenon is occurring more and more regularly. Literature is possible and readable also in / through metafiction.
Keywords : self-referentiality, diegesis, metafiction, fiction making, reader, literature, character-narrator.
Introduction
Dans les années 1970, les narratologues admettent l’importance du métalangage dans la communication littéraire, grâce notamment à Roland Barthes. Ce dernier définit en effet la critique littéraire comme un « discours sur un discours, un langage second, ou métalangage […], qui s’exerce sur un langage premier (ou langage-objet ». (C. Bisenius-Penin, 2015, p. Web). Dans le sillage narratologique, s’est développée la notion de « métadiscours » (Françoise Van Rossum-Guyon, 1979, p. 99), définie comme un discours portant sur la structuration du texte et/ ou de sa signification par le biais du narrateur. Il s’agit donc d’un procédé par lequel le locuteur explique, justifie et commente sa propre énonciation pour la rendre possible et adéquate au bénéfice du destinataire.
Autant le « métalangage » et le « métadiscours » soulignent la faculté de réflexivité du langage, le terme de métafiction, inventé par l’écrivain et critique littéraire américain William Howard Gass, en 1970, met pareillement l’accent sur l’autoréférentialité de la fiction qui se met en scène via divers procédés d’écriture. En d’autres termes, « la métafiction désigne […] un texte fictionnel qui fait référence à lui-même en insérant à l’intérieur de l’œuvre une réflexion sur le processus de composition et de réception du texte littéraire ». (M. Baillargéon, 2019, p. 34). Laurent Lepaludier (2002, p. 11) ajoute : « Toute fiction se centre nécessairement sur les processus de réflexivité et la fabrication de la fiction ». S’en suit aussi celle de Linda Hutcheon (1982, pp. 8-9) pour qui « la métafiction contemporaine intériorise un commentaire non seulement sur l’écriture du texte lui-même, mais aussi sur la lecture ».
La fiction romanesque africaine semble s’inscrire dans cette forme d’écriture autoréférentielle qui dévoile ses propres mécanismes par des références explicites. La fiction renvoie en effet à elle-même. Le texte africain, en général ludique, emprunte aux fictions d’obédiences postmodernes et induit, avec sa structure problématique et sa narration indécidable, certains effets de rupture, caractérisés par le détournement des genres et styles, et comporte souvent des éléments de métafiction. Alain Mabanckou et Sami Tchak développent si bien la tendance naturelle du récit à se fictionnaliser qu’il semble instructif de lire et d’examiner leurs œuvres. Par quels procédés l’autoréférentialité de la fiction se met-elle en scène? Autrement dit, sous quelles formes hypostatiques[27] la métafiction est-elle assimilée à un acte de fabrication de la fiction ? Sous quels critères scripturaux les procédés métafictionnels participent-ils du collège des sophistications esthétiques à cette époque contemporaine ? Dans le fond, ce procédé ne renvoie-t-il pas à une interaction entre texte et lecture ?
Vu que le texte de fiction invite à une prise de conscience critique de lui-même, l’analyse retiendra l’approche narratologique, sémiotique et pragmatique des textes. L’approche pragmatique insistera sur l’effet de lecture. Le premier axe de l’étude porte sur les diverses formalisations de la métafiction. Le deuxième et l’ultime, en revanche, interrogent les mécanismes scripturaux par lesquels le récit met en rapport la fabrication de la fiction avec des procédés hétéroclites qu’il impute légitimement à la métafiction comme interaction entre le texte et la lecture.
1. Les formes hypostatiques de la métafiction
Si de nombreux critiques adhèrent aux travaux de William Gass et soutiennent que tout texte a nécessairement une dimension métafictionnelle, il est essentiel que l’on s’interroge sur les facettes de cette réflexivité structurelle et non conjecturelle. Ce qui reviendrait à dire qu’elle se manifeste a priori dans un texte littéraire, que l’auteur en soit conscient ou non. S’il l’est, son écriture incarne les modalités de la métafictionnalité, matérialisées par le personnage-écrivain, la mise en scène de l’écriture et ses substrats et la narration métacritique.
1.1. Le personnage-narrateur, figure de l’écrivain ou la mise en abyme du travail d’écriture
Alain Mabanckou ouvre l’incipit de Verre cassé sur un personnage considéré comme figure de l’écrivain. Verre cassé est le surnom du narrateur bougon et désabusé de ce petit livre iconoclaste. Ce vieil habitué d’un bar de Pointe-Noire au Congo (ville natale de l’auteur) haut en couleurs, « Le Crédit a voyagé » (A. Mabanckou, 2005, p. 11) dans le quartier Trois-Cents, il se voit un jour assigné par son patron – répondant pour sa part au pittoresque surnom de « L’escargot entêté » – et ami, la mission de produire un journal :
Disons que le patron du bar Le Crédit a voyagé m’a remis un cahier que je dois remplir, et il croit dur comme fer que moi, Verre Cassé, je peux pondre un livre […], ainsi c’est un peu pour lui faire plaisir que je griffonne de temps à autre sans vraiment être sûr de ce que je raconte ici, mais je ne cache pas que je commence à prendre goût de [l’écriture] depuis un certain temps, […] il me pousse encore plus à l’ouvrage. (Ibidem).
Investi de la mission d’écrivain, Verre Cassé élabore le récit des aventures du Crédit a voyagé. Comme la nécessité fait loi, le narrateur ne raconte que ce qu’il croit indispensable, sinon obligatoire ; d’où l’utilisation du mode subjonctif : « il faut que j’évoque d’abord la polémique qui a suivi la naissance de ce bar, que je raconte un peu le calvaire que mon patron a vécu, en effet on a voulu qu’il pousse son dernier soupir, qu’il rédige son testament de judas ». (Idem, p. 13).
Le narrateur-écrivain raconte dans son livre que les déboires de L’escargot entêté ont commencé avec les chrétiens qui l’accusaient de réduire le nombre des fidèles les dimanches. Aussi, ils « ont mené une véritable guerre sainte » (Ibidem) en jetant « chacun leur Bible de Jérusalem » (Ibidem). Il poursuit sa narration en dénonçant le coup de force du syndicat « des cocufiés du week-end et des jours fériés » (Idem, p. 14). Ceux-ci prétendaient que leurs femmes ne préparaient plus de la bonne nourriture et ne les respectaient plus comme les épouses du temps jadis. Le Crédit a voyagé était tenu pour responsable. Verre Cassé n’occulte pas, non plus, l’action mystique des gardiens de la morale traditionnelle qui jetaient leurs gris-gris à l’entrée de l’établissement et prononçaient les paroles de malédiction sur la vie du patron du bar. Verre Cassé rapporte aussi l’action directe des groupes de casseurs payés par certains vieillards du quartier. C. E. Ehora (2018, p. 178) justifie ainsi l’activité scripturale du personnage-écrivain : « L’énonciation dans les romans [africains] est marquée à la fois par la conscience de l’acte d’écrire et le désir de “raconter”, en actualisant et animant les événements passés ».
Outre les histoires de L’escargot entêté, le narrateur éponyme a fréquemment recours à l’artifice de la scripturalité factice et s’approprie de fait le statut d’écrivain : Verre cassé retrace les récits de vies des ivrognes du bar et la sienne qu’il donne à lire. Abondammentinvoquées comme pièces à conviction, la plupart des sources de renseignement proviennent de toutes les histoires qui se racontent dans le bistrot (affabulations de comptoir) et des témoignages verbaux des éclopés de la vie. Le texte biographique s’écrit dans le prolongement direct de ces notes « de première main ». Les spécificités structurelles des textes en viennent à fonctionner comme gage de fiction, « et la biographie peut se lire comme un roman, comme une création où la vraisemblance n’est qu’un mirage supplémentaire qui s’évanouit au profit d’une motivation de pure littérarité. » (J. Wirtz, 1996, p. 58).
L’inscripteur met ainsi en abyme l’acte d’écrire dans le corps même du texte, en y insérant de nombreux récits dans le récit, que ce soit des narrations dans la narration, ou encore des récits écrits en tant que fiction dans le récit principal. L’existence de plusieurs niveaux narratifs dénote un jeu auquel les écritures moderne et postmoderne s’apparentent bien.
L’univers diégétique de Mabanckou dévoile, de texte en texte, les lois : les intrusions métafictionnelles dans Verre cassé discernent le mode de fonctionnement de la fiction. Dans Hermina, elles sont d’une présence remarquable et contribuent à fonder une dimension essentielle du texte tchakien : celle de la réflexivité et de l’endocentrisme[28]. Hermina, en effet,ne se nourrit pas tant de questions relatives à l’émigration (“esclavage” sexuel, mal du pays, chômage, etc.), aupseudo-progressisme et à l’anti-racisme à la mode chez les intellectuels de gauche. Le lecteur a davantage conscience de sa propre matière et de l’artifice du discours que de l’intrigue : « Ton roman, tu l’écris toujours ? – Oui, [je m’y mets] ». (S. Tchak, 2003, p. 12). La question posée par Hermina Martinez, le personnage éponyme, à Heberto Prada, jeune professeur de philosophie et la réponse de ce dernier invitent à considérer leur structure comme un ensemble sémiotique à interpréter. Pris individuellement, les mots « roman », « écris » et le groupe verbal « je m’y mets » appartiennent au champ lexical de l’activité d’écriture,c’est-à-dire le métier d’écrivain exercé effectivement par le narrateur dans l’œuvre. Le segment discursif fait suivre l’idée de sa répétition constante matérialisée par la présence de l’adverbe « toujours ».
Hermina est, au premier degré, le roman fictif qu’écrit Heberto, avec pour personnage principal la fille qu’il aime follement. Elle le luidéclare : « Je suis la muse, je suis ta muse. Touche mes cheveux et le chemin vers le mystère des mots te sera ouvert dans la broussaille de tes idées » (S. Tchak, 2003, p. 13). Heberto, même épris de Hermina, adopte le comportement extrême d’un écrivain, celui qui s’isole du monde pour ne se consacrer qu’à son écriture : « […] il écrivait, isolé du monde pour n’être en contact qu’avec les êtres grouillant dans son esprit, […] » (Idem, p. 12). Aussi, sa production romanesque ne se distingue pas uniquement par la primauté qu’il accorde à la forme narrative, structurelle et graphique, mais s’intéresse de même au sens. Le but est de maintenir les deux aspects de la littérature : « Mais, chaque fois, après avoir peuplé une dizaine de pages de sa menue et fière graphie, il se rendait compte que l’accumulation des mots prenait le pas sur le sens » (Idem, p. 13). Par cette prise de conscience et des aménagements littéraires, Heberto « venait d’écrire un paragraphe dont il semblait fier » (Ibidem), après avoir détruit auparavant toutes les traces de sa tentative et pris un livre pour se laisser envahir par sa puissance. S’il est démontré que les personnages-écrivains accouchent les mots, il est judicieux d’analyser aussi les « accessoires » utilisés par ces derniers pour réaliser une telle activité.
1.2. La mise en scène de l’écriture : supports et substrats
Certains artifices contribuent à la mise en scène de l’acte d’écriture et participent de la tactique métafictionnelle avec une insistance particulière sur le support écrit et l’activité « manuelle » de l’écrivain. En témoigne l’incipit de Verre cassé : « Le patron du bar Le Crédit a voyagé m’a remis un cahier [dans lequel] je dois écrire… » (A. Mabanckou, 2005, p.11). L’extrait ci-contre où L’Imprimeur s’adresse avec emphase à Verre cassé informe autant une médiation métafictionnelle :
Il paraît même que tu écris quelque chose sur les types bien de ce bar, tu écris ça dans un cahier, ça doit être ce cahier-là qui est à côté de toi, n’est-ce pas, je n’ai pas répondu, j’ai posé une main sur la page du cahier parce que le type tentait de lire mes gribouillis. (Idem, p. 63).
Ces mots reviennent, en écho, tout au long du roman Verre cassé : « [L’Escargot entêté] m’a offert un cahier de notes et un crayon en me disant, c’est ton cahier, je te l’offre, écris dedans, […] écris comme les choses te viennent, […] ». (Idem, p. 201). Même si le lecteur reste attaché à un imaginaire “traditionnel” du portrait de l’écrivain assis devant le comptoir d’un bistrot en train de rédiger manuellement ses histoires, le cahier passe pour un support fondamental. Sa redondance est frappante dans le roman de Mabanckou. Objet phare de cette métafiction, le cahier est au centre de l’intelligence narrative et participe des témoignages, portraits et mésaventures des habitués du bar Le Crédit a voyagé écrits par Verre Cassé.
D’autres mises en scène des supports d’écriture apparaissent dans Hermina. L’utilisation d’un ordinateur pour le traitement des textes ne semble pas être privilégié par le narrateur-écrivain à cause de sa désuétude. Heberto reste résolument fidèle à son carnet : « Il avait un ordinateur assez démodé, […]. Mais c’est dans un carnet qu’il tentait de coudre la vie avec le fil doré des mots ». (p.12). Le carnet sert principalement à écrire la prose, à proprement parler, et non à prendre des notes comme il est connu de tous. Les deux questions posées par Hermina à Heberto spécifient le rôle de cet objet : « – Et de quoi tu parles dans ton roman ? lui demanda Hermina. – Je veux savoir de quoi tu parles dans ton roman ». (p. 15). Le carnet tient a prioriune place importante dans le récit et devient l’objet d’une pratique quasiment obsessionnelle pour le personnage-écrivain. Heberto ne vit que pour l’écriture : « Au moins cinq heures par jour, même quand il souffrait d’affreuses migraines, penché sur son carnet, à la lumière du soleil ou d’une lampe, il [écrivait] des phrases compliquées, d’une écriture mystérieuse. » (p. 12). Le support-cahier ou le support-carnetest consommé jusqu’au bout, et le récit se termine par une sorte d’épilogue. Le narrateur peut enfin murmurer « mission terminée » (A. Mabanckou, 2005, p. 244).
La mise en scène du cahier et du carnet est utilisée par Verre cassé et Heberto pour écrire de “vrais romans”, dans une démarche qui ressemble beaucoup plus à celle d’un écrivain, reflétant ainsi le travail auctorial d’Alain Mabanckou et de Sami Tchak. Support et substrat, leur implication dans le récit définit la propriété métafictionnelle du processus d’écriture. Les textes de Mabanckou et de Tchak, comme le souligne François Gavillon (2000, p. 172), « ont un point commun essentiel, celui d’avoir pour sujet principal la question de l’écriture », symbolisée par ses supports. On reconnaît le penchant des narrateurs-écrivains pour les rappels historiques et biographiques. Les récits se plient au souci du détail et à la force de l’anecdote. Les romanciers inscrivent dans un développement fictionnel toutes leurs occurrences risibles, critiques, documentaires ou éducatives. On peut imaginer que le carnet et le cahier ont été utilisés comme espace de pré-confinement des micro-histoires avant l’étape de la publication effective. Ceci montre le lien profond entre fiction et réalité. Il paraît, de ce fait, intéressant de prendre à cœur la constitution de ces manuscrits au fur et à mesure qu’ils écrivent, prenant la place des vrais auteurs, qui s’autorisent, grâce à cette mise en abyme de l’écriture, des réflexions et commentaires.
1.3. Une narration métascripturale : une métacritique ?
Les narrateurs-écrivains d’Alain Mabanckou et Sami Tchak attirent l’attention sur le travail d’écriture. Les commentaires de Verre cassé, qu’ils soient contemporains ou non, sont sans équivoques :
[…] les gens de ce pays n’avaient pas le sens de la conservation de la mémoire, que l’époque des histoires que racontait la grand-mère grabataire était finie, que l’heure était désormais à l’écrit parce que c’est ce qui reste, la parole c’est de la fumée noire, du pipi de chat sauvage, le patron du Crédit a voyagé n’aime pas les formules toutes faites du genre « en Afrique quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle », et lorsqu’ il entend ce cliché bien développé, il est plus que vexé et lance aussitôt « ça dépend de quel vieillard, arrêtez donc vos conneries, je n’ai confiance qu’en ce qui est écrit ».( A. Mabanckou, 2005, p. 12).
En même temps qu’il semble adhérer à l’idée d’une prééminence de l’écrit sur l’oral, lequel assure une grande pérennité et rayonnement, Verre Cassé développe son credo au cours d’une longue tirade qui souligne sa conception de l’acte d’écrire et la méthode usitée pour produire du texte. Le narrateur-écrivain explique d’emblée au lecteur la façon dont il va commencer à écrire son récit et le terminer :
[…] j’écrirai comme les mots me viendraient, je commencerais maladroitement et je finirais maladroitement comme j’avais commencé, je m’en foutrais de la raison pure, de la méthode, de la phonétique, de la prose, et dans ma langue de merde ce qui se concevrait bien ne s’énoncerait pas clairement, et les mots pour le dire ne viendraient pas aisément […]. (Idem, p. 198).
Par la suite, lorsque le récit est bien « lancé », nombreuses sont les remarques sur la mise en forme du texte puis sur sa transformation en livre-objet, celui que le lecteur tient entre ses mains : « […] je voudrais surtout qu’en me lisant on se dise « c’est quoi ce bazar, ce souk […] ça commence d’ailleurs par où, ça finit par où, bordel », et je répondrais avec malice ce “bazar c’est la vie, … » (Ibidem.) La fiction littéraire de Verre Cassé n’exclut pas toute préoccupation véridictoire de sa méthode sous le simple prétexte de mettre en scène l’écriture. Sa construction fictionnelle repose sur des assertions qui tirent leur efficacité, non de la conformité avec les normes traditionnelles de la rhétorique, mais de leur propre cohésion, inhérente à l’univers dans lequel ils s’inscrivent et que, ce faisant, ils créent. Parce que les conditions de vérité ne dépendent pas là d’une méthode de vérification empirique, l’auteur de circonstance peut – plus ou moins librement, selon que la morale et la société de son temps sont ou non permissives – « fabriquer » son récit comme il s’y détermine.
C’est pourquoi, son roman se libère de la rigidité des conventions telles que les ponctuations et les majuscules en début de paragraphes ou de phrases. Verre Cassé le martèle sans ambages : « […] je veux garder ma liberté d’écrire quand je veux, quand je peux, il n’y a rien de pire que le travail forcé, j’écris aussi pour moi-même, […] » (p. 12). Les propos de l’écrivain trouvent une résonnance dans Hermina à travers le dialogue qui s’instaure entre Gombrowicz[29] et Heberto. La mise en scène de la lecture de Ferdydurke dirige la réflexion sur l’art et l’artiste. Gombrowicz livre sa conception de l’artiste à un éventuel créateur fictif. De ce dialogue, il ressort que l’art ne se réclame pas a priori du style de tel ou tel auteur. La posture conformiste rend plutôt inferieur :
Au lieu de créer des conceptions à votre vérité, vous vous parez des plumes de paon et voilà pourquoi vous restez des apprentis, toujours maladroits, toujours derrière, esclaves et imitateurs, serviteurs et admirateurs de l’Art qui vous laisse dans l’anti-chambre. (S. Tchak, 2003, p. 215).
L’imitation rime avec confinement ; elle prive l’art de sa liberté, de son pouvoir d’exprimer le beau. L’œuvre a son but en elle-même, elle n’a pas de finalité extérieure. L’esprit qu’elle exprime lui est immanent. Il n’y a pas que la philosophie et l’art qui l’exprimeraient en la contemplant comme modèle. Il faut penser l’esprit comme le contenu substantiel et immanent de l’œuvre. L’esprit est ce par quoi une œuvre a sens. Il ne suffit donc pas de recycler, voire de réécrire pour atteindre les sommets littéraires. La réécriture est ainsi battue en brèche. Vincent Simedoh (2005, http://www.ethiopiques.refer.sn) explique : « c’est l’idée que tout est question de répétition, de redite qui est remise en cause. Accepter cette idée, c’est demeurer inférieur, imitateur [et même] servile, ce qui mène à la figure du demi-artiste ». Or, à l’en croire, « on est artiste ou on ne l’est pas. Accepter l’imitation, c’est se faire illusion sur soi-même » (V. Simedoh, http://www.ethiopiques.refer.sn). Ses propos trouvent un écho dans Hermina : « […] tout cela, je le répète, n’est qu’imitation, emprunt, et reflète seulement l’illusion qu’on possède déjà un poids, une valeur ». (p. 215).
Heberto ne se prononce pas surl’art romanesque, et sa tactique ne saurait être définie. Tout, dans le dispositif romanesque fictif mis en place, concourt à simuler des réponses. Selon lui, l’acte d’écrire serait, en fin de compte, un retour sur soi. Ecrire revient à se voir en face et livrer son moi. C’est utiliser toutes sortes de moyens d’expressions existants (le style propre et le traitement que le narrateur-écrivain fait subir à la langue française, synonyme d’invention et de transmutation) pour créer une fiction dont la valeur peut se découvrir dans la singularité. Finalement, la réflexion aboutit, chez l’artiste, à cette prise de conscience où Heberto Prada, se regardant dans la glace, se dit :
Mon frère, si tu ne parviens pas à écrire, c’est parce que tu es lâche, tu n’oses pas te regarder en face. Sinon, tu es ton propre sujet. Tout ce que tu as à faire, c’est de mettre noir sur blanc l’histoire de ta vie avortée. Ecoute ! C’est simple ! Tu es un individu inutile, tu le sais, non ? Ecris-le. Pour toi, écrire, ce serait ça : te tuer d’une balle de mots dans la tête pour ensuite faire ta propre autopsie. (S. Tchak, 2003, p. 318).
En somme, écrire consiste à se réaliser soi-même. L’acte implique de regarder sa propre réalité pour mieux exprimer le monde, comme l’endosse Verre Cassé : « […] Il faut que je regarde un peu ce que j’ai déjà écrit jusqu’à présent et que je n’oublie pas de terminer mon poulet-bicyclette qui a fini par refroidir parce que j’ai vraiment pris du temps à remonter ma propre existence […] ». (A. Mabanckou, 2005, p. 203).
Le personnage, figure de l’écrivain, ne se contente pas seulement de raconter des histoires et faire des commentaires sur l’écriture. Dans cette scription originale, il use également de l’intratextualité et l’intertextualité.
2. La fabrication de la fiction et les atours de l’hétérogénéité : entre intratextualité et intertextualité
Le discours des narrateurs dans le corpus prend explicitement pour contenu des éléments variés peu homogènes qui, tous, évoquent les personnages-écrivains. En tant que procédés hétéroclites convoqués, les textes sources ont donc valeurs de documents fondateurs. En gardant ceci à l’esprit, on s’intéressera à l’abondance des références intratextuelles et intertextuelles qui caractérise l’écriture du roman au point de saturer certaines pages.
2.1. L’intratextualité comme propriété métafictionnelle : les personnages romanesques et les croisements discursifs
Selon Nathalie Limat-Letellier (1998, p. 27), l’intratextualité se produit lorsqu’ un « écrivain réutilise un motif, un fragment du texte qu’il rédige ou quand son projet rédactionnel est mis en rapport avec un ou plusieurs [micro-histoires, témoignages ou biographies] antérieurs (auto-références) ».
Le récit de vieest le fait, soit d’un témoin direct qui se contente de relater après ce qu’il a réellement vu, entendu ou connu, soit d’un narrateur qui, totalement extérieur au cadre des événements, rapporte les discours de divers témoins. Ces deux cas de figure sont sujets à variations : le témoin peut, par exemple apparaître comme un simple observateur passif, voire un protagoniste, un acteur plus ou moins actualisé au sein même de l’énoncé.
L’histoire des habitués de la buvette congolaise n’échappe pas à ce cadre théorique. Verre Cassé fait nécessairement fonction de compilator[30] en collectant des données de seconde main, pour reconstituer la vie des clients du bar. Un jour, Holden, un citoyen des États-Unis d’Amérique, vient lui aussi le supplier de consigner quelques épisodes de sa vie :
Je suis un nouveau ici, je m’appelle Holden, c’est pas juste que tu ne parles pas de moi, j’ai des choses intéressantes dans ma saloperie de vie, et je te dis que je suis le plus important de tous les gars qui viennent ici, j’ai fait l’Amérique […], dis donc, tu veux que je te raconte mon histoire ou pas. (A. Mabanckou, 2005, p. 228-230).
Verre Cassé ne veut pas l’écouter, il ne veut plus écouter personne dans ce bar, tellement « la coupe est pleine » (Idem, p. 230). Le modèle pirandellien (N. Jonard, 1997, p. 87) des « personnages en quête d’auteur » semble respecté. Mais, cette fois, l’auteur doit négocier au mieux avec ses héros, car ceux-ci, à l’image du « type aux Pampers»[31], peuvent lui retirer l’histoire qu’ils lui ont confiée. En cela, Verre Cassé n’est pas tout à fait un écrivain public. Les intrigues, tout comme ceux qui les rapportent, ne lui appartiennent pas. Il n’est pas le créateur, mais le régisseur, c’est-à-dire un commis aux écritures. Le patron du Crédit a voyagé, lui, décide de tout ; c’est lui le commanditaire :
En fait L’Escargot entêté m’avait pris un jour à part et m’avait dit d’un air de confidence «Verre Cassé, je vais t’avouer un truc qui me tracasse, en réalité je pense depuis longtemps à une chose importante, tu devrais écrire, je veux dire, écrire un livre », et lui un peu étonné a dit « un livre sur quoi », et il a répondu « un livre qui parlerait de nous[32] ici, un livre qui parlerait de cet endroit unique au monde […], ne ris pas, je suis sérieux quand je le dis, tu dois écrire, je sais que tu le peux […]. (A. Mabanckou, 2005, p. 194).
Pour parvenir à son livre, Verre Cassé ne néglige pas les bonnes vieilles recettes d’antan : unité de lieu et, d’une certaine façon, unité de temps. Il n’y a pas de doute. On voit en outre défiler, les uns après les autres, ses personnages : Le type aux Pampers, un homme au sphincter bousillé par un viol collectif survenu dans la prison où l’avait envoyé son épouse sur un motif mensonger : la pédophilie. Ensuite vient Robinette, une prostituée des plus culottées. Suivent notamment Zéro Faute, un guérisseur escroc, L’Imprimeur, un benguiste[33], Joseph, un Van Gogh nègre, La Cantatrice chauve, une vendeuse des plats chauds et le quartier, et la ville, et le pays qui, d’une manière ou d’une autre, trouvent dans le cahier tenu par Verre Cassé, un écho à leurs faits et gestes, une doléance. Grâce au procédé de l’intratextualité, les récits fragmentés de Verre Cassé prennent l’apparence, assez paradoxalement, d’une œuvre complète.
Ce fait métafictionnel vise à montrer que les histoires se créent elles-mêmes, que les personnages ont une volonté propre, et que l’écrivain n’est là que pour mettre par écrit une vérité fictionnelle. En réalité, l’auteur [Verre Cassé] se dédouane des choses qu’il a fait subir à ses personnages en insistant sur le fait que les histoires ne viennent pas entièrement de lui et qu’il ne fait que subir un devoir de vérité que lui imposent les chimères du cerveau (“figments”) dans sa tête. (M. Thevenon, 2012, p. 373).
Verre cassé est aussi riche en références intertextuelles. Elles renvoient, la plupart du temps, à des auteurs chers au narrateur.
2.2. L’intertextualité ou la bibliotexte de l’inscripteur
Gérard Genette (1982, p. 8) définit l’intertextualité,
d’une manière sans doute restrictive, par une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire, eidétiquement et le plus souvent, par la présence effective d’un texte dans un autre. Sous sa forme la plus explicite et la plus littérale, c’est la pratique traditionnelle de la citation (avec guillemets, avec ou sans référence précise); […] sous forme encore moins explicite et moins littérale, celle de l’allusion, c’est-à-dire d’un énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions […].
Jean Ricardou (1978, p. 304) a pu nommer ce système intertextuel bibliotexte ou « ensemble des textes [et titres d’œuvres] évoqués nommément dans un texte, et ainsi de suite ». Dans Hermina, Heberto cite un paragraphe d’un écrivain qu’il a lu, lequel devait l’aider à construire la figure de son personnage romanesque : « (“Comme le pêcheur d’Islande de Pierre Loti, il partait juste après s’être arraché, sans violence, aux bras de sa femme qui craignait que cette fois-ci la mer ne le gardât pour l’éternité”) ». (p. 13). Ce passage emprunté à Pierre Loti fait autorité pour le narrateur. En le rapportant, Heberto s’approprie cette fonction essentielle de la citation ; celle-ci renforce l’effet de vérité de son récit. Heberto conforte la légitimité du discours de Loti. Aussi convoque-t-il un long passage extrait de Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway :
Le vieil homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la nuque. Les taches brunes de cet inoffensif cancer sur la peau que cause la réverbération du soleil sur la mer des Tropiques marquaient ses joues ; elles couvraient presque entièrement les deux côtés de son visage. […] Mais aucune de ces entailles n’étaient récentes : elles étaient vieilles comme les érosions d’un désert sans poissons ». (S. Tchak, 2003, p. 35).
La pratique de l’intertextualité dans Verre cassé se lit dans l’énonciation de titres de romans et d’œuvres littéraires du monde entier. Marie-Claire Durant Guiziou (2006, p. 32) note à propos : « Sa toile intertextuelle accueille tous les genres, tous les courants, tous les auteurs, toutes les nationalités ». Le narrateur-écrivain incorpore à sa bibliotexte un des grands noms de la « Négritude »[34]. Des pages du roman s’autorisent une prise de conscience du narrateur, vu ses mésaventures (escroqueries des guérisseurs, déchéance accrue, etc.) : « très vite je retournais au pays natal ». (A. Mabanckou, 2005, p. 210). Ce discours renvoie, par allusion, avec une variante, au titre du célèbre recueil de poème du martiniquais Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal. Verre Cassé le confirme : « […] j’écris dans un cahier ». (Idem, p.154).
On note aussi des emprunts à certaines œuvres francophones subsahariennes telles que L’aventure ambiguë (p. 89), Trois Prétendants, un mari, (p. 96.), La grève des battù (p. 162), Jazz et vin de palme (p.183), Chants d’ombres (p. 210), La Vie et demie (p. 210), etc. La littérature américaine n’est pas en reste : l’hypertexte tisse des relations privilégiées avec American Psycho (1991) et The Catcher in the Rye (1951). African psycho de Mabanckou et le roman de Bret Easton Ellis offrent des similitudes, au niveau des titres et de la présence d’un tueur en série. Dans African psycho, le lecteur assiste aux velléités criminelles de Grégoire Nakobomayo qui possède une seule ambition : devenir un tueur en série de renom. Verre Cassé fait aussi allusion à The Catcher in the Rye grâce à Holden Caulfield qui lui demande d’écrire son histoire, parce qu’il lui confie avoir fait l’Amérique (pp. 228-230). L’universalité des sources de l’inscripteur participe donc de la fabrication de sa fiction. Ce qui n’échappe pas au procès du lecteur.
3. La métafiction, une interaction entre texte et lecture
Dans Le roman, Bernard Valette[35] (1992, p. 88) écrivait : «Le lecteur, lui-même, en tant que partie prenante dans le contrat communicationnel est au moins de façon tacite le co-énonciateur du récit qu’il (res) suscite à chaque acte de lecture ». Roger Tro Dého (2013, p. 76) s’inscrit dans la même logique que Bernard valette : « Le sens d’une œuvre littéraire n’est donc pas donné, a priori. Il est co-produit par le texte en tant que structure ou fabrique autonome de significations et par le lecteur qui l’actualise suivant des paramètres (compétences diverses, état psychologique, environnement social, etc.) qui lui sont liés ». Si ce processus d’élaboration du sens peut valoir pour tous les types de textes, le niveau de sollicitation, d’implication et, partant, de responsabilité du lecteur varie d’un type de texte à un autre. Les romans analysés sollicitent, de manière particulière, la mémoire du lecteur pour en saisir la pensée postmoderne et la permissivité discursive.
3.1. La pensée postmoderne
La métafiction est résolument liée à des ambitions de déconstruction de l’illusion référentielle et des conventions romanesques réalistes. L’entreprise est portée sur les fonts baptismaux par des penseurs du postmodernisme littéraire (William Gass, John Barth et Ronald Sukenick). Si l’on en croit Jean-François Lyotard (1979, p. 7), le postmoderne peut se définir comme « l’incrédulité à l’égard des métarécits ».
Plus spécifiquement, dans la pensée postmoderne, la métafiction s’attaque à l’illusion référentielle du langage en mettant en lumière le processus de la mise en récit. Ladouceur Moana (2011, p. 16) écrit justement : « La métafiction postmoderniste naît d’un sentiment toujours grandissant que le monde n’est pas fait de vérités éternelles, mais plutôt d’une succession de constructions, d’artifices et de structures temporaires. »
À partir des propos de la critique, on se rend compte que la fiction littéraire dans Verre cassé et Hermina se détache foncièrement des formes symptomatiques d’une perception ordonnée de la réalité (narrateur omniscient, intrigue, séquence chronologique, genres littéraires définis, etc.) pour réprouver enfin la forme romanesque.
À l’évidence, le jeu sur la prétendue transparence de l’illusion référentielle est une manifestation de ce questionnement. La métafiction utilise les procédés de création de cette illusion dans le seul but de dévoiler le fonctionnement de la fiction. Il est vrai qu’on peut dire que tout texte contient certaines des stratégies que l’on assimile aujourd’hui au genre de la métafiction. Mais, le caractère postmoderne de ce phénomène dans Verre cassé et Hermina réside plus dans le degré d’affichage de telles stratégies que dans la simple réflexivité. À ce niveau, on peut réellement parler de la métafiction postmoderne. Ces stratégies sont en effet poussées à l’extrême ; la dimension auto-référentielle du texte de fiction et son rôle de médiation culturelle peuvent difficilement passer inaperçus. Dans les romans inscrits au corpus, ils s’accomplissent par le biais d’intrusion des narrateurs, de fictions enchâssées, d’inclusion du lecteur dans la narration, de commentaires métafictionnels, d’une mobilisation massive des réseaux intratextuel et intertextuel. Les stratégies narratives ont comme effet de souligner que le texte n’est pas une fenêtre transparente donnant sur le monde, mais le produit des actes complexes.
3. 2. Une esthétique du rédhibitoire
La mention explicite des mots dénotatifs comme « roman » (S. Tchak, 2003, p. 12-15), « livre » (A. Mabanckou, 2005, p. 11), « ouvrage » (Idem, p. 12), « écrivain » (Idem, p.195), « littérature » (Idem, p. 208), qui revient à plusieurs reprises dans les œuvres rappelle un jeu métafictionnel. Elle soulève des questions relatives à l’ontologie de l’auteur et des personnages de fiction. Plus un auteur se met en scène dans un roman, moins il semble exister hors de cette frontière. Mabanckou et Tchak utilisent trois procédés : auctorialisation du personnage soumis à une auto-scénarisation, la narratologisation du personnage et l’encyclopédisation du personnage. En effet, leurs personnages-héros jouent le rôle d’écrivains, narrent des histoires, font des commentaires sur la littérature et les écrivains. Ces mécanismes métafictionnels de type explicite attirent l’attention sur le fait que l’écriture, particulièrement le roman, loin d’être purement référentiel, s’ouvre à toutes les remises en cause, à toutes les désacralisations qui en informent l’intelligence.
La fictionnalisation dans Verre cassé et Hermina rappelle la citation de Jean Ricardou selon laquelle « le roman n’est désormais plus l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture ». (J. Faerber, 2016, https://diacritik.com). Le roman d’aujourd’hui, dont le corpus est représentatif, fait de la recherche de l’écriture sa matière même, sa venue à la phrase, car plus rien ne va de soi, récit comme langage, appelant, incidemment, à une refondation du langage du récit lui-même.
Le corps du récit de Mabanckou et Tchak, marqué par le déconstructivisme des pratiques métafictionnelles, devient au fil de la lecture l’objet de certitude. Le texte est le domaine de l’auteur ; le droit lui revient donc d’en saper les conventions autant qu’il le veut. Si les pratiques littéraires traditionnelles se refusent généralement à ce genre de jeu, les postmodernistes, Mabanckou et Tchak à leur suite, y prennent grand plaisir ; en témoignent les extraits suivants : « je note dans le cahier mes histoires, mes impressions en vrac, et parfois aussi je le fais pour mon propre plaisir » (A. Mabanckou, 2005, p. 201) ou « Une nuit, il retrouva le gout d’écrire et traça une phrase dans son nouveau carnet ». (S. Tchak, 2003, p. 14). La posture qui s’en dégage semble correspondre à ce que Vincent Trovato (2012, p. 27) écrit :
Ça déconstruit la culture, les racines, les idées, moi, la société, l’écriture. Déconstruire ce n’est pas démolir, c’est pour refuser de se réfugier dans les simples évidences, les systèmes, la pensée en rond. Pour « dé-penser » la vie, « re-penser » la vie.
La lecture de Verre cassé et Hermina pousse l’analyste à croire que Mabanckou et Tchak revendiquent un réinvestissement de l’écriture romanesque africaine.
Conclusion
Verre cassé et Hermina sont régis par un mécanisme métafictionnel. Tous les textes font une place à l’écriture, aux cahiers, carnets, livres et ouvrages. Les personnages-héros sont érigés en romanciers ou en scribes qui enregistrent, consignent, traduisent, sauvegardent. Les héros de Mabanckou et Tchak collectent, récupèrent des lectures, des titres d’œuvres et auteurs qui servent à leurs collages romanesques. Ils sont surtout des figures hypostasiées (réalité en soi) d’Alain Mabanckou et Sami Tchak. Leur écriture est fondamentalement endocentrique. Elle est d’abord commentaire sur elle-même par le biais de l’intratextualité et l’intertextualité.
Au-delà de ce pouvoir créatif accordé aux personnages, elle emprunte au jeu narratif sa dimension d’auto-détermination, qu’elle asservit à la satire d’une Afrique drôle et déliquescente.
Références bibliographiques
AILLARGEON Mercédès, 2019, Le personnel est politique : médias, esthétique et politique de l’autofiction chez Christine Angot, Chloé Delaume et Nelly Arcan, West Lafayette, Indiana, Purdue Université Press.
BARTHES Roland, 1970, « L’ancienne Rhétorique. Aide-mémoire. », Communications 16, pp.172-223.
BISENIUS-PENIN Carole, 2015,« Métafiction » dans Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le lexique socius, URL:http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/158-metafiction, page consultée le 21 janvier 2020.
CHEVRIER Jacques, 1999, Littératures d’Afrique noire de langue française, Paris, Nathan.
DURANT Guiziou Marie-Claire, 2006, « L’effet palimpseste dans Verre cassé d’Alain Mabanckou », Logosphère 2, pp. 31-48.
EHORA Effoh Clément, 2018, « Métafiction et autofiction chez Henri Lopes : l’écrivain au miroir de ses textes », in Horizons Littéraires, Revue du Centre de Recherche sur la Critique Littéraire Africaine / N° 2, Décembre, pp. 174-190.
FAERBER Johan, 2016, « Jean Ricardou (1932-2016) : L’aventurier du Nouveau Roman », https : ⁄ ⁄ diacritik.com.
GAVILLON François, 2000, « Endogénéité et métafiction », Paris, Presses universitaires de Rennes, http://www.openedition.org/6540, pp. 171-178.
GENETTE Gérard,1982, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
HUTCHEON Linda, 1982, « Introduction », « L’autoreprésentation : le texte et ses miroirs », Texte, n°1, pp. 8-14.
JONARD Norbert,1997, « Situation du théâtre de Pirandello », dans Introduction au théâtre de Luigi Pirandello, Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Écrivains », URL : https://www.cairn.info/introduction-au-theatre-de-luigi-pirandello-9782130484271-page-87.htm, pp. 87-110.
LE LITTRE, Dictionnaire de la langue française, https : ⁄ ⁄ www.littre.org, page consultée le 23 janvier 2020.
LEPALUDIER Laurent, 2002, Métatextualité et métafiction, théorie et analyses, Paris, Presses Universitaires de France.
LIMAT-LETELLIER Nathalie,1998, « Historique du concept d’intertextualité » in L’intertextualité, Annales littéraires de l’université de Franche-Comté 637, Nathalie Limat-Letellier, Marie Miguet-Ollagnier. Les Belles Lettres, pp. 17-64.
LYOTARD Jean-François, 1979, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Minuit.
MABANCKOU Alain, 2005, Verre cassé, Paris, Seuil.
MOANA Ladouceur, 2011, Voyage au(x) bout(s) du paradoxe métafiction, écriture de soi et traumatisme dans a Heartbreaking Work of Staggerlng Genius deDaveEggers, in Mémoire de maîtrise en études littéraires, Université du Québec à Montréal, mars.
RICARDOU Jean, 1978, Nouveaux problèmes du roman, Paris, Seuil.
SIMEDOH Vincent, 2005, « Sami Tchak, Hermina: l’intertextualité ou une réflexion sur l’art romanesque », Ethiopiques, revue négro-africaine de littérature et de philosophie, n° 75, 2eme semestre, [en ligne] (http://www.ethiopiques.refer.sn), dernière consultation le samedi 04 avril 2020.
TCHAK Sami, 2003, Hermina, Paris, Gallimard.
THEVENON Marie, 2012, Les ”avatars du moi” chez Paul Auster : autofiction et métafiction dans les romans de la maturité.Littératures. Université de Grenoble.
TRO Dého Roger, 2012, « Ecriture et médias chez Emmanuel Dongala : entre intermédialité et médialiture » in Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines, N°20, Tome 2 décembre, pp.63-79.
TROVATO Vincent, 2012, Je suis un autre. L’écrivain et son double, Paris, L’Harmattan.
VAN Rossum-Guyon Françoise, 1979, « Des nécessités d’une digression : sur une figure du métadiscours chez Balzac », Revue des sciences humaines, Paris-Lille, tome XLVII, juillet-septembre, n°175, pp. 99-110.
WIRTZ Jean, 1996, Métadiscours et déceptivité, Paris, Peter Lang.
PRATIQUES SORCELLAIRES ET DEVOIR DE JUSTICE EN AFRIQUE NOIRE
Franck KOUADIO
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La justice est souvent confrontée à des situations à l’égard desquelles l’application des principes juridiques et rationnels devient une véritable gageure. Pareilles situations, imputées dans la plupart des cas à la sorcellerie, génèrent des conflits qui se déportent le plus souvent devant des tribunaux villageois ou civils, là où les populations elles-mêmes ne se font pas justice dans des exécutions sommaires extrajudiciaires. L’institution judiciaire remplira au mieux sa mission si et seulement si elle fonde ses jugements sur le devoir constant d’objectivité, de vérité et de justice.
Mots-clés : Conflits, Justice, Objectivité, Sorcellerie, Vérité.
Abstract :
Justice is often confronted with situations in which the application of legal and rational principles becomes a real challenge. Such situations, attributed in most cases to witchcraft, generate conflicts which are most often transferred to village or civil courts, where the populations themselves do not do justice in extrajudicial summary executions. The judiciary will best fulfill its mission if and only if it bases its judgments on the constant duty of objectivity, truth and justice.
Keywords : Conflicts, Justice, Objectivity, Truth, Witchcraft.
Introduction
Mystère, ésotérisme, irrationalisme sont entre autres les visages de la sorcellerie. Elle semble se dévoiler sous ces traits. Mais, ces apparences sous lesquelles la sorcellerie paraît révéler son être deviennent plutôt des masques qui la voilent. Les moyens d’accès à la signification ontologique de ce concept se muent en obstacles. La compréhension de la sorcellerie se solde par un échec avant même d’avoir commencé. Elle s’avère être une incompréhension, ainsi que le suggère cette remarque d’E. Rosny (2006, p. 10) :
Le manque de définition de la sorcellerie dans le droit, et le manque de preuves objectives pour soutenir l’accusation, nous posent (…) de graves problèmes, car on ne peut pas condamner des gens sur des impressions, ou chacun consciemment ou non peut fabuler à sa manière.
Rendre intelligible un phénomène qui n’a d’être qu’en étant indéfinissable et inintelligible s’assimile à une entreprise presqu’oiseuse. Au reste, faut-il désespérer de la poursuivre, alors qu’au phénomène sorcellaire, est le plus souvent associée et imputée la controversée question du mal ?
La sorcellerie figure au nombre des causes suprasensibles pour expliquer les maux incompréhensibles, rationnellement. Ce procédé ne fait pas l’unanimité eu égard à son caractère présomptueux et non-scientifique. Il conduit à des conflits d’ordre juridique au sujet de la détermination de la culpabilité ou non, des individus désignés comme étant, par leurs pratiques sorcellaires, à l’origine du mal subi par des tiers. Comment l’Afrique noire peut-elle sortir de l’ornière des conflits liés à l’imputation sorcellaire ? Du point de vue du droit, la culpabilité peut être attestée seulement par les faits saisis comme preuves scientifiques rationnellement recevables. Il semble alors que l’institution judiciaire peut remplir convenablement sa mission si elle fonde ses jugements sur le devoir constant d’objectivité scientifique et de vérité. Mais, comment la rationalité judiciaire peut-elle satisfaire à l’exigence d’objectivité, de vérité et de justice alors que la sorcellerie, source des conflits, semble manifestement relever du mystère ? La résolution de cette question exige une analyse préalable du concept de sorcellerie. Qu’est-ce donc que la sorcellerie ?
1. La compréhension de la sorcellerie
1.1. La sorcellerie, un phénomène irrationnel
La sorcellerie serait le symbole du démon, du diable ou de « Satan » dans la perspective religieuse, et convoquée devant le tribunal fidéiste, clérical et divin. Cultes d’exorcisation, prières de délivrance, messes de purification, deviennent, c’est connu, les nouveaux modes d’expression de l’efficacité du combat religieux contre les forces ténébreuses et maléfiques incarnées par les présumés sorciers. Les églises se développent à foison dans l’univers africain sous le prétexte de l’omniprésence du mal que se plairaient à répandre les supposés partisans du diable que seraient les sorciers. E. Rosny (2006, p. 32-34) croit savoir d’où pourrait venir le problème. Pour lui, en effet :
La bible considère le pouvoir de nuire comme le mal et le péché. (…) Aujourd’hui, sous l’effet de la crise économique, sociale et politique, et sans doute aussi à cause de l’influence de certaines sectes à visions apocalyptiques, on dirait que (…) Satan triompherait de Dieu, et par voie de conséquence, la sorcellerie maléfique dominerait les hommes.
L’omniprésence du mal et du malheur suffirait, à en croire la logique religieuse, à justifier l’existence de la sorcellerie, coupable de la dérive misanthrope qui mine la société africaine. Les fidèles religieux sont ainsi sévèrement mis en garde contre ceux des leurs qui, n’ayant pas accepté « la bonne nouvelle », seraient en réalité de véritables sorciers, sources des échecs scolaires ou professionnels et des déboires existentiels dans le cercle familial ou dans l’espace social. Leurs relations deviennent timides et s’effritent progressivement, laissant ainsi place à la méfiance, à la suspicion, à la stigmatisation, au mépris, à l’abandon, à l’indifférence et à d’autres sentiments du même ordre. Dans ces églises, les fidèles sont endoctrinés de telle sorte qu’en eux, naît une méfiance antipathique à l’égard de leurs proches sorciers. Ils vont jusqu’à vouloir la mort de ces derniers, mais sans raison valable, si l’on observe avec une grille de lecture objective et critique.
La croyance ou la foi religieuse, c’est la ferme assurance des choses qu’on espère et la démonstration de celles qu’on ne voit pas (Hébreux, 2004, p. 1704). La foi est donc basée sur la croyance, qui se distingue du savoir. La croyance s’appuie sur l’espérance d’un avenir meilleur et glorieux, alors que le savoir se fonde sur la certitude, la clarté et la véracité. Le savoir se dit des faits en tant qu’ils sont objectivables, raisonnables. Or la croyance, elle, est dans l’espérance d’un hypothétique futur bienheureux dont l’homme se convainc qu’il adviendra. Si l’objet du savoir est objectivable, celui de la croyance demeure inconnaissable. La croyance, en tant qu’attitude propre à la religion, fait de cette dernière une instance servant à juguler l’angoisse existentielle de l’homme en lui donnant la possibilité d’espérer le salut.
La distinction entre le savoir et la foi est faite par E. Kant dans la Critique de la raison pure. Le domaine du savoir chez Kant est représenté par l’expérience alors que celui de la croyance se situe en dehors de toute expérience possible. Kant admet par là qu’il existe des objets susceptibles d’être connus et d’autres non. Les premiers (les phénomènes) appartiennent à l’expérience possible alors que les seconds (les noumènes) transcendent toute expérience (Kant, 2012, p. 226-227). Si la seconde catégorie d’objets fonde la morale et la religion, la première, quant à elle, permet de construire la science. Confondre les objets de la religion avec ceux de la science et prétendre produire à partir d’eux un certain savoir qui aurait l’allure d’un savoir certain, c’est courir le risque de donner dans l’illégitimité et l’illusionnisme. Il faut éviter de tels excès. C’est certainement le sens de cette remarque de Kant (2012, p. 24) : « Je dus donc abolir le savoir afin d’obtenir une place pour la croyance ». La religion n’a donc pas fondamentalement une visée noétique. Comment pourrait-elle alors identifier, reconnaître et arraisonner la sorcellerie, phénomène qui n’a d’être que par le mystère qui le recouvre ?
La spiritualité religieuse prétend avoir une science des pratiques mystiques, dont la sorcellerie serait la figure la plus pernicieuse. Or, à son évocation, le concept de sorcellerie résonne comme un pur illusionnisme, une prestidigitation dont la seule finalité reste la mystification. Le réseau conceptuel de la sorcellerie nous la fait voir sous les traits d’une fabrique de l’imagination. Il est donc difficile de soutenir que la religion, en tant que pratique fondée sur la croyance ou la foi, est capable de produire un savoir objectif de la sorcellerie, entendue comme pratique mystique de nature métaphysique.
La sorcellerie devient le principe explicatif de tout ce qui porte atteinte à la vie et à l’élan vital. Il s’agit d’une attitude schizophrène des sociétés africaines, incapables de se saisir de leurs problèmes avec responsabilité et d’y trouver une explication scientifique et rationnelle, juridiquement recevable. La conscience traditionnelle africaine veut toujours trouver une origine mystique aux phénomènes physiques réels. La réalité, pour être comprise et justifiée, est systématiquement reliée à une cause déterminante qui serait la sorcellerie. « Malgré l’essor urbain, la scolarisation et les religions comme l’islam et le christianisme en Afrique, la sorcellerie reste, plus que jamais, implantée dans les mentalités et les traditions » (L. Coakley, 2015, p. 2).
C’est à croire que ni l’éveil éducatif ni l’initiation et l’élévation à la spiritualité religieuse ne se montrent aujourd’hui efficaces pour juguler définitivement la croyance en la sorcellerie et les problèmes qu’elle engendre. Au contraire, la religion est dévoyée pour servir de cadre expiatoire et coercitif de pratiques sorcellaires, suscitant à l’occasion, des aveux sous l’effet trop souvent de manipulations psychologiques et spirituelles. Le jeu trouble des églises éveillées ou évangéliques consiste à déterminer si le sorcier doit être cherché du côté des parents paternels ou de celui des parents maternels. Cette sorcellerie familiale s’inscrit dans la longue durée, parfois sur plusieurs générations, avec pour conséquence, l’accumulation des tensions au sein de la famille, l’interprétation rétrospective d’infortunes passées, la répétition du malheur. Ces tensions se déportent, en s’exacerbant, dans les églises dites éveillées, comme le souligne, à juste titre, J. Bonhomme (2012, p. 12-13) :
Les églises éveillées offrent une scène rituelle où rejouer ou déjouer la violence sorcellaire. (…) La diabolisation des sorciers contribue à faire sortir la sorcellerie du cadre familial en l’érigeant en une menace globale ».
La croyance en la sorcellerie découle de l’omniprésence du mal. « Que le monde soit mauvais, c’est une plainte aussi vieille que l’histoire (…), aussi ancienne que le plus ancien de tous les poèmes, je veux dire la religion des prêtres », fait remarquer Kant, dans La religion dans les limites de la simple raison (E. Kant, 1986, p. 29). Le mal inspire la peur et engendre une société de méfiance. Pareille société est aux antipodes du dynamisme naturel qui caractérise les sociétés soucieuses du développement endogène. Ayant la certitude que leurs malheurs sont d’origine sorcellaire, les hommes se déchargent de toute responsabilité dans ce qui arrive. Aimant à croire que des causes surnaturelles peuvent influer positivement ou négativement sur le cours de leur existence, ils se réfugient dans la torpeur et l’inaction, tirant ainsi un trait sur leur responsabilité dans ce qui se produit.
La sorcellerie colle à la vie de tous les jours (…) Nous sommes agacés de devoir encore la prendre en compte mais elle se rappelle tous les jours à notre attention de façon lancinante, peut-être même davantage aujourd’hui qu’hier (E. Rosny, 2006, p. 18).
Pour E. Rosny (2006, p. 24) : « Ce que l’on appelle couramment “sorcellerie” fait partie, en réalité, d’un système, vieux comme le monde qui comporte un versant maléfique et un versant bénéfique ». Ainsi, en Côte d’Ivoire, depuis le sacre de l’équipe nationale de football en 1992, un mythe s’est créé dans la conscience collective au sujet de l’implication du village d’Akradio dans cette victoire à la Coupe d’Afrique des Nations. Les dirigeants de la fédération ivoirienne de football d’alors, auraient sollicité les sorciers de ce village et obtenu leur bénédiction, ce qui aurait rapporté à la Côte d’Ivoire le trophée continental. Suivant cette logique, il aurait fallu entretenir ce lien avec ledit village pour que « les éléphants de Côte d’Ivoire » continuassent de glaner des lauriers internationaux. Mais, cela n’ayant pas été fait, il s’en est suivi une série de défaites humiliantes, notamment les deux finales perdues de 2006 et 2012, ainsi que l’élimination en demi-finale en 2008. Comme on peut le lire dans un numéro de l’Intelligent d’Abidjan :
L’ancien portier des éléphants, (…) Alain Gouaméné, révèle que les ‘’sorciers de Dabou’’ ont apporté leur touche mystique pour la victoire des pachydermes. ‘’Je suis africain, je sais ce qui se passe aussi dans mon village. (…) Ils nous disaient par moment qu’ils avaient déjà fêté la coupe à Dabou avant de venir (R. Dibi, 2013, n°788).
On s’accorde à dire aujourd’hui que le football est une science. Il existe tout un appareillage de sciences autour de ce sport. Est-il concevable que dans une nation moderne comme la Côte d’Ivoire, l’opinion s’en remette à de telles irrationalités pour expliquer des événements dont la cause ne peut venir que de la réalité ?
Que l’équipe nationale échoue ou gagne, cela relève de la responsabilité des acteurs de ce sport à assumer leur fonction avec professionnalisme. Il y a tout simplement un déni de la réalité et une acceptation collective de l’irresponsabilité, à vouloir s’en remettre à la sorcellerie dans le cas d’espèce. L’irresponsabilité est également manifeste chaque fois qu’au lieu de privilégier l’effort et la qualité dans le travail, la bonne gouvernance dans la gestion des ressources, la compétitivité dans les modes de production, les populations cèdent à la facilité en prenant le raccourci de la sorcellerie pour justifier leur inaction et leur incompétence. La croyance en la sorcellerie est une attitude pessimiste et irresponsable qui veut trouver un fondement irrationnel à la réalité vécue. À travers une telle croyance, la sorcellerie fait irruption dans le réel avec la prétention d’expliquer ce qui s’y produit. La survenance d’un malheur tel que la mort d’un proche est ainsi susceptible de conduire à en rechercher l’origine dans le mystère de la sorcellerie. Or, la mort peut avoir des origines diverses, notamment la maladie, les accidents, les empoisonnements, les meurtres, phénomènes que la médecine légale est aujourd’hui capable d’élucider grâce au progrès de la science et des technologies. Seulement, en dépit de ces avancées, lorsqu’une personne, ne présentant physiquement aucun signe de maladie, décède, les supputations vont bon train, désignant illico presto la sorcellerie comme seule explication possible à cette disparition étrange.
Cette attitude est irresponsable en raison de ce qu’aucun effort de compréhension rationnelle du phénomène mortuaire n’est fait préalablement. Les populations ne se demandent pas du tout si le défunt souffrait d’une pathologie latente ou s’il a fait l’objet d’un arrêt cardiaque suite à un accident vasculaire cérébral. Le sorcier ou la sorcière de la famille porte l’entière responsabilité de cette mort subite et a priori insolite. La personne désignée comme telle est très souvent livrée à la vindicte populaire et peut faire l’objet d’un lynchage collectif, après un jugement expéditif. Incapable de la défendre, sa famille assiste, impuissante, à cette parodie de justice. Il s’agit là d’attitudes tout autant sidérantes et révoltantes qui réussissent piètrement à voiler la mauvaise foi qui les porte.
La mauvaise foi est une attitude de la conscience tendant à se masquer la vérité. Elle représente un certain art de former des concepts contradictoires, mais qui rassemblent en eux une certaine idée et la négation de cette dernière. Dans la mauvaise foi, la conscience se ment à elle-même, feignant d’ignorer la vérité, tout en se la voilant. La mauvaise foi est manifeste lorsqu’ayant perdu un proche, les membres d’une famille accusent un tiers d’avoir commandité cette mort en sorcellerie. À l’évidence, le défunt était malade et toutes leurs tentatives pour le guérir se sont révélées insuffisantes et inefficaces. Finalement, ils se réfugient dans la sorcellerie pour décharger leur conscience du poids de cette mort qui aurait pu être évitée s’ils s’y étaient pris autrement. La sorcellerie devient ainsi la cause improbable de la mort, là où, à la vérité, par avarice, par manque de solidarité, par négligence ou par indigence, des populations ont laissé mourir un parent ou un proche. « Elle est un argument commode valorisant qui donne du moi une image positive en face du mal accompli » (T. Boa, 2010, p. 89). En la brandissant pour expliquer le décès, l’avarice voile le mal qu’il a fait pour n’avoir pas été solidaire dans une situation mortelle. L’indigent, qui postule la sorcellerie, camouffle sa pauvreté en prétextant que la maladie dont le défunt souffrait était incurable. Tous deux se rendent coupables de mauvaise foi. Leurs arguments sont des fadaises. Toutefois, cela n’empêche pas les Africains de croire en la réalité supposée de la sorcellerie. La croyance en la sorcellerie est une attitude irrationnelle, pessimiste et irresponsable, bâtie sur un sol illusoire qui se donne des airs de réalité.
1.2. La sorcellerie, une pratique sociale réellement vécue
La croyance commune fait de la sorcellerie une réalité sociale qui a des incidences majeures sur la vie de la communauté et des individus. La sorcellerie ne serait pas que négative, mais en règle générale, l’œuvre des sorciers malfaisants l’emporterait sur les actions bienfaitrices des bons sorciers. En témoigne l’expansion du mal à tous les niveaux de la société.
De nos jours, en Afrique, mais surtout en Afrique noire, le sorcier est défini comme un être humain mu par des affects négatifs et antisociaux que sont la haine, la jalousie, le ressentiment, l’envie, l’égoïsme (T. Boa, 2010, p. 36).
Le sorcier aurait pour objectif essentiel de détruire, de dominer ou de voler. En tant que pratique maléfique, la sorcellerie viserait la suprématie du mal sur le bien, toute chose qui ne manque pas de troubler l’ordre public (L. Kiatezua, 2009, p. 14-15). Convaincu qu’il y a des sorciers partout, surtout dans les villages africains, on est porté à les démasquer, quel qu’en soit le prix. Il s’ouvre ainsi une spirale dangereuse d’identification de sorciers. Les Africains ont tendance à croire et à soutenir l’idée que l’âge a quelque chose à voir avec la sorcellerie. Plus une personne est âgé en Afrique, plus elle est susceptible d’être taxé de sorcier. Les personnes du troisième âge ont la triste et sinistre réputation de sorcières en raison de leurs conditions de vie, comme le souligne T. Boa (2010, p. 89-90) :
Les vieux et les vieilles sont les accusés par excellence. Affaiblies par l’âge, incapables de se défendre, (…) ces personnes sont (…) accusées de vouloir régénérer leurs forces vitales en mangeant le double des plus jeunes.
Vivant le plus souvent à la campagne, sans aucune source de revenu, elles sont presque dans le dénuement. Leur misère en fait des parias, exclus de la vie de la communauté. Elles sont suspectées en permanence d’être les auteurs des souffrances de la société et accusées systématiquement dès qu’un malheur survient. La société recourt pour ce faire à des mystiques, incarnés en pays « agni »[36] par la komian.
La komian est un être humain initié au culte des génies. (…) Elle joue le rôle de voyant, de devin ou d’intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible, entre les vivants et la communauté des esprits des morts. Elle protège la communauté des assauts des individus malveillants et contre les forces du mal (T. Boa, 2010, p. 50).
La komian est capable, par ses pouvoirs, de démasquer un sorcier et de le révéler à toute la communauté. Ayant une fonction protectrice, elle constitue un rempart pour sa communauté, contre les tentatives malfaisantes de déstabilisation et de rupture de l’ordre cosmique et du lien social. La société traditionnelle africaine, notamment la société « agni », à laquelle appartient la komian, fonctionne sur la base du respect de l’ordre et de l’harmonie. Tout est fait pour maintenir l’équilibre. C’est pourquoi, le sorcier, vu comme un anticonformiste, un misanthrope antisocial, friand du mal, de la désunion et du chaos, est démasqué, à peine jugé sous « l’arbre à palabre » et condamné à être un marginal.
Le phénomène sorcellaire en pays « agni » n’est pas circonscrit aux adultes. Tout le monde peut être sorcier, peu importe l’âge. Même les nouveau-nés et les enfants ne sont pas épargnés par cette chasse aux sorcières orchestrée par la société. Ainsi, naître avec une déformation physique (handicap moteur ou verbal) ou avec une difformité morphologique et/ou faciale, peut donner des raisons de croire qu’un tel enfant possède des pouvoirs mystiques susceptibles d’en faire un sorcier. Pareil enfant sera éliminé précocement pour empêcher ses supposés pouvoirs de s’enraciner avec l’âge. Mais si d’aventure ses parents le dérobaient à la vigilance des autorités pour le laisser grandir, cet enfant devient la risée de tous. Et sa famille, qui a osé braver l’interdit en laissant germer et mûrir « une aussi mauvaise semence », en paiera le prix fort, soit par le bannissement d’un ou des deux parents, soit par le paiement d’une amende pour « conjurer le mauvais sort ».
La société est dans une logique d’épuration qui vise à promouvoir des canons esthétiques en matière de constitution physique, mais aussi d’entretenir des mythes à l’effet d’exercer sur la conscience collective une influence dissuasive. Elle met en place un système idéologique d’interprétation par la sorcellerie qui s’alimente de mystifications. « En somme, elle devient un lieu herméneutique visant à assurer l’autorité gérontocratique, l’autorité politique, l’autorité du clan, l’autorité spirituelle communautaire et l’autorité maritale » (T. Boa, 2010, p. 85).
Dans une telle société, se rendre coupable de sorcellerie est synonyme de damnation. La damnation prend le plus souvent l’allure d’une déshumanisation de l’accusé, qui est privé du droit de se défendre. Le sorcier, lorsqu’il est reconnu comme tel, se voit infliger le même sort qu’aurait subi sa victime, souvent même pire que cela. Il est livré en pâture, en raison de sa supposée culpabilité. Dans les situations de mort insolite, le sorcier fait office d’accompagnateur du défunt. Il est enseveli vivant sous le cercueil mortuaire dans l’indifférence la plus totale. Au mieux, celui-ci est battu à sang et laissé dans un piteux état. Saisi par la société comme étant un « mangeur d’âme », le sorcier a peu de chance de s’en sortir indemne tant il est réduit en minorité. Même soutenu par sa famille et des proches, il lui est quasiment impossible de prouver son innocence dans la mesure où cette option lui est rarement offerte.
Du simple soupçon à l’exposition en public en passant par la délation, la machine judiciaire populaire atteint sa vitesse de croisière, et les chances de lui faire entendre raison s’amenuisent elles-aussi. Les rares occasions où les accusés ont pu bénéficier de la présomption d’innocence et ont pu se pourvoir en cassation devant des instances extérieures à leur communauté, ils ont pu être reconnus non-coupables. Si l’imputation sorcellaire a la violence pour elle, elle résiste cependant très peu à l’épreuve de la preuve. En réalité, fait remarquer à juste raison (J. Bonhomme, 2012, p. 2) : « les violences contre les sorciers sont considérées légitimes pour autant qu’elles répondent à des agressions » prétendument réelles et injustes.
La réalité des crimes imputés au sorcier pourrait s’expliquer par le fait que celui-ci incarne la jalousie, le mépris de l’autre, l’antihumanisme, la misanthropie. La jalousie est l’expression d’un dépit, celui de ne pas obtenir ou posséder ce qu’un autre obtient ou possède : la richesse, les succès, la gloire, les talents. Elle peut conduire au mépris, qui est le fait de juger une personne indigne d’estime, d’égard, d’attention. Or, qu’est-ce que l’humanisme, sinon l’amour, l’empathie, l’estime et l’intérêt portés à l’espèce humaine tout entière et à chaque être humain pris individuellement ?
Celui qui jalouse et méprise ne saurait être un humain. Il s’agit au contraire d’un antihumaniste, qui manifeste par là-même la preuve de sa misanthropie. Si le sorcier supprime des vies humaines, ce ne peut être qu’en raison de sa haine pour le genre humain, haine qui le conduirait à chosifier ou animaliser ses victimes avant de les consommer. Or le misanthrope est animé de la même haine. L’imputation sorcellaire est une attitude antihumaniste portée à banaliser et à détruire la vie. Elle corrompt et détruit la réalité dans sa prétention à faire de l’existence supposée de la sorcellerie, un élément structurant fondamentalement les rapports sociaux et intersubjectifs. Il convient alors de sortir de l’ornière des crises consécutives à la croyance sorcellaire et à l’imputation sorcellaire par une application rigoureuse de la raison et de la justice.
2. La rationalité judiciaire et la sorcellerie
2.1. La critique rationnelle de la sorcellerie
La globalité et surtout la nocivité du phénomène de la sorcellerie interpellent partout en Afrique, singulièrement « le juge » et surtout l’État (E. Rosny, 2006, p. 21). La sorcellerie doit sa persistance à un mauvais usage de la tradition, qui la perpétue de génération en génération. Il pèse encore sur la conscience africaine la charge d’un héritage traditionnel perverti et instrumentalisé, qu’elle a de la peine à adapter aux réalités sans cesse mouvantes du monde contemporain. Tel justifiera son refus de contribuer au développement de son espace villageois à cause de la menace sorcellaire tandis que tel autre l’indexera comme la seule coupable de son infortune, de sa misère, de son infécondité. L’étendu et la gravité des chefs d’accusation à l’encontre de la sorcellerie, et partant des sorciers, donnent parfois l’impression que les Africains, surtout certains intellectuels, ont perdu leur subjectivité et leur raison. Ils seraient en ce sens des spectateurs de leur propre vie et de leur destin, impérialement contrôlés par les sorciers. Il s’agit d’une démission de ces intellectuels, attitude du reste, inintelligente, qui laisse nos sociétés dans la crédulité, la passivité, l’ignorance, la perte de sens et l’obscurcissement de l’horizon.
Le développement, entendu comme progrès moral, intellectuel et matériel suivis de l’amélioration des conditions de vie des hommes, passe par la certitude du savoir scientifique. La connaissance scientifique, soutenue par le progrès moral, facilitent l’accès au développement. Dans cette perspective, la croyance et tout ce qu’elle charrie de superstitieux, telle la sorcellerie, est hors-jeu. Confronté à la problématique de la sorcellerie, c’est à la raison, à la science qu’il faut recourir, et non à l’émotion, à la croyance, au mysticisme. Si la sorcellerie est réputée être mystérieuse, elle doit pouvoir être arraisonnée et rationalisée. On comprendrait ainsi qu’elle n’est qu’un système symbolique affabulatoire et qu’y croire encore est aussi indigne qu’irresponsable.
Nourrir et perpétuer l’illusion de l’existence de la sorcellerie et de ses effets sur la réalité humaine, cela n’est rien moins qu’une acceptation coupable de la médiocrité que l’Africain préfère assez honteusement à la culture de l’excellence. Nul ne récuse la valeur et l’importance de la tradition dans la construction identitaire des individus et des peuples. Cela dit, la tradition n’est qu’un prétexte, une assise où chacun doit savoir enraciner ses fondations et puiser les ressources nécessaires à son développement personnel. Elle n’est pas tout, mais seulement un appui. C’est donc une erreur, voire une faute que de la saisir de manière dogmatique et naïve sans en entreprendre la contextualisation et l’adaptation par une critique rigoureuse et sérieuse.
La tradition regorge sans doute de richesses, mais la sorcellerie n’en est pas une. À s’y accrocher comme à sa bouée, c’est renoncer à sa raison, à sa dignité d’homme, à son entière responsabilité dans la construction de son histoire. La sorcellerie est sans doute mystérieuse, mais la critique doit la dépouiller de ce voile qui la recouvre pour qu’enfin les hommes se saisissent de leur liberté. La critique de la sorcellerie est une désaliénation de l’homme qui y croit et qui en fait le principe déterminant de ses actes. Le mythe sorcier doit cesser, et le mystère qui le recouvre, disparaître à jamais. Le voile de l’omerta doit succomber à la critique des pouvoirs dominants qui se nourrissent de la mystification pour susciter et entretenir la peur et la passivité chez les peuples.
L’Europe a eu ses sorciers. Mais elle a réussi à s’en défaire. Les Lumières ont fortement contribué à cette émancipation de la rationalité européenne. Cette espèce de mort intellectuelle dont a souffert ce continent pendant plus d’un millénaire a fini par céder le pas à une résurrection par la renaissance de la conscience européenne et par sa maturation dans l’Aufklärung et laModernité. Au fond, ce dont l’Afrique doit se libérer aujourd’hui, ce n’est pas tant des prétendus sorciers que de cette mentalité paresseuse, incompétente et irresponsable qui alourdit sa marche. Il porte un carcan hérissé d’épines tout aussi vénéneuses que paralysantes, qui l’inhibent et freinent son intention de progrès, son attention au progrès, sa tension vers le progrès.
La croyance à la sorcellerie fait exister la sorcellerie, et par effet d’entraînement, il s’installe une conscience malheureuse et schizophrène, sujette à toutes les formes de manipulation. La conscience africaine beigne dans cette enfance de la raison qu’est la sorcellerie, en tant qu’attitude superstitieuse. La croyance en la sorcellerie constitue un blocage spirituel et intellectuel dans l’émancipation de soi. S’en libérer nécessite un acte de courage et d’audace doublé d’une attitude de bonne foi. La bonne foi est une disposition de la raison à toujours privilégier la vérité quel qu’en soit le prix.
2.2. Le triomphe de la vérité dans la quête de justice
L’Afrique noire est entrée dans la modernité et l’époque contemporaine, sans véritablement en intégrer les valeurs et les principes structurants. Le taux élevé d’analphabétisme et la persistance pernicieuse des pratiques traditionnelles voulues par les pouvoirs dominants freinent l’élan vers la culture des valeurs de la modernité. Les grandes mutations qui se sont produites à l’issu de la colonisation semblent n’avoir eu aucun effet positif sur la mentalité des noirs, donnant ainsi l’étrange impression qu’ils refusent d’opérer leur renaissance. Ce constat est d’autant plus ahurissant et estomaquant que l’intelligentsia africaine résiste, selon T. Boa, au vent de ce nécessaire changement de mentalité qui, par effet d’entraînement, sortirait toute la société de l’ornière de la médiocrité incarnée par la croyance à la sorcellerie :
Aujourd’hui, les élites africaines qui auraient dû être les défenseurs de la modernité étonnent par leurs agissements quelquefois semblables à ceux de l’ignorant analphabète. Elles retournent à un stade d’ignorance qu’elles étaient censées avoir déjà franchi grâce à l’instruction (T. Boa, 2010, p. 104).
Le problème réside dans l’incapacité à s’assumer comme sujet responsable. Il y a des conflits sorciers en raison de ce que l’opinion commune supplante les consciences individuelles. Le venin de la croyance commune circulant dans l’organisme de l’individu, intellectuel ou analphabète, celui-ci peine à activer sa faculté de juger, pourtant seule capable de le délivrer de cette servitude. Incapable de penser, de réfléchir et de juger par lui-même, pareil individu tombera dans les excès, par une propension indue à se substituer à l’autorité suprême en qualité de législateur, magistrat et garant de l’ordre social.
Or, la configuration actuelle des sociétés africaines fait de l’État le détenteur de l’autorité suprême. Il lui revient la responsabilité de légiférer, de juger les crimes suivant cette législation et de faire exécuter ses décisions afin de garantir un climat social harmonieux et apaisé. Tout cela vise à construire l’unité nationale autour de valeurs cardinales telles que le pardon, le vivre-ensemble, la paix, le droit, la vérité, la justice, etc.
Seulement, il y a curieusement un déni de l’État africain et de l’autorité judiciaire, fondé sur une crise de confiance de la part de certaines populations. Ce déni entraîne une insubordination généralisée et fait chanceler les droits de l’homme tout en occasionnant de virulents troubles qui perturbent l’ordre social. Le règlement des crises liées à l’imputation sorcellaire, la radicalité des accusations contre les présumés coupables et l’intransigeance des sentences se font dans un déni total des lois en vigueur au sein de l’appareil judiciaire étatique. Le traitement réservé aux accusés de sorcellerie constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux : la présomption d’innocence, le droit à la défense, la possibilité de faire appel devant les juridictions compétentes en la matière, le droit à la vie et à la socialité, etc. Alors que l’accusation se dit victime du présumé crime sorcellaire, c’est l’accusé qui fait les frais d’une justice populaire expéditive sans que soient convaincantes les preuves qui l’accusent. T. Boa fustige cette parodie de justice en ces termes : « À tous ces individus traités de sorciers, les coutumes infligent finalement la peine de mort, dans un État qui l’a pourtant interdite par l’effet de l’article 2 in fine de la constitution du 1er août 2000 » (T. Boa, 2010, p. 111-112).
Ces jugements expéditifs et extrajudiciaires mis au compte des présumées pratiques sorcières portent atteinte à la dignité des personnes inculpées. Leur persistance constitue une menace à prendre au sérieux par l’institution judiciaire légale pour que règne l’État de droit. La législation nationale, fondée sur le droit positif, ne saurait cohabiter avec les pratiques coutumières à la légitimité et à l’impartialité douteuses. Le droit positif doit se substituer à la justice populaire, dominée par l’émotion. Prétendre que la nature mystique de la sorcellerie rend incompétente la justice républicaine est un faux prétexte. De même, s’en tenir à des aveux obtenus dans des conditions très peu recommandables pour disqualifier la justice, c’est désobéir à l’État.
À vouloir se faire justice eux-mêmes en condamnant des victimes expiatoires accusées de sorcellerie, les tribunaux populaires, mais aussi certaines organisations religieuses défient la loi, sèment le désordre et finissent par se rendre coupables d’injustice. L’État doit, par le biais des intellectuels et des professionnels de la justice et des défenseurs des Droits de l’Homme, s’attaquer à la croyance irrationnelle à la sorcellerie par des moyens scientifiques. Il doit reprendre le contrôle en matière de justice pour que disparaisse cette fausse impression qu’il y aurait deux justices. La garantie des Droits de l’Homme et des libertés individuelles tient à cet impératif.
L’impératif judiciaire est vital à la paix sociale. Or, rechercher la justice, c’est aussi se mettre en quête de la vérité. La quête de justice va de pair avec le souci de vérité. La recherche de la vérité doit ainsi être le leitmotiv de l’appareil judiciaire républicain. Une accusation sans motif valable reste mensongère et calomnieuse. En matière de justice, la preuve est déterminante, et cette preuve doit être basée sur des faits objectifs.
Pour juger les conflits sorcellaires, il importe de privilégier la voie de la vérité par une enquête judiciaire, qui va savoir trouver les liens nécessaires entre l’objet de l’accusation et les causes qui l’ont produit, entre l’acte d’accusation et l’accusé, et ce, conformément au principe de causalité. La culpabilité et la responsabilité du mis en cause doivent être établies de manière indubitable, sans parti pris, mais rien que par l’éloquence des preuves passées au crible de la raison. La rationalité judiciaire doit se saisir du fait sorcellaire pour en établir la consistance ou la vacuité. La recherche de la justice est bien un effort pour établir la preuve de la culpabilité de l’accusé et non pour lui faire subir une épreuve dégradante et déshumanisante. Il s’agit de prouver scientifiquement et non d’éprouver arbitrairement en intimidant pour susciter de faux-aveux. Seule la loi permet de déterminer la culpabilité ou l’innocence d’une personne. Ses caractères objectif, nécessaire et impersonnel en font un instrument fiable pour établir la justice dans le règlement des conflits liés à la sorcellerie.
Prétendre établir la justice par des pratiques occultes à caractère religieux telles que l’exorcisme, la mortification, la flagellation, ou par un système judiciaire qui n’a que la parodie pour elle, est inquiétant dans un continent soucieux de l’état de droit. Cela constitue une dérive sociale que l’autorité judiciaire républicaine se doit de combattre par une application raisonnée de la législation en vigueur. L’application de la loi, qui se double d’un souci permanent de vérité, sera d’autant plus appréciée qu’elle réussira chaque fois à faire triompher le droit dans sa fulgurance extatique. La force du droit et non le droit de la force, la justice et l’équité, en lieu et place de l’arbitraire ; tels doivent être les soucis permanents de l’autorité judiciaire.
La conscience de l’Africain porte encore les stigmates d’une ère révolue, et les résidus de cette influence se donnent à voir dans la croyance en la sorcellerie. Il en est encore à se convaincre de l’omniprésence du mal et du diable à travers la figure du sorcier. Sa conscience est troublée et tourmentée par l’illusion malheureuse d’une exposition mortelle aux flèches meurtrières et assassines de la pratique sorcière. Il est nécessaire, pour bâtir les progrès social, économique et moral du continent encore en friche, de se délier des chaînes de l’illusion de la croyance en la sorcellerie.
Demeurer dans cette attitude, c’est perpétuer l’obscurantisme, le pessimisme, la méfiance, la haine, etc., c’est également inhiber les forces vivifiantes présentes en soi. Il faut se désaliéner de cette illusion paralysante et liberticide pour appréhender la vie avec optimisme, perspectivisme et sérénité. Dans cette optique, si le droit positif doit suppléer la justice populaire, la science doit préalablement prendre le pas sur la croyance, ou à tout le moins, l’éclairer. Autrement dit, les intellectuels doivent pleinement jouer leur rôle d’éveilleurs de consciences. Ils doivent, avec le concours de l’État, éduquer la société à se délier de la croyance en la sorcellerie. Tant que les intellectuels, de même que les juges et les religieux, seront guidés par une croyance non encore éclairée par la lumière de la raison critique, eux-mêmes se révèleront incompétents devant les imputations sorcellaires et même s’ils tentent de trancher ce qui relève de ce domaine, leur verdict sera teinté de subjectivité et donc d’illégitimité.
Conclusion
La sorcellerie relève du mystère. Ainsi, à ausculter les faits prétendument sorcellaires avec la lumière de la rationalité scientifique et critique, on réalise que c’est à partir de la réalité qu’elle est générée et saisie comme phénomène réellement vécu. La sorcellerie est une tentative d’explication de la réalité par des causes ou des fondements mystiques et mystérieux. Or dans les domaines du mystique et du mystérieux, la rationalité judiciaire, à l’instar de la foi religieuse, est incapable d’opérer avec objectivité. Le devoir de justice commande donc de s’en tenir aux faits, c’est-à-dire à une causalité réelle pour comprendre les phénomènes et juguler le problème du mal, au lieu de donner dans l’illusion de la croyance sorcellaire. Car, selon E. Kant (1986, p. 31) : « Le fondement du mal ne peut se trouver en aucun objet déterminant l’arbitre par une inclination, ni dans aucun penchant naturel, mais seulement dans une règle que l’arbitre se donne à lui-même pour l’usage de sa liberté, c’est-à-dire dans une maxime ». Autrement dit, l’imputation criminelle doit être fondée sur la preuve rationnelle que l’accusé a agi en toute liberté et non sur la croyance en une détermination mystique de la sorcellerie. L’Afrique noire gagnerait ainsi à s’approprier les instruments de la raison pour non seulement trancher avec la plus grande impartialité les conflits que l’invocation sorcellaire engendre, mais également extirper des consciences individuelles les résidus nocifs de la croyance en la sorcellerie.
Références bibliographiques
BOA Thiémélé Ramsès, 2010, La sorcellerie n’existe pas, Abidjan, Les Éditions du CERAP.
BONHOMME Julien, 2012, « D’une violence l’autre. Sorcellerie, blindage et lynchage au Gabon », In B. Martinelli, J. Bouju (éd.), Sorcellerie et violence en Afrique, Karthala, p. 259-279./https://halshs.archives-ouverte.fr/halsshs-00801517.
COAKLEY Laura, 2015, Impact de la sorcellerie en Afrique francophone subsaharienne : des femmes agissantes dans les nouvelles de Florent Couao-Zotti et d’Éveline Mankou, Ontario.
DIBI Raymond, 2013, « Succès des Éléphants à la CAN 1992/21 ans après-Alain Gouaméné fait des révélations sur les hommes d’Akradio », In L’intelligent d’Abidjan, n°788. https://news.abidjan.net.
HÉBREUX, 2004, « Nouveau testament », In La Bible, TOB.
KANT Emmanuel, 2012, Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, PUF.
KANT Emmanuel, 1986, La religion dans les limites de la simple raison, Œuvres philosophiques III, Paris, Gallimard, nrf.
KIATEZUA Lubanzadio Luyaluka, 2009, Vaincre la sorcellerie en Afrique, Paris, L’Harmattan.
ROSNY Éric de (dir.), 2006, Justice et sorcellerie. Colloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005), Paris, éd. Carthala.
QUÊTE DU SENS DANS L’ÉCRITURE POÉTIQUE DE JULES LAFORGUE
N’guessan Antoine KOUADIO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La poésie de Jules Laforgue est marquée par un brassage de tons, de rythme et de métriques variées. Cette caractéristique résulte d’une écriture subordonnée à la vue, à l’ouïe et à ses connaissances antérieures. Dans ses complaintes, le poète met en exergue, la tonalité lyrique qui affiche sa conception de la femme et de l’amour. Aussi fait-il mention du repère temporel pour traduire les acceptions des différents cycles de sa vie et donner une signification à sa thématique.
Mots clés : Brassage, Écriture, Femme, Signification, Temps, Tonalité lyrique.
Abstract :
The poetry of Jules Laforgue is marked by a mix of tones, rhythm and varied metrics. This characteristic results from a writing subordinate to sight, hearing and its prior knowledge. In his complaints, the poet highlights, the lyrical tone that displays his conception of woman and love. So he mentions the time frame to translate the meanings of the different cycles of his life and give meaning to his theme.
Keywords : Brewing, Complaint, Woman, Meaning, Time, Lyrical tone.
Introduction
La poésie est un langage différent, qui obéit à des règles qui lui sont propres. Elle exprime par moment, la réalité en ce qu’elle la dépeint au plus près, pour mieux la dénoncer et la faire comprendre au lecteur. Elle lui offre un miroir qui lui permet de réfléchir au sujet de la réalité dans ce qu’elle a de plus saisissant, de plus beau et même révoltant. Elle permet également de projeter un nouvel éclairage sur les faits de la société. Le poète devient, ainsi, un créateur, renouant avec l’étymologie de la poésie, du grec ‘’poieîn’’ qui signifie « créateur, fabricant », « artisan ». Le poète est donc créateur d’un monde original fait de rapprochement de choses réelles que lui seul peut percevoir. Pour cette raison, il utilise des images poétiques qui naissent de ces deux réalités. Plus ces rapports sont éloignés et justes, plus les images sont fortes et ont une puissance émotive et évocatrice. Alors, dans l’optique de trouver une signification à ces rapprochements, le poète s’adonne à la création poétique. Cette fonction créatrice du poète auréolée de la quête du sens de sa production motive le sujet suivant : « Quête du sens dans l’écriture poétique de Jules Laforgue ».
Par cette étude, il est question de mettre en exergue l’originalité et la quête de sens dans la poésie de J. Laforgue. Alors il importe de savoir : comment se manifeste cette quête de sens à travers l’écriture poétique chez J. Laforgue ? Mieux, comment cette écriture poétique, qui valorise la femme, débouche-t-elle sur la signification de l’œuvre ? Par ailleurs, quel sens donne-t-il au repère temporel ? Pour mener à bien une telle entreprise, la stylistique et la sémiotique sont les deux méthodes d’approche qui aident au décryptage du sujet. Ainsi, « la stylistique qui est à la fois une méthode et une pratique, c’est-à-dire une discipline » (G. Molinié, 2011, p. 9), sera une aide précieuse dans le décodage des textes. Il en est de même pour la sémiotique qui « explore la portée significative vers l’extérieur-la significativité- d’un système sémiologique donné : le langage.» (G. Molinié, Op. cit., p. 10). Quant à la conduite de ce travail, elle tient en trois phases : la première partie met en évidence la manifestation sémantique de l’écriture de J. Laforgue. La deuxième partie porte sur la conception poétique de la femme et de l’amour. Quant à la troisième partie, elle concerne l’expression du repère temporel.
1. L’écriture poétique pour la manifestation sémantique
La question de l’écriture poétique dans sa manifestation prend en comme aussi bien la perception lyrique de la parole que de l’intertextualité. Dans la rhétorique classique, la poésie lyrique est définie par l’interruption de tout récit :
Tant que l’action marche dans le Drame ou dans l’épopée, la poésie est épique ou dramatique ; dès qu’elle s’arrête, et qu’elle ne peint que la seule situation de l’âme, le pure sentiment qu’elle éprouve, elle est lyrique : il ne s’agit que de lui donner la forme qui lui convient pour être mis en chant. (Abbe Batteux, 1746, p. 243).
Cette affirmation nettement perceptible rappelle réellement l’origine directe de la parole poétique : le chant. En effet, par le chant, la voix et plus généralement le corps s’imbriquent directement dans la mise en scène du « je ». L’élan d’un sujet lyrique, dont les caractéristiques sont à la fois négatives et valorisantes sur le plan esthétique (évidence d’une qualité), dont la présence dispense de toute définition et travaille à hausser le niveau d’énonciation à travers les missions que le poète assigne à ses œuvres écrites, est évident.
Ainsi, la quête du sens est au premier chef sans doute, celle qui aspire à comprendre les destins individuels ou collectifs dans la tourmente de toute société humaine de son temps. Cette quête de sens ne saurait donc se limiter à l’opposition de « la poésie pure » ou de la « poésie engagée ». Cet acte poétique est une autre manière de penser le temps, d’interroger l’historicité des consciences et de leurs émotions. Comme le notait Marc Fumaroli (1997) :
la poésie n’a pas besoin de s’engager politiquement pour être politique (…) Si toute grande poésie est politique, on peut dire très exactement qu’elle l’est par définition, puisqu’elle cherche pour la cité un fondement dans la vérité du cœur, gagée et regagnée par l’intégrité du langage.
Par ailleurs, l’une des caractéristiques de la poésie lyrique de J. Laforgue se fonde sur la réécriture, la reprise et la variation par le truchement de la réalité qui peut engendrer l’éclatement du style et du ton. Pour cette raison, cette poésie se fonde aussi sur les sens du poète : la vue et l’ouïe.
1.1. Une écriture lyrique subordonnée à la vue et à l’ouïe
Dans l’écriture poétique de J. Laforgue, l’on observe les mélanges des tons, des textes, des mètres, des rythmes. Ils ont pour fonction de poser des questions d’identité dans la parole. Philippe Hamon dans un article arrive à la conclusion suivante sur la vue et l’ouï parce que dans la poésie la notion la disposition typographique et la sonorité :
Ce texte polyphonique est-il assumé par une quelconque voix autorisée d’auteur unique, y va-t-il une source unique à cette énonciation ? La réponse est dans ce texte : ‘’Et je me sens ayant pour cible/ Adopté la vie impossible / De moins en moins localisé !’’. Les cinq actants de l’aire de jeu ironique (l’ironisant, la cible, le complice, le gardien de la loi, le naïf) sont ici insituables. L’ironie en régime lyrique moderne, c’est sans doute cela : une délocalisation de la voix. (Philippe Hamon, 1996, p. 57).
Cette délocalisation est opérée chez Laforgue dans la redistribution des instances énonciatives : le chant de la poésie n’est plus réductible à des personnes inscrites. Il s’entend dans les effets de dialogue obtenus par l’opposition des plans structuraux, stylistiques aussi bien que sémantiques et linguistiques. La tentative de déterminer l’énonciation de J. Laforgue peut se résumer par la proposition suivante empruntée à D. Rabaté :
L’énonciation lyrique comme totalisation de postures énonciatives mouvantes est la place, le lieu d’inscription d’un type d’expérience qui trouvent à se configurer alors qu’elles débordent tout sujet, d’expériences qui arrivent bien encore à une subjectivité qui n’est plus un sujet au sens où le poète exercerait sur elles sa maîtrise. (1996, p. 68-69).
Ainsi l’énonciation lyrique, dans les complaintes, décline une série de possibles discursifs et stylistiques, de l’ironie à la naïveté assumée, de la parodie et de la déception. Partant de ce fait, la configuration générale est, précisément, ce qui continue à chanter quand toutes les possibilités de faire entendre des voix individuelles ont échoué. Alors, si le poème peut souffrir quelquefois de n’être pas pur chant, il bénéficie cependant de l’espace de la page de son encadrement, de visibilité. Il est donc nécessaire de regarder cet espace avant d’entamer toute lecture linéaire. Entre ses ‘’grandes marges de silence’’, comme disait Eluard, « on interroge donc sa disposition, l’image qu’il produit, le sens créé par sa densité ou son aération par la façon dont le poète peut rassembler ou disperser l’écrit ». La matérialité du texte poétique produit donc ce que constitue la sensibilité du lecteur grâce aux mots qui mettent en relief les reflets réciproques. Ce fait est évident dans les calligrammes, mais cette dimension fondamentale n’en est pas moins présente dans chaque poème, et n’est pas l’apanage de la modernité poétique.
Le dispositif figural c’est-à-dire une figure graphique, en effet, ou encore les éclats de syntaxe tirent profit de la typographie du rythme visuel et respiratoire, de l’écriture. Même quand il ne tend pas à une mimesis, les dispositifs graphique et spatial d’une page contribuent à la construction du sens, en donnant des indications de registres, ou en rivalisant avec l’art abstrait. Plus subtilement, le jeu de rimes se donne à voir autant qu’à entendre. Dans ce contexte, s’inscrit l’extrait du poème suivant :
C’est, sur un coup qui, raide, émerge
D’une fraise empesée idem
Une face imberbe au cold-cream
Un air d’hydrocéphale asperge.
Les yeux sont noyés de l’opium
De l’indulgence universelle
La bouche clownesque ensorcèle
Comme un singulier géranium
Bouche qui va du trou sans bonde
Glacialement désopilé
Au transcendantal en-allé
Du souris vain de la Joconde.(…) (J. Laforgue, 2000, p. 256).
Avec des strophes en quatrains, écrits en vers réguliers car tous en octosyllabes, ce poème est un pantoum. Les rimes disposées de la manière suivante : (abba) sont embrassées. Elles traduisent l’état d’âme du personnage qui est la résultante de son portrait physique : « cou raide, face imberbe, air hydrocéphale, yeux noyés de l’opium et bouche clownesque ». On peut donc retenir que ce personnage est rêveur, étourdi et égaré. Cet état d’âme du personnage est mis en exergue par l’emploi d’adjectifs qualificatifs épithètes : « face imberbe », « bouche clownesque », attributs : « les yeux sont noyés ». Aussi, est-il comparé à un singulier géranium.
En somme, le sujet de l’énonciation qui se lit en toute transparence dans le texte poétique est dérivé de sa propre subjectivité qui dissimule derrière l’artifice ornemental (prosodie, métrique, rhétorique) la vraie nature de son dire et de son faire. Le « je » de la tradition lyrique est, avant tout un signe, un élément d’un code. C’est cet « indice de personne » (E. Benveniste, 1974, p. 82) que la lecture des items grammaticaux invite à chercher ailleurs que dans les occurrences nominales. La poétique de J. Laforgue semble prendre appui sur ce fait et met en œuvre une parole qu’il voue délibérément à l’éclatement à travers le dialogue ou l’invitation d’autres textes dans les tiens.
1.2. L’intertextualité : une quête du sens
L’intertextualité adoptée par Laforgue lui confère une modernité. En effet, l’intertexte dont il s’agit est soit ouvertement, soit au moyen d’un code parfaitement accessible au lecteur attentif. Ainsi, l’intertextualité est mieux appréhendée toute comme les sources, car l’important est dans la transformation plus que dans l’emprunt. Inscrits dans cette optique, les textes de l’œuvre poétique les complaintes sont riches en liens intertextuels, allant de l’antiquité aux œuvres contemporaines, prenant la forme d’allusion et d’épigraphe, ou bien s’inscrivant dans de tissus textuel tel un palimpseste de quelques modernes ou décadents , ou encore faisant écho aux chansons de rues.
En effet, « la complainte des débats mélancoliques et littéraire» « met en exergue une citation extraite de Corinne ou l’Italie de Mlle de Staël que J. Laforgue avait lu et relu en 1882. Et dès la publication des complaintes, il projetait une moralité légendaire. Mais le sujet de cette pièce pourrait être la source de sa méditation sur une idylle de Böcklin, Soir de printemps, dont il rendit compte dans ses critiques d’art. Il la décrit ainsi, en y mêlant ses préoccupations du moment »: (Hubert de Phalèse, 2000, p. 86).
Sur le talus d’une prairie de velours vert naïvement émaillée de fleurettes rouges, blanches, violettes et jaunes, est assis une sorte de troubadour en pourpoint et en bottes à l’écuyère qui accorde sa guitare en regardant sa compagne , une Corinne moderne vêtue en mousseline blanche (…) apporte à gouter à deux bébés en rose qui cueillent des fleurs ; à droite , un fleuve bordé de superbe arbres aux troncs blancs (…) ; entre deux de ces arbres, une figure d’homme, en redingote, les mains derrière le dos, regarde mélancoliquement couler le fleuve dans l’ombre du soir. .. » (J. Laforgue, 2000, p. 316).
La préoccupation du poète dans cet extrait est de décrire tout ce qui se passe dans cet espace géographique. Il s’agit bien sûr des actions des personnages masculins et féminins dans ce lieu. Cette description participe à la quête de sens que poursuit le poète à travers ses écrits.
Dans cette même perspective pourrait s’inscrire les allusions à Charles Baudelaire qui sont aussi fréquentes dans l’œuvre de Laforgue : « Deux semaines errabundes, / En tout, sans que mon Ange Gardien me réponde », (J. Laforgue, 1979, p. 56), qui évoquent la tonalité générale des Fleurs du Mal, et aussi le titre d’un poème de la section spleen et idéal. On peut également se rendre compte des réminiscences baudelairiennes dans le troisième vers de la complainte « Litanies de mon Sacré-Cœur » : « Mon cœur est une urne où j’ai mis certains défunts » (J. Laforgue, 2000, p. 144), qui présente d’évidentes similitudes avec ces vers du ‘’Mauvais moine’’ : « Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite. Depuis l’éternité je parcours et j’habite ».
On pourrait aussi de manière légitime rapprocher la complainte « de la bonne Défunte » et « à une passante », ou celui entre les derniers vers de la complainte « Du temps et de sa commère l’Espace » : « Nuls à tout, sauf aux rares mystiques éclaires
Des élus, nous restons les deux miroirs d’éther
Réfléchissant, jusqu’à la mort de ces Mystères
Leurs nuits que l’Amour distrait de fleurs éphémères » (J. Laforgue, 1981, p. 138)
et « la mort des amants » :
« Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux,
Un soir fait de rose et de bleu mystique (…) » (C. Baudelaire, 2005, p. 205).
Dans ces deux extraits, il est mis en évidence la vie éternelle des amants après la mort physique sur la terre. Au-delà de cette analogie entre J. Laforgue et certains poètes, il reste toujours original. Il adopte des vers libres par rapport à la modernité poétique. Et sa poésie donne la latitude au lecteur de contempler la réalité en l’éloignant des habitudes de perception grâce à un langage poétique hautement symbolique. Paradoxalement, elle peut par conséquent faire rapprocher du réel grâce à sa relation privilégiée des choses. Cependant, ce langage poétique tend finalement non pas à exprimer le réel, mais bien à le transfigurer, à le métamorphoser pour en faire un objet poétique. L’intertextualité paraît ainsi un moyen de quête de signification pour sa poésie. Et cette préoccupation constitue une originalité qui ne réside pas dans une mise à l’écart, sur le plan thématique et linguistique, de tout ce qui pourrait être commun. Mais il s’agit en revanche, « d’une opération inédite, de récupération et de revalorisation du déjà dit » (Alissa Le Blanc, 2016, p. 73). Pour ce faire, le poète Laforgue fait une approche particulière du thème de l’amour à travers la quête du sens de la femme et de l’amour.
2. La conception poétique de la femme et de l’amour
Dès l’aube de la poésie de langue française, l’ambition des troubadours et des trouvères a pu ainsi se définir : si l’amour y est présenté comme une raison de vivre et le sens même de la vie, c’est en raison de la transposition esthétique et éthique qu’il est sensé engendrer.
Pas de canso sans amour ni d’amour sans canso, quand le raffinement du sentiment transparaît dans le culte de la femme. L’ascèse conduisant à la joie, cet idéal d’incandescence intérieure est fondée sur un travail complexe de frustration et de sublimation du désir, qui se fond et confond d’emblée avec l’écriture. Pour y atteindre, l’art des troubadours propose une idéalisation et une généralisation de tous les traits anonymes, et toute singularité effacée dans la gloire de la forme. (éduscol, 2013, p. 13).
Il s’agit, à travers cet extrait, de donner la raison de la dépendance du poète à l’être aimé. Cette préoccupation fait de l’amour une valeur qui est souvent associée à la poésie au point que leur articulation paraît une évidence. D’où les variations dans une quête de forme poétique bâtie autant qu’elle reflète à travers les figures de styles à partir des matériaux prédéterminés pour décrire le corps de la femme qui a été créé par Dieu par nécessité.
2.1. Le portrait de la femme
Pour J. Laforgue comme A. Schopenhauer, la femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes, ou plus exactement « un ‘’mammifère à chignon’’, un ‘’fétiche’’ qu’il faut absoudre car Dieu se sert d’elle pour tromper des hommes.» (Hubert de Phalèse, 2000, p. 90). Pour cette raison, le poète ne dresse jamais un portrait tout entier tant désiré, plutôt quelques rapides esquisses qui se font tant au niveau physique que moral. Sur le plan physique, qu’il s’agisse du visage, des membres, ou des organes, ces portraits sont pour le poète souvent en voie d’annihilation, presque ‘’décorporés’’, ou comme le laisse entendre J. Kristeva (1983) « un ‘je’’ envahi par le cadavre. »
Pour les visages, chez le poète, plus précisément concernant la bouche, il met en évidence quelques occurrences des lèvres gourmandes et sensuelles :
Pour lécher ses lèvres sucrées
Nous barbouiller le corps de fruits
Et pourtant, le béni grand bol de lait de ferme
Que me serait un baiser sur sa bouche ferme ! (J. Laforgue, 1981, p. 150).
Mais qu’on ne s’y trompe pas, même les lèvres tendues du petit dieu Pan Tanagra sont transies jusqu’au trépas. Ainsi se révèlent les fonctions assignées aux lèvres de la femme, source et objet de l’amour. Outre la bouche, les yeux tiennent sans conteste une place de choix dans certaines complaintes. Les yeux que décrit J. Laforgue peuvent certes briller d’une clarté mystique en disant à Notre Dame de Soir : « De vrais yeux m’ont dit : au revoir ! » (J. Laforgue, Op. cit., p. 60). Le poète insinue qu’à la différence de ces yeux humains, il existe des regards divins, tels que des regards incarnés. Toutefois, on trouve aussi des yeux plus canoniques et plus poétiques : « yeux gais », « yeux chauds, lointains ou gais » (J. Laforgue, Op. cit., p. 94.) Ou encore conformes à l’idéal de pureté de la jeune fille laforguienne : « Berthe aux sages yeux de lilas. Qui priait Dieu que je revisse » (J. Laforgue, Op. cit., p. 123).
Contrairement à l’ensemble de complaintes, il y a dans ‘’la complainte de l’époux outragé’’ un regard familier, affectueux : « Afin qu’à peine un prétexte te reste. De froncer tes chers sourcils » (J. Laforgue Op. cit., p. 96). Plus étranges sont les insinuations de ces « cils » dont les calices vont se clore après avoir vu les yeux subir un étrange traitement. Avec d’autres regards, on trouve la lune et les landes, qui pourraient laisser espérer quelques échanges de coups d’œil fervents fascinés dans les paysages propices au rêve. Mais fidèle à son esprit décadent et morbide, J. Laforgue est aussi attiré par les yeux « mortels » : « tes yeux se font mortels, mais ton destin m’appelle ». Ce qui, dans « la complainte de Lord Pierrot », pourrait être un instant magique, Pierrot se changeant en cygne pour aimer Léda, dévie vers une vision digne des métamorphoses du vampire :
Jusqu’à ce que tournent tes yeux vitreux
Que tu grelottes en rires affreux (J. Laforgue, 2000, p. 105).
Excepté le visage, les autres parties du corps féminin sont mentionnées dans les complaintes du recueil du poète. Ainsi, les bras du fiancé ‘’de la complainte des formalités nuptiales’’ sont loyaux, alors que ceux des jeunes filles de bonnes familles des quartiers aisés doivent être pudiquement croisés sur leurs seins plats : « sur nos seins nuls croisons nos bras ». Ce vers met en exergue l’état des seins de ces jeunes filles à travers l’emploi de l’épithète « nuls ». Par ailleurs, quand le poète fait état de ses membres, c’est à dessein car il veut mettre en évidence la fébrilité : « je frisonne de tous mes membres » Malgré cet état de fait, le poète ne fantasme pas sur les seins triomphants : « remarquez que les femmes qui ont une poitrine exorbitante sont très imperturbables et même arrogantes » (J. Laforgue, Op. cit., p. 147). Telle une peinture, la poésie de J. Laforgue fait état des parties du corps féminin qui peuvent être appréciées ou comprises par chaque lecteur.
Pour le portrait moral de ces femmes, le poète procède par un ensemble de questions :
Ces enfants, à quoi rêvent-elles ?
A Roland le preux ? à l’idéal ? à la broderie ?
De la dentelle ? (J. Laforgue, 1979, p. 68).
Ces questions sont d’un passant qui les adresse aux femmes qui jouent du piano dans les quartiers aisés. Apparemment, leur portrait moral issu de ces questions semble négatif. Ces femmes sont futiles, comme ces dames « aigries par des questions de préséance », dont l’une vous demande de l’aider à chercher sa bague, « un souvenir d’AMOUR, dit-elle ! » (J. Laforgue, Op. cit., p. 109). Un souvenir d’amour écrit en majuscule voudrait dire que cette union si importante et appréciée par tous n’existe plus, elle est rompue. La cause fondamentale de cette désunion est l’infidélité de la femme. Cette assertion s’explique par les vers suivants : « Qui n’a jamais rêvé ? Je voudrais le savoir ! Elles vous sourient avec âme, et puis bonsoir » (J. Laforgue, Op. cit., p. 148).
Nous constatons à travers «Et puis bonsoir », qu’il y a une suppression volontaire du verbe « dire ». Ce fait résulte de l’état d’âme qui anime le poète. Ce procédé stylistique est l’ellipse qui est une figure de pensée, car elle « concerne le discours en lui-même : elle souligne les rapports des idées entre elles, mais surtout les rapports du discours avec son sujet (le narrateur) d’une part, son objet et le traitement d’autre part » (A. Beth et E. Marpeau, 2016, p. 73). Par la litote à travers « et puis bonsoir », le poète met en évidence la trahison de la jeune femme qui quitté son fiancé sans le prévenir. Dans cette même perspective s’inscrivent les vers ci-dessous : « Oh ! Oui rien qu’un rêve mort-né. Car, défunte elle est devenue. » (J. Laforgue, Op. cit., p. 71).
Ces vers évoquent la jeune provinciale, « Berthe aux sages yeux de Lilas » qu’il revoit mariée. Ainsi, à travers l’expression « un rêve mort-né » se révèle la déception issue de cette union amoureuse. Suite à ce crève-cœur, le poète aspire ou rêve d’une confidente à qui il veut s’épancher pour lui faire part de ses humeurs du moment. Et il attend de l’inconnue la révélation de la femme véritable pour l’amour et de la sensualité. Au regard de ce portrait de ces femmes, il convient de retenir qu’elles sont futiles et infidèles.
2.2. La conception laforgienne de l’amour comme quête de sens
Si la louange de l’être aimé ou la plainte de l’amant traverse la poésie antique, en faisant du désir la source du chant, le lyrisme médiéval a fondé pour des siècles de poésie un lien considéré comme primordial. De ce fait, l’amour pourrait être associé à la poésie. Pour cette raison, la poésie serait l’expression du sentiment et du désir qui animent l’homme, le poète. Les complaintes de J. Laforgue, à cet effet, laissent transparaître « le type d’amour qu’il aborde et comment chez lui, sous l’influence de la philosophie de Hartmann, toute la nature se sexualise. Il n’est pas sûr que les citations de ‘’Volupté’’ et de ‘’Corine’’ soient mises en exergue de ses poèmes par pure ironie » (H. Phalèse, 2000, Op. cit., p. 77).
Le parcours amoureux, en effet, se situe entre les préludes autobiographiques, où le poète se déclare lui-même « bon misogyne » et la complainte épitaphe :
La femme
Mon âme
Ah quels
Appels (J. Laforgue, Op. cit., p. 155)
Cette complainte dans l’épitaphe fait de la femme l’unique destinataire de ces chants. Quant au pauvre Chevalier-Errant, en quête d’amour, il appelle toute femme orpheline du Tout-Universel, se promettant de lui faire découvrir le réservoir des sens :
Nous organiserons de ces parties !
Mes caresses, naïvement serties,
Mourront, de ta gorge aux vierges hosties,
Aux amandes de tes seins !
O tocsins,
Des cœurs dans le roulis des empilements de coussins (J. Laforgue, Op. cit., p. 96).
Par la présence des pronoms personnels : « nous », première personne du pluriel et des adjectifs possessifs « mes », « ta » et « tes », se révèlent les fonctions émotive centrée sur le poète et conative centrée sur le destinataire qui est la femme aimée. Ces deux fonctions mettent en relief l’état d’âme du poète. Il s’agit d’un lyrisme amoureux, qui est confirmé par la ponctuation utilisée dans extrait. Cependant, la chute de la complainte le ramène à une triste réalité, car toutes les femmes « s’en fichent ». Cette fin de poème, permet alors de comprendre que, l’amour est un sentiment que le poète se doit de mettre à distance, et sur lequel il n’a de cesse d’ironiser. C’est ce qu’il fait avec la célèbre chanson du roi en la réécrivant à sa manière :
Soleil- crevant, encore un jour,
Vous avez tendu votre phare
Aux holocaustes vivipares
Du culte qu’ils nomment l’Amour (J. Laforgue, Op. cit., p. 116).
Par l’expression « soleil-crevant », l’on a l’impression d’être en face d’un état humain. Cette manière de procéder est la personnification qui est une figure de pensée. Elle consiste à représenter un objet ou une idée comme un être humain, ou à lui attribuer des qualités humaines. Partant de cette figure macrostructurale, le roi personnifie le soleil dans cet extrait en lui faisant des reproches d’avoir trop éclairé les autres couples. En donnant la parole au roi, malheureux, le poète partage ses états d’âme suite à la futilité des dames de cour au maquillage surchargé : « ces être-là sont adorables ! » chante-il ironiquement. Pour autant est-on condamné aux amours tarifiés, qui n’engagent à rien, s’interroge le sage Paris. Et il conclut que tout est bien pesé : « Allez ! Lassez- passer, laisser faire ; l’Amour/ Reconnaître les siens : il est aveugle et sourd » (J. Laforgue, Op. cit., p. 152).
Le sage aboutit à cette constatation banale et désabusée parce que selon lui, personne ne peut supporter l’absence d’amour. Cependant il ne manque pas de mettre en exergue certains aspects difficiles et dangereux de l’amour :
Mon aimée était là, toute à me consoler ;
Je l’ai trop fait souffrir, ça ne peut plus aller (J. Laforgue, 1981, p. 145).
Lorsqu’il écoute son cœur, son sacré cœur, comme il dit avec un humour blasphématoire, le poète en vient à cette unique vérité, qu’il veut aimer et être aimer en retour. Il ne sait pas qu’en toute relation amoureuse, il y a des douleurs issues des trahisons et des incompréhensions :
Le vent assiège, A
Dans sa tour, B
Le sortilège ; A
De l’amour B
Et pris au piège, A
Le sacrilège A
Geint sans retour B
Je rentre au piège A
Peut-être y vais-je A
Tuer l’Amour ! B (J. Laforgue, Op. cit., p. 113).
Dès cet instant où surviennent le vent, le sortilège et le sacrilège dans cette union, l’amour ne semble plus harmonie et bonheur. On peut alors considérer ce mariage comme un leurre, la mort de l’amour. Et la disposition des différents types de rimes employées par le poète : les rimes croisées (ABAB), les rimes plates ou suivies (AA) et les rimes embrassées (BAAB) confirment cette union vécue par le personnage. Il s’agit d’un amour qui n’est pas partagé par les deux conjoints. En plus de la disposition des rimes, le champ lexical de la souffrance (piège, sans retour, geint, tuer) employé par l’auteur dans cet extrait, met en relief la particularité de cette union qui est objet de souffrance et de douleur.
Par rapport à l’amour, l’on retient que le poète est déçu. L’amour est difficile et dangereux parce qu’il n’y a pas toujours harmonie et bonheur. Ainsi, dans cette souffrance et ce tourment de l’amour, le temps ne laisse pas indifférent au poète.
3. Le sens de l’expression du repère temporel
Le temps qui passe et qui mène inéluctablement, vers la fin de chaque vie, concerne tout être vivant. Par ailleurs, il importe de savoir quelle signification l’on peut avoir des mesures du temps.
3.1. Les perceptions du temps : les saisons et les jours
L’emploi des moments de l’année comme les quatre saisons qui sont si importantes et symboliques dans tant d’œuvres littéraires, restent discrets dans la poésie de J. Laforgue. On est tenté de dire que le temps est relégué chez lui au second plan. La mention d’une saison dans les Complaintes peut se limiter à une simple indication temporelle peu significative à la vérité : « cet hiver » ou « en ce blanc matin d’été » (J. Laforgue, Op. cit., p. 110). Il est de toute évidence que le printemps est la saison chantée par la plupart des poètes. Parfois, ils l’assimilent aux fleurs, à la renaissance de la nature et à la fraicheur. Mais chez Laforgue, on constate qu’il n’en est pas ainsi. Cette saison perd presque sa véritable valeur avec lui dans sa présentation, car le poète use du sarcasme lié à une formulation peu ordinaire dans son poème « complainte des printemps » :
C’est le printemps qui s’amène !
Ce système, en effet, ramène le printemps,
Avec son impudent cortège d’excitant (J. Laforgue, Op. cit., p. 85).
Dans cet extrait, se révèle un ton ironique à travers le présentatif « c’est » accompagné du verbe « s’amener » qui traduit la valeur dépréciative de cette saison qui est cependant synonyme de la renaissance. Cette mésestime du printemps est renforcée par l’emploi de l’adjectif démonstratif « ce » du second vers de l’extrait : « ce système », qui de manière péjorative présente sans enthousiasme le printemps. En plus du printemps, le poète fait mention de la saison de l’automne qui constitue le titre d’une complainte : « L’automne monotone » :
Automne, automne, adieu de l’Adieu !
La terre, si bonne
S’en va, pour sûr, passer cet automne (J. Laforgue, Op. cit., p. 88).
Dans ces vers, l’automne traduit la séparation que confirme le verbe s’en aller au présent de l’indicatif « s’en va », le terme « adieu » et annonce également la fin d’un processus. Cet état de séparation engendre une souffrance que ressent le poète à cette période qualifiée de monotone ou de « spleenuosité » :
Oh ! Qu’il fait seul ! Oh ! Fait-il froid !
Oh ! que d’après-midi d’automne à vivre encore !
Le spleen, eunuque à froid, sur nos rêves se vautre ! (J. Laforgue, Op. cit., p. 75).
Avec une fréquence abondante de points d’exclamation et de nombreuses interjections « oh », dans cet extrait, le poète traduit le sentiment qui l’anime : il souffre et il est malheureux. Ainsi, le poète commente lui-même cette hypocondrie en termes définitifs : « Tant il est vrai que la saison d’automne/ n’est aux cœurs mal fichus rien moins que folichonnes » (J. Laforgue, Op. cit., p. 9). L’emploi de la négation restrictive « n’est…que » met en situation l’état malheureux du poète. Après ces saisons, comme indices temporels, J. Laforgue s’adonne à cœur joie à l’emploi des jours de la semaine. En effet, une complainte les chante sous une forme particulière. Il s’agit de « la fin de la journée » qui, présente le poète en un incompris, un exilé dans sa propre société :
Et comme le jour naît, que bientôt il faudra,
A deux bras,
Peiner, se recrotter dans les labours ingrats,
Allez, allez, gens que vous êtes,
Ce n’est pas tous les jours jour de fête ! (J. Laforgue, Op. cit., p. 118).
La vie humaine transparaît dans cet extrait comme une banalité à laquelle l’homme est condamné au quotidien. Tous les soirs n’accordent pas de repos aux comices agricoles qui sont de simples pauses avant le retour fatal des tâches quotidiennes. Par la comparaison, une figure de pensée, en début de cet extrait, « et comme le jour naît », le poète établit une relation entre la naissance du jour et le début des supplices du personnage issus des activités quotidiennes : « peiner, se recrotter dans les labours ingrats ». La répétition du mode impératif employé dans le vers suivant : « allez, allez gens que vous êtes » insiste et confirme cette souffrance, et la suite de la complainte enjoint clairement : « tous les jours ne sont pas jour de fête », donc il n’y a point de repos dans les sociétés humaines. Pour cette raison, le poète J. Laforgue ne cite aucun jour nommément, étant donné que tous les jours de la semaine sont ceux de dur labeur excepté le dimanche qui est celui du Seigneur et du repos. Ce jour est aussi de la vacuité à l’intérieur d’une vie elle-même monotone. Ce dimanche-là, de manière exceptionnelle, le pauvre corps humain :
S’endimanche pour sa peine
Quand il bien sué la semaine
Les cloches sonnent à toute volée
( …)
Car on devine que la fête ! (J. Laforgue, Op. cit., p. 121).
Le point d’exclamation à la fin de ce dernier vers est très significatif. Il traduit les sentiments du poète par rapport à cette fête de dimanche, qui n’est qu’un cache-misère momentané. Après ce jour l’homme revit sa misère quotidienne. Pour cette raison, le poète s’intéresse aussi aux différentes périodes de la vie humaine c’est-à-dire les phases de la vie humaine.
3.2. Les différents cycles de la vie
La vie de tout être humain est organisée en différents cycles aussi importants les uns que les autres, qui rythment celle-ci. Ainsi, dans son processus de socialisation, l’homme devrait être en train de se réaliser pleinement. Malheureusement, étant un être mortel, les contingences peuvent mettre fin à sa vie pour l’empêcher d’atteindre ses objectifs. L’idéal serait qu’il s’accomplisse avant de rendre l’âme dans sa vieillesse. Pour cette raison, cet être humain doit être suivi, encadré et réglementé par les parents. Cela n’a pas été le cas de J. Laforgue, car à six ans, il a été admis en pension au Lycée à Tarbes avec son frère aîné. Il reste au Lycée jusqu’à quinze ans où il connaît les premières souffrances de la solitude.
Après ce temps de l’enfance difficile et mélancolique, commence sa jeunesse. Sa famille décide de rentrer définitivement avec lui en France, malheureusement deux ans après, il perd sa mère. Pour cela, il le dit lui-même : « je n’avais presque pas connu ma mère.» (L. Guichard, 1977, p. 14). Il avait, en effet, sept ans quand elle dut le quitter, et il ne la retrouva à quinze ans pour la perdre à dix-sept ans. Il fréquente par la suite les bibliothèques, assiste au cours de Taine, visite les musées et compose « des pièces de théâtres, des chapitres de romans et des masses de vers qu’il porte dimanche à Paul Bourget, lequel lui en montre les faiblesses et l’engage à les corriger. » (Léon Guichard, Op. cit., p. 14).
Après la mort de son père, il reste seul à Paris. Devenu adulte, il travaille le matin comme secrétaire pour assumer sa substance auprès de Monsieur Charles Ephrussi, amateur et historien d’art, d’un goût très sûr, qui faisait une étude sur Albert Düner. C’est là sans doute, et dans les musées, que s’est formé le goût pour la lecture de J. Laforgue et sa connaissance très précise de l’art, d’avantage qu’aux leçons de Taine. Jusqu’à lors la vie de Laforgue ressemble à celle de jeunes gens venus de la province, heureusement doués, passionnés pour la littérature et pour l’art, et menant à Paris une existence difficile et plutôt solitaire. Mais par un brusque coup du sort, sa vie va changer en tout et pour tout positivement. Dans le cadre de sa nouvelle fonction il est tenu de quitter Paris le 29 novembre 1881. Dans la pleine jeunesse, c’est- à-dire à vingt un ans, et cinq années durant, à part de brefs congés, il va demeurer en Allemagne, attaché à la maison de la vieille impératrice. Bien qu’étant jeune, timide et doux, J. Laforgue loge dans un somptueux appartement au « Prinzessimen Palais unter den Linden », et se demande si ça n’est pas un rêve. Il dine parfois avec des demoiselles d’honneur, et mange parfois dans la vaisselle royale, lui qui a « déjà broyé pas mal de vache enragée et celui qui allait longeant les boutiques dans les rues grises de Paris, portant veston tout reprisé, gilet en loques et pantalon frangé, porte un impeccable frac et peut s’acheter une pelisse » (Léon Guichard, Op cit, p. 17). Il a un domestique à ses ordres, suit la vie de la cour, et se voit présenter les armes. Tout ceci pour dire que la vie de J. Laforgue depuis son enfance jusqu’à l’âge de la maturité où il assume sa vie d’homme responsable, rien n’a été facile jusqu’à ce stade de son existence où il devient responsable en donnant des ordres.
Par ailleurs, d’une manière générale, sa correspondance permet de suivre la genèse des complaintes. Pour ce faire, s’il est un auteur pour lequel la lecture des œuvres complètes s’impose, c’est bien lui. Point d’autres Avertissement, donc, que celui qu’il donne lui-même :
Mon père (un dur par timidité)
Est mort avec un profil sévère :
J’avais presque pas connu ma mère,
Et donc vers vingt ans je suis resté
( …)
Or, pas le cœur de me marier,
Etant, moi au fond, trop misérable !
Et elles, pas assez intraitables !
Mais tout le temps là à s’extasier
(…)
C’est un portrait du poète lui-même, un poète orphelin qui, même s’il a vingt ans, tend à s’immobiliser sur l’« adagio des vingt ans ». Laforgue s’abandonnant à sa passion de la littérature, a eu l’impression d’avoir à ses côtés le même démon, ressemblant au Méphistophélès de Goethe, à l’esprit qui toujours nie » (B. Pierre et B. Corinne, 2000, p. 10). Il s’est demandé, à cause de ce destructeur toujours dans l’ombre, si ce qu’il prenait pour de la littérature, ou plutôt (déjà plus modestement, avec plus de désinvolture volontaire, pour de la littérature, n’était pas seulement les écritures d’un scribe. Par conséquent, pour l’amour, pour le mariage, il n’en a pas le cœur, ne s’en croyant pas plus digne que de trop faciles partenaires. Pourtant, « en 1886, celles qui étaient dédaigneusement désignées comme elles vont prendre le visage unique d’une jeune anglaise. Comme l’écrivait Pascal Pia, qui a tant œuvré aussi pour Laforgue : les jeunes filles ne sont qu’une seule jeune fille, qui s’appelle Miss Leah Lee » (J. Laforgue, 1979, p. 26).
Celui qui se croyait mal-aimé, et mal-aimant, qui est par ailleurs, le thème d’une complainte ; plus précisément ‘’la complainte litanies de mon Sacré-Cœur’’, qui s’achève sur le distique :
Et toujours mon cœur ayant ainsi réclamé
En revient à sa complainte. Aimer, être aimé. (J. Laforgue, Op. cit., p. 145)
Cet extrait révèle l’apaisement du poète quand il épouse l’élue le 31septembre 1886 après-midi, dans une petite Eglise protestante de Kensington. Mais, quelques mois après, c’est une mort prématurée qui arrache le poète à sa femme.
Conclusion
L’écriture poétique et la recherche de valeur significative sont les concepts fondateurs autour desquels s’est réalisée cette étude. Concernant l’esthétique poétique de J. Laforgue, elle révèle un brassage de tons, de mètres pour une mission bien précise : celle de faire connaître sa légitimité et sa raison d’être en vue de la manifestation du sens. C’est pourquoi, ses textes poétiques laissent entrevoir des allusions, des épigraphes à travers des dialogues avec d’autres textes différents, c’est-à-dire une intertextualité comme un moyen pour la quête sémantique. Par des vers libres, le plus souvent, le poète en vient aux thèmes de la femme et ses dérivés : l’amour, le mariage suite au portrait physique et moral de celle-ci. La tonalité ainsi révélée est lyrique. Outre la femme, le poète accorde un intérêt au repère temporel dans la vie de tout être humain. Ce temps est constitué des saisons et des différents cycles de la vie humaine, c’est-à-dire l’enfance, la jeunesse et l’âge adulte.
Références bibliographiques
ABBE BATTEUX, 1746, Les Beaux-Arts réduits à un seul principe, Paris, Slatkin.
BAUDELAIRE Charles, 2005, Les Fleurs du Mal, Paris, Gallimard.
BENVENISTE Emile, 1974, Problème de linguistique générale, Paris, Gallimard.
DE PHALÈSE Hubert, 2000, La forgerie des complètes de Jules Laforgue, Paris, Nizet.
FUMAROLI Marc, 1997, Le poète et le Roi-Jean de la Fontaine en son siècle, Paris, Fallois.
GUICHARD Léon, 1977, Jules Laforgue et ses poésies, Paris, P U F, ed, Nizet.
HAMON Philippe, 1974, L’ironie Littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette.
KRISTEVA Julia, 1983, Pouvoir de L’horreur, Paris, Seuil.
LAFORGUE Jules, 2000, Les Complaintes, Paris, L’imprimerie Nationale.
LAFORGUE Jules,1997, Œuvres Complètes, Lausanne, L’âge d’Homme.
MOLINIÉ Georges, 2014, Éléments de stylistique française, Paris, P U F.
Pierre Brunel, 2000, Lecture d’une œuvre Les Complètes de Jules Laforgue, Paris, édition des Temps.
RABATÉ Dominique, 1996, Figure du sujet lyrique, Paris, PUF.
[1] Allusion est ici faite au célèbre ouvrage Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Dans cet ouvrage paru en 1996, le Professeur de Harvard annonce qu’avec la fin de la guerre froide, ce sont les identités et les cultures qui engendreront les conflits et les alliances entre États, et non plus les idéologies.
[2] La Bible, 2015, Jean 15, 25.
[3] Selon cette théorisation freudienne, le petit garçon éprouve la crainte de la mutilation ou de la disparition possible de son propre appendice pénien en découvrant le sexe féminin, réalisant que le membre viril ne fait pas nécessairement partie du corps. L’angoisse liée à la possibilité d’une castration constituera le socle de son évolution affective et sexuelle. Pour la petite fille, la découverte de l’existence du pénis est perçue comme découverte douloureuse d’un manque, et cette découverte sera pour elle également décisive dans son évolution psychologique et sexuelle.
[4] ″BokoHaram″, nom donné par la population locale et les médias, peut se traduire par ″L’éducation occidentale est un péché″. « L’organisation se présente pour sa part comme ″la communauté des fidèles du prophète pour la sunna″ » (M.A. P. de MONTCLOS, 2015, « Le retour des djihadismes africains », in L’OBS : Le retour des guerres de religion, Hors-série, Paris, Novembre –Décembre 2015, p. 71)
[5] Le conflit entre Chiites et Sunnites remonte aux premiers temps de l’islam, surtout sur l’héritage temporel (et quelques points doctrinaux) du prophète Mahomet. Il refait surface en Irak, en Syrie et en Iran au 20e siècle dans un contexte d’influence géopolitique
[6] La Bible, 2015, 1 Timothée 6, 10.
[7] Lire relativement à l’autorisation de piller, les textes bibliques suivants : Deutéronome 20, 11-15 ; Josué 8, 27 ; Esaïe 8, 1 ; 2Chronique 15, 11 ; 20, 25. Lire aussi relativement au désaveu des butins de guerre, les textes suivants : Josué 7, 20-25 ; 1Samuel 15, 14-22 ; Ezéchiel 38, 11-12.
[8] Jules Ferry (1980, p. 40) disait que « la politique coloniale est fille de la politique industrielle ».
[9] « Le général de Gaulle, en paraphrasant Lord Palmerston, « L’Angleterre n’a pas d’amis ou d’ennemis permanents ; elle n’a que des intérêts permanents », rappelait que, d’une façon plus générale, « les États n’ont pas d’amis ; ils n’ont que des intérêts » (https://www.arri.fr/articles/21063-la-france-n-a-pas-d-amis-elle-n-a-que-des-interets).
[10] Il faut l’admettre, l’enseignement dominant du Moyen Âge, à partir du XIIe siècle, est la scolastique. La scolastique, en effet, peut se définir comme l’interprétation de l’œuvre d’Aristote par les théologiens. L’illustre de ces théologiens est Saint Thomas d’Acquin (1227-1274) qui a concilié la philosophie aristotélicienne et la théologie chrétienne (Cf. B. Jarrosson (1992, p. 20).
[11] Nicolas Copernic (1473-1543), est considérer comme le père de la révolution héliocentrique pour avoir postuler que la terre n’était ni le centre de l’univers, ni immobile. C’est dans La révolution des orbes célestes (1543), publiée peu de temps avant sa mort, qu’il a consigné ses thèses qui ont sonné le glas du géocentrisme.
[12] Ptolémée (vers 100- vers 170) a apporté des solutions à certaines énigmes du système géocentrique aristotélicien, notamment les questions du mouvement apparent de recul des planètes et des variations de taille et de brillance de la lune et des planètes. Il émit l’idée selon laquelle, les planètes, le soleil et la lune se déplaçaient sur de petites orbites circulaires qu’il nomma épicycles. Dans l’ensemble, la contribution de Ptolémée n’a consisté qu’à accroître l’autorité d’Aristote.
[13] Selon Descartes, l’heuristique de la vérité scientifique obéit à quatre règles fondamentales. Ces règles sont, dans l’ordre chronologique, la règle d’évidence, la règle de division des difficultés qui est l’analyse, la règle d’ordre et de synthèse, enfin la règle d’énumération et de vérification. De plus, ce modèle doit être valable dans toutes les sciences.
[14] Pour Descartes, la nature est composée de matières. De la sorte l’univers est appréhendé en sa matérialité qui conduit à le voir comme une grande machine, régi par des forces mécaniques qui sont soumises aux lois de la raison. C’est l’interprétation mécaniste du monde par Descartes, interprétation qui a dominé tout le XVIIe siècle jusqu’au XIXe siècle, même si Isaac Newton (1642-1727) a apporté à la physique de bien meilleurs résultats que celle de son prédécesseur Descartes.
[15] La révolution industrielle marque le changement dans le mode de production. D’une production agricole et traditionnelle, on passe à une production mécanisée et à grande échelle. Ce qui peut être considéré comme la première grande révolution est celle qui eut lieu en Grande Bretagne vers 1780.
[16] Aristarque de Samos (vers – 310, vers – 250), astronome grec, est considéré comme un précurseur de Copernic. En effet, il a été le premier à avoir affirmé que la terre tourne autour du feu central, c’est-à-dire le soleil. Ses affirmations ont été rapportées par Archimède, et sa méthode de calcul qui consistait à mesurer les distances relatives du soleil et de la lune à partir de la terre était très rationnelle, même si ses calculs n’étaient pas justes, faute d’instruments d’observation.
[17] Giordano Bruno (1548-1600), philosophe et astronome italien, Bruno s’est opposé au monde clos d’Aristote et le considère comme le fruit d’une approche sensorielle qui aboutit à ce résultat illusoire. Il conçoit donc la prééminence de l’intellect sur les sens et affirme une multitude de mondes en mouvement dans un espace infini, c’est l’affirmation de l’infinité de l’univers. Il est condamné par l’Inquisition pour ses affirmations et est brûlé vif le 17 février 1600 à Rome.
[18] Chez Claude Bernard, plutôt que de voir un antagonisme entre matière vivante et matière inerte, il faut faire référence à une autre dimension, plus complexe, mais douée de sens, pour comprendre le mécanisme physico-chimique des êtres vivants. C’est le milieu intérieur. En effet, le « milieu intérieur est doué de fonctions essentielles : il est en relation avec le milieu extérieur, perçoit donc ses variations (…) et reçoit les nutriments qu’il véhicule aux divers tissus constitutifs de l’organisme ; il leur apporte aussi des produits élaborés par des organes spécialisés, qu’il s’agisse de matériaux assimilables (glucose) ou de signaux chimiques d’intégration (…) ; la composition du milieu intérieur fluctue avec les changements issus du « milieu cosmique ambiant », mais elle revient ensuite à la moyenne, un point d’équilibre, parce que de puissants systèmes de régulation assurent la constance de la composition du milieu intérieur » (Cf. P. Meyer et P. Triadou, 1996, p. 130).
[19] L’avènement de la physique quantique avec la découverte des quanta par Max Planck en 1900, et l’affirmation de la relativité par Albert Einstein en 1905 marquent la rupture entre physique classique (physique moderne) et la physique quantique (physique postmoderne). La nature n’est plus approchée seulement en sa structure macroscopique, mais en sa structure microscopique qui appelle à revoir fondamentalement la plupart des théories de la physique classique.
[20] Nanotechnologie, Biotechnologie, Intelligence artificielle et Cognitivisme.
[21] Les pythagoriciens Philolaos et Aristarque ont émis l’idée que la terre n’est pas au centre de l’univers et qu’elle tourne autour du soleil.
[22] L’INED est l’Institut national d’études démographiques. C’est un établissement public français spécialisé dans les recherches en démographie et les études de population Wikipédia, 2020).
L’INSERM est l’Institut national de santé et de la recherche médicale. C’est un établissement public, à caractère scientifique et technologique. (Wikipédia, 2020).
[23] L’expérience télévisuelle se définit comme étant l’acte de regarder un contenu choisi, diffusé par un programmateur et qui est suivi, en même temps, par un certain nombre de téléspectateurs. (Jean-Samuel Beuscart, 2012).
[24] Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) est l’autorité publique française de régulation de l’audiovisuel. Il est à l’origine de la signalétique jeunesse (-10, -12, etc.). Soucieux de la protection des enfants contre la nuisance de certains contenus télévisuels, le CSA a une campagne de sensibilisation dénommée « Enfants et écran ». Cette campagne télévisuelle est portée par le slogan : « Ce qu’ils regardent, nous regarde tous ».
[25] Serges Beynaud et DJ Arafat sont des icônes du rythme musical ivoirien baptisé « Coupé décalé ».
[26] Verre cassé d’Alain Mabanckou et Hermina de Sami Tchak ont été abondamment sollicités dans le cadre de nos travaux. Ces romans ont été exploités sous des angles de vue variables, précisément selon les perspectives métalinguistique, métadiscursive et métafictionnelle. La pertinence des résultats obtenus agrée la justesse de notre choix. Le capital de leur investissement est donc délibéré et contraint, vu leur proximité manifeste avec les phénomènes littéraires, concepts et théories en rapport avec notre champ d’analyse.
[27] Le Dictionnaire Le Littré définit la forme hypostatique comme « Celle qui constitue une chose, qui la fait être ce qu’elle est ». https : ⁄ ⁄ www.littre.org. Page consultée le 23 janvier 2020.
[28] En anthropologie et en sociologie, l’autocentrisme, ou endocentrisme, désigne la tendance d’un groupe social ou d’un individu qui le représente à se centrer sur lui-même, à considérer sa propre culture comme purement autochtone, dénuée d’influence externe. La métafiction l’est par analogie. (Nous soulignons).
[29] Gombrowicz est l’auteur de Ferdydurke dans Hermina. C’estlui qui suscita le dialogue avec Heberto, Op.cit., p. 215. (Nous soulignons).
[30] Dans « L’ancienne rhétorique », Roland Barthes (1970, p. 172) rappelle que le compilator « ajoute à ce qu’il copie, mais jamais rien qui vienne de lui-même », tandis que le commentator « s’introduit bien dans le texte recopié, mais pour le rendre intelligible ».
[31] Le nom de ce personnage signifie l’homme qui est réduit à porter des couches. (Nous soulignons).
[32] Le « nous » renvoie à tous les habitués du bar Le Crédit a voyagé. Le récit de leur vie (hypotexte) relaté à Verre Cassé sera réutilisé par ce dernier pour produire un livre. Le dernier paragraphe du sous-titre est très instructif. La forgerie de Verre Cassé devient là une vraie prouesse littéraire.
[33] Un benguiste, c’est celui qui a fait la France. Ce néologisme est aujourd’hui utilisé par nombre d’Africains.
[34] À ce sujet, Jacques Chevrier écrit : « La paternité du mot “Négritude” revient donc à Aimé Césaire, mais le mot comme la chose n’en sont pas moins également redevables à Léopold Sédar Senghor dont toute la carrière comme l’intégralité de l’œuvre, poétique et théorique, militent ardemment en faveur d’une juste reconnaissance des valeurs du monde noir. » in Littératures d’Afrique noire de langue française, Op.cit., pp. 31-32.
[35] Cette approche de Valette rejoint la question de la dépragmatisation (défamiliarisation ou décontextualisation). Le lecteur en arrivera à la répramatisation au moyen de la reconstitution, de la reconstruction ou de la reconsidération de la situation énonciative conventionnelle. Dans Rhetoric of fiction, Wolfang Iser parle de stratégies. Les stratégies sont, selon Wolfang, des orientations opérationnelles qui offrent des possibilités combinatoires ou des sortes de réajustements à l’appui desquels le lecteur accède au signifié global du texte. Il déduit, conjecture, infère à partir du texte donné. De ce fait, le lecteur est capable de découvrir, en remplissant selon Umberto Eco dans Lector in fabula les espaces des non-dits ou même des sous-dits, le projet idéologique pré-structuré.
[36] Groupe ethnique ivoirien, appartenant au grand groupe Akan, et vivant majoritairement dans l’est et le sud-est de la Côte d’Ivoire.