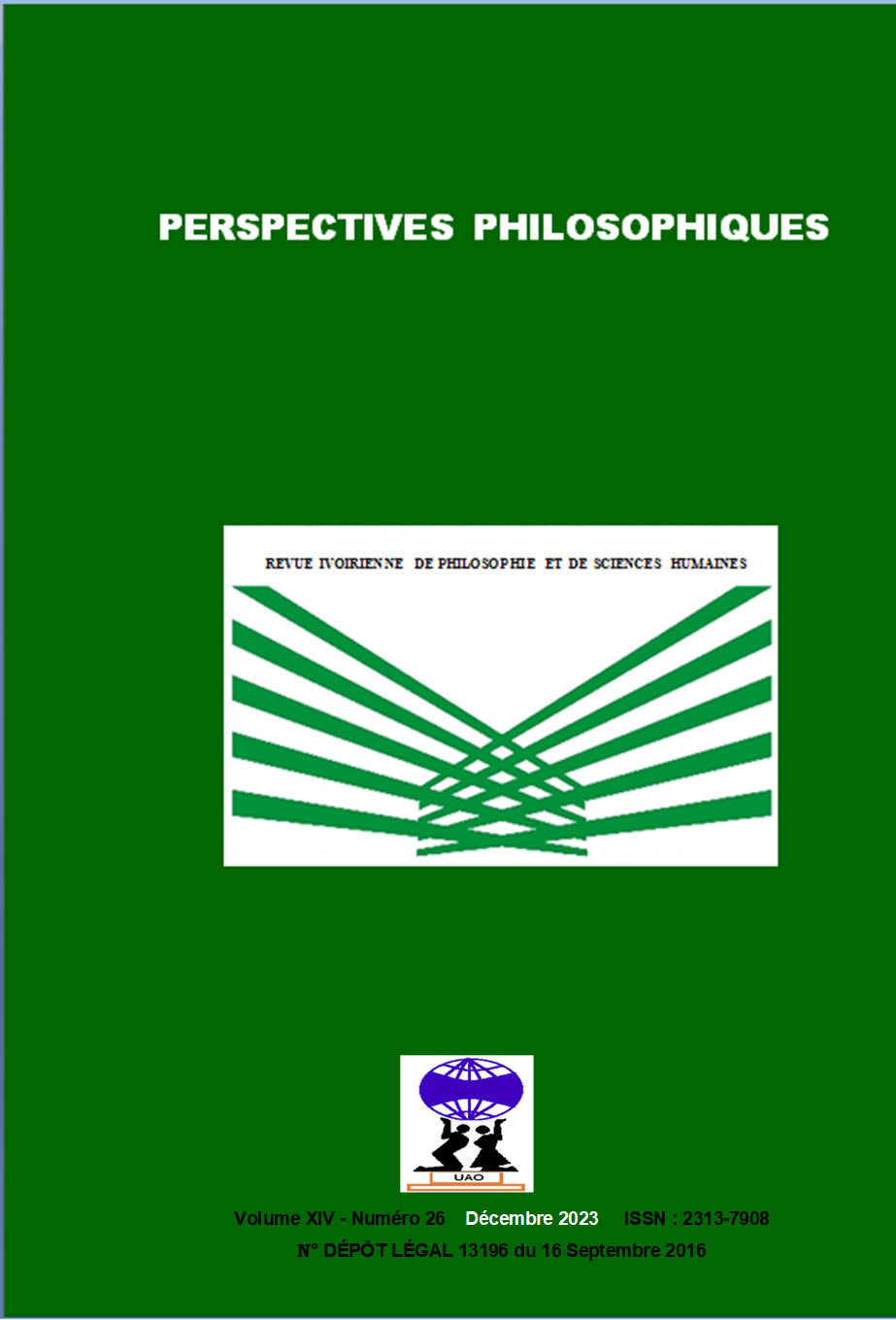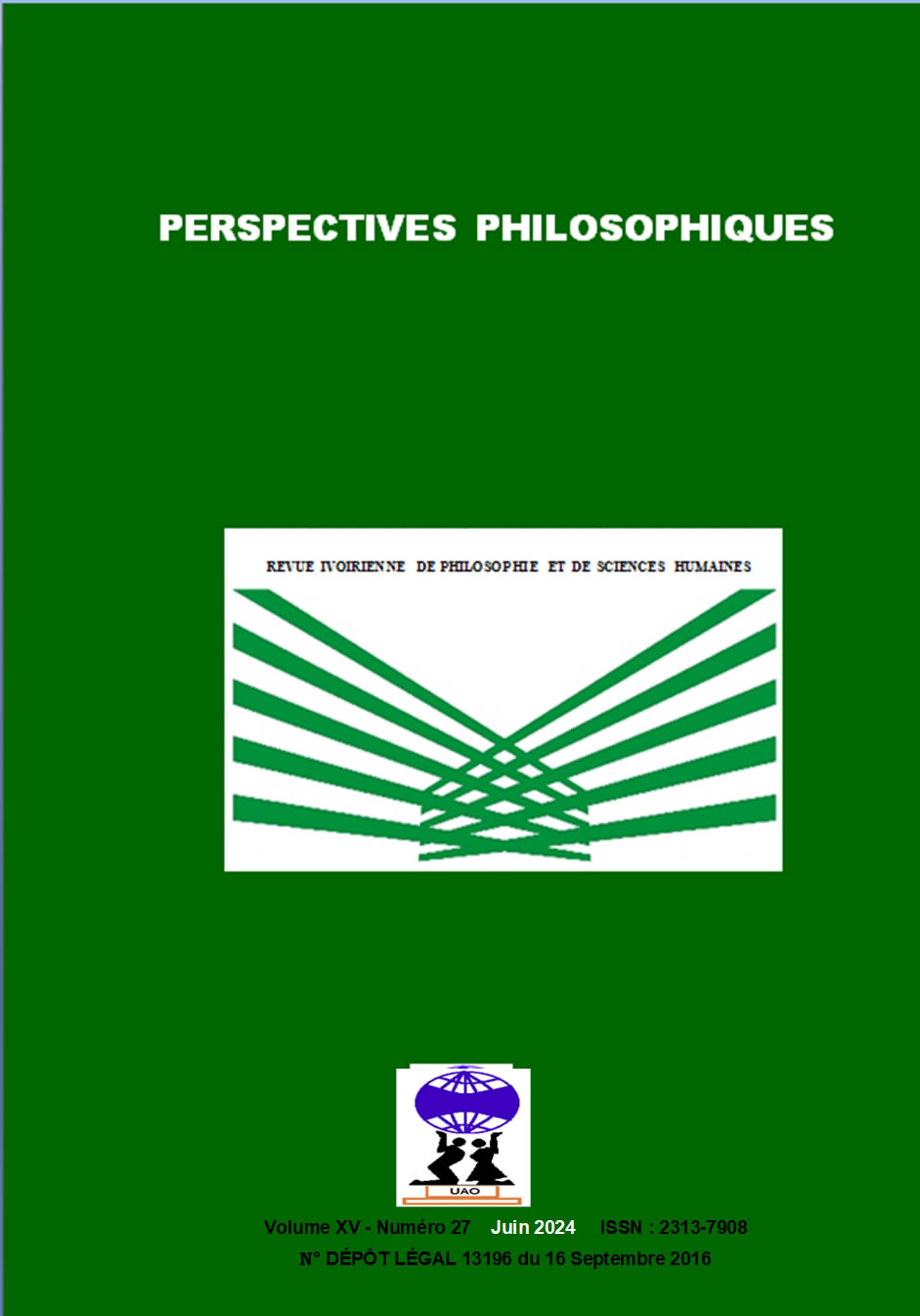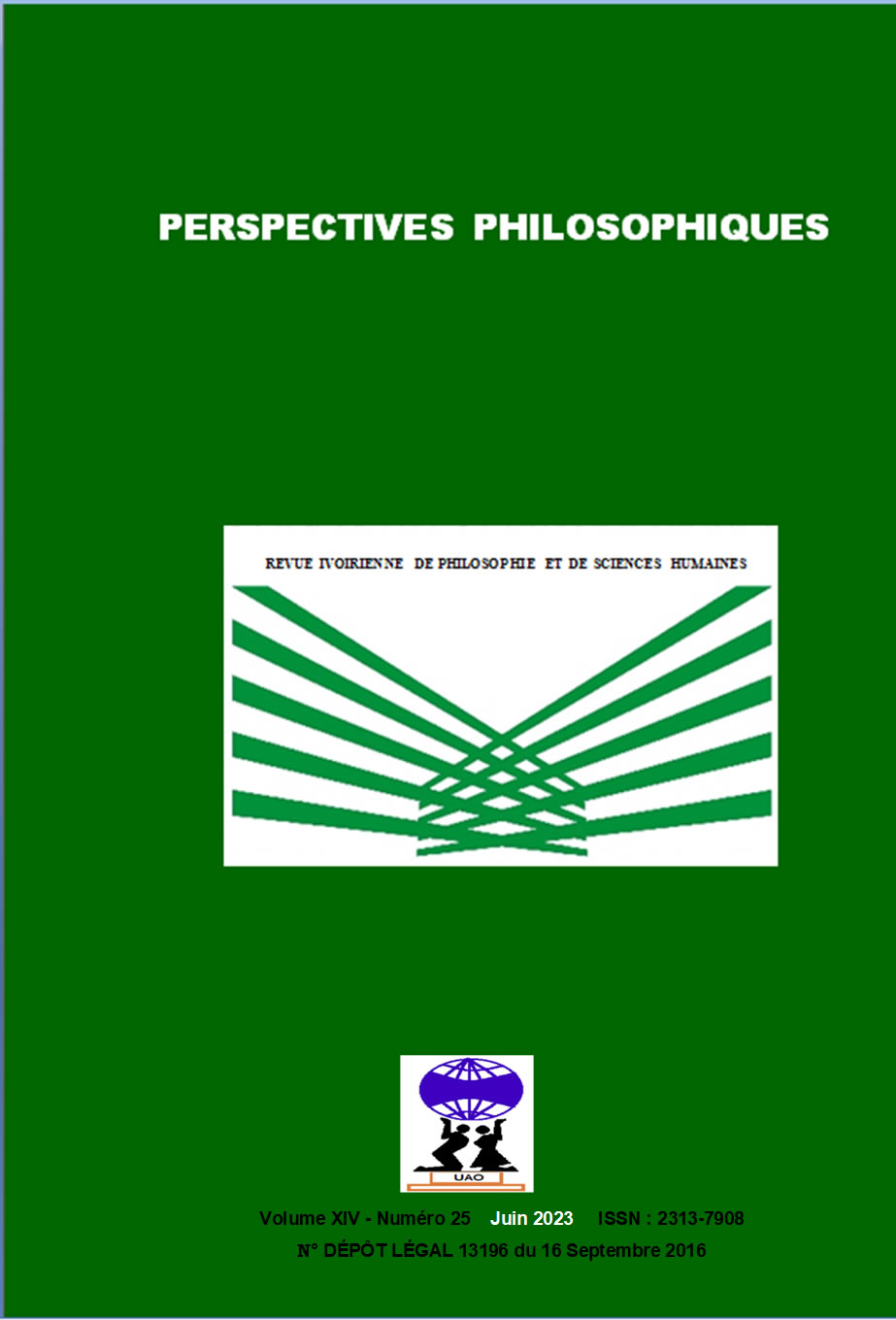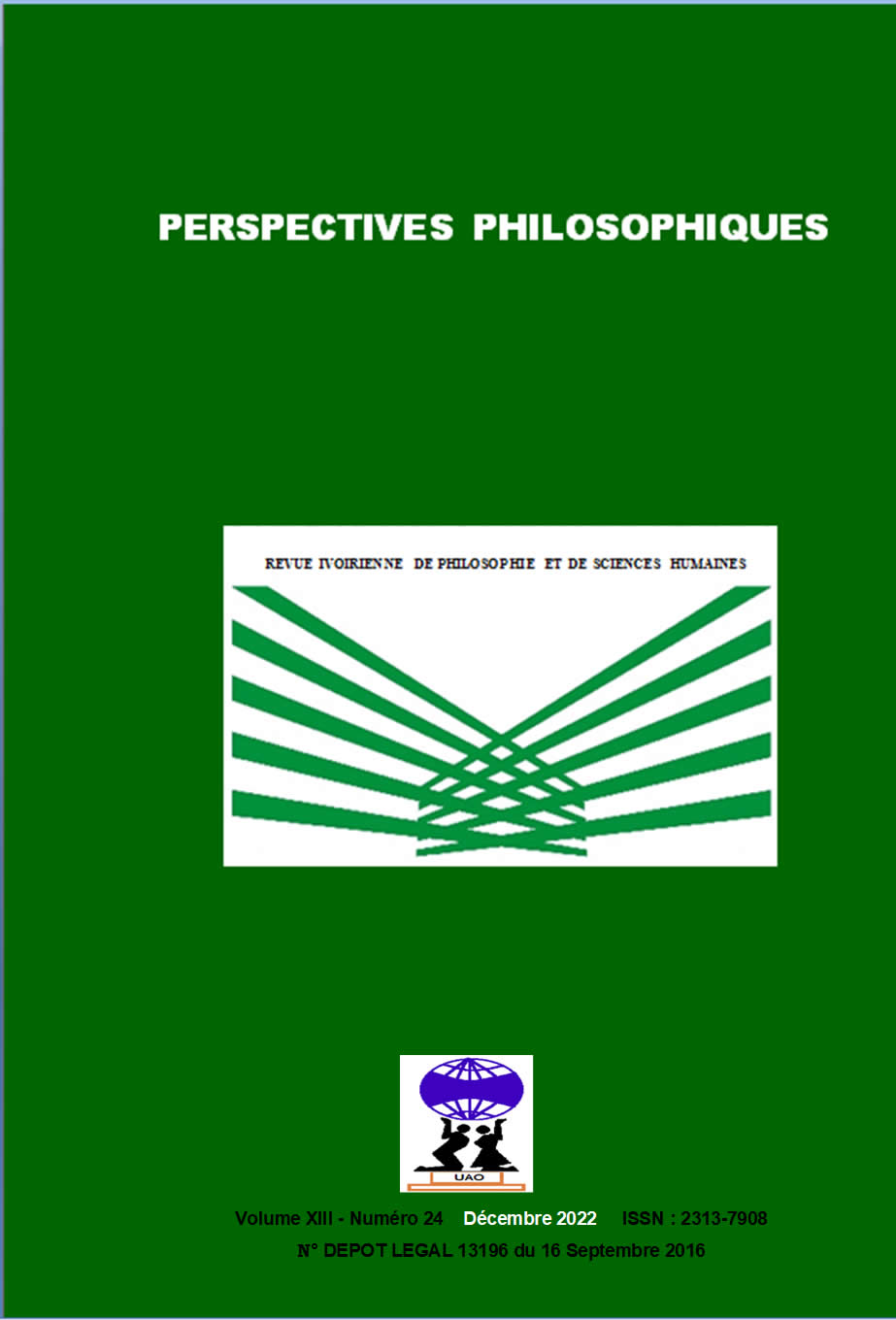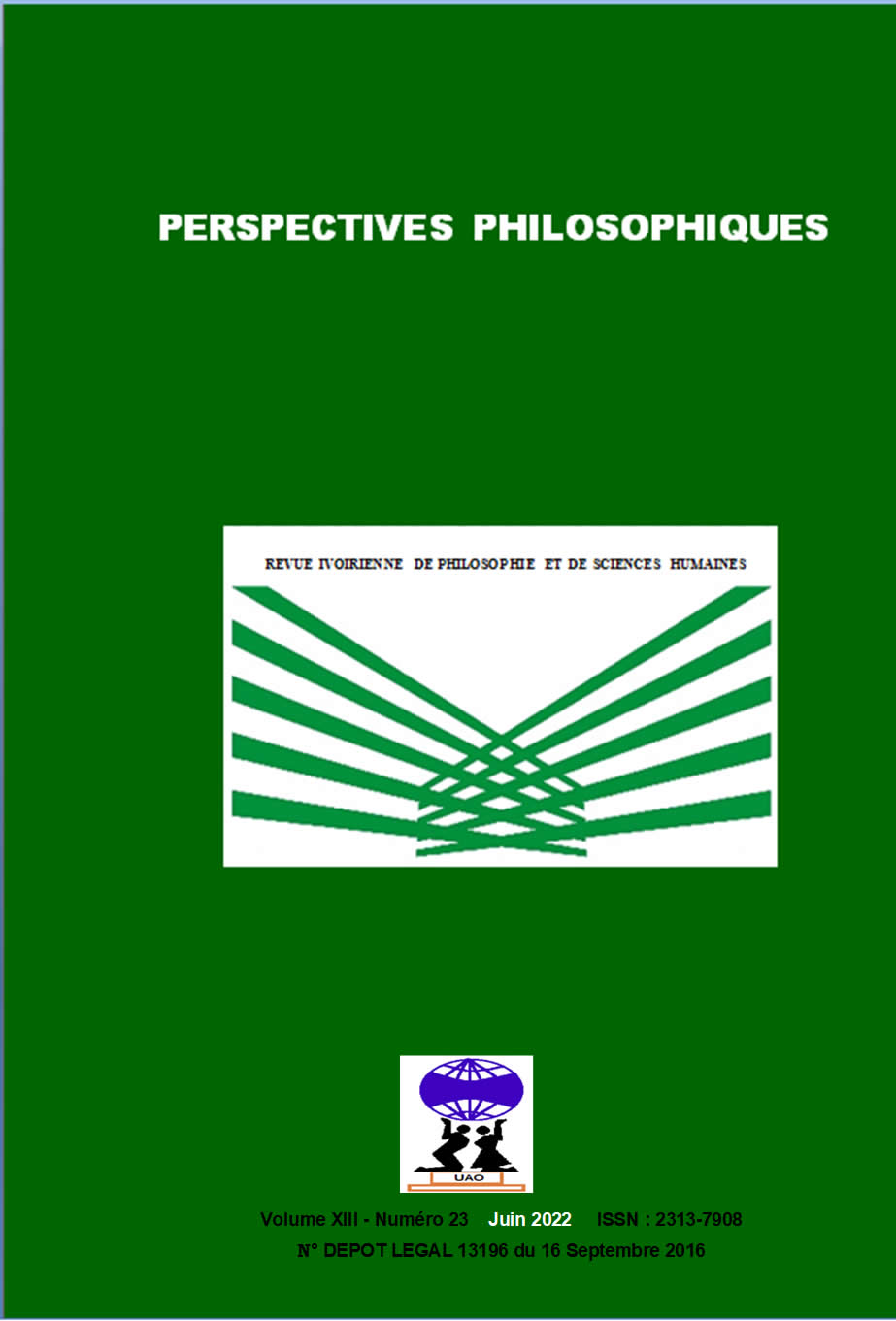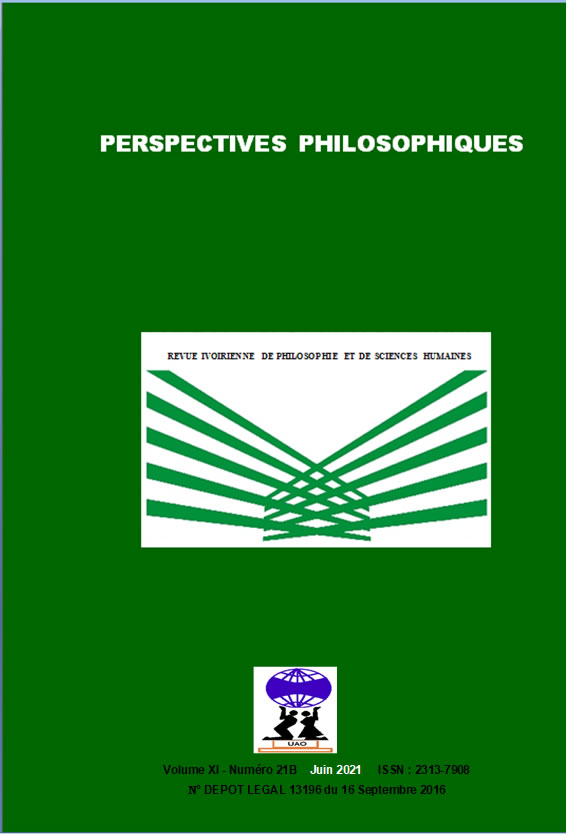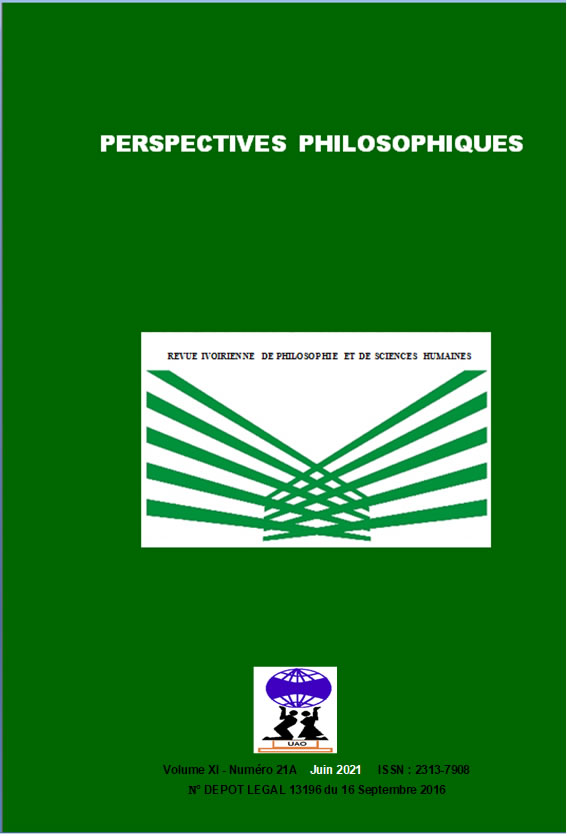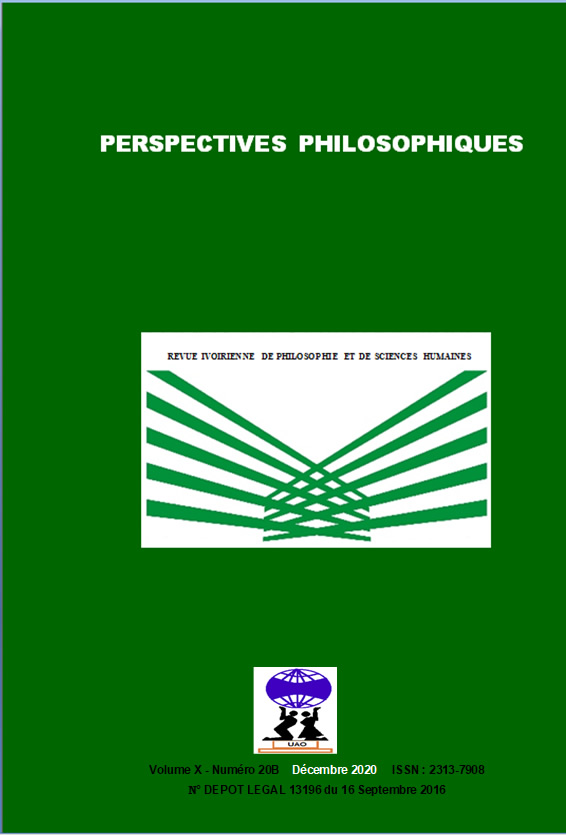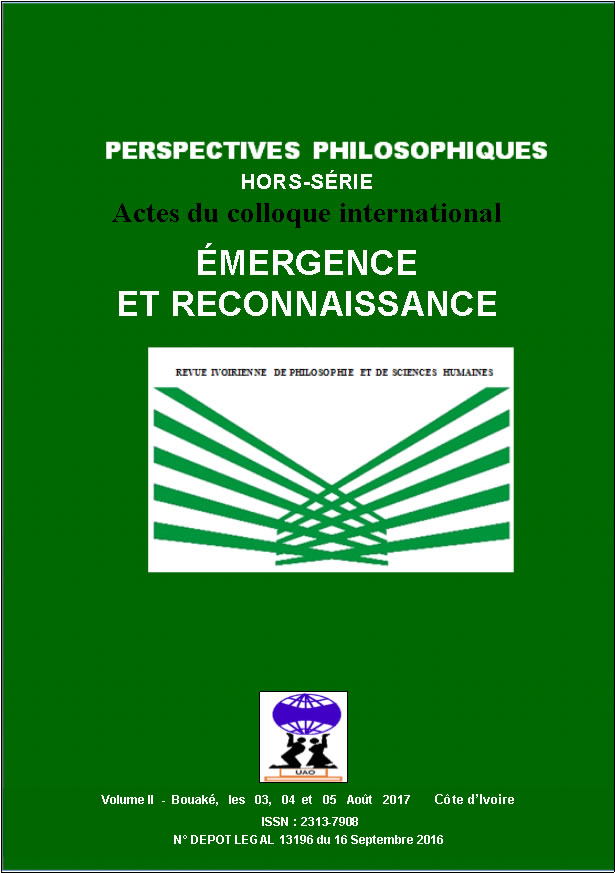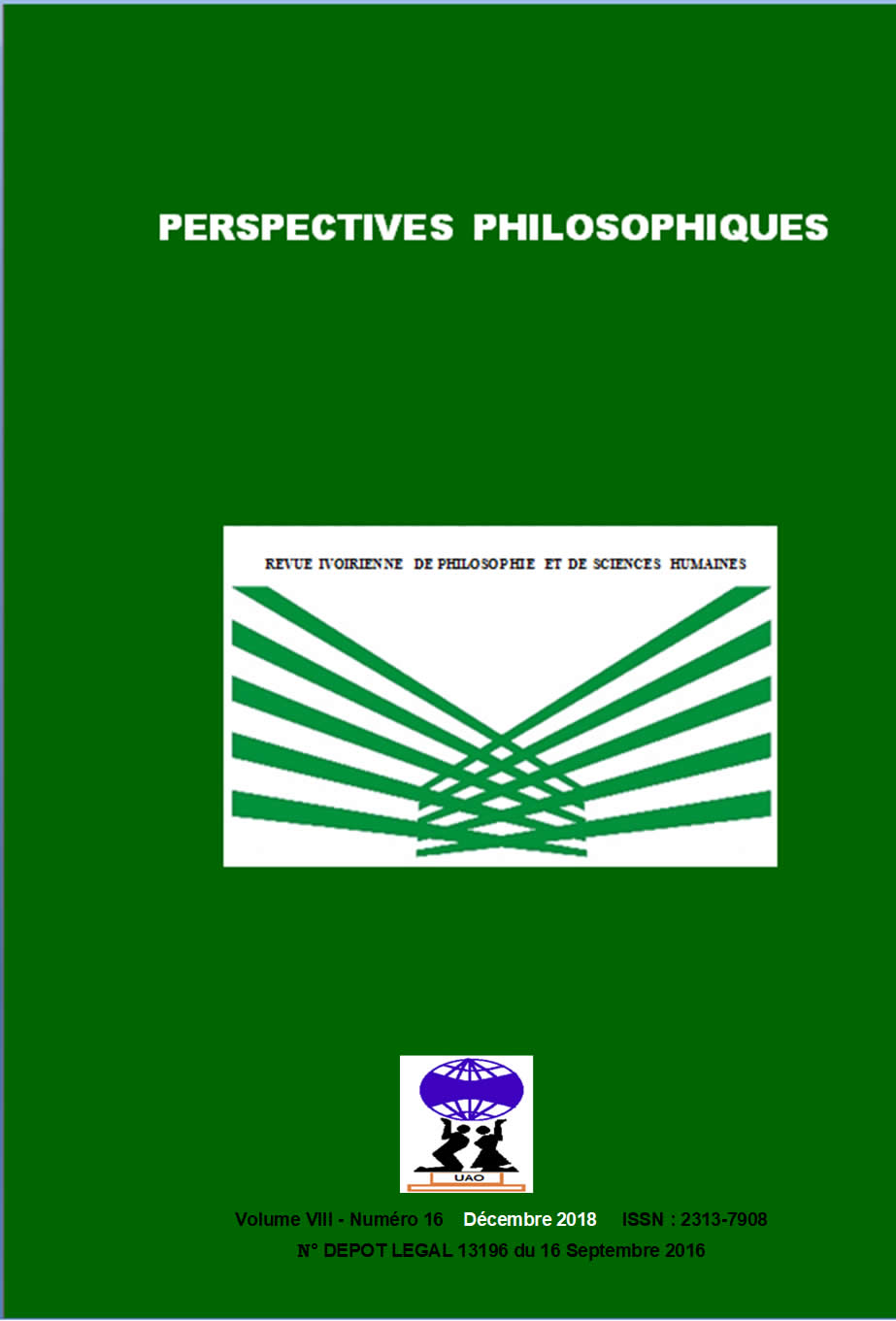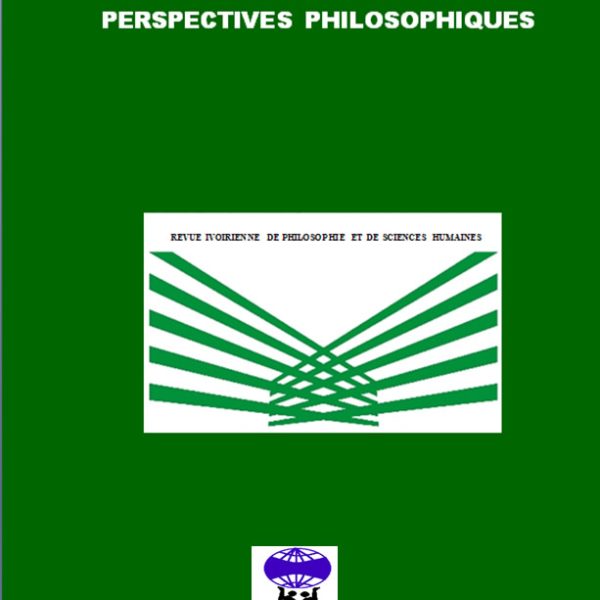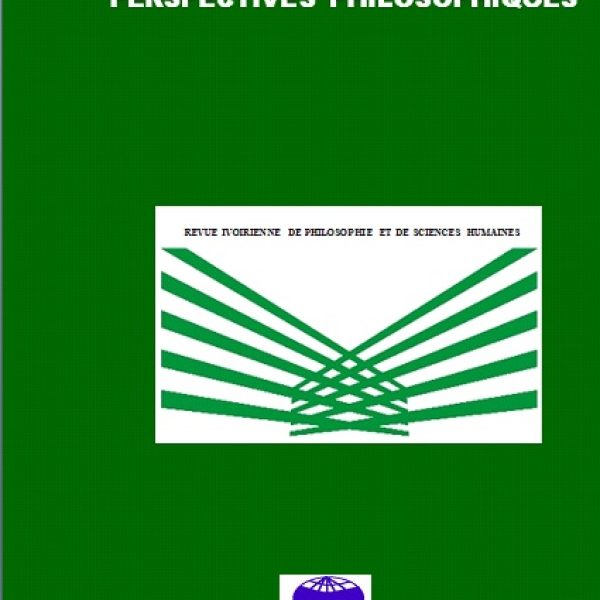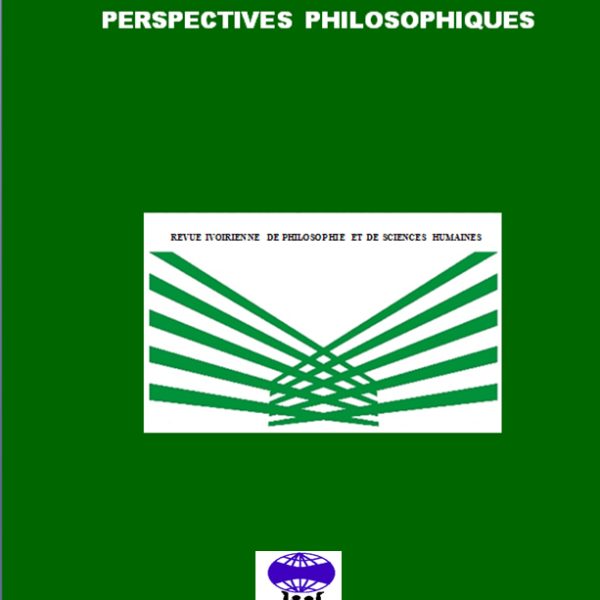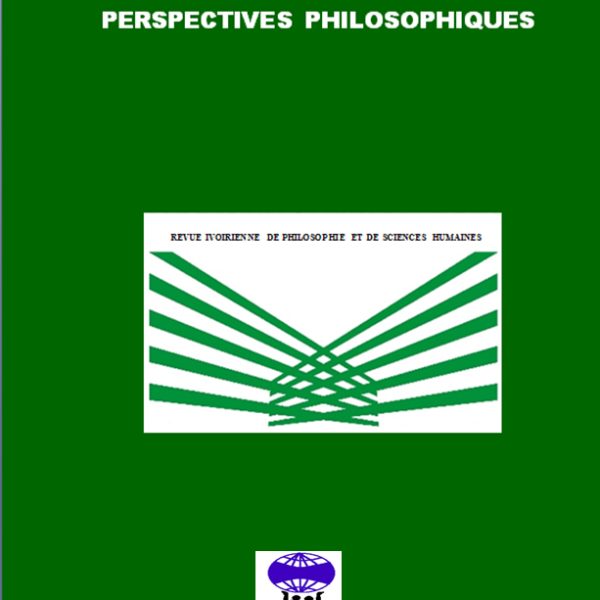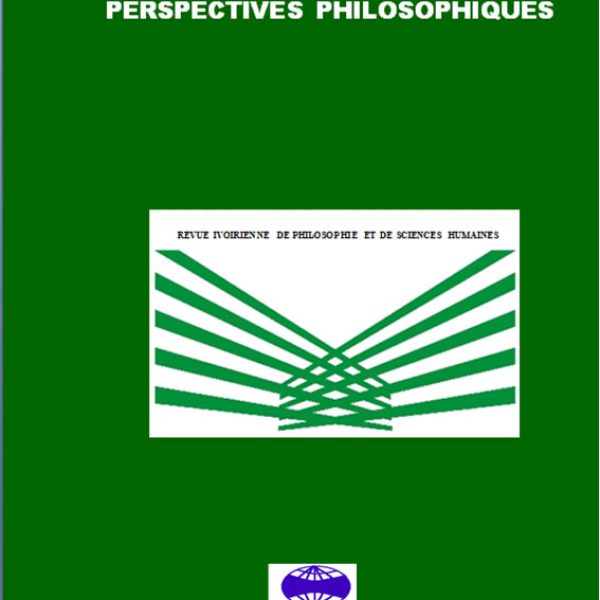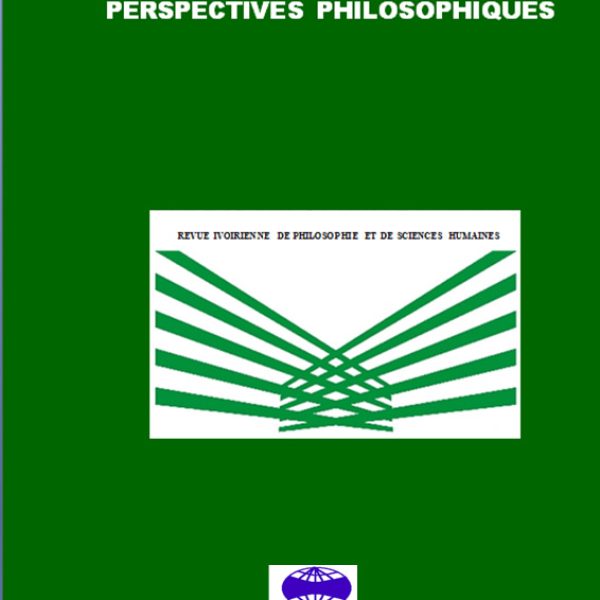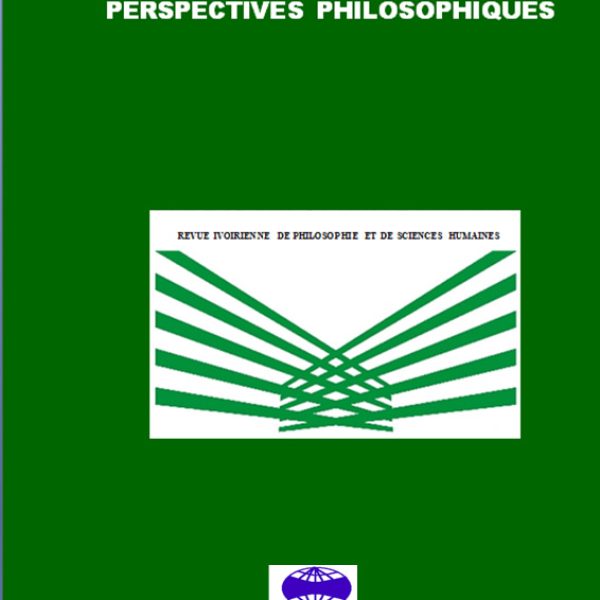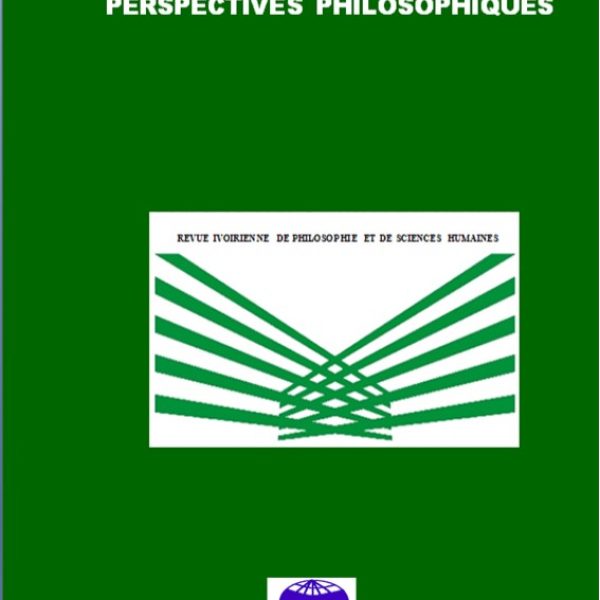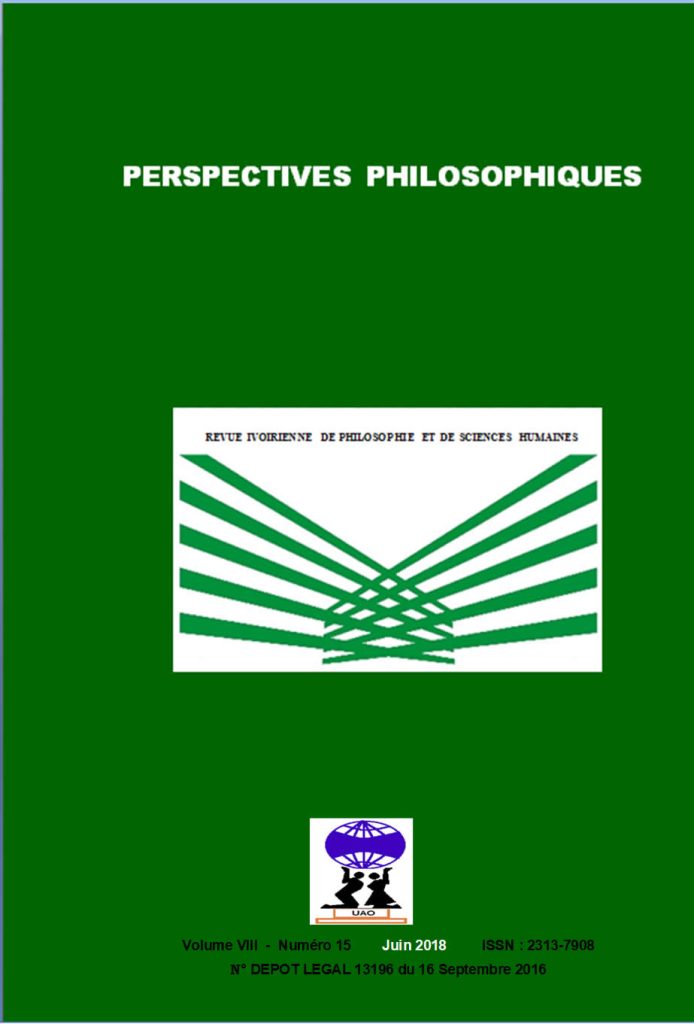
2. Montesquieu, philosophe ancien ou moderne ?, Daniel Chifolo FOFANA …………………………………………….. 21
Présentation et Sommaire N°015 > Résumés des articles N°015
| Volume VIII – Numéro 15 Juin 2018 ISSN : 2313-7908N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : http:// perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Prof. N’dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités
Rédacteur en chef Adjoint : Dr. Assouma BAMBA, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane OUATTARA
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. N’Dri Marcel KOUASSI, Professeur des Universités, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des Universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Dr. Abou SANGARÉ, Maître de Conférences
Dr. Donissongui SORO, Maître de Conférences
Dr Alexis KOFFI KOFFI, Maître-Assistant
Dr. Kouma YOUSSOUF, Maître de Conférences
Dr. Lucien BIAGNÉ, Maître de Conférences
Dr. Nicolas Kolotioloma YEO, Maître-Assistant
Dr. Steven BROU, Maître de Conférences
Secrétaire de rédaction : Dr. Blé Sylvère KOUAHO, Maître de Conférences
Trésorier : Dr. Grégoire TRAORÉ, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités
SOMMAIRE
1. Pouvoir politique et richesse matérielle en Afrique à l’aune du penser platonicien,
Bi Gooré Marcellin GALA……………………………………………………….…….1
2. Montesquieu, philosophe ancien ou moderne ?,
Daniel Chifolo FOFANA………………………………………………..…………….21
3. Le développement durable en Afrique subsaharienne : de l’indifférence aux actions concrètes,
Salif YÉO………………………………………………………………………..………39
4. Isaïah Berlin : un critique de la liberté chez Jean-Jacques Rousseau,
Marceline EBIA………….……………………………………………………..…..….59
5. Vice et éthique de la participation dans les processus de délibération publique,
Anicet Laurent QUENUM………..………………………………………….………87
6. Y a-t-il un humanisme de la mondialisation ?,
Ezechiel Kauhoun Kpangba KOUAKOU ………………………………….……105
7. Le défi de la glocalisation dans la recherche sur les droits de l’homme et leur éclosion en Afrique,
Bilakani TONYEME..………………………..………………………………………115
8. Conséquences sociales des mesures de lutte contre le virus Ebola en Côte d’Ivoire,
Noel Kouadio AHI, Antoine DROH et Djané dit Fatogoma ADOU ….……134
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
POUVOIR POLITIQUE ET RICHESSE MATÉRIELLE EN AFRIQUE À L’AUNE DU PENSER PLATONICIEN
Bi Gooré Marcellin GALA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Dans l’imaginaire africain, le lien entre la politique et l’acquisition des richesses matérielles semble être naturel et quasi insécable. Aussi, l’engagement politique, en contexte africain, apparaît-il comme la meilleure des voies d’un enrichissement rapide et d’un confort matériel personnels assurés. Cela justifie la présence de logiques immorales de prédation, promouvant l’égoïsme primaire, le mépris du bien commun, et occasionnant, de ce fait, des révoltes et des crises sociopolitiques dommageables à la vie communautaire. Au regard du philosopher platonicien, la politique comme voie d’enrichissement matériel est, en réalité, la conséquence de l’ignorance des vertus morales et d’une terrible confusion dans la hiérarchie des valeurs. Pour lui, les vertus morales et l’intérêt commun, qui sont les vraies richesses, constituent les véritables principes d’une politique soucieuse du bien de l’ensemble des citoyens. De tels principes devraient servir de modèles aux dirigeants et futurs gouvernants africains pour une renaissance politique de ce continent.
Mots-clés : Afrique, Communauté, Gouvernant, Pouvoir politique, Richesse matérielle, Vertu.
Abstract :
In the imaginary African, the tie between the politics and the acquirement of wealth seems to be natural and almost indivisible. Also, the political involvement, in African context, appears it as the best of the ways of a fast enrichment and a comfort material staffs insureds. It justifies the presence of immoralities predations, promoting primary selfishness, the contempt of the common good, and causing thereby, the revolts and the prejudicial socio-political crises to the communal life. To the look to Plato’s philosophize, the politics like way of material enrichment is, actually, the consequence of ignorance of the moral virtues and a terrifying confusion in values hierarchy. For him, moral virtues and common interest, that are true welfares, constitute the real principles of a politics aiming at citizens’ welfare. Such principles should serve as models to the leaders and African governors futures for a political rebirth of this continent.
Keywords : Africa, Community, Governor, Political power, Material wealth, Virtue.
Introduction
L’Afrique est encore malheureusement le lieu de grandes confusions. Il est possible, entre autres, de citer la curieuse synonymie qui s’y établit entre la politique et l’enrichissement matériel personnel. Cela est d’autant plus ancré dans les esprits que, le plus souvent, dans ce continent, « la richesse est entre les mains (…) des gouvernants » (T. Mendy, 2006, p. 69). Ces dirigeants qui institutionnalisent ainsi la prise en otage des biens de la collectivité ne contribuent guère à démentir la perversion de la politique en Afrique comme moyen de faire corps avec la richesse. À les observer, on se rend bien vite compte que l’intérêt personnel et les règles du profit sans fin, au grand dam du bien de leurs concitoyens, sont les véritables maîtres-mots de la politique.
Avec ces Africains oligarques, la noble acception de la politique, comme science de la gestion vertueuse de la cité qu’enseignait Platon, est résolument rejetée dans les lointains de l’archaïsme, pour laisser place à celle perçue comme un gagne-pain. Les abus du pouvoir, les actes de barbarie avec leurs corollaires d’injustice, sont les conséquences inéluctables de cette acception et pratique étriquées du pouvoir politique. Or, selon Platon, la politique est, avant tout, liée aux soins à apporter à l’âme du citoyen, afin de la rendre vertueuse. Il s’agit, par l’éducation, d’assurer les conditions optimales pour la transformation et l’épanouissement efficients de l’individu. Cela dit, les dirigeants, qui ont en vue la possession de la richesse matérielle, gouverneraient, comme en Afrique, dans leur intérêt propre et non dans celui de la communauté. Cela n’est pas sans rappeler encore une fois l’intimité du rapport entre l’activité politique en Afrique et le désir malsain d’un enrichissement matériel sans borne.
Mais, demandons-nous en quoi la politique en Afrique se confond-elle avec le désir égoïste d’un enrichissement matériel et quelle solution peut-on apporter à la lumière du philosopher platonicien ? L’analyse de cette préoccupation centrale mobilise les interrogations subsidiaires suivantes qui orienteront notre cheminement : la politique, construite autour de l’amour des richesses matérielles, n’est-elle pas à l’origine des crises et des conflits sociopolitiques constatés dans les États africains ? Si tel est le cas, n’apparaît-il pas urgent de restaurer les droits d’une véritable renaissance politique en Afrique, en s’inspirant du modèle platonicien ?
Cette contribution entend démontrer, à la lumière de la pensée platonicienne et à l’aide d’une approche analytique, que trop souvent en Afrique, la politique est galvaudée, au sens où elle ne représente qu’un simple moyen d’acquisition personnelle de biens matériels ; d’où la misère qu’elle installe au sein des États. Cela admis, seule une pratique politique brodée sur le modèle platonicien, établissant la mesure dans l’enrichissement personnel des dirigeants et la primauté de l’intérêt de la collectivité, assurerait proprement le salut du continent africain. Aussi, apparaît-il judicieux de montrer, premièrement, que la passion des dirigeants pour les richesses matérielles est à la fois l’enjeu de la politique et la cause des crises sociopolitiques en Afrique ; et deuxièmement, de relever que la recherche des vertus, comme vraies richesses, et de l’intérêt commun garantira la renaissance politique dans les États africains.
1. L’accaparement des richesses matérielles : enjeu de la politique et cause des crises sociopolitiques en Afrique
Les crises sociopolitiques que traverse le continent africain sont une résultante de la passion que ses dirigeants ont pour les richesses matérielles. Ces derniers usent, sans gêne, des méthodes les plus cyniques pour s’approprier illégalement les biens de la communauté. Il s’ensuit, de la part des populations, des réactions de révolte aboutissant à des crises qui affectent constamment les États. C’est dire que, derrière l’ambition de briguer des postes de hautes responsabilités politiques, se dissimule, en réalité, le souci inavoué de la garantie d’une meilleure condition matérielle d’existence personnelle.
1.1. L’accaparement des biens matériels : enjeu de la politique en Afrique
La politique, consistant fondamentalement en l’art de gérer et d’organiser la société en vue du bien de la collectivité, semble ne pas recueillir l’assentiment de nombre d’Africains. Ainsi, la plupart du temps, les dirigeants politiques trahissent le serment prêté de se mettre au service de leurs populations, en abusant de celles-ci par des schémas d’exploitation des ressources matérielles à des fins personnelles. Selon les dires de D. Cohen (2010, p. 27), ces hommes politiques « ne se contentent pas de prélever au passage une dîme sur les richesses produites. Ils appauvrissent jusqu’à l’extrême les nations qu’ils gouvernent. Ils transforment en misère, quand elles existent, les ressources minières ou pétrolières de leurs pays ». Cela signifie que, ce qui compte, pour la majorité des dirigeants, c’est bien l’accaparement des richesses du pays, et non le noble projet de contribuer à son épanouissement.
Le contraste choquant entre la pauvreté des Africains et la richesse de leur continent est, pour une assez large part, le fait de leurs gouvernants. En effet, les biens nationaux sont constamment l’objet de pillages massifs au profit de cette minorité de hauts dignitaires oligarques alors que les populations avilies et humiliées sont incapables d’assurer le minimum vital. Or, à en croire C. Rogue (2005, p. 51), « l’accaparement de la propriété par une minorité d’oligarques conduit en effet à ne même plus accomplir correctement, pour les pauvres, cette fonction économique minimale qu’est la satisfaction du besoin ». Autrement dit, les besoins fondamentaux du peuple en nourriture, en vêtements, en accès à l’eau potable et en soins de première nécessité sont loin d’être, pour ces dirigeants possédants, des priorités à assouvir.
Cette réalité est vécue presque partout au sein des États africains. Par exemple, dans un pays comme la République Démocratique du Congo[1] qui dispose des meilleurs gisements métallifères et forestiers du monde, les populations demeurent curieusement piégées dans l’antre de la pauvreté. Si l’on en croit H. Mahicka (2018, p. 238), les citoyens y « sont pauvres parmi les pauvres de la planète (…). Leur richesse est aujourd’hui sous contrôle d’un gouvernement qui (…) possède désormais l’ensemble du sol, du sous-sol et du vivant ». Visiblement, en République Démocratique du Congo, les richesses du pays échappent injustement aux forces vives de la nation au bénéfice d’une catégorie restreinte de personnes voraces. On peut en dire de même pour la Côte d’ivoire, la République centrafricaine etc., pays riches en matières premières, mais où la majorité des populations demeure encore dans le tunnel de la misère, alors que leurs dirigeants détiennent de grandes richesses émanant des ressources publiques.
La passion pour la conquête et l’accumulation privée des biens publics reste donc vive dans le champ politique africain. Presqu’aucun dirigeant ne réussit sérieusement à résister à son pouvoir enchanteur. Ainsi, de moins nantis qu’ils étaient avant leur accession aux charges publiques, ils baignent dans l’opulence après seulement quelques mois de fonction. F. Kanvaly (1998, p. 224) n’avait nullement tort quand il faisait remarquer que « la confusion dans la gestion des biens sociaux entre la propriété privée et le bien de l’État est une des caractéristiques du pouvoir politique en Afrique ». La transparence dans la gestion du patrimoine commun est le plus souvent inexistante dans les États africains.
L’impunité régnant au cœur du jeu politique, « on trouve toujours le même enchaînement : un pouvoir corrompu qui engage des dépenses inutiles pour détourner l’argent public, des caisses d’investissement immédiatement vidées, ou des programmes d’aides sociales qui sont détournés de leur fin » (D. Cohen, 2010, p. 28). Ces agissements savamment planifiés prouvent que le combat pour le développement est très souvent loin du programme politique de ces gouvernants : l’objectif étant d’être à l’abri du manque matériel. L’appropriation du patrimoine collectif par le dirigeant établit bien la thèse d’une personnification de l’État et milite en faveur de l’existence d’un réel sentiment d’égoïsme politique en Afrique.
L’altruisme et la philanthropie n’ayant plus aucun sens à leurs yeux, ces politiques n’éprouvent aucune gêne à voir leur peuple croupir sous le poids de la misère. Voilà pourquoi, l’homme politique africain est bien, selon le mot de S. Diakité (2014, p. 67), « ce prédateur qui veut le tout ou ne laisse que le presque-rien ». La possession du confort matériel est donc ce qui détermine l’ambition et l’exercice d’un pouvoir sans partage des politiques africains. C’est la raison pour laquelle, les nombreux engagements pris et les promesses faites lors des campagnes électorales ne sont presque jamais respectés. La règle d’or est qu’une fois les échéances électorales terminées, les heureux élus rompent tout contact avec ces populations qui les ont portés aux charges publiques, pour espérer les retrouver plus tard, lors des prochaines campagnes. Le voile démagogique qui enveloppe le dire politique montre que les peuples africains sont bernés, infantilisés, ridiculisés par leurs dirigeants.
La corruption est au cœur de ces idéologies manipulatrices, et le discours qui demeure quasiment le même partout, au soir de la victoire, laisse toujours entendre que « les caisses, au propre et au figuré, sont vides » (A. Kabou, 1991, p. 181). Cela donne le sentiment que l’exercice de la gouvernance politique débute toujours par une table rase économique. Le plus souvent, le dirigeant fraîchement élu se trouve à la tête d’un pays économiquement très affaibli, du fait des pillages et expropriations de fonds tous azimuts. Les compétitions électorales deviennent ainsi des occasions où les pays sombrent davantage économiquement. Au lendemain de son élection, le Président libérien George Weah, par exemple, n’a pas manqué de chanter, lui aussi, la ritournelle des caisses vides.
Où va l’argent du pays au terme des échéances électorales en Afrique ? Qui vide les caisses du trésor public : les gouvernants entrants ou sortants ? Sur ces interrogations, le flou reste toujours entretenu. Mais, la vérité est que l’appropriation des richesses du continent par ses propres gouvernants est une honteuse constance bien connue. On comprend pourquoi l’Afrique enregistre si souvent les détournements de deniers publics, les fraudes et les scandales financiers les plus incroyables. À cet effet, les observations judicieuses de J.-M. Ela (1994, p. 164) font état de ce que « dans l’univers de la fraude, de l’escroquerie et de la supercherie, d’éminentes personnalités politiques sont ébranlées compte tenu de la collusion du pouvoir et de l’argent ». L’actualité récente sur l’implication de nombreux membres de la classe politique comorienne sous les régimes des présidents Abdallah Sambi et Ikililou Dhoinine, de l’ex-président Jacob Zuma de l’Afrique du Sud et de l’ex-ministre du pétrole nigériane, Diézani Alison-Madueke dans les détournements de fonds publics, est un élément qui justifie hélas que le pouvoir est un vecteur d’enrichissement illicite en Afrique. La fortune douteuse d’hommes politiques actuels et d’anciens dirigeants en dit assez long sur ce rapprochement flagrant entre le pouvoir et la richesse matérielle.
De cette analyse, il ressort que la course aux richesses matérielles est ce qui détermine en réalité la politique en Afrique. L’appropriation monopolistique de ces biens éphémères par les dirigeants a pour conséquences directes un désordre politique et un déchaînement de crises sociopolitiques récurrentes.
1.2. L’appropriation monopolistique des biens publics : un abus du pouvoir à l’origine des crises sociopolitiques en Afrique
La politique fondée sur le détournement des biens de la communauté à des fins personnelles aboutit à des travers et des crises sociopolitiques. En effet, les crises sociopolitiques récurrentes qui enfoncent l’Afrique dans l’abîme du désespoir découlent des agissements immatures de certains leaders politiques africains, soucieux de défendre leurs intérêts personnels au détriment de ceux de l’ensemble du peuple. Le système de centralisation excessive du pouvoir politique et économique et le refus de certains dirigeants de rendre des comptes sont des approches courantes, favorisant la primauté de l’intérêt personnel comme méthode de gouvernement en Afrique.
Dans ce contexte, une distribution inégalitaire et injuste des ressources du pays se fait jour : les dirigeants se comportent comme si le patrimoine de l’État leur appartenait en propre. Ils en disposent comme ils l’entendent, les distribuent comme ils le veulent. Le plus souvent, ils en donnent plus à leurs proches, et presque rien aux autres. Les accents de cet absolutisme du pouvoir avaient été indiqués par T. Mendy (2006, p. 71) quand il notait que l’ex-président sénégalais A. Wade s’octroyait « tous les pouvoirs et les droits de décider tout ce qu’il veut, de nommer et de limoger qui il veut, quand il veut et comme il veut ». En un mot, cet ancien dirigeant était comme “le dieu” de sa nation. Comme Wade, la majorité des gouvernants africains se comportent exactement comme s’ils avaient droit de propriété sur leur pays et ses biens, droit de vie et de mort sur leurs concitoyens.
En agissant ainsi, ces leaders africains adhèrent malheureusement à une conception calliclésienne du pouvoir politique apparenté à l’arbitraire, à la domination et à la jouissance personnelle. En effet, pour le Calliclès du Gorgias de Platon (2011, 492c), la vertu des gouvernants consiste à suivre sans résistance leurs propres penchants au point d’être capables, lors d’un partage de ressources, de « donner à leurs amis une plus grosse part » qu’aux autres. Cette approche abusive du pouvoir, contribuant au délitement de l’État, est prégnante en Afrique. Cela fait dire à R. Dussey (2008, p. 65) que « l’appareil d’État en Afrique fonctionne la plupart du temps sur le mode prébendier, parasitaire, c’est-à-dire sur le mode d’un prélèvement d’une rente redistribuée entre les segments de l’élite au pouvoir », des individus du clan, de la région ou du parti. La prédominance de l’intérêt personnel et du sentiment tribal ou partisan fait que « seuls ceux qui appartiennent à la même ethnie que le chef de l’État occupent des postes clés, ‘’juteux’’ pour dilapider les biens de l’État » (R. Dussey, 2008, p. 74).
Dans ce cas, l’idée d’une puissance publique, travaillant pour le bien de l’ensemble des citoyens, n’est plus à l’ordre du jour. Les richesses nationales sont partagées entre une poignée d’individus, laissant pour compte la majorité des citoyens. Or, un gouvernement ou une cité « qui fait de l’accumulation illimitée des richesses une fin en soi ne peut éviter à terme le courroux de la majorité appauvrie » (A. Nguidjol, 2008, p. 65). Car, tous les autres citoyens vivant dans l’indigence et la précarité, à la réserve des dirigeants et de leurs proches, ne resteront pas sans réactions. Ces populations laissées pour compte sont souvent à l’origine des mouvements de révolte conduisant à de graves violences.
Cette atmosphère sociale favorise quelque fois la tentative ou la prise du pouvoir d’État par l’armée ; ce qui ne complique pas moins la situation d’instabilité, de désordre et de division dans l’État ou dans la cité. Le Platon (2011, 551d) de la République dira qu’« une telle cité, nécessairement, ne sera pas une cité, mais deux : une cité des pauvres, une cité des riches, habitant en un même lieu et conspirant constamment les uns contre les autres ». C’est dire que l’appropriation des biens communautaires par une frange de la population conduit bien évidemment à des mécontentements, des frustrations et des révoltes. L’unité nationale, en ce sens, sera fragilisée et il en résultera une fracture sociale opposant la minorité riche à la majorité pauvre.
Il n’est donc pas abusif d’admettre avec H. Mahicka, (2018, p. 156) qu’en Afrique, « l’accaparement de la rente est au cœur des conflits politiques ». La gestion opaque des richesses nationales conduit de toute évidence à des violences destructrices qui ruinent la stabilité des États, et établit pour vraie la thèse selon laquelle« tout système politique reposant entièrement sur l’intérêt personnel (…) ne peut être stable pendant bien longtemps » (S. Diakité, 2016, p. 18). Cela signifie qu’il importe de se convaincre que là où triomphe l’égoïsme politique, la révolution et les soulèvements populaires finissent inéluctablement par s’y manifester. Ce fût le cas récemment au Burkina Faso où, le peuple, exaspéré, a fini par se soulever pour mettre fin au régime de Blaise Compaoré. Le refus du partage du pouvoir et de ses biens entraîne bien souvent la naissance des maux sociaux.
Voilà pourquoi, les crises sociopolitiques, les guerres civiles liées aux antagonismes tribaux ou à des intérêts divergents au sein d’un même État sont quasiment la norme en Afrique. Pour leurs intérêts personnels, certains leaders politiques laissent des groupes sociaux s’opposer et se livrer à des affrontements sanglants. La misère et la frustration s’ensuivent ; et celles-ci deviennent encore plus insupportables quand l’on se rend compte que les gouvernants imposent, par des procédés habilement élaborés, leurs successeurs, dans l’optique d’assurer encore leur place dans cet univers de kleptocrates, même lorsqu’ils n’assumeront plus directement les charges publiques. Ainsi, la misère du peuple sécrétée par le mal politique de l’égoïsme économique conduira assurément à des affrontements fratricides. Car, l’exploitation et la réification d’un groupement humain ne peuvent se faire impunément.
En somme, la confiscation et l’utilisation des ressources matérielles de la communauté à des fins personnelles justifient l’absolutisme et la dictature de la plupart des dirigeants politiques africains. Une telle attitude méprisante expose le continent à de nombreuses crises sociopolitiques dévastatrices et meurtrières. C’est pourquoi, pour Platon, il est « essentiel à la rectitude politique que la même classe ne soit pas détentrice à la fois du pouvoir politique et de la richesse » (M. Canto-Sperber, 2001, p. 176). La philosophie politique de Platon apparaît alors, à bon droit, comme un modèle servant à élaborer une pratique politique susceptible d’assurer l’épanouissement des citoyens des États africains.
2. La politique chez Platon comme architecture paradigmatique : pour une pratique politique vertueuse en faveur de l’intérêt commun en Afrique
La scène que présente la politique africaine est encore insatisfaisante. Les citoyens qui investissent ce champ ne s’en font pas toujours une idée assez exacte. La preuve est qu’ils sont plus enclins à se servir eux-mêmes, alors qu’ils devraient, comme l’entend Platon, gérer les intérêts de la communauté entière, en prendre soin ; de sorte à favoriser l’émergence de citoyens vertueux et utiles à la construction de leur État.
2.1. L’activité politique comme soin de la communauté chez Platon
Contrairement à son acception africaine, l’activité politique est perçue par Platon comme une entreprise orientée vers le bien de la collectivité. Sa vocation est avant tout d’être altruiste, en ce sens qu’elle ne vise guère prioritairement les intérêts du politique lui-même, mais de ceux en faveur desquels est exercée l’action politique. Cette vérité est mise en relief par M. Dixsaut (2016, p. 566) lorsqu’elle affirme que « l’action politique n’a aucun effet (…) sur celui qui l’exerce (…). Elle a pour finalité le bien des gouvernés, non celui du gouvernant ». Autrement dit, l’exercice politique véritable est plus une question de responsabilité envers les gouvernés qu’un simple privilège, qui fait du dirigeant un chef usant de sa position pour réaliser ses propres desseins et ambitions matérielles.
Dans la perspective platonicienne, l’art politique n’est jamais en rupture avec l’idée de soins à apporter aux concitoyens en vue de leur pleine réalisation. En fait, pour Platon, la technique politique est un art spécifique qui trouve sa justification dans l’obligation qu’ont les hommes d’organiser dorénavant leur vie à partir du moment où le retrait des divinités créatrices et dirigeantes s’est vu établir. Ainsi, en s’aidant du mythe cosmologique du Politique, Platon (2011, 274d) souligne cette nécessité de l’organisation politique en ces termes : « Lorsque les hommes furent privés de la providence qu’assurèrent les dieux, (…) ils durent apprendre à se conduire par eux-mêmes et à prendre soin d’eux-mêmes ». En d’autres mots, la politique est une œuvre humaine calquée sur le modèle du soin divin, en vue du bien-être de la communauté. En tant qu’aide à l’auto-détermination, l’activité politique vise à remédier à la situation d’abandon dans laquelle se trouve l’homme, en tissant la cité en un tout unifié. C’est dire qu’elle prend soin des citoyens et des lois dans l’optique d’unifier en un tissu, les caractères opposés qui risquent d’installer la division dans la communauté.
Les avatars des conflits sociopolitiques d’Athènes ont conduit Platon à vouloir introduire un nouvel ordre dans la politique. Et « ce nouvel ordre politique implique une cité où les citoyens se comporteraient de manière excellente » (L. Brisson, 2017, p. 134). En d’autres termes, l’espoir du rétablissement de l’ordre politique passe inévitablement par la voie de la réforme des citoyens. Voilà pourquoi, l’introduction de l’excellence dans le comportement citoyen est justement l’une des tâches essentielles du vrai politique. Ce dernier a la responsabilité de créer les conditions d’un progrès social en assurant et en veillant sur l’éducation de ses concitoyens. C’est dire qu’il a le devoir de les rendre meilleurs, de contribuer au changement de leur mode de vie. F. L. Lisi (2006, p. 234) a raison de noter que la politique est perçue, par Platon, comme « une technique essentiellement formatrice, qui doit rendre l’âme meilleure au moyen de l’éducation ». Il en ressort que la science politique a pour fin ultime le traitement de l’âme humaine en vue de sa bonification.
En tant que véritable science thérapeutique, la politique est à l’âme ce que la médecine représente pour le corps. Ce rapprochement entre la politique et la médecine souligne que l’homme d’État ne se contentera pas seulement de gouverner, mais devra faire une vraie œuvre d’éducation en administrant des soins appropriés au corps politique. Dans ce sens, écrit J. Lombard (1999, p. 36-37), « l’éducation même, qui est au cœur de la politeia, le mouvement par lequel se forment les citoyens, est un traitement en vue de l’excellence et de la vertu, comparable à celui que prescrit le médecin en vue de la santé ». La politique consiste donc principalement à prendre soin de la communauté en l’éduquant à la vertu. Le lien que la politique entretient avec l’éducation sous-entend que la cité elle-même se trouve dans un état pathologique. Et c’est la raison pour laquelle elle a besoin d’avoir à sa tête un politique thérapeute, et non un politique sangsue qui aggraverait davantage son état de morbidité. Une telle analyse émane du fait que, selon Platon, le gouvernant est l’homme qui a reçu, lui-même, une éducation lui permettant d’être au service de sa cité. Cette éducation aura forgé en lui des dispositions particulières lui donnant de sacrifier ses intérêts personnels au bénéfice de ceux de sa cité.
À cet égard, le politique, dans la vision platonicienne, est tout l’opposé de son homologue africain pour qui l’exercice de la gouvernance politique confère quantité de richesses matérielles ; lesquelles contribuent, à leur tour, à augmenter la puissance, à conserver et à consolider le pouvoir politique du leader. Si l’idée de ce cycle de prédation politico-économique rédhibitoire est fermement maintenue en terre africaine, pour Platon, par contre, le politique doit s’engager non seulement à assurer la sécurité collective des citoyens, à favoriser la construction d’un environnement social harmonieux, mais surtout à forger le sens moral de toute la communauté.
Dans l’Apologie de Socrate, l’invitation que lançait Platon (2011, 29d-e) au citoyen athénien s’inscrivait dans cette perspective morale : « Athénien (…), n’as-tu pas honte de te soucier de la façon d’augmenter le plus possible richesses, réputation et honneurs, alors que tu n’as aucun souci de la pensée, de la vérité et de l’amélioration de ton âme, et que tu n’y songes même pas ? ». Pour le fondateur de l’Académie, le citoyen tout comme le politique doit accorder la priorité au développement de sa vie intérieure plus qu’au progrès de sa vie matérielle ; car, l’humain, à la différence des autres êtres, est essentiellement caractérisé par son âme.
La formation morale de l’âme, qui se confond proprement au sens platonicien avec la politique, affranchit des penchants et des passions les plus sauvages, et permet l’éclosion de la vertu dans la cité. Dans ce contexte, « le but de la politique n’est donc ni la conquête, ni l’enrichissement général, mais la vertu collective » (M. Prélot et G. Lescuyer, 1984, p. 62). En faisant de la formation à la vie vertueuse l’objectif principal de l’activité politique, Platon a tracé de toute évidence les conditions d’une renaissance politique dans les cités en général ; et celles-ci peuvent être particulièrement utiles à l’Afrique.
2.2. La promotion des valeurs morales et de l’intérêt commun : gage de la renaissance politique en Afrique
La passion que les gouvernants éprouvent pour les richesses matérielles constitue un réel acte préjudiciable au progrès de la politique en Afrique. Elle justifie, au sein des États, l’existence de cycles de violence, de dictature, de tribalisme, de scènes ignominieuses de corruption et de détournements récurrents de fonds publics. Au regard de la prolifération de ces fléaux et crises de tous ordres en Afrique, il est loisible d’affirmer que les hommes politiques n’ont pas encore compris le sens des propos du Platon (2011, 66c) du Phédonselon lequel, « les guerres ont pour origine l’appropriation des richesses ».
Car, lorsqu’un dirigeant et ses proches, manquant de sens du partage, accaparent les richesses de l’État, ils exposent ipso facto les autres membres à la misère et rabaissent la condition humaine. Dans la République, Platon (2011, 552d) laisse bien entendre, à cet égard, que la mendicité régnante de la cité est l’effet de la présence des gouvernants véreux et égoïstes tels « des voleurs, des coupeurs de bourses, (…) et des auteurs de toute espèce de maux de ce genre », dont l’action maligne contraint les citoyens à une vie de mendicité extrême. De telles bassesses qui délitent les relations humaines révèlent la faiblesse de la politique africaine. Cela instruit sur l’idée qu’en Afrique, la politique et les valeurs morales s’excluent mutuellement ; mieux, que les biens matériels représentent la vertu politique même.
En faisant allusion à cette idée, C. Yahot (2015, p. 202) tire la conclusion selon laquelle, en Afrique, « le dirigeant politique, en tant que gardien des valeurs républicaines, d’une part, et concepteur d’un programme de développement national, d’autre part, n’existe pas véritablement, ni dans l’esprit et encore moins dans la pratique ». Il en ressort que, parce qu’évoluant en dehors d’un cadre axiologique convenable, la politique africaine demeure encore malheureusement une politique induisant la misère des peuples.
Au regard du penser platonicien, cette vision, à caractère matérialiste, est l’indice d’une vraie décadence politique. Il faudra donc la réorienter vers la recherche de l’intérêt commun et la promotion des vertus morales, seules véritables richesses susceptibles de garantir la restauration politique d’une cité. Il en résulte que les États qui visent une renaissance politique devront mettre à leur tête des gouvernants qui font de la vertu et de la promotion de la gestion des ressources matérielles dans l’intérêt général les principes politiques suprêmes. Et seuls ces leaders auront le statut de gens véritablement riches. À ce sujet, Platon (2011, 520e-521a) écrit :
Si tu peux découvrir, pour ceux qui s’apprêtent à diriger, une vie meilleure que le pouvoir, tu peux alors faire advenir une cité bien administrée. C’est en effet dans cette cité seulement que dirigeront ceux qui sont réellement riches : riches non pas d’or, mais de cette richesse qui est nécessaire à l’homme heureux, c’est-à-dire une vie bonne et remplie de sagesse.
La vie bonne et pleine de sagesse, c’est-à-dire la vie vertueuse est ce qui donne à la politique sa rectitude et conduit l’homme d’État à émettre des jugements éclairés, à poser des actions allant dans le sens de la prospérité sociale. Elle lui procure un profond sens de discernement et lui permet de suivre les règles de ce qui vaut le mieux pour lui-même et pour ses concitoyens. C’est en ce sens que, pour Platon, le dirigeant idéal est sans nul doute le philosophe ; car, la sagesse, qui habite comme une lumière l’âme de ce dernier, lui permet de délibérer en connaissance de cause, c’est-à-dire en direction des « choix les plus justes » (R. Bonan, 2014, p. 36) et d’élaborer des projets viables pour le bonheur de tous. La vertu de sagesse peut donc anoblir la politique africaine. C’est pourquoi, les politiques africains devront comprendre la nécessité de poser de nouveaux leviers en rapport avec une saine révision de la hiérarchie de leurs valeurs. En la matière, les vertus morales telles que la sagesse, la tempérance, le courage, la justice, et non le principe économique, devront constituer les repères essentiels de la vie politique.
L’usage de la vertu de tempérance, par exemple, aidera le politique à observer la mesure dans l’acquisition des richesses matérielles ; puisque la tempérance est la qualité qui assure la soumission des désirs à la raison humaine. Dans l’Alcibiade, en s’y référant, Platon (2011, 134b) déclare au jeune Alcibiade, candidat à la gouvernance politique athénienne, que ce n’est pas « en devenant riche qu’on se délivre du malheur, mais en devenant tempérant ». C’est dire que la passion des richesses n’est pas toujours la carte d’accès au bonheur, et la possession d’une grande fortune peut conduire dans le piège d’une grande servitude. Elle représente une menace pour le principe d’association politique, car elle fait oublier à son possesseur, obnubilé par ses biens personnels, les élans de solidarité, d’entraide et d’altruisme. En un mot, elle empêche les dirigeants d’être vertueux et de poser des actions allant dans le sens de l’intérêt de la collectivité.
Considérant que la trop grande fortune agit comme un maître despote, « Platon légitime la recherche d’une fortune à laquelle l’homme ne deviendra guère simple serviteur » (A. Marouani, 2010, p. 136). La vertu de tempérance aidera donc le politique à la retenue, en le délivrant de l’orage et de l’esclavage des passions des richesses. Convaincu ainsi que la décadence sociopolitique et morale relève d’une causalité économique, le philosophe Platon conseille humblement que la vertu politique réside dans la stricte limitation des biens matériels et dans des interventions favorisant l’épanouissement ou le bien-être commun des citoyens.
La vie politique vertueuse sera donc également liée à la question de la responsabilité politique des gouvernants des États, c’est-à-dire du devoir, pour ces derniers, de répondre des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le contexte africain, « cela suppose que chaque acteur mesure la plénitude de ses responsabilités et qu’il comprenne que chaque pas qu’il pose est un pas sacré pour son pays et que l’histoire de ce pas est l’histoire – pour – l’Afrique » (S. Diakité, 2014, p. 10). Cet appel à la vertu de responsabilité est une épître adressée à l’homme politique en vue de changer de paradigme, de l’inviter à poser des actes sensés à l’égard de ses concitoyens, et d’œuvrer ainsi pour la restauration de l’image de la politique en Afrique.
La destinée des peuples dépend en grande partie de la qualité des actions de leurs dirigeants. Pour cela, les dirigeants africains doivent définitivement rompre avec ce désir malsain d’exploiter et de dépouiller les gouvernés. Ils devront user de transparence dans la gestion des affaires publiques. Leur responsabilité se confinera à « assumer la production de biens et de services publics en conformité avec les besoins des populations et au profit de celles-ci » (M. Koulibaly, 2011, p. 79). Conduites par une haute éthique de la responsabilité, ces élites dirigeantes devront jouer uniment leur rôle de régulateur de la société, en faisant du sens du partage, de la générosité quelques principes directeurs de leur action gouvernementale. À l’opposé de cette idée, la transformation de la politique en une activité lucrative ou en une entreprise de défense d’intérêts personnels est bien un idéal biaisé et condamné à l’infécondité. Elle est tout le contraire d’un idéal de justice, susceptible d’instaurer la droiture et l’ordre au sein de la communauté politique.
La vraie pratique politique garde de la distance vis-à-vis d’une accumulation illimitée des biens matériels, tout en promouvant les valeurs morales de tempérance, de justice, du partage. Or, lorsque malheureusement l’homme d’État devient un possédant, il sera porté à diriger pour son propre avantage et non plus dans l’intérêt de l’État. Le politique africain devra se rendre à l’évidence que le souci de la gouvernance et celui de l’enrichissement personnel sans limite ne font très souvent pas bon ménage. À ce propos, Platon (2011, 550e-551a) fait remarquer ce qui suit :
N’y a-t-il pas entre la richesse et la vertu une différence telle que, si on se les représente posées l’une et l’autre sur les plateaux d’une balance, elles exercent leur pesée toujours dans un sens opposé ? (…). Si la richesse est honorée dans une cité, et aussi les riches, la vertu y sera moins honorée, de même que les gens de bien.
L’argumentation platonicienne laisse comprendre que les biens matériels et les vertus morales sont des valeurs antagoniques. Ainsi, lorsqu’un homme d’État fait de la quête des richesses la valeur absolue de la vie politique, il cesse d’être vertueux, et expose son État à la ruine. Car, dès lors que coïncident le désir de diriger et celui de s’enrichir, la politique perd de sa pureté, et se laisse, pour ainsi dire, revêtir de souillures. La voix de la sagesse de l’Apologie de Socrate laisse entendre, à cet effet, que « la fortune ne fait pas la vertu, mais que de la vertu provient la fortune et tout ce qui est avantageux, soit aux particuliers, soit à l’État » (Platon, 2011, 29d-30b). La vertu, c’est-à-dire la disposition au bien, a donc l’avantage d’assurer l’épanouissement complet de la cité. Aussi, dans tous les domaines et secteurs d’activité, l’absence de vertu ou d’excellence conduit-elle à poser des actes vicieux et destructeurs. Pour cela, le politique doit, à travers l’éducation civique, privilégier la vertu sociale.
Or, si l’on part du principe selon lequel un homme ne donne que ce qu’il possède, on consentira que le politique lui-même devra posséder la vertu qu’il aura à transmettre. C’est pourquoi, les vertus de justice, de tempérance, de courage et de sagesse ne devront ni être ignorées ni manquer au dirigeant africain. Ce dernier devra viser la recherche du bien commun. Il devra comprendre que les biens nationaux appartiennent à la communauté entière et que tous doivent donc en bénéficier. À l’instar du philosophe-roi ou du roi-philosophe de Platon, le gouvernant africain devra donc privilégier l’intérêt supérieur de la collectivité, en cherchant chaque fois à satisfaire ses attentes. Il sera, pour ce faire, exclusivement au service de ces concitoyens, s’attachant à l’amélioration de leurs conditions socio-économiques (emploi, éducation, santé, habitat, etc.), faisant une répartition rationnelle et un bon usage des ressources publiques. C’est dans la stricte observation de ces conditions que la politique en Afrique restaurera son image ternie par la maladie politique chronique de l’enrichissement matériel personnel.
Conclusion
En définitive, notons qu’il était question de montrer, à la lumière du penser platonicien, que la politique en Afrique entretient un lien direct avec les richesses matérielles, de sorte que l’engagement politique s’y révèle comme un véritable vecteur d’enrichissement matériel personnel. Cela justifie, au sein des États, la récurrence d’actes de corruption, de détournement et d’appropriation des biens publics à des fins personnelles. Cette pratique politique est à l’origine des pouvoirs dictatoriaux, des frustrations des peuples et des crises sociopolitiques regrettables. Eu égard à la pensée politique de Platon, il est loisible de dire que de tels égarements sont dus à l’ignorance du véritable but de la politique, comme soin de la communauté. Selon Platon, en effet, en tant qu’art qui se propose de prendre soin des âmes des citoyens, la politique a naturellement pour socle la morale et l’intérêt général. C’est pourquoi, les valeurs morales telles que la sagesse, la tempérance, la justice, le courage, l’altruisme, le partage seront les vraies richesses qui ne devront aucunement manquer au politique. Qui plus est, les conditions du bonheur public imposent que les dirigeants politiques changent leur mode de gestion de la chose publique. Le pouvoir politique ne doit pas donner l’occasion de jouir personnellement des biens publics au détriment des intérêts des populations. Il est impératif que les ressources matérielles des États aient une destination communautaire. Les politiques africains gagneraient donc à tourner le dos au détournement de deniers publics à des fins personnelles, en vue d’une plus juste redistribution des ressources étatiques. Ce faisant, ils assureront l’épanouissement des citoyens et la renaissance politique dans les États africains.
Références bibliographiques
BONAN Ronald, 2014, Platon, Paris, Les Belles Lettres.
BRISSON Luc, 2017, Platon, Paris, Cerf.
CANTO-SPERBER Monique, 2001, Éthiques grecques, Paris, PUF.
COHEN Daniel, 2010, Richesse du monde, Pauvretés des nations, Paris, Flammarion.
DIAKITÉ Samba, 2014, Politiques Africaines et Identités. Des liaisons dangereuses, Québec, Différence Pérenne.
DIAKITÉ Samba, 2016, Révolutions et développement. Pour une philosophie de l’émergence en Afrique, Québec, Différence Pérenne.
DIXSAUT Monique, 2016, Le naturel philosophe. Essai sur les Dialogues de Platon, Paris, Jean Vrin.
DUSSEY Robert, 2008, L’Afrique malade de ses hommes politiques, Paris, Jean Picollec Éditeur.
ELA Jean-Marc, 1994, Afrique : l’irruption des pauvres. Société contre Ingérence, Pouvoir et Argent, Paris, L’Harmattan.
FADIGA Kanvaly, 1998, Stratégies africaines d’éducation et de développement autonome, Abidjan, CEDA.
KABOU Axelle, 1991, Et si l’Afrique refusait le développement ?, Paris, L’Harmattan.
KOULIBALY Mamadou, 2011, La responsabilité politique. Le cas de la Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan.
LISI Francisco Leonardo, 2006, « La politique platonicienne : le gouvernement de la cité », Luc Brisson et Francesco Fronterotta (sous la direction de), Lire Platon, Paris, PUF, p. 231-247.
LOMBARD Jean, 1999, Platon et la médecine. Le corps affaibli et l’âme attristée, Paris, L’Harmattan.
MAHICKA Hervé, 2018, L’Afrique une promesse. Comment l’Afrique s’éveillera, Paris, Michalon Éditeur.
MAROUANI Ahmed, 2010, Platon et l’homme dans les derniers Dialogues, Paris, L’Harmattan.
MENDY Toumany, 2006, Politique et puissance de l’argent au Sénégal. Les désarrois d’un peuple innocent, Paris, L’Harmattan.
NGUIDJOL Antoine, 2008, PLATON : le procès de la démocratie africaine, Paris, L’Harmattan.
PLATON, 2011, « Alcibiade », Œuvres Complètes, traduction de Jean-François Pradeau et de Chantal Marboeuf, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, « Apologie de Socrate », Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, « Gorgias », Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson et de Monique Canto-Sperber, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, « Phédon », Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson et de Monique Dixsaut, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, « Politique », Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson et de Jean-François-Pradeau, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, « République », Œuvres Complètes, traduction de Georges Leroux Paris, Flammarion.
PRÉLOT Marcel et LESCUYER Georges, 1984, Histoire des idées politiques, Paris, édition Jurisprudence générale, Dalloz.
ROGUE Christophe, 2005, D’une cité l’autre. Essai sur la politique platonicienne, de la République aux Lois, Paris, Armand Colin.
SPECTOR Céline, 1997, Le Pouvoir, textes choisis et présentés, Paris, Flammarion.
YAHOT Christophe, 2015, Réflexions sur la Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan.
MONTESQUIEU, PHILOSOPHE ANCIEN OU MODERNE ?
Daniel Chifolo FOFANA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Simone Goyard-Fabre pense que Montesquieu n’est pas un philosophe de la Modernité mais, plutôt, un philosophe ancien. La préoccupation fondamentale dans le présent article est de savoir si la pensée de Montesquieu est ancienne ou moderne. Nous voudrions pousser la réflexion plus loin pour montrer que les critiques de la philosophe Simone Goyard-Fabre adressées à Montesquieu sont discutables et ont des limites. Montesquieu est bel et bien un philosophe de la Modernité eu égard à l’actualité de la théorie de la séparation des pouvoirs de l’État et de son analyse critique sur la révolution scientifique et technique. Cette idée nous conduit à montrer, d’une part, les fondements de la méconnaissance de Montesquieu comme philosophe de la Modernité. Et, d’autre part, il s’agira de réfuter les critiques de Simone Goyard-Fabre selon lesquelles Montesquieu ne serait pas un philosophe de la Modernité.
Mots-clés : Ancien, actualité, État, Modernité, forts discutables, philosophe, séparation des pouvoirs, science et technique.
Abstract :
Simone Goyard-Fabre thinks that Montesquieu is not a philosopher of Modernity but, rather, an ancient philosopher. The basic concern in this article is whether Montesquieu’s thought is ancient or modern. We would like to go further to show that the criticisms of the philosopher Simone Goyard-Fabre addressed to Montesquieu are debatable and have limits. Montesquieu is indeed a philosopher of Modernity with regard to the actuality of the theory of the separation of powers of the state and its critical analysis of the scientific and technical revolution. This idea leads us to show, on the one hand, the foundations of Montesquieu’s misunderstanding as a philosopher of Modernity. And, on the other hand, it will be necessary to refute the criticisms of Simone Goyard-Fabre according to which Montesquieu would not be a philosopher of Modernity.
Keywords : Old, current, State, Modernity, arguable fortunes, philosopher, separation of powers, science and technology.
Introduction
Pour S. Goyard-Fabre (1993, p. 343), « par son plaidoyer pour la liberté, Montesquieu est apparu à des nombreux commentateurs comme un philosophe politique dont la pensée serait l’un des phares de la Modernité ».Cependant, selon la philosophe(1993, p. 343),« Montesquieu ne trouve pas sa place dans cette philosophie de la « Modernité » qui, à l’époque où les Lumières s’allument sur l’Europe, célèbre à l’envie les puissances de la raison conquérante par laquelle les hommes vont se rendre « maîtres et possesseurs de la nature » ». Il ressort de ce passage que Montesquieu a, certes, développé de grandes théories sur la liberté mais cela ne saurait faire de lui un philosophe de la Modernité à l’ère des Lumières où la raison demeure le moyen pour l’homme d’être « maîtres et possesseurs de la nature ». Pour s’en convaincre, S. Goyard-Fabre invoque Lévis Strauss :
Il est certes exact, comme le remarque Lévis Strauss que, ayant dépeint deux idéaux politiques opposés la république romaine dont le principe est la vertu, et la monarchie constitutionnelle anglaise dont le principe est la liberté politique, il accorde sa préférence au second modèle : il [c’est-à-dire Montesquieu] pense que celui-ci correspond au genre de vie dont la société ouverte de l’Europe du XVIIIe siècle a besoin parce que les hommes y sont en train, dans la vie politique comme dans le commerce juridique, de se hausser à la conscience d’eux-mêmes (S. Goyard-fabre1993, p. 343).
S. Goyard-Fabre ne croit pas que les analyses politiques de Montesquieu sur la monarchie constitutionnelle anglaise ont participé à la Modernité, voire à l’éclosion d’un éveil de conscience dans le domaine du droit politique en Europe.
Ainsi, ceux qui considèrent l’auteur de De l’esprit des lois comme un philosophe de la Modernité se trouvent désavoués. Le problème qui se pose est donc le suivant : Montesquieu peut-il être considéré comme un philosophe de la Modernité ? En termes plus clairs, peut-on attribuer le titre de philosophe de la Modernité à Montesquieu ? L’analyse de cette interrogation conduit aux questions suivantes : Pourquoi S. Goyard-Fabre refuse-t-elle de reconnaitre Montesquieu comme un philosophe de la Modernité ? L’auteur de De l’esprit des lois n’est-il pas l’un des célèbres philosophes de la Modernité ?
L’intention fondatrice de cette recherche est de montrer, à partir d’une méthode analytique et critique, que contrairement à ce que pense S. Goyard-Fabre, Montesquieu remplit les conditions de philosophe de la Modernité. Mieux, la philosophe se trompe lorsqu’elle ne reconnaît pas Montesquieu comme philosophe de la Modernité. Pour le justifier, on montrera dans la première partie du présent travail, les fondements du refus de l’attribution du titre de philosophe de la Modernité à Montesquieu. Dans la deuxième partie, il sera question de réfuter la pensée selon laquelle Montesquieu ne serait pas un philosophe de la Modernité.
1. Montesquieu comme un philosophe de la Modernité : La contestation de la philosophe Simone Goyard-Fabre
S. Goyard-Fabre refuse de reconnaître Montesquieu comme un philosophe de la Modernité. Elle classe l’auteur de De l’esprit des lois, parmi les philosophes anciens. Selon elle, la pensée de Montesquieu ne participe pas à la modernité. Voici les propos qui le signifient clairement :
Dans un souci constant de l’homme, il [c’est-à-dire Montesquieu] le place, comme le faisaient les Anciens, au sein de la totalité cosmique dont les Grecs avaient vanté l’harmonie. La loi de décadence que l’histoire des romains lui a révélée lui fait redouter que l’homme, en s’accordant trop d’importance par sa volonté d’autonomisation, ne procède à la dévastation de l’ouvrage du créateur. Pour sauver l’homme dont il craint qu’il ne se soit engagé, comme le montrent la marche de l’histoire et le destin des politiques, sur un chemin de perfection, il faut retrouver les principes : renouer avec la nature primordiale des choses, parce que c’est en elles, et non les griseries d’un rationalisme artificialiste, que réside la vérité de la vie humaine. Il n’est donc guère douteux que, songeant à la politique de l’avenir, Montesquieu, dans une espèce de néo-stoïcisme, préfère “la liberté des Anciens” à la “liberté des Modernes. (S. Goyard-Fabre, 1993, p. 347-348).
Les présentes déclarations montrent que Montesquieu suit le chemin des Anciens qui plaçaient l’homme en harmonie avec la nature ou le cosmos. De l’histoire de la décadence des Romains, il forge l’idée que l’homme, abandonné à lui-même et à sa raison, finira par détruire l’œuvre de Dieu. Ainsi, la seule condition pour le salut de l’homme, c’est de vivre en symbiose avec les principes de la nature, car la vérité et le bonheur ne sont pas consubstantiellement liés à la raison humaine. En effet, pour S. Goyard-Fabre, Montesquieu rappelle la philosophie des stoïciens qui préconise que l’homme s’abandonne à la nécessité parce que sa vie et sa liberté ne lui appartiennent pas mais, sont en symbiose avec le cosmos. Ainsi, engouffré dans son stoïcisme nouveau, Montesquieu préfère la liberté des Anciens à celle des modernes. Cela revient à dire que, Montesquieu, en pensant la liberté dans le moule des Anciens, n’est pas un vrai philosophe de la Modernité.
« La problématique de la liberté à laquelle Montesquieu a consacré toute sa vie n’est étrangère (…) ni à la mise en œuvre des procédures expérimentales (…) la leçon qu’il dégage (…) n’est pas celle qui conduira (…) à glorifier les victoires de la raison » (S. Goyard-Fabre 1993, p. 343). Même si, Montesquieu utilise une méthode logique et cohérente en symbiose avec la méthode des sciences expérimentales et surtout avec la philosophie newtonienne qu’il a tant appréciée, la science qu’il développe en tant que philosophe ne cadre pas avec la pensée des modernes. Par conséquent, elle ne peut conduire à la victoire de la raison dans le monde (à l’image de la science Newton et de Galilée). Pour S. Goyard-Fabre (1993, p. 344), l’auteur de De l’esprit des lois « est donc il le dit lui-même et il le fait croire le penseur des principes, celui qui a besoin de rattacher l’œuvre des hommes leurs mœurs et leurs lois à une philosophia prima, qui ne peut être qu’une pensée fondamentale » Car, « les fondements des lois ne se voient pas, ils ne se représentent pas ; ils se pensent et ils se comprennent : des lois du monde, ils sont l’esprit, ce qui les rend intelligibles et leur confère leur dignité normative » (S. Goyard-Fabre,1993, p. 344). Il ressort que Montesquieu demeure attaché à la philosophie de l’esprit, voire à l’idéalisme. Ce qui ne signifie rien d’autre qu’il s’éloigne de la philosophie des modernes et du matérialisme[2] moderne.
C’est pourquoi, S. Goyard-Fabre (1993, p. 344), pense qu’« on pourrait (…) songer à la silhouette exemplaire de la République platonicienne. Néanmoins, Montesquieu préfère le modèle aristotélicien parce que, dans la grande Nature qu’observait le stagirite, c’est l’homme, en définitive, qu’il rencontrait toujours ». En d’autres termes, la philosophie de Montesquieu s’apparente à l’idéalisme de Platon. Mais, il demeure rattaché à Aristote qui met l’homme au centre de la réflexion philosophique. « Montesquieu est trop (…) subtil pour conclure (…) que les hommes sont soumis à la nécessité (…). Il n’adopte pas cette démarche épistémologique (…) de la connaissance (…) dont la finalité est explicative »(S. Goyard-Fabre, 1993, p. 345). En d’autres termes, c’est à la fois étonnant et surprenant que le nommé Montesquieu, philosophe moderne, soumet les hommes à la nécessité de la nature ou à la loi du cosmos. En principe, il devrait être un philosophe de son temps, et s’atteler à tout démontrer rationnellement.
Or, Montesquieu s’emprisonne dans une « démarche inductive » (B. Groethuysen, 1956, p. 126) qui admet les faits indéterminés ou irrationnels. À ce titre, Montesquieu apparaît comme le philosophe qui n’établit que des principes dans la société. S. Goyard-Fabre (1993, p. 345), l’énonce clairement : « Nous l’avons dit : il [c’est-à-dire Montesquieu] cherche à établir les principes qui meuvent la politique et ses diverses figures ». Mais qu’entend-t-on par principes ? Ici, les principes sont les règles morales. L’auteur de De l’esprit des lois est donc celui qui se préoccupe à élaborer des règles morales dans la vie politique dont la validité est admise sans être véritablement démontrée. Pour la logique du rationalisme, ce n’est pas moderne le fait de ne pas rationnellement démontrer les choses, mais de montrer dans les us et coutumes les usages moraux.
C’est le lieu pour S. Goyard-Fabre de signifier que l’auteur de De l’esprit des lois ne mérite pas d’être un philosophe de la Modernité. Car, à l’ère de la Modernité, à laquelle il prétend appartenir, tout doit s’expliquer raisonnablement et rationnellement. Mieux, la raison doit être la lumière centrale en l’homme qui lui permet dans le même temps de connaître, de comprendre le sens et la raison des choses du monde. Ainsi, contre Montesquieu, S. Goyard-Fabre (1993, p. 346), a pu écrire : « Montesquieu ne construit pas une « science » du politique ; il pratique un art (…) des « Anciens », (…) Au milieu des philosophes (…) rattachés à la rationalisation (…) il (…) vante (…) la modération ». Au regard de la présente déclaration, il ressort que Montesquieu n’a jamais été fondateur d’une « science du politique » à l’instar de Machiavel ou de Hobbes. Il ne fait que développer comme les « Anciens » une philosophie de l’esprit qui aboutit à un « idéal politique ». Selon S. Goyard-Fabre, les philosophes du XVIIIe siècle auquel Montesquieu appartiendrait, se sont adonnés au principe rationnel de la faculté de juger, c’est-à-dire à une explication épistémologique, rationnelle ou scientifique des phénomènes du monde. Seul, parmi eux, Montesquieu demeure fidèle à « la promotion des vertus, du juste milieu et de la modération » (S. Goyard-Fabre, 1993, p. 346).
Ainsi, pour l’auteur (1993, p. 346) « au cœur de la “Modernité “, l’œuvre de Montesquieu participe de l’esprit des « Anciens » ». Elle est emprisonnée « dans le contexte classique où la sociabilité (…) est (…) naturelle, où la liberté (…) est affaire de vertu et de devoir (…) où la santé de la société n’est pas le résultat de calculs théoriques (…) mais s’apprécie selon des critères de sagesse » (S. Goyard-Fabre, 1993, p. 347). La philosophie de Montesquieu, ici, coïncide avec l’école des « Anciens » qui enseigne que l’avènement de la société est naturel, que la liberté ne donne pas droit de faire ce que l’on veut, que les lois doivent répondre au souci de conformité aux normes sociales couramment acceptées.
Quant à la vie en communauté, loin des « calculs théoriques », elle se renforce et se caractérise par la sagesse et la modération. Sur fond de cela, S. Goyard-Fabre pense que « Montesquieu s’écarte de l’inflation spéculative et théorisante qui envahit la philosophie de son siècle (…) Comme Aristote, il pense la politique par rapport à des êtres naturels qui ont une fin et une destination naturelle » (S. Goyard-Fabre, 1993, p. 346-347). Cela signifie que, Montesquieu ne philosophe pas en moderne mais en ancien dans la mesure où il pense comme Aristote, que la vie politique est naturelle et qu’elle obéit à un destin.
« « De l’Esprit sur les lois » (…) il rejoint (…) Aristote et, penseur (…) des « questions fondamentales ». (…) Dans (…) la justice naturelle (…) il découvre (…) la destinée des hommes. Les chemins de la liberté sont ceux qui remontent des lois à la Nature » (S. Goyard-Fabre, 1993 p. 349). Autrement dit,« les lois civiles et politiques ne médiatiseront la liberté des hommes quand la relativité de leurs maximes positives respectent l’universalité de la loi naturelle » (S. Goyard-Fabre, 1993 p. 349). Bien entendu, dans la réflexion sur les questions fondamentales, Aristote devient le maître de Montesquieu. Pour eux, l’homme dans la société, est déterminé par la nature. Les lois humaines n’ont de sens véritable et ne peuvent aider l’homme si, et seulement si, elles sont taillées dans l’ordre de l’univers cosmique.
Sur la présente base, Montesquieu ne peut être reconnu comme un philosophe de la Modernité parce que sa pensée apporte moins au nouveau monde. C’est ce que signifie S. Goyard-Fabre (1993, p. 346) en ces termes : « Les écrivains de notre fin de siècle, (…) n’ont rien inventé : Montesquieu (…) avait bien avant eux perçu les dangers d’une raison rationnelle (…) dont la philosophie antique(…) lui fournissait le modèle ». Ce qui revient à dire, que les écrivains modernes n’ont rien conçu de nouveau. Montesquieu, qui se présente comme leur devancier, imprégné des tendances antiques n’a pas d’originalité propre dans sa pensée. Il savait quela rationalité des Lumières allait déconstruire les requêtes ou les sollicitations de la pensée antique, voire ancienne.
Si l’on suit bien l’analyse de S. Goyard-Fabre, Montesquieune s’inscrit pas dans le rationalisme des Lumières. La philosophe a pu écrire à ce sujet : « Avant Burke, Montesquieu refuse l’engouement égalitariste (…) des Lumières ; avant Tocqueville, il pressent le conflit dans lequel la légalisation des conditions submergera la liberté » (S. Goyard-Fabre, 1993 p. 348). Le refus de l’égalité de principe entre les hommes symbolise que Montesquieu n’est pas un vrai partisan de la liberté. En outre, pour S. Goyard-Fabre Montesquieucroit que « les lois de la politique de liberté que réclame l’avenir [c’est-à-dire à la suite des Lumières] seront évidemment l’œuvre des hommes mais elles ne serviront pas la liberté si elles procèdent de leur arbitre ou de leur art rationnel » (S. Goyard-Fabre, 1993 p. 348). Autrement dit, les lois politiques revendiquées par le rationalisme des Lumières sont inefficaces pour ordonner la société parce qu’elles sont humaines et produites par la raison trop rationnelle[3]. Ainsi, « les lois civiles et politiques dont l’humanisme libéral doit se prévaloir ont pour office de restituer à l’homme les structures ontologiques et l’horizon axiologiqueque le “grand Jupiter ” lui avait assignées » (S. Goyard-Fabre, 1993 p. 348). Les lois doivent, pour ainsi dire, avoir pour fondement la transcendance et non la raison chez Montesquieu qui, cependant, est à l’origine du rationalisme des Lumières ou de la Modernité.
Dans l’entendement de S. Goyard-Fabre, Montesquieu est un philosophe ancien. Il n’est pas de l’espace moderne caractérisé par la rationalité ou la démonstration. La philosophe (1993, p. 348) écrit en effet : « Que l’on salue en Montesquieu l’un des hérauts de la liberté, il importe de balayer les malentendus. L’auteur (…) dans sa fidélité à Domat, à Cicéron ou à Aristote, demeure un « Ancien » perdu dans le monde des « Modernes » ».Ainsi, ceux qui pensent que Montesquieu est un martyr de la rationalité et de la liberté se trompent. L’auteur de De l’esprit des lois, en tant que fidèle élève de Domat, de Cicéron et d’Aristote, ne s’est pas affranchi de la pensée des Anciens. Ainsi, « si en Moderne, il [c’est-à-dire Montesquieu] pense à la (…) liberté qui (…) doit permettre (…) de sauvegarder « ce bien qui fait jouir de tous les autres biens », c’est en « Ancien » qu’il en dessine les voies » (S. Goyard-Fabre, 1993 p. 348). Mais comment ?« Par une médiation sur les principes naturels, donc, méta-politique de la politique. En cela, sa philosophie politique est sans doute, comme les jusnaturalismes “plus problématique encore que la philosophie elle-même » » (S. Goyard-Fabre, 1993 p. 348). Montesquieu demeure ainsi dans la coquille des Anciens, à penser la politique de la liberté. C’est donc au cœur de la philosophie des Anciens, basée sur la nature, que l’auteur de De l’esprit des lois, a développé la question de la liberté politique. Mieux, sa pensée politique est plus rattachée au jusnaturalisme et non au rationalisme des Lumières ou des modernes. En conclusion logique, c’est en quelque sorte une « méta-politique de la politique » que Montesquieu défend. C’est pourquoi S. Goyard-Fabre refuse de reconnaître l’auteur de De l’esprit des lois comme un philosophe de la Modernité et le retient parmi les Anciens. Mais, n’est-il pas possible d’être dans le moule des Anciens et être dans la Modernité ?
2. Les Limites de la controverse de Simone Goyard-Fabre : Montesquieu comme philosophe de la Modernité
Lacontroverse de S. Goyard-Fabre qui stipule que Montesquieu n’est pas un philosophe moderne trouve ses limites dans la structure des lois et dans l’idée de la séparation des pouvoirs de l’État. Qu’est-ce que la Modernité ? La Modernité est comprise comme un état d’esprit. Ainsi, ce qui doit changer ce sont les contre-valeurs et les modes de vie qui ne correspondent pas aux exigences sociales et politiques. Dans La politique d’Aristote (1253a),« l’homme est un animal politique ». Cela signifie que l’homme ne peut se réaliser qu’avec les autres. Le projet de la Modernité préconise donc un changement qui permettra à l’homme de ne pas seulement vivre mais de bien vivre. En ce sens, le changement propre à la Modernité n’est pas un processus naturel, c’est un changement orienté vers des buts significatifs, rationnels, raisonnables et universels « qui justifie le fait que l’on associe le projet de la Modernité à l’idée de progrès principiellement entendu comme le progrès de la raison » (L. M. Poamé, 2001, p. 88). Au premier plan, la Modernité se conçoit comme « ce qui va dans le sens de l’innovation et de la rationalisation » (L. M. Poamé, 2001, p. 88). Ainsi, sous le signe de l’innovation et de la rationalisation dans le monde, la Modernité selon Lazare Marcelin Poamé (2001, p. 88), impose « l’instauration de l’État de droit ». Autrement dit, la promotion des valeurs républicaines dirigées et dominées par la justice et la liberté.
Mais, qu’est-ce que la liberté ? « La liberté (…) est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sureté ; et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen » (Montesquieu, 1979, p. 294). Cela signifie que la liberté est une liberté-sécurité dans la mesure où elle exclut toute crainte du prochain. Dans le même ordre d’idées, Bertrand Binoche (1998, p. 287), la conçoit comme « le droit d’agir à son gré dans l’espace circonscrit légalement ; ou ; l’assurance pour le citoyen d’être protégé par la loi de tout arbitraire, celui de l’État (droit politique) comme celui de ses concitoyens (droit civile) ou de ses congénères (droit des gens) ». On peut prétendre qu’en soumettant à des règles de droit ceux qui exercent le pouvoir politique et qui agissent pour le compte de la collectivité, les valeurs républicaines régissent le pouvoir et encadre la vie politique. Elles déterminent les règles auxquelles l’autorité politique se soumet. Ces règles qui prennent forme dans la constitution politique déterminent la Modernité.
Le droit à la liberté explique, pour ainsi dire, que le citoyen trouve dans la Modernité sa protection et sa sureté dans le pouvoir « de faire ce qu’il doit vouloir sans jamais être contraint de faire ce qu’il ne doit pas vouloir » (Montesquieu, 1979, p. 292). Dans les normes, le droit politique doit faire en sorte que les libertés individuelles soient respectées. Lorsque le droit politique ne remplit pas cette condition, l’esprit de la liberté est menacé et l’État se corrompt. C’est ainsi que de nos jours, on assiste à une forme nouvelle du droit politique qui consiste en l’acceptation de l’opposition politique dans la prise des décisions publiques pour s’assurer de l’effectivité de la séparation des pouvoirs et de l’État de droit.
L’on pourrait donc affirmer que c’est dans le contexte général de la Modernité que naquit le principe de la séparation des pouvoirs de l’État, gage de la liberté chez les modernes. Dans les déclarations suivantes, la reconnaissance de Montesquieu comme un philosophe de la Modernité ne fait aucun doute : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (…) Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir » (Montesquieu, 1979, p. 292). Cette pensée énonce l’éclosion de l’esprit républicain qui, d’ailleurs, est le principe premier de l’État de droit et de la modernité politique. Il convient de contrôler le détenteur du pouvoir pour éviter qu’un attentat soit perpétré contre la liberté. Fort de cela, un contrepoids entre la puissance exécutrice et la puissance législative, est un impératif. Quant à la troisième puissance, c’est-à-dire la puissance de juger, selon les termes de Montesquieu, elle est « nulle et invisible » (Montesquieu, 1979, p. 296), dans la mesure où elle doit s’isoler des deux autres pour mieux assurer sa fonction objective ou impartiale d’appareil judiciaire de l’État.
L’esprit républicain de Montesquieu et sa force de philosophe de la Modernité se trouvent concentrés dans le passage suivant :
Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutive. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. (Montesquieu, 1979, p. 294).
En d’autres termes, la liberté se perd si chacune des puissances exécutrice, législative et judiciaire s’approprie les prérogatives essentielles de l’autre. Le secret de la liberté et de la modernité politique se situe à plusieurs degrés. Au premier, le Président de la république et ses ministres doivent se garder de faire des lois ni juger les affaires politiques et civiles. Cette règle est instituée pour éviter que le pouvoir exécutif prenne en otage le législatif et le judiciaire. Au Deuxième, « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi », (Montesquieu, 1979, p. 301). En principe, les juges ne doivent pas se reconnaître dans l’établissement des lois de la république à plus forte raison s’adonner à l’exécution. Car, si les juges font et exécutent les lois, la vie et la liberté des citoyens seraient en péril, puisque les lois instituées seraient la volonté des juges et non du peuple que représente le parlement. Ainsi, pour sauvegarder la liberté dans une république, l’idéal serait que de façon autonome le parlement(les députés) fasse les lois, l’exécutif (le président et ses ministres) les exécutent et que les juges visent à leur application saine ou normale.
À partir de cette grammaire du pouvoir et de la liberté, des grands penseurs voient subtilement en Montesquieu un philosophe de la mathématique de la Modernité. Le premier c’est Raymond Aron (1967, p. 63) : « Quel que soit la structure de la société, à une époque, il y a toujours possibilité de penser à la façon de Montesquieu ». Il suffit pour lui, « d’analyser la forme propre d’hétérogénéité d’une certaine société et de chercher par l’équilibre des puissances, la garantie de la modération et de la liberté » (Raymond Aron, 1967, p. 63). Cela signifie que la séparation des pouvoirs est dans le quotidien social. C’est une réalité incontournable inscrite pour l’avancement de la politique. Car, par l’équilibre des puissances, l’on réussit à garantir la modération et la liberté. Le deuxième c’est Jean Starobinski (1961 p. 15) : « Nous vivons dans une société aménagée en grande partie selon le vœu de Montesquieu : l’exécutif, le législatif et le judiciaire y sont séparés (…) tout cela nous est si familier que nous y faisons à peine attention ». La théorie de la séparation des pouvoirs telle que conçue par Montesquieu est d’actualité. Elle est inscrite dans les mœurs politiques du monde moderne et contemporain. Ainsi, ne pas reconnaître cette théorie comme une réalité constructrice, c’est « faire preuve de myopie intellectuelle ». Le troisième est Maurice Duverger (1965, p. 168) : « Il est intéressant de noter que la théorie de la séparation des pouvoirs a partiellement changé aujourd’hui la signification politique ». De nos jours, la séparation des pouvoirs a transformé et rationalisé la politique de la gouvernance dans le monde. Le quatrième, est Louis Althusser (1974, p. 123) : « Je dirai de cet homme [c’est-à-dire Montesquieu] qui partit seul et découvrit des terres nouvelles de l’histoire (…) avait cru les temps s’arrêtés. Mais il avait ouvert les voies ». Mais, de quelles voies s’agit-il si ce n’est celles de la Modernité ? Car, Montesquieu est appréhendé comme le « père » de la constitution moderne.
« Il faut (…) que le pouvoir arrête le pouvoir » (Montesquieu, 1979, p. 293) est une maxime essentielle qui justifie la constitution de l’État moderne. La confirmation se trouve dans l’article XVI de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ». Ce qui veut dire que tout État qui ne respecte pas les droits de l’homme et notamment, le principe de la séparation des pouvoirs, n’est pas reconnu dans la constitution universelle des États. Cette déclaration responsabilise Montesquieu et l’engage comme le symbole de la Modernité. L’on peut donc conclure avec L. Althusser (1959, p. 11) que « c’est une vérité reçue de déclarer Montesquieu le fondateur de la science politique. Auguste Comte l’a dit, Durkheim, l’a redit et personne n’a sérieusement contesté cet arrêt ». Cet arrêt engage Montesquieu comme philosophe de la Modernité. C’est dans le même ordre d’idées que C. Larrère appréhende Montesquieu comme un philosophe de l’humanisme. Les propos qui l’attestent sont les suivants : « On trouve le Montesquieu moraliste, critique passionné de la torture, (…), observateur de la relativité des institutions humaines (…) engagé dans la défense des grandes valeurs humanistes, essentiellement moralistes » (Cathérine Larrere, « La typologie des gouvernements chez Montesquieu » in Revue de Montesquieu n°5, 2001, p. 160. Version remaniée et corrigée disponible sur internet : http://montesquieu.ens-ish.fr/IMG/pdf/155-172pdf). Pour Cathérine Larrère Montesquieu est le philosophe de la défense des droits de l’homme et de la dignité humaine.
S. Goyard-Fabre ne s’éloigne pas, elle-même, de cette idée lorsqu’elle affirme (1993, pp. 274-275) : « Montesquieu estime qu’une politique sans éthique est condamnable (…) Parce que la politique (…) doit être l’expression d’un humanisme éthique capable de défendre l’homme contre ce qui menace sa dignité ». Par-là, l’on peut dire que S. Goyard-Fabre reconnaît Montesquieu comme un philosophe de la modération, de la liberté, de l’humanisme, de l’éthique et de la dignité humaine. Ces valeurs n’intègrent-t-elles pas la Modernité ?
S. Goyard-Fabre devrait comprendre que l’essence de la Modernité n’est pas obligatoirement la maîtrise de la nature et que les philosophes dits Anciens, sont plus modernes que les modernes eux-mêmes dans la mesure où les modernes se basent sur les idées des Anciens pour développer leur pensée. Le constat ici, est clair : le philosophe S. Goyard-Fabre pense la Modernité dans l’esprit marxien : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières, ce qui importe c’est de le transformer ». (K. Marx, 1982, p. 54). Mais, il faut se mettre à l’esprit que si le projet de la transformation du monde a pour source unique la raison, il ne vise pas seulement la victoire de la raison sur l’obscurantisme. La transformation du monde est aussi dans l’idée, la pensée, la prudence, la religion, le respect du jusnaturalisme. La prétendue victoire de la raison sur tout dont se servira l’homme pour dominer la nature cause, aujourd’hui, un dommage au bien-être social. Pour preuve, la Modernité scientifique et technologique dont la manifestation est la raison a conduit à la pollution de l’environnement. S. Goyard-Fabre doit comprendre que « la réalisation de tous les rêves peut tourner court et plonger l’humanité dans une catastrophe sans précédent » (G. Traoré, 2014, p. 4). Mieux, la réalisation de tous les rêves par la raison ne conduit pas toujours l’humanité au bonheur souhaité, mais souvent dans des difficultés.
La Modernité taillée par la raison a conduit à une crise environnementale activée par la dynamique technologique qui dégrade les conditions de vie et la nature. Comment la raison peut-elle être le moteur de la modernité et mettre à mal l’environnement dont l’humanité dépend ? Cette dimension paradoxale et obscure de la raison, soutenue par une certaine utopie de la Modernité conçue par S. Goyard-Fabre est « provocatrice » parce qu’« un danger suprême… » (M. Heidegger, 1951, p. 33-34), menace le monde. Ce danger, Montesquieu [1979 p. 22 (Introduction)] l’avait subtilement perçu :
Chez les Grecs et chez les Romains, l’admiration pour les connaissances politiques et morales fut portée jusqu’à une espèce de culte. Aujourd’hui, nous n’avons d’estime que pour les sciences (…), nous en sommes uniquement occupés, et le bien et le mal politique sont, parmi nous, un sentiment, plutôt qu’un objet de connaissance.
Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains accordaient une très grande importance à la morale et à la politique. Mais, de nos jours, les hommes sont beaucoup plus préoccupés par les raisonnements scientifiques. Pour eux, la politique et la morale sont des attributs du sentiment plutôt que de la raison. Ils ont toujours cru que la Modernité est fille de la raison révoltée pour la science et non pour la morale et l’ordre politique. Montesquieuaverti du péril que cela pouvait produire dans la société, affirma : « Ainsi, n’étant point né dans le siècle qu’il me fallait, j’ai pris le parti […] de me mettre dans l’esprit que, dans sept ou huit cent ans, il viendra quelque peuple à qui mes idées seront très utiles » [Montesquieu, 1979 p. 22 (Introduction)]. Cette déclaration situe Montesquieu dans un renouveau politique. Il convient à l’homme moderne de repenser la société.
La raison considérée comme l’ultime bâtisseur de la Modernité a fini par se lancer dans une transformation du monde à travers la science et la technique dont les conséquences dans la société deviennent néfastes. La raison a produit des dommages incontrôlables sur l’environnement social menaçant l’humanité de destruction. La victoire de la raison ou de la science a « fini par pénétrer, non seulement les entrailles de la nature, mais aussi et surtout les séquences de notre propre être » (M. Kouassi, 2013, p. 28). Dans cette mouvance, la survie des hommes se trouve fortement compromise par la force et les ambitions démesurées de la raison. Quelle que soit la révolte de la raison pour la science, l’enjeu politique et moral que Montesquieu a toujours défendu occupe une place de choix dans la société moderne. « Je (…) crois que l’excès de la raison n’est pas toujours désirable » (Montesquieu, 1979, p. 304). L’auteur exhorte l’homme moderne à limiter les œuvres de la raison pour ne pas sombrer dans une Modernité qui endommage et qui « tue ». À ce titre, n’est-ce pas faire preuve de « myopie intellectuelle » quand on pense que Montesquieu n’est ni moderne ni au cœur de la Modernité ?
L’auteur a signifié, en effet, dans De l’esprit des lois que les lois
doivent être relatives au physique du pays ; au climat glacé, brûlant, ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur ; au germe de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs : elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leur richesse, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leur manière (Montesquieu, 1979, p. 128).
Cette affirmation est une idée politique. Elle est l’émanation des principes de vie, car tout part de l’idée pour le bonheur ou l’épanouissement de l’homme dans la société.
Dans l’évolution des structures des lois, Montesquieu a joué un rôle prépondérant. Pour lui, l’idée politique s’extériorise dans la société à travers les lois. Elle devient, pour ainsi dire, une norme structurante et adaptable pour tout peuple. C’est à partir de la manifestation de l’idée qu’on parvient à la rationalité politique. On ne peut donc pas dire que Montesquieu est plus proche des anciens qu’il ne l’est des modernes. Montesquieu a étudié la société et les lois « dans une perspectives moderne d’étude de structures, d’évolution des structures » (M. Golder,1972, « Marxisme, Anthropologie et religion » in Christian Bourgeois et al, Epistémologie et Marxisme, Paris, UGE, p. 219). Montesquieu part d’une sorte d’idéalisme pour aboutir à la Modernité en passant par le matérialisme comme « science de l’histoire » (Ibidem, p. 218) politique.
Conclusion
Après cette odyssée, l’on peut retenir que S. Goyard-Fabre s’efforce en vain de méconnaître Montesquieu comme un philosophe moderne. C’est sur « l’imminence de la justice naturelle » (S. Goyard-Fabre, 1993, p. 346) que Montesquieu enseigne l’authenticité de la Modernité retrouvée chez Spinoza (1964, p. 329) : « La fin de l’État est (…) la liberté ».
En toute évidence, la structure de la constitution politique chez Montesquieu apparait comme le sens de la démocratie voire de l’État droit. B. Kriegel (1994, p. 65) le confirme en subtilement : « Le droit politique républicain n’est pas une alternative à la démocratie. Mais (…) la séparation des pouvoirs ». Cela montre que la meilleure république se caractérise par la séparation des pouvoirs, et que ce principe constitutionnel est la vrai garantie de la sécurité et de la liberté des citoyens confirmées par B. Constant (1980, p. 498) :
Demandez-vous (…) ce que de nos jours (…) un habitant (…) entend par le mot liberté ? C’est (…) le droit (…) de ne pouvoir (…) ni être détenu, ni mis à mort (…) d’aucune manière par (…) une volonté abstraite d’un ou de plusieurs individus. C’est (…) le droit de dire son opinion.
C’est sur cette base que la Modernité a un sens[4].
Le philosophe de la Modernité serait donc celui qui, en suivant la nature, établit les règles et les maximes qui permettront aux hommes de renouer avec les principes du bien être politique et social. C’est pourquoi, « Montesquieu est d’autant plus sensible (…) que théoriquement, il est voulu poser les jalons d’une philosophie politique libérale (…) qui, par la disposition même des choses, puisse exclure toute possibilité d’abus ou de détournement de pouvoir » (S. Goyard-Fabre, 1993, p. 347). Si, S. Goyard-Fabre s’y refuse de reconnaître en Montesquieu un philosophe de la Modernité, c’est parce que celui-ci ne s’inscrit pas dans la révolution de l’esprit scientifique opérée par les grands avants[5] ou encore de l’esprit politique engendrée par Rousseau.
Pourtant, Montesquieu s’est illustré dans l’organisation politique de fort belle manière par le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs de l’État. Il fut même l’« idole » des constituants américains (A. Alexander, J. Jay, J. Madison, p. VIII, préface d’A. Esmein). Ainsi, méconnaitre Montesquieu comme philosophe de la Modernité, c’est faire preuve de mauvaise foi.
Références bibliographiques
ALTHUSSER Louis, 1974, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, PUF.
ARISTOTE, 1982, La politique, trad. J. Tricot, Vrin.
ARON Raymond, 1967, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard.
KRIEGEL Blandine, « Déclaration d’Indépendance des États Unis du 4 juillet 1776 », Trad. Thomas Jefferson in Texte de philosophie politique Classique, Paris, PUF, 1993.
KRIEGEL Blandine, 1994, La politique de la raison, Paris, Payot.
BINOCHET Bertrand, 1998, Introduction à l’esprit des lois, Paris, Presse Universitaire de France.
CAMBIER Alain, 2010, Montesquieu et la liberté, Paris, Hermann Editeur.
CONSTANT Benjamin, « De la liberté des anciens comparés à celle des modernes », in De la liberté chez les anciens, textes choisis, présentés et annotés par Marcel Gauchet, 1980, Paris, Livre de poche.
CASABIANCA Denis, 2008, Montesquieu, De l’étude des sciences à l’esprit des lois, Paris, Honoré Champion.
DESCARTES René, 1951, Discours de la méthode, Paris, Presse Universitaire de France.
DUVERGER Maurice, 1965, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Presse Universitaire de France.
GOLDER Maurice, 1972, « Marxisme ; Anthropologie et religion » in Christian Bourgeois et al, Epistémologie et Marxisme, Paris, UGE.
GROETHUYSEN Bernard, 1956, Philosophie de la révolution française (précédé de) Montesquieu, Paris, Gallimard.
GOYARD-FABRE Simone, 1993, Montesquieu, la nature, les lois et la liberté, Paris, Presse Universitaire de France.
TRAORE Grégoire, 2014 « L’heuristique de la peur et les contresens de la modernité » in http : www. Contrepoint philosophique.ch, rubrique philosophique, 8 février 2009, Consulté le 21 Avril 2017.
HEIDEGGER Martin, « La question de la technique » in Essai et conférence, Paris, Gallimard, Trad. André Préau, 1953 / 1958.
HAMILTON Alexander, JAY John, MADISON James, 1988, Le Fédéraliste, trad. Gaston Jèze, Paris, Economica.
KOUASSI Marcel, 2013, Heidegger et la question du transfert des technologies en Afrique, Abidjan, creste Edition.
POAME Marcelin Lazare 2001, « La Modernité en question dans une Afrique en mutation » in Cahier du Cerlesh, n° 18, Université de Ouagadougou.
MARX Karl, 1982, Le manifeste du parti communiste, Paris, Edition sociale, Trad. Jules Molitor.
GOYARD-FABRE Simone, 1993, Montesquieu : la nature, les lois, la liberté, Paris, Presse universitaire de France.
SPINOZA de Baruch, 1968, Traité Théologico-politique, trad. Madeleine de Fraise, Paris, Gallimard.
STAROBINSKI Jean, 1970, Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, Paris, Seuil.
VOLPILHAC-Auger Catherine, 2003, Montesquieu, Paris, presse de l’Université de Paris-Sorbonne.
Webographie
LARRERE Catherine, « La typologie des gouvernements chez Montesquieu » in Revue de MONTESQUIEUn°5, 2001, p. 160. Version remaniée et corrigée disponible sur internet : http://MONTESQUIEU.ens-ish.fr/IMG/pdf/155-172pdf, consulté le 12 Août 2017 00h 21mn.
MONTESQUIEU, 1959, « Notes sur l’Angleterre »in Œuvres complètes Paris, Flammarion.
Paradigme occidental, in
http://www.deshumanisation.com/origines/autopsie-du-paradigme-occidental,consulté le 9 Août 2017 7h 15mn.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : DE L’INDIFFÉRENCE AUX ACTIONS CONCRÈTES
Salif YÉO
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Le développement durable ne semble pas être une préoccupation pour plusieurs États de l’Afrique subsaharienne qui sont plutôt soucieux de répondre aux besoins pressants de leurs peuples. Les besoins alimentaires et sanitaires, d’éducation et d’emploi sont autant de préoccupations qui ne laissent pas aux gouvernements des États de l’Afrique subsaharienne le loisir de penser autrement qu’en termes de développement économique, en vue de trouver à ces différentes inquiétudes, les réponses urgentes attendues. Mais si le souci de satisfaire les besoins des générations actuelles doit conduire à un développement économique incontrôlé, il faut craindre, pour l’écosystème africain, des conséquences préjudiciables à la conservation de ce qui en reste. Pendant qu’on peut sauver quelque chose de cet écosystème, il faut agir vite et bien, en s’appropriant dès maintenant le développement durable, par des actions planifiées tendant à en faire une réalité concrète dans le contexte politique subsaharien. On éviterait ainsi de commettre la même erreur que les pays développés qui ont dû se résoudre, après dégâts, à penser développement durable.
Mots-clés : Besoins, Développement, Économie, Écosystème, États, Responsabilité.
Abstract :
Sustainable development seems not to be a preoccupation for many Africa sub-Saharan States which are caring to find responses to their peoples’ instants needs. The needs of food, health, education and job, are preoccupations that cannot give Africa sub-Saharan governments the leisure to think about something else if not only to the economic development in order to find for these different concerns adequate and urgent responses which are waiting for. But if the worry to satisfy actual generations needs must bring to an uncontrolled economic development, we must fear some prejudicial consequences for the conservation of what is yet intact in Africa sub-Saharan ecosystem. Since we can save something of that ecosystem, we must act quickly and well, by appropriating from now, the sustainable development with planned actions which can turn it to concrete reality in Africa sub-Saharan politics context. Thus, we should avoid to commit the same error as developed countries which have been forced, after damages, to figure sustainable development.
Keywords : Development, Economy, Ecosystem, Needs, States, Responsibility.
Introduction
Depuis l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, par les 193 États membres de l’ONU en septembre 2015, le développement durable est devenu, en vertu du principe de responsabilité partagée, un enjeu majeur et une boussole pour les politiques de développement de l’ensemble des États de la planète. Défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »[6], le développement durable tend à s’imposer, aujourd’hui, comme un concept à promouvoir solidairement au nom de la survie et du bien-être de l’humanité. Mais si elle est partagée, la responsabilité à assumer en matière de développement durable n’est pas la même pour tous les États, dans la mesure où les niveaux de développement et les types de dégâts causés sur la planète sont parfois très différents d’un pays à l’autre.
Il serait donc inconséquent d’envisager un plan d’action de développement durable qui implique, au même degré, chacun des États de la planète. C’est dans cette logique que certains États se sentent moins concernés que d’autres par la question du développement durable. Dans les États africains subsahariens, la question du développement durable est reléguée au second plan dans l’ordre des préoccupations qui sont les leurs. Avant de le concevoir durable, les Africains pensent le développement, d’abord et essentiellement, en termes économiques et pour les générations actuelles. En tout état de cause, l’indifférence réelle de la plupart des États africains, qui tranche avec l’engagement apparent, manifesté seulement par leur participation aux conférences mondiales sur le développement durable, nous amène à nous interroger :
Le développement durable est-il un luxe pour les États d’Afrique subsaharienne ? Cette interrogation fondamentale en appelle d’autres qui tendent à l’expliciter : Pourquoi, dans les politiques de développement des États d’Afrique subsaharienne, le développement durable est-il relégué au second plan ? Quels sont les risques encourus par ces États du fait qu’on ne s’y soucie guère aujourd’hui de développement durable ? À quels besoins réels répond, la nécessité de penser le développement durable en Afrique subsaharienne ? Nous formulons ici l’hypothèse selon laquelle les États africains subsahariens sont si préoccupés par les questions de développement économique, que le développement durable leur apparaît comme un luxe.
Notre objectif est de montrer, à travers une analyse critique des réalités politiques et environnementales, que l’intérêt bien compris de l’Afrique subsaharienne se trouve dans l’appropriation intelligente qu’elle fera du concept de développement durable, qui n’est pas à opposer au développement économique. Dans cette optique, nous ferons, dans un premier temps, l’analyse de l’indifférence des États subsahariens à l’égard de la question du développement durable. Nous montrerons ensuitele risque de l’obsession du développement économique encouru par ces États, et l’opportunité qu’ils ont de tirer instruction de l’histoire des pays développés. Nous nous attèlerons enfin à appeler l’attention des États d’Afrique subsaharienne sur la nécessité de penser le développement durable aujourd’hui.
1. L’indifférence à l’égard du développement durable en Afrique subsaharienne
L’idée de développement durable n’est pas le fruit d’une génération spontanée. Les hommes et les États n’ont pas pu penser développement durable sans la médiation de l’expérience. C’est l’expérience qui leur a ouvert les yeux sur le danger que constitue l’insouciance à l’égard de la dégradation de l’écosystème naturel et les a amenés à concevoir et à promouvoir l’idée de développement durable. C’est dans le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies, dit rapport Brundtland, que ce concept est apparu pour la première fois en 1987. Explicité et précisé au fil des conférences et sommets des Nations unies, le développement durable a connu son acception la plus large avec le Programme 2030. Fondé sur les Objectifs pour le développement durable (ODD), au nombre de 17, visant à transformer le monde,
le Programme 2030 est le plan le plus complet à ce jour pour éliminer l’extrême pauvreté, réduire les inégalités et protéger la planète. Il va au-delà de la rhétorique et constitue un appel à une action concrète en faveur de l’humanité, de la planète et de la prospérité. (…) Le Programme 2030 admet cinq dimensions essentielles (appelées les 5P en anglais) : humanité (people), prospérité, planète, partenariats et paix[7].
Mais l’appropriation collective de ce programme, dans son intégralité, reste encore à réaliser dans plusieurs pays où le concept de développement durable a de la peine à s’imposer. Certains chefs d’États restent dubitatifs face à l’idée de développement durable dont l’un des principaux arguments, le réchauffement climatique, fait toujours l’objet de controverses. Mais ce n’est pas vraiment sur le terrain de la contestation que l’indifférence des États africains à l’égard du développement durable trouve sa justification. Si l’idée de développement durable peine à prendre racine dans les esprits d’une frange importante d’Africains, c’est essentiellement pour des raisons économiques et sociales.
Au plan économique, plusieurs dirigeants politiques africains sont préoccupés par la satisfaction des nombreux besoins fondamentaux de leurs peuples. Dans chaque État d’Afrique subsaharienne, « le gouvernement et ses partenaires doivent relever les défis multiples de l’emploi, des revenus, de l’alimentation, de l’accès à l’eau et à l’énergie, de l’éducation, de la santé, des communications, etc. ». (Christian CHABOUD, Géraldine FROGER, Philippe MERAL, 2007, p. 7). C’est ainsi que les États africains, au sud du Sahara, s’investissent dans la lutte contre la faim et la pauvreté, dans la résolution des problèmes de santé et d’éducation de leurs peuples. Ces besoins sont si criants que les gouvernants qui y pensent vraiment n’entendent pas détourner leurs efforts de ces impératifs qui les interpellent continuellement pour se consacrer à ce qui n’entre pas, pour eux, dans la catégorie de l’essentiel. Les contraintes économiques actuelles, en Afrique subsaharienne, sont donc telles que les efforts des gouvernants ne sont pas orientés spontanément vers les politiques de développement durable qui n’ont pas d’effets immédiats sur le bien-être des peuples qu’ils gouvernent.
Au plan social, l’urbanisation galopante des pays subsahariens, place les gouvernants face au défi de trouver des solutions aux besoins de logement et de centres de santé, de scolarisation et de moyens de transport. Or la satisfaction de ces multiples besoins passe par une action d’exploitation et de dévastation de la nature et de ses richesses, dégradant ainsi l’environnement naturel et, par conséquent, la possibilité pour les générations futures de mener une vie de qualité. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les populations des États subsahariens, surtout celles des villes, croissent à une vitesse vertigineuse. Les gouvernants de ces États africains sont ainsi pris entre deux exigences contraires : l’exigence de satisfaire des besoins sociaux d’une population à forte et constante croissance, et celle de veiller à la préservation de la nature et de ses richesses. Dans un tel contexte, les États subsahariens sont dans une situation d’écartèlement s’ils veulent s’approprier le développement durable puisque, « la croissance forte, soutenue dans la durée, dont le pays a absolument besoin pour faire reculer la pauvreté, ne peut se faire au détriment d’une biodiversité » à préserver. (Christian CHABOUD, Géraldine FROGER, Philippe MERAL, 2007, p. 7).
On le voit donc, les multiples besoins économiques et sociaux des peuples au sud du Sahara constituent, par leur caractère pressant, autant de préoccupations qui ne laissent pas aux dirigeants, la liberté d’entreprendre des actions en faveur du développement durable qui ne semble pas représenter une urgence à leurs yeux. Dans l’esprit des gouvernants des États de l’Afrique subsaharienne, mais également dans la mentalité du citoyen ordinaire, les besoins urgents à satisfaire sont ceux des générations présentes. En effet, si les générations présentes doivent envisager le développement de manière à ne pas compromettre le droit au développement des générations futures, il reste bien entendu que cela ne peut se faire au détriment des premières. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même ? Le développement ne peut être envisagé comme durable par les générations présentes que s’il leur offre la possibilité de satisfaire leurs propres besoins. C’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire, par exemple, où les gouvernants sont préoccupés par la résolution des problèmes liés à la pauvreté, Issouf MEITE (2014, p.17) observe que
sur le plan national, l’État n’a pas une approche intégrée du développement durable et les actions restent éparses, ce qui s’explique par la faiblesse des engagements politiques. Il en résulte un manque d’appropriation des principes du développement durable et de leur mise en œuvre sectorielle.
Par ailleurs, il ne faut pas ignorer que la mise en œuvre d’une politique de développement durable a un coût, et requiert certaines connaissances, toutes choses qui nécessitent un certain niveau de développement. C’est donc à juste titre qu’en Afrique subsaharienne, les États, acteurs principaux des politiques nationales, s’attèlent à acquérir un niveau de développement qui leur permettra, à terme, de prendre une part active au développement durable. Le développement durable est, en effet, en premier lieu, une affaire d’État, même si on ne peut en exclure les actions des collectivités locales et des organisations de la société civile qui doivent, somme toute, s’inscrire dans le cadre défini par l’État. En effet, « que ce soit au niveau macro (national ou international) ou micro (communal, local, etc.), les États sont, à nos yeux, les acteurs clés des changements des trajectoires du développement ». (Christian CHABOUD, Géraldine FROGER, Philippe MERAL, 2007, p. 11). On peut, ainsi, affirmer qu’un État qui n’a pas les moyens de sa politique de développement économique, ne peut s’approprier de manière effective, le développement durable. Pourtant « le Programme 2030 a une portée universelle et engage tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu et leur statut en matière de développement, à consentir un effort global en faveur du développement durable »[8].
C’est le lieu de s’interroger sur la portée et la possibilité même d’une politique de développement durable dans un pays dont le niveau de pauvreté est à peine supportable. Comment envisager et réaliser un projet de développement durable dans un pays qui ne dispose pas de moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux de sa population ? Pour un État qui n’a pas de solutions aux problèmes fondamentaux qui se posent à lui aujourd’hui, n’est-ce pas un luxe que de penser aux besoins des générations futures ? Il y a donc lieu de s’interroger avec réalisme : « Quelle place les États des pays en développement accordent-ils aux enjeux de développement durable dans leurs agendas ? Le développement durable est-il une réalité ou un mythe dans des pays confrontés à une extrême pauvreté ? ». (Christian CHABOUD, Géraldine FROGER, Philippe MERAL, 2007, p. 11). Il est évident que c’est avec un certain pessimisme qu’on s’interroge ainsi, sachant qu’on ne voit pas comment un État qui croupit sous le poids de la pauvreté peut soutenir efficacement une politique de développement durable.
Préoccupés donc à chercher des solutions aux nombreux problèmes qui assaillent leurs peuples, les gouvernants des États d’Afrique subsaharienne ne se donnent que fort peu de temps pour entreprendre des actions de développement durable qui paraissent les détourner de ce qui constitue pour eux la priorité : le développement économique et ses retombées sociales. Mais y a-t-il antinomie entre la recherche du développement économique et celle du développement durable ? Hormis certains aspects onéreux des actions de développement durable comme la dépollution des eaux et le traitement des ordures ménagères, les pays pauvres ne peuvent-ils pas concilier l’impératif de satisfaire les besoins de leurs populations et celui de préserver l’environnement pour les générations à venir ? Par ailleurs, dans la mesure où le développement économique rime avec l’exploitation et souvent la destruction de la nature, on peut se demander si la quête d’un tel développement est compatible avec la sauvegarde de l’écosystème naturel. Dans cette logique, « est-il utopique de vouloir concilier la production du capital économique et la conservation du capital naturel ? ». (Christian CHABOUD, Géraldine FROGER, Philippe MERAL, 2007, p. 7).
Toutes ces questions méritent d’être posées en Afrique subsaharienne, dans la mesure où plusieurs États de cette partie du continent donnent la nette impression d’être placés entre deux impératifs non conciliables : la lutte pour le bien-être économique et social des générations actuelles et le combat pour la préservation de l’écosystème naturel nécessaire à la possibilité d’une vie épanouie des générations futures. La plupart des gouvernants ayant opté pour l’impératif de rechercher les moyens de satisfaire les besoins des générations présentes, le risque de l’obsession du développement économique est bien réel. Mais l’histoire des pays économiquement avancés ne devrait-elle pas nous instruire au sujet de l’attitude correcte à avoir vis-à-vis de la question du développement durable ?
2. Le risque de l’obsession du développement économique : les leçons de l’histoire
Si plusieurs États subsahariens ont fait le choix de faire face aux besoins actuels de leurs populations plutôt que de penser développement durable, ce n’est certainement pas pour des raisons farfelues. Mais si les bonnes raisons qu’on a de faire un choix doivent conduire à des conséquences désastreuses pour soi-même et pour les autres, le bon sens veut qu’on renonce à ces raisons. Ce ne sont pas les bonnes raisons de rechercher le développement économique qui manquent aux États africains subsahariens, c’est plutôt le regard critique qui permet de tirer les leçons de l’histoire des pays industrialisés. La question du développement durable se pose aujourd’hui, parce qu’il s’est produit, dans la recherche effrénée du développement économique dans les pays occidentaux, un phénomène étrange, la pollution, qui a un impact négatif sur la planète tout entière. « Le concept du développement durable apparaît au moment où les pollutions globales ont été décelées avec des conséquences imprévisibles sur la nature (déchirure de la couche d’ozone, désertification, réchauffement des glaciers, inondations, perturbations cycloniques, déforestation…). (Modeste Chouaïbou Mfenjou, 2002, p. 15).
Ce sont donc les effets pervers du développement sur l’écosystème naturel qui ont donné l’alerte aux scientifiques et à la communauté internationale. C’est dire que si l’on n’y avait pris garde, le développement économique – qui engendre, à travers l’industrialisation sauvage et les déchets chimiques qu’elle produit, la destruction de l’écosystème – aurait poursuivi son œuvre de dégradation de la nature, jusqu’au jour où il deviendrait impossible de vivre sur la planète. L’indifférence générale face à un tel phénomène aurait été dommageable à la vie sur terre. Si donc, grâce à la vigilance de la communauté scientifique, un tel danger a pu être détecté, il n’est pas sage, pour les États africains et pour quiconque, de l’ignorer royalement. L’histoire des pays économiquement développés ayant révélé les effets pervers de l’industrialisation sans frein, il convient, pour ceux qui veulent leur emboîter le pas, d’en tirer les leçons qui s’imposent. Personne n’est obligé de commettre la même erreur que son prédécesseur.
C’est, en effet, une erreur commise par les pays industrialisés que de pousser le développement jusqu’à mettre en péril la vie sur terre. Cette erreur s’explique par la trop grande importance accordée au développement économique qui est devenu la solution-miracle aux problèmes des États et des peuples. « L’économie s’est ainsi constituée comme sphère autonome non seulement par rapport au social et au politique, mais aussi par rapport à l’environnement qu’elle a démembré en “ressources naturelles” et dont elle a pu ignorer les principes et la dynamique de régulation ». (Corinne Gendron, 2006, p. 11). Quand on se permet d’ériger le développement économique en norme régulatrice des projets et des actions politiques, il faut s’attendre à une désintégration des valeurs morales et des principes sacro-saints qui assurent la préservation d’un climat favorable à la vie sur Terre. L’obsédé du développement économique n’a que faire de principes sacro-saints, il lui faut à tout prix satisfaire ses besoins.
Or, lorsqu’il s’agit de préserver la vie sur Terre, aucun alibi n’est recevable pour échapper à l’obligation de collaborer. Quand on se croit obligé de rechercher d’abord le développement économique de manière à pouvoir satisfaire les besoins des générations présentes, avant de penser aux générations futures, on se met en situation de commettre la même erreur que les pays développés. L’attitude raisonnable n’est pas celle-là. Sachant que les pays industrialisés sont aujourd’hui amenés à prendre des mesures pour lutter contre les effets pervers de la course effrénée au développement économique, les États africains gagneraient à prendre plutôt les mesures nécessaires pour se développer en évitant de subir le même sort qu’eux. Si les erreurs commises par les pays développés ont entamé l’intégrité physique de la biosphère, il convient de se conduire désormais en hommes avertis. « Dès lors le progrès économique doit non seulement rechercher la satisfaction des besoins présents, mais intégrer les préoccupations des générations futures ». (Modeste Chouaïbou Mfenjou, 2002, p. 15). Si l’on n’est pas capable de tirer des leçons de l’histoire, c’est en vain qu’on se proclame raisonnable et qu’on clame son humanité.
L’humanité authentique ne peut consister à s’enfermer dans le présent, à se préoccuper exclusivement des besoins des générations présentes. L’humanité se déploie dans le présent ; mais elle se projette également dans l’avenir dont elle est en droit d’attendre un mieux-être. « Cette espérance en des temps meilleurs, sans laquelle jamais un désir sérieux de faire quelque chose d’utile au bien universel n’aurait échauffé le cœur humain, a toujours exercé une influence sur l’activité de ceux qui ont l’esprit droit ». (E. Kant, 1994, p. 88). Il s’agit donc d’avoir l’esprit droit pour comprendre que le sort des générations futures dépend de ce qui se décide aujourd’hui et que l’unicité de la biosphère requiert les soins diligents de toutes les générations.
Ce qui a conduit les pays développés à porter atteinte à la biosphère avant de le regretter, c’est l’absence de vision prospective du développement à long terme. C’est aussi le choix d’une mauvaise stratégie de développement, car lorsqu’on fait du développement économique le point de mire de tout ce qu’on entreprend, on est bien parti pour faire une déviation par rapport à la droite ligne de la morale et des valeurs protectrices de la vie. Le mobile du gain à tout prix est toujours mauvais conseiller. La recherche du développement économique fétichisé ne s’embarrasse pas de mesures d’accompagnement pour prévenir les effets pervers de l’industrialisation à outrance. Si les pays africains prennent le chemin d’un tel développement, ce ne sera pas faute d’exemples mettant en évidence les risques encourus. La Chine a cru bon de prendre la voie du développement économique, après les Occidentaux, à toute vitesse. Aussi Hongkong est-elle aujourd’hui la ville la plus polluée au monde. L’Inde qui s’inscrit dans la même logique, se trouve également confronté au danger de la pollution.
Pourquoi faut-il, fatalement, que chaque pays fasse l’amère expérience de la dégradation de son environnement naturel par le développement économique incontrôlé, pour se rendre compte de la nécessité de s’approprier l’idée du développement durable ? Deux mots/maux nous semblent expliquer cette situation déplorable : l’intérêt égoïste et l’obsession de la richesse. C’est parce que les États ne pensent qu’à faire personnellement l’expérience du développement économique qu’ils se battent obstinément, chacun pour soi, pour y parvenir quel que soit le prix à payer. C’est parce qu’ils ne rêvent qu’à être riches, que tous les États s’emploient à devenir économiquement puissants. La fibre égocentrique et capitaliste est au fondement du désir immodéré de parvenir au développement économique quoi que cela doive entraîner comme conséquences négatives sur l’environnement. Les États-Unis qui sont réfractaires aux mesures adoptées à la 21e Conférence des parties (COP 21), en faveur du développement durable, le sont par intérêt nationaliste et par obsession du capital. En somme, ce n’est jamais par altruisme, ni même par amour pour la vie sur Terre, mais par une soif du capital, aiguisée par l’intérêt égoïste, que des États sont réfractaires au développement durable.
Pourtant le constat de la communauté scientifique et même du commun des mortels est sans appel : les eaux, l’air, la biosphère en général, sont soumis à une pollution qui en compromet gravement la qualité. Il est temps de tirer la sonnette d’alarme. Ce phénomène qui a fait son apparition avec l’industrialisation incontrôlée, est l’un des signaux les plus patents du dérèglement de l’équilibre naturel. C’est pourquoi Bertrand Zuindeau (2000, p. 12) observe que « l’”idée nouvelle”, le développement durable, est à l’évidence étroitement liée avec le “fait nouveau”, les pollutions globales ». Or, si le constat des pollutions est général autant que les pollutions elles-mêmes sont globales, il ne reste plus de place ni pour tergiverser, ni pour se perdre en atermoiements. Il faut agir vite et bien, avant qu’il ne devienne impossible de faire quoi que ce soit.
Un constat s’impose à nous aujourd’hui : les pays développés n’ont pu éviter de polluer, les pays émergents non plus, et les pays en voie de développement ne semblent pas prendre le chemin de la sagesse. Pourtant, visiblement, la question de la pollution et celle du développement durable n’épargnent pas une partie du monde. Les effets du réchauffement climatique se font sentir en Afrique comme partout ailleurs. Tous les continents et tous les pays, quel que soit leur rang sur l’échelle du développement, sont globalement touchés par les problèmes de pollution et de réchauffement climatique, et interpelés par la question du développement durable. « Ainsi, le caractère global des problèmes conduit à faire du développement durable, une problématique globale ». (Bertrand Zuindeau, 2000, p. 13). La particularité des pays d’Afrique subsaharienne, dans cette condition déjà déplorable, c’est leur “situation d’ex-colonies”, appellation qui ne vaut que pour faire politiquement correcte puisque la colonisation se camoufle difficilement sous des formes nouvelles de coopération Nord-Sud.
Les “anciens colonisateurs”, en effet, n’éprouvent aucune gêne à déverser dans les dépotoirs que constituent les colonies, des déchets toxiques avec ou sans l’accord des gouvernants africains. Ce fut le cas, en août 2006, à Abidjan, en Côte d’Ivoire où furent déversées 581 tonnes de déchets toxiques par le Probo Koala, un navire pétrolier immatriculé au Panama, appartenant à une compagnie grecque et affrété par la société hollandaise et suisse dénommée Trafigura. Un tel fait est déplorable comme l’est aussi la délocalisation des industries polluantes de l’Europe, où les règles de protection de l’environnement sont sévères, vers d’autres continents.
Les firmes les plus polluantes, pour échapper à ces règlementations et aux éventuelles pénalités et taxes, comme la taxe carbone dans l’Union européenne, se délocalisent des zones les plus réglementées vers les plus tolérantes. En général, les pays en développement sont les destinations favorites de ces entreprises polluantes. (Issaka Dialga, 2017, p. 38).
Si la condition des États d’Afrique subsaharienne doit rester telle qu’elle se présente aujourd’hui, il est évident que la perspective de l’appropriation de l’idée de développement durable par l’élaboration et la réalisation de politiques vigoureuses visant à donner une application concrète à cette idée, s’éloignera chaque jour davantage. Or nous considérons que la nécessité de penser le développement durable s’impose ici et maintenant, en Afrique.
3. La nécessité d’agir ici et maintenant pour le développement durable en Afrique
La liberté que prennent les États occidentaux ainsi que ceux qui sont considérés comme émergents, à déverser dans les pays africains leurs déchets et produits manufacturés de qualité médiocre, constitue un signal fort qui invite les Africains à penser le développement durable avant d’être littéralement envahis, si ce n’est déjà fait, par des produits détériorés de toutes sortes. La part de responsabilité active qu’ont les partenaires au développement des États de l’Afrique au sud du Sahara, dans la dégradation de l’écosystème local, peut se situer également dans l’implantation des usines et l’exploitation des richesses naturelles du continent. Les pays d’Afrique subsaharienne sont soumis à un régime d’exploitation de leurs ressources minières et minérales qui les expose à toutes sortes de pollution avec une maigre compensation financière loin de faire le poids devant les multiples préjudices causés à la nature et aux hommes. Il est souhaitable que les États africains prennent l’engagement de réglementer l’implantation des industries, et d’opérer une sélection rigoureuse de celles qui doivent exercer leurs activités sur leurs territoires. Issaka Dialga (2017, p. 38) observe que dans l’Union européenne,
les enjeux climatiques ont poussé les États et les territoires à adopter des normes réglementaires et des politiques environnementales plus ou moins fortes en vue d’atténuer les effets du changement climatique voire inverser les tendances. Cependant, ces mesures même si elles sont d’envergure internationale (Sommet de la Terre en 1992, Rio+20 en 2012, la COP21 en 2015) elles ne sont pas appliquées avec la même rigueur sur tous les territoires.
C’est pour cela qu’il est également souhaitable que les multinationales qui implantent leurs filiales en Afrique trouvent les moyens de faire, pour les pays d’accueil, ce qu’elles font ou feraient dans leurs pays d’origine en application du concept de développement durable. Si le développement durable doit devenir une réalité pour tous les peuples, il importe que les mesures de protection de la nature, jugées nécessaires pour les pays développés, soient aussi appliquées dans les pays en développement, quand et partout où cela est nécessaire sur la planète Terre qui constitue, pour le moment, le seul cadre favorable à la vie et à la biodiversité. Si « la nature a renfermé tous les hommes ensemble (au moyen de la forme sphérique qu’elle a donnée à leur séjour en tant que globus terraqueus) à l’intérieur de certaines limites » (Emmanuel Kant, 1994, p. 179), elle leur a ainsi intimé l’ordre d’en prendre soin, collectivement, au profit de tous.
Dans quelque lieu où se produisent donc des dégâts sur la nature, tous les hommes devraient se sentir concernés. « Faire preuve d’humanité, affirme Emmanuel Kant (1997, p. 336) consiste à prendre part au sort des autres hommes ». Tel est le sens du cosmopolitisme kantien qui crée les conditions favorables au développement durable. En effet, « le développement durable exprime l’idée d’un développement qui combine le souci des plus démunis, le souci des générations à venir et le souci de la préservation d’un environnement humainement viable et nécessaire à la durabilité du développement humain ». (Stéphane LEYENS et Alexandra HEERING, 2010, p. 12). C’est ainsi compris que le développement durable gagnera, en partie, la bataille de l’implantation dans les pays africains. Notons bien que c’est seulement en partie, car l’appropriation du développement durable par les États africains ne peut se faire par procuration.
C’est pourquoi, après avoir relevé la responsabilité des partenaires au développement des États africains dans la dégradation de l’écosystème naturel de l’Afrique ainsi que dans l’action en faveur du développement durable, on ne peut passer sous silence celle des Africains eux-mêmes, puisqu’il s’agit ici de montrer la nécessité de les engager à s’approprier l’action en faveur du développement durable. Qu’il soit nécessaire pour les Africains de penser le développement durable et d’élaborer des politiques d’exploitation rationnelle et de protection de l’environnement, c’est la conclusion à laquelle l’on parvient lorsqu’on observe leur comportement à l’égard de la nature. Les Africains sont portés, essentiellement dans le milieu rural, à détruire le couvert végétal, par la pratique de la culture extensive des vivriers et des produits d’exportation, et à adopter des pratiques qui favorisent l’appauvrissement de la nature, comme la culture sur brûlis et la traque de certains animaux sauvages, pour leur chair, au moyen des feux de brousse. Ces pratiques, qui s’inscrivent dans la droite ligne des moyens de satisfaction des besoins alimentaires des peuples africains, sont autant d’héritages culturels à repenser pour donner droit au développement durable, en Afrique.
Par ailleurs, sachant que la vie des Africains, dans leur majorité, se déroulait, en milieu traditionnel, dans une temporalité non propice à la programmation parce que non déchiffrable avec précision, il n’est pas, dans leurs habitudes, de faire des projections dans le futur, pour planifier une action à moyen ou à long terme. La conséquence en est que nombre d’Africains exploitent et consomment les richesses naturelles, sans se soucier de ce qui peut advenir dans un futur lointain. Bien plus, dans l’Afrique traditionnelle, plusieurs peuples et tribus vivaient en autarcie, et même en castes autonomes, ce qui n’a pas cultivé chez eux une appréciation globale des besoins des populations de l’Afrique, encore moins de la planète. Or, au cœur de toute politique au service du développement durable, se trouve « la nécessité de prendre en considération différentes dimensions et temporalités ». (Géraldine Froger, 2006, p. 15). Dans la perspective du développement durable, en effet, il faut toujours agir, en tenant compte des multiples aspects de la vie sur terre et du droit pour les générations à venir, de trouver dans la nature, les ressources nécessaires pour satisfaire leurs besoins.
Dans l’Afrique traditionnelle dont la population était relativement peu nombreuse, l’usage qu’on faisait des richesses et produits de la nature n’était pas de nature à faire craindre des pénuries et des pollutions. Mais, force est de constater que les choses ont évolué considérablement aujourd’hui. La population urbaine, multiplicatrice des besoins vitaux et génératrice de besoins nouveaux, s’accroît à grande vitesse en Afrique, et avec elle, les risques de pénurie, de pollution et de destruction de d’écosystème. Une conversion des mentalités s’impose donc si l’on veut gérer efficacement les besoins des générations présentes et futures en rapport avec la nécessité de préserver les ressources naturelles disponibles. Il faut planifiez, faire des projections à court, moyen et long terme, et agir de manière concertée avec l’ensemble des secteurs d’activité de la vie communautaire et des autres parties du monde. C’est dans cette logique que
la notion de développement durable met l’accent tant sur les politiques environnementales au Nord et le développement du Sud que sur l’équité intergénérationnelle – sans oublier la question intragénérationnelle de la répartition équitable des richesses – ainsi que sur la recherche de l’articulation de différentes dimensions : environnementale, économique, humaine et sociale, au-delà de la simple juxtaposition. (Géraldine Froger, 2006, p. 13).
C’est un esprit cosmopolitique au sens kantien, c’est-à-dire un esprit sensible aux besoins et aux problèmes des hommes, où qu’ils vivent sur la terre, qu’exige l’appropriation du développement durable. Cet esprit, qui ne peut qu’être à l’avantage des États africains qui ont besoin d’oreilles attentives à leurs multiples besoins, ne les dispense pas d’assumer leurs responsabilités devant l’histoire et vis-à-vis de leurs peuples.
C’est pourquoi, les États africains s’évertuent à produire en grande quantité, des vivres et autres biens de consommation, pour satisfaire les besoins vitaux des populations rurales et surtout ceux des populations urbaines en constante croissance. C’est ainsi qu’ils sont souvent conduits à l’exploitation anarchique et abusive des ressources naturelles, et à l’utilisation non rationnelle des terres. Que ne fait-on pas, aujourd’hui, en Afrique subsaharienne, où l’agriculture est la principale source de revenu, pour produire en quantité suffisante en vue de satisfaire les besoins des populations ? L’utilisation de produits chimiques de toutes sortes, le renforcement, par mutation génétique, de la productivité des denrées de grande consommation, tout y passe, pourvu que les besoins fondamentaux des citoyens soient satisfaits. C’est à juste titre que Issaka Dialga (2017, p. 38) écrit à propos des pays en développement :
L’environnement y est perçu comme un bien de luxe dont sa protection passerait après la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, laquelle satisfaction, nécessitant une croissance soutenue de l’économie, donc une industrialisation forte acceptant même celles les moins respectueuses de l’environnement.
Les pays africains sont ainsi exposés, comme les pays occidentaux, même si ce n’est pas au même degré, à des agressions permanentes de l’écosystème naturel. La prise en compte, à la fois globale et locale de ces menaces contre les conditions de possibilité de la vie et du bien-être sur terre, et la recherche subséquente de solutions préventives, palliatives et curatives, est l’objet des politiques de développement durable recommandées par le système des Nations unies. Le concept de développement durable fonctionne ainsi, comme un nouveau paradigme politico-éthique, à vocation mondiale, favorisant l’action collective et concertée en vue de préserver la planète des périls écologiques et des conflits générés par les inégalités criantes. C’est ce qu’exprime Bruno Villalba (2009, p. 37) quand il écrit :
Le développement durable, dans ses approches normatives, esquisse les voies d’un véritable projet de changement social, un projet politique de grande ampleur puisqu’ayant une visée in fine mondiale, s’appuyant sur le double constat de la crise écologique et du niveau intolérable des inégalités, qui l’un comme l’autre s’aggravent.
Si donc l’idée de développement durable emporte celles d’attention à la qualité du cadre naturel de vie, et de justice sociale, il n’y a pas lieu de s’en méfier pour quelque raison que ce soit.
Quand même il faudrait s’investir dans les actions en faveur du développement durable pour n’en récolter que de maigres résultats, cela vaudrait encore la peine ; car l’alternative, c’est l’abandon, la perte de soi et des autres, la destruction de ce que nous n’avons pas créé. La position privilégiée des Africains, celle de n’avoir pas encore fait subir trop de dégâts à l’écosystème du continent, en comparaison avec les autres continents, devrait constituer un motif d’encouragement, pour eux, à s’impliquer, à fond, dans les programmes et actions en faveur du développement durable, pour préserver cet avantage. Le risque de dégradation de l’environnement urbain est bien réel en Afrique subsaharienne. Le rapport pays 2010 du Ministère de l’environnement et du développement durable de la côte d’Ivoire est édifiant à ce sujet :
Presque tous les plans directeurs d’urbanisme n’ont pas été appliqués et il n’existe aucun Plan d’Occupation des Sols (POS) en Côte d’Ivoire. En plus de l’occupation des sols par les habitants non contrôlés, il convient de mentionner les 2.822 établissements industriels installés principalement (92, 8%) à Abidjan. La non-existence de POS et le non- respect des règles d’urbanisme et de construction résultent, entre autres, en une juxtaposition spatiale des habitants et des industries, une expansion rapide et inefficiente de la superficie urbaine et souvent aussi en une modification des systèmes de drainage provoquant des inondations et la pollution de l’environnement[9].
Il est donc souhaitable que les gouvernants africains sortent de la logique binaire qui oppose le développement économique au développement durable pour leur assigner un noble objectif commun, celui de la qualité de la vie inscrite dans la durée. Ainsi compris, « le développement durable en Afrique ouvre la voie à une réconciliation des sphères environnementales et économiques pour une meilleure harmonisation des processus de l’évolution naturelle et du progrès économique, et ce de façon intemporelle ». (Modeste Chouaïbou Mfenjou, 2002, p. 15).
Conclusion
L’Afrique ne peut pas ignorer la question du développement durable, au moment où elle amorce son développement, sans commettre la même erreur que les pays développés qui se sont aperçus, après des dégâts considérables causés sur l’écosystème naturel, qu’ils auraient dû penser plus tôt à la survie de la planète et des générations futures. Il existe, certes, des contraintes économiques, des impératifs impérialistes, et des pesanteurs culturelles qui empêchent les Africains de prendre en compte, de manière effective, le développement durable dans leurs politiques de développement, mais on ne peut excuser si facilement une erreur qui coûterait la dégradation de l’écosystème indispensable à la vie sur terre. La responsabilité qui incombe à tous les États, de s’investir dans la recherche de méthodes et stratégies nécessaires à la mise en œuvre d’une politique cohérente de développement durable, ne peut faire l’objet de tergiversation.
C’est le lieu d’en appeler au changement de mentalité de ceux des Africains pour qui le concept de développement durable serait une invention des pays développés, sous le couvert de la communauté internationale, pour freiner l’élan de ceux qui cherchent à se développer comme eux. Il faut se raviser avant d’avoir à le faire avec la conscience chargée de regrets. C’est aussi le lieu de réveiller de leur scepticisme ceux qui tiennent le développement durable pour une chose irréalisable, et qui ne trouvent aucune raison de s’en préoccuper. Il n’y a qu’à se détacher de tout préjugé pour qu’une analyse sans passion révèle la pertinence de ce concept. C’est à juste titre que Géraldine Froger (2006, p. 15) fait cette observation : « Dès qu’on ne considère pas le développement durable comme une utopie généreuse, il est possible de poser les problèmes différemment et de réfléchir au sens qu’on peut lui donner ».
Si les projets politiques de développement d’un grand nombre d’États d’Afrique subsaharienne restent tributaires de pratiques culturelles peu soucieuses du développement durable, il y a lieu d’appeler l’attention des Africains à plus de vigilance à l’égard de tout ce qui peut contribuer à la destruction irréversible de la planète. Tous ceux qui prennent une part active aux actions de sauvegarde et de restauration de la planète ne se rendent pas seulement utiles à la préservation de la vie sur terre, mais aussi à la paix qui lui est indispensable. Car là où la raréfaction des ressources vitales point à l’horizon, se profile aussi le spectre des conflits et de la guerre qui ne laissent aucune place aux droits des peuples et de la personne humaine.
Références bibliographiques
Bertrand ZUINDEAU, 2000, Développement durable et territoire, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaire du Septentrion.
Bruno VILLALBA, 2009, Appropriation du développement durable. Emergences, diffusions, traductions, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.
Christian CHABOUD, Géraldine FROGER, Philippe MERAL, 2007, Madagascar face aux enjeux du développement durable ; Des politiques gouvernementale à l’action collective locale, Paris, Karthala.
Corinne GENDRON, 2006, Le développement durable comme compromis : La modernisation écologique de l’économie à l’ère de la mondialisation, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Emmanuel KANT, 1793, Théorie et pratique, traduit par Françoise Proust, Paris, Flammarion.
Emmanuel KANT, 1796, Métaphysique des mœurs II, traduit par Alain Renaut, Paris, Flammarion.
Emmanuel KANT, 1920, Leçons d’éthique, traduit par Luc Langlois, Paris Librairie Générale Française.
Géraldine FROGER, 2006, La mondialisation contre le développement durable ? Ecopolis nº 6, Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes.
Issaka DIALGA, 2017, Un développement durable fondé sur l’exploitation minière est-il envisageable ? Élaboration d’un indice de soutenabilité des Pays Miniers appliqué au Burkina Faso et au Niger, Thèse soutenue le 22juin 2017 à l’Université Bretagne Loire.
Issouf MEITE, 2014, Gouvernance du transport urbain et mobilité durable dans le district d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Thèse soutenue le 06 mars 2014 à l’Université de Strasbourg.
Modeste Chouaïbou MFENJOU, 2002, L’Afrique à l’épreuve du développement durable, Paris, l’Harmattan.
Stéphane LEYENS et Alexandra HEERING de, 2010, Stratégies de développement durable : Développement environnement ou justice sociale ? Namur, Presses universitaires de Namur.
ISAÏAH BERLIN : UN CRITIQUE DE LA LIBERTÉ CHEZ JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Marceline EBIA
Grand Séminaire de Philosophie d’Abadjin-Kouté (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Placée sous les mauvais auspices du monisme et du rationalisme des anciens, la liberté chez Rousseau apparaît dans la critique du penseur russo-britannique Isaiah Berlin comme une justification intellectuelle du totalitarisme des XXe et XXIe siècles. Contrairement aux penseurs politiques modernes tels que Locke, Constant ou encore Mill qui ont développé une théorie négative de la liberté, Rousseau donne une interprétation positive de celle-ci, arrachant ainsi à l’individu toute possibilité de choix personnel. Or, la possibilité de choix demeure le critère ultime d’une liberté individuelle véritable, puisque la pluralité de fins est consubstantielle à la condition humaine. De ce fait, la liberté rousseauiste, en ce qu’elle prône l’exaltation d’un moi idéal, serait moins attrayante dans le champ de la philosophie politique moderne.
Mots-clés : Individu, liberté, pluralisme des valeurs, rationalisme, société, volonté générale.
Abstract :
Placed under the bad auspices of monism and rationalism of the ancients, Rousseau’s freedom appears in the criticism of the Russian-British thinker Isaiah Berlin as an intellectual justification of the totalitarianism of the twentieth and twenty-first centuries. Unlike modern political thinkers such as Locke, Constant or Mill who developed a negative theory of liberty; Rousseau gives a positive interpretation of liberty, thus depriving the individual of any possibility of personal choice. Now, the possibility to choose remains the ultimate criterion of true individual liberty, since the plurality of ends is consubstantial with the human condition. As a result, Rousseau’s liberty, since it advocates the exaltation of an ideal ego, would be less attractive in the field of modern political philosophy.
Keywords : Individual, liberty, Value pluralism, rationalism, society, general will.
Introduction
La liberté individuelle chez Rousseau s’enracine dans une réflexion construite autour du passage de l’état de nature à l’état social. La relation interpersonnelle devient indispensable dans la définition de la liberté dès lors qu’on admet que l’individu en société cesse d’être une entité isolée. Pourtant, en dépit du rôle que joue la société, celui d’assurer la liberté, Rousseau estime qu’elle reste un lieu de lutte perpétuelle. L’enjeu principal de sa théorie politique consiste à « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéit qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 360). Ainsi naît son célèbre concept de la volonté générale, l’une de ses notions centrales, dont l’aboutissement est de « mettre la loi au-dessus de l’homme » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 955). Pour garantir la liberté, cette loi doit « partir de tous pour s’appliquer à tous » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, 373); c’est à elle seule que l’individu doit obéissance.
Une telle conception de la liberté de l’individu pose problème à plusieurs égards et a suscité un certain nombre de critiques dont celle d’Isaiah Berlin. Entendre la voix critique d’Isaiah Berlin[10] sur la liberté chez Rousseau, constitue la préoccupation de la présente étude. On s’interrogera, non seulement, sur les implications de la conception rousseauiste de la liberté au niveau politique, mais aussi sur sa recevabilité dans le contexte de la postmodernité politique où la pluralité s’impose à la fois comme valeur et critère de liberté individuelle[11]. On verra que la dynamique de la critique de Berlin cache, au fond, la promotion de ses propres paradigmes, lesquels émergent dans un contexte de crise socio-politique. Ainsi, après un examen de la dialectique entre liberté et volonté générale (1), L’étude visera les fondements métaphysiques de la volonté générale (2) afin de la confronter avec le pluralisme des valeurs, un des traits caractérisant la modernité politique (3).
1. La liberté chez Rousseau : une tyrannie déguisée de la volonté générale
La question de savoir comment concilier le désir humain de liberté et le besoin d’autorité occupe les penseurs politiques modernes tels que Machiavel, Bodin, Hobbes, Locke… Ils étaient tous conscients que la vie en société présuppose de ne pas laisser libre cours à toutes les envies de chacun parce que cela serait préjudiciable à tous. Il fallait donc un arrangement social de nature à établir un minimum de régulation. Mais peut-on vraiment jouir de la liberté dans une société où les lois sont contraignantes ? Cette préoccupation avait donné lieu à une diversité de réponses selon l’anthropologie des penseurs politiques en présence, plus précisément, Hobbes et Locke dans leurs théories du contrat social.
L’anthropologie de Hobbes l’avait conduit à l’élaboration d’une autorité plus forte susceptible de freiner les passions désordonnées de la nature humaine. Car pour lui, s’il n’y a aucun « pouvoir commun qui les tienne tous en respect » (Thomas HOBBES, 1971, pp. 125-126), les hommes vivraient dans une société conflictuelle, brutale et éphémère (Thomas HOBBES, 1971, p. 125). Pourtant, en dépit de son absolutisme, Hobbes a pu définir la liberté du sujet comme « absence d’obstacle extérieur » (Thomas HOBBES, 1971, p. 220). présupposant ainsi que la liberté exige une aire minimum d’action qui ne « devrait en aucun cas être violée » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 173).
Locke, par contre, était convaincu qu’il n’était pas nécessaire de créer une société dotée d’une autorité politique qui dominerait l’individu. Il fait donc jouer au droit, non pas un rôle de restriction de la liberté, mais de préservation, de protection et surtout d’accroissement de la liberté. La préoccupation de Locke était de définir un champ à l’intérieur duquel l’individu s’exprimerait librement. Il en ressort une définition de la liberté plus négative que positive chez Hobbes et Locke, et qui a conduit Berlin à les considérer comme deux auteurs qui auraient tenté de « fixer la limite » entre la liberté et l’autorité politique (Isaiah BERLIN, 2009, p. 66). Ce faisant, ils ont fourni « les bases philosophiques essentielles à la synthèse libérale en ouvrant la voie à la promotion de la liberté individuelle» (Jean-Fabien SPITZ, 1995, p. 31). Or, c’est justement ce projet de fixer une limite entre la liberté et l’autorité politique que Rousseau remet en cause.
Berlin fait remarquer, dans son livre, La liberté et ses traîtres[12], que Rousseau, en conférant à la liberté « une valeur absolue » défend une thèse assez séduisante (Isaiah BERLIN, 2009, p. 68). Identifiant la liberté à l’essence humaine, l’auteur du Contrat social nie toute différence profonde entre le concept de liberté et celui de l’homme. Comme le souligne le Contrat social: « renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 356). Dans cette perspective, la liberté ne peut être modifiée ou compromise sans que l’on ne porte atteinte à la nature humaine. Berlin trouve cette approche conceptuelle assez originale et très respectueuse de l’individu. La liberté chez Rousseau apparaît, non seulement, le plus sacré des attributs humains, mais l’essence même de l’être humain.
Pourtant, à en croire Berlin, l’argument de Rousseau rencontre, très vite, un problème crucial qui va subvertir sa définition de la liberté lorsqu’il aborde la question de l’homme en société. En érigeant la liberté en valeur absolue, il fonde sa théorie politique sur un paradoxe puisqu’il établit aussi les règles par lesquelles chacun est préservé de l’oppression d’autrui comme une valeur absolue. En proclamant la liberté et les lois comme deux valeurs absolues, la pensée de Rousseau devient, très vite, contradictoire. Nous avons, à la fois, « la valeur absolue de la liberté, et la valeur absolue de bonnes règles » (Isaiah BERLIN, 2009, p. 74). Que faire, puisqu’il ne laisse pas la possibilité d’un choix ?
Ce dilemme en présence de deux valeurs est tel que Berlin juge Rousseau comme un vrai « maniaque » (Isaiah BERLIN, 2009, p. 77). Mais pour l’auteur du Contrat social, il paraît nécessaire de supprimer la vieille querelle entre l’autorité et la liberté, d’où l’invention de cette mystérieuse compatibilité entre les deux termes à travers sa célèbre formule : « chacun se donnant à tous ne se donne à personne » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 361). Dès lors que la formule est prononcée, la compatibilité entre liberté et autorité est aussi produite parce qu’en réalité « l’État, c’est vous, et d’autres comme vous qui recherchent tous le bien commun » (Isaiah BERLIN, 2009, p. 88). Mais, ironie du sort. Pour former l’État, l’individu doit transporter le « moi personnel » dans le « moi commun ». Si donc la liberté est maintenue, ce n’est qu’au travers de la volonté générale dans laquelle tous se retrouvent désormais. Berlin le mentionnera à juste titre, cette volonté générale, en apparence inoffensive, constitue la cause majeure du malheur de l’individu.
En la voyant sous cet angle, Berlin renvoie la liberté rousseauiste à la vieille tradition qui remonterait aux penseurs antiques pour qui la recherche d’un bien commun reste le critère ultime d’une bonne communauté politique. Dans ce contexte, l’individu ne reçoit la signification de sa propre existence que comme un don de la totalité. Jacqueline de Romilly souligne comment chez les Grecs, mener sa vie au service de la cité, ou encore, se conformer au bien commun, est considéré comme le meilleur exemple du citoyen vertueux et de la liberté. Rousseau fait exactement appel à ce modèle des anciens : « chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le fait par lui-même, il était sans cesse assemblé sur la place » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 430). De fait, la liberté pour lui implique la participation politique : dans une cité bien conduite : « chacun vole aux assemblées » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 429).
La défense de la participation populaire apparaît, aux yeux de Berlin, comme une pure illusion d’autant plus que ce qui gouverne, dans la réalité, c’est la volonté générale. Tout individu ayant renoncé à son droit pour le transférer à la communauté politique lui est désormais intimement lié. Le Contrat social stipule qu’« à l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres […], lequel reçoit de ce même acte d’unité, son moi commun, sa vie et sa volonté » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 361). Autrement dit, au moment où le « moi individuel » s’aliène pour former le corps social, il s’ensuit aussi sa dissolution. Berlin considère, avec raison, que le pacte social qui constitue ce « moment mystique » est l’une des pires monstruosités de la théorie de Rousseau ; il produit l’État en supprimant l’individu (Isaiah BERLIN, 2009, p. 89). Rousseau serait resté à l’orée de la modernité politique puisqu’il n’a pas compris que la liberté devrait passer de sa signification d’exercice de la vertu à celle de la possibilité de choix.
C’est pourquoi, d’après Berlin, la définition d’une liberté portant sur la faculté de choisir des fins de manière autonome, énoncée au début du Contrat social, fait place à la domination de la volonté générale. L’individu rousseauiste n’est ni libre ni responsable ; car « agir, c’est choisir et choisir implique d’effectuer une sélection entre divers objectifs » (Isaiah BERLIN, 2009, p. 69). Mais, si Rousseau paraît assez éloigné de la liberté au sens où Berlin l’entend, c’est que pour lui, une liberté où persiste l’autonomie personnelle maintient l’état conflictuel. C’est une erreur de penser la liberté à l’état social à partir des catégories de l’état naturel. Sans doute que le point de vue de Rousseau est peu pertinent, il pose pour autant le problème des relations interpersonnelles comme crucial en philosophie politique.
Quelles que soient les justifications qu’on pourrait apporter, Berlin estime que la coïncidence entre l’État et l’individu constitue l’erreur majeure de Rousseau. L’entité qui commande, c’est toujours la volonté générale, et qu’importe si elle décide de supprimer la vie de l’un de ses membres pour le bien de tous ! Cette mystérieuse coïncidence entre deux termes incompatibles à travers le sophisme de l’aliénation totale conduit à déposséder l’individu de tout contrôle sur lui-même. Si Berlin reconnaît qu’on ne peut nier des prémisses individualistes dans la pensée politique de Rousseau, elles se transforment, cependant, en totalitarisme (Céline SPECTOR, 2011, p. 59). Mais si Berlin voit en Rousseau le théoricien d’une liberté périlleuse, c’est que, pour lui, les fondements métaphysiques de ce concept restent profondément marqués par une conception rationaliste
2. Les fondements rationalistes de la volonté générale
La théorie rationaliste est fondée sur un dédoublement de la personnalité entre, d’un côté, un « moi transcendant » reconnu comme une instance de contrôle, et de l’autre, un ensemble empirique de désirs et de passions « qu’il faut soumettre à une stricte discipline » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 180). Ce « moi transcendant » appelé aussi « moi authentique », peut prendre l’ascendant sur l’individu pour devenir quelque chose de plus grand, comme « une totalité, une tribu, une race, une Église, un État, […] dont l’individu ne constituerait qu’un élément ou un aspect » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 180). Il n’est pas exclu que le « moi transcendant » soit assimilé à la partie rationnelle de l’individu lui-même.
Cette définition montre, très clairement, que le rationalisme constituerait une vraie entorse pour la liberté négative dont Berlin entend être le promoteur. Le rationalisme est la doctrine dont les « diverses transpositions au plan politique, aussi disparates et opposées les unes aux autres soient-elles, sont aujourd’hui au cœur de nombreuses doctrines nationalistes, communistes, autoritaires et totalitaires de notre époque » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 192). En indexant donc le concept de la volonté générale, il s’agit bien pour Berlin de freiner l’influence de la doctrine rationaliste qui aurait fait déjà assez de mal à l’individu. Si la pensée de Rousseau peut constituer une cible de critique, c’est que Berlin voit, dans son concept de volonté générale, l’exaltation d’un « moi » mythique.
En soutenant la volonté générale comme la volonté « la plus juste », Rousseau lui attribue aussi un statut rationnel (Jean-Jacques ROUSSEAU, p. 246). Ce faisant, elle devient la seule volonté susceptible de s’arroger le droit à la vérité. Chez Rousseau, la volonté générale représente le « moi transcendant ». Vu sous cet angle, la volonté générale implique une dissociation d’un « moi dominateur » et d’un « moi dominé » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 180). L’enjeu de la volonté générale consiste, dans ce cas, à arracher l’individu à toutes formes de désirs irrationnels. Dans cette optique, Leo Strauss démontre comment la volonté générale, se basant sur des règles normatives universelles se rapprocherait de la justice raisonnée. C’est cela qui lui permet d’agir efficacement contre les errances de l’égoïsme. En jouant ce rôle, elle devient la raison qui remplace la nature.
Chez Rousseau, le « moi commun », l’État ou encore la volonté générale représente ce moi supérieur auquel tout individu, une fois le dépassement du « moi personnel » effectué, devrait se conformer afin d’espérer atteindre la liberté. Dès lors, la liberté devient compatible avec la domination de la volonté générale. Ayant le statut du divin, elle est amenée à jouer le rôle de référence axiologique; c’est-à-dire, charger de professer le juste ou l’injuste puisqu’elle est « toujours droite » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 371). L’individu rousseauiste ne sera libre que s’il se conforme, non à ses propres désirs, qui avilissent l’image de la conscience en lui, mais aux décrets divins de la volonté générale.
On peut aisément comprendre que l’obéissance à la loi pouvant être considérée comme le fait même de la liberté, on aboutit à cette célèbre phrase de Rousseau : « quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 364). Mais affirmer les choses de cette manière suppose de considérer la contrainte, non pas comme un instrument d’oppression, mais plutôt de liberté. Elle a une mission salvifique, celle d’arracher l’individu à ses passions. À ce sujet, l’ironie de Berlin en dit long ! L’individu qu’on force à être libre, c’est l’individu qui n’a pas « le cœur à la bonne place » (Isaiah BERLIN, 2009, p. 85). Ces considérations sur la volonté générale conduisent Berlin à affirmer que si en apparence, Rousseau encourage une participation politique elle est, en réalité, un leurre puisqu’il n’y a pas d’individu concret dans sa société politique. S’il est vrai que Berlin voit dans la conception politique de Rousseau une absence d’individu concret, en revanche, pour ce dernier, la volonté générale est à la portée de tout individu qui argumente rationnellement.
Le principe de la majorité fait partie des concepts majeurs utilisés dans la critique faite à Rousseau. Pour le citoyen de Genève, « Il n’y a qu’une seule loi qui par nature exige un consentement unanime, c’est le pacte social : car l’association civile est l’acte du monde le plus volontaire […]. Hors ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige tous les autres ; c’est une suite du contrat même» (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 440). Et il poursuit : dans la délibération, « quand donc l’avis contraire au mien l’emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m’étais trompé, et que ce que j’estimais être la volonté générale ne l’était pas. Si mon avis particulier l’eut emporté, j’aurais fait autre chose que ce que j’avais voulu, c’est alors que je n’aurais pas été libre » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 441). Ces deux citations qui occupent une place de choix dans le Contrat social, apparaissent aussi comme la pierre d’achoppement des reproches qu’on adresse souvent à Rousseau. Nombre de commentateurs les considèrent comme la preuve de son totalitarisme[13].
Ces textes du livre IV tels qu’ils sont formulés signifient que, chez Rousseau, la minorité devrait obéir à la majorité parce qu’elle s’est méprise sur la volonté générale. Par manque d’une méditation suffisante, elle n’a pas pu découvrir ce que la majorité a perçu au travers des résultats du vote. La minorité a donc obligation d’obéir à la majorité : quelle liberté paradoxale ! Car affirmer la suprématie de « la voix du plus grand nombre » (Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 440), n’est-ce pas encourager la dictature de la majorité au mépris de la minorité ? Comment Rousseau en est-il arrivé là, lui qui militait en faveur d’une loi qui part de tous pour s’appliquer à tous. Rousseau n’a sans doute pas su que le principe de la majorité pousser plus loin déboucherait sur une société de classe : d’un côté les sachants, les sages et ceux qui gouvernent ; et de l’autre côté les ignorants, les insensés et ceux qui obéissent. Aussi, ses adversaires pour qui on ne peut obéir à une volonté à laquelle on n’a pas donné son assentiment ne tardent pas à lui reprocher son opposition à la diversité[14].
Berlin insiste sur les germes oppressifs présents dans la pensée politique de Rousseau. La défense d’un moi authentique maintient l’individu dans un état d’abnégation et de répression constante. La remise en cause du désir personnel rend vulnérable l’individu puisque sa volonté peut, à tout moment, être tenue pour une volonté erronée. La volonté générale, l’aliénation totale, le « moi commun » ou encore, le principe de la majorité sont autant de concepts qui auraient fondé les pires tyrannies de l’histoire, de Robespierre à Staline parce qu’ils n’offrent aucune possibilité aux hommes de faire librement leur choix. Au contraire, un seul choix est valable : la vie selon la raison.
Mais comment autrui saurait mieux que moi ce qui me conviendrait ? La raison étant le partage des humains, tout individu devrait pouvoir raisonner, émettre des jugements ou opérer des choix pour son bien-être. Pour Berlin, en tout cas, si la liberté comme la volonté de se gouverner soi-même peut paraître un postulat pertinent, elle déboucherait sur une « monstrueuse supercherie qui consiste à assimiler ce que Untel choisirait s’il était ce qu’il n’est pas, […] de ce qu’en réalité il recherche et choisit» (Isaiah BERLIN, 1988, p. 168).
Il convient, ici, de préciser que la critique du rationalisme chez Berlin ne signifie pas le rejet systématique de toute référence rationnelle; mais plutôt le rejet du « rationalisme de la tradition rationaliste occidentale » (Alexis BUTIN, 2014, p. 131) qui remonte à Platon[15] et dont Rousseau continue d’être le protagoniste. Berlin refuse ce rationalisme désuet et milite en faveur d’un rationalisme qui fait, non seulement la promotion de choix rationnel, mais surtout personnel. Il admet que la raison est capable de faciliter la résolution des conflits politiques et éthiques ; or cela n’est possible que si elle reconnaît la pluralité des fins. Berlin suggère donc une raison critique capable de connaître ses propres limites.
C’est pourquoi, à aux yeux de Berlin, Rousseau reste prisonnier d’une raison qui, au final, cesse d’être universelle pour devenir un bien privilégié et accessible à un cercle restreint de sages. La raison rousseauiste se voit privée de sa capacité à opérer des choix libres devant une pluralité de biens alors que c’est cela même qui fait l’essence de la nature humaine et de la liberté. Ainsi, celui dont on a pendant longtemps associé l’image au romantisme des lumières devient, pour Berlin, le promoteur d’un « moi abstrait ». Mais, avant lui, Derathé relevait déjà des accents rationalistes dans la pensée de Rousseau. Bien qu’il le reconnaisse comme un penseur profondément sensualiste[16], Derathé observe, tout de même, la présence d’un rationalisme, quoique assez spécifique, qui le rapprocherait de « tous les grands penseurs rationalistes » (Robert DERATHE, 1948, p. 120).
Aussi logique que puisse paraître la pensée politique de Rousseau, Berlin estime qu’elle porte les traces de sa propre subversion. On ne peut obliger une personne à agir pour son bien sous prétexte de lire dans son moi intime l’intention de vouloir ce qu’il refuse en apparence. Les critiques de Berlin à l’égard de Rousseau peuvent avoir toute leur pertinence si l’on admet la possibilité de l’errance de la volonté générale, laquelle peut exposer la minorité à une dictature de la majorité. En insistant uniquement sur la validité de l’opinion de la volonté majoritaire, Rousseau omet, non seulement, de protéger la minorité en cas d’errance de la majorité, mais aussi d’intégrer le fait que la voix de la minorité peut fortement contribuer à la dynamique sociale. Aussi, on pourrait déduire que le concept même de la volonté générale, comme le souligne Berlin, n’offre pas de possibilité à la volonté personnelle de se manifester pleinement. On peut donc comprendre que l’admiration pour le pluralisme devenue une valeur majeure de la postmodernité éloigne Berlin du concept de liberté rousseauiste.
3. Rousseau, l’ennemi du pluralisme des valeurs
La volonté générale devenue l’épicentre de la critique ne tarde pas à être passée au crible des paradigmes philosophiques dont le pluralisme demeure le plus important chez Berlin. Le pluralisme qu’il considère comme intrinsèquement lié à la liberté de l’individu le conduit à situer Rousseau parmi les philosophes monistes. Ce courant de pensée représenterait la thèse centrale de la philosophie occidentale depuis l’antiquité jusqu’à l’époque moderne : Aristophane, Théopompe, Evhémère, Zénon, Blossios de Cumes, Platon pour les temps anciens et Helvétius, Rousseau, Fichte, Hegel, Saint-Simon, Maistre pour l’époque moderne sans oublier les théories marxistes (Isaiah BERLIN, 1992, pp. 33-39). Le monisme considère qu’« il devrait y avoir une voie qui conduise les penseurs éclairés vers des réponses correctes à toutes les questions aussi bien en théorie morale, sociale et politique que dans les sciences naturelles ; après avoir obtenu et mis ensemble toutes les réponses aux questions morales, sociales et politiques les plus profondes, nous obtiendrons ainsi la solution finale à tous les problèmes de l’existence » (Isaiah BERLIN, 2000, p. 5).
Dans cette perspective, toutes les bonnes réponses sont compatibles entre elles et forment un tout unique et hiérarchique. Le postulat du monisme repose sur des présupposés métaphysiques d’un univers ordonné et cohérent derrière le désordre apparent. Ainsi, tous les conflits moraux peuvent être résolus grâce à une valeur prépondérante qui ne peut être reconnue que par des êtres rationnels. Or, pour Berlin, il est impossible, en théorie et en pratique, de trouver des réponses définitives « même dans un monde idéal composé d’hommes parfaitement bons et rationnels et d’idées parfaitement claires » (Isaiah BERLIN, 2000, p. 217). Pourtant, en dépit de ses erreurs, le monisme, aurait énormément influencé la pensée occidentale au travers des universités et les cercles intellectuel (Jean WAHL, 2005, p. 25). Ce succès moniste s’expliquerait par le simple fait que la croyance en un seul critère constitue une grande source de satisfaction, à la fois, pour l’intellect et pour les émotions. La force du monisme réside dans sa tendance à suggérer « des jugements raisonnables sur la morale comparée des multiples conceptions et traditions de la vie bonne» (John KEKES, 1993, p. 34-35).
L’hégémonie du monisme n’empêche pas Berlin de croire que le pluralisme demeure « un idéal plus véridique et plus humain » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 217). Car prétendre classer toutes les valeurs à une même échelle de sorte que l’on puisse déterminer la plus importante serait en contradiction avec l’idée que tous les hommes sont « des agents libres » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 217). Le pluralisme reconnaît l’existence d’une pluralité de buts humains qui ne sont pas tous commensurables, mais sont en perpétuelle rivalité les uns avec les autres. Berlin entend donc défendre l’idée que l’existence de plusieurs valeurs morales d’égale importance et non conciliables exige de l’individu qu’il fasse librement ses choix. On peut très bien comprendre pourquoi il peut considérer Rousseau comme l’ennemi du pluralisme : « l’ennemi du pluralisme, c’est le monisme » (Isaiah BERLIN, 2000, p. 14).
Berlin perçoit Rousseau comme l’un des théoriciens les plus influents du monisme occidental. Ce n’est pas qu’il lui reproche d’avoir tenté la résolution du conflit à travers sa théorie du contrat social ; mais d’avoir édifié son discours politique sur des bases monistes. La théorie de la volonté générale prend ses racines sur le sol du monisme parce que ce concept se positionne comme la seule instance susceptible de donner des réponses justes et vraies. En ce sens, il existe, chez Rousseau, l’idée que la question des fins n’a qu’une réponse unique et exclusive. Il en résulte que pour le Genevois, « tout comme dans les sciences, la réponse vraie donnée par un seul scientifique sera acceptée pour tous les autres scientifiques également doués de raison ; de même en éthique et en politique, la réponse rationnelle est la seule correcte : la vérité est une, l’erreur seule est multiple » (Isaiah BERLIN, 1990, p. 63). Autrement dit, la pluralité des réponses à la question des fins impliquerait que la question elle-même est viciée ; « à chaque question vraie, il devrait exister une unique et seule réponse vraie » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 192).
Comme dans toute conception moniste, Rousseau croit trouver une solution aux conflits politiques à travers l’instauration d’un ordre juste. Sa foi en une société harmonieuse dans laquelle les problèmes éthiques seraient résolus par les règles de la volonté générale l’empêche de reconnaître que la pluralité est consubstantielle à la vie humaine. L’établissement d’une vie sous la conduite suprême de la volonté générale devrait faire advenir un monde meilleur de telle sorte qu’il n’existe plus de questions morales et politiques. Si l’on arrive à créer un corps social où les individus ont une volonté commune alors les conflits disparaîtront, mais pour cela, il faut une vie selon la raison. Car l’irrationnel en l’homme est ce qui le pousse à la passion, à l’intérêt égoïste et à l’exploitation d’autrui.
L’utopisme de Rousseau réside dans sa quête d’unité ; il ne se préoccupe nullement de la préservation de la possibilité de choisir parce qu’il est convaincu que la prédétermination du bien produit le silence des passions. Grâce à la volonté générale dont le processus du dévoilement se fait dans la solitude et par méditation, les buts communs sont fixés d’avance. Il suffit d’entrer en soi-même pour les découvrir ; la volonté générale étant déjà posée, il revient à chacun de chercher le « chemin qui y mène » (Isaiah BERLIN, 1992, p. 40). Le rêve moniste consiste donc à élaborer une société dans laquelle les hommes vivent dans « une clarté perpétuelle, égale, sous un climat tempéré, au sens d’une nature généreuse et infiniment féconde » (Isaiah BERLIN, 1992, p. 33). Or, dans ce nouvel ordre statique, il n’existe ni nouveauté, ni changement puisque seul le conflit permet une dynamique de vie. Si exaltant que soit cet état paradisiaque, il n’est pas la réalité humaine ; il n’est qu’une société utopique.
C’est pourquoi, contrairement à cette perceptive moniste, Berlin insiste plutôt sur le fait que « n’importe quelle étude de la société montre que chaque solution crée une nouvelle situation, qui sécrète à son tour de nouveaux besoins et de nouveaux problèmes, de nouvelles exigences » (Isaiah BERLIN, 1992, p. 27). Autrement dit, il est impossible de supprimer définitivement les conflits interpersonnels ou sociaux. Ce que l’on demande, c’est plutôt la recherche des moyens permettant à la multiplicité des volontés de pouvoir cohabiter ensemble. Avec Berlin, la liberté prend donc la forme du pluralisme, lequel intègre le conflit systématique des valeurs ou des fins également absolues. L’expérience humaine confronte les hommes à des choix face à des fins dont la réalisation implique nécessairement des renoncements ou des sacrifices. Chaque être humain est responsable de ses propres actions puisque nul n’est prédéterminé. Il s’ensuit que « la nécessité de choisir entre des exigences tout aussi absolues est une dimension inhérente de la condition humaine» (Isaiah BERLIN, 1988, p. 215).
Les valeurs ont une existence irréductible qui ne leur permet pas d’être englobantes. Elles peuvent se contredire tout en gardant leur validité comme des thèses qui, bien qu’opposées, garderaient leurs cohérences. Il est impossible d’échapper à la nécessité de choisir entre des exigences tout aussi absolues. Parce que les valeurs sont, en dernières instances, plurielles, conflictuelles et incommensurables rendant le choix difficile et tragique, il est nécessaire que l’État protège la capacité de choix de chaque individu. Cela suppose d’instaurer un système politique ouvert à la possibilité de choix, c’est pourquoi Berlin confesse sa foi au binôme libéralisme-pluralisme: « je crois à la fois au libéralisme et au pluralisme » (Isaiah BERLIN, 1990, p. 65). Ce n’est pas qu’il établit un lien intrinsèque entre le pluralisme et le libéralisme. Mais, il donne sa préférence au système libéral parce qu’il reste plus ouvert au pluralisme des valeurs.
Berlin rejette la société politique de Rousseau où « la vie intérieure de l’homme, n’a plus voix au chapitre » (Isaiah BERLIN, 1988, p. 28). La solution finale supprimant toutes les alternatives aux problèmes humains n’aboutit qu’à une conséquence périlleuse, celle de la promotion de la répression. Marian Eabrasu remarque, à ce sujet, que c’est précisément pour toutes ces raisons, que le « monisme ne peut pas être dissocié des processus politiques violents mis en place par des agencements de type totalitaire » (Marian Eabrasu, 2009, p. 859). Or, Rousseau, en soutenant l’idée d’une solution univoque, celle de la volonté générale, encouragerait, au final, « des institutions coercitives [qui] ne sont pas le résultat d’un simple choix collectif mais d’un choix collectif qui ne tient pas compte de la pluralité des valeurs disponibles dans la société en question » Marian EABRASU, 2009, p. 868).
À partir de ce qui précède, Berlin estime que Rousseau aurait causé un mal énorme à la modernité dans son exaltation d’une mythologie d’un « moi authentique » et d’une méthode unique aux résolutions des conflits. Aussi, en s’opposant à la diversité, l’ami de la liberté s’est fourvoyé grâce au fondement métaphysique qui sous-tend son concept de la volonté générale. Rousseau s’est érigé en défenseur d’une sorte d’esclavage. Ainsi, « l’amoureux le plus ardent et le plus passionné de la liberté humaine […] qui tenta de briser les chaînes […] n’en fut pas moins l’un des plus sinistres et des plus formidables ennemis de la liberté de toute l’histoire de la pensée moderne » (Isaiah BERLIN, 2009, pp. 94-95). S’appuyant sur la double thèse du pluralisme et d’une interprétation négative de la liberté, Berlin peut découvrir, en Rousseau, le fossoyeur de la liberté individuelle chère aux modernes.
Conclusion
L’analyse de Berlin révèle trois éléments principaux dans sa critique adressée à Rousseau. L’annonce de la liberté comme une valeur absolue d’un côté, et l’obligation politique comme une valeur absolue de l’autre, plongent la théorie politique de Rousseau dans un véritable dilemme. Outre ce paradoxe de la liberté, Berlin décèle une difficulté dans les fondements métaphysiques du discours sur la liberté. La volonté générale telle qu’elle est formulée révèle Rousseau comme le continuateur du rationalisme des anciens. Cette démarche erronée du philosophe aboutit à des conséquences périlleuses, celle du monisme. Au final, en voulant construire une nouvelle conception de la liberté, Rousseau pose les bases philosophiques du totalitarisme et des pires dictatures des « XIXe et XXe siècles, [et que nous] subissons encore » (Isaïah BERLIN, 2009, p. 94).
Chez Berlin, si rationalisme, monisme, totalitarisme et liberté positive ne sont pas radicalement identiques, le ver est dans le fruit : ils baignent tous à la même source. Les uns et les autres constituent différentes facettes d’une même médaille, ils ôtent à l’individu la représentation qu’il a de lui-même. En dépit de la perspicacité de la critique de Berlin, resituée dans le contexte de guerre froide, son discours dépasse le simple apport conceptuel à la science politique pour se transformer en un soutien théorique indispensable aux gouvernements libéraux. L’État apparaît, en période de guerre froide, comme liberticide du fait de ses empiétements tentaculaires sur la sphère privée, d’où la nécessité de dénoncer les affres de l’autoritarisme.
Le souvenir de ces siècles de violence ne peut que lui inspirer le pluralisme des valeurs comme la solution pour éviter, à l’humanité, de nouvelles théories autocratiques. En faisant appel à l’histoire des idées, Berlin entend donc tirer les leçons du passé afin de mieux construire la postmodernité politique. Pourtant, si le pluralisme mérite d’être l’objet de tant d’attention, la société contemporaine ne pourrait correctement en profiter que si elle prend en compte le concept de collectivité dont la théorie de la volonté générale fournit les bases d’une vraie réflexion.
Références bibliographiques
BERLIN Isaïah, 1988 « Deux conceptions de la liberté », in Eloge de la liberté, Paris, Calmann-Lévy.
BERLIN Isaïah, 1990, En toutes libertés : entretiens avec Ramin Jahanbegloo, Paris, Félin.
BERLIN Isaïah, 1992, Le bois tordu de l’humanité : romantisme, nationalisme et totalitarisme, Paris, Albin Michel.
BERLIN Isaïah, 2009, La Liberté et ses traîtres, Paris, Payot & rivages.
BUTIN Alexis, 2014, Isaiah Berlin : Libéral et pluraliste, Paris, Michel Houdiard.
CROCKER Lester, 1965, « Rousseau et la voie du totalitarisme », Annales de Philosophie politique, Paris, PUF, n°5, p. 99-136.
DERATHE Robert, 1948, Le Rationalisme de J. J. Rousseau, Paris, PUF.
EABRASU Marian, « Deux lectures monistes de Berlin », Revue française de science Politique, vol. 59, n° 5, (2009-10), pp. 853-872.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1964, Considération sur le gouvernement de Pologne, tome III, Paris, Gallimard.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1964, Discours sur l’Économie Politique, tome III, Paris, Gallimard.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1964, Du Contrat Social, Œuvres complètes, tome III, Paris, Gallimard.
ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1964, Lettres écrites de la Montagne, Lettre VI, Œuvres complètes, tome III, Paris, Gallimard.
SPECTOR Céline, 2011, Au prisme de Rousseau : usages politiques contemporains, Oxford, Voltaire Foundation.
SPITZ Jean-Fabien, 1995, La Liberté politique : essai de généalogie conceptuelle, Paris, PUF.
VICE ET ÉTHIQUE DE LA PARTICIPATION DANS LES PROCESSUS DE DÉLIBÉRATION PUBLIQUE
Anicet Laurent QUENUM
Université Libre du Burkina
Résumé :
Depuis bien des années, l’espace public est fortement imprégné de discours faisant ostensiblement l’apologie de la participation. Ce concept a le vent en poupe et cela se justifie d’autant plus aisément qu’il trouve grâce aux yeux de la démocratie et des démocrates. Seulement, après avoir trop longtemps servi de poudre aux yeux ou de miroir aux alouettes, l’on s’aperçoit combien le mythe de la participation commence à se heurter à une quête plus offensive de transparence. La présente réflexion se propose d’évaluer les vices de la participation dans le processus de délibération pour mieux définir les exigences éthiques qu’appelle ce principe de bonne gouvernance dans nos jeunes démocraties ouest-africaines. Une opinion bien ancrée semble se ranger à l’idée que c’est la qualité de la délibération qui apporte à une décision son onction démocratique. Le débat reste d’autant plus ouvert que les sciences humaines et sociales n’ont pas fini de nous éclairer sur l’étendue réelle de la frontière entre participation et délibération et entre délibération et décision. De façon spécifique, la présente réflexion se propose d’apporter une réponse à cette question qui taraude bien des esprits ; celle de savoir dans quelle mesure la valeur démocratique d’une décision est fonction de la qualité des mécanismes participatifs et délibératifs ?
Mots-clés : Délibération, décision, démocratie, discussion, éthique, inclusion, participation.
Abstract :
For many years, the public space has been strongly impregnated with speeches ostensibly advocating participation. This concept has the wind in its sails and this is all the more easily justified because it finds favor with the eyes of democracy and the Democrats. Only, after having served too long as a powder to the eyes or mirror larks, one realizes how the myth of participation begins to face a more offensive pursuit of transparency. The present reflection proposes to evaluate the vices of the participation in the process of deliberation to better define the ethical requirements that calls this principle of good governance in our young democracies West-Africa. A well-anchored opinion seems to subscribe to the idea that it is the quality of the deliberation that brings to a decision its democratic anointing. The debate remains all the more open as the human and social sciences have not finished shedding light on the real extent of the boundary between participation and deliberation and between deliberation and decision. Specifically, the present reflection proposes to provide an answer to this question which teases many minds; the question of how far the democratic value of a decision depends on the quality of participatory and deliberative mechanisms.
Keywords : Deliberation, decision, democracy, discussion, ethics, inclusion, participation.
Introduction
La participation est une notion qui n’a pas de valeur en dehors du contexte dans lequel elle est exercée. Si hier, les décideurs et même les donateurs faisaient peu cas de la participation, il n’est plus possible aujourd’hui, sous les soleils de la démocratie, d’ignorer cette modalité dans la gestion de la chose publique ou de la coopération. S’inscrivant dans l’air du temps plutôt favorable à une logique horizontale des rapports institutionnels et diplomatiques, elle a été érigée en principe de gestion à différents niveaux de la chaine opérationnelle des programmes et projets de développement. L’apologie qui entoure ce paradigme délibératif aura finalement érigé la participation en une sorte d’hégémonie dans la pensée politique contemporaine. Il demeure néanmoins un concept important dans le domaine des sciences sociales et du management organisationnel où sont largement sollicités des outils et pratiques de délibération et de décision.
A l’évidence, le regain d’intérêt et la tonalité croissante du discours sur la participation est à l’aune de la soif de liberté et de démocratie qui s’exprime tous azimuts et de façon de plus en plus virulente. Si tous les gouvernants y adhèrent dans les principes, ils n’ont en revanche pas fini de rechercher les moyens d’assurer la pleine participation de l’ensemble des citoyens aux choix stratégiques et aux décisions collectives qui engagent l’avenir des nations. Peut s’inscrire dans cette dynamique, l’avènement depuis quelques années d’émissions interactives qui suscitent un grand enthousiasme auprès du citoyen moyen.
Que ce soit au Bénin, au Mali, au Burkina Faso ou au Sénégal, ces émissions battent des records de participation et permettent à des hommes et femmes de condition modeste de contribuer, de part leurs commentaires, analyses et critiques, à l’influence des politiques publiques et à une amélioration des pratiques de gouvernance. Ce faisant, les adeptes de ces tribunes d’expression se positionnent en amont d’un processus de prise de décision qui vraisemblablement ne franchit pas le seuil de la délibération. Dans bien ces cas, ces activistes du bout des ondes entretiennent juste l’espoir que leurs propositions soient prises en compte dans les réformes politiques et économiques futures. Si de façon évidente, nous sommes bien en présence d’une participation citoyenne au débat public, il paraît en revanche improbable de parler en pareille circonstance de participation délibérative.
Finalement, où avons-nous donc plus de chances de rencontrer les bonnes pratiques de délibération : dans les jurys d’examen ou de recrutement ? Dans les parlements ou les conseils économiques et sociaux ? Dans les Cours constitutionnelles ? Dans les Conseils d’administration ? Au sein des syndicats professionnels ?
1. Corrélation entre participation et délibération
Au cœur de cette réflexion, se trouve la question de la corrélation entre participation et délibération. Qu’est-ce qui peut le mieux valider un processus de délibération et le rendre sincère et irréprochable aux yeux des parties prenantes à une discussion ? Cette question à elle seule suggère déjà en filigrane que la participation n’a pas réponse à tout et n’est certainement pas la condition suffisante d’une bonne délibération. Mieux, la réponse à cette question requiert du coup une exploration plus fine de la typologie même des modèles ou modalités de participation, quitte à évaluer lesquelles sont véritablement garantes d’une véritable intersubjectivité pouvant conduire à une co-responsabilité des acteurs.
1.1. Typologie de la participation
Ainsi, dans le registre participatif, se croisent des modèles assez disparates qui ont chacun leurs adeptes en fonction des intentions et objectifs avoués ou supposés. Il subsiste que certaines pratiques de participation se caractérisent par leurs similitudes un peu comme le suggère le rapprochement entre la participation institutionnalisée et la consultation. Cette dernière part du principe que les mauvaises décisions des gouvernements résulteraient d’un déficit d’information en provenance de la base. D’où la justification d’un recours aux procédures participatives qui, au contraire,
« permettraient d’institutionnaliser une manière de faire remonter les savoirs et les désirs locaux, afin que le pouvoir politique puisse décider en connaissance de cause. Il ne s’agit donc pas, par la participation, de créer un espace de débat politique, mais plutôt d’instaurer une modalité « technique » de l’information gouvernementale » (Romain FELLI, 2005, p. 425-434, consulté le 24 septembre 2015).
Cette forme de participation dite institutionnalisée trouve des accointances avec « l’action collective » et la « mobilisation » à la différence que la première est une modalité de participation s’inscrivant généralement dans une dynamique interne, spontanée, suscitée de l’intérieur tandis que la seconde peut être inspirée depuis l’extérieur et entretenue par un bras institutionnel pour assouvir éventuellement des objectifs d’influence en termes de manipulation voire d’endoctrinement. C’est alors qu’on ferait jouer à la participation une fonction instrumentale :
« Lorsque la participation est conçue de manière instrumentale, le risque est de sous-analyser les relations sociales, de ne pas y toucher ou de ne les modifier que si elles menacent la réalisation d’un objectif donné. A l’inverse, si elle est considérée comme une fin, la participation doit entraîner une transformation des relations de pouvoir, au sein de la communauté et avec les agents extérieurs, que ce soient des bailleurs internationaux, des organisations non gouvernementales (ONG) ou des autorités publiques. La participation implique alors un projet émancipateur qui vise à corriger des relations de pouvoir inégales » (Olivier CHARNOZ, 2010, p. 9).
Face aux limites de la consultation comme modalité de participation, il y a une forte tendance à lui suppléer ou à lui préférer la concertation plus orientée vers le consensus. C’est en d’autres termes ce que certains experts désignent par le concept de participation délibérative où « les négociateurs sont plus des partenaires que des adversaires. Les membres du groupe participent à un processus de recherche de consensus dans lequel les parties intéressées examinent des propositions et parviennent à des accords qui seront acceptés par une majorité de membres » (Olivier CHARNOZ, 2010, p. 16). Ce que confirme à son tour Irina Kouplevatskaya qui voit dans la concertation « l’ensemble des procédures par lesquelles les acteurs et le public sont amenés à débattre d’un problème devant déboucher sur une solution consensuelle » (Irina KOUPLEVATSKAYA, 2007, p. 6).
Et si telle était donc en définitive la finalité de la participation : forger par l’épreuve du dialogue, un consensus sur les choix politiques, les réformes économiques et les projets de développement des gouvernants. Car, au-delà des divergences de perception et de méthodologie, la participation que les porteurs de projets et leurs bénéficiaires appellent désormais de tous leurs vœux, demeure un principe-phare de la démocratie et mieux, elle est, comme cela semble largement acquis, à la fois une modalité de libération de la parole citoyenne et un moyen d’implication voire de responsabilisation des populations dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets et programmes négociés en leur nom et financés à leur profit. Si elle est partout désirée et revendiquée, c’est bien parce qu’elle porte en elle-même la promesse de pouvoir assurer la légitimité des décisions et la qualité de la gouvernance publique au profit des citoyens.
De cela, suit la reconnaissance de cet autre paramètre de la participation qui en somme vient couronner tout le cycle allant de l’information à l’auto-mobilisation en passant par la consultation et la concertation. Là-dessus, le chercheur canadien, Guy Bessette, semble plutôt convaincu du lien de cause à effet entre participer et responsabiliser. Evidemment, dans sa démarche spécifique, la communication pour le développement n’entend pas seulement informer ou consulter, mais plutôt conférer du pouvoir aux populations à travers la capacité pour elles de choisir et de prioriser les problèmes à résoudre et de décider comment, par quels moyens et avec qui elles entendent trouver les solutions à ces problèmes. Etre responsable, c’est aussi se reconnaître individuellement dans les choix qui ont été fait collectivement, pouvoir les assumer à la mesure de son implication. Car, il ne suffit pas de proclamer que le débat public est ouvert, mais l’autorité devra en plus veiller à ce que le citoyen ait voix au chapitre dans le processus délibératif qui, à maints égards, semble représenter le nœud de la démocratie participative.
1.2. Compétences discursives et culte de l’argument meilleur
Mais en fait d’implication, c’est encore là une notion sous-jacente à la participation qui vaut ici son pesant d’or et qui permet justement d’insinuer que la vraie participation est perçue et appréciée comme le grain de sel apporté par chaque sujet à l’effort de réflexion commune et donc la qualité de l’échange ou du débat d’opinions. En clair, la participation exclut la passivité ou la simple présence physique pour se fonder en pratique comme un exercice cognitif voire un appel à l’argumentation. Et cela est censé l’être davantage au moment de la délibération où les protagonistes, dans la quête de l’argument meilleur sont appelés à entrer en confrontation et à déployer leurs capacités discursives. C’est donc le lieu et le moment pour chaque acteur, qui prétend être à tout le moins écouté à l’étape de délibération et peser conséquemment dans la prise de décision, de justifier ces choix et de défendre ses convictions propres.
Sur le principe de l’argumentation comme condition sine qua non de la délibération, la cause est donc entendue pour Hervé Pourtois (2005, consulté le 09 juin 2018), enseignant de philosophie, qui soutient sans ambages que « les processus conduisant à la formation de décisions politiques devraient être des lieux d’échanges de raisons qui visent l’identification de l’argument le meilleur plutôt que des lieux dans lesquels la décision résulterait d’un marchandage entre des acteurs visant exclusivement la satisfaction de leurs intérêts ».
Ni plus ni moins, la validité d’une décision collective doit subir l’épreuve de la discussion ou simplement de la mise en débat public.
Mieux, cet exercice de justification par l’argumentation doit être tenu pour une obligation dans la mesure où elle contraint chacun à développer des raisons assez convaincantes pour emporter entièrement ou partiellement l’adhésion du groupe. J. Ralls et J. Habermas connus pour être les chantres les plus affichés de cette approche de la démocratie délibérative n’ont d’ailleurs pas manqué d’arguments pour justifier l’action délibérative publique comme principe cardinal de la légitimité d’une décision politique. L’on est ainsi fondé à penser, même si cela pourrait ne pas se vérifier dans l’absolu, qu’une bonne délibération s’éclaire des avis, contributions et expériences humaines, professionnelles et politiques des protagonistes de la vie publique. Le philosophe français, Bernard Manin (2010, p.83, consulté le 02 juillet 2018) y apporte son grain de sel en affirmant que « la décision légitime n’est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous ».
Seulement, en insistant autant sur la place de l’argumentation dans le schéma délibératif, de nombreux auteurs plaident en réalité pour une délibération collective qui ne soit pas réductible à une discussion argumentée et encore moins à un simple déploiement d’opinions plurielles. Cette mise au point se fonde sur le constat selon lequel
« des individus peuvent argumenter sans envisager de manière systématique le pour et le contre des options envisagées, et différents points de vue peuvent s’exprimer sans se critiquer pour autant les uns les autres. […]. Or, seule la confrontation systématique de points de vue contradictoires permet, en opposant à chaque argument un contre-argument, d’éprouver pleinement les propositions politiques, et de garantir que tous leurs aspects pertinents ont été envisagés » (Charles GIRARD et Alice LE GOFF, 2010, p. 107).
1.3. La délibération comme espace de dissonance et produit du dissensus
Dans l’esprit et l’intérêt d’une gouvernance inclusive, l’exercice délibératif ne saurait faire l’économie de la dissonance qui, jamais, ne doit être source d’exclusion, mais le plus important est de transcender les particularismes pour définir les conditions minimales de la coopération sociale et humaine et du vivre-ensemble. Ainsi, de la dissonance au dissensus, entendu comme un désaccord manifeste, il n’y a souvent qu’un petit pas à franchir et cela, pour la bonne cause ! Car, en fait de dissensus, certains auteurs en parlent comme d’un mal nécessaire ou du moins « ce qu’il faut à la discussion pour que s’enclenche la réelle capacité d’humanisation de l’espèce humaine » (Faloukou DOSSO, 2008, p. 235).
Si la communication est par essence une transaction d’opinions, la délibération l’est davantage ; une transaction discursive au terme de laquelle, il n’est point nécessaire de révéler au grand jour et de tout leur cru, la nature des clivages ou des divergences qui ont alimenté la discussion consubstantielle à la délibération. En fait, il y aurait comme une éthique de la solidarité ou un devoir de collégialité dans l’assomption de la délibération, dans la mesure où :
« La délibération se déroule en faisant intervenir plusieurs points de vue et la décision qui en découle est assumée par tous, mais sans que pour autant chacun acquiesce à tous les jugements qui l’ont déterminée. Le problème de la décision collective se pose donc dans les termes suivants : bien que tous les acteurs ne partagent pas toujours exactement la même vision des choses, il faut prendre malgré tout une décision en procédant de telle sorte que personne ne puisse en contester la légitimité. Il importe cependant de ne pas faire de la procédure de décision un paravent derrière lequel chacun pourrait se cacher pour ne pas avoir à assumer les conséquences de ses choix et de ceux des autres » (Éric DELASSUS, 2014, consulté le 01 août 2018).
En interrogeant les pratiques décisionnelles dans nos espaces publics, il est plutôt courant de constater que les comptes-rendus de délibération font généralement abstraction des menus détails des opinions individuelles défendues corps et âme lors des échanges ; lesquelles se fondent plutôt dans le compte-rendu global qui prend la forme d’une restitution d’ensemble des idées dominantes ayant reçu l’assentiment majoritaire. En ce moment, seuls les arguments comptent et non ceux ou celles qui les profèrent. Lorsque les protagonistes du débat public parviennent à un tel niveau de maturité, c’est la preuve qu’ils ont atteint un niveau élevé de rationnalisme au sens où l’entend Popper et le définissant comme le
« comportement par lequel nous sommes ouverts à la critique et prêts à nous soumettre à l’expérience être rationaliste, c’est admettre que l’erreur peut être de notre côté et la vérité de l’autre ; c’est être disposé à un effort, et, s’il le faut, à un compromis, pour parvenir à la vérité dans des conditions susceptibles de rallier la majorité de l’opinion » (Franck COSSON, 2005, p. 92).
Cette apologie du rationalisme trouve son accomplissement dans le concept du décentrement prôné par Jurgen Habermas et que Franck Cosson se réapproprie sous le terme de la désingularisation compris au
« sens d’un effort consenti par chacun pour considérer la manière dont il peut s’intégrer à un ensemble d’autres intérêts sous la forme d’un accord sur le compromis ou, au minimum, sous la forme de l’acceptation d’une discussion durant laquelle chacun tente sincèrement de comprendre le point de vue des autres ».
Le principe-clé qui émerge de cette approche de la délibération est finalement celui de l’effacement qui se définirait comme la capacité pour chaque individu de pouvoir, au cœur d’une délibération aux enjeux politiques, citoyens ou professionnels, se défaire de tout réflexe de nombrilisme pour aller dans le sens d’une décision qui lui paraît plus juste, plus légitime, socialement plus avantageuse, politiquement plus constructive et servant par-dessus tout l’intérêt général. Il s’agit bien en définitive d’un intérêt général assimilable ou confondu à l’intérêt commun et à travers lequel les protagonistes du débat public « essaient de mettre en œuvre une péréquation d’intérêts particuliers et divergents » (Jürgen HABERMAS, 1983, p. 94).
Dans le prolongement de cette réflexion sur la prise en compte de l’intérêt général, apparaît en filigrane toute la question de l’après-délibération. Comment sortir indemne voire grandi de l’épreuve de la délibération ? A bien y penser, seule une approche coopérative de la délibération offrirait la possibilité de continuer à « commercer » au-delà des lignes de fracture ou des éventuelles ruptures révélées ou constatées dans le processus délibératif. Les chercheurs français Albert Ogien (sociologue) et Sandra Laugier (philosophe) alimentent utilement cette réflexion en rappelant que
« si une société est raisonnablement libre et démocratique, le désaccord d’un citoyen quant à une décision prise par son gouvernement ou ses représentants n’a pas à s’exprimer sous la forme d’un rejet absolu de son appartenance à la collectivité dont il fait partie. On admet donc généralement que tout citoyen a minimalement consenti à la société, de façon suffisante en tout cas pour que son dissentiment puisse être raisonnablement formulé dans ce cadre » (Albert OGIEN et Sandra LAUGIER, 2010, p. 166).
Si ce principe est applicable à un gouvernement ou à une collectivité, il l’est aussi à un niveau micro, soit à l’échelle de la vie professionnelle ou associative.
2. Vertus et vices de la participation
S’il y a beaucoup à dire sur les vertus de la participation, force est de reconnaître que, comme toutes les médailles, elle a aussi son revers. Elle est sujette à beaucoup de ruses et dans bien des cas, elle a tendance à servir de faux-fuyant à une certaine catégorie d’acteurs qui s’en prévalent juste pour se faire bonne conscience. Du coup, il y un intérêt à identifier ces goulots d’étranglement à l’épanouissement de la participation authentique pour ensuite travailler à mieux les contourner.
2.1. Visages pluriels et contextualisation de la participation
Progressivement, une sorte de dialectique s’est emparée de tous les secteurs de la vie publique où il n’est plus possible de tenir les opinions d’un citoyen ou d’un partenaire pour quantité négligeable sans courir le risque de tomber dans les travers de l’ostracisme et de l’exclusion. Les populations, dans de nombreuses contrées africaines, ont désormais les yeux ouverts et supportent de moins en moins d’être « menées en bateau vers des destinations qu’elles ignorent »[17]. Cette soif de participation exprime donc en réalité à la fois un besoin de considération et une exigence d’inclusion comme cela s’illustre bien à travers l’expérience du vote d’un texte de loi devant encadrer le bail locatif au Burkina Faso. Les associations de commerçants, les spécialistes du bâtiment, le ministère en charge de l’Habitat, les magistrats et les organisations de la société civile ont tous fait converger leurs propositions auprès d’un comité de travail qui a épluché et synthétisé les propositions reçues pour en extraire un texte consensuel. Il y aura donc eu participation et cela est sauf. En revanche, pour qu’il y ait délibération au sens discursif du terme, il sied que ce texte de loi soit à nouveau mis en débat de façon publique entre le comité de travail, les parties prenantes et les décideurs politiques.
Ainsi, de la participation à la délibération, il y a bien un pas de géant à franchir, une plus-value que seul peut garantir une offre sincère de discussion, un débat d’idées rationnel dans un espace public affranchi de toute contrainte, de toute servitude ou risque de manipulation.
En conséquence, c’est bien cette quête de coopération au cœur de la délibération qui en même temps peut le mieux conférer à celle-ci un double caractère éthique et normatif. Car, à bien y regarder, la délibération est aussi une question de procédure, de démarche et de normes comme l’illustre à souhait l’expérience ci-après empruntée au monde syndical et relative à une revendication professionnelle :
Situation 1 : les représentants des employés rencontrent les représentants de la direction de l’entreprise. Une négociation a lieu entre eux, c’est-à-dire que par différents procédés, marchandage, échange de menaces et de promesses, argumentation, ils arrivent à un accord susceptible de clore momentanément le conflit. L’accord obtenu doit encore être ratifié par les employés.
Situation 2 : les responsables syndicaux retournent vers leurs mandataires réunis en assemblée, ils rendent compte de la négociation et expliquent pourquoi ils estiment avoir obtenu un bon accord et préconisent la fin de la grève. Une discussion s’engage avec des prises de parole pour et d’autres contre l’accord, puis les employés votent pour arrêter une décision : ici, il y a délibération de l’assemblée en vue d’une décision collective. (Philippe URFALINO, 2005, consulté le 14 juin 2018).
A l’évidence, la participation rendue effective au moyen de la négociation (situation 1) a encore eu besoin d’une consultation ouverte à tous et d’un quitus manifeste de la base (situation 2) pour créer les conditions de la délibération.
A l’inverse, l’on peut aussi remarquer que la notion de participation change littéralement de contenu et de perspective lorsque, par exemple, l’on a affaire à un processus d’appel à candidatures visant à nommer un nouveau directeur général à la tête d’une institution. Ce type de processus tel que défini par Charles Girard et Alice Le Goff (2010, p. 537) se prolonge souvent par une phase de sélection sous forme de huis clos entre membres du Conseil d’Administration. En pareille circonstance et dans un tel schéma, la délibération n’est pas ouverte aux personnes concernées et pourrait donner un goût d’inachevé ou du moins un sens très relatif à la participation. Lorsque la délibération livre son verdict, c’est juste pour annoncer une décision, plutôt une décision consommée qui ferait dire à plus d’un observateur que les carottes sont cuites ! Du coup, l’on devra s’accorder sur le fait que si la délibération précède la décision, elle ne donne pas lieu systématiquement à une discussion ouverte encore moins à une consultation. Ce qui vient illustrer et conforter une approche de la délibération qui désignerait celle-ci comme
« une phase d’examen et d’évaluation des diverses options, positions ou arguments qui, en principe, précède la phase de décision dans le processus du choix individuel ou collectif. La délibération n’implique pas nécessairement une conversation, une discussion, ou un débat, encore moins une controverse ; de plus, elle ne débouche pas non plus nécessairement sur une décision » (Sylvain LAVELLE, 2013, consulté le 12 juillet 2018).
Suivant une telle logique, jusqu’à quel point un enseignant ayant participé aux travaux de correction d’un examen serait-il par la suite comptable des décisions issues d’un jury de délibération qui aura siégé ultérieurement, sans lui ? Si l’on considère que la partition jouée par l’enseignant-correcteur est strictement technique, il restera à vérifier si les éventuels arbitrages auxquels ont pu donner lieu la phase délibérative, l’engagent dans l’absolu ? Sans que cela puisse paraisse une contrainte, que vaut le devoir de collégialité en pareille circonstance ? Au fond, ces questionnements n’ont pour véritable intérêt que de se convaincre de ce que le mode de fonctionnement de tels jurys de délibération s’avise à prendre en compte une phase de confrontation et de discussion.
2.2. A l’épreuve du schéma habermassien de délibération
On aura ainsi insinué que la délibération n’échappe pas aux turpitudes humaines. Mais plus sérieusement, la question, loin d’être banale, suggère la nécessité d’un dépassement des capacités cognitives et discursives au profit d’une évaluation normative de la délibération comme le propose le schéma habermassien :
« En particulier, si l’accent est mis sur les capacités de jugement ordinaire des citoyens, et donc sur la légitimité de leur participation à la discussion publique, le fait que ces capacités nécessitent pour se déployer, un cadre procédural adéquat est fortement souligné. Les conditions d’une bonne délibération, qui permettent à celle-ci d’être véritablement informée, inclusive et égalitaire, sont au centre de l’attention. Cette inflexion vise à répondre à la critique qui avance que dans le monde réel, la situation sociale des locuteurs et les relations de pouvoir dans lesquels ils sont pris, influent sur la délibération, et que celle-ci saurait difficilement être réduite à la force du meilleur argument. Les procédures et la façon de réguler les interactions discursives visent alors à neutraliser les distorsions produites par les inégalités sociales » (Yves SINTOMER, p. 239, consulté le 02 août 2018).
En effet, selon une acception très générale, la délibération se conçoit difficilement en dehors d’une capacité d’évaluation objective du pour et du contre face à un enjeu où les choix doivent être justifiés ; or, ceux-ci ne peuvent l’être que par le jeu de l’argumentation et l’usage de la raison. Et nous voilà de plain-pied dans la logique de la délibération dite rationnelle et dont Sylvain Lavelle (2013, consulté le 12 juillet 2018) en définit les contours :
« Selon la voie réflexive, une délibération est dite rationnelle si l’individu parvient à suivre un raisonnement cohérent et consistant à repérer toute l’étendue des options possibles qui s’offrent à lui, à identifier la relation des moyens et des fins pour chacune d’elles, à sonder avec acuité et sincérité ses croyances et ses désirs propres, à les comparer avec conséquence avec l’état de sa connaissance et de sa volonté, enfin, à éprouver ses préférences en considérant la force des arguments qui les soutiennent. En comparaison, selon la voie discursive, une délibération est dite rationnelle si l’individu parvient à tenir des propos non contradictoires, à accepter la position d’autrui y compris si elle est contradictoire avec la sienne, à examiner ses arguments et ceux d’autrui avec la même neutralité, ou objectivité, à renoncer à des arguments s’ils se révèlent dénués de valeur ou de pertinence, et à reconsidérer les positions qu’ils sont censés étayer ».
Alors, l’on ne perdra pas de vue, comme le suggère le philosophe français, Charles Girard (2013, p.8, consulté le 29 juillet 2018)que « la délibération est susceptible de propager des informations fausses, de faire prévaloir l’opinion majoritaire en étouffant les voix minoritaires ou de faire valider par le groupe des propositions qui sont en réalité inéquitables ». En conséquence, la qualité de la délibération tiendrait davantage à la droiture des mandants et à leur valeur éthique qu’à la légitimité de la représentation. L’on comprend alors le souci qui a prévalu chez le philosophe allemand Jurgen Habermas dans la définition de ce qu’il a qualifié de conditions idéales de la discussion et qui sont censées gouverner une délibération discursive ou conversationnelle. Une éthique de la délibération devrait alors forcément s’imposer comme critères minima : a) le doit égal de participation ; l’ouverture des échanges à toutes les composantes du corps social ; b) l’égalité des participants dans la jouissance du temps de parole ; c) le statut égalitaire des participants, alternativement orateurs et auditeurs ; d) le respect de la force du meilleur argument plutôt que le recours aux émotions ou à toute forme de pression physique ou psychologique ; e) la sincérité des interlocuteurs, f) l’universalité des décisions devant traduire la volonté de chaque partie prenante à en accepter l’application pour soi-même. On peut y voir clairement un plaidoyer en faveur d’une délibération est coopérative (recherche du bien commun) et non stratégique (assortie de menus calculs, de subterfuges ou de manœuvres dilatoires) ou agonistique (obsession du triomphe personnel et logique du tout pour soi envers et contre les autres).
2.3. La délibération piégée par les inégalités et la démocratie représentative
En fait, la participation a bon dos tant elle devient le paravent derrière lequel se réfugient tous ces gestionnaires de projets ou de ressources humaines qui ont un échec à justifier. Pis, l’on a pu observer dans le sillage de l’action publique, des manœuvres d’acteurs de la société civile, en mal de popularité, tirer avantage de la participation des foules pour assouvir des intérêts personnels ou de positionnement politique. Ainsi, la participation, pour être authentique, doit être le fait d’esprits libres et éveillés mais surtout responsables. Et ceci pour la bonne raison que la participation, précurseur d’une bonne délibération, est un acte aussi responsabilisant que celui du statut de citoyen. Or, on le sait, rien ne définit mieux le citoyen que sa capacité à participer, sa capacité à opiner, à évaluer au besoin les politiques publiques mais aussi et surtout à proposer des alternatives crédibles de changement.
Par-delà tous ces aspects, l’on s’aperçoit qu’à certains égards, la délibération reproduit un certain nombre de vices résultant notamment de sa tendance à privilégier et à soumettre les citoyens à des critères de capacités discursives et argumentatives. Par cette procédure, la délibération succombe, bon gré mal gré, au piège d’une discrimination de nature à mettre à nu les inégalités de statuts socio-économiques mais aussi d’éventuelles disparités de niveaux de cognition et d’analyse entre les participants. En effet, le droit égal de parole recommandé par Jürgen Habermas comme critère de base de toute discussion orientée vers l’entente n’entraîne pas dans l’absolu à un droit égal de participation qui intègre d’autres variables subjectives. C’est certainement en raison de cette complexe dualité que
« John Stuart Mill, défenseur passionné de la discussion publique contradictoire qu’il concevait comme une lutte discursive violente entre les opinions, mettait en garde contre l’illusion selon laquelle le droit à la libre expression suffirait à assurer l’égalité véritable en l’absence d’une relative égalité matérielle » (Charles GIRARD, 2013, p. 8).
En conséquence, et si du fait de ses exigences cognitives et discursives, la délibération venait à s’imposer comme le monopole des esprits les plus éclairés, l’on serait alors en droit de se demander si elle ne trahit pas l’esprit de la participation au sens de l’implication directe et active du citoyen. Cette délibération représentative aux mains des élites sociales, techniques ou politiques laisserait alors craindre dans le pire des cas, un déni de participation contraire aux fondamentaux de la démocratie au point de retomber fatalement dans le vice de l’élitisme qu’elle entendait corriger. Le cas échéant, les Grecs (de l’ère des sophistes) seraient les premiers à s’en offusquer si l’on en croit Philippe Breton soulignant que
« la démocratie grecque peut donc supporter toutes les inégalités sauf une : l’inégalité devant la parole, puisque celle-ci est au centre. Les Grecs inventent d’ailleurs immédiatement une sorte d’enseignement de la parole pour remettre en quelque sorte chacun au niveau de tous, et pour permettre à chacun d’être le plus possible l’égal de l’autre dans l’espace public » (Philippe, BRETON, 2007, p. 141).
En réalité, cette notion de l’égalité des parties prenantes dans le débat public apparait comme le plus petit dénominateur commun des exigences de la délibération et l’on comprend donc qu’elle ait alimenté tant de commentaires mais dont chacun conserve sa spécificité et son intérêt. Pour leur part, Charles Girard et Alice Le Goff abordent l’égalité sous une double approche formelle et substantielle. D’un point de vue formel, la justification tient au fait que « toute personne dotée de capacités délibératives occupe une position égale à celle des autres. Et chaque voix compte également dans la décision » (Charles GIRARD et Alice LE GOFF, 2010, p. 220)tandis que l’égalité substantielle des participants consiste en ce que
« la distribution existante du pouvoir et des ressources ne détermine pas les opportunités de participation à la délibération, pas plus qu’elle ne confère à certains une autorité particulière dans la délibération. Les participants à la procédure délibérative ne se considèrent pas liés par le système existant de droits, sinon dans la mesure où ce système établit le cadre nécessaire à une libre délibération entre égaux » (Charles GIRARD et Alice LE GOFF, 2010, p. 220).
Certes, certaines situations ne requièrent pas forcément une participation directe du citoyen à un processus de délibération publique, mais c’est peut-être sans compter avec les impondérables inhérents à un pouvoir de délibération transféré ou exercé par délégation. Malgré tout, si l’on continue à s’y accommoder, c’est bien parce que la démocratie directe rêvée par Abraham Lincoln à travers la célèbre formule « le gouvernement du peuple par le peuple » n’est plus applicable à la lettre pour diverses raisons qui tiennent, entre autre aux nouvelles réalités démographiques, à l’extrême diversité des interlocuteurs, à la fragmentation du tissu politique et associatif, à la pluralité et à la complexité des instances à résoudre, aux urgences sociales portées par des acteurs aux agenda disparates et à la fréquence des pressions tous azimuts… Cet avis est partagé par le philosophe français Jacques Rancière qui souligne lui aussi, que la
« démocratie directe était bonne pour les sociétés grecques anciennes ou les cantons suisses du Moyen Age où toute une population des hommes libres pouvait tenir sur une seule place. A nos vastes nations et à nos sociétés modernes, seule convient la démocratie représentative » (Jacques RANCIERE, 2005, p. 59).
Et pourtant, la démocratie représentative, elle-même ne s’en porte hélas pas mieux puisqu’elle est de plus en plus, est confrontée à ce qu’il est convenu de désigner sous le terme de « crise de la représentativité » et qui, en réalité s’apparente bien à une « crise de la participation ». Elle se caractérise, selon Gérard-David Desrameaux et Alexandre Desrameaux, spécialistes de la science politique, par
« une perte de confiance, sans doute alimentée par la difficulté toujours plus grande pour les gouvernants d’exercer leurs fonctions eu égard d’une part, à la complexité des problèmes à résoudre et d’autre part, aux attentes innombrables et souvent contradictoires des citoyens, qui finissent ainsi par être désabusés, critiques et sceptiques quant aux chances de voir leurs attentes satisfaites » (Gérard-David DESRAMEAUX, et Alexandre DESAMEAUX, 2015, p. 99).
Curieusement, ce malaise autour des assemblées délibératives n’est pas si récent, puisque que philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) s’interrogeait déjà, avec une pointe de suspicion, sur les fondements de leur légitimité, quoique délibérant publiquement. En effet,
« Hobbes craint pour l’ignorance des membres de l’assemblée, dans les affaires du dedans, et encore plus dans celles du dehors qui doivent rester secrètes ; il craint l’éloquence qui donnera au bien l’apparence du mal et l’esprit facétieux d’où naissent les séditions » (Emile BREHIER, 2012, p. 850-851).
3. Ingrédients pour une éthique de la délibération
Dans tous les cas, qu’elle s’inscrive dans une approche directe ou représentative, la participation devrait favoriser l’expression et la résonance des opinions minoritaires dans le débat public. Plutôt que de céder à l’obsession du nombre qui donne à la participation des allures de marchandage politique, une éthique de la délibération doit émerger et se construire autour de quelques valeurs humaines et démocratiques qui consacrent plus que par le passé, la qualité de la représentation et un sens élevé du bien commun.
3.1. Priorité à la qualité de la représentation et à la quête du bien commun
A tout le moins, en dépit des interprétations divergentes et des causes ambiguës qu’elle peut être amenée à servir ; nonobstant les errements et les « avaries » qu’elle pourrait subir, la participation restera un idéal cher aux démocrates en ce qu’elle permet de ne pas donner un blanc-seing à des élus sur toute la durée d’un mandat. Le philosophe burkinabè, Mahamadé Savadogo, dira à ce sujet que
« le mandat électoral n’est pas à prendre pour l’expression d’une confiance absolue, définitive. […] Le nombre de voix avec lequel il est choisi, l’envergure de la majorité dont il dispose pour soutenir un programme politique importe peu ; fondamentalement, il est susceptible de trahir l’aspiration de la collectivité, de mettre en avant son propre intérêt au détriment du bien commun » (Mahamadé SAVADOGO, 2002, p. 231).
A bien des égards, c’est également là une manière bien prudente de concevoir la participation autrement que par le prisme mathématique du nombre. En effet, aucun processus participatif ne saurait prospérer durablement en sacrifiant les enjeux qualitatifs au profit du critère quantitatif ; le risque étant ici de réduire le débat public à un exercice de pure forme ou à une simple opération esthétique ou de marketing. L’intérêt public n’ayant d’ailleurs jamais été que la somme arithmétique d’intérêts particuliers. Rien ne peut dès lors contrarier ce postulat fondamental selon lequel la qualité de la participation réside moins dans la massification des acteurs des luttes politiques et sociales que dans la pertinence et la qualité de leurs contributions éclairées à la gestion des affaires de la cité incluant tout naturellement leurs capacités de veille citoyenne.
Pour alors ne rien devoir au hasard et si l’on prétexte de ce que l’on est généralement mieux servi que par soi-même, l’idéal démocratique à son tour est mieux servi si le principe de la participation directe venait en appui à celui de l’argumentation pour consolider l’architecture de la délibération et lui conférer plus d’authenticité. Il est à parier que cette soif de participation des populations à la définition des priorités nationales, à l’influence des politiques et à la prise de décision restera pour longtemps encore au cœur des aspirations d’une opinion publique qui a acquis un sens aigu de la citoyenneté après avoir découvert les vertus de la redevabilité politique.
Si ce dernier principe était respecté, il devrait ostensiblement contribuer à rehausser aussi bien la légitimité des décisions que la qualité des choix politiques. C’est d’ailleurs dans cette perspective que s’inscrivent les travaux de trois auteurs américains, Lawrence Jacobs, Lomas Cook et Delli Carpini (2009) qui ont exploré les conditions de validité de la délibération à la fois comme moyen de renouvellement de la citoyenneté, de restauration de la légitimité des décisions politiques et de construction d’une démocratie authentique. Ces conditions, au nombre de cinq, visent, selon eux, l’universalité, l’inclusion, la rationalité, l’entente et l’efficacité politique.
3.2. Sept (07) principes pour une gestion vertueuse de la délibération
Ainsi, si « l’inclusion requiert qu’un maximum de voix soient entendues » et si « l’entente consiste à niveler les conflits et les points de vue divergents afin d’identifier des points communs et des solutions pratiques », on en attend encore davantage de l’efficacité politique dans la mesure où elle « relie la délibération à des résultats tangibles qui renforcent la confiance des citoyens, encouragent l’apprentissage et suscitent l’intérêt envers la politique, ce qui finalement aura un effet sur la politique et les politiques environnementales » (Lawrence JACOBS, Fay Lomas COOK et Delli CARPINI, 2009, p. 138-139).
Si l’on y ajoute la bonne foi et la sincérité des interlocuteurs recommandée par Jürgen. Habermas et le voile de l’ignorance[18] prônée par John Rawls, l’on se retrouverait avec sept (07) grands pincipes dignes de structurer un code de bonne conduite et de gestion vertueuse de la délibération[19]. Aussi peut-on prétendre avoir suffisamment défini les contours et les bases d’une éthique de la délibération ayant pour valeur minimale l’équité dans la participation et une reconnaissance du statut de l’autre comme co-responsable de la vérité recherchée par la seule arme discursive. En interdisant au citoyen convié au débat public de ruser avec les principes et de se contredire abusivement, Habermas mise d’emblée sur la qualité morale de l’Homme comme facteur de validation et de succès de la délibération.
En sus, la délibération est de meilleure qualité si l’échantillon des protagonistes de l’échange est représentatif, si les thèmes débattus sont connus et dans l’ordre des priorités des participants à la discussion et si les objectifs sont bien définis et partagés en amont. À preuve, en juin 2018, la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), qui est l’une des six centrales syndicales du pays, a rejeté une offre de participation aux travaux d’un dialogue national sur la rationalisation des rémunérations des agents de la Fonction Publique. Pour justifier sa position, cette formation syndicale a trouvé inopportun d’aborder la question délicate de la réforme des conditions salariales des fonctionnaires dans un cadre élargi. Elle a notamment dénoncé le choix du gouvernement d’associer des acteurs de la société civile (responsables coutumiers et leaders religieux) à une discussion qui selon elle, engage plutôt directement les travailleurs et leur employé qu’est l’Etat.
À ces préalables, vient s’ajouter un détail de procédures lié à la police des débats qui doit être assez professionnelle pour ne pas être dirigiste et prêter flanc à des conclusions hâtives, dogmatiques ou intéressées. D’où l’apparition et l’importance au cœur du processus délibératif de la notion de facilitation qui fait appel à de réelles aptitudes en matière de modération et de médiation. D’ailleurs, contre cette tentation au dogmatisme, il semble ici opportun d’en appeler au caractère révisable des résultats d’une délibération comme le suggère si bien le philosophe allemand Jurgen Habermas dans son approche de l’éthique de la discussion. Même dans un contexte plus actuel, nos espaces de délibération gagneraient à formaliser et à s’approprier cette modalité dialectique de cheminement vers la vérité et qui du reste peut utilement aider à lever le verrou d’un enfermement dans des décisions que l’on serait tenté de sceller dans le marbre.
Si le facilitateur du débat public est un acteur-clé de la délibération, l’on a encore plus de raison de s’intéresser au statut de celui-là qui se chargera de clore les débats, d’en tirer les leçons qui engageraient toutes les parties prenantes, de procéder à la synthèse des opinions émises ou encore de définir les orientations définitives, de circonscrire les options ultimes sanctionnant les échanges contradictoires et pouvant tenir lieu de décisions concertées. Evidemment, dans la pratique, cette approche ne va pas sans susciter des questionnements en relation avec la légitimité de cette personne qui peut avoir une source institutionnelle ou morale, voire socioculturelle (âge, expérience de la vie, notoriété, leadership communautaire ou religieux…). Idéalement, s’il arrivait qu’une telle personne soit investie d’une telle charge dans le processus de délibération, l’on serait très regardant alors sur sa capacité à se dépouiller de tous ces oripeaux susceptibles d’altérer l’usage exclusif et public de la raison et d’influencer la prise de décisions objectives. Le moins qu’on puisse dire est que le risque est bien là et l’on ne saurait le méconnaître :
« A l’issue de la délibération, il y a toujours en fin de compte quelqu’un qui décide au nom de tous et qui tire une légitimité de la manière dont il a su s’intégrer au processus de décision. Parfois, il détient l’autorité institutionnelle, mais ce n’est pas toujours le cas : qu’il soit médecin, soignant ou le malade lui-même, il est celui qui est parvenu à se faire reconnaître par tous les participants à la délibération, une autorité morale qui lui donne droit d’effectuer la synthèse des différents points de vue exprimés et d’en dégager l’orientation que va impliquer la prise de décision. On peut donc aborder sous cet angle la délibération à la fois dans ses aspects psychosociologiques et aussi en un certain sens « politique » puisque s’y introduisent des enjeux de pouvoir dont il importe de fonder la légitimité. La question se pose donc de savoir non seulement qui décide, mais aussi qui, au bout du compte, incarne la décision. Qui est celui à qui peut être imputée la responsabilité des orientations qui ont été choisies ? » (Éric DELASSUS, 2014, consulté le 01 août 2018).
À ce propos, les appréhensions du citoyen sont d’autant plus légitimes qu’
« il y a des gens qui gouvernent parce qu’ils sont les plus anciens, les mieux nés, les plus riches ou les plus savants. Il y a des modèles de gouvernement et des pratiques d’autorité basées sut telle ou telle distribution des places et des compétences » (Jacques RANCIERE, 2005, p. 54).
Et si un tel mode de dévolution du pouvoir venait à prévaloir dans l’espace public, il va sans dire que la délibération en souffrirait profondément tout autant que la qualité des décisions. Toutefois, contre ces biais de la délibération, il reste encore une astuce à expérimenter : faire appel à des experts ou consultants externes pour animer occasionnellement les discussions et pouvoir remettre en cause les points de vue du groupe et relancer aussi longtemps que possible la machine de la réflexion. Ce qui permettrait en outre de ne pas aller trop rapidement vers des consensus acclamatifs. Ainsi, l’on n’est finalement pas si loin de l’idée selon laquelle « à chaque réunion, une personne au moins peut jouer le rôle d’avocat du diable » (Bénédicte VIDAILLET, Véronique d’ESTAINTOT et Philippe ABECASSIS, 2005, p. 220).
Il en va de même dans le champ plus opérationnel des politiques publiques et de la gestion des programmes/projets où cette exigence de participation prend les accents d’un appel à la responsabilisation. Cette responsabilité, selon le chercheur canadien, Guy Bessette, a un caractère contributif au double plan matériel et humain. Ainsi, la participation, écrit-il,
« va de pair avec la responsabilisation. Il est utile de cerner les rôles et les responsabilités des intervenants engagés dans le projet et de clarifier la contribution financière ou matérielle de chacun d’eux dans le processus. Ces contributions peuvent être variées : donner de leur temps, fournir des services, du matériel utilitaire, du financement, etc. Ces contributions, même modestes, procureront un sentiment d’appropriation des activités. Sans cette appropriation, l’effort sera toujours perçu comme l’initiative des autres » (Guy BESSETTE, 2004, consulté le 20 septembre 2015).
3.3. Participation et délibération : le champ des possibles
Du coup, la frontière entre participation et délibération devient si ténue qu’on gagnerait plutôt à aborder cette relation avec la plus grande souplesse possible. C’est en définitive un vaste champ des possibles à investir et qui autorise à imaginer aussi bien et avec la même pertinence, une participation délibérative et une participation non délibérative. Aussi devrait-on, examiner de plus près le large spectre des contingences liées aux processus décisionnels et pouvant épouser des formes aussi variées qu’une délibération discursive ; une délibération décisive ; une délibération discursive et décisive ; une délibération décisive non discursive…
Cette typologie des modalités de délibération publique permet d’identifier et de reconnaître aisément celle en vigueur dans la plus haute instance mondiale, à savoir les Nations-Unies. Avec ses 193 États Membres, l’institution à vocation universelle est dotée d’une Assemblée générale jouissant du double attribut d’organe délibérateur et décisionnaire. Manifestement, son fonctionnement correspond au mécanisme d’une délibération discursive et décisive comme le suggère ce descriptif :
« Chaque année au mois de septembre, les États Membres au complet se réunissent à l’Assemblée générale à New York pour sa session annuelle et pour le débat général au cours duquel de nombreux chefs d’État prennent la parole. Les décisions sur certaines questions importantes, telles que les recommandations relatives à la paix et à la sécurité, l’admission de nouveaux membres et les questions budgétaires, sont prises à la majorité des deux tiers des États Membres, mais les décisions sur les autres questions sont prises à la majorité simple. Chaque année, l’Assemblée générale élit un Président pour un mandat d’une année » (onu, consulté le 09 juin 2018).
En substance, tout concourt bien à l’idée que la participation est une chance pour la démocratie et la bonne gouvernance. Elle permet d’élargir les espaces de dialogue et de concertation à la base autour des projets de développement et de mettre en confiance les communautés locales quant à leur potentiel de production et leur capacité contributive à la prise de décision. Prôner et appliquer le principe de la participation n’est que justice puisqu’elle relève à la fois d’un souci d’équité et d’une quête d’efficacité. Mieux, c’est un outil de gestion des conflits sociaux, de régulation des relations de pouvoir et un instrument de démocratisation de la décision même si, il lui est bien souvent reproché d’être à la fois chronophage et budgétivore. Ce qui est loin d’être une fausse querelle !
En effet, comme de nombreux gestionnaires de programmes et autres responsables administratifs ou animateurs de foras ont pu l’éprouver, une prise de décision assortie d’une trop grande implication de citoyens requiert beaucoup de temps du fait même d’une multiplicité d’interlocuteurs à solliciter, à écouter et à prendre en charge financièrement dans certains cas. Et pourtant, la démocratie voudrait que l’on écoute tout le monde même si l’on peut parfois avoir de bonnes raisons de douter de la pertinence de certaines interventions, même si a priori, et à juste titre, l’on craint que certains partenaires, déjà connus et étiquetés comme étant d’éternels esprits chagrins, viennent à nouveau jouer les cassandres ou emboucher la trompette de l’obstruction. Mais, en vérité, l’on ne sait jamais ce que l’on perd en les confinant au silence !
Plus rationnellement, le problème se pose en termes d’arbitrage ou de juste milieu à trouver entre les exigences d’une participation maximale et la quête d’efficacité. Que faire devant le schéma embarrassant voire le carcan d’une multiplicité de lieux d’expertise, de délibération et de parties prenantes à la décision ? Selon les chercheurs français, Albert Ogien et Sandra Laugier, « le souci d’efficacité tiendrait plutôt à réclamer la réduction de cette dispersion et la concentration du pouvoir de décision entre les mains de moins en moins nombreuses » (Albert OGIEN et Sandra LAUGIER, 2010, p. 86). Ainsi, on n’est pas loin de penser que l’obsession de la participation ne sert pas toujours la démocratie et que la démocratie elle-même ne fait pas toujours bon ménage avec l’efficacité. Là-dessus, le regard des deux chercheurs se fait encore plus incisif :
« Les exigences de la démocratie sont souvent les ennemies de l’efficacité, plus exactement du principe de l’efficacité tel qu’il est conçu dans le raisonnement qui le réduit à la mesure de la productivité et de la rentabilité d’une action. C’est que le respect des libertés individuelles peut entrer en contradiction avec la recherche de la performance maximale ; et que le temps nécessaire à la délibération collective peut être considéré comme une perte de temps qui engendre des coûts inutiles et risque d’affaiblir la compétitivité » (Ibidem).
Malgré tout, cela ne suffira pas à décourager les adeptes de la participation. Car, pour ces derniers, proclamer et promouvoir la participation, c’est aussi être prêt à en payer la facture sachant que les retombées à moyen terme dépassent souvent les contraintes redoutées. En clair, selon John Clayton Thomas, une pratique assidue et avisée de la participation pourrait offrir une sorte de compensation qui n’est pas négligeable :
« Le surcroît de temps investi dans la prise de décision peut se traduire plus tard par un gain de temps. Le temps passé par les gestionnaires publics à impliquer davantage d’acteurs dans le processus décisionnaire peut avoir l’effet de réduire le temps nécessaire à la mise en œuvre de décisions. Et il y a plus de chances pour que les divers acteurs, précisément parce qu’ils auront été associés aux décisions initiales, soutiennent et même accélèrent l’application des décisions prises » (John Clayton THOMAS, 1995, p. 31).
Conclusion
De cette réflexion, on retiendra que si la discussion est une chose, la délibération en est une autre même si la seconde prolonge utilement la première pour trouver son achèvement dans la décision. Pour la qualité de la décision, les espaces publics (administrations, institutions, foras) ont beaucoup à gagner à éprouver la délibération discursive, quitte à en sortir incompris voire contrarié pourvu qu’en dernier ressort, l’intérêt général ou le bien commun soit sauf après qu’on eut fait valoir son point de vue. Ce qui n’est pas rien !
La participation a manifestement un rôle crucial à jouer tant dans l’animation de la vie publique que dans la gouvernance politique et économique des Etats. Elle innerve toute la vie sociale et appelle en conséquence une approche multidisciplinaire au regard même de son inclination à devenir une norme de l’action publique. Ainsi, l’on n’exagère rien en affirmant que la participation est consubstantielle à la délibération et qu’elles constituent avec la démocratie, un triptyque vertueux. En conséquence, les Etats et acteurs sociaux doivent travailler à parfaire le fonctionnement des instruments institutionnalisés de la participation, désormais légion dans les démocraties africaines (conseils économiques et sociaux, parlements, instances de régulation médiatique, médiateurs de la République, Hauts conseils du dialogue, etc.). Parfaire leur fonctionnement suggère que les pouvoirs publics s’engagent à leur assurer l’accompagnement technique et financier nécessaires qui leur permettent de mieux jouer leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits sociopolitiques et la recherche constante du consensus rationnellement motivé[20] par la libre délibération.
En somme, la délibération a autant besoin d’acteurs citoyennement compétents que de cadres légaux et légitimes pour s’exercer. Ce qui vient conforter la conviction de plus en plus partagée selon laquelle « l’existence d’arènes dans lesquelles les citoyens peuvent proposer des sujets à mettre à l’ordre du jour politique et participer aux débats portant sur ces sujets est un élément essentiel de l’institutionnalisation de la procédure délibérative » (Charles GIRARD et Alice LE GOFF, 2010, p. 220). Mais bien au-delà, ces espaces de délibération ont vocation à s’affirmer comme des laboratoires de la démocratie participative et doivent demeurer des reflets de la diversité idéologique et politique, mieux de la vitalité démocratique des nations. Hélas, des espoirs suscités à leur avènement, il n’en reste pas grand’chose dans de nombreuses démocraties où les libertés concédées de la main droite, dans l’euphorie du renouveau démocratique des années 90, ont été progressivement rognées de la main gauche. Ce qui du reste – trêve d’illusions –, ne restera pas impuni pour longtemps, car les temps ont changé ! Tant et si bien que les délais de réaction et les outils de résistance populaire à toute participation confisquée ou manipulée sont devenus aussi imprévisibles que volatiles et peuvent aller jusqu’à franchir le seuil de l’insurrection.
Depuis l’exemple du Burkina Faso en octobre 2014, les gouvernants sont censés avoir décodé le message selon lequel, le refus d’écouter le peuple équivaut à un refus de participation et à une privation du droit à la délibération. Compris comme tel, il urge de redonner à la participation authentique ses lettres de noblesse en tant que valeur cardinale d’une gestion démocratique des affaires publiques. Mieux, tant et tant d’expériences vécues sous diverses latitudes démontrent à suffisance que c’est encore le chemin le plus sûr pour bâtir ce que les uns et les autres, selon leur expérience citoyenne ou leur sensibilité intellectuelle, qualifient de démocratie de proximité, de démocratie participative, de démocratie délibérative, de démocratie discursive, de démocratie communicative, de démocratie inclusive voire de démocratie pacifiée ; celle-là qui conférera à chacun un regain de confiance en l’Etat mais aussi et surtout sa part de bien-être social et de dignité !
Références bibliographiques
Ouvrages
ADU-AMANKWAH Kwassi et KESTER Gérard (dir), 1999, Comment réussir la participation citoyenne démocratique en Afrique, Padep / L’Harmattan, 110 p.
BESSETTE Guy, 2004, Communication et participation communautaire : guide pratique de communication participative pour le développement, Québec, Presse Universitaire de Laval, 156 p.
BREHIER Emile, 2012, Histoire de la philosophie, Quadrige Manuels, Paris, 1790 p.
BRETON Philippe2007, Eloge de la parole, La Découverte, Paris, 192 p.
COSSON Franck, 2005, La démocratie, Paris, Ellipses, Editions Marketing, 96 p.
DESRAMEAUX, Gérard-David et DESAMEAUX, Alexandre, 2015, Introduction à la science politique, Groupe Studyrama, Coll Panorama du droit, Paris, 350 p.
GIRARD Charles et LE GOFF Alice, 2010, La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, Hermann Editions, Paris, 550 p.
HABERMAS Jürgen, 1983, Morale et Communication, Flammarion, Paris, 212 p.
HABERMAS Jurgen, [1992] 1997, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 554 p.
MONNOYER-SMITH Laurence, 2011, Communication et délibération. Enjeux technologiques et mutations citoyennes, Paris, Lavoisier / Hermès science (Document, réseaux et design social), 270 p.
OGIEN Albert et LAUGIER Sandra, 2010, Pourquoi désobéir en démocratie ?, Editions La Découverte, Paris, 220 p.
RANCIERE Jacques, 2005, La haine de la démocratie, La Fabrique éditions, Paris, 112 p.
RAWLS John, 1987, Théorie de la justice, Seuil, Paris, 672 p.
SAVADOGO Mahamadé, 2002, La parole et la cité. Essais de philosophie politique, L’Harmattan, Paris, 316 p.
THOMAS John Clayton, 1995, Action publique et participation des citoyens. Pour une gestion démocratique revitalisée, Nouveaux Horizons, Paris, 188 p.
VIDAILLET (Bénédicte), d’ESTAINTOT (Véronique) et ABECASSIS (Philippe), 2005, La décision, une approche pluridisciplinaire des processus de choix, de Boeck et Larcier, Bruxelles, 298 p.
Webographie
BESSETTE, Guy, 2004, « Communication et participation communautaire : guide pratique de communication participative pour le développement », Québec, Presse Universitaire de Laval.
https://books.google.fr/books?id=5gqkTH_d0IUC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Guy+Bessete+et+la+responsabilisation+dans+la+participation, p. 20, consulté le 20 septembre 2015.
DELASSUS, Éric. « La délibération comme démarche réflexive accompagnant la décision médicale », Éthique publique [En ligne], vol. 16, n° 2 | 2014, mis en ligne le 19 janvier 2015.
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1569 ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.1569, consulté le 01 août 2018.
FELLI, Romain. Développement durable et participation : la démocratie introuvable, Université de Lausanne,
https://belgeo.revues.org/12126?lang=nl, consulté le 24 septembre 2015.
GIRARD, Charles. « La démocratie par la délibération ? » In MILL J.S., Considérations sur le gouvernement représentatif, trad. M. Bozzo-Rey, J.-P. Cléro, C. Wrobel, Paris, Hermann, coll. « L’avocat du diable », 2013.
https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2013-3-page-8.htm, consulté le 1er juin 2018
GIRARD Charles, La démocratie par la délibération ?
https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2013-3-page-8.htm, consulté le 29 juillet 2018.
LAVELLE Sylvain, 2013, « Délibération », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, ISSN : 2268-5863.
http://www.dicopart.fr/fr/dico/deliberation, consulté le 12 juillet 2018.
MANIN Bernard, « Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une théorie de la délibération politique », p. 83.
https://www.cairn.info/revue-participations-2011-1-page-239.htm#no87, consulté le 02 juillet 2018.
POURTOIS Hervé, « Délibération, participation et sens du désaccord », Éthique publique [En ligne], vol. 7, n° 1 | 2005, mis en ligne le 13 novembre 2015.
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1997 ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.1997, consulté le 23 juin 2018.
SINTOMER Yves, « Délibération et participation : affinité élective ou concepts en tension ? »
https://www.cairn.info/revue-participations-2011-1-page-239.htm#no87, consulté le 02 août 2018.
http://www.un.org/fr/sections/about-un/main-organs/, consulté le 09 juin 2018.
Y A-T-IL UN HUMANISME DE LA MONDIALISATION ?
Ezechiel Kauhoun Kpangba KOUAKOU
Résumé :
La mondialisation est un projet d’une alliance des peuples pour le développement et pour la paix durables. Donc, elle devrait prendre en compte tout ce qui assure la dignité de l’homme. Malheureusement, elle a été détournée de son objectif originel pour servir les intérêts égoïstes de l’impérialisme. Par conséquent et à contrario l’humanisme réglé sur l’humanitas ou l’essence de l’homme apparaît comme le meilleur soin qui peut et qui doit donner une nouvelle vitalité à un tel contrat d’unité mondiale.
Mots-clés : globalisation, mondialisation violée, Avoir, anarchie, guerre, impérialisme, domination, humanisme, humanitas, paix sociale, liberté, Être, thérapie, souveraineté.
Abstract :
Globalization is a project of an alliance of peoples for sustainable development and peace. So it should take into account everything that ensures the dignity of man. Unfortunately, it has been diverted from its original purpose to serve the selfish interests of imperialism. Consequently and on the contrary humanism regulated on the humanitas or the essence of man appears as the best care which can and must give a new vitality to such a contract of world unity.
Keywords : globalization, globalization violated, anarchy, war, imperialism, domination, humanism, humanitas, social peace, freedom, being, therapy, sovereignty.
Introduction
La volonté générale d’organiser et de rendre permanente, la croisade des productions de tout genre, où s’échangent également le savoir et le savoir-faire des peuples et des civilisations de la planète terre, est certainement un espace de partage et de connaissances. Pourtant, il est évident qu’on ne peut échanger ou partager en toute confiance que ce qui est à notre possession. Pour le moment l’Afrique Noire propose peu. Mais, ce n’est pas rien. En effet, ne dit-on pas que la plus belle fille ne donne que ce qu’elle a ? Cependant, s’il n’y a pas la bonne gouvernance éthique, c’est-à-dire, si la confiance fait défaut dans la mondialisation, alors, « l’humanitas » de l’homo humanus ne peut éclore. Dès lors, essayons de comprendre ce sujet dans son intimité d’ « il y a », afin de demander : est-il possible de faire co-exister la mondialisation et l’humanisme en tant que système philosophique qui consiste à promouvoir et à préserver la liberté, l’égalité, la dignité et la nature de l’homme ? En évoquant la nature de l’homme, nous faisons allusion à son essence, qui ne se déploie ou ne s’accomplit que dans la proximité de l’Être. D’où, problème : la mondialisation telle qu’elle fonctionne dans l’actualité, où l’éthique et la vertu n’ont pas de contenu réel, peut valoriser dignement l’humanisme ? En fait la mondialisation, qu’est-ce que cela recouvre comme réalité actuellement ? N’est-elle pas source d’aliénation et de menace existentielle ? En ce sens, ici, l’humanisme n’est-il pas de trop ? Qu’en est-il donc ? Est-il un projet ou une effectivité dans ce monde globalisé ? Enfin, sous quel angle Heidegger peut venir en appui en vue d’une sérénité existentielle ?
1. Le choix de l’avoir et de la césure du spéculatif dans l’existence : les raisons d’une mondialisation déshumanisante
La mondialisation n’est pas une nouvelle idée, même si elle est nouvelle dans son effectuation. Ceci étant, rappelons simplement qu’au 18ème siècle, le philosophe allemand Leibniz faisait déjà allusion à la possibilité de création d’une langue universelle. Et si on pousse les choses jusqu’au 20ème siècle, on peut citer l’ONU en tant qu’une organisation de toutes les nations unies au monde. C’est une structure englobante et planétaire. Dans sa forme, elle est un modèle d’intégration mondiale. D’emblée, elle est à saluer surtout, quand on voit le parcours historique de l’humanité, de la cueillette à la mondialisation. Mais, la question qui vient immédiatement à l’esprit est de savoir, s’il n’y a pas aujourd’hui mieux à faire. Comment fonctionne-t-elle ? Est-ce qu’elle est gérée démocratiquement ? N’est-elle pas devenue un instrument, pour une minorité de dominer le monde et de le maintenir dans la pauvreté ? Sur les problèmes de société, y a-t-il des concertations franches dont les applications de résolutions font objet de suivi strict ? Pourquoi sur des milliers de pays membres, n’y a-t-il que cinq seulement qui siègent en permanence au conseil de sécurité ? À quand, la participation de l’Afrique Noire, aux prises de décisions internationales ?
Devant, cette kyrielle de questions, nous restons impuissant, parce qu’aucune réponse n’adhère à l’idée noble d’un monde de partage, d’équité, d’égalité, de dignité humaine et de paix sociale. On peut même, constater qu’au cours des grandes rencontres internationales, c’est une minorité cachée sous le label de pays développés ou nantis, qui se met en pôle sur divers plans, à savoir : économique, technique, financier, scientifique, militaire, commercial, etc. Cette minorité a un certain droit dit de « véto ». Ce droit de véto lui permet d’ex-poser sa puissance « barbare » et « ego-centrique » en décidant dans son intérêt, pour tout le monde, à la place de tout le monde. Et quelquefois, comble de culot, les plus puissants d’entre eux se mettent au-dessus des traités internationaux. En l’espèce, citons le cas des USA qui n’ont pas ratifié le traité de Rome, juste pour éviter aux citoyens Américains les poursuites judiciaires de la cour pénale internationale(CPI), pourtant les USA siègent en permanence, au conseil de sécurité de l’ONU, qui est l’organe politique qui prend des décisions pour la CPI qui en est l’organe judiciaire. Drôle de comportement ou triste réalité pour une face hideuse de la mondialisation. En fin de compte, où se trouve voilée cette mondialisation ? Et on veut mondialiser les nations sans elles-mêmes, pour quoi en faire ? Si l’idée noble de tendre la bouée de sauvetage ou de développement durable, aux plus pauvres présidait aux sources de cette mondialisation, pourquoi ces grandes puissances s’évertuent-elles à « fabriquer » des guerres d’intérêts pour y vendre des armes ou pour y exploiter des matières précieuses ?
Il est temps qu’on comprenne qu’on peut vivre la paix dans la durée, toutefois, si entre l’Avoir et l’Être, nous faisons le bon choix : l’Être. Mais, tant que les hommes vivront dans la frénésie de la course à l’Avoir comme « l’eldorado » des temps modernes, alors, la paix qui est une qualité de l’essence de l’Être en tant que le paisible, le précieux, se mettra en retrait. Mais, que vaut une mondialisation sans la paix ? C’est le chaos ! Parce que, la paix est une denrée rare en plus d’être un préalable à tout développement durable.
En conséquence, nous sommes dans une mondialisation chaotique et non humaine, voire barbare eu égard à la prédominance des guerres. Dès cet instant, on a du mal à contenir la vague d’adrénaline qui fouette notre cœur. Pourquoi cette mondialisation de façade résiste-t-elle encore au temps, même si la conscience des uns et des autres n’arrive pas pour l’heure à arraisonner cette structure qui ne sert que les intérêts égoïstes des puissances qui n’ont d’yeux que le pouvoir matérialiste qui n’offre que la domination, la soumission, l’avilissement, la désolation et la déshumanisation ? Et comme en un mot, l’Avoir est l’essence de la guerre et de la division, alors il s’en suit permanemment une guerre entre les nantis et les pauvres, entre les pauvres et les pauvres et entre les nantis eux-mêmes. Ainsi, la guerre de l’Avoir est sans éthique, parce que l’envie de l’Avoir ne laisse la liberté à personne : c’est l’anarchie.
En effet, le temps de profit pour l’enrichissement illicite ne suffit pas à la réflexion sur l’Être. Au nom de l’Avoir donc, la mondialisation a glissé dans l’oubli de l’Être. Voici pourquoi l’humanité a perdu le contrôle des nouveautés dans la production industrielle, qui courent au galop, quand l’humain marche à pas de tortue. Il faut avoir le courage de l’assumer. Car nous frôlons désormais la catastrophe, si tant est que, nous perdons plus qu’on ne gagne. Par ailleurs, cette mondialisation, mal goupillée présente de réelles menaces, tant sur le plan de la publicité qui achète toute conscience par la magie du marketing et de la manipulation de tout genre, que sur le plan de la puissance technique, qui en son essence est une part de la vérité de l’Être dans sa production utilitaire pour l’humanité en général. Simplement disons que, la technique est détournée de son sens (vérité) premier. Pour cause, elle n’agit pas pour elle-même. Mais elle sert la cause de l’Avoir dans la mondialisation frelatée.
Nous pouvons ajouter que la mondialisation est aussi une réelle menace pour la pensée à cause de sa fausse ressemblance à l’universel. Mondialiser, pour ce qui est donné de voir dans la mondialisation actuelle, c’est créer et développer une économie de marché de type libéral, qui est très soutenue par l’explosion électronique (par exemple internet). En fait c’est une sorte de marché « du donner et du recevoir », quand on prend la chose sur le plan scolaire avec l’exemple patent du système planétaire de la LMD (Licence, Master, Doctorat), véritable fruit de la mondialisation violée, eu égard, à la dépendance des agogies du poids économique de chaque pays.
En considérant ce qui précède, demandons : de quelle manière peut se présenter l’humanisme pour pouvoir être ou ne pas être de la mondialisation ?
2. L’humanisme comme thérapie de la mondialisation actuelle
C’est dans le souci de donner la dignité et de rendre l’homme heureux et humain que l’idée de le replacer dans son humanité, c’est-à-dire, dans son essence, a fleuré la pensée des Romains et des Grecs. De leur rencontre a surgi le premier pas de l’humanitas. En clair, le brassage culturel de la romanité et de l’hellénisme a opposé l’homme humain (homo humanus) à l’homme barbare (homo barbarus).
L’homme humain serait alors le Romain qui élève et rend noble la « virtus » romaine par l’incorporation de « l’humanitas » des Grecs. C’est alors que le premier humanisme va naître à Rome aux alentours des XIV et XVè siècles de la Renaissance en Italie. Cet humanisme est une doctrine de la valeur humaine, qui au départ a consisté en général à réfléchir et à veiller à ce que l’homme soit humain et non inhumain ou « non barbare ». Cette première conception visait à rendre l’homme libre.
Voici la raison pour laquelle, les différentes conceptions de l’humanisme (chrétien, marxiste, sartrien…) se différenciaient suivant la conception de la liberté et de la nature de l’homme. Invitons maintenant le philosophe Heidegger à ce ballet de sens. M. Heidegger (1966, p. 124) dit relativement ceci sur le mot humanisme : «”humanum”dans le mot, signale l’humanitas, l’essence de l’homme. L”….isme” signale que l’essence de l’homme devrait être prise comme essentielle. C’est ce sens que le mot ”humanisme” a en tant que mot. Lui rendre un sens ne peut signifier que ceci : déterminer à nouveau le sens du mot ».
Nous pouvons après cette citation redéfinir ou résumer la définition du mot humanisme en ceci que, c’est l’expression de l’humanitas de l’homo humanus, c’est-à-dire la manifestation éclatante de l’essence de l’homme. Or l’humanité de l’homme n’existe que dans son essence. Donc, il est non humain qu’en dehors de son essence. Parce que dans son essence il est dans la proximité de l’Être comme dans sa vérité. Et c’est cette position qui détermine son statut d’ek-sistant et de berger de l’Être. Évidemment, il y a une véritable interaction entre l’homme et l’Être, à tel point que l’homme ne peut agit dans le sens du déploiement ou accomplissement de son essence que dans l’éclaircie de la vérité de l’Être ou par revendication de celui-ci. Penser l’humanisme de cette façon, c’est « penser l’humanitas » essentiellement comme ontologie, parce qu’en tant qu’ontologie elle devient nécessaire pour la pensée de l’Être.
Malheureusement, l’ontologie seule ne suffit pas. Dès lors, Heidegger tente de la compléter avec l’éthique. Ainsi, il fait l’expérience des rapports d’une ontologie avec une éthique. M. Heidegger (1966, p. 136) se demande à cet effet : « ce que je cherche à faire depuis longtemps déjà, c’est préciser le rapport d’une ontologie avec une éthique possible ?».Cela dit, nous pouvons affirmer à cet instant que l’humanisme est un mot complexe qui se joue entre l’ontologie et l’éthique. Cela est autant vrai qu’il répond à l’actualité quand on parle aujourd’hui du développement durable assorti de la bonne gouvernance, soucieuse de l’éthique qui doit réguler les comportements sociaux, et de l’ontologie comme repère ou ek-sistence ayant pour fondement la vérité de l’Être.
Ici, Heidegger vient d’élever le sens de l’humanisme qui n’est plus la simple question de l’existence au sens de l’existentialisme où Sartre ne fait que réaliser le renversement des valeurs chrétiennes (essence-existence, en existence-essence). L’humanisme heideggerien est au-delà de la simple connaissance par représentation de la métaphysique. Il est fondamentalement ce qui est sans métaphysique. M. Heidegger (1966, p. 143) le dit lui-même : « penser la vérité de l’Être, c’est en même temps penser l’humanitas de l’homo humanus. Ce qui compte, c’est l’humanitas au service de la vérité de l’Être, mais sans l’humanisme au sens métaphysique». Situant ici l’humanisme au-delà ou en dehors du champ questionnant de la métaphysique, on est enclin à se demander : mais, où le Maître veut encore nous emmener ?
Néanmoins, accrochons-nous à ses idées de M. Heidegger (1966, p. 143) : « la pensée qui pose la question de la vérité de l’Être, et par là-même détermine le séjour essentiel de l’homme à partir de l’Être et vers lui, n’est ni éthique ni ontologie. C’est pourquoi la question de la relation entre ces deux disciplines, est dans ce domaine, désormais sans fondement ».
En cherchant à mieux cerner la logique interne à cette pensée fondamentale et évanescente de Heidegger, nous découvrons cette subtilité qui est en ceci que la destination de la pensée ou de toute bonne pensée est la vérité de l’Être. L’homme doit donc, vivre dans la vérité de l’Être pour vivre son humanité. Voici la raison pour laquelle, il doit accepter l’offrande à lui offerte par l’Être qui n’est ni Dieu, ni fondement quelconque. Il est transcendant pur qui n’a pas encore été pensé. Citons M. Heidegger (1966, p. 74) pour l’offrande vitale : «cette offrande consiste en ceci, que dans la pensé l’Être vient au langage. Le langage est la maison de l’Être. Dans son abri, habite l’homme ». Cet abri est le comment vivre de l’humanité. En tant qu’abri, il n’est pas encore maison. Évidemment, seul l’Être a droit à une maison. L’homme à l’abri parce qu’il est l’homme de l’Être qui ne peut vivre que dans la vérité de l’Être, c’est-à-dire, dans la proximité de l’Être. On comprend bien pourquoi aujourd’hui l’éthique est tant sollicitée. C’est compte tenu des dérapages langagiers, voire comportementaux. C’est là, la preuve du déclin d’un monde (cosmos) qui ne reflète plus la beauté, parce qu’il s’est simplement écarté de son élément originaire qui est ce, à partir de quoi, la pensée de l’homme peut être réellement une pensée.
En nous appuyant sur M. Heidegger (1966, p. 78), nous pouvons affirmer ce qui suit : « la pensée est en même temps pensée de l’Être, en tant qu’appartenant à l’Être, elle est à l’écoute de l’Être ».
Reprenons notre réflexion sur l’humanisme comme « étantité » ou métaphysique et humanisme réglé sur l’humanitas ou l’essence de l’homme. En parlant de l’essence, nous parlons sans le dire de l’ontologie. Soit dit en passant, il y a également ici la scission entre une ontologie métaphysique qui réduit l’Être au concept, parce qu’elle ne pense que l’être de l’étant sans pouvoir penser la vérité de l’Être et une autre qui ne pense que la vérité de l’Être. « Or, aussi longtemps que la vérité de l’Être n’est pas pensée, toute ontologie reste sans son fondement », M. Heidegger (1966, p. 142) conclut sur ce point.
Ainsi, la pensée qui a servi d’expérimentation dans Sein und Zeit, en direction de la vérité de l’Être a pris le nom d’ontologie fondamentale. C’est dans cette ontologie fondamentale que Heidegger scrute désormais un horizon possible à l’émergence d’un humanisme de l’humanitas (essence de l’homme). Nous parlons en termes approximatifs, en usitant l’expression heideggerienne de « horizon possible » parce que, le philosophe Heidegger n’a pu faire le tour de sa réflexion sur le sujet. D’ailleurs, Il s’agit ici d’une adresse par correspondance, dans laquelle il a amorcé une réflexion sur l’humanisme. Néanmoins, comme la pensée doit travailler à construire la maison de l’Être, afin que l’Être puisse enjoindre à l’essence de l’homme, alors l’humanisme sera la réalisation du destin d’habiter dans la vérité de l’Être.
En effet, cet « habiter » même est l’essence de ce qui est « être au monde ». N’est-ce pas naturellement une obligation morale qu’une fois au monde, nous désirons avoir notre abri, familièrement désigné par le mot « toit » ? Mais une fois l’acquisition de cet abri, nous dégageons l’individualisme autour de nous, de sorte qu’on vit seul au lieu de vivre ensemble avec les autres, afin que dans une fraternité chaque humain puisse partager les joies et peines des autres. L’ONU aurait pu constituer le premier pas de salut de l’humanité, si elle pouvait s’inspirer de l’ontologie fondamentale de Heidegger. Il n’a pas construit un abri comme la « rondeur parfaite » de Parménide. Mais, tout de même, il a mis l’humanité sur le chemin de la vérité de l’Être. Chemin d’ailleurs tortueux, donc pénible à emprunter. Néanmoins, c’est un chemin sûr conduisant, non seulement au développement durable, mais aussi, à plus que cela, c’est-à-dire, à l’éternel.
À cet effet, M. Heidegger (1966, p. 83) nous lègue quelques conseils suivants : « Mais si l’homme doit un jour parvenir à la proximité de l’Être, il lui faut d’abord apprendre à exister dans ce qui n’a pas de nom. Il doit savoir reconnaitre aussi bien la tentation de la publicité que l’impuissance de l’existence privée ». Ceci est un conseil pour un exercice de penser quotidiennement. Après quoi, il faudra continuellement penser à élever la maison de l’Être dans la vérité.
Conclusion
Nous faisons cette conclusion dans un premier temps avec Heidegger parce que, sa réflexion sur « es gibt » mot en allemand, qui signifie simplement « il y a », nous éclaire comme une lanterne sur notre chemin. Alors remontons à notre sujet qui prend son départ dans le « il y a » mis en interrogation qui est devenu « y a-t-il ». À la forme affirmative ou interrogative la signification ne change pas. Donc nous pouvons inviter le philosophe Martin Heidegger (1966, p. 108) à faire cet éclairage : « c’est parce que l’Être n’est pas encore pensé qu’il est dit aussi de lui dans Sein und Zeit: ”es gibt” (il y a) ». Autant pour l’Être que pour l’humanisme qui n’ont pas encore suffisamment été pensés, à la dimension de ce que Heidegger appelle pensée essentielle, parce que, pensée de la vérité de l’Être ou de l’ontologie fondamentale. Et « bien plutôt, c’est à partir de l’essence de l’Être pensée selon ce qu’elle est que nous pourrons un jour penser ce qu’est une ”maison” et ce qu’est ”habiter”», M. Heidegger (1966, p. 145). Sinon, pour le moment, la mondialisation n’est pas encore humanisée. Elle demeure toujours une symphonie inachevée.
Malgré cela, est-ce qu’une mondialisation pour la paix perpétuelle comme dit Kant est-elle possible ? De quelle manière elle peut se déployer dans ce sens ? Comment concevoir la vie politique, afin d’être très souvent dans la paix ? Dans un deuxième moment, Kant termine cette conclusion.
En effet, Kant le précurseur de la mondialisation avait pensé autrement que, ce qui est servi au monde aujourd’hui. Selon Kant le fédéraliste républicain, le concept de paix se définit par trois principes à observer pour prétendre être dans la quiétude. Ce sont : la liberté, qui n’obéit qu’à des lois que l’on a approuvées soi-même ; l’égalité de tous devant la loi et des droits et non égalité sociale ou économique ; et la dépendance ou soumission de l’individu au pouvoir d’État.
Cette conception kantienne est la seule constitution qui est en mesure d’assurer la paix. Toutefois, si chaque État se dote de la structure fédéro-républicaine, alors cette constitution peut permettre de mettre fin à l’état de nature qui malheureusement existe encore entre les États.
Or pour être dans une globalisation ou dans chaque organisation des nations unies, il faudra que chaque État comme chaque individu, ait l’obligation éthique de se soumettre à une loi commune. Ainsi, naîtra ”l’alliance des peuples pour la paix” pour laquelle, il sera créé ”une fédération d’États libres, souverains et égaux”. À cet effet et pour finir, E. Kant (1995, p. 134) le penseur politique achève sa pensée sur cette belle note : « pas de super-État mondial, donc pas d’empire universel qui effacerait la singularité et l’autonomie des peuples, mais une « alliance des peuples pour la paix » (friedens-und völkerbund) ».
Références bibliographiques
CARON Maxence, 2005, Introduction à Heidegger, Paris, Ellipses Edition, 93 p.
HAAR Michel, 1990, Heidegger et l’essence de l’homme, Grenoble, Éditions Jérôme Million, 254 p.
HEIDEGGER Martin, 1966, Question III, « lettre sur l’humanisme » pp. 71-154, trad. Roger Munier, Paris, Gallimard, 229 p.
HOMO Léon, 1944 et 1970, Les institutions politiques Romaines, Paris, Édition Albin Michel, 379 p.
KANT Emmanuel, 1995, Pour la paix perpétuelle (projet philosophique), Trad. Joël Lefebvre, Lyon, PUL, 188 p.
LEVINAS Emmanuel, 1991, Entre nous, Paris, Grasset, 253 p.
MARCEL Gabriel, 1968, Être et Avoir, Tome1, Paris, Aubier, 221 p.
LE DÉFI DE LA GLOCALISATION DANS LA RECHERCHE SUR LES DROITS DE L’HOMME ET LEUR ÉCLOSION EN AFRIQUE
Bilakani TONYEME
Université de Lomé (Togo)
Résumé :
Les droits de l’homme, tels que nous les connaissons de nos jours, ont une origine occidentale. Même si l’Afrique emprunte aujourd’hui le discours et les outils de défense des droits humains, comment la recherche sur ceux-ci peut-elle permettre une appropriation et une incarnation de ces droits dans les mentalités à partir des cultures africaines ? Notre approche méthodologique consiste à analyser comment dans les cultures africaines, les droits de l’homme étaient protégés en vue d’en dégager les principes généraux et les référents principaux servant de repères pour l’enracinement et l’éclosion des droits de l’homme en Afrique.
Mots-clés : Droits de l’homme, globalisation, glocalisation, multiculturalisme, universalisme culturel.
Abstract :
Human rights, as we know them today, have a Western origin. But even if Africa today borrows the discourse and the tools of defense of the human rights, how can research on these allow an appropriation and incarnation of these rights in the mentalities in Africa? Our methodology is to analyze how, in African cultures, human rights were protected in order to identify the general principles and main references of this protection that can serve as landmarks for rooting and hatching human rights in Africa.
Keywords : Cultural universalism, Globalization, Glocalization, Human rights, Multiculturalism.
Introduction
Les révolutions française et américaine du XVIIIè siècle sont considérées comme les bases des droits de l’homme et de leur universalité tels que nous les connaissons de nos jours. Jusque dans la deuxième moitié du XXè siècle, les droits de l’homme et leur universalité étaient considérés comme évidents et allant de soi. Mais les critiques socialistes et plus récemment les critiques culturelles démontrent que ces droits de l’homme et leur universalité sont culturellement d’origine occidentale ; ce qui peut être un obstacle à leur universalisation car les autres milieux culturels ne s’y retrouvent pas forcément. Ceci constitue un défi pour la recherche sur les droits de l’homme et leur éclosion en Afrique : partant du principe que chaque milieu culturel se préoccupe de la protection de l’homme à sa manière, comment envisager les droits de l’homme pour qu’ils incarnent cette préoccupation universelle qui prend en compte toutes les particularités identitaires, notamment celles de l’Afrique ?
Même si la plupart des études (P. Hounsounon-Tolin, 2017) montrent assez clairement que le souci de protéger les humains a été la préoccupation essentielle de toutes les sociétés sans exception, il est important de noter que cette préoccupation s’est traduite de différentes manières suivant les milieux. C’est ainsi que les méthodes de protection des droits de l’homme ont été toujours fonction de la culture de chaque société. Mais la Déclaration universelle des droits de l’homme a prétendu à une universalisation qui vise l’uniformisation. Or, tout droit est un droit situé culturellement, exception faite du droit naturel qui reste en général une virtualité dont l’incarnation concrète n’échappe pas aux chaînes culturelles. On ne peut donc défendre des droits en dehors de la culture au sein de laquelle ces droits se déploient. Mais ceci n’implique pas que les droits de l’homme soient fonction exclusivement de la culture du milieu, étant donné que ces droits sont considérés comme des droits inhérents à l’humanité en l’homme. Alors se pose la question de la conciliation entre la défense des droits humains en tant que donnée universelle et leur encrage dans les cultures locales, notamment en Afrique. Comment la recherche sur les droits de l’homme peut-elle permettre une appropriation et une incarnation de ceux-ci dans toutes les cultures dans le contexte multiculturel du monde actuel ? Plus particulièrement comment la recherche permettra-t-elle d’incarner l’universalité des droits de l’homme dans les pratiques quotidiennes des cultures africaines ? Partant du principe que toutes les cultures se soucient de la protection de l’homme, on peut avancer l’hypothèse que si les droits de l’homme peinent à s’enraciner dans toutes les cultures, notamment dans les cultures africaines, c’est que leur protection ne se base pas sur les éléments culturels du milieu où ils se déploient. Il importe donc de comprendre comment dans les cultures africaines, les droits de l’homme étaient protégés. Ce qui permet de dégager les principes généraux de la protection de ces droits. Cette démarche consiste essentiellement en une analyse documentaire des divers travaux sur les droits de l’homme en général et dans les cultures africaines en particulier en vue de dégager les référents communs de protection de l’homme en Afrique. L’objectif de cette étude est de comprendre comment la recherche sur les droits de l’homme pourrait permettre que ceux-ci puissent éclore dans les différents milieux socioculturels dans le contexte multiculturel mondial actuel, notamment dans les milieux africains sans que leur universalité ne soit l’imposition de la conception et de la pratique des droits humains d’un milieu culturel au reste du monde. Autrement dit, comment envisager, concernant les droits de l’homme, un « global » localisé ou un « local » globalisé en vue de leur éclosion universelle ? Pour parvenir à cet objectif, la démarche consiste à comprendre l’avènement des droits de l’homme dans la modernité, notamment leurs fondements et les postulats de leur université ; ensuite à aborder les critiques culturelles du fondement et de l’universalité de ces droits, ce qui conduit enfin à les envisager dans un contexte multiculturel et à postuler la glocalisation pour leur encrage dans les tous les milieux.
1. Les droits de l’homme dans la modernité politique
1.1. Les fondements des droits de l’homme
Les droits de l’homme sont l’une des inventions les plus significatives de la modernité. C’est pourquoi l’avènement des droits de l’homme est en même temps l’avènement de la société moderne. Mais l’une des grandes questions qui ont fait l’objet de débat sur les droits de l’homme depuis leur naissance est leur fondement. J. Rivero (1980, p. 21) observe que « le paradoxe majeur du destin des droits de l’homme depuis deux siècles est sans doute le contraste entre le dépérissement de leurs racines idéologiques et le développement de leur contenu et de leur audience à l’échelle universelle ». Autrement dit l’accroissement et l’élargissement du discours sur les droits de l’homme contraste avec les vifs débats et l’évanouissement progressif des évidences sur leur fondement.
Les premiers fondements esquissés des droits l’homme se sont basés sur le mythe de l’origine. Chez J. Locke comme chez T. Hobbes, la théorie des droits « procède par rationalisation mythique de l’origine. Elle projette dans le passé abstrait de l’état de nature, passé hors histoire, la recherche d’une norme primordiale en elle-même intemporelle quant à la composition du corps politique » (M. Gauchet, 2002, p. 108). Les droits de l’homme, dans cette optique, seraient ce que tous les hommes sont censés « posséder » au seul motif qu’ils sont des hommes.
Cette légitimation par la nature humaine apparaît clairement dans les grands textes fondateurs. La Déclaration d’indépendance américaine dit que tous les hommes ont été créés égaux, qu’ils sont pourvus par leur Créateur (Dieu) d’un certain nombre de droits inaliénables. La Déclaration universelle de 1948 proclame dès son article premier : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». C’est parce qu’ils seraient naturels que les droits seraient inaliénables et imprescriptibles, c’est-à-dire universels.
Beaucoup de tenants de l’idéologie des droits de l’homme s’en tiennent aujourd’hui encore à ce raisonnement. F. Fukuyamaaffirme que « toute discussion sérieuse sur les droits de l’homme doit se fonder en dernière instance sur une vision des finalités ou des objectifs de l’existence humaine qui, à son tour, doit presque toujours se fonder sur une conception de la nature humaine » (F. Fukuyama, 2001, p. 19). Selon lui, seule « l’existence d’une unique nature humaine partagée par tous les habitants du monde peut fournir, au moins en théorie, un terrain commun pour fonder des droits de l’homme universels » (Fukuyama F., 2001, p. 24).
Mais un tel fondement se heurte à de très grandes difficultés, notamment celle de la théorie de la « nature humaine » qui est un sujet de débat dont les conclusions ne sont pas tranchées. Au cours de l’histoire, la notion même de « nature » a fait l’objet des définitions les plus contradictoires. Pour les Anciens, la nature humaine n’ordonne pas les individus au bien commun. En plus, le fait d’invoquer la nature n’est pas une preuve suffisante pour démontrer que de l’existence de la nature humaine, il en découle des droits au sens de la doctrine des droits de l’homme. G. W. F. Hegel (2004, p. 314) remarquait déjà la difficulté à fonder l’égalité des hommes sur la nature : « Il faut dire que, par nature, les hommes sont bien plutôt seulement inégaux ».
L’autre fragilité de cette théorie tient au fait que la nature ne contient et ne fournit en elle aucune norme de vie. Si l’on voulait partir du constat pour tirer des lois, il aurait été plus probable que ces lois soient l’opposé des grands principes défendus par la théorie des droits de l’homme. En effet, la tradition libérale anglo-saxonne n’a cessé d’affirmer, à la suite de D. Hume, que de l’être on ne saurait tirer un devoir-être : l’erreur du « naturalisme » consisterait à croire que la nature peut fournir une justification philosophique de la morale ou du droit. Même si cette affirmation peut être discutable, d’un point de vue libéral, elle entre en contradiction avec l’idée que le fondement des droits de l’homme serait à rechercher dans la nature humaine. Tel est précisément l’argument que J. Bentham faisait valoir contre les droits de l’homme : compte tenu de la scission entre le droit et le fait, on ne saurait tirer du fait aucune prescription. La même argumentation se retrouve, dans une autre optique, chez H. Kelsen (1998) comme chez K. Popper (1979).
L’idée d’un « état de nature » ayant précédé toute forme d’existence humaine apparaît aujourd’hui, de moins en moins tenable. Certains philosophes des droits de l’homme le reconnaissent ouvertement. J. Habermas (1998, p. 252) dit que « la conception des droits de l’homme doit être libérée du poids métaphysique que constitue l’hypothèse d’un individu donné avant toute socialisation et venant en quelque sorte au monde avec des droits innés ».
N. Bobbio (1998) conclura qu’une fondation philosophique ou argumentative des droits de l’homme est tout simplement impossible, et même inutile. Selon lui, les droits de l’homme, loin de former un ensemble cohérent et précis, ont eu historiquement (et continue d’avoir) un contenu variable. De plus, nombre de ces droits peuvent se contredire entre eux. La théorie des droits de l’homme se heurte à toutes les apories et à tous les paradoxes du fondationnisme, car aucun consensus ne pourra jamais s’établir sur les postulats initiaux.
Faut-il alors conclure qu’il est impossible, voire inutile de chercher un fondement aux droits de l’homme ? Si les droits de l’homme ne sont pas fondés, leur portée peut être sérieusement compromise : ils ne seraient que des conséquences sans prémisses. Au bout du compte, le fondement des droits de l’homme ne doit-il pas être ramené au plus simple des bases d’un droit humain : le bon sens ? Celui-ci voudrait que l’on constate qu’il est préférable de ne pas subir d’oppression, que la liberté vaut mieux que la tyrannie, qu’il n’est pas bien de faire du mal aux gens et que les personnes doivent être considérées comme des personnes plutôt que comme des objets, toutes choses qui se basent sur un principe simple, celui de la réciprocité.
1.2. Universalité des droits de l’homme et diversité culturelle
L’idéologie qui fonde le respect des droits de l’homme soutient que tous les êtres humains ont des droits fondamentaux. Ces droits apparaissent comme des droits inhérents à l’être humain. Pour B. Barret-Kriegel. (1996, p. 118 et 119),
La nature humaine comporte des droits inaliénables. C’est la nature avec la loi, c’est-à-dire un univers où l’exigence mathématique conduit en même temps à définir des lois de rapport entre les êtres et à décrire l’égalité fondamentale des conditions. Le fondement du respect des droits de l’homme est donc, ici, leur caractère obligatoire et leur inhérence à la nature humaine.
Mais cette nature de l’homme considérée dans le sens de B. Barret-Kriegel comme le résultat d’une création divine a plutôt ses racines dans la réalité humaine. Dans le concret, ces droits se réfèrent à la satisfaction des besoins essentiels de l’homme, à l’exercice de ses libertés, à ses rapports avec les autres personnes. Comprise par E. Kant (1990, p. 76) comme « ce qui est au-dessus de tout prix et n’admet nul équivalent, n’ayant pas une valeur relative mais une valeur absolue » et par R. Guimbo (1997, p. 73) comme une « certaine conception de soi qui s’oppose aux actes dégradants dont l’individu serait responsable ou dont autrui se rendrait coupable à son égard », la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine n’a de sens que parce qu’elle s’adresse à l’homme concret. Ces conceptions mettent en exergue le caractère universel des droits de l’homme. Que peut-on entendre par l’universalité des droits de l’homme ?
Selon B. P. G. Martinez (p. 2004, p. 271), l’universalité des droits de l’homme couvre trois choses distinctes qui sont toutes liées aux fondements des droits. D’abord, sur un plan rationnel qui est du domaine du philosophie, l’universalité désigne l’attribution des droits à tous les êtres humains quels qu’ils soient : « ces droits sont rationnels et abstraits, en accord avec le fait qu’ils sont attribués à tous les hommes et qu’ils sont porteurs d’une prétention de validité générale du fait des critères de moralité qui les fondent ». Sur un plan temporel, l’universalité reposant sur le caractère général et abstrait des droits de l’homme, ces droits doivent être attribués à l’homme indépendamment du facteur historique. Enfin, sur le plan spatial, les droits de l’homme doivent concerner toutes les sociétés sans distinction aucune.
La définition de l’universalité montre bien cette dimension abstraite de l’être humain, l’universalité rationnelle supposant par définition l’attribution des droits à tous les hommes indépendamment de leurs race, nationalité, sexe ou religion qui ne font pas partie intégrante de l’humanité en l’homme, mais sont de simples accidents. Suivant le modèle exposé par B. P. G. Martinez (p. 2004, p. 272), l’universalité rationnelle est basée sur le principe selon lequel « … la condition d’être humain suffit pour être titulaire des droits de l’homme quel que soit le contexte et en toute circonstance ». C’est en ce sens que J. Mourgeon (1981, p. 54) affirme que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». F. Sudre (2001, p. 43) estime qu’« au cœur du concept des droits de l’homme, il y a l’intuition de l’irréductibilité de l’être humain à tout son environnement social ». Allant dans ce sens, M. Levinet (2006, p.164) affirme que « la personne humaine constitue la pierre angulaire de toute société ». Ainsi la primauté de l’être humain constitue le premier fondement de l’universalité des droits de l’homme.
Mais, malgré que l’universalité des droits de l’homme semble être ainsi fondée sur une certaine rationalité universelle de l’homme, le débat sur la question demeure toujours l’une des questions les plus controversées de la théorie des droits de l’homme. Malheureusement, ce débat a été souvent mené de manière stéréotypée : universalisme et relativisme sont présentés comme les deux pôles d’une dichotomie rigide, donnant l’impression qu’il fallait forcément choisir un terme d’une alternative, qu’il fallait se positionner pour ou contre la suprématie des droits de l’homme sur les différences culturelles. Il existe certes un antagonisme fondamental entre les principes de base de l’universalisme d’une part, et ceux du relativisme de l’autre, et la question de savoir laquelle de ces deux perspectives saisit avec le plus de justesse les « droits de l’homme dans le monde » constitue un enjeu réel. Mais cette dichotomie stricte repose sur une conception réductrice tant de la notion de « droits » que de celle de « culture ». Les relations entre ces deux concepts sont en réalité beaucoup plus complexes et dynamiques que cette vision simplifiée.
La réflexion actuelle sur l’universalité des droits de l’homme reste en grande partie tributaire du cadre conceptuel se situant en faveur de l’un ou de l’autre pôle de l’alternative : universalisme ou relativisme. Mais nombreux sont ceux qui commencent à contester les postulats sous-jacents à cette représentation classique des rapports entre droits de l’homme et différences culturelles. Ces critiques réfutent le caractère essentialiste et a-historique de la conception des droits de l’homme et de la culture qui domine cette doctrine (S. E. Merry, 2001, p. 35). Une certaine doctrine universaliste et a-culturaliste des droits de l’homme appréhende généralement les cultures comme des ensembles homogènes, harmonieux, consensuels et essentiellement stables. Ainsi devrait-on trouver les mêmes référents culturels partout, constituant la base de la défense et de l’universalité des droits de l’homme. Or, si de nos jours le discours des droits humains s’est mondialisé, c’est moins grâce à une homogénéisation culturelle qu’en référence aux significations concrètes qu’il reçoit dans différents contextes culturels. Le langage des droits de l’homme est devenu, selon l’expression de R. Rorty (1997, p. 27), « un fait du monde ». Mais ce fait global n’a pas de sens par lui-même, il n’acquiert de signification qu’à travers les utilisations qui en sont faites dans des contextes culturels locaux. Le concept de « droit humain » peut être décrit comme un « signifiant vide » (E. Lacan et C. Mouffe, 1986, p. 36), constamment, mais toujours provisoirement, empli de signifiés locaux. C’est un signifiant global vide qui se remplit des signifiés locaux particuliers. Ainsi donc les droits de l’homme ont un fondement rationnel théorique et n’ont de sens réel que dans leur pratique concrète à travers les différents milieux. La globalisation des droits humains (leur fondement rationnel et leur universalité) n’a de sens et de portée concrets que parce qu’ils sont localisés. Ceci pose à l’humanité actuelle et plus particulièrement aux chercheurs africains le défi d’une approche « glocale »[21] concernant la réflexion sur les droits de l’homme.
2. Les défis d’une approche complexe des droits de l’homme
2.1. Les droits de l’homme entre dynamique locale et mouvement global
R. Vachon, dans un article (2000, p. 9)), soulevait des questions essentielles de débat à propos des droits de l’homme, questions relatives à leur caractère universel et à leur encrage local.
Une des découvertes les plus troublantes (insécurisantes) et en même temps les plus libératrice de notre temps est qu’il n’existe pas de critères universels qui nous permettent de tout juger sous le soleil. Non seulement Dieu n’est pas un universel culturel, mais l’homme et le Cosmos non plus. Encore moins les notions de développement, de démocratie, de droits de l’homme, … Les droits de l’homme, le droit lui-même et l’ordre (même négocié) ne constituent qu’une culture parmi d’autres et pas nécessairement plus valable que d’autres.
Reconnaître ce fait dans la pratique me paraît de prime importance, sinon on tombe dans le colonialisme et le totalitarisme du droit, des droits de l’homme. Il faut donc se poser des questions sérieuses et délicates par rapport aux notions d’interculturalisation et d’universalisation des droits de l’homme.
R. Vachon remarquera que les référents, à partir desquels les discussions sont menées à propos des droits de l’homme, sont souvent considérés somme universels. Or ces référents sont particuliers et de type occidental. C’est pourquoi, toute discussion sur les droits de l’homme doit commencer par un certain désarmement des mentalités qui relativise les positions de départ.
Le point de référence est universel si on le contemple de la position où est établie la culture qui l’affirme, mais pas universel si le regard qu’on porte sur lui vient du dehors. Personne n’a accès direct à toute la gamme universelle de l’expérience humaine. Toute culture exprime son expérience de la réalité et de l’humanum par des concepts et symboles qui appartiennent à cette tradition et, comme tels, ne sont pas universels, ni très vraisemblablement universalisables. Non seulement les réponses des civilisations à nos questions ne sont pas nécessairement les mêmes, mais les questions elles-mêmes (et les présupposés) ne le sont pas. Ce n’est donc pas en regardant par la même fenêtre (le droit, les droits de l’homme, l’ordre, etc.) que je vais connaître ce que représente le tout vu par l’autre fenêtre. Je devrais commencer à faire l’effort de regarder le tout tel que vu par les autres fenêtres. De cette façon, elles me révéleront mes propres mythes, et le caractère particulier de ce que je crois être leur universalité (R. Vachon, 2000, p. 10).
Cette prise de conscience mène à distinguer deux approches radicalement différentes, mais complémentaires, des droits de l’homme. On peut effectuer une relativisation contextuelleen s’interrogeant sur la réception, la traduction, l’inculturation des droits de l’homme dans divers contextes culturels et en inscrivant cette interrogation dans les cadres conceptuels de la culture dont les droits de l’homme sont une expression. Ou alors, on peut procéder à une relativisation radicalequ’il ne faudrait pas confondre avec le relativisme culturel. Il ne s’agit pas d’enfermer les cultures dans des « ghettos », mais plutôt de reconnaître la relativité radicaledu monde dans lequel nous vivons. Cette relativité radicale ne signifie pas que les cultures n’ont pas de points communs et ne peuvent pas se rencontrer, mais plutôt elles constituent les différentes manières de traduire la diversité de la réalité humaine. D’où la nécessité du dialogue car chaque culture traduit ce qui manque à l’autre et dont elle a besoin pour mieux comprendre le monde.
L’enjeu, selon C. Eberhard (2002), n’est pas de savoir si les autres cultures ont une conception des droits de l’homme et, si oui, laquelle, et comment rentrer en dialogue avec elle en vue d’une interculturation des droits de l’homme. Il s’agit plutôt de voir ce qu’une conception (la conception occidentale des droits de l’homme) peut apprendre d’une perspective extérieure si elle laisse éclairer ses propres constructions qui sont enracinées dans un univers de sens bien différent. Ainsi, il semble aujourd’hui possible, avec l’émergence du « plurivers » ou « pluriversalisme » (en opposition à univers ou universalisme), de commencer à explorer de manière plus approfondie les enjeux du local et du global, c’est-à-dire le glocal à propos des droits de l’homme.
Les définitions de « glocal » et de « glocalisation » proposées par The Oxford Dictionnary of New Words, indiquent que l’idée de glocal se comprend dans le contexte japonais où elle a été introduite en premier dans le domaine de l’agriculture comme un processus d’adaptation des techniques agricoles à des conditions locales. Dans les années 1980, le terme de « glocalisation » a fait son entrée dans le business dans le sens de « localisation globale », c’est-à-dire comme technique d’élaboration d’une perspective globale tenant compte des conditions locales. Autrement dit, il faut se livrer à un jeu dual, à la fois objectif et subjectif, composé des variables de local et de global. Cette dialectique entre le local et le global est un jeu perpétuel entre deux composants interconnectés et interdépendants. C’est dans cette dynamique que doivent s’inscrire les droits de l’homme de nos jours.
2.2. Les droits de l’homme à l’épreuve de la glocalisation
La réflexion sur les droits de l’homme porte aujourd’hui, entre autre, sur les relations de l’universel et du relatif : l’universalité de l’humain en rapport avec la diversité des cultures. G. Berthoud, (1992, p. 142) résume cette approche et ses limites comme suit :
Les deux extrémismes universaliste et relativiste constituent deux univers opposés mais inséparables. L’un est la stricte inversion de l’autre. Ou encore, ils forment une unité cachée dont les deux composantes sont toujours présentées dans une relation d’extériorité totale. Á suivre les arguments des défenseurs inconditionnels de l’universalisme abstrait, nous sommes alors vite pris dans le jeu facile des positions simplistes et réductrices, et donc porteuses de graves dérives idéologiques et politiques. Comme la vue individualiste et universaliste du monde tient lieu de vérité exclusive sur l’homme et la société, toute autre idée est rejetée dans l’univers douteux du différentialisme culturel.
Cependant, on assiste maintenant depuis quelques années à une reconfiguration au sein de ces champs de recherche. La problématique de l’unité / diversité humaine se réarticule dans le contexte contemporain de globalisation de plus en plus autour de la tension entre global et local. Ainsi, ce qui se trouve de plus en plus au cœur des réflexions est cet « espace intermédiaire » que constitue le glocal et où s’actualisent en se rencontrant, s’entrechoquant, s’enrichissant, etc. non seulement les discours, les logiques et les visions du monde des acteurs impliqués, mais aussi leurs pratiques.
Cette irruption du « glocal », met au goût du jour la question du pluralisme concernant les droits de l’homme et ses enjeux contemporains. Une approche glocale des droits de l’homme fait fi d’analyses opposant modernité occidentale et traditionalité des autres cultures, notamment les cultures africaines. La thématique des droits de l’homme se fondant sur un humanisme normatif s’inscrit explicitement dans l’entre-deux du global et du local, du prescriptif et du descriptif.
Se dessine ainsi un champ nouveau pour la réflexion sur les droits de l’homme. Nous vivons aujourd’hui une époque marquée par l’incertitude, le flou, le mouvant, le risque. Nos approches modernes fondées sur des perceptions plus figées de la réalité, que ce soit aux niveaux politiques, juridiques, sociaux ou individuels montrent leurs limites. Nous sommes obligés de réinventer des rapports au monde qui prennent en compte la fragilité de nos existences ainsi que leur impermanence. La pensée moderne s’est trouvée déconstruite par diverses approches postmodernes qui remettent en cause beaucoup de nos « croyances » : l’universalité de la raison, l’orientation téléologique de l’évolution en direction du progrès, le contrôle du réel par notre savoir. Ces approches postmodernes insistent sur nos subjectivités, nos limites, nos imperfections, l’absence de buts ultimes… Cela demande non seulement de déconstruire nos cadres de pensée hérités de la modernité, mais aussi de les réinventer pour permettre l’émergence de nouveaux rapports au monde qui fassent sens. En s’inspirant de l’intuition de R. Panikkar (1984), on peut postuler que c’est par la déclinaison cosmothéandrique des responsabilités humaines que se trouveront enrichies et approfondies les approches des droits de l’homme.
3. Les droits de l’homme et leur enracinement dans un monde multiculturel : l’approche glocale
3.1. La réflexion postmoderne sur les droits de l’homme : multiculturalisme et découverte du pluriel
La réflexion sur les droits de l’homme, abordée à partir des acteurs, au lieu du système, nous amène à la découverte du pluralisme. En effet, et comme le remarque justement J. Vanderlinden (1989, p. 153), c’est en prenant la perspective de l’individu, plutôt que celle du « système juridique » qu’émerge la problématique du pluralisme dans le domaine des droits de l’homme, l’individu se trouvant confronté dans sa vie quotidienne à une multitude d’ordres régulateurs relatifs à ses différentes inscriptions sociales.
Penser le pluralisme des droits de l’homme nous oblige à penser le pluralisme de la personne, à penser le « je » comme ayant du « jeu » nous permettant ainsi de jouer le je(u) social voir les je(ux) sociaux. Cette reconnaissance du pluralisme nécessite une analyse dynamique pour pouvoir rendre compte de la complexité des situations et des processus et peut se faire sous la forme d’un « jeu de lois » : lois régissant le jeu social (E. Le Roy, 1998, p. 252-254).
Mais dans le cadre d’un dialogue interculturel sur les droits de l’homme, on peut découvrir un pluralisme encore plus radical et encore plus fondamental : il s’agit, au-delà d’un pluralisme conceptuel, du mythe du pluralisme tel que défini par R. Vachon (2000). En effet, tout en pensant un certain pluralisme dans le domaine des droits de l’homme, on est resté dans une perspective anthropocentrique qui caractérise la modernité occidentale. Cette perspective constitue encore le paradigme des théories et pratiques contemporaines des droits de l’homme. Mais l’ouverture à un monde multiculturel doit amener les théories modernes des droits de l’homme à s’émanciper de ce cadre anthropocentrique. Il importe d’enrichir la modernité occidentale des droits de l’homme, en trouvant « des ensembles sécants » entre les valeurs, les représentations et les formulations des modes de protection des droits de l’homme qui tiennent compte des modes diversifiés de vie. Car au-delà de la pensée occidentale, d’autres cultures (celles de l’Afrique par exemple) adoptent d’autres perspectives concernant les droits de l’homme. R. Panikkar remarque que contrairement à la perspective anthropocentrique caractéristique des droits de l’homme tels qu’abordés en Occident, la perspective africaine est plutôt cosmo-théocentrique ou même cosmo-théo-andrique. La protection des droits de l’homme n’ayant de sens que par rapport à l’univers dans lequel l’on se trouve, mais aussi par rapport aux dieux et à l’homme (culture). Cela donne aux droits de l’homme une dimension plus globale au lieu qu’ils ne soient centrés que sur l’individu et tout le reste servant de moyens pour lui.
S’il est vrai que de nombreuses cultures traditionnelles ont Dieu pour centre, et que certaines autres sont fondamentalement cosmocentriques, la culture qui est apparue avec la notion des droits de l’homme est nettement anthropocentrique. Peut-être devons-nous maintenant nous tourner vers une vision cosmo-théo-andrique de la réalité, dans laquelle le divin, l’humain et le cosmique sont intégrés en un tout, lequel est plus ou moins harmonieux selon que nous exerçons plus ou moins complètement nos véritables « droits humains » (R. Panikkar 1984, p. 22).
Il importe donc de lier la réflexion sur les droits de l’homme dans le dialogue interculturel à une réflexion plus générale sur notre condition globale et sur nos rapports avec les autres, la nature, les générations futures, la vie, « Dieu », sans toujours forcément aborder ces questions à travers un prisme juridique unique, mais en les éclairant dans un véritable dialogue interculturel à travers les différentes perspectives – ou « fenêtres » – culturelles.
Si dans son contexte, on peut être d’accord avec la remarque de F. Mayor (1997, p. 3), ex-Directeur Général de l’UNESCO, qu’ « Une paix durable est la condition préalable de l’exercice de tous les droits et devoirs de l’être humain », construire la paix comme un droit fondamental, en l’incorporant dans une seule vision du monde (vision occidentale) limiterait les potentialités que pourrait renfermer un dialogue entre la tradition des droits de l’homme, qui peut être comprise comme une tradition de paix, avec d’autres traditions de paix (qui ne sont pas occidentale). Pour pouvoir entrer en véritable dialogue interculturel sur des questions aussi essentielles que celles des droits de l’homme et de la paix, il faudrait que chaque vision des droits de l’homme et de la paix accepte l’existence d’autres manières de poser ces questions et d’y répondre et ainsi de s’inscrire dans le mythe d’un pluralisme sain, en n’essayant pas de trouver une unité mais plutôt de vivre dans la complémentarité de nos différences.
Ce qui divise les hommes et cause leur conflit perpétuel, c’est que chacun croit avoir raison, s’oppose à toute opinion différente, affirme et nie catégoriquement. Dépasser toute affirmation catégorique, toute négation tranchée, et apercevoir la complémentarité d’une affirmation et d’une négation données, voilà le salut de l’homme (Tchouang-Tseu, 1997, p. 18 et 19).
Et c’est le chemin par excellence aujourd’hui pour aborder et faire éclore les droits de l’homme dans toutes les sociétés. C’est par ce respect de l’autre à travers la découverte et la reconnaissance du pluralisme de la réalité qu’on peut poser quelques jalons permettant, dans le cadre de la problématique des droits de l’homme, d’aborder un « pluralisme sain » à travers le dialogue interculturel et en vue de permettre l’invention d’un futur partagé et pacifié dans la complémentarité de nos différences.
3.2. Les droits de l’homme entre glocalisation et postmodernisme : l’enracinement dans le multiple
Repenser les droits de l’homme dans une perspective interculturelle nous oblige, non seulement à prendre en compte l’autre et à l’intégrer dans nos paradigmes scientifiques et dans nos matrices culturelles mais aussi à fondamentalement ouvrir le cadre du dialogue, à créer de nouveaux espaces qui demandent de notre part une véritable transformation (C. Eberhard, 2002, p. 114).
Il n’est pas juste de considérer les stades parcourus par une société pour parvenir à un certain niveau de développement comme l’unique chemin du progrès. Ce genre d’« ethnocentrisme est souvent à l’œuvre dans le discours moderne à relent occidental sur les droits de l’homme, spécialement lorsqu’est postulée leur universalité » (C. Eberhard, 2002, p. 114). L’universalisme n’est pas synonyme d’homogénéisation des différences. De même, les droits de l’homme ne sont pas l’apanage d’une seule culture qui se considère comme unité de mesure des autres, productrice absolue de la réalité, unique source d’émanation des valeurs.
Il convient de penser de manière plurale le pluralisme, de rompre avec le credo de l’unitarisme pour ne retrouver l’unité que là où elle s’impose comme somme des données identifiées (principe d’addition) et non comme un ensemble dont une partie des constituants font l’objet de récusation ou de réduction (principe de soustraction) (E. Le Roy., 1997, p. 37 et 38).
Une universalité hégémonique des droits de l’homme est porteuse d’injustice parce qu’elle rend subalternes les dissemblances, nie toute relation vraie et provoque révolte et violence.
Ces deux extrémismes (universalisme/relativisme) peuvent cacher une prétention d’une culture à abriter toutes les cosmovisions ; ceci est à l’origine de la pollution de l’écosystème des droits de l’homme. Il convient d’extirper ces extrémismes à travers la particularisation de l’universel et l’universalisation du particulier sans préjugés : c’est le « pluriversalisme » ou le « mutiversalisme », conséquence de la multiplicité et de la pluralité de l’expérience humaine. Cela invite à un particularisme non réfractaire de l’universalisme en constituant l’espace de transformation de nos attitudes surhumaines en attitudes humaines, de nos sociétés fermées en sociétés ouvertes. Le modèle « pluriversaliste » n’est pas synonyme de localisme fermé ni d’universalisme totalitaire des droits de l’homme. Il exige la « traversée » de ces derniers pour aboutir à un droit transculturel, à un ordre juridique global et innovateur des droits de l’homme. Il ne s’agit pas de rejeter le particularisme juridique occidental qui offre encore des services significatifs ; il s’agit plutôt de reconnaître « l’interculturalité » des droits de l’homme qui sous-tend le droit à la différence sans être un prétexte de fermeture ou de formation des monades culturelles où rien n’entre ni ne sort. Aucune culture ne saurait incarner à elle seule l’universel parce que celui-ci se fonde sur le pluriel et la multiplicité des cultures. Le globalisme qui va désormais de pair avec le localisme propulse la réflexion sur les droits de l’homme vers la « glocalisation ». Il faut alors sortir des dilemmes « universalisme et relativisme », « universalisme et particularisme » pour s’éveiller au « pluriversalime » qui exige l’abandon du « monoculturalisme » au profit du multiculturalisme.
Le pluralisme de la réalité est le fondement théorique de l’interculturation et de la multiculturation des droits de l’homme. Pour R. Vachon (1997, p. 7), le pluralisme est
L’éveil non pas au relativisme mais à la relativité […], l’éveil non pas à l’hétéronomie mais à l’autonomie. C’est l’éveil à l’autre non pas comme simple objet ou terme d’intelligibilité, mais comme source d’autocompréhension (…) On pourrait dire que c’est l’éveil à l’autre, non comme un vide à remplir, mais comme une plénitude à découvrir.
Le pluralisme est considéré comme un corps dont l’existence est assurée par le fonctionnement de chacune de ses parties. Il « apparaît lorsque la pluralité devient un problème non seulement intellectuel mais existentiel, quand la contradiction devient aiguë et la coexistence impossible, quand on découvre l’irréductibilité ultime de nos différences, l’unité totale de chaque être » (R. Vachon, 1997, p. 7). Le pluralisme de la réalité et de la vérité nous révèle donc que nos différences sont non seulement d’ordre profondément existentiel, mais aussi fondatrices de l’« interculturalité » des droits de l’homme.
Conclusion
On ne peut plus continuer à soutenir une conception universaliste des droits de l’homme en tant qu’unicité, alignement sur un mode de pensée des droits de l’homme. En effet, nous sommes dans un monde ouvert qui laisse entrevoir l’existence, non d’une réalité, mais de plusieurs réalités qui sont autant de civilisations et de vies. Ces différents modes de vie, nés de différentes cosmovisions du monde contiennent, chacun en son sein, une vision de l’homme, de sa dignité et par conséquent, de la manière de la protéger. Ce sont ces différentes visions et façons de protéger l’homme qui nous posent aujourd’hui le défi de l’universalisation des droits humains.
Celle-ci doit partir de la réalité de la mondialisation ambiante. La mondialisation, considérée comme processus de valorisation des richesses socioculturelles en vue qu’elles contribuent au patrimoine mondial, a pour base les particularismes identitaires. Elle est inclusive.
C’est dans ce processus que doit s’inscrire l’universalité des droits dans notre monde postmoderne. En tant qu’incarnés dans les différentes cosmovisions, les droits de l’homme doivent porter ce pluriel caractéristique de notre réalité. Autrement dit, ils doivent refléter cet entre-deux d’un localisme globalisé et d’un globalisme abstrait. C’est pourquoi le terme « glocalisation » reflète mieux cette nouvelle posture de l’universalisme des droits de l’homme dans la postmodernité : un universalisme multiculturel. Un tel universel laisse la porte ouverte à la découverte et l’adoption d’autres réalités. On comprend par-là que l’universalisme multiculturel se place dans une posture dynamique, de perpétuelle évolution et non d’une fixation définitive. Il faut ouvrir nos cercles culturels pour accueillir l’autre à travers le dialogue entre les cultures. Il est vrai que nos cercles culturels sont généralement clos, nos mentalités assez rigides pour être fléchies. Mais, l’universalisme postmoderne passe par la relativisation de nos évidences culturelles. Un dialogue sur les droits de l’homme, pour en faire un signe identitaire fort, est indispensable et ce dialogue n’est possible que lorsque nous laissons tomber nos rigidités pour avancer vers l’autre. Ce dialogue devra avoir lieu dans l’entre-deux des « territoires » culturels.
Références bibliographiques
BARRET-KRIEGEL Blandine, 1996, Cours de philosophie politique, Paris, Librairie Générale Française.
BERTHOUD Gérard, 1992, Vers une anthropologie générale. Modernité et altérité, Berne, Librairie Droz.
BOBBIO Noberto, 1998, Essai de théorie du droit, Paris, LGDJ.
CALOGERO Guido, 1974, Il fondamento dei diritti dell’uomo » in La Cultura, 1974.
EBERHARD Christoph., 2002, Droits de l’homme et dialogue interculturel, Paris, Editions des Écrivains, 2002.
FUKUYAMA Francis, 2001, « Natural Rights and Natural History » in The National Interest, été, p. 13-32.
GAUCHET Marcel, 2002, « Les tâches de la philosophie politique », revue Mauss, premier semestre, p. 101-122.
GUIMBO René, 1997, Les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant.
HABERMAS Jürgen, 1998, L’intégration républicaine, Paris, Fayard.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 2004, Encyclopédie des sciences philosophiques, tome 2 : Philosophie de la nature, Paris, Ellipses [1817].
HOUNSOUNON-TOLIN Paulin, 2017, Droits de l’homme et droits de la femme, Paris, l’Harmattan.
KANT Emmanuel, 1990, Fondement de la métaphysique des mœurs, Paris, Vrin.
KELSEN Hans, 1998, Théorie pure du droit, Boudry-Neuchâtel, Éditions de la Baconnière.
LEVINET Michel, 2006, Théorie générale des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant.
LACLAU Ernesto, MOUFFE Chantal, 1986, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London / New York, Verso, 1986.
LE ROY Etienne, 1997, « L’hypothèse du multijuridisme dans un contexte de sortie de modernité » in
LE ROY Etienne, 1998, « Logique institutionnelle et logique fonctionnelle, de l’opposition à la complémentarité », Tessier Stéphane (éd.), A la recherche des enfants des rues, Paris, Karthala.
MARTINEZ Barba Peces Gregorio, 2004, Théorie générale des droits fondamentaux, Paris, LGDJ.
MAYOR Federico, 1997, Le droit de l’être humain à la paix, déclaration du Directeur Général de l’UNESCO, SHS-97/WS/6, p. 3.
MOURGEON Jacques, 1981, Les droits de l’homme, Paris, PUF.
PANIKKAR Raymond, 1984, « La notion des droits de l’homme est-elle un concept occidental ? », Interculture, vol. XVII, n°1, Cahier 82, p. 3-27.
POPPER Karl, 1979, La société ouverte et ses ennemis, Paris, Seuil.
RIVERO Jean, 1980, Les droits de l’homme, droits individuels ou droits collectifs ? Actes du colloque de Strasbourg des 13 et 14 mars 1979, Paris, LGDJ.
SUDRE Frédéric, 2001, Droit international européen des droits de l’homme, Paris, PUF.
TCHOUANG-TSEU, 1997, Œuvre complète, Saint Amand, Gallimard/UNESCO.
VACHON Robert, 1997, « Le mythe émergent du pluralisme et de l’interculturalisme de la réalité », Conférence donnée au séminaire : Pluralisme et société, Discours alternatif à la culture dominante, séminaire organisé par l’Institut Interculturel de Montréal le 15 février.
VACHON Rober, 2000, « Au-delà de l’universalisation et de l’interculturation des droits de l’homme, du droit et de l’ordre négocié », Bulletin de liaison du LAJP, n°25, p. 9-21.
VANDERLINDEN Jacques, 1989, « Return to Legal Pluralism, Twenty Years Later » Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, n° 28, 149-157.
CONSÉQUENCES SOCIALES DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE VIRUS ÉBOLA EN CÔTE D’IVOIRE
1. Noel Kouadio AHI
Institut National de Santé Publique, Abidjan (Côte d’Ivoire)
2. Antoine DROH
Institut National de la Jeunesse et des Sports, Abidjan (Côte d’Ivoire)
3. Djané dit Fatogoma ADOU
Institut National de Santé Publique, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Résumé :
La maladie à virus ébola survenue en Afrique de l’Ouest constitue un enjeu majeur de santé publique au regard du nombre de décès qu’elle a occasionné selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Vue sa proximité géographique avec les pays affectés, la Côte d’Ivoire a adopté les mêmes mesures de lutte contre cette épidémie que ces pays. La présente recherche s’intéresse aux conséquences sociales induites par les mesures préventives relatives à la menace et/ou à la dangerosité de la maladie à virus ébola. Elle a pour objectif d’analyser l’implication de ces mesures sur l’organisation et le fonctionnement social des communautés locales. Elle s’appuie sur une enquête mixte (quantitative et qualitative). L’analyse des données s’est faite sur la base des théories de l’habitus de P. Bourdieu et des représentations sociales de D. Jodelet pour aboutir aux résultats suivants : les mesures préventivesontd’une partmodifié le rapport à l’hygiène de façon mitigée et peu durable et d’autre partentrainé des formes de conflictualité entre les acteurs en présence.Egalement, elles ontformaté des imaginaires sociaux négatifs vis-à-vis de la maladie à virus ébola.
Mots clés : Conséquences sociales, mesures préventives, virus Ebola, Côte d’Ivoire.
Abstract:
The diseases with virus ébola arisen in western Africa establish a major stake in public health with regard to the number of deaths which she caused according to the World Health Organization. Seen his geographical closeness with the affected countries, Ivory Coast adopted the same measures of fight against this epidemic as these countries. The present research is interested in the social consequences led by the precautionary measures relative to the threat and/or to the dangerousness of the disease with virus Ebola. It has for objective to analyze the implication of the measures on the organization and the social functioning of the local communities. She leans on a mixed investigation (quantitative and qualitative). The data analysis was made on the basis of the theories of the habit of P. Bourdieu and social representations of D. Jodelet to end in the following results: the precautionary measures modified on one hand the report in the hygiene in a reserved and little long-lasting way and on the other hand entrained of the forms of confliction between the actors in presence. Also, they formatted negative social imagination towards the disease with virus Ebola.
Keywords : Social consequences, precautionary measures, Ebola virus, Ivory Coast.
Introduction
Les maladies virales les plus indexées au plan médical et au plan des média, sont le Vih/sida, les hépatites et plus récemment la maladie à virus ébola. Cette maladie est apparue en Afrique pour la première fois de façon simultanée en 1976 à Nzara au Soudan et à Yambuku en République Démocratique du Congo. Elle tire son nom de la rivière Ebola située à proximité de Yambuku (OMS, 2014). Par la suite, elle s’est signalée au Gabon (1994, 1996 et 2001), au Congo (2001 et 2003) et en Ouganda (2000 et 2007). L’épidémie qui a concerné les pays de l’Afrique de l’ouest (Guinée, Libéria, Sierra Léone et Nigeria) de 2013 à 2016 a été la plus meurtrière depuis sa découverte. L’on a enregistré environ 28616 cas (suspects, probables et confirmés) et elle a provoqué 11310 décès dans les quatre pays (OMS, 2016). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la maladie à virus ébola constitue une urgence de santé publique de portée mondiale.
Face à cette situation, diverses réponses politiques et médico-sociales ont été mises en place. Il s’agit d’une intervention d’un genre nouveau au regard des réponses locales. L’introduction de nouvelles manières de faire a entrainé des modifications aussi bien dans les pratiques, dans les imaginaires que dans les statuts et positions. En effet, une forte résistance à l’égard de la lutte contre le virus a vu le jour entrainant une violence verbale et physique. Une théorie populaire s’est répandue, associant les autorités, les équipes soignantes et les ONG dans un sombre complot pour diffuser l’affection et prélever les organes des malades (A. Desclaux et M. Egrot, 2016).
A l’image des pays touchés, la Côte d’Ivoire a formulé les mêmes réponses pour parer à toutes éventualités. Car le risque de contamination de la population était élevé du fait de sa proximité géographique avec les pays affectés et de la forte porosité de ses frontières. En plus, la zone Ouest du pays a été fortement impactée par la crise militaro-politique de 2002 à 2011. Elle a eu pour effets corollaires, des déplacés internes et externes, la fragilisation des infrastructures sanitaires et sécuritaires et des besoins humanitaires urgents (D. Adou, 2016).
Fort de ce constat, cet article s’intéresse particulièrement aux conséquences des dispositifs et politiques de prévention contre la maladie ébola sur la vie sociale des populations urbaines et rurales. Il s’agit d’une recherche socio-anthropologique qui met en évidence d’une part, la manière dont la population s’est appropriée ces dispositions et pratiques sociales induites, et d’autre part, comment celles-ci ont impacté la vie sociale dans les milieux à l’étude.
L’objectif de l’étude est d’analyser les conséquences sociales des mesures de lutte contre le virus Ebola en Côte d’Ivoire. En d’autres termes, il s’agit de : i) décrire les pratiques sociales observées face au virus Ebola ; ii) déterminer les types de rapports sociaux entre les acteurs en présence ; iii) identifier les imaginaires sociaux sur la maladie à virus ébola en Côte d’Ivoire.
Méthodologie
L’étude s’est intéressée aux localités de Tabou, Man, Odienné et Abidjan (les communes de Yopougon et Abobo). Pour le choix de ces localités, nous avons tenu compte de leur position géographique par rapport aux pays limitrophes de la Côte d’Ivoire concernés par l’épidémie à virus ébola. Le choix d’Abidjan s’explique par le fait que cette ville est la plus peuplée de Côte d’Ivoire et accueille tous les jours des personnes venant d’horizons divers. En plus, toutes les décisions de lutte contre cette maladie (prise en charge médicale, mesures préventives, stratégies de communication, etc.) ont été prises par les autorités étatiques à partir d’Abidjan. Et c’est de là que les messages de lutte sont transmis à la population par l’entremise des medias (radio, télévision, journaux), internet, etc.
La démarche méthodologique a consisté en une approche mixte (quantitative et qualitative) à dosage équivalent. Les outils de collecte des données ont été constitués à l’aide des ouvrages de R. Quivy et L. V. Campenhoudt (2013) et de N. Berthier (2010).
Le volet quantitatif de l’étude cherche à mesurer le niveau d’influence des dispositions institutionnelles, normatives et pratiques associées à la prévention de la maladie à virus ébola sur la population.
La technique d’échantillonnage était celle du choix raisonné. Le questionnaire a concerné les chefs de ménage ou toute autre personne âgée de 18 ans et plus dans le ménage. Il était constitué des thématiques suivantes : les caractéristiques sociodémographiques, les représentations sociales du virus Ebola et les implications des mesures préventives sur le corps social. Nous avons interrogé au total 500 personnes en raison de 100 par zone d’étude.
Quant à l’aspect qualitatif, des entretiens individuels de type semi-directif ont été réalisés. Les acteurs concernés étaient composés de dix personnels de santé, cinq membres de la notabilité traditionnelle, cinq leaders religieux, cinq responsables du système éducatif, trois membres des groupements associatifs, trois praticiens de la médecine traditionnelle, trois commerçants et de dix restauratrices.
En outre, cinq focus groups ont été réalisés. L’objectif de ces échanges de groupes était de reproduire une microsociété pensante proche de la réalité sociale et favoriser le discours des sujets en leur proposant des dilemmes (S. Caillaud, 2010). Ils offrent une possibilité de développer des méthodes de recherches fondées sur les dynamiques de la communication, du langage et de la pensée. Les participants confrontent leurs idées, les laissent se heurter dans des polémiques ouvertes ou cachées, dans des dialogues internes ou externes, les uns avec les autres (I. Markova, 2004). Ils nous ont permis de comprendre en profondeur les attitudes ou comportements des participants à l’égard des mesures de prévention contre la maladie à virus ébola.
Nous avons également utilisé l’enquête par observation directe/immersion à l’aide d’une grille d’observation composée d’éléments suivants : la présence de dispositif de lavage des mains dans les structures ou institutions publiques ou privées et religieuses, ne pas se serrer les mains et/ou se faire des accolades, le port systématique des gants par les agents de santé pour les consultations et/ou les soins des malades, la disponibilité de solutions hydro alcooliques dans les services administratifs et son usage pour la désinfection des mains, la non commercialisation de la viande de brousse dans les restaurants et ménages, l’application des mesures d’hygiène lors des grands rassemblements, etc.
Les données recueillies à partir de ces différents outils ont été traitées à l’aide du logiciel épi data (volet quantitatif) et analysées à partir de l’analyse de contenu en procédant par le repérage des idées significatives et leur catégorisation (L. Negura, 2006). Les modèles théoriques mobilisés sont la théorie de l’habitus de P. Bourdieu (1980) et celle des représentations sociales de D. Jodelet (1994). Ce qui nous a permis d’obtenir les catégories analytiques ci-après.
Résultats
1. Les pratiques sociales observées face à la maladie à virus Ebola.
L’étude a montré que les mesures préventives contre l’épidémie à virus ébola instaurées par l’Etat pendant la période épidémique dans les pays touchés ont modifié le rapport de la population à l’hygiène de façon mitigée et peu durable. Elles étaient motivées par la crainte de cette maladie qui occasionnait de nombreux décès. L’observation de ces mesures était sélective et concernait beaucoup plus les fluides et les gestes du corps (hygiène quotidienne, salutations, éternuement, mouchage, contacts avec les malades, pratiques funéraires, etc.). Elle s’est faite aussi bien au niveau individuel que collectif.
1.1. Les mesures individuelles de prévention contre ébola
L’étude a révélé que les mesures individuelles observées par les enquêtés ont concerné l’interdiction de se serrer les mains et/ou de faire des accolades, l’utilisation régulière des hydro alcooliques pour les mesures hygiéniques. Ces mesures individuelles ont été observées tant au niveau de la cellule familiale, en milieu de travail que dans la vie courante.
Ainsi, 85 % des populations enquêtées ont-elles affirmé qu’elles ne se serraient pas les mains ni ne se faisaient pas d’accolades pour les salutations. Pendant la période de crise de cette maladie dans les pays voisins, les modes opératoires utilisés pour les salutations étaient les mains levées, l’abaissement de la tête ou le croisement des bras ou encore l’inclinaison du corps en avant selon les enquêtés. Par ailleurs, l’étude a révélé que 99 % des enquêtés utilisaient régulièrement soit du savon, soit de l’eau de javel ou une solution hydro alcoolique pour se laver les mains. Au cours de l’étude, 76 % des enquêtés possédaient des produits de désinfection des mains dans leur habitation. Ces règles de prévention de la maladie sont enseignées aux enfants pour qu’ils les observent partout où ils se trouveraient. L’on a observé que certaines personnes surtout les femmes, les mettaient dans leurs sacs de sortie ou de travail, tandis que d’autres les déposaient dans leur véhicule personnel pour les utiliser au cas échéant. En témoignent les propos de cet enquêté :
« Chaque fois que je sors, j’ai mon petit pot de solution hydro-alcoolique que j’utilise. Quand, je voyage, je l’ai sur moi. Je l’ai sur mon bureau de sorte que les gens qui me rendent visite l’utilisent. Je recommande à mes enfants d’en faire autant ».
Parallèlement à ces mesures individuelles, des dispositions collectives ont été mises en place pour la lutte contre la maladie à virus ébola.
1.2. Les dispositions collectives de lutte contre ébola
L’étude a montré qu’en plus des mesures individuelles, des actions collectives de prévention contre cette maladie ont été menées dans les institutions publiques, privées, religieuses, etc. Ainsi, a-t-on noté qu’en dehors des habitations, les populations utilisaient systématiquement des solutions hydro alcooliques dans les lieux publics et lors des grands rassemblements. Cela a entrainé une ruée des populations dans les marchés et magasins de vente de ces produits.
Des dispositifs pour le lavage régulier des mains ont été mis en place dans des institutions notamment scolaires et sanitaires à la suite des campagnes de sensibilisation. Les usagers de ces institutions ont été formés à l’utilisation de ces points d’eau et aux techniques de lavage des mains. En plus, le port systématique de gants était exigé au personnel dans les services d’urgences. La majorité des agents de santé était habité par un sentiment de peur en raison du risque d’exposition qui était permanent. A ce propos, un enquêté a révélé qu’une information sur la présence d’un cas suspect dans un hôpital, a entrainé l’abandon du service par le personnel. Après les examens médicaux, ce cas s’est avéré négatif.
Par ailleurs, ces mesures de prévention de la maladie à virus Ebola ont remis en cause l’importance de certains rituels religieux comme le fait de se serrer la main et l’utilisation collective d’objets ou produits religieux, etc., avant, pendant ou à la fin des cérémonies. En effet, chez les chrétiens catholiques, au cours de la célébration des messes, il y a un temps où les prêtres demandent aux participants de se serrer les mains. Ce geste marque l’amour, la paix entre les fidèles. De même, chez les musulmans, à la fin de la prière, les fidèles se serrent la main. Mais, pour le respect de ces mesures de prévention, ces pratiques étaient déconseillées par les leaders religieux. Pour l’application de ces mesures, les prêtres catholiques ont reçu de leur hiérarchie des directives instituant de nouvelles dispositions pour la célébration des messes.
Comme s’exprimait l’un d’eux en ces termes :« On ne fait plus l’échange de la paix du Christ. On l’a remplacé par « Dieu nous protège ». Les fidèles et les prêtres ne se serrent plus les mains entre eux ».
Un autre ajoutait ceci : « l’Eucharistie ne se donne plus dans la bouche ».
Quant à l’interdiction de chasser et/ou de consommer la viande de brousse, les autorités administratives, les agents de sécurité, les chefs des villages et les leaders communautaires ont été chargé du suivi strict du respect de cette mesure. A cet effet, l’on a enregistré la fouille des restaurants à la recherche de viande de brousse.
Ces différents faits relatés montrent que les populations (89 %) ont suivi l’application des mesures de prévention contre la maladie à virus dans les zones d’enquête. En revanche une frange de la population soit 11% ne l’a pas respecté. Cela est dû aux différents rapports de conflit entre les acteurs impliqués dans l’application de ces mesures préventives et aux imaginaires sociaux liés à cette maladie. Bien que la grande partie de la population ivoirienne ait cessé de continuer ces pratiques de prévention, certaines structures ont maintenu le dispositif de lavage des mains depuis la déclaration de la fin de l’épidémie dans la sous-région ouest africaine.
2. Le formatage de rapports sociaux entre acteurs en présence lié à l’application des mesures préventives du virus Ebola
L’application stricte des mesures préventives de la maladie à virus Ebola dans les zones d’étude était confrontée à des contraintes structurelles (culturel, économique et politique). Elles ont occasionné des rapports sociaux conflictuels ou de méfiance ou de rejet dans la société.
2.1. La culture, élément d’obstacle au respect des mesures de prévention du virus ébola
L’étude a montré que la culture a eu une influence sur le respect ou non des mesures préventives d’ébola. Si ces mesures ont été respectées par une grande majorité de la population pendant la période d’épidémie d’Ebola dans les pays voisins, force est de constater qu’elles étaient moins appliquées au moment de l’enquête. Selon les enquêtés (47%), elles sont sources de conflits dans certaines familles et/ou au sein de la population car non conformes aux normes sociales qui sont ancrées. En effet, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, l’interdiction de se serrer les mains et/ou de faire des accolades n’a pas été respectée par une frange de la population (11%). Pour l’ensemble des populations interrogées, cette manière de se saluer fait partie intégrante des habitudes de vie. Elle traduit l’expression de la fraternité et la manifestation symbolique de marque de considération, d’entente, de pardon mutuel. Cela est enseigné aux enfants aussi bien dans la cellule familiale qui constitue le premier lieu d’apprentissage des normes sociétales (S. Dédy et G. Tapé, 1995) que dans l’ensemble des communautés.
Ainsi, la manière de saluer quelqu’un détermine-t-il le type de relation qui lie deux personnes. Lorsque l’on s’abstient de faire ces rites de salutation, cela peut être vécu par autrui comme une frustration, une humiliation et peut détériorer la qualité des relations interindividuelles. A titre d’exemple, un enquêté a expliqué que lorsque l’on rend visite à un proche, il est d’usage de se serrer les mains pour les salutations. De même, quand l’on est de retour d’un voyage, il doit tendre la main ou faire des accolades pour saluer les parents et amis. C’est la manifestation de sentiment de joie pour les retrouvailles. Le refus d’exécuter ces rites de salutations est donc contraire aux habitudes et normes de la population. L’on traite alors la personne qui a commis cet acte de personne « imbue » ou de personne « gonflée », oud’« impolie » ou encore d’« irrespectueuse». Cela a provoqué parfois chez des individus un sentiment de frustration et de rejet ou de stigmatisons et suscité des tensions sociales au sein des communautés. Ainsi, plusieurs cas de figure se sont-ils produits dans les zones visitées pendant la période d’épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest selon les répondants. En témoignent les propos d’une enquêtée :
« Un jour, j’ai rencontré l’une de mes meilleures que je considère comme une sœur. Et tellement j’étais contente de la voir, je lui ai tendu ma main pour la saluer, elle a reculé et m’a dit : « y a Ebola ! ». Je suis restée là, inerte en la regardant. J’ai insisté mais elle a refusé de me serrer la main. Mais cette dame-là, je ne vais plus jamais lui serrer la main jusqu’à ma mort parce que je me suis sentie humiliée ».
Un autre disait ceci :
« Je suis allé au village pour voir les parents. A mon arrivée, comme d’habitude, je passe saluer les proches dans les cours. Chemin faisant, je croise un cousin et je lève mes bras pour le saluer. Il rétorque, mais salue-moi !!! Y a quoi !!! Ça fait combien de temps on ne s’est pas vu ou bien … ? Et lorsque je lui ai expliqué la situation, il m’a répondu, est-ce que je ressemble à quelqu’un qui est malade ? Et il est parti tout furieux »
Les propos de ces enquêtés montrent bien que le respect de l’interdiction de ces actes gestuels qui constituent les artefacts culturels du langage peut détériorer la qualité des relations qui lient les populations. Donc, l’application stricte de cette mesure n’a pas été suivie par un grand nombre d’enquêtés (83%) ou s’est faite sous un sentiment de contrainte ou de résignation vue son caractère symbolique dans la société ivoirienne.
Comme le reconnaît un enquêté dans ces propos : « Honnêtement pour les salutations, c’est difficile, je recommence à saluer les gens avec ma main ».
2.2. Le respect des mesures de lutte contre Ebola comme obstacle à la pratique d’activités économiques
L’étude a révélé que la prévention de la maladie à virus Ebola a eu un impact négatif sur les activités économiques des commerçants. En effet, ces derniers ont révélé que les activités commerciales entre la Côte d’Ivoire et les pays voisins touchés par cette maladie ont baissé suite à la fermeture des frontières de la Côte d’Ivoire avec ces pays. A ce propos, une commerçante disait ceci :
« Les temps sont durs actuellement, je fais du commerce international, on ne peut plus aller dans ces pays pour des achats à cause d’Ebola, on attend que le gouvernement annonce que c’est fini, on va reprendre ».
En outre, l’interdiction de la chasse aux animaux et de la consommation de la viande de brousse a fortement touché le secteur de la restauration en Côte d’Ivoire. En effet, avant la survenue de la maladie à virus Ebola, la viande de brousse occupait une place de choix dans le tissu économique. Son commerce impliquait des spécialistes de la chasse, des revendeurs, les restaurateurs et les consommateurs.
L’on rencontrait de nombreux restaurants spécialisés dans la vente de viande de brousse tant en milieu urbain que rural. Ces structures de restauration employaient une main d’œuvre relativement importante. D’autres activités se développaient aussi autour de ces lieux. En occurrence des vendeurs ambulants de différentes sortes d’articles (les cireurs de chaussures, objets électriques, etc). L’interdiction de consommer la viande de brousse a entrainé la baisse des recettes de la majorité de ces structures ou la fermeture d’autres alors qu’elles reversaient des taxes à la municipalité en milieu urbain. Ce qui a eu pour effet corolaire, la mise au chômage d’office de ces acteurs impliqués dans cette activité dans des zones d’enquête comme à Abobo PK 18 et yopougon ciporex, réputées pour la commercialisation de la viande de brousse. Par ailleurs, cette mesure a bouleversé les habitudes alimentaires des populations rurales visitées car elles pratiquaient la chasse aux animaux pour assurer leurs besoins en protéine. Son interdiction a occasionné un déficit en protéine dans ces milieux. L’on a assisté à un moment donné à une accentuation de la pauvreté et à un déséquilibre nutritionnel. Cela a provoqué un sentiment de dépit de certaines personnes envers l’Etat. Car, une frange des enquêtés (47%) ne croyait pas à la version de l’Etat quant à la transmission du virus par la viande de brousse. Les principaux acteurs de cette activité (restaurateurs, chasseurs, revendeurs) accusaient l’Etat de les avoir appauvris.
En dehors des contraintes culturelles et économiques qui ont influencé l’application de ces mesures préventives, l’on a noté l’apparition d’autres types de relations sociales à caractère politique au sein des populations. Il s’agit de rapport de méfiance, de raillerie ou de rancœur et de sentiment de rejet.
2.3. Lutte contre ébola source de tensions sociales
Les mesures de lutte contre le virus ébola instaurées par l’Etat ont fait ressurgir les tensions sociales au sein des communautés. Elles pouvaient s’observer soit entre les populations ivoiriennes, soit entre les communautés ivoiriennes et les ressortissants venus des pays touchés par la maladie, ou encore entre les populations locales et les occidentaux. En effet, dès les premiers moments de la survenue de l’épidémie à virus ébola en Afrique de l’ouest, les pouvoirs publics ont procédé à la fermeture des frontières avec les pays voisins touchés pour empêcher l’entrée d’éventuels cas de malades sur le territoire ivoirien. Mais compte tenu de la porosité des frontières, des populations des villages proches des frontières procédaient elles-mêmes à la surveillance de leur localité. Les populations des zones d’étude étaient en majorité méfiantes des ressortissants des pays confrontés à la maladie qui venaient d’arriver dans leur milieu. Elles avaient développé des comportements de suspicion à l’égard de ces personnes.
Au niveau politique, la gravité de cette maladie et les mesures de prévention préconisées par l’Etat, ont fait ressurgir un tant soit peu les tensions politiques qui existaient après la crise post-électorale de 2011 dans certaines régions. En effet, pour certains sympathisants des partis politiques de l’opposition, les tenants du pouvoir actuel sont responsables de ces rumeurs d’Ebola en Côte d’Ivoire. Ils les accusaient d’être de connivence avec les “blancsʺ pour le complot de destruction de ce pays. Comme en témoignent les propos d’un leader communautaire :
« Depuis que la Côte d’Ivoire existe, il n’y a pas eu de maladie comme ça ici avec les présidents Houphouët, Bédié, Guéi et Gbagbo. Mais pourquoi c’est maintenant qu’on nous parle de cette maladie. Mon frère, il faut juger toi-même… ».
Un autre enquêté renchérit : « Mon frère, ils sont incapables de nous protéger. Depuis qu’ils sont au pouvoir, il n’y a que des problèmes dans le pays ».
Par contre, les sympathisants du pouvoir actuel ont affirmé que le fait qu’il n’y ait pas encore de cas d’Ebola dans le pays montre la “puissanceʺ et la capacité des gouvernants actuels à faire face aux problèmes sociaux. Ils manifestent leur soutien et leur admiration aux autorités comme l’atteste ces propos : « Tant que le président Ouattara sera là, il n’y aura pas d’Ebola en Côte d’Ivoire. Il a payé l’amende aux blancs !».
L’enquête a révéléune réapparition des rancœurs et des tensions entre les sympathisants des partis politiques. Les uns soutiennent être les meilleurs gestionnaires du pays et les autres accusent leurs adversaires d’être responsables de tous les malheurs qui s’y abattent. Cela a donné lieu souvent à des railleries ou moqueries ou à la colère de certaines personnes au sein des communautés. L’on note donc que la maladie à virus Ebola a mis la société toute entière dans une situation d’angoisse ou de stress qui pourrait avoir une incidence sur l’état de santé de la population car il constitue un facteur de risque des maladies cardiovasculaires (N. Ballon, 1994). Ces rapports sociaux relevés ci-haut montrent que les populations enquêtées ont des imaginaires sociaux négatifs sur la maladie.
3. Des imaginaires sociaux négatifs sur la maladie à virus ébola
L’étude a montré que les populations enquêtées ont des représentations sociales de cette maladie qui seraient à la base des rapports sociaux conflictuels. Elles concernent les causes supposées de cette maladie qui seraient d’origine divine ou liées à un complot.
3.1. Ebola comme une conséquence de la colère des dieux
Les données de l’étude nous ont montré que les causes de cette maladie seraient d’ordre divin selon les enquêtés. Pour certains (24 %), la survenue de la maladie à virus Ebola est due à une transgression des lois prescrites par Dieu. Et pour d’autres (22%), elle est la résultante du non-respect des normes qui régissent la société.
En effet, pour les partisans de ces idéologies, Ebola est une “punition de dieuʺ ou la manifestation du mécontentement de Dieu. Ils soutiennent cette idée par le fait qu’il y aurait trop de vices dans le monde et surtout en Afrique. Au nombre de ces maux, l’on note que les “blancs″ veulent imposer aux pays africains la légalisation de l’homosexualité comme chez eux par l’entremise des chefs d’Etats africains. A cela s’ajoutent les nombreuses guerres en Afrique avec leurs corolaires de tueries, la dépravation des mœurs, etc. En témoignent ces propos d’un enquêté :
« Vous voyez ! Aujourd’hui, il y a des guerres partout en Afrique et les gens meurent. L’homme ne représente plus rien, on le tue comme un animal. Dieu n’aime pas ça ! C’est pour ça qu’il a amené cette maladie pour nous frapper et nous remettre en cause »
Une autre renchérit :
« Tu vois, regarde l’habillement des jeunes, tout leur corps est dehors. En plus, comment peut-on demander à deux personnes de même sexe de se marier. Et les africains copient bêtement ce que les blancs font chez eux. Il n’y a plus de moral ici. Et tu penses que Dieu va nous pardonner ! Non !».
Pour d’autres, la colère de Dieu viendrait du fait que l’intervention des “blancs″ dans la crise post-électorale de 2011 a occasionné de nombreux décès. Elle est perçue par ces derniers comme une injustice. La survenue d’Ebola est donc un signe annonciateur de cette colère et d’une punition, comme l’a affirmé un enquêté : « C’est parce qu’ils ont tellement fait du mal aux ivoiriens que “dieuʺ est en train de les punir ».
3.2. De l’Ebola à la théorie du complot contre les africains
L’enquête nous a révélé que des enquêtés (46%) ont des imaginaires sociaux négatifs sur les causes de l’épidémie à virus ébola. En effet, ils affirment que cette maladie est due à un complot ou à une machination ou encore à une invention des occidentaux.
Pour ces enquêtés, la maladie à virus Ebola est l’émanation du « mauvais » comportement des pays occidentaux envers l’Afrique. Certains (32%) la définissent comme une ̎”arme chimique ou une invention des occidentaux pour piller les ressources naturelles et économiques des pays africains afin de les maintenir dans leur statut de pauvreté”. Tandis que pour d’autres (14%), “Ebola est la destruction de l’Afrique ou une invention de microbes par les occidentaux pour réduire le nombre de la population africaineʺ.
Pour ces enquêtés, les occidentaux sont les vraies responsables de la survenue de cette maladie en Afrique de l’Ouest. De ce fait, les causes du virus ébola seraient venues d’ailleurs et non de leur milieu. Ce sont les “blancsʺ qui ont introduit le virus Ebola dans les forêts pour des expérimentations sur les animaux. Egalement, ils affirment que l’apparition de cette maladie est due aux enjeux démographiques, migratoires et économiques dans cette zone d’Afrique. En effet, ils expliquent cela par le fait que la population africaine devenant de plus en plus nombreuse, les occidentaux ont trouvé la maladie à virus ébola comme moyen de contrôle afin de réduire le flux migratoire en Europe. Aussi, est-elle utilisée comme un moyen de pression des pays occidentaux sur les pays africains pour les contraindre à signer des contrats d’exploitation de leurs ressources économiques. Et une fois que cela est fait, ils manifestent leur compassion à leur égard par leur élan de solidarité en apportant des aides alimentaires et des moyens de lutte contre cette maladie. Comme le soulignent ces propos d’un enquêté :
« C’est du mensonge, est-ce que les animaux peuvent parcourir toute cette distance depuis l’Afrique centrale pour venir dans notre localité ? Ce n’est pas du tout vrai. Ils ont fabriqué leur maladie là-bas et nous l’ont apportée pour nous appauvrir. Après, ils font comme s’ils nous aiment en nous apportant des médicaments et des supposés docteurs qui sont en réalité des militaires pour contrôler nos pays. Mais pendant ce temps les gens sont morts !!! Vraiment, les “blancsʺ sont méchants ».
Ces faits montrent que les enquêtés ont des imaginaires sociaux négatifs sur Ebola qui seraient à l’origine de la structuration des rapports sociaux entre les acteurs impliqués dans sa prévention.
Discussion
Cette discussion est structurée autour des pratiques sociales de lutte contre Ebola observées, des représentations sociales de cette maladie et des rapports sociaux engendrés par ces mesures.
A l’analyse des données, l’étude a montré qu’une grande partie des enquêtés dit avoir respecté les mesures préventives contre Ebola. Cependant, elle les a trouvées contraignantes car opposées à leur habitus.
Selon P. Bourdieu (1980),un habitus est « un système de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente des fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre ».
Il forme un patrimoine social et culturel qui s’exprime dans les pratiques quotidiennes (P. Bourdieu, 2000). Ces pratiques sociales et culturelles ont été acquises au cours de la prime éducation et des premières expériences sociales (A.C. Wagner, 2012). Cet auteur explique que l’individu est structuré par sa classe sociale d’appartenance, par un ensemble de règles, de conduites, de croyances et de valeurs propres à son groupe. Ces dispositions sont relayées par la socialisation. L’étude montre que les mesures de prévention constituent des éléments de déséquilibre du milieu social car les habitussont des principes structurant la cohésion de la société dans son ensemble. Puisque leur production et leur reproduction respective nécessitent l’adhésion de tous les membres, impliqués dans des relations de complémentarité ou d’opposition (T. Ledru, 2012). En effet, le respect de ces instructions exige une renonciation à certaines pratiques culturelles (accolades, se serrer les mains, la chasse, consommer la viande de brousse) que la communauté interprète comme un comportement de déviance par rapport aux normes de la société.
Pour exister comme question sociale, la déviance suppose la réunion de trois éléments : une norme, une transgression à cette loi et une « réaction sociale » à la transgression de celle-ci qui peut se traduire par un rejet ou une punition, une malédiction ou une maladie (L. Mucchielli, 2014).
Pour être conformes aux règles sociales, des populations ont continué certaines attitudes habituelles. C’est le cas des rites funéraires. En effet, l’étude a montré que les rassemblements pour les veillées funèbres, l’exposition des corps des défunts et les enterrements se faisaient de la même manière qu’avant l’annonce de ces mesures de prévention tant en milieu urbain que rural. Cela était lié à des pesanteurs culturelles.
Par ailleurs, des enquêtés ont affirmé que la chasse se pratiquait dans les localités éloignées des villes et villages. Pour éviter de se faire repérer par les autorités ivoiriennes, les populations ont initié des stratégies de contournement contre cette interdiction. Les chasseurs et les commerçants ne vendaient plus la viande de brousse dans les endroits publics ou lieux habituels. Ils la vendaient par personnes interposées et elle se consommait dans des habitations dans le strict secret. En témoignent les propos de cet enquêté : « la chasse aux animaux continue. Très souvent, on voit des individus allés dans les champs avec leur fusil caché dans des sacs ».
Egalement, les populations ont adopté une stratégie de camouflage ou de dissimulation en désignant la viande de brousse par le nom ébola.
En plus des contraintes sociales, les populations ont des représentations sociales sur cette maladie qui seraient un obstacle à la mise en œuvre des mesures de lutte. En effet, bien qu’une partie de la population ait respecté les méthodes de prévention, bon nombre d’enquêtés attribuaient cette maladie au surnaturelle. Cela est conforme aux études de (F. H. Mémel, 1998 et D.M. Gadou, 1995) sur les représentations sociales de la santé. En effet, selon ces auteurs, chaque peuple a ses représentations sociales de la maladie.
Pendant que certains attribuent la cause à des agents pathogènes, d’autres incriminent l’entourage, la transgression des normes de la société (non-respect des aînés, de la culture, etc.) ou à une loi divine (C. Herzilich et M. Auge, 1994). Les représentations sociales sont des formes de connaissances, socialement élaborées et partagées, ayant une visée pratique et concourent à la construction d’une réalité commune à un groupe social (D. Jodelet, 1994). Dans ce sens, l’étude a révélé que des enquêtés interprètent les causes de l’épidémie ébola comme un châtiment de Dieu qui est la conséquence de la dépravation des mœurs, des tueries occasionnées pendant la crise, etc. Les représentations sociales sont une forme d’expression sociale et culturelle (G. Ferréol, 1995).
Par ailleurs, d’autres liaient sa survenue à un complot ou machination des occidentaux à cause des enjeux économiques. Ils sont considérés à tort ou à raison comme responsables de la survenue de cette maladie en Afrique de l’Ouest pour maintenir cette zone dans un statut de dépendance envers ces « bourreaux ». Ces données confirment celles de (D. M. Amalaman, T-O. Gakuba et S. Ouattara, 2017) qui mettent en cause les occidentaux dans la survenue du virus Ebola en Guinée. Dans leur étude, les enquêtés ont affirmé que ceux-ci agiraient de connivence avec les autorités du pays, les partenaires et acteurs humanitaires impliqués dans la riposte contre Ebola. Ils s’enrichiraient sur le dos de la population, d’où l’idée répandue « d’Ebola business ».
Ainsi, les imaginaires sociaux d’Ebola et les pratiques de lutte contre cette maladie, ont-ils structuré des rapports sociaux de conflit, de méfiance, de suspicion, d’antipathie ou de rejet au sein de la société. Ces mesures viennent bouleverser des normes sociales. Cela est semblable aux études de D.M. Amalaman, T-O. Gakuba et S. Ouattara (2017), de J. Anoko (2015) et d’A. Desclaux et M. Egrot (2016) qui ont révélé que la lutte contre cette maladie en Guinée a engendré des tensions sociales entre la population et les acteurs de lutte.
Conclusion
L’étude avait pour objectif d’analyser les conséquences sociales de la lutte contre le Virus Ebola en Côte d’Ivoire. Elle a permis de comprendre les transformations de la vie sociale dans l’application des mesures préventives contre Ebola. Elle a contribué à relever le vécu et les représentations socioculturelles des individus pour mieux saisir le sens de leurs réactions en réponse aux mesures préventives du virus Ebola. L’on note que quand bien même, il n’y aurait pas eu de cas avéré de cette maladie en Côte d’Ivoire, la lutte contre ce fléau a suscité des controverses dans la société.
L’étude a montré que dans ces milieux, l’instauration des mesures de lutte contre cette maladie a entrainé des modifications aussi bien dans les pratiques, les imaginaires sociaux que dans les relations sociales.
Ces dispositions ont modifié le rapport de la population à l’hygiène de façon mitigée et peu durable. Elles ont formaté des imaginaires sociaux négatifs vis-à-vis de la maladie à virus ébola. Ces imaginaires sociaux négatifs sur Ebola, associés aux pratiques sociales de lutte contre cette maladie, ont eu pour conséquences la modification des rapports sociaux au sein de la société ivoirienne.
Cette étude a permis de comprendre le rôle prépondérant de la culture dans l’application des mesures préventives contre l’épidémie à virus ébola. Cependant, il est nécessaire d’envisager une étude sur la question suivante : comment peut-on concilier culture et santé dans la lutte contre les maladies épidémiques en Côte d’Ivoire ?
Reférences bibliographiques
Amalaman Djedou Martin, Gakuba Théogène-Octave, Ouattara Syna, 2017, « Les enjeux socio-culturels de la lutte contre l’épidémie d’Ebola dans la Préfecture de Forécariah en Guinée Conakry », LONNIYA Revue du Laboratoire des Sciences Sociales et des Organisations de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Sciences Sociales et Humaines,Vol.1- N°1- 2017.
Adou Djané dit Fatogoma, 2016, « Transition humanitaire en Côte d’Ivoire : Idéologies et pratiques des acteurs à l’épreuve de la demande locale », Les Papiers du Fonds Croix-Rouge française, janvier 2016, n°3, 18 p.
Anoko Julienne, 2015, « Communicaton lors d’épidémie de Maladie à Virus Ebola avec des communautés révoltées en Guinée : approche anthropologique », [en ligne], Colloque EBODAKAR 2015, Dakar, 19 – 21 mai 2015. https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/ 2225/files/2014/10/150520-Communication-Julienne-N.-Anoko.pdf
Ballon Nicolas, 1994, Psychiatrie, Paris, édition Marketing, 110 p.
Berthier Nicole, 2010, Les techniques d’enquête en sciences sociales. Méthodes et exercices corrigés, Paris, Armand Colin (4e éd.)
Bourdieu Pierre, 2000, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, éditions du seuil (essais, 405), sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/habitus.pdf.
Bourdieu Pierre, 1980, Le sens pratique, Paris, éditions de Minuit 480 p.
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Le_Sens_pratique-1955-1-1-0-1.html
Caillaud Sabine, 2010, Représentations sociales et significations des pratiques écologiques : Perspectives de recherche, [VertigO] La revue électronique en sciences de l’environnement, https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2010-v10-n2-vertigo3982/045522ar.pdf
Dédy Seri Faustin et Tapé Gozé, 1995, Famille et Education en Côte d’Ivoire, Abidjan, édition des Lagunes.
Desclaux Alice et Egrot Marc, 2016, « L’intrevention anthropologique face à Ebola », Sciences au Sud. Le journal de l’IRD. N°83, Juin à Octobre 2016.
Gadou Dacouri Mathias, 1995, Dynamique religieuse et tradition en pays Dida, Thèse de Doctorat de 3ème cycle de Sociologie et d’Anthropologie de la religion, Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire, 493 p.
Ferréol Gilles, 1995, Dictionnaire de la sociologie, édition Armand Collin, Paris.
Herzilich Claudine et Auge Marc, 1994, Le sens du mal, Paris, édition des archives contemporaines, 210 p.
Jodelet Denise, 1994, Les représentations sociales, Paris, PUF.
Ledru Thierry, 2012, Habitus de Pierre Bourdieu
la-haut.e-monsite.com/blog/l-habitus-de-pierre-bourdieu.html
Markova Ivana., 2004, Langage et communication en psychologie sociale : dialoguer dans les focus groups, Bulletin de psychologie.
www.bulletindepsychologie.net/vente/achat/produit_details.php?id=304
Memel Fôté Haris, 1998, Les représentations de la santé et de la maladie chez les ivoiriens, Paris, Editions Le Harmattan « collection société africaine et diaspora », 206 p.
Mucchielli Laurent, 2014, « Déviance », Sociologie, Les 100 mots de la sociologie, consulté le 25 août 2016, URL : http://sociologie.revues.org/2469.
Negura Lilian, 2006, L’analyse de contenu dans l’étude des représentations sociales.
OMS, 2016, Rapport de situation, maladie à virus ébola, 26 mai 2016,
http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports.
OMS, 2014, « Maladie à virus Ebola : informations générales et résumé de la situation en Afrique de l’Ouest », in
http://www.who.int/csr/don/2014_O4ebola/fr/
Quivy Raymond et Van Campenhoudt Luc, 2013, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod (4e éd.)
Wagner Anne-Catherine, 2012, « Habitus », Sociologie [En ligne], Les 100 mots de la sociologie, mis en ligne le 01 mars 2012, consulté le 15 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/sociologie/1200.
[1] L’indéniable richesse de La République Démocratique du Congo se perçoit à travers ses immenses réserves de bois exportables et de minerais en Cobalt, en cuivre, en diamant, en or, en étain et bien d’autres ressources qui attirent la convoitise des grandes puissances mondiales.
[2] Le matérialisme est entendu ici comme la science de l’histoire.
[3] Pour Montesquieu, « les hommes s’accommodent presque toujours mieux des milieux que des extrémités ». Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, p.304.
[4] Les principes de la Modernité recommandent que l’individu ou le citoyen soit privilégié dans la société.
[5] Newton, Einstein et Galilée.
[6] Commission mondiale sur l’environnement et le développement,1987, Notre avenir, Paris, Éditions du fleuve
[7] Programme de développement durable à l’horizon 2030, UNSSC Knowledge Center for Sustainable Development, Martin-Luther-King-Strasse 8, 53175 Bonn, Germany, p. 1-2, Sustainable-development@unssc.org. www.unssc.org, consulté le 18 novembre 2018 à 16h55mn.
[8] Programme de développement durable à l’horizon 2030, UNSSC Knowledge Center for Sustainable Development, Martin-Luther-King-Strasse 8, 53175 Bonn, Germany, p. 1, Sustainable-development@unssc.org. www.unssc.org, consulté le 18 novembre 2018 à 16h55mn.
[9] Ministère de l’environnement et du développement durable, 2010, Rapport pays national du développement durable en Côte d’Ivoire dans la perspective de Rio+20, p. 15.
[10] Isaiah BERLIN (1909 –1997) est un juif russo-britannique, philosophe et historien des idées ; il est un penseur du social et du politique. Toute la critique de Berlin en théorie politique est soutenue par sa définition des deux libertés. Distinguant deux formes de liberté, il démontre que si la liberté négative (LN) tente de répondre à la question « Jusqu’où le gouvernement s’ingère-t-il dans mes affaires » ; la liberté positive (LP) se concentre plutôt sur l’origine de la souveraineté ; d’où elle s’intéresse à la question : « qui gouverne » ? Aux regards des conséquences totalitaires de la LP, Berlin plaide pour une interprétation négative de la liberté, celle-ci laissant à l’individu la possibilité d’opérer des choix libres. On retrouve sa critique de Rousseau dans son article « Deux conceptions de la liberté » et dans son livre : La liberté des traîtres.
[11] L’ère postmoderne est celle de l’exaltation de l’individu souverain. La connaissance étant devenue incertaine et subjective, chacun est renvoyé à lui-même pour trouver ce qui lui semble bien afin de se déterminer selon ses propres fins. Dans ce contexte, seul le pluralisme a droit de cité puisqu’il s’agit pour l’individu de vivre non plus selon une conception du bien, mais selon ce qu’il considère être bien pour lui.
[12] L’ouvrage : La liberté et ses traîtres est une transcription d’émissions diffusées en 1952 sur la BBC. Même si le fait que l’émission étant très courte exigeait d’être concis, il n’empêche que Berlin subvertit quelque peu la notion de volonté générale. Céline Hatier souligne à juste titre qu’il reste « très succinct, voire par moments, très vague » dans la manière dont il aborde Rousseau. Cf. Céline HATIER, 2002, pp. 646-651.
[13] C’est faire un anachronisme que de parler de totalitarisme chez Rousseau puisque le concept s’est véritablement formé au XXe siècle. Mais pour certains commentateurs, sa pensée comportait déjà des prémisses totalitaires puisque la théorie de la majorité est un refus de la contestation. Cf. Florent BUSSY, 2014, p. 7-9.
[14] Corey BRETTSCHNEIDER, 2009, p. 105. Lester CROCKER, 1965, p. 99-136. Les commentateurs omettent souvent de rappeler que pour Rousseau, l’individu ne peut être obligé par une loi à laquelle il n’a pas participé. La contrainte compatible avec la liberté est celle qui respecte une bonne délibération et un vote juste. Mais, si on peut s’opposer à certains interprètes, on ne peut nier, cependant, le caractère idéaliste de la théorie politique de Rousseau. Cf. Gabrielle RADICA, 2008.
[15] Le livre de La République de Platon souligne comment les passions constituent la source de l’esclavage humain alors que la liberté dépend de l’usage de la raison. Cf. Platon, 2008, p. 233-313.
[16] Le sentiment intérieur chez Rousseau paraît plus important que la certitude rationnelle. D’ailleurs, il prend bien souvent le pas sur la raison dans la recherche de la vérité. Cf. Jean-Jacques ROUSSEAU, 1964, p. 683 / Jean-Jacques ROUSSEAU, 1969, p. 585.
[17] Cette formule est empruntée aux paroles de la chanson de l’artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly dans sa célèbre composition « on a tout compris » et dont la date de production remonte à l’année 2002.
[18] Cette notion est développée par le philosophe anglais John Rawls, grand théoricien du contrat social. Elle renvoie à l’image d’un rideau ou d’un écran qui masque les intérêts individuels et stratégiques des protagonistes au débat public. Sous l’effet de ce voile de l’ignorance, chacun ignorant les implications des décisions à venir, est davantage disposé à agir dans un esprit d’impartialité, de droiture voire de bonté. Ce qui présage alors de décisions ou d’engagements moins égoïstes, plus rationnels, plus justes et tournés vers le bien commun.
[19] Ces sept grands principes garants d’une délibération vertueuse sont : l’universalité, l’inclusion, la rationalité, l’entente, l’efficacité politique, la bonne foi et la sincérité des interlocuteurs et le voile de l’ignorance.
[20] Ce concept habermasssien traduit la construction d’un accord commun, satisfaisant pour tous et auquel des parties engagées dans une discussion parviennent au moyen de l’usage public de la raison et non en privilégiant des intérêts égoïstes.
[21] Pour la définition de ce concept, voir dans la section suivante.