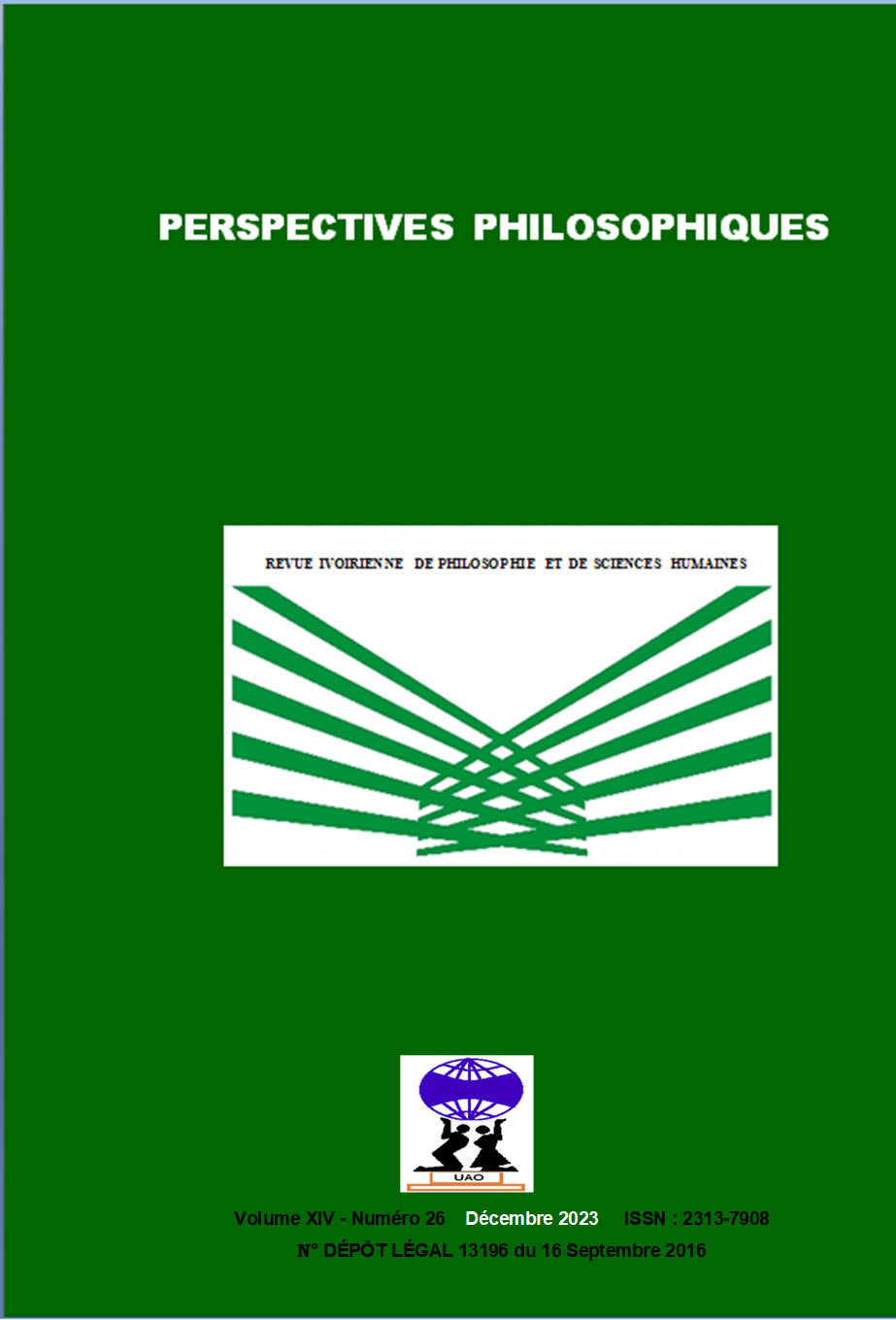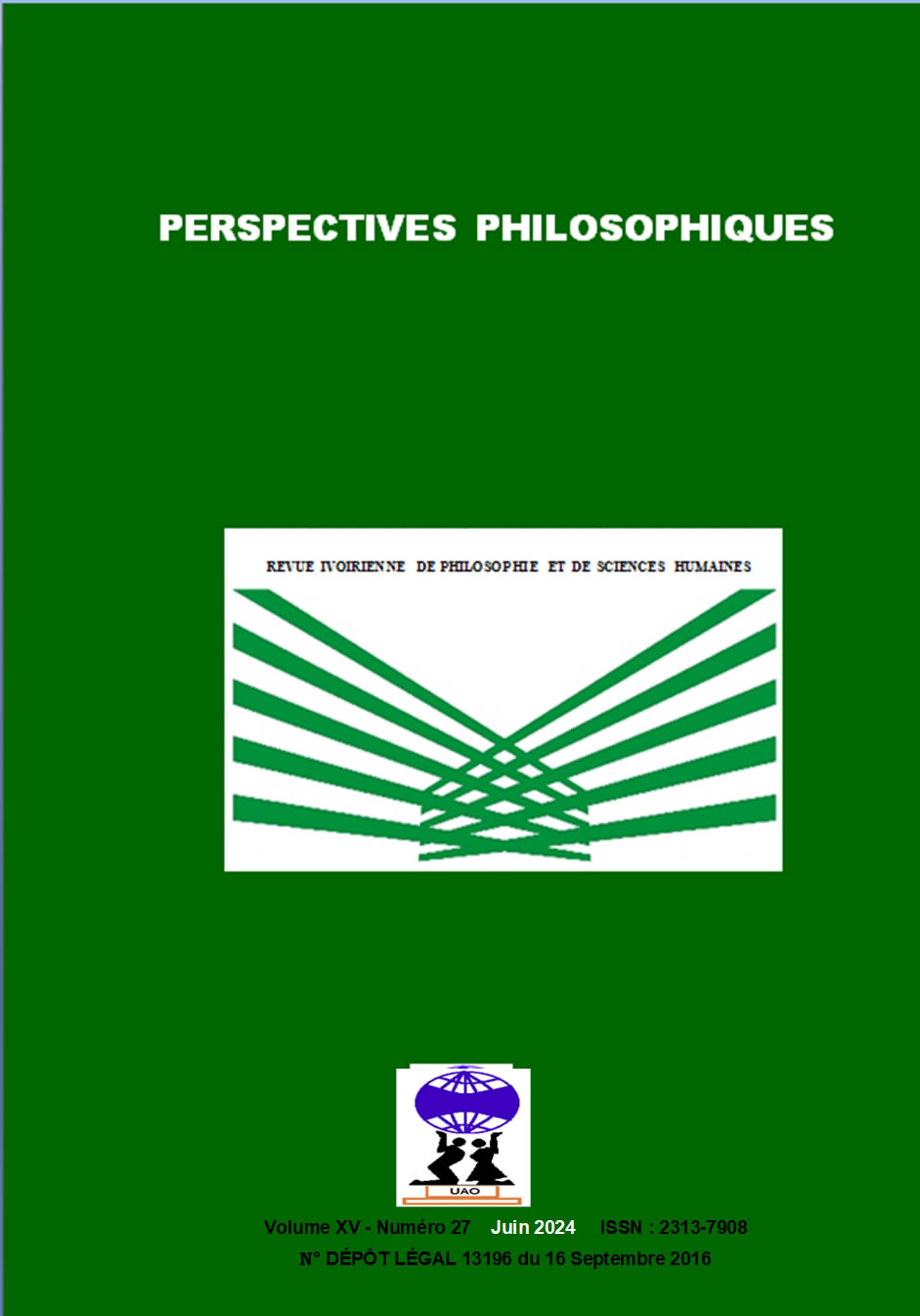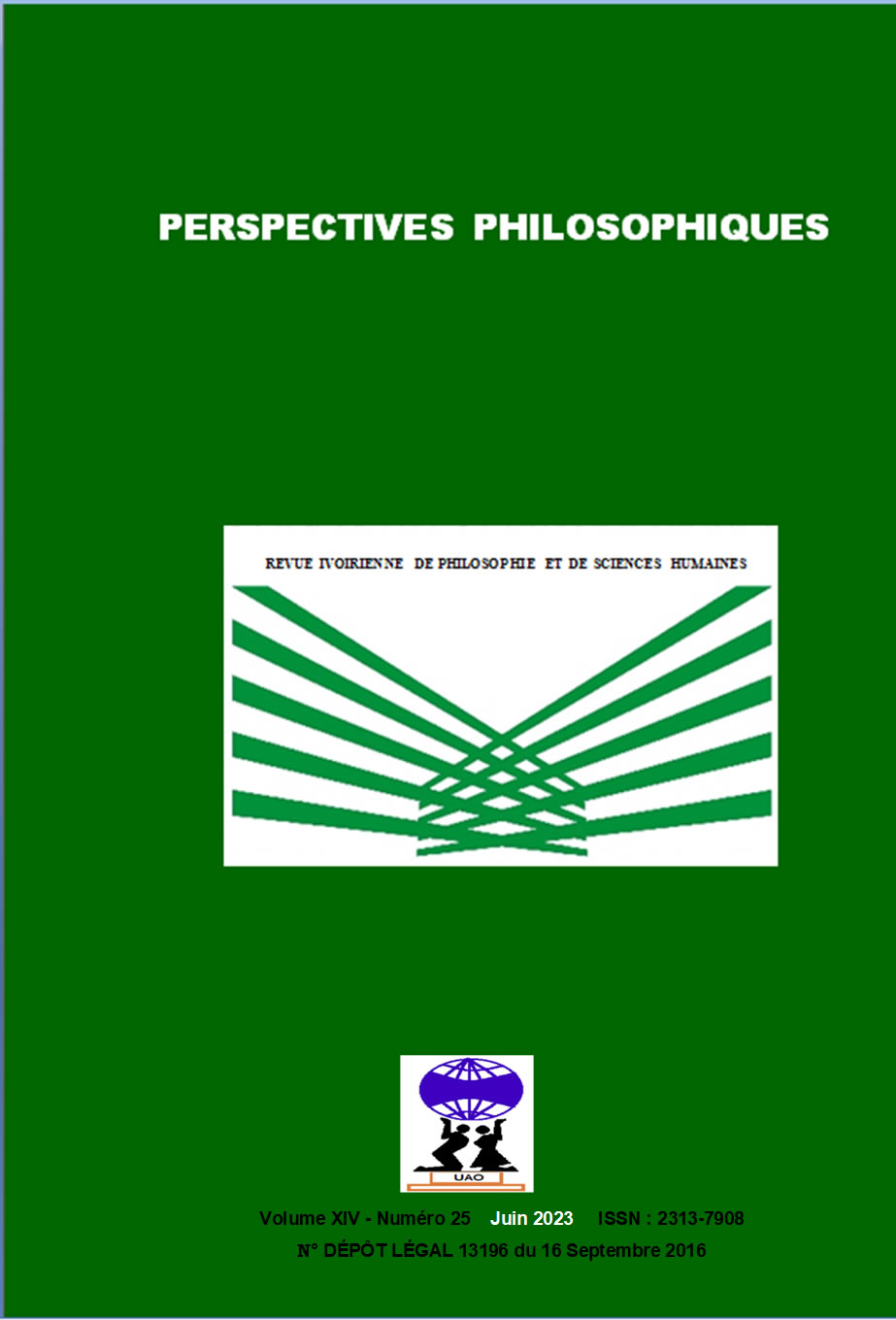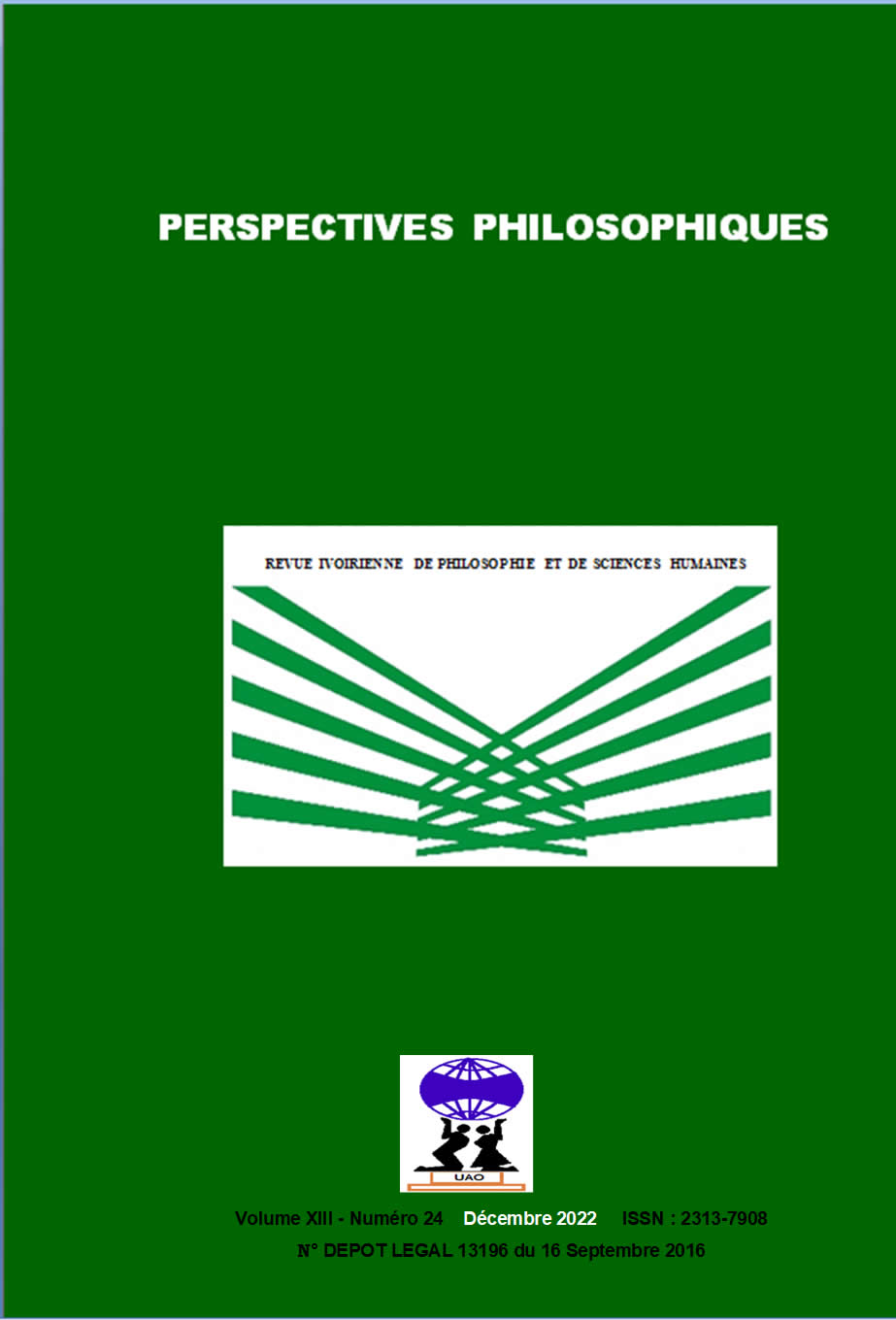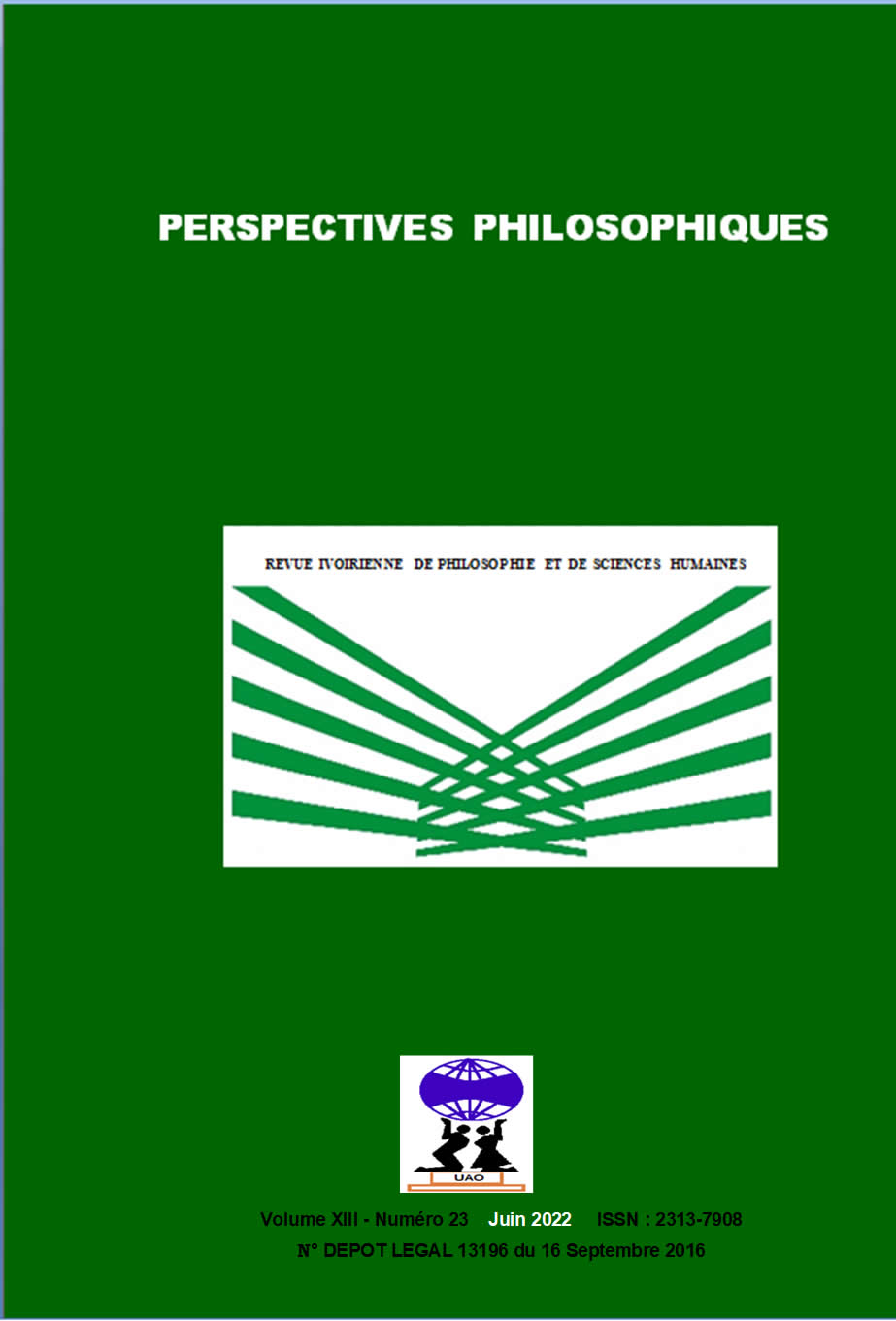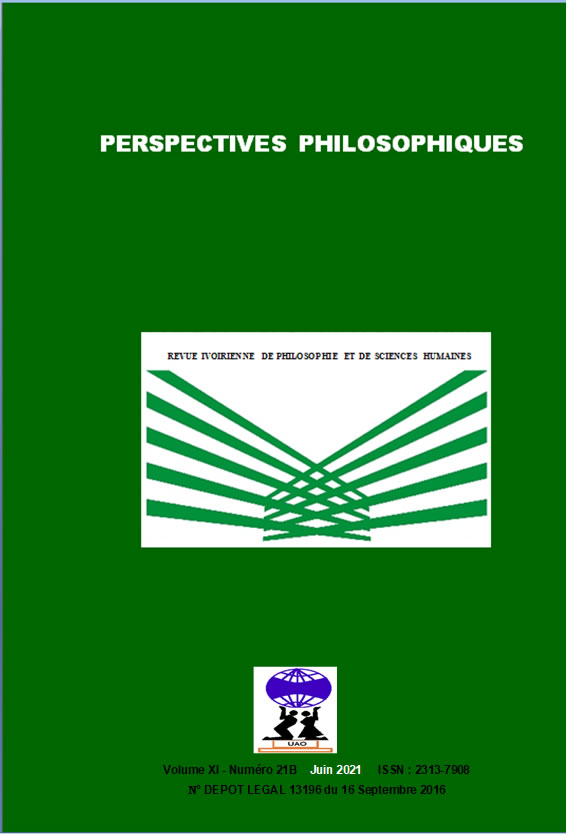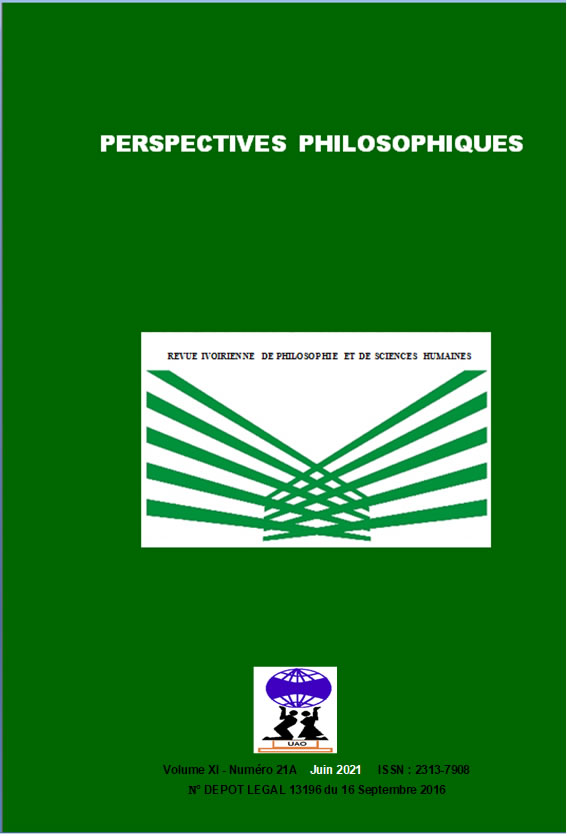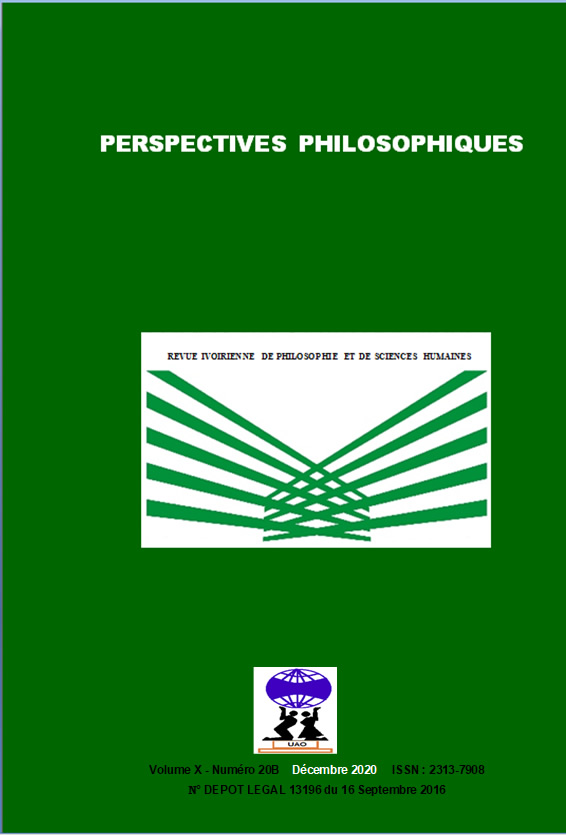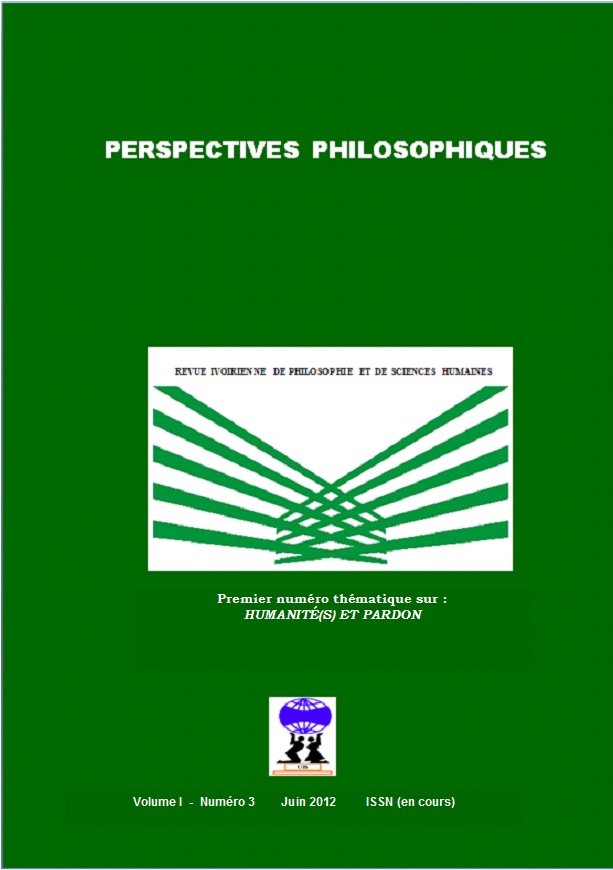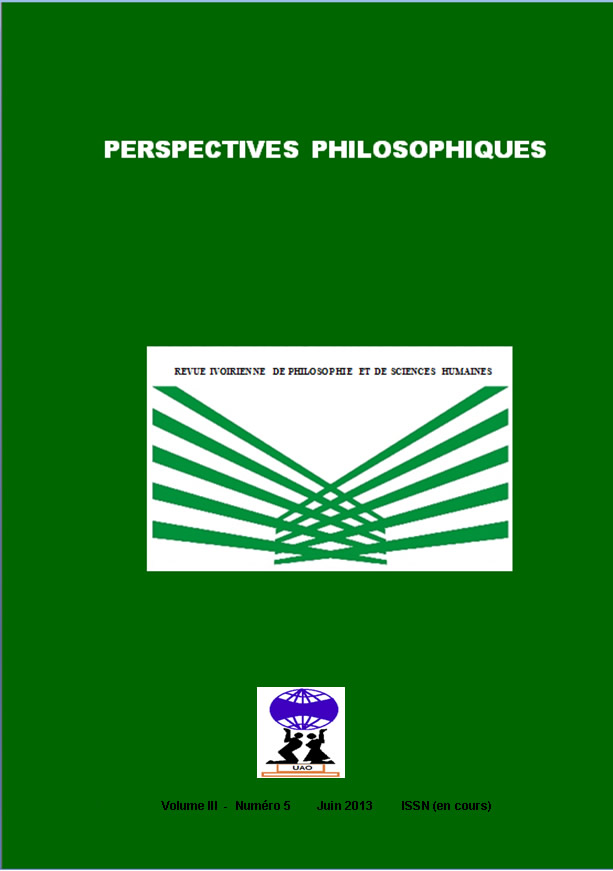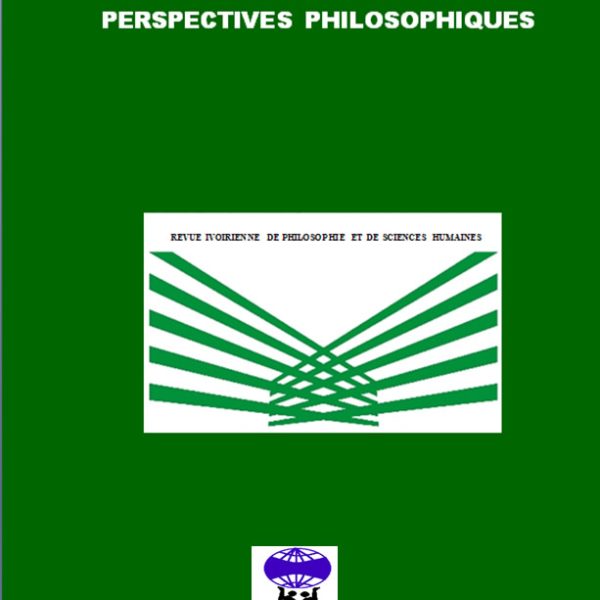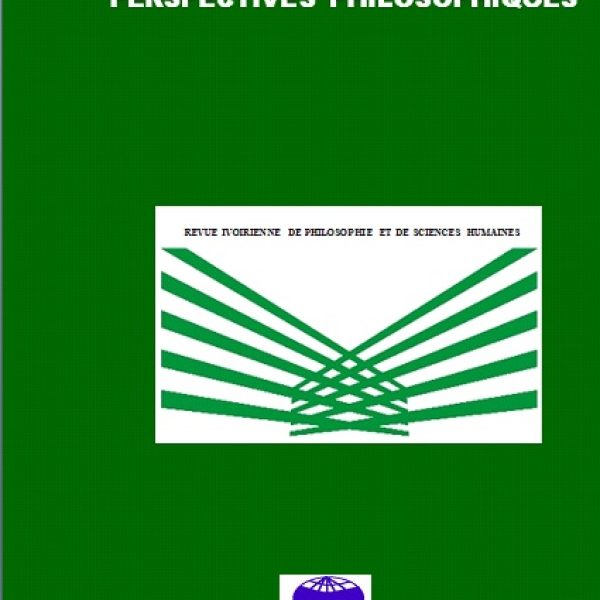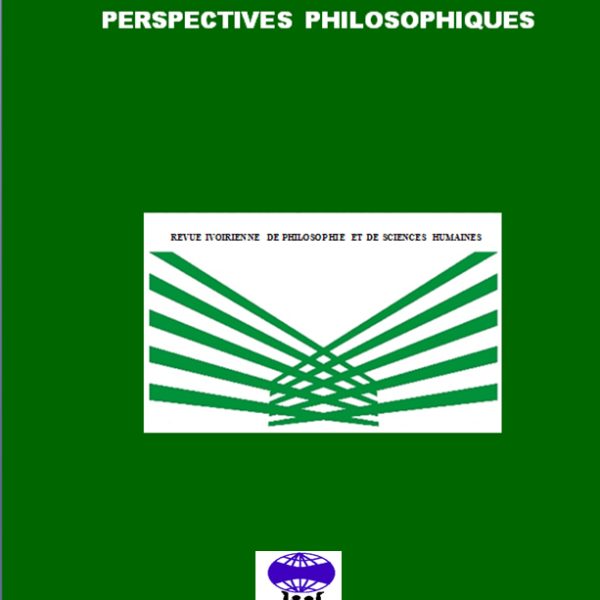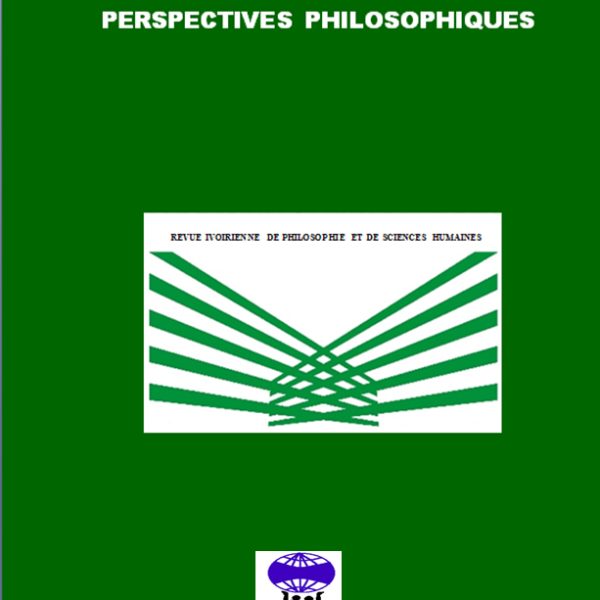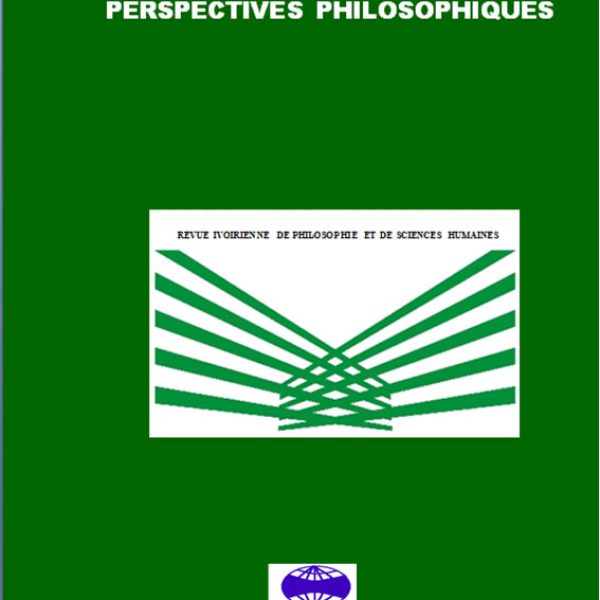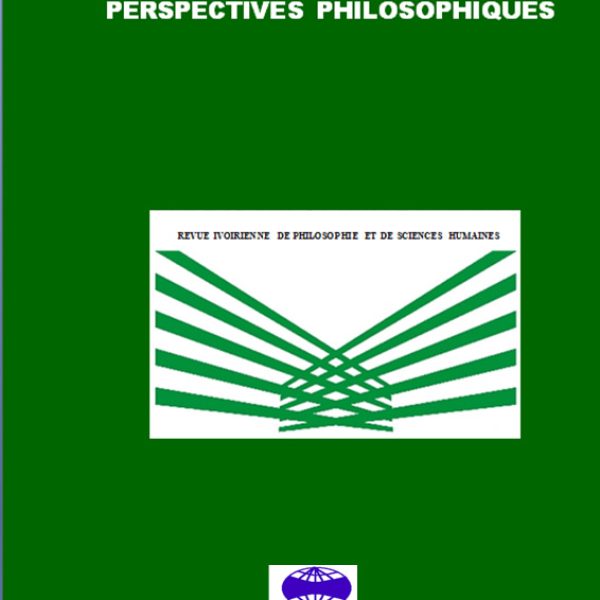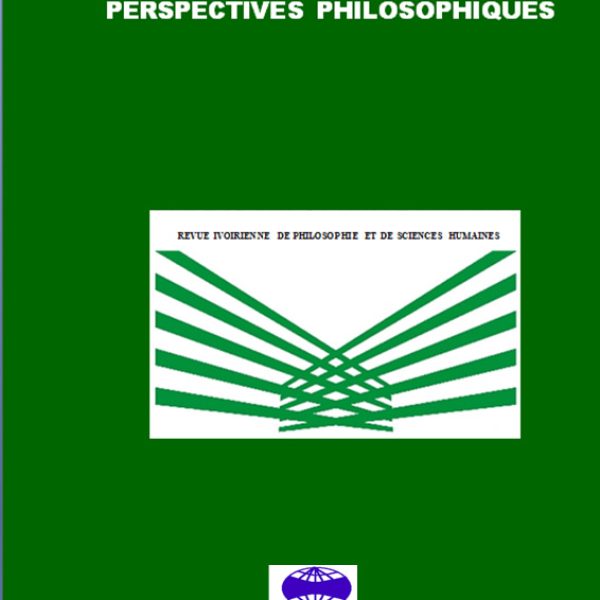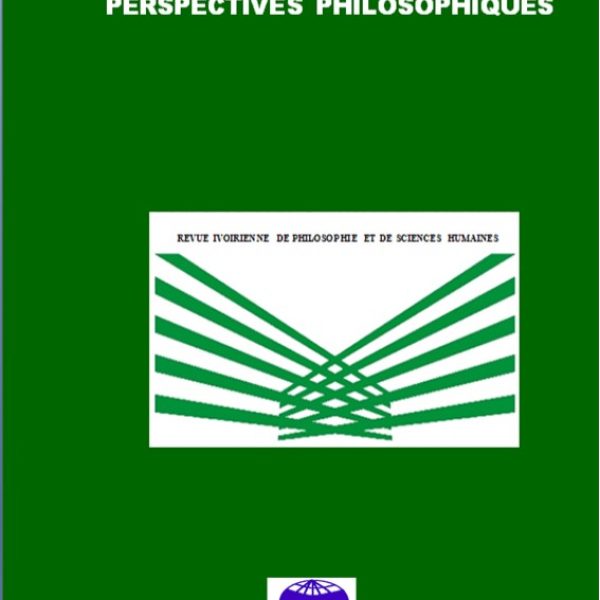| Volume II – Numéro 4 Décembre 2012 ISSN (en cours) |
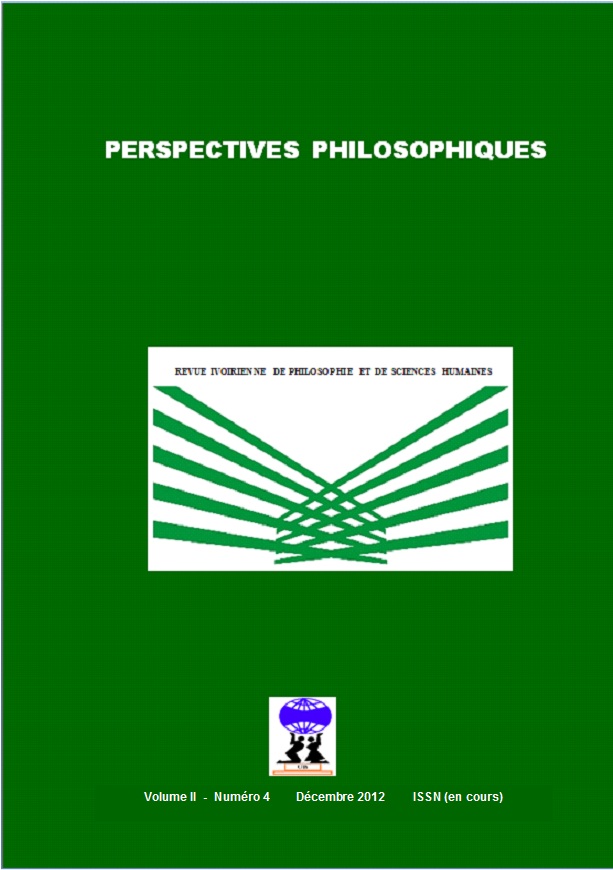
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 27 BP 529 ABIDJAN 27
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : revueperspectivesphilo@yahoo.fr
Site internet : http://perspectives.bouakephilo.net
ISSN (en cours)
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Maître de Conférences
Rédacteur en chef : Prof. N’dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences
Rédacteur en chef adjoint : Dr Assouma BAMBA, Maître-Assistant
Secrétaire de rédaction : Dr Blé Sylvère KOUAHO, Maître-Assistant
COMITÉ DE REDACTION
: Prof. Kouassi Edmond YAO, Maître de Conférences
: Dr Abou SANGARÉ, Maître-Assistant
: Dr Donissongui SORO, Maître-Assistant
: Dr Jean-Baptiste Grodji, Maître-Assistant
: Dr Kouassi Clément AKPOUÉ, Maître-Assistant
: Dr Lucien BIAGNÉ, Maître-Assistant
: Dr Maurice KoladÉ, Maître-Assistant
Trésorier : Dr Grégoire TRAORÉ, Maître-Assistant
Responsable de la diffusion : Prof. Antoine KOUAKOU, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Antoine KOUAKOU, Maître de Conférences, Métaphysique et Éthique, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Azoumana OUATTARA, Maître de Conférences, Philosophie politique, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Maître de Conférences, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Henri BAH, Maître de Conférences, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Maître de Conférences, Métaphysique et Théologie, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Kouassi Edmond YAO, Maître de Conférences, Philosophie politique et sociale, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. N’Dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences, Éthique des Technologies, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Samba DIAKITÉ, Maître de Conférences, Études africaines, Université Alassane Ouattara de Bouaké
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Maître de Conférences, Métaphysique, Université Alassane Ouattara de Bouaké
SOMMAIRE
1. Du pré-humanisme des sophistes : fondement et enjeux,
Kolotioloma Nicolas YÉO………………………………………………………………… 1
2. Le scandale de la démocratie depuis Platon,
Kpa Yao Raoul KOUASSI …………………………………………………………….. 18
3. L’Afrique face au verdict hégélien de la fin de l’histoire,
Oumar DIA……………………………………………………………………………….. 34
4. Du pouvoir métamorphique de l’art chez Nietzsche,
Dagnogo BABA………………………………………………………………………….. 50
5. Heidegger : La tradition et l’oubli,
Léonard Kouadio KOUASSI ………………………………………………………….. 69
6. Bergson : De la découverte de la durée à la négation de la négation déterministe de la liberté,
Ahissi Thomas Daquin KOUABLAN…………………………………………………. 90
7. Préscolarisation et performances scolaires à l’école primaire,
Léopold B. BADOLO………………………………………………………………….. 110
8. Conflits identitaires et dialogue interculturel : pour une culture de la paix en Afrique, Bilakani TONYEMÉ…………………………………………………………………… 123
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
DU PRÉ-HUMANISME DES SOPHISTES : FONDEMENT ET ENJEUX
Kolotioloma Nicolas YÉO
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La philosophie dite présocratique est essentiellement caractérisée par des approches cosmologiques, précisément par la recherche de la substance primordiale à partir de laquelle l’univers est constitué. Relativement à cette orientation, les sophistes ont réalisé une rupture que l’on pourrait qualifier de pré-humaniste, dans le sens d’un humanisme avant la lettre. Car, au lieu de cette pensée dont l’objet est la nature, les réflexions des sophistes se sont plutôt orientées vers la connaissance de l’homme et sa place dans la société. Tout en posant les approches cosmologiques des présocratiques comme le fondement de ce pré-humanisme sophistique, la présente réflexion vise à montrer que ledit pré-humanisme aboutit à la rationalisation de l’éducation, d’une part, et d’autre part, à celle de la rhétorique et de la politique.
Mots clés : Éducation, Politique, Pré-humanisme, Présocratiques, Rhétorique, Sophistique, Substance primordiale de l’univers.
ABSTRACT :
Philosophy known as presocratic is mainly characterized by cosmological approaches, precisely by the research of the primordial substance from which the universe is made up. In relation to this orientation, the sophists carried out a break that one could describe as pre-humanistic, in the direction of humanism before the letter. Because, instead of this thought whose object is nature, the thoughts of the sophists were rather directed towards the knowledge of the man and his place in the society. While posing the cosmological approaches of presocraticas the fundament of this sophistical pre-humanism, the present thought aims at showing that the aforesaid pre-humanism leads to the rationalization of education, on the one hand, and on the other hand, with that of rhetoric and the politic.
Key words : Education, Politic, Pre-humanism, Presocratic, Rhetoric, Sophistic, Primordial substance of the Universe.
INTRODUCTION
Les premiers philosophes, encore appelés présocratiques, ont généralement fait de la nature leur principal objet d’étude[1]. Précisément, « ils développèrent la conception d’une substance élémentaire dissimulée derrière chaque forme créée dans la nature »[2]. Cette forme de pensée a été remise en cause par les sophistes. Avec ces derniers, ce n’est plus tant la nature qui fait l’objet de la réflexion, mais plutôt l’homme.[3]Ainsi, si par humanisme, l’on entend, au XVIè siècle de notre ère,[4] le fait de considérer la personne humaine comme une valeur suprême, l’on est en droit de penser que les sophistes sont des pré-humanistes.
Seulement, si l’on ne se réfère qu’aux différents griefs adressés à la sophistique, ce pré-humanisme, en tant qu’intérêt porté aux recherches sur l’homme, paraît n’avoir apporté aucune contribution à la science. En effet, la sophistique, généralement assimilée à une « sagesse apparente »[5] ayant une « influence dissolvante »[6], est considérée comme une anti-philosophie, ou plus exactement comme une pseudo-philosophie.[7] Elle serait à l’origine de la décadence de la science, et non de son essor.
Mais, peut-on considérer à juste titre que le pré-humanisme des sophistes est nécessairement l’expression d’un recul de la science ? Plus précisément, la rationalisation sophistique de l’éducation ainsi que celle de la rhétorique et de la politique ne constituent-t-elles pas un apport scientifique important du mouvement sophistique ? Telle est la question centrale de cette réflexion.
Tout en indiquant que les pensées des présocratiques pourraient être considérées avec Jostein Gaarder comme le fondement du pré-humanisme des sophistes,[8] l’intention fondatrice de la présente contribution est de montrer que ledit pré-humanisme aboutit à la rationalisation du domaine de l’éducation à Athènes, ainsi qu’à celle de la rhétorique et de la politique. L’établissement de cette hypothèse générale exige le questionnement suivant : dans quel sens les approches cosmologiques des présocratiques constituent-elles le fondement du pré-humanisme des sophistes? La rationalisation de l’éducation, en tant que produit du pré-humanisme des sophistes, n’est-elle pas un des acquis scientifiques de la sophistique? Par ailleurs, n’est-ce pas, au fond, dans ce même sens qu’il convient de comprendre la rationalisation sophistique de la rhétorique et de la politique ?
I. LES APPROCHES COSMOLOGIQUES DES PRÉSOCRATIQUES : FONDEMENT DE L’HUMANISME DES SOPHISTES
Il est connu que les pensées des présocratiques sont, dans leur ensemble, des cosmologies. Ce qui signifie qu’elles sont des pensées dont le principal objet d’étude est la connaissance de la nature. Selon Jean-Paul Dumont, la substance primordiale de l’univers, « c’est-à-dire ce qui se trouve posé par la pensée comme la condition première du mouvement de croissance et de vie qui est la Nature elle-même »[9], a été l’objet d’étude par excellence des présocratiques.
D’une manière générale, les études portant sur les présocratiques exposent leurs différentes conceptions de la nature les unes à la suite des autres, sans dégager de thématiques à partir desquelles l’on pourrait les catégoriser[10]. La présente partie tente de combler cette lacune en procédant à une classification thématique des cosmologies des présocratiques. La première thématique rassemble les présocratiques assignant des éléments naturels palpables à la substance primordiale de l’univers. La deuxième est relative à ceux pour qui l’univers est fondé, au contraire, à partir d’éléments non-saisissables.
Dans la première thématique, s’insèrent les pensées de Thalès, Anaximène, Héraclite et Empédocle. En effet, Thalès affirme que « l’eau est le principe des choses »[11]. Ce qui signifie que l’univers s’est constitué à partir de l’eau. Il ajoute que l’eau est l’élément premier de la nature.[12] Ces déclarations permettent de comprendre que, dans sa vision, la substance primordiale de l’univers est l’élément palpable « eau ».
La pensée d’Anaximène répond également à ce même souci d’identification d’un élément naturel palpable comme substance primordiale ou archè de l’univers. Pour lui, cet élément est l’« air ». À ce sujet, il affirme : « L’air est l’unique principe, mû et illimité de toutes les choses qui existent »[13]. « De même, [poursuit-il], que notre âme, qui est d’air, nous soutient, de même le souffle et l’air enveloppent la totalité du monde »[14].
Le système théorique d’Héraclite ne se dérobe pas à cette identification d’un élément naturel palpable comme archè de l’univers. Nous en voulons pour preuve sa doctrine du « feu ». Héraclite affirme :« Toutes choses sont convertibles en feu et le feu en toutes choses »[15]. Cela sous-entend que, pour lui, le feu est le principe premier de l’univers.
Comparativement aux pensées de ces trois présocratiques, c’est la pensée d’Empédocle qui, de manière remarquable, traduit le plus l’approche cosmologique identifiant un élément naturel palpable comme essence fondamentale de l’univers. Alors que ces trois présocratiques n’ont identifié chacun qu’un seul élément saisissable comme substance primordiale de l’univers, Empédocle en a identifié quatre. Ce sont l’eau, l’air, le feu et la terre.
De ce qui précède, l’on est en droit de conclure que les pensées d’Héraclite, de Thalès et d’Anaximène, sont l’expression d’une philosophie de la nature, notamment d’une d’identification de l’archè de l’univers, en tant qu’élément naturel palpable.
À l’opposé de cette catégorie de présocratiques, la deuxième thématique fait référence à ceux qui assignent des éléments non-saisissables à l’archè du monde. Les premiers à avancer dans cette voie du penser sont les pythagoriciens. Leur système théorique pose les nombres comme les principes premiers de l’univers. Pythagore et les siens sont unanimes que « tout est nombre »[16]. Pour eux, « les nombres sont, […], le principe, la source et la racine de toutes choses »[17]. Comme le rappelle si bien Godin, chez les pythagoriciens, « les nombres gouvernent le monde »[18]. Il en résulte que, dans leur approche, l’univers est constitué à partir des éléments non-saisissables que sont les nombres.
Cette même idée est perceptible dans la pensée d’Anaxagore. Sa doctrine des « fluides-qualités »[19] ou « homéoméries »[20], telle que rappelée par Jean Brun, est symptomatique de cette idée. Celui-ci rappelle que, pour Anaxagore, « aucune chose ne se crée ni ne se détruit, mais à partir de fluides-qualités préexistants se produisent des mélanges qui se différencient à nouveau »[21]. Il en ressort que les « fluides-qualités » ou les « homéoméries » constituent dans le penser anaxagoréen la substance primordiale de l’univers à partir de laquelle le monde est engendré.
La théorie atomistique des Abdéritains, encore appelés atomistes, n’exprime rien d’autre que la même idée d’identification d’un élément non-saisissable comme essence fondamentale de l’univers. En effet, lorsqu’ils affirment que les atomes sont les plus petits éléments possibles de ce qui est, et que ces petits éléments ne peuvent subir une quelconque modification[22], les Abdéritains veulent montrer que les atomes constituent le principe premier à partir duquel l’univers est créé.
Somme toute, telle que développée par les premiers philosophes dits présocratiques, la pensée est restée tributaire de la nature, prise comme principal objet d’étude. Tout bien considérée, cette forme de pensée relative à la nature constitue le socle de l’intérêt des sophistes pour l’homme. Comme le reconnaît Gaarder, le désintérêt des présocratiques pour l’homme a conduit les sophistes à développer un intérêt pour les recherches relative à l’homme.[23] C’est que, pour ces derniers, une pensée n’ayant « aucun rapport avec la vie humaine »[24] doit être évincée de l’ensemble du savoir. La thèse de l’homo mensura de Protagoras qui soutient que « l’homme est la mesure de toute chose »[25] semble corroborer cette idée. En effet, cette affirmation programmatique, bien que faisant l’objet d’une multitude d’interprétations, porte le projet de placer l’homme au cœur de la pensée. En tant que telle, elle apparaît comme une négation des cosmologies des premiers philosophes. Elle montre que les présocratiques n’ont pas correctement cerné ce qui doit constituer le contenu du savoir, c’est-à-dire l’homme. Évidemment, leurs approches ne pouvaient apparaître que comme de pures spéculations sans objet.[26] Telle est la raison pour laquelle les sophistes ont abandonné la recherche relative à la nature, confirmant ainsi que les approches cosmologiques des présocratiques constituent le fondement de leur intérêt pour les recherches relative à l’homme.
En optant pour cette voie du penser concevant l’homme comme l’objet d’étude par excellence, cela en remplacement de celle relative à la nature développée par les présocratiques, les sophistes pourraient être considérés comme des pré-humanistes, c’est-à-dire des humanistes avant la lettre. Car, quoique n’étant pas les concepteurs du vocable d’ « humanisme », ils sont les premiers à avoir considéré l’homme comme le point focal de la pensée. Une telle pensée pré-humaniste ne saurait être perçue comme une pensée dépourvue d’intérêts. L’un des acquis scientifiques de ce pré-humanisme des sophistes est la rationalisation de l’éducation à Athènes.
II. LA RATIONALISATION DE L’ÉDUCATION COMME UN DES ACQUIS SCIENTIFIQUES DU PRÉ-HUMANISME DES SOPHISTES
Le pré-humanisme des sophistes ne saurait être considéré comme une pensée sans intérêt. Car, il aboutit à la rationalisation de l’éducation à Athènes. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre l’affirmation de Werner Jaeger : Le mouvement sophistique
« répondit à un besoin non pas théorique ou philosophique, mais pratique. C’est la raison profonde du succès qu’il connut à Athènes, alors que la science physique des Ioniens n’a pas pu s’y implanter. Le fait est que, dans l’esprit des sophistes, la philosophie ne se séparait pas de la vie. Ils furent les continuateurs de la tradition éducative des poètes, les successeurs d’Homère, de Solon et Théognis, de Simonide et Pindare »[27].
Il ressort de cette affirmation que les sophistes, loin de se contenter des spéculations cosmologiques des présocratiques, ont orienté leurs réflexions vers les besoins pratiques de la vie humaine, précisément vers l’éducation des citoyens. Ainsi, sans exagération, on pourrait affirmer que les sophistes portèrent à son achèvement l’œuvre d’éducation initiée par les poètes Homère, Solon, Théognis, Simonide et Pindare.
Mais, pour bien cerner le sens et l’intérêt scientifique de la rationalisation de l’éducation opérée par les sophistes, il convient de mettre leur nouvelle éducation en rapport avec l’éducation traditionnelle proposée aux Athéniens.[28] Cela nous impose de revisiter les différentes étapes de l’éducation telle que pratiquée à Athènes, avant l’éclosion du mouvement sophistique. À cet effet, trois étapes essentielles de cette forme d’éducation méritent d’être évoquées. Elles permettent d’appréhender le caractère rudimentaire et primaire de l’éducation des Athéniens de cette époque.
Selon Jacqueline De Romilly, la première étape de cette éducation est celle du « pédotribe, c’est-à-dire celui qui entraîne les enfants ; et il s’agit, bien entendu, d’entraînement sportif »[29]. Sous cet éclairage, on comprend bien que la première étape de l’éducation des jeunes athéniens est, avant tout, une éducation physique et sportive. La deuxième étape de l’éducation traditionnelle des Athéniens est celle du « cithariste, c’est-à-dire le maître de musique »[30].Chez le cithariste, les jeunes athéniens apprenaient à chanter et à danser. Ainsi, ces deux premières étapes de la formation des jeunes athéniens valorisent médiocrement la formation intellectuelle. C’est avec ce piètre bagage intellectuel qu’ils sont conduits chez « le grammatiste, c’est-à-dire le maître chargé d’enseigner à lire et à écrire »[31], pour y subir la dernière étape de son éducation.
C’est chez le grammatiste que « l’enfant commençait à apprendre à lire, puis à écrire »[32]. On lui enseignait les rudiments de la lecture et de l’écriture en l’amenant, comme le dit Flacelière, à « réciter par cœur les noms des lettres de l’alphabet, alpha, bêta, gamma, delta, etc. »[33].Mais, remarquons avec Henri-Irénée Marrou que« cette éducation ne s’élevait guère plus haut que notre enseignement primaire actuel »[34]. Quand on sait qu’à l’école primaire, on enseigne seulement que les rudiments de la science, de la lecture et des mathématiques, on comprend aisément que le niveau intellectuel du jeune athénien ayant subi toutes les étapes du processus de l’éducation traditionnelle n’était que dérisoire.
C’est dans ce contexte de primarité de l’éducation athénienne que le mouvement sophistique naquit. Il trancha avec cette éducation élémentaire, aussi bien par ses méthodes que par le contenu de son enseignement. En effet, « les sophistes imaginèrent des moyens nombreux et étonnamment divers »[35] que l’on pourrait résumer en deux étapes fondamentales : « l’une consistait à lui [c’est-à-dire l’enfant] apporter une quantité encyclopédique de faits, les matériaux du savoir ; l’autre, à lui donner un entraînement formel de type très variable »[36]. Suivant les propos de Werner Jaeger, la première est relative à la nette détermination des matériaux du savoir. Ici, les sophistes amènent l’enfant à dresser un répertoire des faits susceptibles de constituer les matériaux de son éducation. La deuxième étape, en tant que couronnement de la première, consiste à faire subir à l’apprenant une sorte de stage-pratique en l’amenant à connaître les relations nécessaires qui lient les faits répertoriés.
À ce stade de la réflexion, il est loisible de remarquer la rupture qui existe entre l’éducation proposée parles sophistes et celle traditionnelle des Athéniens. Pour eux, ce qui importe, c’est la culture intellectuelle de l’apprenant. À ce propos, Werner Jaeger soutient que « pour la première fois, le côté intellectuel de l’homme eut la prééminence absolue »[37]. Par leur méthode d’éducation, les sophistes se sont fixés pour mission essentielle de soigner l’esprit de l’apprenant, au lieu de son corps. Ainsi, si dans l’éducation classique des Athéniens, le corps est l’objet de beaucoup d’attention, dans celle prônée par les sophistes, la culture de l’esprit surclasse les soins du corps. Romilly a donc raison d’affirmer que les sophistes ont armé les Athéniens « pour le succès et pour un succès reposant non sur la force ou le courage, mais sur l’intelligence »[38]. Tel est le sens de la révolution méthodologique des sophistes.
Pour ce qui est du contenu de l’enseignement, rappelons qu’à Athènes, l’enseignement était essentiellement composé de disciplines sportives ; de chants et de danses ; et enfin, de lecture et d’écriture de poèmes des poètes grecs tels qu’Homère, Hésiode, Simonide, etc. Un tel contenu est forcément élémentaire, aux yeux des sophistes. En effet, comme l’affirme Théodore Gomperz, « aux exigences plus grandes de la vie politique, au développement des besoins intellectuels ne suffisait plus la connaissance élémentaire de la lecture, de l’écriture et du calcul, qui, avec la musique et la gymnastique […] formait toute la culture de la jeunesse »[39].
Sans rejeter formellement ce contenu de l’enseignement traditionnel des Athéniens, les sophistes entreprirent cependant de l’amplifier. Ils
« appliquèrent un système plus évolué d’éducation formelle ayant pour but non pas d’expliquer la structure de la raison et du langage, mais de cultiver toutes les facultés de l’âme. Un tel procédé fut représenté par Protagoras. Outre la grammaire, la rhétorique et la dialectique, ce dernier utilisait la poésie et la musique pour former l’âme»[40].
À ces différents éléments, s’ajoutent la technique, « la politique et la morale »[41]. L’ensemble de tous ces propos visent à montrer que le contenu de l’éducation des sophistes est la résultante d’une véritable culture de l’intellect. En effet, il reflète le souci d’une éducation qui embrasse à la fois divers domaines de compétence. Pour ce faire, il est composé des « distinctions grammaticales, que l’on commençait justement à établir »[42], de l’apprentissage de l’art du discours et de l’argumentation, de la propédeutique aux joutes verbales, de « l’interprétation et de la critique des œuvres poétiques »[43], de l’apprentissage de la musique, de la formation technique et surtout, de la formation à l’administration de la cité, c’est-à-dire la formation à la politique. On voit donc comment l’« enseignement nouveau »[44] que proposent les sophistes surclasse en contenu celui l’éducation traditionnelle des Athéniens.
En définitive, la rationalisation de l’éducation opérée par les sophistes se traduit par une révolution qualitative de la méthode et du contenu de l’enseignement tel que pratiqué traditionnellement à Athènes. Les sophistes ont élaboré une méthode et un contenu d’enseignement orientés vers une véritable culture de l’esprit.
Cependant, il est bien de noter qu’en plus de la rationalisation de l’éducation, Protagoras et ses pairs ont également entrepris de codifier la rhétorique et le domaine de la politique. Ignorer cette double codification, c’est ignorer deux autres contributions scientifiques importantes du pré-humanisme des sophistes.
III. LA RATIONALISATION DE LA RHÉTORIQUE ET DE LA POLITIQUE : AUTRES INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES DU PRÉ-HUMANISME DES SOPHISTES
En plus de la rationalisation de l’éducation, le pré-humanisme des sophistes a abouti à la rationalisation de la rhétorique et à l’élaboration des premières idées politiques, prémisses des sciences politiques.
Concernant la rhétorique, il convient de noter que la majorité des sophistes a accordé une place prépondérante au discours bien formulé et bien exprimé. Selon Romilly, les sophistes furent « avant tout des maîtres de rhétorique, et tinrent à faire montre de leur habileté dans ce domaine en traitant les sujets les plus paradoxaux »[45]. Il résulte de cette affirmation que tous les sophistes, dans leur ensemble, sont assimilables à des personnes ayant développé une compétence exceptionnelle dans l’art du discours bien conçu et bien exprimé. Rien de ce qui est relatif à la rhétorique ne semble leur échapper. Rappelons, dans ce sens, une affirmation de Gorgias et un témoignage de Socrate. Gorgias affirme: « mon art est la rhétorique »[46]. Quant à Socrate, il reconnait, d’une part, que « tout le monde le vante [Protagoras] et l’on dit qu’il est habile à parler »[47] ; d’autre part, il admet avoir reçu de Prodicos la leçon d’une drachme sur l’utilisation du « terme exact »[48]. À partir de ces propos, l’on est en droit de considérer que la rhétorique est ce en quoi Gorgias, Protagoras et Prodicos excellent. Du reste, au-delà des trois, c’est l’ensemble des sophistes qui passent pour avoir été des maîtres du discours. C’est pourquoi, généralisant la compétence rhétorique à tous les sophistes, Olivier Reboul explique qu’« on peut en tout cas dire que les sophistes ont créé la rhétorique en tant qu’art du discours persuasif faisant l’objet d’un enseignement systématique et global »[49]. L’idée exprimée à travers cette affirmation est que les sophistes sont les inventeurs de l’art de bien parler ou de bien argumenter.
La rhétorique chez les sophistes est fondée sur l’institution d’un ordre d’agencement et d’une méthode du discours persuasif. Cet art du discours persuasif repose sur trois éléments importants. Ce sont, premièrement, les ébauches de systématisation de la grammaire et de la conjugaison ; deuxièmement, la disposition du discours et, troisièmement, l’idéal d’une prose ornée et savante.[50] En effet, pour ce qui est de la grammaire et de la conjugaison, le mouvement sophistique, par le biais de Protagoras, s’est intéressée à une typologie des noms selon leur genre. Cela signifie que Protagoras a distingué le temps des verbes.[51] Par cette systématisation de la grammaire et de la conjugaison, ce sophistea posé les jalons de ce qui devait devenir plus tard la forme élaborée de la grammaire et de la conjugaison.
À propos de l’organisation du discours, il convient de retenir avec Dumont que les sophistes le configurent « en quatre parties : le vœu, l’interrogation, la réponse et l’injonction. D’autres parlent de sept parties : l’exposition, l’interrogation, la réponse, l’injonction, la narration, le vœu et l’invitation »[52]. Cette déclaration véhicule l’idée que, pour les sophistes, tout discours, pour être admis comme tel, doit respecter ces différentes étapes. Il doit débuter par un exposé du sujet, pour se terminer par une invitation, en passant par une interrogation-problème, une réponse-thèse, une injonction, une narration-justification et un vœu.
Enfin, en ce qui concerne la prose ornée et savante, c’est-à-dire l’argumentation bien conçue et bien exprimée, toute approche argumentaire, qu’elle se décline sous les figures de rhétoriques de l’antiphonie, du paradoxe, du probable ou de la dialectique, est redevable aux sophistes.[53] On pourrait certainement, ainsi que l’a fait Aristote,[54] dénoncer la véridicité matérielle des propos des sophistes, mais on ne saurait leur refuser l’ingéniosité et la qualité rationnelle d’élaboration des procédés d’argumentation.
De ce qui précède, on pourrait affirmer que la rationalisation de la rhétorique constitue indéniablement l’un des acquis scientifiques liés au pré-humanisme des sophistes. En effet, grâce à eux, la rhétorique a été l’objet d’une importante rationalisation au point que Reboul n’hésite pas à les classer parmi les inventeurs de l’art du discours.[55] Ainsi, à partir des principes de la raison, on peut produire ou concevoir un beau discours qui retienne l’attention des auditeurs. Mais, pour réglementer les relations humaines, il a semblé important aux sophistes d’adjoindre à la codification de la rhétorique celle de la politique.
Pour ce qui est de la rationalisation sophistique de la politique, George Briscoe Kerferd a relevé à juste titre que la pensée de Protagoras est l’expression d’une théorie de la société à travers laquelle le sophiste pose la nécessité du vivre-ensemble,[56] lequel ne peut se réaliser sans gestion politique. Cette gestion politique est, chez les sophistes, régie par certains principes dont la reconnaissance antiphonienne du caractère arbitraire de la loi.[57] En effet, affirmer que la loi est arbitraire, revient à dire qu’il « n’y a pas d’essence de la loi, il n’y a que “des lois”, qui ne se définissent que par rapport à la décision prise dans la cité »[58]. Cela signifie que, pour le sophiste Antiphon, il ne saurait y avoir une loi universelle, universellement applicable à tout le monde entier sans exception. Autrement dit, la société ne serait pas viable, si les lois n’étaient pas relatives à chaque groupe social. Étant donné qu’elle résulte « du pacte social »[59], la loi ne peut qu’être relative à chaque société. Chacune d’elles doit avoir la possibilité, en fonction de ce qui lui paraît bon et juste, d’élaborer les lois auxquelles elle souhaite être soumise. Telle est la première règle politique par laquelle les sophistes ont tenté de codifier le domaine de la politique.
Le deuxième principe politique des sophistes se profile au terme de la théorie des antilogies de Protagoras. Selon cette théorie, « il y a sur tout sujet deux discours mutuellement opposés »[60]. C’est que, pour Protagoras, chaque sujet appelle légitimement deux approches contradictoires. Appliquer au domaine de la politique, ces propos signifient que le monisme, l’unanimisme et l’unilatéralisme sont à récuser, à moins qu’on ne veuille faire l’apologie de la pensée unique.[61] En effet, le domaine de la politique doit transcender le dogmatisme religieux à travers lequel les opinions, affirmées de manière catégorique, sont incontestables et irrévocables. En d’autres termes, pour les sophistes, loin de tout dogmatisme religieux, « la décision politique [doit être] en effet, devant le peuple, toujours discutée ; on la sent donc toujours discutable, c’est-à-dire réversible et modifiable »[62]. Car, un peuple est rarement unanime. En tenant compte des différentes positions que peuvent développer les membres d’une société, chaque décision politique doit toujours être l’objet et le produit de discussions. Dans ce sens, aucune proposition ne saurait être considérée comme absurde. Par conséquent, le propre de tout régime démocratique doit être de « comporter une opposition, c’est-à-dire d’accepter la légitimité possible d’un discours contraire à celui du pouvoir en place »[63]. C’est à cette forme de tolérance politique de l’opinion adverse que les sophistes invitent l’humanité. Cet appel à l’admission de la contradiction dans le domaine de la politique constitue la deuxième idée politique des sophistes.
Toutefois, on ne saurait réussir à valoriser ce respect de l’autre et de la volonté commune sans éducation à la politique. C’est pour cette raison que, chez les sophistes, Protagoras se propose d’enseigner et d’éduquer les citoyens à la politique. « L’objet de mon enseignement, [affirme-t-il précisément], c’est la prudence pour chacun dans l’administration de sa maison, et, quant aux choses de la cité, le talent de les conduire en perfection par les actes et la parole »[64]. On s’aperçoit, à partir de cette affirmation, que l’objectif de Protagoras est d’enseigner l’art de l’administration de la famille et celui de la cité. Selon lui, un dirigeant doit être capable d’administrer correctement la société. Pour cela, Protagoras pense qu’il lui faut une formation adéquate. Cela a conduit Kerferd à affirmer que « Protagoras a donné pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un fondement théorique à la démocratie directe »[65]. Autrement dit, l’éducation politique à laquelle ce sophiste soumet les citoyens constitue, en fait, un fondement théorique de la démocratie.
Comme l’on peut le constater, la rationalisation sophistique de la rhétorique ainsi que celle de la politique constituent, en plus de la rationalisation de l’éducation, des contributions scientifiques non moins importantes du pré-humanisme des sophistes. Car, on ne saurait concevoir une société sans communication et sans gestion politique.
CONCLUSION
Contrairement à l’intérêt manifeste des présocratiques pour les recherches relatives au cosmos, les sophistes ont orienté leurs réflexions vers l’homme et sa place dans la société. En plaçant ainsi l’homme au cœur de la pensée, Protagoras et ses pairs sont les premiers, avant le « connais-toi, toi-même » de la tradition delphico-socratique, à considérer l’homme comme l’objet d’étude par excellence. Ce qui justifie le qualificatif de pré-humaniste que nous leur attribuons.
En dépit des critiques visant à montrer le caractère dissolvant de la sophistique en général, et par conséquent de leur pré-humanisme en particulier, cette contribution a tenté de montrer que ledit pré-humanisme aboutit à la rationalisation de l’éducation, d’une part, et d’autre part, à celle de la rhétorique et de la politique. Toutefois, suspendre la réflexion à ce niveau serait contre-productif, car aussi importante que puisse paraître la rationalisation de ces trois domaines, elle ne suffit pas à rendre compte de tous les enjeux appréciables auxquels le pré-humanisme des sophistes a abouti. En d’autres termes, si cette contribution se limite à montrer que la rationalisation de l’éducation ainsi que celle de la rhétorique et de la politique sont les enjeux appréciables du pré-humanisme des sophistes, cela n’implique pas que la rationalisation de ces trois domaines épuise à elle seule la liste des contributions positives des sophistes à la science. En effet, le mouvement sophistique a, à travers son pré-humanisme, fourni certains de ses principes fondamentaux à la sociologie, à la morale, au markéting, pour ne citer que ces domaines. Une réflexion relative aux contributions positives des sophistes à ces différents domaines offrirait l’occasion de rehausser davantage leur image, fortement entamée par les critiques d’origine aristotelo-platoniciennes.
BIBLIOGRAPHIE
ADELINE, Yves-Marie, Histoire mondiale des idées politiques, Paris, Ellipses, 2007.
BRÉHIER, Émile, Histoire de la philosophie, tome I, Paris, PUF, 1981.
BRIANT, Pierre, Lévêque, Pierre, et alli, Le Monde grec aux temps classiques, tome I, Paris, PUF, 1995.
BRISSON, Luc et alli, (dir), Lire les présocratiques, Paris, PUF, 2012.
BRUN, Jean, Les présocratiques, Paris, PUF, 1968.
CHEVALIER, Jacques, Histoire de la pensée, Vol. I : Des présocratiques à Platon, Paris, Éditions Universitaires, 1991.
DHERBEY, Gilbert Romeyer, Les Sophistes, Paris, PUF, Que sais-je ? n°2224, 1985.
DUMONT, Jean-Paul, (dir.), Les Présocratiques, trad. Jean-Paul Dumont, Paris, Gallimard, 1988.
GAARDER, Jostein, Le Monde de Sophie. Roman sur l’histoire de la philosophie, traduit du Norvégien par Hélène Hervieu et Martine Laffont, Paris, Seuil, 1995.
GODIN, Christian, La Philosophie : Antiquité, Moyen Âge et Renaissance, Paris, Éditions First-Gründ, 2008.
GOMPERZ, Théodore, Les Penseurs de la Grèce. Les Sophistes, Paris, Manucius, 2008.
JAEGER, Werner, Paideia : la formation de l’homme grec, trad. André et Simonne Devyver, Paris, Gallimard, 1964.
KERFERD, George Briscoe, Le mouvement sophistique, trad. Alonso Tordesillas et de Didier Bigou, Paris, Vrin, 1999.
PLANTIN, Christian, L’argumentation, Paris, Seuil, 1996.
PLATON, Protagoras, in Protagoras. Gorgias, Ménon, trad. Alfred Croiset, Paris, Gallimard, 1984.
PRADEAU, Jean-François, (dir.), Les Sophistes. Écrits complets, Vol. I et II, Paris, G.F., 2009.
REBOUL, Pierre, Introduction à la rhétorique, Paris, PUF, 1991.
ROMILLY, Jacqueline De, Les Grands sophistes de l’Athènes de Périclès, Paris, Librairie Générale Française, 1989.
VERNANT, Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, La Découverte, 1996.
ZONGO, Alain Casimir, « Élitisme platonicien et égalité d’éducation en question », in Le Cahier philosophique d’Afrique, n°006, 2008, pp. 171-193.
LE SCANDALE DE LA DÉMOCRATIE DEPUIS PLATON
Kpa Yao Raoul KOUASSI
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody Abidjan (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Si la démocratie se présente comme la panacée politique pour les superpuissances, force est de reconnaître cependant que, depuis Platon, elle apparaît comme pouvant compromettre la liberté de l’individu. C’est pourquoi, nous pensons que sa suprématie n’est pas le fondement de la société moderne : elle est, au contraire, le scandale qui l’anime, et la négation de ce scandale est l’une des voies de la libération de l’homme.
Mots clés : Démocratie, Individu, Justice, Libération, Scandale, Société.
ABSTRACT :
If democracy appears as a political panacea for the superpowers, force is to recognize therefore that democracy, since Plato seems to be able to compromise the freedom of the individual. This is why we believe that the supremacy of democracy is not the basis of tomodern society: it is, on the contrary, the scandal behind him and the negation of this scandal is one of the ways of human liberation.
Keyword : Democracy, Individual, Justice, Liberation, Scandal, Society.
INTRODUCTION
Les crises et les coups d’État se répètent sans cesse. Pour l’opinion, les contradictions sociales actuelles sont la cause d’une mauvaise pratique politique, parce qu’elle s’éloigne de la démocratie. C’est à croire que la bonne pratique de politique existe et se trouverait dans la démocratie, ce pouvoir dont la visée est la liberté de tous en vue du bien de tous.
Mais, les faiblesses de la démocratie se présentent comme le scandale de l’existence humaine : la démocratie a abusé des hommes. Or, cet abus n’échappe à aucun continent. Les époques se succèdent à la recherche d’une bonne pratique démocratie. Si tel est le cas, les vissicitudes de l’existence politique ne se présentent-elles pas comme les manifestations des tares de la démocratie au cours des temps dans divers espaces ? Les problèmes qui minent la société la bouleversent en son fondement même. C’est comme si les hommes ont marché continuellement par la démocratie vers la perte d’eux-mêmes ? Mais cette perte de soi est-elle nouvelle ? N’est-ce pas depuis l’Antiquité que la perte de soi par la démocratie est posée par Platon comme un scandale ? À l’inverse, comment la négation de la liberté par la démocratie posée depuis l’Antiquité avec Platon comme un scandale, peut être source de la libération des hommes opprimés aujourd’hui par des dirigeants assoiffés de se servir exclusivement du peuple comme moyen et non comme fin ? La reprise de l’analyse du scandale de la démocratie est-elle encore actuelle ?
I. LES FAIBLESSES DE LA DÉMOCRATIE
Tout le monde considère la démocratie comme un gouvernement qui trouve ses origines dans les sociétés antiques, qui a son histoire intimement liée à celle des hommes. Or, quand il s’agit de parler du passé, il faut être prudent surtout s’il faut rattacher l’origine d’un gouvernement à une époque, à un penseur du passé. Selon Roger-Pol Droit, « on perd de vue, fréquemment, que nous appelons Antiquité plus d’un millénaire. Douze siècles séparent les aurores présocratiques des derniers néoplatoniciens. Des mondes mentaux et sociaux très divers s’y sont affrontés, des écoles de pensée s’y sont succédées ou combinées et la plupart nous manquent. De nombreux philosophes antiques sont à jamais silencieux sans épitaphe, sans même la sépulture minimale d’un nom mentionné quelque part. »[66] Sans justifier ici ce silence comme coupable, il convient de s’en servir comme un point de départ. Il s’agit de montrer dans ce cas que le choix de Platon se justifie comme une rupture dans le silence, une possibilité de frayer un chemin dans le passé. Platon devient ici un point de départ et non pas le point de départ à partir duquel nous voulons analyser le scandale de la démocratie. Platon s’illustre alors comme un moment du scandale de la démocratie qu’il faut comprendre.
Le choix de Platon nous renvoie d’abord à sa vie et à ses écrits. La condamnation injuste de Socrate par la ‘’démocratie athénienne’’ confirme les craintes de Platon vis-à-vis de la démocratie. Mais, à cela s’ajoute l’interprétation platonicienne du pouvoir politique. Dans ce cas la démocratie se présente comme s’opposant à la liberté de l’individu au profit de l’injustice sociale. La démocratie conduit à la déchéance au lieu de libérer l’individu, telle est l’origine du scandale. Dans les livres Livres V à VII de La République, Platon cherche à travers Socrate la possibilité d’éviter le scandale que produit la démocratie en se demandant « à quelles conditions se réalisera la justice ? » Pour y répondre, malgré ses hésitations, Socrate doit affronter trois vagues sociales en apportant la solution de l’éducation à celles-ci : la coéducation de l’homme et de la femme, la communauté des femmes et des enfants et l’exercice du pouvoir par les philosophes seuls. Il s’agit de fonder l’opinion vraie, c’est-à-dire la consacrer comme pensée, en vue de rendre la justice possible. Mais ce qui est regrettable, c’est le scandale de l’injustice qui s’installe à la fois dans la cité et dans l’individu. La démocratie est le pouvoir mis en cause parce qu’elle semble mettre en place la déchéance progressive de la cité et de l’individu.
La démocratie est combattue de part en part par Platon pour lutter contre ses faiblesses et pour faire participer l’homme à la justice. Sur le plan méthodologique, Platon introduit le mythe dans la recherche de la justice. En mettant en scène l’étranger, il affirme ceci : « c’est pour cela que nous avons introduit notre mythe : nous voulions non seulement montrer que tout le monde dispute à celui que nous cherchons en ce moment le titre de nourricier du troupeau, mais aussi voir sous un jour plus clair celui qui se changeant seul, à l’exemple des bergers et des bouviers, de nourrir le troupeau humain, doit être seul jugé digne de ce titre »[67]. Cette nouvelle méthodologie veut rompre avec le pouvoir de la multitude qui masque le pouvoir réel de la libération de l’homme. L’homme est confiné dans la multitude et c’est cela même le scandale. Platon va jusqu’à soutenir que dans le pouvoir démocratique ou pouvoir « de la multitude, tout y est faible et il ne peut rien faire de grand, ni en bien, ni en mal, comparativement aux autres, parce que l’autorité y est repartie par petites parcelles entre beaucoup de mains »[68].
La démocratie efface l’autorité, elle est tiède au lieu de mettre en place les contradictions à surmonter. La démocratie règne comme le scandale du pouvoir, elle est le contre pouvoir du pouvoir, elle rompt avec la science. À ce niveau, Platon oppose la science aux partisans. La démocratie suscite des partisans au lieu de pousser à la science et finalement fait l’éloge des « plus grands imitateurs et les plus grands charlatans (…) les plus grands sophistes. »[69] Il faut dire dans ce cas avec Platon que l’injustice est la résultante des faiblesses de la démocratie. Suivant ce schéma, l’injustice n’est pas consubstantielle à l’individu, mais l’effet d’un pouvoir décadent. Mais d’où vient que personne ne réussit à faire disparaître la démocratie pour assurer aux hommes la justice recherchée ? Platon n’a-t-il pas abusé de la démocratie au profit d’une démarche elle-même faussée au départ puisque basée sur le mythe ? N’est-ce pas la soif d’irrationalité qui a poussé Platon à dévaloriser la démocratie ?
La condamnation de la démocratie par Platon est particulière, mais elle traverse l’histoire. Les grands moments de la vie des États se posent par rapport à la réalisation de la justice. Selon Platon, la démocratie est le mal, elle est à l’origine de l’injustice. En ce sens, le scandale de la démocratie est à prendre au sérieux pour rendre possible la justice. Là où est aboli le scandale de la démocratie, est aussi abolie la justice. Certes, les hommes peuvent se représenter différemment la justice, mais il y a une seule justice. Mais comme l’injustice subsiste, la démocratie se présente comme le scandale permanent.
II. LE SCANDALE PERMANENT DE LA DÉMOCRATIE
Si nous convenons avec Alexis de Tocqueville, « le développement graduel de l’égalité des conditions est donc un fait providentiel, il en a les principaux caractères : il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine ; tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. »[70] Et le scandale est bien là, il est même profond au point de troubler la foi et « tout l’univers chrétien »[71]. Ainsi personne ne résiste au mal démocratique. « Où allons-nous donc ? »[72] Cette question qui traduit l’angoisse tragique d’Alexis de Tocqueville préfigure celle qui se vit aujourd’hui comme si depuis Platon, nous n’avons connu que des déchéances. En effet, en commençant son étude par la période située depuis le XIe siècle, jusqu’à son époque à lui, de Tocqueville voulait faire ressortir que la négation de la monarchie pour la démocratie, ne traduit pas la libération de l’homme. La négation de la monarchie a provoqué le scandale de la démocratie qui traverse de part en part l’histoire.
A. L’extension du scandale
Le scandale de la démocratie est donc permanent puisque la démocratie est basée sur des fondements qui rompent avec le fondement de l’homme. L’analyse du scandale démocratique depuis Platon conduit à penser à plusieurs types de scandales liés entre eux non pas de manière dialectique, mais dans un désordre non encore élucidé. En effet, la faiblesse du pouvoir démocratique annoncé par Platon insiste sur la rupture entre la raison et le pouvoir de la multitude. Certes, il apparaît avec Descartes que la raison est égale entre tous, mais cela a conduit à la déchéance même de la raison. Ainsi si pour Emmanuel Kant, la raison a été humiliée depuis Platon et qu’elle « se lamente, repoussée et délaissée comme Hécube »[73], c’est parce que la raison n’a pas connu de critique. La raison s’est exercée là où elle n’avait pas la possibilité de faire prévaloir ce droit. Comme depuis Platon, le scandale dans l’usage de la raison n’avait pas été décelé, on peut dire avec Kant que le scandale est au cœur de la démocratie par l’usage excessif de la raison. Au fond, l’orgueil de la raison a brisé la démocratie. C’est dire que depuis Platon, la raison est aussi à l’œuvre dans la permanence du scandale de la démocratie. Au lieu de percevoir seulement le scandale du côté de la démocratie, il faut aussi voir le scandale dans ce qui sert à disqualifier la démocratie.
La permanence du scandale de la démocratie n’est pas seulement dans la relation entre la démocratie et la raison, mais à la fois au cœur de la raison, au cœur de la démocratie et dans la relation entre la raison et la démocratie. Dans cette triple extension de l’origine du scandale, se trouve aussi le scandale dans le fondement même de la démocratie. La démocratie s’éloigne, selon Platon, de la science politique parce qu’elle ne conduit pas au commandement. Or, le commandement s’appuie sur la loi fondamentale de l’Etat qu’est la constitution. La constitution est le repère de la démocratie. En ce sens, la constitution en tant que repère ou fondement rend statique la démocratie qui se veut alors dynamique. La contradiction apparaît ici alors comme un scandale, mais alors où situer le scandale ? Est-il possible à la démocratie de se mettre au-dessus de la loi ? Si tel n’est pas le cas, la démocratie n’est-elle pas limitée par la loi fondamentale ou dérangée par elle ?
Il est difficile de trouver une frontière réelle entre la démocratie accusée de toutes parts et la loi fondamentale. L’absence de limite crée des confusions à mettre aussi sur le compte, hélas de la démocratie toujours mal jugée comme la bête à abattre. Or, la confusion qui règne ici est oubliée et cela depuis Platon. Nous pensons que la confusion est aussi à l’origine du rejet de la démocratie sous le couvert d’un scandale permanent. En effet, Pierre Rosanvallon traduit la confusion comme un malaise démocratique qui se manifesterait par la désacralisation de la fonction de l’élection, par la perte de centralité du pouvoir administratif et par « la dévalorisation de la figure du fonctionnaire »[74]. Cette thèse vient confirmer l’hypothèse de départ qui se lit aussi chez Miguel Abensour. Selon ce dernier, « la démocratie ne laisse jamais advenir une confusion mystifiante entre une partie et le tout, entre l’État politique et le demos »[75]. Mais là où il y a problème c’est que la confusion qui baigne dans cette situation qui est en fait le scandale, est dédouanée au détriment de la démocratie. On peut dire que depuis Platon, la démocratie est accusée alors qu’elle aurait pu être regardée autrement.
Finalement le scandale se reproduit comme l’expression d’une égalité mal cernée. La finalité de la démocratie se manifeste dans la justice. Or la démocratie est originairement décadente depuis Platon. Comment est-il possible que du non-être dérive l’être ? Cette question qui a guidé la démarche de Platon est aussi celui qui fausse les bases de l’égalité et accuse à tort la démocratie. Or, le mal vient de loin, le problème a été posé d’une certaine manière depuis les origines. La démocratie n’est donc pas à l’origine du scandale de l’égalité, mais ce scandale est permanent depuis les origines. La difficulté à fonder l’égalité ne traduit pas seulement une faiblesse de la démocratie, mais aussi la faiblesse de la méthode employée pour fonder l’égalité depuis Platon.
Platon se fait l’héritier de la tradition philosophique grecque. Or elle est dominée selon lui par Socrate qui n’est pas venu à la philosophie par hasard. Dans le Parménide, Socrate est consacré par ses maîtres. Ce geste traduit une forme d’égalité mal cernée. De plus, l’égalité dans le Parménide se présente comme ce qui s’oppose à l’inégalité. Cette opposition ne rend pas clairement les choses, mais ouvre la voie de l’opposition qui se traduira aussi plus tard entre la démocratie et l’égalité elle-même. La difficulté n’a donc pas été bien résolue depuis Platon et la connaissance tomba aussi avec ses dérivées dans la confusion. Selon René Schaerer, il y a chez Parménide trois voies de la connaissance : « celle de l’Etre qui est indispensable et première ; celle qui va de l’être à l’opinion, qui est légitime ; et celle qui prétend atteindre directement l’opinion, qui est toujours mauvaise »[76]. Si nous convenons avec Hegel que, pour Parménide, cette distinction a été mal faite depuis ses origines grecques, alors on peut affirmer que la démocratie a été sapée depuis ses origines. Hegel rejette la force de Parménide à distinguer l’être du néant en soutenant « qu’exprimer le résultat, tel qu’il se dégage de la considération de l’être et du néant, par le truchement de la proposition : être et néant sont une seule et même chose, est imparfait»[77].
B. Le rapport entre la démocratie et l’égalité
Le rapport entre la démocratie et l’égalité pose aussi le problème entre l’être et le néant qui, dans l’histoire de la philosophie, n’a pas toujours été bien clarifié. On peut dire que la démocratie n’a pas été bien cernée depuis les origines grecques si pour Hegel, Parménide serait au point de départ de la distinction entre l’être et le néant. Toutefois, avec Alain Boutot, on peut dire que le scandale de la démocratie n’a pas véritablement commencé avec Parménide, mais à partir de Platon. C’est depuis Platon que le scandale de la démocratie est permanent puisque selon lui, « le concept d’Etre est une idée utile à beaucoup d’égards ; mais par le fait qu’il est simplement une idée, il est incapable d’accroître par lui seul notre connaissance par rapport à ce qui existe »[78]. Mais pourquoi Platon n’a-t-il pas réussi à échapper au scandale de la démocratie qu’il dénonçait tant ? Est-ce un mal permanent qui subsiste au cœur même de la démocratie comme une fatalité ?
La contradiction dégagée par Platon au sujet de la démocratie appelée le gouvernement de la multitude est la conséquence d’une contradiction dégagée aussi dans l’étude faite dans Le Parménide. En, effet, « Socrate l’audition finie, aurait prié qu’on relût la première hypothèse du premier argument cela fait, demandé : « Que veux-tu ceci, Zénon ? Que, si les êtres sont multiples, ils ne peuvent manquer d’être à la fois semblables et dissemblables, ce qui est impossible, vu que les dissemblables ne peuvent être semblables, ni les semblables dissemblables ? N’est-ce pas cela que tu veux dire ? »[79] Les interrogations de Socrate ici restent liées à sa forme figée des choses. Alors que la démocratie recherche ce qui est dynamique, ici tout semble statique. « Il est faux que ceci change » alors que « ceci peut changer ». Il aurait fallu dégager cette contradiction qui est en fait un paralogisme non clairement signifié. Toutefois, les choses restent dans l’ombre qui devient de plus en plus épaisse et c’est la démocratie qui est accusée de se démarquer de l’égalité là où il est difficile de traduire en des termes exacts ce que l’on entend par égalité.
L’écart entre le multiple et le particulier constitue l’une des causes du rejet de l’égalité. Mais nous pensons que le rejet s’est fait depuis Platon et par conséquent depuis Platon, le scandale de la démocratie est permanent. En effet, quand Socrate interroge Zénon, il crée aussi la confusion et finalement la difficulté à établir une unité entre le multiple et le particulier se traduit aussi comme l’expression de l’inégalité qu’impose cette relation. Or, la difficulté est aussi du côté de celui qui établit les relations et ne se situe pas seulement dans les relations entre les termes. Par cette question, « donc, s’il est impossible que les dissemblables soient semblables et les semblables dissemblables, il est par là même impossible que le multiple existe parce que le multiple, une fois posé, ne peut échapper à ces possibilités ? »[80], Socrate touche du doigt le problème même s’il refuse de le nommer : la démocratie n’est pas bien perçue. Depuis Platon, le scandale n’était pas fort perçu parce que la possibilité de mettre fin à ce scandale se dessinait dans la démarche de Platon, mais il n’avait pas tous les atouts pour résoudre cette épineuse question qui bouleverse même toute l’humanité. Finalement la permanence du scandale de la démocratie en relation avec l’égalité traduit que l’homme y a un grand intérêt. La recherche de l’égalité ne se limite pas seulement au pouvoir politique, il prend aussi en compte les connaissances de l’homme, chacune recherchant à sa façon et au mieux une voie vers l’égalité. Mais cela n’est pas facile à cerner.
À cette difficulté s’ajoute une autre. La démocratie n’a pas été bien cernée depuis le début. En effet, il n’est pas rare de condamner la démocratie pour telle ou telle raison. On peut le lire par exemple chez Badiou : « Je dois vous dire que je respecte absolument pas le suffrage universel en soi ; cela dépend de ce qu’il fait. Le suffrage universel serait la seule chose qu’on aurait à respecter indépendamment de ce qu’il produit. Et pourquoi donc ? »[81] Cette réaction qui pose le problème du rapport entre le nombre et le suffrage renvoie le problème ailleurs et fait comme si c’est maintenant que le problème de la justice doit être pris en considération quand il s’agit de parler de démocratie. Et le scandale persiste même au niveau de l’actualité où on entend des accusations de tous genres sur la démocratie. Or là où il y a problème, c’est le fait de vouloir apprécier le problème comme un problème nouveau ; ce qui rompt avec l’idée de la permanence du scandale alors que le scandale est permanent depuis les conceptions grecques de la démocratie. D’ailleurs Aristote lui-même relevait déjà ce scandale quand il avançait ceci :
« Il apparaît aux tenants de la démocratie que le juste est quelque chose d’égal, et il l’est en réalité, non pas cependant pour tous, mais pour ceux qui sont égaux (…) or les partisans de la démocratie (…) suppriment ce qui a rapport aux personnes et portent un jugement erroné. La raison en est qu’ils sont ici juges de leur propre cause, et on peut dire que la plupart des hommes sont mauvais juges quand leurs intérêts personnels sont en jeu »[82].
Dans ce cas le scandale de la démocratie touche à tout et se présente alors comme exigeant une nouvelle vision de la politique.
III. LA POLITIQUE ET LA DÉMOCRATIE
Platon résout le scandale de la démocratie par la mise en place d’une politique qui valorise l’aristocratie. Mais cette voie n’a pas été suivie dans l’histoire. On peut dire alors que la démocratie persiste pour autant que les hommes lui donnent une chance d’exister. Dans ce cas, il convient de revoir le plan proposé depuis Platon pour donner une chance à la politique à travers la démocratie. Il convient donc de réviser la thèse de Platon sur la politique qui met au premier plan le philosophe roi ou le roi philosophe.
A. Le nombre et le bien
Depuis Platon, signifie aussi l’héritage de Platon à la postérité. Or, Aristote à la suite de Platon avance « qu’il existe [d’ordinaire] deux types principaux de constitution »[83] liés à la fois à l’aristocratie et à la démocratie. Ce schéma s’avère insatisfaisant parce que selon Aristote le piège de la démocratie reste lié à la présence du nombre au détriment des hommes. Aristote faisait remarquer que l’étude de l’être conduit aussi à l’étude de la politique. Or, la cassure installée dans cette étude avait séparé, pour diverses raisons, la politique de la démocratie. Aristote sort du piège du nombre et fonde la démocratie sur le « bien »[84] comme but. Aristote reproche à Socrate d’avoir réduit la démocratie au nombre au détriment du bien des individus qui se manifeste dans le fait de « rendre la justice et juger conformément au droit. »[85]
Aristote dépasse le nombre par le bien à réaliser chez les individus et la division du travail de Socrate par une division réellement plus complexe à laquelle Socrate n’avait pas accordé une importance capitale. Cette difficulté non résolue par Socrate sur qui Platon s’appuie, ne lui a pas permis de distinguer aussi plusieurs espèces de la démocratie. Aristote éprouve le besoin d’insister sur les espèces de la démocratie et de montrer finalement qu’il y a un lien étroit entre la politique et la démocratie. C’est par la démocratie que la république est possible. Contre Platon, Aristote peut soutenir qu’il existe plusieurs types de gouvernement, plusieurs types de constitution et celles-ci sont variables non pas en tant que nombre, mais en tant que visant le bien des individus. La prédominance des nombres mathématiques chez Platon dans la fondation de la politique, domine également sa thèse du rejet de la démocratie au cœur de la politique. En remplaçant les nombres par les individus, Aristote montrait déjà que la démocratie rend possible la politique. Par cette possibilité, on peut aussi faire confiance à la démocratie. Nous soutenons donc dans cette recherche que le pouvoir a mal compris l’égalité avec Platon, et sous son influence, l’opposition a été maintenue entre la politique et la démocratie alors que la politique et la démocratie vont bien ensemble.
L’analyse d’Aristote montre bien que depuis Platon, la philosophie a perdu de vue le lien étroit entre la politique et la démocratie. Si Platon est fidèle à Socrate, il a cependant habitué la philosophie à fuir les instincts, cette fuite a aussi conduit à l’oubli de l’unité entre la politique et la démocratie. La rupture du lien entre la politique et la démocratie s’exprime aussi comme le refus socratique de l’instinct. L’instinct se présente alors comme le scandale de la raison. Or, le scandale envahit aussi la raison, le scandale est aussi dans le refus de l’instinct. La philosophie, dans le refus de l’instinct, a contribué à la négation de la démocratie et à sa banalisation. Et la banalisation est amère. En effet, « tandis que chez tous les hommes productifs l’instinct est une force affirmative et créatrice, et la conscience une force critique et négative, chez Socrate l’instinct devient critique et la conscience créatrice – c’est une véritable monstruosité par carence. »[86] La monstruosité ou le scandale de la séparation existe depuis Socrate dont le reflet est Platon.
B. Le regard vers la morale
L’unité entre la politique et la démocratie se traduit alors comme la possibilité de repenser le scandale comme l’absence de l’unité. Repenser, c’est ouvrir l’horizon d’une possibilité unificatrice qui conduit à offrir une chance à la politique en vue de la démocratie. Dans ce cas, Kant a aussi raison de critiquer la séparation que Platon érige entre l’individu et l’exercice du pouvoir. Platon présentait constamment le philosophe comme celui par qui cette séparation est contradictoire. Or, le philosophe est un individu. Comment peut-il seulement au nom de la philosophie, fonder la politique ? Si tel est le cas, comment est-il alors possible que la fondation de la politique par le philosophe ne réussit pas à fonder la démocratie comme un gouvernement qui vise aussi le bien et non le nombre ?
Platon était conscient de la décadence de la démocratie. Ce fait qui devenait ordinaire lui a fait perdre de vue la corruption dont l’homme est capable. Selon Emmanuel Kant, « que les rois deviennent philosophes, ou les philosophes rois, on ne peut guère s’y attendre. Il ne faut pas non plus le souhaiter, parce que jouissance du pouvoir corrompt inévitablement le jugement de la raison et en altère la liberté »[87]. C’est dire que ce qui a manqué depuis Platon, c’est la juste perception de la possibilité de l’altération de la liberté du philosophe-roi. Et comme selon Kant, les philosophes n’étaient pas libres suivant le schéma de Platon, la politique et la démocratie n’ont pas fait bon ménage. De plus, Platon avait oublié le rôle de la morale comme devant se mettre même au-dessus de la politique.
La corruption de la raison est possible quand la raison s’appuie sur des mobiles non fondateurs de la liberté. Au lieu de s’appuyer sur les lois de la moralité, celui qui gouverne se donne la possibilité de fonder son agir sur sa propre façon de voir ; dans ce cas l’unité entre la politique et la démocratie est compromise, voire impossible. Pour mettre fin à cette contradiction, Kant met au cœur même de l’agir de tous, le respect. Le respect devient la ligne directrice à partir de laquelle se commande l’agir des hommes. Au lieu d’accuser la politique ou la démocratie, il faut leur donner la chance d’exister en invitant les hommes au respect. Ainsi, les problèmes qui se posent en termes de politique ne suffisent pas, il faut nécessairement incliner la politique vers la morale et la liberté. En effet, « s’il n’y a ni liberté ni loi morale qui en découle ; si tout ce qui est et peut arriver, n’est qu’un simple mécanisme de la nature, toute la science pratique se réduira à la politique, c’est-à-dire à l’art de faire usage de ce mécanisme pour gouverner les hommes ; l’idée du devoir ne sera plus alors qu’une chimère »[88].
Kant avait compris que l’échec de la philosophie politique n’entraîne pas la mort du mauvais roi, mais l’absence de liberté. En effet, les exigences semblaient plus s’imposer au peuple qu’au roi. Dans ce cas la philosophie politique ne conduit pas à la politique. Platon ayant constaté la corruption aurait pu soutenir que c’est la morale qu’il faut consulter par tous. Il ne faut pas être philosophe d’abord pour que la primauté de la morale s’impose à tous. La morale est première, telle est selon Kant l’exigence fondamentale. Ainsi « la politique doit plier le genou devant la morale »[89] parce que c’est la morale qui « tranche le nœud que la politique est incapable de délier »[90]. C’est dire que l’universalité recherchée dans la multitude à travers la politique n’a pas son fondement dans la politique, mais dans la morale. La politique est un moment particulier dans lequel s’exprime des voix fussent-elles majoritaires, mais la reconnaissance de ces voix par le camp adverse ne dépend pas de la politique, mais de la loi morale qui exige du camp adverse le respect de l’autre en tant que fin et jamais comme moyen.
L’universalité redoutée par Platon est possible si les hommes peuvent tourner le regard vers la morale ; cela ne nécessite pas qu’il y ait des philosophes pour leur montrer la voie à suivre. L’exigence morale s’impose selon Kant comme un commandement dont la force est d’exister en chacun de la même manière. L’universalité est recherchée par les hommes parce qu’elle habite naturellement en eux. Dans la pratique quotidienne, il s’agit de passer de l’universalité en soi habitant en chacun vers l’universalité possible dans la pratique de la politique. Ce renversement opéré par Kant montre que l’unité entre la politique et la démocratie s’impose comme un fait moral. Mais est-ce à dire que la morale échappe à la corruption ? N’est-ce pas au nom de la morale que certains sont bafoués ? En quoi la force de la morale est-elle inébranlable là où elle semble piétiner ?
Le problème de l’unité dégagée dans la majorité prise comme le multiple par Platon, revient à la surface, mais d’une autre manière. La morale doit pouvoir conserver la force de l’universalité que lui accorde Kant au risque de la céder à autre chose ; ce qui apparaît suivant le schéma kantien comme le remplacement de l’un par le multiple et inversement. Dans ce cas, que convient-il de faire ? Faut-il simplement dire que le rapport entre la politique et la démocratie se posant comme une relation entre l’un et le multiple, reprend finalement le scandale de la démocratie comme un fait nécessaire ? Est-il possible de dépasser le scandale de démocratie élaboré depuis Platon par la reconsidération du rapport entre l’un et le multiple ? Que gagne finalement la philosophie à poser tous les problèmes comme des problèmes mettant en relation l’un et le multiple ? Selon Jean-Marie Donegani et Marc Sadoun, « cette question remonte à l’origine de la philosophie et parcourt toute l’histoire de la pensée. Elle condense le mieux la nature de l’interrogation ontologique prise entre le scandale du pluriel et le mystère de l’unique, tendue entre la dérive de l’hétérogénéité et la tentation de l’unité »[91].
CONCLUSION
Si toute la vie de l’homme se réduisait à contester la démocratie alors on peut dire que la vie de l’homme est bien menée parce qu’il ne se passe pas un jour sans que la démocratie ne soit contestée. Or, la démocratie n’est pas contestée parce que l’homme en tire une satisfaction, mais parce qu’il veut être totalement libre. Avec Platon, nous avons découvert dans cette réflexion que la démocratie n’est pas source de libération de l’homme parce que c’est un pouvoir non du peuple, mais un pouvoir écrasant le peuple. Ce rapport négatif de la démocratie au peuple qui devrait se limiter au monde grec antique, a traversé l’histoire et est encore actuel avec ses pires visages. Il est bon de dénoncer le scandale de démocratie et de montrer que cet effort de négation a été mis en place depuis les origines grecques. C’est un combat qui a été entrepris depuis longtemps dont la portée est aussi libératrice que la démocratie tant vantée. C’est en pointant du doigt le scandale de la démocratie que les hommes recherchent les fondements de la liberté sur de nouvelles bases comme la morale par exemple. La force de la morale à œuvrer pour la libération des hommes, réside dans son universalité à commander les hommes à ne rechercher que le bien des autres parce que l’homme est la seule fin du bonheur de l’homme. C’est en visant l’homme comme fin que la critique du scandale de la démocratie par Platon prend un sens orignal et ontologique.
BIBLIOGRAPHIE
ABENSOUR, Miguel, La démocratie contre l’État, Paris, P.U.F., 1997.
ARISTOTE, La Politique, Paris, Vrin, 1962, trad. J. TRICOT.
BADIOU, Alain, De quoi Sarkozy est-il le nom, Paris, Éditions Lignes, 2007.
BOUTOT, Émile, Heidegger et Platon Le problème du nihilisme, Paris, PUF, 1987.
De TOCQUEVILLE, Alexis, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1986, Tome I.
DONEGANI, Jean-Marie, SADOUN, Marc, La démocratie imparfaite, Paris, Gallimard, 1994.
DROIT, Roger-Pol, La compagnie des philosophes, Paris, Éditions Odile Jacob, 1998.
HEGEL, G W. F., Science de la Logique, Premier tome, Premier livre, Paris, Aubier, 1972.
KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure in Œuvres philosophiques, Paris,Gallimard, 1980, trad. Alexandre J.-L. DELAMARRE et François MARTY, Tome I.
KANT, Emmanuel, Projet de paix perpétuelle in Œuvres philosophiques, Paris,Gallimard, 1986, trad. Heinz WISMANN, Tome III.
NIETZSCHE, Friedrich, La naissance de la tragédie, Paris, Gallimard, 1949, trad. Géneviève BIANQUIS.
PLATON, Œuvres complètes, Paris, Les Belles Lettres, 1967, tome 8.
PLATON, Politique in Sophiste Politique Philèbe Timée Critias, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, trad. Émile CHAMBRY.
ROSANVALLON, Pierre, La légitimité démocratique, Paris, Seuil, 2008.
SCHAERER, René, L’homme antique et la structure du monde intérieur, Paris, Payot, 1958.
L’AFRIQUE FACE AU VERDICT HÉGÉLIEN DE LA FIN DE L’HISTOIRE
Oumar DIA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
RÉSUMÉ :
Le problème que nous nous sommes posé dans ce texte est celui de savoir si des peuples (les Africains par exemple) qui, d’après Hegel, n’auraient joué aucun grand rôle dans l’histoire universelle, peuvent profiter de l’acquis de cette dernière et se retrouver − contre toute attente peut-être ! − au devant de la scène mondiale. La compréhension que nous avons eue de ce que Hegel considère comme la fin de l’Histoire nous a amenés à reconnaître l’existence de deux niveaux en histoire chez lui : l’histoire universelle qui a une fin et l’histoire empirique destinée à ne jamais finir. C’est cette distinction qui ouvre la possibilité à des peuples qui ont été d’après Hegel absents de la première histoire (l’histoire universelle) à jouer un grand rôle dans la seconde (l’histoire empirique). L’Afrique, comme tous les autres peuples du monde, a donc la possibilité aujourd’hui d’être présente sur la scène mondiale. Mais cette possibilité ne peut-être effective que si l’Afrique réussit à apporter des réponses adéquates aux défis du temps présent.
Mots-clés : Afrique, Défi, Fin de l’Histoire, Histoire empirique, Histoire universelle, Mondialisation, Réponse.
ABSTRACT :
The question raised in this paper is whether some peoples ( the African people for instance), who, in Hegel’s view, did not play any prominent role in universal history, can still make advantage of the latter, and unexpectedly find themselves on the international scene. I came to identify two levels of history in Hegel’s philosophy: universal history, which has an end, and empirical history, which is supposed to never come to an end. This distinction allows for peoples that, in Hegel’s view, have been missing from universal history, the possibility to play a prominent role in empirical history. Consequently, like all other peoples in the world, African peoples have the possibility to be present, today, on the international scene. But this possibility can only be effective if Africa succeeds in coming up with relevant answers to the challenges of present time.
Keywords : Africa, Challenge, empirical History, end of History, Globalization, Response, universal History.
INTRODUCTION
La question posée dans cette contribution est de savoir si des peuples qui, d’après Hegel, n’auraient joué aucun rôle dans l’histoire universelle, peuvent aujourd’hui profiter de l’acquis de cette dernière et occuper une place que le philosophe allemand ne leur reconnaissait pas sur la scène mondiale. Cette question, lourde de sens, s’impose, à notre avis, à tout philosophe africain qui pense le monde – la philosophie hégélienne est une philosophie du monde[92] – à partir de la plateforme hégélienne.
Un philosophe africain qui pense le monde à partir de Hegel ne peut donc raisonnablement faire l’impasse sur une telle question. Il pourrait d’ailleurs convaincre de la nécessité de réfléchir sur cette dernière en montrant que celle-ci trouve sa source et sa justification dans les textes mêmes de Hegel. En effet, dansl’introduction aux Leçons sur l’histoire de la philosophie et dans la préface aux Principes de la philosophie du droit, Hegel assigne comme tâche au philosophe de penser l’urgence du temps présent. Dans l’introduction aux Leçons sur l’histoire de la philosophie, il refuse la dignité philosophique à toute pensée qui ne ferait qu’exhumer des systèmes philosophiques dépassés. Pour lui, de tels systèmes philosophiques n’ont aucune chance de retrouver leur actualité. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre ces propos du philosophe de Berlin
« Animer de nouveau ces philosophies, vouloir ramener à elles l’esprit qui s’est pénétré plus à fond serait l’impossible et une sottise semblable à celle de l’homme qui s’efforcerait d’être de nouveau un jeune homme, ou du jeune homme qui voudrait redevenir un garçon ou un enfant, quoique l’homme, le jeune homme et l’enfant soient le même individu (…) des momies qu’on introduit dans ce qui vit ne peuvent s’y maintenir »[93].
Dans la préface aux principes de la philosophie du droit, Hegel assigne une autre limite à la philosophie, apparemment opposée à celle de l’introduction aux Leçons sur la philosophie de l’histoire. Dans cette seconde œuvre, il rejette de façon catégorique l’idée que la philosophie puisse être conçue comme une pensée située par-dessus son temps. C’est dans ce sens qu’il écrit :
« Concevoir ce qui est, est la tâche de la philosophie, car ce qui est, c’est la raison. En ce qui concerne l’individu, chacun est le fils de son temps ; de même aussi la philosophie, elle résume son temps dans la pensée. Il est aussi fou de s’imaginer qu’une philosophie quelconque dépassera le monde contemporain que de croire qu’un individu sautera au-dessus de son temps, franchira le Rhodus. Si une théorie, en fait, dépasse ces limites, si elle construit un monde tel qu’il doit être, ce monde existe bien, mais seulement dans son opinion, laquelle est un élément inconsistant qui peut prendre n’importe quelle empreinte »[94].
La contradiction apparente entre ces deux conceptions hégéliennes de la philosophie – d’une part, défense absolue de ranimer sans esprit critique des pensées antérieures et, d’autre part, interdiction tout aussi absolue de discourir sur l’avenir – permet en réalité à Hegel de délimiter la sphère du discours philosophique et de définir son objet. En définissant la philosophie comme un discours sur le présent, Hegel ne fait rien d’autre qu’inviter tout philosophe à penser les défis de son temps. Le philosophe africain qui pense à partir de Hegel ne peut pas constituer une exception ; il est condamné – sous peine de se voir disqualifié comme philosophe –, à prendre en charge les problèmes de son temps. D’où la nécessité pour lui d’identifier judicieusement les défis de son époque et d’y proposer des solutions idoines.
Apprenant nous-même à philosopher à partir de Hegel, c’est un tel objectif que nous nous proposons dans le présent article que nous avons divisé en trois parties. Dans la première partie, nous traitons du rapport que Hegel établit entre l’Afrique et l’histoire universelle ; dans la deuxième partie, de l’existence chez lui de deux niveaux en histoire – ce qui ne condamne aucun peuple à rester à la périphérie du monde et donc dénote au moins d’une certaine forme d’histoire chez tous les peuples – et dans la troisième partie, des défis que doit relever l’Afrique pour occuper une place importante sur la scène mondiale.
I. LE RAPPORT DE L’AFRIQUE A L’HISTOIRE UNIVERSELLE
Une lecture de la raison dans l’histoire amène à constater que la démarche suivie par le philosophe Hegel est différente de celle que suivent d’habitude les historiens professionnels. Là où ces derniers mettent l’accent sur les événements empiriques qui se succèdent dans le temps, Hegel, lui, s’intéresse davantage à ce qu’il qualifie de déterminations essentielles de l’esprit du monde. Ces dernières sont, pour lui, plus importantes dans l’exposé de l’histoire universelle que les évènements empiriques qui se succèdent dans le temps et qui, pour l’opinion, font l’actualité. Cette primauté accordée aux déterminations essentielles de l’esprit du monde par rapport aux évènements empiriques en tant que tels s’accompagne, chez le philosophe de Berlin, d’une discrimination dans le temps et dans l’espace.
Pour Hegel, l’histoire universelle n’a pas concerné toutes les époques et tous les peuples. En effet, il y a bien chez lui un début de l’histoire universelle, un point de départ précis qui est le moment à partir duquel l’esprit du monde a entrepris le long parcours devant le mener à la connaissance de soi-même, mais également un moment où, dans le cadre de ses activités créatrices, il est arrivé à maturité dans le savoir qu’il a de sa propre liberté. Ces deux limites que sont la préhistoire et la post-histoire encadrent toute l’histoire universelle qui, seule, mérite de retenir l’attention du philosophe. Cette première forme de discrimination dans l’exposé hégélien de l’histoire universelle va toutefois de pair avec une autre qui a lieu dans l’espace et qui est en rapport direct avec le trajet spatial de l’esprit du monde.
Pour Hegel, l’esprit du monde qui régit les évènements historiques ne s’est pas manifesté dans tous les endroits du monde. En réalité, il n’a parcouru que les lieux géographiques où les peuples se sont organisés en États et ont laissé à la postérité, par la médiation de l’écriture et de l’archive, la possibilité de connaître leur passé. C’est ainsi qu’il exclut de l’histoire universelle tous les peuples naturels et sans culture qui n’ont pas participé à la finalité de l’histoire universelle qui est l’avènement de l’État rationnel moderne. Dans son exposé de l’histoire universelle, Hegel avance que cette dernière va de l’Orient qui constitue son début, le moment par excellence du lever du soleil extérieur – « le soleil se lève à l’orient »[95] – à l’Occident qui en est véritablement le terme, c’est-à-dire le moment tant attendu et espéré du lever du soleil intérieur de la conscience. Parlant de cette trajectoire de l’histoire universelle, de son début et de sa fin, à savoir l’Asie et l’occident Hegel affirme : «ici se lève le soleil extérieur physique (…)et à l’Ouest il se couche, mais à l’Ouest se lève le soleil intérieur de la conscience qui répand un éclat supérieur »[96].
Avec une telle démarche, Hegel ne pouvait pas s’intéresser à tous les peuples et à toutes les époques. Ce qui a véritablement retenu son attention, c’est l’histoire des moments où se sont objectivées les déterminations essentielles de « l’esprit du monde ». Ces moments correspondent, chez lui, à quatre principaux peuples historiques : les Orientaux, les Grecs, les Romains et les Germains. L’ordre croissant de ces étapes de l’histoire universelle n’est rien d’autre que la manifestation graduelle des principaux niveaux historiques de conscience de la liberté et d’avènement progressif de l’État rationnel moderne. Pour Hegel, l’histoire universelle nous livre une série de civilisations et d’États, qui apparaissent successivement au premier plan de la scène historique, qui atteignent leur apogée à un certain moment, avant de sombrer dans la décadence pour ne plus réapparaître. S’il en est ainsi, il faut admettre qu’un peuple – si éminent soit-il – ne fait époque qu’une seule fois dans l’histoire.
Mais, cette possibilité consistant à ne faire époque qu’une seule fois dans l’histoire n’est pas un privilège partagé par tous les peuples. Pour Hegel, seuls les Orientaux, les Grecs, les Romains et les Occidentaux[97] ont incarné un principe de l’esprit du monde. Tous les autres peuples – les Africains notamment – se situent en dehors de l’histoire universelle. D’ailleurs, à propos du rapport précis de l’Afrique à l’histoire universelle Hegel avance la sentence que voici :
« L’Afrique proprement diteest la partie de ce continent qui en fournit la caractéristique particulière. Ce continent n’est pas intéressant du point de vue de sa propre histoire, mais par le fait que nous voyons l’homme dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l’empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. L’Afrique aussi loin que remonte l’histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde ; c’est le pays de l’or, replié sur lui-même, le pays de l’enfance qui, au-delà du jour de l’histoire consciente, est enveloppée dans la couleur noire de la nuit »[98].
L’Afrique est, pour Hegel, en dehors de l’histoire puisque jusqu’au moment où il professait ses leçons sur la philosophie de l’histoire à Berlin, aucune des déterminations essentielles de l’esprit du monde n’avait été actualisée d’après lui par le continent noir[99].
Pourtant, ce verdict relatif à la place de l’Afrique dans l’histoire universelle pourrait ne pas être paralysant ou démotivant pour les Africains s’il n’était pas accompagné dans la philosophie de l’histoire de Hegel par un autre, plus terrible ; celui de la fin de l’Histoire. En effet, au moment où Hegel situait l’Afrique et d’autres peuples au seuil de l’histoire universelle, il nous apprenait en même temps que l’esprit du monde, qui régit les évènements historiques, avait fini d’exposer son sens politique total. Ayant fini de produire après les étapes orientale, grecque, romaine et germanique la structure socio-politique vraie de l’existence dans la monarchie constitutionnelle prussienne, l’esprit a désormais, selon Hegel, le loisir de s’adonner à la production absolue de son sens absolu dans l’art, la religion et la philosophie. L’esprit ayant désormais son intérêt ailleurs que dans la sphère historico-politique[100], aucun autre peuple ne pourra plus avoir le privilège d’incarner une détermination à la fois nouvelle et vraie de l’esprit du monde. C’est ce que Bernard Bourgeois exprime en ces termes :
« L’histoire universelle, celle de l’universel, des déterminations universelles régissant l’existence historique des hommes, est une histoire finie. Et l’actualité de cette fin signifie pour Hegel que, désormais, aucune détermination à la fois nouvelle et fondamentale ne viendra régir de façon vraie, c’est-à-dire durable, la vie socio-politique de l’humanité »[101].
Avec ce verdict, l’Afrique, comme les autres peuples que Hegel a situés hors de l’histoire universelle, perd tout espoir de pouvoir un jour actualiser une des déterminations essentielles de l’esprit du monde et faire, elle aussi, une fois, époque dans l’histoire. Du point de vue de l’histoire universelle exposée par Hegel, la messe serait dite pour l’Afrique et les Africains: l’Afrique et les Africains n’ont pas compté et ne compteront pas parmi les peuples historiques. Dans la philosophie de l’histoire de Hegel, les évènements post-historiques n’ont pas la même dignité que ceux de l’histoire universelle. C’est ce qui amène probablement Mahamadé Savadogo à écrire: «Il est manifeste que l’achèvement de l’histoire que proclame la philosophie hégélienne réduit la portée de tout événement postérieur à sa formation »[102].
Une telle présentation de l’histoire universelle pourrait susciter chez certains Africains le sentiment amer qu’ils n’ont désormais rien d’exceptionnel à apporter au monde et que même la possibilité pour leur continent de s’affirmer un jour comme une grande puissance mondiale est totalement exclue d’un point de vue hégélien. À notre avis, une bonne compréhension de ce que Hegel considère comme étant la fin de l’Histoire ouvre la possibilité à des peuples qui n’ont joué, d’après lui, aucun rôle dans l’histoire universelle, d’entrer dans une autre histoire – la petite – et de marquer celle-ci de leur empreinte.
II. DEUX NIVEAUX EN HISTOIRE CHEZ HEGEL
L’option philosophique en faveur de deux niveaux en histoire a permis à Hegel de séparer l’histoire universelle qui a une fin et l’histoire événementielle ou empirique destinée à ne jamais finir. C’est seulement de cette façon qu’il est parvenu à proclamer sans se contredire la fin présente de l’Histoire. Quand Hegel parle donc de fin de l’Histoire, il ne fait pas allusion à l’histoire empirique en vigueur sur la scène mondiale mais à celle des moments où se sont objectivés, d’après lui, les déterminations essentielles de l’esprit du monde. L’histoire qui l’intéresse est celle de la prise de conscience progressive par l’esprit de sa finalité qui est la liberté. C’est ce que reflète sa démarche dans ses réflexions philosophiques sur l’histoire. En effet, là où l’historien professionnel se serait penché essentiellement sur les évènements empiriques en vigueur dans le monde, le philosophe Hegel, lui, s’intéresse à la raison dans l’histoire. C’est pour cette raison que, dans sa philosophie, l’histoire, tout comme sa fin, est essentiellement politico-étatique. Sa fin signifie d’un point de vue philosophique que l’intérêt fondamental de l’esprit n’est plus à chercher dans l’histoire et la politique mais dans la spéculation. À la fin de l’Histoire, l’intérêt historico-politique subsiste certes, mais il se retrouve subordonné au Savoir absolu qui devient pour Hegel le lieu véritable de la réconciliation, de la jouissance du chez-soi.
Ces précisions, sur le sens à donner au concept de fin de l’Histoire, permettent de comprendre les raisons pour lesquelles Hegel s’est intéressé principalement à l’histoire de la conscience de la liberté. Celle-ci s’accomplit, comme il le démontre lui-même dans Les Principes de la philosophie du droit, dans la figure politico-étatique dont les composants sont : lien rationnel d’abord de la sphère religieuse et de la sphère socio-étatique, puis de l’État et de la société. La fin de l’Histoire dont parle Hegel est celle de l’histoire des grands principes politiques, et essentiellement du processus laborieux et deux fois millénaire d’invention des structures universelles vraies de l’existence politique ou tout simplement de ce qu’il appelle le droit en général. Pour lui, la figure de l’État moderne représente le telos de cette longue histoire d’invention des structures universelles vraies de l’existence politique.
Toutefois, si sur le plan des principes, aucune structure à la fois nouvelle et vraie de l’esprit ne peut plus venir au jour, sur le plan empirique le processus de réalisation de l’acquis de l’histoire universelle est sans fin. Seule l’histoire narrée par le philosophe est susceptible d’avoir une fin. Celle de l’historien est toujours nouvelle et donc ultimement sans fin[103]. Bernard Bourgeois a donc raison d’écrire que « la fin de l’Histoire comme réalisation essentielle du sens de l’histoire n’est pas la fin de l’histoire comme processus de réalisation empirique multiple de ce sens »[104]. Au sein de cette dernière histoire, qui se manifeste aujourd’hui sous la figure de la mondialisation, l’Afrique, comme n’importe quel autre peuple invisible de nos jours sur la scène mondiale, peut entrer et s’imposer comme l’ont fait les États-Unis et comme le font aujourd’hui de nouvelles puissances comme la Chine et l’Inde que Hegel avait pourtant tous exclus de l’histoire universelle au moment où cette dernière s’achevait d’après lui. L’exclusion de l’histoire universelle – fût-elle prononcée par un philosophe aussi éminent que Hegel – n’implique pas ipso facto l’impossibilité d’émerger ou de ré-émerger sur la scène mondiale. Mais cette possibilité qu’ont tous les peuples du monde d’émerger sur la nouvelle scène mondiale ne peut être effective que s’ils refusent de se complaire dans des idéologies passéistes qui pourraient se présenter comme des momies qu’on introduit dans ce qui vit pour identifier et affronter de façon lucide les obstacles auxquels ils sont confrontés.
Pour ce qui est du cas spécifique de l’Afrique, il faut reconnaître que la marginalisation est aujourd’hui le principal problème auquel elle est confrontée. C’est du moins le constat fait par Gilbert Zué-Nguéma dans son ouvrage intitulé Africanités hégéliennes: alerte à une nouvelle marginalisation[105]. D’ailleurs, pour ce spécialiste de Hegel, les philosophes africains ont des leçons à tirer des propos du philosophe allemand sur leur continent, qui sont, selon lui, révélateurs d’un fait indéniable; celui de la marginalisation de l’Afrique y compris sur le plan de la production du savoir[106]. Si les Africains veulent occuper une place honorable sur la nouvelle scène mondiale, une place à la hauteur du passé glorieux qu’ils s’attribuent souvent, ils doivent résoudre le problème de la marginalisation de leur continent. À son niveau, il est attendu du philosophe africain qui pense à partir de Hegel qu’il invente les voies qui conduiront l’Afrique à sortir de la marginalisation. Pour ré-émerger sur la scène mondiale et sortir donc de la marginalisation, les Africains doivent nécessairement identifier les défis du temps présent – l’Afrique d’aujourd’hui est très différente de celle des générations antérieures – et leur apporter les réponses politiques, économiques, scientifiques et philosophiques adéquates.
III. RÉPONDRE AUX DÉFIS DE L’ÉPOQUE
Dans « Défi-et-réponse »[107], l’historien anglais Arnold Toynbee définit les grandes civilisations et les grands moments de l’histoire du monde comme des réponses pertinentes aux défis posés par les différents milieux naturels et les différentes époques. L’avènement d’une grande civilisation ou d’une grande époque historique n’est donc pas fortuit selon Toynbee. En tant que réponse adéquate à un défi précis, il relèverait d’une sorte de nécessité implacable. Cette idée de Toynbee n’est pas nouvelle dans toutes ses facettes. En réalité, elle se rapproche et s’éloigne à la fois de la théorie hégélienne de l’histoire universelle. Elle s’en rapproche dans la mesure où, comme cette dernière, elle considère les principaux moments de l’histoire du monde comme des réponses à des défis précis mais elle s’en éloigne également parce que, pour elle, le défi géographique ou environnemental ne constitue pas, dans l’absolu, un obstacle insurmontable. D’ailleurs, tout au long du texte « Défi-et-réponse », Toynbee s’évertue à montrer que plus le défi naturel est grand, plus le stimulant pour le vaincre est puissant. Ce qui n’est pas du tout le cas chez Hegel qui condamne les Africains, par exemple, à rester en dehors de l’histoire universelle à cause de la grande hostilité de leur environnement géographique.
Toutefois, ce qu’il faut retenir des théories sur l’histoire universelle de Hegel et de Toynbee, c’est qu’une civilisation est la réponse à des défis d’ordre naturel, politique, économique, scientifique et philosophique. Un peuple n’émerge comme civilisation phare que s’il arrive à identifier les défis de son époque et à leur apporter des réponses adéquates. Si l’Afrique veut donc aujourd’hui sortir de sa marginalisation, elle doit nécessairement identifier les défis du temps présent et leur apporter des solutions idoines. Ce qui l’obligerait à tenir compte de la phase actuelle de l’histoire du monde caractérisée par la mondialisation. Cette dernière se présente comme un processus multidimensionnel et contradictoire que l’Afrique aurait tort d’ignorer d’autant plus qu’il détermine fortement le contenu, l’orientation, le rythme et les modalités de la marche du monde dans lequel elle évolue. Face à la mondialisation en cours, l’Afrique ne doit pas se comporter comme si elle évoluait hors du monde. Ignorer les problèmes et les défis que la mondialisation pose à l’humanité entière équivaudrait, de sa part, à adopter une attitude la condamnant à évoluer hors du nouvel ordre mondial. En réalité, les problèmes et les défis que l’humanité d’aujourd’hui a à résoudre sont également ceux de l’Afrique.
Dans son texte intitulé « Projet d’une philosophie de la mondialisation »[108], le philosophe sénégalais Sémou Pathé Guèye, envisageant la mondialisation au-delà de ses simples aspects économiques, la présente aussi comme « le symptôme d’une « crise de civilisation » qui pose à tous les peuples, chacun en fonction de ses repères culturels spécifiques et de son degré d’implication dans le mouvement actuel du monde, des défis historiques cruciaux qui engagent leur avenir »[109]. Parmi les défis qui semblent les plus décisifs à Sémou Pathé Guèye pour le monde d’aujourd’hui et auxquels il se doit d’apporter des réponses, nous avons :
- Le défi de l’orientation : Celui-ci pose, selon Sémou Pathé Guèye, la question de savoir si nous avons encore les moyens d’infléchir la marche actuelle du monde de sorte à ne pas subir la mondialisation mais à en tirer profit. Relever un tel défi reviendrait de son point de vue à reprendre l’initiative historique que nous semblons avoir perdue avec la mondialisation néo-libérale.
- Le défi philosophique : Il a pour lui une double dimension dans la mesure où il pose d’une part la question de notre capacité à penser notre monde dans sa complexité et dans l’accélération de son temps et d’autre part celle de la signification et de la finalité à assigner à notre existence et à nos actions.
- Le défi éthique : Il consiste, selon l’auteur du texte, à nous demander si nous nous identifions à des valeurs sous l’autorité desquelles nous plaçons notre existence et notre conduite de tous les jours.
- Le défi culturel : Ce défi pose, d’après le philosophe sénégalais, la question de savoir si face à la tendance actuelle à l’uniformisation culturelle sur la base des valeurs occidentales (parfois indûment estampillées du sceau de l’universalité), il est possible aux autres peuples et donc aux Africains de sauvegarder et de promouvoir leurs propres valeurs de civilisation, dans le cadre de ce que Senghor aura appelé « le rendez-vous du donner et du recevoir ».
- Le défi politique: Il invite à repenser la politique au-delà de la simple question de la démocratie autour de laquelle un large consensus s’est dégagé depuis la chute du mur de Berlin. Relever le défi politique qui se pose à tous quoiqu’à des degrés différents, revient à mettre en œuvre une pratique politique qui soit non seulement acceptable moralement mais aussi rigoureusement centrée sur le citoyen restauré dans son statut de sujet authentique de l’histoire et de la politique.
- Le défi économique : Il exige de trouver une alternative crédible au système capitaliste en vigueur dans la mondialisation. Face à ce système qui accorde plus d’importance au profit qu’à la promotion des humains, le monde, et singulièrement l’Afrique, a-t-il les moyens de mettre en place un système alternatif d’exploitation des ressources naturelles et de production sociale des richesses qui fasse de la satisfaction des besoins matériels, sociaux et culturels de tous, une sure priorité ?
- Le défi social : Avec lui, nous sommes amenés à nous demander comment abolir les mécanismes économiques, politiques, sociaux et culturels à l’origine de la pauvreté et de l’exclusion de l’immense majorité des populations du Monde en général et de l’Afrique en particulier de l’essentiel des profits générés par la mondialisation. Relever ce défi reviendrait à donner l’occasion à ces populations de tirer tout le profit possible de leur génie créateur.
- Le défi scientifique : Ce défi pose à tous la question de savoir comment s’approprier des avancées les plus récentes de la science, de la technique et de la technologie considérées de plus en plus, à juste titre, comme les « nouveaux pouvoirs » tout en tirant le meilleur parti possible des techniques et des technologies endogènes par lesquelles, avant l’universalisation de la « modernité » occidentale, divers peuples, y compris les Africains, avaient réussi à assurer leur survie en maîtrisant et en dominant à leur manière la nature.
- Le défi idéologique : Lié également au défi économique, il pose la question de savoir comment, devant la proclamation insistante de la mort des idéologies qu’on peut légitimement soupçonner d’être un discours idéologique[110], les populations désœuvrées qui subissent le poids de la mondialisation néo-libérale peuvent proposer des mythes et des utopies alternatives qui soient le reflet de leurs aspirations fondamentales et de leurs conditions concrètes d’existence.
- Le défi écologique : face aux graves problèmes écologiques causés par la surexploitation des ressources de notre planète, avons-nous les moyens d’envisager une alternative réaliste qui nous permette de continuer à profiter des richesses de la nature tout en ne compromettant pas notre survie et celle des générations futures ?
Ces dix défis majeurs de l’époque de la mondialisation identifiés par Sémou Pathé Guèye se posent à tous les peuples du monde quoiqu’à des degrés différents. L’urgence des réponses à apporter à ces défis dépend donc de la position qu’on occupe sur la scène mondiale. Plus la position occupée sur la scène mondiale est marginale, plus l’urgence à relever les défis énumérés par le philosophe sénégalais est grande. C’est ce qui, à notre avis, condamne l’Afrique, plus que tout autre continent, à s’attaquer sans tarder à ces défis de la mondialisation. Ils sont certes tous très importants, mais leur ordre d’exposition obéit probablement chez l’auteur du « Projet d’une philosophie de la mondialisation » à un ordre de priorités qu’il faut, autant que possible, respecter. Quand on se penche sur l’ordre d’énumération de ces défis de l’époque de la mondialisation, on se rend compte qu’une certaine priorité est accordée à l’éducation et à la formation. En procédant de la sorte, Sémou Pathé Guèye plaidait probablement pour une mondialisation qui ne réduise pas l’être humain à sa dimension strictement matérielle. Si l’Afrique d’aujourd’hui arrive donc à résoudre ces dix défis majeurs de la mondialisation sans négliger les priorités qu’impose leur ordre d’exposition, elle sortirait non seulement de la marginalisation où elle se trouve actuellement mais elle apporterait une alternative crédible à la mondialisation néo-libérale en cours qui réduit l’être humain à une dimension strictement matérielle. Ce qui serait, de sa part, une contribution non négligeable au « rendez-vous du donner et du recevoir ».
CONCLUSION
En intitulant cet article « L’Afrique face au verdict hégélien de la fin de l’Histoire », nous n’avions pas cherché une occasion de reprendre à nouveaux frais le vieux débat sur le rapport de Hegel à l’Afrique qui se réduit généralement à la question de savoir si les propos du philosophe allemand sur le continent noir relèvent ou non d’une attitude raciste. Nous avons plutôt cherché dans les propos de Hegel sur l’Afrique un prétexte pour penser la situation actuelle de notre continent. Cette démarche, fidèle à celle de Hegel qui fait injonction à tout philosophe de penser les défis de son temps, nous a amené au constat froid que l’Afrique d’aujourd’hui est absente des grandes décisions et des grandes innovations qui engagent le devenir de l’humanité. Mais, ayant admis également que la marginalisation actuelle de l’Afrique n’était nullement une fatalité – même pour la philosophie qui l’a exclue définitivement de l’histoire universelle –, il nous revenait de chercher à identifier les défis qui se posent à notre continent et auxquels il se doit impérativement d’apporter des réponses s’il veut être présent, selon l’expression de Senghor, au « rendez-vous du donner et du recevoir ». À notre avis, l’une des conditions minimales à remplir pour être présent à ce « rendez-vous » c’est d’apporter, comme tous les autres peuples mais avec une plus grande urgence pour les Africains, des réponses adéquates aux dix défis majeurs de la mondialisation dont a parlé le défunt philosophe sénégalais Sémou Pathé Guèye.
BIBLIOGRAPHIE
BOURGEOIS, Bernard, Éternité et historicité de l’esprit selon Hegel, Paris, Vrin, 1991.
BOURGEOIS, Bernard, Études hégéliennes: raison et décision, Paris, PUF, 1992.
BOURGEOIS, Bernard, La raison moderne et le droit politique, Paris, Vrin, 2000.
BOURGEOIS, Bernard, « La philosophie du monde », in Le Magazine littéraire, n°293, novembre 2001, pp. 39-46.
D’HONDT, Jacques, Hegel, philosophe de l’histoire vivante, Paris, PUF, 1987.
DUMONT, René, L’Afrique noire est mal partie, Paris, Éditions du Seuil, 1962.
GUEYE, Sémou Pathé, « Fin de l’histoire et perspective de développement: l’Afrique dans le temps du monde » in DIAGNE, S.B.D. et KIMMERLE, H, dir., Temps et développement dans la pensée de l’Afrique subsaharienne, 1997, pp. 73-101.
GUEYE, Sémou Pathé, « Projet d’une philosophie de la mondialisation », in Éthiopiques, n°64-65, 1er et 2ème semestre 2000, pp. 184-199.
HEGEL, G.W.F., La raison dans l’histoire, trad. K. PAPAOAINNOU, Paris, UGE, 1965.
HEGEL, G.W.F., Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. J. GIBELIN, Paris, Vrin, 1965.
HEGEL, G.W.F., Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. J. GIBELIN, Paris, Gallimard, 1957.
HEGEL, G.W.F., Principes de la philosophie du droit, trad. A. KAAN, Paris, Gallimard, 1940.
KABOU, Axelle, Et si l’Afrique refusait le développement? Paris, L’Harmattan, 1991.
SARKOZY, Nicolas, « Discours adressé à la jeunesse africaine », Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 26 juillet 2007.
SAVADOGO, Mahamadé, Philosophie et histoire, Paris, L’Harmattan, 2003.
SPIRE, Arnaud et NIELSBERG, Jérôme Alexandre, L’Idéologie toujours présente, Paris, la Dispute, 2006.
TOYNBEE, Arnold, L’histoire, trad. Jacques POTIN et Pierre BUISSERET, Bruxelles, Elsevier Séquoia, 1978.
ZUÉ-NGUMA, Gilbert, Africanités hégéliennes: alerte à une nouvelle marginalisation de l’Afrique, Paris, L’Harmattan, 2006.
DU POUVOIR MÉTAMORPHIQUE DE L’ART CHEZ NIETZSCHE
Dagnogo BABA
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Dans l’esthétique de Nietzsche, l’art se caractérise par trois pouvoirs métamorphiques : le pouvoir de délivrance, le pouvoir éducatif et le pouvoir perfectionniste. Par ces pouvoirs, l’homme maîtrise les forces artistiques et culturelles. Ce qui lui permet de vaincre le mal inhérent à la vie en triomphant de la souffrance par la glorification de la beauté, de parachever par son pouvoir démiurge de l’éducation et l’effort de perfectionnement, l’œuvre incomplète de la Nature.
Mots-Clés : Délivrance, Éducation, l’Art, Métamorphose, Perfection, Plaisir.
ABSTRACT :
In the aesthetics of Nietzsche, art is characterized by three metamorphic powers: the power of deliverance, the educational power and perfectionist power. With these powers, man controls artistic and cultural forces. This allows man to defeat the evil inherent in life by overcoming suffering through the glorification of beauty, complete the work incomplete nature with the demiurge power of education and self-improvement.
Keywords : Delivery, Education, Art, Metamorphosis, Perfection, Pleasure
INTRODUCTION
Entrer dans l’œuvre de Nietzsche, c’est pénétrer dans les infinis méandres de du concept de vie. La présence constante de ce concept dans cette philosophie montre qu’il est le plus problématique auquel s’attache Nietzsche. S’il fait de cette notion la problématique fondatrice de sa philosophie, c’est parce que, comme l’annonce l’avant-propos de son ouvrage : Le cas Wagner[111], il est préoccupé par le problème de la décadence de l’homme, de l’appauvrissement de la vie et de la dégénérescence humaine. C’est cette angoisse philosophique qu’il nous annonce en ces termes : « Ma préoccupation la plus intime a toujours été, en fait, le problème de la décadence »[112] humaine. Ayant participé à la guerre Franco-allemande de 1780 comme ambulancier, Nietzsche, dans ses contacts avec les blessés, va vivre dans sa chaire et dans son âme les horreurs de cette guerre. Elle fut pour lui, un moment d’expérience de la perte du sens profond et de la valeur réelle de vie, une expérience de la faillite des instincts lassés et affaiblis, un moment de pessimisme et de désespérance. De cette désespérance, va naître la préoccupation fondatrice de sa philosophie, à savoir la question du sens et de la valeur de la vie. Ainsi, se pose chez lui la question de la libération de l’homme de l’emprise du pessimisme existentiel. Comment donner à l’homme le goût et la joie de vivre ? L’homme ne peut-il pas se libérer du joug de la décadence et du pessimisme grâce au pouvoir métamorphique de l’art ? Au-delà de cet ensemble de questions, se pose dans la philosophie nietzschéenne, le problème du devenir parfait de l’homme, en vue de la préservation de sa vie.
Nietzsche, s’inspirant de la culture des anciens peuples comme les Grecs qui, selon lui, se sont libérés du pessimisme grâce au pouvoir métamorphique de la tragédie artistique, pense que, à l’image de ceux-ci, nous devons faire de l’art un moyen de consolation de la terreur que provoque l’horrible image du monde, un moyen de libération et de régénérescence de l’homme. C’est ce pouvoir de l’art que nous allons interroger dans cette contribution.
Ainsi, il s’agira d’abord de montrer comment chez Nietzsche, l’art, étudié à partir de ses origines mythologiques grecques (Apollon-Dionysos), est un pouvoir qui délivre l’homme des souffrances inhérentes à la vie (I). Nous indiquerons ensuite comment l’artiste, par le pouvoir de se retourner l’œil dans lui-même avant d’interroger le monde extérieur à travers ses œuvres, devient un éducateur qui enseigne de nouvelles formes de vie (II). Et enfin, il sera question de l’enchantement de la puissance métamorphique de l’art comme un pouvoir de perfectionnement (III).
I. LE POUVOIR DE DÉLIVRANCE DE L’ART
Avant de montrer la vertu thérapeutique de l’art chez Nietzsche (l’art comme un pouvoir de délivrance qui puise son origine de la mythologie grecque), il nous faut d’abord le définir. L’art ou du moins les arts, ce sont toutes les formes de création que l’homme, dans son vécu quotidien, utilise pour réaliser des belles œuvres. Cette entreprise de production du beau peut être musicale, poétique, dramatique, picturale ou sculpturale. Quelles que soient les formes de productivité de l’œuvre artistique, elles ont toujours la même finalité qui est de procurer du plaisir à l’homme, de le rendre heureux. Ceci est la première promesse de toute œuvre artistique.
La contemplation de la beauté des œuvres d’art provoque des émotions qui, selon Nietzsche, peuvent être agréables ou déplaisantes. Dans le penser esthétique de Nietzsche, l’art ne se limite pas à cette fonctionnalité. Au-delà de la production de la beauté réjouissante, Nietzsche fait de l’art un facteur d’embellissement de la laideur humaine qu’expriment les odieux comportements de l’homme. Cette approche nietzschéenne de l’art nous invite à ne plus observer l’art comme un simple « divertissement paisible, quelque chose à « consommer » tranquillement avec femmes et enfants, comme un ornement domestique, sur le modèle du concert familial »[113]. La dimension fonctionnelle de l’art est plus que la fonction de divertissement. Le plaisir, la joie, la gaité, l’enthousiasme et le bonheur que sécrète la contemplation d’une belle œuvre sont comme une anesthésie qui atténue les souffrances auxquelles l’homme est quotidiennement confronté. Comme des fortifiants, les œuvres d’art donnent l’envie et la joie de vivre. Elles exaltent la volonté de vivre. Ce pouvoir cathartique, d’apaisement, d’embellissement et adoucissement que Nietzsche donne à l’art est la principale leçon qu’il enseigne dans La Naissance de la tragédie[114]. La substance de cette leçon est résumée par la signification qu’il donne au couple de divinités grecques : Apollon et Dionysos, origine mythologique de l’art tragique.
Dans la mythologie grecque, si Apollon est le dieu qui incarne les vertus de beauté, de mesure, de stabilité, d’ordre et d’harmonie, Dionysos, par contre, est le dieu dont les attributs sont la laideur, la souffrance, la douleur, le désordre et la démesure. Toutes les formes d’art expriment les attributs de ces deux divinités. Quelle que soit la méthode qu’utilise l’artiste, il exprime ces deux différents types de vertus. Si les arts plastiques comme la peinture sont l’expression esthétique des vertus apolloniennes, les arts non plastiques comme la musique[115] expriment celles de Dionysos. Cependant, dans le penser nietzschéen, cette distinction des types d’art n’est pas rigide. Toutes les formes d’art (plastique et non plastique) expriment à la fois les vertus de Dionysos et celles d’Apollon. Elles reproduisent le sens de l’union du couple Dionysos-Apollon. C’est pourquoi, Angèle Kremer-Marietti, dans l’introduction de la version corrigée de La Naissance de la tragédie soutient que « l’art est le terrain commun à l’apollinisme et au dionysisme »[116]. Faire de l’œuvre d’art une reproduction du sens de l’union de Dionysos et d’Apollon, un terrain commun à ces deux divinités, c’est faire de l’art un moyen qui, avant de consoler l’homme en adoucissant les souffrances de la vie par les émotions de plaisir et de jouissance qu’émanent de la contemplation de la beauté plastique apollonienne de l’œuvre d’art, doit d’abord présenter à l’homme la face odieuse, tragique, triste et désolante de la vie. Il doit d’abord reproduire l’horrible visage de l’homme en exprimant ses incertitudes, ses angoisses et son désespoir au-delà de la beauté plastique de l’œuvre. C’est ainsi qu’il embellit la laideur et rend supportable ce qui n’était plus supportable. C’est le sens du devenir dionysien et du devenir apollonien de l’artiste.
Dans l’esthétique nietzschéenne, le devenir dionysien de l’artiste est fondamental. Il consiste à exprimer à travers l’œuvre, les réalités tragiques qui attristent l’homme. Les évènements tragiques qui décorent horriblement l’existence humaine comme les génocides, les misères sociales, économiques, financières et politiques avec leurs cortèges de conflits armés, sont autant de « torrent(s) de maux et de tourments »[117] que l’artiste communique dans ces œuvres. C’est de cet esprit dionysiaque que s’est nourri l’expressionnisme dès sa naissance.
S’inspirant des travaux de Vincent Van Gogh et d’Edvard Munch, l’expressionnisme fait sa naissance au début du XXe siècle dans une Allemagne tourmentée annonçant des torrents de maux. Le mouvement d’art : Die Brücke (le pont), animé par des auteurs comme Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein et Emil Nolde, et le courant d’art : Der Blaue Reiter (le cavalier bleu) dirigé par Wassily Kandinsky et Franz Marc, se nourrissant de l’esprit dionysiaque, vont peindre la face tragique de l’univers[118]. Ces courants d’art, en refusant de se soumettre aux principes de l’académisme et du naturalisme, s’épanche sur la terreur quotidienne de l’homme. Ce qui fait d’eux, des arts qui veulent « se salir »[119]. Se salir esthétiquement, c’est exprimer « les perceptions et sentiments du peuple, ses espérances et aspirations, ses refus, ses requêtes »[120]. En exprimant les souffrances humaines, le mal de vivre, les angoisses, les inquiétudes, les ennuis et les désespoirs de l’homme, l’art dionysien (tragique) devient une empathie (l’Einfühlung)[121], c’est-à-dire un moyen de connaissance du moi social. C’est pourquoi, dans la philosophie de l’art de Nietzsche, la productivité du tragique est d’une importance fondamentale. Elle s’exprime dans l’exploitation de la dimension affective de l’homme.
L’esthétique nietzschéenne, en effet, est un projet philosophique qui exploite la dimension affective de l’homme. Dans ses études, Nietzsche distingue deux types de plaisirs qui constituent l’entité affective de l’homme. Le plaisir que procure la simple contemplation du beau, et le plaisir émanant non pas de la simple observation du tragique, mais de l’effort fourni pour sublimer l’horreur. Le plaisir que procurent la sublimation, le dépassement (Aufhebung), est ce que Burke appelle le délice (delight) ou le ravissement. À cet effet, dit-il, « J’emploierai le terme délice pour exprimer la sensation qui accompagne l’éloignement de la douleur ou du danger (…) »[122]. C’est en exprimant le mal de vivre, l’esprit du dieu « souffrant des mystères, le dieu qui éprouve en soi les douleurs de l’individuation, (…) source et origine primordiale de toute souffrance »[123], que l’artiste met l’homme en relation avec la douleur. Il prescrit le sentiment de douleur dans la chaire et dans l’âme de l’homme afin que, ému par cette sensation, germe le souci de la conservation et de la préservation de soi. En éprouvant la sensation provoquée par l’idée de la douleur et des violences mortifères à travers les œuvres d’art, nous restons suspendus à l’idée d’une mort violente qui, à tout moment, peut nous surprendre. Ainsi, sans avoir fait l’expérience de cette violence, nous la vivons. Par l’art tragique, nous vivons l’idée de la terreur et non la terreur elle-même. Vivre avec l’idée de la terreur, c’est vivre le danger à distance. Ceci procure le délice et par conséquent, nous donne la force, la volonté et l’intelligence d’éviter les pièges de la terreur. Cette volonté sublimatoire puise sa force de la perception à distance de la terreur. L’art tragique est comme un pont de passage qui relie la terreur à l’idée de la terreur, et de cette idée à la volonté sublimatoire. Les piliers sur lesquels se dressent ce pont sont le sombre, l’obscure. C’est pourquoi, tout art tragique, qu’il soit pictural, poétique, musical ou cinématographique, pour exprimer l’horreur, utilise l’obscurité, le sombre pour représenter l’horrible image du monde[124] et afin que l’homme éprouve le sublime, l’horreur agréable.
Par contre, le devenir apollonien de l’artiste consiste à produire le beau. Par cette productivité du beau, l’artiste crée une sensation de plaisir. Ce type d’art, se définissant comme celui de la sensation, se distingue de l’esthétique sensationnelle. Est sensationnel, l’art qui se contente de recopier le donné. Comme le dit Deleuze, cet art n’évite pas « le détour ou l’ennui d’une histoire à raconter »[125]. C’est un art de mesure, de calcul et d’étude de dimensions. Soumis aux principes de la raison, le plaisir que procure cet art est aussi mesuré, calculé. C’est pourquoi, la production du beau par l’art sensationnel nécessite l’emploie « des formes rigoureusement abstraites et géométriques, basées sur l’orthogonalité des lignes, ainsi que le traitement lisse, sans empâtements et en aplat des couleurs pures fondamentales »[126]. Les angles droits que crée l’orthogonalité des lignes, donnent à l’œuvre les vertus canoniques apolloniennes, à savoir le repos, le calme, l’équilibre, la stabilité et le désir de s’apaiser.
Contrairement à l’art sensationnel, celui de la sensation s’adresse au corps. Par cette adresse, il nous touche ; il nous permet de devenir tout ce que nous veut être[127] en revêtant toutes les enveloppes émotionnelles ; il nous affecte de telle sorte que, en tant que sujet sentant, nous ne puissions nous distinguer de l’objet senti. La distance entre le sujet sentant et l’objet senti est effacée. Le sujet se sent uni et consubstantiel à l’œuvre. C’est cet attribut de l’art de la sensation que Deleuze exprime lorsqu’il dit : « je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par la sensation, l’un par l’autre, l’un dans l’autre »[128]. Qu’est-ce-que la sensation fait venir pour que je devienne dans la sensation ? Pour Nietzsche, c’est le plaisir que fait venir l’art de la sensation (carmen de Bizet). Ce plaisir rend fécond, gai, libre, heureux, indulgent, meilleur à telle enseigne qu’ « on en devienne soi-même un « chef-d’œuvre » »[129].
Dans l’art de la sensation, le corps n’est pas envisagé comme une matière brute que l’on banalise. Il est pensé comme un organe savant, intellectuel et organisé. Il est l’interlocuteur de l’artiste. C’est à lui que l’artiste s’adresse et lui promet le bonheur. Pour réaliser cette promesse, afin d’accomplir sa tâche (Aufgabe), l’art doit rendre la vie possible. Il doit être :
« « Le grand stimulant qui pousse à vivre », à « parfaire », en un mot, le Soi de l’individu vivant, et cela grâce à l’intensification de son affectivité constitutive, seul moyen dont nous disposons ici-bas de le conduire, ce Soi, jusqu’à ce point (proprement salvateur) où la souffrance elle-même – la souffrance de vivre, le désespoir d’exister – apparaît enfin comme « une forme de la grande volupté » »[130].
En rendant possible la vie au-delà des atrocités humaines, l’artiste récrée ce qui était déjà créé mais qui a perdu la perfection de la création manifestée par « les vertus de la jubilation »[131], par l’enthousiasme, la gaité, la joie de vivre et le goût de la vie qui, selon René Daval, sont nos modes d’être fondamentaux[132], le soubassement qui supporte la vie. Cette opération de création que Nietzsche qualifie de phénomène dramatique originel consiste à amener l’homme à « se voir soi-même métamorphosé devant soi et agir alors comme si l’on vivait réellement dans un autre corps, avec un autre caractère »[133]. Par la sensation du plaisir esthétique, émotion qui augmente la force de la vie, l’homme se voit hors de lui-même, dans une autre vision plus agréable. C’est « l’accomplissement apollinien de sa condition nouvelle »[134], c’est le devenir apollonien de l’artiste. En exprimant dans son œuvre les attributs d’Apollon, « dieu de toutes les facultés créatrices de formes »[135], dieu de la beauté, de l’accalmie, de la douceur, de la mesure, de l’ordre et de l’équilibre, « le reflet sacré de la vision de beauté »[136], l’artiste rend ainsi supportable l’insupportable et horrible vie de l’homme. Il permet de supporter l’horrible visage de Dionysos, symbole divin de la souffrance humaine. La thérapie de l’artiste ou, comme le dit Deleuze « la clinique esthétique »[137], berce les souffrances de l’homme par la recherche de l’émotion dionysiaque, de la sensation de l’ivresse qui est « une sensation de puissance élevée »[138]. Cette ivresse s’exprime dans la joie, la gaité et le bonheur. Elle donne l’envie de vivre autrement, de se transformer. Dans le penser nietzschéen, l’ivresse dionysiaque constitue le pouvoir métamorphique de l’artiste. Il ne peut cependant avoir ce pouvoir s’il ne s’inscrit pas lui-même dans son œuvre, s’il n’y met pas sa peau et son âme. C’est pourquoi, Stefan Zweig, parlant de l’art poétique de Hölderlin, fait des œuvres de cet auteur une fraction de sa vie, une fraction qui exprime le sens de sa vie[139].
Alors, l’enchantement de la métamorphose artistique que Nietzsche qualifie de charme magique, est la condition préalable de tout art dramatique[140]. Grâce à ce pouvoir, l’artiste délivre l’homme en transformant sa douleur en plaisir, sa peine en joie, son malheur en bonheur, son désespoir en espoir, son incertitude en certitude. Comme une source d’énergie, il permet de vivre agréablement en amenant l’homme à regarder « au-dessus de sa propre souffrance et qui ne voit dans sa propre vie qu’un chemin pour aller à lui-même »[141]. C’est pourquoi, chaque coup de pinceau ou chaque son musical est pensé comme une prière qui exorcise une âme en détresse en domptant les démons qui la hantent. Ainsi, en plus d’être le psychologue qui délivre l’espèce humaine des souffrances de la vie, l’artiste est aussi un éducateur.
II. L’ARTISTE ÉDUCATEUR, UNE « CRÉATURE-CRÉATEUR »
L’art, en plus d’avoir un pouvoir métamorphique permettant à l’homme de se transformer par la puissance du plaisir et du délice, a aussi un autre pouvoir par lequel, l’homme pallie l’incapacité foncière de la Nature en corrigeant les erreurs commises par le sculpteur originel, à savoir la Nature. Cette opération de correction est le processus d’éducation de l’homme. L’art, qu’il soit poétique, musical, pictural, architectural ou sculptural n’a de valeur, de sens et même d’existence que dans la création. Or, toute entreprise de création consiste à faire surgir quelque choix qui n’existait pas auparavant afin que cette chose communique à l’humanité le message que lui a confié son créateur. Ceci fait de l’œuvre un messager doté d’un pouvoir prophétique. Elle annonce à l’humanité ce que celle-ci ignore d’elle-même et du monde. C’est pourquoi, Nietzsche pense que « toutes les formes (d’art) nous parlent, nulle n’est indifférente, aucune n’est inutile »[142]. Ces propos de Nietzsche expriment le pouvoir de communication de l’art.
Parler, c’est exprimer sa pensée, ses sentiments ou autres émotions en se servant du langage articulé, ou en utilisant des sons, des symboles, des couleurs ou même par des figures géométriques. Si l’art parle, cela veut dire qu’il a une fonction transmissible, une possibilité communicationnelle. Il est un instrument de communication. Par son pouvoir communicatif, il nous soumet à un processus éducatif. L’objectif de cette instruction, c’est de faire de l’homme un être parfait, un être qui tend à la perfection, à l’achèvement de soi. L’artiste, initialement une créature imparfaite, se récrée par sa production. Il se donne une autre sculpture plus parfaite grâce à la puissance de son génie souverain et à son péché actif prométhéen. Il fait sortir le pur de l’impur, le parfait de l’imparfait. Il met dans son œuvre l’image de sa puissance. En tant qu’un être impur, indéfini, sans identité définitive, il sculpte sa propre identité, sa propre forme, sa propre nature. Il mène à son terme, c’est-à-dire jusqu’à son propre télos (épitelei) ce qui, de façon incomplète, s’est déjà produit au-dehors en parachevant la production « déjà entreprise »[143]. C’est ainsi que l’artiste pallie l’imperfection foncière de la Nature non pas pour avoir de nouvelles créatures, mais pour parfaire les créatures inachevées de la Nature.
Étant à la fois la matière à sculpter et le sculpteur de cette matière, un être dont le propre est « d’être un animal aux caractères non encore définis »[144] (Der Mensch ist das noch nicht festgestellte Tier), l’homme devient, par le pouvoir de l’art, une sorte de divinité qui se donne sa propre perfection. Si le verbe allemand Feststellen, renvoie au sens des verbes français fixer, caler, bloquer, ceci revient à dire que l’homme, en tant que créature, n’est pas encore défini. Il n’est pas encore déterminé. Il n’a pas encore une forme définitive, une identité fixe. C’est par son pouvoir artistique, qu’il se reforme, se redéfinit, se ré-identifie. C’est ce pouvoir de l’artiste qui fait dire à Nietzsche que « dans l’homme sont unifiés la créature et le créateur ; dans l’homme, on trouve la matière, le fragment, le superflu, le limon, la boue, la démence, le chaos ; mais dans l’homme se trouve aussi un créateur, un sculpteur, la dureté du marteau, la divinité du spectateur et le spectacle du septième jour »[145]. Par le pouvoir de l’art, l’homme devient une créature-autocréateur. Pour réaliser cette récréation de soi, l’artiste se met dans son œuvre. Il y prescrit la forme de sa vie, la manière dont il vit en tant qu’individu représentant une communauté humaine, la manière dont il voit le monde et dont il souhaite que le monde soit.
Dans l’esthétique nietzschéenne, l’œuvre d’art n’est pas innocente, sourde et muette. Étant produite par un regard, elle est réalisée pour un regard. Ce regard producteur est celui de l’artiste sur lui-même et sur le reste du monde. Ce qui fait de l’œuvre d’art, une créature identique à son créateur. Chaque peintre ou poète reproduit ses propres idées dans son œuvre. Il se peint lui-même. Il saisit les idées par intuition pour les livrer au public à travers son œuvre. Par ce don, il « nous prête ses yeux pour regarder le monde »[146]. Pour souligner cette relation narcissique de l’artiste à son œuvre, Stefan Zweig fait de la poésie une fraction de sa vie qui exprime le sens de la vie et non un condiment musical de la vie, une simple parure du corps spirituel de l’humanité[147]. Dans son œuvre, l’artiste met « violemment en relief les traits principaux (de la vie), de sorte que les autres s’estompent »[148]. Ce sont ces traits qui s’adressent à l’auditeur d’art en ces termes : « voyez ! Regardez bien ! Voilà votre vie ! Voilà l’aiguille qui marque les heures à l’horloge de votre existence »[149]. C’est ce langage, expression du reflet de la plénitude et de la perfection de l’artiste, expression de l’effort qu’il fournit pour pouvoir supporter son existence en la soumettant à la contrainte du perfectionnement, qui donne à l’œuvre d’art sa valeur éducative. C’est de ce type d’œuvre que « l’homme tire jouissance de se voir parfaire »[150]. Elle est une sorte d’instrument de mesure de la valeur de l’homme, une sorte de tableau éducatif universel sur lequel, non seulement l’homme lit la nature, le monde et sa société tels qu’ils sont et tels qu’il souhaite qu’ils soient, mais aussi, il se lit lui-même exactement tel qu’il est et tel qu’il souhaite être. Comme une fenêtre ouverte sur le monde, l’œuvre permet de percevoir tous les mystères du monde. Comme un miroir, elle nous communique notre reflet. C’est pourquoi, Schopenhauer fait d’elle « un moyen destiné à faciliter la connaissance de l’idée, connaissance qui constitue le plaisir esthétique »[151]. En se contemplant dans ce miroir, l’homme s’observe non pas comme « un être difforme (qui se pavane) comme un coq devant son miroir en échangeant avec son reflet des regards admiratifs »[152], mais comme un être qui observe par delà de la beauté de l’œuvre sa propre laideur, c’est-à-dire sa propre négation, l’appauvrissement de la vie, son impuissance, sa décomposition et sa dissolution[153]. Cette contemplation est une épreuve de mea-culpa. Elle consiste à reconnaître et à accepter nos imperfections. Ce mea-culpa est un procès éducatif de l’homme. Il permet de prendre conscience de la laideur de la vie. C’est pourquoi, pense Paul Audi,
« L’art se révèle comme étant de l’ordre du savoir (épistèmè) : il équivaut à un « s’y entendre en quelque chose », à un « s’y connaître », au sens d’un « savoir s’y prendre avec »… En tant qu’il est un « savoir » d’un type particulier, l’Art représente une attitude prise par rapport à tout ce qui vient se montrer au-dehors ; il désigne une posture adoptée face à un phénomène »[154].
En prenant conscience de sa laideur à partir du reflet que lui renvoie l’œuvre d’art, nous sommes invités à nous investir sur nous-mêmes pour tendre à la perfection. C’est à cet effort d’investigation de soi sur soi-même que l’artiste nietzschéen éduque. Cette esthétique éducative est une philosophie de réalisation de soi à travers la récréation de soi. Pour que cette réalisation soit possible, nous devons envisager la vie comme un métier, comme un champ d’application et d’exercice. C’est ainsi que nous arriverons à nous porter nous-mêmes au-delà de nous-mêmes, à nous affirmer en nous brisant nous-mêmes pour ensuite nous recréer. Ainsi, l’art, en nous permettant de vaincre le mal inhérent à la vie, de triompher sur la souffrance par la glorification de la beauté, de parachever par le pouvoir de démiurge de l’éducation, l’acte incomplet de la Nature, il prend la forme d’un véritable pouvoir métamorphique qui conduit l’homme sur le difficile chemin du devenir meilleur. Ce pouvoir perfectionniste permet à l’homme de naviguer sur le sombre océan de l’existence comme « un navigateur tranquille et plein de confiance en sa frêle embarcation, au milieu d’une mer démontée qui, sans bornes et sans obstacles, soulève et abat en mugissant des montagnes de flots écumants, (…) »[155].
III. LA PERFECTION, L’ENCHANTEMENT DE LA MÉTAMORPHOSE
La notion de perfection exprime un degré maximal de qualité qu’une personne ou une chose (une œuvre d’art) peut avoir. En faisant de la perfection l’une des merveilles qu’engendre l’art par la puissance de son pouvoir métamorphique, Nietzsche répond à la préoccupation fondatrice de sa philosophie, à savoir le problème de la décadence de l’homme. C’est cette réponse qu’il annonce dans le Crépuscule des idoles en ces termes : « Rien n’est beau, l’homme seul est beau : c’est sur cette naïveté que repose toute esthétique, c’en est la vérité première. Ajoutons-y aussitôt la seconde : rien n’est laid, si ce n’est l’homme qui dégénère, – cela circonscrit le champ du jugement esthétique »[156]. Dans ces propos, il fait de l’homme le seul être qui a la capacité de devenir beau, mais aussi celui qui peut devenir laid.
Devenir beau, c’est avoir « le talent d’agir à la perfection, de voir à la perfection »[157] en exaltant la sensation de puissance par une obligation intérieure de faire des choses le reflet de notre plénitude. Par contre, le laid est exprimé dans et par la négation de soi, l’appauvrissement de la vie. Il a une action déprimante et exprime la dépression[158]. Alors l’art, en tant que processus qui permet à l’homme de se remodeler, de s’aménager, d’accroître sa puissance, fait de la perfection (Vollkommenheit ou Vollendung) de l’artiste et celle de l’amateur d’art (le récepteur esthétique), l’une de ces tâches authentiques. Si Nietzsche fait de la création l’authentique tâche de la vie (die eigentliche Aufgabe des Lebens), la perfection devient alors le souffle vital de cette création qui donne un sens à l’œuvre d’art et à la vie.
Pour donner de la perfection à son œuvre, l’artiste doit s’offrir en sacrifice à celle-ci. Ce sacrifice exprime son rapport immédiat et intime avec son œuvre. En s’y projetant, l’artiste prend l’engagement de faire de son œuvre non pas le reflet de l’image d’une expérience de sa vie, mais le reflet de cette expérience et par conséquent, celle de sa vie. Il fait de son œuvre l’incarnation de la vie. En se mettant dans son œuvre sous l’effet de la puissance de l’imagination, il donne à celle-ci la forme de sa vie, la manière dont il la sent, la goûte. C’est pourquoi, un tableau, une musique ou une représentation théâtrale ne doit pas être vu comme l’image d’une expérience de vie. Il doit être observé comme l’expérience de cette vie qu’il représente.
Le pouvoir de donner aux choses (la matière inerte, amorphe et muette) par le génie créateur, la possibilité de communiquer aux autres le reflet de sa propre plénitude et de sa propre perfection, impose à l’artiste une éthique de la connaissance. Cette éthique conduit non seulement au savoir initial ‘’ la première connaissance’’, mais aussi à la ‘’ connaissance première ‘’. La première connaissance est celle qui commence par la connaissance de soi. Elle renvoie au connais-toi toi-même de Socrate, à la connaissance de notre propre statut d’artiste créateur. Elle est le savoir initial qui préside à l’avènement de la seconde, la connaissance première. Celle-ci est la saisie (connaissance) esthétique des choses et du monde dans leur apparaître, dans leur phénoménalité matérielle. Elle consiste à contraindre les choses de la nature et les phénomènes sociaux afin qu’ils livrent leurs intimes secrets, à être « le témoin de la vie quotidienne »[159] de l’homme. Dans l’esthétique nietzschéenne, contraindre les choses à livrer leurs secrets, c’est comme le dit Michel Thévoz, amener la réalité à « parler d’elle-même »[160]. C’est la raison pour laquelle chez Nietzsche, l’œuvre d’art n’est pas observée comme un simple objet, mais comme un sujet qui, pour plaire aux yeux, doit pouvoir séduire et surprendre, appeler le spectateur, s’adresser à lui en l’informant de ses défauts et de ses qualités. Elle ne doit pas être pensée comme une simple image de la société. En plus d’être le reflet de la société, elle est aussi l’expression de l’idéologie sociale, économique, culturelle, politique de la société. Dans son dialogue, elle communique avec toute la société. Ce dialogue nous élève à la connaissance de nous-mêmes et celle de toute la société. Cette connaissance nous donne le pouvoir de nous aménager, de nous améliorer, de nous perfectionner. Ainsi, par le pouvoir communicationnel de son œuvre, l’artiste « entre par la pensée dans d’autres âmes »[161] et crée une harmonieuse communauté universelle où chacun se sent « avec son prochain, non seulement, réuni, réconcilié, fondu, mais encore identique à lui, (…)»[162].
Par la communication, l’art donne à l’homme le pouvoir de passer d’une forme de vie à une autre, d’éviter l’inertie, la fixité qui, en soi, au lieu d’exalter la vie, l’exténue, l’amoindrit, l’appauvrit. Or, fixer la vie, la condamner à l’inertie, à l’amoindrissement, c’est tout juste exister et non pas vivre. La communication du message de l’artiste, en tant que révélation de la significativité des choses, enclenche le processus métamorphique de l’enrichissement perpétuel de l’homme qui, pour Nietzsche, « est une conséquence de l’accroissement de force. (…), l’expression d’un vouloir victorieux, d’une coordination plus grande, d’une harmonisation de tous les désirs forts, d’un équilibre infailliblement juste »[163]. C’est cette perfection métamorphique que Nietzsche évoque en parlant de l’œuvre perfectionniste Carmen de George Bizet en ces termes : « chaque fois que j’ai entendu Carmen, je me suis senti plus philosophe, meilleur philosophe qu’il ne me semble d’habitude : rendu si indulgent, si heureux, si indien, si rassis… »[164]. Pour Nietzsche, le bel ouvrage artistique, l’ouvrage qui exalte la volonté de puissance est un ouvrage perfectionniste si riche et précis qui construit, organise et achève l’ouvrage inachevé et imparfait de Dieu. Cette vertu est comme un pouvoir divin que détient l’artiste. Par ce pouvoir, il devient un divin qui, certes, ne crée pas à partir de rien (nihil ex nihilo), mais qui ajoute de la valeur et du sens à ce qui semble ne pas en avoir. Il ajoute de la perfection aux choses. Mieux que les anges qui, dans leur perpétuelle fixité, ne deviennent pas, ne changent pas, ne se métamorphosent pas, l’artiste, par son pouvoir Prométhéen et son péché actif, émerveille l’homme par la puissance esthétique de la métamorphose.
CONCLUSION
Dans sa philosophie de l’art, Nietzsche confère à l’esthétique trois types de pouvoir métamorphique qui permettent à l’homme de se régénérer en se libérant du joug de la dégénérescence. Ces pouvoirs sont : le pouvoir de délivrance, le pouvoir éducatif et le pouvoir perfectionniste de l’art. Ils sont les piliers fondamentaux sur lesquels se dresse tout édifice culturel qui se veut excellent.
En tant qu’un pouvoir de délivrance, l’art libère l’homme de la peur que nourrit l’horrible image du monde par la production du délice découlant de la sublimation à laquelle invite la contemplation de la terreur. En plus de cela, il est aussi un moyen de production du beau dont la contemplation procure du plaisir qui, comme une anesthésie, adoucit les souffrances de l’homme. Cette thérapie esthétique, en libérant l’homme du poids de la terreur et de celui de la souffrance, fait de cet être un esprit autonome disposé à parachever l’œuvre qu’il est et que la Nature a laissée inachevée. Ce qui fait de lui une créature, certes imparfaite, mais animée par la volonté de se parfaire.
Ainsi, avec l’art, l’homme devient une « créature-créateur » qui, maîtrisant les forces artistiques et culturelles les plus élevées et les plus nobles[165], dresse son honorable édifice culturel sur lequel, le temps vient se casser les dents. Dans le penser nietzschéen, l’art est donc un pouvoir métamorphique qui procure à l’homme non seulement le plaisir, mais aussi la liberté et la compétence, trois vertueux pouvoirs impératifs au devenir de l’homme.
BIBLIOGRAPHIE
AUDI, Paul, L’Ivresse de l’art, Paris, L.G.F., 2003.
BERNARD, Edina, L’art moderne 1905-1945, Paris, Bordas, 1988.
BLANQUÉ, Pascal, Histoire du Musicien à l’âge moderne, Musique, Cité et Politique, Paris, ED. Economica, 2009.
BURKE, Edmund, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau (A Philosophical Enquiry into the origin of Our Ideas of the Beautiful), Paris, Vrin, 1990, Trad. Baldine Saint-Girons.
COLLI, Giorgio, Après Nietzsche (Dopo Nietzsche), Trad. Pascal Gabellone, Paris, Édition de l’Éclat, 2000.
DAVAL, René, « Pour une anthropologie de la joie. Otto Friedrich Bollnow et Nietzsche » in Revue Noésis (Nietzsche et l’humanisme), N°10, Paris, 2006.
DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Logique de la sensation, La Roche-sur-Yon, Édition de la différence, 1981.
FIÉ, Doh Ludovic, Musiques populaires urbaines et stratégies du refus en Côte d’Ivoire, Paris, Edilivre, 2012.
JEAN PIC de la Mirandole, « Sur la dignité de l’homme », in Œuvres philosophiques, Paris, P.U.F., 1993, Trad. G. Tognon et O. Boulnois.
ONFRAY, Michel, L’art de jouir, Paris, Grasset et Frasquelle, 1991.
NIETZSCHE, Friedrich, La Naissance de la tragédie (Die Geburt der Tragodie), Paris, LGF-Livre de poche, 2008, Trad. Jean Marnold et de Jacques Morland, Revue par Angèle Kremer-Marietti.
NIETZSCHE, Friedrich, « Appel aux Allemands » in Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, Trad. Michel Haar et Marc de Launay.
NIETZSCHE, Friedrich, « considérations inactuelles » in Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, Trad. Jeans-Louis Backès.
NIETZSCHE, Friedrich, « La vision dionysiaque du monde » in Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, Trad. Jeans-Louis Backès.
NIETZSCHE, Friedrich, La volonté de puissance I, (Der Wille zur March), Paris, Gallimard, 1995, Trad. Geneviève Bianquis.
NIETZSCHE, Friedrich, Par-delà le bien et le mal (Jenseits von Gut und Böse), Verviers, Marabout Université, 1975, Trad. Angèle Kremer-Marietti.
NIETZSCHE, Friedrich, Le cas Wagner (Der Fall Wagner), Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hémery.
NIETZSCHE, Friedrich, Crépuscule des idoles, (Götzen-Dämmerung), Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hemery.
THEVOZ, Michel, Le théâtre du crime. Essai sur la peinture de David, Paris, Minuit, 1986.
SCHOPENHAUER, Arthur, Le Monde comme volonté et comme représentation (Die Welt als Wille und Vorstellung), Paris, P.U.F., 1992, Trad. Auguste Burdeau.
ZWEIG, Stefan, Le combat avec le démon (Der Kampf mit dem Dämon), Paris, L.G.F., 2005, Trad. Alzir Hella.
HEIDEGGER : LA TRADITION ET L’OUBLI
Léonard Kouadio KOUASSI
Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La philosophie de Heidegger est, principalement, un procès contre la tradition métaphysique. Selon lui, cette tradition a oublié, pour l’essentiel, la question de l’Être au profit de celle de l’étant. C’est pourquoi, il propose l’ontologie fondamentale dont la finalité est la vérité de l’Être en tant qu’Être. Cependant, en dépit de la rupture qu’il instaure entre la métaphysique traditionnelle et son ontologie fondamentale, il semble attaché à cette même tradition qu’il a voulu dépasser.
Mots-clés : Étant, Errance, Oubli de l’Être, Tradition, Vérité de l’Être.
ABSTRACT :
Heidegger’s philosophy is mainly a trial intended against the traditional metaphysics. According to him, this tradition, for the main part, has forgotten the issue of the To BE at the profit of the being. Therefore, he puts forwards the fundamental ontology whose aim lies in disclosing the truth of the TO BE. But despite the severance he stresses on to make a clear cut frontier between traditional metaphysics and his ontology, he seems to be stuck to this same tradition he pretended to outstep in his approach.
Key words : The Being, Diffidence, Oblivion of Being, Tradition, Truth of Being.
INTRODUCTION
Une idée fondamentale structure la philosophie heideggérienne : celle de l’oubli de l’Êtredans la tradition philosophique. C’est pourquoi toute la réflexion qu’il a consacrée à la question de l’Être se présente comme un dialogue avec les penseurs d’autrefois. Écoutons Alain Boutot à ce sujet : « (…) Pour Heidegger, la loi d’un dialogue avec la tradition historique est de pénétrer, dans la vigueur, la pensée d’autrefois »[166]. En effet, par ce dialogue, le philosophe de Fribourg en sort avec le constat que la question de l’Être s’est éloignée de son éclaircie. En lieu et place de cette dernière, le primat a été accordé à celle qui porte sur l’étant.
Si donc, pour Heidegger, toute la tradition, précisément depuis Platon, a questionné en direction de l’étant dans son être, une urgence s’impose : celle de dépasser la métaphysique traditionnelle afin de proposer la sienne propre. D’où ces interrogations essentielles : quelle est la particularité du philosopher heideggérien au point de se présenter comme une rupture d’avec la tradition ? Heidegger s’est-il véritablement débarrassé des errements de la métaphysique classique ? Ne peut-on pas parler d’un glissement heideggérien dans la tradition ? Les réponses à ces questions nous conduiront d’abord à jeter un regard rétrospectif sur la métaphysique traditionnelle qui se présente comme oublieuse de l’Être. Ensuite, nous exposerons l’essentialité du philosopher heideggérien, à savoir l’ontologie fondamentale, et enfin, nous présenterons Heidegger comme étant, dans une certaine mesure, un penseur de la tradition.
I. L’OUBLI DE L’ÊTRE DANS LA METAPHYSIQUE TRADITIONNELLE
Que retenir essentiellement de ce titre qui entame ce travail ? Il convient de réaffirmer que, selon Heidegger, l’oubli de l’Être est le moteur de l’histoire de la métaphysique. Une telle remarque le conduira à ouvrir un dialogue constant avec la pensée occidentale. Lequel lui a permis d’expliciter les non-dits des doctrines philosophiques majeures qui ont contribué à l’éclipse de l’Être vis-à-vis de sa vérité. Ici, Rüdigger Safranski nous autorise à étayer une telle idée en ces termes : « Philosophiquement Heidegger vient de loin. Il a fréquenté Héraclite, Platon, (…) comme s’ils avaient été ses contemporains. Il est entré dans une telle proximité avec eux qu’il a pu entendre leur non dit et lui a donné voix »[167]. Ceci dit, Il entame fondamentalement la critique avec Platon. En effet, dès le début, il ne condamne pas celui-ci. Au contraire, il voit en sa philosophie un présage de la vérité de l’Être. La preuve est qu’à la page inaugurale d’Être et Temps, il passe brièvement en revue cette pensée du sophiste qui s’intéresse au sens vulgaire du mot « Être ». Autrement dit, la préoccupation qui guide la réflexion platonicienne est celle de l’être de l’étant. En clair, il considère que la philosophie classique a été, pour l’essentiel, à l’origine du nihilisme contemporain.
Mais retenons que cette essence première de l’étant est, pour lui, l’Être en tant qu’Être. À ce titre, la philosophie doit quêter en direction de cette essence. Alain Boutot explicite cette idée en ces termes : « Platon présente la philosophie dans le Phédon comme ‘‘une chasse de l’Être’’ »[168]. Au regard d’une telle idée, peut-on dire que Platon a manqué la question de la vérité de l’Être ? Heidegger, en penseur averti, ne privilégie-t-il pas l’ascèse au détriment de tout ce que peut nous fournir la matière ?
Si tel est le cas, il devrait saisir a priori Platon comme celui qui a posé la question ontologique véritable. Cependant, il range en bloc sa philosophie au compte des sciences ontiques. En effet, questionnons à nouveaux frais en direction de l’allégorie de la caverne. Que véhicule-t-elle ?
C’est au livre VII de la République qu’il présente des personnes vivant depuis leur enfance dans une caverne. Liées entre elles, elles ont le regard fixé sur la paroi interne de cette caverne où elles ne recueillent que les images de tout ce qui se passe dehors. Mais, pourquoi cette allégorie ? Elle nous permet de saisir chez Platon, d’une part, le monde sensible comme celui des étants évanescents, et d’autre part, le monde intelligible où l’étant suprême se donne comme la source fondatrice du monde sensible. Mieux, c’est l’Idée du Bien, cause des causes, qui achève le monde intelligible. Platon lui-même le souligne de la façon suivante : « (…) Dans le monde intelligible, l’Idée du Bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne peut le percevoir sans conclure qu’elle est la cause de tout… » [169]. Cette citation nous conduit au versant ontico-ontothéologique de la pensée de Platon. Comment cerner cela ?
Pour lui, le Bien est l’Idée principielle qui anime les autres étants. C’est le modèle. En un mot, cette Idée première est en fait Dieu. À l’image du démiurge éternel, le Bien a un caractère éternel, d’où l’idée qu’il constitue l’essence de l’Être-Créateur. De là, se saisit la récupération médiévale de la question théologique très tôt engagée chez les grecs en général et chez Platon en particulier.
Alain Boutot affirmera que
« Dieu n’entre pas dans la philosophie parce que la théologie chrétienne, en s’emparant de la philosophie grecque pour reformuler le témoignage de la foi, lui aurait donné une dimension théologique dont elle aurait été dépourvue. Du reste, dit Heidegger, ‘‘aussi longtemps que nous nous contentons de passer en revue, par des méthodes dites « historiques », l’histoire de la philosophie, nous trouverons partout que Dieu s’y trouve déjà’’»[170].
Ainsi, à partir de la question de l’Être, nous nous heurtons à celle de Dieu. Ceci ouvre, du coup, une autre problématique qui est celle du temps chez l’auteur du Timée. En effet, Platon traite du rapport étroit entre l’Être et le temps. Or, nous savons que chez lui, l’Être rime avec l’Idée du Bien qui est le modèle éternel. L’éternité se découvre à travers le temps lui-même produit de deux substances indissociables, à savoir le Même et l’Autre. Dans leur rapport dialectique, le Même et l’Autre représentent le monde, ‘‘image devenue des dieux éternels…’’. Au regard d’une telle analyse, il est indéniable que la philosophie platonicienne glisse dans ce que Heidegger appelle l’ontothéologie. C’est d’une telle conception qu’hérite Aristote. Quelle est dès lors l’approche aristotélicienne de l’Être ?
Aristote, quant à lui considère l’Idea comme la forme substantielle qui doit investir le réel en vue de son appréhension. Autrement, l’étant, tel que conçu par Platon, conduit à un échec total de la connaissance du réel. Car l’Être ne va jamais sans ses attributs. La forme, proprement, n’a de sens que dans son rapport avec la matière. Heidegger explique cette approche en ces propos :
« À la différence de Platon, qui tenait les Idées pour l’étant véritable, tandis qu’il ne laissait venir l’étant particulier en tant que l’étant en apparence et abaissait à l’étant de ce qui ne devrait pas proprement se dire un étant, Aristote a fait descendre de leur lieu supra céleste les Idées y flottant librement pour les convertir en des formes, et ces formes, il les a conçues en tant qu’énergies et forces qui logent dans l’étant »[171].
Si donc Aristote pense que l’Être doit se saisir avec ses attributs, il mentionne néanmoins qu’il se prend en plusieurs acceptions. Mais ne pouvons-nous pas affirmer que la diversité de sens pourrait empêcher de saisir l’Être ? Cela semble être évident. Mais, pour lui, c’est la première cause, c’est-à-dire le principe premier, unificateur de l’étant, qui prime. Philosopher, dans une telle perspective, consiste à questionner en direction de la nature des choses. Car connaître véritablement ne vise pas seulement les attributs de la chose à connaître.
La vraie connaissance qui implique les prédicats est celle qui prend en compte l’essence des choses. Aristote lui-même insiste en ces mots :
« Nous croyons connaitre le plus parfaitement chaque chose quand nous connaissons ce qu’elle est, par exemple, ce qui est l’homme ou le feu, bien plutôt que lorsque nous connaissons sa qualité, sa quantité ou son lieu, puisque chacun de ses prédicats eux-mêmes, nous les connaissons seulement quand nous connaissons ce qu’ils sont, ce qu’est la quantité ou la qualité. En vérité, l’objet éternel de toutes les recherches présentes et passées, le problème toujours en suspens : ‘‘ qu’est-ce que l’Être ?’’ consiste d’une manière ou d’une autre à demander : qu’est-ce que la substance ? »[172].
Suite à cette interrogation d’Aristote, nous découvrons que la question qui porte traditionnellement sur l’étant, conduit à la découverte de la Substance. Mais la Substance se prend elle aussi en plusieurs acceptions. Puisqu’«…elle (la Substance) se prend, sinon en un grand nombre d’acceptions, du moins en quatre principales : on pense d’ordinaire, en effet, que la Substance de chaque Être est soit la quiddité, soit l’universel, soit le genre, en un lieu le sujet »[173]. Cela dit, qu’est-ce donc la Substance ?
Cette question invite à considérer une Substance plus significative et efficace que les autres, car il existe des primautés entre elles et les sciences qui les étudient. Ce qui amène Aristote à opter pour l’Ousia fondamentale. Visiblement, la Substance fondamentale, qui fait fonctionner les autres, est ce qu’il qualifie de premier moteur. L’Être est donc en réalité ce premier moteur, l’acte pur qui meut sans être mû. Dès lors, la connaissance du premier moteur est réservée à la plus noble des sciences théorétiques qu’est la théologie. Il peut dire : « …Les sciences théorétiques sont estimées les plus hautes des sciences, et la théologie la plus haute des sciences théorétiques »[174].
Ici, la thèse aristotélicienne vient confirmer l’enracinement de l’argument ontothéologique dans la tradition métaphysique. Car, selon Heidegger, qu’elle soit posée par Platon ou Aristote, la question directrice de la métaphysique n’a conduit qu’à spéculer sur l’étant en tant qu’étant. Il l’exprime en ces termes : « Les deux modes de l’Ousia, l’Idea et l’Energia, forment, dans l’alternance de leur distraction, la structure fondamentale de toute métaphysique, de toute vérité de l’étant en tant que tel »[175]. Une telle conception de l’Être n’a-t-elle pas influencé la philosophie moderne ?
En effet, il faut entendre par métaphysique moderne, toute la réflexion philosophique entamée précisément depuis Descartes, en passant chez Hegel, et qui se poursuit jusqu’à la fracture ontologique nietzschéenne. En quoi consiste fondamentalement cette nouvelle entente de l’Être ? Comment ne pas ébaucher cette analyse avec Descartes ?
Descartes, en effet, considère que la méditation consiste à douter de toutes les connaissances jusqu’ici admises. Il désire ardemment construire la science et rechercher la vérité à partir de lui-même. C’est cette idée qu’il traduit de la manière suivante : « Je ne saurais tenir pour vrai que ce que mon esprit produit par lui-même, ce qui m’apparait en toute certitude comme étant vrai »[176]. Ainsi, par ce doute, il arrive à la découverte du cogito. Au regard d’une telle analyse, on découvre que le philosopher cartésien lui aussi retombe encore dans les errements de ses prédécesseurs, car ce qui est dévoilé, c’est la pensée, synonyme du Moi. Descartes survole la question ontologique et la situe plutôt dans une perspective anthropologique ou psychologique. Heidegger confesse que « par Descartes et depuis Descartes l’homme, le ‘‘Moi’’ humain, devient, d’une manière prééminente, le sujet dans la métaphysique »[177]. Mais Descartes n’a-t-il pas suspendu le monde extérieur lors du doute ? S’est-il définitivement débarrassé de l’idée de Dieu ?
Il faut reconnaitre que le ‘‘Moi’’ cartésien n’a de sens que dans son rapport à Dieu, puisque la possibilité du doute témoigne de la faiblesse de l’homme. Or les Méditations Métaphysiques doivent conduire à la découverte des objets immatériels tels l’âme ou Dieu. N’oublions pas d’ailleurs que l’un des soucis majeurs de l’auteur du Discours de la méthode était d’échapper au bûcher et donc de satisfaire à la fois la communauté scientifique et catholique. Le souci qui fût le sien a été exprimé par Jean Revel en ces termes : « Le rôle historique (de la philosophie de Descartes) a été de résoudre le problème de l’adaptation de la pensée théologique à l’ère scientifique »[178]. À regarder donc de près la démarche cartésienne, nous pouvons conclure qu’elle a contribué à enfouir l’Être dans l’obscurité et donner de la clarté à l’idée de Dieu. C’est en réalité la tâche à laquelle Hegel s’adonnera.
Pour lui, la philosophie est la connaissance encyclopédique par excellence. Ainsi son objet constitue la totalité de l’étant. Dans cette perspective, comment le sujet pensant est-il capable d’assumer l’absolu ?
Pour réussir une telle tâche, Hegel fait confiance à la raison humaine, marque indéfectible du sujet pensant. Il présente cette aventure historique de la marche de l’Esprit ou de la conscience à travers la Phénoménologie de l’Esprit. En effet, au regard de l’odyssée de la conscience, qui commence par la conscience naïve jusqu’au savoir absolu, en passant bien entendu par les différentes étapes, résultat d’un processus dialectique, l’on découvre le parcours du sujet pensant jusqu’à la communauté religieuse. La question de l’Être prend elle aussi la direction d’une théologie en lieu et place de l’ontologie. Avec lui, le concept de temps devient synonyme d’infinité. Le temps hégélien est l’essence même de l’Être, car l’Être parachève son chemin dans le temps. Heidegger peut alors dire : « pour Hegel, la vraie essence de l’Être, l’infinité, est l’essence du temps… »[179]. Cette citation démontre que le temps hégélien, saisi comme essence de l’Être, ne répond guère à l’entente heideggérienne du temps, puisqu’il est simplement le temps historique que met l’esprit pour parvenir à l’Absolu, c’est-à-dire à Dieu. Mais Dieu n’est-il pas mort ?
Cette question ouvre sur le philosopher nietzschéen. En effet, Nietzsche entame la destitution systématique de l’Être et partant de Dieu. « En fait rien n’a jamais eu force de persuasion plus naïve que l’erreur de l’Être »[180]. C’est pourquoi il faut renverser le platonisme accusé d’oublier la vie. Les idéaux sont des inventions des faibles, puisqu’ils empêchent le surhomme de vivre hic et nunc. Toute la scène est donnée au Surhomme, maître incontesté de la terre. Nietzsche peut dire : « Le Surhomme est le sens de la terre : que votre volonté dise : puisse le Surhomme être le sens de la terre ! »[181]. Une telle vision consacre le double oubli de l’Être et donne ainsi libre cours aux passions du sujet pensant. Il hérite doublement de la pensée moderne de la subjectivité.
Michel Haar pouvait dire ce qui suit : « L’enjeu global de la lecture de Nietzsche consiste à montrer que sa pensée obéit à la structure interne de l’ontothéologie qu’elle pousse à son extrême achèvement, posant ainsi les bases sourdes de notre époque. Achèvement implique, pour Heidegger, l’ultime renversement. Sont renversées, et néanmoins conservées dans la doctrine du surhomme, les positions fondamentales de Descartes et de Hegel »t[182]. La subjectivité, tout comme le nihilisme, apparaît dès lors comme la loi logique de la réflexion philosophique depuis Platon en passant par Aristote, Descartes, Hegel, et trouve son point culminant chez Nietzsche. Heidegger finit par dire que : « le terme de subjectivité désigne l’histoire unitaire de l’Être, depuis le façonnement de l’essence de l’Être en tant qu’idée jusqu’à l’accomplissement de l’essence moderne de l’Être en tant que Volonté de puissance »[183]. Cette volonté de puissance se traduit, de façon tangible, à travers la technoscience enchaînante et aliénante. En observant ainsi l’histoire de la pensée métaphysique, depuis Platon et s’achevant avec Nietzsche, nous retenons que l’Être s’est maintenu en retrait. Ce qui justifie la nécessité pour Heidegger de questionner à nouveaux frais la question du sens de ‘‘Être’’.
II. L’ONTOLOGIE DU DASEIN : ESSENTIALITE DU PHILOSOPHER HEIDEGGERIEN
La désobstruction de l’histoire de la métaphysique indique combien la tradition a manqué la question de l’Être. Ce qui nécessite, selon Heidegger, son dépassement et sa réhabilitation. Une telle tâche doit se faire à la lumière de la différence ontologique. Qu’est-ce que Heidegger entend fondamentalement par différence ontologique ? Quels sont les arguments qui témoignent effectivement du renouveau heideggérien vis-à-vis de la tradition ? Faisons remarquer d’abord que l’oubli de l’Être ne résulte pas d’une quelconque défaillance psychologique. C’est plutôt le signe de sa possibilité, c’est-à-dire du dé-voilement. Michel Haar l’explicite en ces termes : « l’oubli de l’Être n’indique pas une négligence ou une faiblesse de la mémoire humaine, mais l’essence du dé-couvrement »[184] . Pour parvenir à la vérité de l’Être, Heidegger se réfère à l’auteur de la Critique de la raison pure qui, selon lui, ouvre les brèches à l’ontologie fondamentale à travers une relecture des concepts tels le temps, l’espace, l’existence.
Ainsi à partir de Kant, la question de l’Être ne s’appréhende plus dans une acception théologico-anthropologique. La question est : comment situer la préoccupation leibnizienne en question fondamentale ? D’abord, pour Leibniz, rien ne se fait sans une raison suffisante. Pour telle réalité, l’on peut bien se demander pourquoi il en est ainsi et pas autrement ? Cette question doit se situer dans l’éclaircie d’un étant particulier que Heidegger nomme ‘‘terminologiquement’’ : Dasein, qui signifie Être-là. Cet Être-là, doit, de manière franche, poser la question de l’Être. En réalité, si on s’en tient à la question de l’auteur des Principes de la nature et de la Grâce, on risque bien de retomber dans les erreurs des anciens et faire de l’ontologie, une théologie naturelle. C’est pourquoi il précise qu’« elle ne peut, d’aucune façon, constituer une réponse à notre question parce qu’elle n’a aucun rapport avec cette question »[185].
Mais comment Heidegger reformule-t-il cette question ? Voici son questionnement : « pourquoi y a-t-il l’étant et non plutôt rien ? »[186]. Cette préoccupation, selon lui, impose, pour ainsi dire, une démarche plus formalisée lui permettant d’installer la métaphysique dans une terre non aride. Il affirme : « Nous affrontons la grande et longue tâche de dégager un déblaiement, l’origine d’un monde vieilli, et d’en bâtir un vraiment neuf, c’est-à-dire d’un savoir plus rigoureux qui nous engage plus qu’aucune autre époque antérieure et qu’aucune autre révolution de pensée avant nous »[187]. On découvre que Heidegger a pour souci de bâtir une véritable ontologie inscrite formellement dans l’Être du Dasein.
En situant désormais l’essentiel de la pensée sur l’unique possibilité du Dasein, l’on ne construit pas du coup une ontologie. C’est pourquoi Heidegger lui ajoute la méthode phénoménologique qui doit faire sortir l’Être de son sol aride et immuable. Le Temps, dans ce cas, devient inéluctablement la condition du dé-couvrement de l’Être. Mais comment entend-il fondamentalement le Temps ?
La compréhension du Temps heideggérien, se donne à comprendre dans l’étrangeté du Dasein. Qu’est-ce-à-dire ? La question qui s’ouvre à partir de l’ombre inquiétante de l’étrangeté est celle du souci. En effet, le souci est l’une des tonalités du Dasein qui le présente comme Être-au-monde (In-Der-Welt-Sein). Dans la présence au monde, le Dasein se découvre soi-même dans une sorte de vacuité absolue. Cette vacuité est le Néant : unique réalité Ek-sistentiale. On peut donc affirmer que l’Être du Dasein est le souci, c’est-à-dire ce vide intriguant. Mais, il ne s’agit pas du vide traditionnel ou de l’espace mathématique. Ce cadre spatio-temporel naît dans la constitution intrinsèque du Dasein lui-même. Seule une prospection phénoménologique ou analytique peut nous amener à dévoiler l’Être intime du Dasein. Il s’ensuit dès lors que le Dasein représente la loge où vit l’Être. C’est grâce à lui que l’Être peut sortir de son mutisme total, mieux il est le Berger de l’Être. Dans sa donation, l’Être s’annonce comme phénomène. Le phénomène est ce qui apparait et se dissimule à la fois. Tel qu’appréhendé, le phénomène cesse d’être réduit à l’étant. Au contraire il : « (…) représente un mode d’être de l’étant »[188]. Mieux : « le concept de phénomène est entendu : Le se-montrant-par-soi-même »[189]. Ainsi le manifester du phénomène se laisse percevoir dans l’espace qui constitue le dedans apriorique des choses. En effet, l’espace étant ainsi impliqué dans le déploiement des étants, il s’ensuit que pour Kant : « Le temps est une représentation nécessaire qui sert de fondement à toutes les intuitions »[190]. Au regard de tout ce qui précède, nous affirmons que L’Être se donne, car il est, pour ainsi dire, inscrit de façon co-originaire dans l’essence du Dasein. Cette essence, en son déploiement, s’annonce dans le temps. Cela veut dire simplement que toutes les possibilités existentiales du Dasein n’ont de sens que dans l’horizon transcendantal du Temps où seule la démarche phénoménologique peut faire suspendre le Dasein dans une sorte de réduction eidétique pour n’observer que le noyau dur qui le compose. Ce noyau toujours présent, où peut se lire le tracé-ouvrant, est la Parole.
Chez lui, la parole requiert une autre entente. C’est elle qui fonde l’essentiel de l’ontologie fondamentale. Qu’en est-il ? Chez les Anciens, la parole est comprise comme un étant, alors que Heidegger questionne en direction de l’essence de celle-ci. Christian Dubois peut dire qu’« il ne se s’agit pas de fournir un discours théorique objectivant sur, à propos de la langue, mais de penser à partir de la langue, à l’écoute de la langue, y correspondant de faire l’expérience de l’essence de la langue »[191]. Ce qui vaut pour l’auteur d’Acheminement vers la parole, c’est : die Wesen der Sprache. On comprend ici qu’il fait une phénoménologie de la parole, car en elle, se dé-couvre le déploiement de l’Être. La parole ne passe plus pour une simple activité humaine où se joue la bouche, la langue. Au contraire, elle constitue la patrie, le Templum de l’Être où se recueille toute sa vérité. Ainsi, se voit inscrite au cœur du Dasein cette trilogie où se lisent ces trois concepts consubstantiels et intimes : Parole-Être-Vérité. Que dire alors de l’Être et de la vérité ?
L’Être est saisi comme dé-voilement, c’est-à-dire qu’il s’annonce comme vérité. Dans cette approche, la vérité réside dans la constitution fondamentale du Dasein, puisque l’énoncé vrai est l’œuvre de l’Être dans toute sa clarté. C’est en cela que l’Être dans son apparaître répond au sens d’A-lèthéia. Dans son procès dévoilant dans l’horizon du temps, l’Être est ce qui donne vie ou ‘‘possibilise’’ le monde et les étants, en ce sens que le monde sort de son mutisme et n’est monde qu’à travers la vérité dé-voilante qui surgit de façon ek-statique à partir du Dasein. Heidegger illustre cela à travers ce vers extrait d’un poème de Stefane Georges en ces termes : « Aucune chose ne peut être là où le mot a failli »[192]. En effet, le Temps, la Vérité et la Parole trouvent leur sens à l’intérieur de l’étant-homme (Dasein). En d’autres termes, l’ontologie fondamentale devient, du coup, un humanisme. Comment le philosopher heideggérien nous conduit-il à l’humanisme alors que son initiateur affirme que sa philosophie n’a rien à avoir avec l’homme ?
Il affirme que son ontologie enquête en direction de l’étant, mais vise essentiellement l’Être ; elle ne se laisse pas obnubiler par le fait qu’elle questionne en direction de l’être de l’étant. La question quête en direction de l’étant-homme, mais ne se limite pas à lui. C’est pourquoi le philosopher heideggérien repose sur un langage particulier. D’où la déconstruction traditionnelle de l’homme entendu comme animal rationale. En le définissant de cette façon, toute métaphysique échoue devant la question de l’humanisme et le situe dans le domaine du mesurable, voire de l’animalité pure.
C’est pourquoi, il fait de la pensée la norme capable de bâtir un réel Abri authentique à l’homme. C’est à partir de la vérité de l’Être que l’homme pourrait trouver une véritable assise. En ce sens : « penser la vérité de l’Être, c’est penser en même temps l’humanitas de l’homo humanus »[193] . Penser l’homo humanus, c’est être capable de présenter le Dasein, avant tout, comme séjournant là. Le séjour parle de l’Ethos originaire où le dieu communique la chaleur dont a besoin l’âme pour vivre.
Il indique que « le séjour (Éthos) est pour l’homme le domaine ouvert à la présence du dieu »[194]. De là, nous déduisons que toutes les valeurs essentielles puisent leur force là, en ce lieu où la vie est initialement donnée aux mortels par le divin. Mais peut-on soutenir que la philosophie heideggérienne est sans reproche quant à la question de l’humanisme ? Ici nous épiloguerons, un tant soit peu, sur ce que nous qualifions de faux débat et exposerons, en quelques lignes, ce que nous considérons comme une goûte d’eau dans la mer ou le trébuchement de Heidegger.
Selon lui, l’oubli de l’Être résulte d’une posture dans laquelle le Dasein grec était installé. Ce qui veut dire qu’il a déjà chuté. Dès lors, il incombe de lui substituer un Dasein nouveau. D’où l’avènement d’Être et Temps. Déjà certains penseurs voient en cet ouvrage une forme d’activisme, dans la mesure où en parlant du Dasein inauthentique et du Dasein authentique, il jette, selon ses détracteurs, les bases théoriques du nazisme. Pis encore, Heidegger a accepté d’être le recteur de l’université de Fribourg en 1932, année où Hitler accède à la chancellerie du Reich. Mais, pour notre part, il s’agit d’un faux débat puisqu’il n’hésitera pas à démissionner du rectorat parce qu’il venait de comprendre que la révolution, qu’il souhaitait tant voir au niveau de l’université allemande, ne se réaliserait pas, surtout que Hitler conduisait la société allemande vers d’autres horizons qui ne sont nullement con-voqués par l’élan ontologique qu’annonce son ouvrage. On peut bien comprendre que l’adhésion de droit et non de fait au national socialisme fût une erreur qui, comme tout penseur original, le fait glisser, pour ainsi dire, dans la tradition métaphysique. C’est comme si l’ego du philosophe a pris le pas sur la question de l’Être. En d’autres termes, l’on est en droit de se demander si Heidegger, en engageant la déconstruction de la métaphysique traditionnelle, a pu proposer une ontologie de rupture systématique ! Le double et insidieux jeu du retrait et de l’apparaître, qui caractérise l’Être, n’a-t-il pas conduit Heidegger à des retouches régulières de sa pensée ? Ne pouvons-nous pas affirmer que la philosophie heideggérienne constitue, pour l’essentiel, la somme des commentaires des thèses de tous ses devanciers ? L’Être heideggérien n’est-il pas le reflet de l’Être des anciens ?
III. D’UN GLISSEMENT HEIDEGGÉRIEN DANS LA TRADITION
Que recèle fondamentalement cette formulation ? À quelle période de l’histoire de la pensée doit-on spécifiquement limiter la tradition philosophique ? Est-ce uniquement à partir des présocratiques, des postsocratiques ou encore plus loin des moyenâgeux ? Ne doit-on pas situer le pic de la tradition philosophique, si on s’en tient à la démarche critique de Heidegger, à partir de la question inaugurale soulevée par Être et Temps ? Évidemment, ces questions nous invitent à réfléchir sur le rapport que Heidegger a entretenu avec les anciens à savoir la question de l’Un depuis l’antiquité jusqu’aux préoccupations d’ordre ontologique de certains de ses contemporains. En clair, toutes ces interrogations donnent l’occasion d’indiquer que la philosophie heideggérienne, bien qu’originale dans sa forme, est liée, pour ainsi dire, en son fond, à la philosophie des penseurs qu’il a voulu dépasser. On pourrait donc dire qu’en voulant échapper au passé, il se retrouve rattrapé, comme œdipe-roi, par son propre destin historial. Quels sont les arguments qui pourraient autoriser une telle affirmation ?
Pour comprendre qu’il a toujours un pied de géant dans la tradition, il suffit de passer en revue quelques commentaires relatifs aux pensées ou doctrines d’un certains nombres d’auteurs qui n’ont pas pu être systématiquement évacuées par Heidegger. Au contraire, il semble répéter ou s’inspirer tacitement de ce que ses prédécesseurs ont déjà dit. Cette remarque commence avec Nietzsche. Car, contre toute attente, il y a, paradoxalement, un point de convergence entre les critiques nietzschéenne et heideggérienne de l’idéalisme platonicien. L’on sait bien que l’auteur du Le crépuscule des idoles récuse le platonisme. En ce sens, Platon est un pseudo-hellène qui est à l’origine du nihilisme. Heidegger partage pour une bonne part la même thèse. On comprend l’abondance des articles sur Nietzsche autour des années trente (30), où il critique le platonisme en tant que nihilisme. D’ailleurs il affirmait dans son Nietzsche II cette pensée assez évocatrice :
« Rien ne semble nous autoriser de prime abord à prendre la philosophie de Nietzsche pour l’achèvement de la métaphysique occidentale : car du fait qu’elle supprime le monde suprasensible en tant que le ‘‘monde vrai’’, elle constitue bien plutôt le rejet de toute métaphysique et se prépare à la désavouer définitivement »[195]. Qu’est-ce à dire ?
En méditant cette pensée, nous pouvons dire que Nietzsche a contribué au déblaiement de la nouvelle voie de Heidegger. Même si, concernant la question de l’Être, les deux auteurs ne convergent pas dans la même voie, ils ont néanmoins, ensemble, un même discours sur le fait que le nihilisme tire sa source depuis Platon. Ceci pour dire que Heidegger s’appuie constamment sur les anciens ou même la tradition pour construire sa philosophie. Ce qui nous amène à dire que la désobstruction qu’il engage contre l’impensé de la métaphysique est une forme de réhabilitation de cette tradition en ce qu’elle a d’essentiel et d’historial. N’est-ce pas toujours chez Husserl, qu’il retiendra la méthode phénoménologique dans le but de rendre possible son ontologie ? Il est vrai qu’il avoue lui-même que sa démarche ne coïncide pas du tout avec celle du maître ; aussi pouvait-il affirmer : « ‘‘La phénoménologie’’ n’a rien à voir, ni dans son thème, ni dans son mode de traitement, encore moins dans son questionnement fondamental et sa visée avec une phénoménologie de la conscience au sens actuel, c’est-à-dire au sens de Husserl »[196].
Cependant, nul ne peut, de façon audacieuse, nier que cette science a eu une réelle emprise sur Heidegger. Certains voient, en son ontologie, une pâle copie de la pensée de son maître (lorsqu’il s’agit des termes tels l’Etre-au-monde : In-Der-Welt-Sein, l’Être-avec-les-autres=Mit-sein). Néanmoins, il semble avouer que « la phénoménologie est la manière d’accéder à et de déterminer légitimement ce que l’ontologie a pour thème. L’ontologie n’est possible que comme phénoménologie »[197].
Déjà, à partir de la pensée husserlienne, nous pouvons confesser que la philosophie heideggérienne ne se nourrit pas seulement aux sources de Kant comme il le dit lui-même, il prend çà et là chez les anciens, des bribes pour en faire quelque chose de solide. Mais, au-delà de la lecture que celui-ci fait régulièrement des philosophes qui ont posé la question ‘‘qu’est-ce que l’étant ?’’, nous pouvons réitérer qu’il a visiblement du mal à faire une véritable ontologie débarrassée des termes traditionnels. Par exemple, la différence entre le Dasein et l’Homme. Ce qui nous amène à nous interroger de la manière suivante : comment appréhender l’homme d’une part et le Dasein d’autre part ? Le Dasein ne peut-il pas être assimilé au cogito cartésien? Ne pouvons-nous pas dire que l’effort d’éviter les pièges de la métaphysique moderne de la subjectivité est semblable à celui d’un paysan qui sème en terre aride ?
Remarquons que de peur de basculer dans les mêmes voies erronées que ses devanciers, le philosophe de l’Être refuse les approches classiques qui font de l’homme un animal rationale. C’est pourquoi il retient le mot Dasein pour désigner cet étant particulier. En d’autres termes, il nourrit l’ambition de faire dépérir l’homme, une façon de contourner les pièges de la métaphysique moderne de la subjectivité. Cependant Heidegger n’arrivera pas véritablement à rompre avec une telle philosophie. Il se heurte à de réelles difficultés dont l’une se situe au niveau du rapport intime que le Dasein entretient avec la conscience morale. Comment comprendre cela ? Suivons Heidegger à travers cette pensée : « La conscience morale doit être poursuivie de manière à retourner à ses soubassements et structures existentiaux et elle doit être rendue visible comme phénomène du Dasein »[198]. En commentant cette pensée, nous pouvons induire qu’il fait de la conscience une faculté au même titre que Descartes, à la différence qu’il la fait reposer sur l’Être.
Or, Descartes, en lieu et place de la vérité de l’Être, parle plutôt de lumière naturelle, c’est-à-dire de la raison, ultime faculté psychologique et morale de l’humain. Ce qui donne à croire qu’il ne s’éloigne pas de la métaphysique moderne de la subjectivité. Finalement, nous pouvons faire remarquer que le sujet pensant cartésien n’est que l’autre nom du Dasein.
À bien y voir de près, tout se présente comme si Heidegger fait dépérir le sujet pensant et ne laisse qu’un simple squelette dépourvu de chair. Finalement ce qui reste, c’est l’Être. Mais qu’est-ce que l’Être si ce n’est ‘‘la dernière fumée d’une réalité volatilisée’’ au sens nietzschéen du mot ? Ce qui veut dire que seul le sujet pensant, objectivable, a de la réalité. Il y aurait, subrepticement, une sorte d’incapacité de la part de Heidegger à évacuer la subjectivité. Cela se perçoit à travers les écrits sur Kant. Sa philosophie est, pour ainsi dire, nourrie à la source de la subjectivité transcendantale telle que pensée par l’auteur de la Critique de la raison pure.
Non seulement, il reste influencé par la subjectivité, mais semble sombrer dans ce qu’il a le plus reproché aux anciens : la constitution onto-théo-logique de l’histoire de l’Être. En effet, l’on sait que Heidegger redoutait de voir sa pensée être travestie et taxée de théologique. Mais une lecture approfondie témoigne de ce qu’il garde toujours, dans ses écrits, cette teinture religieuse ou théologique. La notion de Dieu est quasi permanente en sorte qu’on pourrait dire qu’Être et Temps représente la face visible de l’iceberg qui traduit une certaine conviction religieuse. Quand on sait l’emploi des notions tels le Sacré, la fuite des dieux ou l’expression grandement mentionnée ‘‘Seul un Dieu peut encore nous sauver’’ dans son entretien avec le journaliste de Der Spiegel. D’ailleurs il avoua substantiellement lui-même, lors de son entretien, avec un Japonais, dans Acheminement vers la parole, ce qui suit : « sans (ma) provenance théologique, je ne serais jamais arrivé sur le chemin de la pensée »[199]. Quel aveu ! Or, nous savons que l’auteur d’Introduction à la métaphysique affirmait qu’ « une philosophie religieuse est un cercle carré »[200]. Au regard de ces contradictions évidentes, nous pouvons retenir, pour l’essentiel, qu’il y a autant de subterfuges que d’ambiguïtés dans les approches conceptuelles élaborées par Heidegger. On note dès lors que la philosophie heideggérienne tombe elle aussi dans l’ontothéologie qu’il s’efforce vainement d’enrayer.
N’affirmait-il pas lui-même qu’: « (…) il faut donc poser en termes tout à fait neufs la question du sens de Être »[201]. Cela dit, en analysant cette affirmation, l’on s’attend bien à une définition tout à fait neuve donc originale de l’Être. Mais, hélas, l’auteur de Lettre sur Humanisme (ouvrage qui, en un sens, constitue une œuvre de maturité) en vient à démontrer qu’il s’est heurté lui aussi à des difficultés quant à la définition du concept de ‘‘Être’’. Au contraire, il retourne chez Parménide et réduit le sens de ‘‘Être’’ au silence, en ce sens que, même, la parole ne saurait le définir. Il manifeste visiblement cette difficulté qui l’emmène à la répétition de la même difficulté rencontrée depuis les présocratiques en ces termes : « L’Être est ce qu’il est »[202].
Quelle tautologie rébarbative ! Il finira par sombrer dans le vieux conflit des anciens. L’Être prend ainsi le visage du Logos héraclitéen. Car « Il reste un mystère »[203] ; mieux « une énigme »[204]. En outre, convient-il de mentionner que l’une des raisons qui indique que Heidegger n’échappe pas totalement à la tradition est qu’Être et Temps reste inachevé. Ce qui veut dire que l’Être semble poursuivre son chemin dans le cèlement, c’est-à-dire que l’Être s’enracine dans l’oubli. Nous pouvons donc dire que la métaphysique reste inachevée en dépit de l’ontologie fondamentale. La question de l’Être semble toujours demeurer dans l’oubli. Questionner son sens à nouveaux frais ne saurait mettre fin à l’histoire, c’est-à-dire à l’histoire de l’Être. C’est ce qui donne à dire que l’errance est ce qui caractérise la saisie de l’Être. Heidegger demeure dans l’errance comme ses prédécesseurs ; bien plus, il ne peut pas mettre fin à l’histoire, puisque ce qui est avant tout historial le transcende et se donne à penser selon les époques. Michel Haar confirmait cela en ces termes : « Sans l’errance (Irre), il n’y aurait pas de rapport d’envoi à envoi, pas d’Histoire »[205]. C’est comme si l’on s’installait dans un cercle vicieux où ce qui importe est la ‘‘philosophia perennis’’. Chaque penseur vient ajouter une pierre à l’édifice de la métaphysique. Puisque jamais, l’Être ne se laisse cerner pour de bon. Le principal est qu’il se révèle à chaque époque aux esprits devenus Esprits, afin d’assumer sa marche. N’est-ce pas ce que les anciens ont nommé sous le nom d’A-lèthéia ? L’Être, en un mot, est la Vérité elle-même qui, comme un objet d’amour, suscite la passion des prétendants, mais jamais ne se laisse épouser pour toujours. D’ailleurs l’Être et la Tradition sont, pour ainsi dire, consubstantiels, en ce sens que l’Être se retire en se donnant, il se transmet. C’est cela même le sens du verbe latin tradere.
CONCLUSION
La réflexion sur Heidegger : La tradition et l’oubli nous a conduit chez les anciens et a permis de nous rendre compte que la question de l’Être est aussi vieille que la tradition philosophique. Mais, ce qui est primordial, c’est que l’Être prend diverses figures au cours des différentes époques qui, malheureusement, ont contribué à l’éloigner de sa vérité. D’où la nécessité, pour Heidegger, de critiquer sans ménagement cette tradition métaphysique. Qui plus est, la première ontologie, développée avant lui, est mineure et ne fait fondamentalement pas l’expérience de l’Être ; alors que l’ontologie fondamentale est celle qui se lie depuis l’ouvert du Da-sein. Cependant, à la vérité, Heidegger semble être pris au piège en son propre Dasein historial. Il est toujours dépendant de son passé, des époques. Mieux, l’on pourrait dire que toute son ontologie, sa philosophie n’est que la répétition de l’histoire matinale de la métaphysique jusqu’à lui, en y ajoutant sa petite et essentielle pierre dans l’éclairage de l’énigme qu’est l’Être. N’avouait-il pas ceci : « Être et Temps, s’il est permis d’en dire un mot encore, n’est pas l’étiquette d’un nouveau médicament que l’on pourrait et devrait essayer, c’est le nom d’une tâche, c’est-à-dire d’un travail grâce auquel, peut-être, nous redeviendrons dignes de risquer un débat avec le plus intime de la philosophie effective, c’est-à-dire non pas de la nier mais de réaffirmer sa grandeur dans une réelle compréhension »[206].
BIBLIOGRAPHIE
ARISTOTE, La Métaphysique Tome 1, Paris, J. Vrin, 1953, Trad. J. Tricot.
BOUTOT, Alain, Heidegger et Platon : Le problème du nihilisme, Paris, PUF, 1987,
DESCARTES, René, Discours de la méthode, Paris, Garnier-Flammarion, 1966
DUBOIS, Christian, Heidegger, Introduction à une lecture, Paris, Seuil, 2000
FRANCE-LANORD, Hadrien, Paul Celan et Martin Heidegger, Paris, Librairie arthème Fayard, 2004
HEIDEGGER, Martin, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1967, Trad. G. Kahn.
HEIDEGGE, Martin, Nietzsche II, Paris, Gallimard, 1971, Trad. P. Klossowski
HEIDEGGER, Martin, Lettre sur l’humanisme, Paris, Aubier-Montaigne, 1983, Trad. R. Munier.
HEIDEGGER, Martin, La « Phénoménologie de l’Esprit de Hegel », Paris, Gallimard, 1984, Trad. E. Martineau.
HEIDEGGER, Martin, Etre te Temps, Paris, Gallimard, 1986, Trad. F. Vezin.
HEIDEGGER, Martin, Acheminement vers la parole, Paris, 1994, Trad. J. Beaufret, W. Brokmeir et F. Fédier
HAAR, Michel, La fracture de l’histoire, Grenoble, Jérôme Millon, 1994,
KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, Paris, Garnier Flammarion, 1976, Trad. J. Barni
NIETZSCHE, Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Le club français du livre, 1958, Trad. M. Robert.
NIETZSCHE, Friedrich, Le crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 1974, Trad. J-C. Hemery.
PLATON, La République, Paris, Garnier-Frères, 1966, Trad. R. Baccou.
REVEL, Jean-François, Descartes, inutile et incertain in Discours de la méthode, Paris, Librairie Générale Française, 1973,
SAFRANSKI, Rüdigger, Heidegger et son temps, Paris, Grasset et Fasquelle, 1996, Trad. I. Kalinowski.
BERGSON : DE LA DÉCOUVERTE DE LA DURÉE À LA NÉGATION DE LA NÉGATION DÉTERMINISTE DE LA LIBERTÉ
Ahissi Thomas Daquin KOUABLAN
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody Abidjan (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
À s’en tenir aux cadres de l’intelligence, on est enclin à universaliser le principe de causalité qui n’a de valeur certaine que dans le monde de la matière inerte. C’est ce que Bergson nous permet de dépasser en montrant que l’intuition de la durée arrache nos actes qui reflètent notre moi concret à tout déterminisme et témoigne que la liberté est un fait. Nous sommes libres quand nous brisons la croûte superficielle du moi pour coïncider avec notre durée. Parce qu’elle nous engage et dépend de nous, une telle liberté a pour corollaire, la responsabilité.
Mots-clés : Déterminisme, Durée, Liberté, Libre arbitre, Responsabilité, Temps spatial.
ABSTRACT :
Referring to intelligence concepts (framework), one is inclined to universalize causal principle that has no real value other than in the world of inert matter. This is what Bergson let us overcome by demonstrating that the intuition of duration tears out our actions which reflect our concrete self to every determinism and testify that liberty is a fact. We are free when we break the crust of me to coincide with our duration. For it “engages” us and belong to us, such a liberty involves responsibility.
Keywords : Determinism, Duration, Free will, Liberty, Responsibility, Space time.
INTRODUCTION
Dès l’avant-propos de son premier livre qui expose l’intuition fondatrice de sa philosophie et en dégage la première application pratique, Bergson annonce ceci :
« Nous essayons d’établir que toute discussion entre les déterministes et leurs adversaires implique une confusion préalable de la durée avec l’étendue, de la succession avec la simultanéité, de la qualité avec la quantité : une fois cette confusion dissipée, on verrait peut-être s’évanouir les objections élevées contre la liberté, les définitions qu’on en donne, et, en un certain sens, le problème de la liberté lui-même»[207].
De là, l’idée que la liberté est un fait qui ne devient problème que lorsque l’on confond la durée et son reflet spatial que nous tenons de la primauté de la vie sur la réflexion théorique. En fait, la liberté n’est pas une illusion subjective, elle est un fait qui peut être vécu mais non rationnellement pensé. C’est pourquoi, il faut, de l’aveu de Bergson, dépasser les conceptions déterministes et le libre arbitre dogmatique, qui témoignent d’une démission de l’esprit, et, alors, réhabiliter, réaffirmer la liberté créatrice de l’esprit.
Qu’est-ce qui distingue la durée du temps scientifique et comment se joue le rapport de la durée réelle à la liberté pour que Bergson puisse s’en prévaloir pour nier le déterminisme dogmatique ? Si la liberté se présente comme jaillissement de l’intériorité, peut-elle se distinguer de l’acte inconscient pour engager la responsabilité de celui qui l’éprouve ?
Nous entendons établir l’effectivité de la liberté et, par delà, la responsabilité de celui qui l’éprouve.
Notre démarche consistera à montrer que si la liberté fait problème dans le temps spatialisé de la science, la découverte de la durée réelle autorise à affirmer avec Bergson, que la liberté est un fait. Ainsi, nous pourrons mettre en rapport liberté et responsabilité.
I. LE FAUX PROBLÈME DE LA LIBERTÉ
En apparence opposés, le déterminisme et le libre arbitre font de la liberté un problème. Comment se présente-t-il de part et d’autre ?
A. Déterminisme et Liberté
Dans la préface à sa Théorie analytique des probabilités, Laplace présente l’expression la plus pure du déterminisme. Il écrit :
« Nous devons envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ses données à l’analyse, embrasserait dans la même formule, les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux »[208].
Ainsi, le déterminisme laplacien fait de l’état présent de l’univers une simple résultante de l’état précédant et rend possible la connaissance de l’avenir et du passé par une intelligence qui disposerait de toutes les conditions requises. On peut donc envisager le déterminisme comme la thèse selon laquelle tous nos actes sont déterminés nécessairement par des causes antécédentes assignables et donc prévisibles en droit, si l’on avait de ces causes une connaissance parfaite. A l’idée d’une telle détermination de l’action actuelle par ses antécédents, le déterminisme rejette toute idée de liberté.
Bergson distingue deux ordres d’arguments en faveur de la négation déterministe de la liberté. Il écrit :
« On invoque contre la liberté des faits précis, les uns physiques, les autres psychologiques. Tantôt on allègue que nos actions sont nécessitées par nos sentiments, nos idées, et toute la série antérieure de nos états de conscience ; tantôt on dénonce la liberté comme incompatible avec les propriétés de la matière, et en particulier avec le principe de la conservation de la force»[209].
De là, l’exposé qu’il fait du déterminisme physique d’une part, et du déterminisme psychologique de l’autre quoiqu’il sache qu’il s’agit de deux « espèces de déterminisme, deux démonstrations empiriques, différentes en apparence »[210].
Lié aux théories mécaniques, le déterminisme physique soutient que de par notre corps, nous sommes soumis comme les autres êtres de l’univers, aux lois du monde physique. Notre corps est comme toute matière organisée ou inorganisée, composé de molécules et d’atomes qui se meuvent sans relâche, s’attirent et se repoussent les uns les autres. Et, en tant que les éléments constitutifs du corps entretiennent entre eux et avec l’environnement des relations, les chocs reçus par le système nerveux influencent l’état moléculaire du cerveau qui se voit, à l’occasion, modifié. De ce point de vue, les états et les actes du sujet psychologique s’expliquent par les causes matérielles telles que les mouvements des molécules dans le cerveau. Loin d’être des créations de la conscience, les sensations, les sentiments et les idées seraient les effets mécaniques des chocs qui les ont précédés. Les chocs peuvent également partir du cerveau au système nerveux qui les distribue alors dans notre organisme. Ce sont les réactions de l’organisme à ces mouvements moléculaires et atomiques qui s’expriment à travers les mouvements réflexes et les actions que l’on qualifie de libres et volontaires.
On le voit, selon le déterminisme physique, ce qu’on appelle actes libres, ce sont en réalité des actes nécessairement déterminés qu’on pourrait prédire sur la base de leurs antécédents. Au même titre que l’on prévoit les phénomènes astronomiques, on pourrait, par exemple, prédire les actions d’un individu sur la base d’une connaissance de la disposition des molécules et atomes de son organisme et de ceux de l’univers qui peuvent l’influencer. Bref, notre volonté serait conditionnée par notre détermination physique. Par conséquent, nous ne sommes pas libres.
C’est à cette même thèse qu’aboutit le déterminisme psychologique en postulant que nos états psychologiques se déterminent mécaniquement comme une cause détermine un effet. Ainsi, envisage-t-on nos états psychologiques à l’image de ce qui a cours dans le monde matériel où le physicien énonce comme loi : prises dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets.
Le déterminisme psychologique se représente le moi comme un agrégat d’états de conscience. Ces états de conscience, étant des phénomènes dévitalisés, sont soumis aux lois qui régissent les phénomènes. Ils tombent dans la sphère de la multiplicité numérique, caractéristique des objets matériels. C’est pourquoi, le déterminisme psychologique, avec l’associationnisme, soutient que nos états de conscience actuels sont déterminés par une nécessité géométrique, par les états antérieurs. Chaque état psychologique est alors déductible du précédent et cause du suivant. Dans cette perspective, un état psychique peut se reconstituer et même se constituer par addition de faits de conscience élémentaires.
La pensée apparaît alors comme une association mécanique d’idées. Ainsi, on pourrait prévoir nos idées ou humeurs futures sur la base de nos émotions actuelles. Ce n’est pas de manière fortuite que la psychanalyse soutient que nos actes dont nous ignorons les motifs sont les moins libres et les fait reposer sur des mobiles inconscients dont nous sommes d’autant plus esclaves que nous les ignorons.
En somme, de quelque ordre qu’il soit, le déterminisme nie la liberté humaine. L’affirmation de la liberté apparaît, dans cette perspective, comme l’expression de l’ignorance du déterminisme. C’est ce que Spinoza rend bien dans l’Éthique quand il affirme : « … les hommes se croient libres pour cette seule cause qu’ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés … Ceux donc qui croient qu’ils parlent, ou se taisent, ou font quelque action que ce soit, par un libre décret de l’Ame, rêvent les yeux ouverts »[211].
Que le déterminisme soutienne que c’est un rapport nécessaire de cause à effet qui lie nos états de conscience les uns aux autres, et rejette par ce fait même la possibilité de la liberté, voilà qui signifie que pour les déterministes le même demeure le même et que nos actions peuvent se prévoir et même se rééditer. D’un tel point de vue, le déterminisme fait prévaloir l’idée selon laquelle le sujet n’est qu’un acteur sur lequel le temps ne mord pas. Le temps déterministe est donc un temps homogène qui ne nous révèle pas la nature réelle du temps.
Si le libre arbitre qui entend affirmer de manière absolue la liberté humaine s’inscrit contre la négation déterministe de la liberté, comment le temps y est-il perçu ?
B. Le libre arbitre
Pour les défenseurs du libre arbitre, l’acte présumé libre échapperait à tout déterminisme. Cette définition s’apparente à l’image que le langage commun donne de la liberté. La liberté y est, en effet, présentée comme une absence de contrainte. Notre volonté apparaît alors comme une force souveraine et puissante. C’est ce que nous traduisons par l’expression : « Je fais cela parce que je le veux». Le “je” qui fait cela, le fait parce que le même “je” le veux. Rien ne l’empêche de faire ce qui lui plaît. Cela sous-entend que tout en étant le même homme, avec les mêmes idées, les mêmes passions et dans les mêmes circonstances, j’aurais le pouvoir de me déterminer autrement que je ne l’ai fait. L’acte libre supposerait alors la contingence, le pouvoir de dire oui ou non, non seulement aux motifs de ma nature, mais aussi aux contraintes extérieures. On trouve chez Descartes l’illustration philosophique la plus concrète de ce libre arbitre.
En effet, pour Descartes, c’est par la liberté que je reconnais que « je porte l’image et la ressemblance de Dieu » car si la liberté de Dieu s’étend à plus d’objets que la nôtre, le pur pouvoir que nous avons de dire oui ou non est égal à celui de Dieu. Aussi, la liberté ne se démontre pas, elle ne se prouve pas mais s’éprouve. « La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons »[212]. C’est constamment que nous expérimentons en nous, notre pouvoir de vouloir ou de ne pas vouloir, d’affirmer ou de nier, de choisir, en somme, l’un ou l’autre des deux contraires qui s’offrent à notre jugement ou à nos possibilités d’action. Cette expérience de la liberté, nous la faisons en particulier dans le doute.
Dans le doute nous affirmons en effet, l’indépendance absolue de notre volonté à l’égard de la raison et faisons ainsi l’expérience de notre liberté. Cette liberté se manifeste d’abord dans l’état d’indifférence lorsque la volonté « n’est pas poussée d’un côté plutôt que de l’autre par sa perception du vrai ou du bien»[213]. L’âne de Buridan en est l’illustration. En fait, placé à égale distance d’une picotin d’avoine et d’un seau d’eau, l’âne est également porté à l’un ou à l’autre et mourra s’il n’a pas la liberté de faire un choix. Ici, la liberté est précisément ce qui permet de choisir entre deux partis auxquels nous sommes également déterminés. Dans l’indifférence, la volonté n’est déterminée par aucun motif ou mobile capable de l’emporter dans un sens ou dans l’autre ; sa liberté est précisément ce qui lui permet de sortir de cet état d’indifférence.
La liberté se manifeste également par le pouvoir d’affirmer ou de nier, de choisir ou de ne pas choisir dans une indépendance absolue à l’égard de toutes déterminations sensibles ou intellectuelles. C’est à proprement parler ce qu’on appelle le libre arbitre, cette possibilité qu’a la volonté de prendre absolument ses décisions d’une façon totalement libre et indépendante de toute détermination.
« Au point que, même lorsqu’une raison fort évidente nous pousse vers un parti, quoique, moralement parlant, il soit difficile de faire le contraire, parlant néanmoins absolument, nous le pouvons. Car il nous est toujours permis de nous empêcher de poursuivre un bien qui nous est clairement connu, ou d’admettre une vérité évidente, pourvu seulement que nous pensions que c’est un bien de témoigner par là notre libre arbitre »[214].
Être vraiment libre, c’est pour Descartes obéir à la raison, refuser le servage de nos passions et préjugés. Seule la connaissance de la vérité doit guider ma volonté. Mais la liberté n’est possible que si nous avons la liberté d’être libre c’est-à-dire si nous pouvons librement choisir entre la liberté et l’esclavage. Pour être vraiment libre en obéissant à la raison, il faut non seulement avoir le pouvoir de se déterminer en accord avec elle, mais aussi de lui désobéir. L’absolu de la liberté lui vient de ce qu’il est possible à la volonté d’opter délibérément pour le mal ou le faux car c’est aussi le choix d’un bien, celui de l’affirmation de notre liberté. Le moralement impossible est absolument possible au nom de la liberté absolue de notre volonté.
Selon les défenseurs du libre arbitre, nous sommes libres quand nous choisissons entre deux possibles d’égale valeur. Ainsi, la liberté est possibilité de choix. Précisément, aucun d’entre les motifs ne pèse plus que l’autre au moment du choix libre. Ils se valent.
Spinoza avait déjà émis des réserves sur le libre arbitre cartésien, particulièrement à propos de l’exemple de Buridan. Il avait, en effet, fait remarquer que si l’on supposait un homme et non un âne dans la situation d’indifférence, il lui faudrait plutôt être le plus sot des ânes et non une chose pensante pour mourir de faim et de soif. Du point de vue de la raison, en vertu même de la définition de l’homme comme une chose pensante par Descartes lui-même, Spinoza en arrive à ironiser l’affirmation cartésienne de la liberté d’indifférence.
Une analyse bergsonienne permet de voir que derrière l’égalité de valeur des possibles se cache l’identité du sujet qui choisit. Au lieu d’être à la fois identique et changeant, le sujet demeure le même. Ainsi, c’est dans une entière indifférence que la volonté opte pour l’un ou l’autre motif. Comme telle, elle est soumise au temps mécanique et non au temps de l’existence. De ce fait, nous pouvons dire que dans l’égale possibilité des contraires, il ne nous est pas révélé la nature réelle du temps. C’est donc un temps desséché de toute réalité qui est à l’œuvre dans le libre arbitre. Par cela même, le moi se trouve spatialisé et ne connait ni le progrès, ni l’hésitation caractéristique du choix libre. Au lieu de tenir un discours parallèle au discours déterministe, le libre arbitre nie donc la liberté sans le savoir. Il tient, sans le savoir, le même discours que le déterminisme.
Ce qui précède nous autorise à affirmer que c’est la confusion du temps réel et du temps mécanique qui fait de la liberté un problème. Comment Bergson présente-t-il cette origine ?
II. DU TEMPS SCIENTIFIQUE AU TEMPS DE L’EXISTENCE
Dans une correspondance adressée à William James le 09 Mai 1908, Bergson écrit :
« Ce fut l’analyse de la notion de temps, telle qu’elle intervient en mécanique ou en physique, qui bouleversa toutes mes idées. Je m’aperçus, à mon grand étonnement, que le temps scientifique ne dure pas, qu’il n’y aurait rien à changer à notre connaissance scientifique des choses si la totalité du réel était déployée tout d’un coup dans l’instantané, et que la science positive consiste dans l’élimination de la durée. Ce fut le point de départ d’une série de réflexions qui m’amenèrent, de degré en degré, à rejeter presque tout ce que j’avais accepté jusqu’alors, et à changer complètement de point de vue »[215].
Se lit à travers ces lignes, ce que Bergson lui-même considère comme l’événement majeur de sa carrière : la découverte presqu’à son insu de l’irréalité du temps scientifique. Le temps est donc au cœur de la révolution de Bergson. C’est, en effet, la découverte de la durée réelle qui le délivre de ce qu’il avait jusque-là tenu pour le savoir et l’inscrit dans l’ambiguïté qui caractérise le philosophe. Cette ambiguïté, Merleau-Ponty la présente, avec raison, comme « Le mouvement qui reconduit sans cesse du savoir à l’ignorance, de l’ignorance au savoir, et une sorte de repos dans ce mouvement…»[216]
Une fois le bouleversement consommé, Bergson va faire de la durée vraie qu’il venait de découvrir, le critérium de sa réflexion philosophique. C’est à la découverte de ce critérium que nous sommes conduits par le détour du temps scientifique.
A. Le temps scientifique
C’est à la conquête de la nature profonde du temps tel qu’il apparaît dans les sciences que Bergson est conduit, malgré lui, au constat que « le temps scientifique ne dure pas ». Autrement dit, c’est un temps privé de ce qui en réalité le fonde, le caractérise. Il est desséché de toute réalité. Le temps dont parle la science est abstrait et homogène, c’est une succession d’instants extérieurs les uns aux autres. On sait, cependant, que « dès l’instant où l’on attribue la moindre homogénéité à la durée, on introduit subrepticement l’espace »[217].Le temps qui passe y est substitué par des intervalles qui se valent et n’ont que faire de ce qui s’y fait.
En ce sens, l’expression temps scientifique est synonyme de l’irréalité du temps. Cette irréalité s’origine dans le symbolisme scientifique nécessaire à la manipulation et à l’action. C’est la substitution de la représentation à la réalité, du signe au réel, si nécessaire à la pratique scientifique, qui l’éloigne pourtant de la réalité.
« Il est de l’essence de la science, en effet, de manipuler des signes qu’elle substitue aux objets eux-mêmes. Ces signes diffèrent sans doute de ceux du langage par leur précision plus grande et leur efficacité plus haute ; ils n’en sont pas moins astreints à la condition générale du signe, qui est de noter sous une forme arrêtée un aspect fixe de la réalité»[218].
Fait pour nous faciliter la tâche en nous offrant un équivalent figé du mobile qui en facilite la manipulation, le signe escamote la réalité. « La ligne qu’on mesure est immobile, le temps est mobilité. La ligne est du tout fait, le temps est ce qui se fait, et même ce qui fait que tout se fait»[219].
Du temps à la ligne, de la mobilité à l’immobilité, du se faisant au déjà fait, il y a toute la distance qui sépare le réel de sa représentation spatiale. « Le temps, conçu sous la forme d’un milieu indéfini et homogène, n’est que le fantôme de l’espace obsédant la conscience réfléchie»[220]. En effet, familiarisés avec l’idée de l’espace,
« nous juxtaposons nos états de conscience de manière à les apercevoir simultanément, non plus l’un dans l’autre, mais l’un à côté de l’autre ; bref, nous projetons le temps dans l’espace, nous exprimons la durée en étendue, et la succession prend pour nous la forme d’une ligne continue ou d’une chaîne dont les parties se touchent sans se pénétrer»[221].
Convertie en trajectoire, la succession épouse la divisibilité et l’uniformité qui caractérisent l’espace. Quand le temps cesse d’être du se faisant pour se convertir en une trajectoire, ce n’est plus ce qui s’y fait mais un ensemble d’intervalles qui est pris en compte. Le mouvement apparaît en ce sens comme un ensemble d’unités uniformes.
« Bref, le temps dont on parle en astronomie est un nombre, et la nature des unités de ce nombre ne saurait être spécifiée dans les calculs : on peut donc les supposer aussi petites qu’on voudra, pourvu que la même hypothèse s’étende à toute la série des opérations, et que les rapports successifs de position dans l’espace se trouvent ainsi conservés »[222].
Temps-nombre, le temps de la science n’est pas le temps de la conscience ; il n’est pas le temps vécu, mieux, ce n’est pas le temps réel. L’expérience nous confirme que lorsque nous nous laissons vivre, lorsque nous nous confions à cette conscience intime qui résiste à toute quantification, une heure d’horloge peut nous paraître longue ou brève. C’est ce temps qualitatif subjectivement vécu que Bergson nomme durée pure, durée concrète, durée intérieure, durée réelle.
B. Le temps de l’existence : la durée réelle
Si la science manque le devenir qui caractérise le temps de l’existence, nous expérimentons le flux continuel de la durée intérieure quand nous rentrons en nous-mêmes.
« La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s’abstient d’établir une séparation entre l’état présent et les états antérieurs (…) On peut donc concevoir la succession sans la distinction, et comme une pénétration mutuelle, une solidarité, une organisation intime d’éléments »[223].
Très expressives, ces lignes bergsoniennes traduisent l’épaisseur de la durée. La durée est une étoffe substantielle. Elle échappe à la distinction tranchée qui caractérise l’espace. C’est pourquoi, nous ne l’expérimentons qu’en nous libérant, mieux, en nous purifiant des habitudes de l’intelligence discursive. La durée rime avec la fusion les uns dans les autres de nos états psychiques. Elle est le grossissement continuel de la vie intérieure qui intègre et colore ses différents moments. « Notre durée n’est pas un instant qui remplace un instant : il n’y aurait alors jamais que du présent, pas de prolongement du passé dans l’actuel, pas d’évolution. La durée est le progrès continu du passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant »[224].
À l’opposé du temps de l’horloge dont les différents moments se juxtaposent, la durée retient le temps qui passe, elle fait boule de neige avec elle-même. Elle se vit comme totalité, plénitude et abolit, de ce fait, le passé, le présent et le futur dans leur distinction tranchée. Ici, le passé colore le présent, l’enrichit. La durée est mémoire.
« La durée ne désigne plus seulement ici l’étendue du temps, comme la « duratio » des classiques, mais l’acte de la continuation, l’acte de se maintenir dans et à travers le temps, cette dureté, cette endurance, cette solidité que l’on entend dans la « durée » même(au-delà de sa « fluidité ») et qui conjure la disparition non pas par les enchantements éternitaires de la représentation spatiale, mais par l’épreuve réelle de la conservation , du passage (comme acte de passer, bien loin de la passivité), ou de la création »[225].
C’est le propre de la durée de se ramasser et de continuellement prolonger ses moments les uns dans les autres. Elle conserve ses moments pour, de l’intérieur, les porter vers l’avenir. Par ce continuel enrichissement de soi par soi, rien n’y demeure jamais le même. « La durée proprement dite n’a pas de moments identiques ni extérieurs les uns aux autres, étant essentiellement hétérogène à elle-même, indistincte, et sans analogie avec le nombre »[226]. La durée récuse la répétition, la réédition.
Dans L’évolution créatrice, Bergson dégage dans une formule saisissante, les traits caractéristiques de la durée : « pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même »[227]. Il convient d’examiner les trois moments de cette assertion pour mieux cerner l’existence consciente et par-delà l’existence en général puisque la suite du texte nous le demande.
Affirmer qu’exister consiste à changer, c’est situer le devenir au cœur de l’existence, en faire l’étoffe. Cela signifie que rien n’est donné au départ ; tout advient. Et pour parler comme Héraclite, tout coule. Rien ne demeure. Tout est porté à n’être plus ce qu’il était ; la transformation est consubstantielle à l’existence. « Il n’y a pas d’état d’âme, si simple soit-il, qui ne change à tout instant, puisqu’il n’y a pas de conscience sans mémoire, pas de continuation d’un état sans l’addition au sentiment présent du souvenir des moments passés. En cela consiste la durée »[228]. Mais le devenir n’est pas étourdissant puisqu’il s’agit de changer à se mûrir. Il n’est point besoin d’une dynamique extérieure qui soutiendrait le devenir afin que tout ne bascule. Il s’agit ici d’une succession sans extériorité qui signifie que le passé ne passe pas mais se continue dans le présent, le gonfle, le grossit. C’est un rapport de soi à soi qui fait que le passé ne détermine pas le présent et que changer, c’est se mûrir. Ce mûrissement est création de soi par soi. Si le devenir est mémoire, il n’entame cependant pas la création. Le passé se conserve certes, mais il colore le présent toujours différent qui en fait par ce fait même un passé toujours différent ; de là l’originalité caractéristique de la durée, son imprévisible nouveauté. Si dans la durée le mûrissement est création, c’est bien parce que quoique coloré par le passé, le présent n’en découle pas comme son effet. Le présent n’est pas contenu dans le passé ; passé et présent coexistent et créent continuellement. La durée est cette création même.
III. DURÉE ET LIBERTÉ
« Durée et liberté sont une seule et même chose, et chaque fois que, brisant la croûte du moi superficiel constitué par les habitudes, la vie sociale et le langage, nous ressaisissons au plus profond de nous-mêmes le dynamisme de la durée, nous sommes libres, d’une liberté qui s’affirme elle-même, incommensurable à toutes les prétentions du déterminisme scientifique »[229].
Si le temps scientifique porte à adhérer au déterminisme, la durée qui organise et fond les uns dans les autres les différents moments de ma vie entière, est le temps de la liberté. Révélatrice de ma personne entière et profonde, cette liberté m’exprime, m’engage. N’est-elle pas en ce sens, le témoignage de ma responsabilité ?
A. La liberté comme fait
« Au-dessous de la durée homogène, symbole extensif de la durée vraie, une psychologie attentive démêle une durée dont les moments hétérogènes se pénètrent ; au-dessous de la multiplicité numérique des états conscients, une multiplicité qualitative ; au-dessous du moi aux états bien définis, un moi où succession implique fusion et organisation »[230].
De même qu’il distingue deux niveaux de la temporalité, de même, Bergson distingue deux aspects du moi : le moi social qu’il nomme également moi superficiel « aux états bien définis » et le moi profond « où succession implique fusion et organisation ». Il en est ainsi parce que « la durée, loin de désigner seulement la succession temporelle, quand on la purifie de toute spatialité, désigne aussi l’acte réel d’une conscience ou d’un moi dans cette succession »[231]. La conscience connaît donc deux niveaux de vie : une vie authentique où elle vit sa propre durée et une vie inauthentique où elle se conforme au temps social. Cela signifie que nous agissons par extériorisation ou par intériorisation. Ainsi, « Agir librement, c’est reprendre possession de soi, c’est se replacer dans la pure durée »[232].
Être libre, c’est se libérer du temps spatial pour se situer dans la durée, c’est se prendre en charge, agir par intériorisation. En ce sens, la liberté n’est pas un donné ; il s’agit de se libérer, et, il faut le vouloir. « Nous sommes libres toutes les fois que nous voulons rentrer en nous-mêmes »[233]. Ainsi, la liberté est une tâche ; nous en avons l’initiative. Pour être libre, il faut en avoir la volonté parce que la liberté n’est pas un attribut de l’homme. L’homme doit en décider. Elle est le fait de quelques privilégiés qui ne l’éprouvent que rarement parce qu’il s’agit d’être soi, de rompre la servitude spatiale et sociale. Cela ne signifie pas que Bergson en fait l’attribut de ces privilégiés. La liberté n’est pas un attribut social comme dans la Grèce antique. Les privilégiés dont parle Bergson sont les hommes capables de conquérir leur soi intérieur.
La liberté bergsonienne est conformité à soi. « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu’on trouve parfois entre l’œuvre et l’artiste»[234]. En fait, l’acte libre est un témoignage de notre caractère, et notre caractère, c’est notre histoire, dont l’image temporelle est notre ‘’ passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant ‘’. À l’mage de l’artiste qui part de son histoire pour faire venir au jour une œuvre qui, quand elle est originale, manifeste son ipséité, l’acte libre est le total rassemblement du moi en lui-même, la puissance créatrice de la durée. Je suis tout entier dans l’acte libre et dans ses motifs. Un tel acte a raison de ses motifs car c’est mon caractère, c’est-à-dire moi, ma personne qui en est l’origine. Ce qui compte ici, c’est mon total engagement par lequel je me fais.
« Nous voulons savoir en vertu de quelle raison nous nous sommes décidés, et nous trouvons que nous nous sommes décidés sans raison, peut-être même contre toute raison. Mais c’est là précisément, dans certains cas, la meilleure des raisons. Car l’action accomplie n’exprime plus alors telle idée superficielle, presque extérieure à nous, distincte et facile à exprimer : elle répond à l’ensemble de nos sentiments, de nos pensées et de nos aspirations les plus intimes, à cette conception particulière de la vie qui est l’équivalent de toute notre expérience passée »[235].
Je suis d’autant plus libre que mon acte me révèle en tant qu’œuvre de mon âme entière. C’est tout entier qu’on va à la liberté et non du bout de l’âme. Le libre c’est le tout simple, c’est le profond. Il n’a que faire du mécanique, du régional et du partiel caractéristiques du comique. Bergson le distingue à juste titre du comique quand il affirme que « Tout le sérieux de la vie lui vient de notre liberté »[236]. L’acte libre jaillit des profondeurs de l’âme ; c’est l’acte où, cherchant après coup les motifs de notre action, nous nous rendons compte que nous nous ne saurions en rendre raison. L’action, par excellence, sera celle qu’aucune raison ne saurait justifier ou du moins celle dont la seule raison c’est moi, l’ineffable, et comme le dit Bergson, la meilleure des raisons.
« Une action est notre œuvre quand elle exprime notre personnalité, quand elle se rattache à notre histoire, se rapporte à notre caractère. Ce n’est pas à dire qu’elle soit nécessitée par notre caractère ou déterminée par notre histoire. Les antécédents psychologiques n’agissent pas comme des causes physiques. Des antécédents étant posés, étant donnée une vie antérieure, plusieurs actions sont données comme également possibles, mais une fois l’action accomplie, elle ne sera nôtre que si elle nous ressemble »[237].
La liberté bergsonienne ne réside pas dans l’assomption ou la négation d’une quelconque nécessité mais dans l’adhésion à son moi profond qui est durée créatrice. « La liberté est donc un fait, et, parmi les faits que l’on constate, il n’en est pas de plus clair»[238]. Si elle est impénétrable au spectateur, elle est pour la conscience suffisamment claire et simple. Faite pour être vécue, la liberté n’est pas faite pour qu’on en parle. Bergson se contente justement d’indiquer : « On appelle liberté, le rapport du moi concret à l’acte qu’il accomplit »[239]. Quel sens prend la responsabilité dans un tel contexte ?
B. La liberté et la responsabilité
André Lalande présente la responsabilité comme « situation ou caractère de celui qui peut être appelé à « répondre» d’un fait »[240], avant de définir la responsabilité morale comme « situation d’un agent conscient à l’égard des actes qu’il a réellement voulus. Elle consiste en ce qu’il peut alors, devant tout être raisonnable, en donner les motifs, et qu’il doit, suivant la valeur et la nature de ceux-ci, encourir le blâme ou l’estime qui s’y attachent »[241]. Peut-on, au regard de ces définitions, affirmer que l’acte libre bergsonien est un acte responsable ?
C’est Bergson qui présente l’acte libre comme celui dans lequel c’est « sans raison », voire « contre toute raison que nous nous sommes décidés ». Cela laisse penser qu’il n’est pas un acte lucide mais une libération de l’instinct. On pourrait alors le rapprocher de la manifestation du moi inconscient freudien. Tout comme l’inconscient freudien est une zone souterraine, Bergson présente le moi profond comme le moi d’en bas, l’eau vive sous la croûte de glace du moi superficiel. Cela n’autorise cependant pas une réduction du moi profond bergsonien à l’inconscient freudien pour ainsi faire de l’acte libre bergsonien un acte inconscient dont on ne saurait répondre. L’inconscient, ce système de l’appareil psychique qui contient des représentations refoulées qui cherchent à se libérer en faisant éclater la croûte des conventions sociales et des lois morales, ne dispose que de voies inconscientes et involontaires. A contrario, le moi profond bergsonien est cet aspect de notre moi avec lequel nous coïncidons chaque fois que, volontairement, nous rentrons en nous-mêmes pour reprendre possession de nous-mêmes. Il s’agit de le vouloir, il suffit d’y prendre garde.
On comprend donc qu’on est loin des manifestations de l’inconscient dont chacun fait l’expérience à travers lapsus, rêves, actes manqués et bien d’autres formes. La fatalité freudienne s’oppose à la liberté bergsonienne qui est un effort continuel de libération.
« Il faut que, par une contraction violente de notre personnalité sur elle-même, nous ramassions notre passé, qui se dérobe, pour le pousser, compact et indivise, dans un présent qu’il créera en s’y introduisant. Bien rares sont les moments auxquels nous nous ressaisissons nous-mêmes à ce point : ils ne font qu’un avec nos actions vraiment libres »[242].
L’acte libre, c’est celui où je me ramasse. C’est tout entier qu’on va à l’acte libre. C’est mon moi, ma personne la plus profonde, qu’il exprime. La liberté, c’est le profond, le total. Je ne saurais m’y soustraire, je ne saurais m’en dérober. Elle m’engage entièrement. « La liberté, c’est aussi d’abord d’être soi, et de l’être réellement : non comme une brève et incertaine brèche dans le déterminisme mais comme une poussée irrésistible qui nous exprime pleinement »[243].
On ne triche pas avec la liberté ou plutôt, la liberté ne trahit pas le libre. Elle est révélation de ce que je suis foncièrement. En ce sens, c’est entièrement que je réponds de mes actes libres. Il n’y a pas d’actes dans lesquels j’engage ma responsabilité autant que dans les actes libres parce qu’il n’y a pas d’actes qui manifestent aussi profondément mon soi intérieur, mon moi profond. C’est ce qui autorise Jankélévitch à affirmer que
« L’action libre est de toutes les œuvres dont un homme est l’auteur celle qui lui appartient le plus essentiellement ; il se reconnaît en elle mieux que l’artiste dans son ouvrage, mieux que le père dans son enfant. C’est une paternité plus profonde, une sympathie puissante et intime. La liberté se dégage du passé total ; elle exprime une sorte de nécessité supérieure – la détermination du moi par le moi ; car c’est le même qui est ici à la fois cause et effet, forme et matière »[244].
On ne saurait donc sérieusement taxer d’irrationnel l’acte libre bergsonien et affirmer, par delà, l’irresponsabilité de celui qui l’éprouve. Au fond, tout comme le sujet ne se réduit pas à sa dimension rationnelle, la liberté n’est pas simplement rationnelle. J’y vais de tout mon être et c’est justement parce qu’elle est une expression singulière de mon moi profond que j’en suis l’unique responsable.
« Si l’acte libre est celui qui exprime au mieux mon caractère, c’est-à-dire, comme toute notre expérience semble l’attester, celui en lequel je me reconnais le mieux – et dont je suis assuré qu’il fut le mien, seulement le mien, et non pas celui d’un autre -, alors on comprend le sens précis de la récusation, par Bergson, de la problématique du rapport entre la liberté et la rationalité : c’est que la raison est, par essence, la même pour tous, et qu’une action simplement rationnelle ne serait pas encore mienne, et partant pas encore libre »[245].
En somme, l’acte libre est celui dans lequel je suis tout entier dans la cause et l’effet, celui qui affirme ma personnalité ; il est le témoignage de ma personne dont je suis responsable.
CONCLUSION
À voir de près, les arguments déterministes qui militent en faveur de la négation de la liberté reposent sur la confusion du temps de l’existence avec son symbole, le temps scientifique. Pour résorber le problème de la liberté qui en résulte, Bergson établit une distinction entre ces deux niveaux de la temporalité.
L’irréalité du temps scientifique exige, en effet, son dépassement pour accéder au à la durée vraie. Il s’agit de dépasser le superficiel qui est impersonnel, pour reconquérir notre personnalité profonde, notre moi intérieur. C’est dans le surgissement de notre intériorité qui est durée créatrice, que nous éprouvons notre liberté. Il s’agit d’être soi dans notre agir, d’engager notre personnalité entière, de faire éclater le superficiel. Un tel engagement appelle la responsabilité.
Il convient donc de retenir qu’en nous réconciliant avec nous-mêmes pour faire éclater la croûte superficielle du moi, nous éprouvons une liberté qui est le témoignage de notre personne la plus profonde et engage le mieux, notre responsabilité.
BIBLIOGRAPHIE
BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997.
BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1997.
BERGSON, Henri, Le rire, Paris, PUF, 1997.
BERGSON, Henri, La pensée le mouvant, Paris, PUF, 1998.
BERGSON, Henri, Cours II, édité par Henri Hude avec la collaboration de Jean-Louis Dumas, Paris, PUF, 1992.
BERGSON, Henri, Lettre à William JAMES, in MELANGES, Paris, PUF, 1972.
DESCARTES, René, Lettre au Père Mesland, 9Fév.1645, trad. Alquié, in œuvres philosophiques de Descartes, t.III, Paris, Dunod, 1973.
DESCARTES, René, Principes de la philosophie, Paris, J.Vrin, 1993.
FRANÇOIS, Arnaud, Bergson, Paris, ellipses, 2008.
JANKÉLÉVITCH, Vladimir, Henri Bergson, Paris, PUF, 1959.
LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 2002.
LAPLACE, Pierre Simon, Théorie analytique des probabilités, Paris, Courcier, 1814.
LOMBARD, Jean, Bergson : création et éducation, Paris, L’harmattan, 1997.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Eloge de la philosophie, Paris, Idée/Gallimard, 1979.
MEYER, François, Pour connaître Bergson, Paris, Bordas, 1988.
SPINOZA, Baruch, Éthique, Paris, G/F, 1965.
WORMS, Frédéric, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, 2004.
PRÉSCOLARISATION ET PERFORMANCES SCOLAIRES À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Léopold B. BADOLO
Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
RÉSUMÉ :
Le présent article se propose d’étudier les liens entre préscolarisation et performances scolaires chez deux groupes indépendants d’élèves burkinabé. 168 sujets des deux sexes, moyennement âgés de 8ans5 mois, ont été évalués. Les performances scolaires ont été évaluées à partir de la moyenne annuelle obtenue par chaque apprenant. Les résultats montrent qu’au CP2, il n’y a pas de lien statistique significatif entre préscolarisation et performances scolaires. Par contre, au CE2, ce lien est significatif et distingue nettement les filles et les garçons. Il en ressort que bien qu’entretenant des liens avec les productions scolaires, la préscolarisation n’est pas en soi et à elle seule suffisante pour déterminer ou expliquer les performances des apprenants.
Mots-clés : Burkinabé, Classe-Elèves, Performances scolaires-Préscolarisation, Primaire-Sexe.
ASBRACT :
This article aims to study links between preschool and school performance in two independent groups of Burkina Faso pupils. 168 subjects of both sexes aged averagely 8 years and 5 months have been concerned by the study. School performances were evaluated from the average obtained by each student. The results show that the CP2 form, there is no statistically significant relationship between the preschool and school performance. But, with the CE2 form, this link is significant and clearly distinguishes girls and boys. It appears that although it has links with school productions, the preschool is not in itself and by itself sufficient to determine or explain the performance of learners.
Keywords: Burkinabe, Class-Pupils, School performance- Preschool-Primary-Sex.
INTRODUCTION
Le préscolaire représente la période qui précède la scolarisation obligatoire. De plus en plus, l’inscription des enfants à l’école primaire est précédée par un passage à l’école maternelle (3-6 ans). Les attentes des parents vis-à-vis de l’école maternelle (autre appellation du préscolaire) sont diverses: socialiser les enfants, faciliter leur développement, élargir leur univers en les séparant du milieu familial, favoriser leur adaptation au milieu scolaire, les rendre plus autonomes, leur apprendre à parler ou les discipliner.[246] L’éducation préscolaire permet aux enfants de lier des amitiés dès le bas âge et aussi de reconnaître l’existence d’autrui. En cela, elle constitue, selon Barro[247], un lieu de socialisation pour les enfants. Elle éveille et prépare pour l’épanouissement intellectuel et social. Le souci des parents, c’est de contribuer, par la préscolarisation, à assurer un meilleur parcours scolaire à leurs progénitures. Il devient alors intéressant de s’interroger pour savoir si effectivement la préscolarisation contribue à une meilleure scolarité des élèves. C’est ce qui fonde la présente recherche. Pour rendre compte des résultats, nous proposons d’organiser le travail en différents points distincts mais articulés entre eux d’une façon chronologique. Un premier point définit le problème que la présente recherche voudrait résoudre. Il ouvre sur la présentation de la méthodologie suivie pour recueillir les données dont le traitement a fait l’objet d’un troisième point. Enfin, la discussion des résultats obtenus constitue le dernier aspect que nous avons abordé.
I. POSITION DU PROBLÈME
L’éducation préscolaire peut être définie comme l’ensemble des activités éducatives destinées aux jeunes enfants de trois (3) à six (6) ans en vue de développer leurs potentialités affectives, intellectuelles et physiques et de les préparer à l’enseignement primaire. Elle correspond au cycle des « apprentissages premiers », ainsi appelés parce qu’ils permettent à l’enfant de découvrir que l’apprentissage est dorénavant un horizon naturel de sa vie, par lequel ou grâce auquel il apprendra à articuler jeux et activités et à construire, par-là, son statut d’écolier[248]. Les programmes officiels d’enseignement qui sont appliqués dans les écoles maternelles couvrent les domaines suivants : l’appropriation du langage, la découverte de l’écrit, l’acquisition du statut d’élève, l’action et l’expression avec le corps, la découverte du monde, l’observation, l’imagination, la créativité.
L’école maternelle prépare donc, dans un souci de continuité des apprentissages, un parcours dédramatisé vers l’école élémentaire. Les enfants y arrivent avec des bagages linguistiques différents. Le vocabulaire qu’ils acquièrent diffère fortement selon le niveau culturel de leurs parents. Ces déséquilibres ont tendance à s’aggraver dans le courant des études, les enfants ayant connu un terrain linguistique favorable disposant de plus de capacités pour acquérir un vocabulaire plus étendu[249]. Selon Suchaut, ces écarts sociaux, en fin d’école élémentaire, résultent, d’une part, du degré de compétences à l’entrée au cours élémentaire et, d’autre part, du fait que, à niveau initial comparable, les enfants originaires des milieux sociaux les plus favorisés progressent davantage[250]. On parle alors d’ “effet Mathieu”, en référence au passage biblique qui dispose que : « À celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l’abondance, mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris, même ce qu’il possédait » (Matthieu, XXV-28-29)[251]. Chiland confirme ce constat en considérant que « l’école est à la fois et contradictoirement un instrument de promotion sociale pour un nombre limité d’individus et un instrument de maintien de la stratification sociale pour le plus grand nombre»[252].L’école maternelle contribuerait à réduire ces écarts puisque l’un de ses objectifs est, selon Gilabert, de « bâtir une école démocratique visant à donner à tous les enfants, très tôt, toutes les chances »[253].
Pour Gilabert, les effets bénéfiques de la maternelle ne s’arrêtent pas au primaire. Lorsque les enfants de la maternelle ont la chance d’avoir des enseignants leur faisant confiance, leur ouvrant les portes du savoir, leur prodiguant tout le trésor de leur expérience, ils acquièrent de réels atouts, une réelle liberté intellectuelle pour aller à l’assaut du futur. Gillig[254] soutient cette thèse en insistant sur l’idée que la maternelle a une fonction éducative et sociale et qu’elle permet aux enfants de réussir leur scolarité future (école élémentaire, collège, lycée). Une bonne base de lecture à la maternelle aide beaucoup dans la suite de la scolarité. Citant « Le monde de l’éducation », Gillig rapporte que la probabilité de réussir à l’école élémentaire augmente avec la durée de la scolarité maternelle. Ainsi, un enfant qui arrive au cours préparatoire sans passer par la maternelle a 46,6% de chances seulement de suivre une scolarité normale, c’est-à-dire sans redoubler. Les statistiques montent à 59,5% s’il a fréquenté la maternelle pendant une année. « S’il l’a fréquenté pendant deux (2) ans, on progresse à 63%de chances, à 69,7% pour une préscolarisation de trois (3) ans et à 71,6% si l’enfant est entré à deux(2) ans et a fait quatre (4) années complètes»[255]. La préscolarisation participe donc à la détermination des performances scolaires, à côté d’autres facteurs que relèvent Kalamo[256] et Mingat[257]. Kalamo mentionne le rôle des facteurs internes à l’école dans la réussite des apprenants. Il souligne la part importante des enseignants, largement responsables des différences d’apprentissage entre les élèves, au-delà des différences concernant les effectifs et l’hétérogénéité des classes. Mingat, quant à lui, relève le temps alloué à l’enseignement, la disponibilité des manuels scolaires, la pratique de l’évaluation.
D’un point de vue psychologique, Zazzo, relève que pour la majorité des enfants, l’entrée à l’école constitue une dure expérience, une sorte de “solitude en commun”, la rupture d’un équilibre qu’il ne retrouve que lentement. Les progrès réalisés en cours d’année ne s’installent que progressivement par la suite, et vont des contacts avec les autres, à l’accroissement et à la diversification des jeux en passant par la communication verbale[258]. Winnicotts’inscrit dans la même vision en soulignant la souffrance subie par l’enfant à la suite de la séparation d’avec la mère à l’occasion de son entrée en maternelle.[259]Kowalski, quant à elle,relève la tristesse et la morosité constatées dans certaines classes de maternelle, en raison de la souffrance endurée par les enfants ou par les encadreurs. Selon elle, l’organisation de l’accueil des enfants qui tentent de se séparer pour la première fois de leur toute petite enfance est un indicateur majeur de la difficulté de l’école.[260]
Au regard des analyses ci-dessus, la question fondamentale qui se pose est la suivante. Si, comme l’ont établi les auteurs précités, la scolarisation maternelle produit des effets avantageux sur le parcours scolaire des apprenants, cette influence s’exerce-t-elle de la même façon selon le sexe des apprenants et selon leurs niveaux d’études? Ces effets avantageux se maintiennent-ils tout au long du parcours scolaire primaire ? La pertinence de ces interrogations s’analyse et s’apprécie en rapport avec le contexte scolaire burkinabé, caractérisé par de fortes disparités entre garçons et filles en termes d’accès et de maintien à l’école. Les filles accèdent moins et se maintiennent moins longtemps à l’école que les garçons. Par exemple, au secondaire, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie a établi le taux brut de scolarisation à 21,8% en 2008. Il est plus élevé chez les garçons (25,3%) que chez les filles (18,3%). Quant au taux net de scolarisation, il est de 18,3% chez les garçons et de 13,3 % chez les filles[261]. L’élucidation des interrogations ci-dessus formulées pourrait contribuer à affiner le discours sur la nécessité de la démocratisation de l’éducation, en termes d’accès et de réussite. On peut supposer que le fait d’être passé par l’école maternelle n’influence pas de la même façon les acquisitions et donc les performances scolaires des apprenants selon qu’ils sont garçons ou filles. Les écarts d’avec les élèves qui ne sont passés par la maternelle tendraient à se réduire progressivement. Pour tester ces hypothèses, nous avons élaboré une démarche méthodologique dont la présentation fait l’objet du point qui suit.
II. MÉTHODOLOGIE
A. Participants
L’étude a concerné 168 élèves dont 79 de CP2 et 89 de CE2. Ils proviennent du Groupe Scolaire Sainte Colette, de l’École Marie Poussepin de Ouagadougou. La moyenne d’âge est 8ans 5mois. Au CP2, 39 élèves sont préscolarisés et 40 non préscolarisés. Ce sont tous des garçons. Au CE2, il ya 34 non préscolarisés (dont 13 garçons et 21 filles) et 55 préscolarisés (dont 32 garçons et 23 filles). Il ya plus de garçons préscolarisés que de filles. Cette distribution reflète ‘’le moindre accès’’ des filles à l’école, comparativement aux garçons.
B. Procédure
Nous nous sommes intéressé à deux complexes scolaires (Maternelle/Primaire). Les apprenants, après la maternelle, sont admis au cycle primaire pour y continuer leurs apprentissages. Le Primaire reçoit cependant, suivant les capacités d’accueil, de nouveaux arrivants, ayant passé ou non par d’autres maternelles. Cela donne l’opportunité de comparer les performances selon que l’on a été ou non préscolarisé. L’identification des apprenants qui sont passés par l’école maternelle et ceux qui n’y sont pas passés a été faite avec l’aide des enseignants. Les performances scolaires ont été appréciées à partir des moyennes de fin d’année (2011/2012).
En ce qui concerne les sujets enquêtés, nous n’avons pas tenu compte de la durée de la scolarité maternelle (Petite Section, Moyenne Section et Grande Section). Le simple fait d’être passé par la maternelle a été considéré comme un critère inclusif suffisant. Il s’agit de sujets provenant de milieux socio-économico-culturels moyens ou favorisés, définis à partir du niveau d’études des parents, de leurs occupations professionnelles, du milieu de résidence. La nécessité de contrôler la variable « milieu d’appartenance » s’explique par le fait que la diversité des origines entretient un rapport avec la diversité des conduites scolaires des enfants.
S’agissant des performances évaluées à partir de la moyenne annuelle, elles ont été structurées en trois niveaux distincts : bonnes, moyennes et mauvaises. Les élèves qui ont obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 7/10 sont considérés comme ayant réalisé de bonnes performances. Ceux dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 5/10 mais inférieure à 7/10, sont considérés comme ayant obtenu des performances moyennes. Ceux dont la moyenne annuelle est inférieure à 5/10, sont considérés comme ayant réalisé de mauvaises performances.
Après avoir présenté la démarche suivie pour le recueil des données, nous présentons, dans le point qui suit, les résultats auxquels nous sommes parvenu.
III. RÉSULTATS
Nous présentons les résultats par niveau d’études. Nous examinons d’abord les performances réalisées par les élèves de CP2 et, ensuite, celles réalisées par les élèves de CE2.Les informations sont synthétisées dans des tableaux. Elles sont ensuite analysées à partir de la technique statistique du Khi deux (Chanquoy)[262].Par son principe, le test du khi deux permet de mesurer l’écart entre une ou plusieurs répartition(s) d’effectifs observéset une ou plusieurs répartition(s) d’effectifs considérés comme théoriques ou attendus(distribués selon le modèle probabiliste). Si X2calculé est inférieur à X2 théorique ou critique, on retient l’hypothèse nulle (H0) et on rejette l’hypothèse alternative (H1).Si X2calculé est supérieur à X2 critique, on rejette H0 et on retient H1. Lorsque les effectifs observés sont inférieurs à 10 ou les effectifs théoriques sont inférieurs à 5, cela indique que théoriquement la statistique de ce test ne peut être approchée par une loi de khi deux. C’est pour cela que, dans tous les cas où nous avons observé la faiblesse des effectifs dans une case donnée, nous avons eu recours à la correction de Yates.
Tableau 1 : Préscolarisation et performances scolaires au CP2
| Performances Statut | Bonnes | Moyennes | Mauvaises | Total |
| Préscolarisé | 32 | 07 | 00 | 39 |
| Non préscolarisé | 24 | 14 | 02 | 40 |
| Total | 56 | 21 | 02 | 79 |
Au CP2, on n’observe pas de lien statistiquement significatif entre préscolarisation et performance scolaires. À 2 degré de liberté et au seuil de probabilité 05, nous observons que le X2 calculé après correction de Yates est inférieur (3.102) au X2 théorique (5,991). Un tel constat autorise le rejet de l’hypothèse H1 et, subséquemment, le maintien de l’hypothèse nulle Ho. Le fait d’être ou non préscolarisé ne constitue un facteur différenciateur, du point de vue des performances scolaires, des apprenants.
Il n’y a pas eu d’analyse des performances scolaires selon le sexe au CP2, en considération de la composition de cet échantillon qui ne comprend que des garçons.
Tableau 2 : Préscolarisation et performances scolaires au CE2
| Performances Statut | Bonnes | Moyennes | Mauvaises | Total |
| Préscolarisé | 09 | 29 | 17 | 55 |
| Non préscolarisé | 14 | 16 | 04 | 34 |
| Total | 23 | 45 | 21 | 89 |
Au CE2, il s’établit un lien statistiquement significatif entre préscolarisation et performances scolaires. À 2 degré de liberté et au seuil de probabilité .05, le X2 calculé après correction de Yates est supérieur (6,639) au X2 théorique (5,991). Nous rejetons l’hypothèse nulle Ho et maintenons l’hypothèse H1.
Une analyse des résultats inter-sexes a été faite à partir du tableau ci-après.
Tableau 3 : Préscolarisation et performances scolaires selon le sexe
| Sexe &Performances Statut | Bonnes | Moyennes | Mauvaises | Total | |||
| Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
| Préscolarisé | 03 | 06 | 15 | 16 | 05 | 10 | 55 |
| Non préscolarisé | 10 | 04 | 07 | 09 | 04 | 00 | 34 |
| Total | 13 | 10 | 22 | 25 | 09 | 10 | 89 |
À 5 degré de liberté et au seuil de probabilité .05, le X2 calculé après correction de Yates est supérieur (11,57) au X2 théorique (11,07). Nous rejetons l’hypothèse nulle et maintenons l’hypothèse H1. Il ya un lien statistiquement significatif entre préscolarisation et performances scolaires des garçons et des filles. Ce lien se joue plus à l’avantage des garçons que des filles. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les filles, accédant moins que les garçons à la préscolarisation, ne bénéficient de ses avantages au même titre que les garçons. Le temps de parcours entre le CP1 et le CE2 ne semble pas suffisant pour permettre aux filles de rattraper leur retard et d’établir l’égalité avec les garçons.
Comme on peut le constater, les liens entre préscolarisation et performances scolaires ne se présentent pas de la même façon en passant du CP2 au CE2. Si au CP2 ces liens ne sont pas significatifs d’un point de vue statistique, tel n’est pas le cas au CE2. À ce niveau, il ya un lien statistiquement significatif entre préscolarisation et performances scolaires. Les apprenants se distinguent en fonction du sexe. En particulier, les garçons semblent davantage bénéficier des effets positifs de la préscolarisation que les filles. La non existence de lien statistique significatif au CP2 et son existence au CE2 semblent enseigner que les effets bénéfiques de la scolarisation s’expriment de façon progressive.
IV. DISCUSSION
Nous avons voulu, à travers la présente étude, apprécier les liens qui pourraient exister entre la préscolarisation et les performances scolaires des apprenants. Les résultats montrent que ces liens existent, ce qui conforte les observations et analyses de Suchaut[263], CHiland[264], Gilabert[265] et Gillig[266]. Ils revêtent un caractère différentiel et génétique. Le fait que des différences significatives n’aient pas été observées au CP2, alors qu’elles l’ont été au CE2 confirme la dimension évolutive des effets de la préscolarisation telle que soulignée par Zazzo[267]. L’aspect différentiel réside dans le fait de la significativité des différences de performances entre garçons et filles au CE2. En mettant ces résultats en rapport avec ceux de Winnicott[268], Zazzo et Kowalski[269], on peut faire l’hypothèse explicative que le caractère traumatisant de la préscolarisation annihile ses avantages supposés en début de scolarité. Dans le même temps, les élèves non préscolarisés qui étaient supposés être désavantagés se retrouvent sur un pied d’égalité avec les camarades préscolarisés. Au fil du parcours scolaire, les effets traumatisants des premiers instants s’estompant, les avantages de la préscolarisation se manifesteraient de telle sorte que les différences de performances entre les enfants préscolarisés et leurs pairs non préscolarisés tendent à être plus significatives.
Pour autant, il est nécessaire de relativiser les liens entre préscolarisation et performances scolaires, au regard des connaissances actuelles en psychologie. Les productions scolaires des élèves résultent d’un processus psychologique de traitement de l’information qui médiatise la relation entre les enseignements reçus, l’assimilation et la restitution qui en sont faites. Dans un tel paradigme, la préscolarisation fait partie des facteurs pouvant (pré)disposer à des attitudes favorables de réception et d’assimilation des enseignements. Mais elle n’est pas suffisante en soi et à elle seule pour déterminer ou expliquer les performances scolaires des apprenants. Au-delà du fait d’avoir ou non été préscolarisé, l’apprenant doit développer des capacités d’attention, d’application, de persévérance, de mémorisation, de réflexion indispensables à la réussite scolaire. À côté de ces processus internes de type cognitif, il y a aussi les aspects conatifs. En effet, l’analyse des productions scolaires nécessite de prendre en compte les perceptions que l’apprenant a de la valeur de l’activité à réaliser (ses attitudes), celles qu’il a de lui-même (contrôle de soi / estime de soi) et de ses capacités à réussir (Bandura[270] ; Viau[271]). Ces dimensions créent « une dynamique motivationnelle »[272], qui affecte directement le degré d’implication de l’apprenant dans les tâches scolaires (Florin&Vrignaud)[273]. On rejoint là les idées de Zazzo[274] et de Kowalski[275]qui ont relevé que l’expérience scolaire est une épreuve qui marque psychologiquement, d’une manière positive ou négative, le jeune enfant. Cela ne manque pas d’affecter son rapport à l’école et au savoir.
CONCLUSION
La prise de conscience de l’ampleur du phénomène de l’échec scolaire a entraîné la nécessité de bien préparer les enfants afin de leur donner une chance de réussir à l’école. L’engouement pour la préscolarisation, conséquence de cette prise de conscience, expliquerait la prolifération des structures préscolaires en contexte burkinabé. Cependant, l’unanimité n’est pas faite autour des avantages de la préscolarisation. Les uns voient dans le préscolaire un espace d’éveil bénéfique, à tous points de vue, au devenir scolaire de leurs enfants. Les autres, par contre, trouvent qu’inscrire un enfant au préscolaire est un gaspillage financier qui n’ajoute rien à ce que devrait devenir l’enfant et qui pourrait même être source d’épuisement psychologique préjudiciable à un parcours scolaire étalé dans la durée.
Nous avons voulu contribuer au débat en nous intéressant aux liens entre préscolarisation et performances scolaires. Les résultats confirment l’existence d’un lien statistiquement significatif entre ces deux variables, en particulier à partir de la classe de CE2. C’est un lien relatif, dans la mesure où il n’a été établi qu’à partir de deux classes, chez deux échantillons indépendants réduits. Ce lien mérite d’être confirmé par des études plus larges. On peut dès maintenant suggérer que l’État s’investisse dans la construction des infrastructures, dans le recrutement et la formation des encadreurs de la petite enfance, en vue d’un accès à la maternelle pour tous les enfants en âge d’y aller. Il s’agit de démocratiser l’accès à l’école maternelle pour que tous les enfants aient les mêmes chances.
BIBLIOGRAPHIE
ARRIGHI-GALOU, Nicole,La scolarisation des enfants de 2-3 ans et ses inconvénients, Paris,ESF, 1988.
BANDURA, Albert,Auto-efficacité : le sentiment d’efficacité personnelle, Bruxelles,De Boeck, 2003.
BARRO, Oulo Moussa, L’éducation préscolaire : quelle incidence sur le rendement scolaire des élèves à l’école primaire ? : Cas de la CEB de Koudougou II, Ecole Normale Supérieure/Université de Koudougou, 2006.
CHANQUOY, Lucile, Statistiques appliquées à la psychologie et aux sciences humaines et sociales, Paris, Hachette, 2005.
CHILAND, Colette,L’enfant, la famille, l’école Paris,PUF, 1988.
FLORIN,Agnès& VRIGNAUD, Pierre,Réussir à l’école : les effets des dimensions conatives en éducation, Rennes,Presses Universitaires de Rennes,2007.
GILABERT, Hervé, Apprendre à lire en maternelle,Paris, ESF,1993.
GILLIG, Jean-Marie,L’enfant et l’école en 40 questions, Paris,Dunod, 1999.
KALAMO,Augustin, Des déterminants des performances scolaires à la fin de l’enseignement élémentaire au Sénégal : Cas de l’Inspection Départementale de l’Éducation de Vélingara, dans la région de Kolda,Mémoire de Master en éducation et formation,Université Cheikh AntaDiop Dakar, 2012.
KOWALSKI, Isabelle, « Souffrances à l’école maternelle », In Spirale, 1, n° 53, 2010, pp. 85-94.
LINDENBERGER, Ulman& CHICHERO, Christian, « Développement intellectuel au cours du cycle de vie : sources de variabilité et niveaux d’analyse », In L’Année Psychologique, 108/4, 2008, pp. 757-793.
MINGAT,Alain, L’école primaire en Afrique, Paris, L’Harmattan, 1993.
VIAU,Roland,La motivation en contexte scolaire, Bruxelles,De Boeck, 2005.
WINNICOTT, Donald Woods, Jeu et réalité, l’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.
ZAZZO, Bianka,L’école maternelle à 2 ans: oui ou non ?Paris, Stock, 1984.
WEBOGRAPHIE
Les maternelles, lieu privilégié pour prévenir l’échec scolaire Analyse UFAPEC 2009 n°15. Disponible sur le web :<www.ufapec.be>, Consulté le 18.08.12
SUCHAUT, Bruno, Etude maternelle. Disponible sur le web : <www.inegalites.fr/IMG/pdf>, Consulté le 18.08.12.
CONFLITS IDENTITAIRES ET DIALOGUE INTERCULTUREL : POUR UNE CULTURE DE LA PAIX EN AFRIQUE
Bilakani TONYEME
Université de Lomé (Togo)
RÉSUMÉ :
Nous vivons en Afrique, de nos jours, une époque paradoxale : les États africains sont de plus en plus intégrés à un monde ouvert ; mais à l’intérieur de ces États, les revendications identitaires vont croissant. Et vu la diversité identitaire à l’intérieur de chaque État, on en arrive à la conclusion que les différences identitaires seraient à l’origine de la recrudescence des conflits en Afrique. Mais une telle conclusion ne résiste pas à une analyse profonde de l’origine des conflits à l’intérieur des États, surtout lorsque l’on s’interroge sur la capacité des gouvernants à concevoir des projets de coexistence pacifique. Pour parvenir à la construction d’un État où la diversité pourra devenir une énergie pour une dynamique de mobilisation en vue d’un vivre-ensemble pacifique, il serait indispensable d’engager les différences culturelles dans un processus de complémentarité à travers un dialogue dialogique et non-hégémonique.
Mots-clés : Conflit identitaire, Dialogue interculturel, Diversité culturelle, État démocratique, Paix.
ABSTRACT :
We live in a paradoxical age in Africa: African states are increasingly integrated into an open word. But within those states, identity claims are going to be growing. Seeing the diversity of identities within each state, one can come to the conclusion that identity differences are the major cause of the resurgence of conflicts in Africa. But such a conclusion does not withstand a deep analysis of the origin of conflicts within states, especially when one questions the ability of governments to develop projects of peaceful coexistence. To achieve the construction of a state where diversity can become a dynamic energy for mobilization for peaceful coexistence, it is essential to take culture differences into a process of complementarity through dialogic and non-hegemonic dialogue.
Key-words: Cultural diversity, Democratic state, Identity conflict, Intercultural dialogue, Peace.
INTRODUCTION
La question de l’identité s’impose aujourd’hui comme un des grands débats socio-politiques. Le constat a quelque chose de paradoxal à l’heure de la mondialisation porteuse d’ouverture et de complémentarité des différences. Dans un contexte de résurgence des revendications identitaires, l’identitarisme paraît se nourrir d’une sorte de Choc des civilisations[276] associé, selon Touraine[277], à une mondialisation qui inquiète, à la désocialisation de l’économie, au brouillage des identités nationales et au repli sur le local, autant de phénomènes dont l’interprétation met à rude épreuve les systèmes explicatifs globaux peu enclins à prendre en considération la subjectivité des acteurs. C’est généralement à l’Afrique (surtout subsaharienne) que l’on pense, et sur le mode négatif le plus souvent, quand on évoque cette question. Il est vrai que l’identité, c’est-à-dire la conscience d’appartenir à un groupe humain différent des autres et de la revendiquer, y imprègne profondément les imaginaires et les comportements, en même temps qu’elle y participe puissamment à l’organisation sociale et politique. Et la vision de l’Afrique est souvent tributaire du paradigme identitaire censé tout expliquer. On oublierait même que le pluralisme socio-culturel – entendu comme la coexistence, plus ou moins conflictuelle, au sein d’un même ensemble politique de groupes ethniques ou religieux différents – loin de se restreindre à l’Afrique noire, est au contraire une donnée largement commune aux sociétés humaines, quelles qu’elles soient. Plus discutable encore, l’hétérogénéité des sociétés africaines est fréquemment perçue comme un obstacle insurmontable à leur démocratisation et par conséquent à la construction d’un d’État pacifié. Il est important de rappeler ces propos de Jacques Chirac condamnant le multipartisme en Afrique, car susceptible, selon lui, d’y exacerber les clivages ethniques.
« C’est que les pays d’Afrique ont une caractéristique, c’est d’être divisés, non pas par l’idéologie. Il n’y a pas d’affrontement idéologique entre Africains dans tel ou tels pays, mais des divisions ethniques. Il y a dans ces pays un très grand nombre de tribus qui ont leurs traditions, qui ont leur culture, qui ont leur histoire et qui se sont toujours battus. Le grand effort des dirigeants modernes de ces pays depuis les indépendances, c’est de rassembler ensemble ces gens, de les faire s’entendre et de réaliser l’unité nationale et l’effort de redressement. Dès que vous envisagez la création, comme cela, simplement parce que l’Europe considère que c’est bien, d’un certain nombre de partis, ce que je peux comprendre, que se passe t-il ? Vous avez immédiatement un parti par tribu et au lieu d’avoir la démocratie, vous avez l’affrontement et un risque d’anarchie »[278].
Si l’on suit un tel raisonnement, on aboutirait à l’idée que non seulement la diversité identitaire est incompatible avec la construction d’un État démocratique stable, mais aussi que les particularismes identitaires sont voués à la disparition dans un monde ouvert. Alors comment expliquer les montées des revendications identitaires ces dernières décennies en Afrique ? Les différences identitaires étant historiquement consubstantielles aux sociétés africaines, est-il normal de penser que c’est à travers une certaine harmonisation identitaire que la construction d’un État stable est possible ? Ne faut-il pas penser à des projets de sociétés prenant en compte les différentes identités et les intégrant dans une dynamique de complémentarité à travers le dialogue ?
I. L’AFFIRMATION IDENTITAIRE, SOURCE DE CONFLIT EN AFRIQUE ?
A. Le conflit identitaire
Il est reconnu que la plupart des conflits qui ravagent l’Afrique sont des conflits identitaires. Il y a conflit identitaire lorsqu’un groupe humain est persuadé, à tort ou à raison, qu’il est menacé (par un autre groupe « ennemi » ou perçu comme tel) de disparaître – ou d’être diminué- sur le plan physique ou politique[279]. Ce type de conflit éclate généralement entre des communautés qui ont vécu ensemble depuis des temps et les lignes de front s’établissent le long des distinctions identitaires, fussent-elles concrètes ou imaginaires. Le conflit identitaire est donc un conflit où s’affrontent des narcissismes collectifs. Il se cristallise sur la base des appartenances ethniques, territoriales, linguistiques, confessionnelles et culturelles. Il peut aussi se construire sur la base de l’histoire, des constructions idéologiques et des affiliations politiques. Ces deux derniers éléments sont particulièrement caractéristiques des conflits en Afrique.
Les mécanismes identitaires ne surgissent pas ex-nihilo. Ils ont une origine et une évolution qui trace l’itinéraire de leur formation. Dans la genèse d’un conflit identitaire, il y a la peur existentielle, et la négation de l’histoire et tout mouvement identitaire pratique une sorte de démarche intemporelle qui fixe l’histoire de la communauté dans une espèce d’essence éternelle. Le mécanisme identitaire fonctionne comme le mythe gnostique. Dans un premier temps, il existe une entité parfaite, puis dans un second temps, surgit un élément perturbateur qui peut être un conquérant, une religion rivale ou une ethnie dominante ou supposée être telle et, enfin dans un troisième temps, la réintégration et la restauration de l’état primitif : il appartient à la communauté menacée de se libérer et de détruire ceux qui la menacent[280].
Presque tous les conflits en Afrique illustrent bien ce phénomène. C’est l’exemple du conflit ivoirien. Il y a au départ, au-delà des phénomènes exogènes comme la crise économique, la croissance de la population qui peuvent être considérées comme étant les causes lointaines, une entité identitaire parfaite, « l’État ivoirien » avec son melting-pot ethno-culturel. Puis surgit un élément perturbateur, qu’on peut englober sous le nom générique d’« ivoirité » qui semble à la fois envahissante et fonctionnant dans une logique d’exclusion. Et dans un troisième temps, pour restaurer l’état primitif, « parfait » par définition, il appartient aux identités menacées ou considérées comme telles de mobiliser tout le groupe (ou une partie de celui-ci) pour détruire la menace de cette altérité mortifère, en l’occurrence l’« ivoirité » excluante[281]. Tous les conflits rwandais, de la révolution de 1959 au génocide de 1994, font aussi clairement ressortir cette dynamique à trois temps. Elle n’est pas rationnelle certes, mais cela ne l’empêche pas d’être fonctionnelle.
Les crises identitaires sont l’aboutissement de phénomènes de longue durée. Trois éléments doivent être conjugués pour qu’il y ait éclosion de l’identitaire : la crise socio-économique, la crise de l’État et l’hétérogénéité interne ou de proximité. La crise socioéconomique voue à l’exclusion tel ou tel autre groupe et radicalise les perceptions identificatoires collectives des groupes autour des besoins ontologiques. La crise de l’État induit son incapacité à assumer convenablement ses fonctions et fait que celui-ci passe au service d’une minorité de privilégiés (ou d’un groupe ethnique) en cautionnant les injustices et les frustrations des autres groupes. Ces deux aspects ont caractérisé le Rwanda sous les deux premières Républiques, sans épargner les pays voisins, notamment la République Démocratique du Congo, mais aussi les crises identitaires au Nigeria, au Libéria. La récente tentative de sécession des Touaregs du Nord Mali est aussi de cet ordre. Le facteur d’hétérogénéité est aussi déterminant dans le surgissement de la crise identitaire. En général, le sentiment de différence est le fruit des constructions idéologiques qui s’appuie sur des paramètres peu rationnels, mais fonctionnels : la langue parlée, les pratiques coutumières, la religion, la taille, la forme d’une partie du corps[282], etc. L’hétérogénéité ethno-culturelle caractérise les conflits en République Démocratique du Congo, en Uganda et au Nigeria avec la particularité, pour ces deux derniers, qu’elle se superpose à l’hétérogénéité confessionnelle. Ce qui montre l’aspect idéologique et sentimental de ces facteurs d’hétérogénéité, c’est leur caractère arbitraire et l’incapacité, pour ceux qui les revendiquent, d’indiquer clairement et de manière rationnelle les critères objectifs de leur identification. Comme le dit Chrétien à propos de l’ethnie, l’imprécision du concept est illustrée par les populations habitant la région des grands lacs africains[283]. Amselle et M’Bokolo expliquent très bien cette situation des grands lacs : « Voici des “ethnies” qui ne se distinguent ni par la langue, ni par la culture, ni par l’histoire, ni par l’espace géographique occupé[284] », encore moins par des traits physiques « naturels ». Autrement dit, rien de « naturel » et de concret ne les distingue si ce ne sont des considérations purement psychologiques et par conséquent arbitraires.
Annan[285] remarquait que les pays qui composent le continent africain sont très différents de par leur histoire, leur culture et leur géographie, leurs politiques internes et leurs relations internationales. Les sources de conflits qui les déchirent reflètent aussi cette diversité et cette complexité. Certains sont le résultat des facteurs internes, d’autres sont fonction de la dynamique d’une région, d’autres encore comportent d’importantes dimensions internationales.
Certains prennent leurs sources dans des processus historiques impliquant les perceptions identificatoires collectives conflictogènes, d’autres surgissent des facteurs conjoncturels liés notamment à la violation ou à l’absence de satisfaction des besoins ontologiques[286]. Toutefois, et par-delà toutes les causes qui en servent de lit, le rôle des gouvernants et l’attitude des prétendants à cette catégorie sont constamment au cœur de la violence politique et des conflits. Ainsi, tous les conflits identitaires contemporains en Afrique sont la résultante d’un jeu de gouvernance trouble, basé sur des critères peu rationnels et dans lequel une partie de la population ne trouve pas son intérêt. Dès lors, malgré les diverses sources de conflits identitaires en Afrique, on peut dire que ce qui est à l’origine immédiate des conflits identitaires sur le continent est l’héritage colonial instrumentalisé, la mauvaise gouvernance et les systèmes politiques inadéquats et conflictogènes.
B. L’instrumentalisation des identités en Afrique comme source majeure de conflits
Si le concept d’identité n’est pas récent, son utilisation pour expliquer les grands conflits africains date du 20ème colonial. En effet, les identités, sous forme de groupes ethniques ou culturels en général, aux frontières spatiales et culturelles nettement distinctes, ont été l’œuvre de la colonisation. Et les revendications identitaires ont été depuis lors utilisées parfois, à tort ou à raison, comme explication de certains conflits et pratiques politiques. Ces interprétations font que Weber envisage par exemple de « jeter par-dessus bord le concept général d’ethnie parce que c’est un fourre-tout[287] » permettant de justifier tout ce que l’on veut. Ceci trouve son explication dans les différentes perceptions de l’identité. Celle-ci est abordée aussi bien sous l’angle psychologique qu’anthropologique. Sous l’angle psychologique, l’identité apparaît comme une conscience d’appartenance à un groupe et elle s’exprime par la préférence sentimentale à ce groupe. L’un des exemples que l’on peut donner en Afrique, aujourd’hui, est le sentiment d’appartenance à un groupe ethnique que Bouchard définissait comme « tout ce qui nourrit un sentiment d’identité, d’appartenance, et les expressions qui en résultent[288] ». Sous l’angle anthropologique, l’identité se présente comme une ressemblance physique à un groupe caractérisé par un certain nombre de traits anthropologiques « naturels » communs à ce groupe. Les soi-disant traits raciaux identitaires en sont un exemple. Ce second sens trouve sa source dans les études de De Gobineau[289] et de De Lapouge[290].
L’identité est donc ambivalente. Elle est tantôt sentiment, tantôt identification physique. Pour la saisir, il est nécessaire de la cerner selon ces deux dimensions. Dans le premier cas, l’identité, qu’elle soit ethnique, religieuse…, est perçue comme un fait social fondé sur des critères subjectifs édifiés par la culture des groupes. Dans le second cas, elle est considérée comme un fait naturel qui repose sur des critères objectifs fondés sur les liens « naturels » de sang. L’identité se caractérise donc par un héritage socio-culturel commun concret (ou supposé l’être) et un sentiment d’appartenance à un groupe lié par cet héritage. Mais malgré le caractère apparemment concret, tout sentiment identitaire est dominé par la dimension psychologique et subjective. Ainsi appréhendons-nous l’identité selon la dimension subjectiviste qu’aborde le courant instrumentaliste. Le courant instrumentaliste explique de nos jours les revendications identitaires comme un instrument de mobilisation politique et sociale qui permet d’atteindre les objectifs qu’on se fixe. De ce fait, la manipulation politique peut s’appuyer sur les liens de sang ou la culture des groupes pour utiliser les sentiments identitaires comme une idéologie. L’approche instrumentaliste permet de comprendre ce va et vient que l’homme politique réalise entre les liens de sang et la culture comme justification des pratiques politiques.
L’approche instrumentale permet de comprendre les sentiments ethnicistes, les comportements religieux extrémistes dans la sphère politique en Afrique. Ces sentiments fondent l’imaginaire collectif qui revendique à travers un homme ou une classe politique la participation au pouvoir. Cet imaginaire collectif fait l’objet de mobilisation politique par les hommes politiques qui en font un instrument de leur lutte. Les revendications identitaires ne sont ainsi d’emblée ni négatives ni positives. Leurs effets sont fonction des objectifs qui leur sont assignés. Et, à travers la manipulation dont elles font l’objet dans le contexte africain, nous pouvons avoir une vision claire des effets attendus d’elle dans l’environnement politique. C’est pourquoi, il faut se méfier de l’explication (considérée souvent comme évidente) selon laquelle les revendications identitaires sont à l’origine des conflits et des difficultés de construction de l’État-nation démocratique en Afrique. D’ailleurs, cette explication résiste très peu à l’épreuve de la réalité : le fait qu’un État se compose de multiples entités ethniques, religieuses… ne constitue pas en soi un handicap à une cohabitation harmonieuse ni à sa démocratisation. La Nouvelle Zélande, la Malaisie, le Canada, la Suisse sont des sociétés multiethniques et multi-religieuses, mais ne connaissent pas pour autant des conflits identitaires. Le Rwanda et le Burundi ne sont pas constitués de plus d’ethnies, ni de religions ou de toutes autres particularités que le Ghana ou le Bénin où pourtant les revendications identitaires menant à des conflits ne surgissent pas.
Ainsi, les conflits et la désorganisation de l’État en Afrique, au lieu d’être la conséquence des revendications identitaires, seraient plutôt la conséquence de l’instrumentalisation des identités par le politique. En effet, manquant pour la plupart de projets de société mobilisateurs, les leaders politiques se sont souvent axés sur les clivages identitaires (plutôt que sur des clivages philosophiques résultant d’un débat d’idées) pour attirer les sympathisants, asseoir leur autorité et parvenir au pouvoir. Dans un contexte brimant l’esprit d’entreprise et décourageant l’effort et l’initiative individuels, seul le pouvoir politique et le contrôle de l’appareil de l’État garantissent l’accès à la richesse et l’ascension sociale. Et l’accès à la tête de l’État permet au leader d’organiser et de consolider le pouvoir autour de sa tribu, de son clan ou de la communauté à laquelle il s’identifie. Les richesses de l’État, les rentes et la confiscation des biens permettent de contrôler la société, de nouer des alliances, de remercier les fidèles à travers la distribution de postes administratifs et de portefeuilles ministériels. L’absence de possibilité de contestation pacifique et le climat d’oppression poussent les identités qui se jugent opprimées à se révolter violement contre l’ordre en place jugé injuste en s’en prenant aux identités considérées comme représentant la classe dirigeante puisque souvent les élites dirigeantes sont hors d’atteinte. La confédération nigériane, « organisée » tacitement autour de la succession au pouvoir, de manière alternative, entre chrétiens du Sud et musulmans du Nord, serait à l’origine des attaques actuelles des groupes religieux musulmans radicaux du Nord contre les chrétiens. Ces attaques s’expliqueraient par la succession à la tête de l’État d’un chrétien par un autre chrétien, rompant ainsi le contrat tacite. Les revendications identitaires, loin d’être la cause de la dégénérescence des États en Afrique, ne sont que la conséquence d’absence de projets de société unificateurs et d’une absence de gestion rationnelle et juste de l’État.
II. CONSTRUIRE LES ÉTATS AFRICAINS EN TENANT COMPTE DE LA DIVERSITE IDENTITAIRE
A. L’enrichissement mutuel et le principe de la complémentarité comme base de l’État démocratique
La diversité et la complémentarité ont été les points centraux autour desquels se sont organisées les sociétés africaines précoloniales et antérieures à l’État-nation jacobin. Mais, le rapport de domination constitutif de la situation coloniale sera perçu comme le reflet de la supériorité de la « civilisation » de l’État-nation sur la « barbarie tribale »[291]. L’Administration coloniale va donc s’évertuer à « mettre de l’ordre » dans une Afrique de « l’anarchie » qui s’oppose à la rationalité étatique universalisante de l’Occident. D’où un travail de classification ethnique dont le résultat sera de figer des identités qui préexistent à la colonisation. Les identités culturelles en Afrique apparaissent aujourd’hui pour une large partie comme « un produit de l’histoire coloniale, des pratiques militaires, administratives et intellectuelles des pouvoirs métropolitains qui ont besoin de stabiliser, de classer, de nommer pour régner »[292]. Mais il n’est pourtant pas question d’y voir seulement l’effet des dynamiques du « dehors »[293]. En effet, au lendemain des indépendances, les Africains se sont saisis des catégories classificatoires forgées par le colonisateur dont ils ont poursuivi et amplifié l’œuvre de bornage des frontières ethniques, culturelles, religieuses, bornage d’autant plus fonctionnel qu’il constituait souvent le pivot des stratégies d’accès au pouvoir et aux mécanismes d’accumulation des biens. Cette réappropriation s’est faite très subtilement car les élites au pouvoir ont instrumentalisé les différences identitaires tout en se prévalant de l’idéal jacobin pour stigmatiser les solidarités primaires comme incompatibles avec la « civilisation rhétorique des mœurs politiques[294] ». Et, si les particularismes identitaires trouvent dans l’État jacobin africain un terrain privilégié de résurgence et d’expression à l’heure de la démocratisation du continent, c’est parce que le contexte identitaire demeure une dimension essentielle des modes d’organisation et de perception de soi en Afrique. Ces particularismes ont assuré (et continuent d’assurer d’ailleurs) la structure fondamentale de l’héritage culturel, spirituel et artistique des populations africaines. L’État moderne « importé » n’a pas le monopole du contrôle de la nation, des structures politiques, des structures administratives et de la société civile. Au contraire, nous nous trouvons en face d’un ensemble de structures et de comportements politiques originaux qui ne se laissent pas aisément définir et qui donnent du fil à retordre tant aux dirigeants politiques africains qu’aux spécialistes des sciences politiques. Ces structures et comportements politiques s’enracinent en tant que praxis politiques, construites et inscrites dans l’histoire locale et non-officielle ; ils tiennent en échec l’État moderne wébérien qu’ils forcent à respecter leur espace vital, créant ainsi de nouveaux pôles de pouvoir politique à côté du pôle officiel.
Aujourd’hui, et cela depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix, les États africains, chacun selon les modalités dictées par sa propre histoire, se sont engagés dans le processus de démocratisation. Avec le renouveau des conflits et des replis identitaires qui accompagnent ce processus de démocratisation, se pose le problème du rapport entre diversités identitaires et démocratisation. Mais les différences et la diversité identitaires ne doivent pas amener de facto la présence de diverses identités dont les gens se revendiquent, une gêne pour la démocratie. En effet, même si la démocratisation est confrontée à de nombreuses pressions et résistances, à l’incertitude et à l’insécurité, la démocratie suppose plutôt la paix et la concorde ente les différents particularismes, le respect mutuel et la jouissance des libertés publiques. C’est pourquoi les rapports entre la diversité identitaire et le processus de démocratisation ne sont pas forcément dysfonctionnels. Au contraire, on ne peut parler de concorde, de cohabitation et de paix qu’entre des identités et des logiques différentes, parfois opposées. Dans les conflits identitaires en Afrique et la dialectique identités-démocratisation, certains facteurs doivent être pris en compte. Ces facteurs renvoient aux capacités de l’État et, partant, des gouvernants à faire cohabiter et travailler ensemble multiples identités en les engageant non dans un rapport conflictuel de relations dialectiques et exclusives, mais dans une attitude dialogale inclusive où l’autre ou les autres ne sont plus perçus comme une menace pour notre survie, mais comme complémentaires et indispensables pour notre construction. L’autre sera ainsi perçu comme une des innombrables expressions de notre commune humanité.
Une telle démarche nécessite de
« (…) concevoir un cadre de référence original qui puisse comprendre toutes les ressemblances et toutes les différences sans présupposer, directement ou indirectement, un effet de hiérarchie. Ceci implique la construction de « modèles, comme représentations simplifiées mais globales d’un phénomène ou d’un système répondant au moins à deux qualités dégagées par le canadien Robert Vachon et déjà exploitées de manière positive : être diatopique et dialogale »[295].
Il semble primordial, pour pouvoir entrer en véritable dialogue interculturel sur des questions essentielles, d’accepter l’existence de manières ultimement différentes, de poser des questions et d’y répondre. Cela permettra de nous inscrire dans le mythe d’un pluralisme sain, en n’essayant pas de trouver une unité, mais plutôt de vivre dans la complémentarité de nos différences.
« Ce qui divise les hommes et cause leur conflit perpétuel, c’est que chacun croit avoir raison, s’oppose à toute opinion différente, affirme et nie catégoriquement. Dépasser toute affirmation catégorique, toute négation tranchée, et apercevoir la complémentarité d’une affirmation et d’une négation données, voilà le salut de l’homme »[296].
C’est par ce respect de l’autre, à travers la découverte et la reconnaissance du pluralisme de la réalité, que nous pourrions poser quelques jalons nous permettant d’aborder un pluralisme sain à travers le dialogue interculturel dans le but de nous permettre l’invention d’un présent et d’un futur partagés et pacifiés dans la complémentarité de nos différences.
Les identités, si elles sont figées, comme tendent à le faire les courants et idéologies qui se sont développés autour d’elles (l’ethnocentrisme, les fondamentalismes religieux notamment), ne peuvent qu’être envisagées comme obstacle à la construction d’un État stable et pacifié en Afrique. Les identités en Afrique, que ce soit dans le contexte ethnique, culturel ou religieux, ne se distinguent pas uniquement en termes de particularités et de spécificités. Chaque identité cherche à communiquer avec les autres jugées potentiellement complémentaires. Elle représente un matériau fonctionnel dans l’identification des groupes, leur intégration, leur opposition, leur distinction et leur compréhension. D’où le fait qu’il soit légitime aujourd’hui, de considérer les différences identitaires et de les utiliser dans des travaux afin de repérer leur mode d’identification et d’adaptation dans des rapports sociaux, culturels et politiques. Ce qu’il faut éviter dans une telle démarche, c’est de considérer que les éléments d’identification ont toujours existé, qu’ils sont statiques. Ils s’inscrivent plutôt dans un processus d’évolution et par là, dans une dynamique d’ouverture. C’est justement pourquoi la différence identitaire devient une ressource essentielle dans la construction de l’État démocratique en Afrique. En effet, l’État démocratique étant le lieu de vie et d’expression de la diversité, chaque réalité devant être ouverte aux autres, les différentes expressions identitaires devraient y trouver le lieu idéal d’expression de la multiplicité identitaire. Cela n’est possible que grâce à cet aspect dynamique et ouvert des différentes identités qui les prédisposent à un dialogue non hégémonique au sein de l’État. Reste à savoir la nature de ce dialogue et comment il doit se faire pour asseoir l’État-nation démocratique dans une Afrique multi-identitaire.
B. Promouvoir le dialogue interculturel pour une paix des cultures
Dans le cadre d’un dialogue interculturel, l’échange n’est pas un simple échange de connaissances, mais également un échange entre identités (cultures) différentes, c’est-à-dire entre des univers de significations incommensurables, au sens fort, et différents. Ces univers de significations sont faits de constellations de puissants topoi. Ce sont des lieux communs rhétoriques qui structurent une culture donnée. Ils fonctionnent comme prémisses de toute argumentation et rendent ainsi possible la production et l’échange d’arguments. Ces topoi deviennent hautement vulnérables et problématiques dès lors qu’ils sont utilisés dans une culture différente. Au mieux, ils seront déclassés du statut de prémisses d’une argumentation à celui d’arguments même. Comprendre une culture donnée à partir des topoi d’une autre culture peut s’avérer très difficile, voire impossible. C’est pourquoi il faut une herméneutique diatopique. L’appropriation, dans ce sens, ne peut être obtenue par une cannibalisation culturelle. Un dialogue transculturel et une herméneutique diatopique sont nécessaires.
Une herméneutique diatopique est basée sur l’idée que les topoi d’une culture individuelle, quelle que soit leur force, sont aussi imparfaits que la culture elle-même. Cette imperfection n’est pas visible depuis l’intérieur de la culture elle-même puisque l’aspiration à l’achèvement conduit à prendre la partie pour le tout. Par conséquent, l’objectif de l’herméneutique diatopique n’est pas d’atteindre l’achèvement – ceci étant un but impossible – mais au contraire de susciter une conscience aiguë de l’imperfection réciproque en engageant le dialogue comme si l’on avait un pied dans une culture et le second dans l’autre. C’est là son caractère diatopique. L’herméneutique diatopique offre un vaste champ de possibilités pour alimenter les débats dans les diverses régions culturelles. Quoiqu’il en soit, une conception idéaliste du dialogue transculturel oubliera volontiers qu’un tel dialogue n’est possible que grâce à la simultanéité temporaire de deux ou plusieurs réalités « contemporaires » différentes. Les partenaires du dialogue ne sont que superficiellement contemporains ; en réalité, chacun d’eux se sent uniquement contemporain de la tradition historique de sa propre culture. C’est le cas, lorsque les différentes cultures impliquées dans le dialogue partagent un passé d’échanges inégaux entrecroisés.
Nous nous plaçons ainsi dans le contexte de l’histoire de Tchouang-Tseu dans une position permettant de trancher le nœud gordien de l’attente éternelle d’un « quatrième » pour nous départager, et ce, grâce à la reconnaissance de l’autre à travers le dialogue.
Mais essayons de cerner l’enjeu du problème à partir de cet enseignement de Tchouang-Tseu :
« Si je discute avec toi et que tu l’emportes sur moi au lieu que je l’emporte sur toi, as-tu nécessairement raison et ai-je nécessairement tort ? Si je l’emporte sur toi, ai-je nécessairement raison et toi nécessairement tort ? ou bien l’un de nous deux a raison et l’autre tort ? ou bien avons-nous raison tous les deux ou tort tous les deux ? Ni toi ni moi nous ne pouvons le savoir et un tiers serait tout autant dans l’obscurité. Qui peut en décider sans erreur ? Si nous interrogeons quelqu’un qui est de ton avis, du fait qu’il est de ton avis, comment peut-il en décider ? S’il est de mon avis, du fait qu’il est de mon avis, comment peut-il en décider ? Il en sera de même s’il s’agit de quelqu’un qui est à la fois de ton avis et du mien, ou d’un avis différent de chacun de nous deux. Et alors, ni moi ni toi, ni un tiers ne peuvent trancher. Faudra-t-il attendre un quatrième ? »[297]
Cet enseignement sur la manière d’aborder la problématique de la relation « unité/diversité » ne paraît rien avoir perdu de son actualité et semble nous renvoyer directement à notre condition actuelle de conflits identitaires en Afrique. Au-delà des questionnements qu’il suscite, l’enseignement de Tchouang-Tseu nous suggère une « réponse » : il semble qu’il nous invite à abandonner la quête d’une vérité par une méthode principalement dialectique pour nous engager dans une démarche plus dialogale avec les autres et avec la réalité. En prenant la réalité telle qu’elle est et non telle que nous la pensons, elle pourrait nous éveiller à son caractère fondamentalement pluraliste et nous permettre, dans un contexte de diversité des identités, de nous ouvrir, à travers le dialogisme, à un « pluralisme sain[298] »
Ignorer les pièges d’une démarche purement dialectique dans nos rapports interculturels risque fort de nous barrer à jamais la voie à un véritable dialogue avec l’autre, nous condamnant à l’enfermer dans des constructions ethnocentriques et à lui imposer notre vue de la réalité. Comme l’ont montré les travaux de Le Roy, la mesure de la diversité et des ressemblances n’est « possible, voire concevable, qu’à l’intérieur d’une même culture ou d’un ensemble de cultures ayant une origine commune et dont on peut reconstruire la matrice originelle[299] ».
La simple comparaison aboutit à des constructions ethnocentriques qui relèvent du principe de l’englobement du contraire dégagé par Dumont dans ses travaux sur la hiérarchie et sur l’idéologie moderne : tout en posant l’autre comme égal, et en l’englobant ainsi rationnellement dans la catégorie générale d’« humanité », on se construit implicitement soi-même comme point de référence de cette humanité, introduisant ainsi une hiérarchie cachée. On ne tient pas compte du témoignage de l’autre, de son originalité propre. En fait, on considère que nos propres présupposés, nos propres mythes, considérés comme universels, peuvent servir de cadre de référence ultime pour entrer en relation avec lui. Le dialogue est ainsi biaisé et l’autre est réduit à une construction comme image inversée de soi-même, ne permettant pas de découvrir l’« Autre » derrière l’« autre ».
Il semble donc que si le dialogue dialectique peut se révéler un outil fort utile pour éclairer des objets à l’intérieur d’un cadre de référence déterminé, il se révèle insuffisant voire contreproductif, dès lors qu’on essaye de dialoguer entre cultures différentes ayant des cadres de référence différents.
Devant la diversité de nos réalités, le dialogue semble aujourd’hui incontournable si nous voulons construire des États pacifiés. Mais s’acheminer vers un tel dialogue n’est pas forcément chose aisée et il se pourrait bien qu’on ait besoin d’un certain nombre de « passeurs », de médiateurs interculturels dans cette entreprise, qui par leur sensibilité et leur compréhension de différentes visions du monde peuvent contribuer à l’émergence d’un espace de dialogue fertile, d’un « entre-deux », voire d’un « entre-multiple » créateur (puisque nous sommes aujourd’hui beaucoup plus « entre-multiple » qu’« entre-deux »). C’est là certainement l’un des buts par excellence d’une réflexion interculturelle sur le dialogue entre les identités différentes, comme le rappelait le titre évocateur d’un ouvrage : Un passeur entre les mondes[300].
Il faut donc s’atteler à l’ouverture d’espaces dialogaux à travers le partage de notre expérience culturelle et à la réception de celle des autres. Ceci nous oblige à questionner certains de nos présupposés initiaux et nous permettra de passer en quelque sorte de l’« univers » (Un, unique) auquel nous sommes habitués, à un « plurivers » (pluriel, plusieurs) ou « multivers » (multiple, multitude), monde encore à découvrir, mais riche de potentialités et de promesses, pour repenser de manière pluraliste et complexe notre « vivre ensemble » dans le respect mutuel. C’est donc, d’une certaine manière, un voyage initiatique qu’il faut entreprendre pour parvenir à l’ouverture de ces espaces dialogaux. Les étapes de ce périple sont constituées par ce que nous désignons comme trois désarmements successifs :
- Le premier désarmement consiste en la découverte de l’autre et du pluralisme : cette découverte consiste à prendre conscience que nos identités et nos valeurs ne sont que quelques unes parmi tant d’autres et que nous ne sommes pas au centre du monde ; nous ne sommes qu’une des facettes de la réalité humaine. L’autre, le différent, constitue une autre facette qu’il faut découvrir et respecter, car elle complète la nôtre dans la connaissance de la réalité humaine ;
- Le second désarmement consiste, après avoir désabsolutisé notre culture, de relativiser d’une manière quelque peu différente la « culture », en inscrivant les représentations culturelles dans le contexte plus large et plus complexe des variations spatio-temporelles d’attitudes et de comportements ;
- Le dernier désarmement est une invitation à un désarmement plus existentiel où il s’agira de s’émanciper du règne tout puissant du logos et de nous ouvrir au domaine du mythos (ou présupposé) et de ce que Panikkar et Vachon appellent une « confiance cosmique ». Ce désarmement ne signifie pas rejet du logos et de la Raison, mais sa traversée, le fait que tout en les respectant, on les traverse, on ne se laisse pas emprisonner par eux, car souvent, nos identités relèvent beaucoup plus des présupposés que de la rationalité.
Ces désarmements permettent de nous ouvrir à l’écoute, d’aborder notre « ici et maintenant » : « il s’agit de prendre conscience des limites qui émergent dans nos expériences de crise de société […] et de trouver des solutions à l’échelle de la complexité redécouverte[301] ». Ce faisant, nous sommes invités à un certain « lâcher prise » qu’il ne faudrait pas confondre avec de l’indifférence. C’est le « lâcher prise », l’ouverture aux situations, l’ouverture à nos vies, l’ouverture à la réalité qui semblent se trouver au cœur de la paix.
Pour penser les fondements d’un vivre-ensemble plus harmonieux que ce soit à des échelles nationales ou plus globales, nous pouvons considérer que ce sont l’écoute, l’ouverture à soi-même, aux autres et au monde qui sont aux fondements de la paix. Comme le fait remarquer Vachon[302], si toute paix est culturelle, le fait qu’on la réduise à la seule conception culturelle qu’on peut en avoir, constitue un obstacle à la paix, et transforme la culture en une arme C’est pourquoi, il propose un double désarmement culturel, horizontal et vertical.
Horizontalement, il convient de désabsolutiser et de relativiser radicalement nos cultures respectives, tout en reconnaissant qu’elles représentent pour chacun d’entre nous nos points d’ancrage, le point de référence symbolique de nos dialogues (nos topoi) : « Il faut (…) s’assurer que la question (…) de la paix ne soit pas posée, décrite ou définie à partir des catégories, postulats et présupposés d’une seule culture, mais à partir des paradigmes de toutes les cultures qui se trouvent en présence »[303]. Ceci implique de réfléchir à des fondements interculturels de la paix en s’intéressant non seulement à ses diverses dimensions socio-économiques, juridico-politiques et religieuses, mais aussi à ses fondements épistémologiques, anthropologiques et cosmologiques telles qu’ils apparaissent à travers les diverses traditions humaines. Ce désarmement horizontal nous invite à aller au-delà d’une simple théorisation de la paix pour la compléter par une approche interculturelle.
Verticalement, le désarmement culturel consiste
« à libérer la Vie (et donc sa vie) de l’emprise exclusive d’une culture de la paix ou de l’ensemble des cultures de la paix, mais en passant par, c’est-à-dire à travers elle(s). (…) La paix n’est pas simplement question de préserver nos cultures traditionnelles, ni de nous ouvrir à la modernité ou à la postmodernité, ou même d’accepter nos différentes façons de vivre, de coexister dans l’indifférence mutuelle ou dans la tolérance résignée. Elle requiert la rencontre, la compréhension, un horizon commun, une vision nouvelle. Mais cela requiert que nous reconnaissions ensemble un centre (un cercle) qui transcende l’intelligence qu’on en a ou peut en avoir, à un moment donné de l’espace et du temps. Bref, pour avoir la paix, on ne saurait partir du présupposé qu’on sait ce qu’est la paix. Ni avant, ni pendant, ni après notre démarche de paix »[304].
Fondamentalement, comme le note Panikkar[305], malgré tous les obstacles, la voie vers la paix consiste à vouloir l’emprunter et le désir de paix équivaut au désir de dialogue qui nous renvoie à une attitude d’écoute, d’ouverture. Et Vachon fait très clairement ressortir les défis de la paix en relation avec une démarche dialogale et interculturelle lorsqu’il précise :
« (…) L’accord et la concorde ne requièrent pas nécessairement une unité formelle, idéologique, doctrinale, une théorie universelle, une culture commune – au sens d’homogénéité – où les différences disparaissent dans un dénominateur commun. Bien au contraire, l’accord / concorde appelle des différences (irréductibles les unes aux autres ou à une troisième) mais dans la non-dualité. Donc ni monisme, ni dualisme, mais acceptation mutuelle des différences (dans la non-dualité). Les différences rehaussent justement la qualité de la concorde, de l’harmonie et de la paix. Elles sont une condition requise pour l’harmonie. La concorde et la paix, c’est l’harmonie, non pas malgré, mais dans et à cause (grâce à) de nos différences »[306].
Et donc dirons-nous avec Panikkar : « Si vis pacem, para teipsum »[307]. Ainsi, le dialogue interculturel pourra contribuer efficacement à la paix des cultures et à une culture de la paix, à la paix tout court ; la paix ne serait plus ainsi considérée comme unicité de pensée et d’action, une identité culturelle, mais cohabitation, compréhension et complémentarité de différentes façons de penser et d’agir comme diversité.
CONCLUSION
Les revendications identitaires conduisant souvent à des conflits, surtout en Afrique, ne doivent pas être réduites à un vulgaire avatar des dynamiques du « dehors », au détriment des processus socio-politiques endogènes, déterminants. Elles constituent, en réalité, un instrument pour le changement social. Comme l’explique Coulon, l’expression identitaire en Afrique « exprime la gestation de l’État et des incertitudes qui l’accompagnent ». Mais, prévient-il, elle y est « moins une donnée de base agissant et emprisonnant le politique et l’État que l’un des effets de la construction de celui-ci[308] ». Le problème est que depuis le début du processus de démocratisation en Afrique corrélé à la multiplication des revendications identitaires, il est tentant d’incriminer la démocratie qui aurait libéré cette « force du mal » longtemps refoulée ou contenu dans les régimes de parti unique et d’en conclure qu’un certain régime (démocratique) est inadapté à ces sociétés africaines fortement segmentées et constamment exposées aux conflits identitaires.
Certes, les partis uniques avaient globalement réussi à préserver le caractère unitaire de l’État hérité de la colonisation, mais au prix de la négation, souvent violente, de la diversité sociale et d’une centralisation excessive et dysfonctionnelle, car génératrice de tensions de nature à accentuer les tentations centrifuges des périphéries et la primauté des allégeances particularistes sur le sentiment d’identification nationale. Aussi, plutôt que de voir dans l’affirmation identitaire qui affecte aujourd’hui les États du continent, un effet pervers des réformes démocratiques, il faudrait y voir une réaction à l’obsession unitariste de l’État autoritaire, à l’incapacité des politiques d’engager les diverses composantes de l’État dans une dynamique de cohabitation pacifique.
BIBLIOGRAPHIE
AMSELLE, Jean-Loup, M’BOKOLO Elikia, Au cœur de l’ethnie : ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 1985.
ANNAN, Kofi, Rapport du Secrétaire Général de l’ONU au Conseil de Sécurité sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durable en Afrique. New York, avril 1998.
BADIE, Bertrand, Le développement politique, Paris, Economica, 1988.
BOUCHARD, Gérard., « Ouvrir le cercle de la nation. Activer la cohésion sociale. Réflexion sur le Québec et la diversité », in Sarra-Bournet Michel et de Saint-Pierre Jocelyn (sd), Les nationalismes au Québec, Laval, Presse de l’Université de Laval, 2001, p. 319-338.
CHRÉTIEN, Jean-Pierre, Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala, 2003.
GIRARD, René, La Violence et le Sacré, Ed. Grasset, Paris, 1972.
CARPINSCHI, Anton, TONYEME, Bilakani, « Cultural Minorities and Intercultural Dialogue in the Dynamics of Globalisation. African Participation », Cultural. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Université de Iasi (Roumanie), Vol. 8, n°1, pp. 7-26, janvier 2011
COPANS, Jean, La longue marche de la modernité africaine. Savoirs, intellectuels, démocratie, Paris, Karthala, 1990.
COULON, Christian, « Les dynamiques de l’ethnicité en Afrique noire » in Burnbaum Peter et alii (éd.), Sociologie des nationalismes, Paris, P.U.F, 1998, p. 37-53.
DIAKITE, Samba, « La déréliction du langage dans le penser politique en Afrique », Le Portique (en ligne), 1-2005, Varia, mise en ligne le 12 mai 2005, consulté le 26 juin 2012. URL : http//leportique.revues.org./index521.html.
DIAKITE, Samba, Les nasses identitaires en Afrique : Pour une remise en question des pouvoirs balafrés, Paris, Presses universitaires européennes, 2011.
DIAKITÉ, Samba, Philosophie et contestation en Afrique : quand la différence devient un différend, Paris, Publibook, 2011.
GOBINEAU, Joseph Arthur (Comte de), Essai sur l’inégalité des races humaines, Paris, Pierre Belfond, 1967.
LAPOUGE, Georges Vacher (Le Comte de), Les sélections sociales, Cours libre de science politique professé à l’Université de Montpellier 1888-1889, Paris, A. Fontemoing, 1896.
LE ROYEtienne, « Les droits de l’homme entre hâtif et le ghetto des particularismes culturels », L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, AUPELF – UREF, 1994.
LE ROY, Etienne, Un passeur entre les mondes. Le livre des anthropologues du droit disciples et amis du Recteur Michel Alliot, Paris, Publication de la Sorbonne, 2000.
LEWIS, William Arthur, Politics in West Africa, London, George Allen and Unwin, 1965.
PANIKKAR,Raymond, Cultural Desarmament – The way to Peace, Westminster, John Knox Press, 1995, p. 102 et 103.
SHYAKA, Anastase, Conflits en Afrique des Grands Lacs et Esquisse de leur Résolution, Varsovie, Dialog, 2003.
SINDJOUN, Luc, La politique d’affection en Afrique noire. Société de parenté, « Société d’État » et libéralisation politique au Cameroun, Boston University, Graf, 1998.
THUAL, François, Les Conflits Identitaires, Paris, Ellipses, 1995
TCHOUANG-TSEU, Œuvre complète, Saint Amand, Gallimard/UNESCO, 1997.
TONYEME Bilakani,« État-nation démocratique et multiethnicité », Particip’Action, Revue interafricaine de littérature, linguistique et philosophie, Université de Lomé, Vol. 4, n°1, janvier 2012, pp. 277-290
VACHON, Robert, « Guswenta ou l’impératif interculture – Partie 1, volet II : un horizon commun, Interculture, vol. XXVIII, n°128, p. 40, 1995.
WEBER, Max, Economie et société, tome 2, L’organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l’économie, Paris, Plon, 2000.
[1] DUMONT, Jean-Paul (dir.), Préface à Les présocratiques, trad. Jean Paul Dumont, Jean-Louis Poirier et alli, Paris, Gallimard, 1988, XIII.
[2] GAARDER, Jostein, Le Monde de Sophie. Roman sur l’histoire de la philosophie, traduit du Norvégien par Hélène Hervieu et Martine Laffont, Paris, Seuil, 1995, p. 48.
[3] Cf. La thèse de l’homo mensura de Protagoras selon laquelle « l’homme est la mesure de toutes choses ». PRADEAU, Jean-François (dir.), Les Sophistes, tome I, De Protagoras à Critias : Fragments et témoignages, trad. Mauro Bonazzi, Luc Brisson et alli, Paris, G.F., 2009, p. 69. Nous y reviendrons.
[4] L’idée de considérer l’homme comme une valeur absolue a été développée au XVIè siècle par les humanistes tels que Didier Erasme, Jacques Lefèvre d’Étaples, Jean Pic de la Mirandole, etc.
[5] ARISTOTE, Les réfutations sophistiques, trad. J. Tricot, Paris, Librairie Philosophique Jean Vrin, 1977, p. 3.
[6] ZONGO, Alain Casimir, « Élitisme platonicien et égalité d’éducation en question », in Le Cahier philosophique d’Afrique, n°006, 2008, p. 175.
[7] BRISSON, Luc et alli, (dir), Lire les présocratiques, Paris, PUF, 2012, p. 183.
[8] GAARDER, Jostein, Op. cit., p. 81.
[9] DUMONT, Jean-Paul (dir.), Préface à Les présocratiques, Op. cit., XIII. L’orientation de la pensée vers la nature a valu aux présocratiques l’appellation de « philosophes de la nature ».
[10] Les travaux d’Émile Bréhier, Jean Brun, Christian Godin, Luc Brisson, etc., s’inscrivent dans ce registre de présentation linéaire des conceptions des présocratiques.
[11] DUMONT, Jean-Paul, (dir.), Les présocratiques, Op. cit., p. 21.
[12] Idem, p. 23.
[13] Idem, p. 50.
[14] Ibidem.
[15] Idem, p. 166.
[16] BRUN, Jean, Les Présocratiques, Paris, P.U.F, 1968, p. 28.
[17] BRUN, Op. cit., p. 31.
[18] GODIN, Christian, La Philosophie : Antiquité, Moyen-âge et Renaissance, Éditions First-Gründ, 2008, p. 34.
[19] GODIN, Op. cit., p. 106.
[20] Idem, p. 47.
[21] BRUN, Op. cit., pp. 105-106.
[22]Idem, p. 115.
[23] GAARDER, Op. cit., p. 81. Voici ce qu’il écrit à ce sujet : « s’il n’est pas en notre pouvoir de résoudre [définitivement] les énigmes de la nature, nous savons néanmoins que nous sommes des hommes qui devons apprendre à vivre ensemble. Les sophistes choisirent de s’intéresser à l’homme et à sa place dans la société ».
[24]JAEGER, Werner, Paideia : la formation de l’homme grec, trad. André et Symonne Devyver, Paris, Gallimard, 1964, p. 342.
[25]PRADEAU, Jean-François (dir.), Op. cit., p. 69.
[26]GAARDER, Op. cit., p. 80.
[27]GAARDER, Op. cit., p. 343.
[28] Les sophistes sont, dans leur ensemble, des étrangers à Athènes.
[29] ROMILLY, Jacqueline De, Les Grands sophistes de l’Athènes de Périclès, Paris, Libraire Générale Française, 1989, p. 50.
[30] ROMILLY, Op. cit., p. 51.
[31] Ibidem.
[32] FLACELIÈRE, Robert, La Vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, Paris, Hachette, 1959, p. 131.
[33] FLACELIÈRE, Op. cit., p. 135.
[34] MARROU, Henri-Irénée, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris, Seuil, 1955, p. 81.
[35] JAEGER, Op. cit., p. 340.
[36] Ibidem.
[37] JAEGER, Werner, Op. cit., p. 339.
[38] ROMILLY, Jacqueline de, Op. cit., p. 53.
[39] GOMPERZ, Théodore, Les Penseurs de la Grèce. Les Sophistes, Paris, Manucius, 2008, p. 14.
[40] JAEGER, Werner, Op. cit., p. 340.
[41] JAEGER, Werner, Ibidem.
[42] GOMPERZ, Op. cit., p. 14.
[43] Ibidem.
[44] ROMILLY, Jacqueline de, Les Grands sophistes de l’Athènes de Périclès, Op. cit., p. 50.
[45] ROMILLY, Op. cit., p. 78.
[46] PLATON, Gorgias, in Protagoras. Gorgias. Ménon, trad. Alfred Croiset, Paris, Les Belles Lettres, 1984, 449a.
[47] PLATON, Protagoras, in Protagoras. Gorgias. Ménon, trad. Alfred Croiset, Paris, Les Belles Lettres, 1984, 312 e.
[48] DUMONT, Jean-Paul, Les Sophistes : fragments et témoignages, Paris, P.U.F, 1969, p. 117.
[49] REBOUL, Pierre, Introduction à la rhétorique, Op. cit., p. 21.
[50] Ibidem.
[51] DUMONT, Jean-Paul, (dir.), Les présocratiques, Op. cit., p. 983.
[52] DUMONT, Jean-Paul, (dir.), Les présocratiques, Op. cit., p. 984.
[53] PLANTIN, Christian, L’argumentation, Paris, Seuil, 1996, pp. 5-7.
[54] Cf. ARISTOTE, Les Réfutations sophistiques, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1977.
[55] REBOUL, Pierre, Op. cit., p. 16.
[56] KERFERD, George Briscoe, Le mouvement sophistique, trad. Alonso Tordesillas et de Didier Bigou, Paris, Vrin, 1999, p. 206. Pour Kerferd, en effet, le point de départ logique des sociétés humaines est le même pour Protagoras, Platon et Aristote : il s’agit de l’incapacité de l’homme à vivre seul.
[57] DUMONT, Jean-Paul, Les sophistes : fragments et témoignages, Op. cit., p. 17.
[58] ADELINE, Yves-Marie, Histoire mondiale des idées politiques, Paris, Ellipses, 2007, p. 91.
[59] DUMONT, Les sophistes : fragments et témoignages, Op. cit., p. 17.
[60] DUMONT (Jean-Paul), (Dir), Les présocratiques, Op .cit., p. 1001.
[61] DHERBEY, Gilbert Romeyer, Les Sophistes, Paris, P.U.F, 1985, p. 12.
[62] DHERBEY, Gilbert Romeyer, Ibidem.
[63] Ibidem.
[64] PLATON, Protagoras, in Protagoras. Gorgias, Ménon, trad. Alfred Croiset, Paris, Gallimard, 1984, 319 b-c.
[65] KERFERD, George Briscoe, Op. cit., p. 211.
[66] DROIT, Roger-Pol, La compagnie des philosophes, Paris, Éditions Odile Jacob, 1998, p. 37.
[67] PLATON, Politique in Sophiste, Politique, Philèbe, Timée, Critias, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, trad. Émile CHAMBRY, p. 194.
[68] Idem, p. 240.
[69] Idem, p. 241.
[70] De TOCQUEVILLE, Alexis, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1986, Tome I, p. 41.
[71] Ibidem.
[72] Ibidem.
[73] KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure in Œuvres philosophiques, Paris,Gallimard, 1980, trad. Alexandre J.-L. DELAMARRE et François MARTY, Tome I, p. 726.
[74] ROSANVALLON, Pierre, La légitimité démocratique, Paris, Seuil, 2008, p. 317.
[75] ABENSOUR, Miguel, La démocratie contre l’Etat, Paris, P.U.F., 1997, p. 72.
[76] SCHAERER, René, L’homme antique et la structure du monde intérieur, Paris, Payot, 1958, p. 156.
[77] HEGEL, Georg. Wilhelm. Friedrich., Science de la logique, Paris, Aubier, 1972, trad. Gwendoline JARCZYK et Pierre-Jean LABARRIÈRE, Premier tome, Premier livre, pp. 65-66.
[78] BOUTOT, Émile, Heidegger et Platon, Le problème du nihilisme, Paris, P.U.F, 1987, p. 42.
[79] PLATON, Œuvres complètes, Paris, Les Belles Lettres, 1967, tome 8, p. 56.
[80] Ibidem.
[81] BADIOU, Alain, De quoi Sarkozy est-il le nom, Paris, Éditions Lignes, 2007, p. 42.
[82] ARISTOTE, La Politique, Paris, Vrin, 1962, trad. J. TRICOT, p. 204.
[83] Idem, pp. 266-267.
[84] Idem, p. 272.
[85] ARISTOTE, La Politique, Op. cit., p. 273.
[86] NIETZSCHE, Friedrich, La naissance de la tragédie, Paris, Gallimard, 1949, trad. Géneviève BIANQUIS, p. 92.
[87] KANT, Emmanuel, Projet de paix perpétuelle in Œuvres philosophiques, Paris,Gallimard, 1986, trad. Heinz WISMANN, Tome III, p. 365.
[88] Idem, p. 367.
[89] Idem, p. 376.
[90] Ibidem.
[91] DONEGANI, Jean-Marie, SADOUN, Marc, La démocratie imparfaite, Paris, Gallimard, 1994, pp. 103-104.
[92] C’est par l’expression Philosophie du monde que Bernard BOURGEOIS a désigné la philosophie hégélienne dans un numéro spécial du Magazine littéraire consacré à « Hegel et la Phénoménologie de l’esprit », n°293, novembre 1991, p. 39. La signification de l’expression est développée plus exhaustivement par le même auteur dans Éternité et historicité de l’esprit selon Hegel, III. « Politique et Philosophie », Paris, Vrin, 1991.
[93] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Introduction aux leçons sur l’histoire de la philosophie, Paris, Gallimard, 1957, trad. J. GIBELIN, pp. 92-93.
[94] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Préface aux principes de la philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1940, trad. A. KAAN, p. 39.
[95] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La raison dans l’histoire, Paris, U.G.E, 1965, trad. K. PAPAOAINNOU, p. 279.
[96] Idem, p. 280.
[97] Hegel parle plus précisément de monde germanique dans les Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. J. GIBELIN, Paris, Vrin, 1965. Mais il faut préciser que chez lui le monde germanique ne renvoie pas à l’Allemagne du dix neuvième siècle mais correspond à une division majeure de l’histoire universelle qui englobe des évènements qui se sont produits dans divers pays européens. C’est tout le sens de l’intitulé « Siècle des lumières et révolution » qui clôt la dernière partie de ses Leçons sur la philosophie de l’histoire.
[98] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La raison dans l’histoire, 1965, trad. K. PAPAIOANNOU, p. 247.
[99] Cette idée de Hegel sur la place de l’Afrique dans l’histoire universelle a été remise au goût du jour par le président français Nicolas SARKOZY dans son « discours à la jeunesse africaine » du 26 juillet 2007 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous prenons délibérément le parti de ne pas nous y attarder pour au moins deux raisons. La première, c’est que là où le philosophe de Berlin distingue deux niveaux en histoire (nous y reviendrons dans le point suivant), lui, confond l’histoire universelle et l’histoire événementielle en une seule histoire. La seconde c’est qu’il s’est totalement trompé d’époque en exhumant un argument ayant servi à justifier au dix-neuvième siècle l’entreprise coloniale. Ayant montré plus tôt qu’en philosophie nous n’avons affaire qu’aux défis du temps présent, nous ne pouvons donc pas nous attarder davantage sur ce discours à retardement de Nicolas SARKOZY encore moins sur les réactions souvent indignées qu’il a suscitées en Afrique. La thèse défendue dans ce discours avait été brillamment battue en brèche en temps opportun par les intellectuels africains qui avaient travaillé à la réhabilitation du continent noir.
[100] C’est de cette façon qu’il faut comprendre l’idée d’une fin de l’Histoire chez HEGEL qui ne saurait en aucun cas signifier la cessation des évènements empiriques en vigueur dans le monde.
[101] BOURGEOIS, Bernard, La raison moderne et le droit politique, ch. XVIII. « La fin de l’histoire », Paris, Vrin, 2000, pp. 269-270.
[102] SAVADOGO, Mahamadé, Philosophie et histoire, Paris, L’Harmattan, 2003, p.31.
[103]C’est, en tout cas, le point de vue que défend Jacques D’HONDT dans son ouvrage intitulé Hegel, philosophe de l’histoire vivante, Paris, PUF, 1987.
[104]BOURGEOIS, Bernard, « Hegel et l’Afrique », in Études hégéliennes : raison et décision, Paris, PUF, 1992, p. 268.
[105] ZUÉ-NGUEMA, Gilbert, Africanités hégéliennes: alerte à une nouvelle marginalisation, Paris, L’Harmattan, 2006.
[106] Il faut souligner que ce constat avait été également fait quelques années plus tôt par Sémou Pathé GUEYE dans « Fin de l’histoire et perspective de développement: l’Afrique dans le temps du monde » (in Temps et développement dans la pensée de l’Afrique subsaharienne, édité par Souleymane Bachir DIAGNE et Heinz KIMMERLE, 1997) où, à la suite de René DUMONT (L’Afrique noire est mal partie, Paris, Éditions du Seuil, 1962) et de Axelle KABOU (Et si l’Afrique refusait le développement? Paris, L’Harmattan, 1991), il admet à son tour que l’Afrique occupe une place peu enviable sur la scène mondiale.
[107]TOYNBEE, Arnold, L’histoire, trad. Jacques POTIN et Pierre BUISSERET, Bruxelles, Elsevier Séquoia, 1978, pp. 130-156.
[108]GUEYE, Sémou Pathé, « Projet d’une philosophie de la mondialisation », in Éthiopiques, n°64-65, 1er et 2ème semestre 2000, p. 186.
[109]Idem, p. 188.
[110] C’est en tout cas le soupçon fait par Arnaud SPIRE et Jérôme Alexandre NIELSBERG dans leur ouvrage intitulé L’Idéologie toujours présente, Paris, La Dispute, 2006.
[111] NIETZSCHE, Friedrich, Le cas Wagner, Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hémery.
[112] Idem, Avant-propos, p. 17.
[113] COLLI, Giorgio, Après Nietzsche, Paris, Édition de l’Éclat, 2000, Trad. Pascal Gabellone, p. 107.
[114] NIETZSCHE, Friedrich, La Naissance de la tragédie, Paris, LGF- Livre de poche, 2008, Trad. Jean Marnold et Jacques Morland, revue par Angèle Kremer-Marietti.
[115] Idem, p. 47.
[116] NIETZSCHE, Friedrich, La Naissance de la tragédie, Paris, LGF- Livre de poche, 2008, Trad. Jean Marnold et Jacques Morland, revue par Angèle Kremer-Marietti, § 2, p. 17.
[117] Idem, § 9, p. 91.
[118] BERNARD, Edina, L’art moderne 1905-1945, Paris, Bordas, 1988, p. 17.
[119] FIÉ, Doh Ludovic, Musiques populaires urbaines et stratégies du refus en Côte d’Ivoire, Paris, Edilivre, 2012, p. 91.
[120] Idem, p. 92.
[121] BERNARD, Edina, L’art moderne1905-1945, Paris, Bordas, 1988, p. 20.
[122] BURKE, Edmund, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Trad. Baldine Saint-Girons, Paris, Vrin, 1990, p. 78.
[123] NIETZSCHE, Friedrich, La Naissance de la tragédie, Paris, LGF- Livre de poche, 2008,Trad. Jean Marnold et Jacques Morland, revue par Angèle Kremer-Marietti, p. 94.
[124] Idem, p. 174.
[125] DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Logique de la sensation, La Roche-sur-Yon, Édition de la différence, 1981, p. 28.
[126] BERNARD, Edina, L’art moderne1905-1945, Paris, Bordas, 1988, p. 62.
[127] JEAN PIC de la Mirandole, « Sur la dignité de l’homme », in Œuvres philosophiques, Paris, P.U.F., 1993, Trad. G. Tognon et O. Boulnois, p. 13.
[128] DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Logique de la sensation, La Roche-sur-Yon, Édition de la différence, 1981, p. 27.
[129] NIETZSCHE, Friedrich, Le cas Wagner, Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hémery, p. 21.
[130] AUDI, Paul, L’Ivresse de l’art, Paris, L.G.F., 2003, p. 125.
[131] ONFRAY, Michel, L’art de jouir, Paris, Grasset et Fasquelle, 1991, p. 272.
[132] DAVAL, René, « Pour une anthropologie de la joie. Otto Friedrich Bollnow et Nietzsche » in Revue Noésis, N°10, Paris, 2006, p. 301.
[133] AUDI, Paul, L’Ivresse de l’art, Paris, L.G.F., 2003, p. 83.
[134] AUDI, Paul, L’Ivresse de l’art, Paris, L.G.F., 2003, p. 83.
[135] Idem, p. 49.
[136] Idem, p. 50.
[137] DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Logique de la sensation, La Roche-sur-Yon, Édition de la différence, 1981, Trad. Geneviève Bianquis, p. 37.
[138] NIETZSCHE, Friedrich, L a volonté de puissance, tome I, Paris, Gallimard, 1995, Trad. Geneviève Bianquis, p. 381.
[139] ZWEIG, Stefan, Le combat avec le démon, Paris, L.G.F., 2005, Trad. Alzir Hella, p. 261.
[140] AUDI, Paul, L’Ivresse de l’art, Paris, L.G.F., 2003, p. 83.
[141] ZWEIG, Stefan, Le combat avec le démon, Paris, L.G.F., 2005, Trad. Alzir Hella, p. 261.
[142] NIETZSCHE, Friedrich, La Naissance de la tragédie, Paris, LGF- Livre de poche, 2008, Trad. Jean Marnold et Jacques Morland, revue par Angèle Kremer-Marietti, p. 48.
[143] AUDI, Paul, L’Ivresse de l’art, Paris, L.G.F., 2003, p. 147.
[144] NIETZSCHE, Friedrich, Par-delà le bien et le mal, Verviers, Marabout Université, 1975, Trad. Angèle Kremer-Marietti, Deuxième partie « L’esprit libre », § 62, p. 93.
[145] NIETZSCHE, Friedrich, Par-delà le bien et le mal, Verviers, Marabout Université, 1975, Trad. Angèle Kremer-Marietti, Cinquième partie « Pour une histoire naturelle de la morale », § 225, pp. 182-183.
[146] SCHOPENHAUER, Arthur, Le Monde comme volonté et comme représentation, Paris, P.U.F., 1966, Trad. Auguste Burdeau, Livre premier « Le Monde comme représentation », § 37, p. 251.
[147] ZWEIG, Stefan, Le combat avec le démon, Paris, L.G.F., 2005, Trad. Alzir Hella, p. 120.
[148] NIETZSCHE, Friedrich, Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hemery, « Divagations d’un inactuel», § 8, p. 92.
[149] NIETZSCHE, Friedrich, La Naissance de la tragédie, Paris, LGF- Livre de poche, 2008, Trad. Jean Marnold et Jacques Morland, revue par Angèle Kremer-Marietti, p. 171.
[150] NIETZSCHE, Friedrich, Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hemery, « Divagations d’un inactuel», § 9, p. 93.
[151] SCHOPENHAUER, Arthur, Le Monde comme volonté et comme représentation, Paris, P.U.F., 1966, Trad. Auguste Burdeau, Livre premier « Le Monde comme représentation », § 37, p. 251.
[152] NIETZSCHE, Friedrich, « considérations inactuelles » in Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, Trad. Jeans-Louis Backès, p. 431.
[153] NIETZSCHE, Friedrich, La volonté de puissance I, Paris, Gallimard, 1995, Trad. Geneviève Bianquis, Chapitre VI « physiologie de l’art », § 446, p. 385.
[154] AUDI, Paul, L’Ivresse de l’art, Paris, L.G.F., 2003, p. 151.
[155] NIETZSCHE, Friedrich, La Naissance de la tragédie, Paris, LGF- Livre de poche, 2008, Trad. Jean Marnold et Jacques Morland, revue par Angèle Kremer-Marietti, p. 50.
[156] NIETZSCHE, Friedrich, Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hemery, « Divagations d’un inactuel», § 37, p. 102,.
[157] NIETZSCHE, Friedrich, La volonté de puissance I, Paris, Gallimard, 1995, Trad. Geneviève Bianquis, Chapitre VI « physiologie de l’art », § 440, p. 382.
[158] NIETZSCHE, Friedrich, La volonté de puissance I, Paris, Gallimard, 1995, Trad. Geneviève Bianquis, Chapitre VI « physiologie de l’art », § 446, p. 385.
[159] BLANQUÉ, Pascal, Histoire du Musicien à l’âge moderne, Musique, Cité et Politique, Paris, ED. Economica, 2009, p. 195.
[160] THEVOZ, Michel, Le théâtre du crime. Essai sur la peinture de David, Paris, Minuit, 1986, p. 52.
[161] NIETZSCHE, Friedrich, La volonté de puissance I, Paris, Gallimard, 1995, Trad. Geneviève Bianquis, Chapitre VI « physiologie de l’art », § 446, p. 386.
[162] NIETZSCHE, Friedrich, La naissance de la tragédie, Paris, LGF- Livre de poche, 2008, Trad. Jean Marnold et Jacques Morland, revue par Angèle Kremer-Marietti , pp.51-52.
[163] NIETZSCHE, Friedrich, La volonté de puissance I, Paris, Gallimard, 1995, Trad. Geneviève Bianquis, Chapitre VI « physiologie de l’art », § 438, p. 381.
[164]NIETZSCHE, Friedrich, Le cas Wagner, Paris, Gallimard, 1974, Trad. Jean-Claude Hémery, p. 21.
[165]NIETZSCHE, Friedrich, « Appel aux Allemands » in Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, Trad. Michel HAAR et Marc de Launay, p. 424.
[166] BOUTOT, Alain, Heidegger et Platon : Le problème du nihilisme, Paris, P.U.F, 1987, p. 16.
[167] SANFRANSKI, Rüdiger, Heidegger et son temps, Paris, Grasset Fasquelle, 1966, Trad. I. Kalinowski, p. 11.
[168] BOUTOT, Alain, Op. cit., p. 26.
[169] PLATON, La République, Paris, Ganier-Frères, 1966, Trad. R. Bacou, p. 276.
[170] BOUTOT, Alain, Op. cit., p. 175-176.
[171] HEIDEGGER, Martin, Nietzsche II, Paris, Gallimard, 1971, Trad. P. Klossowski, p. 328.
[172] ARISTOTE, La métaphysique, tome 1, Paris, J. Vrin, 1953, Trad. J. Tricot, pp. 349-350.
[173] Idem, p. 352.
[174] Idem, p. 333.
[175] HEIDEGGER, Martin, Op. cit., p. 329.
[176] DESCARTES, René, Discours de la méthode, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 45.
[177] HEIDEGGER, Martin, Op. cit., p. 115.
[178] REVEL, Jean-François, « Descartes, inutile et incertain » in Discours de la méthode, Paris, Librairie Générale Française, 1973, p. 82.
[179] HEIDEGGER, Martin, “ La Phénoménologie de l’Esprit’’ de Hegel, Paris, Gallimard, 1984, Trad. E. Martineau, p. 224.
[180] NIETZSCHE, Friedrich, Le crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, Trad. J- C. Hemery, p. 28.
[181] Idem, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Le Club français du Livre, 1958, Trad. M. Robert, p. 12.
[182] HAAR, Michel, La fracture de l’histoire, Grenoble, Ed. Jérôme Millon, 1994, p. 164.
[183] HEIDEGGER, Martin, Nietzsche II, Paris, Gallimard, 1971, Trad. P. Klossowski, p. 362.
[184] HAAR, Michel, Op. cit., p. 251.
[185] HEIDEGGER, Martin, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1967, Trad. G. Kahn, p. 19.
[186] Idem, p. 13.
[187] France-LANORD, Hadrien, Paul Celan et Martin Heidegger, Paris, Librairie arthème Fayard, 2004, p. 7.
[188] HEIDEGGER, Martin, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1986, Trad. F. Vézin, p. 58.
[189] HEIDEGGER, Martin, Ibidem.
[190] KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, Paris, Garnier Flammarion, 1976, Trad. J. Barni, p. 89.
[191] DUBOIS, Christian, Heidegger, Introduction à une lecture, Paris, Édition du Seuil, 2000, pp. 218-219.
[192] HEIDEGGER, Martin, Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1994, Trad. J. Beauffret, W. Brokmeir et F. Fedier, p. 207.
[193] HEIDEGGER, Martin, Lettre sur l’humanisme, Paris, Aubier-Montaigne, 1983, Trad. R. Munier, p. 139.
[194] Idem, p. 151.
[195] HEIDEGGER, Martin, Nietzsche II, Paris, Gallimard, 1971, Trad. P. Klossowski, p. 9.
[196] Idem, La ‘‘ Phénoménologie de l’esprit’’ de Hegel, Paris, Gallimard, 1984, Trad. E. Martineau, p. 64.
[197] Idem, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1986, Trad. F. Vezin, p. 63.
[198]HEIDEGGER, Martin, Op. cit, p. 324.
[199] HEIDEGGER, Martin, Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1994, Trad. J. Beauffret, W. Brokmeir et F. Fedier, p. 95.
[200] HEIDEGGER, Martin, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1967, Trad. G. Kahn, p. 20.
[201] Idem, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1986, Trad. F. Vezin, p. 21.
[202] HEIDEGGER, Martin, Lettre sur l’humanisme, Paris, Aubier-Montaigne, 1983, Trad. R. Munier, p. 83.
[203] Idem, p. 77.
[204] Ibidem.
[205] HAAR, Michel, Op. cit., p. 11.
[206] HEIDEGGER, Martin, La ‘‘Phénoménologie de l’esprit’’ de Hegel, Paris, Gallimard, 1984, Trad. E. Martineau, p. 224.
[207] BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, pp. VII-VIII.
[208]LAPLACE, Pierre Simon, Théorie analytique des probabilités, Paris, Courcier, 1814, p. II.
[209]BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, p.107.
[210]Ibidem.
[211]SPINOZA, Baruch, Éthique, Paris, G/F, 1965, pp.139-140.
[212] DESCARTES, René, Principes de la philosophie, Paris, J.Vrin, 1993, p. 39.
[213]DESCARTES, René, Lettre au Père Mersenne, 9 fév.1645, trad. Alquié, in œuvres philosophiques de Descartes, t.III, Paris, Dunod, 1973, p. 550.
[214]DESCARTES, René, Op. cit., p. 550.
[215]BERGSON, Henri, Lettre à William JAMES, in Mélanges, Paris, PUF, 1972, p. 766.
[216] MERLEAU-PONTY, Maurice, Eloge de la philosophie, Paris, Idée/Gallimard, 1979, p. 11.
[217] BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, p. 77.
[218] BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1997, p. 328.
[219] BERGSON, Henri, La pensée le mouvant, Paris, PUF, 1998, p. 3.
[220] BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, p. 74.
[221] Idem, p. 75.
[222] BERGSON, Henri, Op. cit., pp. 146-147.
[223] BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, pp. 74-76.
[224] BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1997 p. 4.
[225] WORMS, Frédéric, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, 2004, pp. 10-11.
[226] BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, p. 89.
[227]BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1997, p. 7.
[228] BERGSON, Henri, La pensée le mouvant, Paris, PUF, 1998, p. 200.
[229]MEYER, François, Bergson, Paris, Bordas, 1988, p. 35.
[230]BERGSON, Henri,Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, p. 95.
[231]WORMS, Frédéric, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, 2004, p. 35.
[232]BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1997, p.174.
[233]Idem,p. 180.
[234] Idem, p. 129.
[235] BERGSON, Henri, Op. cit.,p. 128.
[236]BERGSON, Henri, Le rire, Paris, PUF, 1997, p. 60.
[237]BERGSON, Henri, Cours II, édité par Henri Hude avec la collaboration de Jean-Louis Dumas, Paris, P.U.F, 1992, p. 153.
[238]BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, P.U.F, 1997, p. 166.
[239]BERGSON, Henri, Op. cit.,p.165.
[240]LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 2002, p. 926.
[241]Idem, p. 927.
[242] BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1997, p. 201.
[243]LOMBARD, Jean, Bergson : création et éducation, Paris, L’harmattan, 1997, p. 40.
[244]JANKÉLÉVITCH, Vladimir, Henri Bergson, Paris, PUF, 1959, p. 78.
[245]FRANÇOIS, Arnaud, Bergson, Paris, ellipses, 2008, p. 115.
[246]ARRIGHI-GALOU, Nicole, La scolarisation des enfants de 2-3 ans et ses inconvénients, Paris, ESF, 1988.
[247]BARRO,Oulo Moussa, L’éducation préscolaire : quelle incidence sur le rendement scolaire des élèves à l’école primaire ? Cas de la CEB de Koudougou II.École Normale Supérieure /Université de Koudougou, 2006.
[248] KOWALSKI, Isabelle, « Souffrances à l’école maternelle », In Spirale, 1, n° 53, 2010, pp. 85-94.
[249] Les maternelles, lieu privilégié pour prévenir l’échec scolaire Analyse UFAPEC 2009 n°15. Disponible sur le web :<www.ufapec.be>, Consulté le 18.08.12.
[250] SUCHAUT, Bruno, Etude maternelle. Disponible sur le web : <www.inegalites.fr/IMG/pdf>, Consulté le 18.08.12 ;
[251] SUCHAUT, Bruno, Etude maternelle. Disponible sur le web : <www..inegalites.fr/IMG/pdf>.Consulté le 18.08.
[252] CHILAND, Colette, L’enfant, la famille, l’école, Paris, PUF, 1988, pp. 152-153.
[253] GILABERT, Hervé, Apprendre à lire en maternelle, Paris, ESF,1993, p.12.
[254] GILLIG, Jean-Marie, L’enfant et l’école en 40 questions, Paris, Dunod, 1999, p.10.
[255] GILLIG, Jean-Marie, L’enfant et l’école en 40 questions, Ibidem.
[256] KALAMO, Augustin, Des déterminants des performances scolaires à la fin de l’enseignement élémentaire au Sénégal : Cas de l’Inspection Départementale de l’Éducation de Vélingara, dans la région de Kolda, Mémoire de Master en éducation et formation, Université Cheikh Anta Diop Dakar, 2012.
[257] MINGAT, Alain, L’école primaire en Afrique, Paris, L’Harmattan, 1993.
[258] ZAZZO, Bianka, L’école maternelle à 2 ans: oui ou non ?Paris, Stock, 1984.
[259] WINNICOTT, Donald Woods, Jeu et réalité, l’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.
[260] KOWALSKI, Isabelle, « Souffrances à l’école maternelle », In Spirale, 1, n° 53, 2010, pp. 85-94.
[261]Institut National de la Statistique et de la Démographie (2008)
[262]CHANQUOY, Lucile, Statistiques appliquées à la psychologie et aux sciences humaines et sociales, Paris, Hachette, 2005.
[263] SUCHAUT, Bruno, Etude maternelle. Disponible sur le web : <www..inegalites.fr/IMG/pdf>, Consulté le 18.08.12 à 11h39.
[264] CHILAND, Colette, L’enfant, la famille, l’école Paris, PUF, 1988, pp. 152-153.
[265] GILABERT, Hervé, Apprendre à lire en maternelle, Paris, ESF,1993, p.12.
[266] GILLIG, Jean-Marie, L’enfant et l’école en 40 questions, Paris, Dunod, 1999, p.10.
[267] ZAZZO, Bianka, L’école maternelle à 2 ans: oui ou non ?Paris, Stock, 1984.
[268]WINNICOTT, Donald Woods, Jeu et réalité, l’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.
[269]KOWALSKI, Isabelle, « Souffrances à l’école maternelle », In Spirale, 1, n° 53, 2010, pp 85-94.
[270]BANDURA, Albert, Auto-efficacité : le sentiment d’efficacité personnelle, Bruxelles, De Boeck, 2003.
[271]VIAU, Roland, La motivation en contexte scolaire, Bruxelles, De Boeck, 2005.
[272]VIAU, Roland, Ibidem.
[273] FLORIN, Agnès& VRIGNAUD, Pierre, Réussir à l’école : les effets des dimensions conatives en éducation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.
[274] ZAZZO, Bianka, L’école maternelle à 2 ans: oui ou non ? Paris, Stock, 1984.
[275] KOWALSKI, Isabelle, « Souffrances à l’école maternelle », In Spirale, 1, n° 53, 2010, pp 85-94.
[276] HUNTINGTON, Samuel, The clash of civilizations and the remaking of the world order, Touchstone, Touchstone Books, 1997.
[277] Cf. TOURAINE, Alain, « Faux et vrai problèmes », dans Michel Wieviorka et al., Une société fragmentée ? Le multiculturalisme en débat, Paris, La Découverte, 1996, p. 291-319 et « La nationalisme contre la nation », dans Pierre Birnbaum (dir.), Sociologie des nationalismes, Paris, P.U.F, 1997, pp. 402-423.
[278] DAVID Junior, Quand l’Afrique s’éveillera ?, Paris, Nouvelles du sud, 1998, p. 65.
[279] THUAL, François, Les conflits identitaires, Paris, Ellipses, 1995, p. 20.
[280] THUAL, François, Op. cit., p. 25.
[281] Cf. DIAKITÉ, Samba, « La déréliction du langage dans le penser politique en Afrique », Le Portique [En ligne], 1-2005, mis en ligne le 12 mai 2005, consulté le 26 juin 2012. URL : http//www.leportique.revues.org./index521.htlm.
[282] Dans la crise Rwandaise, l’identification des Tutsi ou des Hutu se faisait par les uns et les autres à travers la forme du visage, l’épaisseur du nez… Bien entendu, ces soi-disant traits naturels sont arbitraires.
[283] Voir CHRÉTIEN, Jean-Pierre, Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala, 2003.
[284] AMSELLE, Jean-Loup, M’BOKOLO, Elikia, Au cœur de l’ethnie : ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La Découverte, 1985, p. 129.
[285] ANNAN, Kofi, Rapport du Secrétaire Général de l’ONU au Conseil de Sécurité sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durable en Afrique. New York, avril 1998.
[286] SHYAKA Anastase, Conflits en Afrique des Grands Lacs et Esquisse de leur Résolution, Varsovie, Dialog, 2003 ; voir aussi Burton W. (ed.), Conflict : Human Needs Theory, New York, St. Martin’s Press, , 1990.
[287] WEBER, Max, Economie et société, tome 2, L’organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l’économie, Paris, Plon, 2003, p. 139.
[288] BOUCHARD, Gérard, « Ouvrir le cercle de la nation. Activer la cohésion sociale. Réflexion sur le Québec et la diversité », in Sarra-Bournet Michel et de Saint-Pierre Jocelyn (sd), Les nationalismes au Québec, Laval, Presse de l’Université de Laval, 2001, p. 319.
[289] Voir GOBINEAU, Joseph Arthur Comte de, Essai sur l’inégalité des races humaines, Paris, Pierre Belfond, 1967.
[290] LAPOUGE, Georges Vacher Le Comte de, Les sélections sociales, Cours libre de science politique professé à l’Université de Montpellier 1888-1889, Paris, A. Fontemoing, 1896.
[291] Voir COULON, Christian, « Les dynamiques de l’ethnicité en Afrique noire » in Burnbaum Peter et alii (éd.), Sociologie des nationalismes, Paris, P.U.F, 1998, pp. 37-53.
[292] COPANS, Jean, La longue marche de la modernité africaine. Savoirs, intellectuels, démocratie, Paris, Karthala, 1990, p. 187.
[293] Ibidem.
[294] SINDJOUN, Luc, La politique d’affection en Afrique noire. Société de parenté, « Société d’Etat » et libéralisation politique au Cameroun, Boston University, Graf, 1998, p. 13.
[295] LE ROY, Etienne, « Les droits de l’homme entre hâtif et le ghetto des particularismes culturels », L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, AUPELF – UREF, 1994, p. 681.
[296] TCHOUANG-TSEU, Œuvre complète, Saint Amand, Gallimard/UNESCO, 1997, pp. 18 et 19.
[297] TCHOUANG-TSEU, Œuvre complète, Paris, Gallimard, 1997, p. 44.
[298] PANIKKAR, Raymond, « La notion des droits de l’homme est-elle un concept occidental ? », Interculture, vol. XVII, n° 1, Cahier 82, 1984, pp. 3-27, p. 23.
[299] LE ROY, Etienne, « Comparaison n’est pas raison : anthropologie et droit comparé face aux traditions non-européennes », Cendon Paolo (éd), Scritti in onore di Rodolfo Sacco – La comparazione giuridica alle soglie del 3° millenio, Milan, Milano Dott. A. Giuffrè Editore, 1994, p. 680.
[300] LE ROY, Etienne, Un passeur entre les mondes. Le livre des anthropologues du droit disciples et amis du Recteur Michel Alliot, Paris, Publication de la Sorbonne, 2000.
[301] LE ROY, Etienne, « L’hypothèse du multijuridisme dans un contexte de sortie de modernité », Lajoie André, Macdonald Roderick, Janda Richard, Rocher Guy (s.d.), Théorie et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Bruxelles, Bruylant/Thémis, 1998, p. 29.
[302] VACHON, Robert, « Guswenta ou l’impératif interculture – Partie 1, volet II : un horizon commun, Interculture, vol. XXVIII, n°128, 1995, p. 38.
[303] Idem; p. 40.
[304] VACHON, Robert, Op. cit., pp. 40 et 41.
[305] PANIKKAR, Raymond, Cultural Desarmament – The way to Peace, Westminster, John Knox Press, 1995, pp. 102 et 103.
[306] Idel. pp. 10 et 11.
[307] « Si nous voulons la paix, commençons à nous préparer nous-mêmes », PANIKKAR, Raymond, Cultural Desarmament – The Way to Peace, Westminster, John Knox Press, 1995, p. 104.
[308] COULON, Christian., « Les dynamiques de l’ethnicité en Afrique noire », dans Pierre Birnbaum (dir.), Sociologie des nationalismes, Paris, P.U.F, 1997, p. 51.