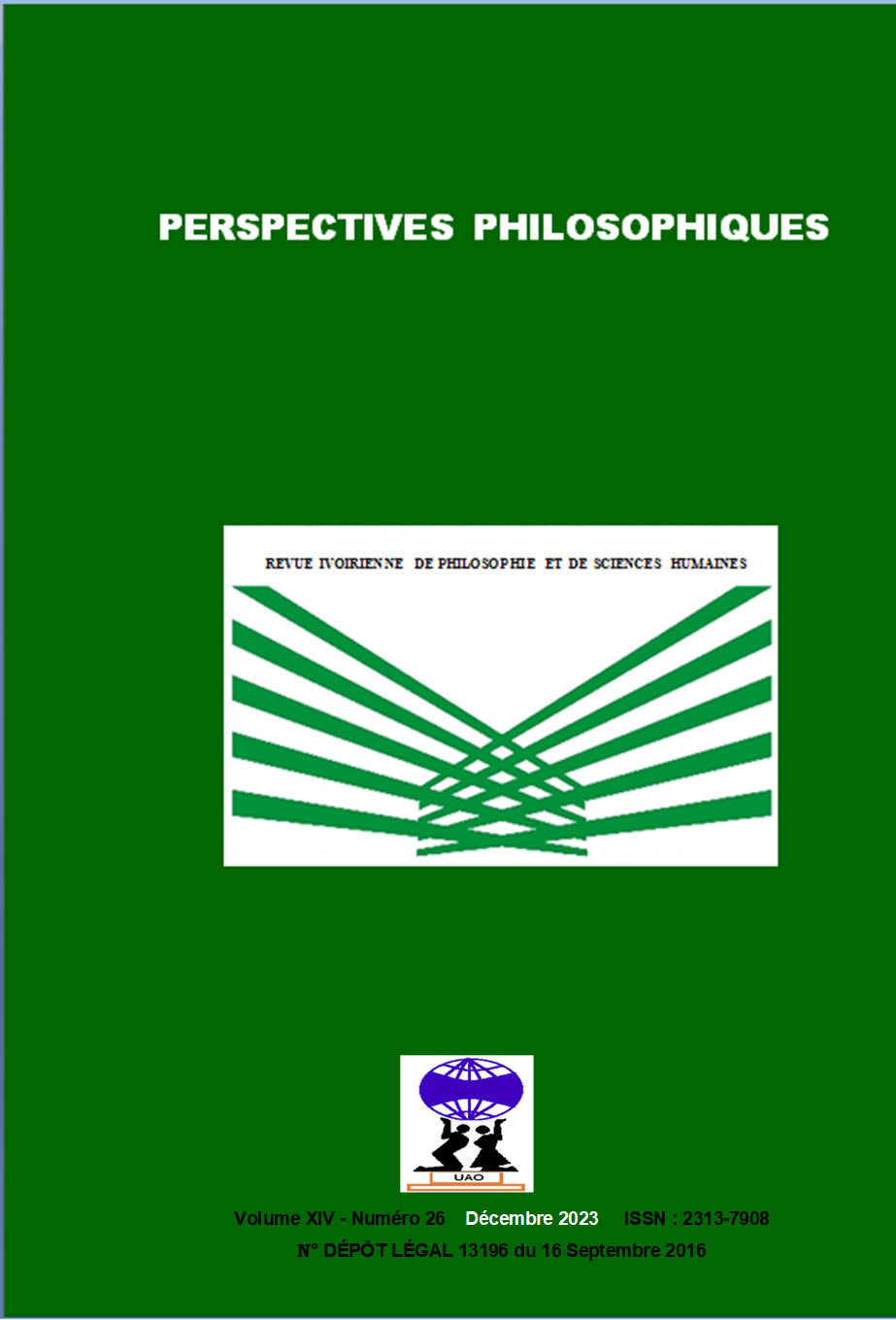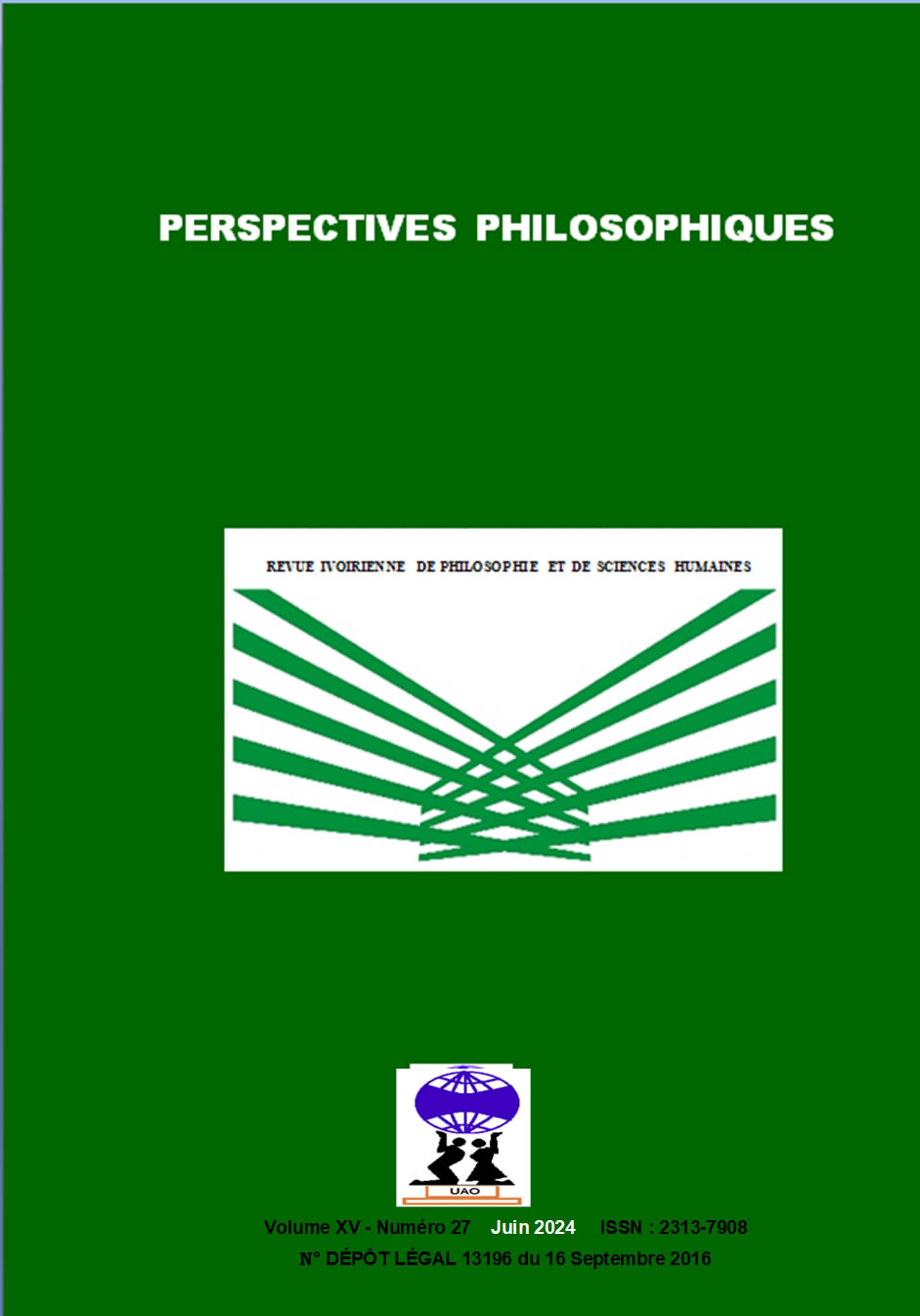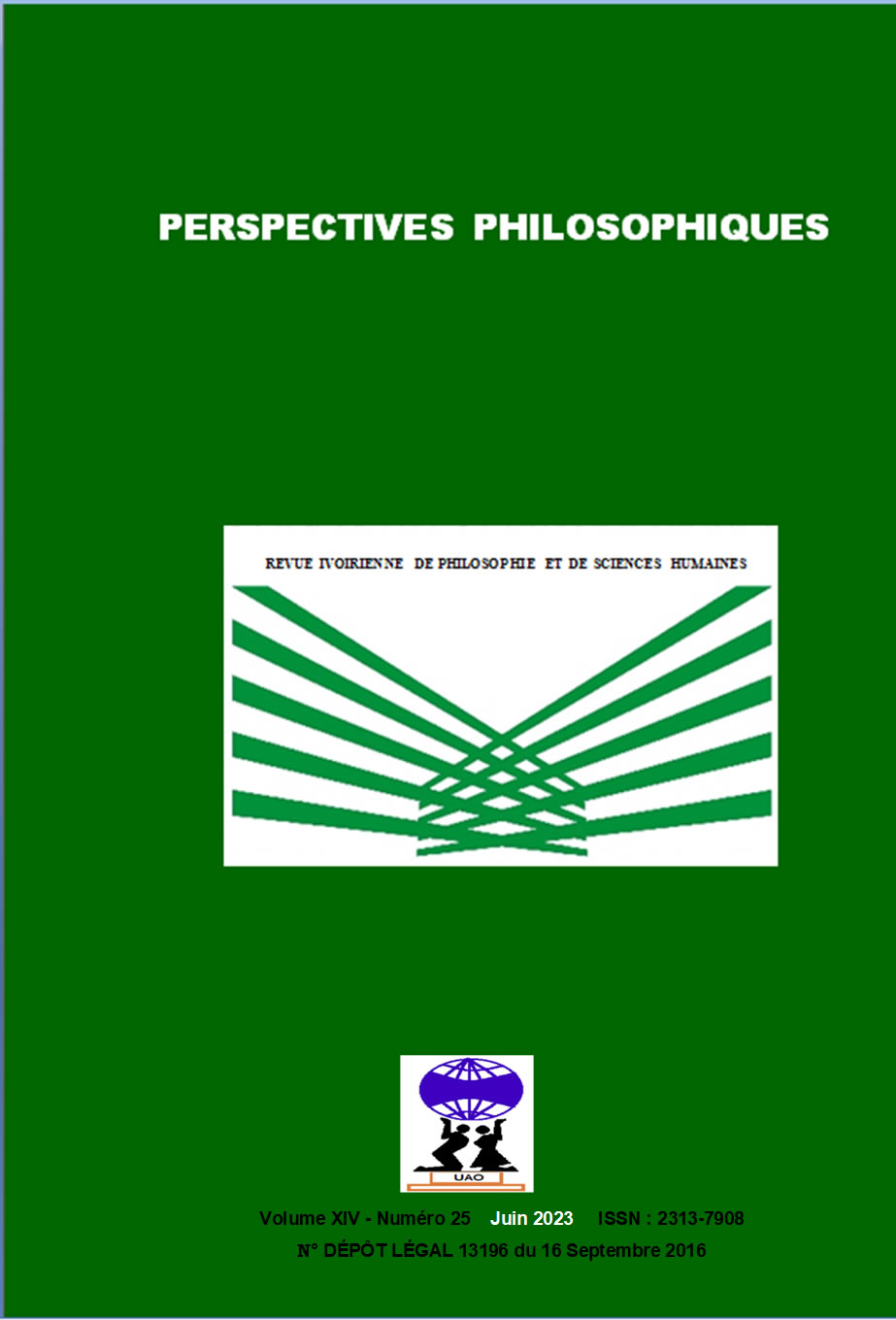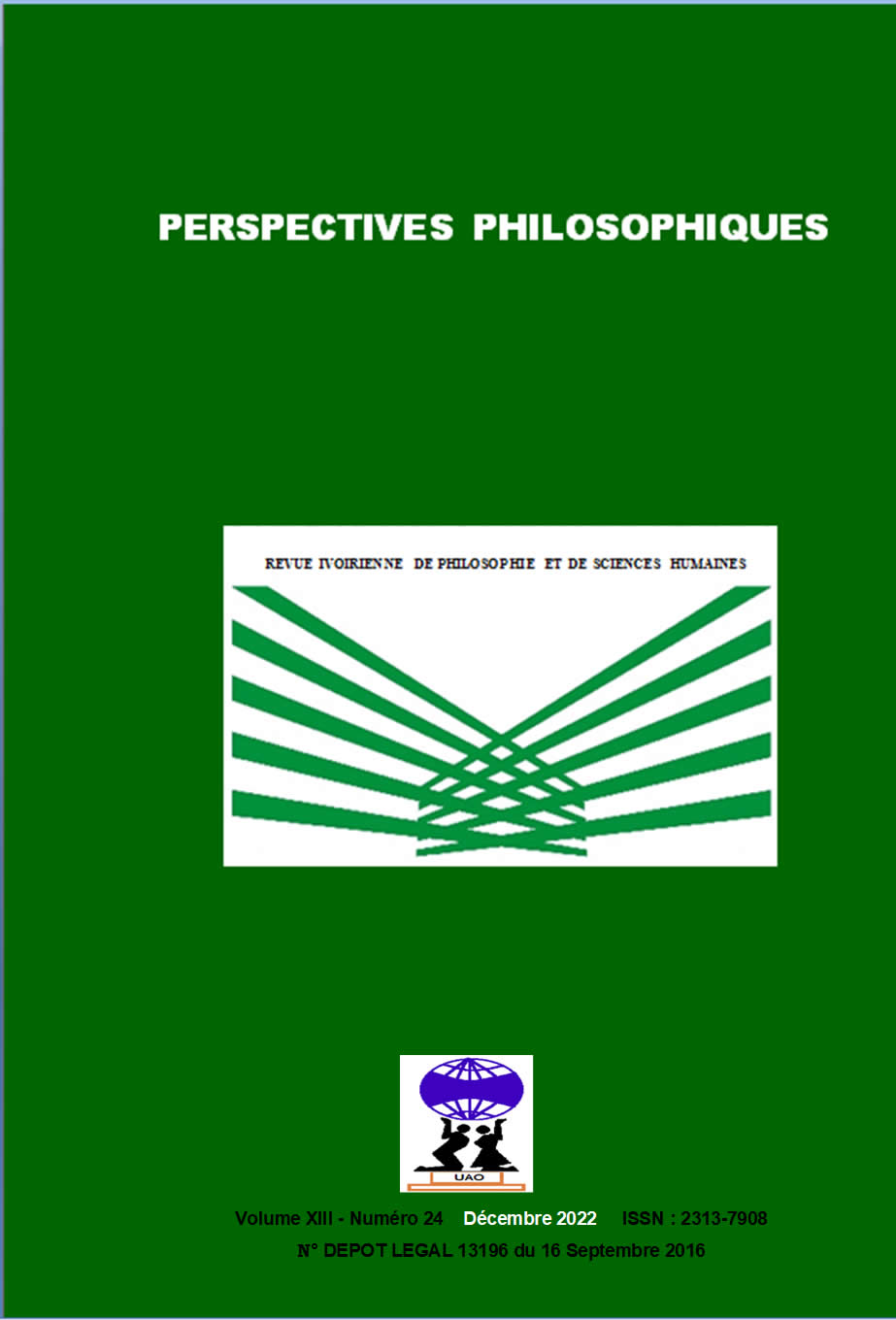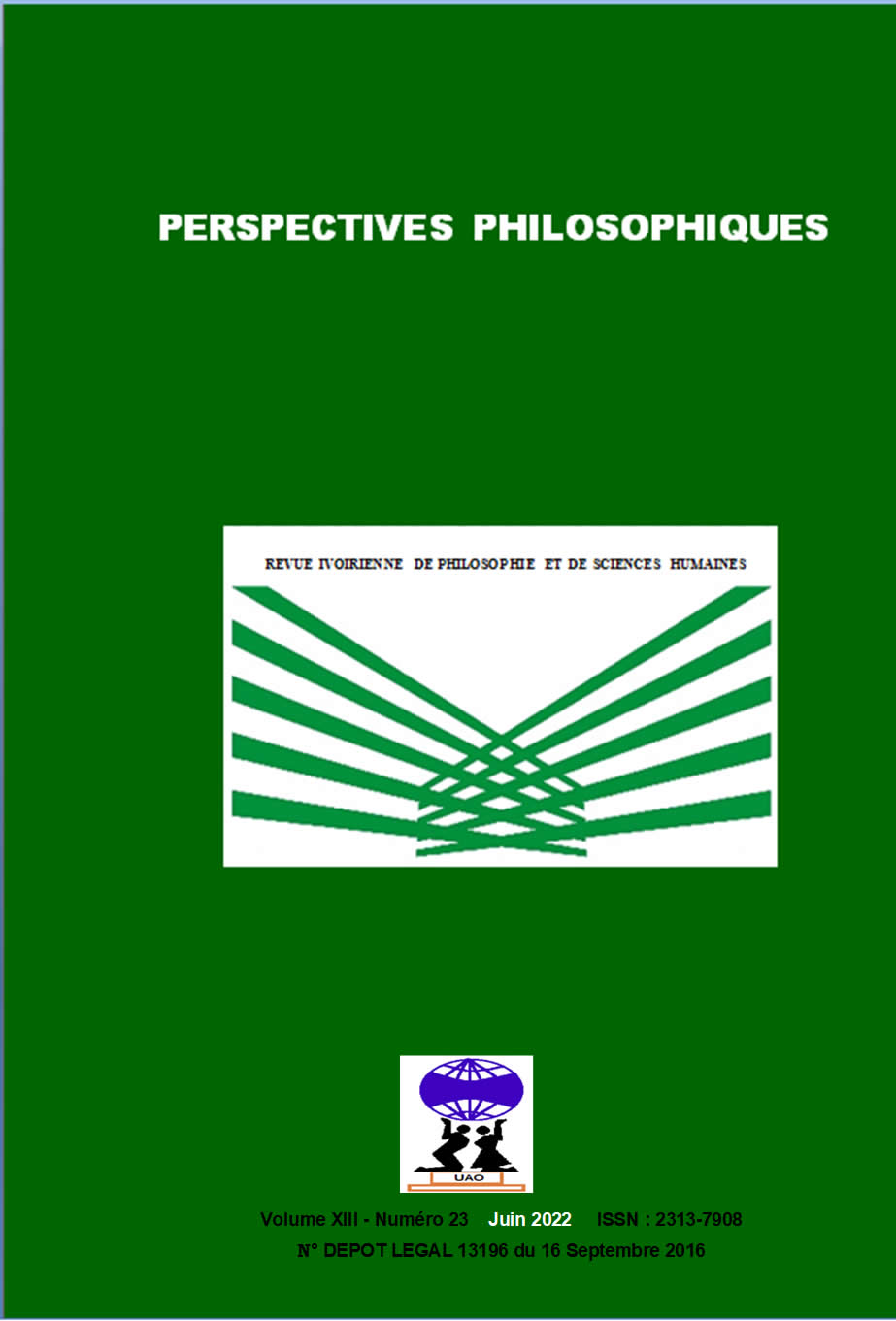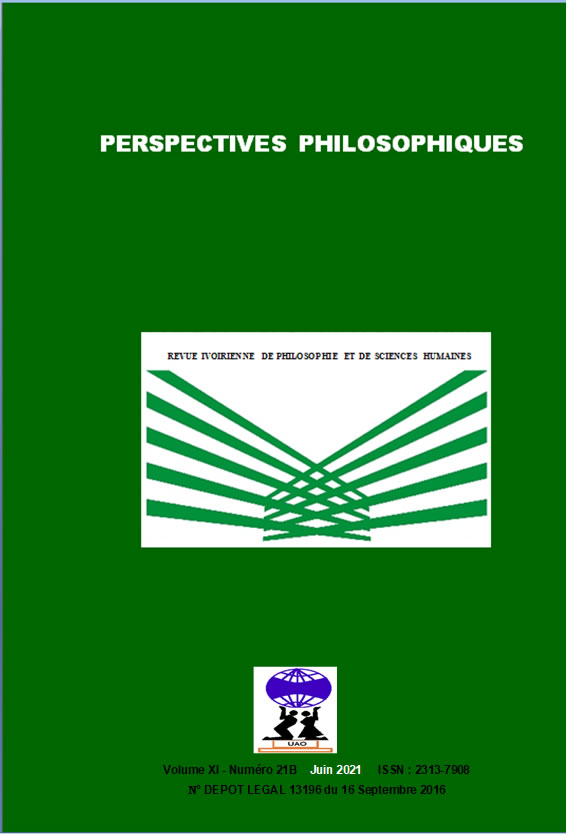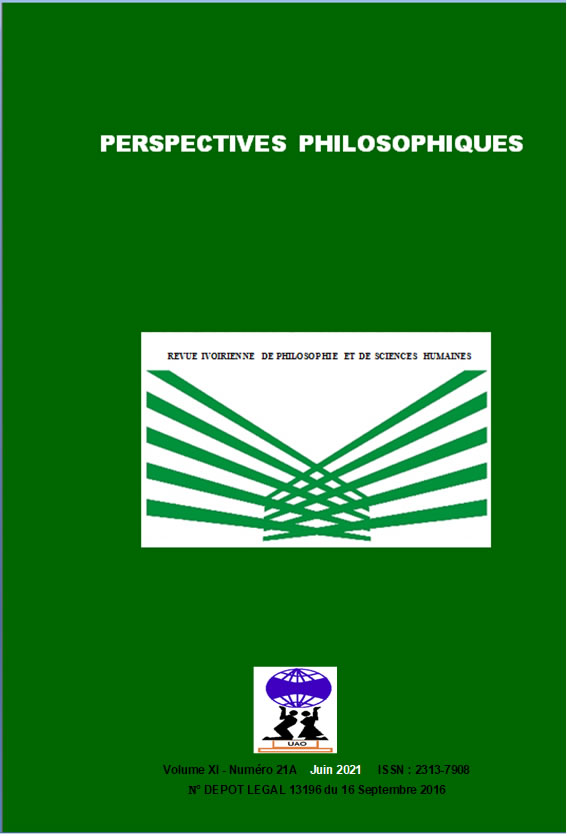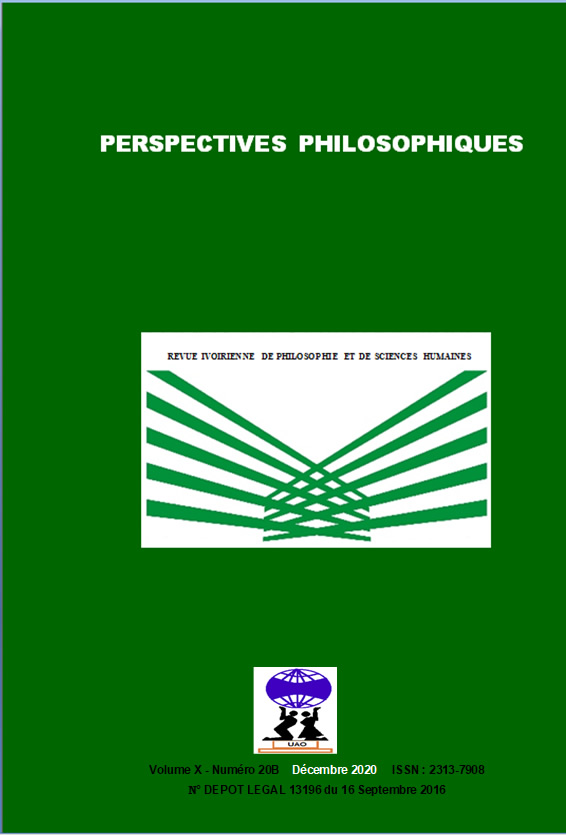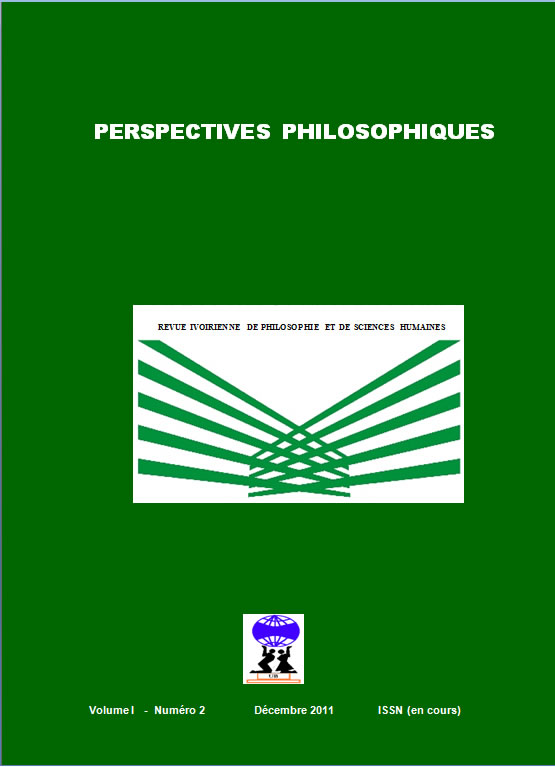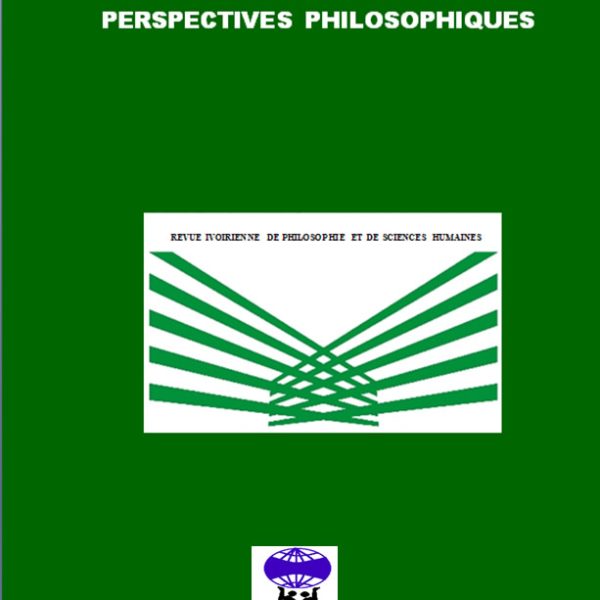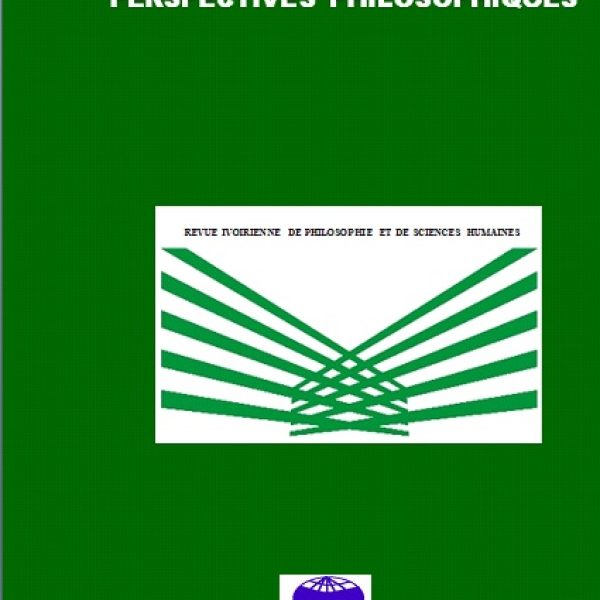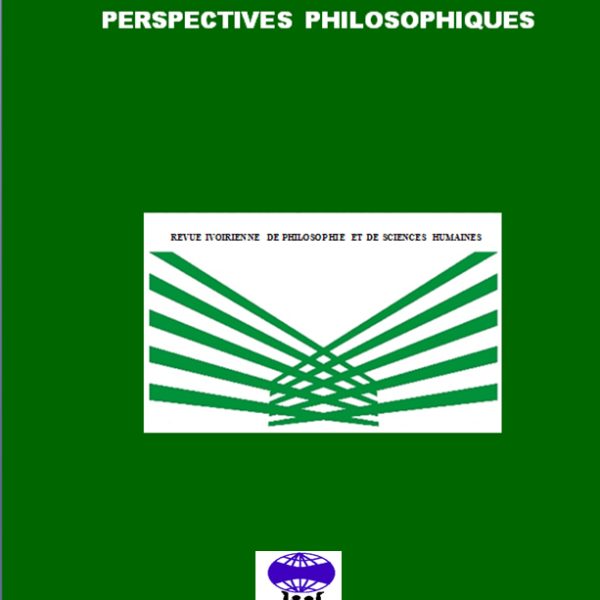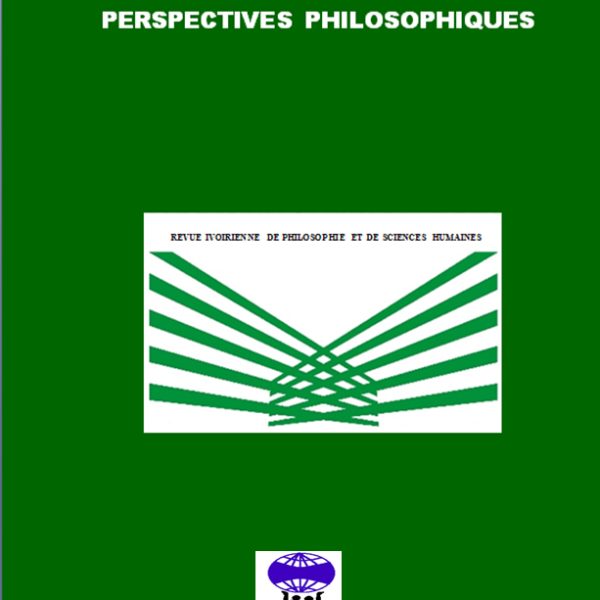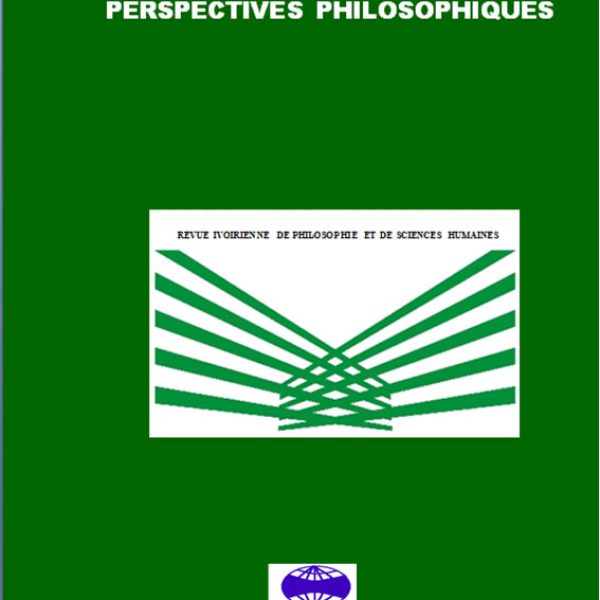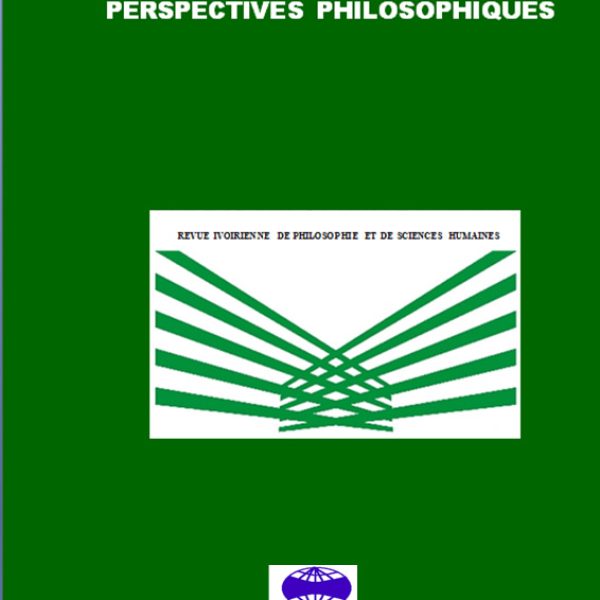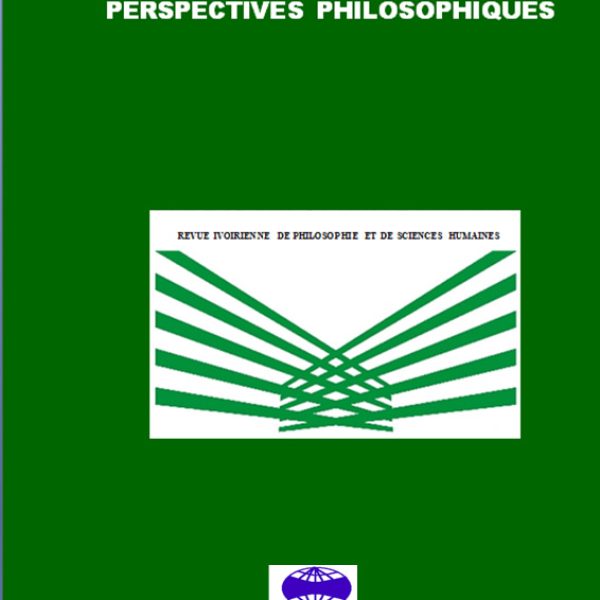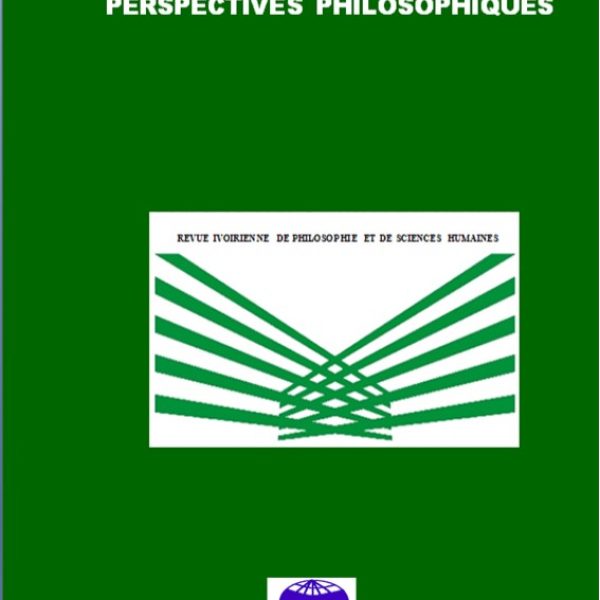PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 27 BP 529 ABIDJAN 27
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : revueperspectivesphilo@yahoo.fr
Site internet : http://perspectives.bouakephilo.net
ISSN (en cours)
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Maître de Conférences
Rédacteur en chef : Prof. N’dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences
Rédacteur en chef adjoint: Dr Assouma BAMBA, Maître-Assistant
Secrétaire de rédaction : Dr Blé Sylvère KOUAHO, Maître-Assistant
COMITÉ DE REDACTION
: Prof. Kouassi Edmond YAO, Maître de Conférences
: Dr Abou SANGARÉ, Maître-Assistant
: Dr Donissongui SORO, Maître-Assistant
: Dr Jean-Baptiste GRODJI, Maître-Assistant
: Dr Kouassi Clément AKPOUÉ, Maître-Assistant
: Dr Lucien BIAGNÉ, Maître-Assistant
: Dr Maurice KOLADÉ, Maître-Assistant
Trésorier : Dr Grégoire TRAORÉ, Maître-Assistant
Responsable de la diffusion: : Prof Antoine KOUAKOU, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique,
Université de Bouaké
Prof. Antoine KOUAKOU, Maître de Conférences, Métaphysique et Éthique,
Université de Bouaké
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université de Bouaké
Prof. Azoumana OUATTARA, Maître de Conférences, Philosophie politique,
Université de Bouaké
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique,
Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et
Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université de Bouaké
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Maître de Conférences, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université de Bouaké
Prof. Henri BAH, Maître de Conférences, Métaphysique et Droits de l’Homme,
Université de Bouaké
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et
Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Maître de Conférences, Métaphysique et Théologie,
Université de Bouaké
Prof. Kouassi Edmond YAO, Maître de Conférences, Philosophie politique et sociale, Université de Bouaké
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université de Bouaké
Prof Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de
Ouagadougou
Prof. N’Dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences, Éthique des Technologies,
Université de Bouaké
Prof. Samba DIAKITÉ, Maître de Conférences, Études africaines, Université de Bouaké
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Maître de Conférences, Métaphysique, Université de Bouaké
SOMMAIRE
- Donissongui Soro – Le désordre par l’ontologie :
relativité et hégémonie d’un possible…………………………………………….. 07
- Jean Foly Koblan Kossi – La justice comme principe
de la paix chez platon ………………………………………………………………… 31
- Diby Cyrille N’dri – Machiavel et aristote : continuité ou rupture ?..47
- Cablanazann Thierry Armand Ezoua – La dialecticité
du concept de religion chez hegel………………………………………………….. 65
- Georges Zongo – La proximité de l’absolu chez hegel………………….. 85
- Abou Sangaré – Hegel et les lumières : adversité résolue ou expression d’un subtil mode de pensée dialectique ?………………….. 103
- Samba Diakité – De l’esthétique negro-africaine
comme quête inlassable du graal afrique………………………………………. 120
- Issiaka-P. L. Lalèyê – Le défi théoréthique de l’école africaine dans le contexte du développement et de la mondialisation……………… 143
- Marie-Thérèse Yah kabran – La mondialisation : lecture
speculative et enjeux ethiques pour l’afrique ……………………………….. 167
- Cyrille Semde – L’éthique de la discussion et les nouvelles technologies de l’information et de la communication……………………… 192
- François Bruno Traore – Apologie du féminisme et rhétorique
machiste du discours christinien………………………………………………… 223
- Anne Marilyse Kouadio – Stratégies résidentielles d’une catégorie de citadins du bas de l’échelle de qualification : les personnels domestiques
féminins de la ville d’abidjan………………………………………………………. 245 LIGNE EDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
LE DÉSORDRE PAR L’ONTOLOGIE : RELATIVITÉ ET
HÉGÉMONIE D’UN POSSIBLE
Donissongui SORO
Maître-Assistant
Université de Bouaké-Côte d’Ivoire
Résumé : Les panégyristes de l’ordre ont souvent perçu le désordre à travers le prisme des dogmes simplificateurs qui le réduisent à une violation de l’ordre. Synonyme de ruine, d’anarchie et de crise morale, il serait négation des mœurs, de la paix, de la stabilité politique et de la croissance économique. Mais à ce réductionnisme, le présent article tente d’opposer une esthétique de ce concept galvaudé. Car l’ontologie du désordre le manifeste comme un type de relation que la conscience entretient avec son objet, comme un autre ordre qui s’impose à notre esprit, et dont celui-ci n’a que faire. Car, aussi, elle le manifeste comme un moment déterminant du progrès et comme le référent d’une téléologie universelle.
Mots clés : Désordre, esprit, morale, nature, ordre, progrès, science, société
Abstract: The panegyrists of the order often perceived the disorder through the prism of the simplifying dogmas which reduce it to a violation of the order. Synonym of ruin, anarchy and moral crisis, it would be negation of manners, peace, political stability and the economic growth. But against this reduction, this article tries to oppose an esthetic of this deteriorated concept. Because the ontology of the disorder manifests it as a type of relation which the conscience maintains with its object, as another order which is essential on our spirit and this one has to only make. Because it also expresses it like one moment determining of progress and as the referent of a universal teleology.
Key words: Disorder, mind, morals, nature, order, progress, science, society Introduction
On considère le désordre comme pure négation de l’ordre et de l’être. Le pédagogue le soupçonne d’être un obstacle à la formation du citoyen de demain. Le politique le tient pour une puissance de déstabilisation qu’il urge de dompter. L’économiste voit en lui l’ennemi du développement, de la croissance et de la productivité. Le moraliste le réduit à une atteinte aux bonnes mœurs. Le matérialisme réductionniste le pose comme une désagrégation de l’être à laquelle eut dû s’opposer la rigidité du tangible. Au total, il coïncide avec le mal, se réalise en lui et le réalise sous la symbolique de l’euphémisme. Aussi Machiavel, dans Le Prince, préconise-t-il qu’il ne soit jamais toléré[1].
Mais le désordre est-il synonyme de décadence, de chaos, et de perdition ? Si on se soustrait un instant de l’influence des intérêts pour en faire une ‘’endoscopie’’, ne le verra-t-on pas comme une dimension nécessaire de l’être par rapport à laquelle notre esprit préfère le contraire ? Mieux, n’est-il pas l’hypostase d’un esprit désabusé cherchant à perpétuer son rêve ? Si nos esprits, abusés par des a priori de tous genres, l’ont souvent réduit à ce qui ruine et rebute, ne faut-il pas, enfin, s’émanciper des catéchismes idéologiques et des dogmes simplificateurs, pour rechercher, avec Jean-Pierre Dupuy, une pensée neuve, un nouveau paradigme2 ? Et si son ontologie n’était, au fond, qu’une phénoménologie de l’esprit humain !
Baudelaire avait écrit Les fleurs du mal. Nous voulons penser l’ordre du désordre. Nous voulons repenser le désordre et, peut-être, le panser.
Ce poète avait suscité et essuyé le courroux de son siècle[2]. Nous espérons donner au nôtre une image réaliste de cette autre dimension de l’existence qui nous est renvoyée par le prisme de la négativité comme altérité austère. L’ontologie du désordre comme phénoménologie de l’esprit, la dialectique qui le lie au progrès, autant que son optique eschatologique, font droit à cette orientation du penser. Et il importe de suspecter la fascination du préférable au profit de la réalité, fût-elle troublante.
I. L’ontologie du désordre comme phénoménologie de l’esprit
Au sujet pleinement conscient de Descartes, la psychanalyse freudienne a substitué l’homme de l’inconscient. Mais ce qui, de ce dépassement, reste inébranlable, c’est la définition de l’homme par la pensée. Loin des formes pathologiques qui le nient, l’homme pense et se pense. Il pense ses actions, son être et ses pensées. Ainsi, le désordre, lorsqu’il est celui de l’homme moral, ne serait que l’exutoire d’un désordre intérieur qu’on peut percevoir, avec Platon, sous les traits d’une subversion dans l’âme.
1. La subversion dans l’âme
Sauver le concept. C’est là le pas inaugural de toute réflexion sérieuse sur le désordre. En effet, la critique nominaliste a fait du concept une abstraction sans correspondant réel. Car, idée générale et abstraite, il ignore les spécificités individuelles et reste en-deçà de l’ici et maintenant, condition de toute perception. Comme le Beau en soi de Platon, qui n’apparaît « ni comme une force corporelle, ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme une chose qui existe en autrui »[3], mais qui, au contraire, existe en lui-même et par lui-même, simple, parfait, universel et éternel, et qui rend belles toutes les belles choses[4], il n’a ni corps ni couleur, ni forme ni ombre.
Ainsi, ce qui est et dont l’homme fait l’expérience, ce n’est pas le désordre en général, c’est tel ou tel désordre qu’il a devant lui et par rapport auquel il a à se déterminer. C’est le désordre de cette salle de conférences, de la chambre des enfants, du marché, du bureau de l’état civil qui ne peut retrouver tel ou tel registre. C’est le désordre cosmique, moral, social, politique, économique, culturel, etc.
Mais, loin d’être un credo, un tel point de vue est une invitation à penser. Il signifie que le vrai n’est pas spontanément, et qu’il faut, au penser, un dépassement de soi et du donné. Certes, le désordre est un concept, le résidu d’un processus d’abstraction mû par la quête de l’universel. Sans doute, il est un singulier-pluriel, une marque de l’universel, procédant du divers et le subsumant. Sans doute aussi, lorsqu’au divers se substitue l’unicité, l’esprit humain ne se réfère pas moins, pour autant, à telle ou telle individualité spécifique qui le guide et crée le sentiment du général. Mais, il est, en tant qu’il est, le désordre.
Dans La République, Platon, cherchant à identifier la justice dans l’individu, en laisse une définition remarquable. L’enquête de La République a, en effet, pour objet de cerner la justice dans l’individu. Mais on ne sait y parvenir directement, et l’enquêteur passe du particulier à l’ensemble, du microcosme au macrocosme. Il cherche à la déceler dans un cadre plus grand, où elle sera plus « grande et plus facile à étudier[5]», c’est-à-dire, dans la cité. Quand elle sera ainsi saisie dans la cité, on pourra la déchiffrer dans l’individu.
Et ce que révèle l’enquête, c’est que, dans la cité, il y a trois classes ayant chacune une fonction spécifique : les chefs dont le rôle est de gouverner, les gardiens qui doivent assurer la sécurité tant intérieure qu’extérieure, et les producteurs qui ont pour rôle de générer les biens et services indispensables au fonctionnement de la cité. Elle est donc juste quand cet ordre est respecté, et injuste lorsqu’il ne l’est plus, lorsqu’aux chefs se substituent, par exemple, les gardiens.
De même, dans l’âme humaine, il y a trois éléments : la raison ou l’élément par lequel l’homme connaît, le courage encore appelé l’élément irascible, et l’appétit ou l’élément concupiscible[6]. Et la justice, dans l’individu, consiste en ce que la raison gouverne, que le courage défende l’intégrité et l’honneur de l’individu, et que l’appétit lui apporte les éléments indispensables à son bien-être matériel. Quant à l’injustice, en lui, elle est le désordre que produit le non-respect de cet ordre. Ainsi qu’il le fait dire à Socrate : « Donc, engendrer la justice n’est-ce pas établir selon la nature les rapports de domination et de sujétion entre les divers éléments de l’âme ? Et engendrer l’injustice n’est-ce pas leur permettre de gouverner où d’être gouvernés l’un par l’autre contre nature ? »8.
Cette ontologie de l’âme amène Platon à une typologie qui lui permet d’établir qu’il existe « trois principales classes d’hommes, le philosophe, l’ambitieux, l’intéressé »[7], puis au fondement du désordre moral. Passant au portrait de chacun de ces types de personnes, en effet, il note que le philosophe est l’homme en qui la raison gouverne, qui veut « connaître la vérité telle qu’elle est »[8]et qui mène une vie réglée par la philosophie[9]. Quant à l’ambitieux, ami de la victoire et des honneurs, et à l’intéressé, soucieux d’amasser des richesses, ils vivent dans le désordre, l’un étant gouverné par l’élément irascible, par la quête de la victoire et des honneurs, et l’autre par le concupiscible ou la recherche effrénée des plaisirs du corps.
Ainsi, lorsqu’au lieu du philosophe, l’ambitieux ou l’homme intéressé gouverne, la cité ne peut que souffrir du désordre. De même que dans l’âme, seule la raison doit gouverner, de même dans la société, seul le philosophe doit gouverner, si les maux du genre humain doivent cesser. C’est pourquoi Socrate dit à Glaucon : « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes […] il n’y aura de cesse, mon cher Glaucon, aux maux des cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain »[10].
Le désordre auquel aboutit ainsi la quête de la justice, n’est pas une spécificité de la cité platonicienne. Tous les groupements humains en font l’expérience. Le christianisme le lie sans ambages à l’être-homme et en dévoile les racines profondes. Aux pharisiens et aux scribes conservateurs, qui reprochaient à ses disciples de manger sans s’être au préalable lavé les mains, le Christ avait répondu : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme ; mais ce qui sort de la bouche, c’est ce qui souille l’homme. […]. Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies »[11].
Par cette déclaration, le Messie lève les yeux de ses auditeurs vers le ciel. Il refuse d’atteler sa mission rédemptrice aux pesanteurs, certes utiles mais éphémères, des traditions humaines ou des besoins d’hygiène corporelle. Il prône la santé de l’âme et non pas du corps. Il les invite, comme Socrate face aux Athéniens, à donner des soins à leurs âmes.
Par elle aussi, il leur signifie qu’une vie déréglée n’est que la manifestation d’une dissolution intérieure. Le mal, le vice, la perversion, et toutes les avancées du désordre moral sont sans doute manifestes, et affectent le corps social. Mais ils ne sont que des témoins d’un désordre primaire dont la trame se tisse dans les profondeurs invisibles du psychisme.
Le mérite scientifique de Platon et du Christ, ici, c’est d’avoir compris le désordre par ses causes ou par ses origines. C’est de l’avoir perçu comme l’extériorisation d’un état d’âme. Par là, ils posent un fondement épistémologique sur lequel bâtira Bergson lorsqu’il cherchera à en cerner l’essence.
2. L’avancée bergsonienne face à l’essence travestie du désordre
Dans L’évolution créatrice[12], tout comme dans La Pensée et le Mouvant[13], Bergson donne à la réflexion sur l’ordre et le désordre une véritable chiquenaude. Il observe que les scientifiques et les philosophes ne les ont vus que partiellement. Car il existe deux espèces d’ordre : l’ordre « vital », et l’ordre « géométrique », l’ordre dont nous saisissons la réalité dans l’expérience intérieure, et celui qu’offre l’espace vital. Mais au premier, les scientifiques sont restés aveugles, sourds et muets. Leur pensée, mécanique, a spatialisé l’ordre. Aussi ne peuvent-ils s’élever à la conscience que ce qu’ils appellent de ce nom n’est qu’une fabrication de leur intelligence, un artifice opératoire au service d’une finalité.
Contrairement aux hommes de science, les philosophes se sont toujours gardés de cette fascination de l’ordre spatial, mais à l’hallucination du désordre, ils n’ont pu résister. Admettant « qu’il pourrait ne pas y avoir d’ordre du tout »[14], le réaliste et l’idéaliste confirment, l’un et l’autre, cette hallucination, « le réaliste quand il parle de la réglementation que les lois ‘’objectives’’ imposent effectivement à un désordre possible de la nature, l’idéaliste quand il suppose une ‘’diversité sensible’’ qui se coordonnerait »17. Ils ont ainsi ouvert, dans la théorie de la connaissance, une carrière prospère à ce concept malheureux en supposant un désordre sous-jacent à l’ordre. Or, le désordre, pense Bergson, n’est ni le socle ni le substrat de l’ordre. Il suppose un ailleurs latent, un ordre vécu par la conscience, et non mécanique. Entre cet ordre vital et cet ordre mécanique, l’esprit humain oscille selon ses intérêts. Et lorsque, cherchant l’un, il trouve l’autre, on parle de désordre.
Ainsi, le désordre n’est, en réalité, qu’une « entité verbale »[15]. Comme les concepts de néant et de rien[16], il n’est pas dans les choses. Il n’a pas d’existence objective, absolue. C’est seulement par rapport à une intention, à un usage, qu’on parlera de désordre. Une salle de classe, par exemple, n’est en désordre que relativement à l’usage qu’on souhaite en faire. Il en va de même de l’ordre : il n’est pas dans les choses, mais dans l’intention humaine, dans le rapport humain aux choses. C’est pourquoi Bergson considère l’ordre comme une satisfaction et le désordre comme une déception de l’esprit, comme la déception d’un esprit qui trouve devant soi un ordre différent de celui dont il a besoin. Et les termes du philosophe sont sans équivoque : « D’une manière générale, la réalité est ordonnée dans l’exacte mesure où elle satisfait notre pensée. L’ordre est donc un certain accord entre le sujet et l’objet. C’est l’esprit se retrouvant dans les choses »[17].
Le désordre n’est donc pas une absence totale d’ordre. Il est un type de relation que la conscience entretient avec son objet. Il est un autre genre d’ordre, mais un ordre qui rebute la conscience désireuse. On parle de désordre quand l’ordre trouvé ne correspond pas à nos attentes ; et on parle d’ordre quand il est celui que l’on souhaitait rencontrer. Le concept de désordre est donc aussi positif que celui d’ordre. Et si on tient à en saisir vraiment l’essence, le désordre est « un ordre différent »[18]de celui dont on a besoin. Il est « simplement l’ordre que nous ne cherchons pas »[19]. On le comprend aisément quand il nous arrive de chercher à substituer à un ordre donné, à un ordre « de l’inertie et de l’automatique », un ordre voulu, un ordre « du vital ou du voulu »[20].
Dès lors, appliquer à la nature les idées d’ordre et de désordre comme Romain Rolland dans Au-dessus de la mêlée[21], relèverait de l’anthropomorphisme. Il n’y a pas de désordre naturel, il n’y a que des états naturels. Le chaos originel est celui de la théogonie d’Hésiode ou des Grecs. L’entropie qui angoisse ou dont on redoute les avancées effroyables et irrémédiables, est celle de la conscience en quête de néguentropie face à la mort programmée de l’univers, désormais comprise grâce aux progrès des sciences physiques, et surtout, grâce au second principe de la thermodynamique[22]. Les cataclysmes, les déserts, les volcans, les inondations, les sécheresses, les éclipses, les géocroiseurs, les pathologies, les dysfonctionnements organiques, etc., sont ceux d’un esprit qui redoute un ordre de la nature qui lui est inhabituel et qu’il a à intégrer.
De même, le désordre, lorsqu’il affecte la vie morale, politique, économique, sociale ou autre, n’est que celui d’un esprit qui désire autre chose que ce que lui offrent ces cadres. Il n’est pas ontologique. Il n’est ni en soi ni pour soi. Il est un concept négatif, une non-valeur, une dimension répugnante de l’être. Son contraire, l’ordre, est une valeur, un référent normatif qui peut être collectif ou individuel. Comme le bien et le mal, le beau et le laid, comme la vertu, il est fonction de l’espace et du temps, des besoins et des attentes, et ne saurait ignorer les luttes de classes, de sociétés ou d’intérêts. Il est par rapport à une conscience mue par des intérêts manifestes ou latents, et ne peut échapper à la loi de la relativité.
C’est pourquoi, si l’humanité doit évoluer, l’ordre ne doit être ni transcendant, ni hégémonique, ni immuable. Il doit pouvoir s’adapter au cours changeant de l’histoire, aux aspirations nouvelles des sociétés. Et cette adaptation exige qu’il intègre l’altérité, qu’il admette en son sein la contradiction, le passage dialectique du soi au non-soi, au désordre.
II. La dialectique du désordre et du progrès
Il n’y a pas de progrès sans désordre. C’est par cette formule que se comprend la dialectique du désordre et du progrès. Car lorsqu’il est, le désordre signifie que l’ordre est devenu caduc, et se donne comme promesse d’un mieux-être. Et parce qu’il est promesse d’une réalité supérieure, il regimbe à l’image négative qu’on s’est forgée de lui. Il suggère qu’à côté de celle-ci, il y a ce qui n’est pas elle, ce qui la transcende et la soupçonne d’impérialisme, il y a une valeur dont on ne peut nier l’existence.
1. L’ambivalence du désordre dans la quête du progrès
Dans son article intitulé ‘’Vie et temps : dialectique de l’ordre et du désordre’’, Jean-Yves Heurtebise a dépouillé le désordre de la tunique de la négativité, pour le revêtir de celle de l’esthétique. L’opposant à l’ordre dans la dynamique du progrès, il a vu en lui le mode opératoires de toute évolution. Pour lui, en effet, l’ordre et le progrès sont dans une relation d’antinomie absolue. Ils « ne peuvent aller ensemble, ils appartiennent à deux systèmes de pensée trop distincts […] le règne du Progrès est forcément un règne du Désordre »[23].
Non sensibles à cette réalité, les penseurs du début du XIXe siècle, comme Hegel et Comte, ont voulu concilier ce qui répugne à toute conciliation. Ils ont voulu célébrer le progrès messianique d’un siècle naissant en l’amarrant aux pieux asservissants d’un siècle acquis à l’apologie de l’ordre. Aussi durent-ils soumettre le développement phylogénétique et ontogénétique du réel, et même le flux du devenir universel, à une finalité. Et si le progrès suppose le désordre, il importe de voir luire, sous le voile de l’image négative qu’on s’est forgée du désordre, la chandelle de la positivité et tout au moins de l’ambivalence. Il n’est certes pas le mode parfait de l’être soustrait à toute incongruité. Mais il n’est pas non plus l’absolu négatif dont on n’a que faire.
La loi essentielle de l’être-au-monde est celle du dualisme de l’être et du non-être, du bien et du mal, du positif et du négatif. Tout se passe comme si chaque être avait lui aussi mangé le fruit défendu, et était condamné à connaître le bien et le mal. Et le désordre n’en est pas exonéré. À lui aussi s’applique l’adage : ‘’Chaque médaille a son revers’’.
Littéralement, cette maxime populaire signifie qu’il n’y a pas de médaille sans revers, pour dire qu’à chaque chose ses qualités, mais aussi ses défauts. Mais limitons-nous à ce sens littéral et laissons la réflexion aller à ses conséquences les plus immédiates. On notera alors, aisément, que s’il n’y a pas de médaille sans revers, il n’y a pas non plus de médaille sans envers. Autrement dit, tout porte en soi la marque du bien et du mal, du positif et du négatif. La dynamique des mutations sociales, des sciences et des techniques, des systèmes politiques et économiques, met en relief cette ambivalence ontologique du désordre.
L’évolution humaine est polymorphe et polysémique. Cette pluralité souterraine, qui traverse son unité apparente, détermine son image cognitive et ouvre la voie à une divergence idéologique ou à une discordance des esprits soucieux de la soustraire aux apparences qui abusent. Ainsi Comte la soumet aux âges théologique, métaphysique, et positif[24]. Claude Bernard observe se succéder, dans l’histoire du penser, « le métaphysicien, le scolastique et l’expérimentateur »[25]pour conclure que « l’esprit humain, aux diverses périodes de son évolution, a passé successivement par le sentiment, la raison et l’expérience »[26]. Hegel distingue trois niveaux de progression dans la compréhension humaine : l’art, la religion et la philosophie[27].
Dans chacun de ces cas, évoluer, pour l’humanité, c’est passer d’un ordre à un autre supposé plus apte à réaliser ou à améliorer son épanouissement. Mais ce passage, justement parce qu’il est passage, est négation. Il est la négation d’un ordre qui ne satisfait plus, au profit d’un autre que l’on souhaite et qui n’est pas. Il est dialectique au sens hégélien du terme. Il est désordre.
2. La contradiction surmontée comme moteur des sciences
On reconnaît à la techno-science ses progrès spectaculaires et ses résultats étonnants. Mais l’histoire des sciences, c’est aussi celle de ses crises, de ses contradictions et de ses efforts pour les surmonter. Dans La philosophie du non, Bachelard révèle que « la connaissance cohérente est un produit non pas de la raison architectonique (qui consiste à coordonner les divers éléments d’un système), mais de la raison polémique »[28]. Avec lui, la destruction devient une opération et une valeur scientifiques. Car « en détruisant ses images premières, la pensée scientifique découvre ses lois organiques. On révèle le noumène en dialectisant un à un tous les principes du phénomène »32.
Par ailleurs, Claude Bernard note que l’esprit scientifique n’est pas inné et que l’explication scientifique des phénomènes n’est pas spontanée. Elle n’est pas a priori mais a posteriori. Ce qui est spontané, au contraire, c’est l’anthropomorphisme ou la tendance à voir le monde non pas comme il est, mais plutôt comme nous sommes. Mais le rôle de la science est de substituer à ce pseudo-savoir la connaissance expérimentale :
« Chaque homme se fait de prime abord des idées sur ce qu’il voit, et il est porté à interpréter les phénomènes de la nature par anticipation, avant de les connaître par expérience. Cette tendance est spontanée ; une idée préconçue a toujours été et sera toujours le premier élan d’un esprit investigateur. Mais la méthode expérimentale a pour objet de transformer cette conception a priori, fondée sur une intuition ou un sentiment vague des choses, en une interprétation a posteriori établie sur l’étude expérimentale des phénomènes »[29].
Cette tendance aux idées préconçues, pense Claude Bernard, est métaphysique. L’homme est, par nature, un métaphysicien présomptueux. Il a pu croire que les fantasmes de son esprit représentent la réalité. « D’où il suit que la méthode expérimentale n’est point primitive et naturelle à l’homme, et que ce n’est qu’après avoir erré longtemps dans les discussions théologiques et scolastiques qu’il a fini par reconnaître la stérilité de ses efforts dans cette voie »[30].
Et l’esprit, même devenu scientifique, n’est pas à l’abri des faux savoirs. « Chaque temps a sa somme d’erreurs et de vérités »[31], chaque science aussi. Car les théories scientifiques sont loin de représenter des vérités immuables. Lorsqu’une apparaît, la seule certitude qu’elle porte en soi est qu’elle est fausse absolument parlant. Elle n’est qu’une vérité partielle et provisoire qui, comme un degré, est nécessaire pour avancer dans l’investigation, mais ne représente que l’état actuel des connaissances et devra, par conséquent, se modifier avec leur progrès. Mieux, « ces théories et ces idées n’étant point la vérité immuable, il faut être toujours prêt à les abandonner, à les modifier ou à les changer dès qu’elles ne représentent plus la réalité »36.
Abandonner des théories, les modifier ou les changer, pour faire place à des théories plus pertinentes, c’est introduire en elles le moment dialectique de la contradiction, de la négation. Mais l’humanité scientifique n’est pas toujours prête à admettre cette négation. Au nom de son ordre qu’elle veut immuable, elle mobilise contre elle ses mécanismes de maintien de l’ordre. Ainsi, Giordano Bruno expira sur le bucher des vivants, le 17 février 1600 à Rome, au terme de huit ans de procès, pour avoir substitué à la conception aristotélicienne d’un monde clos, celle d’un monde infini. De même, Galilée, au XVIIe siècle, fut condamné à la réclusion pour avoir soutenu les thèses héliocentriques de Copernic.
Ces exemples montrent que la vérité n’est pas toujours celle de l’autorité ni celle du plus grand nombre. L’autorité, en matière de connaissance, ne lui donne d’autres critères qu’elle-même. Les majorités, pour leur part, étouffent les minorités et les en excluent. Légitimée par la démocratie, aujourd’hui posée comme l’idéal des systèmes politiques, cette dictature du plus grand nombre considère toute tentative de secouer son joug comme un désordre, et peut être une entrave au progrès scientifique.
Enfin, l’ordre n’est pas qu’épistémologique. Il est aussi social. Et sous cette détermination, il peut être celui des forts, et partant, un ordre prédéfini, intéressé, injuste, aliénant et révoltant. Mais quand l’ordre devient injuste ou aliénant, le désordre ne constitue-t-il pas un commencement de justice ? En introduisant dans un tel ordre la contradiction ou le déchirement, ne chemine-t-on pas vers des sphères plus élevées ?
3. Le désordre sociopolitique ou le progrès par l’absurde
Comme les sciences, le corps social n’évolue qu’au moyen de la contradiction surmontée. Il la vit et en saisit la force motrice pour donner forme à ses mutations. Car il comprend que pour s’accomplir, il doit se nier. Que le progrès social intègre donc le moment redouté du désordre, voilà un des principes que la dynamique sociale ne peut tenir pour superflu. Au contraire, elle le pose comme un moment primordial de soi.
Cela, la dialectique hégélienne l’a éminemment compris, elle qui, à la postérité, l’a laissé comme une leçon d’écolier. Pour Hegel, on le sait, l’Esprit absolu, c’est-à-dire la totalité du réel, évolue selon la logique dialectique vers une fin au sens de but ultime et de destination. Et cette fin est la réalisation complète de l’Esprit où l’Absolu se saisit lui-même comme Absolu, où il est semblable au cercle, c’est-à-dire, à la ligne droite qui a réussi à se rejoindre elle-même, entièrement fermée, sans commencement ni fin[32]. La méthode dialectique, quant à elle, a pour banc d’essai la nature et se saisit dans l’image de la fleur qui résulte de la négation du bourgeon, et dont la négation produit le fruit :
« Le bouton disparaît dans l’éclatement de la floraison, et on pourrait dire que le bouton est réfuté par la fleur. A l’apparition du fruit, également, la fleur est dénoncée comme un faux être-là de la plante, et le fruit s’introduit à la place de la fleur comme sa vérité. Ces formes ne sont pas seulement distinctes, mais encore chacune refoule l’autre, parce qu’elles sont mutuellement incompatibles. Mais en même temps leur nature fluide en fait des moments de l’unité organique dans laquelle elles ne se repoussent pas seulement, mais dans laquelle l’une est aussi nécessaire que l’autre, et cette égale nécessité constitue seule la vie du tout »38.
Analysant cette image botanique, on a mis en avant les schèmes de thèse, d’antithèse, et de synthèse. Quoique Hegel s’en soit gardé, on n’hésite pas à les utiliser pour comprendre ou faire comprendre le concept de dialectique. Aussi explique-t-on que la thèse pourrait être une idée ou un mouvement historique. Cette idée, ou plutôt, ce mouvement, n’est pas parfait. Il renferme au contraire un certain inachèvement. Cet inachèvement donne naissance à une idée ou à un mouvement qui s’oppose à l’idée ou au mouvement de départ. C’est l’antithèse. De ce conflit naît une troisième idée ou un troisième mouvement qui surmonte le conflit et relève, à un niveau supérieur, la vérité contenue à la fois dans la thèse et dans l’antithèse. C’est la synthèse. L’évolution se poursuivant, cette synthèse devient, à son tour, une thèse qui génère une nouvelle antithèse qui donne lieu à une autre synthèse. Et c’est ainsi que se réalise continuellement le développement intellectuel ou historique.
De ce fait, une société qui refuserait la contradiction, refuserait le progrès. La psychologie moderne, avec ses théories de la dynamique des groupes, a suffisamment mis en lumière le rôle des minorités hétérodoxes qui, en refusant le statu quo et en aspirant à des ordres nouveaux, entraînent le changement par opposition aux majorités orthodoxes qui, conservatrices, freinent le progrès du groupe.
À la vérité, les grands hommes ne sont pas ceux qui se logent rigidement dans le moule de leur société, mais ceux qui secouent le joug des dogmes et des prêt-à-penser. Ce sont « précisément ceux qui ont apporté des idées nouvelles et détruit des erreurs. Ils n’ont donc pas respecté eux-mêmes l’autorité de leurs prédécesseurs, et ils n’entendent pas qu’on agisse autrement envers eux »[33]. Pour passer de l’explication religieuse du monde à son explication métaphysique, puis scientifique, ou de l’art à la religion, et de la religion à la philosophie, il a fallu des esprits non-conformistes. Et en fait, l’humanité, en quête de mieux-être, ne conquiert des espaces nouveaux qu’avec des hommes qui refusent de se laisser charrier par son flux, qu’avec des hommes qui la suspectent et lui résistent, à l’image de Socrate, d’Antigone, de Mandela, et du général De Gaulle.
Dans une Athènes obnubilée par la quête des honneurs, le mépris de la vertu, les plaisirs du corps, et en particulier la pédérastie, Socrate voulait un ordre nouveau qui conserve à l’homme sa dignité et sa noblesse. Il enseignait à tous, et gratuitement, par opposition aux sophistes qui faisaient école et autorité, les normes de la raison génératrice de la vertu et du savoir vrai. Mais Athènes y a fermé les yeux et les oreilles.
Contre l’édit de Créon ou contre sa société, Antigone donne une sépulture à son frère Polynice et est enterrée vivante[34]. En 1940 le général De Gaulle refuse l’armistice et part pour Londres d’où il lance l’appel du 18 Juin 1940. Les Français ne l’ont véritablement compris qu’en 1945. En Afrique du Sud, Nelson Mandela s’oppose à l’apartheid et passe plus d’un quart de siècle en prison : arrêté le 5 août 1962, il ne fut libéré qu’en février 1990.
Mais le désordre social positif n’est pas seulement le fait d’individualités éclairées et isolées. Il peut être celui d’une collectivité ou d’un groupe prenant conscience de la nécessité d’un ordre nouveau. La Révolution française de 1789 mit fin à la royauté, institua la Première République et engendra la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Celle de 1848 tua la Monarchie de Juillet et créa la Deuxième République. En Afrique, des États sont confrontés à la sédition, aux mouvements de rue, aux mutineries et aux soulèvements de tous genres, parce que les populations excédées réclament plus de liberté, de justice et de mieux-être.
Les manifestations de rue qui mirent fin à l’apartheid, en Afrique du Sud, furent réprimées au nom de l’ordre. Pourtant c’était là la naissance d’une société multiraciale et démocratique. La marche des femmes d’Abobo, le 3 mars 2011, contre le pouvoir illégitime de Gbagbo, en Côte d’Ivoire, s’acheva dans le sang au nom de l’ordre. À cet ordre pourtant, il fallait celui de la liberté politique. En Tunisie, en Égypte, en Lybie, en Syrie et au Yémen, pour ne citer que ces cas, les forces de l’ordre se battent contre des populations déchaînées qui aspirent à un ordre différent.
Par ces manifestations que les politiques tentent d’étouffer, au nom de l’ordre public, de leur ordre, des peuples entiers réclament ce que Hegel appelait la liberté politique. Ainsi, ces manifestations signifient que la notion d’ordre ne peut être séparée de celle de légitimité, de morale. Elles signifient que quand l’ordre se nourrit du sang du peuple, il faut lui préférer le désordre qui, en tant que ‘’dé-ordre’’, anarchie, est le tremplin à un ordre nouveau.
Au total, le désordre n’est pas que négativité, il est aussi positivité. Lorsqu’il est la réaction d’une conscience éclairée qui récuse l’obscurantisme d’une tradition qui n’a d’autres arguments que son autorité, ou lorsqu’il exprime le ras le bol d’une collectivité qui réclame un mieux-être, il revêt le sceau du positif et conforte souvent la dynamique de la mode.
Phénomène social sans cesse mouvant, la mode est le refus du traditionnel, du classique. Elle voit le monde autrement et veut un rapport nouveau avec lui. Elle pense que la société a tort de rester ce qu’elle est, et lui propose une réalité autre. Généralement promue par les jeunes, elle mène souvent au désordre et aux conflits de générations. Car aux valeurs des anciens qui exaltent le rétroviseur de la vie, les générations montantes préfèrent celles d’aujourd’hui et hâtent celles de demain. Et toute société qui étoufferait le flux de la mode au profit du reflux du passé se condamnerait à l’inertie et à l’immobilisme stérile.
Ainsi, la loi du désordre semble plus forte que celle de l’ordre. Dans la société comme dans la nature, tout se passe comme s’il y avait une téléologie inexorable ou une eschatologie subtile du désordre. Et l’être humain se trouve englué dans le flux de cette eschatologie.
III. L’optique eschatologique du désordre
Les philosophies de l’histoire ont vu dans le processus historique le cheminement de l’univers vers une fin. Cette fin, pense Comte, est l’âge positif, quand, pour Hegel, elle est la réalisation complète de l’Esprit ; et pour Marx, la société communiste. Mais si l’univers peut avoir une fin, il n’est pas exclu que celle-ci soit le désordre. Car il semble tributaire d’une programmation téléologique dont ce dernier apparaît comme l’inévitable aboutissement.
1. Un univers programmé et condamné au désordre
Le déterminisme des sciences physiques a ouvert la voie à l’idée d’un monde programmé. La théorie de la relativité générale d’Einstein y contribua particulièrement. Théorie qui améliora celle de la gravitation universelle de Newton, en la reformulant dans le contexte de l’espacetemps, celle-ci avance en effet que l’Univers, dans son ensemble, tient en quelques formules[35]. D’après Christian Magnan, le Père Pierre Teilhard de
Chardin avancera aussi que l’univers est programmé, mais précisera qu’il est programmé pour faire émerger l’homme[36]. Les astrophysiciens des années 60, avec leur « principe anthropique », pensaient que les conditions d’apparition de l’univers ont été spécialement choisies pour conduire de façon sûre le monde à la vie. La découverte de l’ADN a renchéri ce point de vue en faisant dire aux biologistes que nous sommes irréversiblement programmés par notre code génétique.
Certes, aujourd’hui, la reprogrammation consciente de l’ADN semble désormais faire partie de nos possibilités. Déjà des compagnies pharmaceutiques tentent de s’approprier notre code génétique à cette fin[37]. Mais ces nouvelles avancées ne nient pas la programmation. Elles donnent lieu à une reprogrammation et non à une absence de programme. Elles signifient que notre ADN est comme un ordinateur très puissant, contenant des milliers de programmes parmi lesquels le choix reste
possible[38].
La question de l’auteur de cette programmation est polémique et ne prime pas ici. On observera, cependant, que pour les Grecs anciens, au commencement était Chaos, gouffre sombre et silencieux. Chaos, engendra Nyx ou la Nuit et Érèbe ou la région insondable des Enfers. Ces deux enfants s’unirent ensuite pour créer l’Éther et le Jour. Vinrent ensuite Gaia, la Terre, puis Éros, l’amour. Parmi les nombreux enfants de Gaia, se trouve Ouranos, le Ciel-Père, qu’elle conçut « sans l’aide d’un principe mâle »[39], puis auquel elle s’unit pour engendrer les Géants et les Titans. Cronos, l’un des Titans s’unit à sa sœur Rhéa et engendra les premiers dieux que sont Zeus et Héra. Le premier homme, quant à lui, fut formé dans l’argile par Prométhée, fils du Titan Japet et d’une Océanide.
De nombreux récits cosmogoniques, et singulièrement le texte biblique de la création, décrivent aussi en termes de chaos, l’origine de toutes choses. Même en concevant un Dieu créateur, ils n’admettent pas moins l’idée d’un tohu-bohu comme forme initiale de l’univers : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux »[40].
La science moderne, enfin, ne semble pas rompre avec cette idée de chaos originel. Pour elle, l’être proviendrait d’une nébuleuse ou d’un big bang qui ne sont pas mieux organisés que le chaos des mythes et des religions. Et si, à l’origine, était le chaos, un chaos se trouverait aussi à la fin, idée que la science, encore, relaie et solidifie.
S’opposant à la théorie de l’évolution de Darwin, Nigel Kerner introduit, en science, le concept de dévolution. Il montre que les lois darwiniennes, même modernisées par les dernières découvertes, sont tout à fait inaptes à expliquer le monde. La preuve de cette inaptitude, c’est la présence, dans notre patrimoine génétique, d’anomalies que l’hypothèse évolutionniste, si elle avait été valide, aurait dû effacer. En effet, une grande partie du code de notre ADN semble inutile et est appelée, pour cela, ADN poubelle, ou Junk ADN. Pourquoi, se demande Kerner, ce code inutile a-t-il survécu au processus de l’évolution ? L’évolution serait-elle si paresseuse qu’elle n’effacerait pas les programmes superflus ?
À cette interrogation, Kerner répond par la négative, et estime plutôt que tous les organismes vivants ont dévolué vers leur état actuel à partir d’états plus sophistiqués. Dans un monde entropique, tout a tendance à se dégrader, à être déformé par la loi de l’entropie. Et les codes inutiles de notre ADN ne proviendraient que de cette dégradation[41]. Par conséquent, la réalité de la vie serait celle de la dévolution qui doit se comprendre comme une régression, comme une sorte de décadence évolutive.
Avec cette théorie dont les preuves restent à renforcer, ou même à établir, Kerner ouvre une nouvelle ère du soupçon. Il porte un regard nouveau sur l’histoire des espèces biologiques, et en particulier de l’humanité. Il l’a vue sous une lumière qui, si elle est confirmée, sonnera le glas de nombre de nos théories. Il nous invite à l’observer désormais, comme lui, et à réaliser que ce sont les primates qui descendent de l’homme et non l’inverse. On peut décliner une telle invitation, mais ce qui nous suivra encore longtemps, c’est l’idée d’un monde programmé à objectiver un désordre qui lui est consubstantiel.
2. Le désordre, un pan de l’être-au-monde
Nous avons assez mis en lumière le caractère imaginaire, ou tout au moins relatif, du désordre. Néanmoins, puisqu’on le pose encore comme une réalité objective, et pour mieux le saisir comme concept galvaudé, considérons-le en tant que réalité, et regardons-le en face. Pour ce faire, observons-le, principalement, dans la nature.
Le désordre naturel, ce qu’on appelle de ce nom, est un pan de l’être-au-monde, un mode d’être aussi positif que l’ordre. Il n’est pas absence d’ordre ni négation d’ordre. Il est tout simplement un autre ordre. C’est un mode de rangement au même titre que l’ordre. Ainsi, il est, et on ne peut faire qu’il ne soit pas. Être, c’est être à la fois ordre et désordre.
Dans La veuve[42], Corneille l’avait bien compris, quand il notait que le monde est un chaos, et que son désordre excède tout ce qu’on y voudrait apporter de remède. Et si ce désordre est sans remède, c’est parce qu’il est téléologique. Il fait partie des fins inconscientes et inavouées de l’être. Un désordre programmé semble, en effet, lié à notre univers. Sorti du chaos, il semble s’acheminer inexorablement vers le chaos. Car, comme l’avait déjà compris Platon, « tout ce qui naît est sujet à la corruption »[43].
Jacques Attali relève que le désordre est l’état naturel du monde, et que c’est sa forme organisée qui est l’exception50. Les sciences actuelles le constatent et se contentent de nous conseiller la résignation. Le second principe de la thermodynamique, on l’a vu, stipule que l’évolution d’un système isolé se fera toujours dans le sens de l’augmentation de l’entropie, c’est-à-dire vers un état de désordre maximal. Et lorsqu’un système a atteint cet état, il retrouve son état d’équilibre. Or l’univers tend vers un état d’équilibre énergétique parfait. Il tend donc vers un chaos total qui sera sa mort thermique[44].
Par ailleurs, Georges Alvarado Planas note, à juste titre, que depuis toujours, l’homme a observé le cosmos avec une profonde admiration, en supposant qu’il est régi selon des lois préétablies. Aujourd’hui encore, on l’imagine dans une harmonie impassible. Mais en réalité, une grande partie de la nature est envahie par le désordre. Car partout, ce sont des systèmes dynamiques de type chaotique, désordonné et imprévisible qu’on observe.
Les sciences physiques des deux dernières décennies l’ont admis et confirmé. Elles ont même enregistré l’avènement d’une nouvelle branche, la physique du chaos, spécialisée dans l’étude des systèmes naturels qui n’obéissent pas aux équations de type linéaire. Avec celle-ci, l’existence, dans l’univers, de nouveaux facteurs de désordre ne fait plus de doute[45].
Conclusion
L’odyssée du penser, qui s’achève ici, a tenté de s’émanciper des catéchismes idéologiques et des dogmes simplificateurs, dans lesquels les panégyristes de l’ordre, ont toujours cloisonné le désordre. Elle a tenté de secouer le joug pour rechercher, avec Jean-Pierre Dupuy, un nouveau paradigme, une pensée neuve. Mais le paradigme, ici, n’est pas celui des libertins mus par des inclinations mal maîtrisées, ni celui des anarchistes las de la discipline sociale et regimbant contre tout principe de l’autorité, ni celui des utopistes en rupture avec l’ici-maintenant. Il est celui du penser qui veut être pleinement penser.
Platon observait que nul n’est méchant volontairement[46], que seule l’ignorance fonde le mal. Le vice, l’injustice, l’intolérance, la tyrannie, les crimes et toutes les formes d’atteintes à la vertu procèdent de l’ignorance du bien. De ce point de vue, tout non-savoir est une infortune potentielle. Et le désordre n’est pas à l’abri d’un tel possible. Il faut donc soustraire l’esprit à l’ignorance de sa réalité ontologique, si les maux qu’elle peut induire doivent s’épuiser dans les simples possibilités.
Son ontologie nous l’a révélé comme un mal-connu à connaître et comme un incompris à comprendre. En effet, on l’oppose, par nature, à l’ordre qui est organisation et creuset de sens, mais il est un autre ordre dont la nécessité nous échappe encore. On l’oppose aussi à l’ordre qui éduque, construit et épanouit, mais tout progrès le suppose comme un moment de soi. On le considère, enfin, comme ce qui reste quand l’ordre n’est plus, mais il semble au début et à la fin de toutes choses. L’univers entier, l’évolution phylogénétique et ontogénétique, celle des sciences et de la société, semblent englués dans une téléologie dont il est à la fois le but et le terme.
Au total, le désordre est une forme de l’être. Comme le mal et le bien, comme le vrai et le faux, il est fondamentalement une valeur que notre esprit attribue aux choses, mais une valeur qu’il redoute lorsque celles-ci contrarient sa logique d’intérêt. Et comme toute valeur, il est essentiellement relatif. Aussi, avec lui, faut-il encore un esprit philosophique, une attitude d’analyse, de discernement et de tolérance.
Bibliographie
- ATTALI, Jacques, Lignes d’horizon, Paris, Édition Fayard, 1990.
- ALVARADO, Planas Georges, ‘’L’esthétique du chaos’’, in Nouvelle Acropole, 2009.
- ANOUILH, Jean, Antigone, Poitiers, Éd. de La Table Ronde, 1982.
- BACHELARD, Gaston, La philosophie du non, Paris, PUF, 1940.
- BAUDELAIRE, Charles, Les Fleurs du Mal, Paris, L’École des Lettres, Le Seuil, 1993.
- BERNARD, Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, GF, 1966.
- BERGSON, Henri, La Pensée et le Mouvant, Paris, PUF, 1969.
- BERGSON, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1982.
- COMTE, Auguste, Cours de philosophie positive, in La science sociale, Paris, Gallimard, 1972.
- CORNEILLE, Pierre, La veuve in Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1963.
- DUPUY, Jean-Pierre, Ordres et désordres : enquête sur un nouveau paradigme, Paris, Seuil, 1990.
- GRANT, H., Dictionnaire de la mythologie, Paris, Marabout, 1984.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La phénoménologie de l’esprit, tome I, Paris, Aubier Montaigne, 1941, trad. Jean Hyppolite.
- HEURTEBISE, Jean-Yves, ‘’Vie et temps : dialectique de l’ordre et du désordre’’, in Colloque “La vie et le Temps”, [en ligne]. Disponible sur le site Web : www.sciences-occultes.org.
- La Bible, traduite sur les textes originaux hébreux et grecs par Louis Segond, docteur en théologie, version revue, Berne, Éditions La Société Biblique de Genève, 1975.
- MACHIAVEL, Nicolas, Le Prince, Paris, Éditions Fernand Nathan, 1982.
- MAGNAN, Christian, Et Newton croqua la pomme, Paris, Éditions Belfond, 1990.
- PLATON, Le Banquet, Phèdre, Paris, GF, 1964, trad. Émile Chambry.
- PLATON, La République, Paris, GF, 1966, trad. Robert Baccou.
- PLATON, Protagoras, Paris, GF, 1967, trad. Émile Chambry.
- Revue l’Initiation, Mars-Avril, 2008.
- Revue Karmapolis, [en ligne], URL : www.sciences-occultes.org.
- ROLLAND, Romain, Au-dessus de la mêlée, Paris, Albin Michel, 1932.
LA JUSTICE COMME PRINCIPE DE LA PAIX CHEZ PLATON
Jean Foly Koblan KOSSI
Maître-Assistant
École Normale Supérieure d’Abidjan-Côte d’Ivoire
Résumé : La justice, selon le commun des mortels, consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû ; pour les plus téméraires, elle traduit l’avantage des plus forts. Platon rejette ces conceptions, et admet que la justice consiste, pour chaque citoyen, à accomplir uniquement la fonction pour laquelle il est naturellement fait. La justice est ainsi le principe assurant l’harmonie et la paix du citoyen et de la cité tandis que l’injustice ruine l’individu et détruit le corps politique et social.
Mots clés : Commun des mortels, Destruction, Fonction naturelle, Harmonie, Injustice, Justice, Paix, Platon, Principe.
Abstract: For the common run of mankind, justice consists in returning to the individual what is owed to him; for the most daring, it expresses the dominance of the strongest. Plato rejects these concepts, and admits that for every citizen, justice consists exclusively in achieving the function for which man is naturally made. Justice is therefore the principle ensuring the harmony and the peace of the citizen and the city, whereas injustice ruins the individual and destroys the political and social body.
Key words: Common of the mortals, Destruction, Harmony, Injustice,
Justice, Natural function, Peace, Plato, Principle
« Le plus grand méfait que l’on puisse commettre à l’égard de sa propre cité, c’est l’injustice »[47].
Introduction
Les prédécesseurs de Platon étaient avant tout des penseurs tragiques méditant sur la condition de l’homme face à la nature et face au destin. Mais Platon, quant à lui, a bien voulu réfléchir sur un autre aspect tragique de la condition de l’homme dans la cité : la condamnation à mort de Socrate, provenant, selon lui, d’une injustice de ses concitoyens. Ainsi, s’il ya une tragédie de l’homme dans le monde, tragédie que plus d’un poète et plus d’un mythe racontent, il y a, avec Platon, une véritable tragédie de l’homme dans la cité. Et, cette tragédie de l’homme dans la cité ne doit pas être seulement perçue comme un drame qui se vit, mais plutôt et surtout comme un drame qui se dénonce parce qu’il résulte d’une ignorance et d’une mauvaise organisation de la cité. Platon écrit à ce sujet :
« Jadis dans ma jeunesse, […], J’avais le projet, du jour où je pourrais disposer de moi-même, d’aborder aussitôt la politique. Or voici en quel état s’offraient alors à moi les affaires du pays. La forme existante du gouvernement battue en brèche de divers côtés, […] cinquante et un citoyens furent établis comme chefs. […]. Je m’imaginais, en effet, qu’ils gouverneraient la ville en la ramenant des voies de l’injustice dans celle de la justice. […]. Or je vis ces hommes faire regretter en peu de temps l’ancien ordre des choses […]. Je fus indigné »[48].
Une situation historique intenable où triomphent dérisoirement et dans le désordre, corruption et injustice, mensonge et violence. Comment alors assumer une bonne organisation de la cité garantissant le bonheur aux citoyens ? Pour Platon, c’est uniquement en ramenant le gouvernement de la cité des voies de l’injustice dans celle de la justice. Seule la justice procure la paix et le bonheur. Comment donc Platon conçoit-il la justice, et à quelle nécessité répond-elle dans la quête du bonheur des citoyens ?
I. Ce que n’est pas la justice
A. La justice, c’est rendre à chacun ce qui lui est dû
La réflexion de Platon relative à la nature de la justice commence dans la première partie de la République[49]à partir d’ une conversation engagée sur le bonheur que goûte au déclin de la vie l’homme modéré dans ses désirs. Pour le vieillard Céphale, la possession de biens matériels a pour l’honnête homme d’incontestables avantages moraux.
Cette possession de biens matériels permet, premièrement de pratiquer la justice, ensuite elle permet de rendre aux dieux un culte décent. Aux yeux du vieillard Céphale, ce sont là les seuls moyens de bien vivre en ce monde et de le quitter avec une conscience pure.
Mais, interroge, Socrate, qu’est ce que cette justice qui met l’homme d’accord avec lui-même et avec les dieux ? La réponse du vieux Céphale indique que la justice est une vertu qui « consiste à dire la vérité et à rendre ce que l’on a reçu de quelqu’un »[50]. Pour approfondir cette définition évidemment superficielle, Polémarque5, le fils du vieillard Céphale, affirme que la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui convient, car c’est là précisément ce qui lui est dû. De la sorte, pratiquer la justice revient à faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis. Du point de vue de Platon, la justice est la vertu propre de l’homme. En conséquence, tout homme qui pratique la justice doit être toujours bon et ne nuire à personne, pas plus à son ennemi qu’à son ami.
La conception de Polémarque est donc incorrecte et la question de la définition de la nature de la justice reste toujours posée[51]. Surgit alors le sophiste Thrasymaque qui définit la justice en la rattachant à ce qui déterminerait, dans la cité, l’avantage du plus fort des citoyens au détriment des autres.
B. La justice, c’est l’avantage du plus fort
Thrasymaque, depuis un moment, s’impatiente d’intervenir dans ce dialogue. N’y tenant plus, il se lance dans la discussion, sous les regards effrayés de l’auditoire, tel un fauve dans un combat. Il donne sa définition de la justice et demande aussitôt à être loué pour cela.
« Ecoute donc, dit-il, à Socrate, j’affirme que le juste n’est autre chose que l’avantageux au plus fort. Eh bien ! Qu’attends-tu pour me louer ? Tu t’y refuseras ! «[52]Mais comment comprendre cette conception de la justice ? Thrasymaque l’explique en ces termes : « L’élément le plus fort, dans chaque cité, est le gouvernement. […]. Et chaque gouvernement établit les lois pour son propre avantage ; la démocratie, des lois démocratiques, la tyrannie, des lois tyranniques, et les autres de même ; ces lois établies, ils déclarent juste, pour les gouvernés, leur propre avantage, et punissent celui qui le transgresse comme violateur de la loi et coupable d’injustice. Voici donc, homme excellent, ce que j’affirme : dans toutes les cités le juste est une même chose : l’avantageux au gouvernement constitué ; or celui-ci est le plus fort, d’où il suit, pour tout homme qui raisonne bien, que partout le juste est une même chose : l’avantageux au plus fort »8.
Mais, demandera-t-on avec Socrate, les gouvernants, considérés par le sophiste Thrasymaque comme les citoyens les plus forts dans la cité, connaissent-ils de manière infaillible leur propre avantage ? Ne leur arrivent-il pas de se tromper souvent au sujet de ce qui serait leur avantage ? Il s’en faut de beaucoup. Dans ce cas, si les gouvernants ne sont pas infaillibles et qu’ils se trompent, les gouvernés n’en sont pas moins obligés d’obéir, autrement dit de coopérer à une action qui serait désavantageuse pour les plus forts que sont les gouvernants. La définition que Trasymaque donne de la justice se révèle donc contradictoire. Car, à parler avec rigueur, la justice n’est point ce qui se présenterait comme étant avantageux au plus fort des citoyens.
Ceci étant, l’on observe que le livre 1 de La République s’achève sans que la discussion inaugurale conduite sans ordre par Socrate ait abouti à un résultat positif. Deux digressions, en effet, ont éloigné les interlocuteurs de la question qu’à l’origine ils se proposaient de résoudre. Ils ont cherché à savoir si la justice est sagesse et vertu, et si elle est avantageuse ou non, de sorte que l’on ignore encore l’essentiel, c’est-à-dire la nature de la justice.
« Il me semble que j’ai fait comme les gourmands, qui se jettent avidement sur le plat qu’on leur présente, avant d’avoir suffisamment goûté du précédent, de même, avant d’avoir trouvé ce que nous cherchions au début, la nature de la justice, je me suis lancé dans une digression pour examiner si elle est vice ou ignorance ou sagesse ou vertu ; un autre propos étant survenu ensuite, à savoir si l’injustice est plus avantageuse que la justice, je n’ai pu m’empêcher d’aller de l’un à l’autre ; en sorte que le résultat de notre conversation est que je ne sais rien, car, ne sachant pas ce qu’est la justice »[53].
Toutefois, soucieux d’expliquer ce qu’est la justice, Glaucon et Adimante, deux disciples de Socrate, se chargent, dans une autre conversation, de reprendre et de développer les arguments de Thrasymaque. L’on découvre d’après leurs argumentations respectives que la justice est un bien que l’homme loue pour ses avantages, mais sans l’aimer lui-même.
C. La justice est un bien que l’on loue sans l’aimer
Dans son argumentation touchant la définition de la nature de la justice, Glaucon précise qu’il existe pour l’homme trois sortes de biens ; les uns que nous recherchons pour eux-mêmes, les autres pour euxmêmes et pour les avantages qui y sont attachés, les troisièmes enfin pour ces seuls avantages. Selon lui, l’opinion commune range la justice dans la troisième catégorie de biens à savoir les biens qui sont recherchés, non pour eux-mêmes, mais pour les seuls avantages qu’ils procurent10.
Poursuivant son argumentation sur l’origine et l’essence de la justice, Glaucon mentionne que du point de vue de l’opinion, la justice provient, d’une part, de l’impuissance où sont la plupart des hommes de commettre l’injustice, et d’autre part, de la peine qu’ils éprouvent à la subir. Ce qui fait que les lois de la cité, qui ont été établies à partir de ses deux sentiments, ne sont que de simples conventions ayant pour but de remédier à un état de choses nuisibles au plus grand nombre.
« Je devais t’exposer en premier lieu : quelle est la nature et l’origine de la justice. Les hommes prétendent que, par nature, il est bon de commettre l’injustice […]. Ceux qui ne peuvent point l’éviter […] estiment utile de s’entendre pour ne plus commettre ni subir l’injustice. De là prirent naissance les lois et les conventions, et l’on appela ce que prescrivait la loi légitime et juste. Voilà l’origine et l’essence de la justice : elle tient le milieu entre le plus grand bien, commettre impunément l’injustice, et le plus grand mal, la subir quand on est incapable de se venger. »[54]
Cependant, quelle que soit la gravité des sanctions que prévoient les lois pour châtier l’injustice, cette dernière n’en reste pas moins conforme à la nature. Ainsi, ceux qui peuvent commettre l’injustice sans danger ne s’en font jamais faute. Au fond, suivant cette conception traditionnelle que mentionne Glaucon, nul homme n’est juste volontairement. Ce qui signifie que l’homme est injuste naturellement. « Personne n’est juste volontairement, mais par contrainte, la justice n’étant pas un bien individuel, puisque celui qui se croit capable de commettre l’injustice la commet. Tout homme, en effet, pense que l’injustice est individuellement plus profitable que la justice. »12
L’homme injuste, ajoute Glaucon, réalise d’ailleurs le chef-d’œuvre de passer pour ce qu’il n’est point ; il peut ainsi jouir en toute sécurité des avantages de l’injustice, et bénéficier des honneurs réservés à la justice. Paradoxalement, ces honneurs, l’homme réellement juste ne les reçoit pas. Seul, en butte au dénigrement et à la haine, il avance dans la plus pénible des voies ; et parce que réellement il est le juste, on le traite en méchant accompli. Tandis que son contraire, l’injuste hypocrite, connaît toutes les félicités, lui, subit les pires ignominies, et, au terme de sa carrière, se voit condamner, comme un criminel, à d’atroces supplices[55].
Glaucon termine son propos en montrant l’infériorité de la justice vis-à-vis de l’injustice. Pour le soutenir, son frère Adimante intervient dans la conversation et se met à expliquer pourquoi la justice est louée pour la réputation qu’elle procure sans pourtant être aimée elle-même[56]. Selon lui, à tous ceux qui pratiquent la justice sont réservés ici bas le bonheur, la richesse et la prospérité ; de tels hommes sont les amis toujours favorisés des dieux, et après leur mort ils sont admis, chez Hadès, au banquet des saints, où, couronnés de fleurs, ils goûtent les délices d’une ivresse éternelle[57].
Adimante soutient son argumentation en faisant mention des plus anciens et plus prestigieux poètes de la Grèce antique, Homère et Hésiode qui, selon lui, avaient la même conception que celle de l’opinion. Adimante affirme que pour Homère et Hésiode, l’homme juste est récompensé jusque dans sa postérité[58], tandis que le méchant, l’injuste, est voué à des maux sans nombre.
Cependant, poursuit Adimante, si la pratique de la justice procure tous ces avantages, il convient de reconnaître que cette pratique de la justice est dure et pénible. « Examine, Socrate, une autre conception de la justice et de l’injustice développée par des particuliers et par les poètes. Tous, d’une seule voix, célèbrent comme belles la tempérance et la justice, mais ils les trouvent difficiles et pénibles »[59]. Pour pratiquer la justice, il faut absolument vaincre la nature humaine pour laquelle l’injustice est aisée puisqu’elle lui est inhérente. Au fond, ajoute Adimante, pour celui qui est assez habile et surtout puissant pour se ménager une entière impunité, il n’est tout à fait pas mauvais de commettre l’injustice ; car le plus important, c’est de pouvoir se soustraire aux châtiments prévus par les lois humaines et divines. Celui qui est capable de s’offrir une telle immunité, peut alors jouir en paix des profits de l’injustice et du renom de la justice.
Il faut dire avec Platon que toutes ces conceptions couramment énoncées lorsqu’il s’agit de présenter la nature de la justice restent de vagues conjectures, même si elles se parent de l’autorité de la tradition. Puisque nous devons dire ce que la justice est en elle même, ces conjectures vagues doivent donc être dépassées.
II. Ce que la justice est en elle-même
A. Que la notion de justice est complexe et difficile à saisir
Qu’est ce donc que la justice ? À vrai dire, la réponse à cette question, si simple en apparence, n’est pourtant pas toujours facile à déterminer. En effet, contrairement à ce que pensaient les interlocuteurs de Socrate (le vieillard Céphale, son fils Polémarque, le sophiste Trasymaque, Glaucon et Adimante), il est ressorti des différents exposés que ce n’est pas une chose aisée que d’arriver à une définition de la justice. Toute chose que confesse Socrate, lorsqu’il se propose de dire ce que la justice est en elle-même : « Je ne sais comment venir au secours de la justice. […] La recherche que nous entreprenons n’est pas de mince importance, mais demande, à mon avis, une vue pénétrante »[60].
Cela s’explique, pense Platon, par le fait que la notion de justice figure au rang d’un certain nombre de réalités abstraites et complexes dont la saisie est et reste difficile pour le commun des mortels. Il écrit ceci : « Il y a, ce me semble, une chose qui échappe au vulgaire, c’est que, pour certaines réalités, il y a des ressemblances naturelles qui tombent sous les sens et sont faciles à percevoir, […] ; mais qu’au contraire, pour les réalités les plus grandes et les plus précieuses, il n’existe pas d’image faite pour en donner aux hommes une idée claire. »[61]
Dès lors, il tombe sous le sens que la saisie de la nature de la justice est marquée par une difficulté qui, si elle n’est pas surmontée, constitue un obstacle majeur pour le commun des mortels en ce sens que son esprit reste plongé dans une ténébreuse confusion qui ne le préserve pas de l’erreur et ne le dispense pas non plus des contestations interminables ainsi que des controverses.
Heureusement, Platon ne nous laisse pas souffrir dans cette sorte de labyrinthe où se trouve l’esprit humain en quête de ce qu’est la justice en elle-même. Il esquisse un premier degré de réponse à cette épineuse et délicate question de la définition de la nature de la justice en faisant remarquer que la justice est à la fois commune à l’homme et à la cité. « La justice, affirmons –nous, est un attribut de l’individu, mais aussi de la cité entière[62]».
Dans la cité, l’attribut que constitue la justice se trouve, en quelque sorte, inscrit en caractères plus grands, et par conséquent plus faciles à découvrir ; tandis que dans l’individu, cet attribut est inscrit en caractères plus petits, et donc difficile à appréhender. Aussi convient-il d’étudier d’abord la justice dans la cité ; ensuite, elle sera étudier dans l’âme humaine[63].
B. Nature et origine de la justice
Aux yeux de Platon, la justice est un attribut de la cité. Ce qui signifie la même chose que la justice est une caractéristique de la cité c’est-à-dire encore que la justice est une réalité appartenant en propre à la cité. Si la justice constitue ce qui appartient en propre à la cité, elle en constitue alors la vertu. Or que signifie, pour Platon, la vertu ? Notons que pour Platon, la vertu, c’est l’excellence dans la fonction propre. Ceci étant, chaque chose, c’est-à-dire chaque objet aussi bien que chaque être vivant, ayant une ou plusieurs fonctions, la vertu consiste dans le fait d’exercer parfaitement cette fonction[64]. Ainsi, dans La République, Platon montre que la cité devient parfaite lorsqu’elle renferme quatre vertus cardinales parmi lesquelles figure la justice, et dont les trois autres sont la sagesse, le courage et la tempérance. Et dans la cité, c’est la justice qui fait naître la tempérance, le courage et la sagesse, et, une fois qu’elles sont nées, c’est encore la justice qui assure leur sauvegarde, aussi longtemps qu’elle est présente. « Je crois que dans la cité, le complément des vertus que nous avons examinées, tempérance, courage et sagesse, est cet élément qui leur a donné à toutes le pouvoir de naître, et, après leur naissance, les sauvegarde tant qu’il est présent. Or nous avons dit que la justice serait le complément des vertus cherchées »[65].
De plus, parmi ces quatre vertus cardinales que renferme la cité parfaite, la justice demeure celle qui avec la modération s’impose à tous les citoyens. Mais pourquoi la justice, dans la cité parfaite, s’impose-t-elle à tous les citoyens ?
C’est que chez Platon, la cité naît de la nécessité où sont les hommes de subvenir à leurs besoins vitaux[66]; ce besoin trouve vite dans la division du travail le moyen rationnel de parvenir à une production plus abondante et facile. Dès lors, la cité, dès son origine, est un rassemblement d’êtres inégaux et dissemblables par leurs capacités, leurs aptitudes et leurs fonctions. Dans une telle situation, la justice qui est indispensable au salut de la cité, ne sera autre chose que l’acceptation par les citoyens du principe (devenu sacré) de la division du travail et de la spécialisation des fonctions. Ce qui signifie concrètement que chaque citoyen accomplisse convenablement la fonction qui lui est assignée, et que chacun accomplisse sa fonction selon ses aptitudes naturelles. « Le principe que nous avons posé au début, lorsque nous fondions la cité, comme devant toujours être observé, ce principe ou l’une des formes est, ce me semble, la justice. Or, nous posions (…) que chacun ne doit s’occuper dans la cité que d’une seule tâche, celle pour laquelle il est le mieux doué »[67].
La justice dans la cité apparaît ainsi comme un principe qui ordonne[68]à chacun de remplir sa propre fonction et à ne point se mêler de celle d’autrui[69]. Mieux, elle s’installe dans la cité et dans l’âme du citoyen, lorsque chaque groupe fonctionnel, dans la cité, et chaque espèce d’âme, dans l’âme, accomplit la tâche qui lui a été assignée par la nature. La présence de la justice chez l’enfant, la femme, l’esclave, l’homme libre, l’artisan, le gouvernant et le gouverné contribue à la perfection de la cité[70]. En définitive, Platon souligne que la justice est une force qui contient chaque citoyen dans les limites de sa propre tâche. Elle concourt, avec la sagesse, la tempérance et le courage à la réalisation de la vertu de la cité[71]. Mais, d’où provient la justice ?
Si la justice est indispensable pour le citoyen et la cité, il reste que l’existence de la justice, selon Platon, est bien antérieure à la constitution des sociétés humaines. C’est dire que malgré son importance, la justice ne saurait être une émanation de l’intelligence humaine. Bien au contraire, la justice apparaît dans l’aventure sociale des hommes comme un don divin. Ceci est capital dans la mesure où ce qui est d’origine divine se trouve revêtu de la sacralité et mérite, par cela même, respect, adoration et vénération de la part des humains. Dans Protagoras, Platon rapporte que c’est Zeus qui, voyant les menaces de destruction et de disparition planer sur l’espèce humaine, leur fit don de la pudeur et de la justice. Platon écrit : « Zeus alors, inquiet pour notre espèce menacée de disparaître, envoie Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice »[72]. Quelle est donc la finalité de ce don divin que représente la justice ?
C. La justice, condition pour la sécurité, l’harmonie et la paix des citoyens
Platon condamne fermement l’injustice qu’il considère comme le plus grand des méfaits que l’on puisse commettre à l’égard de sa propre cité. L’injustice, pour lui, est bien le contraire de la justice. Il y a injustice lorsqu’il existe un changement et une confusion dans l’accomplissement des principales fonctions sociales regroupées en trois classes : « la classe des hommes d’affaires, celle des auxiliaires et celle des gardiens »[73].
Autrement dit, il y a injustice dans la cité lorsque chaque citoyen ne se contente pas d’accomplir la tâche pour laquelle il est naturellement fait, mais s’occupe des tâches des autres citoyens. Ce qui engendre tout naturellement un bouleversement dans l’ordre normal des choses ou encore un désordre dans la cité. Or le désordre, aux yeux de Platon constitue, pour la cité, le plus grand des méfaits ; il empêche la cité de parvenir à sa perfection. Dès lors, le désordre dans l’accomplissement des fonctions entre les trois classes de citoyens constitue aussi pour la cité le dommage suprême qu’engendre l’injustice. « La confusion et la mutation de ces trois classes entre elles constituent donc pour la cité le dommage suprême, et c’est à très bon droit qu’on appellerait ce désordre le plus grand des méfaits[74]».
À ce qu’il paraît, l’injustice qui consacre l’absence de la justice ne favorise nullement l’instauration de l’ordre et de l’harmonie qui sont pourtant indispensables à la bonne marche de la cité. Nous sommes donc fondés à dire que le manque de justice reste la plus grave maladie du corps politique et de la cité. Pour Platon, le changement et la confusion suscités par l’injustice entrainent tout simplement la ruine de la cité.
« Quand un homme, que la nature destine à être artisan […] tente de s’élever au rang de guerrier, ou un guerrier au rang de chef et de gardien dont il est indigne ; quand ce sont ceux-là qui font échange de leurs instruments et de leurs privilèges respectifs, ou quand un même homme essaie de remplir toutes ces fonctions à la fois, alors je pense que ce changement et cette confusion entrainent la ruine de la cité »[75].
Que le propre de l’injustice soit de favoriser à la fois le malheur du citoyen et de la cité. Cela constitue, par excellence, l’argument platonicien sur le rapport entre la justice et son contraire l’injustice dans la problématique de la paix et du bonheur de l’homme. L’injustice occasionne le désordre, le dysfonctionnement et la violence. L’injustice cause aussi la déstabilisation, la destruction et la disparition. Bref l’injustice corrompt, détruit et ruine en dernière instance l’espèce humaine et la cité.
C’est pourquoi enfin, et cela aussi mérite d’être dit haut et fort, seule la justice favorise l’harmonie et la concorde, la paix, le progrès et le bonheur des citoyens. En effet, seule la justice est la vertu qui favorise la sécurité individuelle et collective ; c’est encore la justice qui entraine l’harmonie individuelle et collective ; enfin, c’est toujours la justice qui occasionne la paix individuelle et collective. Dans Protagoras, Platon nous donne de lire ce qui suit :
« Les humains vécurent d’abord dispersés, et aucune ville n’existait. Aussi étaient-ils détruits par les animaux. […]. Ils cherchèrent donc à se rassembler et à fonder des villes pour se défendre. Mais une fois rassemblés, ils se lésaient réciproquement, faute de posséder l’art politique ; de telle sorte qu’ils recommençaient à se disperser et à périr. Zeus alors, inquiet pour notre espèce menacée de disparaître, envoie Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice afin qu’il y eût de l’harmonie et des liens créateurs d’amitié »[76].
Il convient ici de bien comprendre et de retenir pourquoi la justice et la pudeur sont accordées aux hommes en mal de la science politique Zeus fait don de la pudeur (c’est-à-dire de la retenue ou de la modération) et de la justice aux hommes, doublement menacés de destruction et de disparition, afin qu’il y ait dans les villes de l’harmonie et de l’amitié. L’harmonie dans les villes signifie l’existence d’une sérénité dans la vie de chaque citoyen, et l’existence d’une bonne entente entre eux entretenue par un équilibre satisfaisant. L’amitié, quant à elle, découle déjà des rapports excellents qu’établit la justice ; elle instaure des relations affectives ou de sympathie entre les citoyens, mais également des relations de cordialité et de bonne entente entre les groupes humains.
En l’absence de l’art politique, la justice et la retenue apparaissent comme deux vertus ayant pour fonctions la pacification, la sécurisation et la pérennisation, en toute harmonie, de la cité. Ces vertus favorisent, d’autre part, la consolidation du tissu social par des liens d’amitié et de solidarité. Toutes choses qui domptent les agressions et violences, et éloignent fortement les sentiments de belligérance. Ainsi, « en l’homme comme dans la cité, c’est la justice qui assure l’harmonie sans laquelle il ne peut y avoir de vie bonne »[77].
Remarquons que par le don de la justice et de la pudeur, Zeus veut voir absolument établis dans les villes l’harmonie et des liens d’amitié entre les citoyens. Pour cette fin, Zeus est catégorique et impitoyable. Tous les citoyens doivent nécessairement participer à la justice pour que l’existence de la cité soit possible[78]. Il dit alors à Hermès de distribuer la justice entre tous les hommes « car les villes ne pourraient subsister si quelques uns seulement en étaient pourvus »37.
À la différence de tous les autres arts, la justice devient la vertu propre de l’homme. Elle acquiert du coup un fondement ontologique. Dès lors, tous les citoyens, sans exception, doivent participer à cette vertu ; chacun doit conformer toutes ses actions sans jamais s’en écarter ; et, dans le cas où quelqu’un y resterait étranger, s’il convient de l’instruire et de le châtier, ou sinon, lorsque les corrections et les conseils n’y font rien, s’il faut le considérer comme incurable, il faut alors le chasser ou le faire mourir. « Tu établiras cette loi en mon nom, dis Zeus à Hermès, que tout homme incapable de participer à la pudeur et à la justice, doit être mis à mort, comme un fléau de la cité »[79]. La justice est donc obligatoire pour tous les citoyens ; tous doivent être justes pour que règne l’harmonie et que la cité subsiste.
Que faut-il donc retenir de cette analyse sur la question de la justice chez Platon ?
Conclusion
Retenons que l’injustice, à coup sûr, provoque à la fois le malheur et la disparition de l’homme ainsi que la destruction de la cité. Ceci étant, la justice devient importante dans la quête du bonheur des citoyens. Elle constitue, aux yeux de Platon, un gage fondamental pour l’établissement de l’harmonie et de la paix sociale. Cependant, la saisie de ce que la justice est en elle-même est et reste difficile pour le commun des mortels. C’est pourquoi du vieillard Céphale à Adimante, frère de Glaucon, en passant par Polémarque, fils de Céphale, et par le sophiste Trasymaque, nul n’est parvenu à présenter correctement la nature de la justice. Toutefois, pour Platon, la justice traduit l’acceptation par tous les citoyens du principe de la division du travail et de la spécialisation des fonctions. Elle s’installe dans la cité et dans l’âme du citoyen, lorsque chaque groupe fonctionnel, dans la cité, et chaque espèce d’âme, dans l’âme, accomplit la tâche qui lui a été assignée par la nature. Voici donc une piste, mieux, un chemin qu’ouvre Platon pour toute bonne conscience aspirant à promouvoir, en lieu et place de la sauvagerie et de la barbarie qui ne mènent qu’à l’enfer, la paix, l’humanité et la citoyenneté.
Bibliographie
- ALAIN, Propos 16 juillet 1910, Paris, Gallimard, 1956.
- ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Paris, Garnier Frères, trad. Jean Voilquin,
- CHÂTELET, François, Platon, Paris, Gallimard, 1965.
- BRISSON, Luc, Lire Platon, Paris, P.U.F, 2006.
- BLAISE Pascal, Les Pensées, Paris, 1950.
- BRISSON, Luc et PRADEAU, Jean-François, Dictionnaire Platon, Paris, Ellipses, 2007.
- BRUN, Jean, Platon et l’académie, Paris, P.U.F., 1960.
- MAIRE, Gaston, Platon, Paris, PUF, 1970.
- PLATON, La République, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, trad. R.
Baccou.
10.PLATON, Gorgias, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, trad. E.
Chambry.
11.PLATON, Politique, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, trad. E.
Chambry.
12.PLATON, Œuvres complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1994, trad. L. Robin.
13.PRADEAU, Jean-François, Platon et la cité, Paris, P.U.F, 1997.
14.POPPER, Karl R., La société ouverte et ses ennemis L’ascendant de
Platon, Paris, Éditions du Seuil, 1979, trad. J. Bernard et P ; Mignod,
15.RAWLS, John, Théorie de la justice, Paris, Éditions du Seuil, 1987, trad. C. Aldard.
MACHIAVEL ET ARISTOTE : CONTINUITÉ OU RUPTURE ?
Diby Cyrille N’DRI
Assistant
Université de Bouaké-Côte d’Ivoire
RESUMÉ
Dans sa tentative de résoudre les problèmes politiques de son époque, Machiavel s’est inspiré de l’expérience d’Aristote. Ainsi, une analyse minutieuse révèle qu’au cœur du champ machiavélien de la politique, se trouve l’aristotélisme dont il tire sa source. Il existe, à l’évidence, une continuité entre ces deux penseurs qui ont rejeté les considérations imaginatives de leurs prédécesseurs dans l’élaboration de leur pensée politique. Cependant, par delà cette position de principe, il est incontestable de noter une rupture entre eux. En effet, des données irréfutables attestent de la démarcation entre Machiavel et Aristote.
Mots clés : Constitution, État, Idéalisme, Réalisme, Vertu, Virtù,
ABSTRACT:
In this attempt to solve the political issues of his epoch, Niccolo Machiavelli was greatly inspired by Aristotle’s experience. A meticulous analysis reveals that at the heart of the Machiavellian vision of political field, stays aristotelism from which it takes its origin. Indisputably, there exists continuity between those two philosophers who both absolutely rejected their predecessors’ imaginative thoughts in the conception of their political ones. However, above this principle positions, it is indisputable to notice a breach between Machiavelli and Aristotle.
Keywords: Idealism, Institution, Realism, State, Virtue, Virtù, INTRODUCTION
« Tout en reconnaissant les grands mérites de Platon, on peut affirmer que le plus grand penseur de la Grèce antique a été Aristote. Il étudia toutes les branches du savoir humain et ses œuvres forment une véritable encyclopédie dans laquelle est composée toute la science de l’époque la plus brillante de la civilisation hellénique »[80].
L’œuvre d’Aristote n’est guère séparable d’une tentative de généralisation ou de totalisation de la connaissance. Aristote, qui de façon singulière, s’est focalisé sur des principes factuels, est doué d’un réalisme. C’est donc fort de ses préceptes scientifiques qu’il a influencé nombre de penseurs.
À l’imitation de ces penseurs métaphysiciens ou de la technique, un nombre pléthorique de philosophes politiques vont donc s’abreuver de la visée politique d’Aristote. Parmi ceux-ci, Nicolas Machiavel. Parlant de la gestion des affaires publiques, Aristote désignait la politique au livre premier de l’Éthique à Nicomaque comme la première des sciences, celle qui est plus que toute autre architectonique. Selon lui, c’est la science des fins les plus hautes de l’homme, par rapport auxquelles, les autres ne sont que les moyens. Ainsi, chez Aristote, « de même qu’il y a une hiérarchie des êtres, il y a une hiérarchie des sciences »2. La plus grande de toutes les sciences, théoriques, poétiques ou pratiques est la politique. Celle-ci vise l’activité humaine qui a pour objet la perfection, mieux le bonheur de l’être humain. La philosophie de Machiavel qui vise l’activité humaine semble s’inspirer du conseiller d’Alexandre le grand, c’est-à-dire Aristote. Le penseur italien dans sa quête des fins humaines, c’est-à-dire le bonheur de la communauté, s’est uniquement intéressé à la pensée politique de celui qui n’a eu de cesse de démontrer que l’homme est un animal politique. C’est sans doute pour cette raison que J.F. Duvernoy révélait ceci : « De quelque côté que l’on aborde Machiavel, il est aussitôt question de politique, du moins rien ne le préoccupe qui ne soit appelé par sa réflexion sur la politique »[81]. Le penseur de la Toscane, (Machiavel), dans sa quête de la conservation du pouvoir, a emprunté les voies comparatives, observatrices donc empiriques d’Aristote. On peut alors souligner que Machiavel est un prosélyte du stagiriste (Aristote). Est-il cependant totalement juste de prôner une continuité entre Aristote et Machiavel ? Machiavel n’est-il pas un dissident de l’aristotélisme ? Machiavel est-il un continuateur systématique ou asystématique ?
I- DES POINTS DE CONVERGENCE : DU RÉAL POLITIQUE D’ARISTOTE ET DE MACHIAVEL
Le sens que les différentes sociétés humaines ont donné au bonheur, a toujours et partout constitué sinon le pôle principal de toutes les activités humaines, du moins une motivation déterminante de l’agir de l’homme. C’est pourquoi, dès l’Antiquité, le point de départ de la pensée politique a été la quête du Souverain Bien. Pour accéder à cette béatitude, Platon conseille une voie : « la démarche consistant à examiner une chose au moyen de la vue est toute remplie d’illusions aussi celle qui se sert des oreilles ou de n’importe quel autre sens »[82]. Le maître d’Aristote revendique la voie de l’idéalisme puisqu’il rejette ce que les sens, c’est-à-dire l’expérience, enseignent. Aristote, en revanche, a eu une admiration pour l’empirisme.
C’est pour cette raison que
« Dès les premières pages de la morale de Nicomaque, nous découvrons chez le penseur un des traits qui caractérisent essentiellement son esprit : l’intention bien arrêtée de s’appuyer sur les données du sens commun, d’admettre dans son audience la foule, les vieillards, les sages, bref de fonder son étude sur l’expérience et de ne pas se laisser égarer par les abstractions platoniciennes »[83].
La vérité que recherche Aristote échappe aux conceptions imaginatives. Elle est le reflet des événements de son temps. Parlant d’Aristote, Jacqueline Russ le désignait comme celui qui dirige les regards vers le monde tel qu’il est, vers les individus, les singularités qui le composent, ici et maintenant, non là-bas ou ailleurs. Tout comme Russ, Allan justifie la voie de l’expérimentation empruntée par Aristote dans la quête du bonheur des êtres humains. « Aristote soutient-il qu’en matière pratique un philosophe doit interpréter les opinions régnant que les régenter ».[84]
Aristote a, dès lors, scruté l’être humain en sa nature, en son expression. Machiavel, dans sa pensée politique, s’est attelé à ouvrir une nouvelle voie d’obédience empirique. « Mon intention étant d’écrire à qui l’entend, il m’a paru pertinent de me conformer à la vérité effective de la chose qu’aux imaginations qu’on s’est fait »[85]. La révolution machiavélienne se démarque ainsi des conceptions utopistes qui ont précédé son époque. Machiavel, il faut le souligner, rejette la période médiévale qui prône la quête des hommes en se focalisant singulièrement sur les principes divins. Aussi répugne-t-il l’idéalisme de l’Antiquité qui imaginait les lois politiques sans se référer à la réalité humaine.
Si Aristote et Machiavel conviennent que les hommes sont condamnés à vivre en société, ils sont aussi unanimes que les êtres humains doivent être organisés. Cette organisation est le fait de la politique, de l’État. C’est pour ce fait qu’Aristote a analysé les origines et les finalités de l’État. Qui plus est, il a étudié les mécanismes de fonctionnement des systèmes ou régimes politiques. Dans ses recherches, il veut dégager le meilleur régime politique, c’est-à-dire l’État idéal. Il est donc aisé de comprendre pourquoi « la politique, le plus ancien des traités de droit constitutionnel, énumère toutes les constitutions et les modes de gouvernement non seulement des cités grecques, mais des principales métropoles d’alors du monde méditerranéen »[86]. La cité qui est une communauté politique doit être régie par une constitution. Il convient de dire que c’est la constitution qui, en définissant l’être de la cité, lui donne son essence politique.
Machiavel était, à l’instar d’Aristote, animé par cette envie de trouver la meilleure constitution (régime) qui puisse favoriser le bonheur des Italiens. Car, comme l’avait souligné son prédécesseur, il ne s’agit pas de vivre, mais de bien vivre en société. Cette recommandation est fort appréciée par Machiavel. L’Italien, de ses investigations, accepta cette conclusion d’Aristote :
« Le gouvernement exercé par un seul individu au bénéfice de tous est la monarchie, sa perversion est la tyrannie. Exercé par un petit nombre coïncidant avec les meilleurs nous avons l’aristocratie dont la dégénération est l’oligarchie. Quant au gouvernement du grand nombre dans l’intérêt général, Aristote l’appelle : République ou politie synonyme d’État ou de construction. Sa forme dégénérée est la démagogie »[87].
En analysant ces différentes structures politiques, Aristote n’omet pas d’établir une distinction entre la meilleure constitution absolument et la meilleure constitution selon les circonstances. Machiavel s’engage dans cette même perspective, dans la mesure où, il découvre qu’il y a une correspondance entre la matière, c’est-à-dire la structure de la société et la forme qui représente le régime politique. Ainsi, chaque type de société doit s’accorder avec un régime politique. Il convient toutefois de noter que tous ces régimes doivent nécessairement avoir en vue le bonheur des hommes dans la mesure où la fin de tout État, c’est l’épanouissement des citoyens. Tous les moyens et toutes les fins du pouvoir politique tendent au bonheur de la communauté. Mais quelle est l’origine de ce pouvoir politique ? Comment ces deux penseurs réalisent-ils l’autorité souveraine des États ?
L’un des mérites de l’idéologie machiavélienne, à la base du pouvoir d’État, est sa cohérence et son réalisme, d’influence aristotélicienne, concernant la nature humaine. En effet, dès les premières pages de La politique, le stagiriste écrit ceci :
« Si on considérait, les choses à partir de leur origine, dans leur développement naturel, comme on le fait dans les autres domaines, nos présentes investigations elles-mêmes apparaîtraient ainsi aux regards sous l’angle le plus favorable »[88].
Contrairement aux Sophistes du temps de Platon et des disciples d’Antisthène, Aristote démontre que l’État n’est pas une formation conventionnelle. Il a son origine dans les exigences de la nature humaine. L’État est donc une œuvre des êtres humains, une création spontanée et nécessaire de la raison. La constitution dans laquelle les citoyens trouvent leur épanouissement, par l’accomplissement de leur destinée, n’est pas une œuvre de Dieu.
Machiavel soutient la thèse d’une constitution humaine de l’État. Car, avec lui, la gestion des affaires publiques n’est plus fondée sur Dieu dans la mesure où ses bases procèdent des relations entre les hommes. En se séparant des Anciens de l’Antiquité dans leurs conceptions imaginatives, puis des Exégètes de la période médiévale pour qui seul Dieu fait et défait les législateurs, Machiavel initie une révolution. Ainsi :
« Du même coup, comme la notion d’efficacité remplace la théologie éthique, la notion du meilleur régime est remplacée par celle du gouvernement efficace. Du même coup aussi disparaît le décalage essentiel pour les classiques entre le régime idéal et le régime légitime, compte tenu des circonstances »[89].
À la suite d’Aristote, Machiavel a profondément désacralisé le pouvoir d’État qui a, dorénavant, ses caractéristiques qui s’éloignent des données métaphysiques et divines.
Le pouvoir a pour fondement les lois qui favorisent la vertu et la justice, tant à l’échelle individuelle que collective. Chez Aristote, les termes constitution et gouvernement ont la même signification. Aussi le gouvernement est-il l’autorité souveraine des États qui agit en faveur de la vertu. En effet, avec Aristote la vertu du citoyen doit nécessairement être relative à la constitution. Chaque citoyen accomplit ainsi la tâche qui lui est dévolue. La politique, qui vise le bien de la communauté, se fonde sur la morale. Elle a visiblement pour rôle de rendre heureux les citoyens soumis aux lois. Le bien suprême prend sa source dans les lois de la société qui convergent vers la liberté, la justice et la dignité, « car de même qu’un homme, quand il est accompli, est le plus excellent des animaux, de même aussi, séparé de la loi et la justice, il est le pire de tous »[90]. Il découle de cette assertion qu’une cité, pour vivre et surtout bien vivre, doit fuir la corruption et toutes les déviations qui sont antipathiques à la quête de l’intérêt général. Le corps social doit être nécessairement vertueux.
Le philosophe italien préconise une quête inlassable de la vertu source du bonheur dans la cité. C’est pourquoi le dirigeant politique, selon Machiavel, doit s’inspirer de la République de Rome qui a eu sa renommée grâce à la vertu. L’Italien répugne ainsi la corruption, la quête des intérêts particularistes et égoïstes sources de dégénérescence cités. « Je sais que chacun confessera que ce serait chose tout à fait louable que chez un prince on trouvât, de toutes les qualités susdites, celles qui sont tenues pour bonnes »[91]. Le législateur ou le prince doit impérativement se focaliser sur la rectitude politique qui est la somme des qualités moralement considérées comme vertueuses. Pour le chancelier italien, les êtres humains ne jugent que par l’apparence. Il découle de ce fait que les hommes d’État sont contraints d’être bons. Nicolas Machiavel, on peut le dire, met, ainsi, en exergue son humanisme. Cette doctrine qui renferme un ensemble de vertus pour pacifier l’État se fonde sur l’amour du prochain. Ce comportement contribue, dès lors, à l’éducation du peuple qui ne songe qu’à son bonheur. On comprend mieux qu’à l’image d’Aristote, Machiavel prône l’éducation comme moyen de réalisation des citoyens.
N’est-il pas juste de noter à l’issue de cette première analyse que les constitutions sont différentes les unes des autres ? Aussi ne convient-il de souligner que les principautés sont divergentes ? Cependant les mêmes finalités doivent les régir. Pour reprendre, en effet, les termes d’Aristote, la communauté politique existe en vue de l’accomplissement du bien et non simplement en vue de la vie en société. À cet égard, la somme des attitudes redevables aux législateurs ou aux princes, émanant de la nature des hommes, se regroupent, selon Aristote, en trois.
« Il y a trois qualités que doivent posséder ceux qui sont appelés à exercer les principales fonctions de l’État : la première, c’est la loyauté envers la constitution établie, ensuite, une éminente capacité pour les affaires qu’on administre, et en troisième lieu, une vertu et une justice appropriées, dans chaque forme de constitution en vigueur »[92].
Tout comme Aristote, Machiavel a aussi exalté ces attitudes en fonction de la fortune, c’est-à-dire les circonstances. Selon Machiavel, si le monarque peut monopoliser tous les pouvoirs, le républicain, quant à lui, doit son succès à un partage équitable des pouvoirs, mais tous deux sont condamnés à songer à la béatitude. S’il faut un système d’éducation adapté à chaque forme de gouvernement, celui-ci doit obligatoirement regrouper de façon radicale les trois qualités suscitées.
Ces différentes qualités sont l’œuvre de la raison. Ce qui permet d’affirmer que l’homme recherche son épanouissement par la recherche des lois de sa nature. Ces normes obligent les êtres humains à prendre en compte uniquement l’homme. Heidegger n’avait pas tort lorsqu’il affirmait que « la métaphysique (…) ne pense pas en direction de son humanitas »[93]. En effet, l’homme est appelé à s’actualiser, à s’ouvrir à l’autre pour son épanouissement total. Cette ouverture, à travers laquelle l’être s’affirme, démontre que l’homme ne peut se suffire. En revanche, « l’être est incréé, impérissable, car seul, il est complet, immobile et éternel »[94]. Les hommes sont donc condamnés à vivre en société. Aristote n’a-t-il pas démontré qu’un être humain qui vit seul est semblable à une bête ? Tout comme chez Machiavel, la raison permet aux hommes de rechercher les qualités susceptibles de favoriser l’harmonie dans la cité.
On retient que les deux penseurs pragmatistes sont respectivement d’accord sur les moyens de réalisation de la félicité. Il faut toutefois noter que les fonds abyssaux de ces deux pensées se répugnent. Machiavel ne dépasse-t-il pas Aristote dans sa révolution ? Les qualités que revendique Aristote suffisent-elles à réussir une gouvernance ?
II- D’ARISTOTE À MACHIAVEL : UN PARCOURS DISCONTINU
Aristote considère que les êtres humains, conçus pour vivre en société, entretiennent des rapports d’utilité et de justice. Selon lui, « il résulte que la fin de la politique sera le bien proprement humain »[95]. En faisant usage de la justice, l’on peut affirmer que le bien que recherche l’État procède de la morale. Ainsi, la politique et la morale ont pour fins le bien. On le voit bien chez Aristote, la politique et la morale ont pour rôle de rendre les citoyens honnêtes et soumis aux lois. Cette analyse permet d’insinuer que toute l’éducation, chez le conseiller d’Alexandre le Grand, s’efforce de cultiver la vertu chez le citoyen pour qu’il devienne meilleur.
L’homme d’État italien trouve insuffisant ce vœu d’Aristote. En effet, la vertu à elle seule ne peut guère aider à l’harmonie dans une cité. Pour Machiavel, cela part de la simple constatation que les hommes sont toujours mus par leurs passions auxquelles ils veulent toujours donner raison en essayant de les contenter. Il apparaît aussi que les hommes sont par nature méchants. C’est pourquoi, pour le florentin, « quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit supposer d’avance les hommes méchants et toujours prêts à déployer ce caractère de méchanceté toutefois qu’ils trouveront l’occasion »[96]. Les vertus politiques ne peuvent donc pas se résoudre à celles de l’amitié et de la confiance réciproque. Ainsi, à côté des lois, c’est-à-dire l’éducation, il faut, selon Machiavel, l’usage de la force et de la ruse.
Sans ces moyens hors de l’usage commun, en effet, rien ne se crée, mais rien non plus ne se garde. Les êtres humains qui n’ont pas la capacité de se restreindre et de se plier totalement aux lois de la société ne peuvent qu’être tenus que par la force. La crainte en devient facilement le principe. Ainsi,
« vous devez donc savoir qu’il y a deux manières de combattre : l’une avec les lois, l’autre avec la force, la première est propre à l’homme, la seconde est celle des bêtes, mais comme la première très souvent ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi est-il nécessaire à un prince de savoir bien user de la bête et de l’homme »[97].
Machiavel exige donc un emploi judicieux et rigoureux à la fois de la vertu et du vice, en fonction de ce qu’exigent les circonstances. C’est l’alternance judicieuse de la vertu et du vice qui est la virtù, entendue comme la somme de qualités bonnes pour mener à bien un pouvoir politique. Cette analyse permet de constater que la morale de l’Italien s’oppose à celle d’Aristote.
En effet, la vertu, pour le stagiriste, apparaît comme une œuvre de la raison dont se servent les citoyens pour accomplir des actes bons. Il est clair que la morale aristotélicienne s’oppose aux vices qui sont des dispositions au mal. Il faut donc, selon Aristote, être bon et tempérant aux fins de la rectitude politique. Il est établi que, pour Aristote, la vertu est une excellence qui consiste dans la « Médiété », c’est-à-dire le juste milieu entre un excès et un défaut. « La raison n’a pas seulement fonction de connaissance, mais elle s’applique aussi à la pratique comme la sagesse et la prudence »[98]. Le bonheur est l’équilibre de toutes les fonctions de l’âme et du corps au sein d’une cité juste. C’est pourquoi, Aristote met en exergue la tempérance, la libéralité, la douceur, le convenable que le législateur et les citoyens doivent rechercher.
Machiavel en se fondant sur son pessimisme naturel revendique certes le juste milieu mais également le défaut ou l’excès selon la fortune, c’est-àdire les circonstances. En d’autres termes, les humeurs de chaque classe sociale étant changeants, il revient au dirigeant de savoir être bon (vertueux) ou méchant (vicieux). En clair, chez Machiavel, le dirigeant peut pratiquer uniquement la vertu si les hommes sont bons. Or, les citoyens qui sont méchants par essence voudront quels que soient les actes du prince sa déchéance. C’est pour ce fait que selon Machiavel, le législateur doit agir selon le comportement des êtres humains. Cependant, « il lui est nécessaire d’être assez sage pour savoir éviter le mauvais renom de ces vices qui lui feraient perdre son État, et de ceux qui ne lui feraient pas perdre, se garder, s’il lui est possible, mais ne le pouvant pas, il peut avec moins de réserve s’y laisser aller »[99]. Le prince machiavélien doit ainsi tenir compte des réalités effectives. Il est contraint de prendre conscience et de comprendre la spécificité de l’espace social et politique, en somme, du contexte de son action. Le dirigeant est prié de rester en éveil pour s’adapter à la fortune au lieu de rester figé dans un optimisme exacerbé comme Aristote.
Le stagiriste, en effet, résout la quête de la béatitude par la sagesse. Il la définit comme la science de l’intelligence des choses qui sont de nature honorables. Elle atteint la réalité suprême, fin de l’État : le bien. Ainsi, le bon législateur est celui dont la vertu excède tous les autres. Aussi, une famille est-elle digne de royauté si sa vertu surpasse celle de toutes les autres familles. Cette vision des choses pour Machiavel n’est possible que dans une société où tous les citoyens sont vertueux. Or, de par leur nature, les hommes ne deviennent vertueux que par la force. Cette violence, si Aristote semble ne pas la récuser, il ne l’évoque pas dans les moyens de la conservation du pouvoir politique. Chose que Machiavel trouve inadmissible à cause de la nature complexe des hommes.
Machiavel a, en effet, observé que les hommes ne visent que la préservation de leurs intérêts personnels. Une telle entreprise fait naître des rivalités dans la cité. La force ne devient-elle pas le moyen de cohésion de la cité ? Aristote préconise la vie modérée pour la pacification d’une cité livrée à des rivalités. Il dira ceci :
« Ceux qui ont le souci de la constitution ont le devoir d’entretenir des sujets d’inquiétude (…) leur devoir est aussi d’essayer, au moyen notamment d’une législation appropriée, de prévenir les rivalités et les discussions des notables (…) car la connaissance du mal à ses débuts n’est pas à la portée du premier venu, mais demande un véritable homme d’État »[100].
Si le seul viatique est la Virtù chez Machiavel, Aristote écarte la violence sous toutes ses formes et revendique la Médiété pour restaurer une cité corrompue surtout que la force appartient au petit nombre qui recherche ses intérêts personnels.
Cette éducation réfute de façon drastique la monarchie que l’italien vante dans une société vouée aux diverses contradictions.
« Ainsi donc, vouloir le règne de la loi, c’est semble-t-il vouloir le règne exclusif de Dieu et de la raison, vouloir au contraire le règne d’un homme, c’est vouloir en même temps celui d’une bête sauvage, car l’appétit irrationnel a bien ce caractère bestial et la passion fausse l’esprit des dirigeants, fussent-ils les plus vertueux des hommes »[101].
Il n’est jamais profitable, ni juste qu’un homme ait la suprématie sur tous. Il est contre nature qu’un seul homme soit le maître absolu de tous les hommes dans la mesure où « les êtres semblables en nature doivent, en vertu d’une nécessité elle-même naturelle, posséder les mêmes droits et la même valeur »[102]. Cette observation faite, on comprend que si les deux penseurs songent au bien, il est clair que leurs voies divergent.
Machiavel et Aristote se sont inspirés des Grecs. Ils ont également étudié les êtres humains. Les deux reconnaissent que l’homme, à la différence de l’animal, objective son milieu. Ils ont vécu plusieurs crises, cependant leur vision de la nature des hommes est différente. L’optimisme d’Aristote s’est mué en un pessimisme chez Machiavel. C’est sans doute pour ce fait que la signification de leur morale va varier. Ainsi, la perception du cosmos chez Aristote n’est plus celle de Machiavel. La philosophie de l’italien, on peut le dire, opère une rupture avec la pensée politique d’Aristote.
Machiavel ne distingue pas, comme Aristote, les pouvoirs légitimes et non légitimes. On retient de lui la revendication des moyens qui ont permis aux Anciens d’acquérir le pouvoir et surtout de le conserver. Il s’écarte, dès lors, de la morale traditionnelle d’Aristote pour mettre en lumière une efficacité politique basée certes sur les lois, c’est-à-dire la vertu mais surtout sur la ”bête” qui renferme la force et la ruse. C’est donc l’usage de ces moyens extraordinaires considérés comme immoraux qui surpasse la vertu aristotélicienne. La constitution idéale d’Aristote, selon Machiavel, doit se fonder sur le «lion » et le « renard » pour une harmonisation de la cité dans la mesure où la prudence (sagesse) ne suffit pas. Si pour Aristote « rien ne sert, en effet, de posséder les meilleures lois, mêmes ratifiées par le corps entier des citoyens, si ces derniers ne sont pas soumis à des habitudes et à une éducation entrant dans l’esprit de la constitution »[103]. Pour Machiavel :
« Quiconque compare le présent et le passé, voit que toutes les cités, tous les peuples ont toujours été et sont encore animés des mêmes désirs, des mêmes passions. Ainsi, il est facile, par une étude exacte et bien réfléchie du passé de prévoir dans une république ce qui doit arriver, et alors, il faut ou se servir des moyens mis en usage par les Anciens, ou, n’en trouvant pas d’unités, en imaginer de nouveaux, d’après la ressemblance des évènements »[104].
Pour Machiavel, le monde demeure toujours dans le même état. À cet égard, seules la force et la ruse, qui ont fait la puissance des Anciens, peuvent être utilisées par un chef charismatique aux fins de rendre un État vertueux. Car la vertu est incontournable dans les bonnes formes de gouvernement et la Virtù dans les cités douées de corruption favorisée par la nature complexe des êtres humains. Si Machiavel demande une force surhumaine, celle-ci tire ses fondements dans les qualités personnelles du prince. Tout monarque ou républicain doit se résoudre à transcender, de ce pas, les valeurs morales ou religieuses pour utiliser à bon escient celles dites surhumaines. « La sagesse politique devient différente à la moralité mais intelligente de ses propres moyens d’action et de matière de cette action ».[105]La gestion des affaires publiques piétine les valeurs morales pour pratiquer celles dites politiques. Car ce qui importe, c’est comment conserver la souveraineté. Pour ce faire, il faut faire usage de tous les moyens fussent-ils bons ou mauvais. Il revient, dès lors, au dirigeant de se fonder sur sa sagesse du moins son intelligence pour réussir sa gouvernance.
Ce point de vue s’oppose à celui d’Aristote. En effet, s’il convient avec Machiavel qu’il existe une vertu surhumaine, celle-ci ne procède pas seulement de la volonté de puissance des dirigeants.
« En somme, après avoir longuement défini la vertu humaine que l’on peut atteindre en tant qu’homme, le philosophe nous propose (…) une vertu surhumaine, à laquelle on ne peut accéder que dans la mesure où l’on possède en soi quelque chose de divin ».28
Jean Voilquin révèle que pour Aristote, si le dirigeant peut se surpasser, cela résulte du fait qu’il prend appui sur Dieu. Ainsi, chez Aristote, le sage est celui qui s’adonne à l’exercice de la pensée pure. En se consacrant ainsi à la contemplation « but dernier de la sagesse », il prend plaisir à la vie et se dévoue totalement à la cité. Le stagiriste considère la contemplation non pas comme un moyen mais une fin visée par l’activité humaine. La raison pour acquérir la connaissance est amenée à prendre son élan, non dans des données factuelles, mais dans la pensée pure. Ainsi, « le sage est celui qui aime Dieu et trouve son bonheur à participer à sa vie »[106]. Aristote fait consister la félicité ultime de l’homme dans la contemplation de l’intelligible. Pour le conseiller d’Alexandre le Grand, Dieu est le moteur immobile qui meut le monde. L’homme est heureux parce qu’il est imitation de cet acte divin. La contemplation apparaît donc comme le besoin d’un soulagement de l’individu en quête d’un refuge. C’est sans doute pourquoi pour Aristote, l’activité des vertus « est un cheminement vers la contemplation »[107].
Cette vision se démarque totalement de la révolution machiavélienne qui exclut l’idée du divin pour hisser les qualités personnelles des dirigeants politiques. Si Aristote finit par replonger dans un idéalisme, Machiavel demeure réaliste puisque la gestion du pouvoir d’État n’est que l’œuvre des hommes. Le dirigeant machiavélien ne tire pas sa puissance d’une quelconque puissance, fut-elle métaphysique ou religieuse, mais de la Virtù.
Conclusion
« L’influence d’Aristote sans avoir été aussi prépondérante et exclusive qu’au Moyen-Ậge, continua à s’exercer en Europe dans les XIVè et XVIIè siècles, et encore aujourd’hui la pensée moderne tire quelques-uns de ses éléments fondamentaux de l’œuvre du grand philosophe de Stagire »31.
Pour pasticher Jacques Dufresne démontrant de l’influence d’Aristote révéla que Spengler, Gabriel Marcel, Scheler, Ellul, Heidegger et Mumford sont différents les uns des autres; mais ceux-ci se sont fortement imprégnés du philosopher aristotélicien. Nous pouvons, également, à la suite de Dufresne, affirmer que si Bergson et Heidegger redéfinissent l’Être du stagiriste, Machiavel en s’inspirant d’Aristote offre une approche nouvelle de la pensée politique.
À l’instar de Machiavel, « les adversaires du péripatétisme, Mégariques, Epicuriens et Stoïciens, ont, dans l’ensemble comme dans le détail de leurs attaques, utilisé constamment les ouvrages scientifiques d’Aristote »[108]. Cette analyse permet d’affirmer qu’en dépit des nombreux points de convergence entre Aristote et Machiavel, les modifications que l’italien fournit, mettent en exergue leur rupture. Le machiavélisme, en se distinguant de l’aristotélisme, vise à démontrer que Machiavel n’est pas un dévot, un diseur, pas même un diablotin comme le prétendent ses détracteurs.
Le florentin se démarque d’Aristote en révélant tout simplement que tout dirigeant ne peut compter que sur sa dextérité. Seule son adresse, son habileté pourront surpasser la vertu qui réduit singulièrement les hommes à une bonté excessive. Or, selon Machiavel, les épineux problèmes que le prince doit surmonter, la kyrielle d’obstacles et écueils qu’il devra rendre solubles procèdent de sa volonté affichée de ruser ou de violenter souvent les citoyens qui sont oublieux, changeants, méchants, en somme, complexes. Cette attitude subreptice conduit de façon anhypothétique une impassibilité chez le dirigeant et les citoyens.
BIBLIOGRAPHIE
- ALLAN, Jean Donald, Aristote le philosophe, Paris, Éd Nauwelaerts Louvain Beatrice, 1962.
- ALTHUSSER, Louis, Solitude de Machiavel, Paris, P.U.F, 1989.
- ARISTOTE, Éthique de Nicomaque, traduction préface et index et notes et index par Jean Tricot, Paris, J. Vrin, 1967.
- ARISTOTE, La métaphysique, Tome1 Introduction et notes et index par Jean Tricot, Paris, J. Vrin, 1974.
- ARISTOTE, La politique, Paris, J. Vrin, 1987.
- AUROUX, Sylvain et WEIL, Yvonne, Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la philosophie, Paris, Herissey, 1978.
- COMBES, Jean,Valeur et Société, Paris, P.U.F, 1967.
- BARINCOU, Edmond, Machiavel par lui-même, Paris, Seuil, 1957.
- BOUTHOUL, Gaston, Histoire des doctrines politiques, Paris, Payot, 1966.
- CERIELON, Christophe, « La virtù de Machiavel et la prudence d’Aristote » in Théorie et Pratique, Paris, Vrin, 2002.
- DURKHEIM, Emile, La constitution selon Platon, Aristote, Paris, Minuit, 1975.
12.DUVERNOY, Jean-François, Pour connaître la pensée de Machiavel, traduction de Georges Buis, Paris, Bordas, 1974.
13.GAUTHIER, René-Antoine, La morale d’Aristote, Paris, P.U.F, 1968.
14.GRANGER, Gilles-Gaston, La raison, Paris, P.U.F., 1989.
15.HEIDEGGER, Martin, Lettre sur l’humanisme, traduit de l’allemand par Roger Munier, Paris, Aubier, 1964.
16.HUME, David, Essais politiques, traduction Raymond Polin, Paris,
J. Vrin, 1973.
17.KOMENAN, Aka Landry, Le concept de philosophie : Essai sur les limites du rationalisme scientifique en matière politiques, Thèse d’État, Grenoble, 1982.
18.MACHIAVEL, Nicolas, Œuvres complètes, Introduction par Jean Giono, Édition Établie et Annotée par Edmond Barincou, Paris, Gallimard, 1952.
19.MACHIAVEL, Nicolas, Le prince suivi de l’Anti-Machiavel de FrédericII, Paris, Flammarion, 1957.
20.MACHIAVEL, Nicolas, Le prince, traduction chronologie, Introduction de Guiraudet revue & corrigée, Paris, Flammarion, 1980.
21.-MACHIAVEL, Nicolas, L’art de la Guerre, traduction de Georges Buis, Paris, Berger, Levrault, 1980.
22.MACHIAVEL, Nicolas, Discours sur la première Décade de Tite-Live, traduction d’Alexandre Fontana et xavier Tablet, Paris, Gallimard, 2004.
23.-PLATON, Phédon, traduit du Grec de M. Dixaut, Paris,
Flammarion, 1991.
24.RAWLS, John, Théorie de la justice II, traduction française Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987.
25.RUSS, Jacqueline, Histoire de la philosophie de Socrate à Foucault, Paris, Payot, 1980.
26.SAINT-AUGUSTIN, Les confessions, Livre X, chap. XVIII, traduction Trabucco, Paris, Flammarion, 1991.
LA DIALECTICITÉ DU CONCEPT DE RELIGION CHEZ HEGEL
¶
Cablanazann Thierry Armand EZOUA
Maître de Conférences
Université de Cocody – Côte d’Ivoire
RESUME : La relation de l’Homme à Dieu se dit essentiellement dans la religion qui est particulièrement digne d’intérêt, parce qu’elle est pour tous les hommes contrairement à la philosophie. Cependant, de la religion Hegel n’en donne pas une définition comme l’on a coutume de le faire dans les dictionnaires. Dans la Théorie du concept, nous trouvons la confirmation que la définition chez HEGEL s’appuie sur l’identité, au sens d’identité dialectique : « (…) cette assise fondamentale, la définition, la certitude immédiate, l’intuition intellectuelle, a été admise comme quelque chose d’immédiat, alors que, suivant sa nature, mais aussi suivant sa forme expresse, elle est quelque chose de médiatisé, parce que, essentiellement, elle ne contient pas quelque chose d’abstraitement simple, mais l’identité, en tant qu’identité de termes différents, donc la négativité et la dialectique, mais en elle-même »[109]. HEGEL dialectise donc le concept de religion.
MOTS-CLES : Religion, Homme, Dieu, Sentiment, Représentation,
Recueillement, Culte, Raison.
Abstract: The relation of man to God is essentially done or realized in the religion which is worthy of interest, because it is for all men in contrast philosophy. However, about religion, Hegel doesn’t give a definition as it is usually done in dictionaries. In the theory of concept, we find confirmation that the definition, with Hegel, is based on identity in the sense of dialectic identity: “(…) this fundamental basis, the definition, the immediate certitude, the intellectual intuition was admitted as something immediate, whereas, according to his nature, but also to its specific form, it is something mediated, because it does not contain something abstractly simple, but identity, as the identity of different terms, so negativity and dialectic, but in itself”. So, Hegel dialectizes the concept of religion.
Keywords: Religion, Man, God, Feelings, Representation, Meditation, Cult, Reason.
INTRODUCTION
Si l’étude de la section “Religion” dans la Phénoménologie de l’Esprit correspond au trajet de la conscience jusqu’à l’élévation au Savoir Absolu, c’est-à-dire à la vérité « en et pour soi »[110], il importe, pour élargir l’examen de la religion chez Hegel, de se référer aux Leçons sur la Philosophie de la Religion qui abordent le phénomène religieux sous un mode plus exotérique. Il va s’agir en effet de la religion en son objectivité socioculturelle, « institution inscrite dans l’histoire »[111]comme l’exprime Francis Guibal dans son ouvrage Dieu selon Hegel. Dans les Leçons sur la Philosophie de la Religion, Hegel aborde le phénomène religieux sous la diversité de ses aspects.
L’étymologie du terme “religion” reste incertaine. Mais au point de vue pratique, la question de la signification de la religion est résolue. En effet, les auteurs chrétiens, à la suite de Lactance et de Tertullien expliquent “religio”, mot latin, par les verbes “ligare, religare” qui signifient « lier, relier ». Ainsi, la religion signifie un lien de piété, un attachement et une dépendance à l’égard de Dieu. Mais ce lien est plus qu’une simple disposition intérieure. Il implique un effet d’obligation dans le culte, dans les œuvres, dans le comportement public et dans les rapports sociaux. Selon Emile Benveniste, l’étymologie basée sur un verbe “ligare” est fausse. Ce verbe donne tout au plus comme dérivé abstrait “ligatio” et non “ligio”, ce dernier étant par contre le dérivé attesté de “legere” qui signifie entre autre “recueillir”, “amener à soi”, “assimiler”, “reconnaître”.[112]
« La religion, nous dit Hegel, en son concept, est le rapport du sujet, de la conscience subjective à Dieu qui est esprit »[113]. L’homme parvient à cette conscience de la vérité par trois moments que nous étudierons successivement : par le sentiment, la représentation et la pensée raisonnable.
I – LE MOMENT DU SENTIMENT
En premier lieu, on a comme un rapport purement théorique du sujet à Dieu, un “savoir immédiat” de Dieu, c’est-à-dire la conscience de Dieu en général. Dieu est ici l’objet de notre conscience, objet dont nous avons des représentations, mais aussi objet que nous savons être. Que l’objet soit, c’est là le savoir immédiat que l’on a de Dieu. Il est certain que Dieu existe, et n’existe que pour moi, dans ma conscience. En dehors de ce que je sais de lui, l’objet, Dieu n’existe pas. L’être de Dieu et le mien sont donc étroitement liés dans la certitude que j’ai de mon objet. La certitude est, comme l’exprime Hegel, « le rapport immédiat du contenu et de moi-même »[114].
Il est évident que dans cette première approche du sujet à Dieu, son objet, la seule certitude qui soit, c’est l’existence de l’objet mais sous un mode purement extérieur. Ce qui manque est la connaissance du “quoi” de l’objet. Le sujet sait l’existence de l’objet, mais non ce qu’il est. Le rapport du sujet à l’objet est donc tout à fait abstrait au sens où il demeure indifférent à la nature du contenu de l’objet. Ainsi, pour Hegel, « le savoir immédiat est la pensée pure en sa généralité tout abstraite, sans contenu, l’activité du Moi identique à elle-même »[115]. L’être de l’objet dont le sujet est certain, est la généralité même. C’est un être vide, creux, qui demeure pur rapport à soi. C’est l’unité avec soi.
A ce Savoir immédiat, à cette certitude abstraite d’un être vide, dont le sujet ignore les déterminations, Hegel va opposer la nécessité d’atteindre un rapport à l’objet plus vrai, et la seule vérité est pour lui conforme au processus dialectique : en-soi, être-là, être-pour-soi. Le critère d’un rapport vrai entre sujet et objet sera donc en premier lieu l’éclatement de cette position toute immédiate, donc la séparation de la certitude et de l’objectivité et leur médiation[116]. Au “Savoir” doit s’opposer le “connaître” qui n’est autre qu’un “savoir développé”.
Dans le savoir véritable, on trouve selon Hegel, « ce qui sait et ce qui est su, donc le rapport et la médiation »9. La médiation apparaît comme la vérité du savoir immédiat, car dans tout immédiat il y a aussi le médiatisé. Tout ce qui est doit être conçu comme immédiat et médiatisé à la fois. Et cela est le simple point de vue pour lequel le fini, par exemple, est médiatisé puisqu’il a besoin, pour être, d’autre chose : l’infini. Tout immédiat dépend d’une médiation. Ainsi, dans toute conscience, dans toute certitude, deux déterminations sont unies : si je possède un contenu, il est certes en moi, son être et mon être sont étroitement liés ; mais ce contenu est aussi pour soi. Ces deux déterminations contenues dans ce qu’on appelle la simple certitude de l’existence de Dieu, ou la foi, vont donc conduire à distinguer : le contenu, objet de ma conscience, et la forme de la foi, c’est-à-dire ma conscience subjective.
Si donc, comme nous l’avons vu, Dieu est dit être, et que son être et le mien sont liés, où cette liaison s’opère-t-elle ? Quel est le lieu de certitude de l’existence de Dieu ? C’est ce que l’on appelle communément le sentiment. Avoir le sentiment de quelque chose, c’est en posséder le contenu en soi, contenu et individualité nécessairement rattachés. C’est donc dans le sentiment que Dieu est dans mon être. Le sentiment est ce lien où l’objet devient mien. Tant qu’un objet demeure indépendant, il ne saurait être dans le sentiment. Le sentiment doit se comprendre essentiellement comme la forme où est déposé un contenu, en l’occurrence Dieu en tant qu’être. Mais, il apparaît aussitôt que l’on peut aussi bien affirmer avoir le sentiment que Dieu existe, ou qu’il fait jour, ou tout simplement le sentiment de joie, de colère, etc. … Le sentiment apparaît donc comme une « forme propre à toute espèce de contenu »[117], une « forme où le contenu est posé comme parfaitement contingent »11. Comme le montre Hegel, dans le sentiment de l’existence de Dieu, le contenu est posé parmi d’autres sans avantage sur les autres. Tout contenu se trouve au même titre qu’un autre dans le sentiment.
Il importera donc de rejeter systématiquement l’opinion souvent répandue, selon laquelle, le sentiment est le critère du vrai, du juste. Il est impossible d’affirmer qu’une chose est vraie parce qu’elle est dans mon sentiment. Et cela s’explique plus précisément par l’opposition sentiment et pensée. Dans le sentiment, nous sommes au niveau d’un simple contenu que nous trouvons en nous, donc le rapport a lieu entre la chose et nous, mais la chose comme telle n’y existe pas. Dans le sentiment, « chacun fait de la chose, sa chose, sa particularité »[118]. C’est donc le lieu où l’être est conçu, mais c’est un être subjectif, borné.
Seule, la pensée peut élever le contenu au général, car la pensée seule se donne son contenu. La pensée seule effectue le lien réel entre la chose et le sujet, consistant à avoir la nature de la chose, et non simplement un contenu vide de déterminations. La pensée est le fondement. Le sentiment n’est que la forme par laquelle l’être de l’objet entre en nous. Celui que nous avons de Dieu est nécessairement un stade trop immédiat, donc un moment à dépasser, puisque Dieu ne saurait se concevoir comme particulier alors que le sentiment n’a que pour détermination la subjectivité, la particularité. Dans le sentiment, le caractère particulier du sujet est présent essentiellement et ne se détache pas de la sphère de la corporéité. Avoir un sentiment, c’est sentir ; le sentir fait partie intégrante de mon être particulier. A cet égard, l’existence de Dieu y est comparable au premier mode d’existence de la plante : la graine. Il est dans l’enveloppe d’un Moi particulier. Si donc, la certitude immédiate de Dieu relève du sentiment comme forme de la foi, elle relève d’autre part de la représentation comme contenu.
II – LE MOMENT DE LA REPRÉSENTATION
« La religion est affaire de sentiment, mais aussi de représentation »[119]. La représentation se rapporte au côté objectif de ma certitude. « Dieu se trouve pour l’homme d’abord [connu] sous la forme de la représentation »[120]. La représentation comprend des images, c’est-à-dire des figurations sensibles, ainsi que des figurations non sensibles. Les images correspondent à la figuration directement empruntée à l’intuition immédiate, dont « nous sommes aussitôt conscients que ce ne sont des images, qu’elles ont un sens différent de ce qu’exprime tout d’abord l’image comme telle »15. Ce qui se rapproche en d’autres termes, des métaphores nombreuses dans la religion et les religions. Ainsi, par exemple, l’histoire de Jésus qui offre le double aspect d’être l’histoire ordinaire d’un homme, histoire extérieure, mais aussi de posséder un contenu divin et substantiel, n’est pour la représentation que l’histoire extérieure du monde phénoménal.
Les figurations non-sensibles correspondent au « contenu spirituel tel qu’il est représenté en sa simplicité, c’est-à-dire une action, une activité »[121]. Ce sont des déterminations offrant, selon Hegel, le « caractère contingent »[122]de pure identité à soi-même18, de rapport abstrait et simple avec soi-même. Exemple : la création du monde est une représentation qui conçoit Dieu lui-même comme un universel, général.
Mais la représentation proprement dite doit se distinguer de l’image qui emprunte son contenu au sensible : l’image étant ainsi essentiellement limitée par le particulier qu’elle s’attribue comme contenu, par la figure finie qu’elle représente. A cette limite inhérente à l’image, vient s’opposer la représentation qui, elle, s’élève à la forme de la généralité. En ce sens, ce qu’elle retient et représente c’est « la détermination fondamentale qui constitue l’essence de l’objet »[123]. Elle s’est ainsi élevée à la générosité, ce qui rejoint la forme de la pensée, mais tout en demeurant, d’une certaine manière, asservie au sensible. La représentation ne s’est pas réellement libérée du sensible, elle en a besoin, mais en même temps, elle la surmonte. Il y a donc un double aspect constitutif de la représentation qui en fait une forme supérieure à la simple image. Ainsi Hegel montre que « la représentation se trouve en perpétuelle agitation entre l’immédiate intuition sensible et la pensée proprement dite »[124].
La représentation a en elle le général qui correspond à la forme de la pensée. Mais, si dans la représentation les diverses déterminations de la chose représentée sont chacune pour soi, dans la pensée, « l’objet en soi est connu comme rapport réciproque des choses diverses ou comme son propre rapport à autre chose que nous savons lui être extérieur »21. La représentation a un contenu simple, alors que la pensée fait naître le rapport des diverses déterminations de l’objet et la contradiction. Dans la pensée, l’objet a la nécessité d’avoir le rapport à autre chose. Tout l’immédiat de la représentation est nécessairement destiné à être dépassé par la pensée qui ne connaît comme vérité de l’immédiat que la médiation.
Ainsi Hegel différencie par exemple la représentation du fini et la pensée du fini : « Pour la représentation, le fini est ce qui est (das Ist). Pour la pensée c’est une chose qui n’est pas pour soi, mais qui exige autre chose pour être »[125].
La forme de la pensée dans la représentation est la réflexion, qui conduit le sujet à une certitude immédiate de Dieu, à une “conviction” que Dieu existe. En ce sens, Hegel montre que la conviction est moins immédiate que le simple sentiment ou la simple représentation, en tant qu’elle fait intervenir la médiation par la pensée ou la réflexion. Cette certitude immédiate de Dieu, certitude qui a lieu dans la conscience subjective, se constitue donc sur un rapport du sujet à l’objet, rapport qui se formule finalement comme une opposition.
Dans la conscience qu’il a de l’objet, le sujet se situe comme un autre que l’objet. Il y a le sujet d’un côté et l’objet de l’autre, chacun étant en fait “l’autre d’une manière déterminée”. Le sujet a le sentiment d’une unité avec lui-même puisque c’est bien en lui, que se situe ce rapport à l’objet, mais en même temps il a le sentiment d’autre chose en lui. Le sujet se voit donc limité par rapport à cet objet qu’il a en lui, mais qui est autre que lui. L’objet étant Dieu en l’occurrence, le sujet se sent limité par Dieu, fini par rapport à Dieu : un au-delà, un infini. C’est l’opposition courante fini/Infini qui se fonde, comme l’interprète Hegel, sur “la négativité du Moi” au sens où les deux déterminations, « ma finité et mon aspiration vers mon au-delà rentrent dans le Moi »[126]. Le sujet ne se quitte donc pas, l’opposition n’a lieu que dans le Moi. Cette opposition du fini et de l’Infini est pour Hegel le point de vue de l’observation où le sujet, en tant qu’observateur se limite essentiellement à l’extérieur, au fini, point de vue de la conscience finie, ne connaissant rien de l’Intérieur.
Selon l’opinion courante, « l’esprit de l’homme est fini et cette finité apparaît sous trois formes »[127], comme le montre Hegel, dans l’existence sensible de l’homme, dans sa réflexion et enfin dans l’esprit même. Dans son existence sensible, l’homme se trouve en effet, « excluant et exclu »[128], sa nature même étant constituée par la finité. Ainsi la mort apparaît comme la fin de la vie sensible de l’individu. « Cette vie est posée dans la mort comme supprimée »[129]. Elle est « le néant effectif » 27. A cet égard, Hegel montre qu’un néant effectif est un néant supprimé. La mort ne saurait donc se concevoir comme pure fin en soi, mais bien plutôt comme finalité, c’est-à-dire, autre mode d’existence positive succédant à l’existence temporelle et spatiale de l’individu dans le monde.
Dans la réflexion, la finité se manifeste sous une seconde forme, dans sa simple opposition à l’infinité. Hegel voit dans cette opposition, une position finie de l’Infini. Poser l’Infini comme Un en face du fini, revient à le poser comme fini, comme autre que le fini, autre fini que le fini. Dans sa réflexion, l’homme constate qu’il est finalement le lien entre fini et Infini. « Je suis la réflexion qui (…) ruine les deux côtés »[130]de l’opposition. Fini et Infini se confondent. Comme l’écrit Hegel : « On peut ici aussi facilement songer à s’exprimer en disant qu’ainsi l’infini et le fini ne font qu’un, que le vrai, la véritable infinité sont déterminés et énoncés comme unité de l’infini et du fini »[131]. C’est le point de vue tout à fait objectif qui reconnaît l’unité du fini et de l’Infini. Pour Hegel, un tel point de vue exclusif est « le point de vue de l’orgueil »[132]qui aboutit à l’opinion courante de ses contemporains : le plus grand mérite consistant à ne rien savoir de la vérité ni de Dieu.
La réflexion ne fournissant donc que des pensées subjectives sur un objet et non l’objet tel qu’il est en et pour-soi, se distingue essentiellement de la pensée qui seule, lie le subjectif à l’objectif, en amenant la pensée immédiate de la chose à la forme de la généralité. C’est là l’activité qui médiatise tout rapport, activité dont le résultat apparaît lui-même comme un immédiat.
Cette distinction est d’importance capitale puisqu’elle permet à Hegel de justifier son opinion selon laquelle le recours à la philosophie est nécessaire pour que la conscience de soi de l’individu ait la forme objective, et ne se confine pas simplement à cette pure objectivité de la réflexion. Suivant cette distinction, le seul point de vue impliquant la solution du conflit fini et Infini est de se nier comme moi fini et de s’universaliser.
III – LE MOMENT DE LA PENSÉE RAISONNABLE
Selon Hegel, la religion est précisément cette activité de la raison pensante consistant à se généraliser comme individu et, se mettant de côté comme tel à produire son moi comme être général[133]. C’est le propre du recueillement où le sujet se met de côté comme moi fini, en pensant Dieu, son essence, et l’universalité absolue. C’est le moment qui doit s’achever dans l’unité du fini et de l’Infini, le fini devenant moment essentiel de l’Infini. Comme l’écrit Hegel : « C’est donc en général la nature du fini luimême que de s’outrepasser, de nier la négation et de devenir infini »[134].
Pour Hegel, seul un tel rapport est vrai. Ainsi il existe, selon lui, deux infinis : le vrai et le faux. Le mauvais infini, c’est l’infini de l’entendement. On pose une détermination, on réalise qu’elle est limitée, et alors on la fait devenir autre en en posant une autre indéfiniment. Tout se passe comme si le fini est perpétuellement envoyé au-delà de lui-même.
Comme dit Hegel, « une limite est posée, elle est dépassée, puis c’est à nouveau une limite et ainsi de suite à l’infini »[135]. Il ne faut pas concevoir l’Infini comme étant la progression du fini qui en avançant, recule sans cesse ses bornes, mais ne fait ainsi que s’en donner de nouvelles. On peut donner le nom de mauvaise ou fausse infinité, soutient Hegel, à cette infinité qui est définie comme l’au-delà du fini[136].
A l’inverse, le véritable infini consiste à être relation à soi dans le passage dans l’autre. C’est l’égalité avec soi-même se mouvant. C’est l’être pour soi comme négation de la négation. Ainsi, le véritable infini c’est la totalité des moments de l’être en tant que cette totalité est elle-même dans chacun des moments posés par l’universel du devenir. De cette manière, l’être est rentré dans soi à partir de la suppression de son immédiateté. Il faut concevoir l’infini dialectiquement comme se réalisant dans le fini et par le fini, où il se manifeste en s’imposant des limites qu’il nie ensuite, cette négation de la négation étant son affirmation. Autrement dit, l’infini vrai c’est pour Hegel la totalité des moments de l’être qui se détermine ellemême dans chacune des bornes posées par le devenir universel. Dans le vrai infini, le fini se révèle moment essentiel de la vie divine. Ainsi : « Si nous posons Dieu comme l’infini, il ne peut pour être Dieu se passer du fini. Il se finitise (verendlicht sich), il s’attribue une détermination concrète … ». Dieu est donc mouvement en lui-même : « Dieu seul est et il n’est que par sa médiation avec lui-même »[137].
Hegel conçoit donc l’opposition du fini et de l’Infini comme un “épouvantail” dont il est nécessaire de se libérer, car déjà « Platon a déclaré que le πέρας [le limité], la limite qui se limite en soi, était supérieur à άπειραυ, l’illimité »[138].
La religion apparaît donc comme la conscience de Dieu sous n’importe quelle forme, conscience du vrai, du contenu spéculatif. Or pour
Hegel, la conscience doit se comprendre comme un simple moment de
l’être et de l’esprit, moment où la conscience individuelle a la conscience de l’esprit absolu comme conscience de soi, où « la religion est la connaissance qu’a de soi l’esprit divin par la médiation de l’esprit fini »[139]; c’est le rapport de l’esprit à l’esprit absolu. Si, comme on l’a vu, la conscience individuelle “s’avance jusqu’à la conscience du substantiel”, le substantiel lui-même s’avance « jusqu’au phénomène et à la condition d’exister pour soi »[140]. C’est là le concept véritable de la religion pour Hegel, qui s’oppose à la Théologia Naturalis qui s’était bornée à ne considérer Dieu que comme essence et non comme esprit, se limitant par là au côté purement subjectif. L’esprit, pour Hegel, doit être conçu non seulement comme substance, mais aussi comme sujet[141]. L’esprit est essentiellement subjectif. Ainsi, le moment de l’esprit comme conscience ne peut constituer qu’un côté de l’esprit. L’autre étant la nécessité de ce qui est pour lui[142].
Aussi le développement de l’Esprit, ou de Dieu, suivra-t-il le développement logique que nous avons déjà considéré comme développement de la nature. « Le développement de Dieu en soi offre donc la même nécessité logique que [celui de] l’Univers »[143]. Puisqu’il s’agit ici de religion, donc du contenu absolu, la nécessité ne peut être qu’absolue. La nécessité est la forme et l’évolution intimes du phénomène religieux42. En tant qu’il se réalise, se développe, l’Esprit se phénoménalise, s’extériorise, se donne l’être-là, mais cette extériorisation est ce par quoi l’esprit est pour soi. En elle, l’Esprit ne sort pas de soi, n’est pas pour autre chose, sans quoi il ne serait pas l’esprit absolu.
Il y a donc deux déterminations contenues dans le point de vue religieux : l’objectif, domaine de l’universel, de l’illimité et le subjectif, domaine de la conscience de soi. Mais ces deux domaines ne doivent pas se concevoir comme deux totalités indépendantes, à côté l’une de l’autre, car elles s’informent l’une, l’autre[144]. Le développement de Dieu en soi et celui de l’univers ne sont pas absolument distincts. Il y a bien deux mondes, mais c’est la même matière qui se développe, les sphères de l’action de la vie de Dieu se confondant avec celles de l’univers44. Il y a bien deux vies, l’une phénoménale, l’autre spirituelle, mais Dieu est la substance même de l’univers, sa vérité. Ainsi, comme le montre l’exemple emprunté à la religion chrétienne, en Dieu existe l’altérité. L’autre, c’est le Fils de Dieu, le Christ. Le Christ est la vérité du monde fini et phénoménal. Mais il est Dieu, Fils de Dieu, donc il s’agit bien, en effet, de la même matière : la vérité.
En résumé, il importe de préciser qu’il y a trois formes dans le concept de la religion correspondant respectivement à la nécessité du développement de la vie de Dieu.
La première forme apparaît dans ce que Hegel appelle “l’Unité substantielle” où Dieu est conçu comme une substance absolue qui demeure l’Unique, et qui ne sort pas de soi. Comme l’absolu ne saurait être limité au substantiel, une deuxième forme va naître : celle de la différenciation de cette Unité[145]. Dieu, étant pour soi sujet, va sortir de soi et devenir un autre. « Ce n’est qu’avec la différence que commence la religion comme telle »[146], dans l’élément de la conscience. Comme l’exprime Hegel : « Cette différence est d’ordre spirituel, c’est la conscience »47. Car Dieu, étant devenu pour soi un autre, devient par-là même, objet de la conscience. Il y a désormais deux instances : Dieu et la conscience dont Dieu est l’objet. C’est simplement dans ce deuxième moment que Dieu se manifeste, se révèle, se communique. Cette séparation de soi en soi, cette division, cette différence dans l’élément de la conscience, est ce que Hegel nomme “le jugement” (Urteil). Pour Hegel, « le concept juge (ur-teilt) c’està-dire le concept, l’universel passe au jugement, à la division, à la séparation »[147]et ne laisse pas se maintenir l’unité substantielle. Enfin, cette distinction de Dieu en lui-même, doit revenir en soi. Et ce sera la troisième forme de la vie divine, rejoignant l’unité substantielle primitive, mais enrichie de par sa phénoménalisation, sa conscience de soi dans l’autre.
Ce développement de l’Esprit est constitutif de la vérité. Ainsi, selon Hegel, Dieu n’est le vrai que déterminé. Il n’est le vrai que s’il possède en lui l’universalité diverse, infinie, la détermination concrète, c’est-à-dire la différence en lui comme différence[148]. Le vrai est donc ce qui inclut en soi le côté subjectif et le côté objectif, le côté de l’identité et de la différence.
Tout cela défini, le point capital reste, pour Hegel, l’adéquation entre la réalité et le concept de Dieu. La vraie religion est celle qui présente le phénomène de Dieu identique au concept de Dieu. Ainsi toutes les religions dont la représentation de Dieu ne s’effectue pas selon cette exigence d’adéquation, ne sont pas la vraie religion : c’est l’exemple du Dieu juif et du Dieu des Hindous, Brahma, qui, en tant que dieux purement abstraits, ne correspondent à aucune image représentative et demeurent dans l’immatérialité d’un au-delà.
La vraie religion, conforme au concept, au développement logique, implique que Dieu tout entier se phénoménalise, se révèle. Ainsi plus rien de caché, Dieu se manifeste, pouvant par là être connu. Il importe de rappeler que puisqu’il s’agit de l’esprit absolu, cette connaissance de Dieu ne saurait se limiter à la connaissance par la conscience subjective, car, l’esprit absolu, savoir en soi, est le savoir de soi-même. « S’il connaît autre chose que lui, il est fini et n’est plus absolu »50. En ce sens, la vraie religion, la religion absolue, est celle où « le fini se supprime et se conserve »51 faisant de l’infini sa vérité. Il n’y a plus un objet et la conscience qui s’y rapporte, il n’y a plus un être fini qui demeure autre chose que son objet, l’infini, mais une unité indissoluble de l’infini et du fini, de l’être et de l’objet.
Tout ce qui constituait le rapport de la conscience humaine à Dieu, la représentation de Dieu, consistait en un rapport théorique de l’homme à Dieu. Ce rapport n’est qu’un côté du rapport à Dieu. Il y a un second côté, un rapport pratique : le culte. Représentation et culte se rattachent l’un à l’autre.
Le culte est le moment de l’élévation de soi à Dieu et de la connaissance de cette élévation. Si le côté théorique que constituait la connaissance de Dieu, consacrait finalement une sursomption (Aufhebung) de l’individu, du sujet, au profit de l’objet, le culte au contraire, accorde la place primordiale au sujet et à la conscience de soi. Là où je suis pour moi-même, commence le côté pratique du rapport à Dieu. Le culte doit donc être compris comme cette activité purement intérieure, par laquelle le sujet va s’unir à Dieu, participer à l’absolu, s’unifier à lui, dans la conscience de soi. Unir mon objet à moi et m’unir à lui : voilà la détermination principale du culte. – Cette unité de l’objet et du sujet demeurait théorique dans le premier rapport.
Mais, si le culte se comprend comme cette activité intérieure, cette tentative du sujet pour s’unifier à son objet, il importe toutefois de ne pas le limiter au simple côté subjectif ; le moment objectif lui est intimement associé. L’un ne va pas sans l’autre, sinon le culte serait absolument vide de sens et s’écarterait de sa détermination principale. « Le culte est donc l’éternel processus du sujet pour s’identifier avec son essence »[149], identification qui s’effectuera par trois déterminations successives : le moment où l’unité est présupposée, le moment de la scission et le moment du rétablissement dans la liberté de l’unité du sujet et de l’absolu.
Les différentes formes du culte correspondent respectivement à ces trois déterminations.
La première forme est le moment du recueillement où, la foi du sujet en Dieu étant vivifiée, le sujet tente de s’absorber tout entier, par la prière, en ce contenu qu’est Dieu. Conscient de s’être uni à Dieu, l’homme tente de se dépouiller de sa subjectivité ; c’est le moment de la négation extérieure où, par les sacrements, les sacrifices, l’homme s’efforce de rejeter tout ce qui est encore “trop humain”, puis, apparaît le moment où l’homme s’est libéré de sa subjectivité, l’a sacrifiée à Dieu, s’élevant jusqu’au spirituel. C’est le moment de la moralité, culte véritable où l’homme consacre toute son existence au Vrai, à l’Universel, se dépouillant de tout ce qui peut constituer son “humanité” : ses passions, ses désirs, … L’individu ne vit plus qu’en et pour Dieu, et atteint par là l’unité véritable.
C’est, par exemple, le monde de la moralité sociale, de l’Etat, où la conscience et l’essence absolue sont en accord parfait. Ce moment considéré comme « le culte le plus vrai »[150]conduit Hegel à affirmer que la philosophie est un culte perpétuel, en tant qu’elle a précisément pour objet le Vrai. Le philosophe est celui qui, se dépouillant de sa subjectivité, ne sert que l’Universel et l’Absolu.
La première forme que l’on rencontre donc dans le culte, unifiant la conscience de soi-même avec l’universel, est la foi. La foi est ce savoir du contenu absolu, exprimé comme le témoignage que l’esprit rend de l’esprit. Et cette foi est la connaissance telle, qui correspond à l’unité exprimée comme témoignage de l’esprit au sujet de l’esprit absolu54. En tant que la foi est le lieu de réconciliation du divin et de la conscience, du spirituel et du naturel, elle est la réalisation du culte.
Etre dans l’esprit, voilà le but du culte. Or comme le montrent les trois déterminations du culte, c’est à moi, individu, de rétablir cette unité. Et ma tâche est précisément de me détacher de tout ce qui constitue ma naturalité, mon enveloppe finie, car pour Hegel il n’y a d’affirmatif que la connaissance pure qui absorbe un objet, qui y a plongé son
individualité[151]: s’affranchir de son individualité, est l’unique moyen permettant la réunion et de Dieu et de l’homme.
« Le côté pratique de l’esprit est la Volonté »56 permettant à la conscience individuelle de décider par elle-même, et d’effectuer l’action dont la foi est la fin. Par la volonté, l’individu se dépouille de sa subjectivité, au profit de l’infini. Deux côtés sont donc à considérer dans l’action accomplie par l’homme dans le culte : un côté négatif consistant dans le renoncement à soi et le côté positif de la réconciliation de la conscience humaine avec l’essence divine.
Dans l’étude hégélienne du culte comme organisation sociale, trois étapes sont à distinguer.
En premier lieu, il y a le culte populaire qui manifeste le commencement de la religion et se fonde sur la peur du supra-sensible. Le recours aux formules magiques ou aux hymnes est le moyen de se libérer de cette peur de l’inconnu, et fait naître le développement de la conscience. Mais dans cette forme du culte, pensée et foi sont totalement dissociées. Vient en second lieu le culte païen où Dieu a la détermination d’une pure abstraction, d’un pur absolu. L’unité de Dieu et de l’individu est comprise d’une manière immédiate, la réconciliation n’a donc pas besoin de s’opérer, la scission étant absente de la conscience humaine. Le culte y est donc « la manière de vivre journalière »[152]. Toute la vie temporelle est culte en elle-même, et donne un aspect tout à fait religieux à la moindre des actions de l’homme qui se doit d’être digne. C’est le règne de tout “le cérémonial” des exercices journaliers rituels et des offrandes ; c’est aussi la naissance du travail religieux qui va de la danse – simples mouvements corporels –, à la construction colossale. Tous ces travaux font partie de l’offrande. C’est aussi la naissance de l’art qui consacre « l’unité de la conscience de soi et de son objet »58, mais l’unité est limitée de par son immédiateté, et ce monde est empli de tristesse. C’est l’éclatement de la division du divin et de l’humain. Dieu y est conçu comme maître de la nature, et l’homme naturel se sent tragiquement destiné à “passer”. C’est la conscience de la mort. Le tragique de la fatalité vient contredire l’affirmation de la nature et de l’existence temporelle. « Le culte des morts devient un côté du culte essentiel »[153]. Cet éclatement de l’unité primordiale par la conscience de la mort donne lieu à une troisième forme de culte. Le culte spirituel est celui, où le sujet est donc devenu conscient que la vie temporelle est finie, par la mort, et que l’infinité existe en lui. Cette conscience de l’infinité produit une espèce de représentation de l’homme naturel en opposition au monde spirituel. L’homme naturel est “méchant” parce qu’il est fini. Le fini est conçu comme le mal. L’éducation apparaît alors comme unique moyen de se libérer du mal de la finité, en mettant du côté de son individualité tout ce qui n’est pas susceptible d’atteindre une valeur universelle. L’homme devient ainsi libre, ne retenant plus en lui que l’infinité, c’est-à-dire l’individualité absolue. Et « cette liberté est comme le mouvement en lui de l’esprit absolu du fait de la mise à l’écart de l’esprit naturel »[154], et « le culte consiste ici à reconnaître, à savoir le contenu qui constitue l’esprit absolu »61.
CONCLUSION
Deux formes du culte ont donc été distinguées : le culte limité et le culte dans la liberté. Les deux côtés considérés successivement, la représentation et le culte, constituent “la réalité de la religion”. La représentation est essentielle à la religion qui présente son contenu sous cette forme. La représentation dans la religion a la détermination d’être vraie. Mais en tant qu’un contenu est connu de moi, que je me l’approprie, il me demeure encore extérieur. Je ne lui suis pas identique. Le général et le particulier demeurent encore dissociés. Or, cette imperfection de la représentation religieuse se dissout dans la philosophie, qui, elle, a la forme de la pensée, du concept. Et « seul le concept peut saisir l’enchaînement nécessaire des déterminations concrètes du contenu absolu hors du temps »[155].
C’est cette différence entre religion et philosophie qui explique la nécessité d’une philosophie de la religion ; la philosophie transformant la représentation religieuse en concept, l’élevant à la pensée, et fournissant à la conscience de soi le rapport absolu de la liberté. Parce que la représentation est limitée à la sphère de la nécessité extérieure, à la forme du sensible, du spatial, du temporel, elle ne saurait s’élever au contenu absolu éternel sans le secours de la philosophie. Et cela, bien évidemment par le fait que le contenu est comme nous l’avons vu, identique en religion et en philosophie. « Car il n’existe pas deux consciences de soi de l’esprit absolu pouvant avoir un contenu divers et opposé »[156].
Si donc la philosophie est le secours de la représentation religieuse, le contenu de la religion demeure toutefois le vrai contenu. La philosophie ne saurait lui fournir qu’une forme plus adéquate à la vérité de son contenu ; mais la religion est née d’elle-même, et, comme le précise Hegel, « les hommes n’ont pas eu besoin d’attendre la philosophie pour recevoir la conscience, la connaissance de la vérité »64.
BIBLIOGRAPHIE
- CHÂTELET, François, Hegel, Paris, Seuil, 1965.
- GUIBAL, Francis, Dieu selon Hegel, Paris, Aubier-Montaigne, 1975.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Leçons sur la philosophie de la religion, Paris, Vrin, 1971 ; La religion déterminée, Paris, Vrin, 1972 ; La religion absolue, Paris, Vrin, 1975, Traduction Jean Gibelin, Concept de la religion.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopédie des sciences philosophiques, La Science de la Logique, Paris, Vrin, 1970, Tome 1, traduction Bernard Bourgeois.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Science de la logique, Premier Tome, Premier Livre : “L’Etre”, Paris, Aubier-Montaigne, 1972, traduction PierreJean Labarrière et Gwendoline Jarczyk.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier-Montaigne, 1941, Tome 1, traduction Jean Hyppolite.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Foi et Savoir, Paris, Vrin, 1952, traduction Marcel Méry.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Les preuves de l’existence de Dieu, Paris, Aubier-Montaigne, 1947, traduction Henri Niel.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Ecrits théologiques de jeunesse, L’Esprit du christianisme et son destin, Paris, Vrin, 1948, traduction Jacques Martin.
- HYPPOLITE, Jean, Les Figures de la pensée philosophique, Paris, Quadrige/P.U.F., 1991, Tome 1.
- PASCAL, Blaise, Pensées, Paris, Seuil, 1962.
- SPINOZA, Baruch de, Œuvres III, Ethique, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, traduction Charles Appuhn.
LA PROXIMITÉ DE L’ABSOLU CHEZ HEGEL
Georges ZONGO
Assistant
Université de Ouagadougou-Burkina Faso
Résumé : L’absolu est l’objet d’une quête essentielle de la part de l’homme. Cependant on se représente l’absolu comme étant tellement éloigné qu’il paraît hors d’atteinte. La philosophie hégélienne identifie l’absolu à l’Idée, à l’esprit. L’homme étant un être spirituel est participant de l’absolu, lequel se manifeste sous des formes variées. L’absolu peut donc être compris comme ce qui, dans l’apparence de l’éloignement, se trouve en vérité dans la proximité même de l’homme parce qu’en soi il l’abrite.
Mots-clefs : Absolu, apparence, éloignement, esprit, proximité.
Abstract: The absolute is the main part of human research. However, man tends to see it so far away that it seems to be out of reach. Hegel’s philosophy identifies the absolute to the Idea, the spirit. Man, who is a spiritual being, participates in the absolute which appears through varied forms. So the absolute can be perceived as something that appears to be far away, and however lies in the vicinity of man, being within him.
Key words: Absolute, appearance, distance, spirit, vicinity.
Introduction
Les philosophes du système, dans l’idéalisme allemand, se sont également présentés comme d’illustres interprètes de l’Absolu. Hegel par exemple, dans la Phénoménologie de l’esprit, par la médiation d’une description de la raison observante,[157]nous enseigne que la vérité des choses sensibles est de passer au néant en entrant dans la consommation. S’il est vrai que l’homme, en tant qu’être-aumonde, est au quotidien confronté de toute nécessité au sensible en raison du corps qu’il doit entretenir, il convient cependant de souligner que ce rapport aux choses est loin de représenter pour lui toute réalité. L’homme est un être spirituel et à ce titre, il recherche ce qui a une assise ferme à partir duquel il puisse justifier sa présence au monde ainsi que l’existence dans laquelle il est engagé. Il est en effet porté, dans un mouvement de transcendance fondatrice, vers ce qui est qualitativement autre que lui, il est comme de soi poussé vers l’absolu. Or, l’absolu vers lequel se tourne l’homme est souvent conçu comme étant radicalement éloigné, et par conséquent, hors d’atteinte. Mais si l’absolu était vraiment inaccessible, s’il se perdait dans l’infiniment lointain, le poursuivre ne serait-il pas purement et simplement un acte dénué de sens pour l’homme ? Toutefois l’absolu ne se trouve peut-être pas là où, souvent, on se tourne pour le chercher. Dans La doctrine de la science,[158]Fichte soutenait justement que nous pouvons rendre présent en nous l’absolu, c’est-à-dire, nous rendre présent cet étant suprême appelé Dieu. Une telle conception qui met en lien l’être et la pensée dans le savoir, conditionne toute compréhension et constitue le fondement de sa philosophie transcendantale. Selon Philippe Grosos, l’absolu n’est point une idée abstraite, étrangère et contraire aux réalités humaines : « l’Absolu est la Vie et nous vivons »[159]. Si l’absolu peut constituer l’objet d’une quête essentielle de la part de l’homme, n’est-ce pas dans la proximité même de celui-ci qu’on peut le rencontrer, n’est-ce pas comme proximité même de l’homme qu’il peut se manifester ? C’est à partir d’une interrogation sur le sens de l’absolu chez Hegel que nous essaierons de montrer qu’il s’identifie à la présence en soi de l’esprit.
L’éloignement absolu de l’absolu comme apparence
Dans la préface de la Phénoménologie de l’esprit, Hegel dénonce, entre autres, le formalisme de la connaissance. L’une des figures à laquelle il renvoie cette dimension du savoir essentiellement abstrait est l’obscurité complète que symbolise la nuit. En effet, écrit-il, « donner son absolu pour la nuit dans laquelle, comme on a coutume de le dire toutes les vaches sont noires – c’est là l’ingénuité du vide dans la connaissance ».[160]La nuit est l’exemple même de l’opacité puisqu’elle obscurcit les choses en les faisant paraître comme ce qu’en vérité elles ne sont pas. Elle est productrice de confusion pour l’esprit qui essaie d’appréhender les choses au moment où l’œil physique qui renseigne sur leur forme se trouve limité par le pouvoir assombrissant de l’extériorité. En ce sens, elle constitue un écran contre l’appréhension de la raison, n’autorisant à celle-ci qu’une perception unilatérale du monde qu’elle observe. En effet, l’esprit qui s’affronte à l’extériorité dans la nuit ne perçoit que l’identité alors que la différence qui devait apparaître d’emblée s’est de soi-même niée par le temps qu’il fait.
La différence est la propriété de la chose à se distinguer soi-même et à ne pas être assimilée avec ce qui est autre que soi. La suppres-sion d’une telle possibilité rend le réel indéfinissable car elle pose alors son essence dans l’identité immédiate. Elle nie par ce fait la possibilité même de la négation comme moyen de détermination spécifique du réel. Contrairement à la proposition de Spinoza selon laquelle toute affirmation est ipso facto une négation[161], le réel est ici défini par son “indéfinité” même. L’affirmation de ce qui est ne serait pas autre chose que la réfutation de ce qui n’est pas. Une telle conception sera reprise et développée par Hegel pour qui toute proposition se pose par la négation de son autre. Le développement de la pensée n’est possible que parce qu’aucune position ne vaut pour elle-même mais seulement en rapport avec une autre et que nous excluons, en réfléchissant, les éventualités incompatibles avec ce que la proposition indique. Sans une telle démarche de l’esprit, la compréhension qui suppose qu’on s’accorde sur un minimum de significations dans l’emploi des concepts serait rendue impossible.
Or, si l’absolu est posé comme ce qui échappe à l’appréhension de l’esprit, cela revient à dire qu’il est incompréhensible, qu’il se dérobe totalement à l’homme qui vise à l’atteindre, parce que, notre intelli-gence aime à saisir ce qui en soi est pourvu de contours bien spécifiés à l’intérieur desquels se nouent et se dénouent diverses hypothèses et interprétations. L’absolu, posé comme la nuit par Hegel, indique par ce fait son caractère éminemment voilé en ce que d’emblée, il ne se présente pas comme transparent à notre esprit, mais, au contraire, montre les apparences d’être avant tout dissimulé, replié sur soi, opaque. Certes, la réalité nocturne a-t-elle une valeur en soi négative puisqu’elle concentre en soi l’épaisseur des ombres dont l’essence est de masquer. Toutefois, dans la mesure où elle se rapporte à l’absolu, elle indique aussi que celui-ci est négativement caractérisé par sa proximité à la vie ordinaire de l’homme. La vie connaît aussi bien ses ombres que ses lumières ; et on pourrait même dire que les ombres de la vie une fois traversées permettent de mieux apprécier la lueur qui lui succède. La nuit est donc de ce point de vue un négatif positif parce qu’elle valorise sans le vouloir le jour qu’elle voudrait nier. Dans les Principes de la Philosophie du droit, Hegel souligne justement le fait qu’elle est le moment où « la chouette de Minerve prend son envol »[162]. La nuit rend ainsi possible le décollage de la pensée en apaisant les importunités diurnes. Elle indique le moment le plus propice pour réfléchir sur les sujets essentiels, pour prendre dans le calme de l’esprit les décisions capitales. Pour s’engager dans la vie religieuse, partir à l’aventure, investir des fonds dans une affaire, on attend souvent de la nuit qu’elle “porte conseil”. Toutefois, reconnaître rétrospectivement que la nuit est favorable à la pensée ne signifie pas de toute nécessité que la pensée saisit l’absolu dans l’immédiat en s’exerçant. Que faut-il donc entendre par là ?
La réalité nocturne en sa relativité même constitue le signe précurseur de ce qui la supprime comme telle, elle est le signe de la proximité essentielle de la lumière diurne que de façon conjoncturelle elle ne laisse pas encore devenir manifeste. Nous côtoyons au jour le jour aussi bien la lumière que les ténèbres. Toutefois, c’est la lumière qui nous guide dans la réalisation de nos actions dans la mesure où nous recherchons à travers elles le bien comme but ultime de notre présence au monde. Ainsi, la lumière l’emporte sur les ténèbres comme la vie l’emporte sur la mort. Mais toutes deux sont d’une certaine manière nos compagnes au quotidien, bien que notre préférence porte plus sur la clarté que sur la pénombre, tout comme nous préférons la vie à la mort.
Si la mort apparaît en général comme un événement catastrophique pour l’homme, du point de vue de Hegel elle participe à la vie de l’individu comme de l’espèce. On ne peut vivre sans mourir. On ne peut non plus mourir sans avoir vécu. De cette manière, il s’avère que la vie et la mort sont des manifestations de l’absolu. En effet, la vie n’est réellement vécue que dans le sens où elle signifie que la mort elle-même est en perspective ou en sursis. Car être en sursis veut dire que l’échéance est différée, mais que la réalisation de l’événement quant à elle ne saurait l’être de façon irréfragable. Se produire quoi qu’il advienne, est pour lui en soi une assurance absolue.
Se présentant d’abord comme épaisseur nocturne opposée à la lumière de la raison, puisqu’il se présente sous la forme d’une indifférenciation initiale, l’absolu semble a priori inaccessible à la raison humaine. Selon les apparences, l’absolu est là comme s’il était absent, comme s’il était indifférent à nos aspirations à le connaître selon la vérité. En effet, l’absolu prend aussi en sa signification sublime la figure du transcendant et celui-ci ne semble pas avoir affaire, de façon directe, avec les préoccupations humaines. En cela consiste sa différence et son ascendance, laquelle consiste à rester distant. Ce qui est absolument distant semble du même coup difficile à identifier.
En effet, l’absolu semble être introuvable aux hommes qui en font l’objet d’une quête essentielle. Christian Berner, se référant à Novalis écrivait ceci : « Nous recherchons l’inconditionné et nous ne trouvons que des choses »[163]. Pour le courant de pensée romantique que représente Novalis, l’absolu est absolument inaccessible. Les choses ont une valeur relative car dans la multiplicité même de leur apparence, elles sont soumises à la causalité. Seulement, le romantisme s’en tient au constat des choses qui sont, sans pour autant s’interroger sur l’existence d’une cause première unifiante. L’inconditionné est un fondement sans fondement, parce que autofondé, cet inconditionné dont l’existence donne à douter à l’esprit humain fini. Toutefois, que l’absolu ne soit pas à la portée de l’homme ne supprime pas notre désir d’absolu. L’homme serait donc attiré par l’inconditionné, et on pourrait dire que ce désir est luimême absolu. Mais dans la logique des romantiques comme cela se manifeste dans la pensée de Schlegel[164]par exemple, l’homme étant caractérisé par la finitude ne peut abriter l’absolu déterminé par son infinité même. Cette essence infinie rapportée à l’absolu explique notre difficulté à le saisir et justifie les approximations entretenues à son sujet quand nous nous décidons à en parler.
La subjectivité de l’absolu
Hegel écrit dans un passage de la Phénoménologie de l’esprit : « De l’absolu il faut dire qu’il est essentiellement résultat, c’est-àdire qu’il est à la fin seulement ce qu’il est en vérité ; en cela consiste proprement sa nature qui est d’être réalité effective, sujet ou développement de soi-même »[165]. De cette proposition hégélienne on peut retenir cette idée, à savoir que l’absolu, contrairement à la manière dont nous avons l’habitude de le concevoir, se présente comme étant sujet. L’absolu c’est justement ce qui a en soi une intériorité et s’oppose de ce fait à l’extériorité, à ce qui est seulement objet, et par conséquent demeure incapable de s’automouvoir. Ce qui est objet en effet, c’est ce qui se tient là comme y étant jeté, et s’expose à tout, y compris à ce qui s’oppose à lui. Concevoir l’absolu comme sujet, c’est lui reconnaître la faculté de la réflexion. Or, admettre que l’absolu est doté d’une telle faculté, c’est aussi reconnaître que l’absolu n’est pas absolument absolu dès le commencement mais que c’est à l’issue d’un développement immanent à soi qu’il acquiert la détermination d’un absolu rendu à l’effectivité.
Or, lorsque l’absolu est ainsi posé comme résultat, la question suivante apparaît à l’esprit : de quoi l’absolu est-il le résultat ? Autrement dit, l’absolu peut-il provenir de ce qui n’est pas a priori lui-même absolu ? Ce qu’il convient de préciser ici, c’est que dans l’esprit de Hegel, l’absolu n’est résultat que de lui-même. Il n’est pas une substance qui proviendrait de quelque chose d’une nature étrangère à soi. Hegel précise par ailleurs que « le besoin de représenter l’absolu comme sujet a conduit à faire usage de propositions comme : Dieu est l’éternel, ou l’ordre moral du monde, ou l’amour, etc … Dans de telles propositions le vrai est posé seulement comme sujet ; il n’est pas présenté encore comme le mouvement de se réfléchir en soi-même »[166]. Ces formes d’absolus qui sont des représentations du sens commun sont des déterminations fixes qui n’ont pas besoin du devenir, incompatible avec leur nature. Tel que conçu par Hegel, l’absolu ne résulte pas de ce qui est autre que soi, car il est au commencement comme le principe ; mais le principe ne saurait être caractérisé par la fixité. « Le commencement, le principe ou l’Absolu, dans son énonciation initiale et immédiate, est seulement l’universel »[167]. A partir de cette proposition hégélienne, il ressort que l’absolu est ce qui est au départ comme étant encore non effectif ; mais comment ce qui ne s’est pas encore rendu à soi, peut-il constituer un fondement pour ce qui est autre que soi ? Comment ce qui paraît manquer d’assise solide et ferme pour soi-même peut-il offrir à l’autre cette même assise nécessaire à son développement ?
Que l’absolu soit aussi le commencement laisse suggérer qu’il est premier, qu’il a des racines solidement enfoncées dans le sol de l’esprit, si bien que les êtres sensibles peuvent s’appuyer sur lui pour s’élever à leur pleine vérité. Dans la Science de la Logique, Hegel donne des précisions sur l’idée de commencement qui, selon lui, n’a pas en soi un caractère absolu. Le commencement a un caractère relatif. Sa relativité est en rapport avec le sujet. Emmanuel Cattin pense justement que le commencement dans sa vérité est un appel à la philosophie qui suppose l’engagement du sujet. Cette invitation à philosopher est une invitation à la découverte de l’absolu. En effet, selon lui, « c’est (…) la simplicité de l’être luimême qui se découvre comme commencement pur »[168]. Un tel point de vue nous conduit à considérer que l’absolu ne se réfugie pas dans le retrait de soi. C’est que, en tant que position même de l’être, il est la position de la condition de la pensée.
La pensée qui est l’effectivité du déploiement du concept est le transparaître de l’être. Elle est le commencement de tout. Elle est particulièrement le commencement de l’homme dans la mesure où l’individu ne commence réellement à s’affirmer comme être à part entière que du moment où il devient capable de penser par soi, c’est-à-dire, d’extérioriser son intériorité par l’usage de la parole. En effet, « l’élément parfait au sein duquel l’intériorité est tout aussi extérieure que l’extériorité est intérieure est une fois encore le langage »[169]. C’est reconnaître que grâce au langage l’homme s’assume comme homme dans le sens plénier du concept. Dire ce qu’on pense est un moyen de se joindre à la communauté des consciences. « Dans la langue se supprime en effet la différence entre la conscience singulière et la conscience universelle »[170]. L’antithèse de la participation à l’élaboration de la communauté des consciences est le silence, posé par incapacité ou par refus. L’état du monde comme horizon de l’homme commence à être une réalité, d’abord dans la pensée de celui-ci. En effet, « la pensée n’est jamais (…) léguée au souvenir, car elle est le souvenir lui-même, l’anamnèse de soi, en laquelle seulement elle devient pensée effective »[171]. Le salut de l’homme ne lui vient donc pas d’une instance extérieure. La logique n’est pas une articulation formelle de concepts ; elle est la substance même du discours car elle est la révélation du sens par la cohérence qu’elle instaure entre les différentes parties de la totalité verbale. Un ensemble d’idées lumineuses, de propositions seulement juxtaposées sans cette articulation interne qui les innerve, demeurent, en leur indifférence mutuelle, des affirmations dépourvues de sens déterminé. Chez Hegel, l’absolu s’identifie au tout ; il peut, de ce point de vue, revêtir la forme de l’esprit : en quel sens ?
La vérité de l’absolu comme esprit
La philosophie platonicienne avait identifié l’absolu à l’immuable. Il était donc situé en dehors du monde sensible et l’homme, en soi frappé de mobilisme, devait, pour y parvenir, faire preuve d’ascèse[172]. Il devait s’exercer par des efforts soutenus et réitérés, s’élever vers lui par la médiation d’une préalable catharsis. Il est clair, suivant cette considération, qu’une distance infranchissable séparait l’homme, quoique doué de raison, de ce qui était ainsi conçu comme étant l’absolu. Celui-ci en effet était assimilé au céleste, au divin, dont la possibilité d’accès restée ouverte à l’homme, était conditionnée cependant par la négation du monde sensible auquel il était par nature, participant. Il en sera autrement dans la philosophie hégélienne. En quel sens ?
Dans la présentation de La philosophie de l’esprit, Bernard Bourgeois souligne d’emblée en quoi l’esprit constitue l’unité de la pensée de Hegel. En effet, écrit-il, « dans l’organisation triadiquetrinitaire-de l’être absolument considéré, l’esprit ne constitue pas seulement-comme tout troisième moment du processus spéculatif le moment, par sa forme, concret ou total, mais il épuise, en sa signification même, le tout de l’absolu »[173]. Et il poursuit « l’esprit en effet, réalise adéquatement le sens absolu de ce qui est »[174]. Si l’esprit désigne l’absolu, s’il l’exprime au mieux, non seulement en tant que moment, mais encore en tant qu’il traduit l’effectivité complète de l’absolu lui-même en sa totalité, cela montre clairement qu’il n’y a aucune différence entre les deux concepts, mais que l’un désigne ce que désigne l’autre, ce qui revient à dire qu’ils réalisent l’unité dans l’expression du contenu. Ainsi, « l’absolu est l’esprit : c’est là la définition la plus haute de l’absolu »[175]. Dès lors, il apparaît que l’absolu n’est nullement situé en dehors de la sphère de l’homme. L’absolu étant esprit, c’est dans la proximité même de l’homme qu’il faut essayer de le trouver car c’est en lui qu’il se fait effectif.
On pourrait penser au sujet de la conception de Hegel que lorsqu’il traite de l’absolu comme esprit, c’est suivant l’universel, et que pour cette raison on ne peut trouver en l’homme la signification d’un absolu de cette qualité. Cependant, si l’homme en sa singularité n’est pas en soi cet esprit en son essence absolue, peut-il y avoir une conception de l’absolu en dehors de l’esprit humain ? Pour répondre à cette question il convient de préciser d’abord que l’homme en soi est participant de l’esprit universel d’une part, et que d’autre part, l’absolu n’est pas autre chose que l’Idée ou la pensée. Or, la pensée n’est pas une substance existante par soi. Toute pensée est pensée par l’homme, elle est la pensée de l’homme. La pensée n’existe donc que dans l’existence de l’homme, être spirituel par excellence. Bernard Bourgeois écrit que pour Hegel, « en un sens absolu, il n’existe bien que l’esprit»[176]. L’esprit est le tout, il est l’essence de ce qui est, il est la transparence de l’absolu qui n’est pas distinct de soi. Il est l’Idée elle-même en acte de soi. C’est dire que l’esprit est soi-même et son autre en unité. Or si nous postulons que ce qui en l’homme est essentiel, est, non pas l’enveloppe sensible que constitue le corps mais bien l’esprit justement, et étant entendu que du point de vue de Hegel la différence entre l’esprit et l’absolu est une différence qu’il faut considérer comme relevant seulement du concept, alors, on peut dire que l’absolu c’est l’homme lui-même. Le sujet pensant est celui qui est habité par l’esprit, lequel le rend universel. Être la demeure de l’esprit, c’est nier la prison de la singularité unilatérale du corps sensible, car l’esprit c’est la raison. En effet, Bernard Bourgeois fait ressortir cette idée fondamentale, à savoir que « Hegel présente tout autant le procès de l’absolu comme celui de l’esprit »21. Ce procès ne signifie autre chose sinon que c’est l’esprit qui, par le truchement du devenir s’affirme pleinement dans l’histoire. De cette manière nous ne pouvons envisager la possibilité d’être de l’absolu qu’à partir de l’esprit immédiat. Si l’absolu n’était quelque chose de spirituel, s’il n’était esprit lui-même sous la forme de l’effectivité, il ne serait vraiment absolu. Peut-on concevoir par exemple l’idée que l’absolu soit quelque chose de matériel ?
Certes, on peut concevoir une telle idée, mais on devra encore douter quant à savoir s’il est réellement quelque chose de matériel. Dans la nomenclature marxiste en effet, la matière est elle-même absolue parce qu’elle a toujours existé. Mais on pourrait adresser à la théorie marxiste la question fondamentale suivante : qu’est-ce que l’absolu et d’où vient la matière ? Car si la matière est quelque chose de réel, elle doit avoir une origine. Mais la vérité de la matière est l’idée car la matière n’existe que pour la pensée qui la conçoit. « L’esprit est la vérité existante de la matière, à savoir que la matière elle-même n’a aucune vérité »[177]; ce qui est ainsi dépourvu de vérité ne saurait prétendre être l’absolu.
À savoir justement d’où la matière provient, Hegel renvoie l’origine de toute chose à l’Idée. La matière étant une composante de la nature est le résultat de l’auto-aliénation de l’Idée. Elle en est un moment. La matière ne saurait donc chez Hegel avoir la détermination de l’absolu car l’absolu, ou « l’Idée logique en son développement est esprit »[178]et « l’Idée logique s’avère (ainsi) comme l’origine absolue de l’absolu en son développement »24. L’absolu se meut, il se fait lui-même dans un mouvement autonome de formation de soi qui est synonyme de consolidation de soi par la maturation. Cela n’introduit-il pas la différence en l’absolu lui-même comme absolu de départ et absolu d’arrivée ayant obtenu sa détermination ultime, non de soi mais de l’automouvement ? Si à bon droit on peut distinguer un absolu immédiat et un absolu issu de la médiation, on ne peut cependant aller jusqu’à déterminer deux absolus opposés l’un à l’autre. L’absolu dans son effectivité ne connaît aucune différence en soi. Il est lui-même le même dans son procès d’accomplissement de soi. L’apparence de différence qui se laisse percevoir en lui est posée par l’automouvement. L’absolu ne saurait donc être distant de soi. Ce qui caractérise l’absolu réconcilié avec soi-même, c’est la proximité essentielle à soi. Non seulement il est proche de soi, mais aussi, il est proche de ce qui est autre que soi car l’absolu se révèle. C’est ce que montre Hegel dans la Phénoménologie de l’esprit lorsqu’il aborde la question de la religion révélée par opposition à la religion naturelle et à la religion esthétique. Dans la religion naturelle, les objets du monde sont pris pour le transcendant, c’est-à-dire, pour l’absolu. Mais il apparaît que l’absolu est irréductible au phénomène, à ce qui est là ici et maintenant. Quant à la religion esthétique, c’est le symbole qui revêt un caractère absolu. En dehors du fait qu’il soit objet de culte, l’objet esthétique est philosophiquement appréhendé comme doué de sens infinis, et la communication avec un tel objet, en ce qu’elle touche à l’âme du sujet, est considérée comme comportant en soi quelque chose d’ineffable qui s’apparente à l’absolu. Au-delà de ce qu’il est, il comporte une signification universelle et non univoque parce que tout homme peut y découvrir du sens.
La particularité de la religion révélée est qu’elle manifeste l’absolu come Idée et non comme objet représenté. Dieu est l’Idée absolue qui se révèle aux humains, pour être proche d’eux. “Dieu s’est fait homme ” veut dire que l’homme s’est en quelque sorte fait Dieu. L’homme ayant rencontré un Dieu auto-révélé, s’est par cela lui-même divinisé. C’est le moment de la réconciliation de deux essences en soi originairement séparées : Dieu étant d’un côté tandis que l’homme est pour sa part lui aussi d’un autre côté. De cette manière, l’aliénation divine se montre ici comme étant la rédemption humaine. Si l’aliénation apparaît généralement comme l’incursion de la différence dans le réel, pour ce qui concerne précisément la religion révélée, elle est l’attestation d’un abaissement qui élève, le séjour dans le négatif de la corporéité qui précède l’ascension. L’ascension est la transcendance de la corporéité, le triomphe total de l’esprit sur la matérialité[179]. L’Idée en tant que fondement n’est pas en soi achevée à son début, mais elle s’achève seulement moyennent sa médiation par la nature qui, rétrospecti-vement, la conduit à elle-même en la spiritualisant et qu’elle spiritua-lise en retour. À partir de ce moment, elle laisse derrière soi tout rapport à la sensibilité et n’a affaire qu’avec soimême. Ainsi, précise Hegel, « toute forme d’art, de religion et de philosophie n’a pas sa place dans l’esprit vraiment absolu »[180]. C’est que l’esprit absolu est, précisément, savoir absolu. « L’esprit absolu est le savoir (au sens général du terme) réel adéquat de l’idée absolue du réel »27. Comme savoir, comment pourra-t-il être autrement que dans la proximité même de l’homme puisque le savoir est avant tout l’idée que l’homme se forme de soi et du monde ? Bien que ce type de savoir comme l’indique Hegel soit épuré de toute référence à la représentation, il reste encore, quoique l’on pense, un savoir qui trouve son centre en l’homme lui-même. La représentation, dans le processus de la connaissance véritable, n’a pas sa fin en elle-même. Si l’homme semble obligé de recourir à elle, c’est en vue de la nier car ce qui est bien visé à travers elle, c’est l’absolu sous sa forme vraie comme résultat. L’art, la religion, en tant que domaines sensibles du savoir sont des médiations vers leur propre négation en quoi consiste l’affirmation de l’absolu comme vérité devenue.
Conclusion
L’absolu, c’est, en définitive, l’esprit, lequel prend les apparences de l’Idée, de la religiosité ou de la pensée spéculative. Comme l’a montré Hegel dans l’Encyclopédie des sciences philosophiques, c’est sous la forme de l’esprit que la religion comme la philosophie appréhendent la vérité. L’homme est fondamentalement un être spirituel. Or en se posant comme tel, il se détermine en même temps comme ayant en soi une parcelle du divin parce que l’esprit est une puissance impérissable et que par sa médiation l’homme aspire à atteindre l’inconditionné. Dès lors, on peut dire que l’absolu n’est pas si éloigné de l’homme comme on est porté souvent à le croire ; il est près de l’homme, il est en lui. L’homme se cherche donc lui-même en recherchant l’absolu, en poursuivant fermement et inlassablement ce qui, de façon immanente, possède l’éternité comme essence, afin d’échapper aux conditions de la temporalité limitante. En effet, la vie est, quant au fond, une invitation à un effort constant de transcen-dance de soi et du monde, un appel à sortir du temps.
Bibliographie
- BERNER, Christian, La philosophie de Schleiermacher. « Herméneutique », « dialectique », « Éthique », Paris, Cerf, 1995.
- BOURGEOIS, Bernard, Le droit naturel de Hegel. Contribution à l’étude de la genèse de la spéculation hégélienne, Paris, Vrin, 1986.
- CATTIN, Emmanuel, La décision de philosopher, Zürich, Georg Olms, 2005.
- FICHTE, Johann Gottlieb, Œuvres choisies de philosophie première. La doctrine de la science (1794-1797), Paris, Vrin, 1999, trad. Alexis Philonenko.
- FISCHBACH, Franck, Du commencement en Philosophie. Étude sur Hegel et Schelling, Paris, Vrin, 1999.
- GUIBAL, Francis, Dieu selon Hegel, Paris, Aubier, 1975.
- GROSOS, Philippe, Système et subjectivité, Paris, Vrin, 1996.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La Phénoménologie de l’esprit, t. I et II, Paris, Aubier, 1941, trad. Jean Hyppolite.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopédie des Sciences philosophiques, t. III, La philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, 1988, trad. Bernard Bourgeois.
10.HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Principes de la philosophie du droit, Paris, Vrin, 1989, trad. Robert Dérathé.
11.KOJÈVE, Alexandre, Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1947.
12.LONGUENESSE, Béatrice, Hegel et la critique de la métaphysique, Paris, Vrin, 1981.
13.MABILLE, Bernard, L’épreuve de la contingence, Paris, Aubier, 1999.
14.MARQUET, Jean François, Leçons sur la Phénoménologie de l’esprit, Paris, Ellipses, 2004.
15.PAYOT, Daniel, La statue de Heidegger. Art, Vérité, Souveraineté, Strasbourg, Circé, 1998.
16.SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Exposition de mon système de la philosophie, Paris, Vrin, 2000, trad. Emmanuel Cattin.
17.THOUARD, Denis, Symphilosophie. Schlegel à Iéna, (Thouard Denis éditeur), éd. Vrin, Paris, 2002.
HEGEL ET LES LUMIÈRES : ADVERSITÉ RÉSOLUE OU
EXPRESSION D’UN SUBTIL MODE DE PENSÉE DIALECTIQUE ?
Abou SANGARÉ
Maître-assistant
Université de Bouaké – Côte d’Ivoire
RÉSUMÉ
Hegel est souvent présenté comme un farouche adversaire des Lumières. Cette appréciation, bien que répondant à certains aspects de sa philosophie, fait fi du crédit qu’il porte aux Lumières françaises qui ont vaillamment combattu ce que lui-même, à leur école, a étudié et critiqué sous le nom de positivité. D’ailleurs, présenter Hegel comme un adversaire résolu des Lumières, ne serait-il pas un reniement absolu de la dialectique, lieu d’enracinement de son philosopher dans sa globalité ?
MOTS CLÉS
Lumières-Entendement-Positivité-Réflexion-Détermination-Raison
ABSTRACT
Hegel is often presented as a fierce opponent of the Enlightenment. This assessment, while complying with certain aspects of his philosophy, ignores the importance he gives to the French Enlightenment which bravely fought what he himself, at their school, studied and criticized under the name of positivity. Moreover, presenting Hegel as a staunch opponent of the Enlightenment, wouldn’t it be an absolute denial of the dialectic where his whole philosophy takes its root?
KEYWORDS
Enlightenment, Understanding, Positivity, Thought, Determination,
Reason
Introduction
Sans conteste, les Lumières ont exprimé l’une des figures successives de l’Esprit du monde. La clarté qu’elles ont insufflée dans la réalité objective ne pouvait que conduire l’humanité à espérer harmonie, quiétude et bonheur. Avec leur avènement, plus rien d’insurmontable, parce que confus, ne pouvait se dresser devant l’esprit en quête de savoir : religion, organisation sociale, pouvoir politique, en somme, tout ce qui constituait l’armature de la société traditionnelle, et qui s’imposait a priori aux individus, sera désormais convoqué devant le tribunal de la raison. Ce qui avait été mis en œuvre, depuis le 16ème siècle, par des penseurs relativement isolés, (si l’on pense à Machiavel, Montaigne, Hobbes, Locke, Descartes) devient, au cours du 18ème siècle, un mouvement intellectuel, social et politique qui touche progressivement toutes les couches cultivées du continent européen, en mettant fin à l’obscurité.
Les Lumières ont fait preuve d’une formidable conscience de soi en saisissant en profondeur le caractère original de leur mouvement intellectuel. Elles prétendaient, comme leurs prédécesseurs, apporter des réponses définitives à des questions éternelles que ceux-ci, simplement, n’avaient pas bien comprises puisqu’elles se croyaient armées, de la pure raison absolue et immuable. De cette façon, elles pourraient même s’indigner qu’on pût supposer d’autres formes de pensées rationnelles qui leur soient supérieures puisqu’elles supposaient qu’il n’y avait plus rien à faire de la vie sociale qu’à la modifier pour la conformer à leurs directives. Elles ont déterminé et fixé le moment de naissance, le temps de la croissance et de l’expansion de leur mouvement qui a fait suite à la crise culturelle de l’Europe entre 1680 et 1715, sans en envisager une issue, un dépassement et une fin.
Mais bien que survivant encore pâlement dans des prolongements actuels de la philosophie, l’esprit du monde qui, en elles s’était incarné s’est, depuis, évacué dans d’autres avatars comme l’exige la dialectique de la vie et de la mort. Cette désincarnation comme évocation de la “caducité” d’un esprit est pour nous l’indice d’un moment nécessaire de passage d’une figure inférieure à une autre plus supérieure, car l’esprit va toujours de l’avant. Ainsi que le disent Jarczyk et Labarrière, « la Vollendung d’une figure est la condition d’un rebondissement expressif qui détermine le surgissement d’une autre figure »[181].
Précisément, parce qu’elles tentent d’engourdir le présent sans vouloir tourner la page, en s’élevant à une sorte de prétention exceptionnelle à l’éternité, Hegel va leur rappeler le sens historique, car l’une des tâches fondamentales de toute pensée vivante consiste à venir à bout des survivances, à liquider les anachronismes. Et, pour leur avoir appliqué ce que l’on pourrait, en régime spéculatif, appeler le critère de la désuétude, Hegel a souvent été qualifié d’adversaire résolu. Mais un examen patient et endurant de leurs rapports ne peut-il pas apporter des nuances à cette qualification? Sa considération péjorative des Lumières comme philosophie de l’entendement, suffit-elle à le tenir pour leur adversaire radical ? Son enthousiasme pour la Révolution française n’est-il pas la marque de son admiration pour les Lumières françaises ?
I- Les Lumières : expression d’une philosophie de l’entendement
La philosophie des Lumières, malgré son immense et louable effort, malgré sa valeureuse activité négative, reste, aux yeux de Hegel, la proie du dogmatisme, de la parcellarité et de la partialité. Presque tous les domaines, religieux, socio-politique, philosophique sont concernés par cette partialité. Les Lumières distinguent, opposent les notions, les contraires de façon systématique. En les distinguant ainsi, elles n’accomplissent seulement qu’une moitié du chemin à parcourir puisqu’il convient, désormais, de sauvegarder l’unité et même l’identité de ce qui est différent, d’assurer la relativité et la disparition nécessaire des objets finis, de lever les contradictions, de se placer à un niveau synoptique et englobant qui surpasse l’unilatéralité, sans pour autant la brimer.
Malgré cette remarquable perspicacité de leur entreprise critique, Hegel leur a courageusement opposé l’idée que ce n’était pas encore la véritable raison qui se manifestait en elles, mais plutôt un moment, à vrai dire, indispensable de son développement : l’entendement (Verstand), qu’il faut soigneusement distinguer de la raison (Vernuft), bien qu’ils ne puissent fonctionner l’un sans l’autre.
« L’entendement détermine, dit-il, fixe les déterminations ; la raison, quant à elle, est négative et dialectique, parce qu’elle réduit à rien les déterminations de l’entendement. Elle est tout aussi positive parce qu’elle produit l’universel et subsume, en lui, le particulier »[182].
La confiance exclusive des Lumières en l’entendement, leur unilatéralité systématique leur a fait exclure ou nier des réalités auxquelles la pensée spéculative ne peut simplement renoncer : les sentiments, la foi. Il s’agit, pour Hegel, de donner droit de cité à ces réalités que les Lumières avaient inconsidérément bradées, mais sans consentir à s’y réduire. C’est pourquoi, vigoureuses que soient ses critiques contre les Lumières, Hegel ne s’est rallié à aucune de ces philosophies typiquement constituées : sentimentalisme, romantisme, mysticisme. Il ne critique pas le rationalisme des Lumières, du point de vue du romantisme, mais du point de vue d’un rationalisme supérieur. Il ne chasse pas la raison pour faire place au sentiment mais il tente de cultiver une raison qui soit aussi capable de comprendre le sentiment, de lui conférer une signification, de le récupérer.
Dans la philosophie des Lumières, Hegel ne voit qu’une simple philosophie de la réflexion contre laquelle Glauben und Wissen, (Foi et savoir), un article au sous-titre fort saisissant, (la philosophie de la réflexion de la subjectivité dans l’intégralité de ses formes, en tant que philosophies de Kant, de Jacobi et de Fichte), inaugure un combat. Foi et savoir, c’est la manifestation d’une philosophie qui se décline en reproches. Son combat essentiel est de s’attaquer aux oppositions figées de l’entendement qui n’arrive pas à surmonter le point de vue analytique de la réflexion. Mais comment une philosophie, idéaliste, peut-elle s’attaquer à la réflexion qui est l’instrument même de l’activité philosophique ? Qu’est-ce que pour nous, lever cette difficulté, sinon, avant tout, saisir l’intuition de ce concept dans le champ spéculatif hégélien en interrogeant Hegel lui-même ?
« Par réflexion, dit-il, il faut entendre cette fonction psychologique qui s’oppose essentiellement à l’action, implique une sorte d’inhibition de la volonté, une résistance à la spontanéité et une attention intérieure à un objet. Cette fonction arrête, fixe le mouvement, aboutit à une détermination qu’elle sépare d’une autre. Elle est l’œuvre de l’entendement dont elle utilise les concepts. Elle suppose un choix (Entscheidung) et une distinction (Unterscheidung). Les philosophies qui se reposent sur les produits de ce discernement sont les philosophies de la réflexion ou de l’entendement »[183].
Bien comprise, c’est-à-dire spéculativement ou conceptuellement, la philosophie de l’entendement est une pensée qui s’arrête à des limites et à des oppositions, qui ne peut découvrir l’ultime réconciliation.
Les antinomies kantiennes, préfiguration directe de la contradiction qui est au fond du procès dialectique, sont ici visées puisqu’elles constituent l’une des déterminations de cette fixation opérée par l’entendement. Cette référence aux antinomies kantiennes n’exige-t-elle pas un bref séjour dans le corpus kantien afin d’y voir pourquoi et comment elles ont pu être mises à l’index comme philosophie type de la séparation? En effet, selon Kant, la raison, dans son effort et sa prétention de déterminer l’univers, l’inconditionné ultime d’où est issu tout conditionné, se prend elle-même dans des conflits insolubles (antinomies) car elle aboutit à des thèses contradictoires dont chacune semble vraie, juste et démontrable. Chacun des quatre groupes d’antinomie examinés dans la Critique de la raison pure donne, avec éloquence, la preuve de la séparation rigide, de la mutuelle exclusion ou incompatibilité, prototype de toute philosophie de l’entendement. Le lieu n’étant pas indiqué pour les exposer tous, nous nous contenterons du premier qui, reposant sur l’impossibilité d’une série infinie de phénomènes et la nécessité de s’arrêter quelque part, marquant les limites de l’espace et du temps, affirme comme thèse que « le monde a un commencement dans le temps et il est aussi limité dans l’espace »[184]. L’antithèse, se demandant pourquoi l’on devrait s’arrêter ici plutôt que là, arrive à la conclusion que « le monde n’a ni commencement dans le temps ni limites dans l’espace, mais il est infini dans le temps comme dans l’espace »[185]. Mais la philosophie de Kant a eu tant de prestige et fait tellement époque que se déclarer contre elle ou s’efforcer d’y voir des faiblesses, c’est risquer de tomber dans le principe même du kantisme avec plus de confusion et moins de pureté. Ne dit-on pas souvent que quand un système fait époque, la première chose qui s’offre aux yeux, ce sont les malentendus et la maladresse de ses adversaires ? Pour nous, ce recours dialectique à Kant, c’est-à-dire pouvoir trouver à redire sur sa pensée, ne diminue en rien le mérite de ce grand esprit illuminé. Hegel luimême ne disait-il pas de sa philosophie qu’elle est
« la base et le point de départ de la philosophie moderne […] tant elle s’engage de près en d’importants aspects plus déterminés du logique, alors que les présentations ultérieures de la philosophie n’en ont guère tenu compte, et, pour une part d’entre elles, n’ont manifesté souvent là contre qu’un mépris grossier »[186].
C’est pourquoi nous prendrons volontiers le risque d’interroger ses antinomies, modèles de limitation, à la lumière du penser spéculatif hégélien qui ne désigne pas seulement l’aspect formel et théorique d’une connaissance quelconque, par opposition à sa validité concrète, mais son procès total dans l’identité de sa certitude subjective et de sa vérité objective.
Les antinomies kantiennes, disions-nous, demeurent la prise en compte des termes fixés dans une extériorité irréconciliable, alors que le véritable mouvement rationnel les reprend comme les moments d’une unique totalité en devenir. Deux déterminations, en tant qu’elles sont opposées et nécessaires au même concept, ne peuvent valoir, dans leur unilatéralité, chacune pour soi, mais en ce qu’elles n’ont leur vérité que dans leur être sursumé. Kant a bien mis en lumière les aspects antithétiques de la réalité à l’aide de ces antinomies. Mais il a figé, dans une opposition statique, les termes de cette relation. La véritable dialectique surgit dès lors qu’un unique mouvement rassemble ces deux termes et interdit de les saisir comme des totalités extérieures l’une à l’autre.
Une telle philosophie (de l’entendement) mérite d’être dialectisée, soit grâce à la religion, fondatrice d’unité, symbole de dépassement de toute séparation, expression de l’élévation de l’homme, de la vie finie à celle infinie, soit grâce à la philosophie spéculative qui, loin d’être l’exercice abstrait du connaître par opposition à quelque savoir pratique, signifie, dans son identité au dialectique, le mouvement du concept, autrement dit l’auto-développement du réel entendu comme totalité en deçà de toute opposition. Avec un tel souci de réconciliation, ne convient-il pas de définir la philosophie comme une science dont le rôle est de libérer de leur rigidité les oppositions figées, de situer la division dans l’absolu lui-même, et de le saisir comme totalité prégnante de tensions, comme vie et comme esprits ?
Hegel ne disait-il pas, à ce propos, dans ses premières publications, que
« lorsque la puissance d’unification disparaît de la vie des hommes, et que les oppositions, ayant perdu leur vivante relation et leur action réciproque, ont acquis leur indépendance, alors naît le besoin de la philosophie »[187]?
Certes, il est requis que la réflexion pose des limites et des séparations, mais il faut également admettre qu’elle disparaisse ou s’anéantisse ellemême en tant qu’entendement, si sa seule fonction est de séparer et de limiter aux fins de s’élever pour devenir la raison qui saisit l’absolu sous la forme qui lui convient, c’est-à-dire comme une totalité objective, un tout de savoir, une organisation de connaissances où chaque partie est en même temps le tout. Ainsi, la philosophie ne peut se contenter de se satisfaire des principes que lui procure l’entendement dont l’obstination, l’amour propre, la jalousie ne produit que la réflexion isolée qui pose et fixe les opposés, donc qui supprime l’absolu. Pour ne pas courir le risque de demeurer prisonnière des limitations et de rester par son contenu quelque chose d’accidentel, la philosophie doit se constituer en science qui, par essence, est systématique. De cette façon, elle peut concevoir, de manière de plus en plus claire, une méthode qui, non contente de s’arrêter aux oppositions et de décrire leur simple rencontre, les domine plutôt et les situe dans une totalité, toute chose qui permettra, du même coup, de les conserver.
Mais la réflexion ne fait pas seulement que des ravages dans l’esprit. En effet, si elle le met en relation avec l’absolu, c’est-à-dire si elle lui donne le goût d’organiser ses connaissances en une totalité, en un système, alors elle fait œuvre rationnelle. Et, son usage, dans une telle perspective, est salutaire et louable, car il évite l’écueil inférieur du morcellement de l’entendement et celui supérieur d’une intuition prématurée si fréquente chez les Lumières.
Isolée, en tant que limitation, la réflexion est déficiente, et n’a de sens que par sa connexion avec le tout. C’est donc seulement dans la mesure où elle a rapport à l’absolu qu’elle est raison, et que son acte est un savoir.
Supprimer les oppositions fixées, tel est, dans le champ spéculatif de Hegel, la tâche de la raison. Cet intérêt, qui est le sien, ne signifie pas qu’elle s’oppose absolument à l’opposition et à la limitation, car la raison nécessaire est un facteur de la vie qui se façonne par de perpétuelles oppositions, et la totalité n’est possible dans la suprême vitalité qu’en se restaurant au sein de la suprême scission. Que peut signifier une telle assertion sinon que les distinctions, les différences sont, elles aussi, précieuses. Sans leur insistance, comment eût-on pu découvrir la voie dialectique de leur négation ? Elles sont certes nécessaires, mais c’est seul le besoin de les surmonter qui nous redonne la conscience de notre raison, en l’espèce d’une activité infinie qui ne s’arrête pas aux analyses, mais progresse toujours vers une synthèse.
Chaque être que produit l’entendement est déterminé, conditionné, mais tout conditionné a un inconditionné qui l’englobe. L’entendement, dans son déploiement, laisse subsister, côte à côte, dans leur opposition non réduite, le conditionné et l’inconditionné, la finitude et l’infinitude, et maintient l’être en face du non-être. Tendant par essence à une complète détermination, et son être déterminé étant toujours immédiatement limité par un indéterminé, l’entendement ne peut jamais remplir complètement sa tâche puisque dès qu’a lieu l’acte de position et de détermination, ont lieu aussi une non-position et un indéterminé dont les existences doivent se résoudre dans et par la raison.
Au total, l’entendement est une faculté qui divise les réalités et les saisit dans leurs déterminations séparées. Mais la nécessité qu’il y a de les rassembler dans un tout, lui impose, dans une sorte d’auto-invitation, à s’accomplir au-delà de lui-même dans une faculté plus intégrative : la raison. S’il n’opère pas cette dialectique, il va demeurer prisonnier de ses analyses formelles et se verra contraint de rechercher, dans l’immédiateté sensible, le principe d’unité qui lui fait défaut. Tel est le cas de la philosophie de Kant, condamnée à l’abstraction formelle d’une analyse des catégories, et à une dépendance à la sensibilité. Les Lumières, qu’elles soient françaises ou allemandes, en raison de leur qualification comme philosophie de l’entendement, ne peuvent pas satisfaire aux attentes de Hegel. Toutefois, s’il était réduit au malheur d’entrer dans un parti, il adopterait plus volontiers les Lumières françaises qu’il préfère à l’Aufklärung.
II – Hegel, les Lumières françaises et l’Aufklärung
C’est un préjugé très répandu, et solidement enraciné, que Hegel, philosophe de la restauration, penseur des temps de Sainte Alliance, auteur des théories politiques et religieuses réactionnaires, proclamant lui-même son inspiration chrétienne, ne peut rien devoir aux Lumières dont les critiques sont universellement acides contre la religion chrétienne. Nous voulons, ici, faire apparaître l’admiration hégélienne des Lumières françaises à travers un cas particulier, celui de Voltaire, qui peut apparaître comme étant défavorable puisque les érudits ont plutôt insisté sur les différences et oppositions entre les deux penseurs, en excluant l’hypothèse même d’une influence de l’un (Voltaire) sur l’autre (Hegel). Ne convient-il pas de rappeler ici la différence, et à certains égards, l’opposition que Hegel établit entre les Lumières françaises, qu’il admire et l’Aufklärung allemande qu’il méprise ?
En effet, Hegel distingue, en les opposant nettement, les formes que le courant des Lumières a revêtues en Allemagne et en France. Il ne confond pas l’Aufklärung allemande et les Lumières françaises. Son compte rendu des Hamanns schriften pose et justifie cette distinction de l’esprit pensant, scintillant qui, placé en des situations différentes, ne s’est pas engagé dans la même voie en France et en Allemagne. Selon lui, l’Aufklärung a, en Allemagne, une origine universitaire et scolaire. Ce sont des maîtres d’école et des pasteurs qui en sont les initiateurs.
Ensuite, elle a, en quelque sorte, contaminé la société en revêtant la forme systématique de la philosophie wolffienne. Sans doute, s’est-elle attaquée aux formes positives et historiques de la religion et de l’État, mais avec beaucoup de prudence, et d’une manière fade, ennuyeuse, sans faire preuve, en cela, d’originalité ni de vitalité spirituelle. Elle répandait à sa façon, en Allemagne, les principes de tolérance et de moralité ainsi que le déisme dont, en France, Voltaire et Rousseau s’en faisaient les défenseurs. Mais, en France, les philosophes qui n’étaient ni des pasteurs, ni des professeurs, s’adressaient non aux classes moyennes, mais aux personnages les plus haut placés de la nation, les plus influents et les plus cultivés. En France, les Lumières sont un mouvement intellectuel énergique, qui s’est manifestement exprimé dans la réalité à travers la Révolution Française pour laquelle l’admiration de Hegel ne faiblit jamais et dont il tient les principales conquêtes pour irréversibles. Par contre, en Allemagne, l’Aufklärung est restée un mouvement froid, plat et languissant, en raison de l’itinéraire purement moral et théorique induit par sa trop grande proximité de la théologie qui avait déjà tout amélioré par la reforme.
Si discutables que soient les raisons de cette distinction, elle ne manque pas, à nos yeux, d’une certaine pertinence puisqu’elle a permis à Hegel de déceler dans les Lumières françaises les germes d’une philosophie plus haute, même s’il s’agit bien encore, avec elles, de ce qu’il appelle péjorativement philosophie de l’entendement. Cependant, les Français, estime-t-il, font preuve d’esprit qui s’élève au-dessus des ratiocinations du Verstand (entendement) et se rapprochent de ce qu’il appelle précisément la raison. Jacques d’Hondt, dans un article restituant cette admiration, écrit:
« Ce que les Français tiennent pour le meilleur moyen de plaire, c’est ce qu’ils nomment l’esprit. Cet esprit, chez les penseurs superficiels, se contente de combiner ensemble des représentations qui sont éloignées les unes des autres, mais chez les hommes pleins d’esprits tels que, par exemple Montesquieu et Voltaire, il s’élève, par la réunion de ce que l’entendement avait séparé, à une forme géniale du rationnel »[188].
L’admiration hégélienne de Voltaire est étonnamment exposée dans Foi et savoir, où Voltaire est présenté d’une manière surprenante pour un lecteur qui aurait d’abord parcouru la Phénoménologie de l’esprit et n’aurait pas été sensible à toutes les nuances de ce texte. À la fin de Foi et savoir, Voltaire intervient dans une discussion passionnée et passionnante de la philosophie de Fichte. On pourrait même déjà s’étonner de ce recours à Voltaire dans une œuvre de haute teneur philosophique, car il y est question, pour Hegel, d’apprécier les différences et défaillances respectives des systèmes de Kant, de Fichte et de Jacobi. Hegel ne juge pas Voltaire indigne d’être comparé à Fichte. Bien plus, de leur confrontation, Voltaire sort vainqueur.
En effet, à l’époque où il écrivait Foi et savoir, Hegel pensait déjà à un système dans lequel la nature, tout en s’opposant au concept, représentera un moment de son développement, gardant ainsi toujours la possibilité d’être récupérée. Ainsi, il regardait avec méfiance toute philosophie, en l’occurrence celle de Fichte, qui tient la nature pour absolument irréductible à l’esprit et, à laquelle il oppose sa propre conception du rapport de l’homme à la nature, et aussi, en un sens, la pensée de Voltaire sur ce point ; puisqu’il trouvait en germe, chez ce dernier, une critique spirituelle de l’entendement dogmatique. Cette supériorité, cette avance de Voltaire, Hegel les avait déjà reconnues, lorsqu’il écrivait les chapitres de la Phénoménologie de l’esprit qui présente de manière si équivoque la victoire des Lumières sur la foi, croyance grossière, naïve, mal épurée qui s’abandonne à la superstition. Mais, Hegel ne peut accepter que, s’attaquant à juste titre aux superstitions, les Lumières se laissent aller jusqu’à rejeter toute religion, et spécialement la religion chrétienne. Dans leur fureur antireligieuse, les principaux philosophes des Lumières ont jeté le bébé avec l’eau sale du bain. Hegel veut alors sauvegarder la religion vraie, qu’il a d’ailleurs tendance à traduire dans les termes de sa philosophie idéaliste. C’est pourquoi il opère une sorte de tri parmi les croyances religieuses et en prélève quelques unes qu’il tient pour philosophiquement admissibles : l’existence d’un Dieu concret et connaissable, l’existence et l’enseignement de JésusChrist, la Trinité.
Aux yeux de Hegel, la philosophie de l’entendement a atteint, si l’on ose le dire, le sommet de la platitude dans les Lumières que la Phénoménologie de l’esprit soumet à une critique impitoyable. Cependant, il proclame, dans ses Premières publications, que « le comportement de Voltaire est un exemple de l’authentique bon sens, que cet homme a possédé à un si haut degré »[189]. Mais comment Hegel, qui décrit une étape du développement de la conscience qui correspond historiquement à la « lutte des Lumières contre la foi » au 18ème siècle, aurait-il pu gracier Voltaire dans la réprobation de tout ce mouvement de pensée ? L’abondance et la diversité des citations, des allusions, parfois discrètes, témoignent chez lui d’une influence certaine de Voltaire. Tout lecteur perspicace et sensible aux résonances d’une littérature française intimement familière, peut tout de suite, sentir ce que le chapitre sur « l’esprit devenu étranger à lui-même, et la culture » de la Phénoménologie, peut devoir à Voltaire, tant il y est perceptible l’écho de maints propos voltairiens déclinés en d’évidentes allusions. Ainsi, dans une phrase de la Phénoménologie de l’esprit où Hegel évoque « la pâte à pain qui a poussé sur le champ »[190], il rappelle aussi la définition que l’Aufklärung a donnée de l’objet absolu de la foi : « Un morceau de pierre, un bloc de bois qui a des yeux et qui ne voit pas »11. Cette critique de l’idolâtrie, qui peut être subtilement rapprochée de ce texte de Voltaire, est reprise par D’Hondt :
« Ne voient-ils pas aussi que les mêmes raisons qui démontrent la vanité des dieux ou des idoles de bois, de pierre que les païens adoraient, démontrent pareillement la vanité des dieux et des idoles de pâte et de farine que nos déichristicoles adorent ? Par quel endroit se moquent-ils de la fausseté des dieux des païens ? N’est-ce point parce que ce ne sont que des ouvrages de la main des hommes, des images muettes et insensibles ? Et que sont donc nos dieux, que nous tenons enfermés dans des boîtes de peur des souris ? »[191][192].
Transparaît ici, dans ce texte, la crainte obsédante de la souris scandaleuse qui va aussi glisser son museau rongeur au détour d’une leçon de Hegel au travers d’une anecdote, aux dires de Rudolf Haym, que Hegel aurait utilisé contre la doctrine catholique de l’eucharistie, dont il dénonçait avec violence, le caractère matériel, sensible et transubstantiel.
Avec l’intention explicite de démontrer la profondeur et la rigueur de son luthéranisme, Hegel ajouta, « sans doute à titre d’exemple, qu’un casuiste avait prétendu d’une manière tout à fait conséquente, que si une souris dévorait l’hostie consacrée et donc recélait dans son corps le véritable corps du Christ, le catholique devrait s’agenouiller devant cette souris et devrait l’adorer »[193].
Nous analyserons, en d’autres occasions, ces critiques des représentations catholiques de l’eucharistie à la lumière des requisits de la tolérance œcuménique.
C’est aussi la critique des données historiques et positives de la Bible, c’est-à-dire les miracles, qui, dans l’œuvre de Voltaire, suscite le plus d’indignation chez les chrétiens ordinaires que Hegel approuve sans réserve et qu’il reprend à son compte, en tentant le plus souvent d’en rejeter la responsabilité sur le luthéranisme. Contre les miracles, Hegel laisse la même irritation que Voltaire. Certes, admet-il, la foi peut, par souci de persuasion, se présenter d’abord dans des formes extérieures et sensibles, chercher à se rattacher à des miracles où des évènements historiques, mais elle ne doit pas rester à ce niveau puéril. Le Christ luimême ne s’est-il pas déclaré contre les miracles en réprimandant les Juifs qui ne croyaient que ce qu’ils voyaient ? « L’esprit vous conduira en toute vérité »[194], leur disait-il. L’authenticité de ce propos contre l’historicité ne donne-t-elle pas à voir que la vraie foi ne surgit qu’après, quand la première foi, extérieure et sensible, a été dépassée ?
Il n’est pas sans intérêt de signaler au passage, pour clore cette partie, que Hegel est bien un philosophe du 19ème siècle. De fait, il ne publie de travaux personnels qu’après 1800. À preuve, la Phénoménologie de l’esprit, sa première grande œuvre, méconnue du grand public au moment de sa parution, a été publiée en 1807. Mais cette localisation historique de son œuvre fait souvent oublier que, né en 1770, Hegel a passé la moitié de sa vie dans le 18ème siècle où il s’est formé. Il convient, même si nous ne sommes pas en psychanalyse, de tenir compte de la durée d’une enfance, certes dénuée d’activité intellectuelle, mais qui reçoit des empreintes indélébiles et l’influence de l’adolescence et de la jeunesse qui, elles, forgent un caractère, éveillent une vocation, orientent parfois définitivement une pensée. Or Hegel a vécu son enfance et sa jeunesse au siècle des Lumières. D’ailleurs, les Lumières, même si elles se sont épanouies au 18ème siècle, ne se sont pas, d’un seul coup, au début du
19ème, éteintes.
Conclusion
Du point de vue théorique dans lequel se situe Hegel, son rapport aux Lumières ne peut être purement et exclusivement négatif. Un rejet et une négation absolus des Lumières iraient à l’encontre du mode de penser qu’il prétend instaurer : le mode de pensée dialectique et historique. Précisément, il reproche aux Lumières d’ignorer la manière historique et dialectique de penser, et ce sera, à bien y réfléchir, en fin de compte, sa principale critique contre elles. Si sa conception du caractère historique des systèmes lui impose de les condamner tous quand ils ont fait leurs temps, elle lui commande aussi de les conserver en les continuant et en les prolongeant pour les élever à une vérité nouvelle et supérieure. Détruire, conserver, élever, sont-ce là les trois moments indissociables de l’opération hégélienne par excellence : l’Aufhebung. Une fois que ce concept est reconnu comme tel, pourrait toutefois subsister une difficulté : celle qui consiste à moduler ses moments, à désigner, dans un passage historique, ce qui est détruit, ce qui persiste et ce à quoi le tout s’élève. Hegel ne peut repousser absolument en bloc les Lumières, un courant intellectuel qui, à son avis, a conduit à la Révolution française pour laquelle son admiration ne faiblit jamais, même s’il en condamne les éléments terrifiants, et dont il tient les principales conquêtes pour irréversibles. Idéaliste, il croit que ce sont les Idées qui, en dernière instance, mènent le peuple : « L’idée est en vérité ce qui mène les peuples et le monde, et c’est l’esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire, qui a guidé et continue de guider les évènements du monde »[195].
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- BOURGEOIS, Bernard, Études hégéliennes : Raison et décision, Paris, PUF, 1992.
- D’HONDT, Jacques, Hegel et les Français, Zürich, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1998.
- HAYM, Rudolf, Hegel et son temps, trad. Pierre Osmo, Paris, Gallimard, 2008.
- HEGEL, Georg Wilhem Friedrich, Principes de la philosophie du droit, Trad. A. Kaan, Paris, Gallimard, 1940.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, T1, Trad. J.Hyppolite Aubier Montaigne, Paris, 1947.
- HEGEL, Friedrich, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. J. Gibelin, Paris, Gallimard, 1954.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La raison dans l’histoire, Trad.
K. Papaioannou, 10/18, 1965. :
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La science de la logique, T1, trad. Labarrière et Jarczyk, Paris, Aubier Montaigne, 1972.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, T2, trad. J. Hyppolite, Paris, Aubier Montaigne, 1975.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Premières publications, trad. Marcel Méry, Paris Ophrys, 1975.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Trad. J.Gibelin, Paris, J.Vrin 1979.
- JARCZYK, Gwendoline et LABARRIÈRE, Pierre-Jean, De Kojève à Hegel : 150 ans de pensée hégélienne en France, Albin Michel, 1996.
- KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, Trad.
Tremesaygues et Pacaud, PUF, 1950.
- KANT, Emmanuel, Réponse à la question : « Qu’est-ce que les Lumières ?», Trad.Wismann, Paris, Gallimard, 1985.
- VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, Paris, Garnier, 1963.
DE L’ESTHÉTIQUE NEGRO-AFRICAINE COMME QUÊTE INLASSABLE DU GRAAL AFRIQUE.
Samba DIAKITÉ
Maître de Conférences
Université de Bouaké – Côte d’Ivoire
RÉSUMÉ : L’esthétique négro-africaine a été considérée comme un avatar psychologique, une parenthèse du savoir, un envers du développement. Pour amorcer son développement et promouvoir sa culture, les auteurs de la Négritude avaient brandi l’art négro-africain comme le symbole de la renaissance et de la reconnaissance africaine. A partir de ce moment, l’Esthétique s’allie à la politique et ne peut être autrement car l’art dévoile L’identité des peuples et conçoit leur cheminement dans l’histoire. Mots-clés : Afrique – Art – Culture – Développement – Esthétique – Graal Liberté Politique.
ABSTRACT: Black African esthetics has been considered as a psychological avatar, a parenthesis of knowledge, another side of development. To initiate its development and promote its culture, the authors of negritude had brandished black African art as a symbol of rebirth and African recognizing. From that moment, esthetics goes with politics and can’t be otherwise, because art reveals peoples’ identity and design their historical path.
Keywords: Africa – Art – Culture – Development – Esthetics – Grail –
Political freedom.
INTRODUCTION
Dans l’avant –propos de son ouvrage « Qu’est-ce que l’esthétique ? », Marc Jimenez écrivait : « Il y a seulement une vingtaine d’années, le mot « esthétique », employé pour désigner la réflexion philosophique sur l’art, apparaissait prématurément vieilli. Bien que son sens moderne ne date que du XVIIIè siècle, il semblait désuet et prêt à disparaître. Certains philosophes allaient jusqu’à déclarer de façon humoristique, que « dans une histoire bicentenaire depuis le milieu du XVIIIè siècle jusqu’au milieu du XXè siècle, l’esthétique s’est révélée comme un insuccès brillant et plein de résultats »
A quoi tient ce paradoxe ? Certainement aux diverses significations du mot esthétique ; »[196]C’est dire que l’Esthétique, à peine née, est confrontée à sa propre définition. Appliquée à l’Afrique, elle semble être totalement dépourvue de sens surtout que ce continent est déjà confronté à la difficile problématique de l’existence d’une philosophie .De ce point de vue, l’esthétique négro-africaine ne serait qu’un leurre, une simple vue de l’esprit dans la mesure où son objet, l’art, est lui-même sujet à controverse, « un domaine à part, et de surcroît, ambigu. lié à une pratique, il engendre des objets palpables ou donne lieu à des manifestations concrètes qui prennent place dans la réalité : il se prête à des expositions dans tous les sens du mot. Pour reprendre une formule du grand historien et sociologue de l’art Pierre Fanscatel, « l’art n’est pas velléité mais réalisation ». Cependant , l’art ne se contente pas d’être là, car il signifie aussi une manière de représenter le monde , de figurer un univers symbolique lié à notre sensibilité , à notre intuition , à notre imaginaire , à nos fantasmes . C’est son côté abstrait. En somme, l’art s’ancre dans la réalité sans être pleinement réel en déployant un monde illusoire dans lequel , souvent- mais pas toujours -nous croyons qu’il ferait mieux vivre que dans la vie quotidienne »[197].
Comment promouvoir, par l’art, une culture africaine qui puisse peindre la nature par des symbolismes et des figures ? On mesure sans peine la difficulté de cette tâche, surtout à cause de l’ambiguïté de l’art dont nous avons parlée avec Marc Jimenez et surtout à cause du fait qu’à certains moments, l’art peut paraître comme , selon le mot de Nietzsche, le « colifichet » de l’existence, « tel un petit ornement chargé d’apporter un peu de fantaisie dans une vie asservie au fonctionnel »3.
I-DE L’ESTHÉTIQUE NEGRO-AFRICAINE COMME AVATAR DE LA CONNAISSANCE ?
On sait que les premières théories de l’art africain ne sont élaborées de manière cohérente et systématique qu’à partir des années 60. Cela est compréhensible précisément en raison du choc que les œuvres d’art provoquent sur la sensibilité. Mais si l’art africain n’a pas été vite systématisé, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas reconnu. Certes, sa considération comme une Esthétique est encore au stade d’une problématique.
« Mais qu’est- ce au juste que l’Esthétique ? S’interroge Denis Huisman. En un premier sens – qui est d’ailleurs son sens premier- la
Philosophie de l’Art désigne originellement la SENSIBILITE (étymologiquement aisthésis veut dire en grec sensibilité) avec la double signification de connaissance sensible (perception) et d’aspect sensible de notre affectivité .(…) C’est ainsi que Paul Valéry pouvait dire « l’esthétique, c’est L’ESTHETIQUE »(…).En un second sens , beaucoup plus actuel, elle désigne « toute réflexion philosophique sur l’Art »(…).C’est dire que l’objet et la méthode de l’Esthétique dépendront de la façon dont on définira l’art »[198].
Sans trop s’éloigner de cette définition, l’ivoirien Mémel Foté fait une ouverture plus large de la notion. Pour lui, « Esthétique, comme adjectif, dérive du mot grec : aÎsthesis, faculté de percevoir ou de sentir. L’activité de réflexion qu’on appelle esthétique s’entend en deux sens. Comme activité philosophique, l’esthétique peut être, au sens général, la théorie de la sensation. Ainsi Kant nomme –t-il Esthétique transcendantale l’étude des conditions a priori de la sensibilité, des conditions qui rendent possible l’expérience humaine, la perception des phénomènes, c’est-à-dire de l’espace et du temps. En particulier, l’Esthétique peut être la théorie de la sensation du beau et du jugement de goût. Cette théorie comprendrait une psychologie des fonctions sensorielles (ouïe, vue, odorat, etc.), une psychologie de l’intelligence, une métaphysique de la signification du beau. Comme activité scientifique, l’esthétique est la théorie positive de l’art : elle se diversifie en une anthropologie et une histoire, en une sociologie et une technologie, en une psychologie intégrant la philosophie »5.
De cette définition, on comprend aisément nous dit Harris Mémel – Foté , que la philosophie occidentale veuille contester l’idée de cette esthétique comme philosophie sous prétexte que les Africains ne sont pas intellectuellement aptes à une réflexion ou à une spéculation sur l’art , encore moins sur la philosophie . il cite d’abord Gobineau : « Le nègre possède au plus haut degré la faculté sensuelle sans laquelle il n’y a pas d’art possible ; et d’autre part l’absence des aptitudes intellectuelles le rend complètement impropre à la culture de l’art, même à l’appréciation de ce que l’intelligence des humains peut produire d’élevé. Pour mettre ses facultés en valeur, il faut qu’il s’allie à une race différemment douée »[199].
Ainsi donc l’épreuve de la vie du monde négro- africain a été interprétée comme un avatar de la psychologie de la connaissance, une enfance de la raison et de la connaissance objective s’il en est .On la considère même comme une vision particulière à côté d’autres formes de représentations du monde qu’on croit hautement supérieures. Cela implique que l’art africain a valeur puérile et dans ce cas, il est affecté d’un coefficient péjoratif d’intentionnalisme primitif, propre à la mentalité inférieure , au stade où elle structure le monde et les visions du monde à partir non d’une pensée objective, mais par simple ressemblance fonctionnelle et représentative .
Vue sous cet angle, l’esthétique négro-africaine est la connaissance au rouet, des ouï –dires. La pensée africaine serait la conscience qui affirme tout en niant à la même seconde sa propre saisie interne en la généralisant à toutes les formes de la nature. Mais comme l’essentiel dans cette affirmation , c’est la méprise de la connaissance des africains sur la teneur objective de la nature et de la vie elle – même , c’est tout l’art africain, tout genre confondu qui est censé être en dehors de la Vie et semble être suspendu à un miracle ou à un hasard dont on ne sait trop l’origine véritable . Le fond du débat porte en réalité non sur le concept de l’esthétique mais sur la capacité du Nègre à forger un art, à concevoir quelque chose de sensé.
Mais du point de vue de la connaissance , la remise en cause des choses de la vie , par les découvertes contemporaines , l’importance accordée à la surdétermination des significations symboliques , issues des pratiques artistiques et culturelles des Noirs , a fini par imposer comme allant de soi , le génie nègre. En effet, l’Afrique est symbolisme, elle est symbole. Les rites funéraires, les masques et les statuettes des nègres ne sont pas seulement qu’ornements, ils sont pleins de sens. Ils peuvent ne pas être reconnus par l’Occident, mais leur langage reste intact. Car, c’est à travers ce qu’ils disent que réapparaît tout le temps ce qui est à dire. Si l’art africain « n’a ni commencement ni fin c’est parce qu’il est effort pour nous installer d’emblée dans l’instance même du à dire. Car il y a toujours à dire , non pas parce que l’on n’a pas encore tout dit, mais c’est parce que c’est toujours le Même que l’homme a à dire ; le Même, c’est-à-dire, non pas la même chose comme dans un rabâchage sans portée , mais ce Même qui fait que toutes les consciences sont mêmement autres , qu’elles se ressemblent en tant qu’elles sont séparées les unes des autres et qu’elles ne peuvent pas coïncider »[200]. Le problème est de savoir si l’expérience africaine de l’art signifiant et significatif est simplement coextensif à ce que peut nous en donner une conscience par la science et la philosophie.
Mémel –Foté Harris répond que l’esthétique africaine, en tant qu’objet d’un débat scientifique paraît présenter quatre caractères :
- Elle est une discipline objective
- Elle est une discipline de synthèse
- Elle est une discipline jeune
- Elle est une discipline essentielle à toute théorie du développement.
Selon l’auteur de ‘’L’idée d’une esthétique négro-africaine’’, elle serait une discipline objective qui ne doit pas être racialisée en désignant une activité qui serait particulière aux Africains et maîtrisables par les seuls Africains, mais il faut faire en sorte qu’elle soit une discipline qualifiée « par la particularité de son objet socio-culturel, géographiquement délimité »[201].
Elle est aussi une discipline de synthèse par ses sources externes et internes, notamment par Léo Frobénius, Marcel Griaule et par des « chercheurs africains intellectuellement formés en Europe ( L.S.
Senghor) »[202].
Selon Mémel-Fotè , par son objet, l’esthétique négro-africaine « n’est pas seulement la connaissance de l’essence du beau et du sentiment esthétique (M. Griaule, L.S.Senghor, A.A.Gerbrands, M. Leiris, H. Memel –Fotê, etc.) mais c’est encore celle de l’histoire de l’art africain (Léo Frobénius, B.Fagg, Ch.Anta Diop, etc.) et celle des rapports de cet art avec la société (J. Delange, J. Laude et J. Maquet, K. Nkétia et F. Bebey, B.Traoré et J. Mbiti.etc.) »[203]. Par sa méthode, elle est dominée par « deux constantes principales : l’approche pluridisciplinaire, la liaison de l’analyse et de la synthèse . Au premier niveau, alliance de la philosophie et de la science. Non pas dans le sens où une esthétique se serait ici développée comme philosophie explicite et systématique (accompagnant et fécondant la science) »[204]. Et à un second niveau, « l’investigation scientifique proprement dite met en œuvre les approches et les résultats de plusieurs disciplines des sciences humaines »[205]. Par ses résultats, on aboutit, aujourd’hui à « une théorie intégrée où les constantes esthétiques mises en lumière paraissent dominer l’ensemble des arts : sculpture, musique, littérature, etc .Ex. le concept de l’unité des arts »13. Elle est une discipline jeune, « manifeste aux obstacles qu’elle vient à peine de surmonter et aux insuffisances théoriques qui la caractérisent ».14
Pour Memel-Fotê, les obstacles sont d’ordre idéologique à cause de la théorie de l’évolutionnisme et du primitivisme ; l’obstacle méthodologique, technologique, structurel et historique. Les insuffisances résideraient dans l’état des analyses et dans les essais d’explication. Enfin, selon lui, l’esthétique négro-africaine est essentielle à toute théorie du développement. Il y a donc « lieu par conséquent de rappeler aux idéologues et aux philosophes africains que la théorie de l’art , pièce maîtresse de toute esthétique , loin d’être une théorie antidéveloppement , est une structure essentielle d’une théorie du développement intégral de la société des hommes »[206].
Mais faut-il rappeler cela aux philosophes africains ? Quel philosophe ignorerait –il encore aujourd’hui le rôle de la théorie de l’art dans le processus de développement d’une nation ? Ainsi parler de l’échec de la théorie de l’art ne peut –il avoir qu’un sens : l’art est un échec au sens jaspérien du terme ; tout art est une réussite dans la mesure où il échoue , où il échoue non pas là où d’autres activités réussissent , mais seulement dans la mesure où il échoue sur un fonds qu’il ne peut totalement explorer mais dont l’inextinguible découverte était sans nulle doute le pôle justificateur et insondable de son entreprise. L’échec de l’art est bien le dynamisme d’une civilisation. Le progrès d’une culture, l’ascension de l’esprit d’un peuple.
D’ailleurs, Hegel, dans son introduction à l’esthétique, nous apprend que « Le beau intervient dans toutes les circonstances de notre vie ; il est le génie amical que nous rencontrons partout. En cherchant seulement autour de nous où et comment, sous quelle forme , il se présente à nous, nous trouvons qu’il se rattachait jadis par les liens les plus intimes à la religion et à la philosophie . Nous trouvons notamment que l’homme s’est toujours servi de l’art comme d’un moyen de prendre conscience des idées et des intérêts les plus élevés de son esprit . Les peuples ont déposé leurs conceptions les plus hautes dans les productions de l’art, les ont exprimées et en ont pris conscience par le moyen de l’art. La sagesse et la religion sont concrétisées dans des formes créées par l’art qui nous livre la clef grâce à laquelle nous sommes à même de comprendre la sagesse et la religion de beaucoup de
peuples ».[207]
L’intention de Hegel est claire : c’est montrer que la philosophie de l’art forme un anneau nécessaire dans l’ensemble de la philosophie .Et comme tel, il convient de l’inclure dans la philosophie tout entière ; et comme la philosophie est le support à tout développement, il importe donc pour Hegel de mentionner que, étant donné qu’il y a des beautés diverses propres aux différents arts, il faut donc partir de l’idée de beau. Et ce qui l’intéresse est le beau artistique. « Pourquoi ? Tout simplement parce que le beau artistique est toujours supérieur au beau de la nature. C’est une production de l’esprit, et « Le beau artistique tient sa supériorité du fait qu’il participe de l’esprit et, par conséquent, de la vérité, si bien que ce qui existe n’existe que dans la mesure où il doit son existence à ce qui lui est supérieur et n’est ce qu’il est et ne possède ce qu’il possède que grâce à ce spirituel. Le spirituel est le vrai. Ce qui existe n’existe que dans la mesure où il est spiritualité. Le beau naturel est donc un réflexe de l’esprit. Il n’est beau que dans la mesure où il participe de l’esprit. Il doit être conçu comme un mode incomplet de l’esprit, comme un mode contenu lui-même dans l’esprit, comme un mode privé d’indépendance et subordonné à l’esprit »[208].
L’une des conséquences de cette supériorité est que, pour Hegel, l’art ne saurait avoir pour but d’imiter la nature .Il y a chez lui, cette certitude que l’esprit humain est lui-même une parcelle d’un esprit qui le dépasse, c’est-à-dire, un esprit absolu qui régit l’ensemble de la pensée et des activités humaines tout en se déployant au cours de l’histoire. Comme le dit Marc Jimenez, « L’art est inclus dans cette histoire : il exprime, comme la religion et la philosophie, la façon dont l’esprit parvient à surmonter l’opposition ou la contradiction entre la matière et la forme, entre le sensible et le spirituel. Il est ainsi la manifestation concrète de l’esprit, du vrai dans l’histoire de l’humanité »[209].
Dans cette ascension de l’esprit, dans l’histoire de l’humanité, la poésie, selon Hegel, semble occuper le plus haut degré. Pour lui, c’est la poésie qui n’a pas de patrie et non pas la musique. « Ainsi la poésie serait une forme d’art idéal, universel, présent à toute époque , transhistorique , si l’on peut dire , dans la mesure où il s’impose avec la même force à travers les trois formes particulières , symbolique, classique, romantique »[210].
Il n’est donc pas étonnant que les auteurs africains, surtout ceux de la Négritude usent de la poésie pour tenter de redécouvrir la lumière unique de la liberté. Une telle exploitation de l’art est l,un des facteurs essentiels du verbe poétique qui essaye d’éveiller les synesthésies réconciliatrices de l’Afrique d’avec le monde et de l’Afrique d’avec ellemême car le verbe poétique tente d’opérer des transmutations et des transmigrations d’individualités , et Rimbaud n’a pas tort de parler d’une « «Alchimie du verbe ». Dans la mesure où la poésie tend à conférer à la parole cette vertu incantatoire dont elle a soif, le verbe poétique cherche à être « le « sésasme ouvre-toi ! » de toutes les monades »[211].
Dès lors, dans cette quête inlassable du Graal ‘’Afrique’’, l’itinéraire poétique des auteurs de la Négritude, depuis l’Afrique captive, crucifiée jusqu’à l’Afrique libérée est exaltant. Ils ont rêvé le monde, leur monde. Mais souvent, ils sont devenus des cas pathologiques, des schizophrènes, des paranoïaques, désaxés ou névrosés, malades anormaux ou fous, si l’on en croit aux critiques acerbes de Towa, de Hountondji et autres Adotévi Stanislas Spéro.
II-DE L’ESTHÉTIQUE À LA POLITIQUE : VERS UN POLYTHÉSISME DES VALEURS ?
Partant d’un véritable échec de la civilisation européenne, issu du déchirement et de l’aliénation de la société africaine, ces auteurs africains ont pu s’enraciner dans leur sol natal, dans un pieux retour aux sources, mais après avoir profité des leçons de l’Occident. C’est ainsi par exemple que la poésie senghorienne, malgré des réminiscences européennes n’a pas trahit le style nègre, même si elle emprunte les sentiers de l’amour courtois ou le souterrain du surréalisme comme nous l’avons signifié.
Le poète d’Ethiopiques, issu de cette civilisation africaine qui a survécu à l’ancien empire du Mali, a assimilé en lui la culture européenne sans rien perdre de la sienne. Pour Senghor, le domaine privilégié du Noir semble être celui de l’émotion. Celle-ci nous intime de devenir plutôt que de comprendre ; par là, la poésie n’est pas seulement connaissance, mais une véritable communion, une symphonie collective. Comme le dit Gusine Gawdat Osman , « Cette faculté exceptionnelle d’alerter, d’ébranler tous les sens de l’être , mettant sens dessus-dessous toutes ses possibilités émotionnelles , se retrouve dans toute poésie négro-africaine ; elle devient l’émotion , acte de sympathie entre le poète et autrui, pareillement au Récitant qui fait participer l’assemblée , adhère lui-même totalement à ce qu’il psalmodie et chantant la gloire de tel roi, le fait en participant à sa victoire , par le geste , la parure, le
mot… »[212]
Dans l’entendement de Senghor, l’émotion est au service de la fonction cognitive du langage, car elle le dépasse pour révéler le « moi ». « la fonction émotive dans l’art en Afrique noire , oppose l’homo vates qui fait du monde une œuvre d’art , à « l’homo faber » qui conçoit et traite le monde comme une machine , voilà pourquoi elle fait vibrer le poète dans son psychisme le plus profond ; elle met en émoi toute une manière de vivre et de sentir le monde par l’accent , le rythme , l’intonation , les sonorités , le choix du mot, de l’image, l’engageant tout entier . C’est sa relation la plus profonde avec l’univers, la plus attachante »22. L’émotion semble donc apporter la joie, la concorde et faciliter la fraternité entre les peuples.
Les poètes africains , en créant la chose ou la personne par leurs œuvres, s’engagent et engagent avec eux leurs ethnies, leur passé historique, leur appartenance géographique , leur attaches sociales et extra-sociales .Le poète africain se sert donc des réalités et des faits quotidiens qui constituent la trame de sa vie passée et présente , tout en faisant appel aux vivants et aux morts . On comprend pourquoi, selon Senghor, la civilisation africaine procède d’une vision unitaire et existentielle du monde. Dans un tel cas, l’art ne peut être divisé car, les arts en Afrique noire, sont d’abord liés l’un à l’autre, les uns aux autres, de même qu’ils sont fonctionnels, engagés et collectifs.
« Ce qui frappe, c’est la valeur humaine de l’ontologie négroafricaine, sa valeur culturelle. Car qu’est-ce que la culture sinon l’effort de l’Homme pour s’adapter à son milieu par les médiations sociales et pour adapter ce milieu à ses activités génériques ? C’est le lieu de noter les deux traits fondamentaux de l’ontologie négro-africaine. Le premier est que la hiérarchie des forces vitales ne fait qu’exprimer l’intégration de l’univers à la famille ou, peut-être plus exactement, la dilatation de la famille aux dimensions de l’univers. (…) Le second trait de cette ontologie est la place éminente qu’occupent l’homme vivant, l’Existant, dans la hiérarchie des forces. L’homme est le centre de l’univers, qui n’a d’autre but que de renforcer sa force, de le rendre plus vivant et existant, de le réaliser en personne.»[213].
Cette interprétation établit un lien entre la poétique et la politique. Sur un plan plus général, elle révèle les implications politiques au sens large du terme – et le discours sur l’art. On comprend dès lors, l’angoisse de l’homme-africain, prisonnier d’un monde inhospitalier, habité en permanence par la peur, préoccupé par le souci que représente la perte de sa culture. Mais cette situation est paradoxale, car s’ouvrir au monde et à l’autre, sont autant de preuves de son existence. Preuves négatives, douloureuses, mais qui attestent, par le fait même, l’aspiration permanente de l’homme à être ce qu’il est. Quelles chances l’Africain a-til de recouvrer son authenticité ? En vérité, elles sont bien minces. Elles reposent sur sa capacité de continuer à pratiquer sa culture, à recourir aux sources ou plutôt sur sa décision de poursuivre le travail de ses Anciens. Choix palliatif, qui lui évite de sombrer dans l’ennui et le désespoir sécrétés en permanence par la situation coloniale. « Il existe toutefois une autre possibilité offerte à cet-être-pour-la-mort, voué à un destin funeste et imprévisible , conscient d’une finitude qui confère sens et authenticité (tardive) à son existence ; cette possibilité est celle que se donne la parole poétique d’ « habiter » poétiquement sur cette terre » [214].
Ce n’est pas non plus l’idée du beau qui fait recourir à l’authenticité, mais c’est sûrement l’idée qu’il y a quelque chose de beau à faire. En voulant accomplir sa tâche de vouloir appeler au retour aux sources, la poésie veut être belle. Mais en restant à sa source, elle perd sa beauté et toute sa beauté pour n’advenir qu’une parole laide, un verbe en l’air. C’est ce qu’on appelle en malinké le «Koumalankolo», parole en l’air qui n’a pas de fondement, qui ne peut être vulgarisée parce que manquant de consistance.
Mikel Dufrenne a raison de dire que « la poésie, si l’on en considère seulement le comportement à l’égard de la matière qui lui est propre, entreprend de restaurer le langage en le ramenant à sa source »[215]. Le poète africain parle, non pour parler, mais pour utiliser le langage comme outil au service d’une pensée, au service d’une collectivité. « Parler reste au moins un hommage que l’homme rend à l’homme, un geste de bonne volonté qui atteste que la communication avec le semblable est toujours possible. Et cette communication n’est jamais tout à fait sans objet : évoquer le temps qu’il fait , c’est encore une façon de dire que nous sommes au monde , livrés à la contingence , et que le temps nous est donné sans que nulle temporalisation puise à notre gré ; demander à quelqu’un comment il se porte , si usée et aperçue que soit aujourd’hui la métaphore , c’est déjà carrière à une théorie du psycho-somatique.» [216].
Pour Dufrenne donc, « La poésie dit le monde. C’est là son vrai sujet »[217]. Et le poétisable n’est rien d’autre que ce qui se prête à être illimité en un monde poétique par la vertu du langage poétique et l’expression poétique ne serait rien d’autre que la présence sensible du signifiant dans le signifié mais aussi le pouvoir qu’a le signifiant d’élargir le signifié aux dimensions d’un monde . « Il ne s’agit pas, on s’en doute, d’un monde repérable aux contours déterminés, peuplé d’objets parfaitement identifiables. C’est plutôt une aurore de monde, une promesse. L’idée, au lieu de se figer et de se durcir, nous investit, nous sensibilise et semble se répandre sur toutes choses. Ainsi un beau visage peint toutes choses autour de lui aux couleurs de l’amour ;il appelle l’amour , mais aussi l’irradie ; et toutes choses , comme pour lui répondre , parlent avec lui de l’amour : voici que se révèle à moi le monde de l’amour ; la vérité de l’amour est dans cette surrection d’un monde qui anime et qui auréole l’aimé . Combien de temps l’amant émerveillé séjournera-t-il dans ce monde ? Le temps d’un regard peut-être, mais qu’importe ? Etre au monde n’est pas seulement être dans le monde , c’est être capable du monde , s’ouvrir à cette troisième dimension selon laquelle objet ou concept cessent parfois d’être plats et répandent leur sens en tout sens . Le monde n’est pas seulement l’indéfini de l’univers, le recul de tout horizon, mais ce foyer de possibles auxquels un mot aussi bien qu’un concept peuvent donner l’essor.
Ainsi fait la poésie. Elle joue avec ces mots à longue portée, puissants comme les phares dont l’éclat creuse l’espace. »[218]. Faire donc la poésie , c’est découvrir un sens dans la mesure où découvrir ce monde, c’est recueillir le sens du poème ; et l’état poétique bien qu’il soit un état d’enchantement, est aussi un état de connaissance et de communion mutuelle., un état de création.
Ainsi donc, l’on peut dire que si le mystère de l’art ne s’arrête pas aux barrières culturelles, on ne saurait en dire autant du message qu’il véhicule. Pour comprendre pleinement un art, et saisir avec clarté son message, il faut connaître les éléments essentiels de son arrière-plan culturel. En Afrique, nous sommes en présence d’un art qui, en dépit de la diversité de ses productions et des styles propres à chaque peuple, frappe par la récurrence de thèmes qu’il aborde , la permanence de certaines règles, et la parenté qui unit entre elles les œuvres les plus lointaines . L’art est donc essentiel à l’analyse d’une culture parce qu’il permet à des « penseurs », parmi les plus pénétrants et les plus originaux d’une société, de communiquer leurs expériences ,de partager leurs cultures. Pour connaître donc les pensées des peuples, il est nécessaire de jeter un regard interrogateur sur leurs productions artistiques.
Le masque, par exemple, est l’une des formes les plus significatives en Afrique et est porté comme un élément de costume. Il révèle les formes symboliques de la Politique, du Savoir et de la Religion qui peuvent s’incarner au tribunal ou dans le rituel, de façon à donner force de loi au drame juridique ou au mythe religieux. « On voudrait dire que l’homme a fait des idoles parce qu’il était religieux , c’est comme si l’on disait qu’il a fait des outils parce qu’il était savant ; mais au contraire la science n’est que l’observation des outils et du travail par les outils . De même je dirais plutôt que la première contemplation eut pour objet l’idole, et que l’homme fut religieux parce qu’il fit des idoles. Il fallait rendre compte de cette puissance du signe, et inventer la mythologie pour expliquer le
beau »[219].
En effet, dans la plupart des sociétés africaines, on ne présume pas que le mythe est pseudo-historique ou qu’il se réfère au passé. Il est plutôt employé pour expliquer, voire pour communiquer l’immédiat, le tangible. Une grande partie du drame masqué africain est une réincarnation des mythes fondamentaux de la création, de la structure du pouvoir, de la société, de l’histoire et de la religion. Est-ce la révélation profonde de l’irréductibilité du monde négro-africain à l’extériorité par l’épreuve de l’intériorité humaine et par l’expérience onirique où s’approfondit la faisabilité de l’homme adulte , non pas seulement par l’âge mais aussi et surtout par la maturité de l’esprit capable d’analyse et de prise de conscience dans ce qu’il a de plus exaltant et de plus effroyable ?
Léopold Sédar Senghor commente, de son côté, ce monde que l’on qualifie d’animisme nègre de la manière suivante :
« Pour le nègre, il y a un monde d’âme. Qu’est-ce que l’âme ? Les idées du Nègre sur l’âme sont extrêmement nuancées et, d’un peuple à l’autre elles varient dans les détails. On peut dire que c’est une force spirituelle, un principe de vie intellectuelle et morale, qui anime chaque être, chaque plante, chaque chose pourvue d’un caractère propre : la montagne, caverne, rocher, lac. C’est l’âme qui meut le corps mais elle ne le peut faire que par l’intermédiaire du souffle vital. Celui-ci est le principe de la vie psychique … »[220].
Aujourd’hui en Afrique, on peut encore se poser la question de savoir ce que représentent encore pour beaucoup d’africains, notamment les jeunes, les initiations traditionnelles, le poro par exemple au pays senoufo, toutes ces traditions qui ont trait aux mystères des origines, à la fécondité , à la vie adulte . Sont- elles uniquement des formes symboliques ou des systèmes d’éducation dont se charge aujourd’hui l’école occidentale qu’on a vite qualifiée de moderne ?
À la vérité, nombreux sont les africains, qui, emportés par les vagues de l’école occidentale, ne croient plus à ces initiations, à ces formes symboliques masquées, qu’ils considèrent de superflues, de dépassées. Ils ne voient plus en ces initiations que des débris de tradition condamnés à disparaître inexorablement avec ‘’ l’évolution’’. Les danses africaines sont considérées comme folkloriques. Leurs célébrations ne seraient rien d’autre qu’une curiosité dépourvue de tout engagement ; juste pour écouter sans en saisir le sens.
Ainsi la répétition initiatique des rites traditionnelles, les pas des danseurs , le sens des mélodies , les répétitions ont pour but le partage de l’irréel d’avec le réel dans le flux universel, dans la communion avec l’ici et l’ailleurs, le présent et le passé , la mise du néophyte dans des conditions d’épreuve et de dépassement de soi, celle de l’éducation morale , du courage d’être-homme, celle selon la formule de Roger Garaudy, de « danser sa vie » ; un autre nom de la liberté , ne stimule plus aujourd’hui la jeunesse « moderne », encore moins une problématique du fondement , à la lumière de la totalité , de l’être du devenir et à l’être , comme mode de présence d’un nouveau type d’homme, de cet africain nouveau, l’excellent, non le médiocre, par l’éveil à la réalité et à la prise de conscience de soi par le sens du corps . Comme le dit Maurice Merleau Ponty,
« Si notre corps ne nous impose pas , comme il le fait à l “animal , des instincts définis dès la naissance , c’est lui du moins qui donne à notre vie la forme de la généralité et qui prolonge en dispositions stables nos actes personnels. Notre nature en ce sens n’est pas une vieille coutume , puisque la coutume présuppose la forme de passivité de la nature . Le corps est notre moyen général d’avoir un monde. Tantôt il se borne aux gestes nécessaires à la conservation de la vie , et corrélativement il pose autour de nous un monde biologique ; tantôt , jouant sur ces premiers gestes et passant de leur sens propre à un sens figuré , il manifeste à travers eux un noyau de signification nouveau : c’est le cas des habitudes motrices comme la danse . Tantôt enfin la signification visée ne peut être rejointe par les moyens naturels du corps ; il faut alors qu’il se construise un instrument, et il projette autour de lui un monde culturel »[221].
Un art affranchi des valeurs est donc un non-sens. Comprendre les œuvres d’arts africains, c’est percevoir leurs failles et leur signification en se référant à leurs valeurs. C’est pourquoi, nous dit Adorno, « l’esthétique a été élevée au rang de connaissance émancipatrice transcendant selon ses propres termes l’espace et le temps de l’art par l’auto-négation du contemplateur qui s’abîme virtuellement dans l’œuvre . Il est contraint à ce faire par les œuvres d’art dont chacune est index veri et falsi ; seul celui qui se soumet à ses critères objectifs le comprend ; celui qui s’en moque est le consommateur . Le moment subjectif subsiste néanmoins dans le comportement adéquat par rapport à l’art : plus est grand l’effort de participation à la réalisation de l’œuvre et de sa dynamique structurelle , plus est grande la part de sujet investie dans la contemplation , plus le sujet s’oubliant lui-même perçoit l’objectivité : même dans la réception , la subjectivité médiatise l’objectivité »[222].
En effet, pour cet auteur, si les œuvres d’art ne peuvent être expliquées intégralement par leur genèse, il ne faut cependant pas ignorer que l’expérience esthétique se cristallise dans l’œuvre particulière ; cela importe de ne pas en isoler aucune indépendamment de la conscience qui en fait l’expérience . L’œuvre d’art doit s’enraciner dans l’œuvre concrète tout en gardant sa dimension théorique .L’œuvre d’art n’est pas seulement art, « elle possède le caractère chosal d’un fait social et converge finalement dans l’idée de vérité avec du métaesthétique »[223].
CONCLUSION
L’art demeure donc une théologie qui nie sa réalité pour devenir une réalité sui generis et la seule manière de concevoir la vérité de l’œuvre d’art, c’est de rendre lisible un élément transsubjectif dans l’en-soi imaginé subjectivement. Dans ce cas, l’œuvre sert de médiation à ce transsubjectif. « Et pourtant , devant la menace d’une transformation de l’art en barbarie , il convient sans doute plutôt de se taire que de passer à l’ennemi et de favoriser une évolution qui revient à s’insérer dans le statu quo parce qu’il est le plus fort. Le caractère problématique de la fin de l’art proclamée par les intellectuels réside dans la question concernant son pourquoi, sa légitimation face à la praxis hic et nunc. Mais la fonction de l’art dans ce monde totalement fonctionnel est son absence de fonction ; c’est pure superstition que de croire qu’il peut intervenir directement ou inciter à intervenir . L’instrumentalisation de l’art vient saboter sa protestation contre l’instrumentalisation ; ce n’est que lorsque l’art prend en compte son immanence qu’il convainc la raison pratique de sa déraison . Pour s’opposer au principe de l’art pour l’art irrémédiablement tombé en désuétude, l’art ne cède pas aux fins qui lui sont extérieures, mais il renonce à l’illusion d’un pur royaume de beauté qui se révèle rapidement comme kitsch. En une négation déterminée, il enregistre les membra disjecta de la réalité empirique où il a sa place et les rassemble en les transformant en une réalité qui est monstruosité »[224]. Tel semble être le sens du racisme anti –racisme de la Négritude, qui fait de ce mouvement un encagement et compromet douloureusement sa ‘’philosophéité’’.
En effet, la négritude est traditionaliste, son vœu est la pureté originelle de son projet, sa revendication par l’art est selon Bidima
« curieusement occidendentalocentrée. L’art africain n’était produit et étudié qu’en fonction de l’autre pan de la problématique coloniale consistant pour les Africains , à « prouver à tout prix » qu’ils ont une culture aussi valable que les autres cultures . Cette lecture de l’art africain, qui part de l’ethnologue allemand Leo Frobenuis en passant par L.S. Senghor jusqu’aux peintres africains actuels comme Ahyi (Togo), est une réponse coloniale à un questionnement lui-même colonial. Comme les ethnologues européens , les Africains ont insisté sur leur différence et l’originalité de leur art. Comme les explorateurs européens , ils s’attardent sur la tradition et son reflet sacré dans les arts , ce faisant, leur lecture déifie le passé afin d’éviter le présent qui peut ouvrir vers les possibilités futures . Traditions immuables et bonnes , sacralité incurable des arts africains et exhibition sans examen d’un passé antécolonial où l’art aurait indiqué l’harmonie des sociétés africaines , tels sont les schémas qui ont structuré et qui encadrent encore la plupart des colloques , livres et séminaires sur l’art africain »[225].
Selon Jean –Godefroy Bidima, les auteurs africains en général et la négritude en particulier, mettent l’accent de manière ostentatoire sur le passé en escamotant de ce fait la dimension actuelle et proleptique de ces arts . Dès lors, l’art nègre n’apparaît désormais plus que comme une marchandise qui se vend et qui frise la folklorisation dans la mesure où cet art n’est produit et ne se vend que parce qu’il est réglé par les goûts des touristes occidentaux.
En vérité, ce que veut révéler Bidima, c’est de faire comprendre que l’art africain n’a pas aussi malheureusement pu se départir du culte de la différence. Son souhait est que la philosophie africaine se déplace des traditions africaines (le passé) vers la translation de ces traditions. Selon lui, les auteurs africains ont l’impérieux devoir de se poser les questions suivantes « Quel est l’art des marginalisés des sociétés africaines traditionnelles ? Quelle fut l’expression artistique des bannis, des « pervers » et autres marginaux ? Une lecture traversière de l’art africain suggère une lecture de la société africaine de travers. Seul l’art des dignitaires tribaux est représenté sous le vocable totalisant de l’art
africain »[226].
Selon lui, il faut refuser l’image tribale, sectaire et ethnophilosophique de l’art. « On parlera de l’esprit Akan, ou Baoulé dans l’art. S’opère ainsi une liaison intuitive entre les œuvres d’art et la conscience nationale ou tribale qui aboutit souvent à un chauvinisme totalisant. Car, il y a exaltation de l’esprit national ou tribal. A travers cette vue, la notion de force est placée en amont comme production de l’œuvre d’art, la force est ainsi substansifiée et rapportée à l’esprit national /tribal. Dans ce paradigme du plein, l’œuvre d’art exprime la vérité d’une communauté, sa moralité, sa conformité et son unité. Ce paradigme du plein dit avec certitude la réalité , et , avec le pouvoir éclairant de ses schèmes , se mue en donateur de sens , en diction du pensable et fait voir et valoir les catégories du spectaculaire légitime sur fond d’élaboration normative et d’assurance » [227].
On comprend aisément que le vœu de Bidima est un appel à la création d’un art révolutionnaire, d’édifier une esthétique de la dissonance qui s’interdit l’indifférence et l’apologie d’un ordre répressif.
Bidima opte donc pour la conception adornienne de l’art. En effet, en dénonçant l’industrie culturelle, Adorno reconnaît cependant que le processus qui livre aujourd’hui aux musées les œuvres d’art est irréversible. En outre , l’intégration inévitable de l’art traditionnel dans le système marchand , donne selon lui, argument pour défendre les œuvres d’avant-garde . Pour lui, il faut être résolument moderne. L’une des idées maîtresses de l’esthétique d’Adorno est de faire savoir que les œuvres d’art ne critiquent pas suffisamment la réalité en la peignant de façon réaliste, en jouant sur le caractère figuratif de leur sujet ou de leur contenu. Selon lui, la distinction entre la forme et le contenu n’a aucune validité. « C’est justement lorsque la forme paraît émancipée de tout contenu préétabli que les formes prennent d’elles-mêmes leur expression et leur contenu propres ».[228] Dans son apparence esthétique, l’œuvre d’art doit prendre position à l’égard de la réalité qu’elle nie en devenant une réalité sui generis. Elle doit protester contre cette même réalité au travers de son objectivation. L’art doit pouvoir écrire les souffrances de l’histoire.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- ADORNO Theodor Wiesengrund, Autour de la théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1976 , traduit de l’allemand par MARC JIMENEZ & ELIANE KAUFHOLZ.
- ADORNO, Theodor Wiesengrund, Notes sur la littérature, Paris, Flammarion, 1984 traduit de l’allemand par Sibylle MULLER.
- ALAIN, Emile Chartier Dit, Propos sur l’esthétique, Paris, P.U.F, 1948.
- BIDIMA, Jean-Godfroy, La philosophie négro-africaine, Paris, PUF , 1995
- BRUN, Jean, Les conquêtes de l’homme et la séparation ontologique, Paris, P.U.F, 1961.
- DIAKITE, Samba, Les nasses identitaires en Afrique. Pour une remise en question des pouvoirs balafrés, Berlin, Editions Universitaires Européennes, 2011.
- DUFRENNE, Mikel, La poétique, Paris, P.U.F, 1963.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Introduction à l’esthétique, Paris, Aubier-Montagne, 1964, traduction Gibelin.
- HUISMAN, Denis, L’Esthétique, Paris, PUF, coll. « Que saisje ? » ,1992.
10.JIMENEZ, Marc, Qu’est-ce que l’esthétique ? Paris, Gallimard, 1999.
11.MEMEL-FOTE, Harris, ’L’idée d’une esthétique négro-africaine’’ in Revue de littérature et d’esthétique négro-africaine, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1977.
12.MERLEAU-PONTY, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, coll. Tel , 1945.
13.OSMAN, Gawdat, L’Afrique dans l’univers poétique de Léopold Sédar Senghor, Dakar-Abidjan-Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1978.
14.SENGHOR Léopold Sédar, ‘’Psychologie du négro-africain ou conscience et connaissance’’ in Philosophie africaine, tome I, Kinshasa, Presses universitaires du Zaïre, 1975.
15.SENGHOR (Léopold Sédar, Liberté I, Négritude et humanisme (Paris, Seuil, 1964.
LE DÉFI THÉORÉTHIQUE DE L’ÉCOLE AFRICAINE
DANS LE CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA MONDIALISATION[229]
Issiaka-P. L. Lalèyê
Professeur
Université Gaston Berger de Saint-Louis-Sénégal
Résumé : L’école africaine moderne est une école inappropriée. Elle n’est pas assortie à la situation réelle ni aux problèmes véritables de l’Afrique d’aujourd’hui. Pour s’en convaincre, il faut distinguer le théorétique du théorique. L’analyse du système de connaissance en tant que tel, la prise en compte du regard du sujet producteur de la connaissance qui se trouve au foyer de ce système, l’ouverture et la fermeture relatives de ce système, etc. permettent à l’auteur de ce texte de mieux cerner le défi théorétique de l’école africaine en attendant de pouvoir l’exprimer adéquatement. Car l’objectif théorétique de cette école africaine actuelle se situe bien au-delà des buts théoriques et pratiques qu’elle cherche à atteindre pour le moment. Les objectifs théorétiques d’un serpent et d’une souris ne sauraient être identiques : l’un cherche à se nourrir, l’autre n’a pas envie d’être mangée !
Mots-clés : Défi, défi théorétique, école, école africaine, théorique, théorétique, développement, mondialisation, économie du savoir, système de connaissance, serpent, souris.
Abstract: The modern African school is an inappropriate school. It is not suited in the real situation of Africa nor adapted to the real problems of current Africa. To agree with that, it is necessary to distinguish the theoretic and the theoretical. Analyzing the system of knowledge as such, considering the producing subject of the knowledge which is in the center of this system, taking into account the opening and the closure of this system, the author try to encircle better the theoretic challenge of the African school while waiting for to be able to express it adequately. For the theoretic objective of this current African school is well situated beyond the theoretical and practical purposes for which this school tries to achieve for the moment. The theoretic objectives of a snake and a mouse would not be identical: the one tries to feed, the other one does not want to be eaten!
Keywords: Challenge, theoretic Challenge, School, African school, Theoretical, Theoretic, Development, Globalization, Knowledge Economy, System of knowledge, snake, mouse.
Introduction
Le travail, le capital et le savoir ont toujours été présents dans le fonctionnement de toutes les sociétés humaines. Le travail et le capital ont jusqu’ici retenu l’attention des théoriciens et analystes de la vie sociale. Le capitalisme et la révolution industrielle ont ainsi suscité les innombrables études qui leur ont été – et continuent de leur être – consacrées. Mais depuis peu, c’est le savoir qui, porté notamment par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, commence à retenir l’attention de tous ceux qui, à des titres divers, se penchent sur le fonctionnement de nos sociétés.
Pour s’interroger sur les différents aspects de l’économie des savoirs, un retour s’impose au schéma de base de l’analyse du phénomène de la production du savoir en tant que tel. Or ce sont d’abord les philosophes qui se sont penchés sur le processus cognitif en faisant abstraction de ses différents modes, de ses différentes modalités et de ses différents résultats tels que ceux-ci se laissent observer dans les disciplines scientifiques particulières. Il y eut ainsi d’un côté la psychologie conçue comme une véritable anatomie de l’âme[230]humaine, d’un autre côté, la logique considérée comme la science des lois générales du fonctionnement de l’esprit humain et qui faisait figure, dès lors d’une sorte de physiologie de l’intellect humain3, et il y eut enfin, ces grandes théories de la connaissance que l’histoire a retenues tels que l’idéalisme, le rationalisme, le matérialisme, le pragmatisme, l’utilitarisme, etc.
La notion, le mot et le concept indistinctement véhiculés par le vocable théorétique[231]n’ont pas connu, à ma connaissance, d’élaboration majeure depuis le traitement et l’usage essentiellement classificatoire qu’en a fait Aristote au quatrième siècle avant Jésus Christ. De fait, le mot théorétique n’est pas d’usage courant dans le langage philosophique luimême. Néanmoins, c’est ce mot qui me semble le mieux adapté pour décrire l’un des aspects de l’économie du savoir à laquelle nous participons en ce début du vingt-et-unième siècle pour faire voir dans cette économie ce que j’appelle le défi théorétique de l’école africaine actuelle.
La présente communication se développe en trois parties. Dans la première, j’effectue un retour rapide aux trois propriétés du mot – de tout mot, dans quelque langue qu’on le considère – qui permettent de « voir » de quelle manière le vouloir dire joue et se joue des rapprochements et des oppositions qui lui semblent possibles entre deux ou plusieurs mots, entre deux ou plusieurs acceptions du même mot pour atteindre et produire le sens qu’il lui faut. Cette volonté d’expression et ce vouloir dire ne sont l’apanage d’aucune langue et d’aucune culture[232].
Dans la seconde partie, je décris sommairement le système de connaissance comme point de départ et cadre obligé de toute réflexion sur l’économie du savoir. Car si au lieu de considérer le savoir comme une alouette tombée toute rôtie du ciel, on se le représente comme une chose produite par un producteur dûment organisé à cette fin, les principales propriétés du système à l’intérieur duquel s’effectue une telle production deviennent autant de facteurs susceptibles d’éclairer le phénomène de la circulation des connaissances par rapport auxquelles il peut être question d’histoire, de sociologie, de psychologie, d’anthropologie ou d’économie du savoir.
Dans la troisième partie, j’aborde l’école africaine actuelle en examinant tour à tour l’idée d’école au sens large et au sens restreint pour mieux faire apparaître les caractéristiques majeures – ou simplement remarquables – de ce qui se trouve au cœur vivant de la production des savoirs dans la société africaine contemporaine. Les questions parfois inattendues qui me viennent à l’esprit lorsque je pense à cette école africaine m’offrent l’opportunité d’exprimer en des termes encore à parfaire le défi théorétique que j’ai le sentiment qu’il faut que cette école africaine se prépare à relever.
I. Première partie : Opposer et rapprocher pour faire naître du sens.
Un mot isolé des autres mots avec lesquels ce mot appartient à une langue perd tout son sens et toute sa signification. Le sort d’un monème, c’est-à-dire d’un mot simplement prononcé me paraît identique à celui du mot. Les phonèmes qui entrent dans la composition de chaque mot et du monème qui lui correspond n’ont rigoureusement aucun sens et leur signification ne peut être que conjoncturelle et fort limitée, comme en témoigne l’exemple des onomatopées[233].
Il n’en va pas de même des idées ; celles-ci, bien que portées par les mots et les monèmes donnent l’impression de se servir d’eux pour être, se maintenir et voyager à la manière d’une écume qu’une vague porte sans pouvoir l’emprisonner et encore moins la retenir. Et pourtant, les contenus des idées me paraissent eux-aussi limités à un certain minimum. Replacées dans le contexte du mot et du monème qui lui correspondent, les trois caractéristiques de l’idée qui retiennent l’attention sont : une certaine vacuité matérielle, une souplesse formelle avérée et une efficacité opératoire remarquable. Ces trois caractéristiques se rapportent aux trois niveaux de réalité que constituent le mot, le monème et l’idée. Mais ces caractéristiques ne se vérifient pas dans les mêmes termes ni aux mêmes degrés de profondeur à chacun de ces niveaux de réalité.
En nous situant in média res, nous limitant ainsi au niveau du mot, il est facile de comprendre que le sens qui lui est reconnu dans un contexte linguistique donné est le résultat dynamique de deux opérations de base : le rapprochement et l’opposition. La première de ces opérations est l’addition, tandis que la seconde ressemble à une soustraction. Concrètement, c’est par rapport aux mots auxquels on peut l’opposer et par rapport à ceux dans le voisinage desquels on peut le situer qu’un mot donné acquiert son sens et sa signification. Les mots « opposables » et les mots « rapprochables » forment deux sous-ensembles d’un ensemble dynamique aux frontières mobiles et aux contenus changeants. La conséquence de ce dynamisme est le caractère évolutif des mots et des idées ainsi que des concepts construits grâce à eux par les scientifiques des différentes disciplines.
Il n’en va pas autrement du mot théorétique. D’une part, il est semblable à certains mots et de l’autre, il est opposable plus ou moins radicalement à certains autres mots[234]. C’est en parcourant ces deux sousensembles de mots que l’on peut s’approprier le sens du mot théorétique et s’en servir pour construire et reconstruire différentes significations.
Il convient de faire remarquer que théorétique peut être un substantif ou un adjectif. Comme substantif, il évoque aussi bien la rhétorique que la logique, l’éthique, la politique que la mathématique ; en ce sens il se laisse aisément – sans contradiction violente apparente placer dans le voisinage de ces mots que caractérisent leurs terminaisons en ique ; cela fait que ce premier sous-ensemble de mots est relativement vaste et qu’il peut toujours être intéressant d’y rechercher certains mots plutôt que d’autres compte tenu des buts que l’on s’assigne.
Mais en tant qu’adjectif, théorétique ne peut être rapproché et opposé qu’à un ensemble de mots moins nombreux puisque s’en trouvent d’office exclus tous les mots en ique qui correspondent à des substantifs, comme mathématique, rhétorique, logique, etc… La première difficulté dont il faut tenir compte est que plusieurs mots possèdent rigoureusement comme le mot rhétorique la même orthographe nonobstant le fait que cette orthographe correspond souvent à un substantif et parfois à un adjectif8. En conséquence, ce n’est que cas par cas, en s’arrêtant à chaque occurrence de rapprochement ou d’opposition que l’on pourra dresser les deux listes des mots rapprochables de théorétique comme adjectif et ceux auxquels il est opposable comme substantif.
Contentons-nous ici de placer théorétique comme adjectif dans le voisinage de logique, éthique, théorique, pratique et politique. Ce par rapport à quoi se justifie ce premier sous-ensemble de mots relève de ce que tous ces cinq caractérisent ce qu’ils qualifient. De toute évidence, ce qui est dit logique est ainsi considéré parce qu’il l’est dans la perspective d’une rigueur et d’une cohérence ordonnées au vrai et au faux. Ce qui est dit éthique est ainsi qualifié parce qu’on le place dans la perspective de la conduite de l’action ou de l’attitude ordonnée au bien et au mal. Ce qui est dit théorique est ainsi considéré parce qu’on le place dans la perspective de la contemplation opposée à l’action[235]. Ce qui est dit pratique est ainsi qualifié parce qu’on l’ordonne à l’action plutôt qu’à la contemplation ou à la théorie. Tandis que ce qui est dit politique est ainsi traité parce qu’on le met dans la perspective des préoccupations du groupe, opposables, comme telles, aux préoccupations individuelles.
Les cinq perspectives évoquées pour spécifier l’axe de qualification des êtres et des choses considérés comme logiques, éthiques, théoriques, pratiques et politiques pourraient tout aussi bien être appelées des visées, c’est-à-dire des directions dans lesquelles s’oriente le regard de l’esprit en train d’observer et de juger. Comme telles ces perspectives et ces visées correspondent donc à des buts, à des objectifs et, pour tout dire à des fins et même à des finalités.
Intérieurement à ces finalités, les pôles de référence par rapport auxquels et grâce auxquels les semblables sont rapprochés et les dissemblables opposés sont autant de normes. Ces normes sont faciles à mettre en évidence pour la logique et pour l’éthique. C’est le vrai et le faux pour la logique et c’est le bien et le mal pour l’éthique. Pour les trois autres axes de qualification mentionnés ici, la mise en évidence des normes est plus complexe. Car lesdites normes sont elles-mêmes plus subtiles et la relation qu’elles entretiennent avec leurs contraires est elle-même plus complexe. Ainsi en est-il du pratique et du non pratique, c’est-à-dire de ce qui a rapport à l’action et implique parfois que cette dernière transforme la matière et de ce qui, tout en ayant rapport à l’action n’atteint plus la matière ou ne vise qu’à atteindre une matière plus subtile. De même, si le théorique se caractérise par le fait d’être ordonné à la contemplation, à l’opposé du pratique ordonné à l’action, le non-théorique restera ordonné à la contemplation mais n’entraînera pas une opposition radicale à la pratique. Et quant au politique opposable au non-politique, ce ne sera pas par son souci pour l’individu opposé au groupe que le non-politique va acquérir sa consistance ; ce sera bien plus subtilement par son orientation vers différentes manières de viser et d’atteindre des préoccupations du groupe ; préoccupations qui peuvent déjà être qualifiées de politiques par rapport à d’autres manières de viser ces mêmes intérêts du groupe susceptibles d’être qualifiées de « presque-pas-politiques », de « pas-tout-àfait politiques » ou de radicalement « non-politiques ».
On le voit, les rapprochements et les oppositions au prix desquels à l’intérieur d’une visée, les finalités caractéristiques de cette visée sont prises en compte dans les jugements propres à cette visée sont dynamiques et complexes. Nulle part et à aucun moment l’on ne peut s’imaginer avoir totalement et définitivement saisi les normes qui président à ces rapprochements et à ces oppositions pour leur donner une expression rigoureuse, transparente et définitive[236].
Qu’est-ce qui caractérise le théorétique dûment replacé dans sa perspective ou sa visée propre par rapport à sa propre finalité en comparaison du logique, de l’éthique, du théorique, du pratique et du politique que nous avons choisis pour lui servir de contexte et de cadre de résonnance ?
Commençons par distinguer les unes des autres les perspectives ou visées finales des cinq axes de jugement choisis pour entourer la visée théorétique et au besoin s’opposer à elle (i.e. les axes logique, éthique, théorique, pratique et politique). Le premier avantage qu’il y a à distinguer ces 5 mots en ique les uns des autres est que toutes les cinq finalités relatives à ces cinq mots ne se confondent pas avec la finalité théorétique.
Et, si parfois la cohabitation de ces six visées dans le même voisinage ne pose aucun problème de contradiction plus ou moins profonde, parfois cependant il peut y avoir superposition de ces finalités de telle sorte que sans s’opposer, elles peuvent être appelées à se prolonger et provoquer ainsi un effet d’aspiration ou de renforcement ou d’affaiblissement de ces diverses finalités les unes sur les autres.
Ainsi par exemple, le théorétique est loin de s’opposer au théorique. Il y a d’autant moins d’opposition entre les deux que le théorétique suppose presque toujours le théorique. De même, le théorétique ne s’oppose pas au pratique ; ni au logique et pas davantage à l’éthique ou au politique. Mais tout en ne s’opposant pas au théorique, au pratique, à l’éthique au logique et au politique, le théorétique ne les surplombe pas moins en déployant au-delà des finalités de chacune d’elles sa finalité propre.
En conséquence, nous pouvons considérer comme théorétique tout regard, toute visée, tout jugement, toute analyse, etc. qui, étant donné une pratique ou une théorie et nonobstant les visées propres à cette pratique ou à cette théorie, considère le but ultime, l’objectif le plus éloigné – voire la fin dernière – de cette pratique ou de cette théorie, y ordonne et y coordonne son analyse, son jugement, et son évaluation propres. Le théorétique n’est donc pas du théorique à un deuxième ou à un troisième ou même à un énième degré. Le théorétique, c’est le souci de découvrir à l’horizon d’une fin annoncée, quelque belle, pure, utile soit-elle, la fin ultime[237]vers laquelle est ordonnée une pensée ou une action. C’est dans ce sens qu’il faut entendre ici toute préoccupation et tout défi théorétique, y compris les préoccupations de l’école africaine.
II. Deuxième partie : Le système de connaissance et la centralité du sujet connaissant.
La préoccupation théorétique est sous-tendue par un élan qui suppose un système de connaissance. Pour qualifier de théorique ou de pratique une activité donnée, il faut nécessairement s’être abstrait de l’activité en question pour lui appliquer un regard d’ordre cognitif. Le souci théorétique se révèle donc être de nature cognitive. Qu’un tel regard soit appliqué à une activité reconnue elle-même comme pratique ou comme théorique, cela signifie entre autres choses que toute théorie de la théorie n’est pas nécessairement théorétique. Une telle théorie serait tout au plus une théorie au deuxième degré ; mais elle se trouvera déjà installée en pleine connaissance ; à plus forte raison un regard délibérément appliqué dans un souci théorétique sera-t-il assuré d’être nécessairement et toujours dans du cognitif même si, par ailleurs, l’objet auquel ce regard théorétique a choisi de s’appliquer est un objet de nature pratique.
Convenons d’appeler système de connaissance la sphère immatérielle à l’intérieur de laquelle se déploie un regard théorétique conçu comme dit plus haut. Arrêtons-nous aux quatre caractéristiques du système de connaissance aptes à nous permettre de poser le problème du défi théorétique de l’école africaine actuelle.
- Fermeture et ouverture monadique.
L’idée de monade[238]n’est utilisée ici que pour tirer avantage de la fermeture qu’elle connote. Cette fermeture signifie une autosuffisance aussi relative que réelle. Mais, il faut exclure de l’idée de monade celle d’impénétrabilité qui signifierait un isolement et voudrait dire que les monades ne peuvent pas communiquer entre elles. Admettons au contraire que bien que fermées sur elles-mêmes pour s’autosuffire, nos monades soient néanmoins poreuses les unes aux autres. Sur cette base, mon idée est que l’élan théorétique se déploie toujours dans une sphère relativement fermée sur elle-même en raison de l’autosuffisance réelle qui la caractérise. Cette sphère demeure cependant accessible à des sphères semblables engagées dans la connaissance et situées en d’autres points de l’espace et à d’autres moments du temps. Ces caractéristiques d’ouverture et de fermeture monadiques sont celles du système de connaissance. Ce qui renforce cette nature monadique de tout système de connaissance, c’est son pouvoir d’autorégulation. Une fois organisées en système, les connaissances d’une même « monade » se complètent, s’opposent et s’équilibrent sans cesse à l’intérieur d’une totalité relativement et réellement autosuffisante[239].
- Le sujet du regard théorétique n’est pas l’individu.
Ne confondons pas la connaissance telle qu’elle se réalise dans le sujet individuel[240]avec la connaissance telle qu’elle se réfère au sujet impersonnel de la connaissance en général. Le sujet de la science appelé sujet épistémique peut être considéré comme une des meilleures réalisations de ce sujet impersonnel du savoir considéré dans sa généralité. Dans le sujet connaissant individuel, l’activité cognitive s’effectue par rapport à une superposition d’infrastructures, de mésostructures et de superstructures15 qui ont en commun d’être situées et enracinées dans le sujet individuel. Ainsi se superposent et s’entredéterminent au niveau de l’individu, le biologique, le psychologique, le discursif, le logique[241], le socioanthropologique, le métaphysique, le spirituel et même le transcendantal.
Par rapport au sujet individuel ainsi sommairement décrit, le trait distinctif du sujet de la connaissance que supposent le regard et l’élan théorétiques est que les infrastructures biologique et psychologique ne sont plus imputables à un individu isolé, mais se réfèrent à un ensemble d’individus qui s’organisent dans le temps et l’espace pour réaliser le savoir érigé en un but en soi. Mais le sujet connaissant collectif n’échappe pas, bien au contraire, à la détermination des autres structures énumérées telles que les structures logique, discursive, socioanthropologique, métaphysique, spirituelle éthique et politique.
Ce qu’il faut retenir de la nature systémique de la sphère du déploiement de l’élan théorétique, c’est la nécessité permanente pour le sujet situé au centre de cette sphère[242]de veiller à son intégrité comme sujet producteur du savoir ou de la connaissance.
Cette intégrité suppose la mise en place et la sauvegarde permanente d’un minimum d’organisation indispensable pour garantir l’intercommunication des sujets individuels engagés dans la production du savoir en tant que
tel[243].
- Double orientation de l’élan théorétique.
Du centre de sa sphère, l’élan théorétique accomplit deux mouvements opposés mais complémentaires. Il est tantôt centripète et tantôt centrifuge. Avant d’être théorétique, il est d’abord essentiellement cognitif comme dit plus haut. Comme tel, il est à la fois découverte et connaissance du monde pour la découverte et la connaissance de soi dans son mouvement centrifuge ; et découverte et connaissance de soi pour la découverte et la connaissance du monde, dans son mouvement centripète. Le lien indissociable ainsi institué entre le soi du sujet connaissant et l’être-là du monde connu ayant été magistralement décrit et utilisé par et dans l’expérience du cogito cartésien, la pensée qui se trouve au cœur de ce cogito est en effet la pensée du sujet par la pensée du monde et la pensée du monde par la pensée du sujet. Ces deux pensées étant indissociablement liées[244].
Si ces deux pensées forment un cercle, alors loin d’être vicieux et fermé sur lui-même un tel cercle est, au contraire, le seul qui soit apte à révéler le monde au sujet en même temps que le sujet au monde et à luimême. La structure monadique de ce cercle ou système de la connaissance assure par ailleurs sa porosité aux autres sphères et aux autres cercles tout aussi monadiques.
- Effet de cumul des deux mouvements de l’élan théorétique.
Dans la sphère qu’est le système cognitif et du centre duquel s’élance l’élan théorétique en tant qu’élan cognitif, les mouvements centripètes et centrifuges ont des effets dont la conscience du sujet connaissant assure en permanence le cumul. Ce cumul ne s’effectue pas sous la forme d’un simple amoncellement de savoirs et de parties de savoirs. C’est au contraire une articulation de ces savoirs et éléments de savoirs les uns aux autres, à la faveur d’une alchimie qui implique des additions et des soustractions, certes, mais surtout des multiplications et des synthèses qui nécessitent parfois des sauts plus ou moins radicaux, à l’intérieur même du savoir produit. L’élan théorétique en tant qu’élan cognitif assiste au cumul de connaissances ainsi entendu, et tout en étant le principal moteur de ce cumul, il en est également le bénéficiaire
attitré[245].
En conclusion de ces quatre caractéristiques du système de connaissance qui sert de cadre de déploiement à l’élan théorétique en tant qu’élément cognitif, il faut retenir que son sujet n’est pas l’homme individuel, qu’il n’assure son intégrité de sujet producteur qu’en veillant en permanence à son organisation spatio-temporelle ; et que porté par un double mouvement dont il recueille l’effet de cumul, le sujet de l’élan et du regard théorétique s’élance d’un centre qui est en même temps un foyer. C’est pourquoi il est à la fois riche et enrichissant, connaissance du monde en même temps que connaissance de lui-même comme sujet producteur de connaissance[246].
III. Troisième partie : L’école africaine moderne, une école inappropriée ?
1. L’école au sens large.
- En extension ou en étendue.
L’école au sens large, c’est d’abord l’école au-delà des murs, des tableaux et des tables-bancs d’une école particulière. C’est aussi l’ensemble de toutes les écoles d’un village, d’une ville, d’une région et d’un pays tout aussi particuliers. Ainsi conçue, l’école au sens large contient aussi bien toutes les écoles de même niveau primaire, secondaire, supérieur, que toutes les écoles de tous les niveaux et de toutes les spécialités. L’école au sens large, c’est donc tous les lieux matériels plus ou moins fixes, plus ou moins rigides où se déroule l’activité la plus caractéristique de toute école et qui se résume dans la formation de l’homme sous toutes ses formes, professionnelle, religieuse, artistique, militaire, idéologique, politique, etc.
Mais l’école au sens large englobe également en plus de ces lieux dûment estampillés, tout autre espace immatériel et/ou virtuel de structure stable ou éphémère dans lequel la formation de l’homme peut s’effectuer de façon plus ou moins durable.
- En intension ou en profondeur.
En intension[247]et en profondeur, l’école, c’est l’ensemble des moments, des moyens et des acteurs qui, dans une société donnée, s’occupent – et se préoccupent – de la formation de l’homme dans tous les sens de cette formation. Cela fait de cette formation non seulement un projet et à ce titre un idéal mais aussi une activité permanente qui s’exerce à plusieurs niveaux et de différentes manières en entraînant dans son élan tous les matériaux disponibles en un temps et en un lieu donnés. Cette école intensionnellement conçue, lorsqu’on l’envisage dans son étendue la plus vaste possible, déborde les actes et les actions spécifiquement ordonnés à la formation de l’homme ; elle englobe les actes et les actions menés à d’autres fins mais qui comportent une marge, une portion ou un halo de portée formatrice. Car l’école en tant qu’intension, lorsqu’on envisage cette intension dans sa profondeur, c’est tout ce que font les hommes en un lieu et en un temps donnés pour qu’advienne l’homme tel qu’en ce temps et en ce lieu on se représente cet homme[248].
L’école au sens large repose ainsi d’une part sur une infrastructure qui va du matériel à l’immatériel en passant par le virtuel et de l’autre, sur une finalité portée par un idéal. Entre cette infrastructure et cet idéal, l’on ne saurait omettre l’ensemble des acteurs qui travaillent de façon permanente ou occasionnelle, accidentelle ou professionnelle à l’œuvre de l’école en tant que telle. Quitte à distinguer au sein de ces acteurs, différents degrés d’activité et de passivité aptes à leur faire jouer tour à tour, tantôt le rôle de destinataires et tantôt le rôle d’expéditeurs de l’œuvre de l’école.
- L’école africaine au sens restreint.
Si l’on applique à l’Afrique envisagée dans ses dimensions géographique, historique et socioculturelle ce qui vient d’être dit de l’école au sens large, il va sans dire que l’Afrique a toujours eu son école. Partout où les hommes ont vécu en société, ils ont eu à se former les uns les autres en des termes et selon des modalités desquelles l’organisation systématique et progressive a engendré l’école. L’école africaine au sens restreint n’est pas à confondre avec cette école également africaine mais au sens large. Car au sens restreint, l’école africaine a été, d’un point de vue historique, une institution repérable à la fois dans l’espace et dans le temps. Reconnaître la nature historique d’une institution, c’est accepter de la replacer dans la série causale des actions dont l’enchaînement a conduit à cette institution.
L’école africaine au sens restreint doit recouvrir comme réalité d’une part l’école telle qu’elle a été véhiculée par l’Islam et la culture arabe et d’autre part, l’école telle qu’elle fut implantée décisoirement par la colonisation européenne sous toutes ses formes elles-mêmes porteuses de la civilisation européenne globalement entendue. Ces deux écoles araboislamique et européenne cohabitent par conséquent au sein de ce qu’il convient de considérer comme l’école africaine actuelle au sens restreint. Il s’y ajoute les structures de formation issues de l’école traditionnelle telles qu’elles ont survécu dans les religions ancestrales et leurs couvents, dans les palais et autres cours de chefs et de rois ainsi que dans les sociétés secrètes[249]et leurs forêts sacrées et les différentes corporations[250]qui ont toujours veillé à enserrer leurs membres dans des mailles d’éducation et de formation en agissant sur eux de père en fils.
Ces structures héritées du passé sont en effet loin d’être gommées par la modernité. Elles sont au contraire suffisamment encore vivantes pour épauler dans l’ombre, redresser et comme récupérer, les « naufragés » du système éducatif qui prévaut aujourd’hui en Afrique comme ailleurs.
- L’école africaine moderne : une école au sens large.
- Les déterminations historiques de son origine.
C’est de trois manières au moins que l’école moderne africaine est une école au sens large. La première est que comme pour toute autre école au sens large, il faut inclure dans l’école africaine au sens large, toutes les écoles qui s’y trouvent à tous les niveaux et avec toutes les spécialités. La deuxième façon dont cette école est large est qu’elle englobe tous les autres systèmes éducatifs hérités du passé et qui continuent d’être vivants et actifs. La troisième façon dont cette école s’élargit est plus discrète et plus déterminante ; c’est qu’il s’agit d’une école qui s’est construite et s’efforce de se perpétuer sur le modèle de l’école des pays industrialisés parmi lesquels ceux de l’Europe ont eu sur ceux d’Afrique l’influence que l’on sait.
L’école africaine moderne au sens large apparaît ainsi comme une école standardisée non pas à l’échelle euroafricaine mais à l’échelle d’une humanité désormais globalisée. C’est cette école africaine moderne qu’il faut examiner et interroger si nous voulons savoir comment elle fonctionne, quelles difficultés elle rencontre, quelles victoires elle remporte et si la voie dans laquelle elle est engagée et engage tous ceux qui passent par elle est une voie sans issue ou au contraire une voie lumineuse qui autorise des espoirs.
- Son état actuel : un constat d’échec sans pessimisme excessif.
Dans chacune des sociétés humaines actuelles prises isolément, comme dans l’ensemble de notre monde globalisé, l’école est une entité bruyante. On en parle sous de multiples formes en même temps qu’en son sein plusieurs paroles cohabitent, se croisent s’épaulent ou se combattent[251]. Sans doute faut-il tenir le bruit souvent assourdissant de cette école africaine actuelle dans le voisinage des bruits des usines et l’entrechoquement des armes sur les nombreux terrains de bataille qui continuent de marquer notre modernité ; et peut-être est-ce simplement parce que notre époque est bruyante que notre école l’est aussi.
En Afrique, le bruit de l’école d’ores et déjà articulé au bruit de quelques manufactures et aux bruits des luttes intestines par lesquelles les Africains continuent de s’entredéchirer, s’élève sur l’arrière fond d’un autre bruit plus vaste, plus profond mais en même temps moins audible et qui n’est autre que celui de la souffrance. Une souffrance[252]apparemment imméritée mais têtue et pluriforme qui enveloppe dans ses plis le continent tout entier au mépris des frontières, des ethnies, des empires et des religions.
Ici et là en Afrique, cette école bruyante a retenu l’attention de ses ayants droit après l’avoir parfois forcée. Elle s’est accaparée et continue de drainer vers elle une part importante des ressources nationales disponibles ; ce qui fait que cette école si visiblement onéreuse est en concurrence avec d’autres préoccupations et d’autres entités constitutives de la vie des Etats africains et de leurs gouvernements.
Après avoir été boudée, parfois même contournée par les élites africaines d’hier, cette école est désormais regardée comme le seul endroit par où il faut passer pour se libérer d’une certaine médiocrité et réussir sa vie dans tous les sens de l’expression. C’est la raison pour laquelle l’école africaine moderne n’est pas seulement bruyante ; elle se trouve aussi au centre de la vie sociale africaine de telle sorte que s’interroger sur elle ou s’interroger sur la situation sociale africaine ambiante, c’est donner l’impression de poser un seul et même problème ; c’est s’obliger à analyser une situation de départ dans laquelle se confondent les destins mêlés de l’école et de la société africaine actuelle.
Il en va de l’école africaine comme de l’usine, du marché, du village, de la ville ou de l’église, du temple ou de la mosquée africain(s)e(s). Les réalités présentes dans cette énumération ont en commun de viser des activités qui se déroulent en certaines circonstances spatio-temporelles qui supposent des acteurs organisés de plusieurs et différentes manières, qui poursuivent des objectifs plusieurs et différents, qui appliquent plusieurs méthodes, subissent différents échecs, réalisent et obtiennent différents succès et se caractérisent par différentes éthiques, différentes politiques, différentes idéologies, et peuvent même aller jusqu’à se caractériser par différentes ambiances, différentes atmosphères et, pour tout dire, différentes cultures[253].
C’est dans le contexte de cette pluralité d’activités reliées à une pluralité de lieux, à une pluralité d’acteurs, une pluralité d’objectifs, une pluralité de stratégies, une pluralité d’échecs, de succès, d’éthiques, de politiques, d’idéologies, etc., qu’il faut replacer l’école africaine et s’interroger sur son défi théorétique.
Nul ne peut nier que partout où elle existe aujourd’hui, l’école africaine fait un bien réel dont il serait fastidieux mais probablement instructif de s’exercer à décrire les innombrables facettes. Ce bien, partout, chacun voudrait non seulement que l’école continue à le faire, mais surtout qu’elle le fasse chaque jour un peu mieux. Comme en témoignent les réaménagements adaptatifs opérés dans cette école durant le siècle écoulé, l’école africaine renforce quotidiennement sa mise au diapason de toutes les autres écoles du monde. Lentement mais sûrement, les agents de cette école n’ont fait que renforcer la standardisation de leurs méthodes, de leurs outils et de leurs objectifs[254]. Ce qui a eu pour effet d’accroître leur propre mobilité dans les limites d’une école qui désormais s’étendent aux frontières de la planète.
Supposons que l’école africaine réalise la totalité de ses objectifs actuellement identifiés ; cela suppose que tous les moyens nécessaires à cette fin lui auront été fournis, que tous les obstacles qui jonchent actuellement le chemin des agents de cette école auront été écartés, contournés et vaincus. Cela suppose que l’école africaine aura réussi à vaincre toutes les résistances que lui opposent maintenant les autres composantes du vécu des sociétés africaines actuelles. Je ne crois pas être particulièrement pessimiste si j’ose affirmer que même une école africaine aussi miraculeusement efficace ne sortirait pas l’Afrique de la situation dans laquelle elle se trouve présentement.
Aussi scabreuse et provocante que puisse paraître la supposition succinctement évoquée ici pour afficher dans un seul et même élan d’une part l’échec relatif mais réel de l’école africaine actuelle et d’autre part, la futilité du contraire absolu de cet échec qui serait un succès également absolu, c’est néanmoins à partir de cette supposition qu’il faut se poser la question de savoir pour quelles raisons la réalisation des objectifs pratiques et théoriques de cette école ne la rendrait cependant pas capable de résoudre le problème actuel des Africains. Ainsi il est facile de voir que cette supposition permet de comprendre de quelle manière les objectifs de l’école africaine ne coïncident pas avec le problème et les objectifs de l’Afrique. Et tout naturellement, ce n’est qu’en progressant dans la connaissance de ces ensembles de problèmes et d’objectifs que l’on pourra ouvrir l’espace dans lequel l’école africaine et l’Afrique pourront enfin travailler l’une pour l’autre ; quand bien même ce serait en travaillant l’une avec l’autre et l’une en se servant de l’autre.
Si la part de ces deux ensembles qui se rapportent à l’école africaine actuelle nécessite une observation et une étude, les contenus de ces deux ensembles qui se rapportent à l’Afrique ont plus à être conçus, définis et exprimés qu’à être simplement observés et décrits. Ce sont ces problèmes et les objectifs que ces problèmes recèlent et dévoilent qui indiqueront à l’école africaine son défi théorétique.
Pour commencer à défricher l’espace ainsi défini, je propose que la relation entre l’Afrique et son école d’une part et les autres composantes de l’humanité qui forment le monde d’autre part, soit ramenée à la relation que l’on peut observer entre un serpent et une souris ou entre un lion et une gazelle.
Quel que soit celui de ces couples d’animaux que l’on choisit, ce qui les unit profondément est qu’ils sont tous deux des êtres vivants. L’intéressant pour qui se place dans le contexte d’une réflexion sur l’économie du savoir, c’est que dans ces deux couples d’animaux, chacun produit pour son usage propre une connaissance, un savoir, d’aucuns diraient même une science. Chacun de ces animaux est donc à sa manière un agent plus ou moins habile et plus ou moins heureux d’une certaine « économie du savoir ». Sans aller jusqu’à prêter à chacun d’eux une théorie du savoir et une théorie de l’économie du savoir, il est indiscutable que tous possèdent au moins une connaissance pratique du savoir ordonné à l’objectif que crée leur mise face à face plus ou moins soudaine dans un même espace.
Au-delà des préoccupations pratiques et théoriques et des préoccupations éventuellement éthiques, idéologiques et même politiques que l’on peut prêter à un serpent, sa préoccupation théorétique est celle qui a trait à l’objectif que crée sa rencontre avec la souris. Si le serpent a faim, son objectif théorétique sera donc de manger la souris. En même temps, l’objectif théorétique de la souris nonobstant toutes les préoccupations qu’elle pourrait se permettre, sera de ne pas être mangée par le serpent et donc de s’échapper pour aller vivre sa vie.
Dans un tel contexte, on voit mieux ce qu’est un objectif théorétique ; on voit aussi de quelle manière un objectif théorétique peut changer pour un même agent lorsque son contexte de vie change. On voit surtout de quelle manière les objectifs théorétiques de deux sujets et agents engagés dans une même séquence de vie peuvent être situés aux antipodes les uns des autres ; de telle sorte que si l’un de ces objectifs était atteint, c’est par et ce ne peut être que par l’échec total de l’objectif de l’autre. A peine est-il besoin de faire remarquer au passage que l’objectif théorétique n’a pas nécessairement besoin d’une élaboration théorique pour exister. L’instinct animal peut suffire.
Or, d’une part certains serpents mangent toujours des souris, certains lions mangent toujours des gazelles, mais, d’autre part, toutes les souris ne sont pas mangées et toutes les gazelles ne sont pas dévorées ; il reste à savoir si la différence qu’il ya entre un serpent et une souris est du même ordre que celle qu’il y a entre un homme et un autre homme ou entre un groupe d’hommes et un autre groupe d’hommes[255].
Conclusion
Le mouvement qui pousse l’école africaine à aligner ses outils et ses objectifs sur les outils et les objectifs de toutes les écoles du monde entier est sous-tendu et commandé par une force profonde et puissante. C’est à cette force que nous donnons le nom de mondialisation ; et le développement[256]est la forme que cette force épouse ou que nous lui faisons prendre dans les efforts multiformes que nous développons pour comprendre notre être-au-monde et nos relations avec nos semblables.
Dans la structuration progressive des sociétés humaines actuelles, l’école n’est pas un simple outil. Elle est un véritable foyer, un creuset ; et il n’est pas possible que les gazelles ou les souris aillent à la même école que les lions et les serpents pour apprendre comment faire face les uns aux autres et comment survivre les uns aux autres, nonobstant ce penchant apparemment inné des uns à ne vivre qu’en ôtant la vie aux autres.
Le défi théorétique de l’école africaine actuelle est ainsi imagé et symbolisé en attendant de pouvoir connaître une expression verbale adéquate. L’unique certitude qui doit soutenir nos efforts est que l’homme n’est pas un serpent ou un lion pour un autre homme mais son semblable, son alter égo et donc son partenaire.
Références bibliographiques
- LALANDE. André (sous la dir. de), Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, 10ème édition, Presses Universitaires de France, Paris, 1968, 1324 p.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., 20 questions sur la philosophie africaine, Préface du Pr Djibril Samb, Illustrations du Dr François-Xavier Lalèyê, Collection Etudes Africaines, Paris, Editions Harmattan, 2010, 152 p.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., “La philosophie et les cultures. Flux et reflux de la rationalité” dans Monde arabe et Monde occidental : un dialogue philosophique par une approche transculturelle et Transcender les cultures, Journée de la philosophie à l’Unesco, 2003, Paris, Unesco, 2005, pp. 39-55 [104 p.].
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., “La spécificité culturelle à la lumière de la rationalité philosophique” dans Philosophie et culture et Philosophie et transculturalité,
Journée de la philosophie à l’Unesco, 2002, Paris, Unesco, 2004, pp. 47-64 [114 p.].
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., « En deçà de l’idéologie du développement et du culte de la culture » dans ETHIOPIQUES, Revue Négro-Africaine de Littérature et de Philosophie n°62, 1er trimestre 1999, Dakar, Fondation Léopold Sédar Senghor, 1999, pp.103-110.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., «Du temps comme dimension au temps comme condition du développement,» in DIAGNE, S. D. et KIMMERLE H. (édit.), Temps et développement dans la pensée de L’Afrique subsaharienne, Etudes de philosophie interculturelle, no 8, éditions Rodopi, Amsterdam, Atlanta, GA 1998, 327p, pp. 251-265.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., «Temps et développement», in QUEST (Philosophical Discussions), vol.VI, n2, décembre 1992, pp.45-61.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., «Conscience et culture», in QUEST (Philosophical Discussions), vol.VI, n1, juin 1992, pp.11-27.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., «Le fonctionnement idéologique. Enquête sur les infrastructures du dynamisme de l’idéologie dans les sociétés négroafricaines », in Philosophie et idéologies politiques africaines, Actes de la 12ème Semaine philosophiques de Kinshasa, 1989, Revue Philosophique de Kinshasa n°7-8, 1991, pp.17-29.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., «La philosophie, l’Afrique et les philosophes africains : triple malentendu ou possibilité d’une collaboration féconde ?» in Revue Présence Africaine no123, 3ème trimestre 1982, pp.42-62.
11.LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., “Humanismes et idéologies du développement. La contemporanéité à l’épreuve de l’essentiel humain”, in Mélanges en hommage à Feu Madické Diop, Revue URED (Université, Recherche et Développement, N°spécial hors-série, janvier 2008, pp.139-152, Presses Universitaires de SaintLouis.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., «Transdisciplinarité et développement endogène», in La natte des autres. Pour un développement endogène en Afrique, sous la direction de Joseph KI-ZERBO, Dakar, Codesria, 1992, pp.307-323.
- LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., « Humanismes et idéologies du développement. La contemporanéité à l’épreuve de l’essentiel humain », in Humanismos Latinos em Africa : encontros e desencontros. Coloquio internacional, Dakar, 9-11 de Janeiro 2003, Pubblicato a cura di: Fondazione Cassamarca, 1-31100 Treviso, Presso Europrint (Tv), 2003, pp.161-175.
LA MONDIALISATION : LECTURE SPÉCULATIVE ET ENJEUX
ÉTHIQUES POUR L’AFRIQUE
Marie-Thérèse Yah KABRAN
Assistante
Université de Cocody – Côte d’Ivoire
RÉSUMÉ
La mondialisation conduit à des mutations de tous ordres qui affectent le quotidien de l’humanité. Le sens de notre analyse amène à nous interroger sur ce qui fonde ou justifie le nouvel ordre rendu aujourd’hui nécessaire. Notre visée est, en effet, de montrer qu’il est possible de concilier l’aspiration à l’universel à partir de l’intégration des particuliers.
En outre, les défis qu’implique la mondialisation pour l’humanité engagent à en poser des présupposés éthiques. Au-delà de l’approche théorique, il s’agira plus concrètement pour l’Afrique d’opérer des mutations.
De la question de l’espace à une éducation à un nouveau sens de la citoyenneté et du partage, l’enjeu est finalement de penser la mondialisation en termes de tâche pratique. MOTS-CLÉS
Afrique – Citoyenneté – Diversité culturelle – Etat de droit – Ethique – Mondialisation – Particulier – Universel.
ABSTRACT
Globalization undoubtedly, brings out changes which affect the daily activities of man. The purpose of this work is to ask questions about the significance of this new phenomenon.
Indeed the importance of the impacts of globalization in today’s life cannot be left unquestioned, particularly about its basic ethics of functioning.
One of our main objectives is to show that in order to share in globalization African countries have to undertake deep changes involving the political space to the learning of a new sense of citizenship and to the sharing of competence and production facilities. For us these changes are more important than simple theories. In whole, African countries have to think about globalization in terms of practical transforming of their everyday lives.
KEY WORDS
Africa – Citizenship – Cultural diversity – State of law – Ethics –
Globalization – Particular – Universal.
INTRODUCTION
Le monde, aujourd’hui, est largement ramené à un ordre économique. Le constat est que ce qui se désigne sous le vocable de mondialisation, en instaurant un marché planétaire, a redessiné la carte économique du monde, contraignant chaque continent à se redéfinir. Elle prend aujourd’hui une figure particulière qui consiste dans l’expansion du libéralisme reposant sur un principe économique. Même si, outre l’économique, la mondialisation implique d’autres aspects, la tendance, en effet, consiste à s’orienter vers le capital inspiré du modèle néo-libéral. Toutes les cultures semblent converger de fait vers une culture unique et la réalité de la mondialisation se présente comme une sorte de pensée unificatrice. Elle se traduit par une uniformisation des produits et modes de vie, en même temps que naît une opinion mondiale.
L’intérêt de plus en plus croissant de la philosophie suscité par la mondialisation justifie, ici, le sens de notre démarche. Elle est liée au constat que la logique du profit affectant de part en part les rapports humains, désormais évalués à l’aune du simplement quantifiable, témoigne du triomphe de l’économie du marché.
Mais la mondialisation, en instaurant un marché planétaire et de nouvelles valeurs liées aux systèmes de communication, de production de réseaux, n’a pas pour autant effacé le poids du passé. Au moment où se dessine une nouvelle carte du monde, pour l’Afrique le phénomène présente un risque d’accroissement des inégalités. L’existence et la persistance d’inégalités flagrantes entre États et continents amènent alors à se demander si la mondialisation doit s’appréhender du seul point de vue économique.
Les oppositions farouches au phénomène à travers le monde n’expriment – elles pas l’illusion d’un monde parfaitement unifié et homogène ?
La logique libérale fonctionnant sur le modèle de l’efficacité, avec pour visée le bien-être matériel, et donne, en effet, à comprendre que le processus semble vicié en son essence. D’où il apparaît opportun de réfléchir sur la place et le devenir de l’Afrique. Un tel constat n’impose-t-il pas une autre lecture ? La mondialisation n’est-elle pas en fait le lieu de la conciliation de l’universel et du particulier ? Dans quelle mesure l’individuel, le particulier peu-t-il s’intégrer efficacement, négocier au mieux la marche, le mouvement de l’universel ? Et quels en sont les enjeux pour l’Afrique ?
L’analyse reposera sur une tentative d’élucidation, afin de saisir le sens, les enjeux et présupposés de la mondialisation, plus spécifiquement pour l’Afrique contemporaine. Nous voudrions, dans un premier temps, en justifier le sens en montrant qu’elle est une manifestation de la Raison universelle qui se dit comme monde ; en un sens spéculatif, elle est la Raison se donnant en totalité, se manifestant comme universel dans sa médiation avec le particulier. En outre, la mondialisation ne saurait se réduire à une civilisation du quantifiable. Ce qui nous amènera, dans une seconde approche, à poser des présupposés éthiques se ramenant à une tâche pratique pour l’Afrique.
I- MONDIALISATION ET SENS
L’une des caractéristiques de la mondialisation est le flux des personnes d’un pays à l’autre, d’un continent à un autre. En ce sens, l’homme peut être dit ‘’citoyen du monde’’. À cette lumière, il convient d’analyser ce concept que semble véhiculer le nouvel ordre mondial. La question qui s’impose à ce niveau ramène à celle-ci : Qu’est ce que la mondialisation ?
La mondialisation peut se comprendre comme une mutation du monde, un processus déterminant qui se traduit par une intensification des échanges de tous ordres (économiques, culturels, etc.) et aussi par une planétarisation des habitudes et formes de vies. C’est un processus globalisant qui concerne toute l’activité humaine.
L’un de ses traits récurrents ramène aux mutations qu’a subies l’espace. Il s’agit en fait de repenser à nouveaux frais la question de l’espace : espace de vie, espace régional, territorial, économique, politique, socio-culturel, espace virtuel. Le nouvel ordre impose, en effet, une réorganisation de l’espace. Faut-il alors fusionner ces différents espaces en un seul, répondant aux exigences du monde global ?
Nous avons, ici, affaire à un univers structuré en réseaux avec la contraction de l’espace et du temps par des moyens de communication et d’information. Le monde n’est plus soumis à un ordre comme dans la cosmogonie grecque, avec ses réalités propres qui la justifient mais c’est plutôt un monde construit sur la base de lois qui se veulent universelles.
La mondialisation implique également l’idée que l’homme est d’abord citoyen du monde. Cette expression véhicule le sens de cosmopolitisme.
Dans la pensée grecque antique, le discours a vite fait de s’approprier la question du kosmos ou du monde comme un tout organisé.
En remontant aux sources grecques, déjà avec les cyniques, l’idée de citoyen du monde se fonde sur un certain cosmopolitisme politique qu’ils revendiquaient. Le cynique est pour le rejet de la loi fondatrice de la cité au profit de la loi naturelle. Une telle vision est caractéristique d’une période marquée par une remise en cause des fondements traditionnels de la polis grecque, qui voit ses limites éclater à la mesure des ambitions du jeune souverain Alexandre. Le cynique Diogène, par exemple, revendiquait les qualificatifs de A-polis (sans cité), A-oikos (sans maison) ou même de kosmopolites ou citoyen de l’univers. Dans ces conditions, le cynique ne craignait pas l’exil car pour lui finalement, sa patrie, c’est le monde comme le déclarait Cratès. Cette idée sera reprise par les stoïciens, notamment Sénèque qui parle d’une république du genre humain.
À la lumière de cette pensée, nous pouvons comprendre que l’idée cosmopolite, en soutenant que l’homme est citoyen du monde, affirme le rapport de l’homme au monde comme totalité. Il revient alors à l’homme de trouver sa place dans le Tout.
L’homme, à la différence de l’animal, n’est pas cloué à son milieu comme le rappelle Platon, dans le Timée. De même le citoyen n’est pas enfermé dans sa particularité, mais il vit selon la loi du Tout. De ce fait, la belle totalité grecque élève la conscience à l’universalité, ainsi que le précise Taylor Charles : « La Grèce antique avait présumement réussi l’union parfaite entre la nature et la plus haute forme d’expression humaine. L’être humain s’y accomplissait de façon tout à fait naturelle »[257]. Même si l’homme qui s’adonne à la vie théorétique mène une existence solitaire, toujours est-il qu’il reste soumis aux exigences de la communauté. Or, celle-ci n’existe qu’en vue du bien commun. Aristote situe, en effet, au fondement de la communauté la mise en commun en vue d’un tel bien. En ce sens, la communauté parfaite est la communauté politique, « la seule qui se suffise à elle-même et qui puisse donner à l’homme son parfait épanouissement moral. Cette communauté présuppose d’autres communautés, plus simples, enracinées plus profondément encore dans la nature humaine »[258]. Un tel ordonnancement suppose une relation de dépendance naturelle entre les éléments de la cité : tout est dans le Tout.
Pourquoi le Grec parle-t-il alors du barbare, du citoyen, de l’homme libre, de l’esclave ? La différence entre ces catégories de personnes est nette chez Aristote. Tous les hommes ne sont considérés ni comme des esclaves ni comme des hommes libres. Les grecs appelaient barbares, les peuples qui étaient étrangers à leurs constitutions et à leurs mœurs. Ils considéraient comme ce qui leur est propre, le sang, la langue, les mœurs. C’est le génos grec ; mais il y a aussi l’ethnos qui désigne l’ensemble des hommes réunis sous une même autorité ou le stade naturel de la sociabilité. Même si Aristote reconnaît l’ethnos à tout peuple, toujours estil que pour lui, l’ethnos grec diffère des autres en cela qu’il se pose comme le principe éthique de la cité. Certes, la cité grecque reconnaît l’individualité libre, mais celle-ci est refusée aux esclaves et aux étrangers. Le grec ne savait pas que l’homme en tant que tel est libre. L’unité éthique ne concerne que le corps des citoyens. Solange Vergnières précise cette idée essentielle chez Aristote : « c’est la constitution qui assure l’unité et l’identité d’une cité »[259]et non l’unité éthique elle-même. De son point de vue, « c’est elle également qui fonde la citoyenneté »[260].
Au sens d’Aristote, l’harmonie qui préside à l’organisation de la cité se fonde sur un idéal commun de justice et de vérité. Encore que l’homme habite le monde et c’est là qu’il met en sûreté l’essentiel de son être, ce qui nous situe sur le sens humain de la mondialisation.
I-1-UN SENS HUMAIN ET SPÉCULATIF
Notre intuition fondatrice est que chaque être humain est une partie du Tout, de l’universel et l’universel, c’est le monde. L’homme lui-même est un universel et son monde, c’est le monde. En l’homme, c’est la Raison universelle qui est à l’œuvre et prend le visage de la particularité, à travers la singularité de chaque culture, de chaque peuple. Elle ruse en ce sens avec les hommes dans l’histoire. L’homme, afin de satisfaire ses besoins est conduit vers un but qu’il ne connaît pas lui-même. En cela, il est un acteur inconscient de l’histoire, ainsi que le souligne Hegel, dans La raison dans l’histoire : « Cette masse immense de désirs, d’intérêts, d’activités constitue les instruments[261]et les moyens dont se sert l’Esprit du Monde pour parvenir à sa fin (…). Par rapport à cette Raison universelle et substantielle, tout le reste est subordonné et lui sert d’instrument et de moyen »[262]. Il compare l’Idée à Mercure qui conduit les peuples et le monde, en guidant le cours des évènements. Pour Hegel, en effet, c’est la Raison universelle qui se sert de l’homme qui n’est qu’un simple instrument pour réaliser ses buts. Les hommes pensent agir d’eux-mêmes, alors qu’ils ne font que satisfaire ses besoins et ses désirs à leur insu, car celle-ci travaille dans l’intérêt de l’universel. De ce point de vue, le cours de l’histoire ne dépend pas des volontés individuelles.
Dans le sens de la mondialisation, chaque peuple, chaque culture se met au service de l’Esprit à travers quelque chose qui les dépasse, où son vouloir et ses intérêts sont en jeu. Dans ce mouvement, l’universel habite la figure du présent, mais à chaque étape, il la dépasse pour justement se reconquérir comme universel. La mondialisation explique cette aventure de la Raison, cherchant à se poser comme monde, à se donner un contenu dans l’extériorité. L’homme, en tant qu’humain, est embarqué dans une telle aventure car il est d’abord et avant tout citoyen du monde, lieu qui le situe par rapport aux autres hommes. Ici, c’est le même qui se présente comme le différent. L’universel est, en effet, toujours porteur de particulier et la différence s’affirme dans l’identité, dans le Un. Il y a identité parce qu’il y a différence ou altérité. Si l’universel se dit dans la particularité de chaque culture comme une figure singulière de l’identité, la mondialisation n’exprime-t- elle pas alors ce besoin de rencontre de l’autre du même ?
Les choses peuvent se présenter dans une sorte d’extériorité mais les particularités, apparemment figées, se posent comme les propres figures de l’universel ou sa singularité. Il s’agit du libre jeu dialectique de l’Esprit qui surmonte toujours ses propres oppositions. C’est le même Esprit qui se réalise à travers des figures particulières. L’universel qui est la Raison fait signe au particulier qui doit s’intégrer dans le mouvement et y trouver sa place.
Il convient à ce niveau de voir sous quel visage apparaît l’universel, sous quel trait il se donne à saisir. Avec Pierre-Jean Labarriere, il revient alors à se demander si c’est celui « de la vision rassurante d’un ordre objectif défini en lui-même et pleinement valable pour tous, que peut bien signifier la recherche d’une certaine convergence, d’une attitude commune, d’une conscience unique qui se chercherait et s’affirmerait au travers des mille formes que revêt maintenant l’activité de l’homme ? »[263].
Il ne s’agit plus en fait d’une existence unifiée qui n’accepte pas la différence ou d’un irréductible des particularités, ainsi qu’il le précise encore: « en somme, à la rigidité d’éléments repliés sur leur « différence essentielle », définis en eux-mêmes dans leur extériorité solidifiée, se substitue la souplesse d’un univers unique problématique et largement indéterminé »[264]. C’est la prise de conscience de l’appartenance de tous à la même humanité, quand les questions qui engagent le devenir de l’humain se posent à tout homme, aujourd’hui, quelle que soit son origine. Cet autre point de vue de Labarrière illustre un tel constat :
« Quand, par exemple, le combat social, longtemps limité à un groupe ou une société, en vient à prendre une dimension planétaire, quand la conscience d’une injustice lointaine devient capable d’arracher l’homme à sa propre sécurité, quand devient intolérable le fait de penser à la souffrance de ceux là même que jamais nous ne rencontrerons, alors il devient manifeste que c’est l’homme[265]qui acquiert une nouvelle stature, et qui laisse apparaître jusqu’en sa pauvreté le nouveau visage de l’universel auquel il est promu.» [266]
Mais, force est de constater que le “nouveau visage de l’universel” se présente sous les traits d’une civilisation du quantifiable. Tout se mesure à l’aune de l’efficacité technicienne, entraînant un réel bouleversement des valeurs traditionnelles de solidarité, de partage par exemple. En vérité, la réalité d’un monde transnational constitue une menace pour l’homme, évalué désormais selon le dénominateur commun du profit. À l’état actuel des choses, on assiste à une intégration qui se joue sur le modèle européocentrique. Marcuse insiste sur le danger de cette universalisation du monde qu’il qualifie ” d’unidimensionnel “. La nouvelle civilisation est caractéristique de la ” société industrielle avancée” qui s’est progressivement appropriée la mondialisation. Cette société repose sur un système de domination et une tendance totalitaire du système de production industrielle qui tend à tout unifier (mode de consommation, habitudes …) ; au sens de Marcuse, ce qu’il y a à percevoir comme une menace, c’est la « réduction à ” l’unidimensionnel ” de l’univers humain, fruit d’un aplatissement du monde des valeurs sur celui de l’efficacité technicienne »[267].
La civilisation technicienne entraîne un nivellement des valeurs. Dans une telle dynamique, se déploie une nouvelle rationalité qui s’inscrit dans une logique de domination avec des implications politiques, économiques et culturelles, ainsi qu’il le précise encore: « ce qui est nouveau, c’est la souveraine rationalité dans ce phénomène irrationnel, c’est l’efficacité d’un conditionnement qui façonne les aspirations et les pulsions instinctuelles des individus »[268].
Pris dans les mailles inextricables d’un impératif idéologique de domination, l’homme moderne vit son rapport à la machine sous le mode d’une sublimation. Paul Ricœur perçoit ce danger auquel expose l’universalisation à travers ce constat :
« C’est partout à travers le monde, le même mauvais film, les mêmes machines à sous, les mêmes horreurs en plastiques ou en aluminium, la même torsion du langage par la propagande etc.…, tout se passe comme si l’humanité, en accédant en masse à une culture de consommation, était aussi arrêtée en masse à un niveau de sous culture »[269].
Husserl parlait déjà d’une crise de l’humanité européenne, malade de sa civilisation. C’est comprendre par là que la mondialisation économique et ses avatars s’imposent au monde et particulièrement comme un nouveau paradigme.
Cet état de fait montre l’urgence d’un appel pour une éthique de l’humain qui répond à une exigence pour la mondialisation aujourd’hui. À ce propos, ainsi que l’entend Hegel, « l’universalisation de l’individu, c’est le travail de l’éducation qui apprend à l’individu ce qui vaut moralement pour tous. Ainsi s’impose l’éthique »[270].
I-2- UN SENS ÉTHIQUE
Du grec ethicos, l’éthique au sens d’Aristote est du domaine de normes ramenant aux règles de conduite. Il est un lieu commun que nous appartenons tous à la même essence. De ce point de vue, une éthique de la mondialisation doit reposer fondamentalement sur un retour au sens de l’humain, au-delà de la simple dimension économique, car finalement l’homme n’est pas que le pain, la machine ou l’outil technologique. Le critère de l’humain se justifie par le fait que les hommes, malgré leurs différences et leurs complexités, appartiennent à une même humanité. C’est elle qui fait leur unité. L’humain se pose comme le fondement éthique d’une altérité véritable qui repose sur la commune appartenance à la même humanité et sur la reconnaissance de l’identité dialectique de la vie qui fait apparaître la différence comme un autre moi. L’enjeu ici suppose un choix, un parti pris en faveur de l’homme.
C’est aussi comprendre que la dimension de l’universel ne se réduit pas à la société occidentale qui n’en incarne pas les seules valeurs. En ce sens, nous pouvons reconnaître avec Labarrière que « ce qui a valeur universelle et « objective », ce n’est pas seulement le moi, et pas d’avantage l’être que je rencontre, mais bien plutôt le devenir commun de l’un et de l’autre, l’histoire qu’ensemble nous élaborons, et qui nous constitue l’un et l’autre, d’imprévisible façon, dans la vérité de notre être réel »[271]. L’idée d’une essence universelle n’exclut pas toutefois les différences entre les hommes selon les conditions historiques d’existence. Par conséquent, ce qui peut se concevoir aujourd’hui comme la ” civilisation de l’universel ” implique que chaque peuple, chaque culture aille à la rencontre des autres avec ses propres valeurs, sa propre diversité. Il y a à rechercher dans chaque culture des valeurs qui répondent au critère d’universalité.
La question des droits de l’homme pourrait se situer à ce niveau. Ces droits sont dits droits de l’homme parce qu’ils ont acquis aujourd’hui une valeur universelle. Il pose le fondement de l’égalité de tous devant la loi. Au cœur des droits existe un droit fondamental : le droit à la vie. Ce droit repose sur un principe essentiel : la vie est sacrée. Aujourd’hui, face à une civilisation de mort véhiculée par la société moderne d’une part, et d’autre part les guerres civiles, rebellions, coups d’États, dictatures, il y a à valoriser la vie partout, à en faire une valeur universelle. Il en est de même pour les valeurs de liberté, d’égalité, de justice, qui sont des valeurs partout revendiquées, chères à la bonne gouvernance, à la démocratie et garants de l’Etat de droit. Ces valeurs inscrivent nécessairement une rationalité et une exigence d’universalité au cœur de la mondialisation.
Une telle vue rend irrecevable les réplis identitaires visant à se figer dans le particularisme de chaque culture dans une sorte d’identité plate et unifiée. C’est d’ailleurs par là assurer le règne de l’irrationnel, comme en témoignent les nombreux conflits dans le monde. Mais le retour à ces valeurs fondamentales implique une nouvelle éducation. Si l’homme doit être dit “citoyen du monde”, il doit être éduqué aux valeurs de la citoyenneté.
L’éducation citoyenne est une forme d’éducation visant à inculquer au citoyen les bases de la vie en communauté et à faire de lui un être responsable, car comme le reconnaît Husserl, « la vie personnelle, à titre de moi et de nous prend une forme communautaire ; c’est une vie dans un horizon de communauté ».[272]
L’éducation à la citoyenneté, pour nous Africains, porte sur un apprentissage des valeurs traditionnelles positives de solidarité, de partage, de respect d’autrui, le sens de la communauté. Aussi, se pose-t-il la nécessité d’une promotion mondiale de la culture de la paix, d’une nouvelle conscience écologique, d’un nouvel équilibre économique. Pour tout dire, il est urgent de retrouver, à travers ces valeurs, l’humain, et c’est par-là faire “métier d’homme” au sens de Labarrière : « Pour vivre le métier d’homme, il se peut que l’idéal ne suffise point, hors des cas-limite qui arrachent l’individu à lui-même : il y faut aussi l’intelligence, qui exige la confrontation et l’ouverture la plus totale »[273]. L’histoire de l’humanité engage, en effet, celle des différentes humanités. Il s’agit du dévoilement métaphysique de l’homme qui est ouverture à autre chose qu’à l’immédiat. La mondialisation ouvre ainsi à l’infini de l’altérité
En outre, pour éviter le péril de l’unidimensionnel, il faut retrouver la dimension transcendante qui est en tout homme. Il s’agit là de retourner à la dimension de l’intériorité essentielle qui va au-delà de la raison technicienne. C’est la dimension de la profondeur, de l’essence. Comme le conçoit Labarrière, « la dimension de l’essence est ce qui recompose toute réalité phénoménale dans son immanence et son unité devenues, la posant ainsi pour ce qu’elle est en révélant comment et pourquoi elle devient ce qu’elle n’est pas »18. C’est par là aussi donner une âme à la mondialisation, ce que traduit cette prise de conscience de Bergson :
« Or, dans ce corps démesurément grossi, l’âme reste ce qu’elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger. D’où le vide entre lui et elle. D’où les redoutables problèmes sociaux, politiques internationaux, qui sont autant de définitions de ce vide et qui pour le combler, provoquent
aujourd’hui tant d’efforts désordonnés et inefficaces : il y faudrait de nouvelles réserves d’énergie potentielle, cette fois morale. Ne nous bornons donc pas à dire, comme nous le faisions plus haut, que la mystique appelle la mécanique. Ajoutons que le corps agrandi attend un supplément d’âme, et que la mécanique
exigerait une mystique »19.
Telle qu’elle se présente la mondialisation porte en elle-même les germes d’inégalités flagrantes. L’exemple le plus patent est celui du diktat qu’impose la nébuleuse communauté internationale au reste du monde. Sous des paravents altruistes, des pays, des multinationales occidentaux violent au quotidien les droits légitimes des peuples au nom d’intérêts de toutes sortes.
Si l’homme peut être dit “citoyen du monde”, c’est au nom de la même humanité dont l’essence est la Raison universelle qui est à l’œuvre dans le monde. Comme le rappelle la pensée grecque antique, tous les êtres vivants font partie du Tout. L’idée de cosmopolitisme chère aux cyniques grecs rend compte de l’unité de l’homme qui doit se sentir partout chez soi. L’homme est “citoyen du monde”, et c’est par là qu’est affirmée l’unité de l’humanité, son universalité. Aussi, chacun doit-il s’accorder à la loi du Tout. Mais le ‘’citoyen du monde ’’ n’est pas un apatride, dépourvu d’identité, sans lien particulier à une entité culturelle.
Dans une telle perspective, la mondialisation appelle une éthique qui doit reposer sur des valeurs fondamentales dont celles des droits de l’homme. Ainsi perçue, elle signifiera alors le ralliement de tous les hommes à une même conception de l’humanité afin d’en préserver le noyau éthique comme le rappelle Paul Ricœur. C’est l’une des conditions pour que l’Afrique assume sa place dans la communauté mondiale.
19BERGSON, Henri, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, P.U.F, 1973, p.
330.
II-INTÉGRER LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ : UNE TÂCHE PRATIQUE
POUR L’AFRIQUE
Alors que la tendance est à l’homogénéisation, le constat est que les États africains donnent le spectacle d’agrégats, d’entités déviant parfois vers des particularismes identitaires ou de repli sur soi.
L’espace social et politique est, en effet, fortement ethnicisé en Afrique. C’est dire que l’ethnie a un réel impact sur le vécu culturel, social et politique de l’Africain. Du grec « etnos » qui signifie « peuple » par opposition à « polis » qui traduit « cité », l’ethnie repose sur le sens de l’appartenance à un groupe, à une communauté sociale, partageant en commun un patrimoine historique, culturel. Ces traits font de l’ethnie le lieu d’un univers clos, fermé sur soi. En cela, elle se pose dans sa particularité, se différenciant du groupe ou de la communauté. Ainsi perçue, l’ethnie peut être une menace lorsqu’elle se fige dans un rapport d’exclusion qui débouche sur l’ethnocentrisme. Dès lors, gérer un espace multiethnique devient problématique : d’où la nécessité, pour les Africains, de se redéfinir dans le sens d’une nouvelle appartenance. Par ailleurs, il convient de revisiter le sens de la communauté fondée sur la solidarité vraie, le partage ; ce qui débouche sur la question de la citoyenneté.
II-1-MONDIALISATION ET CITOYENNETÉ
La tâche, à ce niveau est d’amener à une nouvelle conscience de la citoyenneté qui requiert une nouvelle éducation. Il revient à s’interroger sur ce qui doit fonder la citoyenneté aujourd’hui. La mondialisation pose, en effet, avec acuité la question de l’appartenance qui implique l’idée de citoyenneté.
La conception moderne de la citoyenneté semble être tributaire de la vision antique, même si aujourd’hui ce concept a beaucoup évolué dans son sens et dans son fondement.
En revisitant la riche tradition des idées, avec Aristote, la citoyenneté est définie comme la liberté qui résulte de la jouissance de la loi. De son point de vue, c’est la constitution qui établit la citoyenneté. Le citoyen jouit des privilèges de la cité (participation politique, judiciaire…). Toutefois, une telle perception de la citoyenneté impose des restrictions, car « si la constitution institue la citoyenneté, celle-ci, ensuite, se transmet par le sang »[274]. Cette restriction démontre que la société grecque était divisée en citoyens et non- citoyens avec des droits limités et des interdictions. La vision grecque de la citoyenneté reposait sur une certaine cosmogonie: le cosmos comme harmonie que la loi établissait en équilibrant les différences sans les aplanir.
A une telle conception restrictive de la citoyenneté, on pourra opposer celle de Solon qui introduit des réformes au point de renverser l’ancienne cosmogonie. Comme le précise Paul Magnette dans la Citoyenneté, une histoire de l’idée de participation civique :
« À la conception (aristocratique) d’une égalité géométrique d’une harmonie résidant dans la complétude des différences, succédait la conception démocratique d’une égalité arithmétique. Tous sont égaux, et liés dans des rapports d’équivalence, d’identité, de réversibilité. Le statut unique institutionnalise cette égalité simple. Tous les citoyens peuvent se concevoir les uns comme identiques aux autres »21 .
Le citoyen, chez le grec, est celui qui jouit du droit ou du privilège de la cité.
Mais, la nouvelle citoyenneté qu’impose la mondialisation dépasse le cadre de la nationalité juridique. La mondialisation réduit les dimensions du monde à un village planétaire. Il s’observe, en effet, aujourd’hui une prise de conscience au plan mondial des devoirs civiques qui élèvent le niveau de la conscience à la communauté plus grande, plus ouverte qui intègre les diverses appartenances. L’une des tâches concrètes consiste alors à faire en sorte que l’Africain en soit citoyen. Il faut, de ce fait, créer une citoyenneté transnationale élargie aux dimensions du monde. Si la citoyenneté dépasse le cadre de la nation, il revient à situer le citoyen africain au cœur de ses multiples appartenances.
Une telle approche nous amène à nous interroger sur le devenir de la citoyenneté à l’heure des grands ensembles régionaux, internationaux. L’‘univers mondialisé étant un monde complexe, sur quels critère va se fonder l’appartenance à la communauté mondiale ?
Comment gérer alors cette complexité et cette contingence si le contingent, ainsi que l’entend Labarrière, est « ce qui advient tout d’abord de l’extériorité de ce qui est simplement donné à l’homme, mais aussi dans tout le domaine des réalités dont la survenance dépend d’une libre décision, – ce qui implique une conjonction toujours en devenir des conditions concrètes du monde qui est le nôtre et du «je » [275]?
Mais le principe d’une uniformisation du monde, fondé sur l’idée d’un universalisme des lois et des droits de l’homme, prôné par la philosophie des Lumières, demeure problématique. Il semble, de fait, se fonder sur la négation d’une appartenance à une entité nationale. Or, la question de l’identité avant d’être celle de la mondialisation se pose avec acuité dans les États multi-ethniques d’Afrique qui ont du mal à affirmer leur propre unité.
En ce sens, la mondialisation requiert un certain niveau d’éducation, principalement une nouvelle éducation à la citoyenneté.
Pour Aristote, il faut éduquer en vue du bien et « l’éducation fondamentale est une éducation à la loi, socialement »[276]. Elle passe par la médiation de la famille, de l’école et de la loi. Pour le cas de l’école, dans son sens moderne, elle a une fonction normative et a la responsabilité de lutter contre la marginalisation et l’exclusion. Elle est, de ce fait, régulatrice de rapports sociaux. Il faut, en ce sens, encourager des pratiques pédagogiques respectueuses des droits de l’homme et porteuses de valeurs démocratiques. L’apprentissage des comportements sociables, dès le jeune âge, aidera au renforcement des structures officielles de régulation. L’école doit spécifiquement œuvrer dans le sens d’un développement de l’esprit critique.
De ce point de vue, l’éducation citoyenne peut être comprise comme une forme d’éducation particulière visant à inculquer au citoyen les bases de la vie en communauté pour faire de lui un être responsable par son sens civique. Galli Médah indique la forme que pourrait prendre cette nouvelle éducation en vue de la citoyenneté :
« Un brassage qui crée l’unité par delà les barrières naturelles et artificielles, celles de la naissance, du sexe, de la fortune, de la religion… Elle utilisera avec beaucoup de profit les canaux des compétitions sportives et artistiques, les rencontres d’échanges économiques, scientifiques, et culturelles, telles les foires, les salons d’artisanat, les semaines culturelles, les séminaires, les conférences etc… »[277].
Le premier niveau de la citoyenneté repose sur le critère de l’appartenance à 1’ tat-Nation et non plus à l’ethnie. Cette appartenance est consacrée par un lien juridique qui crée des droits et des obligations. L’éducation devient ici universelle et la citoyenneté suppose de ce point de vue une capacité à voir au-delà de la simple appartenance au clan, à l’ethnie. Une telle exigence, porteuse d’humanité, traduit la nécessité d’une réelle culture des droits de l’homme en Afrique. Même si l’universalité des droits de l’homme est conditionnée dans l’espace et le temps, il faut, toutefois, reconnaître en Afrique une conscience de ces droits, comme en témoignent diverses cultures. Ce qui était en jeu, c’était l’équilibre communautaire, sociale. Il revient alors à se demander comment situer la question des droits de l’homme à la jonction de la mondialisation et des pratiques culturelles africaines.
La question des droits de l’homme pose le problème de la reconnaissance de la dignité de tout homme. Il s’agit en réalité d’une reconnaissance de l’individualité libre jouissant de tous ses droits. L’un des aspects de la modernité montre qu’elle repose sur une valorisation de l’individualité dans ses droits et devoirs. Pour ce faire, entrer dans la modernité pour l’Afrique, revient à résoudre la question identitaire en refusant par exemple l’instrumentalisation de l’ethnie. Au plan collectif, il s’agira en outre de créer de nouvelles formes de solidarité. Par exemple, uniformiser l’accès à un meilleur niveau de vie pour tout homme, par un sens accru de la solidarité mondiale. Il faut aussi respecter le pluralisme que porte la mondialisation dans l’affirmation de la diversité, notamment au plan culturel. A ce propos, la question de la diversité culturelle reste essentielle.
Le constat est que le nouvel ordre provoque des formes culturelles de réaction au processus d’intégration et de dilution des cultures. Il ne s’agit pas de créer forcément une homogénéité, quand le goût des produits du terroir tend à disparaître ou même à se diluer. À ce propos, la tâche se pose en termes d’alternative. Et pour Bayart :
« L’alternative n’est pas entre l’universalisme par uniformisation, au mépris de la diversité des « cultures », et le relativisme par exacerbation des singularités « culturelles », au prix de quelques valeurs fondamentales. L’universalité équivaut à la réinvention de la différence, et il n’est nul besoin de faire de celleci le préalable de celle-là »[278].
Ce qui donne à constater que la culture mondiale trouve sa source dans les contacts humains entretenus par d’immenses canaux de communications performants. Le constat, en effet, est que partout dans le monde, la tendance est à l’uniformisation des habitudes et des formes de vie. Toutefois, le monde ne peut être compris, aujourd’hui, comme un tout homogène, évoluant selon un modèle unique. Ceci s’explique par les inégalités de tout genre qui marquent les rapports humains. Il faut de fait tenir compte de la diversité, donnant à penser le lieu d’une articulation entre le mondial et le local, le particulier et l’universel.
Dans les cultures africaines, il y a une permanence, un substrat qu’il faut préserver. L’identité peut être comprise comme ce substrat, ce sur quoi repose la permanence d’un groupe. Elle nourrit la conviction d’appartenir à un groupe social avec le sentiment d’une unité géographique, linguistique, culturelle entraînant certains comportements spécifiques. En puisant dans chaque culture une source vivante, il s’agit d’intégrer la diversité des traditions au patrimoine collectif tout en gardant leur originalité. Et « c’est cette intégration de tous par tous qui doit être visée et non pas l’assimilation forcée des cultures qui détruirait les spécificités religieuses, culturelles et personnelles »[279]. Par conséquent, la culture ne doit pas être subordonnée aux lois de l’économie de marché ni à la domination du politique. La diversité culturelle qu’impose la mondialisation doit inscrire le partage à son fondement. Le partage implique l’idée de participation dans le sens de la communauté.
II-2 -MONDIALISATION ET PARTAGE
Toute société est fondée sur un ensemble de savoirs et savoirs faire qui sont des valeurs qui se transmettent et qu’il faut partager dans le cadre d’un dialogue. En tenant compte de leurs mutations dans le temps et dans l’espace, il revient à créer les conditions de circulation de ces savoirs, sous forme d’idées, de valeurs, de technologies en assurant leur diffusion. Mais déjà, par rapport à la nouvelle donne mondiale, l’Afrique doit être sensible à cette énorme pression qui incite à des changements et qui remet en cause les formes traditionnelles de l’économie et de la vie socio-politique. C’est que cette dénationalisation des conditions de vie n’est pas sans risque, car sous cette apparente clarté, persistent des zones d’ombre.
La mondialisation de l’économie par exemple maintient et même accentue les disparités entre pays développés/industrialisés et pays sous développés. Ici il faut se référer aux règles encore rigides de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). Si dans la pratique les pays en développement ont baissé la moitié de leurs droits de douane pour attirer les investisseurs étrangers, les pays développés continuent à prélever des taxes sur les produits transformés ainsi que des droits de douane en moyenne plus élevés que pour les échanges entre eux. Jean Ziegler, dans Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, décrit, à cet effet, cette organisation comme une véritable machine de guerre qui, « à l’aide d’un mécanisme compliqué de conventions et d’accords multiples, (…), fixe les règles du commerce international »[280]. Les qualifiant de mercenaires, il dénonce les seigneurs du capital financier mondialisé avec à la tête le Fonds Monétaire International (FMI dont il désigne les auteurs sous le vocable de « sapeurs pompiers du système financier international »[281]. De son avis, cet ordre meurtrier, immoral et cynique a consacré la corruption et la mort de l’État.
Ces zones d’ombre amènent à percevoir la nécessité d’inscrire des valeurs au cœur de la mondialisation. Comme l’indique Robert Misrashi dans Existence et démocratie, « une nouvelle exigence politique naît de là: la culture, l’éducation et le savoir doivent aussi ré-inventer leurs programmes et leurs finalités dans la perspective (…) de cette nouvelle forme d’action »[282]. Plus concrètement, les différentes tâches doivent être confiées, à un premier niveau, à l’État, car comme le précise Eric Weil,
« l’organisation de la société universelle incombe aux États tels qu’ils existent dans le monde contemporain »[283]. Il faut, de ce fait, repenser l’État Africain dans son rôle et dans sa nécessité.
Pour tout dire, il revient à intégrer une nouvelle vision du politique dans un univers mondialisé. Ce qui contribuera à la mise en place de sociétés ouvertes dont la société civile est le rempart pour faire immerger des hommes et femmes nouveaux, plus aptes à répondre aux grands défis de la mondialisation. Le concept de citoyenneté s’articule nécessairement autour de la société civile qui implique la reconnaissance du droit et du rôle de l’individu en tant qu’acteur social. Aujourd’hui, nous avons affaire à une société civile transnationale, mondiale qui crée de nouveaux espaces de débats. Nous assistons à la naissance d’une nouvelle forme d’identité : l’identité collective fondée sur l’idéal communautaire qui se situe au fondement même de la société civile, et implique la question de la participation. Jean Ziegler parle à ce propos d’une nouvelle société civile mondiale, planétaire comme « le lieu où se déplore de nouveaux mouvements sociaux, où s’affirment des fonctions et des structures inédites, où s’inventent des rapports nouveaux entre les hommes et les nations, où se pensent le monde et la société en dehors des canons figés de la doxa dominante ou de sa négation habituelle »[284]. CONCLUSION
La mondialisation révèle le fond substantiel qui habite les choses. En un sens spéculatif, le mondial, c’est le lieu de l’ouvert, de l’espace comme infini médiatisant son existence avec le particulier. C’est le lieu de l’authenticité où se nouent différents rapports. Le rapport au particulier passe ainsi par la médiation du l’universel-monde. Dans ce processus, c’est la raison qui est en question de soi, pour se pousser, hors d’ellemême, vers l’infini.
Il est certain que la mondialisation n’est pas un phénomène qui surgit ex-nihilo avec des effets de surprise. D’où il convient, pour chaque continent, de s’y adapter dans le temps, en procédant aux changements nécessaires. En clair, un retour à l’humain, une éducation aux valeurs fondamentales, une culture des droits de l’homme, de la paix, une éducation à la citoyenneté sont les présupposés ou fondements éthiques de la mondialisation. Cette éthique a deux visées : donner, dans un premier sens, une âme à la mondialisation, en retournant à la dimension transcendante de l’homme et un appel à trouver sa place dans le nouvel ordre mondial. La condition d’une mondialisation réussie est d’arriver à concilier l’aspiration à l’universel et la particularité propre à chaque culture.
De ce point de vue, l’Afrique ne saurait rester hors du temps du monde. Sa quête d’identité ne doit pas se penser dans un rapport qui la ferme à elle-même. Les problèmes africains sont certes complexes, mais il faut éviter de les isoler. L’Afrique doit, de ce fait, s’intégrer dans le Tout de l’universel ; et, pour elle, y répondre, c’est honorer la Raison qui est l’essence même de l’homme ; car c’est là que la liberté trouve son vrai sens. Et nous convenons avec Labarrière pour dire qu’elle est « au sein d’une expérience[285]où l’homme, peu à peu, vient à s’affirmer comme homme »[286]. Nous croyons, en effet, aux vertus de l’éducation qui est capable de former de vrais acteurs du nouvel ordre mondial.
BIBLIOGRAPHIE
- BAYART, Jean-François, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996.
- BERGSON, Henri, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, P.U.F, 1973.
- DIBI, Kouadio Augustin, L’Afrique et son autre: la différence libérée, Abidjan, Strateca Diffusion, 1994.
- DJEREKET, Jean-Claude, Changer de politique vis-à-vis du Sud, une critique de l’Impérialisme occidental, Paris, L’Harmattan, 2004.
- GALLI, M., « De l’éducation en vue de la citoyenneté de demain dans le contexte africain » in Le Cahier philosophique d’Afrique, Ouagadougou, PUO, 1er numéro spécial : “Philosophie et engagement en Afrique”, 2004.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La raison dans l’histoire, Paris, UGE, 1993, trad., Kostas PAPAIONNOU.
- Hervé, René Martin, La mondialisation racontée à ceux qui la subissent, France Quercy, Climats, 1999.
- HUSSERL, Edmund, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, Paris, Aubier, 1987, trad., Paul RICOEUR.
- LABARRIERE, Pierre-Jean, Dimensions pour l’homme : essai sur l’expérience du sens, Belgique, Desclée, 1975.
10.MAGNETTE, Paul, La citoyenneté, une histoire de l’idée de participation civique, Bruxelles, Bruylant, 2001.
11.MARCUSE, Herbert, L’homme unidimensionnel, Paris, Ed de Minuit, 1970, trad., Monique WITTIG.
12.MISRASHI, Robert, Existence et démocratie, Paris, P.U.F, 1995.
13.PAQUET, Léonce, Les Cyniques grecs : Fragments et témoignages, Paris, Librairie Générale Française, 1992, Choix, trad. introd. et notes par Léonce PAQUET.
14.PHILIPPE, Marie-Dominique, Introduction à la philosophie d’Aristote, Paris, Ed. Universitaires, 1994.
15.RICOEUR, Paul, « Civilisation universelle et cultures nationales » in Revue Esprit, octobre 1961 : De l’assistance à la solidarité.
16.SCHOOYANS, Michel, La dérive totalitaire du libéralisme, Paris, Mame/Ed. de l’Emmanuel, 1995.
17.TAYLOR, Charles, Hegel et la société moderne, Paris, Cerf, 1998, trad. Pierre R – DESROSIERS.
18.VERGNIERES, Solange, Ethique et politique chez Aristote, Paris, Puf, 1995.
19.VERNANT, Jean-Pierre, Les origines de la pensée grecque, Paris,
P.U.F, 1962.
20.WARNIER, Jean-Pierre, La mondialisation de la culture, Paris, la Découverte, 1999.
21.WEIL, Eric, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1996.
22.ZIEGLER, Jean, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Paris, Fayard, 2002.
23.ZUÈ-NGUÉMA, Gilbert, La philosophie par Temps de mondialisation, la conscience de son époque, Paris, Dianoïa, 2009.
L’éthique de la discussion et les
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Cyrille SEMDE
Assistant
Université de Ouagadougou – Burkina Faso
Résumé :
L’article traite des problèmes de nature éthique générés par le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication à la lumière de l’éthique de la discussion, de fondation apélienne. Cette approche de l’éthique fournit-elle une réponse à l’exigence de fondation d’une éthique de la responsabilité imposée par les progrès considérables des NTIC? Quelles sont les normes éthiques qui se dégagent de cette théorie de la discussion et quel bénéfice pouvons-nous en tirer dans le cadre de la fondation d’une éthique de la responsabilité? À l’inverse, le type de communication et de discussion que permettent les NTIC ouvre-t-il des perspectives heureuses pour l’application de l’éthique de la discussion en tant qu’éthique de la responsabilité ? La réflexion aboutit à la conclusion que le type de communication, rendu possible par les NTIC, se tient distancié de l’idéal de la communication consensuelle fondée sur des présuppositions normatives inconditionnées : la justice, la liberté et la responsabilité collective.
Mots-clés : Communauté idéale de communication – Communauté réelle de communication – cybercriminalité – éthique de la responsabilité – NTIC- rationalité éthique consensuelle – rationalité stratégique.
Abstract:
The article is about ethical issues arising from the development of the new information and communications technologies (ICT) in the light of discussion ethics as developed by Karl Otto-Apel. Does this ethical approach provide a response to the need for the establishment of an ethics of responsibility imposed by the tremendous progress of ICT? What are the ethical norms that emerge from this theory of discussion and what benefit can we draw within the framework of establishing an ethics of responsibility? Conversely, does the type of communication and discussion allowed by ICT open happy prospects for the application of discussion ethics in the sense of responsibility ethics? The reflexion leads to the conclusion that the type of communications made possible by ICT stands away from the ideal of consensual communications that rest on unconditioned normative presuppositions: justice, freedom and collective responsibility.
Keywords : Ideal community of communication – Real communication community – Cybercrime – Ethics of responsibility –
ICT – Rational ethical consensus – Strategic rationality
Introduction
Le développement accéléré des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) nécessite la fondation d’une éthique de la responsabilité au regard des dangers qu’elles peuvent générer. Mais quelle orientation convient-il de donner à une telle éthique ? Parmi les théories contemporaines de l’éthique en existe-t-il une qui puisse répondre à ce besoin ? Cette question en apparence banale soulève cependant une difficulté importante que résument avec clarté les propos de Franco Volpi : la réalité de la demande éthique qui s’accompagne de l’abondance des théories qui se proposent de la satisfaire peut cependant donner le sentiment qu’il règne un relativisme « qu’aucune offre contemporaine d’éthique n’arrive vraiment à dépasser »[287].
S’il faut faire un choix après s’être promené dans « le jardinmarché des éthiques »2, n’est-on pas mis en demeure de le justifier ? Opérer un choix ne correspond-t-il pas déjà à une volonté de s’élever au-dessus du relativisme ? Le présent écrit ne s’affronte pas directement et exclusivement à cette question. Il part du présupposé que, puisse qu’avec les NTIC nous sommes de toute évidence dans le cadre des questions liées à la communication et à l’information, l’éthique recherchée doit avoir un lien avec les processus de communication. Or ce qui semble être une innovation de la pensée contemporaine c’est l’émergence, avec notamment Habermas et Karl Otto-Apel, d’une éthique de la communication destinée d’une part à réformer le discours éthique classique, et d’autre part à répondre aux défis auxquels se trouve confrontée l’humanité actuelle. Cette approche de l’éthique fournit-elle une réponse à l’exigence de fondation d’une éthique de la responsabilité imposée par les progrès considérables des NTIC? Quelles sont les normes éthiques qui se dégagent de cette théorie de la discussion et quel bénéfice pouvonsnous en tirer dans le cadre de la fondation d’une éthique de la responsabilité?
À l’inverse, le type de communication et de discussion que permettent les NTIC ouvre-t-il des perspectives heureuses pour l’application de l’éthique de la discussion en tant qu’éthique de la responsabilité ? Nous partons de l’hypothèse que, constituant l’une des formes de manifestation de la mondialisation, les NTIC permettent un élargissement de la « communauté réelle humaine de communication » de telle sorte qu’elles offrent des chances de diffusion d’une éthique planétaire appropriée aux besoins actuels du monde. Mais elles ne peuvent assumer ce rôle que si, en retour, elles sont encadrées dans leur utilisation, par des normes éthiques que nous pouvons inférer de la théorie de la discussion. Parce qu’Apel articule, de manière explicite, la discussion et la responsabilité et que nous postulons que seule une éthique de la responsabilité – postulat devenu d’ailleurs, sinon un lieu commun du moins récurrent – peut répondre au défi technologique, la réflexion mettra l’accent sur l’analyse de son approche en matière d’éthique de la communication.
1. Les NTIC comme problème éthique
a.) Considérations générales. Traiter de la relation entre les NTIC et l’éthique de la discussion revient à montrer qu’elles font partie des éléments qui autorisent à considérer la situation de l’homme aujourd’hui comme étant un problème éthique, étant donné que l’éthique de la discussion, en tant qu’éthique de la responsabilité, entend répondre à la crise éthique contemporaine. Karl Otto-Apel – et bien d’autres penseurs contemporains – lient la crise éthique à la domination technico-scientifique du monde, domination dont l’ampleur quantitative et qualitative des conséquences demeure imprévisible.
À titre d’exemple, nous pouvons citer le danger nucléaire, la détérioration de l’environnement, l’application de la technique à l’homme lui-même. À cela, il faut ajouter la mondialisation de l’économie capitaliste, avec comme corollaire la tendance à tout subordonner à la logique marchande. Ainsi, émerge une diversité d’orientations en matière d’éthique telles que l’éthique écologique, l’éthique de la recherche, la bioéthique et l’éthique des affaires. La situation de crise est telle, qu’elle impose la fondation d’une nouvelle éthique dans la mesure où aucune éthique antérieure ne peut répondre au défi qu’elle engendre. Le domaine de l’éthique ne se restreint plus à la sphère de la vie individuelle. L’éthique recherchée doit prendre la forme d’une éthique collective ou planétaire. Mais fonder une éthique, universellement valable, est-il possible dans la mesure où jusqu’ici on a compris la science et la technique comme étant par principe axiologiquement neutres ? Le progrès scientifique et technique ne signe-t-il pas l’obsolescence de l’éthique ?
Pour Franco Volpi, la crise éthique est significative de la perte d’un paradigme à laquelle répond cependant l’émergence d’un nouveau paradigme. Ce qui est perdu, c’est bien l’ensemble non seulement des théories éthiques classiques mais aussi l’ensemble des valeurs sur la base desquelles on prétendait trouver une réponse aux problèmes auxquels l’humanité était confrontée. L’éthique traditionnelle ou classique était essentiellement orientée par la recherche de la vertu et de la sagesse comme conditions du bonheur. On se préoccupe du bien et du mal, de la découverte de l’ordre de la nature ou de l’ordre divin afin de s’y conformer. On enseigne la domination des passions ou la distinction des bonnes et des mauvaises passions, l’amour du prochain, la charité…Ce qui naît de la mort de l’ancien paradigme, « c’est le paradigme de la technoscience, dans lequel le savoir et le pouvoir se sont fondus selon une dynamique épocale : la technoscience – la science qui raccourcit l’espace et vélocise le temps, qui dépasse la douleur et promet le salut, qui mobilise la vie et les ressources de la planète selon son impératif inévitable – fournit une conduite bien plus efficace et contraignante de l’agir que toute éthique ; elle impose une obligation qui nous oblige plus que toutes les morales écrites dans l’histoire de l’humanité, les rendant dès maintenant superflues…Confrontées au phénomène technoscientifique, l’éthique et la morale n’ont désormais que la beauté des fossiles »[288]. Ce paradigme est d’autant plus tenace qu’il fonctionne comme une idéologie non opaque comme dans le cas des idéologies classiques, mais transparente et par conséquent irrésistible[289]. L’expansion des NTIC et plus spécialement d’Internet participe de la dynamique de la construction de cette idéologie transparente et euphorique. Bien plus, elle contribue à sa diffusion à l’échelle planétaire.
La situation de l’homme aujourd’hui est un problème éthique en raison de la prépondérance de la technoscience sur l’éthique ou en raison du contraste entre le besoin d’éthique et l’impossibilité principielle de la fonder. Le défi qu’il faut relever consiste alors à montrer que cette asymétrie n’est pas insurmontable. Il faut prouver que la raison n’est pas seulement la faculté des principes de la pensée théorique et qu’elle n’est pas non seulement un instrument au service de l’efficacité technique. Il existe également une raison pratique qui sert de fondement à l’éthique, donc aux jugements moraux, ce qui implique que ces jugements sont également susceptibles de vérité. C’est dans cette perspective que le programme de la fondation en raison d’une éthique de la discussion aussi bien chez Apel que chez Habermas représente une réaction contre l’idée d’un échec du « projet des Lumières », celui de faire triompher le cognitivisme contre le scepticisme en éthique. Une éthique cognitiviste repose sur la présupposition de l’existence de normes éthiques ou morales universelles ou sur la possibilité de parvenir à des normes éthiques universellement valables. Ces normes ne résultent pas d’une généralisation abstraite ou arbitraire des valeurs propres à une culture donnée. Elles sont définies grâce à une procédure rationnelle de légitimation, quant elles ne sont pas tout simplement déduites de la raison elle-même. Pour ce dernier cas, il s’agit, à titre d’exemple, de l’impératif catégorique kantien considéré comme la loi fondamentale de la raison pure pratique ou des normes pragmatico-transcendantales chez Apel. Une éthique cognitiviste ne traite donc pas directement du problème des conditions de la vie heureuse comme c’est le cas des théories classiques.
Pour Kant – qui n’évacue pas radicalement la question du bonheur du champ de la réflexion morale -, river l’éthique à la recherche des principes du bonheur conduit à construire des théories morales empiriques et non rationnelles. Seule une éthique cognitiviste peut rendre compte des conditions de validité universelle des normes. C’est pour cette raison que Habermas soutient que « toutes les éthiques cognitivistes se rattachent… à l’intuition exprimée par Kant dans l’impératif catégorique »[290]. Cette intuition consiste dans la thèse selon laquelle aucune norme ne peut prétendre à la validité que si elle est universalisable, c’est-àdire susceptible de rencontrer l’adhésion de toutes les personnes concernées. À l’opposé du cognitivisme, le scepticisme en éthique tient pour suspecte ou même vaine l’entreprise cognitiviste. Pour le sceptique, les normes et les valeurs morales sont relatives et il n’existe aucun principe rationnel qui permet de les hiérarchiser.
À ses yeux, il n’est donc pas possible de fonder une morale universelle. Une éthique destinée à la civilisation technologique, parce qu’elle doit être planétaire est donc mise en demeure de venir à bout du scepticisme. Si Habermas critique l’idée apélienne de la nécessité d’une fondation pragmatico-transcendentale de l’éthique, c’est parce qu’il estime qu’une telle démarche ne permet pas de venir à bout du scepticisme et par conséquent du relativisme moral. Bien entendu, Apel lui-même considère que le relativisme éthique n’est pas indépassable à la condition que, « quiconque a une démarche philosophique »6, reconnaisse l’existence d’une norme éthique fondamentale qui servirait justement d’étalon pour juger les normes particulières. Il s’agirait d’un principe, d’une norme qui devrait permettre la « reconstruction historique de la situation de l’homme »[291], de réinterpréter les différentes situations particulières de l’homme.
En résumé, la situation de l’homme aujourd’hui représente un problème éthique, d’abord, du point de vue fondationnelle théorique : comment fonder une éthique rationnelle dans un contexte de confinement de la rationalité à la rationalité théorique ? Ensuite, la situation de l’homme aujourd’hui est un problème éthique au regard des questions d’ordre éthique auxquelles l’humanité se trouve confrontée : il s’agit des questions relatives au statut de l’homme face à la nature, à la légitimité ou non d’étendre l’éthique à la sphère non humaine, au statut de l’embryon, à la légitimité de l’expérimentation scientifique ou médicale sur l’homme…
b.) Le cas particulier des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Les NTIC s’inscrivent dans le cadre de la domination technico-scientifique du monde qui, comme on vient de le voir, constitue un véritable défi éthique pour l’homme. Elles appartiennent à ce qui manifeste la spécificité de la situation contemporaine en tant que point culminant de l’histoire générique de l’homme, histoire qui permet de décrire la situation de l’homme comme ayant été de tout temps un problème éthique. Le développement et l’usage des NTIC génèrent, en effet, des dangers que résument les concepts de cybercriminalité et de cyberviolence. Par ces notions, il faut entendre l’ensemble des infractions qui peuvent être commises soit sur un système informatique ou par le moyen d’un système informatique. Ces infractions se commettent via la connexion à Internet. À titre d’exemple, nous pouvons citer la diffusion d’images pornographiques accessibles aux mineurs, l’escroquerie à travers Internet, l’accès intentionnel et sans droit à un système informatique, l’interception illégale de données, l’atteinte à l’intégrité des données ou d’un système, l’abus des dispositifs, les cyberattaques[292], la promotion du cyberterrorisme, la violation de la liberté et de la vie privée à travers la collecte frauduleuse d’informations sur un individu.
À la disposition d’entreprises, ces informations peuvent conduire à « des interdictions professionnelles ou [à] des freins à la promotion»[293]. La cybercriminalité, à travers ses modes de manifestation, semble a priori relever du droit pénal engageant la responsabilité politique des États plutôt que de l’éthique. En témoignent les diverses conventions sur la cybercriminalité comme celle de Budapest qui définissent les modalités – dans le respect toutefois de la souveraineté des États membres signataires – de la lutte contre tout acte relevant de la cybercriminalité. Dans cette perspective, la question de savoir en quoi les NTIC posent un problème éthique demeure. Et même, on peut se poser la question de savoir s’il est nécessaire d’en faire un problème éthique à partir du moment où il en existe déjà des solutions ou des tentatives de réponses juridiques. L’éthique se révèle-t-elle plus efficace que la répression pénale ? Pour le moins, nous pouvons affirmer que l’existence de cadres juridiques, la désignation de certaines personnalités politiques comme responsables des structures chargées d’assurer la cybersécurité, la création de Commissions d’Informatique et des Libertés dans lesquelles trônent des juristes – c’est le cas au Burkina Faso –, tout ceci, à notre sens, témoigne d’une récession de l’éthique et des morales traditionnelles. Une telle récession s’inscrit dans la dynamique du nouveau paradigme technoscientifique, le paradigme d’un monde informé par la science et la technique.
Le nouveau paradigme impose des valeurs dont le droit, c’està-dire les mécanismes légaux de préventions et de lutte contre les dangers qu’induit le développement des NTIC. En plus de l’encadrement juridique, il existe les parades techniques qui sont sans doute plus immédiates, plus urgentes et non dépourvues d’efficacité. Articuler problèmes et solutions appartient d’ailleurs à l’essence de l’idéologie scientiste et techniciste. Dans ces conditions, la domination technoscientifique du monde consacre la crise de « toute » éthique et rend toute tentative fondationnelle ou impossible ou superflue. Ceci est encore plus manifeste si l’on tient compte de l’autonomisation toujours croissante de la technique par rapport à des sphères de la vie telles que l’économie, la politique et même l’éthique[294]; selon Limore Yagil le « système technicien…évolue de façon indépendante comme si l’orientation et les choix s’effectuent d’eux-mêmes automatiquement »[295]. Il en résulte, comme conséquence, que la technique semble se développer sans finalité[296]ou du moins n’a de fin qu’elle-même si bien que l’on peut affirmer qu’elle absorbe l’éthique.
Mais c’est justement cette tendance à l’oubli de l’éthique, à la neutralité axiologique qui fait de la science et de la technique et plus particulièrement des NTIC un problème éthique. Réduire le progrès à cette unique dimension engendre une perte de sens de l’existence humaine, d’autant plus que l’idéologie techno-scientifique se développe en masquant comme le dit Habermas les problèmes pratiques. Plus encore, « elle justifie non seulement l’intérêt partiel d’une classe déterminée à la domination et … concurremment elle réprime le besoin partiel d’émancipation d’une autre classe, mais encore…elle affecte jusqu’à l’intérêt émancipatoire de l’espèce dans son ensemble »[297].
Le développement de la science et de la technique ne résout donc pas nécessairement les problèmes de la justice, de la liberté et de l’égalité auxquels l’homme est confronté. Ce qui est vrai pour la technique en général s’applique aux NTIC. L’usage de la téléphonie mobile devient de plus en plus répandu, mais cela ne s’accompagne pas d’une réduction de la pauvreté dans le monde ; bien au contraire, en entrant dans le « monde de la communication » le pauvre contribue, quel que soit le niveau de sa consommation, à l’enrichissement des opérateurs. Internet représente un puissant moyen de communication qui intègre tous les autres média et qui se répand de plus en plus ; « il ne s’agit plus [en effet] d’un outil de communication lié à un territoire physique bien délimité et mesurable. Il permet d’accéder à un monde sans frontières, identifié souvent comme un “village planétaire”… »[298]. Mais cette réduction du temps et de l’espace, ce rapprochement des hommes n’empêche pas la croissance des flux migratoires notamment du Sud vers le Nord. La rencontre virtuelle des autres, la mise en contact virtuelle avec les autres parties du monde ne dispense pas des voyages physiques, réels et même clandestins dans l’espoir d’un mieux-être ailleurs. Internet accroît d’une certaine façon la liberté d’expression tout en s’accompagnant parfois d’une violation des droits de la personne (voir infra, page suivante). Ces remarques permettent de décrire la situation actuelle de l’homme comme étant celle d’une crise qui nécessite la détermination de nouvelles règles et normes.
Par ailleurs, on peut observer que les dispositions juridiques, le droit, les moyens techniques de lutte contre la cybercriminalité reposent sur des présuppositions éthiques comme il en va d’ailleurs pour tout système de droit. Bien entendu, nous n’insinuons pas par-là que l’éthique se confond au droit. Depuis Kant, on sait que l’éthique relève de la sphère privée ou de l’individu, tandis que le droit à affaire aux relations extérieures que les hommes entretiennent entre eux. Mais nous pouvons déjà observer que l’éthique et le droit possèdent les mêmes fondements, à la fois la liberté et la vulnérabilité de l’homme et que Kant lui-même d’ailleurs considère que la doctrine du droit est une partie de l’éthique[299]. De même, il se trouve que l’éthique peut culminer dans la politique, c’est-à-dire dans l’existence collective qui, à travers ses règles, ses lois – donc à travers son système du droit – contribue à l’amélioration morale de l’individu.
Donc, on peut considérer que les dispositifs juridiques en matière de cybercriminalité sont l’indice d’un besoin d’éthique et cela d’autant plus, comme s’efforce de le montrer Limore Yagil, que l’usage des NTIC et plus particulièrement d’Internet conduit parfois à une violation des droits de la personne. Il s’agit par exemple de la violation de la vie privée des individus par la récupération à leur insu des informations les concernant, le renforcement du contrôle de la liberté individuelle. Mais l’éthique recherchée doit posséder des dimensions plus élargies que les dispositifs juridiques qui sont confinés aux États ou à des groupes d’États. En d’autres termes , une éthique appliquée aux NTIC doit prendre la forme d’une éthique planétaire ou d’une « macroéthique » à cause de leur caractère réticulaire qui réduit le monde à n’être qu’un « village planétaire » suivant l’expression désormais consacrée. On peut alors considérer que vouloir opposer à la menace technologique une réponse éthique et même en faire un devoir, au lieu d’être regardé comme un vain projet désigne plutôt un défi.
Face à ce défi plusieurs attitudes sont possibles : ou bien on tente de ressusciter le paradigme perdu avec ce qu’il professe comme valeurs ; mais on risque alors de s’attacher à un cadavre et tenir un cadavre est ce qui demande le plus grand effort (Hegel) ; ou bien on continue dans la logique du nouveau paradigme, ce qui veut dire la fuite en avant ; mais dans cette perspective, on n’a plus le droit de se plaindre du silence de la déferlante technoscientifique face à certaines questions qu’elle-même génère ; ou bien, enfin, sans nécessairement renoncer au nouveau paradigme, on tente de le rectifier en y ajoutant des éléments et des considérations que jusqu’ici elle avait voulu maintenir en dehors d’elle. Il s’agit d’un effort de remise en cause de l’idée de la neutralité axiologique de la science et de la technique. Cette dernière option représente sans doute la tendance théorique générale qui refuse de condamner à tout point de vue la technique et la science en tant qu’elles réalisent l’homme comme être d’anti-nature ; toutefois on se garde de les célébrer sans réserve comme l’aune à partir de laquelle s’évalue l’humain.
Dans une certaine mesure, la contribution d’Apel se situe dans cette perspective. L’enseignement fondamental que l’on retient de sa critique et de son effort de fondation de l’éthique consiste dans l’idée selon laquelle le nouveau paradigme, imprégné du sceau de la neutralité axiologique[300], admet cependant des présuppositions éthiques qui constituent les fondements d’une éthique rationnelle qui vaut comme une éthique de la responsabilité. « La rationalité de la science, dit-il, ne peut pas exclure a priori une rationalité possible de l’éthique »17. Ce qui veut dire que la fondation de l’éthique est possible et elle est destinée à répondre aux défis contemporains.
Mais à peine sommes-nous parvenus à cette conclusion qu’aussitôt surgit une autre préoccupation : la rationalité à l’œuvre dans les NTIC présuppose-t-elle nécessairement les normes qui sont définies dans le cadre de l’éthique de la discussion ? En d’autres termes, quelles relations existe-t-il entre la rationalité technoscientifique en tant qu’elle se détermine dans les NTIC et la rationalité propre à l’éthique de la discussion ? Les NTIC permettent-elles réellement l’émergence qualitativement parlant d’un « village planétaire » et la construction d’une éthique universelle ?
Pour répondre à cette question, il est important de rappeler, dans ses grandes lignes, la doctrine de l’éthique de la discussion telle que la conçoit Apel. Or il nous semble que l’essence de cette doctrine séjourne dans la thèse de l’existence d’une norme éthique fondamentale qui éclaire la tension entre l’idée d’une rationalité éthique propre à la communication consensuelle et celle d’une rationalité communicationnelle stratégique, dans la tension entre l’idée d’une communauté idéale et une communauté réelle de communication.
2. Rationalité éthique consensuelle et rationalité stratégique : à la trace des principes de l’éthique de la discussion
La réponse de l’éthique de la discussion à la situation de l’homme aujourd’hui consiste à soutenir que l’asymétrie entre la domination scientifique du monde et le besoin d’éthique n’est pas absolue ; on peut relever le défi éthique du monde contemporain à travers la construction d’une éthique de la discussion. Mais à quelle condition l’éthique de la discussion elle-même peut-elle constituer une réponse au défi du monde actuel ? À la condition que l’on adopte le point de vue pragmatico-transcendantal. Seule la « version fondationnelle pragmatico-tanscendantale » de l’éthique de la discussion, et non pas simplement sa forme procédurale (Habermas), peut rendre possible l’édification d’une éthique de la responsabilité conforme aux exigences de la situation de l’homme aujourd’hui. Mais la fondation pragmatico-transcendantale de l’éthique de la discussion présuppose une déconstruction des paradigmes classiques dans lesquels se sont formées les théories éthiques, philosophiques, ainsi que la pensée scientifique.
Il s’agit, d’abord, du paradigme de l’insularité de la conscience qui s’est développé avec, par exemple, Descartes, Kant et Husserl. Ce dernier, interprétant la doctrine de Descartes, considère que la philosophie est d’abord l’affaire personnelle du philosophe qui, audedans de lui-même doit reconstruire la science pour ensuite la justifier devant les autres[301]. Pour Apel, dans ce contexte paradigmatique, la rationalité dans l’activité de la connaissance a été située dans la relation sujet-objet, assignant au langage ou à la communication le second rôle d’instrument d’objectivation de la pensée individuelle. Or le langage ne remplit pas uniquement cette fonction. Il est le cadre où s’accomplit l’intersubjectivité. Déconstruire ce paradigme veut dire dépasser le rapport sujet-objet vers la relation sujet-cosujet dans l’activité de la connaissance. En d’autres termes, l’intersubjectivité doit primer sur la subjectivité telle qu’elle est conçue dans la philosophie transcendantale classique.
Privilégier l’intersubjectivité constitue déjà un pas vers la fondation d’une éthique rationnelle, dans la mesure où l’on se rend alors compte « que la validité intersubjective de la connaissance scientifique axiologiquement neutre (donc l’objectivité) est elle-même impossible sans présupposer simultanément une communauté langagière et communicationnelle, et, corollairement, la relation sujet-cosujet, relation normativement non neutre »[302]. Autrement dit, si la connaissance scientifique rationnelle se fonde sur un devoir de justification, cela signifie que l’individu savant se trouve dans l’obligation de produire des arguments susceptibles de convaincre la communauté scientifique de la validité de son savoir. Donc, l’objectivité scientifique dépend aussi de la reconnaissance intersubjective. Cela signifie que le savant se trouve déjà engagé dans une communauté de communication, que la science présuppose l’existence d’une telle communauté d’autant plus que le discours scientifique se doit d’être argumenté[303].
La contribution décisive d’Apel ici consiste à soutenir que la communauté scientifique de communication a déjà adhéré à des normes idéales, transcendantales de communication en fonction desquelles se déroulent les discussions scientifiques. En d’autres termes, le discours scientifique prétendument, axiologiquement neutre repose lui-même sur des présuppositions éthiques normatives. Au fond de la rationalité théorique, se trouve déjà l’éthique.
Ces présuppositions éthiques, ces normes idéales qui fondent tout discours argumentatif consistent, quant à leur contenu, dans les concepts de justice, de solidarité et de responsabilité.
Cette dernière s’entend ici comme co-responsabilité, c’est-àdire comme responsabilité collective[304]. Sur la base de ces normes idéales, transcendantales, peuvent être distinguées une communauté idéale de communication et une communauté concrète de communication qui répond plus à des impératifs stratégiques qu’à un besoin de consensus visant l’intercompréhension.
Pour Apel, la communauté idéale de communication est toujours déjà anticipée de manière contrefactuelle dans les discussions pratiques. Ce qui veut dire qu’elle est présupposée a priori. Mais, à partir de là, l’éthique de la discussion se trouve confrontée à une difficulté qu’il convient de surmonter. En tant qu’éthique de la responsabilité préoccupée par l’histoire, elle se fonde sur une phénoménologie de la situation concrète actuelle de l’homme, situation qui légitime la nécessité de sa fondation. Mais ses fondements, qui ne sont ni métaphysiques, ni ontologiques, ni téléologiques, consistent dans la présupposition de l’existence de normes idéales de communication qui, en principe, régulent tout processus de communication en vue du consensus.
La question qui se pose alors est celle de l’efficacité pratique de cette fondation pragmatico-transcendantale. Qu’est ce qui garantit dans les discussions pratiques que ces normes seront respectées ? Formulée dans les termes d’Apel, la difficulté se présente de la manière suivante : «celui qui a philosophiquement acquis cette intuition, la traduira-t-il aussi, par un acte de la volonté bonne, dans les résolutions à agir – que ce soit au niveau du discours argumentatif, ou même au niveau de la praxis de vie ?»[305]
L’éthique de la discussion, en sa fondation pragmaticotranscendantale, semble atteindre ses limites comme c’est le cas pour toute orientation cognitiviste de l’éthique. Les difficultés apparentes de sa mise en œuvre dans la vie pratique posent le problème de son intérêt pour l’éthique appliquée aux NTIC. En effet, si la justice, la solidarité et la co-responsabilité constituent des normes idéales – donc non réelles – de communication, on ne voit pas comment elles peuvent se réaliser dans le cadre des discussions pratiques. Or, ces discussions pratiques sont suscitées par les situations concrètes de l’homme, par les problèmes de la vie concrète tels que les conflits sociaux, les conflits politiques à l’échelle nationale et internationale, également la crise écologique avec les menaces qu’elle fait peser sur l’humanité, la cybercriminalité sous toutes ses formes. De manière radicale on peut se demander si le développement des NTIC et surtout d’internet ne creuse pas davantage le fossé entre la communauté réelle et la communauté idéale de communication ; si les NTIC ne rendent pas illusoire l’ancrage d’une éthique collective, planétaire de la responsabilité. Les NTIC et plus particulièrement Internet ne sont-telles pas destructrices de communauté ?
3. Les NTIC entre rationalité éthique consensuelle et rationalité stratégique
Il convient de rappeler ici l’une des questions qu’induit notre thème de réflexion. Il s’agit de savoir si l’émergence et le développement des NTIC ouvre la perspective de l’application d’une éthique de la responsabilité pensée à l’aune de la théorie apélienne de la discussion. Autrement dit, le progrès des NTIC et les conséquences qui en dérivent rendent nécessaire la fondation d’une éthique de la responsabilité. Mais, dans un monde dominé par ces nouveaux moyens de l’information et de la communication, une telle fondation est-elle possible dans la mesure où cette fondation signifie l’application des principes de l’éthique de la discussion ?
Par rapport à cette question, l’observation la plus immédiate qui s’impose concerne l’asymétrie entre la communauté de communication ouverte par le développement des NTIC et la communauté idéale de communication que postule la fondation pragmatico-transcendantale de l’éthique de la discussion. D’abord, la communauté de communication rendue possible par l’émergence de NTIC appartient aux communautés réelles de communication qui se tiennent encore distanciées de la communauté idéale de communication.
D’une manière encore plus radicale, les NTIC renforcent cette distance, rendant la réalisation de la communauté idéale de communication, donc l’application d’une éthique de la responsabilité, impossible. En effet, la communauté de communication instituée grâce au progrès des NTIC obéit beaucoup plus à la rationalité stratégique qu’à la rationalité consensuelle.
« Ces deux formes de rationalité, [dit Appel] s’appliquent comme telles à l’interaction et – si l’on veut employer ce mot de cette manière – à la communication entre des hommes considérés comme sujets d’action. Mais seule la rationalité propre à la communication consensuelle présuppose des règles ou des normes qui se situent a priori au-delà de l’intérêt particulier individuel, totalement défini par le calcul»[306].
La raison à l’œuvre dans la communication stratégique s’accomplit dans la logique de l’articulation des moyens appropriés aux fins visées. Quand elle s’exprime sous la forme du discours, ce qu’elle cherche, c’est beaucoup plus à persuader qu’à convaincre. La persuasion n’implique pas le respect de normes morales telles que la sincérité du locuteur et la liberté de l’autre.
À l’inverse, le consensus ne saurait être obtenu par le mensonge. L’intérêt particulier ne prime pas ici. Il s’agit de parvenir à l’intercompréhension par l’usage du discours raisonnable. Chez Apel, le discours est raisonnable lorsqu’il obéit aux normes idéales inconditionnées (justice, solidarité et co-responsabilité). Le consensus implique la co-responsabilité en ce sens que toutes les personnes concernées qui sont les partenaires de la discussion doivent se disposer à assumer les conséquences qui découlent de l’application des normes. C’est ce que Habermas nomme Principe (U)[307]qui fonctionne comme un principe-passerelle devant permettre de passer de la moralité individuelle à la moralité collective. La rationalité consensuelle représente une réinterprétation de la rationalité morale kantienne. Au monologisme kantien est substituée une procédure dialogique, communicationnelle de l’édification des normes.
La clarification conceptuelle qui précède permet de légitimer l’idée ci-dessus énoncée selon laquelle les NTIC s’inscrivent dans la logique de la rationalité stratégique. En effet, elles représentent des instruments de défense d’intérêts économiques, politiques, culturels, et constituent, sous certains angles, de nouveaux instruments du pouvoir. C’est ce qui explique la mainmise du politique et de l’économique sur les NTIC. Il convient cependant de souligner ici que la mise en œuvre d’une rationalité stratégique ne constitue pas nécessairement un désastre moral ou en tout cas une posture incompréhensible.
En effet, la rationalité stratégique répond à un besoin légitime d’autoaffirmation : « Chacun d’entre nous, [dit Appel], doit aussi, en tant qu’être vivant, répondre, sur le plan moral, de systèmes d’autoaffirmation ; il doit répondre de lui-même en tant que système d’autoaffirmation, de sa famille, du groupe social d’intérêts auquel il appartient, y compris – notamment s’il est politicien – de l’État en tant que système d’autoaffirmation »[308]. Dans cette perspective on peut même considérer que la cyberviolence – et non la cybercriminalité – n’est pas répréhensible en soi pour autant qu’on a pu parler de la réalité d’une violence légitime. On se rappelle le sens que Max Weber[309]a donné à cette notion. Si l’existence de la cité se justifie par le besoin de sécurité, donc de protection contre la violence, il n’en demeure pas moins que pour l’auteur du Le savant et Le politique, la cité elle-même, l’État ne saurait exister sans l’instrument de la violence. La violence est essentielle au maintien de l’État pour affirmer son autorité et sa souveraineté. À notre sens, dans le contexte actuel du progrès technologique, on peut concéder que la cyberviolence fait partie désormais des instruments qui servent, à côté des moyens dissuasifs traditionnels, à assurer la sécurité nationale – et éventuellement internationale. Elle peut être directe ou indirecte.
En nous fondant sur cette analyse, on pourrait en déduire que la cybercriminalité en tant que violence négative se situe du côté des particuliers ou des citoyens, tandis que la cyberviolence légitime serait réservée à l’Etat. Donc, en résumé, la communication stratégique, l’usage stratégique des normes y compris de la norme fondamentale[310]de l’éthique décrit une situation normale. Cela d’autant plus que la rationalité stratégique justifiée par le besoin d’autoaffirmation implique également la responsabilité ; elle correspond à une certaine forme d’exercice de la responsabilité ; mais, précise Apel, il s’agit d’une optique de responsabilité dans laquelle
« l’homme, bien souvent, ne peut, voire ne doit pas présumer que les autres – qui sont le cas échéant dans l’obligation de répondre de systèmes d’autoaffirmation – observeront l’impératif catégorique ou le principe de réciprocité généralisée qui sous-tend la formation de consensus. En un mot : il ne peut pas, dans ce genre de situation, se borner à agir conformément à la communication consensuelle, il lui faut au moins aussi agir stratégiquement »[311].
Mais, en même temps, cette analyse conduit à un malaise profond : reconnaître à l’État ou au pouvoir politique le droit de recourir à la cyberviolence en vue d’assurer la sécurité nationale ne revient-il pas à courir le risque de mettre en péril les libertés individuelles ? Ne risque-t-on pas de légitimer le pouvoir déjà réel de contrôle des citoyens jusque dans leur vie privée ? Comment contrôler et limiter les abus de la part des pouvoirs publics de ces nouveaux instruments ? La violation des droits et des libertés privés par le truchement des NTIC fait partie des dangers et justifie la nécessité de la responsabilité. Toujours est-il que, légitime ou non, la cyberviolence, comme nous l’avons dit, s’inscrit dans la logique de la stratégie économique, militaire, politique ou simplement crapuleuse. La communication et l’échange d’informations qui se déroulent dans ce cadre ne sont pas nécessairement conformes aux normes idéales de la communication. La distance entre la communauté réelle de communication et la communauté idéale se creuse davantage du fait de la contradiction entre l’idée que le monde est devenu un village planétaire et la culture de l’individualisme, de l’anonymat[312]promue par le progrès des NTIC. La notion de village planétaire évoque à la fois un élargissement spatial du village par une réduction du temps, et une réduction spatiale de la planète toujours par la réduction du temps. Le village devient planète et la planète devient village. Or le propre d’un village c’est que les hommes qui le forment vivent en communauté, qu’ils ont la possibilité de se connaître, une conception commune du sens de la vie, du bien et du mal, le sentiment commun d’une responsabilité partagée vis-à-vis de la survie de l’ensemble…Or, sous le concept de village planétaire, se dessinent deux notions qui, à première vue, semblent se recouper mais qui, à l’analyse, se différencient quant à leurs implications. Il s’agit des notions de globalisation et d’universalisation.
Au sujet de la relation entre ces deux notions, les propos de jean Philippe Pierron nous semblent suffisamment significatifs :
« Parler de village planétaire ou de village global met l’accent sur une signification spatiale de l’être ensemble [globalisation], alors qu’une universalisation véritable consiste à dire que l’être ensemble se retrouve autour de notions communes, de valeurs partagées sur le beau, la nature, le sens, le vrai ou le juste…Aussi il apparaît que la globalisation est neutre culturellement ; elle est la civilisation sans culture ! (…) c’est vrai, et c’est un bien, que la globalisation a effectivement créé les moyens technologiques d’information, de communication et de production grâce auxquels une solidarisation des hommes par la neutralité des dispositifs matériels à été rendue possible. Mais une solidarisation de fait, ne fait pas encore une solidarisation de projet »30.
propre identité et à celle de l’autre. Tout se passe ici comme si les principes professés par l’éthique de la discussion, à savoir l’égalité et la liberté sont assurés par l’anonymat. Mais, en même temps, cela permet à chacun de diffuser ce qu’il veut en cachant derrière une identité tronquée. D’où la nécessité de codes éthiques censés encadrer les discussions sur le net.
30 PIERRON, Jean-Philippe, Penser le développement durable, Paris, Éditions Ellipses, 2009, p. 8.
Logiquement, le progrès des NTIC devrait permettre une prise de conscience planétaire de l’universalité de l’humain à travers la diversité des cultures qui en sont la manifestation. Bien entendu, à travers, par exemple, la toile des individus ou des groupes d’individus dispersés à travers le monde échangent des informations, des points de vue sur des problèmes ou des questions, des valeurs par eux reconnus. Mais ces réseaux d’échange et de communication ne créent pas véritablement des communautés au sens strict de ce terme. Qui plus est, ces réseaux de communication appartiennent à un espace non réel, l’espace virtuel qui n’est pas un lieu de rencontre où s’éprouvent, se manifestent et se partagent la chaleur humaine d’une rencontre véritable. Une rencontre virtuelle ne permet pas d’éprouver la responsabilité à l’égard de l’autre dans la mesure où son visage et même son identité me sont dissimulés intentionnellement. On pourrait alors conclure que les NTIC créent certes des occasions de rencontres, d’échanges d’informations, mais elles ne créent pas véritablement un village au sens qualitativement humain de ce terme. Car, conclut Limore Yagil, « ce sont certes des outils de communication et de dialogue sans équivalent auparavant. Mais en même temps ils permettent à l’individu de menacer autrui, de diffamer, de diffuser des informations à l’insu de l’autre, etc. »[313]
Notre réflexion aboutit, en fin de compte, à une conclusion négative. Du fait de l’écart entre la rationalité propre à la communication consensuelle et la rationalité stratégique, il semble désespéré que l’idée de rationalité communicationnelle consensuelle permette de venir à bout des dangers générés par le développement des NTIC. Autrement dit, l’éthique de la discussion et l’idée de la responsabilité qu’elle postule ne répondent pas à l’exigence d’une solution éthique des problèmes induits par le développement et l’usage des NTIC. Celles-ci semblent tenir en échec le projet de réalisation de la norme éthique fondamentale, celle qui commande d’agir comme si l’on était membre d’une communauté idéale de communication.
Toutefois, en vue de ne pas se contenter d’un tel pessimisme, nous pouvons soutenir que l’intérêt de l’éthique de la discussion pourrait résider dans le fait que, conformément à la logique de l’auteur, elle permet d’interpréter et de comprendre la domination technologique du monde qu’illustre l’expansion des NTIC comme un problème éthique ; ce qui veut dire aussi comme situation qui invite à la responsabilité en tant qu’elle est la norme éthique fondamentale. Internet figure malgré tout parmi les instruments de diffusion d’un tel appel. Internet est aussi un espace où se rencontrent des scientifiques, des intellectuels, des politiques qui peuvent échanger leurs idées justement sur les principes et les mesures qui s’imposent pour limiter les dangers induits par le développement des nouveaux moyens de communication.
L’éthique de la discussion peut servir de référent aux discussions pratiques sur les décisions à prendre aussi bien au plan national qu’international concernant le progrès et l’usage des NTIC. Celles-ci et plus particulièrement Internet représentent un support pédagogique important par lequel peuvent être diffusés non seulement les informations concernant les dangers générés par les NTIC mais aussi les principes fondateurs de l’éthique de la responsabilité, essentiellement en direction des usagers en vue de la prise de conscience. Il en est ainsi des codes d’éthiques relatifs à l’usage d’internet qui tentent d’indiquer des principes de conduites aux internautes. La réalité de ces codes atteste que les NTIC représentent bien un problème éthique et que de plus en plus on en prend conscience. Bien plus elles engendrent de nouveaux concepts éthiques tels la notion de Néthique et celle de Nétiquette[314].
Conclusion
Il apparaît que nos analyses ont abouti à une mise en échec de notre hypothèse de départ. Elle consistait à présumer que l’éthique de la discussion, au sens d’appel, répondait aux enjeux éthiques des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Si, conformément à l’esprit de la théorie de la discussion, le sens de l’histoire consiste dans la réalisation progressive de la communauté idéale de communication, il semble qu’à l’âge des NTIC l’on s’éloigne d’un tel sens par la promotion d’une rationalité communicationnelle stratégique. Mais n’est-ce pas en vertu de cette asymétrie même entre une communauté idéale de communication et la communauté réelle que le progrès des NTIC – qui contribuent à creuser cet écart – représente un problème éthique ?
Dans cette perspective, nous pouvons alors affirmer que l’injonction « agis comme si tu étais membre d’une communauté idéale de communication », en tant que norme éthique fondamentale révélée par la théorie de la discussion doit en fin de compte fonctionner comme une idée régulatrice dans l’usage de ces technologies.
Bibliographie
- APEL, Karl-Otto, Discussion et Responsabilité, T. I. L’éthique après Kant, Paris, Les Éditions du Cerf, 1996, trad. par Ch. Bouchindhomme, M. Charrière et R. Rochlitz.
- APEL, Karl-Otto, Discussion et Responsabilité, II. Contribution à une éthique de la responsabilité, Paris, éd. du Cerf, 1998, trad. par Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz.
- APEL, Karl-Otto, Sur le problème d’une fondation rationnelle de l’éthique à l’âge de la science. L’a priori de la communauté communicationnelle et les fondements de l’éthique, Presses Universiaires de Lille, 1987, trad. par Raphaël Lellouche et Inga Mittmann, Lille.
- APEL, Karl-Otto, La réponse de l’éthique de la discussion, traduction française par Michel Canivet. Louvain – Paris, Peeters, 2001 (Titre complet : La réponse de l’éthique de la discussion au défi moral de la situation humaine comme tel et spécialement aujourd’hui).
- APEL, Karl-Otto, Éthique de la discussion, Paris, éd. du Cerf, 1994, trad. par Mark Hunyadi.
- BRUNET, Patrick J. et al, Les enjeux éthiques d’internet en Afrique de l’Ouest : vers un modèle éthique d’intégration, Paris, L’Harmattan, 2002.
- BRUNET, Patrick J. (dir), Ethique et internet, Sainte-Foy, Presses de l’université Laval, 2002.
- HABERMAS, Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », Paris, Gallimard, 1973, trad. par Jean Ladmiral.
- HABERMAS, Jürgen, Morale et communication. Conscience morale et activité communicationnelle, Paris, éd. Flammarion, 2001, trad. par C. Bouchindhomme.
10.HUSSERL, Edmund, Méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, Paris, éd. Vrin, 2001, trad. par Gabrielle Peiffer et E.
Levinas.
11.KANT, Emmanuel, Métaphysique des mœurs II. Doctrine du droit. Doctrine de la vertu, Paris, Flammarion, 1994, trad. par Alain Renaut.
12.MICHEAU, Jean (dir), L’éthique à l’épreuve des techniques, Paris, L’Harmattan, 2007.
13.MORIN, Edgar, Pour une politique de civilisation, Paris, Arléa, 2002.
14.PIERRON, Jean-Philippe, Penser le développement durable, Paris, Éditions Ellipses, 2009.
15.VIRILLO, Paul, Cybermonde, la politique du pire, Paris, Textuel, 2001.
16.VOLPI, Franco, « le paradigme perdu : L’éthique contemporaine face à la technique », in HOTTOIS, Gilbert, (dir.), Aux fondements d’une éthique contemporaine. H. Jonas et H.T. Engelhardt, Paris, Vrin, 1993, chap.VII
17.WEBER, Max, Le Savant et le Politique, «10/18 », 1963, trad. Freund.
18.WEIL, Simone, L’enracinement, Paris, Gallimard, 1949.
19.WOLTON, Dominique, Penser la communication, Paris, Flammarion, 1997.
20.YAGIL, Limore, Internet et les droits de la personne : nouveaux enjeux éthiques à l’âge de la mondialisation. Paris, Les éditions du Cerf, 2006.
APOLOGIE DU FÉMINISME ET RHÉTORIQUE MACHISTE DU
DISCOURS CHRISTINIEN[315]
François Bruno TRAORE
Maître de Conférences
Université de Cocody – Côte d’Ivoire
RÉSUMÉ
L’avènement du XVe siècle voit se réduire considérablement l’influence de Rutebeuf, de Guillaume de Machaut et d’Eustache Deschamps, poètes et émérites rhétoriqueurs d’un art de la versification au service de la promotion du masculin – et donc souvent machiste –, au profit d’une excellente poétesse en la personne de Christine de Pisan. Dans une société et un environnement littéraire essentiellement dominés par les valeurs du genre masculin, elle s’investit tout de suite dans un combat sur deux fronts : d’une part, s’affirmer comme poétesse à part entière, femme certes, mais écrivaine talentueuse et, d’autre part, comme première activiste féministe engagée sur le terrain du débat poétique et littéraire médiéval.
Mots-clés : Écrivaine – Féminisme – Machisme – Moyen Age – Pisan – Poésie
ABSTRACT
The advent of the XVe century sees to amount the influence of Rutebeuf, Guillaume of Machaut and Eustache Deschamps, poets and eremites rhetoricians of an art of the versification considerably to the service of the promotion of the masculine – and therefore often chauvinist –, to the profit of a poetess eremite in the person of Christine de Pisan. In a society and a literary environment essentially dominated by the values of the masculine kind, she immediately invests in a fight on two foreheads : on the one hand, to affirm itself like fully-fledged poetess, woman certainly, but talented writer and, on the other hand, as first feminist activist hired on the land of the medieval poetic and literary debate. Key words : Aged Means –Feminism –Machismo –Pisan –Poetry –Woman Writer
« … Plourez, doncques, plourez … femmes du royaume de France »
Christine de Pisan, Le Dit de la Pastoure, 1403. INTRODUCTION
Depuis quelques années, la problématique du genre est au cœur de la réflexion littéraire et critique française. Pour M. Bakhtine[316], il est possible de percevoir dans les textes littéraires, la reprise ou la traduction d’une sensibilité ambiante qui accrédite la thèse d’un discours « genré ». D’où, l’idée qu’il existerait une « rhétorique au féminin », prise de parole pourtant longtemps déniée, voire interdite aux femmes, mais désormais revendiquée, assumée et défendue au début du Moyen Age en France. Dans les études littéraires de langue française et anglo-saxonnes, qu’il s’agisse du Moyen Age ou de l’époque moderne et, indifféremment, de la plus grande diversité des genres – Roman, Théâtre, Nouvelle, Poésie, Essai, etc. –, la littérature et la critique féministes travaillent à une mise en valeur de l’écriture des femmes en ce XXe siècle ; des noms comme Stéphanie Janin[317], Janet Todd, Gertrud Kolmar, Florence Boissenin, Leah Price, Thérèse Moreau, George Eliot sont à retenir, pour leur investissement dans la lutte en faveur de la reconnaissance de l’écriture féminine d’expression féministe, dès l’entame du XXe siècle, alors qu’entrent dans leur phase active, les premiers mouvements de revendication féministe et de lutte en vue de l’affirmation de l’existence sociale et du droit de la femme[318]. Catherine Kelly conçoit que le discours critique de la modernité s’est construit sur une norme masculine, cosmopolite et par trop prétentieuse qui, pourtant, se déclarait universelle ; cette situation inviterait à une remise en question de la théorie littéraire et susciterait une problématique essentielle : le discours et l’esthétique littéraire ont-ils un sexe ? Comment expliquer l’absence des femmes écrivaines dans le panorama littéraire et du « canon » des grands auteurs classiques ? La littérature française a-t-elle quand bien même fini par donner à la littérature générale, des figures féminines illustres au triple titre du statut d’auteures, de personnages et d’héroïnes ? Pourquoi observe-t-on, notamment à partir du XIIIe siècle, l’émergence d’une littérature qui revendique le droit de la femme à une reconnaissance sociale, littéraire et politique, attitude autrement féministe ?
Le jugement esthétique et littéraire, apparemment neutre – ou plutôt faussement naïf –, s’est fondé, au fil de l’histoire de l’humanité, sur un point de vue exclusivement androcentrique implicite et sur un rapport de pouvoir entre les sexes normalisés. T. Moreau illustre les différentes stratégies adoptées déjà depuis le Moyen Age par l’écrivaine française d’origine italienne Christine de Pisan pour se frayer un chemin et se réserver une place et, non des moindres, dans l’histoire et la culture littéraires masculines de son époque : transsexualisme, travestissement, écriture d’une femme qui sait opérer la distinction entre sexe et genre. Il y aurait, selon L. Price, une difficulté à dépasser le système des rapports sociaux de sexe inhérents à l’organisation des genres littéraires[319]. Au regard de ce postulat, toute réflexion se fait avant tout interrogation problématique : le féminisme et la littérature sont-ils compatibles ? Si oui, le discours féminin – ou en d’autres termes, l’écriture – peut-il être au centre, c’est-à-dire neutre et sauf de toute tendance apologétique féministe ?
S. de Beauvoir, au début des années 1950[320], Ann Oakley, Gayle Rubin et Erving Goffman[321]aux Etats-Unis, dès 1970, toutes théoriciennes du « gender » ou genre – masculinité et féminité –, ont conçu l’idée que ledit genre, au-delà d’apparaître comme un attribut naturel, serait « un rôle imposé, une performance qui, avec le temps, se fige et se confond avec le réel »8. « En effet, tout texte – qu’il soit d’un homme ou d’une femme – relaie un ou des discours sur le genre et dissémine les valeurs qui lui sont liées »9. Depuis le Moyen Age et davantage aujourd’hui, de plus en plus de textes littéraires sont lus, appréciés ou évalués par les critiques à travers de telles préoccupations idéologiques. Dans une perspective sémiotique, toute approche du texte qui privilégie l’incidence du genre sur la signification est nécessaire, voire inévitable. L’existence d’une pensée féministe est désormais incontestable, qui investit la fiction et détourne le sens, soit en vue d’abaisser son image quand il s’agit de résiduels misogynes, soit, pour les écrivaines, dans l’optique de rétablir la vérité sur une supériorité masculine supposée contre-productive et l’affirmation des valeurs féminines. Au Moyen Age, l’influence politique, sociale et littéraire de l’écrivaine Christine de Pisan est certaine sur la détermination des mutations de la pensée ; c’est donc, à notre sens, un cas qui mérite d’être examiné. A partir de l’exemple de cette écrivaine, notre projet, à travers la présente étude, est de montrer qu’il existe un discours féministe fondé non pas sur l’auto-justification de la femme ni le dénigrement de la masculinité, mais sur une réhabilitation de la femme – par une appropriation historique du « je », marque de l’autorité narrative, de l’émancipation, voire de la libération – et des valeurs féminines considérées comme des modèles.
I – D’UNE RHETORIQUE FÉMINISTE
La représentation de la femme dans la littérature française est fondée sur la volonté de distinguer le masculin du féminin. Idéologiquement, cette
1999 et de Interaction Ritual : Essays on Face-to-Face Behavior, New York, Pantheon Books, 1982.
8 BOICLAIR, I. & LORI, S.-M., « Féminin / Masculin. Jeux et transformations », in Voix et images, Montréal, UQAM, 2007, p. 10. 9 Idem., p. 10.
perspective d’écriture consciente ou non implique la (re)définition de l’image de la femme, des valeurs qui la caractérisent et des rapports de celle-ci avec les hommes, notamment les écrivains considérés comme ayant progressivement été, au fil du temps, à l’origine d’une déconstruction de l’image idéalisée de la femme. L’opposition sexuée des personnages emprunte à une culture du genre qui distingue le masculin du féminin. Pour I. Boisclair et L. Saint-Martin,
« longtemps, les rapports entre hommes et femmes, entre féminin et masculin, ont été pensés suivant un modèle d’inspiration aristotélicienne qui repose sur une vision binaire et hiérarchisée : le masculin est lié à des valeurs positives – esprit, raison, création – et le féminin au pôle négatif opposé – corps, folie, procréation. Ce modèle a servi à justifier un ordre social inégal et a été légitimé par des méta-récits qui évacuaient ou rabaissaient le féminin. En réaction, une certaine pensée féministe a développé un modèle fondé sur la revalorisation du féminin : le but étant d’atteindre un certain équilibre entre les deux termes, la remise en cause du rapport binaire dans sa dimension systémique n’était pas
envisagée. »[322]
Dans les textes littéraires français, la différence entre masculin et féminin se nourrit d’a priori, du fait de la hiérarchisation des genres et de la dépréciation de la femme. S. Prokhoris s’interroge sur la pertinence et la validité actuelles de la notion de différence[323]– Indéfinir – qui ne résiste cependant pas à l’épreuve de l’analyse qui fait du masculin et du féminin, des valeurs aléatoires. Quels sont les enjeux d’une apologétique féministe dans les textes littéraires français ? N’aspire-t-elle pas, par le biais du texte, à pulvériser les stéréotypes du masculin qui foisonnent sciemment dans le texte ? L’adoption de l’idée d’une rhétorique féministe n’est pas un abus ni une transgression. Pour les écrivaines françaises, il s’agit d’investir dans le texte, les ressorts littéraires – dont le registre de l’ironie, pour relativiser la prééminence de l’homme –, qui portent un discours dont le souci est de convaincre le destinataire de la légitimité de délaisser le ménage au bénéfice de la plume. La féminité redevient une valeur en soi, dans un univers axiologique pourtant déjà constitué et à elle résolument défavorable. La littérature féministe refuse que la femme admette et se reconnaisse à travers le statut « arbitraire » d’actrice sociale passive ; elle bat en brèche l’illusoire étiquette culturelle et littéraire de l’être incapable pour aspirer aux mêmes hauteurs littéraires que les hommes.
Il apparaît qu’il n’y a pas une, mais des rhétoriques féministes : celle de la contestation du discours bien-pensant et misogyne médiéval, de l’ironie caustique classique, du rationalisme des Lumières et du sentimentalisme bourgeois romantique auquel succède la rhétorique de la construction d’un monde imaginaire au féminin qu’incarnent les écrivaines du XXe siècle. A. de Noailles, Collette, S. de Beauvoir, S. Weil, M. Duras et M. Yourcenar. Dans les textes de ces écrivaines et philosophes françaises du premier vingtième siècle, l’écriture n’est pas que sursaturée de marques du féminin, d’un refus de l’autodénigrement ni d’une propension suspecte – parce que subjective – à l’autojustification. Elle emprunte à tous les registres de l’expression littéraire parmi lesquels, l’ironie, l’humour caustique, la parodie, etc.
La représentation littéraire de la féminité au Moyen Age, période de l’enfance d’une littérature féministe qu’il nous a paru intéressant d’examiner, à travers l’exemple de l’écrivaine Christine de Pisan, est le moyen de montrer un modèle et une expression singulière de l’imaginaire au féminin. Première critique féministe, Christine de Pisan s’attaque aux stéréotypes sexistes de l’infériorisation de la femme et des personnages féminins dans les textes littéraires français de son époque.
II – UNE HISTORIOGRAPHIE LITTÉRAIRE DE LA FÉMINITÉ AU MOYEN AGE
Le Moyen Age se reconnaît, entre autres approches, à la caractéristique d’être une sorte de période transitoire entre l’Age Ancien[324]et le Modernisme, dont l’une des manifestations se traduit par l’avènement de la société et de la culture humanistes de la Renaissance que l’histoire littéraire française situe au XVIe siècle. Au cours de cette période culturelle, la littérature s’affirme par la force d’une langue de plus en plus certaine de ses qualités expressives[325], mais également par le fait des idées nouvelles qui la structurent. D’abord essentiellement marquée par le sentiment collectif d’exaltation des hauts faits ou des prouesses guerrières de la chevalerie et des croisés, la littérature se fait ensuite plus individuelle, personnelle, voire intimiste, surtout lorsqu’enfin, elle s’organise pour constituer un chant et une apologie des valeurs courtoises d’une France désireuse de se soustraire à l’influence certes lointaine, mais significative de la culture latine.
A l’instar des récits épiques et poétiques que sont les Chansons de geste et, après une longue période consacrée à une thématique guerrière, la littérature s’adoucit par le moyen de la Poésie que Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps et les autres premiers animateurs du genre rendent accessible au cœur et à l’appréciation d’un public encore attaché aux grands élans épiques. En cela, Rustebuef[326]fait figure de précurseur à travers la poésie qui développe les trouvailles verbales, les effets de rimes et les jeux phonétiques. Ces innovations, fondées sur une technique de plus en plus élaborée et unanimement approuvée, sont la marque d’un art poétique, d’un langage et d’un souffle expressifs, art qui emprunte son inspiration intégrale à divers thèmes, dont celui du « genre » ou de la féminité.
Qui, mieux que les figures féminines de cette poésie médiévale, travaillent de la manière la plus exquise à la célébration de la femme dans la société et dans la littérature ? L’historiographie littéraire du féminisme au Moyen Age relève la part qu’a prise Marie de France[327]dans cette quête d’identité. Mais c’est surtout à Christine de Pisan[328]et à sa nombreuse production que l’histoire littéraire et la critique accordent le plus illustre crédit en la matière, écrivaine et poétesse émérite qui affirme de la manière la plus véhémente et la plus réussie – fécondité et merveille de sa poésie –, le cri de la féminité en cette période du Bas Moyen Age[329].
Si la littérature médiévale n’est pas exclusivement dédiée au machisme, au masculin, aux hommes, elle n’est pas non plus le lieu d’un discours apologétique qui fait de la femme, un sujet exalté. Si tout ce qui s’attache à l’homme – et aux valeurs qui le caractérisent – n’y est pas célébré de manière évidente, en revanche, la femme n’y est pas non plus entretenue par un regard constructif ; en témoigne l’image déconstructive qu’en donne le Roman de la Rose (1275-80) de Jean de Meung que Christine combattra ardemment[330]. La condamnation de cet écrit, parce qu’il « défendait l’assouvissement du désir sans pudeur », promotion explicite ou déguisée de mœurs amoureuses libertines avant l’heure, en tout cas débridées et pernicieuses à l’évidence, est le signe d’un malaise et d’un refus de la femme d’accepter que l’on la dénigre et l’abaisse.
Le machisme médiéval[331]se traduit par les comportements sociaux des hommes en général et ceux de quelques écrivains, en particulier, conscients de cela ou non, qui méprisent la femme par toutes les formes d’allusions vicieuses, jusqu’aux plus abjectes.
Cette déviation du machisme révolte ou, à tout le moins, interpelle Christine de Pisan, dont l’essentiel du combat consiste en la lutte contre une telle perception – angle de défense de la femme –, mais surtout, d’un éloge de la femme et de la féminité. Ses moyens sont un engagement résolu dans une activité, à savoir l’écriture littéraire et, dans un genre, en l’occurrence la Poésie, où les maîtres, essentiellement des hommes, sont déjà bien connus en France et en Europe, adulés et respectés pour la qualité de leur inspiration poétique et de leur envergure. Christine de Pisan n’hésite pourtant pas à apporter une inspiration nouvelle, mise en relief par une œuvre immense, des textes[332]forts sur le thème du féminisme, un discours clair sur le désir de la poétesse de « libérer » la condition féminine du pouvoir et de la domination des hommes, pour que plus jamais « femme du royaume de France [ne] ploure[333][z]… ».
Dans un espace public médiéval réservé, voire entièrement dédié aux hommes et encore codifié, est-il possible – et de quelle manière ? – d’affirmer sa féminité et de contribuer à asseoir ses valeurs, aussi longtemps qu’y travailla Christine de Pisan, une carrière durant ? Quel est l’état du féminisme au Moyen Age ? Comment apparaît l’engagement féministe de Christine de Pisan dans sa poésie à son époque ? Comment une poésie féministe émerge-t-elle et parvient à imposer son discours parmi les thèmes en vogue ? Ce sont là, quelques préoccupations auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses, car il nous semble que des raisons objectives fondent l’empire[334]de la condition féminine de la poésie de Christine de Pisan devant les mœurs machistes dont la littérature en général se fait l’écho.
Au Moyen Age, la production littéraire française reste en partie assujettie à l’influence de l’héritage du monde antique et des foyers européens de culture classique dont l’Italie est l’exemple type. Sur le sol de l’ancienne Gaule, la tradition littéraire, d’expression latine, à travers les points essentiels de ses sources, élabore des thèmes que s’approprient les chroniqueurs médiévaux et les poètes courtois. Dans toute la France et, en passant par l’abbatiale de Cluny, une société et une littérature nouvelles se développent, donnant naissance à des formes[335]elles-mêmes nouvelles. Quel que soit le territoire où elle emprunte ou étend son influence, la littérature bourgeoise, dont la Poésie est l’une des expressions les plus caractéristiques, apparaît essentiellement lyrique[336].
Les Chansons de geste, en tant qu’elles évoquent les exploits des chevaliers ou des guerriers – comme dans La Chanson de Roland (fin XIe s.) – ou restituent des histoires relatives à la brutalité des mœurs féodales – l’exemple de la Geste des Lorrains –, se font l’écho d’une société dont les caractères que sont la ruse, la vaillance, la bravoure ou l’honneur contribuent à asseoir l’idée d’une littérature sinon machiste, du moins misogyne. En réaction à une telle perspective d’écriture, le roman aborde la question de la femme. Lorsque les aventures – généralement extraordinaires – d’un chevalier l’engagent à tout souffrir pour plaire à sa dame, c’est un honneur qui est fait à la femme par cette reconnaissance sociale et littéraire implicite.
À cette époque, la présence en littérature d’une femme – Marie de France – n’est pas aussi significative et productive que les femmes en général étaient en droit de l’espérer dans une société en mutation. Les poèmes d’amour qu’elle compose ne s’attachent pas particulièrement à la valorisation de la femme. Mais cette poétesse a le mérite d’ouvrir la voie à une florissante Poésie lyrique provençale, d’inspiration courtoise, d’une variété de ton et véhiculée par l’art oratoire des trouvères et, dont le thème essentiel est entièrement attaché à la célébration de la femme et de l’amour[337]. Avec Béroul – dans Tristan et Iseut (XIIe s.) –, la passion fatale n’a rien de valorisant pour la femme. Les « Tensons » – dialogues d’amour – pratiqués par une majorité de Troubadours – parmi les centaines d’oralistes que compte la France et dont Guillaume IX d’Aquitaine, Jaufré Rudel et Bernard de Ventadour sont trois des illustres figures – et le lyrisme du Nord ne se ressentent pas de manière expressive du thème de la femme ; ils se contentent de l’évoquer en l’inscrivant dans la relation amoureuse avec son amant.
Le premier maître du vers, figure la plus représentative de la Poésie française du grand XIIIe siècle, le Champenois Rustbuef, s’attache à la description de la souffrance qui lui impose une existence difficile et ne s’engage que fortuitement dans une critique de la femme. Dans un contexte où la bourgeoisie est en pleine expansion et la royauté inspirée par la volonté de renforcer son autorité – et par ce biais, de réduire à l’observation d’une discipline et d’un pouvoir qu’il édicte et soumet aux féodaux et aux ecclésiastiques –, la littérature se réduit en général à des thèmes autres que celui de la femme : ébauche d’un sentiment national et patriotique, obsession de tous par l’idée d’une mort qui n’épargne personne, ni grands ni petits.
Après Rustebuef, Guillaume de Machaut (v. 1300 – v. 1337) s’impose par la qualité d’un souffle poétique qui engendre des chefs-d’œuvre – l’exemple de Le Dit du Verger et de Le jugement du Roi de Navarre, etc. – qui restent cependant « muets » sur le thème de la femme. Avec Jean
Froissart (1337-1414), la littérature est essentiellement chroniques et faits d’histoire. Mais son successeur, Eustache Deschamps (1346-1406), s’intéresse à la femme ; son recueil Miroir du mariage y fait allusion, mais à travers une inspiration résolument anti-féministe. Il ne peut en être autrement, puisque sa poésie est un vaste tableau réaliste de la société de son temps, le XIVe siècle. Ses chagrins d’amour ne relèvent-ils pas d’un échec amoureux dont il impute la responsabilité à ses ex-amantes ?
C’est un tel contexte de Littérature et de Poésie dans lesquelles sont absentes des références joyeuses à la femme et significatives – sur le plan du nombre – qui préexiste à l’avènement de Christine de Pisan (13631431). Cette époque Pré-christinienne – avant 1363 – semble encore sujette à l’influence de l’Antiquité et du machisme qui dominent dans les mœurs. Les Fabliaux apparaissent comme une satire et organisent leur propos autour de la raillerie, sans pitié, mais sans méchanceté. Comme les bourgeois, les femmes y sont l’objet de critique, notamment dans leurs travers et leurs vices. Sur ce ton, la poésie apparaît avant Christine de Pisan comme allégorique et morale. Puis, Christine de Pisan vint et se fit connaître dans cet art.
III – ENGAGEMENT LITTÉRAIRE ET VOCATION FÉMINISTE DE LA POÉSIE CHRISTINIENNE
Jusqu’à l’avènement de Christine de Pisan, la littérature – et la Poésie en particulier – est sujette à la critique : extrême faiblesse littéraire des textes, maladresses de l’exécution, pauvreté de la versification, monotonie des sujets, etc. Fondés peu ou prou, ces reproches sont en réalité l’indice d’une mutation du goût qui se produit, en réaction à une lyrique qui ne se nourrit ni ne se renouvelle au contact d’influences extérieures à la France. Or, tout de suite après l’engagement littéraire et la production de ses premiers textes, Christine de Pisan est adoptée par un public qui apprécie chez elle le mélange judicieux de références fait d’emprunts à son prédécesseur[338]qu’elle admire, à l’Italie dont elle est originaire[339]et au folklore du duché de Bourgogne dont les compositeurs mettent en musique certaines de ses ballades[340].
C’est donc à la fois un espace et un contexte social et littéraire favorables qui accueillent l’entrée en Poésie de Christine de Pisan. A la Cour et jusqu’en province, ses admirateurs sont nombreux et lui apportent le soutien nécessaire à la construction de sa notoriété. Complaintes, Ballades, Rondeaux ou ouvrages de morale, son œuvre est méritoire sur le plan littéraire. Sa pensée est marquée par trois influences : la culture chrétienne dont son siècle se ressent à travers un contexte de foi ardente et de spiritualité repris par une littérature hagiographique tardive29, ses malheurs[341]et l’insuffisance d’une promotion sociale et littéraire de la condition féminine. C’est à cette dernière question que s’attache sa volonté de s’affirmer dans la société et particulièrement en Poésie, un genre alors en quête de nouveaux maîtres.
Dans un espace public réservé aux hommes par les hommes, la vocation de Christine de Pisan est d’imposer une esthétique, une rhétorique féminine et une idéologie féministe. L’idéal d’un monde fictif, mais également réel meilleur lui paraît ne devoir prendre forme qu’avec la défense de la « féminie31 », liant toutes les classes sociales et intégrant jusqu’aux prostituées. Pour couronner le tout, elle dédie sa vie entière à l’écriture et s’invite chez les grands seigneurs par les dons qu’elle leur fait de ses poèmes engagés. Sa poésie est et sera considérée par les critiques comme une œuvre d’utilité publique et universelle dédiée aux femmes en priorité :
« Et ainsi moi, Christine, un peu fatiguée par une longue écriture, mais me félicitant de la digne beauté de cette œuvre […] je me résolus d’en multiplier les copies de par le monde, quel qu’en fût le coût, afin qu’elle soit connue en différents endroits par les reines, les princesses et hautes dames, pour qu’elle reçoive les honneurs et louanges qu’elle mérite, et qu’elles la fassent connaître à d’autres femmes »[342].
Après les pertes affectives considérables qu’elle enregistre – le Roi Charles V, son père et son époux –, Christine s’engage en Poésie par le moyen d’une écriture qui appelle la reine Isabelle de Bavière (1371-1435) à plus de tenue politique et sociale, davantage parce qu’elle est une femme que pour une autre raison, afin que la reine ne commît guère de fautes qui la feraient comparer aux hommes.
Lui est-il à la fois possible et aisé d’affirmer sa féminité dans un espace public acquis et dominé par les mœurs machistes ? Parvient-elle à communiquer ses valeurs et, de quelle manière ? Avant toute action, Christine de Pisan prend conscience de sa condition de femme dans un espace qui ne lui est pas forcément favorable. Il lui paraît de réelle importance de s’assumer, donc d’accepter de rester femme – avait-elle réellement la possibilité de s’y soustraire ? – dans un contexte entièrement conservé dans le règne des Anciens, maîtres antiques et acteurs intemporels de la vie littéraire dont l’image est associée à l’homme et à l’éloge de son pouvoir social, politique, intellectuel et littéraire. La conscience de sa condition féminine lui donne également de s’engager et de s’affirmer en exprimant la volonté, immédiatement traduite en actes, de se faire une place privilégiée dans un univers où, sans être exclue, la femme – et tout ce qui se rattache à sa condition – est considérée comme accessoire.
Par le moyen de sa poésie marquée par une écriture d’un style alerte, Christine de Pisan parvient aisément à communiquer ses valeurs féministes, mais également la somme éprouvée de ses savoirs et son sentiment sur le monde auquel elle appartient et dans lequel elle s’engage intégralement. C’est en somme le sentiment de la société de son époque qu’elle tient pour son premier interlocuteur. Elle accepte les codes de versification de l’époque, qu’elle exploite judicieusement et s’érige en défenseur de l’honneur perdu des femmes, en sa qualité de femme exaltée, notamment dans la querelle[343]du Roman de la Rose (1401-1402). Sans aucune précaution oratoire, elle stigmatise l’amour courtois qui jamais ne lui apparut autrement que comme la manifestation d’une grande hypocrisie. Les hommes, écrit-elle, « aiment à séduire, puis à se vanter entre eux de leurs conquêtes et prouesses sexuelles »[344].
Ainsi Christine de Pisan développe-t-elle des idées nouvelles et est lue par l’élite lettrée de la Cour. Il lui est reconnu de contribuer à la sensibilisation sociale sur la valeur de la femme et à une éducation qui restaure dans l’esprit de la femme, l’amour de sa personne, l’honneur et la dignité dont on lui a fait croire que jamais femme n’en posséda. L’apologie de Jeanne d’Arc[345]nous paraît en être une évidente et brillante illustration. En effet, Jeanne d’Arc est en cette période médiévale tardive, un symbole fort du courage et de la bravoure de la femme, qui, la première fois, occupe, du reste avec succès, une fonction habituellement dévolue aux hommes, aux chevaliers. L’apologie de l’héroïsme de cette guerrière est dans la poésie de Christine de Pisan, une affirmation de l’idée du début de l’égalité des sexes. En outre, Christine affronte le machisme sur quelquesuns de ses terrains de prédilection : la société et la littérature. Comme les hommes, elle donne à voir dans sa poésie, les signes manifestes de ce qu’elle est une femme de lettres encline à l’apprentissage d’un savoir encyclopédique. Mais comme l’indique Le Livre du Chemin de Long Estude (1402-1403), ce savoir est naturellement d’une coloration féminine et féministe. Son œuvre est traversée par des références explicites à l’histoire, à la politique et à la société. En somme, tout chez elle concourt à allier savoir et féminité pour une image plus valorisée de la femme au Moyen Age.
Mais comment est perçu l’engagement féministe de Christine de Pisan dans la Poésie de son époque ? Il nous semble également intéressant d’examiner la manière dont pareille poésie féministe émerge et parvient à imposer son discours ?[346]
IV / – LYRISME ET DIDACTISME DE LA POÉSIE
CHRISTINIENNE
Au Moyen Age, deux influences assez significatives caractérisent la Poésie de la génération de Guillaume de Machaut à laquelle appartient Christine de Pisan : le rayonnement de la rhétorique, autrement « bel art du langage expressif » et le lyrisme qu’elle induit.
Après Machaut, Eustache Deschamps illustre et exploite, avant de les transmettre à Christine de Pisan, les ressources d’une esthétique nouvelle et celles d’une rhétorique qui se refuse de plus en plus à une impersonnalité excessive. Aussi, en revient-on à un lyrisme qualifié de plus intimiste par la critique, plus personnel parce qu’exprimant de manière prosaïque les élans de l’esprit et du cœur. Egalement commune aux animateurs de la Poésie de cette génération, l’expression des sentiments, émotions et états d’âme qui épousent de grandes causes comme celle de la place honorable qui doit être celle de la femme dans la société. A ce lyrisme spécifiquement christinien, est associé un didactisme qui prend explicitement le contre-pied d’une déconsidération culturelle de la femme[347], car il s’agit en réalité d’une attitude collective du moment.
L’engagement féministe de Christine de Pisan dans la Poésie de son époque est perçu de manière favorable. En témoigne la réception réservée par le lectorat qu’elle réunit progressivement au fil de sa poésie et par la postérité – les Grands Rhétoriqueurs[348]– qu’elle contribue à mettre en place. Il nous en est donné témoignage par les critiques et, d’autre part, de voir à travers l’Epître à la Reine Isabeau (1405) et La Lamentation sur les maux de la France (1401), que Christine de Pisan est engagée politiquement, par la dénonciation d’un monde et d’une société en échec, parce que fondés sur le pouvoir masculin. En présentant des exemples de femmes vaillantes et honorables par leurs actions et ce qu’elles sont[349], Christine de Pisan refuse que l’on dégrade l’image de la femme en la réduisant à des exemples isolés qui, à son sens, restent infondés. L’engagement à défendre les valeurs féministes et la contestation sont un trait évident de la Poésie de Pisan pour qui l’éducation des filles doit être orientée de manière à les préparer plus au rôle d’actrices sociales, politiques, intellectuelles et littéraires qu’à celui de futures épouses et de mères. Une telle position féministe est, en soi, dans le contexte machiste de l’époque, un acte d’affirmation de la femme, une révolution idéologique et une prétention osée.
Comment une telle poésie féministe et ouvertement engagée dans la critique émerge-t-elle et parvient à imposer son discours parmi les textes et les thèmes en vogue dont celui de l’héroïsme guerrier des Croisés ? La Poésie épique et sa plus célèbre expression que représente la Chanson de geste avait fixé l’auditoire et le lectorat du Moyen Age sur le goût pour un héroïsme guerrier défavorable à l’image des Mahométans. Cette survalorisation de l’homme, élevé à la dignité d’honorable chevalier pour son amour de la patrie et ses prouesses guerrières a, entre autres, pour conséquence, de réduire la femme à une inexistence individuelle et sociale manifeste. La forte personnalité de Christine de Pisan favorise le triomphe de l’écrivaine sur Rutebeuf dans le débat relatif au Roman de la rose, texte qui a fortement contribué à la déconstruction de l’image de la femme au Moyen Age. Pour accompagner cette apologie du féminisme qui gagne la littérature et la poésie en particulier, Christine de Pisan se présente comme un exemple dans ses textes à travers des passages autobiographiques éloquents et révélateurs. Par sa double foi en la littérature comme moyen de sensibilisation et d’éveil des consciences et la dévotion qui donna d’elle l’image d’une croyante sans histoire avec l’Eglise que jamais elle ne déçut, Christine de Pisan aime les exemples, comme celui de Jeanne d’Arc.
Le didactisme de la poésie de Christine de Pisan est évident et efficace. Il ne peut lui être refusé d’avoir marqué son époque ; des siècles durant, l’histoire littéraire a occulté cette écrivaine, mais jamais elle n’en a ignoré la personnalité ni l’œuvre littéraire. Son combat, soutenu par une imposante bibliographie et par une érudition remarquable pour une femme de son époque, en fait une conscience alerte qui stimule son époque et lui inspire d’accepter de s’ouvrir aux appels du progrès. Cette nouvelle culture est en soi un enseignement en prise directe avec une réalité contemporaine de l’auteur, puisqu’elle n’hésite pas à se représenter dans ses textes qui empruntent du reste à de nombreux faits de sa vie.
CONCLUSION
Le lyrisme de la poésie de Christine de Pisan est l’expression d’un renouvellement esthétique qui se nourrit essentiellement de thèmes héroïques. Au Moyen Age, l’héroïsme est, à travers la plume d’une écrivaine de la valeur de Pisan, l’exaltation publique d’une féminité, dans un contexte gagné à des courants favorables au pouvoir masculin. Pour le triomphe que les études actuelles lui reconnaissent dans les débats et sur l’opinion de son époque, il lui fallut, à la jeune poétesse, épouser l’esprit d’une époque propice aux engagements les plus véhéments, mais surtout, de voir en la poésie, un art utile en tant qu’il permet de communiquer ses plus intimes convictions.
Pour offrir à ses textes les meilleures chances de trouver auprès de son public l’écho et le destin qu’elle leur avait apprêtés, Christine de Pisan s’inscrit dans une étroite unité thématique qui se résume à une dénonciation de toute entreprise de nature à discréditer la femme et à en abaisser l’image à travers une littérature marquée par une inspiration machiste. A l’inverse, la poétesse cultive l’idée de femmes triomphantes, éduquées autrement que comme des ménagères et des mères, toutes modernes selon la nouvelle vision de la femme.
La valorisation de la femme que cultive Christine de Pisan est annonciatrice d’un humanisme nouveau qui reste toutefois profane, car cette idéalisation implicite n’a rien de comparable avec l’apologie christique qui prospère de plus en plus dans l’art et la mystique religieuse chrétienne de cette époque. Christine de Pisan reste une écrivaine du Moyen Age, mais indique le chemin d’une révolution des mœurs en faveur des femmes. La poésie post-christinienne[350]– après 1431 – est éloquente du point de vue du discours et des références qu’elle emprunte à la poétesse dont l’on se prévaut ouvertement de l’influence. Mais déjà, cette
Poésie évacue le féminisme cher au cœur de Pisan, en conservant cependant ses transports exaltés. Chez Alain Chartier (v. 1385-v.1435)[351], il n’est plus question que de pièces de vers allégoriques et galantes quand Charles d’Orléans (1391-1465)[352]évoque les peines de l’amour et que François Villon (1431-1463) écrit des Ballades qui mettent en scène des dames. Avec la Ballade des femmes de Paris[353]par exemple, il évoque les femmes de la capitale sur un ton satirique et ironique qui laisse voir que le combat de Christine de Pisan tendant à affirmer et à ancrer le rôle de la femme dans la vie sociale, politique, intellectuelle et littéraire est … à recommencer.
BIBLIOGRAPHIE
- AVALLE, D’Arco Silvio, « Musique et poésie au Moyen Age », inTravaux de Linguistique et de Littérature, T. 21 (2), Strassbourg, CPLRUS, 1983, pp. 7-19.
- BEC, Pierre, Lyrique française au Moyen Age, XIIe-XIIIe siècles. Contribution à une typologie des genres poétiques médiévaux, Paris, Picard, 1977.
- BEDIER, Joseph, Les légendes épiques, Paris, Champion, 19261929 (3e éd.), 4 vol.
- BOICLAIR, Isabelle et LORI, Saint-Martin, « Féminin / Masculin. Jeux et transformations », in Voix et images, Montréal, UQAM, 2007.
- CHATELAIN, Henri Louis, Recherches sur le vers français au XVe siècle. Rimes, mètres et strophes, Paris, Champion, 1908
(Bibliothèque du XVe siècle, T. IV).
- DE PISAN, Christine, Epistre au Dieu d’amours, 1399.
- DE PISAN, Christine, Le Dit de la rose, 1402.
- DE PISAN, Christine, Le Chemin de longue estude, 1403.
- DE PISAN, Christine, Le Dit de la pastoure, 1403.
10.DE PISAN, Christine, La Cité des dames, 1404-1405,
11.-DE PISAN, Christine, Le Livre des trois vertus à l’enseignement des dames, 1405.
12.DE PISAN, Christine, Epistre à Isabelle de Bavière, 1405.
13.DE PISAN, Christine, Les Lamentations sur les maux de la France, 1410.
14.-DE PISAN, Christine, Les Heures de la contemplation de la Passion, 1420.
15.DE PISAN, Christine, Le Ditié de Jehanne d’Arc, 1429.
16.DULAC, Liliane et RIBEMONT, Bernard (éd.), Une Femme de lettres au Moyen Age, Orléans, Paradigme, 1995.
17.ELWERT, Theodor, Traité de versification française des origines à nos jours, Paris, Klincksieck, 1965 (BFR, A8).
18.HICKS, Eric, et MOREAU, Thérèse (Prés. et Trad.), Christine de Pisan, La Cité des Dames, Paris, Stock/Moyen Age, 1985.
19.HICKS, Eric, (éd.), Le Débat sur le Roman de la Rose, Paris, Champion, 1996.
20.HICKS, Eric et MOREAU, Thérèse (Prés. et Trad.), Christine de Pisan, Le Livre des Faits et Bonnes Mœurs du roi Charles V le Sage, Paris, Stock/Moyen Age, 1997.
21.ISTEVAN, Frank, Répertoire métrique de la poésie des Troubadours, Paris, Champion, 1957.
22.LANSON, Gustave, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 1952.
23.LOTE, Georges, Histoire du vers français. Première partie : le Moyen Age, Paris, Boivin, 1949 (t. 1) et (t. 2), Paris, Hatier, 1955 (t. 3).
24.MARTINON, Philippe, Les strophes. Etude historique et critique sur les formes de la Poésie lyrique en France depuis la Renaissance, Paris, Champion, 1912.
25.MOREAU, Thérèse, « Christine de Pisan, prestigieuse écrivaine du Moyen Age », article électronique – http://sisyphe.org – juillet 2005.
26.POIRION, Daniel, « Christine de Pisan », Littérature française : le Moyen Age, II, Paris, Artaud, 1977.
27.TOGEBY, Knud, « Histoire de l’alexandrin français », Etudes romanes dédiées à A. Blinkenberg, Copenhague, Munsksgaard, 1963, p. 240-266.
28.ZUMTHOR, Paul, « Un problème d’esthétique médiévale : l’utilisation poétique du bilinguisme »,in Le Moyen Age, no 66, 1960, pp. 301336 et pp. 561-594.
29.ZUMTHOR, Paul, Essai de poétique médiévale, Paris, Editions du Seuil, coll. « Poétique », 1972.
Stratégies résidentielles d’une catégorie de citadins du bas de l’échelle de qualification : les personnels domestiques féminins de la ville d’Abidjan
Anne Marilyse KOUADIO
Assistant
Ecole Normale Supérieure d’Abidjan-Côte d’Ivoire
RESUME
Cette étude consacrée au personnel domestique féminin (PDF) de la métropole abidjanaise, s’intéresse aux conditions de logement de ces travailleuses : types de logement, localisation des domiciles, statuts d’occupation des logements. Il s’agit de relever et d’analyser les raisons de ces conditions. Enfin, en quoi ces conditions relèvent-elles de stratégies particulières à ce groupe de travailleuses ? Cette perspective suggère, sur le plan méthodologique, le recours à l’importante littérature consacrée à la question du logement et à la situation des travailleurs et de les confronter à nos enquêtes récentes sur les PDF.
Mots-clés : Insertion – Métropole d’Abidjan – Mobilité – Stratégies résidentielles – Travail domestique.
ABSTRACT
Our study, devoted to the female domestic personnel (FDP) of the metropolis of Abidjan, will be interested in housing conditions of these workers: types of housing, localization of the residences, statutes of occupation of the residences. It will be a question of raising and of analyzing the reasons of these conditions. Lastly, in what these conditions do they concern strategies particular to this group of workers? This prospect suggests, on the methodological level the recourse to the important literature devoted to the question of housing and the situation of the workers and to confront them with our recent investigations into the female domestic personnel (FDP).
Keys-words: Insertion – Metropolis of Abidjan – Mobility – Residential strategies – Domestic work.
INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire est en proie à une forte croissance urbaine nourrit par la crise économique persistante. Celle-ci induit des flux migratoires importants venant de la campagne ivoirienne et des pays limitrophes. A l’instar des pays africains, l’insertion des migrants reste un défi[354]. Des analyses effectuées dans différentes villes africaines révèlent des inégalités de chances d’insertion dans le marché du travail urbain entre les migrants et les natifs de la ville mieux, entre les migrants et les migrantes[355]. La question du logement, analyseur de l’insertion urbaine tient une place non négligeable dans l’insertion sociale des migrants. Dans ce domaine, l’abondante littérature consacrée aux villes africaines révèle une crise chronique, conséquence d’une offre insuffisante et d’un marché immobilier économiquement et socialement discriminant. Les travailleurs des sphères informelles de l’économie urbaine et les salariés modestes sont reclus dans des formes d’habitat non planifié et sous équipés, tandis que les fonctionnaires et salariés moyens du secteur privés constituent souvent la clientèle des programmes de logements sociaux subventionnés. Les logiques d’aménagements dissocient géographiquement les fonctions de la ville. En cela, elles poussent à la concentration des activités économiques et des équipements hors des quartiers habités et exposent inéluctablement les citadins à des mobilités quotidiennes, entre zones de résidence et lieux de travail. Ces déplacements domicile-travail appelés mobilités, appréhendés à une échelle locale et une temporalité quotidienne[356], rendent compte dans une certaine mesure des conditions de vie des travailleurs.
Dans la réflexion sur l’insertion des travailleurs en ville, nous nous intéressons à la situation d’une catégorie de femmes, les personnels domestiques féminins (PDF) souvent oubliés. L’expression de personnels domestiques désigne la main-d’œuvre salariée travaillant au service des familles ou des ménages[357]. Ces travailleuses exercent diverses taches : entretien et maintien du ménage (blanchisserie, nettoyage, cuisine, etc.), garde et éducation des enfants ou encore vente d’objets divers (denrées alimentaires, voire de plats cuisinés, etc.). La hausse de l’activité salariée des femmes a eu pour principale conséquence l’augmentation de la demande de travail domestique salariée[358]. Au regard de l’évolution de cet emploi et de ses contraintes spécifiques, nous nous proposons d’analyser les conditions résidentielles des travailleuses domestiques et les logiques qui leur sont sous-jacentes. Notons que ces conditions sont liées à la rétribution monétaire qui reste l’une des frontières qui sépare le monde du travail masculin de celui du travail féminin. Notre réflexion s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs sur les conditions de vie et les stratégies résidentielles de certaines catégories de travailleurs dans la métropole abidjanaise, tels les salariés de l’industrie[359]ou encore les catégories moyennes[360]. Elle vise à suivre l’itinéraire résidentiel des PDF dans la métropole abidjanaise, en vue de comprendre les processus et mécanisme de leur insertion urbaine dont l’accès au logement constitue un critère. Nous identifierons les lieux et modes de résidence, dans une approche spatiale et temporelle, d’autant que le travail de ce personnel se singularise par la présence quasiquotidienne des concernées sur le lieu d’activité. Au-delà des lieux, nous nous intéresserons aux types de logements occupés et aux statuts d’occupation des travailleuses visées. On peut se demander en quoi les conditions de logement des PDF relèvent-elles de stratégies particulières à ce groupe de travailleuses ?
SOURCES ET MÉTHODOLOGIE
Les informations utilisées dans ce travail proviennent de deux sources. La première est notre thèse de doctorat de géographie dont les données ont fait l’objet d’une actualisation en 2010. La deuxième concerne l’importante littérature consacrée à la question du logement et à la situation des travailleurs non qualifiés dans les villes africaines et singulièrement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Par conséquent, le support de ce travail consiste en des enquêtes de terrains[361]et en l’exploitation de l’importante littérature consacrée à la question du logement et aux situations de vie des travailleurs, ceux d’Abidjan notamment. Les données statistiques proviennent également de sources diverses, des trois recensements[362], des données d`enquêtes sur les migrations telle l`enquête ivoirienne sur les migrations et l`urbanisation (EIMU) réalisée en 1993 et sur des études s`appuyant sur les données d`enquêtes à objectifs multiples[363]. Notre préoccupation est donc de confronter les résultats de nos enquêtes à ces réalités relevées par divers auteurs.
1. PRÉSENTATION DES PDF DE LA VILLE D’ABIDJAN
1. 1. DE JEUNES MIGRANTES ÉTRANGÈRES À LA VILLE
1. 1. 1. Des étrangères à la ville d’Abidjan
Dans sa définition générale, migration signifie « déplacement d’un individu ou d’une population », « changement de lieu d’un individu ou d’une population ». La migration s’appuie donc sur le lieu de naissance des individus, considéré comme un indicateur de mobilité. La majorité des domestiques enquêtées à Abidjan n’y est pas native. Elles sont venues des différentes régions de Côte d’Ivoire et des pays limitrophes, où elles sont nées et y ont passé leur enfance (Cf. tableau 1).
Tableau 1: Répartition des enquêtées selon le lieu de naissance
| LIEU DE NAISSANCE | EFFECTIF | POURCENTAGE |
| Abidjan | 75 | 15 |
| Hors d’Abidjan | 425 | 85 |
| TOTAL | 500 | 100 |
Source : Nos enquêtes de terrain, 2005 et 2010
15% des enquêtées sont nées à Abidjan et y ont toujours vécu tandis que 85% sont nées hors de la ville d’Abidjan et n’y ont pas toujours vécu. Dans cette dernière proportion, 94,6% soit 402 PDF sont issues de la migration interne[364]et, 5,4% soit 23 PDF de la migration internationale. Les migrantes internationales proviennent essentiellement des pays limitrophes de la Côte d’Ivoire : le BURKINA FASO (8 PDF soit 1,9%), le GHANA (8 PDF soit 1,9%), la GUINEE (un
PDF soit 0,2%), le LIBERIA (un PDF soit 0,2%) et le MALI (5 PDF soit
1,2%).
1. 1. 2. Des travailleuses jeunes
Les PDF appartiennent à plusieurs tranches d’âge depuis les moins de 15 ans jusqu’aux 50 ans et plus (Cf. figure 1).
Figure 1: Répartition des PDF de la commune de Cocody selon les tranches d’âge
Source : Nos enquêtes de terrain, 2005 et 2010
Selon les enquêtes restituées dans la figure n°1, des inégalités numériques s’observent dans les classes d’âge en faveur des 1519 ans : celle-ci représente près de 50% de la population enquêtée, avec un effectif de 238 jeunes filles (47,6%). Par ailleurs, les classes de 15-19 ans, 20-24 ans et dans une moindre mesure 25-29 ans sont les classes dominantes. Si l’on se réfère à l’âge de la majorité établi à 18 ans depuis la loi fondamentale de 2001, ce sont 3,8% de mineures qui exercent en 2010 le métier de PDF. Par conséquent, si l’on additionne les proportions des classes de moins de 15 ans, de 1519 ans, 20-24 ans et 25-29 ans, on constate que 89,2% des enquêtés ont moins de 30 ans. Nous en déduisons alors que la majorité des enquêtées ont un âge compris entre 15 et 29 ans. Elles sont donc des travailleuses en majorité jeunes.
1. 2. DES TRAVAILLEUSES PEU INSTRUITES SOUVENT
CÉLIBATAIRES QUELQUEFOIS MÈRES DE FAMILLE
1. 2. 1. Un personnel peu instruit
Une caractéristique démographique notable des enquêtées est la faiblesse de leur niveau d’instruction. A peu près la moitié (45%) des enquêtées sont analphabètes ; elles n’ont jamais été scolarisées et ne savent ni lire, ni écrire en français (Cf. tableau 2).
Tableau 2: Répartition des personnels domestiques féminins selon le niveau d’instruction
| NIVEAU D’INSTRUCTION | EFFECTIF | PROPORTION |
| PRIMAIRE | 178 | 35,6 |
| SECONDAIRE 1 | 55 | 11 |
| SECONDAIRE 2 | 4 | 0,8 |
| NON SCOLARISÉE | 224 | 44,8 |
| AUTRES NIVEAUX | 1 | 0,2 |
| NON RENSEIGNÉS | 38 | 7,6 |
| TOTAL | 500 | 100 |
Source : Nos enquêtes de terrain, 2005 et 2010 Selon le tableau 2, 38 enquêtées (soit 7,6%) n’ont donné aucune information sur leur niveau de scolarisation ; ce qui leur vaut le qualificatif de non renseignés. Hormis ce groupe, les autres (92,4% des enquêtées) sont reparties entre non scolarisées et scolarisées. Les premières, au nombre de 224, représentent 44,8%, soit près de 45% des « renseignées ». Elles n’ont jamais été scolarisées, c’est-àdire qu’elles n’ont jamais appris à lire et à écrire et donc peuvent être classées parmi les analphabètes. Les secondes constituent à peu près la moitié des enquêtées : 237, soit 47,4%. 178 d’entre elles, soit 35,6%, ont un niveau primaire ; 55 soit 11%, ont un niveau secondaire 1[365]et 4, soit 0,8% des enquêtées, ont un niveau secondaire 2[366]. A ces scolarisées, on peut adjoindre le PDF classé dans la catégorie des « autres niveaux » : l’intéressé ne relève pas de l’école classique conventionnelle, et a suivi des cours d’alphabétisation fonctionnelle à l’église. Avec cette dernière, ce sont 238 domestiques scolarisées, soit 47,6% des enquêtées qui savent lire et écrire. Et, dans cette proportion, quelques-unes ont eu des diplômes (Cf. tableau 3).
Tableau 3: Répartition des PDF scolarisés selon le diplôme obtenu
| COMMUNE DIPLOME OBTENU | ADJAME | COCODY | YOPOUG ON | MARC ORY | TOTAL | |||||
| Eff | % | Eff | % | Eff | % | Eff | % | Eff | % | |
| CAP / CEPE | 4 | 11 | 24 | 69 | 6 | 17 | 1 | 3 | 35 | 14,7 |
| BEP / BEPC | 0 | 0 | 5 | 63 | 3 | 37 | 0 | 0 | 8 | 3,4 |
| Aucun diplôme | 41 | 21 | 100 | 51 | 49 | 21 | 5 | 7 | 195 | 81,9 |
| TOTAL | 45 | 19 | 129 | 54 | 58 | 24 | 6 | 3 | 238 | 100,0 |
Source : Nos enquêtes de terrain, 2005 et 2010
Sur la population des 238 domestiques scolarisées (47,6%), seulement 18,1% ont obtenu un diplôme : 14,7% sont titulaires d’un Certificat d’Etudes Primaires (CEPE) ou d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et 3,4% ont obtenu un Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou un Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP). La quasi-totalité de cette population, 81,9%, a fréquenté l’école sans toutefois obtenir de diplôme. La majorité n’a pas pu obtenir le CEPE.
Elles ont arrêté les études au premier échec, « faute de moyens financiers pour continuer », disent-elles. Ces scolarisées sans diplôme sont logées à la même enseigne que les 44,8% d’enquêtées analphabètes, dans le métier domestique, si l’on s’en tient au diplôme sanctionnant les étapes du cursus scolaire.
De ces résultats d’enquêtes, nous déduisons que les PDF ont un faible niveau d’instruction associé à une insuffisance de qualification professionnelle pour prétendre à un métier plus valorisant.
1. 2. 2. Une prédominance de célibataires avec quelquefois des enfants à charge
Par ailleurs, une autre caractéristique des PDF d’Abidjan est leur surreprésentation dans le statut matrimonial de célibataire (Cf. tableau
4).
Tableau 4: Répartition des PDF selon la situation matrimoniale et le nombre d’enfant
| Statut matrimonial Nombre d’enfant | ¨Célibatair e | Mariée | Séparée ou divorcée | Veuve | TOTAL | |||||
| Eff | % | Eff | % | Eff | % | Eff | % | Eff | % | |
| 0 | 35 2 | 70,4 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 72 |
| 1 | 84 | 16,8 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17,6 |
| 2 | 35 | 7 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7,2 |
| 3 | 4 | 0,8 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 9 | 1,8 |
| 4 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 2 |
| TOTAL | 47 6 | 95,2 | 17 | 3,4 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 500 | 100 |
Source : Nos enquêtes de terrain, 2005et 2010
D’après le tableau 4, qui fait le croisement des variables statut matrimonial et nombres d’enfants, on constate que les PDF déclarés célibataires sont les plus nombreux (95,2%). Mais d’autres statuts en proportions moindres cohabitent avec les enquêtées déclarées célibataires : les mariés (3,4%), les séparées/divorcées (0,6%) et les veuves (0,8%).
Par ailleurs, les célibataires n’ayant pas encore d’enfant sont encore les plus nombreuses (70,4% des enquêtées). Avec le même statut de célibataires, viennent celles qui ont un enfant, 16,8% des enquêtées, suivies de celles qui ont deux enfants (7 % des enquêtées) et de celles qui ont trois enfants et plus, 2% des enquêtées. La forte proportion de femmes sans enfant est en lien avec les classes d’âges à forte prédominance de jeunes adolescentes et d’adultes. En effet, les célibataires se concentrent dans les classes d’âge de 15-19 ans à 4044 ans. Mieux, cette population se concentre dans les classes 15-19 ans et 20-24 ans, soit 63% des enquêtées. Ce sont ici encore les classes d’âge dominantes. Dans les classes d’âge supérieures, 25-29 ans (9,6% des enquêtées ont un enfant) et les 30 ans et plus (5% des enquêtées), les enquêtées ont au moins un enfant. Cette réalité tend à justifier les propos de certaines enquêtées, qui estiment que les patronnes préfèrent les plus jeunes pour leur disponibilité.
2. LE PARCOURS MIGRATOIRE DANS LA MÉTROPOLE ABIDJANAISE
Par leurs lieux de naissance ou leurs dernières résidences déclarées, les PDF sont en majorité des migrants. Plus de 85% sont nés hors d’Abidjan, et 91,6% avaient une résidence située hors de cette métropole. En 2006, ces femmes étaient plus de 53% à déclarer y être arrivées depuis à peine 5 ans ; ce qui correspond à des migrations datant du début de la décennie 2000. Les motifs de leur arrivée à Abidjan rappellent ceux qu’on rencontre couramment dans la littérature. Ces raisons sont d’ordre économique et social.
Ainsi, elles sont venues apprendre un métier (36%) ou gagner leur vie (31%), suivre des parents dans le cadre d’une migration familiale, etc. (Jacquemin, 2006 ; Kouadio, 2008).
Les enquêtes (Cf. tableaux 2 et 3) révèlent par ailleurs chez ces migrantes un niveau scolaire faible : la plupart n’ont pas franchi le cap de l’enseignement primaire. Ce faible niveau d’instruction justifie l’orientation de celles-ci vers les activités du secteur informel, singulièrement l’emploi de PDF qui ne requiert pas de qualification scolaire.
2. 1. Les communes d’accueil à l’arrivée
A leur arrivée à Abidjan, les migrantes se sont installées dans les quartiers considérés comme les portes d’entrée de la ville (Cf. tableau 5).
Tableau 5: Répartition des migrantes selon la commune d’accueil à l’arrivée à Abidjan et les motifs de la mobilité
| COMMUNE | Justification de la mobilité | TOTAL | ||||||
| Changement de lieu de résidence | Apprendre un métier | Gagner sa vie | Autres | |||||
| Effectif | % | |||||||
| ADJAME | 5 | 35 | 25 | 20 | 85 | 20 | ||
| COCODY | 4 | 19 | 17 | 14 | 54 | 12,7 | ||
| YOPOUGON | 8 | 50 | 35 | 49 | 142 | 33,4 | ||
| ABOBO | 6 | 44 | 45 | 26 | 121 | 28,5 | ||
| PORT BOUET | 2 | 6 | 10 | 5 | 23 | 5,4 | ||
| TOTAL | Effectif | 25 | 154 | 132 | 114 | 425 | ||
| % | 5,9 | 36,2 | 31 | 26,9 | 100 | |||
Source : Nos enquêtes, 2005 et 2010
Sur les dix communes de l’ancienne ville d’Abidjan[367], cinq ressortent comme les plus hospitalières à l’endroit de ces migrantes. Ce sont les communes périphériques de Yopougon et d’Abobo qui totalisent près des deux tiers de l’effectif (61,9%) ; ensuite viennent par ordre d’importance, la vieille « ville africaine » d’Adjamé (20%), Cocody commune résidentielle de haut et moyen standings (12,7%), et la commune de Port-Bouët (5,4%) au Sud.
Kouadio explique « l’hospitalité » de ces communes à l’endroit des migrantes par leur situation géographique. En effet elles sont les portes d’entrée d’Abidjan, Cocody excepté : « Tous les voyageurs en provenance du Centre, du Nord, de l’Ouest et parfois de l’Est de la Côte d’Ivoire rentrent dans la ville par Abobo, Yopougon ou Adjamé. Tandis que ceux partis de l’Est ivoirien ou du Ghana y entre souvent par Port Bouët. La situation de ces communes à la porte de la ville, leur a valu d’accueillir de nombreuses gares routières. »[368]Aussi, certaines se font-elles héberger par des parents ou des ressortissants de même village ou de même région qui résident non loin des gares routières. Les autres exploitent parfois différents réseaux d’accueil à Abidjan, pour se loger dans les communes suscitées. Ces réseaux sont souvent constitués de parents, ou de connaissances qui promettent à ces jeunes filles la scolarisation, la formation ou tout simplement leur prise en charge, une fois en ville. Ces personnes résident dans ces communes qualifiées ici de zones d’accueil des migrantes.
Carte 1: Flux des migrantes dans les communes d’accueil à leur arrivée à Abidjan
2. 2. Les itinéraires résidentiels des travailleuses
Après l’arrivée dans la ville, les lieux d’accueil se diversifient et d’autres communes apparaissent dans les itinéraires résidentiels. Ainsi, apparaissent Marcory, quartier des années 1960-1970, et Treichville. Certaines communes d’accueil deviennent plus attractives, à l’instar de Cocody, qui accueille à cette deuxième étape 32,7% des PDF, contre 12,7% à leur arrivée dans la capitale économique. D’autres au contraire ont été de simples lieux de transit et perdent donc leurs migrantes accueillies, dans des proportions variables (tableau n°6 et carte 2). La mobilité infra urbaine est essentiellement liée aux activités menées par ces migrantes dans la ville si l’on se réfère aux données du tableau 6 ci-dessous. Elle correspond à une amorce d’autonomie et à une maîtrise progressive du fonctionnement du système urbain, qui semble profiter aux quartiers et communes les plus demandeuses de PDF. Habituées au mode de vie citadin, elles peuvent aisément s’éloigner des premiers quartiers et communes d’accueil.
Tableau 6: Répartition des travailleuses à Abidjan selon la commune et le type d’activité exercée
| COMMUNE | ACTIVITÉ EXERCÉE | TOTAL | ||||||
| Eff | % | |||||||
| Bon ne | Vente/com merce | Coutu re | Coiffu re | Autre s | ||||
| ADJAME | 58 | 7 | 82 | 19,3 | ||||
| COCODY | 71 | 8 | 18 | 20 | 22 | 139 | 32,7 | |
| YOPOUGON | 99 | 6 | 15 | 5 | 9 | 134 | 31,6 | |
| MARCORY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,6 | |
| TREICHVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | |
| ABOBO | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 12 | |
| PORT BOUET | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,6 | |
| TOTAL | Effec tif | 296 | 21 | 35 | 28 | 45 | 425 | |
| % | 69,7 | 4,9 | 8,2 | 6,6 | 10,6 | 100 | ||
Source : Nos enquêtes, 2005 et 2010
Carte 2: Répartition des migrantes dans les communes après leur arrivée à Abidjan
Exemples :
- Venue d’Agnibilékrou, Affoua arrive à Abidjan en compagnie de satante domiciliée à Abobo. L’accueil dure deux jours. La tante place Affoua dans un ménage à Cocody. Affoua fait donc partie des migrantes dont la commune d’accueil à l’arrivée est Abobo. Dans la répartition des migrantes après l’arrivée à Abidjan selon la commune et le type d’activité exercée, elle fait partie des 71 domestiques résidant à Cocody.
- Awa est venue à Abidjan à la demande de sa tante résidant à Yopougon et qui la voulait pour l’aider dans ses tâches domestiques. Trois mois passent ; la tante change de quartier toujours dans la commune de Yopougon. Awa vend, de petites denrées alimentaires (oignons, piment frais et sec, du sel, etc.), de l’eau glacée et des jus de fruits devant la nouvelle concession, pour le compte de sa tante. Yopougon est la commune d’accueil et de résidence d’Awa : elle fait donc partie des 6 migrantes dont l’activité exercée est « vente/commerce » et qui résident à Yopougon.
A cette étape de l’installation dans la ville, et selon le tableau 2, près de 7 migrantes sur 10 exercent le métier de « bonne ». Dans une moindre mesure, certaines s’orientent vers les métiers de la couture (8,2%), de la coiffure (6,6%), et de vente/commerce (4,9%) ; d’autres s’engagent dans l’apprentissage d’un métier ou se disposent comme aide familiale ou se déclarent sans occupation.
3. ÉLÉMENTS DES STRATÉGIES RÉSIDENTIELLES
Nous aborderons les stratégies résidentielles en commençant par la cartographie des quartiers et communes de résidence de ces travailleuses, puis leurs statuts de résidences, et les types d’habitats occupés. Les conditions financières du choix des logements et les contraintes diverses inhérentes aux fondements de ces choix seront abordés pour une meilleure lecture des stratégies en question.
Carte 3: Répartition des PDF dans l’agglomération d’Abidjan selon les communes de résidence et le type d’habitat
3. 1. Des travailleuses hébergées chez l’employeur : un choix stratégique
Les PDF ont été enquêtés sur leur lieu de travail, qui est le domicile de l’employeur. Les enquêtes révèlent que ce lieu de travail se confond avec les lieux de résidence chez la majorité d’entre elles. Elles sont ainsi 89,2 % à demeurer chez l’employeur, contre seulement 10,8% à résider ailleurs, hors du lieu de travail.
Tableau 7: Répartition (en %) des PDF selon le lieu de résidence et par commune d’enquête
| NATUREDE L’HÉBERGEMENT | COMMUNES | TOTAL | |||
| Adjam é | Cocody | Marcory | Yopougo n | ||
| Chez l’employeur | 95,2 | 89 | 82,7 | 90,5 | 89,2 |
| Autres | 4,8 | 11 | 17,3 | 9,5 | 10,8 |
| Total | 12,6 | 47,6 | 15 | 25,2 | 100 |
Source : Nos enquêtes, 2005 et 2010
Cette « hospitalité » à l’égard des PDF est une tendance lourde, et les différences entre les employeurs domiciliés dans les différentes communes sont nuancées. En accueillant plus de 8 employées sur 10, les ménages des communes résidentielles de standing que constituent Marcory et Cocody, partagent les mêmes postures d’hospitalité que la populaire Adjamé (95,2%) ou ceux de Yopougon (90,5%), symbole d’une certaine mixité sociale à Abidjan. Au demeurant, ces situations permettent de déterminer les types d’habitat occupés par ces employées, au moins pendant qu’elles travaillent chez ces employeurs. Cette surreprésentation des PDF qui résident chez leurs employeurs amène à s’interroger sur la signification de cette pratique, vue sous l’angle des employées aussi bien que des employeurs ? Ces employeurs développeraient-ils un sens aigu de la solidarité, ou s’accommoderaient-ils de dispositions réglementaires en matière d’embauche de ce personnel ? Les travailleuses concernées subiraient-elles ainsi la rigueur d’une réglementation du code du travail, à laquelle elles seraient prêtes à se soustraire à la moindre occasion ou contraire, se satisfont-elles d’une situation commode, recherchée, enviée ? En un mot comment expliquer cette propension des PDF à résider chez leurs employeurs ?
Le travail domestique peut être obtenu en échange du gîte et du couvert mais aussi d’argent de poche. C’est le cas des nombreuses domestiques. Par ailleurs, les conditions de déplacement sont difficiles à Abidjan à cause de la congestion et du dysfonctionnement interne du transport urbain. L’Agence de Gestion des Transports Urbains (AGETU) révèle que depuis 2000, les dépenses consacrées aux transports collectifs (SOTRA, ramassage, gbaka, woro-woro) à Abidjan sont comprises entre 105 000 F CFA/habitant/an et 125 000 F CFA/habitant/an soit des charges mensuelles de 8 750 à 10 500 F CFA/habitant/an. Le coût du transport est un luxe pour les PDF dont le revenu moyen n’excède guère 20 000 F CFA. La modicité de leurs revenus ne leur permet pas de financer le coût des déplacements de leur domicile à leur travail et vice versa. Par ailleurs, elles doivent respecter les horaires de travail qui sont 7h, tôt le matin pour finir tard le soir, après 20h. Résider chez l’employeur est donc une garantie pour plus d’efficacité en restant sur place, et de gain en réduisant le coût du transport du domicile au travail.
3. 2. …ou être hébergés par des parents
Celles des travailleuses qui ne sont pas hébergées chez leurs employeurs (10,8% des enquêtées) répondent majoritairement au statut d’hébergés gratuits (72,3%) contre une minorité de colocataires (27,7%). Aucune domestique n’a déclaré être propriétaire.
Les « hébergées gratuit » sont principalement des membres de réseaux de solidarité constitués de parents, de ressortissants de même village ou de région et leur conjoint pour les mariées, etc. Comme celles qui sont logées aux domiciles de leurs employeurs, la majorité des hébergées hors des lieux de travail, le sont soit dans des villas (5,6%), soit des immeubles et logements en bande (35,2%) du modèle économique, soit dans des cours communes (14,8%). Les occupants des baraques caractéristiques de l’habitat précaire y sont également représenté : 9 sur 39 hébergées. Ce type d’habitat est le cadre de vie de 9 des 15 employées en situation de colocation.
Les proportions de PDF dans les différents types de logement, indiquent que leurs logeurs vivent pour la plupart dans des logements économiques. Le caractère hospitalier de l’habitat économique constamment souligné par différents auteurs[369]est alors confirmé par notre enquête.
Les « hébergées gratuit » sont souvent des migrantes récentes (moins de trois mois). Elles travaillent à proximité des lieux de résidence de leurs hôtes.
Carte 4 : Répartition géographique des quartiers de résidence des domestiques non logées selon le type de logement
Pour comprendre ces conditions de logements, il faut se rapporter sans doute aux rythmes de travail de ces travailleuses et voir leur condition de rémunération.
3. 3. Des colocataires dans les habitats non planifiés précaires La différence entre « colocataires » et « hébergées gratuit » réside dans leur ancienneté dans le métier. Elles ont déjà fait l’expérience de résider chez l’employeur ou chez un parent. Connaissant mieux la configuration et le fonctionnement de la ville, elles sont libérées de l’assujettissement des tuteurs. La quête de l’autonomie les amène à prendre une maison dans des quartiers où inconfort et précarité cohabitent.
Tableau 8: Répartition des PDF colocataires selon le coût du loyer en FCFA
| MONTANT DU LOYER | EFFECTIF | % |
| – de 5 000 | 3 | 20 |
| 5 000 à 9 999 | 5 | 33 |
| 10 000 à 14 999 | 4 | 27 |
| 15 000 à 19 999 | 2 | 13 |
| 20 000 et plus | 1 | 7 |
| TOTAL | 15 | 100 |
Source : Nos enquêtes, 2005
D’après le tableau ci-dessus, sur les 15 PDF déclarés colocataires, 99% payent son loyer à un coût inférieur à 20 000 FCFA. Pour ces derniers, le montant des loyers déclarés, ne permet pas d’acquérir des logements décents à Abidjan. Or, ils payent des loyers dont les montants excèdent rarement 20 000 FCFA avec parfois les charges comprenant l’eau et l’électricité.
3. 3. 1. Dans les habitats de cours
Ces habitats évolutifs ne s’assimilent pas tous à des habitats précaires non planifiés. Cependant, les descriptions faites par les PDF des types d’habitat occupés, nous ramènent à la description de l’habitat non planifié précaire. On les trouve dans les communes d’Abobo, d’Adjamé, et de Cocody (Cf. carte 4).
Photo 1 : Un habitat sur cours à Abobo Avocatier dépourvu d’eau et d’électricité voire de sanitaires
Cliché : Kouamé Lambert, 2010 Ces habitats de construction solide, sont hélas dépourvus de sanitaires, parfois d’électricité et d’eau à cause de la modicité des loyers payés aux propriétaires. A plusieurs[370]dans des chambres qui deviennent petites pour contenir un grand nombre de personnes, les PDF vivent dans la promiscuité. Cette situation éclaire sur les conditions de logements des travailleurs non qualifiés, relevant des strates inférieures des revenus. En effet, le logement « moderne » est financé par deux filières, l’une publique destinée à répondre en priorité à la demande des « économiquement faibles », et l’autre, privée orientée vers le logement de standing. L’une et l’autre, par les conditions imposées à l’attribution, favorisent les catégories sociales aisées et moyennes18. Les opérations d’accession au parc public des logements ou à des terrains s’adressent d’abord à des populations solvables ; ce qui exclut les ménages aux revenus faibles.
3. 3. 2. Dans les baraques
Contrairement aux habitats sur cours, les baraques sont construites sur des espaces librement investis, fruit d’une donation ou non.
Photo 2 : Baraque à Adjamé Compensation dans la commune de Cocody
Cliché : Kouamé Lambert, 2010
Edifié en matériaux de récupération et assimilable à des bidonvilles, l’habitat précaire est la troisième composante de l’habitat en Côte d’Ivoire. Si quelques bâtisses sont en matériau solide, le bois demeure le matériau dominant. Les équipements, les services, les commodités qui confèrent au logement moderne un confort, telles les latrines, les douches, les cuisines sont inexistantes. De plus, l’eau potable est une denrée rare. Ces quartiers se répartissent dans toutes les communes de l’agglomération d’Abidjan sauf au Plateau. Malgré l’acharnement des pouvoirs publics à les réduire, les quartiers précaires poussent au rythme de la paupérisation. Parmi les raisons qui justifient leur multiplication à Abidjan, figurent les stratégies de travailleurs non qualifiés modestes du secteur informel pour réduire les contraintes de déplacement liées parfois aux exigences de leur profession.
4. CONTRAINTES LIÉES AUX CHOIX DES RÉSIDENCES
4.1. La faiblesse des rémunérations
Les rétributions perçues par les PDF leur permettent-elles d’avoir accès aux biens et services de la ville, en l’occurrence l’accès aux logements ?
Tableau 9: Barème de salaire des gens de maison
| CATEGORIE | Salaire net mensuel Minima au 01/06/95 | Taux d’augmentation | Soit en F CFA | Nouveaux salaires |
| 1ère catégorie (SMIG) Employé de maison sans spécialité / petit boy ou petite bonne aide cuisinier | SMIG | 36 306 | 36 306 | |
| 2ème catégorie Boy ou bonne n’assurant qu’une partie des travaux de la maison sans lavage du linge | 53 244 | 6% | 3 195 | 56 439 |
| 3ème catégorie Boy ou bonne chargé(e) d’exécuter l’ensemble des travaux de l’intérieur et justifiant de plus de 2 ans de pratique. Cuisinier ayant au moins 2 ans de pratique. | 61 601 | 4% | 2 464 | 64 065 |
| 4ème catégorie Boy cuisinier ou bonne cuisinière assurant l’ensemble des travaux de l’intérieur y compris la cuisine courante / Boy ou bonne qualifié (e) justifiant de plus de 4 ans de pratique Blanchisseur et repasseur | 63 625 | 3% | 1 909 | 65 534 |
| 5ème catégorie Cuisinier ou cuisinière qualifié(e) sachant faire la pâtisserie | 65 289 | 3% | 1 959 | 67 248 |
| 6ème catégorie Cuisinier ou cuisinière qualifié(e) sachant faire la pâtisserie et la charcuterie | 67 805 | 3% | 2 034 | 69 839 |
| 7ème catégorie Maître d’hôtel | 71 313 | 2% | 1 426 | 72 739 |
Source : Inspection du travail de Treichville L’inspection du travail classe et détermine les catégories des employées de maison en fonction de leur niveau d’instruction, de leur expérience dans le métier et de leur qualification professionnelle. Par conséquent, elle a établi un barème des salaires des gens de maison, s’adressant uniquement aux gouverneurs et gouvernantes qualifiés. Or, comparativement aux personnels domestiques masculins, la majorité des PDF n’est pas qualifiées (Cf. tableau 9). Les revenus des employées de maison ne sont donc pas uniformes dans l’espace de la ville d’Abidjan. Ils sont l’objet d’un accord conclu à l’amiable entre employeur et demandeur d’emploi, variable d’un employeur à un autre et d’une commune à une autre. Tableau 10: Répartition en pourcentage des PDF selon les revenus mensuels (en millier de FCFA) et par commune
| Classes de revenus | Communes | TOTAL | |||
| Adjam é | Cocod y | Marcory | Yopougon | ||
| Moins de 5 000 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,8 | 0,6 |
| 5 000 à 10 000 | 4,8 | 6,8 | 6,7 | 1,6 | 5,2 |
| 10 000 à 15 000 | 79,4 | 24,2 | 44,0 | 26,2 | 34,6 |
| 15 000 à 25 000 | 14,3 | 50,4 | 26,7 | 62,7 | 45,4 |
| 25 000 à 35 000 | 0,0 | 15,3 | 6,7 | 0,0 | 8,2 |
| 35 000 et plus | 0,0 | 2,1 | 5,3 | 0,8 | 2,0 |
| Revenus en nature | 1,6 | 1,3 | 8 | 7,9 | 4 |
| TOTAL | 12,6 | 47,6 | 15 | 25,2 | 100 |
Source : Nos enquêtes, 2005 et 2010
Selon le tableau 10, les classes de revenus monétaires sont nombreuses et varient de moins de 5000 CFA à plus de 35 000 FCFA, soit autour du salaire minimum interprofessionnel garantie (SMIG), figé à 36 607 FCFA depuis des décennies. Des employées, en proportion non négligeable, sont rétribuées en nature. Cette rétribution est utilisée pour des charges de nourriture, de denrées alimentaires, de vêtements, etc. La classe modale, où se classe 45,4% des domestiques, est celle de 15 000 à 25 000 F CFA. Cependant, le revenu médian est de 16 250 FCFA, en-dessous duquel se situent 50% des enquêtées. Dans l’ensemble, le revenu moyen perçu par un PDF dans la ville d’Abidjan est de 17 020 FCFA. Toutefois quelques différences salariales s’observent entre communes ?
Ramenée à l’échelle des communes, la distribution des revenus se caractérise par une concentration dans un nombre réduit de classes, à Adjamé, une dispersion marquée à Marcory, relative à Yopougon et à Cocody. Ainsi, 93,7% des PDF d’Adjamé se concentrent dans les deux classes de 10000 à 25 000 F CFA, contre 74,6% de ceux de Cocody ou encore 66,6% à Marcory et 88,9% à Yopougon. La commune de Cocody offre le revenu moyen le plus élevé de toutes les communes d’enquête (18 525 FCFA), soit un niveau légèrement au-dessus du revenu moyen, établi à 17 020 F CFA. Yopougon vient en second rang devant Marcory et Adjamé, avec 16 250 FCFA ; ce qui est supérieur au revenu moyen gagné par les PDF des communes de Marcory et d’Adjamé. Cependant, la commune figure parmi celles qui payent les plus bas salaires (0,8% de PDF gagnent moins de 5 000 FCFA). Le revenu moyen d’un PDF à Marcory est de 15 400 FCFA. Il est supérieur à celui d’Adjamé (13 135 FCFA), à la différence que dans cette dernière commune, on ne note pas de revenu en dessous de 5 000 FCFA. Or à Marcory, 2,7% des PDF perçoivent moins de 5 000 FCFA par mois. En somme, les PDF sont mal rétribués. Leurs rémunérations sont largement en dessous du SMIG.
4. 2. Le prix des conditions de travail soutenu
Le fait que presque tous les employeurs hébergent leurs employées ne peut être compris sans évoquer les conditions de travail de ces personnels. Nous avons donné la parole à quelques unes de nos enquêtées.
- Premier cas : S. Awa, bonne à la cité Sogefiha de Cocody
S. Awa, 22 ans, travaille comme bonne à la cité Sogefiha de Cocody, un habitat collectif de standing économique. Dans ce ménage, les employeurs sont un couple de professeur des lycées et collèges, qui ont deux petits garçons de cinq ans et de sept ans. Il faut ajouter aux enfants, un protégé de trente deux ans, venu du village et apparemment sans occupation.
La journée d’Awa commence à cinq heures du matin. Elle nettoie la maison, met de l’eau à chauffer pour la toilette des enfants et le petit déjeuner, puis les réveille. Les enfants sont tous les deux, des écoliers qui fréquentent l’école primaire du quartier, à quelques mètres de la maison. Elle les aide à se laver, à s’habiller et à prendre le petit déjeuner, puis les conduits à l’école. Au retour, elle passe au marché acheter les condiments qui manquent. A la maison, elle confectionne le repas de midi ; retourne chercher les deux garçons à la sortie de l’école. Les enfants prennent leur repas de midi et se reposent. Awa peut alors déjeuner avant de passer à la vaisselle. A 14h, elle doit raccompagner les enfants à l’école (quand ils ont cours), et de nouveau retourner les chercher à 17H.
Le soir, elle les aide à se laver puis leur sert le repas ; ils vont ensuite étudier. Quelquefois, Awa fait de la lecture et des exercices de calcul avec le plus petits qui est en classe de CP2 son niveau CM1. Pendant ce temps, elle guette l’arrivée des parents, et peu importe l’heure à laquelle ils rentrent. Elle doit les attendre pour le service. Ce sont les consignes laissées par « tantie ». Elle y tient car elle a beaucoup insisté quant à son application stricte. C’est seulement après le dîner de ses patrons qu’elle fait la vaisselle. En général, elle finit de travailler aux environs de vingt deux heures, mais il arrive qu’elle aille au-delà de cette heure.
- Deuxième cas : K. Odette est serveuse dans un restaurant populaire au quartier Champroux à Marcory
K. Odette, 26 ans, travaille comme serveuse dans un maquis en baraque, au quartier Champroux à Marcory. Elle vit chez son employeur, une dame d’une cinquantaine d’années, sa compatriote. C’est une tante éloignée, originaire de Brobo comme elle. Elle est allée la chercher au village et l’a hébergée en attendant qu’elle trouve un emploi. Odette travaille pour sa tante et sont treize personnes dans la maison, les huit enfants et les deux nièces de sa tante, sans oublier elle-même.
Sa tantie gère un restaurant-bar près du stade Champroux non loin de la maison. Elle y passe tout le temps, aidée par deux autres filles, un jeune homme et Odette. Dans ce maquis, sont servis des mets africains à midi et des grillades le soir. Les boissons, notamment les « sucreries », et la bière y sont disponibles à toute heure.
Odette est chargée de collecter l’argent des ventes. Mais son travail ne se limite pas uniquement à collecter les fonds du restaurant. Elle se réveille à cinq heures du matin en même temps que les deux nièces de sa tantie. Elle va faire le marché à Adjamé, accompagnée de l’une d’entre elles. L’autre s’occupe des travaux domestiques de la maison. A leur retour du marché, toutes ensemble, elles confectionnent les différents repas au menu de la journée, du maquis. A midi, lorsque les clients abondent, les deux autres serveuses et le jeune homme s’occupent d’eux, tandis qu’Odette tient la caisse. La même organisation se fait le soir. Elle reste au maquis parfois jusqu’à deux heures du matin. Les jours de fêtes et les week-ends, elle avoue qu’elle n’a pas de répit pour se reposer, ne serait-ce que quelques minutes. Pour ces tâches si absorbantes, elle ne gagne que 20000 F CFA. Et là encore, elle remercie le Ciel, parce que selon ses dires, des filles venues de l’intérieur comme elle, hébergées par des parents, travaillent souvent sans rétribution. Dans son cas, sa tantie reconnaît qu’elle mérite plus, mais comme elle est logée, nourrie et blanchie par cette dernière, ce revenu est acceptable.
Comme Awa et Odette, d’autres domestiques travaillent plus de huit heures par jour. Ces volumes horaires donnent à penser que les employées de maison ne sont pas concernées par les horaires fixés par l’inspection du travail, à savoir, 56h de travail par semaine, soit 9h30mn de travail par jour, pour 6 jours de travail dans la semaine. Le travail commence pour les domestiques entre 6h30mn et 7h30 pour finir au plus tôt vers 18h, voire 20h au-delà, comme dans les cas d’Adjo et d’Awa. Les heures tardives de descente du travail traduisent la lourdeur et la multiplicité des tâches à exécuter. Aussi sont-elles contraintes de loger chez leurs employeurs pour être plus opérationnelles.
CONCLUSION
Le fait d’avoir un emploi de PDF d’abord et l’accès au logement (logées gratuitement, locataire ou colocataire) ensuite constituent, à notre sens, les deux étapes majeures de l’insertion économique des migrantes dans la ville d’Abidjan. Mais, si la première étape est franchie tant bien que mal, pour la plupart d’entre elles, la seconde ne peut l’être que grâce à un accroissement substantiel des revenus des actives. Aussi la mauvaise rétribution et le rythme de travail soutenu contraignent-ils les actives à faire des choix de résidence qui s’inscrivent toujours dans une stratégie de compression des charges financières mais aussi de disponibilité pour les employeurs. Les plus nombreuses souvent jeunes célibataires sans enfant, à la demande des employeurs logent chez ces derniers. Quelques unes restent en famille tandis que les plus âgées, jalouses de leur autonomie mais sans revenus substantiels font de la colocation dans des habitats précaires. Ce qui contribue à la précarisation de l’habitat dans certaines communes de l’agglomération Abidjanaise.
L’emploi de PDF est peu valorisant. Les employeurs ne respectent pas les dispositions du code du travail. Ni la marge salariale (36 607 F CFA), ni les conditions de travail ne sont respectées. L’employeur décide comme bon lui semble du sort de son employée. De plus, une vision patriarcale de la société tend à mieux considérer le service domestique masculin. Les employeurs valorisent mieux ce service en délivrant plus facilement aux domestiques masculins des attestations de travail très utiles pour leur classement en catégorie (Cf. tableau 9). Les PDF classés en catégorie sont rares mais mieux rétribués. Dans ce domaine, on peut dire que les conditions de vie des PDF sont sexuelles. A côté de cela, ces conditions de vie reflètent aussi les disparités socio-spatiales, produit d’un urbanisme d’Etat. La non prise en compte de cette catégorie de travailleurs urbains par les pouvoirs publics dans les programmes de logements est un fait de classes. Seulement les revenus relativement moyens peuvent prétendre aux logements décents à Abidjan. Le campement et le bidonville, établissements humains précaires au plan juridique, aux maisons sommaires élaborés en matériau traditionnel (boue séchée ou banco, planches en bois) ou de récupération sont apparus très tôt comme des solutions possibles à la crise du logement[371]. Cette réalité représente un obstacle pour les efforts de développement en Côte d’Ivoire.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- AGEPE, Enquête sur la situation de l’emploi à Abidjan en 2008, Ministère de la fonction publique et de l’emploi, Abidjan, 2009, 75 p.
- Antoine, Ph. et Herry C., Enquête démographique à passages répétés. Agglomération d’Abidjan (E.P.R. 1978), Ministère du Plan et de l’Industrie de Côte d’Ivoire, Centre ORSTOM de Petit Bassam, Abidjan, 1982, 491 p
- Antoine, Ph. et Herry C, « les populations d’Abidjan dans ses murs », in Cahiers d’Orstom, série Sciences Humaines XIX (4), 1983, 465 p (pp 371-395).
- Antoine, Ph. et Guillaume A., « Une expression de la solidarité familiale à Abidjan : enfants du couple et enfants confiés », in Les familles aujourd’hui (Colloque de Genève, septembre 1984), Association internationales des démographes de langue française, Genève, 1986, 407 p (pp. 289-314).
- Antoine, Ph. et al, Abidjan « côté cours » : pour comprendre la question de l’habitat, Orstom-Karthala, Paris, 1987, 267 p.
- Beauchemin, C., « Des villes aux villages : l’essor de l’émigration urbaine en Côte d’Ivoire », in Annales de géographie, Paris, 2002, 624 p (157-178).
- B.I.C.E., Les petites bonnes à Abidjan. Travail ou exploitation ?,
B.I.C.E., Abidjan, 1998, 157 p.
- BIT-IPEC/ République de Côte-d’Ivoire / INS, Enquête nationale sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire – 2005, Abidjan, 2008, 491 p.
- Chadeau, A. et Fouquet A., « Peut-on mesurer le travail domestique? », in Economie et Statistique, n°136, Paris, 1981, 181 p (29-42).
- Charmes, J., « La mesure de l’activité économique des femmes », in T. Locoh et al., dir., Genre et développement: des pistes à suivre…, CEPED, Paris, 1996, 125 p, (35-44).
- Comoé Fiédin Elise, Relations de genre et migration en Côte d’Ivoire : de la décision de migrer à l’insertion dans le marché du travail, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.) en Démographie, Université de Montréal, Faculté des études supérieures, 2006, 189 p.
- Comoé Fiédin Elise, Genre, migration et insertion dans le marché du travail urbain en Côte d’Ivoire : vers une double discrimination des femmes migrantes? Lors du XXVe Congrès international de la population de l’UIESP, Paris, 2007, 25 p.
- Dureau, F., « Migration et dynamisation des villes de l’intérieur en Côte d’Ivoire », in l’insertion urbaine des migrants en Afrique, Karthala, Paris, 1989, 221 p (pp 119-146).
- Dubresson A., Villes et industries en Côte d’Ivoire. Paris, Karthala, 1990, 843 p.
- Dussuet Annie, Travail domestique et genre,
Université de Nantes – GTM/CNRS – France, 2002, 111 p.
- ENDA TIERS-MONDE, Le travail des enfants au Sénégal. Cas des « domestiques », Enda-Editions, Dakar, 1993, 135 p.
- ENDA TIERS-MONDE, Les Mbindaan sans Mbindou. Étude avec Les petites bonnes de Dakar, Enda T.M, Dakar, 1996, 97 p.
- HAERINGER Ph., 2000 – animateur du secteur informel,
Karthala, Paris.
- Jacquemin, M., « Travail domestique et travail des enfants, le cas d’Abidjan (Côte-d’Ivoire) », in Revue Tiers Monde, n°170, Paris, 2002, 331p (307-326).
- Jacquemin, M., Sociologie du service domestique juvénile : « petites nièces » et « petites bonnes » à Abidjan, Thèse de doctorat de sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/Centre d’Etudes africaines, mai 2007, Paris, 289 p.
- Kouadio, M., Etude géographique de la mobilité des femmes : le cas des personnels domestiques féminins de la ville d’Abidjan, thèse pour le doctorat unique de Géographie, Juillet 2008, 378 p.
- Ouédraogo, D. et Piché, V., l’insertion urbaine à Bamako, Karthala, Paris, 2000, 189 p.
- USAID/RHUDO, Revenus et dépenses des ménages à Abidjan : principaux résultats (enquêtes de MANOU A., N’GUYEN V. T.), Abidjan, 1985, 48 p.
- Vidal, C, Le Pape, M, Pratiques de crise et conditions sociales à Abidjan, 1979-1985, CNRS/ORSTOM,
Paris/Abidjan, 1986, 223 p.
- Yapi-Diahou, A, Baraques et pouvoirs dans l’agglomération abidjanaise, Editions l’Harmattan, Paris, 2000, 456 p.
[1] MACHIAVEL, Nicolas, Le Prince, Paris, Éditions Fernand Nathan, 1982, pp. 105-107. 2 DUPUY, Jean-Pierre, Ordres et désordres : enquête sur un nouveau paradigme, Paris, Seuil, 1990.
[2] Charles Baudelaire est un poète français né en 1821 et mort en 1867. En 1857, il publie aux éditions Poulet-Malassis de Paris, Les Fleurs du mal. Les thèmes abordés par cet ouvrage sont jugés scandaleux. Il est alors censuré et retiré de la vente. Le poète et son éditeur sont condamnés pour outrage à la morale (Microsoft ® Encarta ® 2007. © 19932006 Microsoft Corporation).
[3] PLATON, Le Banquet, 210b – 211b, in Le Banquet, Phèdre, Paris, GF, 1964, trad. Émile Chambry.
[4] Ibidem.
[5] PLATON, La République, 368b – 369b, Paris, GF, 1966, trad. Robert Baccou.
[6] Idem, 580b – 581b. 8 Idem, 444d – 445c.
[7] Idem, 581b – 582a.
[8] Ibidem.
[9] PLATON, Phèdre, 256d in Le Banquet, Phèdre, Paris, GF, 1964, trad. Émile Chambry.
[10] PLATON, La République, 473a – 474a, Paris, GF, 1966, trad. Robert Baccou.
[11] La Bible, Matthieu 15 : 11 et 19, traduite sur les textes originaux hébreux et grecs par Louis Segond, docteur en théologie, version revue, Berne, Éditions La Société Biblique de Genève, 1975.
[12] BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1982, pp. 221 – 228.
[13] Idem, La Pensée et le Mouvant, Paris, PUF, 1969, p. 61.
[14] Idem, L’évolution créatrice, Paris, Quadrige/PUF, 1994, p. 221. L’italique est de l’auteur. 17 Ibidem.
[15] Idem, p. 223.
[16] Idem, La Pensée et le Mouvant, Paris, PUF, 1969, p. 60.
[17] BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1982, p. 224.
[18] Idem, p. 223.
[19] Idem, La Pensée et le Mouvant, Paris, PUF, 1969, p. 61.
[20] Idem, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 1982, p. 225.
[21] ROLLAND, Romain, Au-dessus de la mêlée, Paris, Albin Michel, 1926, 255 pages.
[22] Le deuxième principe de la thermodynamique énonce que l’entropie d’un système isolé ne peut que croître. En conséquence, lorsqu’un système a atteint son état d’équilibre, son entropie est maximale. Ainsi, la mort thermique de l’Univers semble inévitable (Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation).
[23] HEURTEBISE, Jean-Yves, ‘’Vie et temps : dialectique de l’ordre et du désordre’’, in Colloque “La vie et le Temps”, organisé par RezoDoc, novembre 2006, mis en ligne le 16 février 2008. Disponible sur le Web : www.sciences-occultes.org.
[24] COMTE, Auguste, Cours de philosophie positive, in La science sociale, Paris, Gallimard, 1972.
[25] BERNARD, Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, GF, 1966, p. 59.
[26] Idem, p. 60. L’italique est de l’auteur.
[27] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La phénoménologie de l’esprit, tome I, Paris, Aubier Montaigne, 1941, trad. Jean Hyppolite, 358 pages.
[28] BACHELARD, Gaston, La philosophie du non, Paris, PUF, 1940, p. 139. 32 Idem, p. 140.
[29] BERNARD, Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, GF, 1966, p. 59.
[30] Ibidem.
[31] Idem, p. 75. 36 Idem, p. 73.
[32] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier Montaigne, 1941, trad. Jean Hyppolite, 358 pages. 38 Idem, p. 6.
[33] BERNARD, Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, GF, 1966, p. 76.
[34] ANOUILH, Jean, Antigone, Poitiers, Éd. de La Table Ronde, 1982.
[35] De mars à septembre 1905, Albert Einstein publie quatre articles dans la revue Annalen der Physik (volumes 17 et 18) dans lesquels il expose sa vision du monde.
[36] MAGNAN, Christian, Et Newton croqua la pomme, Paris, Éditions Belfond, 1990, 212 pages.
[37] Revue en ligne l’Initiation, Mars-Avril, 2008.
[38] Ibidem.
[39] GRANT, H., Dictionnaire de la mythologie, Paris, Marabout, 1984, p. 272.
[40] La Bible, Genèse 1 : 1- 2, traduite sur les textes originaux hébreux et grecs par Louis Segond, docteur en théologie, version revue, Berne, Éditions La Société Biblique de Genève, 1975.
[41] KARMAONE, ‘’L’univers selon Kerner’’, in Revue en ligne Karmapolis du 09 juin 2008. Disponible sur le Web : <www.karmapolis.be/pipeline/kerner_univers.htm.>
[42] CORNEILLE, Pierre, La veuve in Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1963, 1124 pages.
[43] PLATON, La République, VIII, 545a – 546b, Paris, GF, 1966, trad. Robert Baccou. 50 ATTALI, Jacques, Lignes d’horizon, Paris, Édition Fayard, 1990.
[44] Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.
[45] ALVARADO PLANAS, Georges, ‘’L’esthétique du chaos’’, in Revue en ligne Nouvelle Acropole, 2009.
[46] PLATON, Protagoras, 358a – 359a, Paris, GF, 1967, trad.Émile Chambry.
[47] PLATON, La République, Livre IV, 434c, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, trad. R. Baccou.
[48] PLATON, Œuvres complètes, Lettres VII 324b 326b, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1994, trad. L. Robin.
[49] PLATON, La République, Livre I, 327a-354c, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, trad. R.
Baccou.
[50] PLATON, op. cit., Livre I, 330c-331c. 5 Ibidem.
[51] PLATON, op. cit., Livre I, 334c-336a.
[52] PLATON, op. cit., Livre I, 338c-339b. 8 Ibidem.
[53] PLATON, op. cit., Livre I, 354b-354c. 10 Idem, 357a-358a.
[54] PLATON, op. cit., Livre II, 359a-360a. 12 Idem, 360b-361c.
[55] PLATON, op. cit., Livre II, 361c-362a.
[56] Idem, 362d-363c.
[57] Platon, Ibidem.
[58] Ibidem.
[59] Idem, 363c-364a.
[60] PLATON, op. cit., Livre II, 368b.
[61] PLATON, Politique, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, trad. E. Chambry.
[62] PLATON, La République, Livre II, 368b-369b, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, trad. R. Baccou.
[63] Ibidem.
[64] BRISSON, Luc et PRADEAU, Jean-François, Dictionnaire Platon, Paris, Ellipses, 2007, p.152.
[65] PLATON, La République, Livre IV, 432c-433d, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, trad. R.
Baccou.
[66] Idem, Livre II, 369b-370b.
[67] Idem, Livre IV, 432c-433d.
[68] Ibidem.
[69] PLATON, op. cit., Livre IV, 432c-433b.
[70] Ibidem.
[71] Ibidem.
[72] PLATON, Œuvres complètes, tome III, 1948, 322c, Paris, Les Belles Lettres, trad. A. Croiset et L. Bodin.
[73] PLATON, La République, Livre IV, 434c, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, trad. R.
Baccou.
[74] PLATON, op. cit., Livre IV, 433d-434c.
[75] Ibidem.
[76] PLATON, Œuvres complètes, tome III, 322b-322c, Paris, Les Belles Lettres, 1948, trad. A. Croiset et L. Bodin.
[77] BRISSON, Luc et PRADEAU, Jean-François, Dictionnaire Platon, Paris, Ellipses, 2007, p. 81.
[78] PLATON, Œuvres complètes, tome III, 324e Paris, Les Belles Lettres, 1948, trad. A. Croiset et L. Bodin. 37 Idem, 322d.
[79] Ibidem
[80] BOUTHOUL, Gaston, Histoire des doctrines politiques, Paris, Payot, 1966, p. 35. 2 AUROUX, Sylvain et WEIL, Yvonne, Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la philosophie, Paris, Herissey, 1978, p. 47.
[81] DUVERNOY, Jean-François, Pour connaître la pensée de Machiavel, Paris, Bordas, 1974, p. 6.
[82] PLATON, Phédon, traduction du Grec de Dixsaut, Paris, Flammarion, 1991, p. 249.
[83] ARISTOTE, Éthique de Nicomaque, traduction, préface et notes par Jean Voilquin, Paris, Flammarion, 1992, p. 90.
[84] ALLAN, Jean Donald, Aristote le philosophe, Paris, Éd. Nauwelaerts Louvain Beatrice, 1962, p. 170.
[85] MACHIAVEL, Nicolas, Le prince suivi de l’anti Machiavel de Frédéric II, traduction Jean Giraudet, Paris, Flammarion, 1957, p. 5.
[86] GASTON, Bouthoul, op. cit., p. 13.
[87] RUSS, Jacqueline, Histoire de la philosophie de Socrate à Foucault, Paris, Payot, 1980, p. 48.
[88] ARISTOTE, La politique, Paris, J. Vrin, 1987, p. 24.
[89] KOMENAN, Aka Landry, Le concept de philosophie : Essai sur les limites du rationalisme scientifique en matière politique, Thèse d’État, Grenoble, 1982, p. 62.
[90] ARISTOTE, La politique, op. cit., p. 23.
[91] MACHIAVEL, Nicolas, Le Prince, Paris, Flammarion, 1980, p. 141.
[92] ARISTOTE, La politique, op.cit., p. 384.
[93] HEIDEGGER, Martin, Lettre sur l’humanisme, traduit de l’Allemand par Roger Munier, Paris, Aubier, 1964, p. 57.
[94] PARMENIDE, « De la nature », in VOILQUIN, Jean, Les penseurs Grecs avant Socrate, Paris, G.F, 1976, p. 95.
[95] ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, traduction préface et index et notes et index par Jean Tricot, Paris, J.Vrin, 1967, p. 35.
[96] MACHIAVEL, Nicolas, Le Prince, traduction chronologie, introduction de Guiraudet revue & corrigée, Paris, Flammarion, 1980, p. 139.
[97] MACHIAVEL, Nicolas, L’Art de la Guerre, traduction de Georges Buis, Paris, Berger, Levrault, 1980, p. 14.
[98] GRANGER, Gilles-Gaston, La raison, Paris, P.U.F, 1989, p. 11.
[99] MACHIAVEL, Nicolas, op. cit., p. 150.
[100] ARISTOTE, La politique, op.cit., p. 379.
[101] Idem, p. 249.
[102] Idem, p. 247.
[103] Idem, p. 389.
[104] MACHIAVEL, Nicolas, Œuvres Complètes, Introduction par Jean Giono, Édition établie et Annotée par Edmond Barincou, Paris, Gallimard, 1952, p. 467.
[105] LE PAPE, Marie- Claire, Machiavel le politique, Textes choisis, Paris, P.U.F, 1968, p. 120. 28 ARISTOTE, Éthique de Nicomaque, traduction, préface et notes par Jean Voilquin, Paris, G.F, 1992, p. 12.
[106] AUGUSTIN, Saint, Les Confessions, Livre x, chap. XVIII, traduction Trabucco, Paris, Flammarion, 1991, pp. 267-268.
[107] GAUTHIER, René-Antoine, La morale d’Aristote, Paris, P.U.F, 1968, p.111. 31 BOUTHOUL, Gaston, op. cit., p. 37.
[108] ARISTOTE, La Métaphysique Tome1, Introduction et notes et index par Jean Tricot, Paris, J.Vrin, 1974, p. XI.
[109] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopédie des Sciences Philosophiques, La Science de la Logique, Paris, Vrin, 1970, édition de 1817, Traduction Bernard Bourgeois, Tome l, Théorie du concept, § 141, p. 257.
[110] « Dans ma Phénoménologie de l’Esprit, (…) a été pris le chemin consistant à commencer par la première, la plus simple apparition de l’esprit, la conscience immédiate, et à développer la dialectique jusqu’au point de vue de la science philosophique dont la nécessité est montée par cette progression ». HEGEL, Enc., La Science de Logique, § 25, (édition 1830), p. 291.
[111] GUIBAL, Francis, Dieu selon Hegel, Paris, Aubier-Montaigne, 1975, p. 50.
[112] Dictionnaire Français-latin, Paris, Hachette, 1910, p. 757.
[113] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Leçons sur la philosophie de la religion, Concept de la religion, Paris, Vrin, 1971, Traduction Jean Gibelin, p. 63.
[114] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., Concept de la Religion, p. 81.
[115] Idem, p. 82.
[116] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., Concept de la Religion, p. 81. 9 Idem, p. 86.
[117] Idem, p. 93. 11 Ibidem.
[118] Idem, p. 95.
[119] Idem, p. 98.
[120] Idem, p. 101. 15 Ibidem.
[121] Idem, p. 103.
[122] Idem, p. 104. 18 Ibidem.
[123] Idem, p. 105.
[124] Idem, pp. 105-106. 21 Idem, p. 107.
[125] Ibidem.
[126] Idem, p. 111.
[127] Idem, p. 116.
[128] Ibidem.
[129] Idem, p. 117. 27 Ibidem.
[130] Idem, p. 120.
[131] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopédie des sciences philosophiques, La Science de la Logique, Paris, Vrin, 1970, édition 1830, Traduction Bernard Bourgeois, Tome 1, § 95, p. 359. « l’Infini et le fini ne font qu’un ».
[132] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Philosophie de la Religion, Concept de la Religion, p. 122.
[133] Idem, p. 126.
[134] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Science de la logique, Paris, Aubier-Montaigne, 1972, Traduction Pierre-Jean Labarrière et Gwendoline Jarczyk, Premier Tome, Premier Livre : “L’Etre”, p. 116.
[135] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopédie, La Science de la Logique, Addition au § 94 (édition 1830), p. 528.
[136] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Logique, Tome 1, Premier Livre, “L’Etre”, pp. 119-120.
[137] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Philosophie de la Religion, Concept de la Religion, p. 129.
[138] Idem, p. 130.
[139] Idem, p. 133.
[140] Idem, p. 148.
[141] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie, Tome 1, p. 18.
[142] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Philosophie de la Religion, Concept de la Religion, p. 146.
[143] Idem, p. 149. 42 , p. 150.
[144] Idem, p. 158. 44 Idem, p. 150.
[145] Idem, p. 161.
[146] Idem, p. 170. 47 Ibidem.
[147] Ibidem.
[148] Idem, p. 175. 50 Idem, p. 143. 51 , p. 157.
[149] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., Concept de la Religion, p. 195.
[150] Idem, p. 199. 54 , p. 209.
[151] Idem, p. 216. 56 Ibidem.
[152] Idem, p. 223. 58 , p. 225.
[153] Idem, p. 229.
[154] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., Concept de la Religion, p. 231. 61 , pp. 231-232.
[155] Idem, p. 247.
[156] Idem, p. 246. 64 , p. 249.
[157] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1941, trad. Jean Hyppolite, p. 204 sq.
[158] FICHTE, Johann Gottlieb, Œuvres choisies de philosophie première. Doctrine de la science (1794-1797), Paris, Vrin, 1999, trad. Alexis Philonenko, 3ème pp. 270-272.
[159] GROSOS, Philippe, Système et subjectivité, Paris, Vrin, 1996, p. 216.
[160] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La Phénoménologie de l’esprit, t. I, Paris, Aubier, 1941, trad. Jean Hyppolite, p.16.
[161] SPINOSA, Benoit, Lettre L à Jarig Jelles.
[162] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Principes de la philosophie du droit, Paris, Vrin, 1989, trad. Robert Dérathé, p. 59.
[163] BERNER, Christian, « L’idéalisme transcendantal de Friedrich Schlegel. Sur la réflexion philosophique dans les Leçons de philosophie transcendantale (1800-1801) », in Symphilosophie, Denis Thouard, Paris, Vrin, 2002, p.137.
[164] SCHLEGEL, Friedrich Von (1772-1829), Fragments, Paris, J. Corti, 1996, trad. Charles Leblanc.
[165] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1941, trad. Jean Hyppolite, t. I, p.19.
[166] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., t. I, p. 21.
[167] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., t. I, p. 19.
[168] CATTIN, Emmanuel, La décision de Philosopher, Zürich, Georg Olms Verlag, 2005, p. 21.
[169] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La Phénoménologie de l’esprit, t. II, Paris, Aubier, 1941, trad. Jean Hyppolite, pp. 240-241.
[170] CATTIN, Emmanuel, op. cit., p. 58.
[171] CATTIN, Emmanuel, op. cit., p.108.
[172] Chez Platon, l’absolu est un monde : celui des idées, des essences éternelles. Il est selon lui la patrie du philosophe, mais pour y arriver il est nécessaire de se libérer du monde phénoménal qui est un faux monde, un monde des apparences et des illusions. Toute la question ici est de savoir à quel moment l’homme peut être sûr de s’être débarrassé de toute illusion. Si la mort est la médiation par laquelle on parvient à l’absolu, si l’absolu est le règne des esprits des morts, il est alors inaccessible à l’homme effectif et ne peut être envisagé que sous la forme d’un monde seulement possible. Chez Hegel, l’homme vivant est déjà membre de l’esprit universel, c’est pourquoi l’absolu pour lui n’est pas un monde étranger, mais un monde dans lequel il est depuis toujours engagé.
[173] BOURGEOIS, Bernard, in HEGEL, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, Philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, 1988, trad. Bernard Bourgeois, p. 7.
[174] BOURGEOIS, Bernard, Op.cit. ibid.
[175] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, Philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, 1988, trad. Bernard Bourgeois, pp. 99, § 304.
[176] BOURGEOIS, Bernard, in HEGEL, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, Philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, 1988, trad. Bernard Bourgeois, p. 8. 21 Ibid.
[177] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op.cit., p.186, § 389.
[178] BOURGEOIS, Bernard, in HEGEL, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, Philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, 1988, trad. Bernard Bourgeois, p. 9. 24 Ibid.
[179] Hegel parle de la religion chrétienne, et particulièrement de la rédemption du Christ lorsqu’il parle, d’une façon allégorique du mystère du pain et du vin. Ce mystère récapitule en soi l’incarnation de Dieu, la mort et la résurrection du Christ qui s’achève par l’ascension du Fils de Dieu au ciel et le couronnement du tout par la venue de l’Esprit saint.
[180] BOURGEOIS, Bernard, in HEGEL, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, Philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, 1988, trad. Bernard Bourgeois, p. 79. 27BOURGEOIS, Bernard, op. cit., p. 78.
[181] JARCZYK, Gwendoline et LABARRIÈRE, Pierre-Jean, De Kojève à Hegel: 150 ans de pensée hégélienne en France, Paris, Albin Michel, 1996, p.112.
[182] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Science de la logique, tome1, trad. Labarrière et Jarczyk, Paris, Aubier Montaigne, 1972, p. 6.
[183] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Premières publications, trad. Marcel Méry, Paris, Ophrys, 1975, p. 39.
[184] KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues et Pacaud, Paris, P.U.F, 1950, p. 338.
[185] Idem, p. 39.
[186] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Science de la logique, Tome 1, trad. Jarczyk et Labarrière, Paris, Aubier Montaigne, 1972, p. 34.
[187] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Premières publications, trad. Marcel Méry, Paris, Ophrys, 1975, p. 89.
[188] D’HONDT, Jacques, Hegel et les Français, Zürich, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1998, p. 7.
[189] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Premières publications, trad. Marcel Méry, Paris, Ophrys, 1975, p. 289.
[190] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, tome 2, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier Montaigne, 1975, p. 105. 11 Ibidem.
[191] D’Hondt, Jacques, Hegel et les Français, Zürich, Georg Olms Verlag Hildesheim, 1998, p.
[192] .
[193] HAYM, Rudolf, Hegel et son temps, trad. Pierre Osmo, Paris, Gallimard, 2008, p. 509.
[194] La Sainte Bible, trad. Louis Segond, Jean XVI, 13.
[195] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Raison dans l’histoire, trad. K. Papaioannou, Paris, 10/18, 1965, p.39.
[196] JIMENEZ, Marc, Qu’est-ce que l’esthétique ? , Paris, Gallimard, 1999, p. 9.
[197] JIMENEZ, Marc, op. cit., p. 10. 3 JIMENEZ, Marc, op. cit., p11.
[198] HUISMAN, Denis, L’Esthétique, Paris, P.U.F, coll. « Que sais-je ? » 1992, pp.3-4. 5 MEMEL-FOTE, Harris, ‘’L’idée d’une esthétique négro-africaine’’ in Revue de littérature et d’esthétique négro-africaine, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1977, p. 13.
[199] Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, cité par MEMEL-FOTE (H.), op. cit., p. 14.
[200] BRUN, Jean, Les conquêtes de l’homme et la séparation ontologique, Paris, P.U.F, 1961, p.254.
[201] MEMEL-FOTE, Harris, op. cit., p. 15.
[202] MEMEL-FOTE, Harris, Ibidem.
[203] MEMEL –FOTE, Harris, op. cit., p. 16.
[204] Ibidem.
[205] Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem.
[206] Op. cit., p. 18.
[207] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Introduction à l’esthétique, Paris, Aubier-Montaigne, 1964, traduction GIBELIN, pp. 12-13.
[208] Op. cit., p. 10.
[209] JIMENEZ, Marc, op. cit., p. 187.
[210] Op. cit., p.194.
[211] BRUN, Jean, op. cit., p. 259.
[212] OSMAN, Gusine Gawdat, L’Afrique dans l’univers poétique de Léopold Sédar Senghor, Dakar-Abidjan-Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1978, p. 21. 22 OSMAN, op. cit., p. 22.
[213] SENGHOR, Léopold Sédar,‘’Psychologie du négro-africain ou conscience et connaissance’’ in Philosophie africaine, tome I, Kinshasa, Presses universitaires du Zaïre, 1975, p. 37.
[214] JIMENEZ, Marc, op. cit., p. 350.
[215] DUFRENNE, Mikel, La poétique, Paris, Puf, 1963, p. 34.
[216] DUFRENNE, Mikel, op. cit., p. 36.
[217] DUFRENNE, Mikel, op. cit., p. 70.
[218] DUFRENNE, Mikel, op. cit., pp. 73-74.
[219] ALAIN, Emile Chartier dit, Propos sur l’esthétique, Paris, Puf, 1948, p.10
[220] SENGHOR, Léopold Sédar, Liberté I. Négritude et humanisme, Paris, Seuil, 1964, p. 71.
[221] MERLEAU-PONTY, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1945, p. 171.
[222] ADORNO, Theodor Wisengrund, Autour de la théorie esthétique , paralipomena, introduction première ,Paris, Klincksieck, 1976, , traduit de l’allemand par MARC JIMENEZ & ELIANE KAUFHOLZ , pp.15-16.
[223] ADORNO, Theodor Wiesengrund, op. cit., p. 20.
[224] ADORNO, Theodor Wiesengrund, op. cit., pp. 92-93.
[225] BIDIMA, Jean-Godfroy, La philosophie négro-africaine, Paris, P.U.F, 1995, p. 60.
[226] BIDIMA, Jean-Godfroy, Ibidem.
[227] BIDIMA, Jean-Godfroy, op. cit., p. 64.
[228] ADORNO, Theodor Wiesengrund, Autour de la théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1976, traduit de l’allemand par MARC JIMENEZ & ELIANE KAUFHOLZ p. 53.
[229] Une première version de ce texte a été présentée à l’occasion des 24èmes journées du développement de l’Association Tiers Monde, 20, 21 et 22 mai 2008 à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.
[230] Est-il besoin de le rappeler, l’ouvrage d’Aristote s’intitulait peri psukhê : autour de l’âme. 3Cette anatomie et cette physiologie de l’âme humaine furent fort magistralement initiées par Aristote (384 à 322 av. J.-C., dans la pensée européenne-occidentale.
[231] Le Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie d’André Lalande donne à lire au mot théorique des passages instructifs parmi lesquels on peut retenir : A. Dans la classification aristotélicienne des sciences (…), la mathématique, la physique, la théologie sont des sciences théorétiques par opposition aux sciences poétiques et pratiques ; l’intellect théorétique s’oppose à l’intellect pratique … ;la vie théorétique à la vie politique et à la vie voluptueuse ;…l’ένέργεία la plus haute, celle qui s’exerce selon notre fonction propre et essentielle, c’est l’activité théorétique, ou pure contemplation par l’intellect…B. Dans le langage moderne, théorétique se dit surtout, au sens épistémologique, des points de vue ou des doctrines qui ont pour objet la théorie (et non la pratique). « Le théorétique se rapporte à la théorie, le théorique fait partie de la théorie. »(Goblot…)
En outre, précise le Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, théorique s’emploie très fréquemment en un sens péjoratif (qui n’est jamais donné à théorétique) pour qualifier soit ce qui n’est qu’une spéculation sans application possible, un plan irréalisable ou du moins encoure loin d’être réalisé, – soit une règle qu’on reconnait verbalement, mais qui n’est pas appliquée. Cf. LALANDE, André, op. cit. p. 1127.
[232] Cf. LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., « En deçà de l’idéologie du développement et du culte de la culture », article cité.
[233] Le monème cha a beau n’avoir aucun sens propre ; il n’en va pas de même du mot chat ou du mot cha-cha-cha !
[234] C’est ainsi que théorétique est à la fois « rapprochable » et opposable à théorique comme cela peut se voir à la lecture de la note infrapaginale n°5 ci-dessus. 8Ainsi, logique est tantôt adjectif, tantôt substantif.
[235] Lorsque théorétique est rapproché de théorique, il peut alors désigner la contemplation pure.
[236] La poésie, de toute évidence, sait mettre ce manque de rigueur et de transparence à profit pour nous procurer du plaisir ; le plaisir poétique, justement.
[237] Fin annoncée et fin ultime sont ainsi dans le prolongement l’une de l’autre ; mais bien souvent, l’une peut voiler ou même cacher l’autre plus ou moins radicalement, plus ou moins intentionnellement.
[238] Le dictionnaire Littré donne à lire : « Unité parfaite qui, selon les pythagoriciens, renferme l’esprit et la matière sans aucune division. La monade de Pythagore c’est Dieu lui-même » ou encore : « D’après Leibnitz, éléments des choses, ou substances simples, incorruptibles, nées avec la création, différentes de qualités, inaccessibles à toute influence du dehors, mais sujettes à des changements internes qui ont pour principe l’appétition et pour résultat la perception. Parmi les monades créées, il en est dans lesquelles la perception est plus distincte et accompagnée de conscience : ce sont les âmes proprement dites. Il croyait qu’il y a partout des substances simples qu’il appelait monades ou unités, qui sont les vies, les âmes, les esprits qui peuvent dire moi… »
[239] Cette fermeture sur soi et cette ouverture à d’autres que soi font de la monade telle que je la conçois ici une véritable structure, au sens piagétien du terme.
[240] Dans le sujet individuel qui est un sujet psychologique se trouve et/ou réside le sujet connaissant qui de ce fait est le sujet épistémique individuel. Mais il faut distinguer le sujet épistémique tout court (ou sujet épistémique en général) qui est nécessairement un sujet collectif constamment construit et maintenu en exercice par la coopération et la coaction de plusieurs sujets épistémiques individuels disséminés dans l’espace et dans le temps. 15Pour cette activité cognitive individuelle, le corps individuel peut être situé au niveau de l’infrastructure ; l’intelligence et ses principaux instruments – dont la langue – sont au niveau de la méso-structure ; tandis que la logique et la raison en général sont au niveau de la superstructure.
[241] Le logico-mathématique pour être plus précis.
[242] Pour saisir le recours à l’image de la sphère ici, on peut lire ces propos : « Il ne découle pas de ce que ces trois réseaux comportent trois points que nous ayons neuf termes impliqués dans la relation globale envisagée ici. Ces termes sont en vérité au nombre de sept, étant donné que le dernier de chaque triade est le premier de la triade suivante. Mais ces sept points seraient disposés de manière encore plus suggestive si les trois triangles contigus qu’ils forment étaient placés (dans l’imagination) sur la voûte d’une sphère dont le sujet connaissant occuperait le centre. La globalité du phénomène ainsi suggéré acquiert la complexité qui le caractérise à la fois dans sa structure organique et dans l’organisation que lui impose le devenir ou le temps, si l’on prend conscience que le sujet connaissant dont il s’agit n’est pas un homme en tant qu’individu isolé, mais plutôt l’homme en tant que ce dernier se réalise à travers des individus toujours engagés dans des groupes humains aux frontières plus ou moins étendues. C’est donc l’homme en tant qu’humanité, ou l’humanité en tant qu’homme. » Cf. LALÈYÊ, Issiaka-Pierre, « La restitution phénoménologique. Portée méthodologique pour une pensée africaine efficace » dans Problèmes de méthodes en philosophie et sciences humaines en Afrique, Actes de la 7ème Semaine Philosophique de Kinshasa (du 24 au 30 avril 1983).Recherches Philosophiques Africaines n°9, Faculté de Théologie Catholique de Kinshasa, édit., 1986, pp. 23-35.
[243] Les instituts divers, les universités, les académies et leurs journaux et revues scientifiques constituent l’infrastructure grâce à laquelle est assuré ce minimum d’organisation indispensable pour que le sujet épistémique existe et fonctionne comme producteur de connaissances et de sciences.
[244] Ces deux pensées ne sont pas seulement liées et donc indissociables l’une de l’autre ; elles nous enferment aussi, hélas, mais non point irrémédiablement, dans un monde phénoménal que le génie d’Emmanuel Kant aura eu le mérite de soupçonner et de signaler à l’attention de tout sujet connaissant, en attendant qu’il nous soit possible d’en poursuivre l’exploration. Monde phénoménal dont l’idée va de pair avec celle d’un monde nouménal.
[245] Ce qui est dit de ces deux mouvements (centrifuge et centripète) n’est pas sans rappeler ce que Jean Piaget a dit des deux mouvements essentiels pour tout sujet connaissant que sont l’accommodation et l’assimilation.
[246] Cf. LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., « Le même et l’autre de l’homme. Le savoir aux prises avec la différence », in Philosophies africaines : traversées des expériences, Revue Rue Descartes n°36, Collège International de Philosophie, Juin 2002, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 75-91.
[247] Intension est ici synonyme de compréhension.
[248] Cf. LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., « Humanismes et idéologies du développement. La contemporanéité à l’épreuve de l’essentiel humain », article cité.
[249] En de nombreux endroits en Afrique, plusieurs de ces instances d’éducation se sont refermées sur elles-mêmes, devenant ainsi des sociétés plus ou moins secrètes afin de pouvoir continuer à mener leurs tâches de formation de l’homme – et des hommes – à l’abri des regards indiscrets.
[250] C’est le cas de forgerons, des chasseurs, des devins ou des thérapeutes très souvent – et traditionnellement – organisés en des corporations au sein desquelles prévaut une hiérarchie parfois minutieuse.
[251] Dans plusieurs pays d’Afrique, c’est souvent par les grèves elles-mêmes ponctuées et sous-tendues par des actions plus ou moins violentes que l’école africaine prend sa part au débat social et tient à faire entendre sa voix sur plusieurs questions d’intérêt national et international.
[252] Dans l’opinion publique (nationale comme internationale), l’on semble avoir choisi de parler de la pauvreté ; il faut encore chercher à connaitre les raisons de ce choix. Mais audelà et en deçà de la pauvreté, la souffrance de l’Afrique est plus profonde ; cela aussi devrait être élucidé.
[253] Cf. LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., « En deçà de l’idéologie du développement et du culte de la culture », article cité.
[254] L’adoption toute récente par la plupart de nos universités du système dit du LMD illustre à merveille cette volonté de l’école africaine de s’ouvrir au monde et de se hisser au diapason de tous les autres pays et parties du monde actuel.
[255] Cf. LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., « Le même et l’autre de l’homme. Le savoir aux prises avec la différence » in Philosophies africaines : traversées des expériences, Revue Rue Descartes n°36, Collège International de Philosophie, Juin 2002, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 75-91.
[256] Cf. LALÈYÊ, Issiaka-Prosper L., «Transdisciplinarité et développement endogène», article cité.
[257] TAYLOR, Charles, Hegel et la société moderne, Paris, Cerf, 1998, trad. Pierre R.
DESROSIERS, p. 7.
[258] PHILIPPE, Marie-Dominique, Introduction à la philosophie d’Aristote, Paris, Éditions Universitaires, 1994, p. 80.
[259] VERGNIERES, Solange, Éthique et Politique chez Aristote, Paris, P.U.F, 1995, p. 225.
[260] Idem, pp. 225–226.
[261] Souligné dans le texte.
[262] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, La raison dans l’Histoire, Paris, U.G.E., 1993, Trad. Kostas PAPAIOANNOU, p. 110.
[263] LABARRIÈRE, Pierre-Jean, Dimensions pour l’homme, Paris, Desclée, 1975, p. 53.
[264] Idem, p. 60.
[265] Souligné dans le texte.
[266] LABARRIÈRE, Pierre-Jean, op. cit., p. 67.
[267] Idem, p. 157.
[268] MARCUSE, Herbert, L’homme unidimensionnel, trad. Monique WITTIG, Paris, Ed. de Minuit, 1970, p. 63.
[269] RICOEUR, P., « Civilisation universelle et cultures nationales » in Revue Esprit, Octobre 1961 : De l’assistance à la solidarité.
[270] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., p. 117.
[271] LABARRIERE, Pierre-Jean, op. cit., p. 60. (Les guillemets figures dans le texte).
[272] HUSSERL, Edmund, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, Paris, Aubier, 1987, trad. Paul RICOEUR, pp. 14-15.
[273] LABARRIERE, Pierre-Jean, op. cit, p. 67. 18 Idem, p. 158.
[274] VERGNIERES, Solange, Éthique et Politique chez Aristote, Paris, P.U.F, 1995, p. 226. 21 MAGNETTE, Paul, La citoyenneté, une histoire de l’idée de participation civique, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 20.
[275] LABARRIERE, Pierre-Jean, op. cit., p. 105.
[276] Idem, p. 17.
[277] GALLI, M., « De l’éducation en vue de la citoyenneté de demain dans le contexte africain » in Le Cahier philosophique d’Afrique, Ouagadougou, Presses Universitaires de Ouagadougou, 1er numéro spécial : “Philosophie et engagement en Afrique”, 2004, p. 80.
[278] BAYART, Jean-François, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, p. 342.
[279] Idem, p. 212.
[280] ZIEGLER, Jean, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Paris, Fayard, 2002, p. 181.
[281] Idem, p. 249.
[282] MISRASHI, Robert, Existence et démocratie, Paris, P.U.F, 1995, p. 66.
[283] WEIL, Eric, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1996, p. 244.
[284] ZIEGLER, Jean, op cit, p. 223.
[285] Souligné dans le texte.
[286] LABARRIERE, Pierre-Jean, op. cit., p. 159.
[287] VOLPI, Franco, « le paradigme perdu : L’éthique contemporaine face à la technique », in HOTTOIS, Gilbert, (dir.), Aux fondements d’une éthique contemporaine. H. Jonas et H.T. Engelhardt, Paris, Vrin, 1993, chap.VII, p.164. 2 Idem.
[288] VOLPI, Franco, « le paradigme perdu : L’éthique contemporaine face à la technique », in HOTTOIS, Gilbert, (dir.), Aux fondements d’une éthique contemporaine. H. Jonas et H.T.
Engelhardt, Paris, Vrin, 1993, chap.VII, p. 165.
[289] HABERMAS, Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », Paris, éd. Gallimard, 1973, trad. Par Jean-René Ladmiral, p. 33.
[290] HABERMAS, Jürgen, Morale et communication. Conscience morale et activité communicationnelle, Paris, éd. Flammarion, 2001, trad. par C. Bouchindhomme, p. 84. 6 APEL, Karl-Otto, Discussion et responsabilité, Tome 1.L’éthique après Kant, Paris, éd. du Cerf, 1996, trad. par C. Bouchindhomme et deux autres, p.18.
[291] Idem.
[292] Voir la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23-11-2001.
[293] YAGIL, Limore, Internet et les droits de la personne. Nouveaux enjeux éthiques à l’âge de la mondialisation, Paris, Les éditions du Cerf, 2006.
[294] Bien entendu, cette autonomisation doit être relativisée en raison des liens très étroits qui relient la technoscience à l’économie et à la politique ; la technoscience subit dans son développement les impératifs de l’économique.
[295] YAGIL, Limore, Internet et les droits de la personne. Nouveaux enjeux éthiques à l’âge de la mondialisation, Paris, Les éditions du Cerf, 2006, p.51.
[296] Les observations par lesquelles Heidegger distingue la technique traditionnelle de la technique moderne sont dignes d’intérêt. Voir HEIDEGGER, Martin, « La question de la technique », in Essais et conférences, Paris, éd. Gallimard, 1958, trad. par André Préau.
[297] HABERMAS, Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », Paris, éd. Gallimard, 1973, trad. Par Jean-René Ladmiral, p. 55.
[298] YAGIL, Limore, Internet et les droits de la personne. Nouveaux enjeux éthiques à l’âge de la mondialisation, Paris, Les éditions du Cerf, 2006, p.19.
[299] KANT, Emmanuel, Métaphysique des mœurs II. Doctrine du droit. Doctrine de la vertu, Paris, Flammarion, 1994, trad. par Alain Renaut, p. 9.
[300] APEL, Karl-Otto, Éthique de la discussion, Paris, Les éditions du Cerf, 1994, trad. par Mark Hunyadi, p. 23. 17Idem, p. 37.
[301] HUSSERL, Edmund, Méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, Paris, éd. Vrin, 2001, trad. par Gabrielle Peiffer et E. Levinas, pp. 18-19.
[302] APEL, Karl-Otto, Éthique de la discussion, Paris, Les éditions du Cerf, 1994, trad. par Mark Hunyadi, p. 37.
[303] Pour APEL, il existe une norme éthique fondamentale que toute personne argumentant sérieusement doit reconnaître et qui fonde la communauté idéale de communication. Pour la justification d’une telle thèse, voir le texte ‘’La situation de l’homme comme problème éthique’’, in Discussion et responsabilité, t.1, L’éthique après Kant, pp. 18-20.
[304] APEL élucide le sens de ces normes de la manière suivante : « la norme fondamentale de justice, c’est-à-dire du droit égal de tous les partenaires de discussion possibles à employer tous les actes de langage propres à articuler des prétentions de validité susceptibles, le cas échéant, de consensus ; j’ajoute la norme fondamentale de solidarité entre tous les membres, et au-delà : de tous les membres potentiels de la communauté d’argumentation actuelle, en principe illimitée, étant donné que dans le cadre de l’entreprise commune de la résolution argumentative de problèmes, ils sont liés et renvoyés l’un à l’autre ; et, enfin, la norme fondamentale de coresponsabilité de tous les partenaires de discussion dans l’effort solidaire visant à articuler et à résoudre des problèmes ». Idem, p. 42.
[305] Idem, p. 53.
[306] APEL, Karl-Otto, Discussion et responsabilité, Tome 1.L’éthique après Kant, Paris, Les éditions du Cerf, 1996, trad. par C. Bouchindhomme et deux autres, pp. 30-31.
[307] HABERMAS, Jürgen, Morale et communication. Conscience morale et activité communicationnelle, Paris, éd. Flammarion, 2001, trad. par C. Bouchindhomme, p. 78.
[308] Idem, p. 32.
[309] WEBER, Max, Le Savant et le Politique, « 10/18 », 1963, trad. Freund.
[310] APEL indique qu’il n’est pas toujours évident de distinguer « la rationalité propre à la communication consensuelle et la rationalité stratégique instrumentale ». L’impératif qui commande d’agir toujours comme si l’on était membre d’une communauté idéale de communication peut bien être mis en œuvre par exemple par une mafia s’intéressant au trafic de stupéfiants : elle peut opter dans une situation problématique de recourir à une finalité supérieure commune. Mais souligne l’auteur cette démarche ne peut pas être pertinent sur le plan éthique
[311] APEL, Karl-Otto, Discussion et responsabilité, Tome 1.L’éthique après Kant, Paris, éd. du Cerf, 1996, trad. par C. Bouchindhomme et deux autres, pp. 30-31.
[312] En soi, l’anonymat n’est pas nécessairement un désastre moral à première vue. Il garantit d’une certaine façon l’égalité et la liberté de ceux qui échangent sur le net par la possibilité de la dissimulation des différences raciales, ethniques, sociales, économiques, sexuelles…Sur Internet disparaît, d’une certaine façon, la peur et les complexes liés à sa
[313] PIERRON, Jean-Philippe, Penser le développement durable, Paris,
Éditions Ellipses, 2009, p.24
[314] Voir les dix commandements de l’éthique informatique publiés par le Computer Ethics
Institute sur le site http://www.cpsr.org/program/ethices/cei.html (Consulter le …)
[315] . De l’écrivaine médiévale Christine de Pisan (v.1364-v.1431).
[316] BAKHTINE, Michaël, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978.
[317] JANIN, Stéphanie, « Comment réécrire l’histoire littéraire ? L’exemple du théâtre des suffragettes », in Féminisme et littérature, Vol. 22, n° 2, Liège, PUL, 2003.
[318] COLETTE, DE NOAILLES, Anna, DURAS, Marguerite et WEILL, Simone sont, entre autres écrivaines de la littérature française du début du XXe siècle, quatre illustres figures qui ont contribué à affirmer les droits de la femme.
[319] Les genres seraient implicitement construits comme « féminins » ou « masculins », dualité qu’il est en réalité difficile de dépasser.
[320] Avec Le Deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949, elle avance l’idée qu’« on ne naît pas femme, on le devient ».
[321] Ils sont respectivement auteurs de Sex, Gender and Society, London, Gower, 1985, de L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de sexe / genre (1975) trad. de l’anglais par MATHIEU Nicole-Claude, avec la collaboration de PHETERSON Gail, Paris, Presses de l’Université Paris 7 – Denis Diderot, coll. «Cahiers du CEDREF», n° 7,
[322] BOICLAIR, I. & LORI, S.-M., op. cit., p. 11.
[323] . PROKHORIS, Stéphane, Le sexe prescrit. La différence sexuelle en question, Paris, Aubier, 2000.
[324] Période correspondant à l’Antiquité, mais dont la perception n’intègre pas l’idée d’une culture archaïque et dérisoire ; bien au contraire.
[325] La langue romane, qui naît au VIIIe siècle, nourrit l’ancien français qui s’affirme vers la fin du XIIIe siècle en se détachant de l’influence latine constituée par le cas sujet et le cas régime des compléments.
[326] Connu en littérature sous le nom de Rutebeuf (1230-1285).
[327] Marie de France (1160-1190). Elle mêle évocations de légendes arthuriennes et aventures amoureuses, dans une écriture d’autant plus importante qu’elle affirme la personnalité d’une femme dans un univers masculin.
[328] Christine de Pisan (v. 1364-v.1431), écrivaine et poétesse française d’origine bolognaise. Il sera question d’elle et de sa perspective d’écriture « féministe » tout au long de cette étude.
[329] Cette période se situe avec et après l’avènement du XIe siècle.
[330] Voir La querelle du Roman de la Rose : Epistre au Dieu d’Amours (1399) et surtout, sa défense des femmes dans les Lettres du Débat sur le roman de la Rose (1401-1402).
[331] Le machisme est unanimement perçu comme la vision selon laquelle l’homme doit socialement dominer la femme et faire primer de supposées vertus viriles. Mais alors que dans son expression antique grecque et romaine, il a le sens « élevé » de la phallocratie, une attitude tendant à justifier la domination du sexe masculin sur les femmes et à les exclure par exemple de la gestion impériale, au Moyen Age, le machisme apparaît péjorativement comme l’expression d’un mépris, d’un abaissement des femmes.
[332] Entre autres, Le Dit de la Rose (1402), l’Epistre au Dieu d’Amours (1399), La Cité des Dames (1404).
[333] De l’Ancien français « pleure ».
[334] La suprématie, la domination.
[335] La France médiévale est extrêmement féconde en invention de genres ou de formes littéraires comme le Lai, les Audes et Sérénades, les Pastourelles, les Sirventes, les Tensons et, pour le lyrisme du nord, la Chanson de toile ou à danser, les Romances, les Rotruenges, les Rondels ou Rondeaux, les Virelais et les Ballades.
[336] Le lyrisme est l’expression intense de sentiments personnels. Le lyrisme médiéval reste un mode d’expression dans lequel l’émotion est chantée ou, traduite par les moyens d’une expressivité orale dont les poètes errants – Troubadours – sont les chantres.
[337] Ses lais, dont « Le Lai de chèvrefeuille » du recueil Les Lais, XIIe siècle [trad. J.-C. Payen, Ed. Garnier, 1989] relate des aventures amoureuses, sans plus.
[338] Guillaume de Machaut, compositeur emblématique de la période de l’ars nova et auteur de poésies où se mêlent réalité et fiction, allégorie et sentiment personnel – Le Voir, récit d’amour de vieillesse déçu.
[339] Sa terre natale la marque à travers les musiques de danse et le dolce stil nuovo qui est une caractéristique de la culture Bolognaise.
[340] L’exemple du « Dueil angoisseux » et par des compositeurs comme Gilles Binchois. 29 Il n’est plus fréquent d’avoir affaire en ce siècle à des textes de littérature hagiographique.
[341] Ceux-ci sont liés aux déchirements affectifs causés par la mort des êtres aimés. 31 Du « féminisme », selon le mot de C. de Pisan.
[342] Christine de Pisan, Le Livre des Trois Vertus (1405), cité par HICKS, Eric et MOREAU,
Thérèse, in Christine de Pisan, Le Livre des Faits et Bonnes Mœurs du roi Charles V le Sage, Paris, Stock/Moyen Age, 1997, p. 34.
[343] En publiant en 1399, son recueil Épistre au Dieu d’Amours, l’écrivaine Christine de Pisan fustige l’hypocrisie de Jean de Meung, ce poète qui « ose » enseigner à travers ses textes les astuces pour séduire et posséder les femmes, considérées comme de simples objets. Cela n’est pas du goût de Christine.
[344] Le Dit de la Rose (1402), cité par HICKS, Eric et MOREAU, Thérèse, in Christine de Pisan, Le Livre des Faits et Bonnes Mœurs du roi Charles V le Sage, Paris, Stock/Moyen Age, 1997, p. 42.
[345] Dans Le Dittié de Jehanne d’Arc, 1429.
[346] Parmi les thèmes en vogue, celui de l’héroïsme chevaleresque épique des Croisades.
[347] Celle-ci est pratiquement orchestrée par les apologies tolérées de mœurs amoureuses débridées.
[348] Les « Grands Rhétoriqueurs » sont un groupe d’une quarantaine de poètes dont les œuvres ont paru entre 1460 et le début du XVIe siècle. Ils auraient repris les thèmes majeurs de la tradition médiévale et se sont affirmés comme les successeurs d’Eustache Deschamps et de Christine de Pisan.
[349] Comme dans Lettres du Débat sur le Roman de la Rose (1401-1402) et La Cité des Dames (1401-1405). Le Livre des Vertus ou Trésor de la Cité des dames (1405) est le lieu où la poétesse adresse aux femmes ses conseils.
[350] . Après 1431.
[351] . Auteur de La Belle Dame sans mercy, 1424.
[352] . Son texte qui illustre la question est « Le Rondel du Printemps », Poésies de Charles d’Orléans, d’après les manuscrits des Bibliothèques du Roi et de l’Arsenal, J.-Marie Guichard, 1842.
[353] . « Prince, aux dames Parisiennes / De beau parler donnez le pris ; / Quoy qu’on die d’Italiennes, / Il n’est bon bec que de Paris » (v. 25-18).
[354] Comoé Fiédin Elise, Genre, migration et insertion dans le marché du travail urbain en Côte d’Ivoire : vers une double discrimination des femmes migrantes? Lors du XXVe Congrès international de la population de l’UIESP, Paris, 2007, 25 P.
[355] Idem, Relations de genre et migration en Côte d’Ivoire : de la décision de migrer à l’insertion dans le marché du travail, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.) en Démographie, Université de Montréal, Faculté des études supérieures, 2006, 189 ; P.Ouédraogo, D. et Piché, V., l’insertion urbaine à Bamako, Karthala, Paris, 2000, 189 p.
[356] Ibidem.
[357] Kouadio, M., Etude géographique de la mobilité des femmes : le cas des personnels domestiques féminins de la ville d’Abidjan, thèse pour le doctorat unique de Géographie, Juillet 2008, 378 p.
[358] Dussuet Annie, Travail domestique et genre, Université de Nantes – GTM/CNRS – France, 2002, 111 p ; Kouadio, M., Etude géographique de la mobilité des femmes : le cas des personnels domestiques féminins de la ville d’Abidjan, thèse pour le doctorat unique de Géographie, Juillet 2008, 378 p.
[359] DUBRESSON A., 1990 – Villes et industries en Côte d’Ivoire. Paris, Karthala, 843 p. ; YapiDiahou, A (2000), Baraques et pouvoirs dans l’agglomération abidjanaise, Editions l’Harmattan, Paris, 2000, 456 p.
[360] Antoine, Ph. et al, Abidjan « côté cours » : pour comprendre la question de l’habitat, Orstom
Karthala, Paris, 1987, 267 p.; HAERINGER Ph., 2000 – animateur du secteur informel, Karthala, Paris.
[361] Ces enquêtes ont été réalisées sur la période 2002 à 2006, auprès d’un échantillon de 500 PDF correspondant à 500 ménages répartis dans quatre communes d’échantillon des typologies de l’habitat. Il s’agit de Cocody pour l’habitat résidentiel de haut standing, Yopougon pour l’habitat économique des « classes moyennes », Adjamé symbole de l’habitat de cours et Marcory, concentration des différentes typologies établies.
[362] RGP 1975, RGPH 1988 et RGPH 1998.
[363] L`enquête démographique à passages répétés (EPR) réalisée en trois passages entre le mois de mars 1978 et février 1979, et l`enquête réalisée par la société d`Etudes pour le Développement Economique et Social menée en 1978-1979 dans neuf zones rurales, le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté de 2008.
[364] Il s’agit des différentes régions de la Côte d’Ivoire selon le découpage administratif de 2000.
[365] Elles n’ont pas franchi l’étape de la troisième.
[366] Elles n’ont pas pu franchir l’étape de la terminale.
[367] La ville d’Abidjan est depuis 2001 érigé en District, et elle se confond avec le département d’Abidjan. Elle compte sous ce statut treize communes avec l’incorporation de trois communes périphériques.
[368] Kouadio, M., Etude géographique de la mobilité des femmes : le cas des personnels domestiques féminins de la ville d’Abidjan, thèse pour le doctorat unique de Géographie, Juillet 2008, 378 p.
[369] Antoine, Ph. et Herry C, « les populations d’Abidjan dans ses murs », in Cahiers d’Orstom, série Sciences Humaines XIX (4), 1983, 465 p (pp 371-395) ; Vidal, C, Le Pape, M, Pratiques de crise et conditions sociales à Abidjan, 1979-1985, CNRS/ORSTOM, Paris/Abidjan, 1986, 223 p ; Yapi-Diahou, A (2000), Baraques et pouvoirs dans l’agglomération abidjanaise, Editions l’Harmattan, Paris, 2000, 456 p.
[370] Les travailleuses s’associent avec d’autres personnes : des compatriotes, des ressortissants de même région/village ou des collègues domestiques. 18 Antoine, Ph. et Herry C, « les populations d’Abidjan dans ses murs », in Cahiers d’Orstom, série Sciences Humaines XIX (4), 1983, 465 p (pp 371-395).
[371] Yapi-Diahou, A, Baraques et pouvoirs dans l’agglomération abidjanaise, Editions l’Harmattan, Paris, 2000, 456 p.