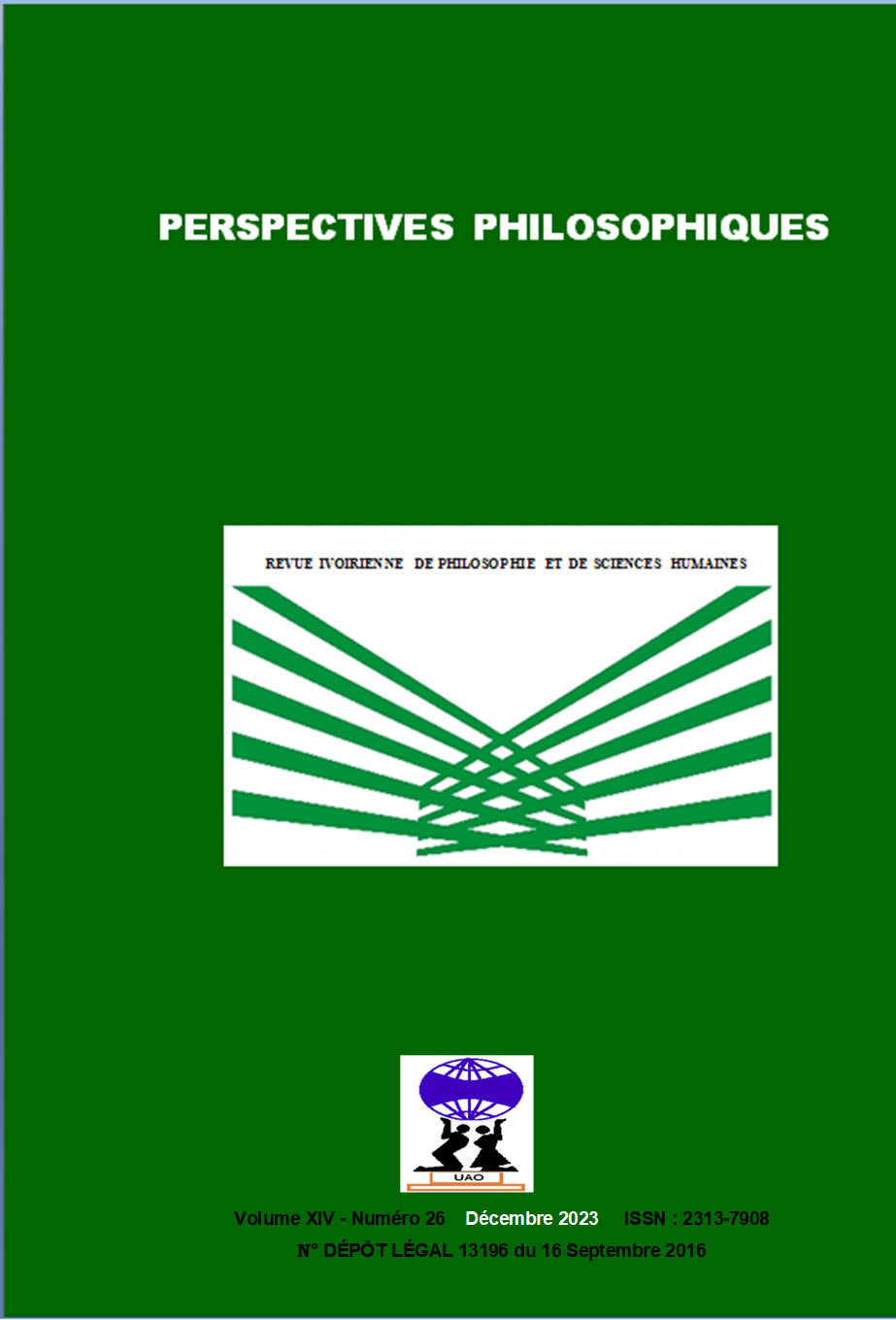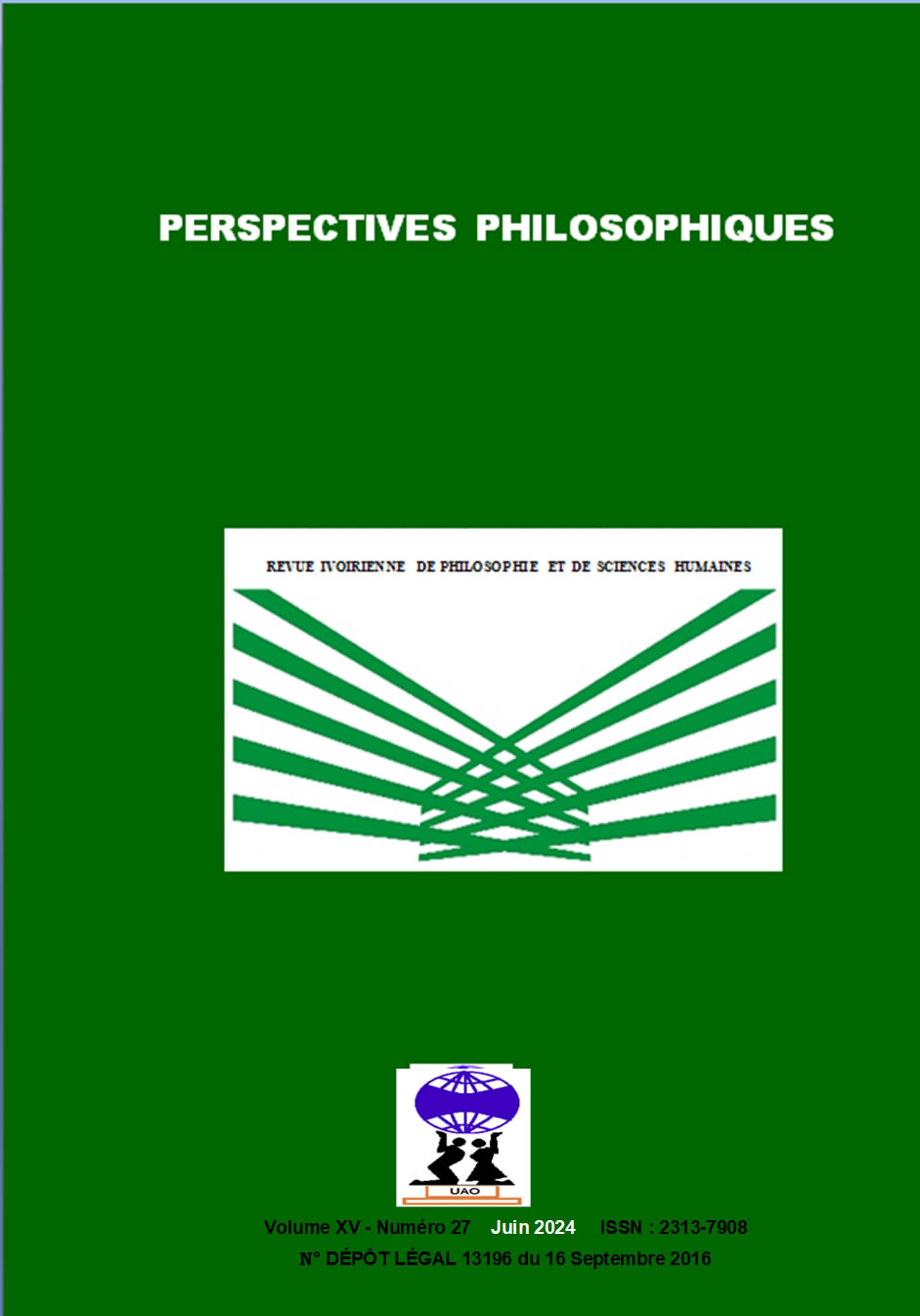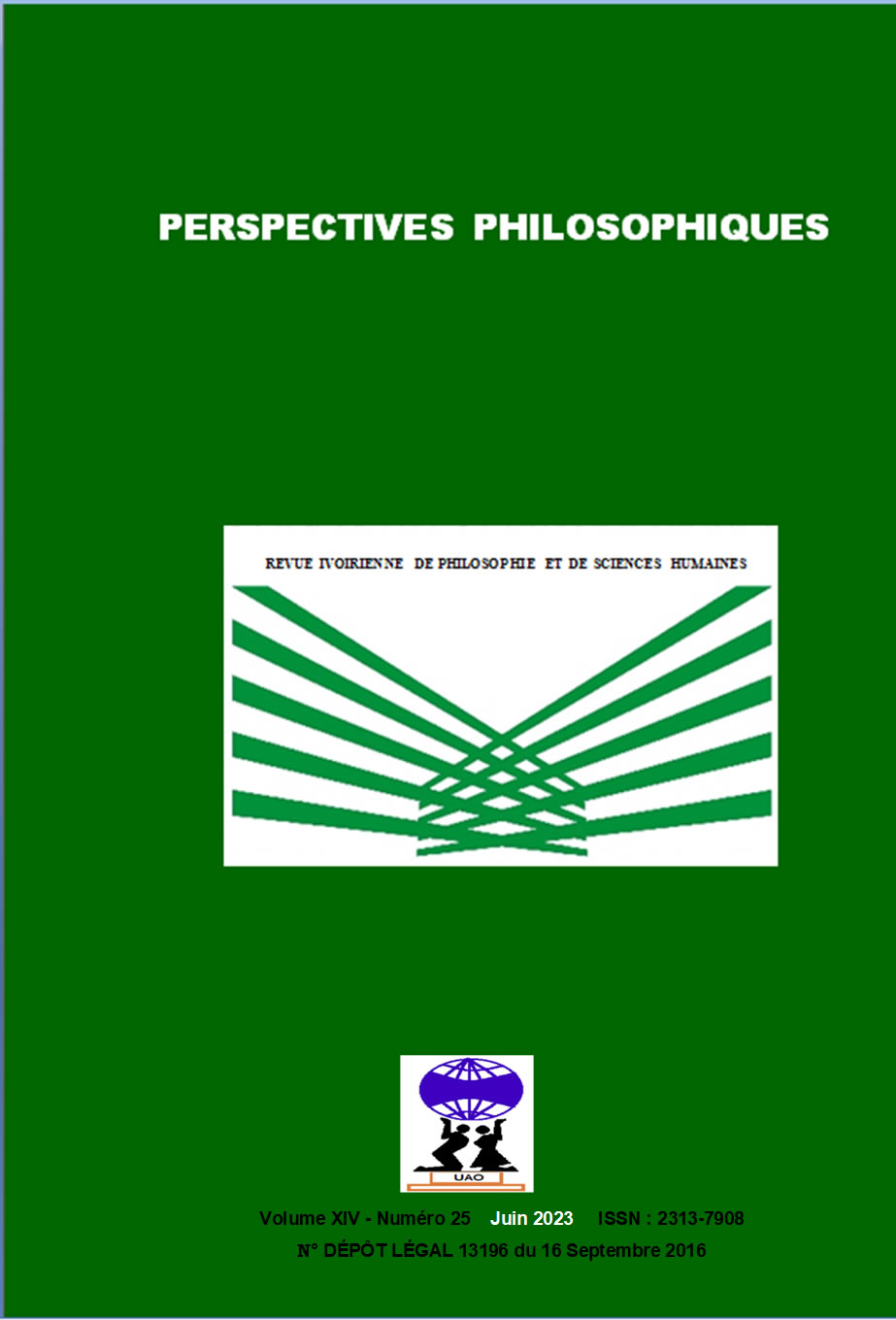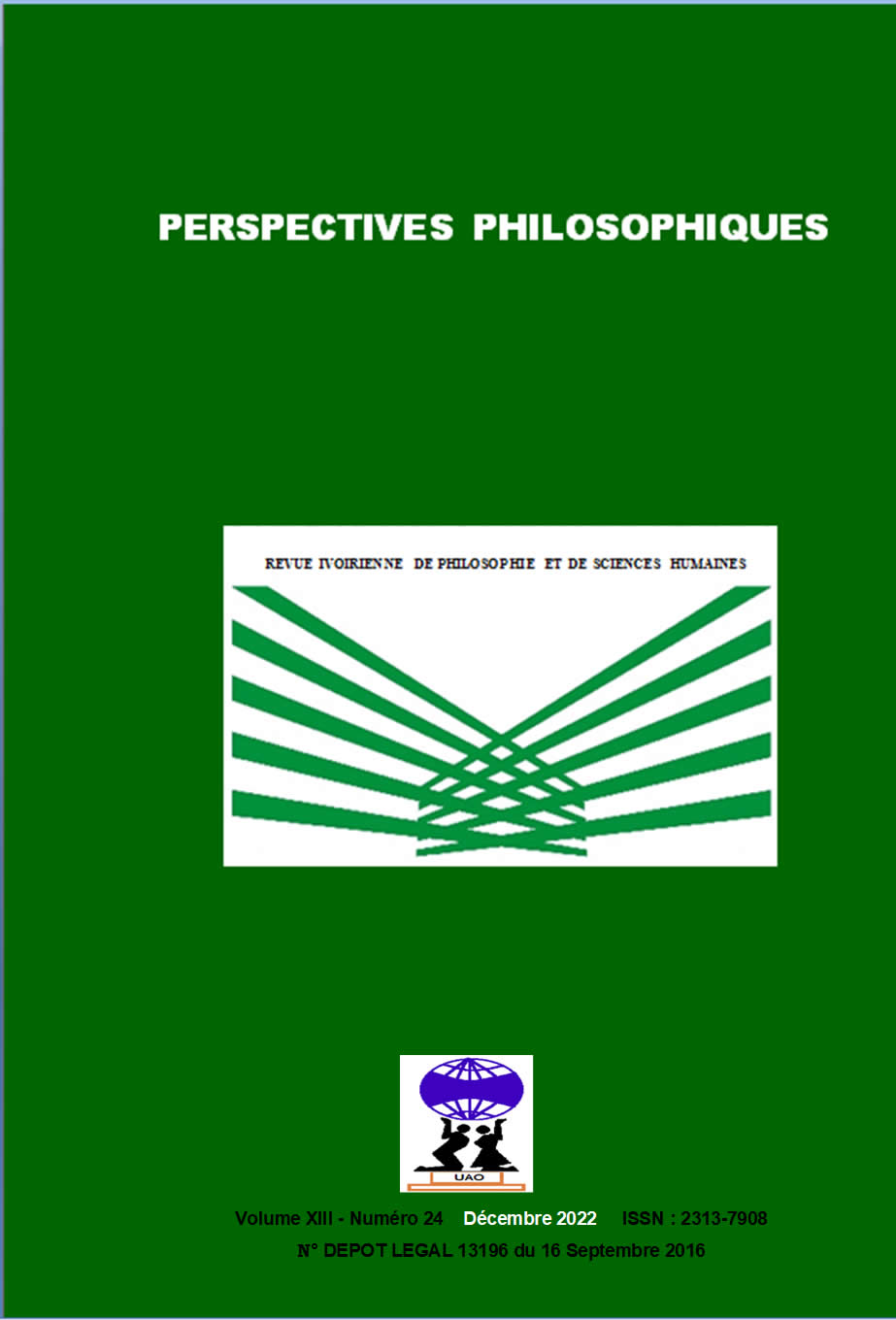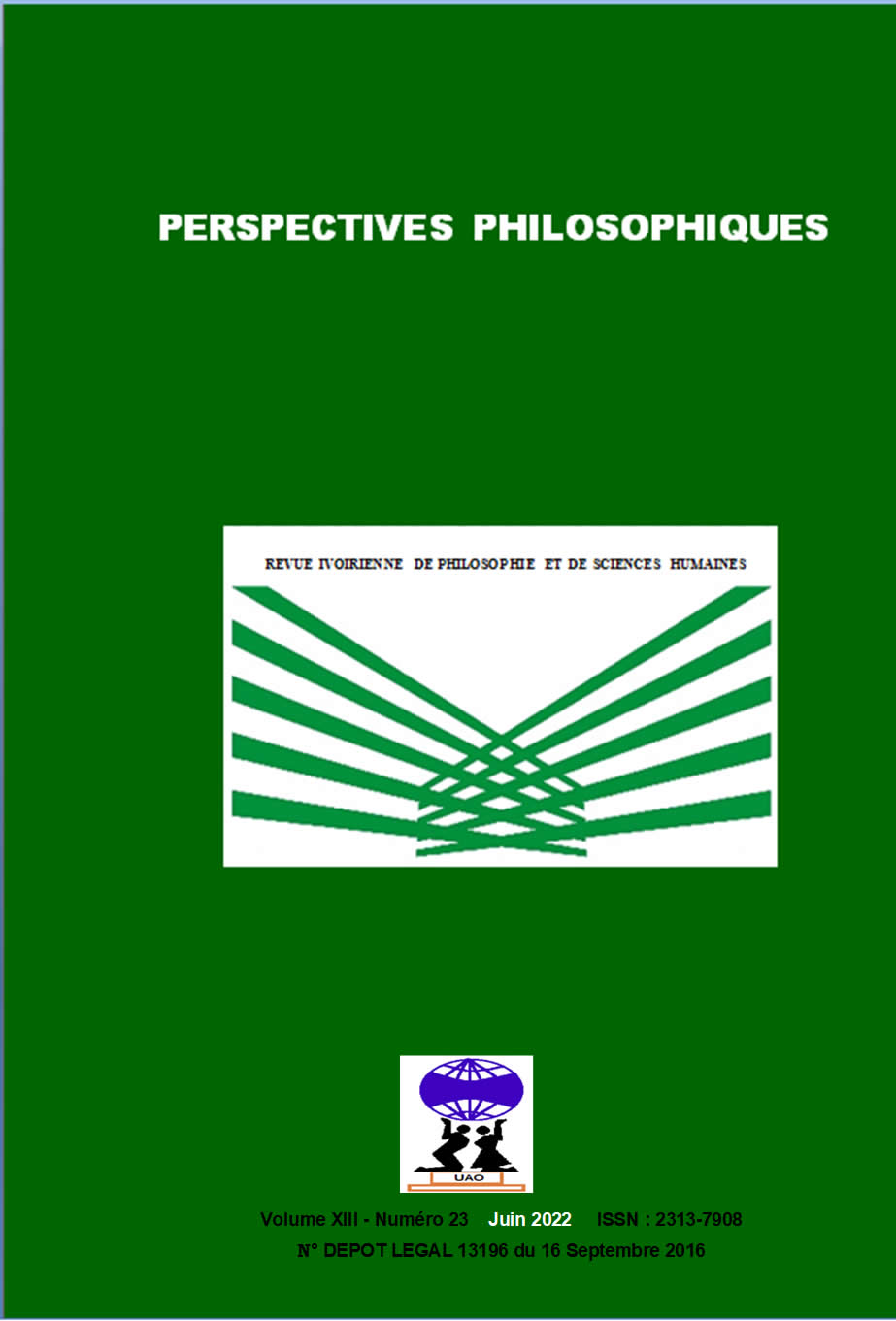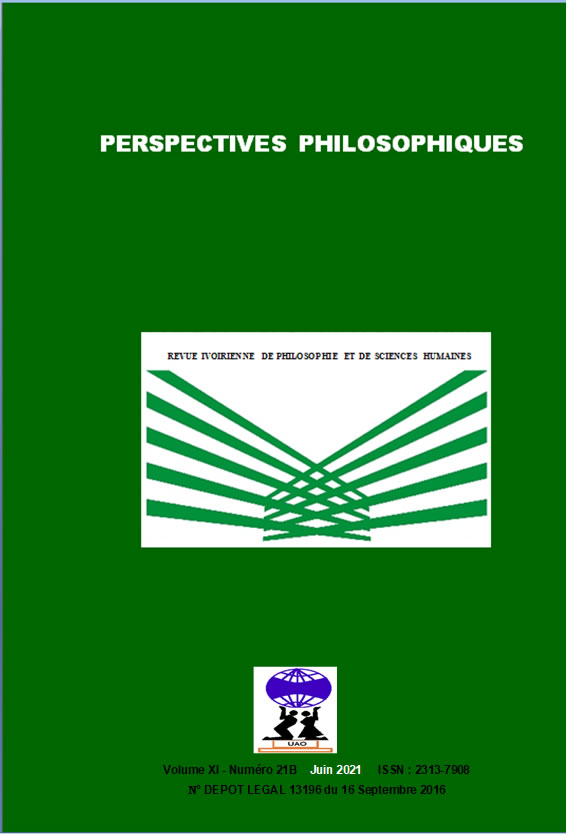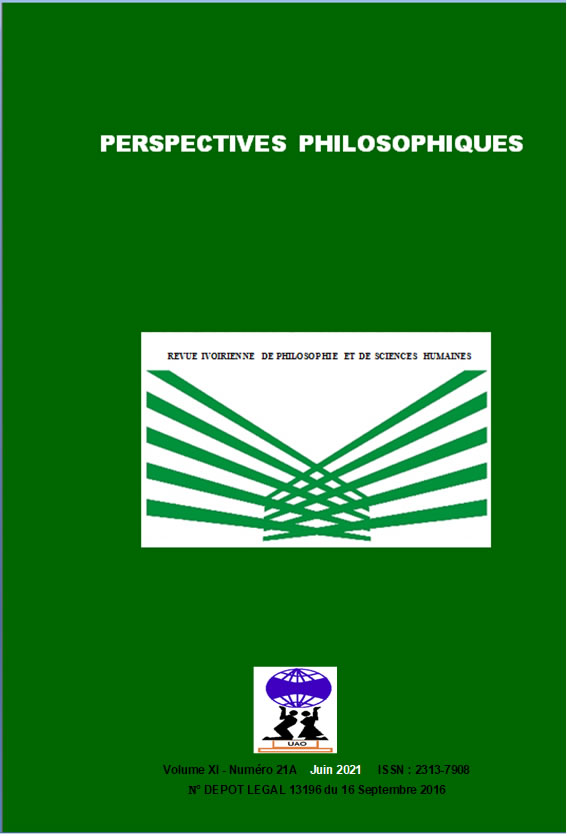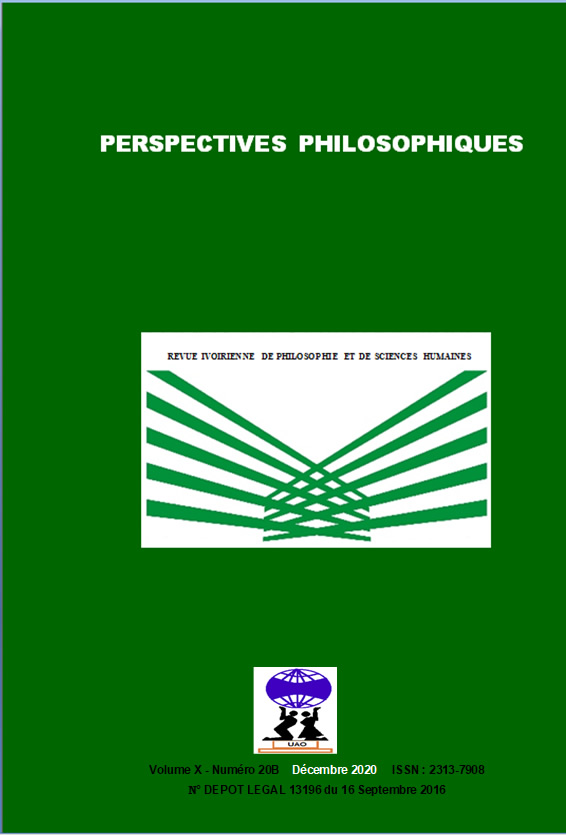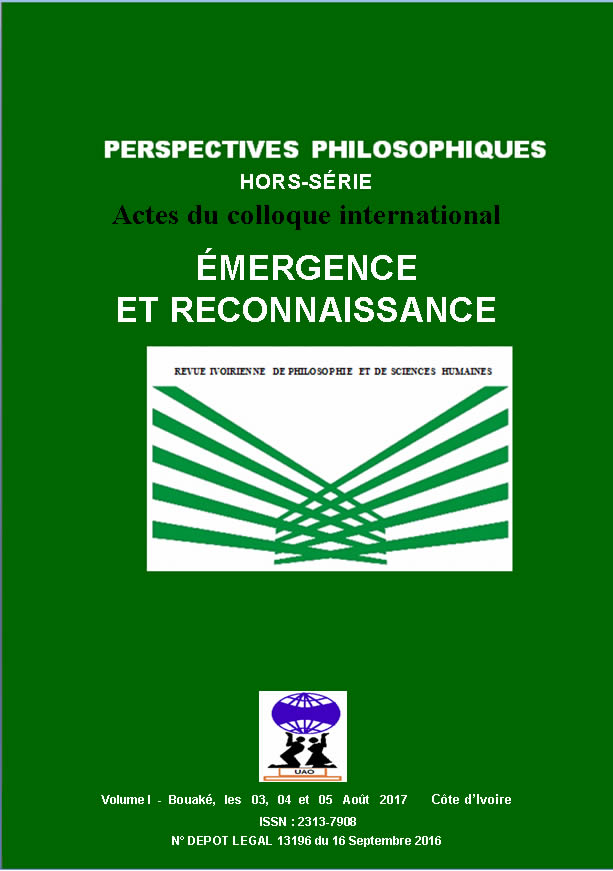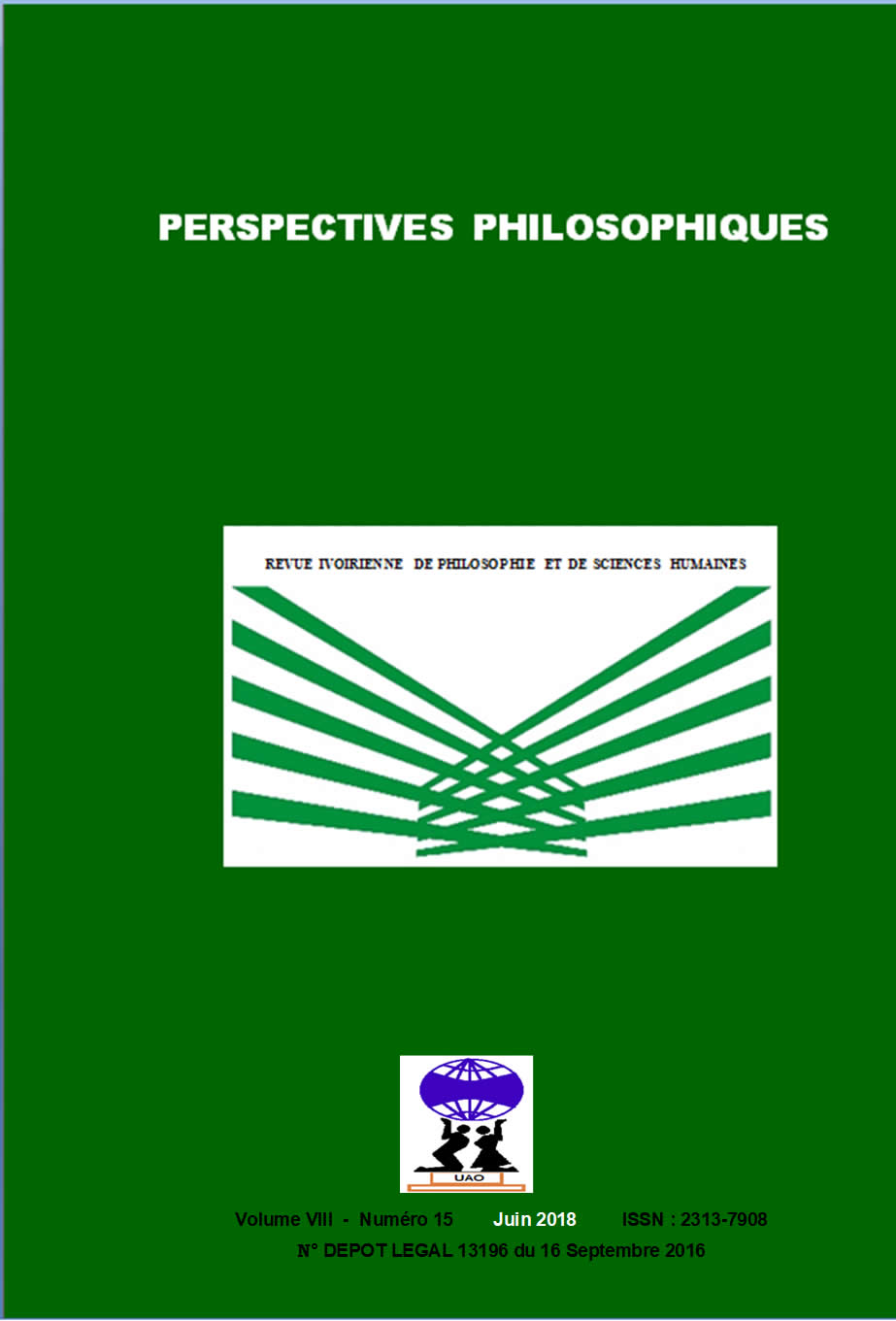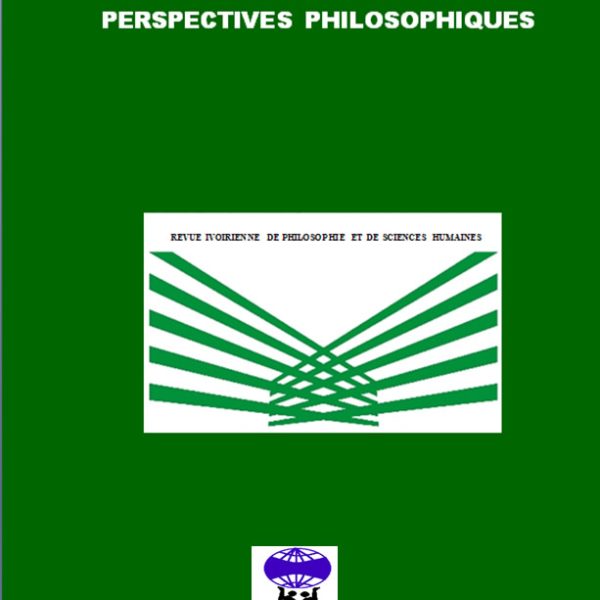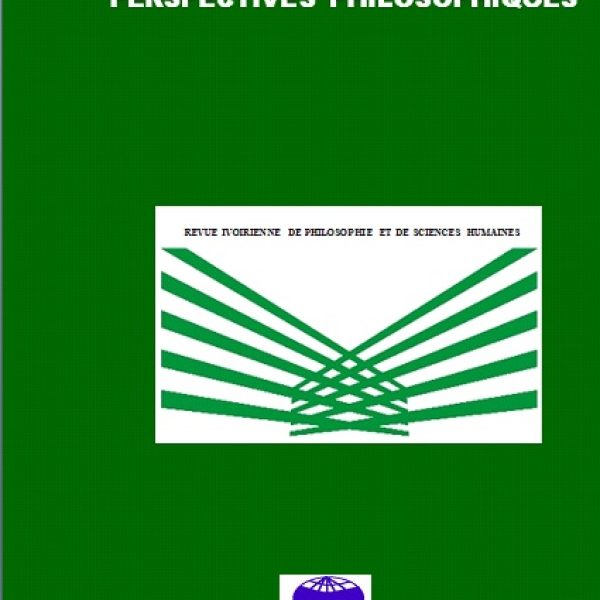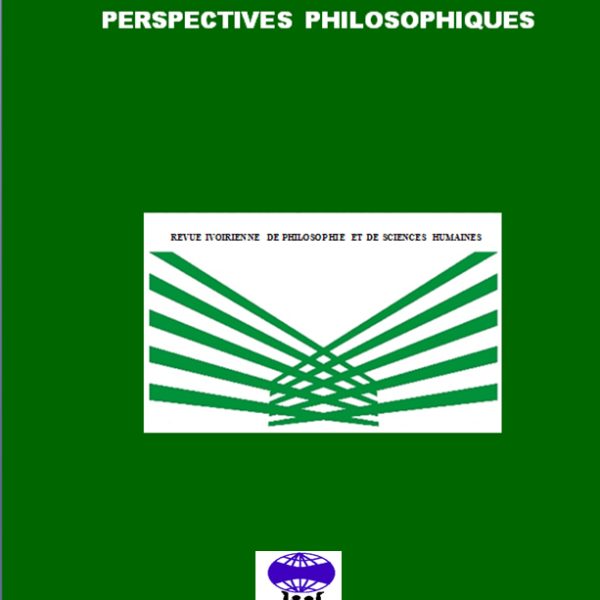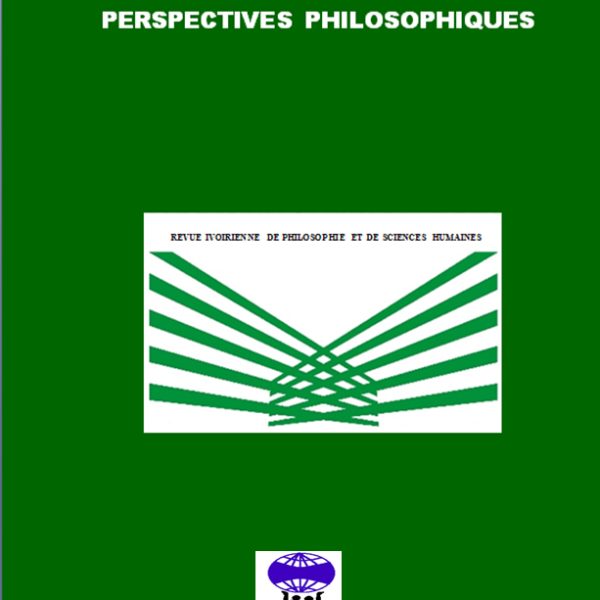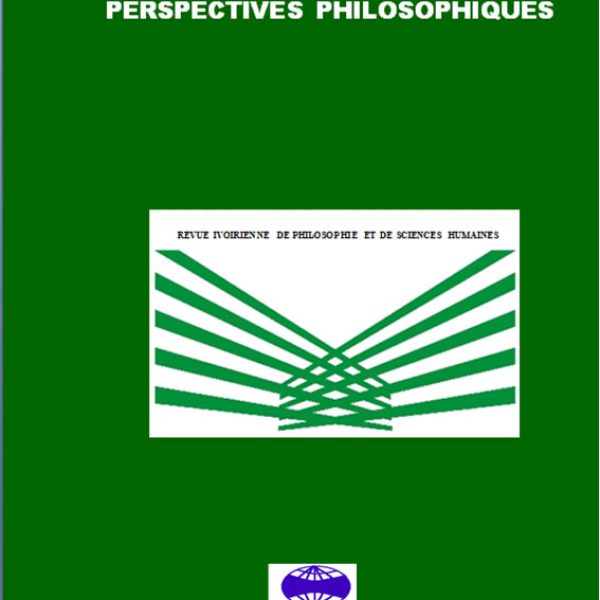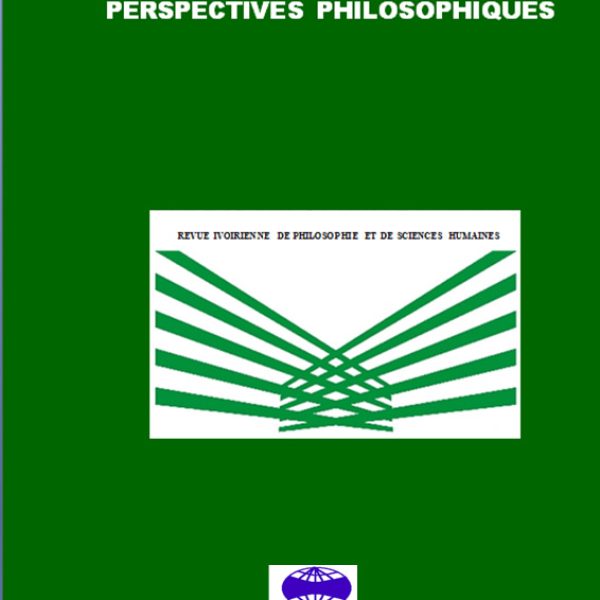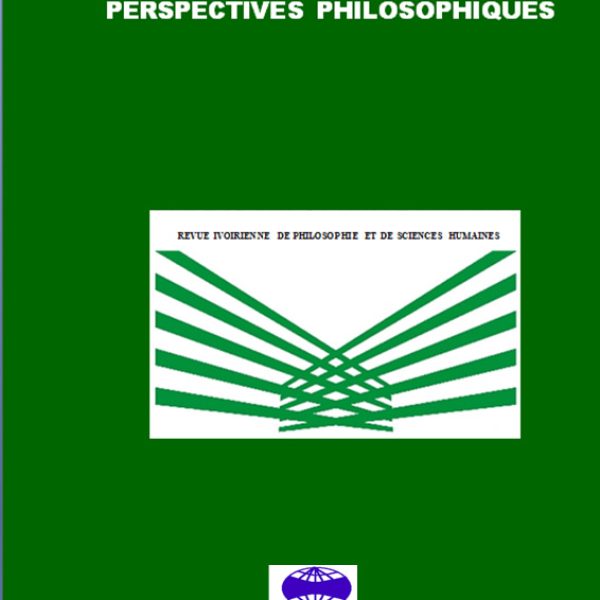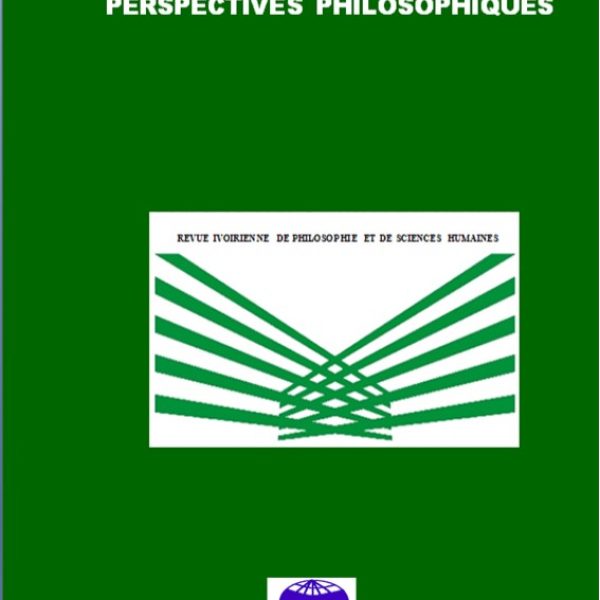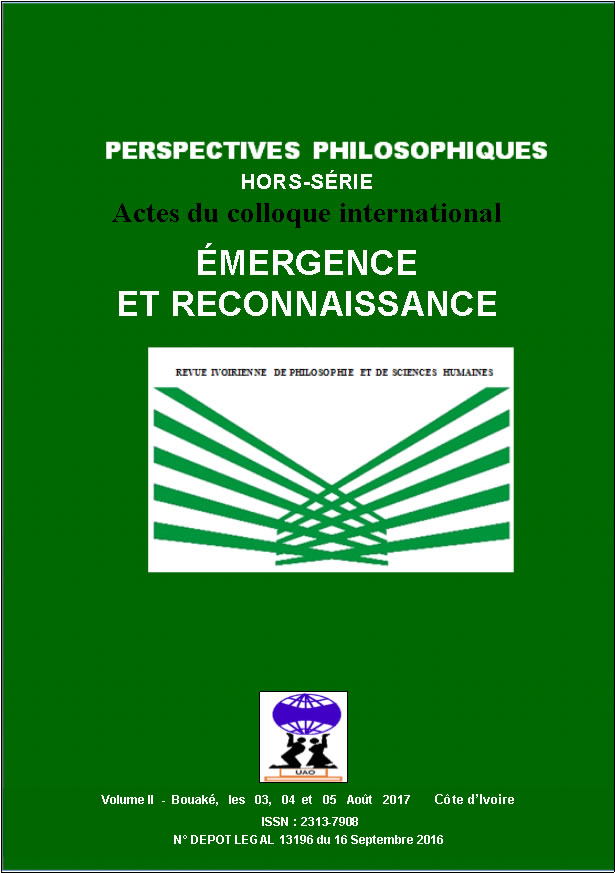
Allocution du Président du Comité d’Organisation ………………………….…… 1 Allocution du Directeur du Département de Philosophie ……………….………… 3 Allocution du Président de l’Université …………………………………………… 7 Allocution du représentant du parrain …………………………………………..… 11 Avant-propos : Argumentaire ……………………………………………………… 13 PLÉNIÈRES ……………………………………………………………………… 15
1. Optimisme et engagement, Mahamadé SAVADOGO ………………………………………………..….. 16
ATELIERS …………………………………………………………….…………… 26
SOUS-THÈME I : ÉTHIQUE, ONTOLOGIE ET ALTÉRITÉ ………………….. 27
3. Le coexister comme un vecteur de l’émergence, Pascal Dieudonné ROY-EMA……………………………………………………28
SOUS-THÈME II : CULTURE ET DÉVELOPPEMENT……………………145
9. L’émergence comme sortie de la minorité, Éric Inespéré KOFFI ……………………………………………………………170
SOUS-THÈME III : GOUVERNANCE ET UTOPIE………………………213
SOUS-THÈME IV : ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ……………………………307
Présentation et Sommaire N°hs2 > Résumés des articles N°hs2
Présentation et Sommaire N°hs2 > Résumés des articles N°hs2
| HORS-SÉRIE Actes du colloque international ÉMERGENCE ET RECONNAISSANCE |
| Volume II – Bouaké, les 03, 04 et 05 Août 2017 Côte d’Ivoire ISSN : 2313-7908 N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : http:// perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Dr. N’dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences
Rédacteur en chef Adjoint : Dr. Assouma BAMBA, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane OUATTARA
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Dr. N’Dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Dr Abou SANGARÉ, Maître de Conférences
Dr Donissongui SORO, Maître de Conférences
Dr Alexis KOFFI KOFFI, Maître-Assistant
Dr Kouma YOUSSOUF, Maître de Conférences
Dr Lucien BIAGNÉ, Maître de Conférences
Dr Nicolas Kolotioloma YEO, Maître-Assistant
Dr Steven BROU, Maître de Conférences
Secrétaire de rédaction : Dr Blé Sylvère KOUAHO, Maître de Conférences
Trésorier : Dr. Grégoire TRAORÉ, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités
SOMMAIRE
Allocution du Président du Comité d’Organisation ………………………….…….1
Allocution du Directeur du Département de Philosophie……………….…………..3
Allocution du Président de l’Université…………………………………………….7
Allocution du représentant du parrain…………………………………………..….11
Avant-propos : Argumentaire……………………………………………………….13
PLÉNIÈRES……………………………………………………………………….15
Optimisme et engagement
Mahamadé SAVADOGO………………………………………………………….16
ATELIERS……………………………………………………………………..…26
SOUS-THÈME I : ÉTHIQUE, ONTOLOGIE ET ALTÉRITÉ……………………27
Le coexister comme un vecteur de l’émergence
Pascal Dieudonné ROY-EMA………………………………………………..……28
Défis culturels de la reconnaissance en Afrique à l’ère de la procréatique
Victorien Kouadio EKPO……………………………………………………….…44
Fondements métaphysiques de l’idée d’émergence : une lecture bergsonienne à partir de la théorie de la durée créatrice
Albert Amani NIANGUI………………………………………………………..…62
Émergence africaine et reconnaissance au prisme de Bergson : entre le possible et le réel
Honoré Kouassi ELLA……………………………………………………….……80
L’altruisme, fondement de l’émergence véritable chez Platon
Fatogoma SILUÉ…………………………………………………………………..98
L’idée d’émergence chez Platon, une ascension vers le bien
Amed Karamoko SANOGO………………………………………………………111
Le désir de reconnaissance au cœur du social: l’éthicité hégélienne en promotion de soi
Kakou Hervé NANOU……………………………………………………………125
SOUS-THÈME II : CULTURE ET DÉVELOPPEMENT……………………145
Le postulat de l’essence critique de la philosophie entre émergence et reconnaissance
Didier NGALEBAYE……………………………………………………………146
L’émergence comme sortie de la minorité
Éric Inespéré KOFFI……………………………………………………….……170
De la réappropriation critique des savoirs endogènes : une théorie de l’émergence
Jackie E. G. Z. DIOMANDÉ ……………………………………………………..187
Reconnaissance et développement chez Kwame Nkrumah
Akpa Akpro Franck Michaël GNAGNE …………………………………………203
SOUS-THÈME III : GOUVERNANCE ET UTOPIE……………………..…213
Société civile et gouvernance de la chose publique chez Spinoza : pour une émergence de la démocratie en Afrique
Assanti Olivier KOUASSI………………………………………………….……214
Démocratie et émergence en Afrique : la reconnaissance de l’idée platonicienne du bien comme creuset paradigmatique des valeurs
N’Goh Thomas KOUASSI…………………………………………………..……234
Émergence et problématique de reconnaissance des droits humains dans les pays en voie de développement
Berni NAMAN…………………………………………………………………..250
La justice sociale platonicienne : pour l’émergence et la reconnaissance des États africains
Nanou Pierre BROU………………………………………………………………266
Réflexion seconde et défi d’émergence de l’Afrique
Moulo Elysée KOUASSI…………………………………………………………284
SOUS-THÈME IV : ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ……………………….……307
La problématique de l’émergence de la femme autour de la philosophie hobbesienne
Amenan Madeleine KOUASSI…………………………………………………..308
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION
————————————–
Mesdames, messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la Presse, chers Étudiants,
Je voudrais, avant tout propos, remercier le Professeur Fie Doh Ludovic, Chef du Département de Philosophie, de l’honneur qu’il nous a fait, à l’ensemble du comité de coordination et à moi-même, de nous avoir confié l’organisation de ce colloque. C’est au nom de cette équipe que j’ai eu plaisir à diriger, et que je remercie, que je prends la parole ce matin pour souhaiter à tous et à chacun la cordiale bienvenue en Côte d’Ivoire et à Bouaké.
Mesdames et messieurs,
Le lieu qui nous accueille pour ces moments de réflexion est l’Université. L’essence de cette école supérieure ne peut parvenir à la puissance qui est la sienne que si, avant tout et toujours, les Départements qui en constituent les poches d’animation sont eux-mêmes dirigés par le caractère inexorable de leur mission : Éveiller et faire briller la lumière. Mais, y a-t-il meilleure manière de faire briller la lumière que d’organiser un colloque qui, comme le mot lui-même l’indique, est un lieu, une occasion qui fait se tenir ensemble des sachants pour rendre un concept fécond en le questionnant convenablement ? Ainsi, le Département de philosophie, pour l’occasion qu’il offre à toute cette crème de pouvoir s’exprime sur « Émergence et reconnaissance », vient pleinement assumer l’obligation qui est la sienne de répondre à l’appel de l’Université.
Mesdames et messieurs,
Permettez qu’à ce niveau de mon propos, j’adresse les sincères remerciements du comité d’organisation à Monsieur le Ministre des Infrastructures économiques, Docteur Kouakou Koffi Amédé, notre Parrain, représenté ici par Monsieur Ekpini Gilbert, son Directeur de Cabinet, pour son soutien et ses conseils. Je tiens également à remercier Madame le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, représenté ici par le Professeur Bamba Abdramane, Directeur de la recherche au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour ses encouragements.
Chers participants, le comité d’organisation a travaillé avec engagement et dévouement pour vous offrir les meilleures conditions d’accueil possibles. Mais malgré cet engagement et cette volonté des imperfections pourraient être constatées. Je voudrais, au nom du comité d’organisation, solliciter votre indulgence pour ces faiblesses liées certainement à la finitude de l’homme.
Mesdames et Messieurs, nous sommes à une messe de la parole. Et de la parole le sage Abron, Kwabenan Ngboko, dit:
« Kasa Bya Kasa. Kasa Yè Ya. Kasa Kasa a. Kasa Krogron », qui se traduit comme suit :
« Toute parole est parole. Parler est facile et difficile. Qui veut parler, doit parler clair, bien, vrai ». Puisse la transcendance permettre à chacun de parler clair, bien et vrai.
Je vous remercie
Monsieur Abou SANGARÉ
Maître de Conférences
ALLOCUTION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
————————————–
Monsieur le Directeur de la recherche, Professeur Bamba Abdramane, Représentant Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur Bakayoko-Ly Ramata,
Monsieur le Directeur de Cabinet, Monsieur Ekpini Gilbert, représentant le M. le Parrain, le Ministre des infrastructures économiques, Docteur Kouakou Koffi Amédé,
Monsieur le Président de l’Université Alassane Ouattara
Monsieur le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société
Mesdames et Messieurs les Doyens des UFR,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de Centres et Chefs de services,
Mesdames et Messieurs les chefs de Départements
Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs, chers collègues,
À nos invités et collègues venus du Burkina Faso, du Sénégal, du Congo Brazzaville, du Niger, de la France et des universités ivoiriennes,
Chers étudiants,
Chers représentants des organes de presse,
Chers invités,
Mesdames et Messieurs,
Qu’il me soit permis, avant tout propos, en ma double qualité de chef de Département et de Directeur de Publication de la revue Perspectives Philosophiques, de remercier très sincèrement Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Le Professeur Bakayoko LY-Ramata, pour avoir accepté la présidence de ce colloque.
Cette rencontre scientifique est organisée sous le parrainage du ministre des infrastructures économiques, Docteur KOUAKOU Koffi Amédé. Si nous sommes en ces lieux ce matin, c’est grâce à sa sollicitude, son esprit d’ouverture et son désir de voir la réflexion se mettre au service de l’homme, de la société.
Nos remerciements vont également aux autorités de notre université, notamment au Président, le Professeur Lazare Marcellin POAME, pour l’appui institutionnel, à Monsieur le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société, Professeur Azoumana OUATTARA pour ses conseils et encouragements,
Nos remerciements vont enfin au Comité d’organisation de ce colloque et à tous ceux qui ont effectué le déplacement à Bouaké, témoignant ainsi leur intérêt pour la chose scientifique, à toute la presse, venue couvrir cette manifestation.
Mesdames et Messieurs, lorsque qu’une après-midi de 2015, à notre bureau, le Professeur Kouakou et moi, entourés des collègues, membres du comité de rédaction de la revue Perspectives Philosophiques, envisagions d’organiser un colloque international, parce que convaincus que le monde universitaire ne peut vivre sans ce type de rencontres, nous étions loin, bien très loin de penser que ce moment réunirait aujourd’hui ces illustres invités que vous êtes, autorités administratives et politiques, chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, venant d’horizons divers.
Deux motivations ont été à l’origine du choix de thème de ce colloque.
Nous sommes des universitaires, mais citoyens d’un pays. Il est de notre devoir de penser notre société. Nous le savons tous, l’émergence, en Côte D’Ivoire, est promue et sous-tend la gouvernance actuelle. Il nous revient d’accompagner le politique dans sa quête d’un bien-être du citoyen. Platon, dans la République, révèle que le désordre social apparait quand chacun ne respecte pas sa fonction. Nous ne sommes pas des hommes politiques, mais des penseurs voulant apporter leur contribution à la quête du plein épanouissement de l’homme, de tout homme. Nous le ferons dans le respect du jeu intellectuel et de l’éthique universitaire. C’est pourquoi nous mettrons l’accent sur la dimension sociale de l’émergence.
En ce sens, il s’agira d’apporter un éclairage sur les enjeux de l’émergence qui semblent se résumer en des chiffres, en des termes économétriques, au point de penser qu’un pays émergent se caractérise par un accroissement significatif de son revenu par habitant. Et pourtant, l’émergence n’est pas uniquement cela, c’est pourquoi nous mettons ce concept en rapport avec la reconnaissance. Expression d’un besoin de visibilité, de respect, de dignité que chacun estime dus, la reconnaissance semble bien être la condition de l’épanouissement du sujet ou du groupe, et son aptitude à participer à la construction de la vie publique. Il s’agira de voir, pendant ce colloque, si l’émergence peut s’accommoder du déni de reconnaissance.
Pour notre génération prise, en effet, dans le vertige de la rationalité instrumentale, dans une société de plus en plus atomisée, caractérisée par l’oubli de la reconnaissance, qu’il soit individuel, fondé par le sujet universel de type kantien d’approche honnetienne, ou collectif, culturel ou politique de la perspective de Charles Taylor, symptôme d’un monde aplati, en quête d’une autodétermination anthropocentrique incertaine, il est impérieux de repenser notre rapport aux autres mais à nous-mêmes. Dans notre société technocapitaliste et totalitaire caractérisée par l’uniformisation des cultures et des comportements, en effet, il n’est pas aisé pour l’individu d’entretenir des rapports véritablement humains et vrais avec lui-même et avec autrui. Inscrit dans une logique capitaliste, l’homme semble agir désormais par calcul rationnel de ses intérêts, observateur à distance du jeu des forces et des chances de gains, loin de toute empathie avec les autres humains. Ce rapport froid et désenchanté au monde consiste à traiter ce monde et les êtres qui l’habitent comme des objets. Cette réification va jusqu’à la fragilisation de l’auto-reconnaissance. La réification comme telle est un oubli de la reconnaissance qui ne peut être réparé que par le ressouvenir d’une existence avec les autres en société. C’est pourquoi, il convient de convoquer l’émergence au tribunal de la raison critique.
Ce colloque a pour ambition de :
- Discuter et débattre autours de sujets relevant du social, de l’éthique, des droits de l’homme et de la culture ;
- Présenter, dans une approche systémique les conditions de l’émergence ;
- Mettre en évidence la nécessité d’une approche interdisciplinaire dans la recherche de l’émergence ;
Nous voulons alimenter le débat, faire de ce moment un lieu d’incubation de la décision politique, c’est-à-dire permettre au politique de faire un choix éclairé.
Mesdames et Messieurs, au sortir de ce colloque, nous comprendrons aussi certainement que la philosophie ne consiste pas à tenir des discours oiseux de types à hypostasier les conditions sociales d’existence de l’homme. En ce sens, les Francfortois, notamment Adorno affirme que si la philosophie ne veut rester à la remorque de l’histoire, elle doit suspecter tout le réel. La philosophie est plus qu’un passe-temps pour des intellectuels qu’on qualifierait de désœuvrés. Ce colloque est un appel à la communauté, un appel à sortir de notre particularité pour retrouver le cosmos des éveillés, qui est pour nous le monde de la pensée, devant projeter sa lumière sur l’univers traversé pas les avatars de la modernité. Ce rôle sociétale de la philosophie convaincra certainement nos autorités afin d’ouvrir le Département de Philosophie de l’Université Peleforo Gon Coulibaly. Annoncé depuis au moins quatre ans, ce Département, malgré le nombre de docteurs en philosophie y affectés, n’existe pas encore.
Je vous remercie
Monsieur Ludovic FIE DOH
Professeur Titulaire
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ
————————————–
Monsieur le Représentant du Ministre des Infrastructures économiques,
Monsieur le Représentant de Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Monsieur le représentant du Préfet de Région,
Monsieur le représentant du Président du Conseil régional,
Monsieur le Maire de la Commune de Bouaké,
Madame et Monsieur les Vice-Présidents de l’UAO,
Monsieur le Secrétaire général,
Madame la Directrice du CROU,
Madame et Messieurs les Doyens des UFR,
Messieurs les Directeurs de Centre,
Mesdames et Messieurs les Chefs de service,
Mesdames et Messieurs les Chefs de département,
Madame et Messieurs les experts,
Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs,
Chers collaborateurs du personnel administratif et technique,
Chers étudiants,
Chers amis de la presse,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un plaisir partagé par tous les acteurs de l’Université Alassane Ouattara que je prends la parole, ce matin, à l’occasion du colloque international sur la thématique de l’émergence en lien avec la Reconnaissance, organisé par le Département de philosophie.
L’effectivité de ma joie singulière est structurée par l’idée que le Département de Philosophie de l’Université Alassane Ouattara continue de faire jouer à ses principaux animateurs le rôle qui doit être le leur, à savoir celui de toujours passer au crible de la pensée critique les idées, les concepts à visée développementaliste, marqués du sceau de l’ignorance, de la connaissance approximative ou d’une vulgarisation brumeuse.
C’est le sens qu’il me plaît de donner à ce colloque dont je salue la tenue à Bouaké, à l’Université Alassane Ouattara, car il permettra certainement de mettre au jour et à jour la complexité du concept d’émergence, ses dimensions et ses usages multiples, perceptibles à travers les discours politiques, les débats de salon et les rencontres scientifiques. Qu’est-ce que l’émergence ? Telle est la question inévitable à laquelle ce colloque devra donc répondre.
Pour ma part, une appréhension globalisante du phénomène me permet d’affirmer que si le concept a bien évolué depuis son émergence au début du 20ème siècle, il apparaît à la conscience de l’analyste averti comme un mouvement ascendant, porté par une totalité cohérente et conquérante, orientée vers une fin économiquement et socialement désirée. L’émergence est un élan construit et constant préparant à un saut qualitatif. D’un point de vue sociétal, elle suppose et présuppose une double modernisation, celle des infrastructures et des institutions.
Autrement dit, nous attendons de ce colloque une bonne archéologie du concept d’émergence, affranchi des premières ébauches des émergentistes. Ce sera l’occasion de prémunir ce dernier contre les extrêmes de l’émergentisme technocratique et du logocentrisme émergentiste.
En effet, en ses dimensions ontique et ontologique, l’émergence peut donner lieu à des usages allant du technocratique au logomachique en passant par l’économocentrique et le propagandiste. Elle doit, de manière impérieuse, se distinguer des notions connexes, susceptibles de la rendre brumeuse, notamment la résurgence et la jactance qui sont en fait des surgissements erratiques.
C’est pourquoi, nous attendons également de ce Colloque une consolidation sémantique impliquant le polissage du concept d’émergence sans polysémie rébarbative afin de faire émerger poliment une mentalité neuve, novatrice et constamment innovante sous-tendue par un besoin rationnel de reconnaissance.
Mesdames et Messieurs, l’émergence étant la chose la mieux partagée dans tous les pays en développement dont les citoyens aspirent à un mieux-être, cette mentalité nouvelle devra s’incarner dans un nouveau type de citoyen, caractérisé par le respect polyforme et exemplaire, transcendant les frontières de l’anthrophos et avec la force du besoin de reconnaissance, porté sur les fonts baptismaux par la dernière figure de l’École de Francfort, Axel Honneth.
La consolidation sémantique dont il est ici question devra s’accompagner d’une vulgarisation scientifique du concept d’émergence. Ce type de vulgarisation doit permettre de sortir le vulgaire de sa minorité au sens kantien du terme et de son ignorance pour le réconcilier avec les valeurs fondatrices de l’Émergence sociétale parmi lesquelles le sens du civisme et le culte du travail.
Fort heureusement, la Côte d’Ivoire, consciente du poids des impondérables susceptibles de peser lourdement sur sa marche vers l’émergence, a adopté la voie prudentielle, plus réaliste, celle qui recommande de fixer un horizon et non une date. D’où l’expression « horizon 2020 » qui traduit une temporalité élastique et raisonnable.
Mesdames et Messieurs, je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser les remerciements de l’Institution à Monsieur le Président de la République et à son gouvernement pour avoir pris la pleine mesure du défi que constitue l’émergence pour tous les pays africains en voie de développement, en situation de mal développement ou en passe d’être développés.
Je tiens également à remercier spécialement Madame le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata. En effet, sous la houlette de notre Ministre de tutelle et des acteurs des Universités, l’on assiste à une mue de l’Enseignement supérieur, appelé à apporter sa contribution à la marche de la Côte d’Ivoire vers l’Émergence. J’en veux pour preuve ce colloque dont je félicite les initiateurs et les organisateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour réunir, sur le sol de l’UAO, les enseignants-chercheurs et les experts nationaux et internationaux susceptibles de débroussailler le terrain toujours en friche de l’Émergence.
Je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde gratitude au Représentant du Ministre des infrastructures, Monsieur Gilbert Ekpini, porteur d’un précieux message de la part du Ministre Amédé Koffi Kouakou, au Représentant du Ministre de l’Enseignement supérieur, le Professeur Bamba qui, bien qu’averti à la dernière minute, a tenu à effectuer le déplacement. Permettez enfin que j’exprime ma gratitude aux Autorités de la ville de Bouaké. Je pense précisément au Préfet Konin Aka dont le soutien ne nous a jamais fait défaut, au Président du Conseil régional, Monsieur Jean Kouassi Abonouan, pour sa sollicitude constante et au Maire Nicolas Djibo, notre partenaire exemplaire. Je n’oublie pas tous ceux qui ont accepté (étudiants, travailleurs, hommes politiques), ce matin, de consacrer une partie de leur temps à l’Émergence philosophiquement interrogée.
Je vous remercie
Professeur Lazare POAMÉ
ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DU PARRAIN
————————————–
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, de prime abord, vous exprimer les sincères regrets du Dr. Kouakou Amédé, Ministre des Infrastructures Économiques, de n’avoir pas pu personnellement être présent à cette cérémonie d’ouverture, en tant que parrain de ce Colloque de la pensée philosophique sur le thème « Émergence et Reconnaissance ».
C’est donc un réel honneur, pour moi, qu’il m’ait désigné pour le représenter à ce colloque, en présence des plus hautes sommités de la réflexion philosophique de notre pays.
Mesdames et Messieurs,
L’Émergence ! Voici un concept qui est aujourd’hui entré dans le vocabulaire de tous les ivoiriens et qui est devenu, pour certains, simplement un slogan politique ; au point où ce terme, qui est sensé traduire, avant tout, un niveau de développement économique et social, est galvaudé du fait d’une utilisation à tort et à travers.
Par ailleurs, l’une des difficultés majeures de nos pays, dans l’approche socio-économique du concept de l’émergence, est de définir le référentiel par rapport auquel s’apprécie le niveau de développement. En somme, par rapport à quel pays doit-on comparer le niveau de développement économique et social de nos États afin de savoir s’ils sont émergents ou non ; d’où la notion de « Reconnaissance » !
En un mot, quelle entité est habilitée à reconnaître l’Émergence ? Sur quelles bases s’établit cette Reconnaissance et comment se décerne cette Reconnaissance ?
Mesdames et Messieurs,
Il ressort donc, de ce bref examen du concept de l’émergence, que le thème « Émergence et Reconnaissance » retenu pour votre colloque qui s’ouvre ce jour est des plus pertinent et d’actualité.
En effet, pour reprendre la célèbre pensée de Boileau, « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement – Et les mots pour le dire arrivent aisément »,
Si donc le concept de l’Émergence est mieux compris et donc mieux conçu pour nos pays, il s’énoncera clairement en termes d’une meilleure orientation des politiques de développement sociales et économiques ; et les mots pour le dire, c’est-à-dire leur explication à nos populations, seront plus aisés parce que ces populations verront concrètement les impacts de ces politiques dans leur quotidien.
Éminents et distingués Professeurs !
Lorsqu’autant de Maîtres du penser sont réunis, moins longs doivent être les discours afin de laisser place à la libre expression du savoir.
Je voudrais donc clore mes propos sur ces mots et déclarer, au nom du Dr. Kouakou Amédé, Ministre des infrastructures Économiques, ouvert le Colloque « Émergence et Reconnaissance ».
Je vous remercie !
Monsieur Gilbert EKPINI,
Directeur de Cabinet du Ministre des Infrastructures Économiques.
AVANT-PROPOS : ARGUMENTAIRE
Plus qu’un vocable, le concept d’Émergence se pose, dans les pays en voie de développement, comme un objectif à atteindre hic et nunc. Le flux temporel qui semble le porter à l’horizon se spatialise à l’aune des aspirations et des potentialités économiques de chaque État. La Côte d’Ivoire l’attend de 2020 ; le Sénégal, de 2025 ; le Cameroun, de 2035, etc. Et contre Lamartine, chacun murmure : « Ô temps, accélère ton vol ! ».
On parle d’émergence, concept introduit par les économistes de la Société financière Internationale (SFI) dans les années 80, pour désigner initialement les pays en pleine croissance et qui mériteraient la confiance et la reconnaissance des investisseurs privés, mobilisant ainsi les ressources pour le financement des différents programmes et projets. L’émergence correspond à un début d’industrialisation, de croissance forte et durable, et de modernisation des institutions de l’État.
Si l’émergence est devenue le leitmotiv du discours politique désormais indissociable de l’économie, c’est parce qu’elle semble s’inscrire dans un dualisme ontologique avec la reconnaissance. La dynamique de l’intersubjectivité pose au moi la réalité de l’autre comme un autre moi qui s’offusque des formes aliénantes. Elle traduit aussi le retour à l’autre, dans l’ordre du symbolique, de ce dont on lui est redevable.
Ainsi, le statut de pays émergents se manifeste aux États sous-développés comme le gage de leur reconnaissance non seulement en tant qu’espaces d’opportunité renvoyant au devoir de reconstruction, mais aussi en tant qu’entités-sujets devant bénéficier, en raison de leurs performances économiques, de l’estime et de la confiance des investisseurs internationaux. Estime, confiance et respect, c’est d’ailleurs en ces termes que Honneth marque le renouveau du concept de Reconnaissance. Cette reconnaissance, en tant que valeur significativement proche des valeurs de considération et de récompense, est aussi celle des populations exigeant de plus en plus une redistribution équitable des richesses.
En outre, la dialectique entre émergence et reconnaissance est interactive et signifie, de ce fait, que la reconnaissance peut fonder et légitimer l’émergence, qu’elle peut la catalyser et l’entretenir. Dès lors, saisir l’émergence unilatéralement, c’est la dévoyer, la galvauder, et c’est ignorer son lien irréductible, originel et non-monnayable avec la Pensée. Aussi est-il nécessaire de la saisir dans la pleine mesure de son être, de son essence pour mieux articuler sa relation avec le devoir de reconnaissance. N’est-il donc pas venu le moment de la reconnaissance si tant est que les pays émergents sont ceux dans lesquels les niveaux de bien-être des populations, les taux substantiels des opportunités d’emploi convergent vers ceux des pays développés ? Quelles sont les réflexions et actions à mener pour rendre compatibles les concepts d’Émergence et de Reconnaissance ?
C’est pour répondre à cette convocation du penser, que le Département de philosophie de l’Université Alassane Ouattara a choisi de mobiliser la réflexion autour du mécanisme d’osmose et de dialyse entre Émergence et Reconnaissance à partir des sous-thèmes suivants :
- Éthique, Ontologie et Altérité
- Culture et Développement
- Gouvernance politique et Utopie
- Technosciences et Progrès
- Économie et Société.
PLÉNIÈRES
OPTIMISME ET ENGAGEMENT
Professeur Mahamadé SAVADOGO
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina-Faso)
* *
*
De prime abord, l’optimisme semble être l’état d’esprit le plus favorable au combat pour la libération, le développement ou l’émergence. Il apparaît simplement comme le support de tout combat qui se veut noble.
Cette observation ne nous apprend pourtant rien de précis sur le rapport entre l’optimisme et l’engagement: faut-il être optimiste pour s’engager?
La réponse à cette question est loin d’aller de soi. S’il apparaît indispensable de croire en une cause pour la défendre, il est clair, cependant, qu’un optimisme exagéré pourrait conduire à accepter son sort ainsi que le rappelle la satire désormais classique de Voltaire dans son ouvrage Candide Ou l’optimisme[1].
Faut-il alors s’en remettre au pessimisme pour encourager l’engagement?
Cette alternative se révèle manifestement paradoxale !
Il est clair que le pessimisme entraîne un renoncement au combat autant que l’optimisme exagéré. Où trouver donc l’optimisme susceptible d’accompagner la lutte pour l’émergence? Par-delà des visions du monde ou des idéologies préétablies, ne convient-il pas d’interroger l’expérience même de l’engagement pour découvrir les exigences qu’elle implique? Bien loin que ce soit l’optimisme qui détermine l’engagement, ne serait-ce pas, au contraire, l’expérience de l’engagement qui justifie l’optimisme ? Telle est la préoccupation fondamentale que notre propos se destine à discuter.
* *
*
Pour comprendre le rapport entre l’optimisme et l’engagement, il est utile de commencer par relever que l’optimisme renvoie à une conviction qui oriente le comportement d’un individu ou d’un groupe, détermine son attitude à l’égard des événements qui marquent le cours de l’existence. L’optimisme ne désigne pas un état d’esprit ponctuel, une bonne humeur qui se manifeste à l’occasion d’un événement particulier, mais une tournure d’esprit, une conception du monde qui prédispose à accueillir favorablement les événements aussi bien heureux que malheureux. Aussi, le personnage de Candide dans la fiction de Voltaire apparait-il comme une illustration réussie de l’optimisme.
Candide n’est pas un niais qui n’est pas affecté par le malheur, mais l’adepte d’une doctrine métaphysique qui le convainc que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes », en d’autres termes, que tout malheur s’inscrit dans un plan à l’intérieur duquel il est appelé à être compensé par un évènement heureux.
Candide évite de désespérer de la vie quelle que soit la taille du malheur qu’il est conduit à rencontrer.
Cette obstination qui caractérise l’optimisme incarné par Candide entraîne à ne pas accorder une importance à sa propre responsabilité dans l’avènement du malheur. L’initiateur d’une action ne se considère pas comme entièrement responsable de son issue. Le résultat visé par une action est toujours dépassé par l’ordre global qui régit les événements constitutifs du monde et qui prescrit un rôle précis à toute initiative. Il existe un équilibre général entre les effets possibles de toutes les actions humaines qui échappe à la perception de celui qui agit et fixe des limites à sa responsabilité.
Cette vision du monde, qui sous-tend l’optimisme selon Candide et qui s’inspire de la métaphysique de Leibniz, ne conduit pas à prendre conscience du rôle de l’engagement dans la vie humaine. L’engagement renvoie à la résolution de mobiliser ses forces pour défendre une cause, encouragée par le pressentiment que cette mobilisation est susceptible de peser sur le sort, de changer l’orientation des événements de la vie. L’optimisme illustré par Candide aide davantage à accepter les situations, ou plutôt à s’adapter à elles, qu’à s’employer à leur conférer un sens, à leur imprimer une orientation qui nous soit favorable.
Cette acceptation des événements, qui caractérise l’optimisme en général, est susceptible de s’appuyer sur une philosophie de l’histoire qui prévoit un aboutissement heureux à tous les malheurs qui se rencontrent dans le cours de l’existence.
Il ne s’agit plus, ici, de considérer l’état global du monde à tout moment donné pour y déceler un équilibre qui atténue la portée des malheurs, mais de supposer une téléologie qui inclut les souffrances dans un processus de manifestation du sens de l’histoire. Dans une telle perspective, qui renvoie davantage à Hegel plutôt qu’à Leibniz à qui Voltaire s’attaque explicitement dans Candide, il devient possible d’envisager le dévouement des individus à des causes qui mobilisent leurs énergies.
Hegel souligne bien que « Rien de grand dans le monde ne s’est accompli sans passion »[2]. À première vue, les implications d’une telle assertion semblent fort éloignées de la conviction selon laquelle ce monde reste le meilleur parmi les mondes possibles.
Hegel, à la différence de Leibniz, accorde plus d’importance à la responsabilité des hommes dans l’orientation des événements qui les concernent. Il montre que la capacité de consacrer sa vie à un but, de se dévouer à une cause, distingue les grands hommes, les héros de l’histoire, des hommes ordinaires qui poursuivent des buts finis et sont incapables de s’attacher profondément à un objectif. Hegel enseigne que la souffrance ou le malheur que les hommes sont appelés à affronter dans leur existence n’est jamais vaine. Le malheur demeure la médiation par laquelle le positif se réalise dans l’histoire, le mal s’avère être l’instrument même du bien.
Il faut pourtant reconnaître que Hegel réhabilite la passion mais méconnait l’engagement. Dans la passion, l’homme se comprend encore comme l’outil d’une force qui le transcende, qui se sert de lui pour s’affirmer. Le grand homme qui sacrifie sa vie à la cause qu’il défend reste la victime d’une « ruse de la raison ».
Il croit poursuivre un but qui a une valeur pour lui personnellement alors que ce but correspond à ce que l’humanité attend à un moment donné de son histoire.
En définitive, le sens de l’histoire s’accomplit par l’entremise des passions humaines. La passion est toujours plus forte que son porteur parce qu’elle est l’indice de la présence de l’infini dans l’être fini. Il en résulte une vision de l’histoire qui reconnaît la possibilité du tragique dans l’existence en la surmontant.
En cela Hegel reste un authentique optimiste. Mais son optimisme, à la suite de celui de Leibniz, ne permet pas d’accorder un rôle fondamental à l’engagement, il ne conduit pas à la formulation d’une pensée de l’engagement. L’initiative individuelle, qui est une dimension essentielle de l’engagement, est rattachée, dans l’optimisme fondé sur une philosophie de l’histoire à la manière de Hegel, à une force transcendante qui l’oriente. Il en résulte une providence qui résorbe le choix de l’individu et atténue, en définitive, la portée de son engagement.
Le héros de toute action libératrice se révèle être le porte-drapeau de la divinité. Son action est condamnée au succès parce qu’elle est le prolongement de la volonté divine. La providence guide la collectivité à travers le choix de son dirigeant. Il est clair que dans une telle perspective l’optimisme réduit la portée de tout engagement. Parce qu’il précède et oriente l’engagement, il lui confère un statut secondaire, lui réserve une place insignifiante.
En somme, un optimisme systématisé à travers une vision du monde, une doctrine métaphysique ou une philosophie de l’histoire, aboutit à méconnaître le rôle de l’engagement dans les combats collectifs quels que soient leurs enjeux : libération, développement ou émergence. Est-il seulement concevable de réhabiliter l’engagement sans renoncer à l’optimisme ?
* *
*
Afin de se préparer à formuler une réponse à cette question, il convient, dans un premier temps, de revenir sur les limites de l’optimisme systématique ou transcendant. Cet optimisme, qui comprend l’action humaine comme prédéterminée par un plan divin ou une providence est, à l’évidence, susceptible de donner de l’enthousiasme à celui qui agit. Il est, en effet, exaltant de se percevoir sous les traits d’un élu des dieux chargé de conduire les hommes. Une telle vision encourage à s’identifier sans réserve à son action. Mais, elle présente, cependant, l’inconvénient de laisser son adepte désarmé devant l’échec, de favoriser, en d’autres termes, une résignation face à l’échec. L’échec, pour lui, apparaît autant guidé par la providence que le succès. L’échec est certes vécu comme un malheur. Mais le malheur lui-même est pour l’homme une épreuve que le maître du monde lui impose pour en tirer un progrès qui ne lui est pas visible.
Il n’échappe pas à la réflexion qu’une telle conception du monde ne saurait soutenir le combat de celui qui voudrait se libérer d’une domination ou simplement s’affirmer face à l’adversité. Pour lui, tout optimisme qui le pousse à admettre la suprématie de l’adversité en renonçant à son combat est à rejeter. Il ressent sa situation dans le monde comme inconfortable, inacceptable et même injuste. Cette conviction est le ressort qui le pousse à rassembler ses forces pour atteindre son but qui est la liberté ou l’indépendance, le développement ou l’émergence.
Il en découle que ce n’est pas l’optimisme ou la confiance dans le sort que la providence lui réserve qui soutient l’action du partisan de l’émergence. Au lieu de se résigner à sa situation, de l’accepter comme une fatalité imposée par une force transcendante, il a besoin, au contraire de se convaincre qu’elle constitue un accident, une condition ponctuelle, contingente, qu’il demeure possible de surmonter.
Ce n’est pas la satisfaction mais son contraire, la détresse, qui procure la ressource pour braver l’adversité et se transformer. Celui qui se lance dans un combat pour l’amélioration de son sort éprouve une détresse qu’il tient pour insoutenable. S’il pouvait trouver le moindre indice pour se satisfaire de sa condition, il se retrouverait privé d’une motivation supplémentaire pour se vouer à son projet.
La détresse est la source principale de l’activité créatrice. Elle est la racine dont la sève nourrit la quête de celui qui poursuit un autre monde que celui dans lequel il vit. Elle traduit une déception profonde à l’égard du présent qui ne laisse d’autre choix que la quête du nouveau. Cette déception, ainsi que l’a bien perçu Heidegger[3], couronne l’évolution d’un monde qui est parvenu au terme de sa propre déstabilisation ou de sa destruction. L’intensité de la désolation que suscite un monde soumis à la violence engendrée par sa propre histoire prépare les grandes âmes, les plus sensibles parmi les hommes, à se lancer dans la recherche d’un salut.
Cette quête prend d’abord la forme d’une parole qui dit, exprime, la profondeur de l’abîme qui écrase le monde. Aussi, les poètes, les artistes, les créateurs d’une manière générale, en tant que gardiens de la source de tout sens qu’est la langue sont-ils appelés à jouer un rôle particulier dans la poursuite d’un monde autre. Ce sont des êtres d’exception qui portent au langage la détresse que suscite l’emprise de la violence sur le monde.
Toute action salvatrice doit d’abord être précédée par une prise de conscience de la profondeur de la désolation, ou, pour parler le langage de Heidegger, de « la perte de l’être », qui hante l’existence. La puissance de l’ambition salvatrice sera à la mesure de la taille du vide qu’elle doit combler. Heidegger, citant Hölderlin, insiste pour montrer que « où est le péril, là, croit aussi ce qui sauve ». Il s’avère, ici, que ce n’est pas la confiance dans le cours du monde ou l’optimisme qui incite l’homme à entreprendre de grands projets, mais au contraire l’expérience du néant ou la détresse. Autrement dit, l’engagement ne se soutient pas de l’optimisme mais plutôt de l’aiguisement du mécontentement ou du désespoir.
L’exigence de l’engagement se manifeste quand la tentation du désespoir est portée à son paroxysme. Le malheur est bien plus favorable à l’engagement que la satisfaction. L’engagement est une réponse à un malheur exacerbé, il est une réaction résolue visant à mettre un terme à une souffrance devenue insupportable. Le passage à l’engagement se présente comme un retournement dialectique engendré par l’exacerbation même de la souffrance ou de la détresse. Là où la souffrance est ignorée, l’engagement a peu de chance de se trouver une place. Ce n’est pas l’optimisme mais la considération du malheur qui est capable d’inspirer l’engagement.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, seul le malheureux est encouragé à s’engager. L’engagement accompagne la peine ou la souffrance et non la joie. Cette leçon, qui se dégage de la considération de la pensée de Heidegger, a été clairement proclamée bien avant lui par Marx. Marx assigne à la classe ouvrière la tâche de sauver l’humanité du désastre en se libérant de l’exploitation capitaliste. La classe ouvrière se voit confiée ce rôle précisément parce qu’elle est, de toutes les classes sociales, celle qui souffre le plus, celle qui subit le plus durement la violence de l’exploitation du système capitaliste. La force de conduire la révolution, qui permettra d’édifier un nouveau monde, est donnée à la classe ouvrière par l’injustice même qu’elle vit, l’exploitation dont elle est victime. L’engagement de l’ouvrier contre le système capitaliste est une conséquence directe de son malheur ou de sa souffrance.
En somme, il est possible de soutenir que le pessimisme, dans la mesure où il traduit la conscience du malheur humain, prédispose davantage à l’engagement que l’optimisme. L’optimisme incline à la résignation cependant que le pessimisme pousse à l’action ou plutôt à la réaction. Il faut être pessimiste pour s’engager. La réhabilitation de l’engagement passe par l’expérience du pessimisme. Il n’est ainsi pas surprenant de noter que la thématique de la décision occupe une place importante dans l’œuvre de Heidegger[4]. La décision est un moment essentiel de l’engagement. Elle est une réponse à une situation devenue insupportable.
La découverte du triomphe du nihilisme ou de la perte de l’être dans le monde contemporain incite à la décision du philosophe qui doit penser l’être ou celle du poète qui est chargé de le porter au langage. Heidegger insiste sur la décision parce qu’il comprend négativement, à la différence de Hegel, le cours de l’histoire qui aboutit à l’époque moderne. Son œuvre témoigne de la liaison entre le pessimisme et la décision, ou plutôt, l’engagement dont la décision est un moment. Il reste à se demander si le pessimisme est susceptible de procurer un sens à l’engagement après l’avoir inspiré : est-il concevable de rester pessimiste après le passage à l’engagement ?
* *
*
La réponse à cette dernière question n’apparait pas bien difficile à dégager. Il est évident, en effet, que l’engagement vise la transformation d’une situation perçue comme malheureuse. Il poursuit une satisfaction qui est refusée au départ à son porteur. Le pessimisme peut être au fondement de l’engagement mais il ne saurait désigner son aboutissement.
Cette conviction apparait dans toute sa netteté davantage chez Marx que chez Heidegger qui lui est pourtant postérieur. Pour Heidegger, l’engagement ou la décision, qui supporte la créativité, demeure un privilège réservé à des êtres d’exception, à des élus appelés par l’histoire de l’être à répondre de lui. Il considère que la libération de la détresse est une grâce accordée à une élite et non une tâche collective. Elle passe avant tout par une relation au langage qui est l’affaire des penseurs, des philosophes et des poètes. Cet élitisme empêche Heidegger de percevoir clairement la condamnation du pessimisme dans le passage à l’engagement.
Marx, quant à lui, l’a bien perçue parce qu’il conçoit la libération comme une tâche nécessairement collective. Non seulement la classe ouvrière a besoin de s’organiser pour conquérir la liberté, mais aussi, elle est tenue de s’assurer le soutien des autres mécontents de l’organisation de la société capitaliste, notamment les paysans, pour réussir dans son ambition. Marx comprend également qu’il est indispensable de disposer d’une autre conception de la société à opposer au système capitaliste. Cette conception de la société, qui est le socialisme, s’érige en un but que poursuit l’action collective guidée par la classe ouvrière.
La conquête de ce but a besoin de s’appuyer sur une analyse des formes sociales que l’humanité a connues par le passé qui dégage les modalités de passage d’une forme de société à une autre. En d’autres termes, une science de l’histoire est nécessaire pour soutenir l’action collective révolutionnaire. Cette science de l’histoire lui découvre un sens, une orientation, qui justifie le combat des classes exploitées. Cette justification suscite la confiance en la valeur de la lutte pour une autre société, elle engendre, en d’autres mots, une forme d’optimisme indispensable à l’action collective.
Il est nécessaire de souligner qu’ici l’optimisme ne précède pas l’action collective pour s’imposer à elle mais se dégage en tant que contrainte exigée par le déploiement même de l’action collective. La connaissance de l’histoire est une dimension importante de la tâche révolutionnaire. La lutte pour la transformation de la société implique l’élaboration d’une théorie qui accompagne l’action. L’optimisme est un état d’esprit que la théorie révolutionnaire aide à entretenir. Mais, de son côté, également, la pratique révolutionnaire, l’expérience de l’action collective, suscite un optimisme indispensable à l’engagement. L’action collective engendre une solidarité entre ses initiateurs qui leur permet de résister face aux épreuves qu’ils affrontent et une confiance qui résulte de la prise de conscience de leur force favorisée par les succès qu’ils emportent. Solidarité contre les épreuves et confiance dans l’organisation qui conduit à des victoires se rejoignent pour bâtir une éthique de l’action collective qui constitue une dimension de l’éthique de l’engagement en général.
L’engagement ne se nourrit pas seulement d’une théorie de l’évolution de la société, d’une science ou d’une philosophie de l’histoire, il suscite une éthique[5] qui lui permet de se consolider. La sincérité envers soi-même, la loyauté à l’égard de la cause défendue, la justice par rapport à ses semblables et le courage face à l’adversité sont, par exemple, des dispositions, des qualités, que développe l’expérience de l’engagement. L’engagement engendre des valeurs qui orientent l’individu et soutiennent son inscription dans un collectif qui s’organise autour d’un combat. La liaison entre l’individu et l’organisation, qui seule rend possible l’action collective, est le principal enjeu de l’éthique de l’engagement. La participation à l’action collective par l’engagement donne un sens, un contenu à l’existence de l’individu. Elle lui imprime un caractère, une personnalité, qui le distingue de ceux qui ignorent l’engagement. D’un être inconstant et égoïste, l’engagement est capable de forger une personne fiable et dévouée.
Il ne s’agit cependant pas d’un miracle inaccessible au commun des mortels, réservé à une élite de privilégiés. L’engagement est une expérience ouverte au plus humble des hommes comme aux esprits dits supérieurs. D’ailleurs, comme Marx l’a bien vu, les dominés et les exploités sont bien plus enclins à se regrouper pour constituer une force collective que les élites. Leur dénuement même les encourage à se rassembler pour se faire entendre alors que les élites, notamment intellectuelles, sont enclines à mépriser l’action collective, à railler la masse indexée comme « un troupeau » selon la terminologie de Nietzsche dont la pensée revendique sans fard l’élitisme. À travers l’engagement par l’action collective, les plus humbles des humains s’érigent en une force créatrice, ils découvrent la possibilité de la créativité qu’une philosophie insuffisamment consciente de ses propres limites voudrait réserver à des êtres d’exception. Avec l’action collective ou le militantisme, l’optimisme cesse d’être une grâce accordée à des esprits supérieurs dans un monde en perdition pour devenir la récompense d’une éthique qui permet à des hommes d’agir ensemble. Cet optimisme pratique ou militant est bien plus consistant que toute conviction métaphysique qui est engendrée par une vision du monde. L’optimisme précédant l’engagement se retourne vite en son contraire alors que l’optimisme né de l’engagement se consolide par la solidarité et la coopération qu’il favorise entre des êtres différents. Cet optimisme, suscité par l’action collective, conduit à entrevoir que, fondamentalement, l’engagement est une exigence pour ne pas désespérer de l’existence dans son entièreté. En d’autres termes, la philosophie de l’action collective[6] aboutit à confirmer la thèse fondamentale de la philosophie de l’engagement qui érige l’engagement en une condition de la quête d’un sens de l’existence[7]. Engagement militant par l’action collective et engagement fondamental par la décision fondatrice pour le sens ne se distinguent que pour mieux se compléter dans le cadre d’une philosophie de l’engagement.
ATELIERS
SOUS-THÈME I : ÉTHIQUE, ONTOLOGIE ET ALTÉRITÉ
LE COEXISTER COMME UN VECTEUR DE L’ÉMERGENCE
Pascal Dieudonné ROY-EMA
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
roypascal2007@yahoo.fr /royema@me.com
Résumé :
Là où règne le désaccord et où les élites sont constamment en quête infructueuse de consensus et de cohésion nationale, dans un milieu où l’instabilité est chronique et où les désordres politiques et les manques sociaux marginalisent les efforts de progrès, l’émergence ne peut naître et prospérer. Il n’est pas alors faux de dire que l’émergence est fondée sur la volonté d’assurer un coexister sinon un vivre-ensemble, du moins un être ensemble meilleur dans la société; lequel coexister est révélateur de la stabilité socio-politique, de la reconnaissance citoyenne et de la confiance collective dans la direction de la nation. C’est donc la prise de conscience d’un destin commun dans un État pacifié, réconcilié et stable qui peut mobiliser les énergies et créer les conditions de la construction et de l’atteinte de l’émergence.
Mots-clés : Coexister, Dasein,Développement, Émergence, État, Être, Existence, Vivre-ensemble.
Abstract :
Where reign the disagreement and where elites are constantly in fruitless collection (quest) of consensus and national cohesion, in an environment (middle) where the instability is chronic and where the political disorders and the social lacks marginalize the efforts of progress, the emerging cannot prosper. It is not then false to say that the emerging is based (established) on the will to assure (insure) one to coexist otherwise a living together, at least a being together better in the company (society); who (which) to coexist is revealing of the sociopolitical stability, the gratitude (recognition) citizen and of the collective confidence(trust) in the direction (management) the nation. It is thus the awareness of a common fate in the calmed, reconciled and stable State which can mobilize the energies and create the conditions of the construction and the infringement (achievement) of the emerging.
Keywords: Coexist, Dasein, Development, Emerging, State, Being, Existence, Living together.
Introduction
À l’instar de l’Inde et de la Chine, l’émergence économique doit se mettre au service d’un dessein ou objectif stratégique de politique mondiale ou civilisationnelle. La croissance économique qui en est le levier principal aura été dans ces pays, un double vecteur de la politique de l’ambition internationale et d’égalisation des revenus ou de réduction de la pauvreté des masses. Elle n’est pas seulement un justificatif de bilan d’un gouvernement, ni une assurance d’accès aux privilèges des profiteurs d’un régime mais aussi et surtout, un indicateur de l’assurance sociale des citoyens en termes vérifiables de la croissance de la confiance en soi des populations, de leur confiance dans leurs voies et moyens de réduire l’écart social et technologique d’avec le monde, confiance dans la direction politique de la nation ; cela signifie que les citoyens adhèrent à une politique commune et se reconnaissent dans l’orientation collective ; une perspective qui devient difficile là où règne le désaccord et où les élites sont chaque jour en quête infructueuse de consensus et de cohésion nationale. Tout État est tout à fait capable d’atteindre l’émergence en travaillant sur des indicateurs très importants à savoir la stabilité socio-politique, le niveau de vie de la population et la compétitivité du pays. L’objectif de faire d’un pays une nation émergente, est une vision volontariste et un défi à relever là où l’État est un socle de coexistence sereine et où se distille le parfum de la confiance voire de la reconnaissance citoyenne.
Les enjeux politiques de l’émergence sont ceux de la restauration ou de la reconquête d’un rôle, d’un rang ou de la gloire perdue sur la scène mondiale ou encore de leur quête, enjeux du pouvoir international dans les conditions de stabilité politique et institutionnelle ainsi que de consensus et de cohésion nationale, conditions de la force nationale. L’émergence économique est une renaissance en nouveauté de vie.
Dans un milieu où l’instabilité est chronique et où les désordres politiques et les manques sociaux marginalisent les efforts de progrès, l’émergence ne peut naître et prospérer. Le caractère apaisé et réconcilié de la nation est une garantie pour la marche vers l’atteinte de l’émergence.
Il n’est pas alors faux de dire que l’émergence est fondée sur la volonté d’assurer un coexister sinon un vivre-ensemble, du moins un être ensemble meilleur dans la société. Coexister, voilà un concept cher à Heidegger. Le coexister est révélateur d’une bonne entente, du vivre-ensemble, de la stabilité socio-politique, de la confiance collective et de la reconnaissance citoyenne en la nation et en ses projets. Comment se dévoile alors le contenu du coexister ? Le vivre-ensemble et la reconnaissance citoyenne, comme imbrications du coexister, ne font-ils pas de lui, le terrain par excellence de la construction de l’émergence ?
Nous nous appliquerons, dans le cadre de cet article, à exposer, d’une part, une approche du sens de l’émergence, en mettant en exergue les conditions de sa réalisation parmi lesquelles, le coexister ou aujourd’hui la stabilité socio-politique comme le vecteur essentiel; d’autre part, nous exposerons le contenu du coexister à partir des rudiments de la philosophie de Heidegger, lequel coexister débouche sur le vivre-ensemble, la fraternité, la reconnaissance citoyenne et la stabilité socio-politique.
1. Le sens de l’émergence et les conditions de sa réalisation
1.1. Le sens de l’émergence
Selon les travaux de H. Juvin (2010, p. 178), essayiste français, Président d’Eurogroup Institute et Vice-Président du groupe Agipi et de la Société de Stratégie, le mot « émergence est occidental », et plus précisément, est issu du monde de la gestion financière ; les « émergents » ont d’abord été un concept d’investissement. L’émergence est une notion occidentale construite par les Occidentaux.
Assez peu de pays que nous disons « émergents » se définissent spontanément comme tels. Pour l’Inde et la Chine, il ne s’agit pas d’émergence mais tout simplement de reprendre la place qui était la leur il y a moins de deux siècles, lorsqu’ils représentaient dans l’économie mondiale la part que leur conférait naturellement leur poids démographique.
Pour d’autres pays, il s’agit d’un phénomène national dont la dimension politique est évidente. En 1965, le niveau de vie du Coréen du sud était trois fois inférieur à celui du Malgache. Aujourd’hui, le niveau de vie moyen du Coréen du sud est quinze fois supérieur à celui du Malgache, et la Corée du Sud est un concurrent qui fait peur au Japon ! La mobilisation coréenne est d’abord nationaliste, et son émergence est d’abord le moyen de sa sécurité.
En réalité, nous sommes face à une hétérogénéité de situations économiques tout à fait impressionnante. Si la façade économique de l’émergence est brillante, la réalité institutionnelle, politique et sociale est d’une tout autre nature.
La notion d’émergence a surgi sur la scène du débat public à l’occasion de grandes peurs : L’émergence va nous dépasser, nous déborder… L’argent était à l’Ouest, il est au Sud ou à l’Est. Le pouvoir était à l’Ouest, il est en train de passer en d’autres mains. Nous en sommes certainement encore loin et le réel basculement du monde n’est pas de nature économique. Dans plusieurs régions du monde, une transformation économique extrêmement rapide et brutale a vu le jour, dont les expressions manifestes sont l’augmentation du revenu moyen, la modernisation des activités, la part dans les échanges mondiaux. Si l’on peut parler d’économies émergentes, la notion d’« États émergents » paraît beaucoup plus compliquée, probablement aléatoire et à prendre avec infiniment plus de précautions. Finalement, « l’émergence reste une notion stratégique, une notion de stratégie économique » (H. Juvin, 2012, p. 11).
Selon les travaux de P. Juignet (2015, pp. 2-5), l’idée d’émergence vient deJohn-Stuart Mill qui, dans A system of logic (1862), considère que la juxtaposition et l’interaction des parties constitutives d’un être vivant ne suffisent pas à expliquer les propriétés de ce dernier. Il propose une distinction entre des « lois homopathiques », dont les effets se combinent selon le principe de « composition des causes » (sur le modèle de l’addition vectorielle des forces en termes contemporains), et des « lois hétéropathiques », dont les effets se combinent en violant ce principe de composition des causes. Les réactions chimiques en particulier mobilisent des « lois hétéropathiques ». Pour Mill, les organismes vivants sont donc strictement composés d’éléments physiques mais leurs propriétés, résultant de lois hétéropathiques, diffèrent d’une simple composition des propriétés de leurs constituants ; d’où « l’aphorisme classique « le tout est plus que la somme des parties », hérité des intuitions des penseurs de l’émergentisme britannique » (P. Juignet, p. 4). La définition de l’émergence ici, correspond, globalement, à une irréductibilité explicative de principe.
À la suite de Mill, des philosophes britanniques ont appelé cette caractéristique emergent. À ce propos, G. H. Lewes (1875, pp. 301-319), explique que « des entités émergentes peuvent être le résultat de l’action d’entités plus fondamentales (…) et pourtant être parfaitement nouvelles ou irréductibles par rapport à ces dernières ». L’idée centrale de l’émergence est lancée. Lewes utilise le terme pour qualifier des systèmes et des processus incompréhensibles du point de vue mécanique. Comme exemple, il cite l’eau dont les propriétés ne résultent pas de celles de l’hydrogène et de l’oxygène, éléments chimiques qui la composent.
Auparavant, dans son Cours de philosophie positive, Auguste Comte avait envisagé divers ordres de phénomènes selon leur degré de simplicité ou de généralité, d’où résulte leur dépendance successive et, en conséquence, la facilité plus ou moins grande de leur étude. Il établit deux grandes classes, celle des phénomènes des corps bruts et celle des phénomènes des corps organisés. Ces derniers, poursuit A. Comte (1943, pp. 119-120), « sont évidemment, en effet, plus compliqués et plus particuliers que les autres ; ils dépendent des précédents qui, au contraire, n’en dépendent nullement ». Comte parle de la plus grande complexité de certains phénomènes et de corps, complexité due à leur organisation.
C’est avec le philosophe britannique Samuel Alexander que la notion d’émergence apparaît pour la première fois, à la fin des années 1910, comme un concept philosophique central au cœur d’un véritable système métaphysique. L’œuvre principale d’Alexander, Space, Time and Deity (1920), expose cette conception métaphysique du monde fondée sur l’idée d’une hiérarchie entre les différents niveaux d’existence. Cet ordonnancement du monde est lui-même le résultat d’un processus évolutif. L’émergence est un concept philosophique formalisé au XIXe siècle.
Alexander place l’Espace et le Temps à la base de ce système, chacun d’eux étant concevable séparément, bien qu’ils soient à l’origine équivalents. Emerge à partir de cette réalité fondamentale l’Espace-Temps proprement dit (première forme d’émergence), au sein duquel les processus se réalisent en tant que simples mouvements ou déplacements. C’est l’Espace-Temps qui constitue pour S. Alexander (2004, p. 342) « la substance proprement matérielle du monde, encore dépourvue de qualités matérielles autres que celles qui définissent le mouvement ».
En 2005, l’idée d’émergence a été reprise par le Prix Nobel de physique Robert Laughlin. Il soutient que les lois physiques résultent de comportements d’ensemble et sont relativement indépendantes de celles des entités sous-jacentes. À la suite d’expériences sur la mesure des constantes fondamentales de la physique, mesures obtenues à partir d’échantillons massifs, il en conclut que ces constantes sont la résultante d’un effet collectif. R. Laughlin et D. Pines (2000, p. 28) en tirent un argument pour soutenir la thèse émergentiste : « La tâche centrale de la physique théorique de nos jours n’est plus de tenter de décrire les équations ultimes, mais bien plutôt de cataloguer et de comprendre les comportements émergents dans toutes leurs manifestations, y compris peut-être le phénomène de la vie ».
Il ne s’agit là que de quelques jalons historiques, car le cheminement des idées concernant l’émergence reste mal connu. Depuis sa formalisation, à la fin du XIXe siècle, le concept d’émergence a été contesté, pour parodier Patrick Juignet (2015), mais il réapparaît régulièrement.
L’émergence implique une ontologie pluraliste ou, ce qui revient au même, une pluralité ontologique, c’est-à-dire que le réel n’est pas homogène. Elle renvoie à un monde pluriel, en évolution, dans lequel de nouvelles formes d’existence peuvent apparaître. Dans ce cadre précis, l’émergence désigne tout simplement le processus de formation de nouveaux degrés d’organisation et d’intégration.
D’un point de vue empirique, l’émergence est une façon de désigner la formation d’entités complexes irréductibles ou, comme le dit le sociologue P. Bourdieu (2013, p. 384),de noter « le passage d’un système de facteurs interconnectés à un système de facteurs interconnectés autrement ».
Pour parler d’émergence, il faut que les entités individualisées se différencient de leurs composants élémentaires par des propriétés spécifiques, qu’elles perdurent un certain temps et que des faits observables attestent de leur existence. Une entité émergente peut être de nature physique, chimique, électronique, biologique, psychologique, ou autre, il importe seulement qu’elle soit composée de divers éléments qui sont liés et intégrés entre eux. L’émergence désigne le passage d’un type d’existence à un autre de complexité supérieure. L’émergence est une façon de désigner et de concevoir le rapport entre les deux. Elle suppose une organisation du monde selon des degrés de succession ; succession qui ne peut être réduite à ses degrés élémentaires. En effet, si un niveau était réductible au précédent, il n’y aurait pas lieu de parler d’émergence, car ce terme sert à noter l’apparition d’une forme d’existence différente, explique Patrick Juignet dans ses travaux précités.
L’émergence socio-économique d’une société forme un tout distinct des éléments et des variables qui y contribuent, car le tout aristotélicien est plus que la somme de ses parties et R. Paris (2012, pp. 2-3) s’en explique en reprenant la thèse fondamentale d’Aristote au Livre VI de la « Physique » :
Il est impossible qu’un continu existe à partir d’indivisibles. (…) Si la ligne était composée de points, le continu serait divisible en indivisibles (…) mais nul continu n’est divisible en éléments sans parties. » Aristote en conclut que la droite n’est pas formée de points consécutifs. S’ils l’étaient, ils seraient en contact. « A) Le contact est impossible car a) s’il a lieu de la partie à la partie, il est impossible parce que l’indivisible n’a pas de parties ; b) s’il a lieu de tout au tout, les points en contact ne formeront pas un continu c’est-à-dire seront confondus. (…) B) La consécution est impossible car si deux points sont distincts, ils ont comme intermédiaire la ligne (un intervalle) ». (…) Les indivisibles, les points, n’ont dans le continu qu’une existence potentielle qui ne s’actualise qu’aux extrémités d’un segment, ou qu’on choisit un en le désignant distinctement. Les individus sont les bornes, mais non les constituants du continu. (…) Le continu se trouve être représenté comme une collection bien enchaînée de parties virtuellement séparées par des points-limites (…) Aristote éludait la difficulté de concevoir que tout point d’un continu, bien qu’ayant des successeurs, n’a pourtant pas de successeur immédiat. (Souligné par moi) Quels que soient les arguments qu’Aristote pouvait puiser dans l’observation de la nature en faveur de l’existence du continu physique, on ne peut se dissimuler (l’absence de) preuve rigoureuse de la divisibilité infinie des grandeurs. (…) D’où la conviction de plusieurs philosophes, dont Aristote, que les grandeurs physiques sont continues et divisibles à l’infini seulement en puissance.
Autrement dit, l’émergence économique d’un État pourrait se définir comme une sorte de valeur ajoutée, surgissant à un moment donné de l’évolution de son processus de développement, grâce à la solidarité et la cohésion de son cadre macro-économique. Cette valeur ajoutée est le résultat de la synergie de plusieurs facteurs, ayant des effets amplificateurs et multiples, affectant l’ensemble de l’activité économique et la société. Nous avons affaire à une chaîne de réactions, s’entremêlant entre elles, et se répercutant les unes sur les autres, de sorte qu’elle n’est plus décomposable d’un point de vue analytique, à ce stade de complexification de la réalité. Il s’agit, de rapports complexes et denses, qui s’auto-organisent et se structurent, sous la pression d’une dynamique interne, faisant intervenir des interactions qui se déroulent sur une gamme très large, située à différents niveaux de l’activité socio-économique.
L’émergence est devenue la référence centrale du discours politique en Côte d’Ivoire et en Afrique en général, où elle semble s’être substituée à un autre référent, le développement. Parfois, ce dernier est réduit à une simple notion de performance macro-économique, dans les discours de mobilisation économique et politique. Le contraste avec la réalité de la situation de ces pays peut surprendre, car dans leur très grande majorité, ils sont classés, parmi les pays les moins avancés du monde. Dès lors, sur quelles bases émergeons-nous ?
1.2. Les conditions de la réalisation de l’émergence
L’histoire économique, selon M. Mbaloula (2011, pp. 77-78), est jalonnée de concepts qui qualifient le niveau ou le statut des pays. « On a ainsi des pays développés et des pays sous-développés, des pays à revenu intermédiaire, des pays pauvres et des pays riches, des pays industrialisés et des pays non industrialisés, etc ». Chaque qualification exprime ainsi des caractéristiques ou des objectifs spécifiques et distinctifs que peuvent se fixer des pays. Le concept de pays émergent correspondant, en d’autres termes, à économie émergente s’inscrit dans cette logique.
L’émergence économique du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine, constituant le premier contingent du groupe appelé les BRIC (créé en 2009 et qui deviendra BRICS en 2011 avec l’arrivée de l’Afrique du Sud), a incité d’autres pays africains à se fixer comme objectifs stratégiques, être pays émergents. Quoique le concept de « pays émergent » ne corresponde à aucune définition économique, il reste qu’il est devenu une préoccupation politique tant pour les spécialistes en économie de développement que pour les hommes politiques. Cette intention stratégique, pour ces derniers, semble oublier que l’émergence économique est différente du développement du pays.
Il apparait, de façon nette, que l’émergence d’une économie est différente du développent d’un pays, qui, lui, fait allusion au développement économique, socio-culturel et technologique impliquant une réduction de la pauvreté.
En effet, le développement implique le changement économique et social. Cette vision du développement est aussi précise chez l’économiste F. Perroux (1954, p. 155) qui le définit comme étant « la combinaison des changements sociaux et mentaux d’une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement, son produit réel global ». Autrement dit, le développement, c’est l’ensemble des changements sociaux et culturels qui rendent possible la croissance économique.
Le changement social, selon les écrits d’A. Piveteau et E. Rougier (2010, pp. 1-17), est défini comme étant toute transformation observable dans le temps, qui affecte d’une manière qui ne soit pas provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l’organisation sociale d’une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire.
À cet égard, il convient en effet d’admettre que l’émergence économique est différente du développement. Mieux, que la question de l’émergence diffère de celle d’une stratégie de développement et que l’émergence ne tient lieu de nouvelle théorie du changement et du développement, ainsi que renchérissent Alain Piveteau et Eric Rougier.
Une économie de l’émergence n’a donc vocation ni à remplacer ni même à concurrencer l’économie du développement. Se situant du côté des énoncés de faits, mais aucunement du côté d’une « évaluation des états du monde, l’émergence recouvre un faisceau de changements contradictoires dont l’issue, même provisoire, reste incertaine » (M. Blaug, 1994, p. 108).
Il devient ainsi compréhensible pourquoi certains analystes qualifient la dynamique systémique des BRICS en matière de développement, comme une dynamique molle, car, les systèmes socio-économiques et technologiques nationaux de ces pays présentent beaucoup de faiblesses qui, à moyen ou long terme, peuvent affecter l’émergence de ces économies. En effet, par exemples, la Russie a encore besoin de la technologie occidentale pour mettre en valeur ses nouveaux gisements. La Chine n’a pas de système national d’innovation moderne et hautement performant, mais plutôt un système traversé par la contrefaçon sur fond de pauvreté ambiante, particulièrement, dans les zones rurales.
Par ailleurs, dans l’ensemble, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa) sont handicapés par une série de faiblesses, notamment, un cadre juridique peu propice à l’amélioration du climat des affaires, un système éducatif insuffisant ou inadéquat, des infrastructures lacunaires, l’écart scientifique et technique qui sépare les pays développés des pays émergents reste considérable, le Brésil et la Russie sont très dépendants du cours des matières premières, la corruption et les inégalités hypothèquent l’avenir russe, l’Inde et la Chine sont des pays dont l’unité est problématique du fait qu’ ils ont un modèle multiculturel fragile voire conflictuel.
Selon P. Hugon (2010, pp. 250-253), chercheur à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques(IRIS), plusieurs critères peuvent être retenus pour caractériser les pays émergents :
taux de croissance économique, transition démographique, remontée en gamme de produits dans les chaines de valeur internationale, diversification de la production, des exportations et des importations, intégration au monde financier international, rôle de l’État facilitateur du développement, capacité de contrôle du territoire, investissement dans la formation, la recherche et développement. (…) Les critères d’émergence diffèrent selon que l’on prend comme indicateur le PIB (Produit Intérieur Brut) par tête en PPA (Parité de Pouvoir d’Achat), l’IDH (Indice de Développement Humain), l’empreinte écologique. (…) Au-delà de ces critères, on observe à la fois une très grande diversité des régimes politiques, des structures sociales et des profils institutionnels, des trajectoires et des configurations nationales depuis les États géants jusqu’aux villes ports, États tampon ou charnières.
Paul Derreumaux, économiste, consultant indépendant et Président d’honneur du Groupe Bank Of Africa, note,lors d’une présentation effectuée à Paris le 11 juin 2015 à l’invitation conjointe de la Fondation Prospective et Développement et de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (FERDI) dans le cadre de leur cycle sur « Les témoins d’Emergence », que, dans une Afrique stable et pacifiée, quatre conditions sont nécessaires pour atteindre l’émergence. Ces conditions ou piliers d’émergence pourraient donc se résumer à quatre consignes : investir, inciter, innover et inclure. Deux d’entre elles au moins relèvent avant tout de la sphère politique. Celle-ci tiendra donc un rôle de plus en plus crucial pour que le développement économique et social s’installe de manière « on-shore » sur le continent, c’est-à-dire profite au plus grand nombre et s’inscrive dans la durée. À la différence de la décennie précédente, l’Afrique, surtout subsaharienne, devrait être de moins en moins considérée comme un bloc homogène et analysée en tant que telle, au fur et à mesure que les piliers évoqués s’édifieront à une vitesse et une solidité variables. L’Afrique laissera ainsi la place aux États africains, et parfois à leurs regroupements en régions économiques si celles-ci sont assez consistantes. Seuls certains territoires du continent accèderaient alors au statut de « zones émergentes » dans les deux prochaines décennies. Les autres pays risqueraient d’évoluer entre une fragilité croissante, s’ils sont trop isolés, et une progression plus lente et incertaine, s’ils restent intégrés dans une zone globalement soutenue par un ou deux pays figurant parmi les leaders. L’avenir nous dira si la sagesse et la solidarité l’emportent pour faire évoluer l’Afrique dans la meilleure de ces deux directions.
Faisant donc la synthèse des réflexions récentes sur les économies émergentes dans la revue géopolitique consacrée à l’histoire des mondialisations, Philippe Hugon propose les critères suivants pour être un pays émergent : le taux de croissance économique, la taille de la population, la diversification de la production, l’importance des exportations et des importations (taux d’ouverture), l’intégration au monde financier international, le rôle stratégique de l’État pour le développement, les investissements dans la Recherche et le Développement et la capacité de protéger le territoire. Lesquels critères ne peuvent être atteints que dans un espace pacifié, réconcilié et stable, dans un environnement de coexistence pacifique ; ce qui fait du coexister l’une des conditions, l’un des vecteurs de l’atteinte de l’émergence et c’est ce que nous allons nous atteler à expliquer dans la seconde partie de ce texte.
2. Le coexister comme un vecteur de l’émergence
Si la question de l’être a été la préoccupation essentielle de Martin Heidegger, c’est pour qu’au-delà de la détermination strictement philosophique, l’homme saisisse radicalement son essence pour y conformer son vécu quotidien dans ses aspirations les plus légitimes, parmi lesquelles nous avons la relation avec l’autre, comme valeur participant à la définition du je. Les autres ne sont pas toujours ceux qui sont différents de moi, mais ceux avec qui je ne me distingue pas et avec qui je me retrouve. Le monde du Dasein est celui où il partage avec les autres puisque l’être-au-monde implique l’être-avec-les autres. Comme M. Heidegger (1962, p. 107) le dit si bien: « Le Dasein se trouve « soi-même » dans ce qu’il fait, dans ses besoins, dans ses attentes, dans ses préventions, dans l’étant disponible intérieur au monde ambiant dont il se préoccupe de prime abord ».
Le Dasein se préoccupe du monde dans lequel il habite, car il est être-au-monde. Heidegger, dans Le principe de raison,parle de la rose qui est sans pourquoi, qui n’a pas de raison d’être. Elle est rose sans qu’elle pense à ce qu’elle est elle-même. Elle est sans pourquoi, comme l’écrit M. Heidegger (1962, p. 107), tandis que :
L’homme diffère de la rose en ce que souvent, du coin de l’œil, il suit avidement les résultats de son action dans le monde, observe ce que celui-ci pense de lui et attend de lui. Mais, là même où nous ne lançons pas ce regard furtif et intéressé, nous ne pouvons pas, nous autres hommes, demeurer les êtres que nous sommes, sans prêter attention au monde qui nous forme et nous informe et sans par là nous observer aussi nous-mêmes.
Les autres sont rencontrés par le Dasein dans le monde car « c’est au monde que la coexistence de l’autre nous accompagne » (M. Heidegger, 1962, p. 151). C’est la vie en société qui commande une connaissance authentique de l’homme et des choses, afin de la porter à sa vérité. En effet, c’est parce que l’autre participe à l’expression de mon être, qu’il apparaît nécessaire de me saisir et de saisir ma relation avec les choses dans la clarté. Le monde dans lequel je suis est un monde partagé. C’est un mode existential du Dasein d’être-au-monde comme être-avec-autrui même si personne n’allait être présente dans le monde. Le Dasein est existentialement un être-avec-autrui. Même lorsque le Dasein est seul, il reste un être-avec-autrui, car il est un être-au-monde avec autrui. Ainsi M. Heidegger (1962, p. 152) dira :
être-avec-autrui est une détermination de l’être-là en tant que mien ; la coexistence caractérise l’être-là d’autrui en tant que cet être-là s’offre à un être-avec-autrui, au monde de celui-ci. Mon être-là ne peut être coexistence offerte à la rencontre d’autre que parce qu’il a lui-même la structure essentielle de l’être-avec-autrui.
C’est là la grande préoccupation du Dasein qui est compris comme souci. Et le souci du Dasein ne peut être authentique que parce qu’il a le souci de l’Être. C’est ce dernier souci qui fait qu’il est le souci du Dasein qui est avec moi dans le monde. Mais le souci de l’Être doit passer par le souci de l’autre qui coexiste avec moi dans le monde. Le Dasein se préoccupe de l’autre parce qu’il est un être-là comme moi. Il n’est pas comme l’outil que je rencontre à l’intérieur du monde. Le Dasein ne doit plus se préoccuper de l’autrui comme pour les choses, mais il doit faire l’assistance de l’être-là qu’il rencontre dans le monde avec qui il coexiste ontologiquement et existentiellement.
Partant, il y a l’idée de destin commun d’une nation chez Heidegger, tel que l’explique J. L. Nancy (2007, p. 36) :
De manière surprenante dans le contexte de Être et temps, mais de manière très classique (fichtéenne, hégélienne, par exemple), le destin commun seul sanctionne en vérité le sort de chacun, ou plus précisément le sens de ce sort. Le sort commun de la mort disparaît en somme deux fois : une fois en tant que décès banal qui reste en extériorité par rapport à l’abandon à la possibilité suprême de l’exister, une autre fois selon la sublimation que le commun destin opère de la mort individuelle.
C’est donc la prise de conscience d’un destin commun dans un État pacifié et stable, ou encore le coexister, qui peut mobiliser les énergies et créer les conditions de la quête et de l’atteinte de l’émergence. Le faisant, le coexister devient le vecteur de l’émergence, c’est-à-dire son ferment, son catalyseur épistémologique, ce qui sert de support à la réalisation de l’émergence. C’est alors que les coexistants pourront examiner la situation sociale attentivement, enregistrer les faits pour connaitre leur substance et confesser une situation nouvelle ou accepter un nouvel état des choses qui se dessine, reconnaître le mouvement d’émergence. Car nul n’ignore l’importance cruciale de la reconnaissance dans le processus de socialisation, tel qu’expliqué dans l’article de Wenceslas Lizé (2015), enseignant de sociologie à l’Université de Poitiers. Ce phénomène est important pour l’avenir de l’État et du vivre-ensemble. Dans l’un des essais les plus influents de ces dernières décennies en philosophie politique, intitulé « La politique de reconnaissance », C. Taylor (2009, pp. 41-42) promouvait là « l’exigence de reconnaissance au rang de besoin humain vital ».
Concevoir une nation émergente, c’est l’envisager réconciliée avec elle-même et avec les autres nations, ce qui implique la rencontre et la reconnaissance de l’autre, dans un dépassement des appartenances communautaires et des solidarités primordiales des sociétés de la parenté dans une société politique volontaire constituée par l’unité de la diversité. Elle appelle à transcender les appartenances premières dans une appartenance nationale tissée dans la paix, la stabilité, le coexister et par la solidarité citoyenne.
Conclusion
En définitive, la définition de l’émergence économique renferme une dose de subjectivité liée au choix des critères de classification qui présente des pays émergents selon le FMI, Standards & Poors, l’IRIS, le CEPII, etc. (E. Brière, 2009). L’émergence d’un pays donné renvoie alors à une vision fortement systémique qui prend en compte des critères économiques, politiques et stratégiques, s’inscrivant dans une dynamique nationale et internationale. L’émergence de tout pays vise l’objectif de puissance économique dans l’environnement mondial et elle ne peut se réaliser que dans un climat apaisé et de coexistence intelligente.
L’émergence implique une ontologie pluraliste. Elle renvoie à un monde pluriel, en évolution, dans lequel de nouvelles formes d’existence peuvent apparaître. Derrière la notion d’émergence économique, il faut entendre une demande d’autonomie qui grandit partout dans un monde qui nous juge sévèrement et qui probablement va nous conduire à de nouveaux « Bandoeng », selon Hervé Juvin (2012). C’est probablement là que se situe le vrai basculement, le vrai renversement de nos certitudes faciles. Le paysage à venir sera tout à fait différent. La demande d’autonomie, la demande de souveraineté et la demande de diversité collective sont devant nous. Derrière la notion trouble d’émergence économique, il faut entendre également la demande de puissance, de dignité et de liberté collectives.
En Afrique principalement, l’émergence est devenue beaucoup plus une notion stratégique de gouvernance politique qu’un projet volontariste de développement. L’émergence est-elle nécessairement un concept positif ? On peut en douter au regard de l’expression « pays émergents ». N’est-ce pas le cynisme de la novlangue qui nous enjoint de ne plus parler de pays pauvres ou en voie de développement, alors même que l’on sait que leurs chances d’émerger sont pratiquement inexistantes ou difficilement réalisables, du moins en l’état actuel des choses ?
Certes, les années 2000/2010 ont marqué le retournement progressif de l’appréciation portée de l’extérieur sur le continent africain et l’arrivée d’un afro-optimisme, selon Paul Derreumaux, lors de son intervention évoquée un peu plus haut. Cette analyse s’est trouvée globalement confirmée ces dernières années, en dépit des crises sanitaires et terroristes qui frappent une partie de l’Afrique, et des dirigeants africains de plus en plus nombreux aspirent eux-mêmes ouvertement à l’émergence économique. L’analyse des conditions de l’émergence en Afrique montre toutefois leur complexité, et les obstacles qui perdurent, parmi lesquels des crises politiques et des instabilités sociales, réduisant les chances d’un coexister, condition sine qua non de l’atteinte de l’émergence, risquent de limiter le nombre de ceux des pays qui atteindront cet objectif.
Comme une pépite du tamis d’un chercheur d’or, sachons faire émerger l’authenticité des vérités contre le fard des illusions !
Références bibliographiques
ALEXANDER Samuel, 2004, Space, Time and Deity, The Gifford Lectures At Glasgow, Vol. I, Whitefish, Kessinger Publishing, p. 342, 396 p.
BLAUG Marc, 1994, La méthodologie économique, Paris, Editions Economica, 285 p.
BOURDIEU Pierre, 2013, Manet, Une révolution symbolique. Paris, Seuil, 384 p.
COMTE Auguste, 1943, «Cours de philosophie positive », 2e leçon, Œuvres choisies, Paris, Aubier, pp. 119-120, 316 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et Temps, traduit de l’allemand au français par François Vézin, Paris, Gallimard, 581 p.
HEIDEGGER Martin, 1962, Le principe de raison, trad. André Préau, Paris, Gallimard, 280 p.
HONNETH Axel, 2013, La Lutte pour la reconnaissance, trad. Pierre Rusch, Paris, Gallimard, 352 p.
HUGON Philippe, 2010, « Crise et mondialisation : La place de second monde émergent et du tiers monde », Revue de Géopolitique, n° 110, pp. 247-264.
JUIGNET Patrick, 2015, « Le concept d’émergence », Philosophie, science et société [en ligne]. https://philosciences.com/Pss/philosophie-generale/complexite-systeme-organisation-emergence/38-le-concept-d-emergence.
JUVIN Hervé, 2010, Le renversement du monde-Politique de la crise, Paris, Gallimard, 272 p.
JUVIN Hervé, 2012, « L’émergence, une notion stratégique », Cahier Les États émergents : vers un basculement du monde ? (Actes du colloque du 10/12/2012 mis en ligne le 06/02/2013 sur le site : www.fondation-res-publica.org
LAUGHLIN Robert et PINES David, 2000, « The theory of everything », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol 97, n°1, p. 28.
LEWES George Henry, 1875, Problem of Life and Mind, Vol 1, numérisé le 17 février 2006, London, Trûbner & co, 500 p.
LIZÉ Wenceslas, 2015, « RECONNAISSANCE, sociologie », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 19 février 2017. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/reconnaissance-sociologie/
MBALOULA Marcel, 2011, « La problématique de l’émergence économique des pays en voie de développement », Revue Congolaise de Gestion, Numéro 14, Roche-Sur-Yon, Editions ICES, 132 p.
NANCY Jean-Luc, 2007, « L’être-avec de l’être-là », Cahiers philosophiques, N° 111, pp. 66-78.
PARIS Robert, 2012, « Le tout est-il la somme des parties et….du rien ? », Matière et révolution, sur le site http://www.matierevolution.org/
PERROUX François, 1964, L’économie du XXème siècle, Paris, PUF, p. 155.
PIVETEAU Alain et ROUGIER Éric, 2010, « Émergence, l’économie du développement interpellée », Revue de la régulation [En ligne], 7 | 1er semestre / Spring 2010, consulté le 13 juin 2017. URL : http://regulation.revues.org/7734, pp. 1-17.
TAYLOR Charles, 2009, « La politique de reconnaissance », Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Flammarion, 139 p.
LES DÉFIS CULTURELS DE LA RECONNAISSANCE EN AFRIQUE À L’ÈRE DE LA PROCRÉATIQUE
Victorien Kouadio EKPO
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
kouadioekpo@yahoo.fr
Résumé :
Les techniques de la procréatique, qui gagnent peu à peu les espaces culturels africains, ne sont pas neutres. Elles touchent le système de parenté qui est une institution sociale fondamentale constituant l’architectonique de la reconnaissance des individus. La procréatique, en dissociant les étapes de la procréation et, surtout, le rôle du père et de la mère dans le processus de reproduction, confère une identité plurielle à l’individu en déstructurant des représentations, fortement enracinées, permettant d’évaluer sa reconnaissance. Elle conduit à une fracture de la filiation et est susceptible de conduire à une éclipse de la visibilité du sujet.
Ce texte ambitionne de comprendre les mutations introduites par les technosciences biomédicales au sein de la procréation naturelle en analysant leurs impacts sur la reconnaissance. Il conduit à affirmer que, pour éviter le mépris social, l’entrelacement de la procréatique avec la reconnaissance doit favoriser l’émergence de normes inédites à la hauteur des défis inédits que la procréatique lance aux cultures africaines. Il s’agit de démontrer que la reconnaissance doit se renouveler en intégrant progressivement et au cas par cas les techniques de la procréatique.
Mots-clés : Afrique, Culture, Émergence, Éthique, Procréatique, Reconnaissance.
Abstract :
Procreatic techniques which are getting to African cultural spaces are not neutral. They affect the kinship system which is a fundamental social institution forming the architectonic of the individuals’ recognition. By dissociating the stages of procreation and, above all the role of the father and the mother in the process of reproduction,procreatics confers a pluralist identity to the individual by destructuring deeply rooted representations, to evaluate its recognition. It leads to a split of filiation which is likely to result in an eclipse of the subject’s visibility.
This text aims to understand the changes brought in by biomedical technosciences within natural procreation by analysing their impact on recognition. It opens out onto asserting that, to avoid social contempt, the intertwining of procreatics with recognition must favour the emergence of new standards up to new challenges that procreatics throws to African culture. The aim is then to demonstrate that recognition must be renewed by gradually integrating procreatic techniques on a case-by-case basis.
Keywords : Africa, Emergence, Ethics, Procreatics, Recognition.
Introduction
Les critères de la reconnaissance dans des cultures africaines sont, dans une large mesure, organisés par la procréation et le système de parenté qui confèrent un statut a priori à chaque individu avant toute compétition sociale. « La parenté (…) constitue le principal élément d’identification et de référence dans la société » (M. Koné & N. Kouamé, 2005, p. 18). Elle est essentielle à la reconnaissance sociale de l’individu. Des attentes et des demandes de reconnaissance sont au centre des normes culturelles qui président à la procréation. Ainsi, les enfants issus des alliances interdites par leur culture ne sont pas pleinement reconnus. Les procréations dans des conditions non tolérées se révèlent préjudiciables à la reconnaissance de l’enfant issu de cette alliance et peut même conduire, dans certaines cultures, au déni de reconnaissance des parents en les privant de certains droits. La question de la reconnaissance qui est fondamentale à tout individu et à toutes les communautés est remise en scelle avec la procréatique, qui gagne peu à peu du terrain sur le continent africain. Cette dernière, met en jeu des institutions traditionnelles qui présidaient à la procréation. En effet, des techniques de la procréatique, le don de sperme, d’ovule ou d’embryon dissocient les étapes de la procréation et les rôles du père et de la mère. Elles déstabilisent des certitudes culturelles fortement ancrées dans les mentalités et les comportements. Il va sans dire que les normes traditionnelles relatives à la naissance et à la filiation, qui constituent l’ossature de la reconnaissance, se trouvent fortement perturbées.
Ce texte a pour objectif de comprendre des mutations introduites par les technosciences biomédicales au sein de la procréation naturelle en analysant leurs impacts sur la reconnaissance. En questionnant en direction de la reconnaissance des enfants issus de la procréatique, l’interrogation suivante sera examinée : faut-il conserver les normes traditionnelles qui organisaient la procréation et avec elles la reconnaissance qui l’accompagne ? L’intellection de cette question centrale se fera à partir des approches historico-critique et prospective. Elle conduira à affirmer que la reconnaissance ne saurait être déterminée une fois pour de bon. Elle doit se renouveler en intégrant progressivement et au cas par cas les techniques de la procréatique. Pour élucider cette thèse, l’émergence de la procréatique en lien avec les cultures africaines sera examinée (1), cet examen favorisera l’intellection des écueils axiologiques de la procréatique en Afrique (2). Pour surmonter les écueils axiologiques de la procréatique en Afrique, des paradigmes éthiques pour une coévolution de la reconnaissance avec la procréatique seront proposés (3).
1. Techniques de la procréatique et cultures africaines
La stérilité et l’infécondité sont présentes dans toutes les sociétés. Toutes les cultures développent des moyens plus ou moins efficaces pour lutter contre celles-ci, puisqu’elles constituent une entrave au désir de procréation. Les sociétés africaines déploient des moyens de lutte contre la stérilité et l’infertilité parce que la procréation assure « la reproduction statutaire de [leurs] (…) membres » (M. Koné & N. Kouamé, 2005, p. 15). La volonté de dépasser la stérilité dans les sociétés traditionnelles africaines se faisait à travers des plantes médicinales ou des prières adressées aux dieux. Elle n’introduisait aucune dissociation dans le processus naturel de procréation. La lutte contre les dysfonctionnements physiologiques, préjudiciables à la procréation, relevait à des degrés variés de la loterie et les causes de l’infécondité n’étaient pas toujours expliquées de façon rationnelle. Ces approches de la stérilité et de l’infertilité sont, aujourd’hui, phagocytées par l’émergence de la procréation médicalement assistée (PMA) qui lutte contre la stérilité ou l’infertilité par une intervention active dans les étapes de la procréation.
Les moyens de lutte contre la stérilité connaissent une révolution avec la médecine contemporaine qui favorise la compréhension et la connaissance des lois qui président à la procréation. Aujourd’hui, le médecin intervient au sein de la procréation en guérissant certaines stérilités ou en contournant leurs effets en vue de satisfaire le désir des candidats inaptes à la procréation pour des raisons physiologiques. L’ensemble des techniques utilisées pour parvenir à cette fin est regroupé sous le vocable de la procréatique dont la finalité première était de lutter contre la stérilité en apportant une assistance aux couples frustrés dans leur volonté de procréer.
La « procréatique est un terme générique pour désigner l’ensemble des nouvelles techniques de reproduction assistée » (F. Leroy, 2001, p. 675). La procréatique ou procréation médicalement assistée désigne les interventions technoscientifiques dans la procréation. Elle s’articule autour de plusieurs pratiques notamment l’insémination artificielle, la location d’utérus, la conservation de sperme et d’embryons congelés, la Fécondation in vitro avec transfert d’embryon (FIVÈTE).
La procréatique interroge, de façon spéciale, les certitudes culturelles relatives à la procréation. « L’apparition du concept de “procréatique” (…) n’est pas innocente. En effet, elle sous-entend l’idée que les méthodes en question sont susceptibles de transgresser le cadre médical pour répondre à d’autres motivations peut-être moins acceptables. Cette dialectique traduit une préoccupation qui se trouve au centre du débat éthique » (F. Leroy, 2001, pp. 675-676).
La médecine de la reproduction explique scientifiquement ce qui apparaissait mystérieux dans la procréation. Elle confère un pouvoir nouveau à l’humanité au sein de la procréation. La procréatique désorganise la reproduction naturelle et la remanie. Elle attribue un nouveau pouvoir à l’homme en consacrant le passage de la délibération naturelle à la délibération humaine au sein de la procréation à travers une intervention active.
En outre, la lutte contre la stérilité en Afrique est une lutte pour la reconnaissance. Et, la procréatique donne des armes de cette lutte aux individus frustrés dans leurs désirs de procréer. Elle semble a priori, de ce point de vue, être en conformité avec les cultures africaines qui accordent une place focale à la procréation dans la représentation du couple. L’histoire de la famille se perpétue « de père en fils (…), par le biais de la filiation et de la progéniture » (H.-C., K. Ouédraogo, 2015, p. 9). L’anthropologie du lien social en Afrique conduit à affirmer que les filiations constituent les déterminants importants des liens sociaux. « Les filiations de type biologique confèrent au lien social une résistance et une persistance dont l’explication ne réside que dans les consciences identitaires et historiques collectives, elles mêmes inscrites dans la reconnaissance et la légitimation de l’ordre social » (F. Akindès, 2003, p. 385). La filiation et la descendance impliquent des liens fortement intégrés que nulle autre forme de sociabilité.
La reconnaissance permet d’identifier et d’attester l’identité du sujet impliquant des capacités personnelles ou le lien social. L’expérience de la reconnaissance donne « la possibilité d’instaurer une relation positive à soi-même » (A. Honneth, 2000, p. 290). Elle comporte une dimension d’intégration et d’approbation sociales favorisant la réussite de la réalisation du sujet.
La reconnaissance se situe à plusieurs niveaux. Elle est aussi bien revendiquée au sein de l’espace public que dans la sphère privée. Elle peut s’exprimer dans le langage, la morale, la culture et en fonction des circonstances. En ce qui concerne la procréation, la reconnaissance peut porter sur la féminité de la femme et la masculinité de l’homme qui, au-delà des apparences, se conçoivent en relation avec leurs capacités respectives de procréer. La procréation est vécue comme un rite initiatique qui ouvre la porte à la féminité et bien sûr, à la masculinité. « Au Maghreb, la stérilité masculine est socialement très dévalorisante » (X. Thévenot, 1989, p. 84).
L’absence d’enfant dans le couple transforme celui-ci en un véritable foyer dont le feu est alimenté par des querelles et le désir de reconnaissance des conjoints par la communauté. Pour atténuer l’univers infernal du foyer sans enfant, des moyens de lutte contre la stérilité sont développés dans toutes les cultures africaines. En Afrique, « ne pas pouvoir engendrer est considéré comme une véritable calamité. En effet, quand il y a naissance, tout le monde se sent concerné et impliqué que ce soit le village et le lignage, les vivants et les défunts ; les hommes et les dieux. L’enfant jouit de la protection et de l’attention de l’ensemble du groupe » (I. Gueye, 2012, p. 65). La procréation est valorisée en Afrique : elle influence les niveaux de reconnaissance des individus.
S’il est évident que la procréation est valorisée en Afrique, toutes les alliances ne sont pas autorisées. Dans des sociétés à castes où la classe des esclaves se distingue de celle des hommes libres et des nobles, l’alliance entre un descendant d’esclave et celui d’un noble est considérée comme contre nature et dangereuse pour la noblesse qui la considère comme un acte d’impureté : le “sang” de l’esclave compromettrait celui de la noblesse en la souillant.
La reconnaissance traduit l’estime de soi. Elle renforce le « degré de confiance en soi, d’autonomie légalement garantie et d’assurance quant à la valeur de ses propres capacités » (A. Honneth, 2000, p. 290). La reconnaissance du sujet contribue à la création de ses projets et à la constitution du sentiment de confiance dans ses capacités pour les mener à bien. Elle influence les rôles et les projets de sorte que son déni exige que l’individu ajourne certains projets dont la mise en œuvre dépend du niveau de reconnaissance. Nous pensons à l’exercice du pouvoir politique dans certaines cultures qui interroge, avant tout, les conditions de naissance de l’individu. Les discriminations ou hiérarchies sociales se reproduisent sur le plan biologique. Cela explique, en partie, dans des cultures africaines le critère de lien de sang dans l’héritage du pouvoir politique traditionnel qui, bien qu’atténué dans certaines cultures, continue de dispenser encore du sens dans d’autres aires culturelles. La parenté détermine les droits à l’héritage. Elle organise la propriété et l’administration de l’ensemble des charges et des droits exercés par le défunt. Elle porte sur la succession aux fonctions et sur celle des biens :
La succession aux fonctions assure la transmission des valeurs sociales et religieuses des charges et pouvoirs détenus par le défunt dans le lignage. Elle suppose aussi la transmission des connaissances, plus particulièrement en matière médicale ; la succession aux biens ne consiste pas seulement en un transfert des biens individuels mais aussi des biens du lignage. La personne désignée pour les recevoir ne devient pas le propriétaire de ces biens. Elle n’en est qu’un administrateur, un gérant au profit du groupe tout entier (M. Koné & N. Kouamé, 2005, p. 60).
Les règles de la filiation recommandent que l’individu hérite de la communauté au sein de laquelle il est reconnu. Ce sont les « vrais parents » selon que nous soyons dans le système matrilinéaire ou patrilinéaire qui ont droit à l’héritage. « Celui qui ne figure pas dans le groupe des héritiers potentiels peut être considéré comme un parent secondaire » (M. Koné & N. Kouamé, 2005, p. 15). La reconnaissance juridique ne suffit pas pour avoir accès aux biens du lignage si les conditions de naissance sont considérées comme inacceptables par la communauté. L’accès aux biens du lignage relève d’une reconnaissance qui est au-delà de celle accordée par le père ou la mère.
S’il est vrai que la capacité de procréer influence la reconnaissance sociale, faut-il procréer à tout prix ? Quels doivent être les moyens utilisés pour la procréation ? Les techniques de la procréatique conduisent-elles à une éclipse ou à une reviviscence de la reconnaissance ? La procréation par les méthodes naturelles doit-elle être le seul fondement de la reconnaissance sociale ? Ces questions préfigurent les écueils axiologiques de la procréatique en lien avec la reconnaissance.
2. Des écueils axiologiques de la procréatique en Afrique : vers une éclipse de la reconnaissance ?
Les questions éthiques relatives à la procréatique se posent surtout lorsque celles-ci transcendent le cadre médical. Cependant, avant tout usage extra médical cette technique s’accompagne de vives questions éthiques invitant l’humanité à une conversion de regard sur la procréation. Cette conversion met en jeu les structures culturelles traditionnelles au sein desquelles les délibérations éthiques relatives à la reconnaissance s’étaient jusque-là enracinées. La technique ne peut toucher aux représentations qui organisent la procréation et la reconnaissance sans déstructurer l’éthique qui les accompagne.
Suffit-il qu’un enfant soit reconnu par son supposé père et sa mère pour que la reconnaissance sociale s’ensuive ? Assurément non ! La reconnaissance de l’individu par ses parents s’inscrit dans un processus de reconnaissance sociale qui semble avoir plus de valeur que la reconnaissance parentale. L’autonomie du couple et le droit de procréer peuvent rentrer en conflit avec les institutions culturelles. Un enfant qui n’est pas socialement reconnue par sa communauté s’intégrera difficilement à celle-ci. Ses droits seront constamment violés. La procréation est loin d’être une simple affaire privée. Elle transcende le couple pour devenir une question communautaire. La communauté à son mot à dire sur les conditions de procréation à travers la mise en place d’un cadre normatif, qui s’impose d’emblée à tous les candidats à la procréation. Dans ces conditions, toucher à la procréation risque d’ébranler le système social qui l’enveloppe.
L’usage des techniques de la procréatique n’est pas seulement une affaire privée. Elle va au-delà de la dimension intime, familiale : « toute conduite humaine s’inscrit dans un réseau de significations culturelles et a des conséquences sociales immédiates et lointaines » (X. Thévenot, 1989, p. 35). La reconnaissance sociale se construit au prisme des liens sociaux irrigués par des valeurs culturelles partagées. Elle s’inscrit dans une idéologie sociale : « les institutions sont des moyens que la société se donne pour agir de façon durable et efficace sur le tissu social (…). Elles sont aussi des instances de négociation entre les intérêts parfois rivaux des groupes et des individus » (X. Thévenot, 1989, p. 37). Toute conduite humaine se situe dans un réseau institutionnel. Elle peut soit la fragiliser, soit la consolider. Une conduite louable, sous l’angle privé, peut être une source de désordre social. La reconnaissance a une dimension éminemment sociale, puisqu’elle confère un statut à l’individu en lui attribuant des rôles sociaux. La reconnaissance n’existe et ne vaut que dans la communauté.
Le déni de reconnaissance de l’enfant issu de la procréatique constituerait une pathologie sociale conduisant la société à un manque de compassion vis-à-vis du couple victime d’une pathologie biologique qu’il atténue ou guérit par le recours à la médecine de la procréation. Le déni de reconnaissance fragilise l’individu en le rendant socialement vulnérable. En fait, un individu non reconnu par sa société manque d’estime sociale et se situe dans l’anonymat. Son invisibilité s’accompagne d’humiliation et de domination liées à des discriminations et à l’injustice.
Le déni de reconnaissance cause du tort aux individus méprisés en ce sens que leur statut est jugé inférieur. Cette infériorité est à la source de la légitimation des discriminations dont ils sont victimes. « Se voir dénier la reconnaissance de ce point de vue, (…) c’est être empêché de participer en tant que pair à la vie sociale, en conséquence de modèles institutionnalisés de valeurs culturelles qui constituent certaines personnes en êtres ne méritant pas le respect ou l’estime » (N. Fraser, 2011, p. 50). Le déni de reconnaissance, en faisant du sujet une victime des représentations culturelles dépréciatives, est à la source d’injustices institutionnalisées entravant l’égale participation des méprisés à la vie collective. La reconnaissance, bien orientée, permet de combattre les injustices. « La forme de reconnaissance que requiert la justice dépend donc des formes de déni de reconnaissance qui doivent être combattus » (N. Fraser, 2011, p. 55).
La procréatique renouvelle le système de parenté d’une façon inimaginable avec le phénomène de mère de substitution, de procréation post mortem, d’insémination artificielle avec donneur anonyme etc. Elle est capable de brouiller les filiations et la descendance par la dissociation des étapes de la conception de l’enfant et celle de sa naissance. Le système traditionnel de parenté se trouve fortement perturbé avec ces différentes techniques. Nous assistons alors au renouvellement des injustices et des dénis de reconnaissance liés à la parenté. « [La parenté] détermine non seulement les mariages et les relations sexuelles, mais aussi le travail et la distribution des biens, les relations d’autorité, de réciprocité et d’obligation ainsi que toutes les hiérarchies symboliques de statut et de prestige » (N. Fraser, 2011, p. 60). La parenté justifie les droits et devoirs de chacun avant toute compétition sociale. Elle constitue le principe qui dicte la position sociale de l’individu et ce qui lui revient. Les privilèges et les désavantages sont ici, dans une large mesure, déterminés par la naissance. Le déni de reconnaissance est à la source de l’injustice puisqu’il entraîne, au sein des cultures africaines, une distribution inique. Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque l’institution économique n’est pas séparée de l’institution politique ou culturelle.
Dans des cultures africaines à économie agricole, les terres sont parfois détenues par une minorité qui exerce le pouvoir politique et organise l’économie liée à la distribution des terres. La discrimination dont seraient victime les enfants issus de la procréatique, qui se manifesterait sous l’angle culturel aurait des répercussions économiques en privant, par exemple, ceux-ci de l’accès à certains biens vitaux comme la terre. Ils seraient condamnés à subir la loi des propriétaires terriens s’ils sont agriculteurs. La reconnaissance peut renforcer ou entraver la distribution des richesses ou des rôles sociaux. Elle est un mécanisme susceptible de servir la justice et l’injustice. « La justice implique à la fois la redistribution et la reconnaissance » (N. Fraser, 2011, p. 14).
La reconnaissance de l’enfant questionne en direction des conditions de sa conception. Un enfant conçu par une relation prohibée comme l’inceste, ou conçu par des parents qui, au regard des normes culturelles, sont censés ne pas se marier au point de concevoir un enfant, à cause de la différence de classe sociale ou d’appartenance ethnique par exemple, ne sera pas reconnu au même titre qu’un enfant issu d’une alliance autorisée. Son statut social sera jugé inférieur à celui des autres. Cette situation conduit à une éclipse de la visibilité du sujet.
Dans certaines cultures africaines, les enfants nés hors mariage sont méprisés et considérés comme une source de honte, d’indignité non seulement pour la femme mais aussi pour sa famille. La faute individuelle rejaillit sur la famille qui se trouve stigmatisée au nom d’une procréation jugée non recommandable. De ce fait, « l’individu s’emploie au maximum à éviter une situation qui l’amènerait à avoir honte. Ce qui n’est pas facile, car nombreux sont les évènements qui peuvent mettre la honte sur une famille ou un clan puisqu’un individu n’affronte jamais seul une telle situation » (I. Gueye, 2012, p. 73). La communauté a un droit et même un devoir de regard sur le comportement de chacun de ses membres. Le comportement de l’individu implique sa famille, son clan, son groupe ethnique. L’honneur invite l’individu à un conformisme qui est à la source de son intégration et de sa reconnaissance sociale. La reconnaissance de l’individu se fait sur la base des conditions de sa naissance et sur la base de la reconnaissance sociale accordée à sa famille, à ses ascendants au sein de la communauté : « derrière [l’individu] on voit toujours sa famille, ses origines, son clan … » (I. Gueye, 2012, p. 63).
Comment concevoir, alors, l’identité d’un enfant issu de l’insémination artificielle avec donneur (IAD) ou d’un don d’embryon avec des donneurs anonymes ou extérieurs à la famille ? Si nous sommes dans des sociétés à patronymes fixes, comment identifier l’individu de façon honorable si l’un des repères fondamentaux de sa reconnaissance est brouillé ? Peut-il porter le nom de famille de son supposé père, tant il est vrai que l’évocation du nom permet de retracer l’arbre généalogique ? Si l’enfant né hors mariage est méprisé dans des cultures africaines, qu’en sera-t-il de ceux issus de la procréatique avec donneurs anonymes ? Si des cultures acceptent difficilement des unions entre des personnes connues qu’en sera-t-il des enfants nés de la procréatique avec anonymat des donneurs de cellules ? Si l’anonymat concerne le père, cela pourrait s’apparenter à la situation des enfants qui ne connaissent pas leur père, soit pour cause de décès, soit parce que ce dernier refuse de les reconnaître, soit parce que la mère n’arrive pas à établir une paternité fiable.
L’anonymat des donneurs de sperme ou d’ovule, ou encore le recourt aux banques d’embryons sera à la source de profondes inquiétudes relatives à la reconnaissance et à la succession si le travail d’intégration de la procréatique comme une modalité de la reproduction n’est pas réalisé. Cette situation favorisera la fécondité des phantasmes relatifs à la procréatique en renouvelant les mépris liés à la filiation qui s’atténuent progressivement.
Dans des sociétés africaines patrilinéaires, l’anonymat du donneur de sperme brouille le statut de l’enfant au sein de sa communauté. L’anonymat serait vécu autrement dans une société matrilinéaire si le sperme est fécondé avec l’ovule de la mère. En fait, dans les mentalités traditionnelles africaines et dans les juridictions, la mère est celle qui donne naissance à l’enfant. Dans ces conditions, une femme stérile qui fait recours à un don d’embryon, et qui porte la grossesse à son terme sera-t-elle reconnue comme la mère de l’enfant dont elle a porté la grossesse ? Si le statut de mère est accordé à la femme stérile, cette situation ne vient-elle pas déstructurer le fondement majeur des sociétés matrilinéaires qui stipule que l’enfant est toujours le “vrai” fils de celle qui le met au monde ? L’éthique qui structure les cultures matrilinéaires stipule qu’on ne peut pas tricher sur la mère.
L’interdiction des mères de substitution ne porterait-elle pas atteinte à la liberté et au droit de procréer si elle est la seule alternative susceptible de satisfaire le désir de maternité d’une femme incapable de porter à terme une grossesse pour des raisons médicales ?
Par ailleurs, les banques d’embryons en dissociant la conception de la naissance, ce qui fait qu’un enfant conçu en 2017 peut naître dix ou quinze ans après sa conception, interrogent la reconnaissance sociale de l’enfant. Dans des sociétés africaines à classe d’âge où il existe des générations, dans laquelle se situerait cet enfant ? Aurait-il la place de petit frère ou de grand frère tant qu’on sait que le droit d’ainesse est prisé dans des cultures africaines et confère des privilèges ?
La dignité sociale de l’individu se mesure à l’aune de sa reconnaissance. Un individu méprisé n’aura pas la même dignité et la même visibilité que celui qui est reconnu. L’invisibilité consacre l’anonymat social de l’individu et sa marginalisation dans la construction de la vie sociale. Le mépris des enfants issus de la procréatique interroge la justice sociale et, avec elle, la dignité qui est inhérente à la reconnaissance. L’expérience du mépris, suivant Honneth, altère la dignité humaine. « L’expérience du mépris constitue une atteinte qui menace de ruiner l’identité de la personne toute entière » (A. Honneth, 2000, p. 224). Le mépris, en isolant et en discriminant l’individu, fait le lit des conflits et peut s’ériger en une menace pour la paix sociale, lorsque la lutte pour la reconnaissance des enfants nés de la procréatique va se heurter à la résistance des cultures ayant la phobie du changement.
La procréatique crée des identités disparates qui déstabilisent les normes de la reconnaissance traditionnellement instituées. La reconnaissance sociale a une influence fondamentale sur nos pensées, nos actions et l’image que nous avons de nous-mêmes. « Le sentiment d’identité peut être non seulement source de fierté et de joie, mais également de force et de confiance en soi » (A. Sen, 2010, p. 23). Le déni de reconnaissance d’une identité peut conduire celle-ci à s’affirmer autrement en devenant une identité belliqueuse.
La famille subit des influences de plusieurs ordres. Son fondement s’inscrit dans une dynamique en fonction des époques et des contextes. « La structure familiale varie parce que la famille est un carrefour d’influences d’ordre [biomédicale], économique, social, religieux, philosophique » (M-H. Renaut, 2012, p. 7). La famille “traditionnelle” est menacée d’éclatement au profit de la diversité des structures familiales qui accompagnent la procréatique. La société doit-elle s’envelopper dans ses normes traditionnelles alors que la procréatique ouvre des perspectives nouvelles dans la procréation ? N’est-ce pas que les normes traditionnelles ont été instituées en fonction des connaissances d’une époque ? Sont-elles encore pertinentes à l’ère du renouvellement des connaissances relatives à la procréation ?
3. Pour une coévolution éthique de la reconnaissance et de la procréatique
La coévolution de la procréatique avec la reconnaissance exige que la société évite toute phobie de cette procréation pour mieux apprécier ses promesses et, bien sûr, ses risques. La procréatique, en permettant aux couples stériles de procréer, favorise le dépérissement du mépris dont ils sont victimes dans des sociétés africaines. Il revient, alors, à la société de réfléchir sur les conditions d’une intégration pacifique de celle-ci dans les normes qui président à la procréation. Dans les sociétés matrilinéaires et patrilinéaires, par exemple, on pourrait lever l’anonymat du donneur en utilisant respectivement les ovules de la sœur de la femme et le sperme du frère de l’homme. La question de la paternité et de la maternité ne se poserait pas, ici, puisque les oncles et les tantes sont considérés respectivement comme père et mère dans les cultures africaines. Cette alternative permet de respecter l’éthique qui structure les sociétés patrilinéaires et matrilinéaires. Il en va de même si la mère porteuse est choisie au sein de la famille de la femme.
Il ne serait pas choquant qu’une sœur puisse être une mère porteuse [pour le conjoint de sa sœur]. Et là, il n’y a pas de risque que la mère ayant prêté son ventre revendique un jour la maternité de l’enfant et des droits sur celui-ci, elle n’aura pas à le faire, car l’enfant est déjà le sien, conformément à la culture africaine (I. Gueye, 2012, p. 153).
Il est évident que les recours aux donneurs de gamètes et aux mères porteuses au sein de la famille peuvent être considérés comme des adultères cautionnés par la science, mais il n’en demeure pas moins qu’ils contribuent au respect de l’éthique qui structure les modes de successions patri et matrilinéaires. La question de la reconnaissance de l’enfant ne se poserait pas dans ce cas de la même manière que s’il était issu d’un donneur anonyme extérieur à la famille. Le lien de sang est dans ce contexte toujours conservé. Ce qui restera à faire sera le travail d’assimilation symbolique et d’intégration de la PMA dans les cultures africaines.
La tolérance des filiations traditionnellement condamnées permet de quitter le mépris caractéristique de la discrimination en consolidant l’union et la reconnaissance des individus, des castes ou des races, dont l’union avec un groupe de référence était jugée comme un sacrilège, contre-nature donc contre-éthique. Les liens du mariage interpellent les parents, les amis et alliés en substituant le mépris à la reconnaissance. « Le cercle du “nous” s’élargit, il met en contact beaucoup plus de gens. Quand les populations se diversifient culturellement et racialement, la sphère familiale devient un espace multiculturel et multiracial, un terrain partagé où chacun découvre l’humanité de l’autre » (J. Rifkin, 2011, p. 437). La présence de l’autre dans notre famille conduit à une conversion du regard sur lui d’autant qu’il devient difficile de continuer à le penser comme une altérité dangereuse à mépriser.
Des barrières traditionnelles rigides relatives à la filiation et à la reconnaissance culturelle, en Afrique, sont de plus en plus souples avec la promotion des droits de l’homme, l’évolution de la société, des mentalités et les voyages hors des aires culturelles favorisant la découverte et la compréhension de l’étranger qui était considéré comme une menace ou une faille dans l’identité. Des mariages jugés traditionnellement scandaleux pour des motifs subjectifs sont de plus en plus tolérés :
Les familles commencent à refléter l’esprit d’ouverture et de tolérance qui existe dans les écoles, sur les lieux de travail et dans la vie publique en général (…). Les nouvelles familles sont de plus en plus multireligieuses, multiculturelles et multiraciales – et, très concrètement, elles sont devenues de mini-diasporas (J. Rifkin, 2011, p. 434).
Les sociétés traditionnelles africaines sont, aujourd’hui, embarquées dans une dynamique d’ouverture permettant d’intégrer, à des degrés divers, des individus perçus jadis comme une menace pour l’identité du clan, de la communauté ou de la famille. C’est pourquoi J. Rifkin (2011, p. 435) écrit : « l’effondrement des murs culturels et le mélange des identités ethniques ont rapproché des personnes appartenant à des cultures autrefois séparées, voire hostiles, et rétréci le champ de l’”exclu” dans la plus intime de toutes les relations sociales, la famille ».
La question de la reconnaissance comporte des approches diverses et variées. Elle peut en fait porter sur plusieurs éléments. Ainsi, toute délibération sur la reconnaissance doit préciser son objet pour éviter toute confusion.
De ce point de vue, on pourrait paraphraser la question de Sen concernant le sujet qui nous occupe et poser la question : « reconnaissance de quoi ? ». Une telle question possède en fait deux versants : l’un objectif, qui concerne les propriétés qui peuvent faire l’objet d’une reconnaissance et servir de variables focales, l’autre subjectif, qui consiste à savoir ce que les hommes désirent voir reconnu. Le traitement de la question serait optimal si le choix des variables objectives, en nombre limité, coïncidait avec le désir des hommes. Or la première difficulté que l’on rencontre vient de ce que son versant subjectif semble immédiatement s’imposer et qu’il est gouverné par un principe de dispersion extrême des préférences. On a donc affaire a priori à une infinité de propriétés ou de capacités que les hommes désirent faire reconnaître : une appartenance civique, culturelle ou religieuse, des compétences dans toutes sortes d’activités qui prennent place dans les projets de vie les plus divers, des particularités personnelles en nombre infini (C. Lazzeri, & A. Caillé, 2004).
Les critères de la reconnaissance de l’individu ne sauraient se limiter aux conditions de sa naissance au point de le stigmatiser. Une hiérarchie peut être établie en fonction des différentes identités qui le caractérise suivant les contextes. Le critère biologique n’est pas forcement prioritaire. Sa priorité dans l’accès à l’emploi, par exemple, est une affaire de convention qui peut être révisée en vue d’intégrer, sous condition, des enfants issus de la procréatique. Une même personne peut avoir une identité plurielle, une affiliation biologique, professionnelle, être citoyen d’un État, appartenir à un parti politique, à une religion, à un groupe ethnique… La volonté de reconnaissance de l’individu varie en fonction des circonstances et des priorités qu’il accorde à la pluralité d’identité qui le caractérise.
L’éthique qui organise la reconnaissance comporte trois différents piliers qui sont complémentaires : la reconnaissance affective répond aux besoins affectifs du sujet, la reconnaissance juridique fait de lui un sujet de droit et la reconnaissance sociale est structurée par les besoins liés à l’estime sociale. Ces trois aspects de la reconnaissance favorisent des « protections intersubjectives garantissant des conditions de liberté intérieure et extérieure » (A. Honneth, 2000, p. 209) à tous les individus. L’expérience de ces trois formes de reconnaissance consolide l’estime de soi et fait du sujet un être capable de « s’identifier à ses désirs » (A. Honneth, 2000, p. 202).
En conséquence, il est nécessaire que toute délibération sur la procréatique tienne compte de l’espace culturel où elle sera pratiquée pour éviter des jugements inadaptés : une même réalité prend des significations différentes suivant la culture où elle se produit. Une attitude tolérée dans une culture peut être vécue comme un sacrilège, une faute lourde dans une autre. Il est important de réorienter la culture pour juguler les injustices liées au déni de reconnaissance. N. Fraser (2011, p. 19) souligne à ce propos que « le remède à l’injustice culturelle (…) réside dans le changement culturel ou symbolique ». Le changement culturel passe par une réévaluation de la culture en général et des identités méprisées en particulier. Les identités méprisées et le déni de reconnaissance qui les accompagne « ne doivent leur survie qu’à l’acceptation pleine et entière, sans remise en cause (…). Les traditions peuvent évoluer [et être réorientées] » (A. Sen, 2010, p. 33). Les éventuels mépris inhérents à l’incursion de la procréatique au sein des cadres traditionnels de reconnaissance doivent être évalués dans une vision prospective sous l’étendard des théories de la reconnaissance contemporaine. « Envisagées correctement, les luttes pour la reconnaissance peuvent aider à la redistribution du pouvoir et de la richesse, favoriser l’interaction et la coopération par-delà des gouffres de différence, et permettre une approche critique de la question du cadre approprié » (N. Fraser, 2011, p. 74). La reconnaissance sociale n’est viable que lorsqu’elle joue un rôle œcuménique en fédérant les identités sociales diffuses au lieu de renforcer les différences. Elle doit travailler à les tolérer sans pour autant sacrifier la dignité des uns au profit des autres.
L’égalité et la liberté sont des repères indispensables à toute délibération. Les écueils liés à la reconnaissance en Afrique se situent dans un climat politique où la démocratie est parfois détournée de ses idéaux d’égalité et de liberté. La perversion de ces idéaux sera un espace favorable pour exclure au plan national un adversaire politique sous prétexte qu’il n’est pas reconnu par sa propre communauté, parce que fruit de la procréatique avec anonymat du donneur par exemple. C’est pourquoi les régimes démocratiques, soucieux de la liberté, de la justice de l’égalité et des droits de l’homme, malgré leurs limites, constituent des terreaux favorables pour discuter des questions relatives à la reconnaissance en Afrique. Cette discussion pourrait se faire sur la base de l’éthique procédurale de la discussion de J. Habermas.
Avec l’éthique de la discussion les Africains doivent réorienter l’argument d’autorité, le droit d’ainesse comme critère de connaissance de sorte que « tous les concernés participent en tant qu’êtres libres et égaux à une recherche coopérative de la vérité où ne vaut que la seule force de l’argument meilleur » (J. Habermas, 1992, p. 61). La force de l’argumentation conduira l’Africain à résoudre de façon rationnelle les questions de la reconnaissance en lien avec la procréatique. La discussion permet de rendre hommage au langage qui est le « médium commun de l’entente » (J. Habermas, 2002, p. 22). L’éthique de la discussion est compatible avec l’évolution des sociétés contemporaines dominées par les technosciences. La palabre peut aussi contribuer au renouvellement pacifique des normes de la reconnaissance : « par la palabre, la société interroge ses références, se met à distance et peut entrer dans un dialogue ininterrompu avec elle-même et son autre » (Bidima, 1997, p. 10). La palabre institue un espace public de discussion favorable à l’examen des normes et à leur éventuel renouvellement. Elle est un cadre indispensable pour débattre de l’intégration de nouvelles normes relatives à la procréatique au sein des normes traditionnelles qui organisent la reconnaissance.
Les questions relatives à la procréatique ne se posent pas encore avec acuité en Afrique, il s’agit de se situer dans une vision prospective pour anticiper « leurs conséquences psychologiques, sociales, économiques, politiques… » (G. Hottois, 2013, p. 248). Cette attitude permettra aux Africains de ne pas se situer devant le fait accompli en prenant des dispositions en amont pour réguler la procréatique qui commence à gagner du terrain en Afrique.
En raison de la complexité des situations concrètes, la sagesse ne consistera pas à accorder ou à refuser l’accès à la procréatique. Elle consistera, plutôt, dans un examen approfondi, autant physique que psychique/psychologique, des demandeurs et dans l’évaluation, au cas par cas, de chaque élément du problème posé. Nous plaidons pour que l’environnement culturel, social, économique et juridique soit pris en compte pour toute autorisation de cette procréation. Légaliser des techniques de la procréatique qui brouillent la parenté dans une société où les droits de l’enfant sont banalisés et violés ou encore dans une société où le statut social dépend des conditions de naissance reviendrait à commettre une injustice.
Par ailleurs, les risques et les bénéfices, les probabilités de succès et d’échec qui accompagnent la procréatique doivent être clairement expliqués aux populations pour que les candidats à la procréation puissent choisir ou refuser de façon libre et éclairée des techniques de procréation médicalement assistée. Le cadre général de l’usage des techniques de la procréatique mérite d’être déterminé de façon consensuelle en tenant compte de la spécificité de chaque culture africaine.
Conclusion
Les nouvelles techniques de reproduction lancent des défis inédits aux cultures africaines. Elles questionnent la pertinence des critères traditionnels de la reconnaissance qui influencent la distribution des rôles, des richesses et la justice sociale. La reconnaissance est un cadre d’identification et de discrimination des membres de la famille ou de la communauté. Il revient aux Africains de ne pas se situer en marge de l’histoire de la famille contemporaine, qui se construit avec le moule de la procréatique. La sagesse consiste à réexaminer les paradigmes familiaux traditionnels et, avec eux, les cadres de la reconnaissance qui les accompagnent pour y intégrer, progressivement, des parentés nouvelles accompagnant la procréatique. Vouloir rejeter sans condition la procréatique risque de conduire cette pratique dans la clandestinité et empêcherait de discuter des vraies questions qui la justifient.
La reconnaissance de l’individu qui implique sa visibilité ne saurait se limiter aux conditions de sa naissance sous prétexte de protéger le système de parenté naturel. Elle doit être un principe de renouvellement de la production de paradigmes éthiques inclusifs au sein desquelles la procréatique peut se situer.
Références bibliographiques
AKINDÈS Francis, 2003, « Le lien social en question dans une Afrique noire en mutaiton » in Souverainetés en crise, Québec, Presses de l’Université de Laval.
BIDIMA Jean-Godefroy, 1997, La palabre, une juridiction de la parole, Paris, Michalon.
FRASER Nancy, 2011, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte.
GUEYE Ibrahim, 2012, Les normes de la bioéthique et l’Afrique, Paris, L’Harmattan.
HABERMAS, Jürgen, 1992, De l’éthique de la discussion, trad. fr. Mark Hunyadi, Paris, Cerf.
HABERMAS, Jürgen, 2002, L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?, trad. fr. Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard.
HONNETH Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, trad. P. Rusch, Paris, Cerf.
HOTTOIS Gilbert, 2013, Généalogies philosophique, politique et imaginaire de la technoscience, Paris, Vrin.
KONE Marietou & KOUAME N’guessan, 2005, Socio-anthropologie de la famille en Afrique, Abidjan, CERAP.
LAZZERI Christian & CAILLE Alain, 2004, « La reconnaissance aujourd’hui. Enjeux théoriques, éthiques et politiques du concept » in Revue du Mauss, 1, pp. 88-115.
LEROY Fernand, 2001, « Procréation médicalement assistée » in Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université.
OUEDRAOGO Kouakou Harold-Cédric, 2015, Paternité responsable. Les enjeux éthiques, Abidjan, Paulines.
RENAUT Marie-Hélène, 2012, Histoire du droit de la famille, Paris, Ellipses.
RIFKIN Jeremy, 2011, Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie, trad. Françoise et Paul Chemla, Nouveaux Horizons.
SEN Amartya, 2010, Identité et violence, Paris, Odile Jacob.
THEVENOT Xavier, 1989, La bioéthique. Début et fin de vie, Paris, Centurion.
FONDEMENTS MÉTAPHYSIQUES DE L’IDÉE D’ÉMERGENCE : UNE LECTURE BERGSONIENNE À PARTIR DE LA THÉORIE DE LA DURÉE CRÉATRICE
Albert Amani NIANGUI
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
nianguia_albert@hotmail.com
Résumé :
En partant des implications socio-politiques de la théorie bergsonienne de la durée créatrice qui génère sans cesse de la nouveauté, nous avons pour objectif de montrer que le concept d’émergence porte en creux, les principes métaphysiques de l’avènement d’une société nouvelle. S’il n’y a pas de générations spontanées et que chez Bergson, la durée est maturation incessante et créatrice de nouveauté, il faut comprendre que le mot ‘’émergence’’ n’est pas qu’un simple slogan politique, un mot vide sans enjeu pratique et existentiel. Il appelle, au contraire, à une action de transformation du monde et surtout de l’homme lui-même par-delà son imagination créatrice. Telle est la thèse que nous défendons dans cet article : elle sera l’occasion heuristique pour nous, de mesurer les enjeux socio-politiques du concept d’émergence dans le contexte de la métaphysique de la durée créatrice de Bergson.
Mots-clés : Changement social, Création, Durée créatrice, Élan vital, Émergence, Fondements métaphysiques, Nouveauté, Société.
Abstract :
Going from the socio-political implications of Bergson’s theory of creative duration which constantly generates novelty; we aim at showing that the concept of emergence brings to the surface the metaphysical principles of the advent of a new society. If there are no spontaneous generations; and according to Bergson duration is incessantly maturing and creative of novelty, it must be understood that the word “emergence” is not merely a political slogan, an empty word without practical and existential stake. On the contrary, it calls for a transformation action of the world and above all man himself beyond his creative imagination. Such is the thesis that we defend in this article: it will be a heuristic opportunity for us to measure the socio-political stakes of the concept of emergence in the context of Bergson’s metaphysics of the creative duration.
Keywords : Social change, Creation, Creative time, Vital momentum, Emergence, Metaphysical foundations, Novelty, society.
Introduction
Le vocable d’‘‘ émergence’’, de simple mot, est passé pour être une voie et la voix de l’idéologique en termes de projet gouvernemental. Il est, ici et là, dans la plupart des pays africains, utilisé dans le cadre d’une finalité socio-politique principale de la gouvernance étatique avec la pleine conscience de ses enjeux. Mais, même si on est conscient desdits enjeux, on prend moins la pleine mesure des contingences socio-culturelles et politico-sociologiques qui peuvent porter un coup d’arrêt à sa réalisation. C’est qu’on ne prend pas objectivement en compte la distance entre notre intention de faire et la chose qui est à réaliser, le possible « qui [peut apporter] un imprévisible rien qui change tout » (H. Bergson, 2001, p. 1331). On se comporte comme si l’émergence étant un stade à atteindre, « [calculable] d’avance » (Idem, p. 1333), elle serait donnée comme toute faite au temps indiqué, sans tenir compte du temps de son élaboration-maturation (durée). Et très souvent, les politiques raisonnent comme si le terme d’émergence se réduit à un état de choses, à des réalités socio-économiques toutes faites, en un mot, à un horizon spatial posé dans un ailleurs temporel à atteindre. Ainsi dit, ils ne tiennent pas compte de ce qui doit se faire au moment présent, dans la richesse foisonnante de la réalité qui dure et en progrès continu.
Au demeurant, dans un contexte bergsonien, il faut comprendre que l’émergence devrait être moins un état qu’une tension de la conscience vers un horizon à faire et à parfaire qui n’a pas de terme. Il faut réinsérer le concept d’émergence dans l’esprit de la métaphysique de la durée où toute la réalité est en maturation continuelle.
En considérant le concept sous le rapport de ce point d’ancrage de la métaphysique bergsonienne de la durée, notre sujet trouve son intérêt pratique à l’échelle socio-politique. Celui-ci trouve son point d’imputation théorique à partir du « possible et le réel », horizon ontologique au regard duquel l’intelligence humaine appréhende les choses. Mais chez Bergson, le réel qui dure, et par sa richesse créatrice, enferme plus de possibilités en termes de virtualités, car « le temps est invention [du nouveau] ou n’est rien du tout » (H. Bergson, Op. cit., p. 784).
Dès lors, comment de ce point de vue, la durée bergsonienne peut-elle être fondement métaphysique de l’émergence, terme usité par les politiques apparaissant comme la trame essentielle de leur programme de gouvernance étatique?
La réponse à cette interrogation dévoile l’objectif de notre article dont les aspects de la problématique se déclinent en les interrogations suivantes : l’émergence, dans un contexte bergsonien peut-elle se réduire à un slogan politique n’étreignant pas le réel social et incapable de le transformer ? L’émergence en son assise métaphysique n’a-t-elle pas une portée pratique dans la théorie bergsonienne de la durée créatrice de nouveauté, celle-ci pouvant être envisagée comme produit du changement social ? Les politiques qui l’emploient pour servir leurs intérêts idéologico-politiques présents, ne devraient-ils pas se rendre à cette vérité métaphysique que la vie qui anime la conscience citoyenne fait que l’émergence est pour elle, aspiration à un renouveau sociétal pour le bien-être des citoyens? Le mot émergence compris dans le registre de la métaphysique bergsonienne de la durée créatrice de nouveauté, ne rime-t-il pas en fin de compte avec l’idée d’un renouvellement des structures socio-politiques ?
Notre point de départ en termes d’hypothèses est d’une part, l’idée que le mot émergence inscrit dans la durée créatrice, traduit le désir de nouveauté et l’aspiration des peuples à un mieux-être futur. D’autre part, il nous permet de comprendre que si c’est la vie qui crée la nouveauté animant les consciences individuelle et collective, elle pourrait être comprise comme une base principielle de la gouvernance politique.
Notre thèse est de montrer que le mot ‘‘émergence’’ bien que relevant de la science politique prospectiviste, est d’essence et d’épaisseur métaphysique.
Pour atteindre notre objectif par-delà la justification de notre thèse, nous utiliserons d’une part, les méthodes phénoménologique et socio-critique. Elles nous permettront de décrire et analyser les manifestations individuelle et collective du désir d’émergence. Et d’autre part, nous ferons usage de la méthode intuitive pour saisir la quintessence métaphysico-spirituelle du concept d’émergence à la lumière de la théorie de la durée créatrice bergsonienne. Il s’agit de cette durée qui promeut le changement en sa forme d’écoulement temporel faisant apparaître le nouveau.
1. Au point d’émergence de la théorie bergsonienne de la durée créatrice : la réalité physique de l’écoulement temporel
Si Héraclite s’est rendu compte dans son rapport immédiat à l’espace que tout coule, il a pris-là, conscience de la réalité du temps dans son expression extérieure. Mais cette prise de conscience ontique de l’écoulement temporel est le point d’émergence de l’idée que tout est changement d’état des choses et dans les choses elles-mêmes.
Cependant, Bergson, dans une posture critique a dépassé cette appréhension héraclitéenne du temps. Celle-ci est du point de vue de l’entendement, de l’intelligence qui ne saisit du réel qui dure que son aspect statique ou spatial. C’est que pour Bergson, dans l’approche du temps, les philosophes ont confondu la durée à l’espace. En effet, « tout le long de l’histoire, temps et espace sont mis au même rang et traités comme choses du même genre. On étudie alors l’espace, on en détermine la nature et la fonction, puis on transporte au temps les conclusions obtenues. La théorie du temps et celle de l’espace se font ainsi pendant (H. Bergson, Op. cit., p. 1256). Et ainsi, « au fond des doctrines qui méconnaissent la nouveauté radicale de chaque moment de l’évolution il y a bien des malentendus » (Idem, p. 1339). Allons plus loin avec Bergson pour dissiper ceux-ci !
Montrons au premier chef que le changement est le principe ontologique de l’idée d’émergence du point de vue ontique.
1.1. De la temporalité ontique : du changement comme principe ontologique d’émergence et de réalité constitutive des choses
La temporalité qui affecte les choses exprime le changement comme principe ontologique de leur émergence. Parlant ainsi, nous sommes dans l’épaisseur psychologique et métaphysique du temps qui passe et que nous sentons. On est passé de l’appréhension du devenir des choses aux choses en devenir dans le temps ; en un mot, de leur passage à l’existence. On dira qu’on passe de l’ontique à l’ontologique et inversement, en raison du changement créatif qui leur est constitutif. Il s’agit donc du temps qui, parce qu’il est invention, donne à Bergson d’avoir « une conception du temps orientée vers l’apparition et la production du nouveau. » (P. Marrati, 2007, pp. 261-271). Avec Bergson, la donne ontologique est celle-ci : la réalité est le temps et le temps est la réalité même des choses en tant qu’elles durent. C’est la durée créatrice de nouveauté qui est l’« étoffe de toutes choses » (H. Bergson, Op. cit., p. 725). C’est pourquoi, « […] notre perception usuelle ne saurait sortir du temps ni saisir autre chose que du changement » (Idem, p. 1364). Mais, selon Jean Wahl (1957, p. 42) « la perception du changement, bien que nous le percevions d’abord dans les choses, implique toujours une sorte d’intuition interne du changement ». C’est pourquoi, à l’échelle heuristique bergsonienne, chercher à appréhender la durée, « conduit la pensée vers un approfondissement de la nature du temps en direction de sa signification métaphysique » (A. Bouaniche, 2000, pp. 43-45). Mais quelle est la faculté, selon Bergson qui nous rend aptes à le faire ?
En effet, pour Bergson (1993, p. 213), cela n’est possible que par la faculté d’intuition qui consiste, pour notre esprit, à « s’installer dans la réalité mobile, (à) en adopter la direction sans cesse changeante, enfin (à) la saisir intuitivement ». Il s’agit là, d’une expérience intérieure de la durée créatrice de nouveauté imprévisible qui est, par ailleurs, l’expression ontologique de notre liberté. Mais, au dedans de nous-mêmes, nous faisons l’expérience la plus personnelle et intégrale de la durée. Sous l’effet de l’énergie spirituelle de la durée psychologique, « […] notre personnalité pousse, grandit, mûrit sans cesse. Chacun de ses moments est du nouveau qui s’ajoute à ce qui était auparavant. Allons plus loin : ce n’est pas seulement du nouveau, mais de l’imprévisible. Sans doute mon état actuel s’explique par ce qui était en moi et par ce qui agissait sur moi tout à l’heure » (H. Bergson, 2001, p. 499). Ainsi, perçu et vécu dans notre intériorité et sous le mode psychologique de notre liberté, « le changement est bien plus radical qu’on ne le croirait d’abord » (Idem, p. 495) puisque,
l’existence dont nous sommes le plus assurés et que nous connaissons le mieux est incontestablement la nôtre, car de tous les autres objets nous avons des notions qu’on pourra juger extérieures et superficielles, tandis que nous nous percevons nous-mêmes intérieurement. […] Je constate […] que je passe d’état en état […]. La vérité est qu’on change sans cesse, et que l’état lui-même est déjà du changement (Ibidem, pp. 495-496).
Exister, pour l’homme est essentiellement durer, durer à changer sans cesse et en faisant, se créer intérieurement. Bergson nous introduit ainsi, par sa théorie de l’évolution de la vie, dans l’épaisseur métaphysique et psychologique du temps pour ainsi dire de la durée créatrice de nouveauté imprévisible. La réalité est que si tout change autour de nous ; nous changeons sans cesse. Notre être est imprégné de durée, et intérieurement nous nous créons continuellement, nous changeons avec ou sans nous.
1.2. De l’expérience intérieure de la durée comme moment psychologique révélateur de la croissance créatrice de notre personnalité
Ceux qui, par une lecture approximative du bergsonisme, l’ont réduit à une philosophie de la durée intérieure saisie par le moyen de l’intuition, n’ont peut-être pas compris que chez Bergson, la nature de l’objet à connaître détermine le type de faculté. Selon J. L. Vieillard-Baron (2004, pp. 45-75), « […] tout se passe comme si c’était la durée elle-même, en tant qu’elle est l’être même, qui créait les conditions méthodologiques de sa découverte et de sa fécondité ». Mais cet objet à connaître, du point de vue bergsonien, n’est rien d’autre que la réalité mouvante traversée par l’élan de vie se donnant comme matière et esprit. Ainsi, si la vie ou la conscience chez l’homme, « […] s’est scindée […] en intuition et intelligence, c’est par la nécessité de s’appliquer sur la matière en même temps que de suivre le courant de la vie » (H. Bergson, 1996, p. 179).
C’est pour cette raison qu’il y a chez Bergson, une exigence gnoséologique subséquente à sa théorie de la durée : il faut plutôt suivre la logique existentiale du réel relevant de sa nature mouvante (durée) qui charrie la nouveauté imprévisible. Il faut savoir que le réel est plus vaste que les catégories de l’intelligence qui saisissent un de ses côtés, et ainsi le parcellisent. C’est pourquoi, dit-il « travaillons donc à dilater notre pensée ; forçons notre entendement ; brisons, s’il le faut, nos cadres ; mais ne prétendons pas rétrécir la réalité à la mesure de nos idées, alors que c’est à nos idées de se modeler, agrandies, sur la réalité (H. Bergson, Op. cit., p. 1439).
Au demeurant, si l’intelligence est naturelle à l’homme qui lui permet de connaître la vie dans sa facette extérieure ; l’exigence de comprendre la réalité dans son essence comme durée, exige aussi que ladite faculté soit « gagnée par l’intuition »[8]. La réalité épistémique est que « l’intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie » (H. Bergson 1996, p. 166). Mais, l’intuition nous donne d’entrer dans son intériorité et toucher dans la mobilité du réel, l’absolu de la durée créatrice. Radical est donc le changement. En tant que réalité intérieure, il se vit intuitivement comme une réalité profondément psychologique, car « la substantialité du changement n’est aussi visible, aussi palpable, que dans le domaine de la vie intérieure. » (H. Bergson, 1993, p. 165). Nous sentons que les choses dans le monde extérieur changent certes, mais « […] notre expérience vécue de ce monde extérieur est intérieure » (J. Hersch, 1993, p. 329). Nous expérimentons dans nos propres états de conscience la création de l’imprévisible nouveauté. Et c’est pourquoi, « plus nous [approfondissons] la nature du temps, plus nous [comprenons] que durée signifie invention, […] élaboration continue de l’absolument nouveau » (H. Bergson, 2001, p. 503).
2. De la réalité ontologique du changement : la durée créatrice comme origine matricielle de la nouveauté
Les philosophes n’ont pas donné une valeur métaphysico-existentielle au temps dont le changement est la manifestation sensible. Ils l’ont limité à l’espace, à l’extériorité et à l’éternité sans vie. On sait aussi que Platon n’a pas donné au temps une consistance ontologique. Il l’a qualifié, du moins disqualifié en faisant de lui, l’‘‘image mobile de l’éternité immobile’’ à partir de son axe métaphysique central, à savoir la doctrine des Idées ou Formes.
Dans sa théorie de la durée, point d’aboutissement de sa théorie de l’évolution de la vie, Bergson montre que l’essence de la vie qui est liberté, est tendance à la différenciation, c’est-à-dire à « l’invention continue de formes toujours nouvelles » (Idem, p. 786). Cette réalité est expliquée par le fait que la durée créatrice est sa trame métaphysique. Il y a de ce fait, un moment phénoménologique de l’évolution de la vie créatrice qui coïncide avec son moment ontologique. Celui-ci est mouvement effectif de genèse de la nouveauté en nous, autour de nous, dans l’univers matériel tout entier. La nouveauté apparaît comme le fond ontologique et métaphysique du temps comme durée pour ainsi dire comme croissance créatrice.
À y voir de près, l’idée d’émergence est constitutive du vécu de l’homme du fait que la durée en est la texture métaphysique. Mais elle est royalement ignorée par le sens commun dès lors qu’il est sous la coupe de l’intelligence spatialisante. Or celle-ci est par nature, négatrice de la mobilité, de la durée qui est « l’étoffe même de la réalité » (H. Bergson, 1996, p. 272). C’est la durée créatrice qui génère la nouveauté. On aurait dit, si on ne s’en abuse, que le terme d’émergence à tonalité idéologique créé dans l’espace politique de la gouvernance prospectiviste, en est affecté. Et pour cause, « le vouloir vital engendre, avec les structures, les fonctions adaptées aux structures, de même que, dans l’âme humaine, la volonté inspire les actions en même temps que la justification idéologique des actions » (J. Vladimir, 1999, p. 137).
2.1. La durée créatrice de l’imprévisible nouveauté : approche phénoménologico-ontologique de l’idée d’émergence
La nouveauté a toujours fasciné non pas en raison de sa beauté puisque, celle-ci est subjective, mais en raison de son apparition, de son émergence dans le monde ! La conscience humaine s’est toujours réjouie de l’avènement d’une chose nouvelle, d’un nouvel enfant ou d’un nouveau parti politique au programme rénovateur. Par son caractère et sa stature, l’avènement de la nouveauté est, en soi, un évènement qui porte la joie au cœur de ceux qui ‘‘l’accueillent’’ ! Cela est dû au fait que ces derniers ayant l’habitude avec l’intelligence spatialisante de voir les choses sous un angle statique, ils sont dans une sorte d’inertie existentielle de la répétition du même. C’est pourquoi si cet état de chose n’est pas expliqué par la beauté de ce qui apparaît, c’est parce que les choses surgissent au sein de choses anciennes.
En effet, chez Bergson, la durée étant l’étoffe de toutes choses, tout est renouvellement incessant et création de l’absolument nouveau. C’est qu’à chaque moment quelque chose se crée et s’y ajoute qualitativement comme par effet boule de neige. Si à chaque moment quelque chose se fait ou se défait, c’est qu’il n’y a rien de tout fait. Il n’y a pas d’état de choses ou des choses données en l’état, dans la forme arrêtée du statique. Cependant, quand la nouveauté est pensée par notre intelligence, elle est coupée de son origine matricielle qu’est la durée. Du point de vue fonctionnel, l’intelligence pense très souvent le nouveau par juxtaposition avec l’ancien. C’est ainsi qu’« une idée neuve peut être claire parce qu’elle nous présente, simplement arrangées dans un nouvel ordre, des idées élémentaires que nous possédions déjà » (H. Bergson, Op. cit., p. 1276).
Dans tous les cas de figure, c’est la nouveauté qui est la réalité prégnante dans notre univers. Elle s’impose par sa densité ontologique parce que les choses étant tissées dans l’étoffe du temps, elles sont imprégnées de durée. C’est pourquoi, étant en perpétuel changement, les choses sont animées continuellement par la durée créatrice de l’imprévisible nouveauté. Ainsi y a-t-il toujours émergence de ceci ou cela. La notion d’émergence est ici, dans ce contexte de création de l’absolument nouveau, à la fois action créatrice et chose créée.
Ainsi entendu, l’émergence n’est pas qu’un simple mot. Elle est une réalité ontologique dont l’apparition du point de vue métaphysique, est l’œuvre de la durée créatrice. Le mot émergence devra donc renvoyer, chez Bergson, à une réalité plus vaste que le mot lui-même. Elle manifeste la présence d’une chose créée dont le poids spirituel réjouit l’âme comme dans le cas de l’artiste qui voit dans son œuvre le reflet de son propre être, de sa propre personnalité, heureux de s’être ‘‘recréé’’ ! Au bout du compte, l’émergence, appréhendée sous le rapport de la durée créatrice de l’imprévisible nouveauté, culmine avec un moment anthropo-ontologique. En celui-ci, la chose créée fait un avec le sujet créateur. Tout se passe comme si l’émergence est un processus ontologique de genèse de l’être économique, social, culturel et anthropologique, envisagé comme son résultat. Mais, en prenant les choses de ce biais, nous sommes victimes du point de vue de notre intelligence. Elle a cette fâcheuse habitude, mais naturelle, de se fixer un point de repos devant un réel mouvant dont la durée est la matrice. Or la durée elle-même est le fond métaphysico-ontologique de l’évolution créatrice de nouveautés. Et pour cause,
le rôle de l’intelligence est, en effet, de présider à des actions. Or, dans l’action, c’est le résultat qui nous intéresse ; les moyens importent peu pourvu que le but soit atteint. De là vient que nous nous tendons tout entiers sur la fin à réaliser, nous fiant le plus souvent à elle pour que, d’idée, elle devienne acte […]. L’esprit se transporte tout de suite au but, c’est-à-dire à la vision schématique et simplifiée de l’acte supposé accompli. (H. Bergson, Op. cit., pp. 747-748).
La critique bergsonienne de l’intelligence en tant que principe de nos actions nous donne de comprendre que cette dernière nous laisse à cheval entre deux points : le commencement mécanique de nos actions et leur point d’aboutissement, résultat qu’elles produisent. Le vice, est que notre intelligence ne nous donne pas de saisir et de vivre le processus de l’action s’accomplissant dans sa propre durée ; durée dans laquelle non seulement quelque chose se créé, mais aussi et surtout où nous nous créons nous-mêmes. D’où la nécessité pour Bergson, d’une distinction ontologique entre le « nouveau en train de se faire » et « le tout fait », entre processus et résultat de la création.
2.2. La nouveauté entre processus et résultat : distinction bergsonienne du « nouveau en train de se faire » et le « tout fait »
La critique bergsonienne des systèmes philosophiques comme celle dirigée contre le mode spatialisant de l’intelligence conceptuelle, étant celle contre le finalisme et le mécanisme, exige qu’on fasse la distinction entre la nouveauté comme processus et comme résultat. Toutefois, chez Bergson, c’est que le finalisme et le mécanisme ont pour vice commun, la négation de l’essence de la durée comme création d’imprévisible nouveauté. L’erreur est donc de portée ontologique. Mais, ses conséquences dans notre vie pratique alors sous le mode de l’élan de notre intelligence spatialisante, sont existentielles : elle a des incidences sur l’idée d’émergence en son enracinement social quant à l’action politique prospective. Comment tout cela peut-il se saisir dans la théorie bergsonienne de la durée créatrice à partir de la distinction entre le « nouveau en train de se faire » et « le tout fait » ?
Ramenons notre propos théorique au terme d’émergence, concept focal de notre texte pour juger de sa portée socio-politique quant à la distinction entre le nouveau en train de se faire et le tout fait. Il est question de l’inscrire dans le cadre de l’action pratique. Cela, parce que le mot « émergence » est une invitation dans le moment présent, à l’action développementaliste pour l’avènement d’une société nouvelle. N’est-ce pas en cette dernière que le bien-être appelé de tout vœu, devient une réalité ?
En effet, la distinction entre le nouveau en train de se faire (processus) et le tout fait (résultat), est une invitation à l’action autant qu’à la pensée rénovatrice. C’est un appel pressant à un effort de vie qui, parce qu’elle est création, exige qu’on ne se prête pas au jeu de l’intelligence qui sacrifie l’action créatrice sur l’autel de la spatialisation. Sa mécanique (son action technique) n’est pas créatrice puisqu’elle consiste à ré-arranger des morceaux de l’ancien, partie par partie, pour atteindre une finalité pratique précise. Cette intelligence qui fait du tout fait son horizon d’action dans l’ordre de la finalité, est, contrairement à ce qu’on pense, inactivité…créatrice. En effet, avec elle, tout serait accompli (comme prévu) par un bond au-delà de la durée créatrice, au-delà de ce que Bergson a appelé, le ‘‘se faisant’’. Or, « l’intuition, attachée à une durée qui est croissance, y perçoit une continuité ininterrompue d’imprévisible nouveauté ; elle voit, elle sait que l’esprit tire de lui-même plus qu’il n’a, que la spiritualité consiste en cela même, et que la réalité, imprégnée d’esprit, est création » (Idem, p. 1275).
Tout porte donc à croire que la durée est créatrice, et qu’elle est éminemment processus d’invention sans cesse de l’imprévisible nouveauté. C’est pourquoi, en la pensant comme la substructure métaphysique de l’action politique, l’émergence ne peut être un état fixe de développement. Elle est un état transitoire de progrès continu. C’est ainsi que dans un contexte bergsonien de création continue de l’absolue nouveauté, si on fixe un terme, un horizon temporel à l’émergence, elle se nie elle-même. Et on aurait donné un coup d’arrêt à l’action politique. C’est dans ce sens, qu’on entend l’émergence comme un état de choses qui seraient faites à un horizon temporel fixé. C’est dans le même ordre d’idée que « […] de l’action, nous ne retenons que le résultat. L’inventeur ne s’intéresse qu’à son invention, non à son pouvoir inventif. L’artiste ne pense qu’à son œuvre, non à sa puissance créatrice » (G. Levesque, 1973, p. 89).
Cependant, l’émergence envisagée comme processus de constitution des conditions générales du mieux-être socio-politique des membres d’une communauté humaine donnée, doit être créatrice. Elle doit s’inventer continuellement dès lors que la durée est la matrice métaphysique qui définit et structure sa fonctionnalité et son dynamisme. On a oublié, ainsi que Bergson (2001, p. 1028) le dit, qu’« entre l’âme close et l’âme ouverte il y a l’âme qui s’ouvre. Entre l’immobilité de l’homme assis, et le mouvement du même homme qui court, il y a son redressement, l’attitude qu’il prend quand il se lève », toujours tendu vers un au-delà de lui-même vers la sphère du parfait qu’il ne peut atteindre. Il s’agit en fait, de saisir « […] l’expérience de la durée comme croissance et création, sous la forme d’un épanouissement continuel » (A. Bouaniche, 2000, pp. 43-45). Tout cela se justifie par le fait métaphysique que « la durée est le progrès continu du passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant » (H. Bergson, Op. cit., p. 498).
Par ailleurs, chez Bergson, « individu et société » se conditionnant circulairement, l’évolution de la vie chez l’homme qui culmine avec l’épanouissement de l’intelligence, le destine à la société pour ainsi dire à la socialité. C’est pourquoi, si au début des Deux sources, Bergson nous fait comprendre que « chacun de nous appartient à la société autant qu’à lui-même » (H. Bergson, Op. cit., p. 986), c’est du fait que chez l’homme, « son intelligence [est] destinée à favoriser la vie individuelle et la vie du groupe » (H. Bergson, 1995, p. 56). Mais l’idée qui rend compte de ces deux vérités est celle selon laquelle « le social est au fond du vital » (Idem, p. 123). Et si le vital est constitutif du social, il faut en déduire théoriquement que le dynamisme sociétal et le progrès social ont un fond métaphysique qui est la durée créatrice symptomatique de la vie évolutive.
3. Le biologique comme réalité constitutive de la vie sociale : le vital comme fond du social et principe de son dynamisme rénovateur
S’il y a un moment critique de la pensée philosophique bergsonienne, c’est parce qu’elle a commencé par une prise de conscience de l’incapacité de la science mathématique et par conséquent de l’intelligence à saisir le temps : Elle manque la durée, fond substantiel d’un réel changeant. Mais, ce qu’il faut comprendre dans la démarche bergsonienne, c’est qu’il y a un moment ontologique qui précède et conditionne un moment épistémique.
Bergson, en fondant la connaissance vraie sur le réel mouvant parce que la durée lui est immanente, réduit à néant l’éléatisme et renverse le platonisme. Il change de paradigme ontologique avec des conséquences méthodologique et gnoséologique non moins importantes. Le nouveau paradigme ontologique bergsonien se résume à l’idée que dans l’évolution de la vie, on a l’expression la plus haute et substantielle de la durée créatrice. Et pour cause, selon Bergson, « c’est en suivant d’aussi près que possible les données de la biologie [qu’il est arrivé] à la conception d’un élan vital et d’une évolution créatrice » (H. Bergson, 1996, p. 264). Ainsi entendu, le biologique est le centre métaphysique de la durée créatrice qui se répand dans l’univers social des êtres vivants, animaux (sociétés de fourmis, par exemple, régulées par l’instinct) et humains (sociétés humaines réglementées par l’intelligence, à défaut de vie intuitive) : « c’est à la vie sociale que l’évolution aboutit » (H. Bergson, 2001, p. 834). Et c’est en cela que chez Bergson, « le social est au fond du vital » (H. Bergson, 1995, p. 123).
De ce point de vue, il est temps que nous saisissions l’impact social de cette animation des consciences par la durée créatrice de nouveauté pour juger de sa portée pratique quant à l’idée d’émergence. En effet, aux dires de F. Worms (2004, p. 11), « s’il s’agit ici de notre vie, c’est pour deux raisons : le contenu du temps, qui n’est rien d’autre que celui de notre vie, mais aussi l’acte de la durée, qui fait de ces évènements notre vie individuelle, singulière et subjective » mais aussi relationnelle.
3.1. De l’animation des consciences individuelle et collective par la durée créatrice : l’aspiration à la nouveauté comme principe du changement social
L’homme est l’entre-deux d’un intérieur et d’un extérieur en raison de sa nature duelle, corps et âme. Il est comme un intérieur ouvert sur l’extérieur et exactement comme un extérieur qui l’introduit dans un intérieur. L’idée qui en ressort est qu’il faut entrevoir le rapport entre l’intérieur et l’extérieur de l’homme dans une relation dynamique. Le fait est que, « notre dehors et notre dedans constituent le contenu un et indivisible de notre existence » (L. Bickel, 1962, p. 51).
Mais si Bergson admet que nous vivons extérieurement à nous-mêmes, c’est du fait d’une intelligence, qui, parce qu’elle est « la vie regardant au dehors » (H. Bergson, Op. cit., p. 162), est plus encline à la spatialisation-socialisation et cela en accord avec sa représentation de l’espace. En conséquence, nous ne vivons pas la durée telle qu’elle se fait en nous où nous sentons que nos états de conscience changent perpétuellement. C’est ce qui fait que,
la plupart du temps, nous vivons extérieurement à nous-mêmes, nous n’apercevons de notre moi que son fantôme décoloré, ombre que la pure durée projette dans l’espace homogène. Notre existence se déroule donc dans l’espace plutôt que dans le temps : nous vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous […] (H. Bergson, 1961, p. 174).
La durée est certes, l’étoffe des choses, mais la connaissance que notre intelligence nous en livre est superficielle et extérieure en raison de sa spatialité endogène et de sa géométrie naturelle. Quand notre moi profond, lieu psychologique dans lequel nous vivons la durée tombe sous la coupe épistémique de l’intelligence, elle en saisit une réfraction dans l’espace : les schèmes sont la discontinuité et la multiplicité distinctes.
Au demeurant, le contexte de découverte de la vérité chez Bergson se limite aux états de conscience. Il a pour ainsi dire une base psycho-ontologique. Cela étant, une exigence méthodologique s’impose à lui quant à la saisie de la durée desdits états de conscience. Ladite exigence méthodologique sous le rapport de cette base psycho-ontologique de découverte de la vérité, le conduit de proche en proche, à opter pour la faculté d’intuition comme mode d’accès authentique à cette dernière.
En effet, parce qu’elle est faite de durée créatrice, notre vie intérieure est le lieu psychologique où nous nous créons nous-mêmes. C’est pour cette raison qu’elle est aussi le lieu d’apparition sans cesse de la nouveauté. Si nous ne saisissons pas objectivement cette réalité psychologique, il n’en demeure pas moins que chacun fait l’expérience d’un continuel changement de lui-même autour d’un centre comme noyau, à savoir sa personnalité.
Par ailleurs, en tenant compte de l’idée de liberté que promeut nos états de conscience, la durée créatrice ne manque pas d’étreindre le réel physique, social et culturel pour le transformer pour lui donner une forme nouvelle. Cela, parce que la création est fondamentalement « […] le jaillissement d’une existence toujours complète et toujours nouvelle » (V. Jankélévitch, Op. cit., p. 218). Si cela est justifié, c’est parce qu’issus de l’évolution créatrice telle que la promeut l’élan vital, nous sommes chacun, « une espèce de création » (H. Bergson, 1996, p. 7). Dès lors, « la création ainsi conçue, n’est plus un mystère, nous l’expérimentons en nous dès que nous agissons librement. » (Idem, p. 248).
Selon Bergson, ce sont les personnalités exceptionnelles dites mystiques qui la promeuvent par une vie intuitive. Elles s’émeuvent dans leur existence socio-politique d’une émotion d’amour en regard d’un principe éthique dont l’incarnation devrait faire l’unité du genre humain. Pour Bergson, en effet, si la faculté d’intuition est infuse en chacun de nous, elle est cependant, masquée par les pesanteurs matérielles de la vie sociale. Seuls les mystiques, continuateurs exclusifs de l’élan vital, l’expriment en et autour d’eux…socialement. Et pour cause, « chacune de ces personnalités est une force créatrice ; et selon toute apparence, le rôle de chaque personne est de créer, exactement comme si le grand Artiste avait produit d’autres artistes comme ouvrages » (H. Gouhier, 1989, p. 99). Leurs pensées chargées d’énergie spirituelle créatrice peuvent impulser, sur le plan pratique, l’élan du renouveau social, point d’ancrage et de finalité de l’idée d’émergence.
3.2. Les personnalités créatrices comme porte-étendards du changement social : l’idée de nouveauté au fondement métaphysique de l’idée d’émergence
Il est sans aucun doute que du point de vue bergsonien, la création est une réalité métaphysique au centre de la vie intérieure de chacun de nous. Et pour cause, « il y a une réalité au moins que nous saisissons tous du dedans, par intuition et non par simple analyse. C’est notre propre personne dans son écoulement à travers le temps. C’est notre moi qui dure. » (H. Bergson, 2001, p. 1396). Mais en vertu de la continuité entre notre intériorité et notre extériorité, et surtout de ce que la vie même se donne comme esprit dans la matière, il faut dire que l’idée impacte la vie sociale.
L’idée est plutôt ici, une action quand elle est portée éthiquement par une individualité mystique ou exceptionnelle. Elle devient alors une personne en laquelle la pensée est action et inversement. L’individualité mystique qui a une vision, est à la fois cette vision même. Son action coïncide avec son objet exactement comme si l’intuition comme faculté se réduisait à l’intuition comme vie de cette personnalité créatrice. Il ressemble à ce qu’il fait ainsi que le dit K. Sarafidis (2013, p. 81). C’est en ce sens que l’intuition devient la « sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet, pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprimable » (H. Bergson, 1969, p. 181). L’inexprimable est le seuil de l’action créatrice où le sujet fait un avec la source régénératrice de la vie, à savoir l’élan vital ou Dieu Lui-même. Toutefois, « il nous faut […] creuser en nous-mêmes pour rejoindre le flux de durée par lequel notre personnalité se forme et se transforme elle-même » (K. Sarafidis, Op. cit., p. 76). Il s’agit, chez l’homme ordinaire, d’une conversion qui nécessite « une torsion de l’intelligence sur elle-même, d’un renversement de sa direction habituelle » (G. Levesque, Op. cit., p .89).
Les personnalités exceptionnelles créatrices, sont, quant à elles, continuatrices de l’élan vital et porteuses de son énergie créatrice en actes. C’est ainsi qu’elles chargent comme une exigence et un poids éthiques et civiques, l’idée de nouveauté pour ainsi dire de renouvellement dans leurs actions socio-politiques. Elles sont comme telles, « les grands hommes de bien, et plus particulièrement ceux dont l’héroïsme inventif et simple a frayé à la vertu des voies nouvelles sont révélateurs de vérité métaphysique » (H. Gouhier, Op. cit., p. 104). Cette révélation de vérité métaphysique sous la forme de durée créatrice s’opère par voie de vie intuitive faite d’émotion créatrice. Parce que ces personnalités mystiques et créatrices (grands hommes), sont dans un plan supérieur de la vie qui les fait coïncider avec l’élan vital, elles expérimentent une vie nouvelle. En contact avec l’existence sociale et politique, elles ne manquent pas de lui insuffler un vent et une atmosphère de renouveau, une nouvelle dynamique en la forme d’une société re-créée, par conséquent nouvelle !
À ce stade de notre cheminement, il convient de comprendre que la durée bergsonienne n’est pas qu’un simple objet de pensée d’essence métaphysique, sans rapport avec le réel ou l’existence humaine. Son intensification métaphysique fait qu’elle est action créatrice. Si lesdites personnalités sont créatrices, c’est en raison du fait que l’impulsion originelle de leurs pensées et actions émane de l’élan vital. C’est ce qui fait qu’elles manifestent une propension à créer la nouveauté qui restitue leur originalité propre. C’est l’intuition mystique qui devra animer les hommes politiques au feu de l’amour de l’humanité, leurs actions promotrices de l’émergence. Le ressort métaphysique de cette dernière, devra être la spiritualité que lui communiquent les personnalités créatrices ou les mystiques. Leur élan mystique se continuera selon Bergson (1995, p. 250), « […] jusqu’au jour où un changement profond des conditions matérielles imposées à l’humanité par la nature permettrait, du côté spirituel, une transformation radicale ». Ceci peut se comprendre dans le même sens où « le grand artiste crée de nouvelles modes et toute une machine culturelle, le grand héros crée une nouvelle politique et toute une machine administrative » (A. Bouaniche, et al, 2004, p. 33). Ainsi, « l’intuition mystique qui se prolonge directement en création et même en action, non seulement en dépassement mais même en transformation de l’humanité » (F. Worms, Op. cit., p. 271) est attestée comme l’énergie spirituelle qui anime les ambitions des grands hommes politiques.
Conclusion
Le mot ‘‘ émergence’’ est usité dans le contexte de la vie politique. Sa portée pratique le dispute à ses enjeux socio-politique et économique. Mais, en l’évoquant dans cette étude qui relève du champ de la métaphysique, nous ne le greffons pas à une réalité qui lui est extérieure. Au contraire, cette étude nous a permis de comprendre ce qui suit : quand le mot ‘‘émergence’’ lui-même est évoqué à des fins politiciennes, et n’est pas saisi en son assise métaphysique, on passe sous silence sa portée socio-politique et pratique. On peut dire, dans un contexte bergsonien, que ladite assise métaphysique est masquée par une vision du monde de l’homme taillée sur un mode d’existence qui porte les stigmates de l’intelligence spatialisante négatrice de la durée créatrice.
Mais à partir d’une lecture bergsonienne du terme d’‘‘émergence’’ au travers de la théorie de la durée créatrice, on comprend qu’il porte en creux des présupposés métaphysiques. De cette lecture, les politiques devraient comprendre que le mot lui-même ne peut se réduire à un simple slogan politique. Il appelle à une véritable philosophie pratique qui est promotion de l’action créatrice, rénovatrice et transformatrice des individus et structures sociales. Ces actions sont entreprises par les personnalités créatrices, ces grands mystiques dont les pensées coïncident avec leur mode d’existence social.
Ainsi, en saisissant ledit concept sous le rapport de la durée créatrice, on en fait mention pour montrer que son évocation est une convocation des politiques à agir continuellement pour hâter à l’avènement d’une société nouvelle par-delà les hommes nouveaux. C’est pourquoi, il est indiqué que « la vision bergsonienne que cette « durée » est la réalité première et ultime et « l’élan vital » n’existe qu’à l’intérieur de ce flux est très proche de la théorie de l’émergence » (A. Huxley, 1994, p. 84).
Toutefois, en évoquant les personnalités créatrices comme susceptibles d’impulser l’élan de l’émergence dans la vie socio-politique ; nous ne proposons ni une mystique de la politique ni une politique mystique. L’enjeu d’une telle démarche se résume à une invitation des hommes d’un génie politique à l’action rénovatrice et transformatrice de l’homme en sujet éthique de la politique. Et pour cause, « il y a déjà quelque chose de quasi divin dans l’effort, si humble soit-il, d’un esprit qui se réinsère dans l’élan vital, générateur des sociétés qui sont génératrices d’idées (H. Bergson, 1993, pp. 64-65).
Références bibliographiques
BERGSON Henri, 1961, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, P.U.F.
BERGSON Henri, 1993, La pensée et le mouvant, Paris, P.U.F.
BERGSON Henri, 1996, L’évolution créatrice, Paris, P.U.F.
BERGSON Henri, 2001, Œuvres, Paris, P.U.F.
BICKEL Lothar, 1962, Le Dehors et le dedans, trad. de Robert Rovini, Paris, Gallimard.
BOUANICHE Arnaud, 2000, « La pensée et le nouveau » in Le Magazine littéraire, (n°386), pp. 43-45.
CHOMIENNE Gérard, 1989, Bergson, la conscience et la vie, le possible et le réel, Paris, Ed. Magnard.
GOUHIER Henri, 1989, Bergson dans l’histoire de la pensée occidentale, Paris, Vrin.
GOUHIER Henri, 1999, Bergson et le Christ des évangiles, Paris, Vrin.
HERSCH Jeanne, 1993, L’étonnement philosophique, Paris, Gallimard.
JANKÉLÉVITCH Vladimir, 1999, Henri Bergson, Paris, P.U.F.
LEVESQUE Georges, 1973, Bergson : vie et mort de l’homme et de Dieu, Paris, Les éditions du Cerf.
SARAFIDIS Karl, 2013, Bergson : La création de soi par soi, Paris, Eyrolles.
VIEILLARD-BARON Jean-Louis, « L’intuition de la durée, expérience intérieure et fécondité doctrinale » in Bergson, la durée et la nature, Paris, P.U.F, 2004, p. 45-75.
WAHL Jean, 1957, Traité de métaphysique, Paris, Payot.
WORMS Frédéric, 2004, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, P.U.F.
ÉMERGENCE AFRICAINE ET RECONNAISSANCE AU PRISME DE BERGSON : ENTRE LE POSSIBLE ET LE RÉEL
Honoré Kouassi ELLA
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
ellahnore27@yahoo.com
Résumé :
L’ambition de l’émergence des pays africains s’inscrit entre lueurs et leurres. Ainsi, l’annonce de leur émergence à divers horizons augure de la lueur d’un possible théorique. Or, en fait, « c’est le réel qui se fait possible, et non pas le possible qui devient réel » (H. Bergson, 1946, p. 115). La réalité africaine invite donc à percevoir que le possible de l’émergence africaine se heurte à trois questions qui révèlent la présence réelle d’empêchements et donc de leurre. En effet, le droit de proclamer l’émergence d’un pays relève-t-il des grandes puissances ou d’une autoproclamation ? Faut-il fonder l’émergence sur l’économie et une cumulation d’infrastructures au détriment d’une superstructure qui les porterait ? Ne gagnerait-on pas à travailler à aller de l’avant plutôt que de quêter des titres pompeux et inféconds ?
Mots-clés : Autoproclamation, Émergence, Possible, Reconnaissance, Réel.
Abstract :
The ambition of African countries’ emergence is inscribed between gleams and lures. Thus, the announcement of their emergence at various horizons presages from the gleam of a theoretical possible. Whereas; in fact “it is the real that becomes possible and not the possible that becomes real” (H. Bergson, 1946, p. 115). The African reality thus invites to discern that the possible of the African’s emergence comes up against three questions which reveal the real presence of impediments and thus of luring. Indeed, is the right to proclaim the emergence of a country a matter of power politics or self-proclamation? Is it necessary to base emergence on the economy and the accumulation of infrastructures at the expense of a superstructure that would carry them? Would not it be better to work on going forward rather than seeking pompous and infertile titles?
Keywords : Self-proclamation, Emergence, Possible, Recognition, Real.
Introduction
Que les pays africains annoncent leur aspiration à faire partie dans un proche avenir de la très élitiste liste des pays dits émergents, cela est indicateur de leur volonté de passer enfin d’une situation de pays immergés dans la nasse du sous-développement vers une meilleure position dans la stratification internationale des pays. Quelle noble ambition, en effet, pour les pays africains que d’afficher leur volonté de sortir la tête de l’eau boueuse des États insignifiants, pour entonner, eux aussi, l’hymne au développement! C’est que le concept d’émergence, comme dit Juignet (2015, en ligne) est « un concept intéressant et porteur d’avenir, car il permet une conception diversifiée du monde ». Mais, il faut se rendre à l’évidence que, d’une part, le concept d’émergence « est aussi dénoncé comme obscur et sans fondement par une partie de la communauté scientifique » (P. JUIGNET, 2015, en ligne), et d’autre part, au souvenir de certaines mobilisations antérieures et de certaines initiatives des Pays en Voie de Développement, on est conduit à l’idée que la lueur d’espoir qui profilait à l’horizon des annonces africaines de l’émergence laisse la place à la prise de conscience d’un leurre.
En mobilisant la pensée bergsonienne au prisme de laquelle nous entendons lire la marche de l’Afrique, on pourrait se libérer des scories propagandistes et électoralistes dont on a entouré le concept d’émergence pour se mettre à la table de la réflexion. Face, en effet, au flou qui entoure le concept émergence et surtout le concept de pays émergent, la question qui surgit est celle de savoir si la reconnaissance d’une émergence africaine relève du possible ou du leurre. Pour prendre en compte cette interrogation, une double interrogation se fait jour dans notre esprit : en quoi le rapport possible-réel dégage-t-il une approche clarifiée de la possibilité d’une émergence africaine ? L’émergence africaine ne soulève-t-elle pas des questions préalables à son effectivité ?
1. Le rapport possible-réel chez Bergson et la problématique de l’émergence africaine
Du latin “emergere”, signifiant “sortir”, “jaillir”, l’Émergence renvoie au fait de sortir de l’eau ou d’un liquide quelconque, d’un système, d’un fluide, au fait de se détacher d’un système d’éléments dont il est initialement composé pour devenir un tout autre système plus complexe. Comme tel, le concept peut s’appliquer à une grande diversité de domaines dans lesquels il prend des définitions spécifiques : physique, biologie, géologie, sociologie-politique. Ainsi, l’émergence se donne aussi comme l’apparition soudaine d’une idée, d’un fait social, économique ou politique. Le concept de “pays émergent” apparu dans les années 1980 véhicule l’idée d’une irruption économico-sociale sur l’échiquier des pays qui comptent du fait d’une croissance économique forte, d’un développement des infrastructures socio-économiques, mais avec un PIB inférieur à ceux des pays développés. « On attribue à Antoine Van Agtmael, économiste néerlandais à la Société financière internationale, en 1981, la première utilisation de l’expression, pour parler de pays en développement offrant des opportunités pour les investisseurs » (M. DAGRY, 2014, en ligne).
La question qui se pose est celle de la possibilité et de l’intérêt pour les pays africains de réaliser une ascension à la position élitiste de pays émergents. Dire si la réalisation d’une telle ascension relève du possible, invite à bien cerner le concept même de la possibilité dans son rapport au réel pour éviter toute méprise ou tout écran conceptuel. À cet effet, l’analyse bergsonienne du possible et du réel nous parait d’un intérêt capital. Il s’agira donc, ici, de saisir avec Bergson la double approche du rapport entre le possible et le réel, avant d’investir cette double approche, sous un double angle, dans la question de la prétention à l’émergence des pays africains.
1.1. Bergson et la double approche du possible
Bergson distingue deux approches dans le possible : la possibilité logique et la possibilité organique ou vivante. Alors que la première relève de l’intelligence calculatrice, la deuxième s’accole à la ligne de faits et relève de l’intuition. Alors que la première est permission en tant que virtualité à laquelle nul obstacle logique ou théorique ne devrait s’opposer à son avènement, la deuxième est promesse, c’est-à-dire projection d’un germe déjà en effectuation conduisant rétrospectivement à en poser la possibilité.
Ordinairement en effet, le possible est conçu comme le virtuel, au sens où il représente ce qui n’est pas mais peut advenir. En ce sens, écrit V. Jankélévitch (1999, p. 215-216), « Les choses seraient possibles avant d’être réelles, et il y aurait plus dans leur existence actuelle que dans leur existence possible ». Le monde serait, dit H. Bergson (1946, p. 111), une sorte d’« armoire aux possibles » où seraient enfermées les virtualités qui se convertissent sous une impulsion démiurgique en réalités quotidiennes. On est ici dans le schéma du Dieu leibnizien choisissant entre les possibles pour faire advenir le meilleur des mondes possibles.
Mais, ce sens du possible est, pour Bergson, un sens négatif et purement logique. Or, la possibilité logique, celle qui se distingue de la possibilité organique, ne se donne que comme permission en tant qu’un rien dont l’avènement ne saurait connaître d’obstacle logique ou théorique. En toute rigueur, ce possible ne convoque pas l’expérience, les faits. Selon que dans la perception de ce possible l’on ignore les empêchements ou que l’on s’y arrête, ce possible se donne comme contingent, c’est-à-dire comme ce qui peut être ou ne pas être. Dans tous les cas il n’est qu’une simple virtualité, fruit de l’esprit, qui précède le réel. On pense alors que « la possibilité des choses précède leur existence » (H. Bergson, 1990, p. 110). Il n’en est pourtant rien pour H. Bergson (1990, pp. 111-112) : « Au fur et à mesure que la réalité se crée, imprévisible et neuve, son image se réfléchit derrière elle dans le passé indéfini (…) Le possible est donc le mirage du présent dans le passé ». En d’autres termes, c’est au regard de la réalité ou des éléments en effectuation d’une réalité que, rétrospectivement, l’on déduit la possibilité à cette réalité, en posant l’antériorité de ladite possibilité. C’est, par exemple, dans son effectuation qu’une œuvre d’art donne de dire de cette œuvre qu’elle était de l’ordre du possible.
C’est la survenue dans la scène politique d’un Lénine qui a suggéré la possibilité d’une révolution communiste et qui peut suggérer aujourd’hui la possibilité d’autres révolutions de même nature. Ainsi, loin de l’apparence théorique, « C’est le réel qui se fait possible, et non pas le possible qui devient réel » (H. Bergson, 1990, p. 115). Les possibles ne peuvent donc être envisagés qu’après coup, au regard des réalités ou des entames de leurs effectuations. De la vie des sociétés, des pays, on ne saurait se livrer à un enfermement dans des rigorismes mathématiques et encore moins à des prospectives de possibles étalés de toute éternité comme des êtres platoniciens. Certes, les calculs économiques et la planification des indices de développement donnent des probabilités et non des promesses – nous reviendront à ce terme qui donne le sens positif du concept de possible comme germe – de développement. Mais, c’est ignorer que la vie des sociétés a d’imprévisibles nouveautés à revendre que de s’arc-bouter à la lueur d’un possible unique et d’en dater la concrétisation.
Dès lors, y a-t-il matière à croire possible et en effectuation l’émergence des pays africains ? On est, a priori, sur le plan logique, tenté de répondre par l’affirmative en portant le regard sur les pays émergents d’aujourd’hui qui, il y a peu, partageaient la même réalité que les pays sous-développés.
1.2. La virtualité de l’émergence africaine : une pale lueur
Que l’Afrique émerge des zones abyssales de la hiérarchie des nations, cela s’impose comme une nécessité après plus de cinquante ans d’indépendance! Aujourd’hui s’affichent des volontés de faire des pas concrets en direction du développement et de faire reconnaître ces pas. Il paraît clair que les annonces avant l’heure de l’émergence des pays africains par eux-mêmes participent de cette bonne volonté et se donne comme une lueur d’espoir. L’émergence africaine parait ainsi de l’ordre du possible, au sens – nous l’indiquions avec Bergson – d’une possibilité logique plaçant en veilleuse la réalité des faits.
Qu’est-ce qui entretient donc le rêve de l’émergence des pays africains ? M. Mbalouladu (2/2011, p. 108) écrit que
l’histoire économique est jalonnée de concepts qui qualifient le niveau ou le statut des pays. On a ainsi des pays développés et des pays sous-développés […], des pays industrialisés et des pays non industrialisés, etc. Chaque qualification exprime ainsi des caractéristiques ou des objectifs spécifiques et distinctifs que peuvent se fixer des pays. Le concept de pays émergent correspondant en d’autres termes à économie émergente s’inscrit dans cette logique.
Cette approche essentiellement axée sur l’économie comme base du développement pose l’émergence comme un objectif spécifique que peut se fixer un pays. Cet objectif que se fixent les pays africains est a priori posé comme possible et devant passer de l’ordre du possible à celui du réel. Et diverses raisons pourraient, a priori du moins, militer en faveur de cette aspiration à l’émergence.
La première de ces raisons parait la légitimité de la volonté de sortir de la dépendance, de la tutelle et du sous-développement. Sitôt que cela devient possible, disait Rousseau, s’émanciper devient un devoir. Aspirer vraiment à émerger, aujourd’hui, est en soi un mérite à saluer et une disposition à la réalisation de l’émergence. Accompagner ce vouloir d’efforts de construction d’infrastructures nécessaires au bien-être des populations, c’est donner des signaux d’une volonté d’émerger enfin du sous-développement. La deuxième raison de penser qu’est possible l’émergence de l’Afrique est donc l’indéniable accroissement infrastructurel. Il faut, comme une cause de cet accroissement, ajouter la croissance économique. À l’opposé de certains pays de l’Europe qui ont frôlé la banqueroute, ces deux dernières années, la plupart des pays africains connaissent une certaine santé économique. Les avancées économiques font de l’Afrique un intéressant pôle de croissance et, à côté des géants d’Asie, d’excellents pôles d’investissement pour le monde des affaires.
Ainsi, non seulement la volonté ne manque pas, mais en plus, c’est ici que pourrait prendre sens l’approche strictement logique et théorique du concept d’émergence : la préséance du possible sur le réel et ne tenant pas compte du réel. En ce sens, tout est logiquement possible, entendu que le virtuel, une fois posée, est appelé au jour par la volonté de celui qui le pose. On entretient alors l’idée que dans le monde vivant, comme dans le monde inerte, « l’émergence désigne tout simplement le processus de formation de nouveaux degrés d’organisation et d’intégration » (P. Juignet, 2015, en ligne). Il s’agirait donc de passer, avec une certaine soudaineté, de l’état de pays en voie de développement ou simplement de pays sous-développés à l’état de pays émergents, c’est-à-dire à l’état de pays côtoyant le développement par une profonde mutation due à une profonde réorganisation globale des secteurs importants de l’existence sociale. Les BRIC (le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine) hier, La Corée du sud, l’Afrique du Sud et le Venezuela aujourd’hui, donnent le témoignage qu’il n’est pas utopique de porter son nom sur la liste des pays émergents.
Toutefois, ces raisons suffisent-elles à nourrir la réalité de l’émergence des pays africains ? Certainement pas, si l’on s’en tient aux critères qui se mettent en place pour l’élection à l’émergence, critères que Mbalouladu (2/2011, p. 114) résume ainsi:
Une imposante population, des capacités technologiques qui impulsent une mutation profonde, la taille gigantesque de réservoir de main d’œuvre, la richesse des sous-sols, particulièrement pour la Russie (…) le développement implique le changement économique et social.
Si donc sur le plan purement logique et théorique, l’émergence parait de l’ordre du possible pour les pays africains, la question mérite d’être posée de savoir si le réel africain est porteur de cette possible émergence ? Cette question nous invite à quitter la sphère de l’intelligence théorique pour aller aux particularités dynamiques du réel que seule perçoit l’intuition. Car, « L’intelligence capte le possible uniquement, et sans se demander quels possibles existeront ; seule l’intuition est faite pour connaître les possibles qui seront actuels, seule elle surprend le virtuel au moment précis de son passage à l’acte » (V. Jankélévitch, 1999, p. 218).
1.3. L’évanescence réelle de l’émergence des pays africains
Ainsi que l’indique Bergson, le véritable possible, celui dont la probabilité de réalisation est plus forte parce qu’il s’enracine dans le réel, est postérieur au réel, dicté par le réel et rétrospectivement perçu à partir du réel. Or, le réel ne montre-t-il pas qu’est évanescente la virtualité de l’émergence de l’Afrique ?
Si « le possible est un être ambigu qui est, en quelque sorte, à califourchon sur le Rien et sur le Quelque chose » comme dit Jankélévitch (1999, p. 217), des questions surgissent qui conduisent au doute et même à des apories sur l’émergence des pays africains. À ces questions, nous reviendrons. Qu’il nous suffise, pour l’immédiat, de noter qu’une fois le mirage de préséance du possible sur le réel relevé, s’évanouit la tendance à tirer de l’armoire du possible un possible rêvé pour en faire une réalité à tel ou tel proche horizon. L’on réalise alors que la réalité qui se projette à l’horizon comme possibilité dont les jalons sont posés, diverge à divers égards du possible de l’émergence attendue. Le réel, c’est celui des conflits larvés projetant le possible de guerres civiles. Le réel qui se donne à voir, c’est celui d’une concentration des pouvoirs aux mains de l’Exécutif perpétrant l’avéré et le possible de prisonniers politiques et d’une justice à la solde du régime en place. Le réel, c’est encore un manque de nationalisme et du sens du bien commun laissant envisager une possible destruction des infrastructures au premier mouvement de colère. Le réel des monnaies sous-tutelle, comme le franc CFA, est aussi là pour rappeler qu’on ne saurait parler d’émergence sans indépendance financière et monétaire. L’historien B-Y Amzat (2017, en ligne), dans un entretien, déclare avec justesse ceci :
La monnaie est donc un élément d’identité nationale et un outil de souveraineté et de reconnaissance internationale. Il est difficile de se développer sans avoir le contrôle de tout le circuit monétaire qui ne se résume pas à la planche à billets. Le franc CFA a été créé en 1945, ce qui veut dire que les États africains sont devenus indépendants dans un système monétaire dépendant. Par conséquent, le maintien dans le franc CFA constitue une amputation réelle de leur souveraineté.
Le réel de nos pays, c’est la hantise à l’approche des jouxtes électorales avec leurs cortèges de déplacement de populations, faisant craindre de possibles guerres ouvertes avec interventions d’avions de combat chèrement achetés par des dirigeants politiques quand des hôpitaux manquent du nécessaire. Et les exemples peuvent être multipliés à l’infini, disant tous que le possible envisagé comme émergence dans les conditions actuelles n’est que leurre pour flatter l’égo de nigauds.
On est en droit de dire qu’en arrimant l’analyse aux réalités quotidiennes dans leurs évolutions, au lieu de s’en tenir, idéologiquement ou par souci de propagande politique, à l’absolu et aux principes, le possible de l’émergence devient évanescent. La porte parait alors ouverte à une grande diversité de possibles qui rompt avec le possible d’une émergence envisagée comme seule réalité dans un futur proche. À moins de conférer à l’émergence un contenu simpliste ou de dilater à l’infini l’idée d’horizon (quand on parle d’horizon 2020 par exemple), il parait difficile que la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun puissent accéder à l’émergence, c’est-à-dire qu’ils atteignent le niveau de développement de la Chine, de la Corée ou de la Russie avant les trente ou quarante prochaines années.
Mais, au fond, n’est-ce pas manquer l’essentiel que de poursuivre un mirage pris pour une noble ambition ? Ne gagnerait-on pas, au-delà de la question de la possibilité de l’émergence, à redescendre des velléités propagandistes pour interroger l’intérêt même à être dit émergent ? En d’autres mots, des questions sur l’émergence nous paraissent s’imposer avec une certaine urgence comme des préalables à prendre en compte.
2. Questions préalables à l’émergence des pays africains
Nous disions que des questions surgissent qui conduisent au doute et même à des apories sur l’émergence des pays africains. Ces questions ne portent pas sur le processus par lequel s’opérationnaliserait l’élévation à l’émergence des pays africains. Pour en arriver à de telles questions, il aurait auparavant fallu clarifier certaines questions de fond sur l’intérêt pour les pays africains à accéder à l’émergence. Pour notre part, ces questions peuvent être réduites à trois principales : à qui revient le droit de la reconnaissance de l’émergence ? Est-il vraiment judicieux de se lancer dans une course à cet autre pompeux concept qu’est l’émergence ? La composante infrastructurelle suffit-elle à dire l’émergence ?
2.1. Du droit de proclamer l’émergence
À qui revient le droit de reconnaître qu’un pays est émergent ? Qui doit reconnaître l’émergence des pays africains ? Il se pose ici le même type de question qui s’est posée, il y a peu, aux africains sur le droit de reconnaissance du statut de philosophe : à qui revient le droit de reconnaître la désignation de philosophes aux penseurs africains ? Jean Paulin Hountondji, dans Sur la philosophie africaine, tomba dans le double piège de la fétichisation scripturaire et de la subjectivité en posant ceci : « J’appelle philosophie africaine un ensemble de textes : l’ensemble précisément, des textes écrits par des Africains et qualifiés par leurs auteurs eux-mêmes de « philosophiques » » (P. Hountondji, 1980, p. 11). Il s’agit pour le penseur africain, dans un acte d’auto-proclamation, de se reconnaître lui-même philosophe. De même, il s’agirait, pour les pays africains, par leurs dirigeants, de se reconnaître pays émergents. La question mérite pourtant d’être sérieusement envisagée : à qui revient le droit de nommer ou d’octroyer un titre comme celui de “pays émergent” ? Ce titre relève-t-il de la propre compétence des pays concernés ou doivent-ils l’attendre des grandes puissances ou de grandes institutions ? Chacune des positions est porteuse d’insuffisances.
Par leurs projections et leurs annonces, les pays semblent engagés dans une logique d’autoproclamation des pays africains au rang de pays émergents. Or, l’acte d’autoproclamation suggère une autodisqualification. En quel sens ? C’est le prix Nobel de littérature 1986, Wolé Soyinka qui, à bon droit, faisait observer que le tigre n’a pas à proclamer sa “tigritude”, mais à agir simplement comme un tigre. On pourrait dire ici que l’autoproclamation est d’autant nuisible qu’elle vient exprimer deux ou trois choses qui disqualifient le proclamateur. L’autoproclamation est, d’abord, l’expression d’un manque d’assurance, car quand on n’est pas sûr qu’on nous voie tel qu’on souhaite être vu, la faste monstration se substitue à la sereine démonstration. Quand on n’est pas sûr d’atteindre un objectif, la tendance est de proclamer assez fort son titre pour donner l’illusion de l’effectivité. Le possible devient alors le réel effectif.
En somme, l’autoproclamation d’une émergence est porteuse d’une subjectivité qui peut s’avérer vide de contenu. Ainsi, en 2020, la Côte d’Ivoire peut se proclamer “pays émergent”. Mais, quel intérêt la Côte d’Ivoire tirerait de cette autoproclamation si le monde entier n’y voit que du vent et si les citoyens ne voient dans leur situation de vie, de santé, d’environnement, de dissensions sociales, rien de changé ? Or, 2020 nous parait trop proche pour qu’une auto-organisation suffisante fasse du rêve une réalité et de la lueur du possible un réel effectif. Peut-être gagnerait-on à tendre vers une proclamation de la reconnaissance par les institutions internationales pilotées par les grandes puissances. Mais, n’est-ce pas ici aussi qu’un flou est à dénoncer ?
Le concept de “pays émergents” serait né dans des circonstances où il s’agissait de dégager des pistes pour déclarer des pays comme des opportunités d’investissement. L’ambition des grandes puissances, est donc avant tout de trouver des opportunités d’investissements. Mais, au nom de quel droit, des pays, aussi puissants soient-ils, ou des institutions se posent-elles en garantes de bonne gouvernance pour distribuer de bons ou mauvais points aux autres pays, les classer et conditionner l’aide internationale à leurs critères ? Là est le flou.
Le flou vient encore de ce que des pays comme la Chine et la Russie soient maintenus au rang de pays émergents. Qu’est-ce que la Chine a de moins que la France ou l’Italie pour être non pays développé, mais pays encore en émergence ? Qu’en sera-t-il de la Côte d’Ivoire en 2020 ou du Cameroun en 2030 ? N’attendront-ils pas indéfiniment leur élection s’ils doivent recevoir leur sésame des pays développés qui dictent les règles aux institutions internationales ? Et puis, à quel stade finit l’émergence et commence le développement ? Cette dernière question est d’autant intéressante que ne manquent pas les critiques suspicieuses adressées aux pays émergents, telle l’observation de M. Mbalouladu (2011, p. 107) :
Dans l’ensemble, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa) sont handicapés par une série de faiblesses, notamment, un cadre juridique peu propice à l’amélioration du climat des affaires, un système éducatif insuffisant ou inadéquat, des infrastructures lacunaires, l’écart scientifique et technique qui sépare les pays développés des pays émergents reste considérable.
En somme, que l’élection au rang de pays émergent soit autoproclamée ou qu’elle soit suggérée par les grandes puissances, la reconnaissance de l’émergence pose l’épineux problème du droit de nommer. Or, là où se pose le problème du droit de nommer, se pose en réalité un problème dont les enjeux oscillent entre subjectivité et hégémonie. Mais cette préoccupation laisse éclore une autre : la question du statut de l’émergence dont la tendance est de la réduire aux infrastructures matérielles.
2.2. La question de la réduction matérialiste de l’émergence
La question ici est de savoir si la croissance quantitative et qualitative des infrastructures suffit à conduire à l’émergence ?
Le constat pour nos pays africains aspirant rapidement à l’émergence, c’est l’accent mis sur deux composantes du tissu social : l’économie et les infrastructures. Dans l’ignorance de la profonde fracture sociale et des menaces de résurgence des démons de la guerre, en Côte d’Ivoire par exemple, les autorités se livrent avec une pointe de fierté à la comptabilité des routes bitumées et des ponts et on parle de croissance tutoyant les deux chiffres. Le Sénégal oublie volontiers ses luttes intestines d’allures politico-judiciaires et comptabilise plutôt ses réalisations en adductions d’eau potable, en électricité et en infrastructures routières. Or, quel est le statut de l’émergence quand elle n’est qu’une cumulation d’infrastructures au détriment de la dimension superstructurelle, au sens marxiste, qui la porte ?
La Chine, par la voix du premier conseiller de son Ambassade en Côte d’Ivoire, nous enseigne qu’elle a mis 35 ans à se forger une nouvelle mentalité pour se donner de la hauteur afin d’être le géant qu’elle est aujourd’hui. Son Excellence Monsieur Quian Jin indique même quatre conditions pour devenir un pays émergent et la première de ces conditions est, non l’économique et l’infrastructurel, mais la stabilité[9]. Où en sont mentalement nos pays pour prétendre être émergents dans 3, 8 ou 18 ans ?
Ponts, routes et même métros ne font pas l’émergence, si persiste une mentalité immergée dans la clôture égocentrique où aux prochaines joutes électorales, la colère pourrait tout emporter au prétexte que des fétiches ont été dissimulés sous les monuments et autres réalisations par l’adversaire politique. H. Bergson (1990, p. 50) nous enseigne que « ce n’est pas en élargissant des sentiments plus étroits qu’on embrassera l’humanité ». En d’autres mots, ce n’est pas par simple élargissement de sentiments égoïstes que l’on peut espérer passer de l’âme ou de la société close à l’âme ou à la société ouverte. Sans une mentalité émergente, la politique économico-infrastructurelle de l’émergence resterait un leurre. Et M. Dagry (2011, p. 107) d’observer qu’« On ne peut pas souhaiter aller vers une émergence avec des habitudes de pays sous-développés, enracinés dans l’impunité, le désordre et la corruption généralisée », les divisions politico-ethniques et la haine.
Sans une assise mentale, l’émergence reste évanescente, un mirage même. L’horizon envisagé, comme tout horizon, reculerait dans le temps à mesure de notre rapprochement. Et dans sa fugacité, l’horizon finirait par ne plus être perceptible à nos regards. On aurait aussi compris qu’au fond la véritable émergence se veut l’élan d’un tout composite qui, comme l’indique Bergson, ne saurait se réduire à une stérile dichotomisation de la vie.
La dichotomisation qui est cette tendance à poser dans un rapport oppositionnel les aspects des réalités de l’existence, aux yeux de Bergson, est une maladroite approche étriquée des réalités vivantes et dynamiques. Il n’y a pas d’un côté la matière et de l’autre l’esprit dans une radicale opposition. Ainsi, autant l’homme n’est pas pur esprit ou pur corps, mais corps et esprit, autant il n’est pas de société humaine évoluant matériellement sans prise en compte de sa dimension spirituelle qui ne conduise à un aboutissement déséquilibré et malheureux pour le corps social. La double frénésie qui a caractérisé l’histoire de l’humanité et conduit à de malencontreux travers préjudiciables pour le genre humain, est là pour dissuader l’homme de reproduire ce que H. Bergson (1990, p. 316) appelle « loi de la dichotomie » :
nous appellerons loi de dichotomie celle qui paraît provoquer la réalisation, par leur simple dissociation, de tendances qui n’étaient d’abord que des vues différentes prises sur une tendance simple. Et nous proposerons alors d’appeler loi de double frénésie l’exigence, immanente à chacune des deux tendances une fois réalisée par sa séparation, d’être suivie jusqu’au bout.
Accentuer par option, dans une logique de développement social, la frénésie matérialiste, c’est n’avoir pas compris le mouvement caractéristique du monde, de l’élan de vie à l’œuvre. En réalité, le monde est un tout composite où le matériel est en imbrication avec le spirituel. C’est faire fausse route que d’espérer réaliser pleinement une émergence en passant sous silence le spirituel, la mentalité des peuples appelés à émerger. Cette vision conduit aussi à poser l’émergence – et sa projection finale le développement – comme étant, au niveau d’une population, la combinaison des changements sociaux et mentaux qui la rendent apte à faire croître globalement, cumulativement et durablement son produit réel.
N’est-ce d’ailleurs pas le superstructurel qui porte l’infrastructurel ? Bien que foncièrement matérialiste et par conséquent croyant en la primauté de la matière et de l’économique, Marx et Engels, dans L’Idéologie allemande, reconnaissent le support inévitable que constitue la superstructure pour que tienne la charpente économique et infrastructurelle. Par « superstructure », ils entendent un tout complexe fait de gestion politique, de lois, d’idéologies, d’us et de faits de cultures qui contribuent à perpétuer les rapports sociaux capitalistes.
Cette superstructure, en particulier l’État qui en est l’expression politique principale, ne saurait se réduire au seul déterminisme économique, puisqu’elle conserve une part relative d’autonomie et peut, le cas échéant, influer sur la sphère économique et la faire évoluer. Il apparaît donc que même chez Marx et le matérialisme dialectique, les données superstructurelles ne sont ni à nier ni à percevoir comme des épiphénomènes. Plus radicalement, nous disons que sans cette superstructure qui fait être et qui conditionne les structures économiques et les infrastructures, elles sont guettées par la destruction à l’instar d’un château de cartes que visite un vent pernicieux. Comme dit P. Juignet (2015, en ligne), « seules les organisations stables se maintiennent, les autres disparaissent ».
Avec Bergson, on est donc en droit de se demander quel statut l’on souhaite donner à l’émergence en la castrant de cette composante tout aussi essentielle que constitue la mentalité des hommes et leur existence sociale. Peut-être gagnerons-nous à nous donner le temps nécessaire pour nous forger une mentalité de développement, dans la réalité et la durée, pour constituer le supplément d’âme nécessaire à nos ambitions. Peut-être gagnerons-nous à cet effet à optimiser le travail attendu de nous, au lieu de glisser sans résistance sur cette pente de la quête du titre de “pays émergents”. Or, quêter un titre ou œuvrer à figurer sur une liste, n’est-ce pas verser – encore une fois – dans des concepts pompeux sans réelle incidence ?
2.3. La question du pompiérisme conceptuel
Par pompiérisme, nous entendons cette grandiloquence qui caractérise certaines personnes ou certains dirigeants pour se donner plus d’importance qu’ils n’en ont. Par pompiérisme conceptuel, nous entendons donc cet amour, frisant le guignolesque, pour les concepts pompeux fonctionnant comme des pis-aller. S’attribuer de grands concepts aux fins de charmer, cela est pour le pompiérisme conceptuel ce que sont les attitudes et les vêtements emphatiques pour le comportement pompiériste : un réflexe de pompier volant au secours des sinistrés. Au fait, comme dit Jankélévitch (1999, p. 226), « Nous sommes immergés dans les réalités visibles, il suffit d’ouvrir les yeux. Mais il faut les ouvrir ». Or, l’Afrique, refusant d’ouvrir les yeux sur la réalité, semble bien se complaire dans le pompiérisme conceptuel.
Hier, en effet, le concept en vogue véhiculant une pointe de fierté était celui de “pays en voie de développement”. Dans les discours politiques, on se plaisait à rappeler le statut enviable de “pays en voie de développement” par opposition aux pays sous-développés. Il s’est même agi d’organiser des rencontres au sommet pour planifier le développement de ces pays africains. C’était le sens du NEPAD[10] qui a suscité de grandes lueurs d’espoir. Quand on voit les Sommets au nom du NEPAD et son échec, on est tenté de dire que le NEPAD relève aussi d’un pompiérisme conceptuel n’ayant valu que du vent.
Curieusement, le nébuleux NEPAD qui attendait que le développement de l’Afrique, moyennant la bonne gouvernance et la démocratie, soit financé et octroyé par les grandes puissances a cédé le pas à la course à un autre concept : “Pays Pauvres Très Endettés” (PPTE). Le cercle vicieux de ce nouveau concept (“les PPTE”) est le suivant : pour être éligible, puis élu, à être déclaré pauvre et incapable de rembourser ses dettes, il fallait au préalable réussir à rembourser une bonne part de ladite dette afin de prouver par cela son incapacité à rembourser ses dettes. La Côte d’Ivoire s’est ainsi battue pendant des années pour avoir l’honneur de figurer sur la liste des PPTE. Mais, ce n’était encore qu’un concept pompeux – peut-être aussi honteux – dont les retombées pour le petit peuple sont encore attendues.
Les afrosceptiques doivent avoir le sourire au coin des lèvres en étant témoins de l’émergence de ces concepts et de ces rencontres suscitées. Car tout se passe comme si au fil de la juxtaposition des concepts, les pays pauvres s’enfonçaient dans d’onéreuses vacuités. Disons avec H. Bergson (1946, p. 180) que les juxtapositions de concepts « ne donneront jamais qu’une recomposition artificielle de l’objet » et ce, d’autant plus que rien dans le vécu ne donne vraiment de voir se dessiner le possible de l’émergence souhaitée. Et pourtant, le nouveau concept qui fait rêver les pays africains et mobilise des moyens pour diverses rencontres au sommet, c’est le concept de “pays émergents”. Une autre course au vent semble résolument engagée. Ne gagnerait-on pas plutôt à éviter la course distractive aux concepts pompeux et fantoches au profit du travail acharné pour simplement améliorer nos conditions d’existence, sans attendre une reconnaissance des grandes puissances ou une stérile autoproclamation ?
« Le travail ! et après le travail, l’indépendance, mon enfant ! N’être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Et il faut fuir l’homme qui n’aime pas le travail » écrit B. B. Dadié (2006, p. 96). Les États africains gagneraient à prendre à leur compte cette injonction de Bernard Dadié : le travail pour n’être à la charge de personne, pour n’attendre de personne une nomination, un titre pompeux, même pas de soi-même.
Si le Zarathoustra de Nietzsche invitait ses disciples à oublier ses enseignements, c’est bien parce qu’il voulait leur enseigner la culture de l’invention, de l’ouverture à des nouveautés. De même, Bergson notait que la mémoire reproductrice peut avoir ceci de nous retenir dans le passé en nous donnant de rêver la vie au lieu de la vivre. La mémoire reproductrice peut alors se donner comme un frein à la vie immédiate qui se donne, à l’instar d’une œuvre d’art, comme jaillissements permanents de nouveautés, constructions de possibilités nouvelles. Il faut aussi observer que la mémoire pure a également cette fâcheuse tendance à nous projeter dans l’avenir en enjambant la réalité immédiate et en peignant un possible imaginaire.
Ce faisant, l’homme s’accroche à cet unique possible tissé dans les fibres de la pure virtualité et il perd pied sur le réel qui, seul, constitue le socle du possible. L’action transformatrice qui donne sens et fait passer du possible au réel, est oubliée au profit du concept qui s’est substitué en percept. On ne perçoit plus la fin à venir parce qu’on récite une fin anticipée conceptuellement comme déjà là. Le possible, alors conçu comme pure virtualité, est transporté par un acte décisoire de l’esprit dans l’immédiat comme étant déjà effectif. L’action dans la durée qui devait permettre une conceptualisation du possible et une effectuation progressive du réel, est revisitée par une compression du temps donnant de voir comme étant ce qui était envisagé comme devant être. L’avenir étant spontanément advenu – que les signes préliminaires soient présents ou absents – l’hymne à la réussite peut être entonnée. On voit là l’ère des proclamations tous azimuts de l’émergence des pays africains.
Or, il s’agit de travailler dans la durée au lieu d’agir dans l’attente d’être mis au rang des pays émergents comme si ce label, à lui seul, vaudrait aux peuples africains d’atteindre une noble fin, un mieux-être social. Aux apologistes des concepts pompeux, «les revanches cruelles de la matière sont là pour leur rappeler leur erreur » (V. Jankélévitch, 1999, p. 221) par l’avènement d’autres réalités que celles pompeusement proclamées. L’important est donc de travailler simplement et ardument et de laisser le soin à l’histoire de dire le mérite au lieu de se fixer des dates pour figurer sur des listes pour on ne sait quel intérêt.
On pourrait sans doute nous objecter qu’il faille se fixer des objectifs clairs dans un souci de programmation du développement et que l’émergence à atteindre en telle ou telle année répond à cette exigence de planification. Il faut alors répondre que l’émergence n’est pas un objectif clair[11], mais un dérivé embelli du sous-développement. Le seul véritable objectif de nos pays est le progrès dans la durée. Cet objectif est déclinable en objectifs spécifiques précis selon les pays, mais prenant en compte à la fois l’économique, l’infrastructurel et le superstructurel.
Conclusion
Trois idées centrales méritent, pour conclure, attention. Il paraît a priori légitime, pour les pays africains, de faire de l’émergence une tension immédiate à des horizons proches. Là est la lueur d’espoir après plus de cinquante ans d’indépendance. En faisant superficiellement du possible une pure virtualité posée a priori, on semble en droit de dire que cette lueur relève du possible.
En posant la vie comme une “armoire aux possibles” – là est la deuxième idée – il ne faut pas perdre de vue que la vie peut laisser jaillir d’autres possibles que le possible attendu. En se fixant donc a priori un possible comme objectif, il ne faut pas perdre de vue que le dynamisme vital affectionne les virages inattendus. C’est pourquoi, la lueur de l’émergence fixée ex nihilo peut bien se transformer en leurre, d’autant que le véritable possible est suggéré par le réel et ne vient que conséquemment à lui. De même, le réel de l’émergence paraitra un leurre si on l’attend au tournant d’une cumulation d’infrastructures oublieuses de l’entretien d’un sentiment national constructif, du sens du bien commun, de la stabilité et de la cohésion sociale.
Par ailleurs et enfin, notons-le : « La croissance est continue, mais tout changement est soudain » (V. Jankélévitch, p. 219).Ce dont on peut s’assurer, c’est la croissance à tous égards de nos États. C’est à cela qu’il importe de travailler dans la durée afin de laisser advenir spontanément, soudainement, le changement d’état de nos États. Il s’agit alors de travailler à aller de l’avant tant dans l’évolution des mentalités, l’unité nationale, le sentiment national que dans la croissance économique et infrastructurelle. Il s’agit de cesser de s’épuiser à s’accrocher à des concepts en vogue. Il s’agit d’éviter les stériles courses à se trouver sur des listes n’ayant de valeur que la flatterie de nos égos. Que l’émergence soit autoproclamée, octroyée ou gagnée, à quoi bon figurer sur une liste de « pays émergents », comme on s’est vanté hier d’être sur la liste des pays en voie de développement, puis, paradoxalement, sur celle des PPTE ? Puissions-nous simplement travailler à aller constamment de l’avant! Là est l’essentiel, le reste n’étant que stérile fanfaronnade.
Références bibliographiques
Entretien avec AMZAT Boukari-Yabara, réalisé par Moulzo, « Le franc CFA ou les ressorts néocoloniaux de la servitude monétaire »,
(https://www.contretemps.eu/franc-cfa-servitude-monetaire. [Mise en ligne le 17 Avril 2017]. Consulté le 7 juin 2017
BERGSON Henri, 1946, La Pensée et le Mouvant, Paris, PUF.
BERGSON Henri, 1990, L’évolution créatrice, Paris, PUF.
BERGSON Henri, 1990, Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF.
BINLIN-DADIÉ Bernard, 2006, Climbié, Abidjan, NEI.
DAGRY Macaire, « C’est quoi être un pays émergent ? », www.connectionivoirienne.net. [Mis en ligne le 28 avril 2014]. Consulté le 7 juin 2017.
JANKELEVITCH Vladimir, 1999, Henri Bergson, Paris, PUF.
JUIGNET Patrick, Le concept d’émergence. Philosophie, science et société [Mis en ligne en 2015]. http://www.philosciences.com. Consulté le 12 Avril 2017.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1991, La Monadologie, Librairie générale Française, Paris.
Les Echos du PNUD – Bulletin d’informations du PNUD-Côte d’Ivoire, « Abidjan, capitale de l’émergence africaine », 2e Trimestre 2015.
MARX Karl et ENGELS Friedrich, 1972, L’Idéologie allemande, trad. Renée Cartelle et Gilbert Badia, Paris, Ed. Sociales.
MBALOULADU Marcel, 2/2011, « La problématique de l’émergence économique des pays en voie de développement », in Revue Congolaise de Gestion, N°14.
RSS – Le Magazine officiel de la Réforme du Secteur de la Sécurité, N°5 ̸ Juillet-Août 2015.
WOLÉ Soyinka, « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore »
http://www.madinin-art.net/wole-soyinka-le-tigre-ne-proclame-pas-sa-tigritude/. [Mis en ligne le 11/11/2006 par le groupe martiniquais Madinin’Art]. Consulté le 12 Avril 2017.
L’ALTRUISME PLATONICIEN, FONDEMENT DE L’ÉMERGENCE VÉRITABLE
Fatogoma SILUÉ
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
silfata@gmail.com
Résumé :
Parler d’émergence véritable, c’est avant tout évoquer l’idée d’une émergence inclusive et tributaire de l’altruisme. Car, un individu, une classe sociale ou une société qui émerge solitairement ne saurait mener une existence véritablement épanouie. Le bonheur solitaire est, en effet, une illusion. C’est sans doute pourquoi Platon recommande le retour du philosophe (l’individu qui a émergé) dans la caverne afin d’éclairer, mieux, d’éduquer les autres citoyens. Ce souci désintéressé du bien d’autrui que traduit l’idée du retour du philosophe dans la caverne où il doit être roi, est une condition nécessaire de la véritable émergence.
Mots-clés : Autrui, Bonheur, Caverne, Citoyen, Éducation, Émergence, Philosophe-roi.
Abstract :
To speak about real emergence, it is before any evoking the idea of an emergence including and dependent on the altruism. Because, an individual, a social class or a society which emerges solitary could not lead a really spread existence. The solitary happiness is, indeed, an illusion. It is doubtless why Platon recommends the return of the philosopher (the individual who emerged) in the cavern to enlighten, better, to educate the other citizens. This concern made lose interest in the another’s property which translates the idea of the return of the philosopher in the cavern where he has to be a king, is a necessary condition of the real emergence.
Keywords : Other, Happiness, Cavern, Citizen, Education, Emergence, Philosopher-king.
Introduction
La thèse du philosophe-roi ou du roi-philosophe est l’épine dorsale de la philosophie politique de Platon. Elle plaide en faveur d’une étroite collaboration entre la philosophie et la politique. Cela signifie que pour le fondateur de l’Académie et par ricochet, pour tous ceux qui s’inscrivent dans la tradition de l’idéalisme politique, la politique n’est pas et ne doit pas être une sphère autonome, c’est-à-dire une sphère qui a ses règles et ses valeurs propres. C’est dire qu’elle ne doit pas être abandonnée aux lubies des seuls politiciens (au sens péjoratif du terme). L’activité politique doit s’allier à la réflexion philosophique dont la vocation est de l’éclairer et de l’orienter par la réflexion critique. C’est le sens de cette analyse du concept de l’émergence.
De nombreux pays, surtout les pays africains sont mus par la volonté d’émerger. Aussi sont-ils engagés dans un processus de développement et le concept de l’émergence est devenu le leitmotiv des discours des dirigeants politiques. Mais au-delà des discours, l’émergence véritable ne requiert-elle pas l’altruisme des dirigeants politiques comme l’une de ses conditions essentielles ? Cette question qui invite à analyser l’attitude des dirigeants suscite d’autres interrogations. Ainsi, l’égoïsme qui s’exprime souvent par la personnalisation du pouvoir politique, ne constitue-t-il pas un obstacle à l’émergence ? L’altruisme platonicien, exprimé par le retour du philosophe-roi dans la caverne, ne pourrait-il pas servir d’exemple aux dirigeants africains dans le processus de l’émergence ?
La présente contribution vise à montrer que l’altruisme, cette attitude platonicienne qui consiste à privilégier l’intérêt des autres, est une condition essentielle de l’émergence. Certes, des conditions économiques sont requises, mais elles ne sont pas suffisantes pour parvenir à une émergence véritable. L’altruisme des dirigeants politiques, à l’instar du philosophe-roi qui ne privilégie pas ses intérêts personnels, mais plutôt l’intérêt général, pourrait épargner aux États africains les troubles politiques qu’ils vivent, et contribuer à leur émergence. Ainsi, dans une approche critique, il s’agira de montrer que l’égoïsme est un obstacle à la volonté d’émerger, ensuite il sera question de présenter l’altruisme platonicien comme l’une des conditions de l’émergence véritable.
1. L’égoïsme dans la cité, un obstacle à l’émergence
Le concept d’émergence induit celui du développement. C’est dire que la question de l’émergence du continent africain est aussi celle de son développement. Mais si l’émergence est une vision du développement, divers facteurs dont l’égoïsme des hommes et plus précisément des dirigeants politiques peuvent constituer un frein à son éclosion.
1.1. L’émergence comme une vision du développement
Selon le Dictionnaire technique et critique de la philosophie, l’émergence est un concept utilisé dans le langage philosophique pour caractériser le fait qu’une chose sorte d’une autre, sans que celle-ci ne la produise à la manière dont une cause produit nécessairement un effet, et suffise à en faire comprendre l’apparition. L’idée de sortir évoquée dans la définition du concept signifie qu’avec l’émergence, l’on s’attend à un dépassement, à l’éclosion d’une chose nouvelle, indépendante de l’ancienne et irréductible à elle.
Dans la philosophie politique de Platon, on peut dire que cela a le sens de la sortie du monde de la caverne vers la lumière du monde intelligible. Pour les pays africains, il s’agit de sortir de la pauvreté, de la famine, de la misère, de la politique de la main tendue et des rébellions armées. En un mot, il est question de sortir du sous-développement, voire de l’enveloppement pour parvenir au stade de pays émergents. Car, il faut le reconnaître, l’Afrique est le continent de tous les maux et à examiner « la situation qui prévaut actuellement sur le continent, l’image que l’Afrique officielle donne d’elle-même, la place qu’elle occupe dans le monde, l’on doit se convaincre qu’il existe une question d’Afrique, un mal africain » (E. Kodjo, 2014, p. 99). Un demi-siècle après les indépendances, le continent africain continue d’être à la traîne et brille par son absence sur l’échiquier mondial. En ce sens, parler de son émergence, c’est, avant tout, parler de son progrès et de son développement.
En termes économiques, l’émergence d’un pays se mesure à des indices objectifs. Ainsi, « ceux qui s’y connaissent, les experts (…) ont leurs critères et parlent d’un certain nombre d’indicateurs : être éligible à l’indice ITIE ; être certifié par le processus de Kimberley ; être bien classé au Doing Business ; avoir un certain taux de croissance, etc. » (C. Yahot, 2015, p. 62). Pour sa part, L. Agbia (2002, p. 5-6) met l’accent sur le critère du taux de croissance qui, à ses yeux, représente le critère commun de tous les pays émergents. Dans son analyse, il précise que
leur caractéristique commune est d’afficher de très forts taux de croissance, de l’ordre de 8 à 10% sur une longue période. Une croissance de loin supérieure à la croissance démographique. Ce qui signifie qu’on gagne chaque année plus d’argent que de bouches supplémentaires à nourrir. L’idéal pour investir dans le développement.
Ces critères économiques qui répondent aux normes internationales sont certes nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants, car l’émergence a aussi un versant politico-social. À ce sujet, C. Yahot (2015, p. 62) souligne qu’il y a
des perspectives et des expertises nombreuses et diverses, notamment celles des intellectuels, des scientifiques, des sociologues, des paysans, des citoyens, etc. qui prennent en compte d’autres critères, comme l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’environnement et des ressources, l’épanouissement de l’individu, l’État de droit, la maîtrise de l’immigration pour une planification efficiente des services, la justice sociale (meilleure répartition des biens et des richesses, etc.).
De ces différents critères, l’on peut retenir que l’émergence est liée à des conditions socio-économico-politiques. Elle intègre le cadre de la bataille pour le développement. C’est d’ailleurs dans ce sens que L. Agbia (2002, p. 6) déclare que « l’étape de pays émergent est la voie d’accès au sanctuaire du développement ». L’émergence et le développement peuvent donc être considérés comme des termes connexes, et l’on peut dire qu’être émergent, c’est être sur le chemin du développement. De ce point de vue, les discours de certains dirigeants africains sur l’émergence doivent être compris comme des visions du développement. Ils constituent une source d’espérance pour le peuple qui aspire à une amélioration de ses conditions de vie. Mais, afin que ces discours ne restent pas lettre morte, il convient que soient dénoncés les obstacles qui, comme des vers rongeurs, obscurcissent le chemin de l’émergence.
1.2. La personnalisation du pouvoir comme un obstacle à l’émergence
Dans le Manifeste du Parti Communiste, M. Karl et F. Engels (1978, p. 55) écrivent : « Le pouvoir politique, à proprement parler, est le pouvoir organisé d’une classe pour l’oppression d’une autre ». À travers cette pensée, ces philosophes entendent dénoncer la nature oppressive du pouvoir politique. En effet, selon eux, toute société humaine est divisée en deux grandes classes qui sont en opposition constante : la classe des bourgeois et celle des prolétaires. Cette lutte des classes qui constitue la loi de l’histoire de l’humanité s’explique par la divergence des intérêts et la volonté hégémonique d’une classe. Dans la société, les hommes ont des intérêts divergents et ils se battent pour leur défense. Ainsi, pour mieux préserver ses intérêts, chaque classe s’organise. C’est dans cette perspective que doit se comprendre la naissance de l’État. Cette instance est donc l’expression dissimulée de la classe dominante, et son principe est la défense de ses intérêts partisans et égoïstes. Cela signifie que le pouvoir politique est oppressif et son organisation par la classe dominante ne vise que l’assujettissement de la classe dominée. Défendre leurs intérêts égoïstes, telle est la maxime de ceux qui sont au pouvoir.
L’analyse de la politique africaine révèle qu’elle n’échappe pas à ce que dénonçaient ainsi Marx et Engels. C’est dire que le pouvoir politique, sur le continent, est autocratique[12] et oppressif. Ainsi, il n’est pas rare de constater le tripatouillage des textes constitutionnels motivé par le refus de l’alternance, la violation des droits de l’homme et du citoyen. E. Kodjo (2014, p. 175) écrit :
L’Afrique offre généralement au monde extérieur, dans l’organisation du pouvoir politique, l’image angoissante du « despotisme obscur ». Ce système caractérisé par l’autocratie, l’extrême concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul homme, marqué par la quasi-inexistence des libertés fondamentales et l’absence de contre-pouvoirs, est quelquefois présenté comme puisant sa source dans les traditions africaines.
De telles pratiques foulent aux pieds l’intérêt général au profit des intérêts personnels et partisans. L’égoïsme de la classe au pouvoir qui abuse du pouvoir en usant du pouvoir pour se maintenir obstinémentau pouvoir conduit les États africains à une instabilité chronique. Ainsi, les coups d’États, les rébellions armées rendent non viables les programmes de développement. Le moins que l’on puisse dire est que l’État de droit demeure une réalité illusoire. Or, au sujet de l’État de droit, tous s’accordent pour reconnaître qu’il est une condition nécessaire du développement. Comme le soutient T. Michalon (2011, p. 150), « le développement économique suivra l’apparition d’un État de droit, c’est-à-dire d’un État capable d’obtenir le respect des règles qu’il émet et où arbitraire et corruption n’auront pas leur place ».
Qui plus est, à l’échelle continentale, l’égoïsme, sinon l’autocratie des dirigeants africains vide de son sens le concept du panafricanisme et le rend non opérationnel. Tout se passe comme si les Africains étaient incapables de fédérer leurs forces autour d’un projet commun de développement, c’est-à-dire un projet qui engage tout le continent et qui serait source d’émergence. L’émiettement du continent qui a engendré un puzzle d’États hérité de la colonisation constitue un véritable frein à son unité. C’est ce que dénonce E. Kodjo (2014, p. 218-219) lorsqu’il s’exprime de la manière suivante :
Dans le cadre de l’organisation de l’unité africaine, les États africains s’efforcent d’harmoniser leurs politiques extérieures. Force est de constater la ressemblance entre les conférences de l’OUA et celles de la Diète impériale de Francfort où plusieurs centaines de royaumes, principautés, duchés et grands-duchés, évêchés, cités-États, margraviats germaniques, etc., se réunissaient, plus pour s’empoigner sur leurs divergences, souvent suscitées et encouragées par des luttes d’influence des grandes puissances, que pour discuter des problèmes qui commandent l’avenir de leurs peuples. À plusieurs reprises, des États membres de l’OUA n’ont pas respecté la promesse faite de se présenter en bloc pour exprimer, dans les instances internationales, des positions communes de l’Afrique sur de graves problèmes mondiaux.
Cette absence d’unité infantilise et fragilise davantage le continent. Quasiment absent de l’échiquier mondial, il doit se battre pour sortir de ses décombres.
On le voit, l’émergence, qui n’est autre que l’autre nom du développement, requiert des conditions. Si l’Afrique veut émerger, elle doit d’abord se battre pour la consolidation, sinon pour la transformation de ses États en de véritables républiques, c’est-à-dire des États de droit où les règles de droit sont respectées ; ensuite elle doit mener le combat de son unité. Parvenir à un tel État est le vœu de tout Africain soucieux du devenir de l’Afrique. C’est ce souci qui motive le penser de Samba Diakité. Pour lui, le continent a besoin d’une véritable révolution dont la mission est de le libérer de sa torpeur et de son mal développement. La révolution apparaît alors comme la source unique de son émancipation. Mais ces forces créatrices, sinon libératrices ne peuvent venir que des Africains eux-mêmes. Ces forces libératrices ne « peuvent être que la jeunesse consciente à l’image du balai citoyen au Burkina Faso ou y’en a marre au Sénégal ; les intellectuels étant de plus en plus inféodés au pouvoir et les oppositions confondant les intérêts des peuples et leurs intérêts particuliers » (S. Diakité, 2016, p. 21).
L’Afrique a donc besoin de ses forces vives, mieux, de ses forces créatrices pour son émergence. L’autocratie, le mépris de l’intérêt général au profit des intérêts personnels et partisans, l’absence d’un projet commun de développement sont autant de maux qui plongent le continent dans l’obscurantisme et le chaos politique. Ces obstacles à l’émergence doivent donc être remédiés. Il apparaît alors judicieux d’analyser et de valoriser l’exemplarité de l’altruisme platonicien qui se traduit par le retour du philosophe-roi dans la caverne.
2. Altruisme platonicien et émergence véritable
L’émergence ne naît pas ex nihilo ; elle n’est pas le fruit du hasard. Elle requiert certaines conditions dont l’altruisme des dirigeants politiques. Ainsi, le retour du philosophe-roi dans la caverne se présente comme un modèle d’altruisme à imiter pour parvenir à l’émergence.
2.1. L’altruisme du philosophe-roi
Dans le livre VII de La République, Platon fait recours à l’allégorie de la caverne pour mieux décrire et comprendre le monde dans lequel nous vivons. Selon lui, le monde sensible est comparable à une caverne dans laquelle les hommes sont semblables à des prisonniers qui ont « les jambes et le cou ligotés de telle sorte qu’ils restent sur place et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux, incapables de tourner la tête à cause de leurs liens » (Platon, 2011, 514 a-b). Cette situation que décrit le philosophe est une métaphore qui traduit l’état de l’homme avant toute éducation. En effet, les liens dont il s’agit dans cette métaphore ne sont autres que l’ignorance, le manque de connaissance véritable, car « c’est la connaissance ou le désir de connaissance qui met en mouvement » (M. Alexandre, 1968,p. 184).
En décrivant ainsi la condition primitive de l’homme, l’objectif du philosophe est de montrer qu’elle doit être dépassée, car elle ne constitue pas la vocation de l’être humain. Son sort peut donc connaître un changement qualitatif. C’est pourquoi, poursuivant son effort d’imagination, Platon (2011, 515 c) suggère « la situation qui résulterait de la libération de leurs liens et de la guérison de leur égarement ». Cela revient à dire qu’il est permis d’espérer la libération et la guérison des prisonniers. Précisons que, pour le philosophe, cette libération ne va pas sans souffrance. L’homme s’attache plus facilement à la fausseté qui déforme son âme et la détourne de la connaissance tandis que la pensée s’éveille à la vérité dans la douleur. Ainsi, le prisonnier, dès les premières heures de sa libération est tenté de retourner à sa condition primitive. En effet, il est plus aisé, pour lui, de vivre dans l’illusion que de peiner à rechercher la vérité.
La libération dont il s’agit s’opère par l’éducation. C’est dire que le naturel philosophe, pour parvenir au statut de philosophe doit être éduqué. Platon propose alors un programme d’éducation du naturel philosophe qui part de la gymnastique et la musique à la dialectique. Cet ambitieux programme a pour vocation d’arracher le philosophe au monde sensible pour l’élever graduellement vers le monde intelligible et plus précisément à la contemplation du Bien. Ce mouvement dialectique est d’une nécessité impérieuse, car le Bien est la réalité suprême que doit contempler tout être pour rationaliser sa conduite ou encore pour avoir une conduite droite dans le monde sensible. Cette idée est précisée en ces termes :
Dans le connaissable, ce qui se trouve au terme, c’est la forme du bien, et on ne la voit qu’avec peine, mais une fois qu’on l’a vue, on doit conclure que c’est elle qui constitue en fait pour toutes choses la cause de tout ce qui est droit et beau, elle qui dans le visible a engendré la lumière, elle qui dans l’intelligible, étant elle-même souveraine, procure vérité et intellect ; et que c’est elle que doit voir celui qui désire agir de manière sensée, soit dans sa vie privée, soit dans la vie publique (Platon, 2011, 517 b-c).
Parvenu à la contemplation du Bien, nous pouvons dire que le naturel philosophe est parvenu au faîte de sa formation intellectuelle. Dans un mouvement de dialectique descendante, Platon recommande au philosophe de ne point demeurer dans le monde intelligible pour s’adonner solitairement à la vie contemplative. Il doit redescendre dans la caverne et mettre « sa connaissance du Bien au service de l’État, réglant les mœurs et les affaires publiques d’après le modèle éternel qu’il lui aura été donné de contempler » (E. Hazan, 1956, p. 22). Il n’est pas superflu de préciser que Platon juge intolérable que le philosophe se recroqueville sur lui-même dans une tour d’ivoire. Pour lui, sa place est dans l’arène politique, près de ses concitoyens pour éclairer leur conduite et édifier une société vertueuse. Il écrit :
C’est donc notre tâche, (…) à nous fondateurs, que de contraindre les naturels les meilleurs à se diriger vers l’étude que nous avons déclarée la plus importante dans notre propos antérieur, c’est-à-dire à voir le bien et à gravir le chemin de cette ascension et, une fois qu’ils auront vu de manière satisfaisante, de ne pas tolérer à leur égard ce qui est toléré à présent. (…) De demeurer, dis-je, dans ce lieu et de ne pas consentir à redescendre auprès de ces prisonniers et à prendre part aux peines et aux honneurs qui sont les leurs, qu’il s’agisse de choses ordinaires ou de choses plus importantes (Platon, 2011, 519 c-d).
Dans ce texte, l’idée d’intolérance qu’évoque le fondateur de la cité idéale à l’égard du philosophe est un remède contre sa plus grande tentation : savoir, demeurer dans le monde intelligible pour mener une vie contemplative. Tolérer une telle attitude signifie que l’on privilégie le salut personnel au détriment du salut de la cité. Il est manifeste que ce que refuse Platon, c’est l’égoïsme. Le philosophe ne doit pas être soucieux de son intérêt individuel. Il doit plutôt être altruiste. Ainsi, son retour dans la caverne est-il un impératif catégorique, au sens kantien du terme.
Au fond, ce que recherche Platon, c’est la défense et la promotion du bonheur collectif. En ce sens, M.-P. Edmond soutient, à bon droit, que la plus grande affaire du philosophe est la politique. Avec elle, il s’agit de se mettre au service des autres, et cette attitude altruiste est ce que recommande Platon pour fonder une société juste et vertueuse. C’est pourquoi, s’adressant à son ami Archytas de Tarente, dans sa neuvième Lettre, il lui indique l’importance de son engagement dans la gestion des affaires publiques. Il écrit :
Sans doute n’y a-t-il rien de plus agréable dans la vie que de s’occuper de ce dont tu t’occupes, toi – c’est là une chose évidente pour presque tout le monde. Pourtant, il faut bien que tu prennes aussi ce point en considération : ce n’est pas pour lui seul qu’est né chacun de nous, mais, une fois que nous sommes nés, la patrie revendique une part de nous-mêmes, ceux qui nous ont engendrés une autre, une autre encore le reste de ceux qui nous aiment ; enfin, une grosse part aussi va aux circonstances qui marquent notre vie de leur empreinte. Or, quand c’est la patrie qui elle-même nous appelle à la gestion des affaires publiques, sans doute serait-il déplacé de ne pas répondre à son appel (Platon, 2011, 357e – 358 a).
L’égoïsme est une attitude inopérante. Il est incompatible avec la droite philosophie. Le philosophe, pour autant qu’il soit porteur de lumière, ne doit point, de son plein gré et par souci de son bonheur personnel, différer l’appel de la patrie, encore moins refuser d’y répondre. Le plaisir de s’occuper des affaires publiques ou encore de se mettre au service des autres est à mille lieues de celui de s’occuper de ses affaires personnelles. Ce qu’enseigne la droite philosophie, c’est la contribution du philosophe au bonheur de la cité toute entière.
2.2. L’altruisme comme condition de l’émergence véritable
Dans le Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, à travers sa réflexion sur la notion d’autrui, N. Depraz (2004, p. 147-148) écrit : « Être altruiste, c’est déployer à l’égard d’autrui une attitude, non seulement d’ouverture et d’attention, mais de dévouement total, par quoi l’intérêt des autres passe au premier plan, c’est-à-dire en tout état de cause, avant tout intérêt personnel. L’altruisme s’oppose à l’égoïsme, cette attitude individuelle de repliement sur soi-même à la limite du “nombrilisme” ». On peut dire que cette définition résume l’attitude que recommande Platon au philosophe-roi. Son retour dans la caverne signifie qu’il se soucie de l’éducation et de l’épanouissement de ses concitoyens. Cette attitude altruiste est une condition nécessaire de l’émergence véritable. En d’autres termes, le retour du philosophe-roi dans la caverne, sa volonté de contribuer à leur éducation signifient que l’émergence véritable se veut inclusive, car une émergence solitaire est un non-sens.
De manière générale, pour un individu, se battre pour émerger consiste à œuvrer pour son épanouissement et son bonheur. Mais le bonheur individuel n’a aucun sens. C’est pourquoi, dans la cité paradigmatique, il n’importe pas qu’une seule classe soit heureuse. Platon (2011, 519 e – 520 a) précise cette idée en ces termes :
Il n’importe pas à la loi qu’une classe particulière de la cité atteigne au bonheur de manière distinctive, mais que la loi veut mettre en œuvre les choses de telle manière que cela se produise dans la cité tout entière, en mettant les citoyens en harmonie par la persuasion et la nécessité, et en faisant en sorte qu’ils s’offrent les uns aux autres les services dont chacun est capable de faire bénéficier la communauté.
On le voit, le bonheur ne doit point se concevoir comme celui de la classe au pouvoir. Il s’agit plutôt d’un bonheur collectif. Le philosophe-roi ne redescend pas dans la caverne pour rechercher son bonheur individuel. Il y redescend pour vivre avec ses concitoyens et pour eux. Sa mission est de prendre soin[13] d’eux.
Cet altruisme du philosophe-roi qui induit une émergence inclusive doit faire tâche d’huile sur le continent africain. Car, tout se passe comme si, parvenus au pouvoir, les dirigeants politiques africains ne défendent que leurs intérêts égoïstes, et le peuple est abandonné à son triste sort. À l’instar du philosophe-roi qui se soucie de ses concitoyens, les dirigeants doivent aussi se soucier de l’intérêt général, c’est-à-dire de l’intérêt du peuple africain. Il s’agit ici de plaider en faveur de l’amour du peuple qui ne doit point être considéré comme un simple bétail électoral. Le peuple, selon la formule d’E. Kant (1976, p. 150) ne doit pas être considéré comme un moyen mais plutôt comme une fin. Cela revient à dire que les dirigeants doivent se soucier de l’éducation du peuple, car seule l’éducation permet de parvenir à la lumière du monde intelligible.
La véritable émergence doit donc être inclusive et empreinte d’altruisme. L’émergence de l’Afrique est une exigence de survie. Ainsi, chaque pays doit se battre dans l’ouverture à l’autre. Se pose alors la question de l’intégration et de l’unité du continent africain. C’est dire que la bataille pour le développement de l’Afrique doit s’engager dans l’unité, dans l’amour de l’autre. A. Nguidjol (2009, p. 82) déclare à ce sujet que « gouverner, c’est essentiellement produire de l’unité là où existe la diversité ». De son côté, E. Kodjo (2014, p. 15) écrit :
Les Africains doivent voir dans la lutte pour l’unité le combat vital pour leur survie collective, pour leur grandeur future. Toute force qui entretient la désunion, qui veut maintenir en l’état des nations non viables ne fait que retarder l’heure de la renaissance et s’oppose, de fait, aux aspirations légitimes des Africains. La tâche d’unification du continent exige la résolution dans l’action individuelle et l’influx dans la détermination collective. C’est à ce prix que pourra émerger une Afrique nouvelle, une Afrique débarrassée de ses maux, une Afrique libérée de ses fantasmes et de ses complexes, une Afrique qui aura fait sa mue et répondu à l’appel du futur.
On le voit, l’altruisme doit être au fondement de l’émergence véritable en Afrique. Assumer son histoire et comprendre que le plus important n’est pas ce qu’on a fait de nous mais plutôt ce que nous faisons de ce qu’on a fait de nous, se battre sans égoïsme, rechercher un bonheur collectif ; celui de l’Afrique tout entière et du peuple africain, concevoir des systèmes éducatifs viables pour l’éducation et l’épanouissement du peuple, tels sont les leviers essentiels pour parvenir à une émergence véritable. L’espoir est permis et les discours des dirigeants politiques sur l’émergence ne doivent pas êtres de simples slogans politiques. L’Afrique doit sortir de son état de continent sinistré, perpétuellement en crise et perpétuellement assisté.
Conclusion
En définitive, l’émergence est la voie d’accès au développement. Ainsi, les discours des dirigeants politiques sur l’émergence doivent être compris comme des visions de développement. Pour sa survie et sa grandeur, l’Afrique doit émerger. Cela signifie qu’au-delà des discours politiques, les Africains doivent être mus par une volonté réelle de sortir de la caverne. Plus précisément, il s’agit de rompre avec cette image tristement célèbre de la pauvreté, de la famine, de l’éternelle assistance, des coups d’États, des rébellions armées et de la violation des droits de l’homme et du citoyen. Cela nécessite un engagement véritable des dirigeants, et un réel amour du peuple qui doit se traduire par son éducation, sa protection et la défense de ses intérêts. L’émergence tant recherchée doit donc se fonder sur l’altruisme.
À l’instar du philosophe-roi platonicien qui redescend dans la caverne pour prendre soin de ses concitoyens, sans se préoccuper de privilégier son intérêt personnel, les dirigeants africains doivent renoncer à leur égoïsme, source de troubles politiques qui constituent un obstacle majeur dans la bataille pour le développement. Ils doivent privilégier l’intérêt du peuple, l’intérêt général, et dans une dimension continentale, ils doivent faire prévaloir l’intérêt du continent. Ils doivent alors s’unir, travailler de concert et s’entraider pour parvenir à une émergence véritable qui se veut inclusive.
Références bibliographiques
AGBIA Lucien, 2002, Le Grand défi : comment la Côte d’Ivoire peut-elle devenir un pays émergent en 10 ans ?, Abidjan, Plantation.
ALEXANDRE Michel, 1968, Lecture de Platon, Paris Bordas / Mouton.
CHRISTOPHE Yahot, 2015, Réflexions sur la Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan.
DEPRAZ Natalie, 2004, « Autrui », Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, sous la direction de Monique Canto-Sperber, Paris, PUF.
DIAKITÉ Samba, 2016, Révolutions et développement : pour une philosophie de l’émergence en Afrique, Québec, Différance pérenne.
EDMOND Michel-Pierre, 2006, Le philosophe-roi : Platon et la politique, Paris, Payot.
HAZAN Émile, 1956, Condensés des écrivains pédagogiques : De Socrate à Freinet, Paris, Ferdinand Nathan.
KANT Emmanuel, 1976, Fondements de la métaphysique des mœurs, traduit de l’allemand par Victor Delbos, Paris, Delagrave.
KODJO Edem, 2014, …Et demain l’Afrique, Abidjan, NEI-CEDA.
LALANDE André, 2010, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Quadrige/PUF.
MARX Karl et ENGELS Friedrich, 1978, Manifeste du Parti Communiste, Union Soviétique, Progrès.
NGUIDJOL Antoine, 2009, Histoire des idées politiques : De Platon à Rousseau, Paris, l’Harmattan.
NJOH MOUELLE Ebénézer et MICHALON Thierry, 2011, L’État et les clivages ethniques en Afrique, Abidjan, les Éditions du CERAP.
PLATON, 2011, La République, Œuvres Complètes, traduction de Georges Leroux sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Lettre IX, Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Politique, Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion.
L’IDÉE D’ÉMERGENCE CHEZ PLATON, UNE ASCENSION VERS LE BIEN
Amed Karamoko SANOGO
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
amedkara@yahoo.fr
Résumé :
L’émergence doit s’entendre avant tout comme un projet qui repose sur le passage d’un niveau de vie insatisfaisant à un autre plus reluisant. Pour les pays en voie de développement, au-delà du fait qu’elle permet d’atteindre un niveau de croissance économiquement acceptable, l’émergence est le critère par lequel les pays sous-développés sont reconnus par les autres comme des entités dignes de considération ou de respect. De ce point de vue, ce qui est mis en relief dans cet effort de réflexion doit prendre nécessairement en compte les valeurs essentielles pour un climat favorable à l’émergence.
Mots-clés : Croissance, développement, économique, émergence, pro-jet, reconnaissance, valeur.
Abstract :
Emergence should first and foremost be understood as a project based on the transition from one unsatisfactory living standard to another one that is brighter. As for developing countries, beyond the fact that emergence enables them to reach an acceptable economic level of growth, emergence is also the criterion by which underdeveloped countries are recognized by others as entities worthy of consideration or respect. From this point of view, what is emphasized in this effort of reflection should necessarily take into account the essential values for a favorable climate for emergence.
Keywords : Growth, development, economic, emergence, pro-jet, recognition, value.
Introduction
Les États, dans leur volonté de créer les conditions d’épanouissement des citoyens, sont en quête perpétuelle du mieux-être, des meilleures conditions de vie de leurs populations. Dans cette logique, les pays sous-développés s’échinent à quitter leur statut pour cheminer vers l’émergence qui serait un stade de développement offrant plus de possibilités d’épanouissement aux peuples. Selon L. Camara, (2015, p. 7), « un pays émergent est caractérisé par un changement structurel dans les domaines juridiques et institutionnel, le passage d’une économie de production agraire à un type industriel et enfin l’ouverture au marché mondial des produits et services et aux flux internationaux de capitaux ».
Á partir de cette définition du pays émergent, le critère de l’émergence à l’œuvre est économique et financier. Ainsi, dans la terminologie financière, un pays est dit émergent lorsqu’il réalise une transformation économique rapide. Les expressions manifestes de cette transformation sont l’augmentation du revenu moyen et la modernisation des activités. Il y a, en effet, un lien étroit entre les notions de développement et de croissance. Il est donc possible d’établir un rapport d’égalité entre pays industrialisé et pays émergent. Sous cet angle, l’émergence est perçue comme une instrumentalisation de la raison qui manque d’intégrer toutes les dimensions de la vie humaine, notamment les droits inhérents à la nature humaine.
Or, L’émergence ne saurait être seulement économique. Ni le développement ni la croissance n’impliquent nécessairement l’émergence. En effet, l’émergence vient du latin emergere qui signifie sortir de l’eau, d’un fluide. Toute émergence présuppose donc un mouvement qui se traduit par le passage d’un état inférieur à un état supérieur. La réalisation de cet espoir présuppose une prise de conscience de ses insuffisances et de ses atouts en vue de s’engager à contribuer à une vie épanouie. Cette voie est celle que doit explorer tout pays s’il veut maîtriser les problèmes liés aux mutations qu’impose son entrée dans l’émergence. Dès lors, l’émergence, en tant qu’exaltation de l’économique est-elle toujours souhaitable ? Autrement dit, étant donné qu’au regard des débats sur l’émergence, la pensée est centrée sur l’économie et que cela est reconnue par bon nombres de personnes, comment doit-on envisager l’émergence ? Telle est la question centrale qui servira de base à notre réflexion et qui se décline en des interrogations secondaires comme suit : quelles sont les prémisses philosophiques du concept d’émergence ? Quels peuvent en être les fondements ? Dans quelle mesure, l’éducation platonicienne peut-elle servir de catalyseur de l’émergence ?Il s’agit pour nous, à partir de cette problématique, de montrer que le concept de l’émergence n’est pas seulement économique, mais qu’elle a des repères philosophiques dont la pensée de Platon peut servir d’indications.
Pour mener à bien notre réflexion nous indiquerons, de prime abord, les intuitions philosophiques qui ont fécondé le concept d’émergence. Nous examinerons, ensuite, les fondements de cette notion pour montrer qu’elle repose sur des valeurs essentielles. Enfin, nous ouvrirons des pistes de réflexion sur l’éducation platonicienne pour l’accès à l’émergence.
1. Les repères philosophiques de l’émergence
L’émergence est un sujet d’un grand attrait pour la pensée philosophique dont les prémices remontent à l’Antiquité grecque. La naissance du concept de l’émergence coïncide avec la sortie du prisonnier de la caverne ombreuse, renseignée par le philosophe athénien Platon. Aussi Aristote et Emmanuel Kant ont-ils établi une équivalence entre l’émergence et le mouvement de passage du virtuel au réel, d’une part ; et entre elle et la sortie du sujet de la tutelle pour son autonomie, d’autre part.
La contribution de Platon se trouve consignée dans l’allégorie de la caverne dans le livre VII de La République (2008, 514a-515b). Rappelons les grandes lignes de cette allégorie : l’humanité est comparée à un ensemble de prisonniers enchaînés dans le fond d’une caverne. Le corps et la tête immobilisés, regardant défiler des ombres sur la paroi de la caverne et percevant des échos de voix. Ces ombres sont des figurines qui représentent des hommes et des animaux dont les prisonniers perçoivent les voix. À l’intérieur de la caverne, et derrière les prisonniers un feu brille et sa lumière laisse voir les ombres. C’est dans cet environnement qu’on délivre un des prisonniers pour le conduire hors de la caverne afin qu’il contemple la réalité.
L’allégorie de la caverne représente notre enchaînement au monde sensible. En effet, ancré dans le sensible, l’homme se trouve oublié, dénaturé, dépouillé de son essence. La montée vers le jour figure l’ascension de l’âme dans le monde intelligible où se trouve la lumière du jour. La progression vers l’état éclairé est décrite comme « un voyage de l’obscurité vers la Lumière » (Platon, 2008, 528d-529e). Ce voyage prend la forme d’une conversion de l’individu dans tout son être, une conversion qu’il éprouve dans son corps et qui le transforme en profondeur. La démarche platonicienne met en évidence l’apparition d’un concept philosophiquement nouveau. Il s’agit, en effet, de montrer que la conversion, c’est-à-dire la réorientation de l’âme dans la bonne direction peut contribuer à l’amélioration des conditions de vie de l’homme. Platon utilisa la conversion pour penser la sortie de l’homme de l’obscurité à la lumière, de l’ignorance à la connaissance, de l’injustice à la justice comme condition de la cité idéale.
En effet, la réalisation de la cité idéale fait prendre conscience de la difficulté à accepter le changement. Pour accepter ce changement, il faut passer par un apprentissage, découvrir peu à peu les choses par étapes progressives. L’allégorie de la caverne nous indique ces étapes : le prisonnier tourne le cou, marche, lève les yeux vers la lumière. À la vue des objets, du soleil, des astres, il a du mal à accepter la réalité, mais « il se réjouira du changement » (Platon, 2008, 516b-517b). À l’analyse, l’allégorie a pour fonction d’illustrer les difficultés que l’on rencontre et auxquelles on fait face lorsqu’on veut contribuer au mieux-être de sa communauté. Il s’agit d’énoncer la raison pour laquelle la lecture de l’allégorie de la caverne est instructive pour l’émergence d’un État. Dès lors, bien cerné, le concept de l’émergence a le sens de la conversion platonicienne, puisqu’il permet de se détourner de l’inessentiel pour se tourner vers le vrai.
Chez Platon, il existe deux mondes : le monde sensible et celui des idées. Le monde des idées est celui où se situe les archétypes, les modèles, le Bien ; quant au monde sensible, voué à la finitude, il ne doit sa réalisation qu’à sa participation au monde intelligible dont il est la copie. Au sommet du monde intelligible, rayonne le Bien dont la nature, selon Platon, (2008, 517b) « doit être regardée comme beaucoup plus précieuse » pour guider toutes actions morales. C’est pourquoi, il faut rechercher pour sa communauté, le Bien qui est la cause du succès. L’approche de Platon s’applique pleinement aux pays dits émergents. L’allégorie de la caverne permet de comprendre que ce qui est plus important pour une société, ce ne sont pas les perceptions sensibles, mais les valeurs qui donnent une signification au travail des hommes et des femmes. Parmi ces valeurs, la reconnaissance du mérite de l’agent exécutif constitue une source de motivation, puisque celui-ci est susceptible de briser les chaînes par son dévouement au travail. En somme, nous trouvons, de nos jours, dans l’idée de Platon, un véritable outil stratégique pour les pays émergents. À la suite de Platon, comment se présente le concept d’émergence chez Aristote ?
Derrière la notion d’émergence, il faut voir le mouvement qui se traduit, à en croire Aristote (2002, 201a-10), par « le processus d’actualisation de ce qui est en puissance ». La puissance est l’idée qui attend qu’on la réalise. Sa réalisation se fait par un mouvement qualitatif de passage du virtuel au réel, de la puissance à l’acte. C’est par le mouvement que ce qui est en puissance devient acte, que le germe devient blé. Ce mouvement évoque les changements d’états bien déterminés. On peut se rendre compte, chez Aristote, de ce changement à partir de la formation de la cité.
En effet, dans l’Antiquité, la cité est la réunion de plusieurs villages. Le village est la « première communauté formée de plusieurs familles en vue de la réalisation de besoins qui ne sont plus purement quotidiens » (Aristote, 1995, 1252b). De la famille au village et du village à la cité, on a l’idée d’une organisation spatiale selon des degrés de complexité croissante, succession qui ne peut être réduite à ses degrés élémentaires. Le constat est que la cité ne se réduit pas au village ni celui-ci à la famille. Ces entités se différencient de leurs composantes élémentaires par des caractéristiques spécifiques. Par exemple, le village se compose de l’ensemble des familles formant une unité administrative, et la famille est l’ensemble des personnes vivant sous le même toit. Si l’émergence désigne le processus de formation de nouveaux degrés d’organisation, cela nous autorise à parler de l’idée d’émergence chez Aristote, puisque le concept d’émergence sert à désigner l’apparition d’une forme d’existence supérieure que la formation de la cité intègre.
Comme Platon et Aristote, Kant, aussi, tente de rendre compte de la notion d’émergence. Dans son essai Qu’est-ce que les Lumières ?, il considère deux états : la minorité et la majorité. Il exhorte l’homme à avoir le courage de se défaire de la paresse et de la lâcheté pour sortir de l’état de minorité. Cet état de minorité est celui de la tutelle, c’est-à-dire de l’incapacité de se servir de son jugement critique sans être dirigé par un autre dans le but de devenir majeur.
La minorité dont parle Kant est mentale et intellectuelle. La plupart des hommes sont mineurs parce qu’ils refusent de se servir de leur propre entendement. Ils restent dépendants des idées reçues. Dès lors, ils restent enfermés dans leurs croyances et leurs coutumes, dans des normes et des traditions transmises par d’autres sans jamais daigner les remettre en cause. E. Kant (1991, p. 18) écrit :
Le mouvement des Lumières est la sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise des Lumières.
Partant de ce point de vue, on pourrait voir l’émergence comme ce mouvement des Lumières correspondant à la sortie de l’homme de l’état de tutelle pour son autonomie. Ainsi, on a une communauté d’hommes libres n’obéissant qu’à leur propre volonté et renonçant à la raison qui met en cause leur propre liberté. Cette pensée kantienne peut être adressée aux pays candidats à l’émergence pour plus d’autonomie. Cependant, le chemin historique de la liberté est toujours aussi difficile que celui de l’émergence qui ne se décrète pas.
En somme, l’idée de l’émergence est originellement un domaine philosophiquement marqué. Cette idée est perçue à travers l’allégorie de la caverne (Platon), le passage de la « puissance » à l’« acte » (Aristote) et la philosophie pratique (Kant). Ces formes du penser sont mues par l’idée de sortir d’un milieu où l’on est abyssalement englouti dans une profondeur, de sorte à apparaître à la lumière de la surface. Cependant, l’émergence doit désigner la capacité de trouver son point d’ancrage dans plusieurs valeurs universelles.
2. L’émergence ancrée dans des valeurs fondamentales
La valeur implique l’idée d’une qualité supérieure en vertu de laquelle, on agit, ou à laquelle on aspire. Elle suscite l’adhésion et invite au respect. Il s’agit d’un principe idéal qui sert communément de référentiel aux membres d’une collectivité pour exprimer leur jugement et leur conduite. Dans l’idéal, chaque pays doit chercher à atteindre un niveau de compétitivité et d’attractivité, le plus élevé possible, en mettant en place un environnement de compétitivité internationale susceptible d’être émergent. L’atteinte du stade de l’émergence dépend de la capacité du pays peu émergent à s’approprier les valeurs de nature politique, juridique, environnementale mais aussi de la reconnaissance.
Au plan politique, l’émergence repose sur la démocratie. La démocratieest le modèle idéal pour le choix des représentants, la gestion des affaires publiques de la cité et la prise de décisions. Ici, c’est le peuple qui est le détenteur exclusif de la souveraineté qui n’est pas associée à une transcendance ni à une divinité. La démocratie exige que l’accession au pouvoir soit faite par la voie élective, acte privilégié de l’expression de la volonté du peuple. Le devoir de respecter fidèlement la volonté populaire est la principale maxime du régime démocratique.
Afin d’éviter que l’exercice du pouvoir par le peuple se transforme en despotisme, il faut œuvrer à la séparation des pouvoirs. De façon générale, le pouvoir absolu conduit à des abus. C’est pourquoi, selon C. L. S. Montesquieu (1979, p. 293), « pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». La confiscation du pouvoir par un individu est un indice de la dégénérescence de l’esprit d’émergence, puisqu’il est mis fin à toute possibilité de changement, contraire à la vision démocratique qui a pour principe l’alternance.
La démocratie suppose aussi, la légitimité des contre-pouvoirs, puisqu’il est admis que les révolutions et les guerres civiles ne deviennent nécessaires que si un régime n’a pas réussi à intégrer l’opposition et ne l’a pas reconnue comme un rouage du processus politique. Le gouvernement démocratique est, de ce point de vue, « susceptible de négocier des compromis » (M. Savadogo, 2000, p. 32). Autrement dit, les limites de la démocratie peuvent continuellement nourrir le désordre et l’instabilité politique préjudiciables à l’émergence. Si l’exercice de la démocratie est essentiel à l’émergence qu’en est-il des droits de l’homme ?
L’une des valeurs fondamentales de l’émergence, à la suite de l’examen de la démocratie dans les passages précédents, est celle liée aux droits de l’homme.Parler des droits de l’homme, c’est parler de l’ensemble des prérogatives inhérentes et inaliénables à l’homme, du seul fait d’être humain. Dans la pratique, cette idée se traduit, pour l’essentiel, par « La Déclaration universelle des droits de l’homme », faite à Paris le 10 décembre 1948, par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Le premier article de cette déclaration stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Ce passage permet de saisir l’importance des droits de l’homme pour la réalisation de l’émergence. L’effectivité de ces droits humains doit être l’objectif premier et le vecteur de la démarche des pays émergents.
La méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont, en effet, conduit à des actes de barbarie et de génocide qui révoltent la conscience de l’humanité. Ces droits qui sont niés sur le plan théorique et violés sur le plan pratique se trouvent confrontés à des « dérives qui invitent au combat » (D. Lochak, 2005, p. 116). Il est difficile de concilier émergence et état de violation des droits humains. Désormais, pour parvenir à l’émergence, il s’agit de permettre à tous de participer aux choix de la société à tous les niveaux en étant en bonne santé, protégés et considérés. On assiste à l’avènement d’une société où les êtres humains sont libres de parler, de croire, libérés de la terreur et de la misère. Il y a urgence aujourd’hui à clairement positionner les droits de l’homme comme la mamelle de l’émergence. La réalisation des droits de l’homme est par conséquent une composante du succès des politiques de l’émergence, celle-ci n’occulte pas les préoccupations environnementales.
Ces préoccupations sont liées aux changements climatiques, à la production exacerbée de déchets, à la pollution agricole et industrielle, à la pression sur les ressources naturelles (pêche, forêt, ressources minières). La crise écologique découle de notre tendance contemporaine à produire, puis à consommer davantage. On ne peut pas être émergent en continuant de dégrader l’environnement, c’est-à-dire d’abuser de la forêt et de décimer la faune, ce qui aurait pour conséquence l’avancée du désert. Vouloir être un pays émergent, c’est développer, chez l’homme, des attitudes et des comportements qui vont dans le sens de la préservation de l’équilibre écologique et de l’amélioration du cadre de vie. Certes, il est difficile d’attribuer une valeur intrinsèque aux entités naturelles, néanmoins il est possible de tenir compte de leur valeur esthétique. L’esthétique renvoie à ce qui est relatif à la conception de la beauté et au sentiment lié à cette dernière. Selon cette conception, l’environnement naturel aurait une certaine valeur, puisqu’il plait à notre jugement esthétique. Cette considération préside à la création des parcs nationaux et elle constitue un atout pour la protection de la nature.
Le concept d’émergence ne peut être uniquement appréhendé sous l’angle politique, juridique et environnemental. Les citoyens d’un pays qui émerge doivent sentir dans leur vie quotidienne que leur bien-être s’améliore et que des opportunités nouvelles de santé et de revenus se présentent à eux. Du coup, nous assistons à une demande de reconnaissance par l’autre. Pour Platon, la connaissance n’est possible que parce qu’il y a reconnaissance, c’est-à-dire réminiscence de ce que notre âme a déjà vu mais oublié dans une vie antérieure. Platon montre que l’esclave du Ménon découvre par lui-même sans avoir fait de la géométrie, « le théorème de Thalès » (Platon, 2008, p. 82a-b). Connaître, c’est donc se souvenir, se remémorer d’un état ancien. Autrement dit, dans un sens épistémologique, la reconnaissance est une opération d’identification de quelque chose qui est présentement perçue et que l’on connaît déjà par l’intellect. Dans la perspective hégélienne, l’esclave et le maître reconnaissent qu’ils ont besoin l’un de l’autre ; d’où l’abolition de l’esclavage et l’avènement d’un État libre et rationnel qui reconnaît l’égalité de droit de tous les êtres humains. C’est « seulement par la reconnaissance d’autrui qu’un individu peut accéder à une véritable conscience de soi » (E. Renault, 2009, p. 27). Pour Renault, toute conscience humaine a besoin de la reconnaissance d’une autre conscience pour exister.
Chaque personne a conscience du fait qu’elle a profondément besoin de reconnaissance pour être appréciée, motivée et pour développer un sentiment d’appartenance à une organisation. Cette reconnaissance par l’autre renforce l’ardeur à exceller dans l’accomplissement de notre tâche au bénéfice de la société. C’est selon Benjamin, « la démonstration claire que nos réalisations, les efforts investis et notre personne elle-même, sont reconnus à leur juste valeur » (J. Benjamin, 2007, p. 3). Il s’agit ici, aussi bien de la reconnaissance du mérite qui est plus liée aux spécificités des agents que de la reconnaissance en tant qu’être humain à visée universelle. C’est une forme de reconnaissance accordée d’emblée à chacun pour la simple raison qu’il est un être humain. Partant de ce principe, la société doit mettre les individus à l’abri de l’expérience du mépris social. Autrement dit, elle doit protéger les individus et les groupes sociaux contre l’humiliation sous toutes ses formes. Le sujet demande à « être reconnu par les autres » (P. Ricœur, 2004, p. 13) quel que soit son statut.
Cette reconnaissance se manifeste par des gestes posés au quotidien lors de contacts et d’échanges. Ainsi, « les conditions de liberté intérieure et extérieure » (A. Honneth, 2000, p. 209) sont garanties à tous les agents et cela leur permet de parvenir à une attitude positive. Ces acteurs ou travailleurs ne sont plus considérés comme de simples salariés, mais ils sont responsabilisés de sorte qu’ils peuvent s’approprier les objectifs de leurs entreprises. Ainsi, la reconnaissance participe de la performance de toute organisation sociale en vue de son émergence. Dans l’atteinte de celle-ci, l’éducation joue un rôle essentiel.
3. L’éducation platonicienne comme moyen privilégié pour l’accès à l’émergence
L’éducation occupe une place essentielle dans la mise en œuvre de l’émergence. Elle traduit parfaitement cette idée de l’émergence qui consiste, dans une perspective platonicienne, à conduire l’individu d’un état d’ignorance vers la connaissance. L’allégorie de la caverne, en effet, part de l’idée que seule l’éducation peut nous libérer des chaînes qui nous asservissent. Platon (2008, 518c) nous indique à ce sujet que « l’ascension du monde d’ombre de la caverne vers le royaume de la Lumière du monde extérieur est le Bien le plus désirable ». Ainsi éduquer, c’est « conduire hors de » (ex-ducere). Cela revient à dire que l’individu à éduquer est retiré d’un milieu qui représente, par exemple, un danger pour lui et conduit vers un autre lieu jugé plus sécurisant. Autrement dit, il faut l’extirper de cet environnement dangereux et malsain pour le conduire dans un lieu plus rassurant, pour épouser la vertu. Dans l’Éthique à Eudème, Aristote (1978, 1127c) affirme que « la vertu est cette disposition qui nous rend capable de poser les meilleurs actes et qui nous dispose le mieux possible à l’égard de ce qu’il y a du meilleur, le meilleur et le plus parfait étant ce qui est conforme à la droite ligne ». La vertu caractérise l’excellence chez l’homme. Considérée comme une disposition intérieure, Platon (2008, 444e) la définit comme « la santé, la beauté et le bon état de l’âme humaine ». On trouve en chaque être humain une prédisposition à l’excellence, c’est-à-dire à la vertu, qui dort en lui qu’il faudra éveiller et développer par l’éducation.
Pour transformer notre société et tirer profit de l’émergence, il nous faut des hommes vertueux. Au sens platonicien, il s’agit de faire aimer et développer chez l’homme, « la sagesse, le courage, la tempérance et la justice » (Platon, 2008, 427c). Le but de l’éducation est de rendre l’homme vertueux, plus précisément, juste et bon. La justice, « vise, par la connaissance et par l’action, à réaliser l’excellence humaine, elle est une école de vertu » (A. Jeannière, 1990, p. 258). Autrement dit, la justice est indistinctement une vertu de l’homme et une vertu de la société. L’action de l’homme se prolonge dans la société de sorte que « les mœurs d’un État viennent des mœurs des individus » (Platon, 2008, 435d). Sans éducation, l’on assiste à l’injustice qui correspond au désordre, à la confusion, à l’intempérance et aux vices empêchant, pour ainsi dire, la réalisation de l’émergence, parce que l’ordre établi, synonyme de valeur, pour les Anciens n’existe plus.
L’éducation est ce qui nous conduit vers notre humaine condition, c’est-à-dire l’élévation de l’homme à un niveau de vie meilleur qui s’opère par le passage de l’animalité à l’humanité. En effet, l’homme ne devient ce qu’il est que par l’éducation. Dès lors, E. Kant (1981, p. 16-17) indique qu’
il est sûr que le règne de la moralité serait l’accomplissement d’une éducation parfaite, dans la mesure où elle apprendrait à l’homme à faire prévaloir le devoir par rapport au penchant, en sorte que sa destination consisterait en un progrès continue vers le mieux.
Cela voudrait dire qu’il nous incombe de prendre en compte l’éducation morale pour parvenir à l’émergence à visage humain. L’éducation morale aura pour but de développer chez l’homme des règles pour la direction des affaires publiques. Il s’agit d’aider l’homme à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le juste de l’injuste. Dès lors, l’éducation morale désigne ce qui fait la grandeur, la supériorité et la dignité de l’homme. C’est à partir de là qu’émerge l’horizon d’un nouvel humanisme. Á ce propos, S. Diakité (2016, p. 75), indique qu’il faut « développer chez l’enfant des comportements en accord avec les valeurs qui visent la construction d’un monde plus démocratique, pacifique, écologique et solidaire ». Il ne s’agit plus de faire des enfants et de les abandonner à leur sort ou de les maintenir dans l’enfance. Il faut faire d’eux des hommes dignes de ce nom, c’est-à-dire des êtres humains responsables, qui n’interdisent pas la musique, ne brûlent pas les livres, ne détruisent pas le patrimoine, ne tentent pas d’effacer la mémoire de ceux qui les précèdent. Ces initiatives mettent en péril tout projet visant à faire l’émergence des sociétés. En accord avec cette idée, Kant estime que l’éducation combat la grossièreté de la nature humaine pour réaliser son humanité, c’est-à-dire le caractère de ce qui est humain dans notre contexte à savoir : l’émergence. L’éducation permet à l’enfant de se réaliser et de contribuer au bien-être de la société.
Et ce n’est pas un hasard si la sortie du prisonnier de l’allégorie de la caverne qui dépeint l’homme excellent porte en épigraphe une pensée de Platon annonçant le règne du « philosophe-roi » (Platon, 2008, 473c-d). L’homme, en effet, qui aspire à être, qui sort de la caverne ombreuse est un homme supérieur. Éduqué à accepter le changement, il découvre, peu à peu, par un l’apprentissage les choses jusqu’à s’élever au-dessus de l’homme ordinaire. L’homme excellent qu’est le philosophe-roi, pur produit de l’éducation, est d’après Platon, celui qui ne se contente pas de vaines paroles mais qui agit en donnant un sens et une valeur à ses actions. Pour l’homme d’État, il ne faut jamais admettre sciemment le mensonge même s’il peut être utilisé à la manière d’un remède pour instaurer la justice. « Il faut le haïr ». (Platon, 2008, 484d-485d). Cet homme résolument engagé dans la libération de soi-même et des autres, l’éducation qu’il a reçue, le rend éminemment responsable. Elle développe chez l’être humain tout ce qu’il a de meilleur. Ainsi, « les rois et les chefs, sont non pas ceux qui portent, un sceptre, ni ceux qui ont été choisis par la foule, ni ceux qui ont été désignés par le sort, ni ceux qui se sont emparés du pouvoir par la violence ou la ruse, mais ceux qui savent commander » (J. Luccioni, 1958, p. 419). Il est de ce point de vue indispensable de placer à la tête de l’organisation sociale et politique celui qui, plus que tout autre, par ses actions, ses initiatives créatrices, engage l’humanité tout entière. Dès lors, ce niveau de responsabilité doit s’accompagner, chez le gouvernant, d’un vouloir être à la hauteur de cette responsabilité non assujettie à des fins partisanes, mais à la volonté générale.
L’éducation s’inscrit dans une dimension pragmatique de réalisation, celle d’une nécessaire vision collective. Platon (2008, 425b-c) indique à ce propos que « l’élan qui vient de l’éducation imprime sa direction au reste de l’existence ». En ce sens, un pays ne pourra devenir émergent que si son leader (le Président de la République) a la possibilité de regarder au-delà de ses intérêts égoïstes pour se conduire selon le Bien et non selon ses passions. L’idée du Bien a une prééminence sur les autres formes intelligibles. Elle est à la fois source de leur être et condition de possibilité de leur intelligibilité à la manière dont le soleil est condition de la visibilité des réalités sensibles. Par conséquent, l’éducation platonicienne est un facteur d’adhésion, de cohérence et d’union indispensables à l’émergence.
Platon considère qu’il y a un « naturel philosophe » (2008, 473c-e), une race d’or que l’éducation accomplit et à laquelle doit revenir le commandement des cités. Malgré les qualités exceptionnelles du naturel philosophe, il ne doit pas être un homme extraordinaire. En d’autres termes, son caractère d’exception ne doit pas être le privilège d’une élite restreinte. Ainsi, nous aurons produit en grand nombre des élites « en sorte que l’élite soit massive et la masse d’élite » (E. N’joh-Mouelle, 1970, p. 144). Cela nous permettra d’avoir une main-d’œuvre formée d’ouvriers à forte valeur ajoutée de compétences créant dès lors des revenus subséquents pour l’atteinte de l’émergence. Le succès d’une telle entreprise est inséparable de l’éducation chez Platon.
Conclusion
En définitive, le problème central du concept d’émergence est celui lié aux conditions de sa réalisation. La réflexion, ci-dessus esquissée, montre à quel point le concept d’émergence est originellement un domaine philosophiquement marqué. Elle prouve qu’il trouve son origine lointaine chez Platon. La référence à la réflexion philosophique nous autorise à penser que l’amélioration des conditions du bien-être des populations ne se limite pas à la croissance de la production et à l’accumulation du capital. Il faut de ce point de vue, se démarquer du caractère économo-centré de l’émergence, en surmontant la prédominance économique pour parvenir à une véritable émergence.
Cette démarcation est réussie par une prise de conscience de l’importance des valeurs liées à la démocratie, au respect des droits humains, à l’environnement et à la reconnaissance de soi par l’autre. Ainsi, c’est autour de ce décor qui est à la fois politique, juridique, écologique et philosophique que nous avons recherché ce qu’exige l’émergence comme valeurs à promouvoir. Ce qui consolide cette détermination réside dans l’éducation qui fait de l’humain le berger de l’émergence, puisque c’est par l’éducation que s’accomplit l’essence éthique de l’homme. C’est donc à juste titre que l’éducation platonicienne peut être présentée comme la source et l’élan d’une véritable émergence.
Références bibliographiques
ARISTOTE, Éthique à Eudème, 1978, traduction, Décarie, Paris, Jean Vrin.
ARISTOTE, 1995, La Politique, traduction, Jean Tricot, Paris, Jean Vrin.
ARISTOTE, 2002, Physique, Tome I, traduction, Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion.
BENJAMIN Julie, 2007, « La reconnaissance en milieu de travail », in Bulletin la vitrine, Vol.3, n°4, p. 1-9.
BERSINI Hugues, 2007,Qu’est-ce que l’émergence, Paris, Ellipses.
CAMARA Loukimane, 2015, Dans l’élan de l’émergence de la Côte d’Ivoire selon Alassane Ouattara, Abidjan, Frat mat Éditions.
CAILLÉ Alain et LAZZERI Christian, 2009,La reconnaissance aujourd’hui, Paris, CNRS Éditions.
DIAKITÉ Samba, 2016, Les larmes de l’éducation, Québec, les Éditions Différence Pérenne.
GIRADOT Dominique, 2011, La société du mérite, Paris, Éditions Le Bord de l’Eau.
HONNETH Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, traduction, P. Rusch, Paris, Cerf.
JEANNIÈRE Albert, 1990, Lire Platon, Paris, Aubier.
KANT Emmanuel, 1981, Traité de pédagogie, traduction de J. Barni, Paris, Hachette.
KANT Emmanuel, 1991 Qu’est-ce que les Lumières ?, traduction, Jean-François Poirier et François Proust, Paris, Flammarion.
LOCHAK Danièle, 2005, Les droits de l’homme, Paris, La Découverte.
LUCCIONI Jacques, 1958, La pensée politique de Platon, Paris, Presse Universitaire de France.
MONTESQUIEU Charles Louis de Seconda, 1979, De l’Esprit des lois, Paris, GF-Flammarion.
MICHAUD Yves, 2010, Qu’est-ce que le mérite ?, Paris, Gallimard.
N’JOH-MOUELLÉ Ébénézer, 1970, De la médiocrité à l’excellence. Essai sur la signification humaine du développement. Yaoundé, Clé.
PLATON, 2008,La République, Œuvres Complètes, traduction, Luc Brisson, Paris, Flammarion.
PLATON, 2008, Ménon, Œuvres Complètes, traduction, Luc Brisson, Paris, Flammarion.
RENAULT Alain, 2004, Qu’est-ce qu’une politique juste ?, Paris, Éditions Grasset.
RENAULT Emmanuel, 2009, « Reconnaissance, lutte, domination : le modèle hégélien. », in politique et société, vol. 28, n°3, p. 21-32.
RICŒUR Paul, 2004, Parcours de la reconnaissance, trois études, Paris, Seuil.
SAVADOGO Mahamadé, 2013,Penser l’engagement, Paris, L’Harmattan.
LE DÉSIR DE RECONNAISSANCE AU CŒUR DU SOCIAL : L’ÉTHICITÉ HÉGÉLIENNE EN PROMOTION DE SOI
Kakou Hervé NANOU
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
Résumé :
Les discriminations sociales donnent au concept de reconnaissance de recevoir une fécondité inouïe dans les débats intellectuels contemporains. En fait, si l’expérience de l’injustice sociale s’identifie au mépris, le désir de reconnaissance, en mettant en exergue la « justice sociale », se dévoile comme un enjeu fondamental pour la condition humaine. Dans ces conditions, comment entrevoir la conditionnalité de la reconnaissance comme panacée des « pathologies sociales » ?
Cette contribution vise à montrer que l’éthicité englobe, chez Hegel, une série d’actions intersubjectives grâce auxquelles les sujets peuvent trouver aussi bien l’accès individuel à un contenu que la reconnaissance réciproque car, un sujet ne peut parvenir à l’autoréalisation que s’il exprime de la reconnaissance à l’autre.
Mots-clés : Autoréalisation, Désir de reconnaissance, Ethicité, Intersubjectivité, Justice sociale, Liberté, Mépris, Pathologie sociale.
Abstract:
Social discriminations give in the concept of recognition to receive incredible fruitfulness over the intellectual’s arguments contemporary. In fact, if the “social injustice” experience is identified to the contempt, the desire with gratitude, from obviously social justice, is uncovered in inscription as a cardinal stake according to the human. In those conditions, how the conditionality of recognition can be glimpsed like panacea of social pathologies?
This contribution aims to establish that ethicity encompasses, with Hegel, a series of intersubjective actions reprieves to which the subjects can well also tumble to the individual access contents without expressing the reciprocal scouting because a subject cannot manage with the devising if he show of it the gratitude of him other.
Keywords : Auto-accomplishment, Contempt, Freedom, Intersubjestivity, Investigation will, Social justice, Social pathology.
Introduction
Le désir de reconnaissance et ses émotions connexes – la colère, la haine, l’indignation, la fierté -, faisant partie intégrante de toute la personnalité humaine, constitue un enjeu fondamental de la condition humaine.
C’est bien Hegel qui insista sur le caractère anthropogène du désir de reconnaissance, et la lutte pour la reconnaissance lui est apparue comme le véritable moteur de l’histoire. En fait, sans vouloir tomber dans l’excessivité d’une interprétation ostentatoire, voire égologique de sa perception de l’éthicité, se donnant comme cadre de réalisation du sujet, il nous faut reconnaitre que chaque homme attend l’écho de sa grandeur interne par le canal de la reconnaissance d’autrui et témoigne, ainsi, de l’incomplétude de son être lorsqu’autrui se soustrait à cette exigence, c’est-à-dire lorsqu’il manque à cet appel. Ainsi, qu’il s’agisse d’aborder les discriminations sociales à travers les inégalités économiques, le mépris des minorités culturelles, les privations des droits politiques, les pathologies du travail, les rapports de domination du genre, etc., le concept de reconnaissance reçoit une signification plurielle et s’avère d’une grande fécondité dans les débats intellectuels contemporains.
Le terme « reconnaissance », qui n’appartient ni au vocabulaire politique traditionnel, ni au vocabulaire classique des sciences humaines, s’est pourtant récemment imposé comme un sujet de préoccupation collective et demeure d’actualité dans les théories philosophiques, sociologiques et psychosociales si bien que selon les mots d’Alain Caillé (2004, p. 5) :
Pendant deux siècles, l’essentiel du conflit social dans les sociétés modernes a porté sur les inégalités économiques. Depuis les deux ou trois dernières décennies, au contraire, il s’organise au premier chef à partir de la question de la reconnaissance.
Le souci pour la reconnaissance est donc présent dans la quasi-totalité des compartiments de la vie sociale si bien qu’il est devenu « un nouveau phénomène social total » (Alain Caillé (dir.) 2007) ainsi que l’une des questions morales et politico-juridiques centrales des temps contemporains.
La prédominance du néolibéralisme dans notre société tend à imposer comme projet idéologique la soumission au « libre marché » avec son corollaire de célébration de la « responsabilité individuelle ». Cette situation pose la quête du bonheur et de l’épanouissement personnel comme un idéal absolu au point que nul ne peut ignorer l’accroissement de la difficulté de vivre pour la majorité de nos contemporains. Du coup, le « déni de reconnaissance » prend des formes diverses selon la sphère en question : mal aimé des autres, exclut des droits, nié dans sa valeur sociale. Ces atteintes à la reconnaissance entrainent une expérience du mépris qui affecte négativement le rapport à soi des personnes concernées. L’on assiste, dès lors, à la perte de confiance en soi en tant que personne digne d’affection, à la perte du respect de soi en tant que membre d’une communauté d’égaux et à la perte de l’estime de soi dans un corps social indifférent ou hostile.
Cette centralité du « déni de reconnaissance » au cœur du social nous incite à nous interroger de la manière suivante : comment parvenir à la reconnaissance effective du sujet au sein d’une société soumis au dictat de l’égologie et du particularisme effrénés ? Autrement formulée, peut-on reconnaitre à l’individu ou au sujet sa valeur intrinsèque ainsi que la liberté existentielle au cœur d’une société marchande, panégyrique de l’acquisivité et donc en crise de valeur axiologique ?
Ces questions dont l’objectif est de montrer que la quête presque généralisée de la reconnaissance dans les sociétés contemporaines et qui constituent, plus que jamais aujourd’hui, un appel qui nécessite l’investigation du champ hégélien, seront analysées selon une approche méthodologique tripartie. Dans la première partie, il s’agira de faire le point sur le cheminement ayant conduit à l’avènement des théories de la reconnaissance, en termes d’archéologie de ce concept, sur la scène philosophique. Le deuxième moment mettra en exergue la question du « déni reconnaissance », lui-même appréhendé comme conséquence de la dissonance ontologique au niveau de l’humain. Quant à la troisième partie, elle s’évertuera à élucider le chemin du triomphe des pathologies sociales pour la réhabilitation plénière du sujet afin qu’émergent, au cœur du social, les conditions d’épanouissement, voire d’autoréalisation des individus.
1. Archéologie du concept de reconnaissance : les spécificités hégéliennes et honnethienne en assomption
De plus en plus, dans tous les secteurs de la société, au travail, dans les relations entre groupes sociaux ou entre traditions culturelles ou religieuses, entre les sexes ou les générations, dans les rapports à l’État et à l’administration, ou même en famille, les individus se sentent mal ou guère reconnus : ils aspirent tous à la reconnaissance. La thématique de la reconnaissance est ainsi devenue centrale en sociologie ou en philosophie politique, comme elle l’est dans la réalité même. Une société juste, pense-t-on aujourd’hui, est celle qui accorde à tous la reconnaissance sans laquelle nous ne saurions vivre heureux et épanouis. Mais pouvons-nous tous être reconnus à égalité dans nos singularités ? Avant d’entreprendre la résolution d’un tel problème, ne convient-il pas de questionner en direction du concept de reconnaissance ? Et comment l’aborder au mieux sans le connaitre ?
Écoutons, à ce propos, ce que Hegel dit sur le connaitre : « C’est une représentation naturelle qu’avant d’aller en philosophie à la Chose même, savoir au connaitre effectif de ce qui est en vérité, il serait nécessaire de s’entendre auparavant sur le connaitre » (G. W. F. Hegel, 1993, p. 89). Nous entendre sur le connaitre, c’est-à-dire, ici, sur le concept de reconnaissance, c’est, d’abord et avant tout, prospecter le terreau de son émergence afin de l’examiner dans sa teneur substantielle. Toutefois, y a-t-il meilleur sol de prospection d’un concept que le sol hellénique ?
En effet, le concept de reconnaissance est loin d’être nouveau dans la tradition philosophique. Et c’est justement ce qui donne sens à « sa polysémie » (P. Ricœur, 2004). Dans leur étude ontogénétique de ce concept, Haud Guéguen et Guillaume Malochet ne manquèrent point d’établir l’équivalence entre la reconnaissance et le terme grec de « anagnôrisis ». Ce terme grec désigne « une opération cognitive par laquelle on identifie un objet ou une personne quelconque » (H. Guéguen et G. Malochet, 2012, p. 7). La reconnaissance, au sens d’anagnôrisis, précisent les deux auteurs, en tant qu’elle est liée, chez Platon, qui l’utilise dans un sens épistémologique, à la problématique de la connaissance, dissociée de l’enjeu affectif ou moral, et, chez Aristote, au passage de l’ignorance à la connaissance, concerne, somme toute, chez eux, le contexte poétique dont « le sens et l’enjeu apparaissent, de prime abord, très éloigné du sens contemporain de la notion de reconnaissance » (Idem, p. 8). Du coup, ce qui est relativement nouveau et particulier dans l’usage contemporain de ce concept,
c’est le renversement au plan grammatical du verbe « reconnaitre » de son usage à la voix active à son usage à la voix passive, au lieu de reconnaitre quelque chose, d’autres personnes ou soi-même, le sujet demande à être reconnu par les autres ( K. Agnidé, 2014, p. 41).
Il convient donc, à ce niveau, de signifier que l’auteur dont le nom est lié à cette révolution sémantique est bien Hegel qui emprunta, lui-même, ce terme à Fichte mais, avant lui, à Machiavel puis à Hobbes.
De fait, dans ses écrits politiques, Machiavel formula l’idée selon laquelle les individus, voire les collectivités politiques, guerroient constamment entre eux, pour la défense de leurs intérêts. Avec lui s’impose, au fil des évolutions historiques, la conviction que l’action se déroule sur fond de lutte permanente des sujets pour la conservation de leur identité physique : « Les hommes, dit-il, aiment à changer de maîtres, espérant chaque fois trouver mieux. Cette croyance leur fait prendre les armes contre les seigneurs du moment » (N. Machiavel, 1972, p. 7). C’est ce thème de lutte pour la préservation du sujet et de ses intérêts qui fut reprit, cent vingt ans plus tard, par Thomas Hobbes pour asseoir le fondement de sa théorie contractuelle de la souveraineté de l’État.
Mais, Hobbes possède sur Machiavel l’avantage d’avoir insufflé le processus de formation d’un appareil d’État moderne et l’extension des échanges marchands lorsqu’il écrit :
Chaque fois que deux hommes désirent la même chose dont ils ne peuvent pas jouir tous les deux, ils deviennent ennemis l’un de l’autre ; et chacun, en vue de la fin qu’il se propose (à savoir, sa propre conservation), s’efforce de soumettre ou de tuer l’autre. C’est pourquoi, s’il n’existe rien de plus que la force d’un seul homme pour détourner celui qui songe à attaquer son voisin, on peut s’attendre, chaque fois que quelqu’un occupera un terrain présentant quelques avantages, qu’il l’aura ensemencé, qu’il y aura planté et bâti, à ce que d’autres, pourvus de forces unies, s’en viennent lui enlever, non seulement le tout de son travail, mais même la vie ou la liberté » (T. Hobbes, 2004, p. 106).
Ainsi, nul ne peut occulter le fait que
le contrat politique, dans la théorie de Hobbes, trouve sa justification décisive dans le fait qu’il est seul capable de mettre fin à cette guerre continuelle de tous contre tous que les sujets mènent pour assurer leur conversation individuelle (A. Honneth, 2000, p. 16).
Toutefois, il nous faut reconnaître que la philosophie sociale moderne, dans son déroulement, tend à réduire l’action de l’État à l’exercice d’un pouvoir instrumentalisé. C’est contre cette tendance que le jeune Hegel d’Iéna a cherché à réagir dans ses ouvrages de philosophie politique. Néanmoins, avant de reprendre cette tendance dans un contexte historique complètement différent, Hegel s’est tout de même servi « du modèle hobbesien de la lutte entre individus pour articuler son projet critique » (Idem, p. 17).
Aussi, les discussions contemporaines et systématique sur le concept de reconnaissance présentent-elles, pour l’essentiel, une réception et une transformation de fragment de doctrines de Fichte ; doctrines qui connurent leur développement plénier avec Hegel. Dans son ouvrage Fondements du droit naturel selon les principes de la doctrine de la science (1796), Fichte définit la reconnaissance comme la relation réciproque d’individus conscients d’eux-mêmes et qui limitent leur liberté d’action pour rendre possible l’exercice de la liberté d’autrui. Voici ce qu’il dit à cet effet :
L’être raisonnable fini ne peut pas s’attribuer à lui-même une causalité libre dans le monde sensible sans l’attribuer aussi à d’autres, par conséquent sans admettre d’autres êtres raisonnables finis hors de lui (J. G. Fichte, 1986, p. 46).
En fait, si pour Fichte le problème était de comprendre comment une conscience pouvait reconnaître une autre conscience, ou une autre liberté différente du phénomène sensible, les individus, en agissant de la sorte, constituent ce que Ludwig Siep qualifie « relation juridique » (L. Siep, 2013 p. 202). Il devient, dès lors, perceptible que Fichte utilisa le concept de reconnaissance pour penser la relation juridique.
Au-delà de tout ce qu’il doit à Fichte, Hegel pense la reconnaissance en termes d’exigence morale. Il s’inspira des travaux de ses prédécesseurs sur la thématique de la reconnaissance, mais dans la logique du dépassement. Il étend en effet la structure de la reconnaissance réciproque entre individus conscients d’eux-mêmes, analysée par Fichte, à une reconnaissance d’un niveau supérieur entre les individus et les formes de communauté, c’est-à-dire les systèmes et les institutions sociales. Ce rapport de reconnaissance se développe entre le « je » et le « nous ». Dans cette perspective, selon Ludwig Siep (Idem, p. 203), « dans la phénoménologie, la reconnaissance de la conviction et de la communauté morale est présentée comme l’achèvement de la reconnaissance entre « je » et « nous » ».
L’idée de Hegel est que la conscience de soi dépend de l’expérience de la reconnaissance sociale. La subjectivité n’advient, comme telle, que dans l’intersubjectivité et l’altérité est la condition d’effectivité de la conscience de soi. Voici ce qu’il dit :
Chacun est à l’autre le moyen terme par lequel chacun se médiatise et syllogise avec soi-même, et chacun, à soi et à l’autre, [est] essence immédiate étant pour soi, qui en même temps n’est ainsi pour soi que par cette médiation. Ils se reconnaissent comme se reconnaissant mutuellement (G. W. F. Hegel, 1993, p. 191).
Le processus d’individuation s’opère donc dans la reconnaissance. Ainsi, c’est « seulement par la reconnaissance d’autrui qu’un individu peut accéder à une véritable conscience de soi, ou à la “vérité” de la conscience de soi » (Emmanuel Renault, 2009, p. 27). Mais, cette reconnaissance passe par ce qu’il convient de nommer, à la suite de Hegel, « la lutte ou le combat à mort ». En effet, pour Hegel, « c’est seulement par l’acte d’engager la vie que [se trouve avérée] la liberté » (G. W. F. Hegel, 1993, p. 193). Mieux, « l’individu qui n’a pas risqué sa vie peut bien se trouver reconnu comme personne ; mais il n’a pas atteint à la vérité de cet être-reconnu comme une conscience autostante » (Idem). C’est dire que tout individu qui n’a pas mis sa vie en jeu ne peut parvenir à la vérité de la reconnaissance en tant que conscience de soi autonome. Dans son commentaire de la Phénoménologie de l’esprit, Kojève écrit ces mots qui suivent : « parler de l’« origine » de la Conscience de soi, c’est donc nécessairement parler d’une lutte à mort en vue de la « reconnaissance ». Sans cette lutte à mort de pur prestige, il n’y aurait jamais eu d’êtres humains sur la terre » (A. Kojève, 1947, p. 14). L’analyse kojèvienne, s’efforce, certes, de comprendre la pensée de Hegel, mais elle la caricature et, se mettant à distance d’elle, nous conduit à dire que la lutte pour la conservation de soi, loin d’être un phénomène de « pur prestige » se donne comme le procès nécessaire de toute existence libre. Ainsi, chez Hegel, la lutte pour la reconnaissance est le véritable moteur de l’histoire.
En conséquence, « ce n’est pas un hasard si la philosophie hégélienne se trouve être la référence centrale des deux principaux théoriciens contemporains qui ont réactualisé la question de la reconnaissance: Charles Taylor et, surtout Axel Honneth » (H. Guéguen G. Malochet, Op. cit., p. 24). En reprenant à leur compte l’idée hégélienne de lutte pour la reconnaissance, Axel Honneth et Charles Taylor octroient au concept de reconnaissance sa valeur sociale actuelle. Mais, comme le note si bien Haud Guéguen et Guillaume Malochet,
la théorie de la reconnaissance qu’un penseur contemporain dégage de la philosophie de Hegel est toujours tributaire du choix des textes utilisés, ainsi, bien sûr, que des enjeux et problématiques qui président au départ de ces choix (H. Guéguen G. Malochet, Op. cit., p. 29).
Axel Honneth, dans sa tentative de réactualisation de la Théorie critique de l’École de Francfort, s’inspira du paradigme hégélien de la lutte pour la reconnaissance pour rendre explicite ce qu’il entendait par le concept de reconnaissance tandis que Charles Taylor utilisa ce même terme pour développer une théorie de la reconnaissance des minorités culturelles. En fait, à partir du concept de reconnaissance qu’il reprend de Hegel, Honneth ne se contente pas, comme Taylor, de formuler une théorie de la réconciliation des différentes identités culturelles au sein de l’espace politique, mais « il s’emploie à proposer une vision globale de la vie sociale incluant aussi bien une conception de la vie accomplie qu’une explication des luttes sociales » (M. Savadogo, 2012, p. 83). S’agissant précisément d’Axel Honneth, la philosophie de la reconnaissance qu’il développe, constitue le troisième moment de la « Théorie critique » à la suite de ses prédécesseurs dont Walter Benjamin, Max Horkheimer, Théodor Adorno, Hebert Marcuse et Jürgen Habermas.
Et c’est au tournant habermassien de la Théorie critique dont l’idée maitresse est l’agir communicationnel, orienté vers l’intercompréhension, qu’a succédé la philosophie honnethienne de la reconnaissance. Honneth reconnait à Habermas un certain nombre de mérites dont celui d’avoir relevé un défi fondamental des premiers penseurs de la Théorie critique en relançant la recherche philosophique sur le social à partir de son paradigme de communication. Toutefois, il lui reproche de sacrifier la structure du social sur l’autel de l’impératif du consensus.
Contrairement à Habermas qui fait la promotion du consensus communicationnel, Honneth pense que ce qui se joue fondamentalement au cœur de la structure du social est la lutte pour la reconnaissance. C’est donc pour rendre compte de cette idée fondamentale jusque-là ignorée par ses prédécesseurs – aussi bien par l’ancienne Théorie critique que par Habermas –, que Honneth fait appel aux sources hégéliennes, en particulier, aux écrits hégéliens de la période d’Iéna dans le but de réactualiser la Théorie critique. En conséquence, Honneth peut écrire : « Et ce conflit dans l’entente me semblait être analysable au mieux à l’aune du paradigme de la lutte pour la reconnaissance développée par Hegel » (A. Honneth, 2006, p. 160). En préférant le paradigme hégélien de la lutte pour la reconnaissance à celui de la communication développé par Habermas, Axel Honneth opère une révolution dans l’histoire de la Théorie critique. Aussi, à travers son concept de « lutte pour l’existence » selon lequel la lutte vise moins la préservation « atomiste » de soi que l’établissement des relations de reconnaissance, calqué sur le modèle hégélien de « lutte pour la reconnaissance », ne se trouve-t-il pas justifié l’élévation, voire l’assomption des théories hégélienne et honnethienne de la reconnaissance ?
Assurément oui! Car si l’idée fondamentale qui structure la démarche honnethienne s’inspire du jeune Hegel de l’avant Phénoménologie de l’esprit,
pour qui la réalisation de l’être humain dépend de l’existence de relations éthiques, aux différents niveaux de l’amour, du droit et la « vie éthique » (Sittlichkeit), dont l’établissement procède uniquement d’un développement conflictuel marqué par la lutte pour la reconnaissance » (Idem, p. 20),
il ne fait aucun doute que la théorie de la reconnaissance, perçue par Hegel et Honneth, soit élevée, dans le contexte social actuel, à la grandeur des théories normatives de références et, surtout, au-dessus des autres théories analogues. En fait, pour Honneth, la formation de l’identité de la personne est tributaire des relations de reconnaissance dont la constitution est forcément de nature intersubjective. Par conséquent, si des individus se sentent atteints dans leur intégrité physique, s’ils sont exclus des droits ou encore s’ils se sentent niés dans leur valeur sociale, c’est-à-dire s’ils font l’expérience du mépris pouvant affecter négativement leur rapport à eux-mêmes, il va sans dire que la société qui les abrite est en crise et que cette crise peut bien conduire au « déchirement du social ». Ne convient-il pas, dans ces conditions, d’aborder la problématique du « déni de reconnaissance » en tant que cause des crises sociales ?
2. Du déni de reconnaissance aux crises sociales : l’humanité à l’épreuve de la dissonance ontologique
La reconnaissance, comme il a été signifié un peu plus haut, est l’un des concepts fichtéens et hégéliens qui a reçu le meilleur accueil dans la philosophie contemporaine. Avec Axel Honneth, elle est comprise comme l’une des conditions de la réalisation de soi. En ce sens, il faut comprendre qu’une société humaine requiert que l’environnement social, culturel ou politique permette aux individus de développer une identité autonome ou une relation positive à soi-même. Dans ce cadre social, chacun devrait pouvoir devenir ce qu’il souhaite être sans passer par l’expérience douloureuse du mépris ou du déni de reconnaissance. Ainsi, ne convient-il pas de nous interroger avec Axel Honneth en ces termes : « comment l’expérience du mépris peut-elle envahir la vie affective des sujets humains au point de les jeter dans la résistance et l’affrontement social, autrement dit dans une lutte pour la reconnaissance » ? (A. Honneth, 2000, p. 162). Et comment le déni de reconnaissance conduit-elle aux crises sociales dans le contexte de négation de la valeur intrinsèque de l’homme ? Somme toute, la dénégation à l’humain de ses valeurs intrinsèques ne se donne-t-elle pas comme le paravent ou l’antécédent d’un déséquilibre ontologique du dénégateur avec son essence ? L’exposé qui suit tentera de répondre à ces questionnements.
Il ne fait aucun doute que l’indignation soit de mise dans notre société contemporaine et que celle-ci relève du mépris. Par indignation, nous entendons l’expression de colère et de mécontentement qui soulève une action contre laquelle réagit la conscience morale ou le sentiment d’injustice. Ce type d’expérience, spécifiquement humaine est vécu lorsqu’une conduite fait scandale et provoque, pour ainsi dire, le bouleversement de notre âme. Elle témoigne surtout que le mépris est insupportable et que toute vie sociale humaine ne peut être fondée sur le déni de reconnaissance. Lorsque des personnes sont atteintes dans leur dignité ainsi que dans leur intégrité physique, lorsqu’elles sont exclues des droits ou encore se sentent niées dans leur valeur sociale, surviennent alors des luttes allant dans le sens de la restauration de leurs valeurs sociales. Les différentes atteintes à la reconnaissance, pouvons-nous le dire, entraînent l’expérience du mépris qui affecte négativement le rapport à soi des personnes concernées. On assiste ainsi, au cœur du social,
à la dissolution de la confiance en soi en tant que personnes dignes d’affection, à la perte du respect de soi comme membres d’une communauté d’égaux en droits, et à la perte de l’estime de soi comme sujets contribuant par leurs pratiques à la vie commune (A. Honneth, 2006, p. 21).
Ce sont de telles privations de reconnaissance qui sont à l’origine des crises sociales dans la mesure où les sujets concernés se voient refuser les conditions d’une formation et d’une appréciation positives de leur identité. Aussi, dans bien des cas, ces expériences du mépris deviennent des motifs de luttes visant à recouvrer l’identité à soi des sujets pour une reconnaissance plénière de leurs droits.
Et lorsque ces revendications pour la reconnaissance des sujets sont bafouées par ceux qui doivent les leur restituer, l’on assiste à la désagrégation, voire à la dissolution du tissu social. C’est ce qui nous donne d’asserter que le déni ou mépris des individus, lorsqu’il est mal maîtrisé, sous-traité, voire mal traité par les responsables de la société, conduit, inexorablement, aux crises sociales. Dans ce contexte, il faut comprendre dès lors que si
L’expérience de la reconnaissance sociale est une condition dont dépend le développement de l’identité personnelle dans son ensemble, l’absence de cette reconnaissance, autrement dit le mépris, s’accompagne nécessairement du sentiment d’être menacé de perdre sa personnalité (Idem, p. 193).
Ainsi, lorsque les droits des sujets sont violés « et que l’on refuse à une personne la reconnaissance qu’elle mérite, elle y réagit en règle générale par des sentiments moraux qui accompagnent l’expérience du mépris » (Ibidem). Ces sentiments moraux, tels que le mentionne Honneth, ne sont-ils pas des réactions au mépris des dignités humaines, pouvant occasionner le malaise social ?
Il faut bien reconnaître que lorsque l’humain est bafoué dans sa dignité, lorsqu’on lui dénie toutes valeurs liées à son existence et qu’on lui refuse la reconnaissance de ses droits fondamentaux, il s’ensuit, bien évidemment, de sa part, une réaction vindicative ; réaction pouvant conduire à la dislocation du lien social. Et si tel est le cas, la logique aristotélicienne de la communauté humaine selon laquelle « toute communauté a été constituée en vue d’un certain bien » (Aristote, 1990, p. 85) et qu’« ainsi, il est tout d’abord nécessaire que s’unissent les êtres [humains] qui ne peuvent exister l’un sans l’autre » (Idem, p. 87) ne se trouve-t-elle pas mise à l’épreuve ?
En effet, selon les mots d’Aristote, « l’homme est un animal politique plus que n’importe quel abeille et que n’importe quel animal grégaire » (Ibidem, p. 91). C’est dire que l’homme n’est fait que pour vivre en communauté et que c’est dans cet espace social que chaque homme coïncide avec son essence pour réaliser son épanouissement authentique. En ce sens, les particularismes effrénés, donnant lieu à la quête inassouvie des richesses avec son corollaire d’empiètement sur la liberté des plus faibles, la célébration de l’égologie et le mépris de la dignité ainsi que de la valeur intrinsèque des individus, ne peuvent que conduire à la distension, voire à la désintégration du lien social.
Dans un tel contexte, la communauté humaine ne peut que se voir détourner de sa destination première, à savoir celle du vivre ensemble harmonieux et convivial de ses composants en vue leur authentique épanouissement. Et, d’autant plus que pour Aristote, « la vie en cité est une certaine communauté » (Ibidem, p. 138) et qu’ « il est en premier lieu nécessaire de partager un territoire commun » (Ibidem), il nous est permis d’arguer que le déni de reconnaissance de la dignité et de la valeur intrinsèque des individus a pour conséquence la dislocation du tissu social; dislocation pouvant conduire la société à basculer dans des crises plurielles. Toutefois, la désintégration du cadre social, lieu de réalisation par excellence de l’humain, n’occasionne-t-elle pas sa désontologisation ? Et que désigne spécifiquement cette désontologisation de l’homme sinon la non coïncidence ou la non correspondance d’avec son essence, à savoir sa pensée ?
S’il est établit avec Pascal que « l’homme est visiblement fait pour penser, c’est [là] toute sa dignité et son mérite » (B. Pascal, 1972, p. 75), alors il convient de se rendre à l’évidence que la pensée, en tant qu’expression de la saisie intelligible des choses, donne, à chaque fois qu’elle est pleinement réalisée, sens à l’être de l’homme : elle est l’essence de l’homme. La pensée – ou du moins le
Concept qui, en régime hégélien n’a pas la signification mutilée d’une représentation générale élaborée par un sujet pensant (…) [et qui se donne comme] la totalité intelligible qui n’est telle que par l’épreuve d’une doctrine qui favorise l’élévation de la pensée » (A. Sangaré, 2016)–,
est ce qui fait la grandeur de l’homme ainsi que sa vocation fondamentale. Car s’il vrai que « L’habiter constant dans l’esprit comme le demeurer intime de [l’homme] (…) conduit sans détours à la pensée » (J. G. Tanoh, 2006), au Concept, n’est-il pas perceptible que c’est la pensée qui constitue l’appel et la mission de l’homme ?
Descartes l’avait compris un peu plus tôt lorsqu’à travers sa découverte du « cogito », il met l’accent sur l’identité spécifique de l’homme en engageant celui-ci à donner un véritable sens à son identité. En s’interrogeant en ces termes « Mais qu’est-ce donc que je suis ? » (R. Descartes, 1956, p. 38) et en répondant lui-même à la question : je suis « Une chose qui pense » (Idem), il posait le premier principe absolument logique et irréfutable de la connaissance. En fait, si l’homme est le seul être qui réalise la connaissance des choses, il nécessite qu’il sache lui-même comment, à partir de lui, la connaissance peut parvenir à sa véritable détermination. Autrement dit, il faut que le sujet qui cherche à connaître, aie la claire connaissance de lui-même avant de se lancer dans une telle entreprise. La pensée est ainsi le principe actif de la conscience qui est visibilité de l’esprit en l’homme.
Or, si l’humain fait l’objet du déni de sa valeur intrinsèque, il convient de se rendre à l’évidence que son bourreau, à savoir le dénégateur de ses valeurs, a perdu le sens essentiel de la correspondance à son être. Car, refuser à une personne ce qu’elle mérite, lui dénier sa valeur existentielle en suscitant en lui le sentiment d’injustice émanent de l’expérience négative qu’il fait du vécu social lorsque ses attentes de reconnaissance sont meurtries, n’est-ce pas là le signe révélateur du diagnostic de la dissonance ontologique de celui qui en est la cause ? Ainsi, il va sans dire que les dénégateurs sont, eux-mêmes, oublieux de ce qu’ils sont essentiellement et qu’ils se dissocient de leur vocation première, à savoir la coïncidence au Concept. Tel est le sens de la dissonance ontologique qui fait que l’homme ne peut plus répondre de lui-même en tant qu’être pensant et qu’il se laisse déterminer par l’acquisivité.
Dans ces conditions, puisque « le monde moderne est le théâtre d’une domination orgueilleuse et sans précaution » (A. Sangaré, Op. cit.) de l’homme par l’homme, l’épreuve de la dissonance ontologique se révèle, selon les mots de Sangaré Abou, comme « le manque d’équilibre, au niveau de l’homme, entre son essence pensante, éthique et son agir » (Idem). Ce déséquilibre, expression de la dysharmonie entre l’homme et l’espace social qui l’abrite se dévoile comme l’antécédent ou la cause fondamentale du déni de reconnaissance. Comprenons dès lors que si la pensée est en l’homme, ce n’est point pour l’ornement de son être mais c’est pour qu’il soit toujours en adéquation parfaite avec son origine, avec son essence afin qu’il soit en entente et en accord intelligible avec lui-même ainsi qu’avec ses congénères. C’est cela le sens et l’essence de l’homme, en tant qu’être capable de coexister sous le mode intelligible. Mais comment l’homme peut-il parvenir à son autoréalisation dans le contexte de sa dénégation et de la dissociation de sa valeur intime ?
3. La voie du triomphe des pathologies sociales : l’éthicité hégélienne comme autoréalisation fondamentale du sujet
Comment triompher des pathologies sociales au sein d’une société où les individus se dissocient, de plus en plus, de leur essence existentielle et où les hommes font sans cesse l’expérience du mépris ainsi que du déni de reconnaissance de leurs valeurs cardinales ? La réponse à ce questionner nous autorise, d’ores et déjà, à fouler le sol hégélien pour y extraire les remèdes curatifs de ces malaises sociaux. Mais, sans toutefois nous aventurer dans tout le champ hégélien, nous scruterons spécifiquement la sphère de l’éthicité qui, à notre sens, regorge des substances palliatives à ces pathologies sociales. Toutefois, que désigne le terme « éthicité » chez Hegel ?
Écoutons à ce niveau les propos de Hegel lui-même : « L’éthicité est l’idée de la liberté en tant que Bien vivant qui a dans la conscience de soi son savoir, son vouloir et, grâce à l’agir de celle-ci, son effectivité » (G. W. F. Hegel, 2003, p. 251). Que faut-il retenir de cette définition? Retenons que l’éthicité se distingue de la « moralité », en tant que rapport de la subjectivité à des normes d’agir qu’elle se prescrit de manière autonome ainsi que du « droit », entendu comme rapport de la personne à des choses et, par l’intermédiaire de celles-ci, à d’autres personnes : elle est, au sens hégélien du terme, la « vérité » de la sphère de la moralité et de la sphère du droit. L’éthicité, en ce sens, unit et recompose en elle le formalisme objectif du droit et le formalisme subjectif de la conscience morale. Elle constitue une forme d’actualisation de la normativité morale-pratique. En elle, « l’idée de la liberté reçoit (…) une effectivité dont elle ne dispose pas par elle-même, et le Bien abstrait auquel se réfère la subjectivité devient un Bien vivant » (J. F. Kervégan, 2007, p. 363) étant donné qu’il s’incarne dans des pratiques et des représentations partagées, c’est-à-dire communautaire.
C’est ainsi qu’aux dires de Hegel, « [l’éthicité est] le concept de la liberté devenu monde présent-là et nature de la conscience de soi » (G. W. F. Hegel, Op. cit., p. 251). En tant que telle, l’éthicité ne désigne rien d’autre que la liberté objectivée dans les configurations institutionnelles : elle est la condition de la moralité. Vue comme sphère « dans laquelle les composantes objectives de l’esprit objectif (les institutions) ont un rôle moteur » (J. F. Kervégan, Op. cit., p. 374), l’éthicité a pour fonction de créer les conditions de la « vie éthique » en produisant les schémas d’actualisation de la subjectivité. Cependant, en quoi la sphère hégélienne de l’éthicité peut-elle aider à soigner les pathologies du social pour qu’advienne, à l’éclat du jour, l’autoréalisation des sujets ?
Les sphères du droit et de la moralité, perçues comme conditions élémentaires mais essentielles de toute existence libre et accomplie, posent la condition préalable selon laquelle, il n’y a
Pas d’autoréalisation individuelle possible si l’accès à ces conditions élémentaires n’est pas reconnu et garanti à tout individu, indépendamment et abstraction faite de toute autre considération, liée par exemple à l’origine ou à la religion des individus (A. Honneth, 2008, p. 11).
Néanmoins, il est à relever que dans le droit et la moralité prévalent le culte de l’individualisme et de l’égoïsme qui génèrent les pathologies du mépris et du déni de reconnaissance. C’est là tout le sens de la nécessité, voire de l’urgence du recours à la sphère de l’éthicité, sphère au sein de laquelle apparaît, en plein jour, l’effectivité des conditions de l’autoréalisation des individus en tant que conditions intersubjectives.
De fait, c’est de la conscience qu’il prend des phénomènes sociaux à caractère pathologique, engendrés par l’autonomisation abusive des sphères du droit et de la moralité que Hegel construit sa théorie de l’éthicité en vue de remédier aux excès absolutisants des sphères du droit et de la moralité dans la société moderne fortement capitaliste. C’est parce que le droit et la moralité occasionnent le jeu de contradiction de l’autoréalisation du sujet lorsqu’ils jouent « un rôle qu’on pourrait dire aliénant » (A. Honneth, Op. cit., p. 12) que la voie de l’éthicité est, pour nous trouvée, pour pallier les pathologies sociales.
Dans un contexte social où la liberté est autonomisée de façon absolue et où les individus laissent libre cours à leurs agir, il demeure, de toute évidence, que des sujets souffrent d’indéterminité et de reconnaissance. Cette souffrance des sujet tient du fait que les types de subjectivités produits par l’autonomisation excessive des sphères du droit et la moralité sont vides, abstraits et sans contenu. C’est ce qui rend explicite le concept honnethien de « souffrance d’indéterminité », à savoir « la souffrance liée au fait d’être indéterminé » qui ne signifie nullement l’indétermination au sens de l’indécision mais bien plutôt le manque de détermination, dans le sens du manque de contenu déterminé. En fait, compte tenu de l’indétermination dans laquelle le sujet se trouve plongé du fait de la célébration du paradigme capitaliste par les sphères de la moralité et du droit en tant qu’elles sont source des pathologies sociales, comment ne pas voir dans l’éthicité le moment salutaire, voire fondamentale de la réalisation du sujet ?
En effet, comprenons que « le passage à la sphère de l’éthique a justement pour objectif proprement thérapeutique de nous guérir de ce genre de conduite et d’attitudes par lesquels nous nous maintenons dans une abstraction sans contenu » (A. Honneth, Op. cit., p. 14). L’éthicité justifie dès lors le rôle proprement libérateur, émancipateur et thérapeutique des pathologies car « dans cette sphère, nous devenons parties prenantes de pratiques sociales historiquement instituées, nous trouvons des fins pour nos actions, nous assumons des orientations normatives intersubjectivement partagés » (Idem, pp. 14-15). En congédiant les figures de la subjectivité vide et sans contenu occasionnées par le droit et la moralité, dans le contexte de leur autonomisation absolue, générant, pour ainsi dire, la souffrance de certains sujets du fait de leur indétermination, l’éthicité se présente comme la voie de résorption des pathologies sociales dans un monde capitaliste, soumis au dictat de l’avoir, et où l’individu fait incessamment l’expérience du mépris ou du déni de sa reconnaissance.
Le concept de souffrance, mis en connexion, par Hegel, avec le phénomène de l’être indéterminé, vide et manquant de contenu approprié, est le concept qui englobe les dommages pathologiques dans un monde où la vie semble orientée vers les libertés unilatéraux. Les crises sociales, naissant sur fond de mépris ou de déni de reconnaissance, comment l’individu peut-il parvenir à s’autoréaliser autrement que par la voie de l’éthicité ? Disons que, l’éthicité libère des pathologies sociales en ce qu’elle procure, de façon égale, à tous les membres de la société les conditions de réalisation de leur liberté. Elle est le lieu de l’ouverture à des possibilités accessibles à tous d’un gain consistant en contenu et de l’autoréalisation, possibilités « dont l’usage par chaque sujet individuel peut être expérimenté par lui comme la réalisation de sa propre liberté » (Ibidem, p. 87).
Et si la réalisation de la liberté individuelle n’est liée qu’à la condition de l’interaction, puisque les sujets ne peuvent s’expérimenter, eux-mêmes, comme libres dans leur limite que face à leurs partenaires humains, alors ce qui doit prévaloir dans la sphère de l’éthicité c’est le principe de « commerce intersubjectif ». Il s’agit ici des conditions de l’autoréalisation individuelle que l’éthicité doit procurer en vue de permettre aux sujets d’échapper aux souffrances liées à leur indétermination. Dans cette logique, ces conditions « doivent d’une façon ou d’une autre être composées de formes de communication dans lesquelles les sujets peuvent réciproquement apercevoir dans l’autre une condition de leur propre liberté » (Ibidem). L’éthicité regroupe, dès lors, une série d’actions intersubjectives qui se révèlent comme des dispositifs constitutifs de formes de reconnaissance. Dans cette sphère, les actions des sujets possèdent un caractère de reconnaissance authentique du moment où ceux-ci, en se rapportant les uns aux autres, se dissocient des dénégations des valeurs intrinsèques pour se reconnaître et s’apprécier comme tel. Il devient, dès lors, compréhensible que l’éthicité constitue le cadre fondamental de l’autoréalisation du sujet. Les actions intersubjectives des individus sont donc, dans l’éthicité, les conditions expressives de leur autoréalisation et de leur reconnaissance mutuelle.
Conclusion
On l’aura bien compris, le désir de reconnaissance est si bien généralisée dans les sociétés contemporaines que jamais, les sociétés humaines n’ont été mues par autant d’ampleur que par la lutte pour la reconnaissance. Alors qu’une bonne part de l’activité humaine est dirigée vers l’assouvissement des envies naturelles et qu’une partie non négligeable de leur temps se passe à la poursuite des buts fugitifs, individus et groupes sociaux aspirent à la reconnaissance. C’est ce qui fait dire à Fukuyama (F. Fukuyama, 1992, p. 182) que « les hommes ne recherchent pas simplement le confort matériel, mais le respect ou la reconnaissance ». Du coup, ceux-ci « croient qu’ils méritent ce respect parce qu’ils possèdent une certaine valeur ou une certaine dignité » (Idem).
Lorsque leur dignité vient à être écorchée ou bafouée et qu’ils font l’expérience du mépris pouvant entrainer leur réification, il s’ensuit que les hommes s’engagent dans une lutte qui vise la reconnaissance de ce qu’ils sont, – à savoir des sujets pensants –, ainsi que de ce qu’ils valent. C’est ainsi que les minorités ethniques, religieuses, culturelles et nationales expriment leur ardent désir d’avoir droit au respect.
Dans les relations interpersonnelles, les relations entre les groupes sociaux, les traditions culturelles, les générations ; dans les rapports des citoyens aux institutions, à l’État et à l’administration, les acteurs évoquent ou mobilisent le concept de reconnaissance. Ce concept est mobilisé quand les attentes de justice des différents acteurs et des groupes sociaux sont déçues dans le contexte du culte de l’injustice sociale. Dans cette situation, « ce qui est posé [comme paradigme] est aussi bien la possibilité de la non-reconnaissance, et de la non-liberté » (G.W.F. Hegel, 1992, p. 138).
La conséquence de cette non-reconnaissance, devenue effective au cœur du social par le mépris des individualités, est la génération des pathologies sociales dont la voie de résolution ne peut s’ouvrir que par l’éthicité hégélienne, entendue comme l’espace ou le cadre au sein duquel se jouent les actions intersubjectives en sorte que les sujets, ne peuvent parvenir à leur autoréalisation que s’ils expriment de la reconnaissance à leurs congénères. Et si « C’est par les multiples luttes pour la reconnaissance sans cesse rejouées qu’une collectivité peut accroître les chances de réunir les conditions nécessaires à l’autoréalisation de ses membres » (A. Honneth, 2006, p. 21), comment ne pas percevoir, au travers de ce qui est rendu au sujet au cœur du social, à savoir la restauration de sa dignité et sa reconnaissance en tant que personne valeureuse, l’émergence de l’humaine condition et, par voie de conséquence, l’émergence de la communauté toute entière ?
Références bibliographiques
AGNIDÉ Koffi, 2014, « Reconnaissance et nouvelles orientations normatives sur la justice sociales », Revue Perspectives philosophiques n°007, Premier semestre, pp. 38-60.
ARISTOTE, 1990, Les politiques, Traduction inédite, Introduction, Références bibliographiques, notes et index par Pierre PELLEGRIN, Paris, Flammarion, 476 p.
CAILLÉ Alain, 2004, « De la reconnaissance : Don, identité et estime de soi », Revue du MAUSS, n°23, premier semestre, pp. 5-15.
CAILLÉ Alain (dir.), 2007, La quête de la reconnaissance : un nouveau phénomène social total, Paris, La découverte, 304 p.
DESCARTES René, 2000, Discours de la méthode, Présentation et dossier par Laurence RENAULT, Paris, Flammarion, 191 p.
FICHTE Johann Gottlieb, 1984, Fondements du droit naturel selon les principes de la doctrine de la science, présentation, traduction et notes par Alain RENAUT, Paris, PUF, 422 p.
FUKUYAMA Francis, 1992, La fin de l’histoire et le dernier homme, traduit de l’anglais par Denis-Armand CANAL, Paris, Flammarion, 455 p.
GUÉGUEN Haud et MALOCHET Guillaume, 2012, Les théories de la reconnaissance, Paris, La Découverte, collection «Repères», 128 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1992, Système de la vie éthique, Traduit et présenté par Jacques TAMINIAUX, Paris, Éditions Payot, 213 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1993, Phénoménologie de l’esprit I, Traduction et notes par Gwendoline JARCZYK et Pierre-Jean LABARRIÈRE, Paris, Gallimard, 918 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 2003, Principes de la philosophie du droit, Présenté, révisé, traduit et annoté par Jean-François KERVÉGAN, Paris, PUF, collection « Quadrige », 503 p.
HOBBES Thomas, 2004, Léviathan, Traduit du latin et annoté par François TRICAUD et Martine PÉCHERMAN, Paris, Jean Vrin, 560 p.
HONNETH Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, traduit de l’allemand par Pierre RUSCH, Paris, CERF, 239 p.
HONNETH Axel, 2006, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Textes traduits par Olivier VOIRIOL, Pierre RUSCH et Alexandre DUPEYRIX, Paris, La découverte, 353 p.
HONNETH Axel, 2008, Les pathologies de la liberté. Une réactualisation de la philosophie du droit de Hegel, Traduit de l’allemand et présenté par Franck FISCHBACH, Paris, La découverte, 192 p.
HONNETH Axel, 2013, Ce que social veut dire I. Le déchirement du social, Traduit de l’allemand par Pierre RUSCH, Paris, Gallimard, collection « NRF essais », 346 p.
KANT Emmanuel, 1979, Fondements de la métaphysique des mœurs, Traduction et notes par Victor DELBOS, Préface de Monique CASTILLO, Paris LGF, 256 p.
KERVÉGAN Jean-François, 2007, L’effectif et le rationnel : Hegel et l’esprit objectif, Paris, Jean Vrin, 410 p.
KOJÈVE Alexandre, 1947, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la phénoménologie de l’Esprit professées de 1933 à 1939 à l’École des Hautes Études réunies et publiées par Raymond QUENEAU, Paris, Éditions Gallimard, 601 p.
MACHIAVEL Nicolas, 1972, Le Prince, Préface de Raymond ARON, traduction, notes et postface de Jean ANGLADE, 306 p.
PASCAL Blaise, 1972, Pensée, sous la direction de Philippe SELLIER, Paris, Le Livre de Poche, 735 p.
RICŒUR Paul, 2004, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 386 p.
RENAULT Emmanuel, 2009, « Reconnaissance, lutte, domination : le modèle hégélien », in Politique et société, vol.28, n°23, pp. 23-43.
SANGARÉ Abou, 2016, « Les fondements de la colonisation moderne de la nature : du bouc-émissairisme cartésien à la dissonance ontologique », in Échanges, revue de philosophie, littérature et sciences humaines, volume 1, n°007 décembre 2016.
SAVADOGO Mahamadé, 2012, Penser l’engagement, Paris, L’Harmattan, 123 p.
SIEP Ludwig, 2013, La philosophie pratique de Hegel : actualité et limites, Présentation par Myriam BIENENSTOCK, traduit de l’allemand par Jean-Michel Buée, Pais, Éditions de l’éclat, 302 p.
TANOH Jean Gobert, 2006, « Être africain (Approche métaphysique de l’identité humaine en Afrique) », in le Portique [En ligne], 2- | Varia, mis en ligne le 15 décembre 2006, Consulté le 12 août 2011.
TAYLOR Charles, 1993, « Politique de reconnaissance », in Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Aubier, 142 p.
SOUS-THÈME II : CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
LE POSTULAT DE L’ESSENCE CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE ENTRE ÉMERGENCE ET RECONNAISSANCE
Didier NGALEBAYE
Université Marien Ngouabi (Congo Brazzaville)
otwere_ossoh@yahoo.fr
Résumé :
La présente contribution interroge l’effectivité de la pratique du postulat de l’essence critique de la philosophie, telle que saisie dans la relation pédagogique et professionnelle, pour en évaluer la difficulté et dégager une possibilité épistémo-éthique permettant de sauvegarder le schéma classique de reproduction des élites philosophantes à travers la dialogique émergence des jeunes penseurs et leur reconnaissance par les penseurs attitrés, notamment à travers le rite de passage que demeure la soutenance de thèse doctorale. Pourquoi le droit à la critique, historiquement et institutionnellement consacré, n’est-il pas souvent pratiquement toléré, laissant libre cours à l’intolérance? Tel est le questionnement principiel de cette réflexion, dont l’enjeu épistémologique est de montrer la possibilité et la nécessité d’un consensus rationnel en philosophie, par-delà les difficultés de son rapport à l’objectivité. La démarche choisie applique performativement les concepts d’émergence et de reconnaissance à la philosophie elle-même, dans un environnement sociopolitique qui présente l’émergence comme étant d’essence économique.
Mots-clés : Critique, disjonction, émergence, épistémo-éthique, philosophie, postulat, reconnaissance, thèse.
Abstract :
This current contribution questions the effectiveness of the practice of the postulate of the critical esence of philosophy, as captured in the pedagogical and professional relationship, to assess the difficulty and to identify the possibility epistesmo-ethical allowing to save the classical pattern of reproduction of philosophical elites through dilogic emergence of young thinkers and recognition by the appointed thinkers, especially through the rite of passage that remains the defense of doctoral thesis. Why the right to criticism, historically and institutionally dedicated, is it not often practically tolerated, giving free rein to intolerance ? This is the main questioning of this reflection, whose espistemological challenge is to show the possibility and the necessity of a rational consensus in philosophy, beyond the difficulties of his report to objectivity. The choosen approach apllies the concepts of emergence and recognition performatively itself, in a sociopolitical environment that presents emergence as economic essence.
Keywords: Critical, disjunction, emergence, epistemo-ethical, philosophy, postulate, recognition, thesis.
Introduction
La présente recherche porte sur la thématique : Emergence et reconnaissance en philosophie et pose le problème général de la capacité théorique et pratique du philosophe à assumer le postulat de l’essence critique de la philosophie : sans faux-fuyant, biaiserie, ni amertume. Ce problème nous inspire la question suivante : Pourquoi le droit à la critique, historiquement et institutionnellement consacré, n’est-il pas souvent pratiquement toléré, laissant libre cours à l’intolérance ?
À l’effet de l’instruire, nous posons l’hypothèse de l’existence d’un impensé du discours, antéprédicatif, qui n’accèderait au langage que pour placer les têtes pensantes dans la situation de renoncer aux exigences épistémo-éthiques auxquelles elles tenaient principiellement, et convoquons la méthode phéno-prospectiviste, qui consiste à descendre du fondé à la fondation du phénomène (1), à analyser complexement le phénomène ainsi identifié et situé (2), avant de tenter de le capitaliser pour reconfigurer la texture de la quête philosophique du Sens (3).
Ainsi, envisagée, la réflexion va s’articuler sur trois moments : critique et émergence en philosophie (1), pratique de l’essence critique de la philosophie et problématique de la reconnaissance (2) et pour réconcilier postulat et pratique critiques de la philosophie (3).
Par ce chemin de pensée, les concepts d’émergence et de reconnaissance sont appliqués à la philosophie elle-même, dans un environnement sociopolitique international qui réduit beaucoup plus le concept ‘’Emergence’’ à sa simple dimension économique, à travers le terme « pays émergents ».
1. Critique et émergence en philosophie
Nous partons du concept de recherche en philosophie, avant de considérer son essence critique postulée, en tant qu’indicateur d’émergence d’un nouvel acteur et d’une nouvelle pensée pour la communauté philosophique, en énonçant les principes et règles qui structurent et sous-tendent le discours des philosophes. En l’absence d’une espèce de ‘’manuel de procédures de la recherche philosophique’’ universellement partagé[14], c’est en confrontant méthodologiquement et brièvement quelques grandes œuvres que l’on pourrait dégager quelques tendances convergentes du ‘’mode opératoire de la recherche et de l’enseignement philosophiques aujourd’hui’’.
Ainsi, en capitalisant l’héritage historique, E. Kant (1987, pp. 624, 625, 626) énonce clairement l’espritdumode opératoire de la recherche et de l’enseignement philosophiques en ces termes :
Entre toutes les sciences rationnelles (a priori), il n’y a donc que les mathématiques qui peuvent être apprises, mais jamais la philosophie (à moins que ce ne soit historiquement) : en ce qui concerne la raison, on ne peut apprendre tout au plus qu’à philosopher…
Cet énoncé kantien constate l’inexistence historiale d’un système philosophique, dans lequel la Vérité soit devenue chair, pour que quiconque l’apprendrait devienne automatiquement philosophe ! Plutôt que cela, il demande à quiconque voudrait émerger comme « philosophe » de s’instruire dans l’histoire de la pensée déjà pensée, en appliquant les principes universels de la raison à l’expérience humaine, au double plan de la nature et de la liberté, pour trouver son chemin, non plus en tant qu’artiste, mais en qualité de législateur critique.
La quête d’originalité, qui permet à l’aspirant à l’émergence pensante de dire : « Je pense que » est, ainsi, le souci majeur de la recherche philosophique, qui dispose celui qui y parvient à sortir de l’anonymat et de la minorité de la répétition ainsi que du commentaire improductif des acquis historiques, pour contribuer soi-même à leur renouvellement, en émergeant comme « auteur ». Pratiquement, cela revient à cesser d’être simplement « professeur de philosophie » pour devenir « philosophe » soi-même. Car, si les prédécesseurs n’avaient pas pris le risque et la peine d’interroger rationnellement le réel, pour en dévoiler le sens, l’histoire de la philosophie et le commentaire des œuvres, comme disciplines philosophiques, ne trouveraient jamais plus de matière, que la pensée tarirait, pour finir par disparaitre de l’architecture universitaire !
L’on peut s’apercevoir que ce propos kantien, qui aura eu le mérite d’être explicite et inflexionnel pour la suite de la réflexion philosophique mondiale, a été précédé par une série de gestes philosophiques fondateurs, marquant l’attitude du philosophe face au Pouvoir d’État, pendant qu’il mène sa recherche de la Vérité, de la Justice et du Beau. Il s’agit, notamment de celle de Platon, qui pense que la recherche philosophique va de pair avec l’amélioration de la gouvernance politique de la Cité, en vue de l’accomplissement de la Justice, et celle de Descartes, qui préfère éviter le heurt, pour s’occuper « sereinement » des méditations philosophiques, tout en collant la paix à l’ordre du monde.
Ainsi, de Platon sont nés les artistes de la pensée, dont les enquêtes sur le réel donnent du travail aux historiens et commentateurs, tandis que les ‘’diplomates’’ de la pensée sont dérivés de Descartes. Mais, compte tenu du fait que la spécificité de la situation du contribuable (public et privé) qui finance la recherche laisse à désirer[15], il nous semble que la philosophie devrait s’impliquer, aux côtés des autres démarches, pour contribuer à la réduction des douleurs existentielles de l’Humain sur terre, à partir des instruments qui sont à sa disposition, à savoir : l’analyse critique et prospective du séjour de l’Homme au Monde spatio-temporellement considéré et devant indiquer quelques pistes d’actions, sous la forme de ce que l’on appelle « Recherche-développement », guidée par l’obligation éthique du règlement de la dette du sens des cadres envers la société organisée qui a supporté et financé leurs études, en vue de l’intérêt général.
Certes, ces héritages platonicien, cartésien et kantien ont fait l’objet de plusieurs critiques, qui les rangent sous la rubrique générale d’épistémologie classique, ainsi qu’en témoigne, notamment, un titre aussi clairement orienté et virulent que Le rationnel voilé. Ou comment vivre sans Descartes (H. Dufrenois, 2010, 161 pages). Mais, avant cet ouvrage, il y a eu celui de T. S. Kuhn, dont R. Nadeau (1994, pp. 159-189) rend comme suit l’esprit dans le résumé de l’article qu’il lui a consacré.
En 1962, Thomas Kuhn fait paraitre un livre qui allait le rendre célèbre, à savoir La structure des révolutions scientifiques. Il visait à produire en philosophie des sciences ce qu’il appela un – « Gestalt switch ». Il entendait, en effet, mettre en cause le « paradigme épistémologique cartésien » et proposer que l’analyse logico-méthodologique cède logiquement la place à une analyse historique et psychologiques des sciences. Mon propos est de faire voir que, bien que les premiers critiques de Kuhn se soient le plus souvent fourvoyés, en proposant ce virage radical, Kuhn a amplifié, sinon induit une crise profonde dans la philosophie des sciences post-positivistes. Car, ni l’histoire, ni la sociologie des sciences ne sont adéquatement outillées pour répondre aux questions spécifiquement logico-méthodologiques que la connaissance scientifique suscite.
Ainsi, le penser cartésien aura manqué de la puissance critique que confère l’iconoclastie de la raison face à la témérité ontologique du réel. Sa pensée s’est constituée en une philosophie de la justification, là où l’on attendait une philosophie de la découverte. Mais, quelle que soit la pertinence de ces critiques, celles-ci ne pourront pas effacer ce qu’aura été le « moment cartésien » de l’histoire de la philosophie. En face, l’attitude issue de Platon est un modèle dans lequel la construction de la science se soucie en même temps de la conduite sociopolitique des affaires d’intérêt général par les hommes d’État et la situation des populations considérées comme ayant droit aussi bien à la Vérité qu’à la Justice, pour lesquelles, le philosophe s’avère être un « consultant » incontournable. Dans cette attitude, il s’agit de concilier le développement des activités strictement épistémo-éthiques de recherche et d’enseignement philosophiques, tout en se donnant les moyens d’infléchir la conduite des affaires publiques par les politiques, sans leur ressembler et sans renoncer au méta-principe critique, non plus.
Dans cette attitude aussi, le philosophe est toujours du côté de ceux qui ont toujours à redire, pour pousser ceux qui ont la charge de l’action à toujours mieux décider et agir pour l’intérêt de tous. Toute l’œuvre théorique et la vie quotidienne pratique du philosophe émergeant portent la marque de cet état d’esprit : le combat pour la Vérité et la Justice. Les deux grandes figures caractéristiques de l’esprit de l’élan méthodologique de la recherche et de l’enseignement philosophiques présentées à l’instant (l’hypocrisie et l’iconoclastie philosophiques) rendent compte du fond de la démarche pensante intérieure, investie par chaque philosophe au moment de la conquête du savoir. Mais, au moment de la publication des résultats de la recherche et de leur partage pédagogique, en vue de leur appropriation par les humanités pensante et agissante, il y a des méthodes plus appropriées qui sont mises à contribution. En résumé, investir la raison dans la quête de la Vérité, sous l’impulsion de la curiosité que mobilise l’étonnement, qui appelle la réflexion, suppose le passage de la raison naturelle à la raison méthodique (Descartes).
À partir de cette posture, la raison humaine opère suivant des principes (universels) et lois (particulières). Ainsi, l’esprit du mode opératoire de la recherche philosophique peut être caractérisé, d’une part, par l’application systématique des principes de la Raison (I) que la Logique explicite, sous l’autorité transversale du méta-principe critique, cette puissance onto-logique du tri interrogateur (nuançant), interrogatoire (profond) et interrogationnel (permanent) qui, distinguant le vrai du faux, le bien du mal, le beau du laid, etc., entretient et aiguise la curiosité, tout en préservant la raison d’une chute dommageable dans le dogmatisme irrationnel, alors que la quête de la Vérité demeure son horizon épistémo-éthique. A cet effet, D. Ngalebaye (2017, pp. 69-71) montre que la rationalité critique, dont la discussion est la sève, se déploie suivant les principes de bivalence, de l’inter-permutabilité, de l’existentialité,de l’abstraction de l’infini actuel, de la double négation et de raison suffisante.
Ces principes sont explicitement connus et pratiqués par certains, tandis que d’autres les pratiquent implicitement, sans en avoir la conscience claire, alors qu’il le faudrait, afin que la rationalité se structure au regard et devant tous.
D’autre part, l’esprit du mode opératoire de la recherche philosophique consiste essentiellement, ainsi que le montre Y. Akakpo (2012, p. 130) dans la décision de problématiser un thème de recherche, central pour la communauté philosophique, en spécifiant son traitement à travers la recherche documentaire, le tout passant clairement par la problématique, qui comprend une question principale et des questions spécifiques, chacune donnant lieu à une hypothèse appropriée, ouvrant elle-même à une documentation circonscrite et à un axe de réflexion orienté. Lebut de ceci est de mieux élaborer l’argumentation d’ensemble, devant marquer à jamais la contribution originale du chercheur émergeant à la réflexion philosophique générale sur le thème choisi, en vue de la reconnaissance de sa contribution par les pairs.
Mais, cet ancrage méthodologique de la recherche et de l’enseignement philosophiques est à nuancer en tenant compte de l’ouvrage de P. Feyerabend, Contre la méthode. Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance au regard duquel l’essai en cours de reconstruction du mode opératoire de la recherche et de l’enseignement philosophiques vise un objectif limité, celui de relativiser toute méthode et mieux faire apparaitre l’objectif de l’émergence philosophante.
Cette base observationnelle nous parait saturée, pour montrer à présent comment les acteurs de la philosophie eux-mêmes présentent celle-ci comme étant un mode de pensée relevant d’une essence critique postulée par rapport aux autres modes de pensée que l’homme a élaborés pour instruire sa curiosité face au monde et travailler à transformer ses questions en réponses, mais dont ils éprouvent eux-mêmes du mal à pratiquer convenablement les principes et lois énoncés au point 1 de la présente recherche.
2. Pratique de l’essence critique de la philosophie et problématique de la reconnaissance
Il y a un paradoxe entre la nature essentiellement critique postulée de la philosophie et la difficile pratique de cette postulation, dont l’enjeu est aussi bien épistémo-éthique qu’heuristique, au sens où, c’est par le travail critique et prospectif que le « candidat » à l’émergence se signale en vue de sa reconnaissance par les pairs. A peu près tous les philosophes et professeurs de philosophie (anciens et émergeants), qui ont eu à se préoccuper de la nature logique de cette discipline, au regard de la quête humaine de Vérité, et comparativement aux approches mythique, religieuse et scientifique de la Vérité, relèvent que la philosophie est une discipline intellectuelle essentiellement critique, et que ce caractère critique lui garantit sa pérennité dans le Temps, tout en la préservant d’une chute dans le dogmatisme irrationnel.
À titre d’exemple significatif, contentons-nous de ce qu’en dit K. R. Popper (1981, pp. 124) :
Il n’y a pas de meilleur synonyme de « rationnel » que « critique » ; la croyance, bien sûr, n’est évidemment jamais rationnelle : il est rationnel de suspendre la croyance.
Par la suite, l’auteur (1981, 166) commente la même idée de la sorte :
Je défendais l’idée que l’un des meilleurs sens du mot « raison » ou « raisonnable » était celui de la disponibilité à la critique : ouverture à la critique d’autrui et promptitude dans la critique de soi.
Cet énoncé, on peut le retrouver dans tout ouvrage, vocabulaire technique ou manuel de philosophie, quant au fond, bien qu’une série de méprises subsistent quant à sa forme, notamment chez certains philosophes, comme Hegel, chez qui la confusion entre critique et contradiction est manifeste.
À cet égard, la question à laquelle nous travaillons ici est la suivante : S’il est vrai que la philosophie est réellement d’essence critique, pourquoi les philosophes et professeurs de Philosophie ont-ils du mal à assumer pratiquement cette essence critique postulée ? Le métier de penser étant à la fois noble et complexe, les philosophes situent dans la curiosité, tout le mouvement épistémo-éthique portant et structurant la recherche du Sens dans les différents modes de pensée que l’homme s’est donné historiquement : le mythe, la religion, la philosophie et la science.
À travers ces modes de pensée, l’homme se pose les mêmes questions concernant l’origine de l’Univers, la place qu’il peut y occuper et son destin après la mort. Les philosophes résument ces questions, généralement, dans les termes suivants : Pourquoi y a-t-il l’étant et non pas plutôt rien ? Cette question ontologique préjudicielle portant sur le Sens de la vie humaine sur terre, est prise en charge dans un rapport différencié d’avec la raison dans les différents modes de pensée qui la travaillent. La philosophie la formule dans le cadre de ses recherches métaphysiques comme la recherche du sens de l’Etre de tout étant, telle qu’on peut la retrouver sous la plume de P. Aubenque (2009). Les penseurs égyptiens de l’Antiquité, comme Shabaka, Kagemni, Vizir Plahotep, etc., se sont aussi posé la même question, sous la figure du Noun (eau abyssale), avant les philosophes grecs antiques, qui se la sont posé sous les figures multiples de l’Eau, du Feu, de l’Air, de la Terre, de l’Idée, etc., ainsi que le montre T. Obenga (1990, 2017). La science se pose la question de l’origine de l’Univers dans le cadre particulier de ses recherches d’astrophysique, ayant ouvert des perspectives comme la théorie du Big bang et la théorie du Big crush, qui ne cessent d’alimenter la réflexion épistémologique. Les considérations mythiques sur l’origine de l’Univers se cristallisent dans le type de mythes cosmogoniques, où les religions situent la genèse de l’Univers.
À l’examen, deux approches de la Vérité se dégagent : celle de la rationalité (philosophie et science) et celle de la dogmaticité (mythe et religion). Mais, un ouvrage comme celui de G. Balandier (1994), montre l’imbrication contemporaine de la rationalité d’avec la dogmaticité. La conscience de cette imbrication conduit à la nécessaire synthèse de ces deux pistes de quête du Sens, dont il convient de négocier la transversalité comme troisième piste, en tant que faisant signe et sens vers l’universalité du Savoir, fondé dans la rationalité critique et prospective, à la frontière de l’irrationnel, mais que le quêteur du Sens regarde rationnellement sous le mode de la complexité épistémo-éthique.
Deux moments marquent cette quête historiale de la Vérité. Dans le premier moment, le quêteur s’engage seul, mais dialogue critiquement avec la communauté (de prédécesseurs et de contemporains), pour contribuer à la construction du Sens. Le deuxième moment est celui de la relation professionnelle et pédagogique entre le Maitre et le disciple, le Directeur de thèse et le thésard, entre confrères. C’est dans ce deuxième moment que se formalisent les conditions du rite de passage et de réception des philosophes émergeants par les philosophes institués, de la « science révolutionnaire » par la « science normale » (selon les expressions de T. S. Kuhn). C’est aussi dans ce moment de l’acte philosophant qu’éclate et apparait la difficulté de la pratique de l’essence critique postulée de la philosophie, comme nous pouvons le voir dans et sur certains cas d’autocritique et de critique historiques, pour lesquels L. Wittgenstein est un cas particulier.
En effet, L. Wittgenstein (1990, p. 27) a publié un livre déroutant : Tractatus logico-philosophicus, qu’il finit par présenter comme thèse sur travaux devant un jury composé de Russell et Moore, dont il discute précisément les pensées dans l’ouvrage en question, au point où, il a cru utile d’en prévenir le lecteur : « Il se peut que ce livre ne soit compris que par celui qui aura lui-même déjà pensé les pensées qui y sont exprimées ou des pensées analogues », notamment, celles de Frege et Russell. Faisant office d’autocritique, L. Wittgenstein (1990, p. 112), à la suite des critiques suscitées par Tractatus, reconnait, dans sa Préface aux Investigations, ce qui suit : « Il m’avait fallu reconnaitre de graves erreurs dans ce que j’avais publié antérieurement». Philosophe émergeant, Wittgenstein discutait déjà avec ses maitres qui, tenus par l’objectivité, ont reconnu l’originalité et l’ampleur de ses travaux, et l’ont accepté comme confrère, occupant une place de choix au cœur de la philosophie analytique, au point où la discrimination de la philosophie du langage idéal d’avec la philosophie du langage ordinaire ne saurait se comprendre sans référence à lui.
Voici L. Wittgenstein émergé, reconnu par la communauté philosophique, dont il est devenu un acteur incontournable. Comment se comporte-t-il face aux autres ? Ici est le problème. Invité à prononcer une conférence par le Secrétaire du Moral Sciences Club de Cambridge, K. R. Popper (1981, 176-178) rapporte longuement la façon dont il fit l’expérience de l’intolérance philosophique de L. Wittgenstein, en présence de B. Russell :
Au début de l’année universitaire 1946-1947, je reçus une invitation du secrétaire du Moral Sciences Club de Cambridge pour faire une communication à propos de quelques « puzzles philosophiques ». Il était clair que la formulation était de Wittgenstein et que derrière se cachait la thèse philosophique qui était la sienne selon laquelle il n’existe pas de véritable problème philosophique, mais seulement des’’ puzzles’’ linguistiques. Etant donné que cette thèse faisait partie de mes aversions favorites, je décidai de parler du sujet suivant : « Y a-t-il des problèmes philosophiques ? » Je fis ma communication le 26 octobre 1946 […]. Mais, à ce moment précis, Wittgenstein bondit sur ses pieds et dit d’une voix forte, sur un ton qui me semble celui de la colère : « Le secrétaire a fait exactement ce qu’on lui a demandé. Il a agi selon mes instructions » […]. Wittgenstein bondit à nouveau, m’interrompit et s’étendis longuement sur les « puzzles » et sur la non-existence des problèmes philosophiques […]. A un moment qui me parut approprié, je l’interrompis, lui soumettant une liste de problèmes philosophiques que j’avais préparée à l’avance [etc.]. Wittgenstein était assis près du feu […]. Il me mit au défi : « Donnez-moi un exemple de règle morale ! ». Je lui répliquai : « Ne pas menacer les conférenciers invités avec des tisonniers ». Sur quoi, Wittgenstein, fou furieux, jeta le tisonnier au sol et sortit de la pièce comme un ouragan, en claquant la porte derrière lui.
Face à cette anecdote philosophique illustrative, certains pourraient objecter que la base observationnelle n’est pas saturée, pour que la conclusion en soit philosophiquement significative, en évitant de tomber dans le réductionnisme inductif dénoncé par Popper lui-même. Certes. Il se trouve que, dans le domaine des idées, il y a des choses singulières qui pèseraient autant et/ou plus que des tonnes empiriques. On l’a vu : avant sa reconnaissance par les pairs, Wittgenstein a sévèrement critiqué Frege, Russell, Moore, etc., qui ont reçu ses critiques avec bienveillance. Mais, devenu mandarin, il a servi à la communauté philosophique une scène d’intolérance, d’intégrisme, de fermeture ouverte et de violence d’esprit indignes d’un philosophe, vu sa notoriété.
Malheureusement, ce genre de scènes constitue le lot quotidien des rapports professionnels et pédagogiques dans certaines Universités et écoles philosophiques du monde, comme si la disjonction entre le signe et le sens était ontologiquement nécessaire dans la collaboration entre Directeurs de thèse et doctorants, ainsi que cela se produit par ailleurs dans certains jurys de soutenance de thèses. Pourrait-on dire ou atténuer ce fait, comme Pythagore à propos de la Sagesse, que la critique est un attribut de Dieu seul débordant l’humaine condition ? Le fait qu’on postule l’essence critique de la philosophie et on la pratique sur les autres, mais l’on ne supporte pas d’en être soi-même publiquement l’objet.
Ceci oblige à donner raison à Bachelard (1983, p. 241) : « Toute doctrine de l’objectivité en vient toujours à soumettre la connaissance de l’objet au contrôle d’autrui ». Devant un objet comme l’évaluation d’une thèse de Doctorat, l’objectivité consisterait, pour les membres du jury, à l’apprécier comme élaborée par l’impétrant qui trace par elle son projet théorique, et non comme chaque membre du jury veut qu’elle soit, en tirant la portée de cette thèse vers sa spécialité, en en faisant ainsi une lecture subjective. Cette donnée parait récurrente dans certaines Universités. Et, là est notre problème avec l’objectivité au moment de l’émergence philosophique, dans la mesure où la soutenance de thèse est un rite de passage, une consécration par laquelle le nouvel acteur émergent se fait aussi reconnaitre par les membres attitrés de la communauté philosophique. En ce sens précis, l’esprit scientifique, pour lequel l’autorité de l’argument devrait primer sur l’argument d’autorité, n’habite ni les universitaires, ni les milieux universitaires, où prospèrent, malheureusement, des comportements et pratiques parascientifiques, en rapport avec la quête du Sens.
Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi est-il facile et courant de critiquer les autres, mais difficile de se laisser critiquer par eux et capitaliser performativement ces critiques dans la reprise de son propre travail philosophique? La critique est-elle ontologiquement incompatible avec la structure anthropologique de l’homme-philosophant? Les humeurs contre la critique étant des obstacles réels au progrès de la connaissance vraie dans les esprits et milieux universitaires, il est nécessaire et urgent de pousser plus loin l’enquête, afin de savoir à quoi cela se rapporte, dans la mesure où le devenir du Savoir vrai en dépend mondialement.
Entre autres pistes, F. Fukuyama (1992, p. 16), tente d’expliquer les relations parfois orageuses entre humains par ce qu’il appelle ‘’le désir de reconnaissance’’, dont le respect mutuel conduit à un contrat de Paix entre le Je et le Tu, tandis que sa violation conduit à la guerre multiforme :
Les êtres humains, tout comme les animaux, ont des désirs et des besoins naturels pour des objets placés en dehors d’eux-mêmes : nourriture, boissons, abri, et par-dessus tout préservation de leur propre corps. L’homme diffère toutefois fondamentalement des animaux parce qu’il désire en outre le ‘’désir’’ des autres hommes, c’est-à-dire qu’il veut être ‘’reconnu’’. En particulier, il entend être reconnu comme être humain, c’est-à-dire un être doué d’un certain mérite et d’une certaine dignité. Cette dignité est liée au premier chef à sa volonté de risquer éventuellement sa vie dans une lutte pour le seul prestige.
L’auteur solidifie son explication, en renvoyant à Platon, le concept de « désir de reconnaissance », qu’il repère chez Hegel.En ce sens, comprendre l’importance de ce désir de reconnaissance, ici adapté à la relation philosophique et pédagogique, en tant que moteur de l’Histoire, là où Marx plaçait la lutte de classes, permet de réinterpréter bon nombre de phénomènes familiers observés entre individus, institutions et États, comme la culture, le travail, la religion, la politique, l’amour, le nationalisme, la guerre, etc.
Précisément adaptée au cas de l’émergence et de la reconnaissance philosophiques, l’explication anthropologique du « désir de reconnaissance » par Fukuyama nous semble mieux faire comprendre pourquoi des sommités philosophiques, élevées dans la discipline kantienne et les normes épistémo-éthiques mondialement partagées de la quête de la Vérité (objectivité, impartialité, universalité, pertinence et responsabilité), qui sont transversales à toutes les régions épistémologiques (sciences formelles ou hypothético-déductives, sciences naturelles ou expérimentales, sciences humaines ou sociales, sciences cognitives ou neurosciences et nanosciences, etc.) éprouvent du mal à assumer pratiquement les ardeurs de la critique d’autrui. Lorsque ces sommités se retrouvent dans la posture de Maître à penser, de Mandarin, avec une notoriété assise sur des travaux historiquement réalisés et des générations d’étudiants devenus eux-mêmes des enseignants-chercheurs, cadres dans l’administration publique ou les entreprises privées de renommée mondiale, elles en viennent à perdre l’esprit scientifique marqué par l’humilité, la modestie, l’acceptation de la critique et la prise en compte des critiques reçues, alors qu’elles professent ces vertus épistémo-éthiques dans leurs enseignements. Ils se réservent tous les droits et traitent souvent autrui (le disciple ou même leurs pairs) comme des moins que rien, c’est-à-dire précisément privés de droit ou de dignité, instituant ainsi un droit asymétrique.
Parmi les vices anthropologiques, l’orgueil et l’égoïsme poussent le soi à ne pas considérer l’autre comme son égal, ni soi-même comme un autre, pour reprendre la célèbre expression de Paul Ricœur. Alors, la disjonction entre le signe et le sens s’installe durablement dans les esprits et pratiques universitaires, comme nouveau protocole parascientifique, non déclaré, ni énoncé, mais qui structure les esprits et pratiques tant individuelles qu’institutionnelles, sous la forme de l’impensé du discours, hypothèse centrale de notre réflexion.
Cette situation que l’on observe au niveau des institutions universitaires, chargées par le contribuable de produire les technosciences vraies, d’en assurer la transmission par l’enseignement et d’éclairer la communauté humaine élargie par la consultance multiforme, on peut aussi l’observer au niveau de l’institution judiciaire, notamment celle des États africains postcoloniaux, où l’éthique et la compétence technique sont disjonctées dans la personne du Magistrat moderne, contrairement à celle du Juge coutumier, où elles sont conjonctées, ainsi que le relève J. G. Bidima (2003, pp. 83 ; 85), qui s’en est aperçu et qui souligne, dans la gouvernance quotidienne moderne, la multiplication improductive des lois et règlements pour les mêmes objets, et leur accumulation au fil du temps, dans les termes suivants :
La focalisation sur les procédures a cette fâcheuse habitude de faire croire que le problème du droit est bureaucratique ; elle néglige ainsi les acteurs du droit… Notre proposition est que le droit n’existe en Afrique que dans la tension entre l’ancien et le nouveau et entre l’imposition et la négociation. La question qui est en jeu est celle de la possibilité de penser l’’’entre-deux réalités’’.
Bidima amplifie et commente ce constat à la page suivante de l’ouvrage précité (2003, p. 85) :
Le juge dans le procès traditionnel mettait en jeu son ethos[16], ce qui n’est pas le cas avec les États postcoloniaux… Les droits traditionnels produisent à ce niveau une efficacité que n’a plus le droit actuel. Le juge, dans son rapport à la diction de la loi semble ne s’en tenir le plus souvent qu’à la technique, sans s’impliquer dans ‘’dire de la loi’’… C’est le problème de la qualification juridique des faits...
En réalité, la possibilité de penser l’« entre-deux réalités », à laquelle Bidima appelle de tous ses vœux, existe déjà dans le code épistémo-éthique Otwere, qui tient fermement unies la compétence technique et la moralité, comme paradigme de leadership devant impulser et propulser le management des affaires d’intérêt général. Bidima ne s’en est pas aperçu à cause de la méthode qu’il utilise pour construire son livre : il ne part pas de la comparaison généralisante des études de cas précis de certains codes épistémo-éthiques d’Afrique (Nord, Ouest, Est, Centre et Sud), pour en dégager une idée générale, mais il sous-entend une telle idée et évoque la situation au niveau africain, sans fondement anthropo-sociologique avéré. Méthodologiquement, cela ne relève ni de l’induction, ni de la déduction, ni même de l’abduction, mais d’une espèce de généralisation sans fondement méthodologique se traduisant par des propos assez vague, malgré leur apparence esthétique[17].
A tous ces égards, l’explication anthropologique fournie par F. Fukuyama nous semble mieux dévoiler l’impensé du discours par lequel l’esprit scientifique déserte les milieux universitaires au profit de l’esprit parascientifique, à travers la difficile pratique du postulat de l’essence critique de la philosophie, telle qu’on peut l’observer dans la relation pédagogique entre le Maître et le disciple, au sein de la communauté philosophante et dans certains jurys de délibération de soutenance de thèses, mécanismes institués d’émergence et de reconnaissance philosophiques.
Pour en présenter l’épreuve et en faire la preuve épistémologiques, nous allons à présent voir brièvement comment ces indicateurs théoriques fonctionnent chez T. S. Kuhn, où ils règlementent l’émergence (se signalant par la structure de la révolution scientifique en chantier) et la reconnaissance (consécration par les pairs et prise en compte de la nouvelle approche discursive dans les débats philosophiques et dans les Références bibliographiques engagés à cet effet), avant de pouvoir en tirer l’essentiel des conséquences épistémo-éthiques prospectives.
L’ouvrage par lequel T. S. Kuhn est entré dans l’Histoire, La structure des révolutions scientifiques, peut permettre d’illustrer ce passage de l’émergence à la reconnaissance philosophique, que nous pouvons caractériser en quatre étapes dynamiques et complémentaires : la science normale (1), la crise scientifique (2), la révolution scientifique (3) et l’impact/influence de cette révolution scientifique sur la communauté (4). Etant donné que la transition ou le passage de l’émergence à la reconnaissance est organisé par la « science normale », voici ce que Kuhn (1972, p. 39) en dit :
Pour voir comment cela est possible, il nous faut réaliser combien un paradigme peut être limité, tant en envergure qu’en précision au moment de sa première apparition. Les paradigmes gagnent leur droit à l’existence parce qu’ils réussissent mieux que leurs concurrents à résoudre quelques problèmes que le groupe de spécialistes est arrivé à considérer comme primordiaux…
Dans la présente quête, nous utilisons l’approche kuhnienne uniquement comme instrument théorique et historique nous permettant, d’une part, d’illustrer la difficulté anthropologique de pratiquer soi-même le postulat de l’essence critique de la philosophie que l’on enseigne aux autres, et d’autre part, de penser le passage de l’émergence à la reconnaissance philosophiques, sans entrer dans le détail de la discussion qu’elle suscite, et au sujet de laquelle, il existe bien des travaux. Parmi ceux-ci, nous épinglons l’article de Robert Nadeau (1994, pp. 159-189.), « La philosophie des sciences après Kuhn ». La conclusion de cet article est très percutante quant à la réserve problématologique que nous émettons sur les travaux interrogateurs à l’égard de l’approche kuhnienne de la philosophie des sciences, dont nous ne soulignons ici que la valeur pédagogique et heuristique illustrative. Toutefois, comme toute production philosophique, sa pensée redonne à penser à la postérité.L’entreprise intellectuelle à laquelle Thomas Samuel Kuhn se livre dans La structure des révolutions scientifiques consiste à montrer que le processus de développement de la connaissance scientifique n’est pas cumulatif, mais discontinuiste.
Les transformations profondes que subit la connaissance scientifique, résultats de processus longs et complexes, Kuhn les appelle « révolutions scientifiques », dont la base d’effectuation est la découverte d’un puzzle ou d’une anomalie qui, à un moment donné de l’histoire de la discipline considérée, met fondamentalement en échec la science normale, considérée comme le modèle de rigueur, s’architecturant autour d’un paradigme, un référentiel théorique, qui propose un dispositif scientifique normalisé (concepts, principes, postulats, méthodes, théorèmes), efficace, mais borné et comportant des biais socioéconomiques.
Quand les prédictions de la science normale s’avèrent de plus en plus fausses, le doute s’installe à son sujet. Le paradigme en place dévoile ses limites et entre en état de crise, favorisant ainsi l’émergence de nouvelles théories, qui candidatent au titre de « nouveau paradigme », pour remplacer celui qui est en défaut. Alors, les idées scientifiques se livrent un combat cruel sur les plans scientifique et social : portées par des chercheurs émergeants (jeunes ou vieux), elles s’opposent à celles défendues par des chercheurs âgés, et tentent de s’imposer, pour relancer un processus scientifique normal. Afin de choisir entre ces néo-théories émergeantes, concurrentes et complexes, la communauté scientifique est embarrassée, du fait qu’alors, les critères strictement logiques ne suffisent plus pour arracher l’assentiment des scientifiques concernés par la crise du paradigme régnant.
Cet embarras est renforcé par la difficulté de porter des jugements rationnels en dehors du cadre de la science normale, d’une part, et celle de la communication entre des proto-langages scientifiques en gestation, incommensurables entre eux, par essence, d’autre part. La résolution d’une crise n’interviendra que si l’un des groupes en présence réussit à convaincre et convertir tous les autres chercheurs au paradigme qu’il défend et qui deviendra progressivement réunificateur, rassembleur et consensuel : c’est la dernière phase de la révolution scientifique, marquée par l’adoption du dispositif technique (outils, méthodes, objectifs, biais) du paradigme triomphant par la majorité des membres réputés de la communauté de scientifiques.
Plusieurs raisons peuvent expliquer le triomphe d’un paradigme sur les autres : échec des prédictions proposées par l’ancien paradigme, et réussite du nouveau, critère du rasoir d’Ockham, découverte des faits nouveaux venant trancher performativement le débat jusque-là enlisé, etc. Ces transformations bouleversent la vision du monde de chaque scientifique qui s’inscrit, alors, dans le nouveau cadre d’observation des phénomènes, remet en cause l’expertise acquise, les réseaux et méthodes en place, ainsi que la légitimité et la notoriété personnelles au sein de la communauté scientifique. Il en résulte que les « rescapés » du paradigme déconstruit perdent rapidement leur autorité scientifique.
Cette approche kuhnienne de l’histoire des sciences a suscité des critiques de deux principaux ordres : d’une part, la thèse que le contenu de la science normale résulterait d’un consensus au sein de la communauté scientifique, non nécessairement fondé sur des critères objectifs, ce qui conduira I. Lakatos et d’autres auteurs à suspecter Kuhn de relativisme épistémologique, et d’autre part, la réalité que l’histoire des sciences de la nature, ainsi que celle des sciences sociales, montre plutôt comment et combien plusieurs paradigmes concurrents peuvent cohabiter sur une longue période, sans que l’un d’eux s’impose comme science normale isolée.
À notre avis, le premier niveau de ces critiques dénote clairement de l’ambiance chaotique et parascientifique qui règne souvent dans les unités de recherches universitaires, les relations professionnelles entre enseignants-chercheurs et les rapports pédagogiques entre Directeurs de thèses et thésards, et aussi bien souvent entre membres de jurys de soutenance de thèses, tandis que le deuxième niveau des critiques adressées à Kuhn relève la possibilité de développer une certaine tolérance épistémo-éthique en milieux universitaires.
Par-delà l’illustration historique, pédagogique et heuristique de la difficulté de pratiquer réellement et sainement le postulat de l’essence critique de la philosophie, que nous venons de faire de l’approche kuhnienne de l’histoire des sciences, en complément de l’échange orageux entre Wittgenstein et Popper, il faille à présent voir quelles leçons épistémo-éthiques prospectives nous pouvons en tirer, afin de contribuer performativement à apaiser et réconcilier les rapports souvent orageux tels qu’observés dans les institutions universitaires entre différents acteurs, et ainsi assainir les milieux, pour propulser la qualité des résultats attendus par le contribuable qui finance la recherche et, comme dirait E. Kant (1987, p. 632) :
Pour le maintien [de] l’ordre, la concorde générale, et même le bon état de la république scientifique, et qui empêche des travaux hardis et féconds de se détourner de la fin capitale, le bonheur universel.
Ainsi, la pratique du postulat de l’essence critique de la philosophie, instance d’émergence philosophique de nouveaux acteurs, a un impact direct sur la reconnaissance de ceux-ci par les membres institués de la communauté philosophique internationale.
3. Pour réconcilier postulat et pratique critiques de la philosophie
Le descriptif réalisé au point 2 de l’analyse montre que les acteurs impliqués dans la recherche universitaire de la Vérité (philosophes et scientifiques de toutes disciplines) cherchent un noumène (le postulat de l’essence critique de la philosophie), mais dont ils ne se donnent ni la conscience claire, ni les moyens, ni la responsabilité pour le phénoménaliser. Cette troisième partie se propose d’indiquer quelques pistes de contenu d’un consensus rationnel en philosophie, qui était déjà le projet leibnizien, dans le sens la réconciliation des points 1 et 2 de la présente réflexion.
Sans relancer la piste leibnizienne de l’entente universelle par le calcul rationnel, nous allons travailler ici à construire pratiquement la même possibilité, en combinant dialogiquement et prospectivement les deux ordres de critiques faites à Kuhn dans une même geste pensante, comme tentative de réponse à la question : Comment un consensus en philosophie serait-il possible sur la base de critères objectifs ?
L’on sait que, concernant la Science, objet de l’épistémologie, une définition et une méthodologie universalistes, tenant transversalement compte de toutes les régions épistémologiques, n’est pas encore possibilisée, alors qu’il l’aurait déjà fallu. A cet égard, la plupart des auteurs qui ont tenté de dégager une idée générale et complexe de la Science sont tombés dans le réductionnisme méthodologique ou disciplinaire, en voulant définir la Science en général à partir des axes de leurs disciplines d’attache, par généralisation, en l’appauvrissant de la richesse ainsi manquée des autres disciplines non prises en compte.
Ainsi, G. Bachelard (2005, p. 5) laisse échapper le propos suivant :
La science, somme de preuves et d’expériences, somme de règles et de lois, somme d’évidences et de faits, a donc besoin d’une philosophie à double pôle. Plus exactement, elle a besoin d’un développement dialectique, car chaque notion s’éclaire d’une manière complémentaire à deux points de vue philosophiques différents.
L’on voit clairement que Bachelard définit la Science en général à partir des marqueurs de ses sciences physico-chimiques d’origine, par l’exclusion des sciences formelles, sociales, etc.
Dans ces conditions, la philosophie s’en sortirait-elle sans imitation ? Comment, par exemple, les jurys de thèses pourraient-ils délibérer et évaluer objectivement et justement les thèses soumises à leur auguste appréciation ? Comment éviter de servir à l’assistance les scènes indigestes courantes où soit la prestation de l’impétrant est visiblement insignifiante, mais la mention « Très Honorable » que le Jury lui décerne souverainement, après concertation, semble disproportionnée, soit la mention attribuée par le Jury sous-évalue visiblement la prestation de l’impétrant, ce qui installe le doute dans l’opinion de l’assistance, bien que son avis ne compte pas, certes ? Comment harmoniser l’objectivité aussi bien dans l’enseignement que dans la docimologie ?
Depuis précisément M. Weber (1917 ; 1959), l’objectivité se définit au moyen de son principe de neutralité axiologique comme l’effort épistémo-éthique que le quêteur du Sens doit fournir pour prendre et considérer l’objet du discours toujours en lui-même, tel qu’il se donne à voir, et non jamais tel qu’il veut qu’il soit, sous le prisme des valeurs culturelles dont l’universalité n’est pas prouvée. Dans l’histoire de la philosophie des sciences, la tendance la plus courante est de disjoindre l’épistémique (le savoir) de l’éthique (la morale transcendée), aussi bien aux niveaux théorique (la conquête de la science et la réflexion axiologique ne font pas de pair) que pratique (le modèle de philosophe socratique ou sartrien ne court plus les rues. Au regard de ce parallélisme, le concept d’épistémo-éthique, que nous suggérons, est un appel à la dialogique de l’épistémique et de l’éthique, contre la dichotomique entre faits et valeurs érigée par les auteurs analytiques classiques comme paradigme de pensée et qui, en pratique, se traduit par la formation d’esprits capables d’assumer et vivre les exigences de leurs pensée avec constance. L’épistémo-éthique est, donc, la pratique dialogique et transversale de l’éthique fondée sur l’épistémique dégagée de l’évaluation prospective de la tradition au moyen de l’herméneutique prospectiviste. Le concept d’épistémo-éthique, ainsi élaboré, à partir du cas significatif de l’Afrique, peut s’appliquer à tout patrimoine culturel mondial, où le lien entre tradition, modernité et postmodernité est en jeu. Ainsi envisagée, l’objectivité est le fondement du consensus rationnel entre acteurs épistémiques relevant de disciplines et régions épistémologiques différentes. En tant que doctrine, elle est professée, mais en tant qu’état d’esprit partagé et pratique professionnelle, elle ne court pas les allées des amphis.
Hegel a prescrit à la postérité pensante que, « philosopher, c’est penser la vie ». Or, notre vie aujourd’hui, c’est la technoscience qui la structure ; d’où, tous les questionnements actuels de posthumanisme et de transhumanisme. Depuis longtemps déjà, la philosophie est invitée à se débarrasser de son orgueil historique, pour se résoudre et s’installer dans une posture modeste face à la Science, dans un rapport disproportionné où elle cesse d’être productrice de savoir, pour en devenir un simple consommateur morose et sans ambitions.
Dans cet élan, B. Russell (2002, pp. 277 ; 280) invite la philosophie à faire l’expérience de la méthode scientifique, qui a fait ses preuves dans l’élaboration de la technoscience, dont l’Humanité vit aujourd’hui, pour ainsi gagner en rigueur :
Pour devenir un philosophe pratiquant la philosophie comme une science, il faut une certaine discipline particulière de l’esprit. Il faut que soit présent, avant tout, le désir de connaitre la vérité philosophique, et ce désir doit être suffisamment puissant pour survivre des années durant, quand ne surgit aucun espoir d’y donner satisfaction […].
En même temps, et comme un auxiliaire essentiel à la perception directe de la vérité, il faut acquérir une imagination fertile en hypothèses abstraites. C’est, je pense, ce qui a le plus manqué en philosophie. L’appareil logique était si maigre que toutes les hypothèses que pouvant imaginer les philosophes se trouvaient incompatibles avec les faits.
Malgré le réductionnisme méthodologique que nous avons vu à l’œuvre chez Gaston Bachelard, comment la philosophie pourrait-elle importer, pratiquer et capitaliser la « méthode scientifique », alors que celle-ci n’est énoncée nulle part, comme nous y invite L. Wittgenstein (1991, 6.53) :
La juste méthode de philosophie serait en somme la suivante : ne rien dire sinon ce qui se peut dire, donc les propositions des sciences de la nature – donc quelque chose qui n’a rien à voir avec la philosophie – et puis à chaque fois qu’un autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer qu’il n’a pas donné de signification à certains signes dans ses propositions. Cette méthode ne serait pas satisfaisante pour l’autre – il n’aurait pas le sentiment que nous enseignons de la philosophie – mais elle serait la seule rigoureusement juste ?
Reconfigurant la philosophie de la doctrine en une méthode, Wittgenstein demande à celle-là d’abandonner l’ineffable (le noumène) et la métaphysique, qui prétend le penser, pour se reconvertir, soit en épistémologie (des sciences naturelles), soit en méthodologie des sciences formelles. Clarifier les propositions des sciences de la nature et procéder à l’analyse logique du langage, qui sera l’objet principiel du discours du positivisme logique, exalté par le Cercle de Vienne, voilà les nouvelles tâches que Wittgenstein confie et confère à la philosophie, si elle veut devenir rigoureuse, en échos au projet de philosophie de la rigueur que l’on voit poindre de Frege à Wittgenstein, en passant par Husserl, qui en aura énoncé le concept : La philosophie comme science rigoureuse[18].
Dans le passage wittgensteinien cité, qui marque aussi la transition du protocole de la philosophie continentale pour celui de la philosophie analytique, la clarté est une exigence formelle du discours très attendue, telle qu’elle structure l’objectivité et facilite l’intercompréhension entre le locuteur et l’interlocuteur. Car, c’est partagé que le savoir devient universel, science : fondé et projeté dans la critique.
L’autre appel à la modestie philosophique vient, non pas d’un auteur individuel, mais de l’esprit du Temps porté par la science sur l’humain, et au sujet du projet de perfectibilité humaine, oscillant entre l’imbécilité (Rousseau) et la perfection de la condition humaine par la technoscience (l’amélioration humaine : H+). Ces questionnements sont au cœur du transhumanisme et du posthumanisme qui appellent, non seulement à la redéfinition de l’humanisme, mais surtout à la reconfiguration de l’épistémologie, à partir du moment où la nature en et autour de l’homme n’est plus durablement naturelle, mais le produit de la technoscience, qui met désormais l’homme en cohabitation avec ses produits (cyborgs, robots, téléphones, ordinateurs…).
Aristote avait pensé la Terre et le Ciel comme deux systèmes cosmiques différents obéissant aussi à des lois différentes : le changement, pour le premier, et l’immobilité, pour le second, en présupposant que l’immobilité était l’état naturel des objets. En face, Issac Newton, sur la base de la méthode expérimentale élaborée par Galilée, tenta une première synthèse des deux systèmes. D’une part, il examina de plus près l’idée galiléenne selon laquelle les corps tombent tous à la même vitesse et que la résistance de l’air agit sur les objets mobiles, et d’autre part, il observa que les objets ont tendance à se maintenir, soit au repos, soit en mouvement, et que des objets différents présentent un degré variable de force d’inertie, dans le sens où la masse d’un objet représente sa quantité d’inertie. De ces observations, il tira trois lois du mouvement (inertie, accélération et mouvement) qui permettent d’expliquer à peu près tous les mouvements et toutes les forces terrestres. Il conclut que le Ciel et la Terre font partie du même univers, à travers l’énoncé même de sa loi de la gravitation universelle (Asimov, 1985, pp. 69-77).
Sur la base de ces acquis de l’histoire des sciences, et en tenant compte des progrès en cours de la technoscience, l’on peut constater que l’homme n’est plus naturel, au sens où la nature (végétale, animale et minérale) n’est plus l’objet exclusif du discours scientifique. Dans ces conditions théoriques, la technoscience structurant désormais l’ensemble de la vie « humaine » individuelle, collective et institutionnelle, « penser la vie » revient, d’une part, à assurer la promotion de l’amélioration de la condition humaine à travers des technologies diverses de perfectionnement de la vie humaine sur terre, avec pour but, l’élimination du vieillissement et l’augmentation des capacités tant intellectuelles, physiques que psychologiques de l’homme, et d’autre part, à étudier prospectivement les bénéfices et dangers, l’éthique du développement et de la mise en œuvre de ces technologies sur la condition humaine et son environnement de vie, qu’il partage désormais avec les produits de la technoscience. Pour cela, l’objectivité est la principale attitude raisonnable devant permettre au Je et au Tu de faire l’expérience du même Monde.
Ce nouveau contexte existentiel, bouleversant à tous égards, appelle le penseur à tout redéfinir : l’homme, la nature, la société, la politique, l’amitié (chacun est plus proche, par exemple, de son téléphone et de son ordinateur que de son voisin humain), l’amour, l’épistémologie, etc. Dans ces conditions, l’alliance entre la critique et l’autocritique peut utilement assurer la veille contre l’incertain sans visage.
Conclusion
Quelle que soit la tradition philosophique dans laquelle on s’installe (continentale, analytique ou autre), la critique, essence de la philosophie dans sa quête séculaire de la Vérité, occupe une place stratégique sur l’itinéraire intellectuel devant conduire l’apprenti-philosophe de l’émergence à sa reconnaissance par la communauté des chercheurs attitrés. Pour cela, la soutenance de thèse reste le rite de passage consacrant le nouvel acteur-philosophe, à défaut de la publication d’un ouvrage révolutionnaire. Dans un cas comme dans l’autre, le postulat de l’essence critique de la philosophie se pratique difficilement, notamment, dans la relation professionnelle ou intersubjective, alors qu’elle demeure engagée pour sauvegarder l’objectivité des évaluations, dans le sens d’un consensus philosophique minimal, qui donne un sens à l’universalité appliquée à la philosophie. Sous ce rapport, le triple appel à la modestie philosophique examiné dans cette réflexion (Russell, Wittgenstein et l’esprit du Temps) est au fond un appel à l’objectivité, en tant que celle-ci est la seule attitude épistémo-éthique indispensable devant permettre à la communauté des quêteurs du Sens (philosophes et scientifiques), par-delà la communauté humaine élargie (bailleur de fonds de la recherche), de faire face en toute responsabilité aux menaces et défis que l’humanité a créés, mais qu’elle doit aussi relever : au bénéfice ou au péril de sa survie.
C’est l’objectivité ainsi entendue qui devrait être la base de l’entente rationnelle entre les humains sur des préoccupations partagées comme la survie multiforme de l’humanité, et dans la reconnaissance réciproque des valeurs de dignité émergentes tant du soi que d’autrui, fondement et finalité de l’éthique. Cette objectivité, l’Université, qui a la triple mission de renouveler les élites par l’enseignement, de procéder à la recherche permanente et multiforme de la Vérité et d’assurer le service à la communauté par la consultance, devrait pouvoir la préserver, la vivifier et la perpétuer dans la geste académique et pédagogique, par la valorisation de la critique et de l’autocritique saines et performatives.
Ainsi, se situant au niveau des enjeux inter-civilisationnels mondiaux, l’épistémo-éthique, articulant dialogiquement l’épistémique avec l’éthique, peut être la garantie tant recherchée de l’objectivité, en ce qu’elle fonde tolérance, sériosité et responsabilité. Pendant que nous positionnons et assurons la promotion de l’épistémo-éthique, nous sommes conscients de l’existence connexe de l’éthique du care, autour de laquelle une littérature scientifique est en train de se densifier. Ainsi, l’éthique du care existe pour les sociétés froides, occidentales, où la solidarité est une conquête sociologique, dans la mesure où elle n’est pas naturelle. Elle est une réflexion compassionnelle dont le but est la reformulation des politiques sociales, en vue de plus d’égalité entre les différentes couches sociales. Son territoire est limité. En face, l’épistémo-éthique concerne les enjeux civilisationnels saisis synchroniquement et diachroniquement, tels qu’ils engagent les relations internationales aujourd’hui. Logiquement, en compréhension comme en extension, le territoire de l’épistémo-éthique étant plus large que celui de l’éthique du care, celle-ci ne peut pas invoquer celle-là comme argument dans une construction partant du local pour l’Universel, et concernant l’ensemble de la condition humaine.
Références bibliographiques
AKAKPO Yaovi, 2012, La recherche en philosophie. De l’intuition du thème à la soutenance de la thèse, Paris, L’Harmattan.
AUBENQUE Pierre, 2009, Faut-il déconstruire la métaphysique ?, Paris, PUF.
BACHELARD Gaston, 1983, La formation de l’esprit scientifique, Paris, VRIN.
BIDIMA Jean Godefroy, 2003, « Rationalités et procédures juridiques en Afrique », in Diogène, 2003/2, n°202.
DESCARTES René, 2000, Discours de la méthode, présentation et dossier par Laurence Renault, Paris, GF Flammarion.
FUKUYAMA Francis, 1992, La fin de l’Histoire et le dernier homme, traduction de l’Anglais par Denis-Armand Canal, Paris, Flammarion.
KANT Emmanuel, 1987, Critique de la raison pure, traduction française par Jules Barni, Paris, Garnier Flammarion.
KUHN Samuel Thomas, 1972, La structure des révolutions scientifiques, traduction française de Laure Meyer, Paris, Flammarion, Collection Champs.
MOLINARIO Jean, 2013, « Le posthumanisme entre humanité élargie et fin de l’humanisme », in 580-Troubles dans la définition de l’humain_553 28/11/13.
Nadeau R., « La philosophie des sciences après Kuhn », in Philosophiques, n°211 (1994), pp. 159-189.
NGALEBAYE Didier, 2016, Le projet de philosophie de la rigueur, I, Paris, Publibook.
PATRY Michel, 1975, « La fonction critique de l’Université », in Philosophiques, vol. 2, n°1.
POPPER Karl Raimund, 1981, La quête inachevée, traduit de l’Anglais par Renée Bouveresse, avec la collaboration de Michelle Boulin-Naudin, Avant-propos de Christian Schmidt, Paris, Calmann-Lévy.
OBENGA Théophile, 1990, La philosophie africaine de la période pharaonique, Paris, L’Harmattan.
OBENGA Théophile, 2017, L’Égypte, la Grèce et l’école d’Alexandrie. Histoire interculturelle dans l’Antiquité. Aux sources égyptiennes de la philosophie grecque, Paris, L’Harmattan.
RUSSELL Bertrand, 2002, La méthode scientifique en philosophie, traduit de l’Anglais par Philippe Devaux, Paris, Payot.
Weber Max, Le savant et le politique (1917 ; 1919), Préface de Raymond Aron et traduction par Julien Freund, Plon, 1959, nouvelle traduction par Catherine Collio-Thelène.
WITTGENSTEIN Ludwig, 1990, Tractatus logico-philosophicus, suivi de Investigations philosophiques, traduction de l’allemand par Pierre Klossowski, introduit par Bertrand Russell, Paris, Gallimard.
L’ÉMERGENCE POLITIQUE PAR LA SORTIE DE LA MINORITÉ JURIDIQUE
Éric Inespéré KOFFI
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
k_inespere@yahoo.fr
Résumé :
Le succès de l’ambition légitime des États de l’Afrique d’émerger sur la scène politique internationale est tributaire d’une reconnaissance de leur propre responsabilité juridique dans leur sous-développement économique et leur domination politique. Notre problème est alors le suivant: comment ces États peuvent-ils sortir de leur minorité juridique pour être de vraies démocraties ? A partir d’une méthode analytique, comparative et critique, notre thèse sera que l’injonction kantienne, « sapere aude », s’adresse encore aux États de l’Afrique pour qu’ils s’engagent résolument dans la voie sûre de la démocratie par la majorité juridique nécessaire à leur émergence politique. Aussi montrerons-nous les signes de leur minorité juridique actuelle (I) afin d’indiquer comment en sortir pour émerger politiquement (II).
Mots-clés : Démocratie, État de droit, Émergence politique, États africains, Justice, Liberté politique, Minorité juridique, Majorité juridique.
Abstract :
The success of the legitimate ambition of the States of Africa to emerge on the international political scene is dependent on a recognition of their own legal responsibility in their economic under development and their political domination. So the problem is: how states can they get out of their legal minority to be real democracy? From an analytical, comparative and critical method, our thesis will be that the Kantian injunction “sapere aude”, is intended again for the States of Africa so that they could resolutely commit to the safe way of democracy necessary for their public policy. Also we show the signs of their legal current minority (I) in order to indicate how to get out to emerge politically (II).
Keywords: African States, Democracy, Legal majority, Legal minority, Political emergence, Political liberty, Rule of law, Separation of power.
Introduction
Les États de l’Afrique sont en quête d’une émergence légitime sur la scène internationale pour devenir des États développés. Or il va de soi aujourd’hui que le développement économique et social est tributaire d’une organisation politique moderne fondée sur la démocratie. En ce sens, la Charte africaine pour la démocratie adoptée par une majorité d’États membres de l’Union africaine à Addis-Abeba le 30 janvier 2007 avait pour objectif, entre autres, de « promouvoir l’adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l’homme ».
Pourtant, si le mot d’ordre de la démocratie semble s’être imposé dans les esprits, l’insuffisance de ses conditions juridiques de réalisation laisse voir les difficultés de sa mise en œuvre. Dans ce sens, il est observable que l’exercice du pouvoir dans les États d’Afrique révèle, depuis leurs indépendances, le développement d’une démocratisation ambiguë dans laquelle les rapports politiques et sociaux sont marqués par une culture de l’intérêt particulier de la classe dirigeante qui résiste aux principes démocratiques universels et subordonne encore les procédures juridiques à un pouvoir personnalisé et paternaliste. C’est le lieu de dire avec Kant que ces États ont un usage défaillant de la raison juridique qui les maintient dans la minorité juridique. En ce sens, la minorité juridique n’est pas seulement le refus de se servir soi-même de son entendement relativement au droit et à la politique, mais aussi le refus de s’en servir objectivement, pour l’intérêt national.
Dès lors, comment ces États peuvent-ils sortir de leur minorité juridique pour être de vraies démocraties ? En quoi consistent concrètement la minorité et la majorité juridiques ? Comment réussir le passage de l’une à l’autre ? À partir d’une méthode analytique, comparative et critique, nous soutiendrons la thèse selon laquelle l’injonction kantienne, « sapere aude »[19] (1997, p. 41), s’adresse encore aux États de l’Afrique pour qu’ils s’engagent résolument dans la voie sûre de la démocratie par la majorité juridique nécessaire à leur émergence politique. Aussi montrerons-nous les signes de leur minorité juridique actuelle (I) afin d’indiquer comment en sortir pour émerger politiquement (II).
1. LA MINORITÉ JURIDIQUE ET POLITIQUE DES ÉTATS AFRICAINS
La minorité juridique et politique est une incapacité à gouverner en vue de l’intérêt public. Elle reflète une mentalité subjective qui est la cause des difficultés qu’ont les États africains à respecter les déterminants de la démocratie que sont l’État de droit et la séparation des pouvoirs.
1.1. Le non-respect des principes de l’État de droit dans les États africains
Depuis les Modernes, l’État de droit rime avec républicanisme ou démocratie. Comme tel, il désigne un État qui reconnaît et protège les droits de ses citoyens. Ce sens se justifie chez Kant par les acceptions des deux termes principaux qui composent l’expression ˝État de droit˝. En effet, l’État, « par considération de sa forme, en tant qu’il a pour lien l’intérêt commun de tous à être dans l’état juridique, est désigné comme la chose publique (res publica) » (E. Kant, 1994, p. 125). En d’autres termes, l’État-République, rassemble une multitude d’hommes vivant sur le même territoire pour réguler leurs rapports et leur permettre de constituer un peuple, une nation. Il est donc un bien commun en ce qu’il assure la coexistence harmonieuse de ses citoyens par le droit entendu comme « l’ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles l’arbitre de l’un peut être concilié avec l’arbitre de l’autre selon une loi universelle de la liberté » (Kant, 1994, p. 17). Le droit permet ainsi à l’État d’assurer à chaque citoyen le respect du sien par autrui. Mieux, l’État lui-même est assujetti à l’obligation du respect du mien et du tien constitutifs des droits des citoyens[20]. En reconnaissant que les hommes ont des droits naturels et civils, les Modernes assignent à l’État le devoir de les respecter et les protéger contre toute violation. L’État de droit est donc l’État qui se fait l’obligation absolue de respecter et de faire respecter les droits fondamentaux de ses citoyens en tout lieu et en tout temps[21] parce qu’il les reconnaît comme détenteurs de la souveraineté dont il jouit. En somme, un État de droit est respectueux des droits de l’homme. Or les États africains, qui se réclament tous comme des démocraties, des Républiques, ont du mal à respecter et à faire respecter ces droits. Pour nous en convaincre, examinons le rapport de ces États aux deux grands ensembles de ces droits : les naturels et les civiques.
Les droits naturels sont constitutifs de l’autonomie privée des individus. Ce sont la dignité de la personne humaine, la liberté individuelle et le respect de la vie privée. Kant explique en ce sens que « la liberté, (…) dans la mesure où elle peut coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle, est cet unique droit originaire qui appartient à tout homme en vertu de son humanité » (1994, p. 26). La liberté est donc le droit naturel incontestable qui confère à l’homme la dignité et l’inviolabilité de la vie privée. En conséquence, la fin de l’État de droit est d’assurer le respect de la liberté civile de tous ses citoyens comme le stipule le XIVe Amendement de la Constitution des États-Unis.
Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est un citoyen des États-Unis et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; ni ne refusera à quiconque relève de sa juridiction l’égale protection des lois.
Mais les États africains donnent le triste spectacle historique et actuel de la violation par eux-mêmes des libertés individuelles et collectives de leurs citoyens à travers l’existence de lois civiles discriminatoires qui sont les produits de la minorité juridique. Par suite, la dignité de leurs populations est bafouée[22] à l’occasion des multiples conflits ethniques et socio-politiques consécutifs aux luttes sociales pour la conquête des libertés. Les femmes sont violées impunément, les enfants sont enrôlés dans les armées, les hommes sont torturés et amputés de leurs membres. Les États empêtrés dans les crises violentes et à répétition sont incapables d’assurer la liberté et la dignité de leurs citoyens. Au nom de la raison d’État, les forces de l’ordre font irruption dans les domiciles et les lieux de travail pour des raisons politiques, violant ainsi la vie privée. L’État lui-même devient responsable du non-respect des droits naturels.
Les droits civils et civiques sont en revanche constitutifs de l’autonomie politique des citoyens dans l’État de droit. Il s’agit de la liberté d’association, la liberté d’expression, la liberté d’opinion, le droit de manifester et le droit de vote. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple qui dispose de moyens pour contrôler et sanctionner les gouvernants. Kant souligne à cet effet que « seule la capacité de voter définit la qualification qui fait le citoyen » (1994, p. 129). Les citoyens sont donc dans l’exercice de leurs droits civiques lorsqu’ils s’associent en partis politiques, quand ils expriment leurs opinions sur la gouvernance et manifestent publiquement leur désaccord avec certaines options politiques et économiques de leurs gouvernements. L’État de droit crée donc les conditions pour que ces droits soient effectifs à travers « la liberté, l’égalité, et l’indépendance civile » (Kant, 1994, p. 129). Mais dans les États africains, les citoyens sont victimes d’élections mal organisées qui entrainent la suspicion, les contestations et les conflits post-électoraux. Comme le souligne le juriste ivoirien Meledje Djedjero, en Afrique, « l’élection n’est plus un facteur de cohésion sociale ; bien plus, elle est source de conflit » (2009, p. 139-155). Les manifestations politiques sont plus interdites et brimées qu’elles ne sont autorisées et encadrées. Les citoyens ordinaires et les leaders politiques font l’objet d’arrestations pour leurs opinions critiques. Tout se passe comme si la contradiction était un mal absolu à combattre au point qu’après le parti unique, le multipartisme à parti dominant est mieux partagé que le multipartisme équilibré. La publicité des opinions n’est donc pas totale. Autant de manifestations de la minorité juridique et politique qui font que les États africains font piètre figure en tant qu’États de droit.
En somme, en principe, l’individu, le citoyen est la fin première de la société et de l’État de droit qui se doit donc d’être démocratique c’est-à-dire d’être soucieux de la liberté individuelle et la justice. Mais les États africains ne sont pas encore des États de droit en raison de leur minorité juridique et politique, leur incapacité foncière à affirmer et à respecter les droits fondamentaux de leurs citoyens. L’autre déterminant de la démocratie, la séparation des pouvoirs, comporte également des insuffisances.
1.2. La séparation factice des pouvoirs dans les États africains
Avec Montesquieu, Rousseau et Kant, la séparation des pouvoirs apparaît comme le moyen de lutter contre l’abus du pouvoir par les gouvernants. Kant affirme en ce sens que « la constitution civile de chaque État doit être républicaine » (1958, p. 91) car elle implique nécessairement une séparation du pouvoir souverain de l’État en trois pouvoirs autonomes et complémentaires qui sont l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais la séparation des pouvoirs représente aujourd’hui un autre déterminant de la démocratie dont l’application fait problème dans les États africains car les pouvoirs n’y sont pas équilibrés : l’exécutif a un fort ascendant sur les autres. En effet, selon Aka Lamarche, « la séparation des pouvoirs, [adoptée sur le continent noir], est inapte à endiguer l’exercice d’un présidentialisme accru » (2013, p. 129). Ce présidentialisme qui se fait même paternaliste avec le titre de « Père de la nation », donne des pouvoirs excessifs au Président de la République qui domine le législatif et le judiciaire. Le chef de l’État possède ainsi une influence décisive sur la conduite de la politique nationale et est doté de prérogatives qu’il n’aurait pas obtenues dans le cadre d’un régime équilibré de séparation des pouvoirs. Il détient ainsi le droit de présenter des projets de lois, celui de s’octroyer des crédits additionnels et de passer outre le refus de l’Assemblée nationale. Un tel déséquilibre des pouvoirs est un signe de minorité juridique et politique.
Cette ascendance de l’exécutif sur le législatif pose le problème de la neutralisation de l’opposition parlementaire en tant que contre-pouvoir politique. Pour Pascal Jan (2008, p. 255), en principe, « la notion d’opposition parlementaire est très fortement liée à la théorie de la démocratie». Pourtant le pouvoir législatif est souvent confronté à deux obstacles en Afrique : l’opposition est empêchée d’y accéder et le parlement n’a pas assez de moyens légaux pour assurer sa fonction de contre-pouvoir.
En effet, si hier, des années 60 à 80, « l’opposition était perçue par les gouvernants comme une hérésie par rapport aux valeurs politiquement correctes du moment » (Mbodj El Hadj, 2000, p. 246), aujourd’hui, elle est toujours perçue comme un danger qu’il faille tenir éloignée du pouvoir politique. De la sorte, bien que l’article 3 de la Charte africaine de la Démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007[23] pose le renforcement du pluralisme politique par la reconnaissance de l’opposition politique comme un moyen de consolidation de la démocratie, dans la réalité, tout est fait pour que la majorité demeure majoritaire et la minorité, minoritaire.
Dans ce sens, le premier obstacle pour l’émergence d’une véritable opposition parlementaire sur le continent noir est l’absence de transparence lors des opérations électorales. Il faut noter que la « démocratie africaine » se distingue des autres par une persistante mascarade électorale, perpétrée par les gouvernants pour se maintenir au pouvoir. Dans cette perspective, des élections non-concurrentielles sont organisées avec pour objectif de réduire à une portion congrue les députés de l’opposition[24].
Par ailleurs, l’Organisation non gouvernementale allemande pour la promotion de la démocratie, Democracy Reporting International (DRI), observe qu’en Afrique, « les droits de l’opposition parlementaire se situent souvent dans le règlement intérieur du Parlement » (2013, p. 1). Ainsi, le second obstacle est que généralement, l’opposition politique n’a pas des droits constitutionnels. Or un règlement intérieur n’a pas la même force de loi qu’un article constitutionnel. L’opposition n’a donc pas assez de ressources juridiques pour assumer sa fonction de contre-pouvoir politique. Ce bâillonnement du parlement est un autre signe de minorité juridique et politique.
Dans ce bras de fer entre l’exécutif et le législatif, « à la séparation classique des pouvoirs, fondée sur la différenciation organique et fonctionnelle des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, se substitue, de nos jours, une séparation politique entre la majorité et l’opposition sous l’arbitrage du pouvoir judiciaire qui veille au respect des droits et libertés » (Mbodj El Hadj, 2000, p. 356). Cet arbitrage détourne le pouvoir judiciaire de sa fonction de contre-pouvoir juridique face à l’exécutif comme il a été conçu par les Modernes. En théorie, comme les contre-pouvoirs politiques, les contre-pouvoirs juridiques devraient permettre une atténuation de la toute-puissance présidentielle. Les contre-pouvoirs juridiques renvoient à l’ensemble des institutions disposant d’une autorité de la chose jugée. Il s’agit essentiellement du pouvoir judiciaire, mais aussi des instances constitutionnelles. Mais bien que les textes fondamentaux sur le continent noir en fassent un pouvoir constitutionnel à part entière, dans les faits, il se révèle être un appendice du pouvoir exécutif.
En fait, l’idée d’une justice contrebalançant le pouvoir politique n’est possible qu’avec la levée de nombreuses digues entre les deux pouvoirs. Mais l’existence des liens constitutionnels trop étroits entre la justice et le pouvoir politique en Afrique fait du pouvoir judiciaire un service public ordinaire, qui est à ce titre, soumis au pouvoir exécutif. Ceci relève proprement de la minorité juridique. D’abord, les responsables du pouvoir judiciaire sont nommés par l’exécutif[25]. Certes, le choix des juges par des instances politiques n’est pas une spécificité africaine. En revanche, l’Afrique se démarque par une absence de mécanismes permettant d’atténuer le risque d’une politisation des nominations.Les juges n’ont donc pas d’autonomie et ne peuvent être impartiaux dans leurs jugements.
Ensuite, l’accentuation des pesanteurs traditionnelles et culturelles de l’exercice du pouvoir en Afrique par les gouvernants s’accorde difficilement avec les exigences modernes d’autonomie et d’équilibre des pouvoirs de l’État. En effet, en postulant une limitation des pouvoirs, le constitutionnalisme tel qu’il s’applique en Europe n’a pas encore totalement droit de cité en Afrique. La recherche d’un pouvoir sans partage de l’exécutif ne peut admettre un contrôle par une autorité extérieure. Selon Jean-François Bayart, l’instrumentalisation de la tradition africaine par les hommes politiques fait prévaloir la suprématie du chef sur la délibération collective et ils ne peuvent admettre qu’une autorité non-élue, disposant d’une légitimité moindre, puisse leur imposer le respect d’une norme, fusse-t-elle constitutionnelle (2009, p. 29). Or, comme le souligne Dominique Rousseau, « la limitation du pouvoir du peuple trouve sa justification dans un système libéral où le principe de légitimité est l’équilibre» (2008, p. 2). Une telle orientation est difficilement acceptée par les gouvernants assoiffés de pouvoir. Une attitude digne de la minorité juridique et politique.
En somme, les difficultés de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs dans les États africains s’expliquent par la minorité juridique conduisant à « la précarité de la démocratie » (Eric Fassin, 2012, p. 4), à l’instabilité politique et à la pauvreté. Comme on le voit, la pauvreté de l’Afrique s’explique pour une grande part par le refus des gouvernants de respecter les déterminants de la démocratie que par une défaillance de leur entendement. Ils sont confrontés à un véritable problème de mentalité dans la gestion de la chose publique. Or la vraie démocratie est le cadre politique qui favorise le mieux la protection des droits de l’homme, la sécurité juridique et la stabilité politique à long terme. Comment sortir alors de cette mentalité de la minorité juridique pour accéder à la vraie démocratie et donc à l’émergence politique ?
2. L’ÉMERGENCE POLITIQUE PAR LA SORTIE DE LA MINORITÉ JURIDIQUE
La minorité juridique étant un usage subjectif de l’entendement aboutissant à une application égoïste des déterminants de la démocratie, il convient, pour en sortir, d’en faire un usage objectif, pour une meilleure conception et application du droit en vue de l’intérêt commun, démocratique. Cette mutation, qui est un changement de mentalité, a permis d’accéder à la majorité juridique en Occident. Pour ce faire, il faut, en Afrique, rééquilibrer la séparation des pouvoirs et donner à la constitution républicaine la place fondatrice et sacrée qui lui revient comme dans les grandes démocraties. Comment y parvenir ?
2.1. Rééquilibrer la séparation des pouvoirs dans les États africains
L’objectif de la séparation des pouvoirs par les Modernes est bien exprimé par Montesquieu :
Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; (…). Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, (2013, p. 292).
L’inconvénient du présidentialisme accru et paternaliste est de rompre l’équilibre des pouvoirs. Il n’y a donc plus de contre-pouvoirs parlementaire et judiciaire, plus d’opposition, de contrôle. Or comme le réaffirme Omar Diop, « l’opposition est l’essence de la démocratie. Elle est un des rouages essentiels de la démocratie pluraliste » (2006, p. 240).
Pour l’intérêt public, les gouvernants africains devraient arrêter de diaboliser l’opposition pour lui accorder la place qui lui revient dans la vie politique nationale. S’il faut convenir avec Montesquieu que « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites » (2013, p. 290), les gouvernants africains doivent avoir le courage et l’humilité d’accepter l’existence d’une opposition parlementaire forte car « la démocratie représentative fait du Parlement le principal cadre organisationnel d’expression de la souveraineté du peuple, le lieu d’affrontement et de confrontation des représentants choisis pour prendre part à la détermination de la volonté nationale ». (J. Beachler, 1985, p. 125).
À cette fin, le statut et le rôle de l’opposition parlementaire ne doivent pas être définis par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale mais par la constitution comme au Ghana et au Sénégal[26]. Par contre la Constitution ivoirienne de 2016 se contente d’affirmer, dans son Préambule, son adhésion à la séparation des pouvoirs sans accorder à l’opposition parlementaire la place constitutionnelle qui lui revient. Elle procède ainsi, de manière générale, comme la plupart des constitutions africaines qui noient les droits de l’opposition dans ceux de tous les membres du Parlement. Or les députés proches de l’exécutif y sont souvent les plus nombreux et n’ont pas les mêmes préoccupations et objectifs que ceux de l’opposition. C’est pourquoi « les parlementaires, notamment ceux de l’opposition, doivent bénéficier de prérogatives supplémentaires pour être en mesure d’œuvrer de concert avec la majorité gouvernementale, ainsi que de contrôler l’action du gouvernement et de la critiquer si besoin est » (Actes du Séminaire interparlementaire, 1999, p. 3). Ainsi l’opposition parlementaire peut mieux jouer son rôle de contrôle de l’action parlementaire en amendant les lois, en participant activement aux activités en commission et conduisant dans enquêtes parlementaires pour démasquer les tentatives d’abus de pouvoir.
Il faut également améliorer la représentativité de l’opposition politique au Parlement par des élections législatives transparentes et crédibles. Omar Diop montre comment cette qualité de la représentation part de l’existence des partis politiques, de leur financement, de leur organisation, de la représentativité de leurs candidats[27] et de leur participation aux élections. Leur statut constitutionnel doit leur permettre de bénéficier de financements publics nécessaires. L’existence d’une opposition parlementaire dynamique est un signe de majorité juridique.
La question de la transparence des élections renvoie au pouvoir judiciaire et à son rôle de contre-pouvoir de l’exécutif et du législatif car « l’indépendance de la Cour vis-à-vis du Parlement comme vis-à-vis du Gouvernement est un postulat évident (…), car, ce sont précisément le Parlement et le Gouvernement qui doivent être, en tant qu’organes participant à la procédure législative, contrôlée par la juridiction constitutionnelle » (Kelsen, 1928, p. 225-226). Ce rôle ne se réduit pas à un arbitrage occasionnel des conflits électoraux entre parti au pouvoir et parti de l’opposition. Il s’étend à un contrôle de la constitutionalité des lois, de la gestion transparente des deniers publics et à la protection des droits des citoyens à un procès équitable. Les juges sont chargés de veiller à la liberté des citoyens et des institutions. Dans tous ces cas de figure, le problème fondamental est celui de l’indépendance et de l’impartialité des juges dans la mesure où ils sont nommés par l’exécutif. L’impartialité du juge n’est pas théorique, proclamée, elle est tributaire de son indépendance pour être effective. En effet, l’indépendance des juges, est la condition nécessaire de l’impartialité, celle qui fera, non pas que les juges seront impartiaux, mais qu’ils ne soient pas empêchés de l’être. De tels juges peuvent rendre effective la majorité juridique que la nation attend d’eux.
L’effectivité de cette indépendance des juges résultera d’un mode de désignation qui échappe à l’exécutif ou au moins prévoit des mécanismes pour qu’ils n’en dépendent pas absolument. Ici, l’exemple des États-Unis est édifiant. Les juges fédéraux y sont nommés à vie, tant qu’ils en sont dignes[28], par le Président mais avec l’avis du Sénat exprimé par vote. Assurés, à vie, d’un traitement décent et de leur inamovibilité, les juges fédéraux rendent leurs jugements libres de toute influence du Congrès ou du Président[29]. Les juges des tribunaux d’États sont élus selon différents mécanismes mais qui ont tous l’avantage de les rendre indépendants. Par ailleurs, exerçant des mandats, ils sont eux-mêmes contrôlés par une élection sanction au terme de ce mandat. Le juge est donc indépendant de la presse, de l’opinion publique, des avocats et de leurs clients, et de quiconque aurait éventuellement intérêt à ce que le cours normal de la justice soit dévié. Par suite il est impartial parce qu’il s’efforce de dire le droit à partir des lois, de sa conscience et de la liberté de chaque citoyen. Joseph Darby souligne l’adéquation entre l’esprit de la séparation des pouvoirs telle que conçue par les Modernes et sa mise en œuvre aux États-Unis :
Les rédacteurs de la Constitution américaine de 1787 étaient familiers avec la théorie de Montesquieu selon laquelle une séparation des trois pouvoirs est essentielle à la liberté civique. La séparation de ces pouvoirs n’a jamais été conçue pour être hermétique. Une série complexe d’interdépendances a été insérée dans l’ensemble du système. Chaque branche exerce ses fonctions constitutionnellement protégée de l’empiétement des autres, mais également de manière dépendante de leur collaboration. De telles limites imposées par une branche envers une autre reflètent l’essence du concept américain de constitutionnalisme : une Constitution écrite ayant pour objectif de protéger la liberté individuelle en empêchant l’accumulation de trop de pouvoir politique dans une branche du gouvernement, (Avril-juin 2003. pp. 351-362).
Pour sortir de la minorité juridique, les gouvernants et les détenteurs des différents pouvoirs de l’État doivent respecter leur équilibre en recherchant l’intérêt public. Cet équilibre dépend en première instance de la qualité de la constitution et du respect qui lui est du.
2.2. Établir et respecter la constitution républicaine
Montesquieu, pour montrer l’importance de la constitution dans la recherche de la justice et de la liberté écrit que « une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet » (2013, p. 290). Kant vient préciser qu’elle doit être républicaine en raison de ses caractéristiques ;
« la constitution qui se fonde premièrement sur le principe de la liberté des membres d’une société, deuxièmement sur celui de la dépendance de tous à l’égard d’une législation unique et commune et troisièmement sur la loi de l’égalité de tous, cette constitution est la seule qui dérive de l’idée du contrat originaire, et sur laquelle doit se fonder toute la législation juridique d’un peuple. » (1958, p. 91).
Il apparaît que pour les Modernes, l’objectif de la constitution républicaine que doit avoir tout État est l’intérêt commun de la société à travers la liberté, la justice et l’égalité des citoyens. Étant ainsi le ciment de l’État, la constitution est sacrée et doit être respectée comme telle. Mais force est de reconnaître que les constitutions africaines ne sont ni républicaines ni respectées.
Certes, il faut reconnaître, également, un progrès de ces constitutions depuis l’époque du parti unique jusqu’aujourd’hui en passant par la période du multipartisme, des élections pluralistes et de la consécration du constitutionalisme dans le règlement des contentieux électoraux. Mais au regard de l’histoire et de l’actualité politique récentes en Afrique, le constat s’impose qu’à la vérité, malgré les progrès réalisés, la pratique constitutionnelle en Afrique, comme un faux messie, n’a pas répondu aux attentes suscitées par le constitutionnalisme triomphant des années 1990 : le statut du chef de l’État, la clause limitative du mandat présidentiel, les règles constitutionnelles de succession qu’on a pu considérer comme des acquis démocratiques sont en sursis. Sa majesté, la Constitution, a aujourd’hui perdu sa couronne. Bousculée par les faits[30], la constitution qu’on avait très tôt sacralisée, fétichisée, en Afrique est devenue un texte ordinaire, voire banal. Quelles en sont les raisons et comment y remédier ?
La première raison, et non des moindres, est d’ordre juridique, elle renvoie à la conception même des constitutions africaines. Elles sont, généralement, les mauvaises copies, dans la forme et le fond, des constitutions européennes. Elles en ont ainsi hérité le présidentialisme comme une forme assouplie de la séparation des pouvoirs mais en ont fait un paternalisme contraire au principe de cette séparation. Il y a là une minorité juridique par le refus des constituants africains d’user de leur propre entendement pour se donner des textes adaptés et justes. Par ailleurs, les constitutions africaines sont souvent conçues à la mesure d’une personne ou d’un parti comme l’indiquent les règles de succession constitutionnelles. Enfin le déséquilibre de la séparation des pouvoirs laissent transparaître au-delà de l’incohérence du texte, l’intention de privilégier des intérêts individuels à l’intérêt commun. Le recours aux Modernes permet de repréciser, si besoin est, que l’objectif d’une constitution est d’assurer la liberté, la justice et l’égalité pour tous les citoyens, car comme le souligne Rousseau, là où il y a un individu au-dessus des lois, il n’y a plus de loi. Telle est aussi selon Kant l’expression de la rationalité juridique objective contraire à la minorité juridique qui est subjective.
Les rédactions subjectives de la constitution doublées de la mauvaise foi des gouvernants débouchent sur les révisions constitutionnelles intempestives et à risques. Certains gouvernants ont en effet réalisé le profit qu’ils pouvaient tirer de la légalité. La stratégie est plus ingénieuse car résultant de l’utilisation du texte constitutionnel. Cette ingénierie constitutionnelle est en réalité au service de la conservation et de la pérennisation du pouvoir individuel. Ainsi pour Francis Wodié, « sous la Constitution en Afrique se dévoile le paravent qui abrite le pouvoir personnel » (1990, p. 196) : une autre illustration de la minorité juridique qui conduit aux crises sociales pour la reconquête du pouvoir confisqué. Les efforts des constituants pour limiter la durée et le nombre des mandats sont ainsi battus en brèche par la volonté égoïste de s’accaparer le pouvoir.
Pour résoudre ces conflits et restaurer les constitutions, se produit l’ironie du sort par laquelle la constitution, symbole de la souveraineté d’un peuple, se trouve arrimée à des accords nationaux et internationaux. Pourtant ces accords n’ont pas toujours en objectif l’intérêt commun du peuple. Tantôt ces accords l’emportent sur la Constitution, tantôt ils coexistent avec elle[31], tantôt encore ils se substituent définitivement à elle[32]. Dans tous les cas, il est loisible de constater que la Constitution s’est inclinée devant ces accords politiques. Dans ces conditions, la Constitution n’est plus la fondation « sur laquelle doit se fonder toute la législation juridique d’un peuple » comme le dit Kant. Une telle situation créée inéluctablement des dysfonctionnements au plan institutionnel. Comme le fait remarquer fort justement F. M. Djedjro, « la succession des arrangements politiques a pour effet de créer des incertitudes sur la notion de Constitution » (2009, p. 23). La minorité juridique, ici encore, est l’incapacité à se servir de façon autonome et objective de sa raison juridique.
En dénonçant cette fragilisation des constitutions en Afrique, il ne s’agit pas de revenir sur la possibilité et la nécessité de réviser la Constitution. Une telle question a été débattue et finalement réglée théoriquement par Kant[33] et pratiquement par les constituants de Philadelphie. Ce qui est en jeu, c’est l’objet et la méthode qui permettent ces révisions. Une constitution, même républicaine, peut être réformée à condition qu’elle contribue davantage à la protection des droits et devoirs des citoyens et à des institutions plus fortes mais pas à consolider le pouvoir de certains sur d’autres. Il suffit d’étudier les constitutions du Royaume-Uni et des États-Unis pour comprendre l’articulation judicieuse entre le respect et la réforme d’une constitution républicaine. Il est, en effet, remarquable que la constitution du Royaume-Uni est un ensemble de règles constitutionnelles non codifiées issues de la loi, de la jurisprudence, d’usages constitutionnels au fil des siècles et des crises majeures de son histoire. Parmi ses textes fondamentaux, il y a “the Petition of Rights” de 1628 qui limite les pouvoirs du roi au profit du parlement, “the Habeas corpus” de 1679 qui précise que nul ne peut être arrêté et détenu arbitrairement sur ordre du roi, ʺthe Bill of Rightsʺ en 1689, qui fonde la monarchie constitutionnelle anglaise en accordant des droits fondamentaux aux citoyens et résidents, et “the Act of settlement” de 1701 qui définit les conditions d’exerce de la monarchie parlementaire. La majorité de ces textes a été établie pendant la guerre civile anglaise du XVIIe siècle et subsiste encore parce qu’ils représentent toujours l’intérêt commun du peuple anglais. De même, la Constitution américaine adoptée en 1787 a connu vingt-sept (27) Amendements qui permettent de l’adapter à l’évolution de la société américaine sans en corrompre l’esprit. Les auteurs de ces constitutions et de leurs amendements ont fait preuve de rationalité juridique objective, de majorité juridique :
Les Pères Fondateurs de la Constitution américaine, héritiers de l’époque des Lumières, savaient pertinemment qu’ils n’écrivaient pas une formule par simple utopie. En reconnaissant que la nature humaine est, et restera imparfaite, soumise à des passions (soif de pouvoir ; avidité ; malhonnêteté ; mégalomanie), ils ont rédigé un document qui donne au gouvernement assez de pouvoir pour être efficace, et en même temps pour préserver un maximum de liberté politique et civile (Darby, 2003. pp. 351-362)
Ces textes sont donc sacrés et bénéficient du respect conséquent. C’est à cela que doivent parvenir les États africains pour devenir de vraies démocraties.
Conclusion
Il convient de retenir que dans les États de l’Afrique, il y a bien une minorité juridique à l’origine du sous-développement et des crises politiques à répétition. Elle consiste, pour les constituants, d’une part, à ne pas suffisamment se servir avec courage et objectivité de leur raison juridique pour établir eux-mêmes des constitutions justes et durables mais à le faire par mimétisme du droit occidental et sous le contrôle de la communauté internationale. D’autre part, elle consiste plus à se laisser aller à concevoir des lois subjectives au profit de l’intérêt personnel que des lois civiles objectives en vue du bien commun, national. Pour les gouvernants, cette minorité consiste à privilégier leur intérêt à l’intérêt national. Cette minorité juridique, qui affecte la mentalité des gouvernants en Afrique, est responsable, au fond, du déséquilibre de la séparation des pouvoirs, des défaillances de l’État de droit et de la démocratie. Elle permet aux États occidentaux d’être les tuteurs des États africains en les maintenant sous leur coupe.
Pour l’émergence politique des États africains, les juristes et les gouvernants doivent faire preuve de rationalité juridique objective ou encore de majorité juridique pour établir des constitutions et des lois justes, ainsi que des institutions fortes pour assurer la liberté de leurs citoyens et leur égalité. Ils doivent changer de mentalité. En termes kantiens, l’émergence politique se fera davantage par « la sortie de l’homme (l’Africain) de la minorité (juridique) où il est par sa propre faute » (1997, p. 41). Ce sera le moyen d’obtenir la paix sociale, de devenir de vraies démocraties et donc de bénéficier du respect qu’ils méritent sur la scène internationale. La question de l’émergence économique sera alors envisagée avec plus de sérénité. A cette fin, au-delà des gouvernants, toutes les populations ne devraient-elles pas faire l’objet d’une éducation à la citoyenneté ?
Références bibliographiques
BAYART Jean-François, 2009, « La démocratie à l’épreuve de la tradition en Afrique subsaharienne », Pouvoirs, N°129, pp. 23-39.
BEACHLER Jean, 1985, Les démocraties, Paris, Calmann-Lévy.
DARBY Joseph, 2003, « Garanties et limites à l’indépendance et à l’impartialité du juge aux États-Unis d’Amérique », Revue internationale de droit comparé, Vol. 55 N°2, pp : 351-362; http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2003_num_55_2_5580
DEMOCRACY REPORTING INTERNATIONAL, 2013, « Les droits constitutionnels de l’opposition », Note d’information n°34.
DJEDJERO Meledje, 2009, « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n° 129, pp. 139-155.
FASSIN Éric, 2012, La démocratie précaire, Paris, La Découverte.
GERHARDT Michael, 2000, The Federal Impeachment Process, Chicago, University of Chicago Press, 2e éd., pp. 23-35.
JAN Pascal, 2004, « Les oppositions », Pouvoirs, N°108, pp 23-43.
KANT Emmanuel, 1994, Doctrine du droit in Métaphysique des mœurs II, traduction de l’allemand par Alain RENAUT, Paris, GF Flammarion.
KANT Emmanuel, 1997, Qu’est-ce que les Lumières ?, in Histoire et progrès, traduit de l’Allemand par Jean-Christophe GODDARD, Paris, Hachette.
KANT Emmanuel, 1958, Vers la paix perpétuelle, Essai philosophique, traduction de l’allemand par J. DARBELLAY, Paris, Presses Universitaires de France.
KELSEN Hans, 1928, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », Revue du Droit Public, p. 205-226.
KOFFI Eric Inespéré, 2015, « Opposition politique et droit de révolte chez Kant », Lomé, Échanges, vol. 1, pp : 116-137.
LAMARCHE Aka Aline, 2013, « L’évolution du régime représentatif dans les États d’Afrique noire francophone », Jurisdoctoria, n°9, URL :
http://www.jurisdoctoria.net/pdf/numero9/aut9_AKA_LAMARCHE.pdf, consulté le 29/07/2017.
MBODJ El Hadj, Avril 2000, « Les garanties et éventuels statuts de l’opposition en Afrique », Les Actes du Symposium international sur les pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone de Bamako.
MONTESQUIEU, 2013, De l’esprit des lois, Paris, GF.
OMAR Diop, 2006, Partis politiques et processus de transition démocratiques en Afrique noire, Broché, Paris.
ROUSSEAU Dominique, 2008, « Constitutionnalisme et démocratie », La Vie des idées, 19 septembre URL : http://www.laviedesidees.fr/Constitutionnalisme-et-democratie.html.
UNION INTERPARLÉMENTAIRE, 1999, « Statut-type de l’opposition au Parlement », Actes du séminaire parlementaire sur les relations entre partis majoritaires et minoritaires dans les parlements africains, Libreville.
WODIE Francis Vangah, 1990, « Régimes militaires et constitutionalisme en Afrique », Penant, juin septembre.
DE LA RÉAPPROPRIATION CRITIQUE DES SAVOIRS ENDOGÈNES : UNE THÉORIE DE L’ÉMERGENCE
Jackie E. G. Z. DIOMANDÉ
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
elise.jackie@yahoo.fr
Résumé :
Après les crises successives qu’ont connues les pays africains, les nouvelles autorités politiques, depuis presqu’une décennie, ont inculqué dans la conscience collective le concept d’émergence. Les discours politiques gravitent autour de l’émergence en réfléchissant sur son effectivité, ses entraves, ses conditions, etc. Concernant ses fondements, il ne serait pas absurde pour un chercheur en philosophie africaine de penser, avant tout, aux savoirs endogènes, c’est-à-dire aux connaissances, aux valeurs locales. En quoi consistent les savoirs endogènes ? Dans quelle mesure peuvent-ils réellement contribuer au progrès social dans les pays africains ? Ce texte se charge d’ausculter la problématique de l’émergence africaine à travers ces questions. Il s’agit précisément de dévoiler l’indispensabilité des savoirs endogènes dans le processus de l’émergence des sociétés africaines. En guise de réponse conjecturale, l’on peut, d’ores et déjà, retenir que la réappropriation critique des savoirs endogènes est favorable au changement de mentalité, à la prise de conscience et à la responsabilité, les fondements de tout développement. Pour approfondir cette idée, l’on s’appuie sur la méthode analytico-critique.
Mots-clés : Afrique, Développement, Émergence, Réappropriation, Reconnaissance, Savoirs endogènes, Valeurs locales.
Abstract :
After the successives crisis that African countries were victim, the new political authorities since a decade have now inculcated in all the mind the concept of advent. The political speeches also turn more and more around the advent by thinking about its effectiveness, it obstacles, it conditions and so on … concerning it basis, it should not be absurd for a researcher in African philosophy after all, to think about endogenous; learning that means to the knowledge, local values. In which do the endogenous knowledges consist of? How they can really contribute to the social improvement in African countries? This text aims at resolving the preoccupation of advent through these questions. It is precisely to reveal the necessity of the endogenous knowledge in the process of the advent of the African societies. For the likely answer, one can already retain that the repossession criticism to endogenous knowledge is available for the change of mentality from the awareness and to the responsability, the basis of any development. For deepen this idea to emphasice on this idea, it is suitable to focus on analytic-criticism.
Keywords: Africa, Development, Advent, Reprossession, Recognition, Endogenous learning, Local values.
Introduction
L’idée d’émergence est apparue au départ comme un concept économique. Mais durant les dix dernières années, elle est un slogan politique qui accompagne les politiques de développement, à partir de la croissance observée et de l’amélioration du niveau de vie, chez un groupe de pays appelés les BRIC, que sont le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, anciennement considérés comme des pays pauvres. Ce groupe de pays à cause de leur niveau de développement a été considéré comme pays émergent. Ce modèle social et économique va inspirer les pays africains à se fixer des objectifs stratégiques pour devenir pays émergents également. Et cela en vue de lutter contre la pauvreté. Dès lors, l’émergence devient une politique de lutte contre la pauvreté. Pour y parvenir, les pays africains vont s’appuyer sur deux éléments fondamentaux, les savoirs endogènes et le capital humain.
Le constat qui se dégage est que tous les BRIC, se sont fondés sur leurs ressources locales et humaines pour devenir émergents. Ce pose, alors, avec acuité le problème de l’émergence de l’Afrique, comme sa capacité à la reconnaissance internationale. Ainsi, le terme émergence apparaît-il comme un passage pour aboutir au développement.
Le projet, qui est ici visé, est un plaidoyer pour la responsabilité littéraire et scientifique de l’Africain. Il n’est plus question de compter sur l’aide extérieure pour penser son émergence. Cependant, cela ne signifie pas un repli autarcique.
Mais, comment l’Afrique peut-elle parvenir à son émergence et obtenir sa reconnaissance et son respect au plan international ? Une étude épistémologique des savoirs et savoir-faire africains ne serait-elle pas l’une des voies royales pour y parvenir ? Quel sera le rôle de l’intellectuel africain dans cette quête de l’émergence africaine ? Le véritable enjeu de cette communication est d’amener à une prise de conscience des Africains pour atteindre le niveau d’émergence escompté.
C’est dans une démarche critico-analytique que nous traiterons, en trois parties, le sujet. Primo, il s’agit de montrer que l’émergence est une aspiration universellement partagée. Secundo, la problématique de l’émergence dans le contexte africain. Tertio, il est question de montrer ce qu’est la théorie de l’émergence.
1. L’ÉMERGENCE, UNE ASPIRATION UNIVERSELLEMENT PARTAGÉE
Ce vouloir universel de l’émergence est une manière pour chaque peuple du monde de revendiquer son être au monde, sa présence dans le monde. Cette volonté d’affirmer son être dans le monde est au fondement de toute bataille pour la reconnaissance. C’est à partir de ces luttes que chaque société pourra parvenir, de manière responsable, à l’émergence prélude au développement.
1.1. Émergence comme revendication de son être-au-monde
Parler de l’émergence, c’est aussi évoquer les termes d’existence, de bonheur ou encore de liberté. Émerger, c’est s’épanouir et exister c’est être libre, alors il en va de l’existence comme de l’émergence. Ce terme traduit l’idée de “ la sortie hors de” et par extension l’idée de dévoilement. Émerger est donc lié au fait d’exister qui, de par son étymologie « ek-sistere » ne signifie autre chose que « sortir de », donc exister, c’est émerger. D’où, l’émergence apparaît comme une exigence pour qui entend manifester son moi profond, son identité propre, en somme son être au monde.
L’être au monde est une terminologie heideggerienne, qui signifie être avec les autres. L’homme est un être au monde, qui cherche à comprendre son quotidien, à se comprendre lui-même et s’améliorer, au fils du temps, pour s’imposer avec respect et se démarquer des autres. C’est pourquoi, il cherche à sortir de lui-même en faisant toujours un pas vers l’avant, pour s’affranchir de toute domination et imposer son hégémonie.
L’on peut voir dans les œuvres de l’action coloniale, non un acte d’évangélisation ou une philanthropie, mais le triomphe de la culture européenne sur celles des autres peuples. Quant aux autres peuples dont font partie les Africains, ils vont œuvrer à s’affranchir du joug de la colonisation afin d’être indépendants et ne plus être étrangers à eux-mêmes. Cette lutte pour la décolonisation et la désaliénation africaine est une revendication de l’être-africain au monde. Car, décoloniser c’est mettre fin à la domination exercée par un peuple ou un individu sur l’autre. Désaliéner, c’est mettre un terme à l’aliénation, c’est-à-dire à la privation de la liberté. D’où décoloniser et désaliéner apparaissent comme des exigences de l’existence. Il s’agit ici de reconquérir sa liberté et le respect de l’égalité des hommes.
Cette affirmation de son être-au-monde est perçue à travers le débat sur l’existence de la philosophie et de la science dans le monde africain. Les Africains se sont attelés à démontrer à l’Occident qu’ils ont aussi la capacité d’user de leur esprit critique pour philosopher. Pour prouver au Blanc que le Noir pense et agit comme lui, ce dernier est parvenu à montrer qu’il existe une philosophie de type africain. Cette recherche de l’originalité est faite dans le but d’affirmer son identité. Tout est fait en fonction de l’Autre, de ce qui se démarque de lui.
Cette philosophie africaine, sur fond d’ethnophilosophie, est une plaidoirie. Cette philosophie est une réplique à l’Occident. Car voulant coûte que coûte prouver à l’Occident que l’Africain est capable de penser, de réflexion, donc aussi intelligent. « On ne le fait même pas pour avoir une philosophie, mais pour en avoir eu ; on ne le fait pas pour être philosophe soi-même, mais pour que le négro-africain ait des philosophies ou soit lui aussi philosophe. » (F. Eboussi-Boulaga, 1977, p. 32).
Ce combat pour la revendication d’une philosophie africaine est un combat pour l’émancipation africaine, le désir d’identité et la quête d’un visage. Le désir des Africains est que leur dignité et leur identité soient reconnues, surtout, par l’Occident. Car, comme le dit Dibi Kouadio Augustin (1994, p. 20), « Le visage me rend présent aux choses et rend les choses présentes à moi. »
Cette lutte pour la reconnaissance est un mouvement universel, car tout peuple ou toute nation cherche à s’imposer et à imposer sa culture, son modèle de civilisation, son savoir- faire et son savoir-être. Les peuples sont perpétuellement en compétition. Ceci est mis en évidence par Hegel dans sa théorie de la reconnaissance à travers la dialectique du maître et de l’esclave : le maître veut demeurer maître et l’esclave souhaite s’affranchir de son bourreau et devenir le maître. (G. W. F. Hegel, 1939, p. 167). Cela montre que les hommes sont en perpétuelle quête d’une identité. Cette quête se perçoit à travers l’acharnement que manifeste chaque peuple dans sa volonté d’acquérir la liberté et la démocratie dans et pour sa nation. La conquête de la démocratie par le peuple lui permettra de s’exprimer et d’extérioriser sa pensée et se faire entendre. Cette conquête s’effectue comme une réactivation continue d’un bien qu’on a en soi déjà, car la démocratie fait partie des mœurs africaines. Ce qui sous-entend que l’existence est faite de lutte perpétuelle. Karl Marx l’explicite, lorsqu’il montre que l’histoire de l’humanité est fondée sur la lutte des classes, qui est aussi une lutte pour la reconnaissance. Cette idée paraît plus explicite quand il soutient : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est faite d’antagonismes de classes, qui, selon les époques, ont revêtu des formes différentes. » (K. Marx, 1977, p. 44).
Ce désir de reconnaissance ne peut pas s’achever, il ne pourrait prendre fin que peut-être à la fin du monde, si l’on peut s’exprimer ainsi. Cette hargne de triompher qui ronge toute nation contribue au progrès de l’humanité. En un mot, cette lutte pour la reconnaissance est le moteur de l’histoire. Elle met le monde en mouvement, le dynamise. Chaque peuple se bat comme il peut pour sa reconnaissance.
Toute existence se résume à la lutte pour ses propres intérêts, pour la conservation de son identité physique, pour sa reconnaissance, dans une communauté ou une société donnée. Alors, tout projet d’émergence de « l’identité personnelle d’un sujet est fondamentalement lié à certains modes de reconnaissance par d’autres ». (A. Honneth, 1992, p. 50). Tout est fait en fonction de l’autre, qu’il reconnaisse sa valeur et préserve sa dignité. Ici, l’on est dans une relation de réciprocité entre les individus. Car, « seul le sentiment d’être reconnu ou approuvé dans sa nature instinctuelle particulière confère au sujet la confiance en lui-même dont il a besoin pour contribuer, au même titre que les autres membres de la communauté, à la formation de la volonté ». (A. Honneth, 1992, p. 52). L’objectif principal qui est visé dans cette lutte perpétuelle pour la reconnaissance, c’est le développement et le bien-être de chaque peuple.
1.2. Le développement, enjeux de la bataille des peuples pour la reconnaissance
Développer, c’est ouverture vers, enrichir le déjà-là, faire connaître à. Quant au concept de l’émergence, il signifie sortir de soi, pour aller conquérir ou reconquérir quelque chose qu’on n’a pas ou qu’on a perdu. Alors, l’émergence apparaît ici comme une autre approche du développement, un slogan pour aller au développement. Toute nation lutte pour son développement, pour le bien-être de son peuple et pour préparer l’avenir des générations futures.
Le concept de développement met l’accent sur le fait que tout ce qui surgit dans la pensée et le monde, n’est qu’une explication de ce qui est déjà en germe au départ, le déjà existant. Hegel dans la science de la logique note que « Le mouvement du concept est (…) un développement, par lequel est seulement posé ce qui est en soi présent. » (G. W. F. Hegel, 1994, p. 591.). Dans la nature, selon Hegel, c’est la vie organique qui correspond au degré du concept. Il prend l’exemple de la plante qui se développe à partir de son germe. Tout développement prend racine dans sa source nourricière, dans ses savoirs endogènes et son capital humain, pour assurer le bien-être de l’homme qui est sa cause première.
La dimension humaine est le pourquoi et le comment de tout développement. L’homme ne doit pas être considéré comme un moyen ou un objet, un instrument du développement, mais au contraire comme une fin. C’est tout le sens de cette maxime kantienne : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen ». (E. Kant, 1989, p. 7).
L’épanouissement de l’homme est au fondement de toute bataille pour le développement dans tous les continents. L’homme doit être au centre de toutes décisions ou ambitions politiques, car c’est l’existence humaine qui donne sens à toutes les activités ou productions humaines. Les activités humaines telles que l’agriculture, la technique, l’art, l’imagination ont pour objectif le bien-être de l’homme, voire son bonheur. « L’homino-centrisme » (…) apparaît donc comme essentiel dans notre manière de concevoir le développement ». (S. Diakité, 1985, p. 132).
Il convient de prendre des mesures adéquates pour le bien-être humain, c’est-à-dire la qualité de vie, dans les processus du développement. Dès lors, « tout objectif de développement devient un objectif socio-culturel. » (S. Diakité, 1985, p. 131). En effet, les facteurs socioculturels sont des facteurs qui font partie des moyens indispensables au développement. Aussi, toutes les décisions prises pour le développement doivent-t-elles tenir compte d’abord des réalités de la société concernée, ainsi que les valeurs culturelles, les lois qui y sont rattachées. Ce qui sous-entend que le développement ne doit pas être réduit à la seule question économique. Ici, « Le développement doit être compris en termes dynamiques, comme une série de processus qui émanent ou se nourrissent de valeurs, de l’expérience historique et des ressources d’une société donnée » (S. Diakité, 1985, p. 132). Il s’agit de trouver la manière dont il faut rassembler et organiser tous les constituants d’une société qui permettent l’épanouissement de sa population.
Un autre aspect est qu’il ne peut y avoir de développement sans la participation du citoyen. Il est le sujet et l’objet du développement, il doit y être impliqué. Et pour ce faire, il convient de créer des structures de formation et d’information du citoyen, afin qu’ayant tous ces outils, il soit capable de participer activement au développement de son milieu de vie. C’est ainsi que
l’on se demande si finalement les corps intermédiaires, les institutions de l’État, les partis politiques, n’ont pas une mission particulière à assumer dans la formation et l’information du citoyen afin qu’il soit associé réellement aux décisions qui déterminent le destin de la communauté nationale, car il n’y a pas de développement possible si le citoyen ne se sent pas concerné par sa participation effective à la réalité du pouvoir. (N. Atangana, 1971, p. 78).
Ce qui signifie qu’il n’y a pas de développement brusque ou spontané. Tout développement suit des étapes. Il s’agit de former ou d’éduquer la population au changement qui sera produit par le développement. Car, selon S. Diakité (2016, p. 5),
le développement ne s’improvise pas, il se planifie méthodiquement, scientifiquement avec rigueur et parcimonie. Tout développement est d’abord et avant tout une prévision. Se développer, c’est se soigner du passé, être bien portant dans le présent et mieux vivre dans le futur. Se développer, c’est comprendre que l’avenir doit prendre le pas sur le passé et le présent. On ne choisit pas forcément son passé mais on peut choisir son futur et l’orienter par notre présent.
Ainsi, l’émergence qui est un prélude au développement, n’est pas une course olympique, pour utiliser l’expression de Joseph Ki-Zerbo (2003, p.151), dans la mesure où tous les pays, tous les continents n’ont pas les mêmes réalités ou encore non pas les mêmes départs. Cependant, comment est-elle perçue dans le contexte africain ?
2. L’ÉMERGENCE DANS LE CONTEXTE AFRICAIN
L’idée de l’émergence est une manière ou un moyen pour chaque pays de sortir du sous-développement, pour l’amélioration des conditions d’existence et de parvenir à leur reconnaissance. Cependant, dans cet objectif de lutte politique, nous assistons, en Afrique particulièrement, à une vision tronquée de l’émergence.
2.1. La nécessité de sortir du sous-développement
L’émergence, d’un point de vue socio-économique, apparaît comme une étape transitoire entre le sous-développement et le développement.
Le sous-développement est perçu comme un mal-être, c’est le symbole de la misère, tant morale que matérielle. Le terme sous-développement a été prononcé pour la première fois par le Président américain Harry Truman en 1945. De là va naître chez les Américains et plus largement les Occidentaux une nouvelle bataille contre le sous-développement qui va prendre le relais de la mission civilisatrice du temps des colonies comme nouvel objectif messianique. Ce qui va déboucher sur la répartition du monde en deux catégories : pays sous-développé et pays développé en fonction du produit intérieur brute par habitant. L’on assiste à la mathématisation et à la catégorisation du monde.
L’expression pays sous-développés est souvent remplacée par pays en voie de développement. Et par la suite sont apparus les pays émergents qui ne font plus partir des pays en voie de développement mais qui n’ont pas atteint le niveau des pays développés. Alors, un pays émergent est un pays qui a enclenché un processus, sur les plans économique et social, pour relever la condition d’existence de sa population. Quant aux pays développés, ce sont des pays où la grande partie de la population subvient à ses besoins vitaux ainsi qu’à un niveau de confort, à l’éducation, à la formation. Parmi les pays émergents, l’on peut citer le Brésil, la Russie, l’Inde, la chine. Au niveau des pays développés, il y a le Canada, les États-Unis, la France, l’Australie. En visant l’émergence, les États africains manifestent, par là même, leur volonté d’aller au développement, ou du moins, de sortir du sous-développement, car pour coller à la thématique du colloque, on recherche la reconnaissance dans le concert des nations, toute chose incompatible avec le sous-développement.
Pour relever le défi de l’émergence, chaque pays africain devra commencer à se départir un tant soit peu de la question de la décolonisation culturelle.
Après l’acquisition formelle des indépendances africaines, les Africains se sentent contraints de lutter pour la reconnaissance de leurs valeurs culturelles, à savoir leurs langues, leur savoir-faire et leur savoir-être. Cela se perçoit explicitement dans la pensée des négritudiens tels que Sédar Senghor qui fait l’apologie des valeurs culturelles africaines. Cependant, le problème ne réside pas dans le fait que l’autre reconnaisse les valeurs africaines. Le plus important, c’est de s’interroger comme suit : comment faire pour que les valeurs culturelles s’imposent d’elles-mêmes ? Cela implique la nécessité de quitter la contemplation des cultures africaines et de passer à une introspection pouvant remettre en cause les perceptions que l’on a de sa culture.
Autrement dit, il s’agit de passer les cultures africaines au crible de la raison afin d’extraire ce qui, en elle, peut permettre l’émergence de l’Afrique. C’est aussi la modernisation des cultures africaines, des héritages ancestraux. La modernisation, ici, ne doit pas s’entendre comme l’actualisation, mais, au contraire, comme le perfectionnement, l’amélioration, le raffinage du legs culturel. L’Homme africain doit, lui-même, être engagé dans le processus de transformation et non se mettre en marge comme un simple spectateur. Pour sortir du sous-développement, il convient de s’affranchir de toutes servitudes qui constituent une entrave à ce bond en avant. L’on peut citer, entre autres, l’ignorance, le repli autarcique ou identitaire. Tous ces travers culturels concourent à étouffer l’humanité de l’Homme africain. Pourtant, toute reconnaissance, quel que soit le domaine, est fonction de son niveau de transformation, voire de son niveau d’émergence. Tout pays qui aspire à sortir du sous-développement est dans l’obligation de développer au sein du peuple le sens de la critique et celui de la responsabilité, la culture de la créativité. Car, la participation de la population de manière critique reste nécessaire pour une émergence à la base, intégrée, endogène et autocentrée.
Les États africains, pour ce faire, vont créer un environnement propice, les conditions idoines pour entamer l’émergence et engager le développement. L’application d’une politique d’industrialisation permettra de réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur en ce qui concerne la transformation de leurs matières premières. Il convient de développer le potentiel des pays africains, particulièrement sur le plan de la créativité, de l’innovation et de l’invention.
Malheureusement, ce n’est pas ce qui se perçoit à travers les discours démagogiques des politiciens qui sont éloignés, très souvent, de la réalité. Le discours tronqué des politiciens se pose comme une antithèse à cet objectif qu’est le développement.
2.2. Le discours tronqué du politique : une antithèse de l’émergence
Une analyse réaliste de la politique menée dans les États africains amène à être beaucoup plus circonspect, lorsqu’il s’agit de parler de l’émergence. Loin d’être l’aboutissement de politiques sociale, intellectuelle, et d’un processus de reconnaissance, l’émergence en Afrique apparaît comme un état social qu’on atteint par décret, c’est-à-dire au moyen d’un acte administratif portant le vidimus d’une autorité. L’émergence s’échelonne à travers un chronogramme (2020 pour la Côte d’Ivoire, 2030 pour le Cameroun et bien d’autres pays). Ce qui cache mal le clivage entre le discours politique et la réalité. Tout se passe comme si les conditions n’étant nullement réunies, on proclamait l’émergence par-dessus les épaules des peuples à qui elle est destinée. Il y a donc, manifestement, une certaine vision tronquée de l’émergence qu’on prône.
Les discours démagogiques ou populistes des hommes au pouvoir mettent à mal la question de l’émergence prônée par eux-mêmes. Le « populisme est un pouvoir qui, tout en magnifiant le peuple comme source ultime de sa propre légitimité, s’emploie par tous les moyens à le bâillonner et à se soustraire de son contrôle. » (P. J. Hountondji, 2000, p. 186). Pourtant, un peuple muselé est un peuple handicapé, qui a du mal à fonctionner normalement et dont les critiques ne sont pas prises en compte. L’émergence ne rime pas avec la confiscation des libertés démocratiques du peuple, la violation des droits de l’homme, la corruption organisée, le développement de la culture de l’impunité. Il faut une sorte de dialectique ascendante entre les dirigeants, la société civile et le sens commun, pour viser l’émergence.
L’émergence, c’est la révolution de la mentalité de la classe bourgeoise, voire les hommes du pouvoir politique. Toute révolution fait appel à un changement, à une révision qualitative de la situation, un examen critique des relations à l’intérieur de chaque nation, c’est-à-dire entre les individus et les diverses couches sociales. Cela ne sous-entend pas la suppression totale des inégalités sociales. Il s’agit plutôt de donner la chance à tout le monde pour sa propre prise en charge. Il faut responsabiliser chaque citoyen. Il ne s’agit plus pour les dirigeants africains de venir chanter les slogans du passé pour figer l’esprit d’ouverture ou créer une société close qui a peur de se perdre en allant à la rencontre de l’autre, car le vouloir vivre en vase clos, c’est « un vouloir-se-répéter, un vouloir-être-toujours-identique-à-soi ; c’est le dos tourné à l’avenir, au devenir et par conséquent à la créativité et à la nouveauté ». (E. Njoh-Mouelle, 2011, p. 51). Il faut retenir qu’aucune culture au monde ne peut se suffire à elle-même. Elle a toujours besoin d’apports extérieurs. Cependant, la base de son développement doit être en grande partie endogène.
3. POUR UNE THÉORIE DE L’ÉMERGENCE
La théorie de l’émergence passe par la réappropriation critique des savoirs et savoir-faire endogènes. Et cela ne peut être effectif sans la responsabilité réelle de l’intellectuel africain, qui est l’éclaireur et même la conscience de sa société.
3.1. La réappropriation critique des savoirs et savoir-faire endogènes
Pour émerger, les pays concernés sont endroit d’analyser les critères et les caractéristiques des pays déjà émergents, c’est-à-dire les BRIC, et voir comment orienter la sienne. L’histoire de l’humanité est marquée par le fait qu’aucun pays ne veut être ou rester à la traine. Pour ce faire, tous les pays, en particulier ceux de l’Afrique, se donnent des stratégies pour y accéder.
Cependant, quelles sont les caractéristiques des pays émergents ? Ce qui caractérise les BRIC, le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, est qu’ils ont une imposante population, des capacités technologiques qui impulsent une mutation profonde, la taille gigantesque de réservoir de main d’œuvre, la richesse des sous-sols, particulièrement pour la Russie. Marcel Mbaloula donne plus de précision, lorsqu’il mentionne : « Le caractère émergent de ces quatre pays apparaît à travers la bonne intégration dans l’économie mondiale plus de biens et en ayant une balance commerciale positive. Dès 2004, selon le rapport de Goldman Sachs, les BRIC appartiennent aux 15 premiers PIB (la Chine : 6ème position, l’Inde : 10ème position, le Brésil : 14ème position, la Russie : 15ème position). » (M. Mbaloula, pp. 110-111, 2011)
À partir de ces informations, il apparaît clairement que pour être pays émergent, il faut avoir un niveau de richesse considérable au niveau international, une participation croissante aux échanges internationaux de produits manufacturés, de façon ostensible et enfin une attraction exercée sur les flux internationaux de capitaux. Mais comment les pays africains y parviendront, à leur tour ? C’est en interrogeant de manière rationnelle les BRIC, en allant depuis leur début. Car, ces pays émergents ont affronté des obstacles. Ils étaient par le passé considérés comme des puissances pauvres, dans la mesure où le Brésil était sous la domination de l’Amérique latine. La Russie et la Chine sont issues du bloc communiste et l’Inde est un ex-pays non aligné. Mais ces situations ne les ont pas empêchées de devenir pays émergents. Le Brésil est devenu un géant agricole, un des leaders des biocarburants, la Chine, un géant manufacturier et l’Inde un géant dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Et cela à partir de leurs connaissances locales.
Alors, pour figurer parmi les pays émergents, les pays africains ont pour tâche de prendre appui sur leurs savoirs endogènes. Il s’agit de construire leur émergence sur la pierre africaine, se réapproprier de façon intelligible leurs savoirs et savoir-faire endogènes, les capitaliser et les exploiter localement. L’insistance répond au fait que les pays africains doivent de par leur investigation mettre fin à l’extraversion dans les domaines d’activité. L’extraversion, c’est lorsque les savoirs et les savoir-faire locaux reste un immense héritage collectif qui est totalement géré et contrôlé par l’extérieur. Il convient de réorienter les savoirs africains, voire les recherches scientifiques africaines. C’est en cela que Hountondji emploie l’expression suivante : « la recherche autocentrée ». (P. J. Hountondji, 1994, p. 9.) Car, selon lui, une Afrique émergente est une Afrique souveraine qui est «capable de compter sur sa propre expertise, sur sa propre matière grise et sa capacité à maîtriser ses problèmes à partir de ses ressources propres ». (P. J. Hountondji, 1997, p. 171). Avoir nos propres laboratoires, valorisant l’excellence dans tous les secteurs d’activité, par la compétence et non par la complaisance. Pour mettre fin au phénomène de la fuite des cerveaux.
Il importe pour les Africains d’avoir une meilleure connaissance de leurs systèmes de pensée traditionnelle et des logiques cachées qui les sous-tendent, reste indispensable aujourd’hui pour atteindre l’émergence escomptée. Cependant, cette connaissance ne doit pas les conduire à l’autosatisfaction, à un repli identitaire, où encore aux revendications d’un nationalisme culturel qui semble-t-il est dépassé. L’émergence des pays africains dépend en partie de la responsabilité des intellectuels africains.
3.2. La responsabilité de l’intellectuel africain
S’il est entendu que l’émergence est sous-tendue par un désir de renaissance et qu’elle se conçoit « in fine » comme désir de reconnaissance, il va sans dire que l’Afrique ne peut aller à l’émergence qu’en offrant au reste du monde ce qu’elle est, ce qu’elle a et ce qu’elle sait ; d’où la nécessité pour elle de revenir sur ces fondamentaux, de se réapproprier son héritage scientifique et intellectuel qui, jadis, a assuré son rayonnement.
On ne peut donc occulter la responsabilité de l’intellectuel africain qui doit, d’une manière ou d’une autre, valoriser l’Afrique tant aux plans culturel, intellectuel que politique. Pour tout dire, c’est à travers « l’exhumation » de l’être africain, c’est-à-dire la sortie de l’Africain de sa léthargie, et à travers nos savoirs et savoir-faire que nous pouvons être au rendez-vous d’une émergence authentique capable, à la fois, de satisfaire notre désir de reconnaissance et d’assurer notre reconnaissance dans le concert des nations.
Un intellectuel n’est pas à réduire à l’état d’un diplômé, à une élite ou à un simple fonctionnaire. Un intellectuel, c’est celui qui se sent responsable ou encore qui se pose comme le garant d’une société et dont l’engagement peut permettre l’émergence de son pays. Il est cet Homme qui prend position quotidiennement dans « les affaires de la cité et du monde, au nom d’une responsabilité qu’il s’attribue d’éclairer l’action de ses concitoyens des lumières de son savoir et de sa conscience. Par conséquent, ce n’est point de sa compétence spécifique (enseignant, artiste, ingénieur, etc.) qu’il tire sa vertu ». (E. Njoh-Mouelle, 1983, p. 60). Autrement dit, c’est celui qui se préoccupe du destin de la nation et qui y prend activement part, en prenant soin d’éclairer les ignorants, d’interpeller les politiciens sur leurs mauvais agissements qui ont un impact négatif sur l’économie du pays, la formation et l’éducation de la population, ce qui met en péril le développement de la société. Ce qui veut dire que le rôle véritable de l’intellectuel est de lutter efficacement pour la justice sociale, qui observe avec vigilance l’état de la bonne gouvernance et y porte des critiques constructives pour le bien-être de ses concitoyens et de la bonne marche de sa cité. Il ne doit pas se fourvoyer, ni se laisser manipuler comme une marionnette par les dirigeants. Car, « lorsque l’intellectuel a peur, la société est condamnée à « décrépir », à se scléroser, et à produire un genre de citoyen passif, amorphe, effrayé, et impuissant ». (S. Tonmé, 2008, p. 9). Alors, lorsque l’intellectuel reste passif face aux maux qui minent sa cité, cela cause l’insécurité, surtout dans le domaine économique. Son objectif premier est la défense de la justice, la promotion des libertés et le respect scrupuleux des constitutions. En Afrique, il y a eu des exemples d’intellectuels engagés tels que Cheikh Anta Diop, Mongo Béti, Amadou Kourouma, etc.
Alors, dans le contexte africain, la responsabilité des intellectuels africains, c’est de valoriser l’Afrique sur le plan culturel à travers la promotion de ses langues locales.
Au plan philosophique, les intellectuels africains ont pour tâche d’amener leurs concitoyens à prendre part aux débats concernant l’Afrique, en particulier, et du monde en général. En fait, il ne s’agit pas, comme l’affirme Hountondji (1980, p. 49), « de parler de l’Afrique, mais de discuter entre Africains. » Il s’agit de penser les problèmes des Africains, à partir de leur propre expérience et celle des autres pour une amélioration constante de leur condition de vie, de leur savoir-faire et leur savoir-être. Il n’est plus question de polémiquer sur ceux qui ont permis le développement de l’Occident, les Africains qui ont travaillé dans les plantations en Europe. Le public africain a besoin d’autres choses. Il a besoin de faire de nouvelles découvertes qui permettront l’émergence du continent noir. En fait,
il attend notamment d’être largement informé sur ce qui se passe ailleurs, sur les problèmes qui constituent, dans les autres pays et sur les autres continents, l’actualité scientifique. Il veut en être informé par curiosité, une curiosité combien légitime, mais aussi, sans doute, pour confronter ces problèmes à ses propres préoccupations, les reformuler librement à sa manière et produire, en tenant compte de ces apports extérieurs, sa propre actualité scientifique. (P. J. Hountondji, 1980, p. 49).
Pour ce faire, il faut la création des plateformes dans les pays africains, pour que la discussion productive, instructive soit possible. Car, la libre discussion où s’entrechoquent, s’entremêlent, les doctrines, les idéologies, les théories les plus diverses est facteur de progrès aussi bien au plan matériel qu’intellectuel. Créer un grand débat public, où s’engage la responsabilité intellectuel de toutes les couches est la meilleure voie pour une émergence effective.
Au plan linguistique, il s’agit de faire la promotion des langues africaines, à travers les manuels scolaires, les programmes scolaires. Ces langues doivent faire partie des éléments de formation scolaire et académique. Lorsque les manuels scolaires et les documents de formation et d’information sont écrits et lus dans les langues africaines cela permet de garantir la vulgarisation, la conservation et la sécurisation des savoirs endogènes, voire des valeurs locales africaines. Ainsi, le vieillard africain ou le sage africain ne s’inquiétera plus, car après sa mort, ses savoirs seront conservés dans les archives, dans ces ouvrages qu’il aura écrits. Ainsi l’émergence africaine devient une auto-émergence. Une émergence qui sera fait pour et par les Africains.
Au regard de ce qui précède, nous retenons que l’émergence est toujours fonction des savoirs endogènes et du capital humain, et qui plus est de l’engagement des intellectuels de toute société.
Conclusion
À l’issue de cette analyse sur le sujet suivant : « De la réappropriation critique des savoirs endogènes : une théorie de l’émergence. », nous avons relevé, d’abord, que la question de l’émergence est une aspiration universellement partagée dans la mesure où le souci de tout peuple est son développement qui favorisera sa reconnaissance et son respect chez les autres. Ensuite, nous avons montré l’émergence dans le contexte africain. Le continent africain, depuis l’accession à l’indépendance de ces différents pays, est en quête de recouvrer son identité perdue pendant la période coloniale. Cette recherche inlassable de son identité a pour aboutissement la reconnaissance des valeurs africaines. Enfin, le troisième point met en exergue une théorie de l’émergence. Ici, nous concevons l’émergence comme une étape d’un processus dont la première assise ou le premier fondement réside dans une réappropriation critique des savoirs et savoir-faire endogènes. Cependant, pour y parvenir la responsabilité de l’intellectuel africain s’avère nécessaire, car il se pose comme le garant de sa société.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons admettre que toute reconnaissance est fonction du niveau d’émergence d’un groupe, d’une nation, d’un pays, d’un continent. Vouloir sa reconnaissance, c’est se donner les moyens de son émergence, aux plans psychologique et matériel.
Références bibliographiques
ATANGANA Nicolas, 1971, Travail et développement, Yaoundé, CLÉ.
DIAKITÉ Samba, 2016, Les larmes de l’éducation : Contribution à l’éthique professionnelle en enseignement, Saguenay, Différance Pérenne.
DIBI Kouadio Augustin, 1994, L’Afrique et son autre : La différence libérée, Abidjan, Éd. Strateca diffusion.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1939, La phénoménologie de l’esprit, traduction de Jean Hyppolite, Tome1, Montaigne, Paris.
HONNETH Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, Traduit de l’allemand par Pierre Rusch, Paris, CERF.
HOUNTONDJI Jidenu Paulin, 1980, Sur la «philosophie africaine» : critique de l’ethnophilosophie, Yaoundé, CLÉ.
HOUNTONDJI Jidenu Paulin, 1994, Les savoirs endogènes : pistes pour une recherche, Dakar, CODESRIA.
HOUNTONDJI Jidenu Paulin,1997, Combats pour le sens : un itinéraire africain, Cotonou, Éditions du Flamboyant.
HOUNTONDJI Jidenu Paulin, 2000, Économie et société au Bénin : le Bénin d’hier à demain, Paris, L’Harmattan.
KABOU Axelle, 1991, Et si l’Afrique refusait le développement ?, Paris, L’Harmattan.
KANT Emmanuel, 1989, Fondement de la métaphysique des mœurs, traduction par Victor Delbos, présentation et commentaires de Pierrette Bonet, Paris, Nathan.
KI-ZERBO Joseph, 1992, Les nattes des autres, Pour un développement endogène en Afrique, Dakar, CODESRIA.
KI-ZERBO Joseph, 2003, À quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein, Paris, L’Aube.
MARX Karl, 1977, Le manifeste du parti communiste, Paris, Ed 10/18.
NJOH-MOUELLE Ébénézer, 1970, De la médiocrité à l’excellence, Essai sur la signification humaine du développement, Yaoundé, CLÉ.
NJOH-MOUELLE Ébénézer, 2000, Considérations actuelles sur l’Afrique, Yaoundé, CLÉ.
TONME Shanda, 2008, La crise de l’intelligentsia africaine, Paris, L’Harmattan.
RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ KWAME NKRUMAH
Akpa Akpro Franck Michaël GNAGNE
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
fmgnagne@yahoo.fr
Résumé :
L’Afrique, caractérisée par les replis identitaires, en proie au néocolonialisme et au sous-développement, retrouve une seconde jeunesse dans le concept d’émergence comme voie indiquée pour aller au développement. Notre contribution qui prend appui sur le consciencisme en tant que est l’idéologie qui conduit au panafricanisme de Nkrumah articule le développement à la reconnaissance de soi comme être pour la vie.
Mots-clés : Consciencisme, Développement, Émergence, Panafricanisme, Néocolonialisme, Reconnaissance, Repli identitaire.
Abstract :
Africa, characterized by isolationism, a prey to neo-colonialism and under development, found a second youth in the concept of emergence as indicated route to go to development. Our contribution is based on the consciencism Nkrumah and Pan-Africanism articulates the development of self- recognition as being for life.
Keywords: Consciencism, Development, Emergence, Panafricanism, Neocolonialism, Recognition, Identity repli.
Introduction
Le concept de « développement » n’est pas un concept vide de sens. Il exige de nous une méthodologie qui désigne en terme pratique, des valeurs à développer chez les citoyens de chaque État et qui s’extérioriseront par des actes ou des attitudes utiles à la réalisation de soi et contribueront efficacement au bien-être social, à l’édification de la communauté toute entière. Le développement donc, exige une attitude conséquentialiste qui se traduit par la quête de soi et la reconnaissance d’Autrui. Cela suppose de considérer, de prendre en compte les intérêts de l’autre et de favoriser son intégration sociale. Ces soucis de quête de soi et de reconnaissance de l’Autre sont ceux qui nous guideront dans le cadre de cette réflexion portée vers le développement.
Mais, comment le panafricanisme de Nkrumah qui a pour fondement idéologique le Consciencisme peut-il favoriser le soi africain pour un développement harmonieux du continent ? La ferme affirmation de ce soi ne conduit-elle pas à se faire reconnaitre par l’autre ?
En nous appuyant sur le panafricanisme de Nkrumah qui a pour fondement idéologique le Consciencisme, nous nous proposerons de mener notre analyse, de voir les tenants et les aboutissants des problèmes posés ci-dessus.
1. Autour de concept de Reconnaissance
Dans sa quête du sens de la nature pour mieux s’en servir et dans ses réflexions sur la nature de la société dans le but de la développer, l’homme se penche de plus près sur le concept de reconnaissance qui permet de prendre en charge la question du mépris comme l’une des sources des malaises sociaux.
Le terme reconnaissance est composé de trois lexèmes que sont : «Re», «co» et «naissance». Nous prendrons le latin nascere, d’où dérive la racine naissance de ” re-co-naissance”, uniquement dans le sens de produire. En reliant ce sens à celui des deux préfixes “re” (toujours, encore, à nouveau) et “co” (avec, ensemble, en compagnie de, en participation avec, en collaboration avec), nous obtenons la signification suivante : “re-co-naissance” signifie “production toujours recommencée ou renouvelée de quelque chose, en collaboration avec quelqu’un ou avec la participation des autres”.[34] L’homme est ainsi un être en constante quête de reconnaissance de soi.
Le désir de s’intégrer, d’être accepté et de voir ses efforts reconnus par les autres dans la société est propre à l’Homme. Dans l’espace philosophique, on attribut la paternité du concept de reconnaissance à Hegel, notamment à partir de «sa dialectique du maître et de l’esclave». Aujourd’hui, ce concept est re-conceptualisé par Honneth, puis repris par Ricoeur.
Par ailleurs, dans ces ouvrages, Hegel énonçait trois formes de reconnaissance. Mais, peut-on réduit la reconnaissance à trois formes ? À ce sujet, (C. Lazzeri et A. Caillé (2004, p. 91) nous disent qu’
il est possible de soutenir, ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse de travail, qu’il existe trois formes fondamentales de reconnaissance, lesquelles –sans prétendre épuiser la variété de tous les actes de reconnaissance – définissent celles que les hommes considèrent comme les plus importantes et qu’ils classeraient au sommet de la hiérarchie de leurs préférences ordinales.
La reconnaissance comme nous pouvons le constater avec C. Lazzeri et A. Caillé, aurait plusieurs formes et se manifeste dans presque tous les domaines de l’existence humaine, mais c’est par préférences que l’esprit humain l’a réduit à trois formes afin de tenter la saisie dans son contenu et son sens profond.
Par ailleurs, de ces trois formes de reconnaissance découlent trois types de rapports sociaux qui expriment les aspects essentiels de la vie humaine : les rapports sociaux liés à la distribution de formes d’estime sociale aux individus (ce qu’esquisse seulement le Système de la vie éthique), les rapports juridiques liés au statut de la propriété et de la citoyenneté, et les rapports interpersonnels au sein de la famille, que Hegel exprime au moyen de trois catégories : l’éthicité sociale, le droit et l’amour.
C’est dans le sillage de cette tripartition hégélienne que se sont situées la plupart des théories de la reconnaissance, même si elles possèdent d’autres fondements et si elles ont modifié ou élargi la portée des catégories hégéliennes : celle du travail par exemple, a acquis une signification plus large en désignant un ensemble de compétences exprimées dans des tâches individuelles et sociales très variées, au point que cette catégorie peut être tenue pour une forme particulière de distribution de l’estime sociale. Celle de l’amour possède, elle aussi, une signification plus étendue et enveloppe l’ensemble des relations amicales et, plus généralement, des relations propres à la socialité primaire. Celle du droit, enfin, ne se réfère pas simplement à la notion de droits individuels ou de groupe garantissant la possession (comme le soutenait Hegel en 1804), mais s’étend aussi à la notion de citoyenneté, tant nationale que supranationale. (C. Lazzeri et A. Caillé, 2004, p. 91.)
À la suite de ses travaux de jeunesse, Hegel va à nouveau s’illustrer avec un chapitre de la Phénoménologie de l’esprit (1807) traitant de la lutte qu’engagent deux individus pour faire reconnaître l’un à l’autre leur liberté. Ils entrent dans un conflit qui peut prendre la forme d’une lutte à mort et conduire à l’instauration de relations de domination à subordination, c’est-à-dire de maitre à esclave.
La reconnaissance, telle qu’elle se développe dans l’idéalisme allemand avec Hegel, renvoie principalement au fait que le savoir que j’ai de ma propre valeur dépend d’autrui qui l’admet comme telle. C’est donc à juste qu’A. Kojève, (2005, pp. 28-30). L’un des commentateurs reconnus de Hegel, considère la dialectique du maître et de l’esclave comme la clef de la philosophie hégélienne. Finalement, Hegel et certains de ses héritiers comme Axel Honneth considèrent que la reconnaissance constitue l’identité des sujets ; elle est constitutive de l’identité personnelle des sujets.
La reconnaissance comme nous pouvons le voir est ce qui détermine et caractérise l’homme, ses agis et son existence. Par la reconnaissance, l’homme aspire à un mieux-être, il aspire à une existence harmonieuse. La reconnaissance est ce qui donne sens à l’existence et fonde la vie humaine. Pourquoi donc ne pas l’intégrer au cœur du questionnement en Afrique, surtout quand on sait le mépris dont est victime ce continent vis-à-vis d’elle-même et des autres continents ? Kwame Nkrumah, l’un des dirigeants qui a lutté pour la libération du continent africain ne restera pas en marge. Qu’en dit-il alors ? Voyons son approche de la théorie de la reconnaissance et comment compte-t-il l’insérer dans l’être africain et le vécu de l’homme africain.
2. Nkrumah et la Reconnaissance
Même s’il n’en fait pas une analyse systématique, la reconnaissance est un concept important auquel Nkrumah articule le destin du développement de l’Afrique. Mais, comment peut-on l’appréhender chez cet auteur qui adosse le développement du continent africain au panafricanisme ? En quoi la reconnaissance est-elle un facteur de réalisation du développement de l’Afrique ?
La reconnaissance chez Nkrumah se traduit ou se perçoit bien à partir de son consciencisme philosophique. En effet, c’est dans cette philosophie appelée consciencisme que Nkrumah fonde sa théorie de la reconnaissance. Mais comment se présente-t-il ?
La quête de soi et la reconnaissance de l’autre sont au fondement de l’existence, en tant qu’unité de la diversité. Le consciencisme qui se fonde sur la matière n’ignore pas l’être qui est au fondement de la matière et dont la matière n’est qu’une représentation physique. Pour parvenir à la reconnaissance de l’autre être, il faut que l’Afrique arrive à sa propre reconnaissance, c’est-à-dire à prendre conscience d’elle-même, de son être-là au monde. Car, si tel est que la charité bien ordonnée commence par soi, il est d’autant impérieux que la reconnaissance de l’autre commence par l’acceptation de soi et sa reconnaissance personnelle en tant que conscience libre.
Or, l’Afrique s’entre-déchire. De sa substance pensante à sa classe dirigeante en passant par les membres qui la composent, on assiste à un déséquilibre qui renforce le dis-fonctionnement de sa vie spirituelle et sociale et, renforce l’impérialisme dans ses œuvres moribondes qui consistent à anéantir ce qui reste de ses ruines. Tel un Samba Diallo[35] qui, ne se reconnait plus dans ses valeurs traditionnelles ancestrales, dont l’être s’est égaré dans modernité, pour qui l’Occident serait un Éden et l’Afrique une géhenne ; cette Afrique est partagée entre les ruines de ses valeurs traditionnelles ancestrales et la civilisation de l’autre qu’elle convoite, en laquelle elle s’identifie désormais. Elle n’a plus de repère. Elle espère en l’Autre comme voie de son salut. Nkrumah veut remédier à ce mal qui se vit sur le continent et qui est renforcé par la balkanisation (les frontières héritées de la colonisation), les replis identitaires et les guerres de tous genres (religieuses, ethniques, etc.).
Ainsi, le système qu’il propose est ce qu’il a appelé le «consciencisme philosophique». Mais qu’est ce que le consciencisme ? Le consciencisme disait K. Nkrumah (2009, p. 98.) c’est
L’ensemble, en termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettront à la société africaine d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu’ils s’insèrent dans la personnalité africaine. Celle-ci se définit elle-même par l’ensemble des principes humanistes sur quoi repose la société africaine.
À partir de cette philosophie, Nkrumah vise la reconstruction identitaire du continent. Laquelle identité servira de tremplin dans la quête de son être. Elle se pose comme la théorie la mieux indiquée en ce sens qu’elle rassemble en un Tout les identités plurielles à savoir les communautés de race, de culture, de langue. Elle permet la reconnaissance de toutes les identités (traditionnelle, religieuse, etc.) qui constituent la société africaine.
Le consciencisme est donc une synthèse identitaire à partir de laquelle l’Afrique peut s’affirmer comme être, comme un visage. Ce visage s’apparente à celui de l’humain et a besoin de s’affirmer sinon être reconnu parce que portant en lui l’humanité. Ce visage qui s’est reconstitué de ses restes veut aussi saisir l’autre comme un visage qui incarne l’être. Car sans la reconnaissance des différences, il est impossible de bâtir une humanité forte au service de l’être (l’Homme) en tant qu’être dans son existence. Favoriser la reconnaissance de soi à partir de toutes les forces vives qui la composent, reconnaître l’autre culture, l’autre identité, l’autre être, le visage qui n’est pas moi et que je ne suis pas, tel est la mission salvatrice que Nkrumah veut atteindre à partir du consciencisme.
En tant que voie de reconnaissance, le consciencisme est perçu comme le visage Lévinassien, C’est-à-dire qu’il est perçue comme le moyen au travers lequel je prends conscience de moi et de l’autre, de ses droits et ses devoirs. En effet, comme le fait remarquer A. Dibi (1981, p. 20.).
Le visage me rend présent aux choses et les choses présentent à moi. Il est surface à travers laquelle il m’est possible d’entrer en contact avec autrui, avec les choses du monde. Par lui je vois et je suis vu en retour comme étant le même, non l’autre. Le visage exprime, et ce qui s’y exprime, ce qu’il exprime est une présence personnelle que rien, pas même la somme infinie de toutes les expressions possibles des autres visages, ne peut dire.
Vu sous cet angle, l’on peut dire du consciencisme qu’il se veut une éthique de la réciprocité. Cette réciprocité se traduit à travers la reconnaissance en tant que «témoignage de l’humain à l’humain» (Augustin Dibi, 1981, p. 54.) et l’acceptation de l’autre. « C’est dire que sur le plan moral et politique, le consciencisme est la conception qui veut que l’on accepte la nécessité de prendre l’homme (l’Autre) comme fin pour le libérer de tout asservissement matériel et psychologique…» (A. S. Touré, Novembre 1972, p. 21.)
Le consciencisme donc, incarne les valeurs d’«humanisme», les quelles valeurs sont au fondement de permettra aux Africains de prendre conscience de leur être, d’eux-mêmes, de leur réalité intrinsèque, de leur réalité politique, sociale, économique et spirituelle, et de voir en l’autre, l’Humain. À l’instar de la conscience historique, le consciencisme permettra de reconstituer le corps d’Osiris qui a été dépecé et qui a été dispersé dans le cosmos. Il nous permettra de reconstituer l’Unité de l’Afrique. Laquelle Unité sera gage de son développement.
Cependant, en quoi peut-on affirmer que l’Unité chez Nkrumah conduit-elle au développement de l’Afrique ?
3. Le Panafricanisme comme Prolégomènes à un véritable développement en Afrique
Qu’est-ce que le développement ? Plusieurs approches définitionnelles s’imposent quant à cette interrogation. Cependant, il convient de retenir que le développement est avant tout une nécessité historique. En effet, toutes les sociétés humaines ont toujours œuvré dans le sens d’une existence meilleure, qualitative. Elles ont toujours rêvé le progrès et le bien-être. Ce fait, donne au développement une connotation non seulement individuelle mais surtout collective. Le développement devient la condition d’existence d’un individu qui assiste à une amélioration qualitative, une croissance de son mode de vie et, d’une société qui assiste à la réalisation de ses aspirations.
Cette pensée est bien théorisée par Ahmed Sékou TOURÉ, lors ce qu’il affirme que : « le développement constitue une vision globale des activités d’un Peuple en tant qu’entité homogène, totale et dont les dimensions doivent sans cesse s’accroître sans porter la moindre atteinte aux intérêts universels aux intérêts des autres Peuples». (A. S. Touré, Op. cit., Novembre 1972, p. 105.). Le développement donc est la dualité individualité-collectivité qui vise le bonheur de l’Homme. Cependant, pour parvenir à ce système de liberté et d’épanouissement de l’homme, il faut bien une attitude à adoptée. En effet, «le développement exige une conscience une mentalité de développement. Aucun homme ne peut se développer à l’insu de soi-même» (A. S. Touré, Op. cit., Novembre 1972, p. 112.). Mais que donne de constater la situation de l’Afrique ?
Le mouvement dans lequel est embarquée l’Afrique c’est le développement, et celui-ci est, le plus souvent, entendu dans le sens d’une accumulation de richesses d’un accroissement quantitatif. De cette façon, il n’est plus saisi que dans sa sphère économique. Son arme est la technique dont le mode de relation à la nature est la domination. (A. K. Dibi, Op. cit., p. 67.)
À voir de plus près cette pensée d’Augustin DIBI, nous réalisons que l’Afrique ne peut se soustraire de ce mouvement à caractère Impérialiste. Saisie sous cet angle, la nécessité pour l’Afrique de penser son développement se pose, «ce qui veut dire : le reconduire à l’unique sol de crédibilité qui puisse le fonder.» (A. K. Dibi, Op. cit.)
Quelle est cette crédibilité qui puisse fonder le développement ? Sinon, quelle est la nature du développement ? «… Le développement est une totalité organique de nature spirituelle.» (A. K. Dibi, Op. cit., p. 68.) Ce que révèle cette pensée, c’est qu’on ne peut concevoir le développement dans la particularité. C’est dans la différence et la relation à l’autre qui se traduit par l’ouverture que l’Afrique pourra poser les fondements de son développement. En tant que totalité, elle est l’ensemble des différences identitaires qui partent de sa propre identité à la reconnaissance de l’autre. C’est bien cette reconstruction identitaire à travers le processus de la quête de soi, de sa réalité ontologique et de la reconnaissance de l’autre en tant que l’autre moi donc mon alter-ego, qui est essentiellement fondée sur la réciprocité, qui donne au développement son fondement spirituel. Vu sous cet angle, en quoi peut-on affirmer que le panafricanisme de Nkrumah serait l’outil efficace pour accéder au développement de l’Afrique ?
Le panafricanisme de Nkrumah ou Unité politique de l’Afrique est la planification, la méthodologie de l’action qui est accompagné du choix prioritaire des objectifs à réaliser en Afrique. Des objectifs qui ne sont à inventer, à s’imposer arbitrairement à la conscience africaine, mais qui découlent d’une analyse objective parce que minutieuse, de la société africaine de son temps et de la nôtre, de ses besoins, de ses possibilités et de ses exigences. C’est donc la mentalité révolutionnaire qui découle du contexte propre à la société africaine en vue de la transformer. Ainsi, pour cette Afrique en quête de soi, de son Identité perdue, le panafricanisme de Nkrumah se pose comme la voie appropriée dans la reconstruction de sa personnalité.
En effet, violentée du dehors et du dedans par les Impérialistes, cette Afrique, après avoir été sujette à la traite négrière, à l’esclavage, à la colonisation et aujourd’hui en proie à la néocolonisation, a perdu l’essence même de sa personnalité et le goût de son existence. Son être est à l’image de l’aveugle qui sombre dans l’obscurantisme, en tâtonnant à la demande d’un secours, d’un guide, d’un être éclairé qui le conduira à destination. Mais, une fois arrivé à cette destination souhaitée, cet aveugle sollicitera à nouveau de l’aide pour se déplacer, manger et faire ses besoins les plus naturels et utiles.
C’est suite à ce constat d’une Afrique déchirée et dispersée dans son être, son être-là dans le monde qui la maintient au stade d’éternel assisté que, Nkrumah propose le panafricanisme. Il permettra à l’Afrique de retrouver sa seconde jeunesse, en l’aidant à se reconstruire intérieurement, et lui permettre de rassembler ses restes en un tout, une unité bien structurée et bien consolidée, à reconstituer son Identité chiffonnée. C’est seulement avec le panafricanisme comme socle idéologique, que ce continent pourra assoir les bases ou les fondements de ce qui serait appelé son développement futur.
Sans une identité, une personnalité et une représentation forte, aucun peuple ne peut s’imposer et penser son développement à cette heure de la mondialisation impérialiste. Si l’Afrique veut se développer, elle doit faire violence sur elle-même pour arriver à son Unité politique, gage de sa survie. Comme l’écrit Nkrumah (L’Afrique doit s’unir, 2009, p. 254) : « la survivance de l’Afrique libre, les progrès de son indépendance et l’avance vers l’avenir radieux auquel tendent nos espoirs et nos efforts, tout cela dépend de l’unité politique. » Le panafricanisme permettra à l’Afrique de se reconstruire et aider les autres peuples à leur réalisation.
Conclusion
L’Afrique ne peut connaître une voie de salut qu’en affrontant son propre présent. Elle doit se savoir embarquer dans un mouvement de développement qui ne dépend pas tout à fait d’elle, mais qu’elle lui faut pourtant assumer. En d’autres termes, elle doit faire de sorte que la nécessité devienne liberté, que son existence soit libre, quoique nécessaire. Pareille transfiguration ne vient au jour qu’en se pensant soi-même intégralement. (A. K. Dibi, 1981, p. 67.)
C’est cette voie que Nkrumah s’est attelé à nous montrer à partir du Consciencisme et du panafricanisme. Il nous propose le chemin de notre propre saisie en tant que identité particulière, nous montre l’importance et la nécessité de cette construction identitaire qui a besoin aussi de l’autre, de le reconnaître dans sa différence. Cette reconnaissance se présente comme l’attitude la plus indiqué et la mieux structurée dans le parcourt vers le développement parce que, il n’existe nulle part de développement dans une société de «mépris».
Références bibliographiques
DIBI Kouadio Augustin, 1981, L’AFRIQUE ET SON AUTRE : La différence libérée, Abidjan, Strateca diffusion, « Collection penser l’Afrique N°1 ».
HONNETH Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Édition le Cerf.
HONNETH Axel, « Reconnaissance », in M. Canto-Sperber, 2001, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF.
HONNETH Axel, « La théorie de la reconnaissance: une esquisse », in Revue du MAUSS 2004/1 (no 23), p. 133-136. DOI 10.3917/ rdm. 023.0133 in http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-1-page-133.htm
HONNETH Axel, « Sans la reconnaissance, l’individu ne peut se penser en sujet de sa propre vie », contribution à Nouveau millénaire, Défis libertaires, propos recueillis par Alexandra Laignel-Lavastine in www.philomag.com/article,entretien,axel-honneth-sans-la reconnaissance-l-individu-ne-peut-se-penser-en-sujet-de-sa-propre-vie,180.php, consulté le 30 Janvier 2016 à 9h.
KOJÈVE Alexandre, 2005, Commentaire de la Phénoménologie de l’Esprit (Section A du Chap. IV) in Introduction à la lecture de Hegel 1947, Paris, Gallimard.
LAZZERI Christian et CAILLÉ Alain, « LA RECONNAISSANCE AUJOURD’HUI. Enjeux théoriques, éthiques et politiques du concept », in Revue du MAUSS 2004/1 (no 23), p. 88-115.DOI 10.3917 /rdm. 023.0088 in http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-1-page-88.htm
NKRUMAH Kwame, 1994, L’Afrique doit S’Unir, Paris, Présence Africaine, première édition 1964, dernière édition « Collection Panafricanisme ».
NKRUMAH Kwame, 1976, Le Consciencisme, Paris, Présence africaine, première édition 1976, dernière édition «Collection Panafricanisme».
RENAULT Emmanuel, « La reconnaissance au cœur du social », Article de la Rubrique « Luttes pour la reconnaissance », Mensuel N° 172 – Juin 2006, in http://www.scienceshumaines.com/articleprint2.php?lg=fr&id_article.
RICŒUR Paul, 2004, La lutte pour la reconnaissance et l’économie du don, Paris, Unesco.
RICOUER Paul, 2004, Parcours de la reconnaissance, Trois études, Paris, Les Éditions Stock.
RITZ Mahaut, « Reconnaissance et identité. Deux concepts critiques dans la philosophie d’Axel Honneth », Mémoire de Master 1 Philosophie. 2012, in http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00778482, mis en ligne le 20 Janvier 2013.
TAYLOR Charles, 1994, « La politique de la reconnaissance », in Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Aubier.
SOUS-THÈME III : GOUVERNANCE ET UTOPIE
SOCIÉTÉ CIVILE ET GOUVERNANCE DE LA CHOSE PUBLIQUE CHEZ SPINOZA : POUR UNE ÉMERGENCE DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE
Assanti Olivier KOUASSI
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
assantikouassi@gmail.com
La société civile est une valeur de la participation des citoyens dans l’espace politique par la recherche de l’intérêt général, d’un intérêt commun, ou encore la défense d’intérêts particuliers. Une telle approche met l’accent sur les valeurs chères à Spinoza à savoir la liberté, les droits inaliénables, la gouvernance de la chose publique et la démocratie. Mais aussi, toute société civile forte repose sur une citoyenneté accomplie et responsable. L’émergence d’une bonne gouvernance dans un quelconque État passe nécessairement par la démocratie et l’implication d’une société civile responsable.
Mots-clés : Afrique, Bonne gouvernance, Citoyenneté, Démocratie, Émergence, État, Société civile, Spinoza.
Abstract :
The civil society is a value of the participation of citizens in the political space through the seeking of a general interest, a common interest, or the defense of particular interests. Such an approach emphasizes the values dear to Spinoza, namely freedom, inalienable rights, governance of public affairs and democracy. But also, any strong civil society relies on an accomplished and responsible citizenship. The emergence of good governance in any state necessarily involves democracy and the involvement of a responsible civil society.
Keywords: Africa, Good governance, Citizenship, Democracy, Emergence, civil society, Spinoza.
Introduction
L’expression « société civile » a une histoire longue de plus de trois siècles, au cours de laquelle sa signification a fortement varié. En effet, la société civile s’opposait à la société naturelle[36], en faisant de la première le dépassement de la nature, la société bien ordonnée, capable de maîtriser les passions naturelles. Cette société civile selon Spinoza, n’est pas le strict opposé de l’état de nature mais une continuité garante de la protection des droits individuels, que chacun possède dans l’État de nature.
La société civile est un concept en perpétuel évolution. Le schéma ci-après permet de synthétiser l’ensemble des évolutions du concept. Il se lit selon trois axes structurés autour de jeux d’opposition : la société civile est société « évoluée » face à une société « arriérée » ; la société civile s’oppose à l’État ; la société civile s’oppose au marché. En effet, le premier axe renvoie aux théories du contrat développées par les philosophes politiques, en l’occurrence Hobbes, Locke et Rousseau. Le second pourrait être rattaché à Hegel distinguant société civile et société politique (conçue comme ensemble des institutions étatiques). D’après Hegel, ce concept désignait un espace indépendant, hors de la sphère naturelle de la famille et de la sphère, plus élevée, de l’État: les citoyens peuvent, en tant que personnes privées, y poursuivre leurs intérêts particuliers légitimes (en premier lieu, leurs intérêts économiques), aplanir leurs différends et, dans une certaine mesure, régler leurs affaires. La société civile jouait un rôle, dans la structuration de ses intérêts, d’intermédiaire entre l’individu et l’État.
Souscrivant au troisième axe, J. Planche, (2007, p. 12), affirme que « La société civile, lieu de l’association volontaire des citoyens selon leurs intérêts, inclut les activités économiques ». Et selon l’entendement de J. Planche, (2007, p. 17), « ces trois axes sont apparus successivement au cours de l’histoire du concept mais, loin de s’exclure mutuellement, les définitions et les clivages se sont superposés, d’où la complexité des définitions actuelles et la diversité des appréhensions de cette notion ». Les définitions de la société civile sont multiples : association, tiers secteur, acteurs non étatiques, organisations non gouvernementales, secteur non lucratif.
Au-delà de son rôle de régulateur de la vie politique, la société civile, dans certains pays, se veut une alternative face à l’échec du politique. Ainsi, elle peut faire émerger la démocratie avec toutes ses facettes, la transparence et la bonne gouvernance. D’où, le constat selon lequel les rôles des sociétés civiles peuvent être multiformes et orientés en fonction des aspirations des acteurs engagés. Spinoza (1966, p. 109), décrivait la société civile comme un conseil de syndics pour satisfaire aux conditions de gestion des affaires publiques de « façon que le glaive ne soit pas au pouvoir d’une personne naturelle mais d’une personne civile dont les membres sont nombreux pour qu’ils ne puissent pas se partager l’État ou s’accorder pour un crime ».
Au regard de l’interventionnisme étatique centralisé qui a cours en Afrique, l’apparition d’une société civile composée d’une multitude d’acteurs sociaux des plus variés devait ainsi contribuer à l’émergence d’une réelle démocratie dans la perspective spinoziste. Quels sens Spinoza donne-t-il au concept de société civile ? Quelle est l’approche spinoziste de la société civile dans la gouvernance de la Chose publique ? Dans quelles mesures cette approche pourrait-elle contribuer à l’émergence de la démocratie en Afrique ? Au cours de notre réflexion, il s’agira d’abord d’étudier les concepts de société civile et de bonne gouvernance, puis montrer comment l’approche spinoziste de la société civile pourrait favoriser l’émergence de la démocratie en Afrique.
1. LES CONCEPTS DE SOCIÉTÉ CIVILE ET DE BONNE GOUVERNANCE VUS PAR SPINOZA
Les hommes, de par la raison, sont conscients de leur autoconservation. Cette conservation les oblige à utiliser les moyens adéquats pour mettre fin au conflit. Ces moyens consistent dans des abandons et des transferts de droits qui prennent forme dans un contrat. C’est le transfert contractuel qui est le gage de conservation des individus. « Car la nature ne se limite pas aux lois de la raison humaine dont l’unique objet est l’utilité véritable et la conservation des hommes ». (B. Spinoza, 1965, p. 263). Le contrat social présuppose un état de nature préexistant à toute société organisée, avec lequel l’individu rompt.
1.1. La nécessité absolue de l’État civil
La condition suivant laquelle une société observe avec la plus grande fidélité un pacte est que :
L’individu transfère à la société toute la puissance qui lui appartient, de façon qu’elle seule ait, à voir sur toutes choses un droit souverain de nature, c’est-à-dire une souveraineté de commandement à laquelle chacun sera tenu d’obéir, soit librement, soit par crainte du dernier supplice. (B. Spinoza, 1965, p. 266).
C’est par un pacte tacite ou exprès que les hommes transfèrent toute leur puissance à un souverain. C’est parce que les hommes n’arrivent pas à défendre leur droit naturel contre les dangers qui les guettent qu’ils le confient à un souverain. C’est donc par nécessité et par persuasion que les hommes se soumettent à un pouvoir.
Pour éviter donc toute rébellion, il faut accorder la liberté comme élément nécessaire à la reforme et à la conservation des institutions. « Il faut laisser chacun libre de penser ce qu’il voudra et de dire ce qu’il pense». (B. Spinoza, 1965, p. 27).La liberté est le point de départ du transfert de droit. Tout transfert de droit qui ne repose pas sur la liberté serait un transfert mort-né.
Toute cité, tout État civilisé prend sa source dans le transfert des droits. Le contrat social doit être général, c’est-à-dire intéresser la totalité des citoyens et concerner l’ensemble de leurs activités. J.-J. Rousseau (1982, p. 54), ne voit d’humanité que le contrat social dans la mesure où l’homme renonce à sa liberté naturelle en vue de la volonté générale : « enfin chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n’y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force pour conserver ce qu’on a ». Il devient citoyen en jugeant en fonction du bien public et non de son intérêt particulier. L’homme à l’état de nature est bon et c’est la société qui le corrompt, le conduit à agir en fonction de son seul intérêt privé. Le contrat social lui donne la souveraineté et l’engage à renoncer à sa liberté naturelle pour gagner sa liberté civile, à suivre l’intérêt général plutôt que son intérêt particulier.
L’État amène l’homme à rompre avec l’état de nature en changeant la communauté des humains. Aussi une organisation sociale juste repose-t-elle sur un pacte social contracté par l’ensemble des citoyens garantissant l’égalité et la liberté. Sa légitimité se fonde sur le fait que l’homme n’aliène pas au sens propre son droit naturel mais qu’il comprend et accepte que ce pacte social en soit la condition d’existence. La seule voie pour n’être dépendant de personne c’est de l’être de tous, d’être soumis à la volonté générale. Ce faisant, le contrat social donne à chacun le moyen d’une vie digne au sein de la société. Vie digne pour laquelle l’expression de la conscience et la liberté, caractéristiques singulières de la personne humaine, sont les éléments essentiels.
La mutation de l’état de nature en état de droit s’accompagne par le contrat, et ce contrat exprime, avec une force jamais égalée, l’idée de légitimité du consentement. C’est la liberté du consentement qui fonde l’État. On n’a vu de façon générale, que le lien social dans l’état de nature se caractérise par le fait que les hommes ont besoin les uns des autres pour vivre mais qu’ils ne peuvent vivre les uns les autres sans désirer s’assujettir. L’État est leur seule chance.
Tous les hommes redoutent la solitude parce que nul d’entre eux dans la solitude n’a de force pour se défendre et se procurer les choses nécessaires à la vie. Il en résulte que les hommes ont de l’état civil un appétit naturel et qu’il ne peut faire que cet état ne soit jamais entièrement dissous. (B. Spinoza, 1966, p. 41).
Cependant, il existe certains liens sociaux de nature Privilégiée. La famille constitue l’un d’entre eux et elle est un moyen fondamental de préservation pour l’individu. Si chacun est protégé par sa famille, il n’a pas besoin de renoncer à son droit surtout parce qu’il n’assure pas sa défense dans les mêmes conditions que s’il était seul. Les risques sont bien moins grands. Dans ce cas, pourquoi l’individu a besoin d’un pouvoir civil pour se conserver ? Lorsque Spinoza (1966, p. 98), se demande en quoi les citoyens sont égaux en droit au sein du corps politique, il explique que « les citoyens peuvent être égaux, parce la puissance de chacun comparée à celle de tout l’État ne mérite pas considération ». On peut dire qu’il en va de même dans l’état de nature du point de vue de la comparaison individu-multitude. Nul ne dispose d’assez de puissance pour pouvoir éviter, en toutes circonstances, que des individus ou groupes d’individus ne lui extorquent une aliénation de droit.
L’homme aussi bien à l’état naturel que dans l’état civil agit selon les lois de sa nature et veille sur ses intérêts, car dans chacun de ces deux états c’est l’espérance ou la crainte qui le conduit à faire ou à ne pas faire ceci ou cela et la principale différence entre les deux états, est que dans l’état civil, tous ont les mêmes craintes, et que la sécurité a pour tous les mêmes causes, de même que la règle de vie est commune. Ce qui ne supprime pas la faculté de juger de chacun. « Qui a décidé en effet d’obéir à toutes les injonctions de la cité, soit qu’il redoute sa puissance, soit qu’il aime la tranquillité, veille à sa propre sécurité et à ses intérêts suivant sa complexion». (B. Spinoza, 1966, p. 26).
Pour Spinoza, dans l’état de nature, on le sait, les hommes sont dominés par la puissance de leurs affects passifs et la puissance même de la raison n’est pas assez forte pour s’imposer à eux. Or les hommes passionnés ne peuvent conclure de contrat. C’est pourquoi les causes de l’État ne sont pas recherchées dans « des enseignements, de la raison, mais de la nature commune des hommes, c’est-à-dire de leur condition». (B. Spinoza, 1966, p. 14).
Il dit aussi que :
Les hommes étant, conduits par l’affection plus que la raison, il suit de là que s’ils veulent vraiment s’accorder et avoir en quelque sorte une âme commune, ce n’est pas en vertu d’une perception de la raison, mais plutôt d’une affection commune telle que l’espérance, la crainte, ou le désir de tirer vengeance d’un dommage souffert. (B. Spinoza, 1966, p. 41).
C’est pourquoi concernant l’état civil, il maintient toujours le droit naturel dans la cité. L’état civil est une continuation de l’état de nature. Il n’existe pas de rupture radicale entre les deux états. L’état civil n’est pas un artifice. La cité est un individu mais cet individu n’est ni artificiel, ni naturel à la manière d’un organisme. Spinoza supprime toute artificialité, toute surnature de son système mais conçoit la nature humaine à la fois comme réalité et comme modèle. Dans la perspective spinoziste, les hommes ne peuvent pas vivre en dehors de quelques droits qui leur soient communs : « les hommes en effet sont faits de telle sorte qu’ils ne puissent vivre sans aucune loi commune ». (B. Spinoza, 1966, p. 12). Même si la majorité des hommes sont dominés par des passions qui les agitent dans des directions les plus contradictoires, le besoin de vivre ensemble leur est inhérent.
1.2. Le sens et rôle de la société civile
Elle supposait un ordre social bien organisé qui protégeait les individus des dangers de la société naturelle. C’est un contrat qui produit la société civile en instituant un souverain. Toutefois, la société n’est pas seulement politique par la sécurité qu’elle offrait au citoyen, elle était aussi économique car elle garantissait la préservation de la propriété privée[37].
L’idée d’une société civile conçue comme une sphère d’action à différencier de l’État est née pendant le siècle des Lumières (aux 17 et 18èmes siècles). Elle acquit son caractère moderne, grâce à un auteur comme John Locke. Il y était question d’une société, dans laquelle les êtres humains vivent ensemble dans une communauté de citoyens qui ont droit à la parole. Ces derniers doivent ainsi être libres et autonomes, jouir du droit d’association, de coopération et de décider des questions les plus importantes dans le débat public. Ils doivent, par ailleurs, être capables de réaliser une cohabitation caractérisée par la tolérance et l’égalité sociale, dans le respect total du droit, mais sans une trop grande pression exercée par l‘État. L’auteur insiste ainsi sur l’autonomie des citoyens et de leurs groupes. L’autonomie, par rapport à l’État, de la sphère privée et économique que représente la société, joue en effet un rôle particulièrement important. Aussi, ces droits de l’homme susmentionnés sont une reprise des droits naturels inaliénables qu’évoquait Spinoza (la liberté d’expression, la liberté de penser, la liberté religieuse, la propriété, la prise de décision hautement politique). Les droits de l’homme sont le produit de la modernité.
En effet, aucun maître ou souverain ne peut parvenir à extorquer sans dommages les droits fondamentaux. Car pour des droits qui relèvent de la raison, il apparaît impossible de les transférer à quiconque. Il serait absurde, parce que totalement impossible, que les gouvernants exigent que leur soit transféré le droit de faire produire à la raison autre chose. C’est pourquoi l’expression libre des croyances et des opinions reste fondamentale chez Spinoza.La présente déclaration est l’aboutissement d’une lutte débutée par Spinoza et bien d’autres. Car la déclaration universelle des droits de l’homme dit ceci :
Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites[38].
La société civile perçue sous l’angle d’une idée ou d’un projet, a connu une évolution temporelle et continue de se réinventer d’un espace géographique à un autre en fonction du contexte socio-politique, des enjeux économiques et de la dynamique relationnelle entre les acteurs sociaux et les politiques. Elle est souvent caractérisée d’ambiguë au regard de sa connotation qui s’adapte aux faits sociaux d’une période précise. Au cours de la modernité, la société civile faisait l’objet de réflexion portée par les théoriciens du contrat social.
Ainsi, elle était opposée à l’État de nature, pour signifier toute société politiquement organisée. En Occident l’évolution de la société civile s’est associée à des faits historiques tels que la révolution industrielle, le développement de la bourgeoisie, des villes et en l’occurrence la séparation de la vie politique de la vie civile. Pour certains, la société civile est un creuset dans lequel l’ensemble des institutions (famille, entreprise, association…) où les individus poursuivent des intérêts communs sans interférence de l’État. (F. Rangeon, 1986, p. 11). Pour d’autres, la société civile n’est pas en marge du corps étatique tant dans son champ de compétence que dans la définition de ses objectifs mais plutôt le lieu où le privé et le public s’interpénètrent. (J. Freund, 1965, p. 299).
La société civile participe du refus de plus en plus fortement exprimé de tout ce qui, dans l’organisation et le fonctionnement de la vie publique, peut entraver la réalisation des aspirations légitimes des individus. Elle est pour l’affirmation pleine et entière de l’autonomie des citoyens.
Le développement et la consolidation de la société civile sont en rapport avec le processus de construction de la démocratie dans les sociétés modernes. La démocratie ne dépend pas seulement de formes, lois et procédures mais elle reçoit sa substance et son dynamisme dans les mouvements sociaux et des aspirations des citoyens qui agissent comme forces politiques. Car
la puissance du nombre, on a coutume de l’appeler pouvoir public, et celui-là possède absolument ce pouvoir, qui, par la volonté générale, a le soin de la chose publique, c’est-à-dire le soin d’établir, d’interpréter, et abroger les lois, de défendre les villes, de décider de la guerre et de la paix, etc. si ce soin appartient à une assemblée composée de toute la masse, le pouvoir public est appelé démocratie. (B. Spinoza, 1966, p. 21).
La société civile est donc cette volonté des citoyens de reconquérir la société sur l’État. Elle le fait en multipliant et élargissant sans cesse leurs espaces d’autonomie, d’initiative et de responsabilité. « La société civile se dote de moyens institutionnels, légaux et juridiques susceptibles de constituer pour eux, un rempart inexpugnable de la terreur et la dictature », (B. Spinoza, 1966, pp. 106-107).
La société civile est une entité qui joue un rôle d’intermédiation entre l’État et le citoyen. C’est en effet à travers les multiples composantes de la société civile – syndicats, associations professionnelles, ligues des droits de l’homme, ONG de développement, organisations féminines, pour ne citer que celles-ci qu’un changement s’est opéré au niveau de la gestion politique et économique de la plupart des pays de la sous-région. Il s’agit ici de la socialisation démocratique et participative des citoyens. On peut également la décrire comme étant l’exigence d’une excellence en matière de culture politique. On entend par là une augmentation de l’intérêt général pour la politique, c’est-à-dire, une augmentation de la motivation et de la capacité à participer à l’événement politique. Par ailleurs, dans ce contexte, la société civile est considérée, comme déjà chez Tocqueville, comme une école de la démocratie. Cette dernière servirait, parallèlement au renforcement de la démocratie, à recruter de manière ciblée des élites démocratiques destinées aux instances de décision étatiques. Comme exemple pour la fonction de participation, on peut citer celle, directe, de représentants du secteur civil à la formulation de projets de loi et autres réglementations ou décisions. La société civile est cette actrice autonome qui joue un rôle d’intermédiaire entre la société et l’État mais sans se substituer à lui, notamment dans les secteurs exigeant une gestion plus souple, plus autonome et plus personnalisée.
1.3. La société civile, une actrice de la gouvernance rationnelle de la chose publique
La bonne gouvernance est un souci d’efficacité, de transparence et de responsabilité citoyenne qui doit être le principal moteur des actions de l’État, de ses hommes et de ses institutions, mais aussi de celles des associations et représentants de la société civile. La gouvernance est un concept éminemment institutionnel dans le sens où ce sont les acteurs dominants de l’arène politique, les Institutions Financières Internationales, qui ont placé ce thème sur l’agenda politique il y a une dizaine d’années. Ce concept est apparu tout d’abord dans les discours des institutions. Progressivement, il a été traduit dans leurs stratégies, leurs programmes, leurs plans d’action, leurs indicateurs, leurs modes d’évaluation…
Cependant, au XVIIème siècle déjà, l’idée de bonne gouvernance s’exprimait sous la plume de certains philosophes. Spinoza se souciait de la gestion qualitative, donc rationnelle de la Cité en préconisant une gestion pour le mieux de la chose publique. « Autre chose est de commander en vertu de son droit et d’avoir la charge des affaires publiques, autre chose est de commander le mieux possible et de gouverner le mieux possible la chose publique ». (B. Spinoza, 1966, p. 37). Il suit clairement de ce qui précède, qu’en déclinant les manières de gouverner, notre philosophe montre sa préférence pour la bonne gouvernance.
Aujourd’hui, l’exigence de bonne gouvernance est d’ordre global et pas seulement national ; la démocratie, la citoyenneté ne se développent nulle part en vase clos, mais en interaction avec les évolutions mondiales, voire en coopération internationale entre acteurs nationaux et transnationaux. De plus, l’ouverture des frontières économiques et médiatiques, les regroupements régionaux, le développement des institutions mondiales dans pratiquement tous les domaines importants. Bref, la globalisation dans toutes les significations érodent peu à peu la souveraineté des États nationaux et soumettent leurs gouvernements à une obligation de compétitivité, voire de viabilité globale des entités politiques. C’est pourquoi, aujourd’hui « le concept de société civile est souvent utilisé dans le cadre de la démocratie, et ces dernières années surtout, il est de plus en plus lié à la bonne gouvernance ». (N. Cevetek et Friedel Daiber, 2009, p. 19).
2. POUR UNE ÉMERGENCE DÉMOCRATIQUE DE L’AFRIQUE À PARTIR DE SPINOZA
Spinoza exige la participation des citoyens à la gestion de la vie politique en la posant comme un principe incontournable de la défense et la promotion des droits individuels, par conséquent de la démocratie. En effet, pour le philosophe juif, « remettre à quelqu’un sans réserve la chose publique et garder la liberté c’est tout à fait impossible ». (B. Spinoza, 1966, p. 68).
2.1. La bonne gouvernance, une exigence de la démocratie
La société civile a une fonction importante dans la démocratisation, surtout au niveau local. « Dans les jeunes démocraties, cette fonction reste souvent tributaire de l’évolution de la démocratie au niveau national où les initiatives de citoyens constituent également un exemple concret ». ». (N. Cevetek et Friedel Daiber, 2009, p. 11).
Dans ce contexte, des séances d’information sont souvent organisées, pour informer l’opinion publique sur un sujet particulier. Elles contribuent ainsi au processus de formation de l’opinion et de la volonté publiques. D’autres groupements (locaux), qui organisent par exemple une séance de discussion hebdomadaire ou mensuelle, appartenant à la société civile, produisent également un travail actif au service de ce processus de formation de l’opinion et de la volonté publiques.
En Afrique l’histoire de la société civile intègre le débat politique et scientifique avec l’avènement du processus de démocratisation. En effet, la société civile a vu le jour dans le cadre des processus de transition socio-politique historiques à savoir le passage du parti unique à la démocratie pluraliste. L’idée de la société civile politique en Afrique voit le jour dans un contexte sociopolitique fragile puisque sa mission était de consolider le processus démocratique enclenché dans certains pays. D’un espace géographique à un autre, elle jouera des rôles différents.
Au Bénin, elle a été initiatrice de la conférence nationale des forces vives de 1990 qui a favorisé l’avènement du multipartisme et marque la transition entre la dictature politique et la démocratie. Au Bénin, la conférence nationale des forces vives a permis de « créer un espace libéralisé de la parole afin que soient définis les grands principes cadres de l’État garant des droits de l’homme ». (T. V. Togonou, 2016, p. 71).
Dans d’autres espaces géographiques comme le Sénégal et au Burkina-Faso, les sociétés civiles se sont interposés à des coups d’États constitutionnels à travers un nouvel activisme de mouvements citoyens tels que « Y EN A MARRE, BALAI CITOYEN ».Ces mouvements de jeunes citoyens ont été catalyseurs d’un nouvel élan démocratique et ont désacralisé le débat politique longtemps pris en otage par des élites, et les entrepreneurs politiques.
Dans beaucoup de pays de l’Afrique de l’ouest, la société civile a été à la tête des revendications populaires. Elle a participé à la bonne marche des élections, à la résolution des conflits et à l’instauration d’une nouvelle culture dans la prise de décisions déterminant le développement socio-économique (discussions des États avec l’Union Européenne sur la convention de Lomé, les accords de l’OMC, participation aux grandes assemblées telles que la Conférence Afrique-France, Conférence de l’ONUDI, etc.)
La société civile devient, par ailleurs, un complément important à la simple représentation d‘intérêts des citoyens au Parlement. En effet, au niveau de cette instance, les désidératas des citoyens ne peuvent pas être toujours pris en compte. Cette pensée s‘inscrit dans l’idée fondamentale du pluralisme politique, un des éléments-clés d’une démocratie. Au sein d’un pluralisme politique, on prend comme point de départ les différents intérêts et idéologies politiques qui existent au sein de la société. Ce pluralisme n’est pas appréhendé comme étant un phénomène négatif comme dans un système autoritaire, par exemple.
L’articulation, la représentation et la réalisation de ces intérêts est légitime, et même expressément souhaitée, même s’il ne s’agit que de garantir la liberté d’expression des minorités, au moins. Cette dernière pourrait, en effet, être considérablement réduite, à cause des systèmes de décision par voix majoritaire, si l’équilibre n’était pas rétabli par l’existence de ce pluralisme d’intérêts. L’articulation et la représentation des intérêts s’effectuent à travers les partis politiques et leurs domaines principaux. Mais il y a aussi, en plus, les organisations et clubs de la société civile, qui représentent des intérêts particuliers, face à l’État. La société civile devient ainsi ce «Moteur de la Démocratie» tant prisé, mais elle est aussi sa source d’énergie et son fondement même. Car une démocratie ne se maintient pas du fait qu’elle soit une machinerie d’institutions et de rituels politiques : Les êtres humains qui y vivent, doivent vivre la démocratie et pouvoir vivre aussi. Ils doivent participer et affirmer leurs intérêts. Cela s’effectue, en premier lieu, par un engagement dans des organisations de la société civile. Il est vrai que l’État est indispensable pour garantir les droits des citoyens ; mais il ne peut et ne doit d’ailleurs pas tout régir. Ainsi, plus de démocratie ne signifie pas « plus d‘État », mais plus de répartition des tâches entre l’État, la société et ses citoyens.
C’est pourquoi, la société civile n’est pas la composition d’organisations suscitées directement par le pouvoir, par d’autres forces politiques. Elle ne fait donc pas allégeance. L’État par les moyens démocratiques notamment la liberté d’expression et le respect des droit de l’homme devrait favoriser le développement de la société civile et non que la société civile ne devienne un alibi mais une réalité tangible. L’idée de société civile ne doit pas être trustée par les gouvernements, en quête d’apparence et de conformité par rapport à des standards internationaux, aussi bien un discours démocratique par des régimes qui le sont peu ou pas du tout. On ne peut raisonner en termes de société civile, sans pour autant évoquer la question de conflictualité et de lutte pour le pouvoir. La société civile organisée, constitue un moyen fondamental pour toute catégorie sociale de défense de ses droits et d’acquisition d’un certain pouvoir.
La société civile ne peut être perçue uniquement à travers le nombre d’associations légales, un certains nombres d’entre elles sont amarrées aux partis politiques, ou à des ONG internationales, qui ne reflètent pas nécessairement la dynamique ni l’identité de la société. La société civile joue un rôle important dans la négociation des intérêts de diverses catégories sociales, qui, naturellement lutte pour assurer leurs intérêts et disposer d’une portion de pouvoir. La culture démocratique inclut aussi bien la responsabilité de l’État que celle de la société civile même et conduit à instaurer un débat concernant la légitimité de la société civile et sa transparence. Le développent de la société civile passe par le développement de toutes les composantes de la société. On ne peut s’imaginer une participation des employés à la vie de l’entreprise, sans une ouverture de l’État à un dialogue ouvert avec les citoyens, sans une ouverture de la scène politique aux nouvelles tendances, et sans une vraie et réelle articulation avec les autres composantes de la société civile. C’est pourquoi, pour une bonne gouvernance aujourd’hui, les cadres juridiques doivent être appliqués de façon impartiale, en particulier les lois relatives aux droits de l’homme. Tous les citoyens doivent participer aux prises de décision, directement ou par l’intermédiaire d’institutions légitimes qui représentent leurs intérêts. Cette participation doit être fondée sur la liberté :
Il faut mener les hommes de telle façon qu’ils ne croient pas être menés, mais vivre selon leur libre décret et conformément à leur complexion propre, il faut donc les tenir par le seul amour de la liberté, le désir d’accroître leur fortune et l’espoir de s’élever aux honneurs. (B. Spinoza, 1966, p. 109).
Elle est source d’innovation sociale et contribue fortement à la transformation de la société. Son utilité sociale ne fait aucun doute : elle dispose des outils du vivre ensemble, a pris conscience de la nécessité de peser sur l’avenir de la société et de trouver de nouvelles formes d’action collective. Cependant, on observe un manque de visibilité et de lisibilité des associations, au sein de la société civile dans l’espace public. On assiste également à la naissance d’un citoyen actif, mais peu désireux de rejoindre des institutions.
Il est évident que le concept de l’État démocratique est cet État dans lequel « nul ne transfère son droit naturel à un autre de telle sorte qu’il n’ait plus ensuite à être consulté, il le transfère à la majorité de la société dont lui-même fait partie ; et dans ces conditions tous demeurent égaux », (B. Spinoza, 1965, p. 268), en tant que pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, ne se limite ni aux élections libres, permettant de définir une majorité, ni au règne sans partage de cette majorité. La fin du pouvoir démocratique est la promotion des droits des citoyens, l’État se donne les moyens assurés de s’organiser en toute autonomie et de se maintenir comme instance autonome et souveraine. La société civile participe grandement à cette autonomisation de la puissance de la Cité en étant maître d’elle-même, la Cité peut mieux s’organiser et se rendre dynamique à la production de principes éthiques pour le bien des citoyens.
Puis donc que la meilleure règle de vie pour se conserver soi-même autant qu’il se peut, est celle qui est instituée suivant les suivant les prescriptions de la raison, il en résulte que tout le meilleur que fait soit un homme, soit une Cité, est ce qu’il fait en tant qu’il est le plus complètement son propre maître. (B. Spinoza, 1966, p. 37).
La démocratie, comme projet sans cesse à construire, implique la liberté d’opinion, le respect des droits des minorités, la confrontation pacifique des intérêts et donc la liberté d’organisation et l’État de droit, la responsabilité des gouvernants, etc. Cela suppose pouvoirs et contre-pouvoirs et donc un espace libre, celui de la société civile forte, indépendante du pouvoir de l’État, de celui de l’économie (de l’argent), de la tradition (clans, etc.). L’édification de cette société civile est donc au cœur de tout processus de démocratisation. Et certaines formes de coopération et de solidarité internationale y contribuent.
2.2. La Société civile comme facteur de bonne gouvernance
Pour mener à bien leur mission, les associations ont besoin d’une certaine indépendance vis-à-vis des différents acteurs politiques, qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition. Elles doivent aussi travailler dans la clarté et veiller à la transparence, surtout en matière de financement. Et si la société civile veut jouer un rôle plus important dans la gestion des affaires publiques, aux niveaux national et international, elle doit être un modèle de rigueur et de probité.
La société civile se caractérise fondamentalement par son attitude collective de refus de subordination de la part des organisations ayant une action sociale (syndicats, organisations charitables) aux partis politiques. Cette attitude ne constitue pas un refus d’engagement politique individuel. Les organisations de la société civile ne s’identifient pas à un parti ou une idéologie politique, pour assurer plus de légitimité dans leur prise de position afin de veiller à la prise en compte des revendications sociales.
Lorsque les acteurs de la société civile sont soumis aux conditionnalités des acteurs politiques, ils perdent leur représentativité et peuvent être ainsi déséquilibrés, basculés du côté de l’État et détruire la condition d’existence de la société civile voire de la démocratie. La confusion entre société politique et société civile jette les jalons d’un totalitarisme dans la mesure où, dans ces pays les partis de l’opposition sont réduits au silence du fait de la répression qu’ils subissent de la part de la puissance étatique. Dans un régime où les organisations de la société civile ne gardent pas leur indépendance vis à vis de la classe politique, le champ d’action des tenant du pouvoir s’agrandit et surgissent avec lui les prémisses d’une toute puissance étatique. La société civile cesse d’être dans ce cas un contre pouvoir. En perdant son indépendance, la société civile se fragilise et fragilise la démocratie quand ses observations ne sont plus liées à l’intérêt général des citoyens mais plutôt à une coloration politique.
Les fonctions de l’État, pour ce qui est de la bonne gouvernance, sont multiples. L’État est la pierre angulaire du contrat qui définit la citoyenneté ; il est l’autorité mandatée pour mener à bien les fonctions de contrôle et pour exercer la force. Il est responsable des services publics et de la mise en place d’un environnement propice au développement humain durable.
Tout cela signifie que l’État est chargé d’établir, de préserver des cadres juridiques et réglementaires stables, efficaces et équitables pour garantir l’accomplissement de l’activité publique et privée. Cela revient pour l’État d’abord à assurer la stabilité, l’équité de l’activité politique, puis à jouer un rôle d’intermédiaire et d’arbitre lors des conflits d’intérêts. Cela signifie enfin qu’il doit garantir la bonne marche du service public et en rendre compte.
L’État constitue une force importante pour promouvoir la bonne gouvernance, mais il n’est pas la seule force. Garantir et préserver la paix, la stabilité et la bonne gouvernance dépend en partie des possibilités offertes par l’économie et la création qui génèrent des revenus suffisants pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Mais qu’est-ce que la gouvernance ? Le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) définit la gouvernance « comme l’exercice de l’autorité politique, économique et administrative dans le cadre de la gestion des affaires d’un pays à tous les niveaux ». (Y. I. Aboubakar, 2007, p. 9).
La gouvernance comprend les mécanismes, les processus, les relations et les institutions complexes, au moyen desquels les citoyens et les groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits et assument leurs obligations et auxquels ils s’adressent pour régler leurs différends. Elle mobilise trois acteurs fondamentaux : l’État, la société civile et le secteur productif :
Ces trois composantes sont essentielles pour un développement humain durable. L’État crée un environnement politique et juridique favorable. Le secteur privé produit des emplois et des revenus. Enfin, la société civile facilite l’interaction politique et sociale, incitant les groupes à participer aux activités économiques, sociales et politiques. (Y. I. Aboubakar, 2007, p. 9).
C’est l’interaction qui est constructrice et génératrice de bonne gouvernance. Chaque fois que l’évolution est positive, chaque fois que la condition de l’homme s’améliore, la bonne gouvernance en est l’explication.
De nos jours, la démocratie et la bonne gouvernance sont les deux principaux critères d’évaluation et de comparaison de la crédibilité des États et de la qualité des gouvernements. Les processus de construction de la démocratie et de la mise à niveau de la gouvernance sont étroitement liés. Plus la démocratie s’approfondit, plus l’exigence de bonne gouvernance ne devient incontournable. Mieux cette exigence est satisfaite mieux, s’impose le perfectionnement toujours plus poussé des institutions et des pratiques démocratiques : « une gouvernance durablement défaillante peut mettre en péril tout acquis et tout progrès démocratique ». (A. Sédjari, 2003, p. 37).
La gouvernance n’est pas la gouvernance d’un chef d’État mais une gouvernance de l’être collectif, en un mouvement de tous ceux qui sont impliqués dans le processus de décision et de conduite de l’action publique. Loin d’être un simple terme de plus ou une mode éphémère, « le concept de gouvernance trouve les fondements de son émergence au cœur des mutations cruciales de la pensée et de la pratique universelle en matière de gouvernement ». (A. Sédjari, 2003, p. 37).
Il ne suffit pas d’exiger une bonne gouvernance, il faut aussi une assise fiable. Il ne suffit pas que la démocratie soit instituée, il faut encore qu’elle soit effectivement et pleinement vécue par son acteur principal présumé : le peuple. Cela suppose que celui-ci jouisse pleinement des libertés fondamentales et assume les droits et les obligations de citoyenneté qui sont à la base de la démocratie et en constituent l’âme. Selon Dominique Schnapper, ( 1994, p. 268), « C’est au nom des droits du citoyen souverain et de la valeur de l’égalité de tous que l’État prend les mesures destinées à assurer de la manière que l’opinion juge équitable la répartition des ressources ainsi que la survie des plus démunis ».
La gouvernance en tant que processus interactif, implique diverses formes de partenariat. Car la gouvernance s’applique au domaine des grandes organisations et aussi à celui des territoires et à des espaces du politique qui intéresse la population. Il est question de la manière de gouverner, de la bonne pratique pour conduire les affaires collectives impliquant une certaine participation responsable des acteurs ou populations concernées. Des acteurs de toute nature réclament d’être associés au processus de décision et sont en mesure de proposer des solutions aux problèmes collectifs. La gouvernance met l’accent sur le déplacement des responsabilités qui s’opère entre l’État, la société civile et le marché. Aucun acteur ne dispose des connaissances et des moyens nécessaires pour résoudre seul les problèmes qui se posent. La gouvernance implique la participation, la négociation, la coordination et le partenariat. Elle constitue la toile de fond des partenariats.
L’État comprend les institutions politiques et celles du secteur public. Le secteur privé comprend les entreprises privées et le secteur non structuré sur le marché. La société civile comprend les individus et les groupes qui agissent de manière concertée sur le plan social, politique et économique, administrés par des règles et des lois formelles et/ou informelles.
L’émergence de la société comme acteur public performant et crédible et comme partenaire de l’État, structure et renforce l’exigence de bonne gouvernance, en la spécifiant par secteur d’activité et en l’adaptant aux rapides évolutions, tout en diversifiant et en outillant les acteurs du contrôle de performance des gouvernants. Les décideurs au niveau du gouvernement, du secteur privé et des organisations de la société civile doivent des comptes au public, ainsi qu’aux parties prenantes institutionnelles. La bonne gouvernance « joue un rôle d’intermédiaire entre les intérêts différents afin d’aboutir à un large consensus sur ce qui sert le mieux les intérêts du groupe et, le cas échéant, sur la politique et les procédures ». (Y. I. Aboubakar, 2007, p. 11).
C’est pourquoi, il est du rôle de la société civile d’intervenir dans les domaines vitaux comme la promotion des droits humains, la réhabilitation citoyenne de la femme, la protection de l’environnement, l’observation des opérations électorales, les réformes éducatives, fiscales ou autres, la normalisation et la régulation de la qualité des produits et des services publics et privés. Car « dans l’État de droit et de bonne gouvernance, les gouvernants et l’État lui-même cessent d’être au- dessus des lois, y compris pénales ». (A. Sédjari, 2003, p. 47).
La bonne gouvernance est l’un des piliers de la stabilité politique. « Il ne peut jamais y avoir ni progrès, ni paix, ni stabilité politique dans un État qui ignore ou méprise les règles de la bonne gouvernance ». (P. Ngoma-Binda, 2002, p. 2019). La gouvernance est la manière avec laquelle une société donnée organise et régule le pouvoir dans ses structures fondamentales dans l’intention d’assurer de façon harmonieuse et efficace le bien public, la paix et le bonheur de chacun des citoyens ; la bonne gouvernance a pour nom authentique la ‘’gouvernance démocratique’’. Il y a deux formes de gouvernance : l’une est dite bonne, efficace, appropriée ; l’autre mauvaise, inefficace, inappropriée. Une mauvaise gouvernance détruit la paix et entraîne l’instabilité des institutions politiques ; une bonne gouvernance garantit le contraire : la stabilité, l’harmonie sociale, le progrès de la société. La bonne gouvernance est l’un des éléments fondamentaux de la stabilité d’un État. Une manifestation de bonne gouvernance est l’utilisation rationnelle des ressources humaines. Elle est facteur de paix sociale, de stabilité politique et de progrès économique.
Conclusion
La crédibilité de la société civile et de réside d’État ans la responsabilité, dans le sérieux et dans la reconnaissance, le respect de chacun comme tel. Leur légitimité aussi. De même la réussite de l’un dépend de celle de l’autre, de ses apports et de ses soutiens. Les organisations de la société civile adoptent une approche très critique vis-à-vis des profils de gouvernance mis en place par les gouvernants. Elles dénoncent toutes les formes de mal gouvernance Aussi, l’émergence d’une bonne gouvernance dans un quelconque État demande l’implication d’une société civile libre et responsable.
Cependant, les OSC, qui agissent également en tant qu’acteurs rationnels en œuvrant pour leurs survies organisationnelles, ont su se réapproprier les discours institutionnels sur la gouvernance. Si elles étaient très sceptiques lors de l’émergence de ce concept sur l’agenda politique international, elles en ont recours aujourd’hui afin de légitimer et de renforcer leur position d’acteurs incontournables des politiques de développement. Cette constatation reflète toute l’ambiguïté d’un terme, qui, s’il est couramment utilisé et accepté dans les discours des différents acteurs, est difficilement transposable dans la pratique de manière consensuelle. Une société civile forte repose sur une citoyenneté responsable.
Références bibliographiques
ABOUBAKAR Yenikoye Ismaël, 2007, Comment analyser la gouvernance : Définir les indicateurs de bonne gouvernance, Niamey, L’Harmattan.
AKAKPO Rose-Ablavi, 2009, « bonne gouvernance en Afrique : les ONG veillent au grain », Revue internationale d’analyses stratégiques et de réflexions économiques de Mars/Avril, p. 42.
CEVETEK Nina et DAIBER Friedel, 2009, Qu’est-ce que la société civile, Antanarivo, KMF-CNOE, en partenariat avec la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Trad. Rabary-Andriamanday Voahanitriniaina.
BEAUCHAMP Claude (Dir.), 1997, Démocratie, culture et développement en Afrique noire, Paris, L’harmattan.
CHÂTAIGNER Jean Marc et MAGRO Hervé (Dir.), 2007, États et sociétés fragiles. Entre conflits, reconstruction et développement, Paris, Karthala.
FREUND Julien, 1965, L’essence du politique, Paris, Sirey.
GUEYE Sémou Pathé, 2003, Du bon usage de la démocratie en Afrique, Dakar, NEAS.
HEGEL Wilhelm Gootfried, 1940, Les principes de la philosophie du droit, Paris, Trad. André Kaan.
HOBBES Thomas, 1999, Léviathan, Paris, Dalloz, Trad. François Tricaud
LE PORS Anicet, 2002, La citoyenneté, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».
LOCKE John, 1992, Traité du gouvernement civil, Paris, Flammarion, Trad. David Mazel.
MARTINIELLO Marcel, 2000, La citoyenneté à l’aube du 21è s : Questions et enjeux majeurs, Liège, Université de Liège.
MONTESQUIEU Charles, 1979, De l’esprit des lois, Tome 2, Paris Flammarion.
MVE Bekale Marc, 2005, Démocratie et mutations culturelles en Afrique noire, Paris, L’harmattan.
NGOMA-BINDA Phumbu, 2001, Une démocratie libérale communautaire pour la R. D. Congo et l’Afrique, Paris, L’harmattan.
PLANCHE Jeanne, 2007, Société Civile, Paris, Charles Léopold Mayer.
POKAM Hilaire de Prince, 2012, Communauté internationale et gouvernance démocratique en Afrique, Paris, L’Harmattan.
RANGEON François, 1986, « Société civile : histoire d’un mot », La société civile, Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique, PUF, pp. 9-32.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1982, Du contrat social, Paris, GF Flammarion.
SCHNAPPER Dominique, 2003, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard.
SEDJARI Ali, 2003, Gouvernance et conduite de l’action publique au 21ème siècle, Paris, L’Harmattan.
SPINOZA Baruch, 1965, Traité théologico-politique, Paris, Flammarion, Trad. Charles Appuhn.
SPINOZA Baruch, 1966, Traité politique, Paris, Flammarion, Trad. Charles Appuhn.
TOGONOU Tiano Valère, 2016, « La protection des droits de l’homme lors des processus électoraux en Afrique noire francophone: cas du Bénin », Mémoire de Master 2 « Histoire, droit, droits de l’homme » Université Pierre-Mendes, France- Grenoble.
VIALAJUS Martin, 2009, La société civile mondiale à l’épreuve du réel, Paris, Charles Léopold Mayer.
DÉMOCRATIE ET ÉMERGENCE EN AFRIQUE : LA RECONNAISSANCE DE L’IDÉE PLATONICIENNE DU BIEN COMME CREUSET PARADIGMATIQUE DES VALEURS
Thomas Kouassi N’GOH
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
ngohthomas@yahoo.fr
Résumé :
L’émergence en Afrique est tributaire de la démocratie. Mais, le constat est que la démocratie qui devrait être le moteur de l’émergence en Afrique, continue d’être le foyer de plusieurs crises : crises identitaires, conflits militaro-politiques, etc. Si l’Afrique ne connaît pas la paix, il est clair que l’émergence tant souhaitée par les politiques serait une simple vue de l’esprit. C’est pourquoi, il faut une réforme de la démocratie fondée sur l’exigence des compétences et des valeurs éthiques, gages de paix et de développement durable. Cette réforme passe par un retour à Platon qui recommande que les dirigeants soient, à l’image du philosophe-roi, compétents et vertueux, et qu’ils aient une parfaite connaissance de l’idée du bien. L’idée du bien est l’essence même des valeurs éthiques indispensables à une émergence véritable.
Mots-clés : Afrique, Démocratie, Éducation, Émergence, Idée du bien, Morale, Paix.
Abstract :
The emergence in Africa is dependent on the democracy. But, the report is that the democracy which should be the mainspring of the emergence in Africa, continuous to be the home of several crises: identity crises, military-political conflicts, etc. If Africa does not know the peace, it is clear that the emergence so wished by the politics would be a simple view of the spirit. That is why, is needed a reform of the democracy based on the requirement of the skills and the ethical values, the wages of peace and sustainable development. This reform passes by return to Plato who recommends that the political leaders are, just like philosopher-king, competent and virtuous, and that they have a perfect knowledge of the idea of good. The idea of the good is the essence of the ethical values essential to a real emergence.
Keywords: Africa, Democracy, Education, Emergence, Idea of the good, Morale, Peace.
Introduction
L’Afrique veut sortir du sous-développement pour amorcer son entrée dans le concert des nations émergentes. Les politiques, à travers le continent, ne cachent plus leur désir de voir leurs États se propulser en avant, aller à l’émergence. Si la quasi-totalité des États occidentaux connaissent un développement remarquable depuis des siècles, les États africains ont compris qu’il est temps, en ce début du XXIe siècle, de prendre leur destin en main, s’ils veulent sortir du sous-développement. Pour ce faire, les chefs État multiplient, çà et là, les actions qui peuvent rendre réelle l’émergence que certains situent à l’horizon 2020. Il s’agit notamment de construction d’infrastructures modernes telles que les routes, les ponts, les barrages hydro-électriques, les écoles, les universités, l’extension des réseaux de communication, le développement des industries, etc. Si ces infrastructures modernes constituent l’essentiel pour aller à l’émergence, alors on dira que l’Afrique est bien partie.
Or, il se trouve, malheureusement, qu’à peine construites, ces infrastructures modernes sont dévastées par les révolutions sauvages, les coups d’État, les rébellions et les guerres civiles. Tous ces conflits mettent à mal l’émergence des États africains. Pour trouver une solution idoine à ces crises, il apparaît nécessaire de faire recours à Platon, car le problème des Africains étant, en réalité, un problème d’éducation, la pensée éducative platonicienne, fondée sur l’idée du bien, peut leur être utile. L’éducation qui consiste à amener l’âme à contempler l’idée du bien est, chez Platon, le socle même des valeurs éthiques fondatrices de l’émergence véritable. Mais, en quoi l’idée platonicienne du bien est-elle, pour les États africains en voie d’émergence, le creuset paradigmatique des valeurs ? L’analyse de ce problème central implique l’examen des questions subsidiaires suivantes : en quoi la crise de la démocratie en Afrique constitue-t-elle un frein à l’émergence ? Par ailleurs, dans quelle mesure la paix et l’idée platonicienne du bien représentent-elles les socles de l’émergence des États africains ?
L’intention fondatrice de cette étude est de montrer que l’émergence de l’Afrique est possible à la condition que les Africains s’imprègnent des préceptes politiques platoniciens par une culture de la paix et par une éducation à l’idée du bien. À partir d’une approche analytique et critique, deux parties serviront à l’élucidation de cette thèse. Il sera question de montrer, dans la première partie, en quoi la crise de la démocratie en Afrique constitue un frein à l’émergence. La seconde partie consistera à indiquer que la paix et l’idée platonicienne du bien représentent les socles de l’émergence des États africains.
1. LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE, UN FREIN À L’ÉMERGENCE
Les États d’Afrique rêvent de sortir du sous-développement pour se propulser en avant vers l’émergence. Mais, que de difficultés sur le chemin de l’émergence, car l’Afrique n’a pas encore rompu avec les grèves et les révolutions sauvages, les coups d’État, les rébellions et les guerres civiles. Ces nombreux conflits sont un frein à l’émergence de l’Afrique. L’absence de paix fait régresser l’Afrique vers le sous-développement.
1.1. Les conflits socio-politiques, un obstacle à l’émergence de l’Afrique
Depuis ces dernières années, les États africains ont compris qu’il était grand temps de s’engager sur la voie de l’émergence. Les années très proches sont déjà retenues par plusieurs chefs d’État africains comme des dates butoirs à partir desquelles l’émergence devra être concrétisée. Les slogans ne manquent pas d’alimenter l’actualité selon les pays où l’on se trouve : Côte d’Ivoire émergente à l’horizon 2020, Sénégal émergent à l’horizon 2025, Cameroun émergent à l’horizon 2035, etc. Au vue de ces propagandes politiques, on peut dire que les dirigeants africains ont affiché clairement leurs ambitions d’aller à l’émergence, c’est-à-dire de sortir leurs États du sous-développement pour les propulser dans la modernité, à l’instar des États occidentaux et de la plupart des États d’Asie dont le développement ne souffre d’aucune ambiguïté. Si le rêve est permis, alors on peut soutenir que les politiques ont des raisons de croire en l’émergence de l’Afrique.
Toutefois, entre le rêve et la réalité, se trouve un très grand fossé, car l’Afrique n’a pas encore fini avec les grèves et les révolutions sauvages, les coups d’État, les rébellions et les guerres civiles, comme si toutes ces mauvaises pratiques faisaient partie de leurs habitudes et de leurs mœurs. Comment comprendre qu’au moment où les tentatives de coups d’État se multiplient, et que les fusils continuent de crépiter, çà et là, dans tous les coins de l’Afrique, les leaders politiques fassent des projets pour aller à l’émergence ? Quel paradoxe ?
La réalité est que, du nord au sud, de l’est à l’ouest, en passant par le centre, l’Afrique connaît des turbulences socio-politiques qui déstabilisent gravement les États et qui constituent, pour ainsi dire, un frein à l’émergence. La démocratie africaine qui cherche encore ses repères, avec un système de gouvernance voué à l’échec, continue, malheureusement, d’être le foyer de nombreuses crises. Ces crises qui secouent la majeure partie des États africains ont, certainement, des causes profondes. Parmi ces causes, on peut relever la question de l’alternance au pouvoir qui reste encore non résolue dans le champ démocratique en Afrique. À ce propos, John Hallowell (1972, p. 39) fait remarquer : « Le pouvoir sans limites de la majorité mène tout droit à la tyrannie. Si la démocratie ne signifie rien d’autre que d’offrir à la majorité des hommes ce qu’ils désirent, il est alors virtuellement impossible de la distinguer du fascisme ».
En effet, une fois installés au pouvoir, les dirigeants africains, pour la plupart, cherchent, par tous les moyens, à y passer tout le reste de leur vie. Ainsi, l’alternance politique, qui devait être le changement régulier de gouvernants par le procédé d’élections libres et transparentes, est balayée du revers de la main. Ces dictateurs, ne respectant aucune loi, inventent leurs propres règles pour se maintenir au pouvoir. Mais, derrière ce refus de l’alternance, se profilent la tyrannie et les violences socio-politiques qui sont de véritables obstacles à l’émergence des États. Michel Terestchenko (1992, p. 84) indique, à ce sujet, ce qui suit : « La destruction des traditions et des institutions héritées du passé constitue une voie préparée à l’avènement de la tyrannie ». Lorsque, dans un État, les lois et les règles du jeu démocratique ne sont pas respectées par les politiques, quand les règles de droit qui limitent le pouvoir dans le champ démocratique sont foulées aux pieds parce que les premiers venus veulent conserver indéfiniment le pourvoir d’État, il est évident que la démocratie vire au despotisme et à la tyrannie. Et les conséquences de cette dictature politique sont, entre autres, les manifestations sauvages de rue, les coups d’État, les rébellions et les guerres civiles. Le drame est que, lorsque ces événements surviennent en Afrique, ce sont tous les acquis hérités du passé qui sont dévastés. À ce propos, M. Terestchenko (1992, p. 257) écrit :
L’État totalitaire et son organisation sont surtout une façade dont le but est de présenter des apparences de normalité vis-à-vis du monde extérieur, alors que la réalité du pouvoir est dissimulée, et concentrée entre les mains de la police secrète. Sa fonction principale est d’exercer la terreur, laquelle ne s’installe définitivement que lorsque les opposants au régime ont été liquidés.
En clair, derrière la dictature, on note que ce sont toutes ces violences qui emportent tout sur leur passage, y compris les vies humaines. Les exemples de crises sont légion en Afrique depuis l’avènement du multipartisme en 1990. Le vent de la démocratie qui a soufflé sur le continent africain, après la chute du mur de Berlin, a eu aussi des conséquences négatives que nous ne pouvons occulter. Ce sont toutes les crises à travers le continent, depuis des décennies, avec leurs cortèges de morts et de destruction de biens. On peut citer pêle-mêle la guerre civile au Liberia, en Sierra-Leone, en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Côte d’Ivoire, en Centrafrique, au Soudan, au Burundi etc. À ces conflits, on peut ajouter les révoltes populaires en l’Égypte, en Algérie, en Tunisie, au Burkina-Faso, au Gabon, au Congo etc. Tous ces États, et bien d’autres encore, ont connu des conflits divers. Mais, en réalité, c’est à la nation qu’on fait du tort lorsqu’éclatent les crises, car c’est l’émergence de la nation qui est mise à mal. Autrement dit, c’est la nation toute entière qui est mise en péril. Justement, c’est le constat que fait M. Terestchenko (1992, p. 93) lorsqu’il affirme que « la tyrannie moderne est d’abord une violence faite à la nation, à l’histoire ». Cela veut dire clairement que l’émergence des nations africaines serait difficilement réalisable tant que subsistent les rébellions et les guerres. Pierre Rosanvallon (2006, p. 126) va même plus loin en indiquant, à ce propos, que« les rébellions et autres révoltes sauvages ont aussi marqué l’histoire de l’humanité ». Cela nous amène à comprendre que les États africains ont très mal amorcé leur entrée dans le concert des nations émergentes.
Si ce continent qu’est l’Afrique doit continuer à être le théâtre de toutes les crises dévastatrices, alors on dira que les ambitions rêvées des politiques de voir leurs États se propulser, sur la voie de l’émergence, sont tout simplement vouées à l’échec. Car, comme le fait remarquer Thomas More (1987, p. 49), lorsque la violence s’installe dans une nation, « ce sont le désordre et la déraison qui s’installent ; après quoi, tous les maux déferlent ». C’est dire que l’Afrique sera toujours loin de l’émergence si les guerres continuent de déstabiliser ses États. On peut donc soutenir que l’émergence de l’Afrique est faussée par les conflits. François Perroux (1981, p. 53) va même plus loin en indiquant que « le développement est faussé par les politiques ». Cela revient à dire que les gouvernants sont aussi responsables du retard de l’Afrique étant entendu que ce sont eux les principaux instigateurs des conflits.
En somme, les crises socio-politiques qui continuent de secouer la majeure partie des États africains sont de véritables obstacles à l’émergence tant souhaitée par les politiques. L’absence de paix fait même régresser l’Afrique vers le sous-développement. Quand on évalue les conséquences des violences politiques aux divers plans politique, social, économique et culturel, selon les États où ces violences ont lieu, on peut soutenir qu’il y a une régression des États africains vers le sous-développement.
1.2. L’absence de paix en Afrique, une régression vers le sous-développement
Toutes les crises socio-politiques, toutes ces violences qui ont secoué et qui continuent de déstabiliser la plupart des États africains ne sont pas faites pour les amener à l’émergence. Bien au contraire, ces nombreux conflits, çà et là, dans tous les coins du continent, causent malheureusement la régression des États africains vers le sous-développement. On dira même que les conflits maintiennent l’Afrique dans le sous-développement. Naturellement, lorsqu’il n’y a pas de paix dans une nation, il est évident que rien de sérieux ne peut être accompli. L’absence de paix signifie, de facto, absence de développement, car toutes les révolutions sauvages, les coups d’État, les rébellions et les guerres civiles qui déstabilisent l’Afrique ont réellement des conséquences graves et profondes aux divers plans politique, social et économique selon le pays où l’on se situe.
En effet, au plan politique, avec l’omniprésence des conflits en Afrique, il n’est guère possible d’envisager une politique cohérente de développement. D’ailleurs, dès que commencent les crépitements des armes et les vrombissements des chars, ce sont les acquis démocratiques qui sont, tout de suite, visés et remis en cause : la destitution des leaders politiques, la dissolution des institutions républicaines, la dissolution de la constitution, etc. Ce sont des faits tout à fait récurrents lorsque surviennent les coups d’État en Afrique. Du coup, toutes les avancées démocratiques qui ont pu être réalisées, depuis les indépendances, sont détruites. À ce titre, Moses Finley (1985, p. 168) indique : « Aucun État dans toute l’histoire, qu’il ait eu à sa tête un despote, n’a jamais eu une politique cohérente pendant une longue période ». L’exemple de la Côte d’Ivoire est édifiant à ce sujet. Quand le coup d’État est survenu en 1999, on a assisté à un bouleversement de tout le système de gouvernance : le changement de régime avec l’apparition des hommes en treillis militaires sur la scène politique, la destitution des leaders politiques et la remise en cause des institutions étatiques, etc. Il faut le souligner, les coups d’État constituent un véritable recul de la démocratie. Jean Copans (1990, p. 260) a raison de considérer finalement que « l’Afrique est en mal de démocratie ».
La violence qui s’est installée, lors de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire, en 2010, confirme que l’Afrique est vraiment en mal de démocratie. Les arrestations arbitraires, les tortures, les condamnations abusives, les assassinats et les autres crimes politiques en Côte d’Ivoire, précisément lors de la période post-électorale, témoignent bien du recul de la démocratie. C’est cette forme de solution tyrannique aux problèmes politiques que R. Aron (2015, p. 227) dénonce en écrivant : « La solution tyrannique est celle dont un groupe d’hommes pourrait s’imposer en s’emparant du pouvoir par les armes ». La crise en Côte d’Ivoire n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, car presque tous les États en Afrique qui ont connu pareilles crises ont eu les mêmes conséquences au plan politique. C’est, d’ailleurs, ce triste tableau de la politique africaine que Mohamed Younouss (2015, p. 24) tente de décrire en ces termes : « Au nom de la politique en Afrique, on martyrise, on tue, on assassine ». Mais, lorsqu’on martyrise, on tue, et on assassine au nom de la politique, tout cela constitue une régression vers la barbarie, barbarie qui, elle-même, maintient l’Afrique encore dans le sous-développement.
Au plan social, les coups d’État, les rébellions, les guerres civiles sont de nature à bloquer le développement des peuples. Ces violences politiques plongent les peuples africains dans les bassesses du sous-développement. Ce que nous entendons par bassesses du sous-développement, ce n’est rien d’autre que la destruction des biens et des acquis sociaux, la destruction des vies humaines. En effet, lorsque la guerre civile éclate en Afrique, on assiste impunément à la destruction des routes, des ponts, des habitats, des écoles, des universités etc. Ainsi, on n’hésite pas à détruire les infrastructures publiques et privées. Pire, les populations subissent des atrocités telles que les tueries et les génocides. Le génocide rwandais reste encore un triste souvenir dans les mémoires et dans l’histoire de l’Afrique. M. Younouss (2015, p. 25) soutient, à ce titre, ce qui suit : « Au nom de la politique en Afrique, on détruit la vie de milliers d’individus, on hypothèque l’avenir de plusieurs jeunes africains et aussi celui des générations futures ».
Ces propos de M. Younouss prouvent que le culte de la violence est une réalité en Afrique. À cette crise rwandaise, il faut ajouter la guerre civile au Libéria, guerre pendant laquelle les populations ont été décapitées, plusieurs individus ont été ligotés puis brûlés vifs. Au Soudan, en République démocratique du Congo, au Burundi, en Centrafrique, etc., on continue, malheureusement, de tuer les populations parce que, dans ces États, les guerres sont récurrentes. Joseph Owona (1985, p. 27) fait savoir, à ce propos, que « la révolution peut se faire par une rébellion ou une insurrection mais, ce qui importe, c’est la profonde restructuration sociale qu’elle opère par la violence détruisant de façon irréversible l’ancienne société ». Quelle émergence l’Afrique peut-elle atteindre quand les sociétés sont dévastées ? Loin de l’émergence, l’Afrique est maintenue, et pour longtemps encore, dans le sous-développement.
Le secteur de l’économie n’est pas épargné par ces nombreux conflits sur le continent africain. Le constat est qu’au premier coup de fusil, c’est l’économie du pays qui est vidée de son contenu : pillage des banques, pillage des caisses de l’État, détournement des fonds publics, etc. Ces pillages de banques et ces détournements de fonds publics sont récurrents en Afrique lorsque les crises éclatent. Aussi, il faut ajouter à ces pillages de banques et à ces détournements de fonds publics, la fuite des capitaux vers l’Europe. Si l’économie, souvent perçue par les experts en développement comme le moteur de l’émergence des États, doit être l’objet de pillage chaque fois qu’il y a des conflits, il sera difficile pour les États africains de sortir du sous-développement. On ne peut pas délibérément piller ou détruire l’économie d’un État et vouloir en même temps qu’il accède à l’émergence. Comme M. Younouss (2015, p. 57) le souligne fort bien : « Le développement a une base et rien ne peut se construire sur des bases fragiles ». En clair, si l’économie qui constitue l’une des bases du développement de l’Afrique est fragilisée par les violences politiques, il est évident que les Africains ne sortiront pas de sitôt du sous-développement. C’est le constat que fait Youssouph M. Guissé (1976, p. 112) lorsqu’il écrit : « Aucun pays africain, pris isolément, ne peut prétendre parvenir au stade de développement atteint actuellement dans le monde ». Cet auteur n’est pas un afro-pessimiste, mais ce qu’il indique ici traduit réellement ce qu’est l’Afrique. Son propos signifie simplement que l’Afrique est encore loin de l’émergence, compte tenu du manque de cohésion entre les États et de l’absence de paix.
En somme, on retiendra que l’absence de paix fait régresser l’Afrique vers le sous-développement. Si, au plan politique, social et économique, l’Afrique doit continuer à être fragilisée par les conflits, il est évident qu’il serait difficile aux États africains de parvenir au stade de développement actuellement atteint par les États occidentaux et certains États d’Asie. Pour autant, faut-il désespérer de l’émergence de l’Afrique ? La solution au problème de l’émergence de l’Afrique passe nécessairement par Platon dont les préceptes politiques constituent des modèles pour tout État moderne et développé.
2. LA PAIX ET L’IDÉE PLATONICIENNE DU BIEN : SOCLES DE L’ÉMERGENCE DES ÉTATS AFRICAINS
Pour sortir l’Afrique du sous-développement et l’amener vers l’émergence, les politiques africains doivent avoir recours à Platon dont les préceptes politiques constituent une référence pour tout État moderne. Pour Platon, les socles de l’émergence sont la paix et l’éducation. La paix s’impose comme un bien qui consiste en des valeurs, des attitudes et des comportements. L’éducation consiste à détourner l’âme du sensible pour qu’elle contemple l’idée du bien, source des valeurs fondatrices de l’émergence véritable.
2.1. La paix, une condition essentielle de l’émergence
Depuis l’Antiquité grecque, on considère généralement Platon comme un farouche opposant à la démocratie. Cette opposition de Platon à la démocratie a certainement une raison. Dans La République, il indique, au sujet du régime démocratique, ce qui suit :
En raison de la liberté qu’on y trouve, il convient à toutes les espèces de constitutions politiques et il est probable que celui qui souhaite établir une cité n’aura besoin que de se rendre dans une cité gouvernée démocratiquement pour y choisir le genre qui lui plairait : c’est comme si on était entré dans un grand marché aux constitutions politiques, et une fois le choix fait, on n’a qu’à fonder la cité selon le modèle choisi. Dans une cité de ce genre, on ne se voit soumis à aucune obligation de gouverner, même si on en possède les capacités (…), ni de maintenir la paix. (Platon, 2011, 557d-558c).
Pour Platon, la démocratie est un régime de liberté tellement grande qu’elle est devenue un gouvernement anarchique. Dans ce genre de régime, aucune loi n’est respectée, et aucun effort n’est consenti pour garantir la paix. On y trouve tous les maux que redoutent les peuples : le désordre, la dictature, la tyrannie, l’injustice, la corruption, les coups d’État, les guerres, etc. La démocratie est semblable à un grand marché, désordonné et anarchique, où aucune politique cohérente de développement ne peut être envisagée. Pour Platon (2011, 558d-559b), la démocratie est « une constitution politique privée d’un réel gouvernement, bariolée, et qui distribue une égalité bien particulière tant aux égaux qu’à ceux qui sont inégaux ».
En parlant ainsi, Platon a souvenance de la grave crise de la démocratie qui a causé la décadence d’Athènes, au moment où cette belle cité avait atteint un développement exemplaire dans toute l’Europe occidentale au Ve siècle avant Jésus-Christ. La très longue guerre du Péloponnèse, entre Sparte et Athènes, qui a détruit la cité athénienne, la tyrannie qui a occasionné l’assassinat de Socrate en 399 avant Jésus-Christ, sont autant de faits qui justifient l’opposition de Platon au régime démocratique. Platon est déçu de la démocratie, car c’est bien ce régime qui a ruiné le développement politique, social et économique d’Athènes. La démocratie est, bien plus, un régime de turbulence qu’un gouvernement de paix. Or, sans la paix, aucune politique d’émergence et de développement durable n’est possible dans aucun État. Pour Platon, la paix est solidaire de l’émergence et du développement des États. Elle est même la condition essentielle de l’émergence et du développement des États. C’est la raison pour laquelle, la pensée politique platonicienne débouche nécessairement sur la recherche de la paix. La cité idéale, qui reste une cité de référence, à l’opposé des cités démocratiques, répond à cette exigence de paix.
En effet, dans cette cité idéale, gouvernée par le philosophe-roi, la paix n’est pas un projet provisoire, mais une paix perpétuelle enracinée dans les mœurs. Parce qu’elle repose sur la morale et l’éthique, la paix est un idéal de la raison que cultivent, au quotidien, le philosophe-roi et les autres membres de la cité idéale. Sa finalité, selon Platon, est de rapprocher les peuples afin qu’ils vivent ensemble dans la convivialité, le partage, l’entente et la solidarité. La cité idéale, telle que décrite par Platon lui-même, est une cité paradigmatique, c’est-à-dire une cité modèle, vertueuse et paisible où l’homme vit heureux. La cité idéale est le prototype même d’une cité émergente, une cité où les coups d’État, les rébellions, les guerres sont totalement bannis, et où le philosophe-roi et les citoyens vivent une vie vertueuse, c’est-à-dire une vie régie par la morale et l’éthique. Cela veut dire explicitement que l’émergence que prônent les politiques ne doit pas être seulement vue comme un progrès industriel, technique ou matériel des peuples, mais elle doit être perçue d’abord comme une œuvre de la pensée morale. Dans Le Politique,Platon (2011, 301e-302c) fait savoir, à ce propos, que le philosophe-roi qui gouverne la cité idéale doit « pouvoir exercer son autorité avec science, distribuant comme il faut à tous ce qui leur revient en vertu de la justice et de la piété, et en se gardant de maltraiter, de tuer, ou de faire du mal à qui il souhaitera en toute occasion. En fait (…), il gouvernerait dans le bonheur ».
En clair, Platon montre que la mission d’un bon dirigeant, à l’image du philosophe-roi, ce n’est pas de massacrer ou de tuer son peuple en créant des conflits, mais c’est de conduire son peuple dans la paix et dans le bonheur. Mais, la culture de la paix passe par une prise de conscience de ceux qui gouvernent, car ce sont eux qui attisent les conflits, violent les droits des citoyens et détruisent la vie humaine. C’est le cas de l’Afrique qui souhaite aller à l’émergence, mais qui continue, malheureusement, d’être le foyer des guerres civiles et des conflits de toutes sortes. À ce propos, S. Mesure et A. Renaut (1999, p. 201) indiquent que « lors de l’émergence du modèle libéral, qui coïncidait aussi avec l’apparition des figures modernes de la conscience de soi ou de la subjectivité, il s’était surtout agi d’éviter la guerre de tous contre tous ».
Ces propos prouvent que c’est dans la paix qu’on peut envisager l’émergence d’un État. Si l’Afrique veut sortir du sous-développement pour amorcer son émergence, il lui faut cultiver la paix que prône Platon, et dont la cité idéale est le reflet. L’Afrique doit copier les vertus qu’incarne la cité idéale, prototype même d’une vraie cité émergente. Ces valeurs sont, entre autres, la paix, la justice, l’altruisme, le respect de l’autre, la tolérance, etc. Cela laisse supposer que l’émergence véritable, au sens platonicien du terme, est, d’abord, un changement de mentalité, de conduite et de comportement. Et, tout cela doit passer nécessairement par une réforme de la démocratie fondée sur les compétences et sur les droits humains. Pour que l’Afrique sorte du sous-développement, il faut que les dirigeants en Afrique soient, à l’image du philosophe-roi, des sages-éclairés et des dirigeants compétents, et qu’ils prennent en compte les valeurs éthico-politiques telles que la non-violence, la tolérance, la solidarité, le respect de la dignité humaine, la justice et la paix. Toutes ces valeurs qui constituent les vecteurs de l’émergence véritable sont celles que défend le platonisme. La préoccupation constante de la philosophie platonicienne a toujours été de définir, dans la tradition ouverte par Socrate, des valeurs qui peuvent contribuer à l’édification morale de la cité. Si la paix est un bien précieux, alors on peut dire, avec Platon, qu’elle est une condition essentielle de l’émergence des États.
De ce qui précède, nous devons retenir que la paix est une condition essentielle de l’émergence. Si les Africains veulent sortir du sous-développement pour faire leur entrée dans le concert des nations émergentes, il faut qu’ils aient la culture de la paix. Cela laisse supposer qu’ils doivent changer de mentalité, de conduite et de comportement. Mais, cela ne peut être possible que si les dirigeants et les citoyens sont bien éduqués, c’est-à-dire s’ils parviennent à détourner l’œil de l’âme du mal pour contempler l’idée du bien, socle de l’émergence véritable.
2.2. L’idée du bien, socle de l’émergence véritable
L’émergence des États africains serait une utopie sans une vraie politique d’éducation. L’éducation est solidaire de l’émergence des États. Elle en est même le socle, car c’est elle qui façonne la conduite des hommes, c’est-à-dire des politiques et des citoyens, et qui leur permet le changement de mentalité, de conduite et de comportement. Quand un individu n’est pas suffisamment éduqué, c’est-à-dire quand il ignore la vraie nature du bien, il est toujours tenté de commettre le mal. Le mal provient de l’ignorance, disait souvent Socrate. Sa fameuse phrase, rapportée par J. Brun (1999, p. 94), « nul n’est méchant volontairement » signifie que le méchant se détourne du bien parce qu’il n’en a aucune connaissance. Et, aussi longtemps que les Africains, autant qu’ils sont, politiques et citoyens, continueront à servir le mal, en faisant les coups d’État, les rébellions et les guerres pour détruire leur nation, on dira que c’est parce qu’ils n’ont aucune connaissance du bien. Et, c’est parce que ces méchants n’ont aucune connaissance du bien qu’ils restent, sans s’en douter, esclaves des conflits qui les enfoncent encore plus dans le sous-développement.
Si, les Africains veulent sortir du sous-développement pour aller à l’émergence, il faut qu’ils s’approprient la question de l’éducation. Ils doivent comprendre que le fondement de la véritable émergence c’est la morale, la vertu que tout homme doit cultiver, et cette morale ou vertu l’on ne l’acquiert que par l’éducation. C’est pourquoi, le modèle platonicien de l’éducation est réellement ce qu’il faut aux Africains. L. Brisson et F. Fronterotta (2006, p. 204) ont bien perçu la finalité de cette éducation : « La finalité de l’éducation platonicienne est la possibilité du bon fonctionnement de la cité ». Mais, en quoi consiste cette éducation platonicienne qui reste une référence pour tout État moderne ? À cette question,on répond en indiquant que la connaissance de l’idée du bien est ce qui fonde essentiellement l’éducation chez Platon. Dans la pensée politique platonicienne, l’éducation consiste à détourner l’œil de l’âme des choses futiles du sensible pour l’amener à contempler l’idée du bien. À cet effet, il est écrit dans La République ce qui suit :
L’éducation n’est pas telle que la présentent certains de ceux qui s’en font les hérauts. Ils affirment que la connaissance n’est pas dans l’âme et qu’eux l’y introduisent, comme s’ils introduisaient la vision dans les yeux aveugles (…). Cette puissance réside dans l’âme de chacun, ainsi que l’instrument grâce auquel chacun peut apprendre : comme si un œil se trouvait incapable de se détourner de l’obscurité pour se diriger vers la lumière autrement qu’en retournant l’ensemble du corps, de la même manière c’est avec l’ensemble de l’âme qu’il faut retourner cet instrument hors de ce qui est soumis au devenir, jusqu’à ce qu’elle devienne capable de s’établir dans la contemplation de ce qui est et de ce qui, dans ce qui est, est le plus lumineux. Or, cela, c’est ce que nous affirmons être le bien. (Platon, 2011, 518b-519a).
Comme telle, l’éducation consiste, dans une ascension dialectique, à élever, progressivement, l’âme du monde sensible vers le monde intelligible. Une fois dans l’intelligible, l’âme contemple le bien, et elle découvre sa vraie nature. En découvrant le bien, l’âme se conforme à lui en s’appropriant toutes les vertus qui le caractérisent essentiellement. « L’idée du bien est la source ultime de toutes les essences (le bien, le beau, le juste, le vrai) » (R. Bonan, 2014, p. 93). Par ce propos, nous comprenons que l’idée du bien n’est pas une idée comme les autres, mais celle qui assure à l’âme sa perfection. L’idée du bien est donc utile à l’âme pour organiser la cité. C’est ce qu’atteste R. Bonan, (2014, p. 94) à travers le passage suivant :
Que serait la science politique par exemple, comprise comme capacité à organiser avec justice la cité, si elle ne visait pas le bien ? Autant dire que l’idée du bien n’est pas une idée comme les autres mais celle qui, en dernière instance, assure leur unité, elle est donc synonyme d’Un. En ce sens, la progression dialectique trouve en elle une assise puissante.
Cela veut dire qu’une fois revêtue des vertus du monde intelligible, l’âme doit redescendre dans la cité pour l’organiser. D’ailleurs, n’oublions pas que la dialectique platonicienne doit toujours être perçue sous sa double dimension, ascendante et descendante. L’éducation acquise dans la pure contemplation de l’intelligible, l’âme doit redescendre dans la cité pour l’achever, car sa mission c’est d’organiser la société afin de la rendre vertueuse et gouvernable. Et, c’est la mission assignée au philosophe-roi à qui est destiné le gouvernement de la cité juste ou cité idéale. Et, c’est ici que l’émergence véritable doit prendre tout sens chez Platon. La cité ou la nation qui veut émerger doit avoir, à l’image du philosophe-roi, des gouvernants bien éduqués, c’est-à-dire des dirigeants vertueux qui, ayant contemplé l’idée du bien, se détournent du mal pour ne penser qu’au bonheur du peuple. En ce sens, l’émergence c’est d’abord la connaissance du Bien, ce Bien qui amène les politiques à organiser la vie dans la cité afin qu’elle soit une vie bonne et remplie de sagesse. À ce sujet, Platon (2011, 520b-521a) écrit : « C’est, en effet, dans cette cité seulement que dirigent ceux qui sont réellement riches : riches non pas d’or, mais de cette richesse qui est nécessaire à l’homme heureux, c’est-à-dire une vie bonne et remplie de sagesse ».
Cela revient à dire que l’émergence n’est pas seulement la richesse matérielle. Ce qui compte le plus, chez Platon, c’est surtout cette vertu d’où découle l’émergence matérielle. En ce sens, Socrate disait : « Ce n’est pas des richesses que vient la vertu, mais c’est de la vertu que viennent les richesses et tous les autres biens, pour les particuliers comme pour l’État » (Platon, 2011, 29e-30d). Autant dire que la vertu est le socle de l’émergence. Et, c’est cette vertu que les Africains doivent cultiver, s’ils veulent sortir du sous-développement pour rejoindre les nations émergentes. Les Africains doivent comprendre que c’est de l’idée du bien que vient la vertu, et que c’est aussi de la vertu que viennent toutes les richesses et les autres biens qui feront de leurs nations des nations émergentes. Si cette leçon morale platonicienne est bien comprise par les Africains, s’ils se l’approprient, et s’ils acceptent de s’éduquer en cultivant la vertu, il n’y a pas de raison qu’ils ne sortent pas du sous-développement pour aller en avant, c’est-à-dire aller à l’émergence. L’éducation doit même s’inscrire dans l’émergence de l’Afrique pour la renforcer et la parachever durablement.
Certaines grandes nations développées, telles que les États-Unis d’Amérique, le Japon, l’Allemagne, l’Angleterre, la France, et certaines nations émergentes telles que la Chine, le Brésil, l’Inde, etc., sont des modèles de nations bien éduquées, nations dans lesquelles l’on ne crée pas de conflits inutiles pour détruire tout ce qui a été bâti durant des siècles. C’est dire que l’éducation, c’est aussi cette prise de conscience, et que les Africains peuvent bien changer de mentalité, de conduite et de comportement, s’ils le veulent. L’émergence de l’Afrique n’est donc pas une utopie, mais celle-ci ne peut se faire sans une éducation qui l’accomplit et la parachève durablement. Pour L. Brisson et F. Fronterotta (2006, p. 206), « ce qui est susceptible d’être éduqué, c’est l’humain en l’homme ; et l’éducation, dans la mesure où elle s’inscrit dans le prolongement et le renforcement de cette tendance humaine naturelle, accomplit et parachève ce processus d’humanisation ». On retiendra donc que c’est l’éducation ou l’idée du bien qui accomplit et parachève l’émergence. De cette analyse, il ressort que c’est de l’idée du bien que vient la vertu, et c’est aussi de la vertu que vient l’émergence. C’est pourquoi, il est indispensable aux Africains de s’éduquer pour acquérir cette vertu qui sera le socle de leur véritable émergence.
Conclusion
En définitive, nous devons retenir que les conflits et autres graves crises qui déstabilisent l’Afrique sont des freins à son émergence. Et l’absence de paix est réellement ce qui enfonce les États africains dans le sous-développement. Mais, le rêve de voir, un jour, l’Afrique sortir de ce cycle infernal de violence est permis. Car, c’est dans l’esprit des hommes que naissent les conflits, et c’est également dans leur esprit que naît la paix. Si, autant qu’ils sont, politiques et citoyens prennent conscience des dangers des conflits, ils comprendront que la paix est un bien précieux qu’il faut cultiver, tel que l’a enseigné Platon.
Si, les Africains avaient la culture de la paix, alors ils auraient fait un pas important vers l’émergence tant souhaitée. Platon l’a indiqué, la paix est une condition essentielle de développement, et les Africains ont le devoir de cultiver cette paix pour pouvoir poser les jalons de l’émergence. En plus de la paix, il faut que les Africains prennent au sérieux l’éducation que Platon considère comme le socle, voire l’essence même de l’émergence véritable. L’éducation consiste à détourner l’âme du sensible pour l’amener dans l’intelligible, pour qu’elle contemple l’idée du bien, la source ultime de toutes les essences ou vertus. L’âme, ayant acquis son éducation dans la pure contemplation de l’intelligible, doit redescendre ici-bas pour apporter sa contribution à l’édification de la cité. Pour nous, en nous inscrivant dans la pensée politique platonicienne, nous disons qu’étant donné que c’est de l’idée du bien que vient la vertu, et que c’est de la vertu que vient l’émergence véritable, il y a lieu d’inscrire l’éducation au bien dans l’émergence de l’Afrique, afin qu’elle l’accomplisse et la parachève durablement.
Références bibliographiques
ARON Raymond, 1965, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard.
BONAN Ronald, 2014, Platon, Paris, Les Belles Lettres.
BRISSON Luc et FRONTEROTTA Francesco, 2006, Lire Platon, Paris, PUF.
BRUN Jean, 1966, Socrate, Paris, PUF.
COPANS Jean, 1990, La Longue marche de la modernité africaine, Paris, Karthala.
FINLEY Moses, 1985, L’Invention de la politique, traduction de Jeannie Carlier, Paris, Flammarion.
GUISSÉ Youssouph Mbargane, 1979, Philosophie, culture et devenir social en Afrique noire, Dakar, Les Nouvelles Éditions Africaines.
HALLOWELL John, 1972, Les Fondements de la démocratie, traduction de Albert Bedarrides Paris, Les Éditions Inter-Nationales.
MESURE Sylvie et RENAUT Alain, 1999, Alter-ego : les Paradoxes de l’identité démocratique, Paris, Champs-Flammarion.
MORE Thomas, 1986, L’Utopie, traduction de Marie Delcourt, Paris, Garnier Flammarion.
OWONA Joseph, 1985, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, Paris, Éditions Berger-Levrault.
PERROUX François, 1981, Pour une philosophie du nouveau développement, Paris, Aubier-Montaigne.
PLATON, 2011, Apologie de Socrate, Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, La République, Œuvres Complètes, traduction de Georges Leroux, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Politique, Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion.
ROSAVALLON Pierre, 2006, La Contre-démocratie, Paris, Seuil.
TERESTCHENKO Michel, 1992, Enjeux de philosophie politique moderne – les violences de l’abstraction, Paris, PUF.
YOUNOUSS Mohamed, 2015, Côte d’Ivoire : En route vers l’émergence, Paris, les Impliqués Éditeur.
ÉMERGENCE ET PROBLÉMATIQUE DE RECONNAISSANCE DES DROITS HUMAINS DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
NAMAN Berni
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
yvantrsor.berni@yahoo.fr
Résumé :
La tendance actuelle à l’émergence des États africains ne doit pas faire perdre de vue le sens de l’aspiration aux mieux-être intégral des populations. L’Afrique est un continent où la couverture sociale n’est pratiquement pas assurée. Les droits sociaux font face au mépris et au déni de reconnaissance. Le chômage, l’éducation, l’accès à l’eau potable, la santé sont des questions qui sont loin d’être résolues. L’analyse de ces questions sous l’angle philosophique pose la problématique de reconnaissance des droits humains surtout des droits sociaux au fondement de l’émergence. Pour résoudre ce problème, les africains doivent s’approprier le principe de développement humain qui prône la promotion et le respect des droits de l’homme.
Mots-clés : Afrique, développement humain, droits humains, droits sociaux, émergence économique, reconnaissance, lutte pour la reconnaissance.
Abstract :
The current tendency to emergence of the African nations should not lose sight of the aspiration to an integral better life of populations. Africa is the continent in which the social security cover is practically not ensured. Social rights face the contempt and negation of recognition. Unemployment, education, access to drinking water and health are issues that are far to find solutions. The analysis of these questions in the philosophical perspective addresses the problematic of the recognition of social right at the foundation of emergence. To solve this problem, Africans must appropriate to themselves the principle of human development which extols the promotion, and respect of human rights.
Keywords: Africa, human development, human rights, social rights, economic emergence, recognition, struggle for recognition.
Introduction
L’essentiel des discours politiques et économiques des dirigeants africains ces dernières années, est axé sur la question de l’émergence. Ceux-ci mettent au premier plan leurs aspirations à une économie émergente. Les institutions financières sous régionales (la CEMAC et l’UEMOA), qui soutiennent cette initiatives ont même fixé l’année 2025 comme le délai de réalisation de cet objectif. Certains États très optimistes comme la Côte d’Ivoire, ont ramené leur délai à 2020. D’autres, plus modérés comme le Cameroun, ont repoussé l’échéance à 2030. Mais au moment où ces différents États cherchent à atteindre cet objectif par la prise d’initiatives innovantes et déterminantes dans la recherche de développement économique et social, la question de la reconnaissance se pose avec acuité. On assiste, de plus en plus, avec l’ouverture des espaces publics, symbole des sociétés démocratiques, à l’explosion des demandes et attentes de reconnaissance. Ces demandes concernent aussi bien des droits fondamentaux que des droits spécifiques ou intérêts privés que l’on cherche à intégrer au rang des droits fondamentaux. Tout se passe comme si la réalisation de l’émergence doit satisfaire, au préalable, aux conditions de reconnaissance des droits humains.
Il se pose dès lors, le problème de l’articulation des droits humains avec l’émergence tant nourrie et souhaitée par les dirigeants africains. Comment ce problème d’articulation se traduit-il en Afrique ? Les droits humains sont-ils reconnus dans la gestion et la gouvernance des pays en voie de développement ? En quoi la promotion du principe de développement humain peut-elle conduire ces pays à l’émergence ? Si toutes ces questions se posent, directement ou indirectement, dans l’espace philosophique qui laisse entrevoir le croisement entre l’idée d’une reconnaissance des droits humains et les exigences de l’émergence, ne serait-il pas important de clarifier ces deux concepts afin de mieux les articuler dans le sens du bien-être de tous ? En clair, la question centrale suivante s’impose : quel sens donner à l’émergence pour une humanité réconciliée ?
Mêlant réflexion théorique et exposé des cas dans une démarche délibérément descriptive et prescriptive, cet article se propose, dans un premier temps, d’analyser le concept d’émergence sous l’angle philosophique, de mettre en évidence, dans un deuxième temps, l’écart existant entre l’ambition d’être émergents des pays africains et la reconnaissance des droits sociaux de la deuxième génération des droits de l’homme et de faire ressortir, dans un troisième moment, des aspects clés propices à l’émergence afin d’orienter les politiques nationales vers les bonnes pratiques.
1. Les logiques de l’émergence. Comprendre le concept à partir de son fondement philosophique
L’idée d’émergence n’est pas une idée proprement politique, encore moins économique. Elle a une histoire et une origine. L’origine de l’émergence est à rechercher dans la philosophie, plus précisément, dans celle de John Stuart Mill dont les philosophes anglais qualifiaient ses caractéristiques d’« émergentes » (P. Juignet, 2015, p. 120). À l’origine de cette appellation, se trouve la réflexion de Mill selon laquelle « la juxtaposition et l’interaction des parties constitutives d’un être vivant ne suffisent pas à expliquer les propriétés de ce dernier » (Idem, p. 111). Si Mill est parvenu à un tel résultat, c’est parce qu’il a constaté que « des entités émergentes peuvent être le résultat de l’action d’entités plus fondamentales et pourtant être parfaitement nouvelles ou irréductibles par rapport à ces dernières » (Idem, p. 123). Cette explication sonne l’annonce de l’idée centrale d’émergence. Depuis lors, l’idée d’émergence a été reprise et employée par les philosophes dans des acceptations très diverses. Elle est présente chez Lloyd Morgan (1923) et Samuel Alexander (2004) sous la forme d’une théorie dénommée « évolutionnisme émergent » (Ibidem, p. 135). Pour ces deux philosophes anglais, le monde se développerait à partir de ses éléments de base en faisant apparaître des configurations de plus en plus complexes. Ils sont suivis par des philosophes et biologistes anglais qui ont employé le concept d’émergence dans le but de sortir du débat sur le vitalisme. Contre les mécanistes qui prétendent que la vie et les phénomènes biologiques pouvaient être expliqués entièrement par les lois physiques, la thèse vitaliste postulait l’existence de certaines forces comme « l’élan vital » (F. Mathieu, 2015, p. 248) ou « l’entéléchie » (Idem). Dans la philosophie d’Henri Bergson (2013, p. 67), l’élan vital est une force vitale ou tendance créatrice qui permet de « passer d’une génération de germes à la génération suivante de germes par l’intermédiaire des organismes développés qui forment entre les germes le trait d’union ». L’élan vital se développe à travers les organismes particuliers, assure la continuité de l’espèce et engendre l’évolution des êtres. Cette force vitale est ce qu’Aristote (2005, p. 240), appelle entéléchie, c’est-à-dire « un être ayant en soi sa fin et sa perfection ». Elle est la force par laquelle un objet passe d’un premier état à un second, de ce qu’il n’était pas encore à ce qu’il est ; force considérée par rapport au but auquel elle tend.
Il ne s’agit là que de quelques jalons historiques qui permettent de suivre le cheminement de l’idée d’émergence et d’en déterminer le contenu sémantique. De ce cheminement, il ressort que la définition du concept d’émergence suppose une pluralité ontologique du monde, c’est-à-dire que le réel ne soit pas homogène. Sous cet angle, l’émergence désigne tout simplement le processus de formation de nouvelles formes d’existence du réel, que l’on peut qualifier de degré d’organisation et d’intégration. Appréhendée du point de vue empirique, l’émergence est une façon de désigner la formation d’entités complexes irréductibles. Comme le souligne le sociologue Pierre Bourdieu (2013, p. 384), elle est « le passage d’un système de facteurs interconnectés à un système de facteurs interconnectés autrement ». Ainsi l’émergence renvoie à un monde pluriel, en évolution. Elle suppose l’organisation du monde selon des degrés de complexité croissante, succession qui ne peut être réduite à ses degrés élémentaires.
On comprend dès lors que l’émergence a jailli du domaine philosophique et que la logique financière et économique qui la caractérise, aujourd’hui, n’a pas présidé à ses origines. Le concept a intégré la terminologie économique et financière moderne par la volonté des chercheurs, en économie, de l’exploiter, au niveau de l’élaboration et/ou la mise en œuvre des politiques économiques, dans le but d’évacuer la problématique de la lutte contre la pauvreté et/ou celle du développement. Le premier économiste à employer le concept de l’émergence est Antoine Van Agtmael. Alors qu’il exerçait au département des marchés de capitaux de l’International Finance Corporation (IFC), une filiale de la Banque Mondiale (BM) orientée vers le secteur privé, celui-ci l’utilisa, en 1980, dans « une analyse des opportunités et dynamiques d’investissement dans différentes économies dont les marchés (marchés émergents) présentaient certaines spécificités attractives » (F. Ülgen, 2016, p. 8). Comme ces nouvelles opportunités se situaient souvent et en nombre croissant dans nombre de pays en développement, le terme de marché émergent a vite été remplacé par celui d’économie émergente.
Selon l’usage conventionnel du terme, une économie émergente signifie une économie de marché émergente, c’est-à-dire les pays en voie de développement qui vivent une forte croissance économique. Dorénavant, on utilisera indifféremment les termes de « pays émergent » ou « économie de marché émergente » (F. Ülgen, p. 13), pour indiquer des exemples en matière de performance économique réalisée de plus en plus par des pays en voie de développement. C’est ce modèle de développement économique que veulent copier les pays africains en voie de développement pour ainsi embrasser la voie de l’émergence. Il s’agit ici d’une prise de conscience pour ces pays qui sont appelés à progresser sur le sentier de la croissance économique ou de la recherche de la puissance économique dans le cadre de l’économie mondiale. Autrement dit, la puissance économique affichée par les pays qui ont été à l’origine du concept de pays émergents ou marchés émergents (la Chine, le Brésil, l’Inde, la Russie), a tellement fasciné certains pays africains en voie de développement (le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Cameroun, etc.). Engagés sur la voie de l’émergence, au regard des délais de réalisation qu’ils se sont fixés, ces pays africains entendent dorénavant être évalués selon des critères bien déterminés par P. Hugon (2010, p. 13) :
Le taux de croissance économique, la taille de la population, la diversification de la production, l’importance des exportations et des importations (taux d’ouverture), l’intégration au monde financier international, le rôle stratégique de l’État pour le développement, les investissements dans la Recherche et le Développement, la capacité de protéger le territoire.
Au regard de ces critères, il est évident que l’émergence économique d’un pays renvoie à une vision fortement systémique qui prend en compte des critères monétaires, politiques et stratégiques qui s’inscrivent dans une dynamique nationale et internationale. En d’autres termes, la vision qui transparait dans la plus part des critères qui déterminent l’émergence d’un pays est essentiellement économique. Cette vision rappelle celle qui préfigurait dans le « Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) » (M. Gazibo et O. Mbabia, 2017, p. 7), qui ambitionnait d’atteindre pour le continent, un taux de croissance du PIB de 7% par an à l’horizon 2015, mais aussi une série d’objectifs en matière de développement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté. Cette vision était contenue également dans le concept de « Renaissance africaine » (Idem), promu par le Sud-africain Thabo Mbeki, concept axé sur des changements économiques, mais surtout idéologiques. Cette vision se trouve enfin dans « l’agenda 2063 » (Idem), élaboré par l’Union Africaine (UA) en 2015, qui reprend le concept de renaissance et articule sept grands objectifs parmi lesquels se trouvent le respect des droits de l’homme et le souci du bien-être social. L’aspiration des africains à l’émergence, à travers ce rappel historique, montre la vision optimiste décrivant un continent d’avenir, qui cherche à refaire son retard économique ou à prendre son envol ou un continent qui « s’éveille » (S. Ellis, 2012, p. 16), qui bouge (A. Ravignan, 2013, p. 12), succédant ainsi à cette vision pessimiste d’une Afrique « mal partie, sans espoir, qui refuse le développement et se meurt » (M. Gazibo et O. Mbabia, 2017, p. 7). Mais l’énonciation, sans cesse, ainsi que l’inclusion des objectifs en matière de développement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre le chômage, le classement du respect des droits de l’homme et le souci du bien-être social au rang des priorités de l’Afrique, tels qu’énoncés par le NEPAD, la Renaissance africaine et l’Agenda 2063, montrent bien que le critère principal de croissance économique qui caractérise l’émergence d’un pays doit se fonder nécessairement sur la reconnaissance des droits humains. La reconnaissance prend ici, le sens de respect, de valorisation, de considération, de la prise en compte des droits humains.
Les droits humains en jeu, dans cette étude, sont les droits sociaux ou « droits de créance » (G. Haarsher, 2015, p. 87), qui appartiennent à la deuxième génération des droits de l’homme dont la Déclaration a été solennellement proclamée le 26 août 1789. L’importance de la question des droits sociaux, dans le processus d’émergence, se mesure à partir du contenu même de ces droits. En effet, la deuxième génération des droits de l’homme – Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 – demande l’intervention de l’État, à la place d’une abstention (le cas de la première génération des droits de l’homme ou droits-liberté). Ces droits dits économiques, sociaux et culturels, sont les suivants : « Droit à la santé, à l’éducation, au travail, à la sécurité sociale, à un niveau de vie décent, etc. » (G. Haarsher, 2015, p. 88). Désormais, c’est une prestation sociale de l’État qui est exigée : construction d’hôpitaux adéquats, médecine gratuite ou du moins accessible, écoles en nombre suffisants et enseignants rémunérés par la collectivité, engagement de l’État dans la vie économique, dépense sociales. Si l’on considère ces droits sociaux comme des droits humains, c’est-à-dire si l’on veut leur donner le même statut fondamental qu’avaient ceux de la première génération (liberté d’aller et venir, respect de la personnalité – respect du domicile, secret de la correspondance -, liberté de conscience et d’expression, pour l’essentiel), quel bilan diagnostic pourrait-on dresser, aujourd’hui, concernant leur reconnaissance par/dans les États africains au moment où ceux-ci ambitionnent d’être émergents ?
2. La reconnaissance des droits humains et ses implications philosophiques dans le processus d’émergence
La reconnaissance des droits humains est un pilier fondamental dans la réalisation des objectifs de l’émergence. Un État qui n’arrive pas à construire ce pilier est bien loin d’atteindre le cap de l’émergence. Car la non prise en compte de cette dimension correspond à ce que Hegel appelle l’ « injustice dans la reconnaissance » (G. F. W. Hegel, 1976, p. 87). En effet, selon Hegel, il existe trois sphères de reconnaissance selon un degré toujours plus fort d’autonomie accordé au sujet : l’amour, le droit et l’éthicité. Pour ce qui est de notre étude, la deuxième sphère de reconnaissance est celle qui nous intéresse, c’est-à-dire le droit. Par droit, il faut entendre « la reconnaissance juridique qui repose sur la garantie des droits fondamentaux entre les individus permettant le respect de soi » (Idem). Cette dimension de la reconnaissance inclue la reconnaissance des droits par l’attribution et le respect des droits de l’individu. Dès lors, le mépris de cette reconnaissance est considéré comme une injustice. Cette injustice correspond à ce que l’on pourrait appeler une atteinte à l’honneur de la personne ou de l’individu. L’atteinte aux droits sociaux des individus constitue, de ce fait, une injustice, car les êtres humains doivent être à l’abri de ce genre d’atteinte afin de construire leur identité, ce qui est un pré requis au bien-être social. On comprend ainsi les mouvements d’humeur (marche de protestations, soulèvement populaire qui se traduisent le plus souvent par des actes de vandalisme et de sabotage des symboles de l’État) qui naissent dans un pays lorsqu’une atteinte est portée contre ces droits. Ces mouvements ont un impact négatif sur le développement économique d’un pays.
Il faut se référer à Axel Honneth pour avoir une compréhension plus nette des implications philosophiques de la reconnaissance dans le processus d’émergence. S’appuyant sur le triptyque hégélien, il a créé une théorie de la reconnaissance. Selon Honneth (2006, p. 252), la reconnaissance se définit comme « un acte performatif de confirmation intersubjective par autrui des capacité et des qualités morales que se prêtent des individus, des sujets ou des groupes ancrés dans un monde social vécu ». Il ne s’agit pas dans notre cas, des qualités et des capacités morales que des individus, des sujets et des groupes se sont prêtées dans un monde social, et qu’ils chercheraient une confirmation performative, c’est-à-dire de la reconnaissance par l’État. Il s’agit ici des droits sociaux des individus, des sujets et des groupes qui sont reconnus et proclamés dans les différentes constitutions d’un État. La reconnaissance de ces droits sociaux s’inscrit ainsi dans la performativité qui est le fait pour un État d’être performatif, c’est-à-dire de réaliser ce qu’il a reconnu et proclamé. Autrement dit, l’acte de reconnaissance des droits humains consiste pour l’État, à assurer la protection sociale qui garantit à chaque sujet, chaque individu et chaque groupe un bien-être social.
La négation ou le mépris des droits des sujets ou des groupes d’individus par un État pousse ces derniers dans une lutte. Cette lutte prend alors une forme particulière, celle de la lutte pour la reconnaissance des droits. En d’autres termes, le concept de reconnaissance est inséparable d’une lutte. Cette lutte doit être comprise non pas en termes d’intérêts biologiques ou matériels pour la conservation de soi, mais comme un processus de formation du rapport pratique à soi à travers des attentes de reconnaissance formulées à l’égard de l’État. Dans cette logique, un État émergent est un État où l’environnement social, culturel et politique offre les possibilités d’une réelle promotion des droits humains. C’est un État dans lequel chaque citoyen doit pouvoir bénéficier des avantages que lui offrent ses droits naturels sans avoir à en passer par l’expérience douloureuse du mépris ou du déni de reconnaissance. C’est à ce niveau que se justifie la théorie de « la lutte pour la reconnaissance » développée par Honneth. Il part de l’idée selon laquelle « le principe de reconnaissance constitue en quelque sorte le cœur du social » (Honneth, p. 154). À partir de ce principe, Honneth dégage un modèle comportant trois sphères de reconnaissance (amour, droit et participation). La sphère du droit (celle qui nous intéresse), suppose qu’une personne puisse se sentir porteuse des mêmes droits qu’autrui et développer ainsi un sentiment de respect de soi. La reconnaissance juridique de la personne passe par le vecteur du droit entendu comme réciprocité entre les droits et les devoirs. Le rapport positif à soi que vise la reconnaissance juridique (ou moral au sens kantien du terme) est la dignité ou le respect des droits des sujets. Le caractère respectable que les sujets ou groupes d’individus reconnaissent à l’État (le respect des lois de l’État) les engagent à agir respectueusement envers lui. Lorsque de telles attentes normatives ne sont pas comblées (dans le cas par exemple de non reconnaissance de droits aux groupes sociaux), des luttes pour la reconnaissance peuvent être enclenchées. Dès lors, Honneth conclut que « le motif de tout conflit est une attente de reconnaissance » (Idem). De telles luttes s’appuient sur le potentiel normatif que contient in principio le registre formaliste et universaliste du droit dans les sociétés modernes. Elles sont souvent accompagnées de débordement qui constitue un frein pour l’émergence d’une nation.
Cette dimension de la reconnaissance dans le processus d’émergence trouve son approfondissement chez Paul Ricœur. Ce dernier présente deux dimensions de la reconnaissance : l’une active et l’autre passive. La reconnaissance active est le fait de « reconnaître un quelque chose en général, le verbe actif qui intervient dans l’ordre de la connaissance » (P. Ricœur, 2005, p. 325). Dans la reconnaissance passive, « le soi demande à être reconnu : je reconnais activement quelque chose des personnes, mais moi-même, je demande à être reconnu par les autres » (Idem). Le soi sait qu’il vit avec les autres dans la société. Ils se rencontrent. Il reconnaît également en chacun des autres quelque chose qui est générale, qui est active. C’est ce quelque chose qu’il demande aux autres, en retour, de lui reconnaître. Or, ce qui est général, actif, universel en chacun de nous, ce sont les droits humains. C’est dire que le soi demande une reconnaissance de ses droits par les autres. Il est donc question d’une reconnaissance mutuelle des droits humains. À de rares exceptions près, l’Afrique demeure jusqu’ici, le continent dans lequel la protection des humains surtout les droits sociaux est moins assurée. Cette situation oblige les populations à lutter pour la reconnaissance de leurs droits sociaux. Ici, conformément à la vision de Ricœur, les populations sont dans la phase passive en demandant à être reconnue. Être reconnu, c’est « le recours à autrui pour [mener] à la certitude personnelle qu’a un agent humain concernant ses capacités et un statut social » (P. Ricœur, 2004, p. 401). Du point de vue des droits humains, les dispositions naturelles n’impliquent pas de demande de reconnaissance par les sujets. La certitude de pouvoir le faire est intime certes, toutefois, chacune appelle un vis-à-vis. Le discours est adressé à quelqu’un qui est capable de répondre, d’entrer en conversation et en dialogue. Ce qui manque à ces implications du sujet dans la certitude privée de pouvoir faire, c’est la réciprocité, la mutualité, qui seule permet de parler de reconnaissance au sens fort du terme. Cette mutualité n’est pas donnée spontanément, c’est pourquoi elle est demandée, et cette demande ne va pas sans conflit, et sans lutte. L’extension ou la généralisation de cette lutte est l’occasion de conflits sociaux qui ne sont pas sans conséquences pour l’émergence des États africains.
Il faut ajouter, à cette fragile situation, les conséquences des activités économiques de certaines entreprises privées avec les effets des innovations technologiques que doivent affronter les populations africaines. Dans la course à l’émergence, l’État encourage les investissements privés. L’objectif de l’État est de promouvoir de l’emploi pour ses citoyens et renflouer ses caisses par l’imposition des taxes. Il arrive malheureusement des fois où les activités de ces entreprises constituent un obstacle considérable à la protection des droits humains. La pollution et la dégradation de l’environnement à travers le déversement des eaux usées et déchets toxiques dans la nature. Il va sans dire que cela entraine les risques de propagation de maladie, sans oublier l’occupation de certaines propriétés privées en violation des droits fonciers (certaines entreprises ne purgent pas les droits fonciers coutumiers), les mauvais traitements des employés nationaux au profit des expatriés, etc. Ce sont là autant de défis que doivent affronter les droits humains dans la marche du continent vers l’émergence. Comment relever avec succès ces défis sans passer par l’appropriation du principe de développement humain, qui met un accent particulier sur la dimension humaine et sociale dans tout programme de développement économique ?
3. De l’urgence du développement humain pour une Afrique émergente
À ce niveau de notre analyse, il ressort que le processus d’émergence dans lequel s’est engagé le continent vise fondamentalement les objectifs de développements économiques. Mais les États africains ne doivent pas perdre de vue que le bien-être de leurs populations ne se résume pas seulement à l’économie et aux revenus que chaque citoyen doit avoir. Leur bien-être réside dans la capacité desdits États à allier développement économique, protection et promotion des droits des concitoyens. Pour ce faire, les États africains doivent s’approprier le principe de développement humain que le Rapport mondial sur le développement humain (2016, p. 2) présente comme suit :
L’approche du développement humain réorientait le discours sur le développement, l’éloignant de la quête de l’opulence matérielle, de la multiplication des revenus et de l’optimisation de la croissance pour le rapprocher de l’amélioration du bien-être humain, du développement des capacités et de l’élargissement des libertés. Il se préoccupait de la richesse de la vie humaine et non pas simplement de la richesse économique des pays, changeant ainsi la perspective sur les résultats du développement.
S’approprier le principe de développement humain, c’est rechercher un développement qui assure l’amélioration du bien-être humain (ou son maintien), ce dernier étant déterminé par des caractéristiques personnelles (éducation, santé, libertés individuelles, etc.). De ce fait, le développement humain s’appuie sur la Déclaration des droits de l’homme de 1948, plus particulièrement l’article 22 qui stipule que « toute personne a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité» (D. Lochak, 2009, p. 39). À l’évidence, le développement humain prône la promotion et le respect de la dimension humaine et sociale de l’individu dans le processus de développement. La dimension humaine exige le respect de la dignité de l’homme dans tout processus de développement économique. Dans ces conditions, le respect de la dignité humaine impose le respect du droit à la sécurité sociale. Celui-ci se présente comme une branche du droit social, qui s’intègre à la notion plus large de protection sociale. Au sens général, la protection sociale vise à protéger les personnes physiques contre les risques sociaux susceptibles d’affecter leur capacité de gain. Elle assure les prestations suivantes : assurances sociales, assurances d’accident du travail, etc. En la matière, la mise en œuvre de politiques sociales en Afrique reste très limitée. Cela constitue une barrière à l’émergence dans la mesure où elle ne permet pas aux pays africains de créer de la croissance et de stabiliser le marché. Pour être un continent émergent, l’Afrique doit accompagner son plan de développement économique de politiques sociales.
C’est dire qu’il existe nécessairement un lien entre l’émergence et le développement de politiques sociales. Les politiques sociales regroupent à la fois les dimensions sociales du développement et la protection sociale. Même si les dimensions sociales du développement, ou encore les dimensions du développement humain, concernent l’accès à l’éducation et à la santé, alors que la protection sociale désigne à la fois les programmes contributifs comme la sécurité sociale et les programmes non contributifs comme l’assistance sociale, elles vont de pairs. Par exemple, l’école participe au développement, mais il faut des élèves en bonne santé pour suivre les cours, qu’elle soit gratuite et accessible et que les parents puissent participer, c’est-à-dire qu’ils soient en bonne santé et avec un revenu qui les encourage à maintenir leurs enfants le plus longtemps possible à l’école. Tout cela nécessite donc des investissements, des infrastructures (constructions d’écoles et routes, d’hôpitaux, etc.) qui participent au développement économique, mais aussi des politiques sociales pour les enfants et les parents. En définitive, les performances des dimensions sociales du développement sont étroitement liées à l’ampleur de la protection sociale. En effet, en l’absence d’un système de protection sociale, l’occurrence d’une maladie peut entamer le revenu des ménages et par conséquent leur capacité à scolariser les enfants. Cela conduit, globalement, à une faible productivité et donc un faible niveau de revenu qui, à son tour, entretient la fréquence des maladies et affecte la capacité d’entreprendre. Ce cercle vicieux qui s’installe, en l’absence de la protection sociale, est confirmé dans le contexte africain où les données montrent qu’un faible niveau de protection sociale est généralement associé à un faible niveau de revenu, de santé et d’éducation.
Le développement humain implique le changement social. Ce dernier se définit comme « étant toute transformation observable dans le temps, qui affecte d’une manière qui ne soit pas provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l’organisation sociale d’une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire » (M. Mbaloula, 2011, p. 108). Le changement social n’est possible, dans un pays, lorsque la croissance économique tient compte de la répartition du revenu et de l’interaction entre production et répartition qui est susceptible de générer le développement humain. Jusqu’ici, les populations africaines souffrent d’un partage insuffisant et d’une inégale répartition des profits de la croissance économique. Les couches sociales qui produisent ne bénéficient pas davantage du revenu de leurs produits. Les zones de productions sont enclavées, les infrastructures de base y sont insuffisantes voire inexistantes, le quotidien des populations ne s’améliore guère, etc. La Côte d’Ivoire, par exemple, est le premier pays producteur mondial du cacao et de l’anacarde. Malheureusement, les paysans ivoiriens vivent dans la précarité, ils éprouvent des difficultés à écouler leurs produits, à scolariser leurs enfants, à s’offrir des soins de santé de qualité. Dès lors, pour conserver à l’émergence toutes ses dimensions, « il semble souhaitable de lui accoler des exigences sociales, humaines » (CIEA, 2017, Communiqué final).
Il faut ajouter à cet impératif la question foncière en Afrique. En effet, l’Afrique est le continent privilégié des nouveaux investissements ces dernières décennies. En général, le continent est décrit comme disposant d’importantes réserves forestières peu ou pas valorisées. La Banque Mondiale qualifie même l’Afrique de « Géant endormi n’attendant que les investisseurs pour s’éveiller » (A. Adamczeweski, J-Y Jamin et al…, 2012, p. 8). Cette vision n’est pas sans conséquences pour les terres africaines. On assiste ainsi à une course à la terre en Afrique et à une constitution de la rente foncière. Certains avancent même les thèses d’« accaparement de terres et d’appropriation foncière » (Rochegude, 2011/Teyssier et Al., 2010, p. 23). Cette ruée vers les terres avec à la clé les grands projets d’investissements a des conséquences sur la vie des populations locales. Elles sont souvent expulsées. Leurs ressources disponibles diminuent (bois de feu, pâturage, etc.), tandis que les terres cultivables se raréfient. Les terrent concernées par les projets d’investissement sont rarement exemptes d’activités humaines, et les droits des populations riveraines sont très peu pris en compte. La substitution des paysans qui exploitent ces terres (agriculture pluviale, élevage extensif, chasse, cueillette, etc.) par les projets est niée ou justifiée par les impératifs du développement et la nécessité du passage d’une économie faible à une économie émergente. Les coûts sociaux sont alors présentés comme le prix à payer pour que la nation accède à un avenir économique meilleur. Une telle approche de l’émergence est contre-productive en ce sens que certains investissements, prenant la « forme de néo-colonialisme » (Idem), se transforment en un système de spoliation de la propriété des populations locales ainsi qu’une violation des droits qui en découlent. Il reste une évidence qu’à ce stade, l’émergence constitue un obstacle pour le bien-être des populations locales dont la prise en compte dans les politiques socio-économiques constitue un gage de stabilité sociale et marche de consommation sécurisé. Afin de lever cet obstacle, les États africains doivent lever le flou qui rend fragile les lois qui reconnaissent peu les droits fonciers coutumiers. Ils doivent, par une nouvelle législation, élaborer des textes qui encadrent les investissements en mettant un accent particulier sur les études d’impact environnemental et social se fondant sur des consultations des populations locales. Cette disposition de la loi doit être une condition préalable au démarrage d’un quelconque projet d’investissement sur le continent. Ces études doivent permettre d’analyser le fonctionnement humain et environnemental du milieu et d’évaluer les répercussions majeures du projet.
Conclusion
Il faut retenir que l’analyse philosophique du concept d’émergence a permis de découvrir sa richesse au plan économique. Cette richesse est celle d’une prise de conscience pour certains pays africains qui se sont engagés à progresser sur le sentier de la croissance économique ou de la recherche de la puissance économique dans le cadre de l’économie mondiale. Elle est aussi et surtout celle d’un rattrapage économique à travers la mise en place des structures et infrastructures économiques, technoscientifiques innovantes dans la recherche de développement économique et social. Mais notre analyse a également révélé les limites d’une telle émergence dans la mesure où l’Afrique est un continent où la protection sociale n’est pas assurée. Les populations africaines souffrent d’un partage insuffisant et d’une inégale répartition des fruits de sa croissance économique. L’éducation, le chômage, l’accès à l’eau potable et aux soins de santé de qualité sont loin d’être résolus. Ce qui dénote du mépris des droits des populations, plus particulièrement leurs droits sociaux. Les initiatives pour la reconnaissance de leurs droits entraînent le plus souvent les populations dans une lutte pour la reconnaissance. Cette lutte n’est pas sans conséquences pour l’émergence en ce sens qu’elle est à l’origine des troubles sociaux dont la manifestation constitue un frein au développement économique. Pour lever cet obstacle, le continent devra s’approprier le principe de développement humain qui implique une nécessaire conciliation entre les politiques de développement économique et la protection sociale. Cette démarche a l’avantage de prendre en compte la dimension humaine de l’émergence qui se traduit par la reconnaissance des droits humains, surtout les droits sociaux des populations qui constituent la couche la plus vulnérable.
Références bibliographiques
ADAMCZEWSKI Amandine, JAMIN Jean-Yves Jamin et al (2012), « Investissements ou accaparements fonciers en Afrique ? Les visions des paysans et de la société civile au Mali », in Revue Développement durable et territoire, vol3. N°3, Décembre.
ARISTOTE (1995), Traité de l’âme, traduction française de Richard Bodéüs, Laval, Laval théologique et politique.
BERGSON Henri (2013), L’évolution créatrice, Paris, Les Écoles du maquis. BOURDIEU Pierre (2013), Manet, Une révolution symbolique, Paris, Seuil.
Comité technique Foncier et développement (2017), « La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et développement », in Regards sur le foncier n°2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril 2017.
Conférence Internationale sur l’Émergence de l’Afrique (CIEA), 2017, Abidjan, Mars.
ELLIS Stephen (2012), « Quand l’Afrique s’éveille », in Magazine Books, n°32, Mai.
GAZIBO Mamoudou et MBABIA Olivier (2017), Index de l’émergence en Afrique. Observatoire de l’émergence en Afrique, Montréal, PRAME et OBEMA.
HAARSCHER Guy (2015), Philosophie des droits de l’homme, Paris, Cerf (Nouvelle édition revue et augmentée).
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich 1976, Le système de l’éthicité, Paris, Payot.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich (1976), Phénoménologie de l’esprit, Paris, Vrin.
HONNETH Axel (2000), La lutte pour la reconnaissance, traduit de l’allemand par Pierre Ruch, Paris, Cerf.
JUIGNET Patrick (2015) « Le concept d’émergence » in Philosophie, sciences et société (en ligne) disponible sur https://philososciences.com/Pss/philosophie-générale/complexite-système-organisation-émergence/38-le-concept d-émergence.
LOCHAK Daniel (2009), Les droits de l’homme, Paris, La Découverte.
MATHIEU Frédéric (2015), Philosophie des sciences, Montpellier, Annuaire.
MBALOULA Marcel (2011), « La problématique de l’émergence des pays en voie de développement », in Revue Congolaise de Gestion, volume 2, n°14, p. 107-118
NANCY Fraser (2004), Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Pais, La Découverte.
RAVIGNAN Antoine (2013), « Les défis d’une Afrique qui bouge », in Alternatives économiques, n°013, Mai.
RICOEUR Paul (2004), Parcours de la reconnaissance. Trois études, Paris, Stock.
ÜLGEN Farouk (2015), « émergence économique et économies émergentes », in Le Développement en question, n°163.
LA JUSTICE SOCIALE PLATONICIENNE COMME CONDITION D’ÉMERGENCE ET DE RECONNAISSANCE DES ÉTATS AFRICAINS
Nanou Pierre BROU
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
docteurnanou18082009@gmail.com
Résumé :
La plupart des États africains sont loin d’être émergents, et par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme des modèles de développement. Dans une perspective platonicienne, pour que ces États deviennent émergents et soient reconnus comme des puissances, il faut la justice sociale. Celle-ci, en tant qu’ordre social ou harmonie entre les différentes classes sociales, a des implications et des exigences qui s’imposent en termes de respect des différences d’aptitudes et de compétences entre les hommes, de spécialisation et de professionnalisation, de respect des tâches ou des fonctions, d’éducation des citoyens, de complémentarité entre les différentes classes sociales, d’intérêt général et de souci permanent d’efficacité dans le travail et de bien-être social.
Mots-clés : Bonheur, Compétences, Développement, Éducation, Émergence, Justice, Reconnaissance, Spécialisation.
Abstract :
Most African states are far from emerging and therefore can not be recognized as models of development. From a Platonic perspective, for these states to emerge and be recognized as powers, we need social justice. The latter, as a social order or harmony between the different classes that make up society, has implications and demands in terms of respect for differences in skills and competences between men, specialization and professionalisation, respect for tasks or functions, education of citizens, complementarity between different social classes, general interest and a constant concern for efficiency in work and social welfare.
Keywords: Welfare, Skills, Development, Education, Emergence, Justice, recognition, specialization.
Introduction
D’un point de vue historico-politique, les États naissent, émergent et se développent. Dans le cas spécifique de la plupart des États africains, considérés comme sous-développés ou en voie de développement, ils sont de nos jours, à un moment décisif de leur devenir, marqué par le désir légitime d’accéder à l’émergence. Vouloir être émergents pour les États africains, suppose qu’ils sont déjà sortis du sous-développement, c’est-à-dire qu’ils ont pu trouver des solutions aux problèmes de famine, de sous-alimentation, de santé, de gabegie, de détournement de deniers publics, de logements, d’emplois, de dictature, de tribalisme, de coups d’État, de guerres civiles, etc.
Or, en l’état actuel des choses, le constat est clair : les conditions qui ont toujours maintenu la majorité de l’Afrique dans le sous-développement n’ont pas fondamentalement changé. Ainsi, au-delà des discours politiciens annonçant en chœur l’atteinte imminente de l’émergence, la réalité africaine est celle d’un continent étreint par les mailles épineuses du sous-développement. Dans ces conditions, les espoirs et les horizons d’émergence ne peuvent que s’obscurcir et disparaître sous le poids de profondes inquiétudes, de grandes interrogations et de graves crises à la fois politiques, sociales, morales et économiques.
Cependant, cela ne signifie pas que l’Afrique ne pourra jamais émerger et se développer dans la mesure où le sous-développement n’est pas une fatalité. À l’instar des pays occidentaux, les États africains peuvent émerger et se développer. En tant qu’Africains, nous devons changer de mentalité, faire disparaître toutes nos attitudes qui contribuent à instaurer le désordre social en Afrique, car rien de grand ne peut se construire dans le désordre dont la source est l’émotion. Il faut de la rationalité, de la mesure et de la justice pour bâtir des États stables, prospères et heureux en Afrique.
La référence à Platon qui a conçu, par la puissance de son imagination, la cité idéale ou la cité juste en s’appuyant sur sa théorie de la justice sociale, peut être bénéfique pour les États africains en mal d’émergence, de développement et de reconnaissance.
Mais en quoi, la justice sociale platonicienne peut-elle contribuer à l’émergence et à la reconnaissance des États africains ? Cette préoccupation principale conduit aux interrogations suivantes : quelle est la spécificité de la justice sociale dans la pensée de Platon ? En quel sens, pouvons-nous dire que la justice sociale chez Platon s’oppose à la décadence des États ? Comment, à partir de la théorie platonicienne de la justice sociale, l’émergence et la reconnaissance des États africains sont-elles possibles ?
La présente contribution repose sur les hypothèses suivantes : d’abord, la conception platonicienne de la justice sociale est naturaliste. Ensuite, à travers cette conception de la justice, Platon voulait contribuer au rétablissement de l’ordre et de la stabilité de la cité d’Athènes. Enfin, la théorie platonicienne de la justice sociale, parce qu’elle privilégie le choix des hommes dans l’exécution des tâches en fonction de leurs aptitudes naturelles et de leurs compétences, peut aider les États africains à émerger et à se développer. Au-delà de ces hypothèses, l’hypothèse principale est que l’émergence et la reconnaissance des États africains ne seront possibles qu’à condition d’une gestion rationnelle des ressources humaines, c’est-à-dire qui tient compte des aptitudes naturelles et des compétences des citoyens.
Trois méthodes, c’est-à-dire la méthode analytico-critique, de la méthode comparative et la méthode prospective nous permettrons d’analyser ces hypothèses.
Cette étude veut d’une part, montrer que les États africains ne sont pas encore sortis du sous-développement. En réalité, il faut qu’ils en sortent d’abord, avant de parler d’émergence. D’autre part, elle ambitionne d’indiquer que l’émergence et le développement sont possibles en Afrique, à condition de mettre de l’ordre dans les États en se référant à la théorie naturaliste de la justice sociale chez Platon.
Pour atteindre nos objectifs, nous montrerons d’abord, qu’il existe une justice sociale naturaliste chez Platon, ensuite, nous indiquerons que la théorie platonicienne de la justice sociale constitue la solution au problème de décadence des États, et enfin, il s’agira d’évoquer le fait que la justice sociale telle que la conçoit Platon, peut créer les conditions d’émergence et de reconnaissance des États africains.
1. La justice sociale naturaliste platonicienne et la voie d’émergence et de reconnaissance des États africains
Les plus importantes réflexions contemporaines sur la justice sociale s’inspirent de John Rawls, à travers son œuvre, Théorie de la justice où il conçoit la justice sociale comme redistribution. Pour lui, un État est considéré comme juste lorsqu’il produit et redistribue les ressources, en particulier aux plus défavorisés des citoyens. Il indique que la redistribution concerne les revenus et la richesse, mais aussi les postes publics, les droits et les libertés. À travers elle, chacun dans la société doit pouvoir jouir d’un ensemble de biens premiers requis par son double statut d’homme et de citoyen. Selon C. Audard (2009, p. 505), ces biens premiers sont, pour Rawls, « tout ce qu’un être rationnel désirera quels que soient ses autres désirs ». Nous comprenons donc pourquoi Rawls (2009, p. 30) écrit que « dans une société juste, l’égalité des droits civiques et des libertés pour tous est considérée comme définitive ; les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage politique ni aux calculs des intérêts sociaux ».
Cependant, pour certains penseurs, la justice sociale ne saurait se réduire à la redistribution. Leur position repose sur le fait que les problèmes sociaux actuels se posent au-delà de la redistribution. D’où l’invitation à une reconsidération du concept de justice sociale qui prend désormais en compte les problèmes de reconnaissance (N. Fraser, 2005), de justice environnementale (U. Beck, 2001) et de justice globale (A. Renaut, 2013).
À y voir de près, ces réflexions contemporaines sur la redistribution, la reconnaissance, la justice environnementale et la justice globale portent sur des aspects de la justice sociale et peuvent être comprises comme des réflexions critiques sur des problèmes sociaux. Elles diffèrent donc de la théorie platonicienne de la justice sociale qui est une réflexion sur l’organisation générale de la société et surtout du travail reposant sur le naturalisme.
Affirmer que la conception platonicienne de la justice sociale est naturaliste, c’est signifier que, chez Platon, la justice sociale ou l’organisation de la société doit reposer sur la nature des hommes, c’est-à-dire sur ce qu’ils sont intrinsèquement et qui détermine les tâches ou les fonctions pour lesquelles ils sont faits et les classes sociales auxquelles ils doivent appartenir. Pour comprendre cet aspect psychosocial et politique de la pensée de Platon se rapportant à la justice sociale, il faut d’abord appréhender ce que celui-ci entend par justice.
Dans le penser platonicien, la justice est avant tout une réalité qui, selon le mot de J.-F. Mattéi (2010, p. 85-86), « dans sa forme universelle gouverne le macrocosme et le microcosme », c’est-à-dire la cité (le macrocosme) et l’homme (le microcosme) dans la mesure où comme le montre Platon (2011, II/368c-369b), « la cité est plus grande que l’homme individuel ». Ainsi, la justice apparaît comme une qualité de l’âme humaine et de la cité ou de la société. En tant que qualité de l’âme humaine, elle se donne à voir comme l’excellence de l’harmonie dans les rapports entre les différents éléments de celle-ci. La République indique que l’âme humaine est composée de trois éléments : l’élément rationnel, l’élément irascible et l’élément concupiscible. En effet, en évoquant le caractère tripartite de l’âme humaine, Platon (1996, IV/435d-436c) écrit que « si nous comprenons par l’un, nous nous irritons par l’autre, désirons par un troisième les plaisirs de la nourriture, de la reproduction et tous ceux de la même famille ». Chacune des parties de l’âme est incarnée par une faculté logée dans une partie du corps humain et correspond à une vertu. Ainsi, la partie rationnelle est incarnée par le noûs ou la raison dont le siège est la tête. Sa vertu est la sagesse. La partie irascible est incarnée par le thûmos, c’est-à-dire la colère. Elle a son siège dans le cœur. La vertu qui lui correspond est le courage et la partie concupiscible incarnée par l’epithûmia qui renvoie aux désirs et passions mondains est logée dans le ventre. La tempérance est la vertu qui lui est liée.
Du point de vue de la configuration, c’est-à-dire de l’extériorité de l’âme par rapport au nombre de ses parties, les hommes sont égaux, car ils possèdent tous, une âme tripartite. Cependant, si nous considérons les choses sous l’angle des rapports entre les différentes parties de l’âme dans leur manifestation spécifique, c’est à ce niveau qu’il y a problème. Car, il y a toujours dans chaque âme humaine, un élément qui domine les deux autres. Et c’est ici, que s’origine la différence de caractères et d’aptitudes naturelles entre les hommes conduisant à une spécification des tâches dans la cité, laquelle spécification appelle et détermine des spécialisations. À cet effet, Platon (2011, II/370b-370e) écrit : « Chacun de nous, au point de départ, ne s’est pas développé naturellement de manière tout à fait semblable, mais […] la nature nous a différenciés, chacun s’adonnant à une activité différente ». Platon justifie, ici, la nécessité et l’exclusivité des tâches. Cela signifie que chaque homme naît avec des aptitudes pour exécuter telle ou telle fonction. La spécificité de la tâche de chaque homme est fonction de l’élément prédominant dans chaque âme qui détermine par-là même le caractère propre à chacun. Les caractères des hommes dépendent de la structuration naturelle de leur âme. Or, il peut se faire que d’une âme à une autre, la structuration diffère révélant ainsi, la différence entre les âmes humaines. Cette différence permet de distinguer l’âme injuste de l’âme juste. Pour Platon, une âme injuste est celle dans laquelle, c’est soit l’élément irascible qui prédomine, soit l’élément concupiscible qui prédomine. L’âme est juste lorsque l’élément irascible et l’élément concupiscible sont subordonnés à l’élément rationnel.
La justice dans l’âme l’humaine consiste donc en un ordre naturel de ses parties dans lequel, la partie raisonnable ou délibérative domine la partie irascible et la partie concupiscible. Ce qui revient à dire que l’homme juste chez Platon, selon S. Manon (1993, p. 167-168), « c’est un être tempérant, maître de lui-même, capable d’introduire ordre et mesure dans les appétits du ventre et les élans du cœur, soucieux de réaliser la concorde intérieure en disposant l’élément inférieur à la docilité envers l’élément supérieur ».
Si la justice est une qualité de l’âme humaine, elle l’est également pour la cité au nom de l’analogie, chez Platon, entre ces deux réalités, c’est-à-dire l’homme et la cité. Pour lui, il y a une ressemblance entre l’âme humaine et la cité. En clair, l’une est le reflet de l’autre, et vice versa. À partir de l’âme humaine, nous pouvons donc comprendre la structuration et le fonctionnement de la société et à partir de la société, la structuration et le fonctionnement de l’âme humaine. Platon indique justement ceci :
La justice […] existe pour un homme individuel. Elle existe donc aussi, d’une certaine manière, pour la cité. […] Nous effectuerons d’abord notre recherche sur ce qu’est la justice dans les cités ; ensuite, nous poursuivrons le questionnement de la même manière dans l’individu pris séparément, en examinant dans la forme visible du plus petit sa ressemblance avec le plus grand. (Platon, 2011, II/368c-369b).
Dans un souci de conformité avec l’esprit et les exigences de l’analogie entre la justice dans l’homme et la justice dans la cité, la justice dans la cité ou justice sociale est la conséquence de la justice dans l’homme. Par conséquent, les trois parties de l’âme humaine correspondent respectivement à trois races humaines qui, à leur tour, représentent trois classes sociales qui coïncident avec des fonctions. C’est au travers d’un mythe d’origine hésiodique, par lequel sont ramenées, selon J.-F. Mattéi (2010, p. 94) « les races humaines à leur nature métallique » que Platon propose de se faire mieux comprendre. Ainsi, en s’inspirant du mythe des races humaines d’Hésiode, Platon écrit :
Vous qui faites partie de la cité, vous êtes tous frères […] mais le dieu, en modelant ceux d’entre vous qui sont aptes à gouverner, a mêlé de l’or à leur genèse ; c’est la raison pour laquelle ils sont les plus précieux. Pour ceux qui sont aptes à devenir auxiliaires, il a mêlé de l’argent, et pour ceux qui seront le reste des cultivateurs et des artisans, il a mêlé du fer et du bronze. (Platon, 2011, II/414a-415a).
Ici, se trouvent évoquées trois races humaines non biologiques, mais psychologiques dans la mesure où chez chaque être humain, un métal, selon Platon (2011, 415a-416a), « se trouve mêlé » à son âme avant sa naissance. Ces trois races sont les suivantes : la race d’or, la race d’argent et la race de fer et d’airain. Elles coïncident, d’une part, avec des classes sociales : celle des gouvernants, des gardiens et des producteurs ; et d’autre part, avec les fonctions de gouvernement, de défense et de production. La justice dans la cité platonicienne consiste donc pour chaque membre de la société, relativement à ses dispositions naturelles et à ses compétences, à n’exercer que la seule fonction pour laquelle il est fait. En d’autres termes, pour Platon (1996, V/452d-453d), la cité juste est celle dans laquelle, chacun est amené à « s’occuper de l’unique tâche propre à sa nature ». La justice sociale repose donc sur la notion de fonction et précisément sur celle de trifonctionnalisme, en référence aux trois parties de l’âme humaine. Chaque citoyen qui exerce la fonction qui lui est dévolue en fonction de ses dispositions naturelles, participe par-là même, à la vie de toute la cité.
Ce qui caractérise, en définitive, la cité juste platonicienne, c’est la division du travail ou la répartition rigoureuse – c’est-à-dire selon les aptitudes naturelles et les compétences – des tâches et la complémentarité entre les différentes classes sociales. Cette exigence de division des tâches et d’entre-aide entre les classes sociales pour le bien de la cité toute entière a été mise en évidence par C. Rogue (2005, p. 30-31) quand il écrit que « la Callipolis est ainsi centrée sur la notion de fonction, c’est-à-dire de tâche spécifique assignée à chacun, en fonction de ses talents et aptitudes, en définissant sa place dans la cité. La cité s’organisera selon un modèle organique, où chacun concourra, à son niveau, à la vie de l’ensemble ». C’est le non-respect de cette exigence naturelle qui constitue le désordre, l’injustice sociale et qui précipite les États dans le chaos. En parcourant le registre de l’histoire de la Grèce antique, nous apprenons que parmi toutes les cités qui formaient l’empire grec, c’est pratiquement la cité d’Athènes qui a pu écrire les plus belles pages qui ont fait la grandeur de la civilisation grecque. Cependant, en tant première puissance politique, économique, militaire et culturelle, la cité d’Athènes va perdre ce privilège après la mort de Périclès par la faute de politiciens véreux qui n’étaient pas réellement imprégnés de la de science et de la sagesse politique. Ainsi, Platon est témoin de la décadence de sa cité natale, Athènes, cette cité dont on lui avait révélée le rôle prépondérant qu’elle avait joué pour l’apogée de la Grèce et qui se trouve à son époque plongée dans un chaos indescriptible. La conception platonicienne de la justice sociale ambitionne donc de réintroduire l’ordre dans la cité, car, c’est l’ordre social qui précède la puissance, le rayonnement et la grandeur d’un État.
2. La justice sociale chez Platon comme expression d’une lutte contre le déclin et la tentative du retour à l’apogée d’Athènes et de la Grèce
Des hommes politiques plus ou moins éclairés comme Solon, Clisthène et surtout Périclès avaient contribué, à travers des actions et des lois rigoureuses, à faire de la cité d’Athènes une cité organisée, c’est-à-dire hiérarchisée, stable, heureuse et la plus puissante des cités grecques. Auréolée de ce statut, elle était le symbole du rayonnement de la Grèce antique. En effet, après sa victoire sur les Perses au Vème siècle avant J.-C., la période qui suivit cette victoire fut la plus brillante de toute son histoire. Maîtresse des mers grecques, la cité d’Athènes dirigea la confédération de Délos et brilla, aux temps de Périclès d’un éclat incomparable. Selon A. Cresson (1962, p. 35), « elle (Athènes) devient […] une grande cité maritime qui entretient avec les îles grecques […] un commerce florissant ».
Périclès avait démocratisé la vie politique et sociale, en ouvrant à tous les citoyens, l’accès aux hautes magistratures. Ce dernier avait initié un programme de grands travaux qui avait permis de répartir sur un plus grand nombre de travailleurs, une part des richesses de la cité. Autour de cet homme politique, s’était constitué une équipe d’artistes. Les œuvres dont ceux-ci dotèrent l’art grec valurent à ce temps, le nom de « siècle de Périclès ». Cette période était celle qui vit l’Acropole se couvrir de splendides monuments comme le Parthénon. Les œuvres du célèbre sculpteur Phidias, les tragédies d’Eschyle et de Sophocle et les discours philosophiques de Socrate, donnèrent à Athènes une renommée universelle. Cette cité, ainsi que le montre A. Cresson (1962, p. 35), « devient la cité des arts, des lettres, des sciences, de l’éloquence, de la réflexion philosophique ».
Cependant, contrairement à Athènes, Sparte, sa grande rivale évolua dans une autre direction et devint une organisation militaire puissante et éprise de domination terrestre. Pour indiquer la spécificité de Sparte, A. Cresson (1962, p. 37) révèle que dans cette cité, « les arts, les sciences, les lettres, la philosophie ne comptent pour rien. […]. Les citoyens libres, hommes, femmes et enfants sont astreints à une vie austère et dure. Tout s’oriente vers la formation d’un personnel de guerriers, de gymnastique intense, d’exercices militaires ». Cette éducation rigoureuse à Sparte fut à l’origine de la suprématie de sa constitution et de ses mœurs (K. Popper, 1979, p. 44). Le plus assidu des disciples de Socrate était encore jeune lorsque la cité d’Athènes, poussée par la jalousie, déclara la guerre à Sparte. À cet effet, K. Popper (1979, p. 24) écrit que « pendant la jeunesse de Platon, Athènes avait été engagée dans une lutte à mort contre Sparte, première des Cités-États dans le Péloponnèse ». Cette lutte à mort est ce qu’il est convenu d’appeler la guerre du Péloponnèse. Elle se termina par la défaite d’Athènes qui, assiégée, dut signer une paix humiliante qui la dépouilla de son empire.
La défaite d’Athènes la fit perdre à la fois sa puissance politico-économique et sa stabilité sociopolitique. Désormais affaiblie, la ville natale de l’auteur des Lois, a été envahie par les vendeurs d’illusions, les opportunistes et les politiciens véreux. Sous, pour ainsi dire, leur contrôle, à la manière de maîtres de cérémonie ou de maîtres de chœurs, la cité d’Athènes passe successivement d’une forme de gouvernement à une autre forme donnée, c’est-à-dire de la démocratie à l’oligarchie dirigée par les Quatre-Cents, de l’oligarchie à la tyrannie des Trente Tyrans qui, selon le témoignage d’A. Cresson (1962, p. 43), « avaient fait mourir un grand nombre de citoyens de l’élite. […] contraint d’autres par la terreur à participer à leurs iniquités », et de la tyrannie à la démocratie restaurée à la faveur de la guerre civile qui éclata avec Thrasybule, à la tête du mouvement démocratique. Cette situation d’incertitudes sociales et surtout politiques à Athènes a amené S. Manon (1993, p. 7) à faire la remarque suivante : « À l’intérieur, c’est l’instabilité politique, la cité oscillant entre la démocratie, l’oligarchie et la tyrannie ».
Dans l’ambiance de la restauration de la démocratie, Athènes a confondu liberté et libertinage. Elle ouvrait ainsi, grandement ses portes au mal. A. Cresson décrit en des termes clairs, le chaos moral, social et culturel dans cette cité qui a rayonné dans l’Antiquité et à laquelle, le monde actuel reste toujours redevable :
Elle y contracte […] quelques maladies délétères : un goût forcené de luxe, une indiscipline sociale entière, des mœurs relâchées, une sensibilité presque excessive à l’éloquence et au beau langage, bref tout ce qui mine en-dessous les édifices sociaux les plus brillants. (A. Cresson, 1962, p. 36).
Telle est la cité d’Athènes et tel est le contexte d’injustice dans lequel, Socrate, le philosophe par excellence et maître de Platon a été condamné à mort. En effet, le régime démocratique à Athènes le trouvait gênant, car il considérait ses opinions subversives. Il s’agissait donc de le faire taire. Et la fin justifiant les moyens, Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse, de ne pas croire aux dieux de la cité et de croire en un autre dieu. Au cours d’une parodie de justice orchestrée par un tribunal populaire, il fut reconnu coupable et condamné à boire la cigüe. Il respecta cette prescription tragique de la loi et mourut en se séparant prématurément de son disciple, Platon. Ainsi, la guerre entre les cités grecques, la défaite d’Athènes, l’effondrement de son empire, le désordre sociopolitique et culturel et surtout la mort inattendue de Socrate, constituent autant d’évènements majeurs qui ont profondément affecté Platon. Cependant, celui-ci ne s’est pas donné le droit d’être un spectateur de la décadence de sa cité natale. C’est à travers une conception naturaliste de la justice sociale qu’il pense sauver cette cité.
En tant que fils d’Athènes, Platon a manifesté l’ardent désir, à travers sa conception naturaliste de la justice sociale, de contribuer au rétablissement de l’ordre dans cette cité naguère stable et puissante. Pour se faire mieux comprendre, il imagine une cité juste qui est selon F. Alquié (1981, p. 1668), « à la fois modèle et loi ». La cité caverneuse d’Athènes (J.-J. Mattei, 2010, p. 7) s’en inspirera non seulement pour émerger, mais pour s’imposer à nouveau comme la plus puissante, la plus stable et la plus heureuse des cités grecques.
À travers sa théorie naturaliste de la justice sociale, Platon a critiqué la société athénienne qui avait, pour ainsi dire, perdu ses repères. En le faisant, il visait ceux qui avaient la charge de la gestion de cette cité : les hommes politiques. Pour lui, c’était des gens sans sagesse qui ne méritaient pas d’exercer cette fonction de gouvernement. La sagesse est, en effet, cette qualité indispensable à tout véritable dirigeant. Elle consiste en la mesure et en la délibération qui permettent de faire la part du lot des inconvénients et des avantages d’une situation donnée avant le choix d’une action politique ou sociale. Après la race des véritables politiques comme Solon, Clisthène et Périclès, la cité d’Athènes a été gouvernée par des pseudo-dirigeants. Ce sont eux que Platon critique sans complaisance au point même de les ridiculiser. Ainsi, en s’adressant à ces derniers, il écrit :
Ceux qui n’ont point l’expérience de la sagesse et de la vertu, qui sont toujours dans les festins et les plaisirs semblables, sont portés […] dans la basse région, puis de nouveau dans la moyenne, et errent de la sorte toute leur vie durant ; ils ne montent point plus haut ; jamais ils n’ont vu les hauteurs véritables, jamais ils n’y ont été portés, jamais ils n’ont été réellement remplis de l’être et n’ont point goûté de plaisir solide et pur. À la façon des bêtes, les yeux toujours tournés vers le bas, la tête penchée vers la terre et vers la table, ils paissent à l’engrais et s’accouplent ; et pour avoir la plus grosse portion de ces jouissances, ils ruent, se battent à coups de cornes et de sabots de fer et s’entre-tuent dans la fureur de leur appétit insatiable, parce qu’ils n’ont point rempli de choses réelles la partie réelle et étanche d’eux-mêmes. (Platon, 1996, IX/586a-587a).
Au regard de ce qui précède, de tels hommes politiques dont le programme est la recherche des plaisirs mondains et le maintien au pouvoir, doivent disparaître du champ de la politique. C’est ainsi que la cité d’Athènes pourra se régénérer, car ces derniers, en n’ayant aucune compétence pour gouverner, ont conduit aveuglément cette cité dans les profondeurs abyssales du déclin. Il faut qu’elle en sorte, c’est-à-dire qu’elle émerge. C’est à cette condition qu’il lui sera reconnu, à nouveau, une place de premier rang en Grèce et dans le monde. C’est à la réalisation de ce projet que contribue la théorie naturaliste de la justice sociale chez Platon.
Cette théorie répond donc à une nécessité : faire en sorte que la nouvelle cité athénienne soit gouvernée comme le montre Platon (1996, VII/520c-521c) par « ceux qui sont vraiment riches, non pas d’or, mais de cette richesse dont l’homme a besoin pour être heureux : une vie vertueuse et sage, c’est-à-dire de véritables philosophes et non des mendiants et des affamés de biens particuliers ». C’est à cette condition que pourront être évités le désordre et tous les maux sociaux possibles, en amenant chaque citoyen à exercer la seule fonction pour laquelle, il a des aptitudes naturelles et des compétences révélées depuis la tendre enfance par une droite éducation (Platon, 1996, VII/536a-537a). À cet effet, Platon met en relief la nécessité du gouvernement des philosophes pour bâtir des États stables, justes et heureux :
Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet ; tant que les nombreuses natures qui poursuivent actuellement l’un ou l’autre de ces buts de façon exclusive ne seront pas mises dans l’impossibilité d’agir ainsi, il n’y aura de cesse […] aux maux des cités, ni, […] à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée, autant qu’elle peut l’être, et ne verra la lumière du jour. (Platon, 1996, V/473a-474a).
Cette pensée prospectiviste du fondateur de l’Académie éclaire son choix du naturalisme, c’est-à-dire le recours à la nature ou à l’essence de chaque homme que dévoilent ses aptitudes naturelles et ses compétences. Nous convenons donc avec A. Baudart (1996, p. 21) que la nature est « génératrice de différences ».
Les conséquences positives du recours au naturalisme chez Platon, dans le cadre général de la réorganisation de la cité d’Athènes, sont l’existence de classes sociales complémentaires ou solidaires les unes des autres d’une part, et, d’autre part, la spécialisation et l’efficacité, dans l’exercice des fonctions, indispensables pour l’émergence et le développement des États. Cela peut s’expliquer par le fait que la justice sociale naturaliste, aux yeux de Platon, permet d’insérer, en fonction de ses qualités naturelles et de ses compétences, chaque individu dans le tissu social. Elle n’exclut donc personne dans, la mesure où tous les hommes, toutes les races – psychologiques – et toutes les classes sociales, en fonction de leurs différences respectives, participent différemment certes, mais collectivement, à l’émergence, au développement et au bonheur de toute la société.
Dans l’esprit de Platon, les sociétés humaines sont responsables de leur déclin par leur manque de rigueur dans la gestion de leurs ressources humaines. Elles ont, d’une manière ou d’une autre, entretenu des maux comme la corruption, le favoritisme et le népotisme. En le faisant, elles ont contribué à la destruction de leur propre ordre sociopolitique et se sont s’installées dans le chaos. Cependant, ces sociétés ont en elles-mêmes les moyens de leur liberté, de leur puissance, c’est-à-dire de leur grandeur, etc.
Il s’agit d’organiser rationnellement les sociétés humaines en tenant compte des aptitudes et des compétences des citoyens. L’objectif à atteindre, c’est l’efficacité dans le travail qui conduit au développement, à la stabilité et au bonheur. Or, cela ne peut être possible dans le désordre, mais plutôt dans l’ordre qui requiert la spécialisation en fonction du caractère des citoyens. Ces idées platoniciennes sur la justice sociale qui s’appuient sur le naturalisme peuvent, avantageusement, s’appliquer à l’Afrique malade de son évolution.
3. Le défi d’émergence et de reconnaissance des États africains et la justice sociale chez Platon : la nécessité d’une référence aux aptitudes naturelles et aux compétences des citoyens
L’état actuel de l’Afrique, c’est qu’elle est presque encore entièrement, après plusieurs décennies d’indépendance, pratiquement immobilisée dans les rets du sous-développement. En effet, les peuples évoluent selon une dynamique spirituelle et intellectuelle historico-dialectique qui se révèle à travers des états successifs et nécessaires de la conscience : il s’agit de l’enveloppement, du sous-développement, de l’émergence et du développement. Ces états coïncident avec des formes d’existence humaine.
Ainsi, si l’état d’enveloppement traduit l’idée de l’enfance, c’est-à-dire de la primitivité de l’existence des peuples à un certain moment de leur histoire, le sous-développement désigne l’état de progrès relatif en comparaison avec l’enveloppement. Le sous-développement est un état de grande dépendance qui rime avec problèmes sociaux, économiques, politiques, éducatifs, éthiques, moraux, technologiques et scientifiques. Quant à l’émergence, elle renvoie aux efforts déployés dans les domaines évoqués précédemment en vue d’atteindre le développement. Ce dernier état traduit le plein épanouissement de ces peuples. C’est l’appropriation de soi, la maîtrise des contingences de l’histoire et du destin des peuples qui ont désiré vaincre l’adversité et refuser de vivoter. Le développement, c’est le progrès réel dans tous les domaines pour rendre un peuple ou une société heureuse.
L’Afrique, continent sous-développé, aspire légitimement aujourd’hui, à l’émergence. Dans les milieux politiques et économiques, l’émergence est devenue un concept en vogue. Si donc les dirigeants en parlent, logiquement, cela devrait signifier qu’ils veulent bien tourner les pages humiliantes du sous-développement. Cependant, ces derniers sont-ils sérieux et lucides quand ils évoquent en chœur ce concept d’émergence ? Est-il juste de parler d’émergence quand les gouvernants africains sont incapables d’impulser des dynamiques allant dans le sens, selon K. W. Kamada (1976, p. 14) « de libérer l’Afrique de toutes les servitudes de la dépendance politique, économique et culturelle, bref de l’aliénation ; du sous-développement, de la faim, de la sous-alimentation, de l’analphabétisation, des maladies, de la misère et de la pauvreté » ?
Comme nous pouvons le constater, de nombreux défis restent à relever, des obstacles restent à surmonter avant de parler de manière responsable, sereine et véridique d’émergence en Afrique en général. En réalité, il ne pouvait en être autrement. Car, en Afrique, le discours sur l’émergence est enfermé dans le carcan économique occultant ainsi, ses dimensions morale, éducative, sociale, politique, culturelle, scientifique et technologique ; ce qui conduit à une confusion entre ce concept à la mode et le développement. En Afrique, c’est la croissance économique – du reste douteuse à cause de la possibilité de manipulation des taux – qui est abusivement appelée émergence. Il est donc clair que cette émergence à l’africaine ne saurait être l’émergence réelle des États et conduire au développement. C’est pourquoi, T. Pujolle (1994, p. 116) peut écrire : « Le développement n’est pas la croissance économique ; c’est l’invention d’un ordre politique légitime et équitable sans lequel la croissance n’est qu’aggravation des inégalités ».
Au-delà des discours politiques et démagogiques, la plupart des États africains sont donc loin d’être émergents. L’émergence ne se décrète pas, sinon elle est douteuse comme c’est le cas en Afrique. Un État émergent doit pouvoir s’imposer de lui-même et être reconnu comme tel par les autres. Les États africains sont condamnés à émerger réellement et à se développer, s’ils veulent cesser d’être méprisés et marginalisés. Mais cela ne sera jamais possible tant que ces États ne sortiront pas effectivement du sous-développement qui, pour K. E. Barouan (2005, p. 38), « traduit la restriction, la régression, le déclin, la réduction des moyens et des aspirations des populations ». Il faut une refonte, une réforme des mentalités des Africains. Comme le souligne K. E. Barouan (2005, p. 30), « la mentalité renvoie à la motivation, à la raison, à l’inspiration, à la conscience, à l’éducation, en un mot à la culture qui pousse, mobilise, engage […] la collectivité sollicitée ». C’est à ce niveau que tout se joue, c’est-à-dire les conditions et la capacité à émerger et à se développer ou demeurer dans le sous-développement en subissant et en souffrant de l’indifférence, du mépris, de la domination, des moqueries et de l’hypocrisie des autres.
Le problème de l’émergence et du développement des États africains ne se pose pas essentiellement en termes de manque de capitaux ou en termes de problème économique. Ce dernier constitue un épiphénomène. Le véritable problème auquel l’Afrique est confrontée est celui de la mauvaise utilisation des compétences, c’est-à-dire de la justesse dans les choix des hommes dans l’exécution des tâches aussi bien publiques que privées. Or, l’émergence implique une gestion rationnelle des ressources humaines. Ce qui caractérise l’Afrique, c’est qu’au nom de « l’africanité », l’on ne met presque jamais les hommes qu’il faut aux places qu’il faut. L’organisation sociale, dans l’Afrique moderne et contemporaine, repose plus sur des fondements occultes, c’est-à-dire autres que des fondements objectifs. Les aptitudes naturelles et les compétences des citoyens devraient être les seuls critères objectifs dans le choix des fonctions ou des tâches à exécuter.
Des liens de parenté, d’amitié, de fraternité et de parrainage aux contours opaques et obscurs sont, entre autres, les facteurs endogènes et exogènes qui conduisent au népotisme, au favoritisme et à la corruption dont l’interaction crée le désordre. La pauvreté, la mauvaise gouvernance, la cherté de la vie, les mouvements de contestations, les guerres civiles, la dictature, l’endettement et le surendettement, le problème du manque d’expertise et de main-d’œuvre de qualité, l’incivisme, le manque d’infrastructures, le chômage, etc. sont autant de réalités qui constituent les conséquences du désordre ou de l’injustice sociale en Afrique. Pour nous inspirer d’A. Baudart (1996, p. 29), nous dirons qu’en Afrique, « chacun fait ce qu’il veut, où il veut, avec qui il veut, sans référence […] à la norme d’équilibre et de mesure ». Ce constat de Baudart nous permet de prendre conscience qu’il y a un désordre structurel en Afrique qui profite à un groupuscule constitué d’Africains et de non Africains.
Aussi longtemps qu’il n’y aura pas de véritable prise de conscience pour mettre fin au désordre, les États africains baigneront dans le sous-développement. Or, ils n’ont pas le droit de rester éternellement sous-développés. Les Africains, sont comme les autres peuples, faits dans le même moule et appelés à évoluer par le sérieux dans le travail physique et intellectuel. Seulement, ce travail, il faut l’organiser pour qu’il serve aux États. Sans quoi, il sera vain. Dans la perspective platonicienne, organiser le travail signifie, que pour chaque tâche, il faut choisir ceux qui sont aptes par nature et qui, par l’action de l’éducation ont des compétences requises. La justice sociale platonicienne s’oppose donc au cumul des fonctions et aboutit à la spécialisation. C’est pourquoi Platon affirme :
Dans notre cité seulement on trouvera le cordonnier, cordonnier, et non pas pilote en même temps que cordonnier, le laboureur, laboureur, non pas juge en même temps que laboureur, le guerrier, guerrier et non pas commerçant en même temps que guerrier. (Platon, 1996, III/397b-398b).
Une telle rigueur ne peut qu’aboutir à la spécialisation qui est synonyme d’efficacité dans le travail. Il s’agira donc d’éviter d’avoir recours à la corruption, au népotisme ou au favoritisme pour accéder vaille que vaille à une fonction pour laquelle nous n’avons vraiment pas de compétences. Nous ne sommes pas obligés de passer pour ce que nous ne sommes pas ou de faire ce que nous ne pouvons, en réalité, faire avec le maximum de perfection. Dans un souci d’efficacité et d’harmonie sociale, nous devons être capables de respecter l’ordre naturel des choses en ne nous intéressant qu’à la seule fonction ou à la seule tâche pour laquelle nous avons des talents. Un État qui veut émerger et se développer doit respecter, se référer et imiter l’ordre naturel des choses, de sorte que l’ordre politique, social, moral, économique et culturel soit le reflet de cet ordre naturel. En Afrique particulièrement, cette exigence n’est pas respectée. Cela peut s’expliquer par le fait que des individus peuvent, au gré de leurs plaisirs ou de leurs ambitions, par le moyen de leurs richesses, de leurs relations personnelles accèdent à des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Ces derniers créent le désordre et contribuent à maintenir l’Afrique dans les fers du sous-développement. Ce comportement dénué de tout dévouement à l’intérêt général et contraire, voire hostile à toute dynamique d’émergence, de développement et de reconnaissance n’a pas échappé à Platon qui écrit :
Quand un homme que la nature destine à être un artisan ou à occuper quelque autre emploi lucratif, exalté par sa richesse, le grand nombre de ses relations, sa force ou un autre avantage semblable, tente de s’élever au rang de guerrier, ou un guerrier au rang de chef et de gardien dont il est indigne ; quand ce sont ceux-là qui font échange de leurs instruments et de leurs privilèges respectifs, ou quand un même homme essaie de remplir toutes ces fonctions à la fois, alors […] ce changement et cette confusion entraînent la ruine de la cité (Platon, 1996, IV/433d-434c).
Ce qui caractérise de tels hommes, c’est l’indignité. Celle-ci témoigne de leur manque de vertu. Sans la vertu, c’est donc le désordre car, c’est elle qui doit nous maintenir à la place qui nous échoit naturellement. Et ici, l’éducation joue un rôle éminemment important dans la mesure où, c’est elle qui forme à la vertu. S. Diakité (2016, p. 10) l’a si bien perçu à la suite de Platon lorsqu’il indique que « tout État devait inculquer à ses citoyens la vertu ». Nous pouvons ainsi, établir un lien entre la justice sociale, l’éducation à la vertu, l’émergence et la reconnaissance des États africains.
Conclusion
L’Afrique apparaît comme une puissance qui s’est toujours ignorée. Si aujourd’hui, elle aspire à l’émergence, cela signifie qu’elle a pris la pleine mesure de son retard, de ce qu’elle est, mais aussi de ce qu’elle a et de ce qu’elle peut faire pour sortir de cet état avilissant que constitue le sous-développement. Le désir d’émergence des États africains est donc légitime.
Cependant, il ne suffit pas de vouloir émerger. Il faut d’abord travailler à sortir effectivement du sous-développement en mettant fin au désordre sociopolitique auquel la plupart des États en Afrique sont confrontés. La théorie naturaliste platonicienne de la justice sociale, élaborée contre la décadence des États, est une pensée salvatrice, une philosophie de l’ordre qui s’offre et s’ouvre à l’Afrique qui est, dans tous les cas, condamnée à émerger et à se développer, si elle ne veut pas continuer à se voir bafouer et mépriser. Cela signifie que la reconnaissance ne se quémande pas en se lamentant ou en pleurnichant, mais elle se mérite par le travail, la discipline, la justice, le dévouement à l’intérêt général, etc. Elle doit être perçue comme une sorte de couronne, c’est-à-dire une récompense.
Pour que la théorie naturaliste de la justice sociale soit opérante en Afrique, il faut que les Africains soient éduqués à changer de mentalité. Concrètement, cela signifie qu’il faut les amener à se détourner des pesanteurs comme la corruption, le favoritisme, le népotisme en faisant en sorte qu’ils reconnaissent et acceptent leurs limites et leurs talents. C’est à partir de là, que l’intégration des uns et des autres dans le monde du travail dans les États africains se fera de manière rigoureuse et rationnelle. Cette rigueur et cette rationalité garantiront l’ordre social ou la justice sociale qui constitue en dernière analyse, la condition sine qua non de la stabilité, de la paix, de l’émergence, du développement et de la reconnaissance des États africains.
Références bibliographiques
ALQUIÉ Ferdinand, 1981, Emmanuel Kant : des premiers écrits à la critique de la raison pure, Paris, Gallimard.
AUDARD Catherine, 2009, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société, Paris, Gallimard.
BAUDART Anne, 1996, La philosophie politique, Paris, Flammarion.
BAROUAN Kipré Edme, 2005, L’Afrique peut-elle s’en sortir ? Attitudes mentales et développement, Abidjan, EDUCI.
CRESSON André, 1962, Socrate, Paris, PUF.
DIAKITÉ Samba, 2016, Révolutions et Développement : pour une philosophie de l’émergence en Afrique, Québec, Différance Pérenne.
KAMADA Wa Kamada, 1976, Le défi africain : une puissance économique qui s’ignore, Paris, Afrique Biblio Club.
MANON Simone, 1993, Pour connaître Platon, Paris, Bordas.
MATTEI Jean-François, 2010, Platon, Paris, PUF.
PLATON, 1996, La République, traduit par Robert Baccou, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, La République, Œuvres complètes, traduction et sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion.
POPPER Karl, 1979, La société ouverte et ses ennemis : l’ascendant de Platon, traduit par jacqueline Bernard et Philippe Monod, Paris, Seuil.
PUJOLLE Thérèse, 1994, L’Afrique noire, Paris, Flammarion.
RAWLS John, 2009, Théorie de la justice, traduit par Catherine Audard, Paris, Éditions Points.
ROGUE Christophe, 2005, D’une cité l’autre : essai sur la politique platonicienne, de la République aux lois, Paris, Armand Colin.
RÉFLEXION SECONDE ET DÉFI D’ÉMERGENCE DE L’AFRIQUE
Moulo Elysée KOUASSI
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
landrewkoua@yahoo.com
Résumé :
L’émergence est à la fois la promesse d’une Afrique future pleine d’espérance et un temps de changement historique. Mais un regard étriqué sur les promesses successives que l’Afrique s’était données présente un véritable contraste entre la généreuse proclamation populiste de l’émergence, idéal louable, et les paradoxes que nous offre le fonctionnel informel de nos États restés jusqu’ici nécessiteux, un demi-siècle d’indépendance après. Au risque de verser dans une simplification, l’on devrait reconnaître assez clairement l’exigence de la réflexion seconde pour opérer la nécessaire réforme intellectuelle et morale. Celle-ci demeure l’une des grandes exigences, si tel est que le projet-émergence est la meilleure des croyances, capable de permettre à l’Afrique de progresser le plus sûrement sur la voie du bonheur. Le couronnement doit être une gouvernementalité qui conçoit nos sociétés autrement que sous la forme de collectivités organisées et hiérarchisées qui servent les efforts de la majorité au progrès.
Mots-clés : Développement, Émergence, Fonctionnement informel, Ontologie, Pro-jection, Reconnaissance, Réflexion seconde, Romantisme politique.
Abstract :
Emergence is at once the promise of a future Africa full of hope and a time of historical change. But a narrow look at the successive promises that Africa has made presents a real contrast between the generous populist proclamation of emergence, a laudable ideal, and the paradoxes offered by the informal function of our so far needy states. , half a century of independence after. At the risk of being simplistic, the requirement of second thought should be fairly clearly recognized in order to affect the necessary intellectual and moral reform. This remains one of the great demands, if it is that the project-emergence is the best of beliefs, capable of allowing Africa to progress most surely on the road to happiness. The coronation must be a governmentality that conceives our societies differently than in the form of organized and hierarchical communities that serve the majority’s efforts to progress.
Keywords: Development, Emergence, Informal functioning, Ontology, Projection, Recognition, Second thought, Political romance.
Introduction
L’« utopie » a toujours été, au sens spirituel du terme, le grand principe du progrès et du développement humain. Elle est censée porter au zénith l’aspiration légitime et permanente de l’être humain à un plein accomplissement. Ainsi, de Platon à notre époque, la cité idéale ou, pour reprendre Alain BADIOU (2014, p. 14.), « la politique vraie », habite l’esprit humain. Dans cette logique, en emboitant les pas aux sociétés occidentales avancées sur la route du progrès technologique et industriel, nonobstant, selon Germain GAZOA (2006, p. 52.), l’ « immaturité politique », les États africains fondent beaucoup d’espoir dans l’idée d’un renouveau, voire l’émergence. Pour les dirigeants du continent, le projet-émergence, tel un projet-espérance, témoignera d’une reconnaissance de l’Afriquedans le concert des nations ; puisque le continent est à la croisée des chemins, assaillie par la nécessité d’émerger, de créer des changements positifs. Le projet-émergence, quel que peu douteux, est devenu aujourd’hui un rêve pieux, une soif, un terme assez courant dans les débats sur l’Afrique.
Mais notre époque, époque de densité obscure et apeurée, nous confronte à la réalité d’une Afrique contrastée qui appelle à réflexion, et qui nécessite une sérieuse méditation sur la destinée de l’homme africain dans son habitacle. Ainsi, quoique l’utopie tienne dans la conscience des élites intellectuelles et des dirigeants politiques :
Le rêve éveillé : images d’avenir, désirs, souhaits, visions d’évasion et d’anticipation, autant de forme du rêve qui occupe sans cesse notre conscience, comme une force vague et imprécise qui nous pousse en avant, comme une soif qui toujours nous habite sans jamais se nommer, un « au-delà » qui agit en nous et nous met en mouvement. (Pierre MASSET, 1997, p. 1.),
ce projet semble douteux, car entre le rêve et la réalité, il existe un écart, un fossé indéniable.
De la sorte, si pour les décideurs et leurs partenaires économiques, l’Afrique est dans la bonne espérance eu égard à une certaine croissance économique galopante, aux réformes structurelles amorcées à divers niveaux, à l’organisation d’élections « dites » libres et transparentes, à une certaine amélioration des conditions d’existence matérielles des populations, voire une justice sociale ; une phénoménologie critique du développement montre que les conditions d’existences matérielles des populations et leurs attentes révèlent un véritable contraste. La crise de la confiance engendrée par des politiques inhumaines, les crises interminables, l’absence criarde de justice sociale et équitable, le manque de sollicitude à l’égard des populations, etc., constitueraient des objections possibles. Subséquemment, les insuccès (constatés) des politiques africaines et l’absence criarde d’une éthique des politiques, posent la nécessité du questionnement radical de l’être africain et des fins de l’émergence.
Dès lors, le questionnement des fondements et du dynamisme du projet-émergence africaine, cette projection vers le mouvement spirituel du progrès, pose la nécessité d’une réflexion seconde, et ce, afin de penser l’exigence du réalisme politique. Cette réflexion exige, notamment le nécessaire examen des fondements et le dynamisme, les racines historiques et culturelles de la vision progressiste de l’émergence, devenue aujourd’hui un refrain. L’enjeu de l’analyse consiste en une remise en cause du fonctionnement informel des États africains, afin de réaliser une émergence bâtie sur des fondements et des assises solides et non des buildings sur fondement de sable.
Le présupposé fondamental de notre analyse réside en ceci : tant que la réflexion seconde ne sera pas le dénominateur du projet-émergence, que l’histoire et l’espoir se rencontrent, que cette espérance soit susurrée, l’on risquerait de sombrer dans une utopie ou un mirage partagé. N’est-ce pas que le spectacle désolant d’un continent incapable d’exploiter à fond ses énormes trésors matériels et humains pourrait faire de cette projection un arc – en – ciel dans la nuit, voire une reconnaissance terne et inessentielle ? Nier les dérélictions dans les politiques africaines qui nécessitent un redressement moral, n’est-ce pas une déresponsabilité éthique ? La question fondamentale demeure : De quoi et avec quoi émerger ? Les justifications rationnelles de cette aspiration doivent être recherchées et, dans le prolongement, favoriser une transfiguration de l’habitacle de l’être africain, pour une réhabilitation véritable de l’Afrique. Cette réflexion seconde[39], selon Gabriel MARCEL(1951, p. 131.), en tant que « refaçonnement intérieur »se veut être une analyse critique des concepts d’ « Émergence » et « Reconnaissance », sinon l’être du développement africain, l’enjeu fondamental étant de poser des prolégomènes pour un sursaut véritable. Car si tel est que le véritable agent du progrès a toujours la pleine mesure de ses actions et ses projets, il paraît douteux de croire en l’émergence quand la phénoménologie des rapports entre les États laisse croire que ce changement souhaitable escamote certaines réalités concrètes, dans la mesure où, dans cette ruée vers l’émergence, certains États pourraient sacrifier à une fade reconnaissance extérieure au détriment du bien-être véritable de leurs populations.
Ce passage à l’émergence exprime, non seulement, la volonté des États africains de sortir de la médiocrité, mais requiert aussi et surtout un projet lucide. Car les enjeux du projet-émergence doivent être orientés vers l’éthique des politiques, c’est-à-dire une consécration des dirigeants à faire des projets modèles empreintes de sollicitude à l’égard des populations, d’honnêteté exemplaire dans la production et la redistribution des richesses ; le développement humain ; la sécurité nationale et économique ; l’éducation pour une transformation des mentalités en vue de la transfiguration totale de l’habiter.
1. L’exigence de la réflexion seconde et de l’historicité : vers la quête du fondement du Projet-Émergence
La réflexion sur l’émergence africaine requiert une phénoménologie critique et profonde, ou du moins une ontologie existentielle. Cette approche préliminaire mais essentielle, doit pouvoir faire la membrure de toute l’analyse du projet-émergence des Africains. Elle est primordiale dans la re-constitution et la ré-construction de l’histoire africaine. Saisir le développement africain dans son effectivité, c’est souscrire avant tout à l’exigence de saisir son indéterminé ou sa détermination même. En suivant une logique hégélienne, nous dirions que la problématique actualiste de l’émergence ne doit pas être un ex-nihilo. Bien au contraire, elle doit avoir traversé les trois extases ontologiques[40], ou du moins s’inscrire dans le tryptique Passé-Présent-Futur, ou encore, elle doit tirer sa source d’un antécédent logique qui en déterminerait son sens, son essence et sa signification. En traversant le devenir pour de suite atteindre sa détermination consciente, l’effectivité de l’émergence africaine doit procéder d’une marche consciente d’elle-même, à travers les trois extases du temps. Cette exigence est ce que nous nommons les fondements et les racines historico-culturelles. Mais que peut bien signifier cette manière d’approcher la problématique de l’émergence ? En quoi résiderait l’essentiel d’une approche historico-culturelle ?
À partir de la dialectique hégélienne, nous constatons que le fruit a toujours un passé logique qui détermine aussi bien son processus de maturation que sa maturité même. L’exemple de la graine, qui donne le bourgeon, ensuite la fleur et la tige et enfin, les fruits, montre pertinemment que le progrès, ou le développement historique se fait de pas en pas, et conserve un enracinement historique. Ainsi, pouvons-nous, dans le cadre de cette méditation de la problématique d’émergence et reconnaissance, convoquer l’ontogenèse ou l’approche historico-culturelle. Cette approche ne consiste pas en une sociologie ou une histoire du goût et du caprice ; elle suppose, pour faire sens, que l’on soit dans une ré-flexion. Ce retour sur soi, cette ré-appropriation de son passé est un appel à l’évaluation du processus historique, comme actuation et action humaines : c’est l’exigence de la metanoia, ou un regard nouveau. Si tel est que l’homme produit l’histoire, comme ensemble des œuvres spirituelles et matérielles, il n’est pas inessentiel de souscrire à un criticisme de cette marche, même si cette histoire n’est une fixation radicale. C’est ici que la mémoire joue un rôle essentiel puisqu’elle permet le recueillement profond, et ce, pour opérer le nirvana ou la metanoia.
Le passé de l’Afrique est et doit être le premier substrat de sa pro-jection ; l’ignorance absolue de cette exigence peut soumettre les africains à un projet-émergence sans un réel fondement historique et culturel. Il ne s’agit pas tant de ressusciter un passé douloureux, un passé qui viendrait faire obstacle à tout dynamisme ; cependant, c’est aussi (et surtout) une révocation au doute de toute une marche dans les sentiers battus de la Liberté. Dès lors, le passé devient ce par quoi nous nous referons, ce sur quoi nous nous appuyons pour toute projection. Les racines historiques et culturelles sont le fondement. À ce titre, elles exigent la prise en compte du patrimoine matériel et immatériel[41] dans le projet-émergence. Cetteexigence de la mémoire historique est un facteur essentiel dans le recueillement ou la réflexion au second degré, puisque la co-naissance de soi, c’est-à-dire l’éveil spirituel de notre être intérieur, exige la prise de conscience de l’historicité de notre être pour assumer pleinement notre existence.
Le patrimoine matériel et immatériel des sociétés constituent les éléments de leur intégration cosmique, leur repère existentiel, leur mémoire culturelle et spirituelle, ou leur richesse historique. Aucune société, dans sa philosophie existentielle, n’a cessé de se référer à une mémoire matérielle et immatérielle, afin de ménager au mieux son avenir, voire son devenir[42]. Le devenir culturel et historique des peuples porte toujours une estampille particulière, celle-ci émanant de son passé ontologico-historique. L’essence réelle et vraie de toute société allie cette identité qui oriente ses décisions, ses actions, et détermine même l’orientation générale de la vie humaine. Le patrimoine culturel vient combler l’incomplétude ontologique et amener les individus à un « plus-être » ou un « mieux-être ». À bien considérer les choses, aux dires de Philippe CAPPELLE (2005, p. 7.), la société occidentale vit toujours sa conscience historique :
La pensée occidentale vit un double héritage par la tradition philosophique et les théologies issues de la foi en un Dieu révélé. Le plus souvent oublié, voire dissimulé, le rapport entre ces deux traditions se trouve désormais engagé dans la reconnaissance et la communication de rationalités irréductibles.
Tout individu, soucieux de son intégration socioculturelle et ontologico-historique, doit répondre de cet appel où les ancêtres, dont les idées fondent les traditions et les coutumes, communiquent la transcendalité capable de dire la substantialité de leur être et orientent la destinée. Ce substrat ontologico-culturel, inhibé de fritures matérielles et immatérielles, guide et détermine le sens philosophique de l’existence. Disons simplement que, les données ontologiques, les valeurs africaines, voire les tragédies culturelles sont à prendre en compte. Mieux, elles constituent les premiers maillons. Cela exige notamment, une rappropriation du substrat ancestral sans tomber dans un repli identitaire. Cette rappropriation du patrimoine matériel et immatériel est fortement exprimée par la figure du masque “Wamblê” en pays senoufo, en Côte d’Ivoire. Ce masque, dont la symbolique nous invite à regarder dans le patrimoine passé, et à avoir en même temps les regards rivés sur le présent, voire le futur, dévoile aux africains la nécessité d’une metanoia permettant la dé-construction de notre essence pour la reconstituer. Cela montre que la reconstitution et la reconstruction de notre être historique requiert un temps de réflexion sur nous-mêmes, une réflexion à la seconde puissance (Gabriel Marcel).
Mais ce besoin doit s’appuyer sur la situation spirituelle et historico-culturelle de notre temps. Car le rapport entre l’homme et le monde s’établit avec la conscience sous le signe du temps, surtout que cette conscience inscrite dans la temporalité est appelée à une subsomption. L’identité ou le patrimoine culturel doit traverser le temps d’une histoire toujours marquée par des souvenirs, mais aussi (et surtout) par le besoin de nivellement actué et nécessaire – référence faite à Matière et Mémoire de Bergson. Vivre son temps, c’est vivre son histoire. Cette nécessité qu’a l’homme de laisser des traces à chaque passage dans son existence, est le fruit de l’exercice d’une pensée profonde sur la question fondamentale : avoir et être, questions essentielles pour l’homme. Ainsi avoir une histoire, c’est vivre pleinement son temps, c’est donc penser / panser les problèmes de son temps en jetant un regard critique sur ceux-ci. Penser les réalités de son temps, c’est sans doute contribuer d’une certaine manière à la réalisation de l’histoire de son époque et, par là même, la perpétuer.
Le rapport entre toute culture et son temps est toujours orienté sur un problème de temps. Le problème qui survient à une époque conduit toujours le philosophe à s’y intéresser et à proposer des tentatives de solutions en vue de solutionner ce problème. Et, c’est le devoir du philosophe, traduisant ainsi une exigence de dépassement de soi pour apporter la nouvelle « évangile » aux peuples. Le philosophe, à partir de ce là seul, n’est pas loin de se confondre à un messie. Il a une mission fondamentale à accomplir. Comme l’affirme N’joh – MOUELLÈ (1970, p. 14.) :
Le rôle du philosophe est de veiller constamment pour pouvoir révéler aux autres le sens du présent et la direction du futur. Le philosophe est celui qui ne dort jamais. Sa voie, constamment doit trouer, percer le silence mortel des nuits de la servitude et de l’aliénation sous toutes ces formes (…) Le philosophe est comme l’oracle d’une société.
Cette projection doit questionner en direction du sens, de la valeur et de la signification du patrimoine culturel et du sens de la reconstruction de l’histoire africaine. Elle doit, par ailleurs, méditer l’épineuse problématique de l’Avoir et l’Être, en vue d’indiquer des possibilités nouvelles à la réalisation de l’Afrique. Car, il faut appréhender, selon Christophe YAHOT (1999, p. 71.), « la Culture comme force », comme acte-créateur de sens et de développement, même. Toutefois notre dessein ici n’est point de réchauffer le débat sur « l’identité culturelle » dont nous savons très bien que les arguments ne peuvent servir qu’à alimenter la mauvaise foi, celle qui fait, n’exprime qu’une morale close, une involution ou conduit à une vie inchoative. Mieux, il s’agit d’analyser des éléments patrimoniaux qui constituent l’âme des peuples et qui sont en principe une vitrine d’une communauté dans son être, son savoir-faire, son savoir-être, afin de réaliser un nivellement axiologique et un changement de mentalité. Plus précisément, il s’agit de poser la question relative au degré d’implication de la Culture, de l’Histoire africaine dans le projet-émergence, c’est-à-dire procéder à une analyse critique de notre conscience historique, de sa fonction et de sa finalité dans cette aspiration légitime à l’émergence.
C’est ici que le recueillement en jeu dans la réflexion au second degré trouve son sens. Cette exigence est fondamentale en ce sens qu’elle permet de procéder à un examen de notre parcours historique, de nos projets d’hier, de nos victoires et de nos échecs. La perception que nous aurons de notre historicité à travers nos lunettes culturelles pourra éveiller les consciences individuelles et collectives africaines à « la perception de la différence », selon les mots de Yahot (1999, p. 72.). Il ne s’agira pas d’hypostasier, de fétichiser le passé, ce qui importe plus, c’est l’interrogation de l’historicité africaine, et ce, afin de bien fonder notre projet-émergence. Car, si le sens des choses relève d’une construction rationnelle, d’un effort constant de l’esprit à une intuition véritable des exigences et des fins de toute action, il revient aux africains de donner un sens et un contenu significatif à cette projection. Comme le témoigne encore si bien YAHOT (1999, p. 74.) :
Par cette capacité à donner un sens aux choses l’homme en arrive à établir, peut-être à moindre coût, une différence de degré et pourquoi pas de nature entre l’homme et la bête, l’homme et toutes les autres choses de la nature(…) et, souvent même une différence entre lui et son semblable, faisant ainsi de tous ces êtres des êtres au second degré, des ingrédients ou presque.
De la sorte, l’émergence doit être articulée sur les valeurs et les cultures locales, c’est-à-dire prendre aussi en compte les réalités existentielles de nos sociétés particulières. Il nous faut reconnaître assez que fonder l’émergence avec notre historicité, c’est-à-dire avec notre conscience historique, n’est pas une piètre action. Elle demeure soutenable, bien sûr, si nous convenons, avec Lévi-Strauss – Races et Cultures -, que les cultures locales ont beaucoup à apporter à l’édification de l’humanité. L’émergence est une fin, c’est-à dire une représentation qui détermine la volonté ; et tant que cette volonté sera celle de quelque chose d’extérieur à la propre volonté des africains, ou bien si elle est poussée dans le dos par une volonté extérieure, elle butera ; elle échouera lamentablement. Or il est manifeste que c’est un réalisme politique africain ; ainsi il importe que sa représentation et sa réalisation n’excluent pas les données historico-culturelles voire même l’historicité de notre existence. C’est une exigence fondamentale. Notre capacité à cet éveil et notre décision à prendre notre historicité comme levier de ce projet établiront la différence, démonteront si nous sommes des agents ou des êtres au second degré, c’est-à-dire des producteurs et des agents du développement ou non.
Nous rattachons une grande signification à l’historicité car, suivant MERLEAU-PONTY (1945, p. 105.), « l’histoire n’est ni une nouveauté perpétuelle, ni une répétition perpétuelle, mais le mouvement unique qui crée des formes stables et les brise ». C’est donc un refaçonnement de notre histoire qui apparaît à la lumière de cette remarque. Plus précisément, comme le fait remarquer Marcien TOWA (1970, p. 39), « la volonté d’être nous-mêmes ; d’assumer notre destin, nous accule finalement à la nécessité de nous transformer en profondeur, de nier notre être intime pour devenir autre ». Ce devenir-autre doit s’appuyer sur nos réalités africaines, notre historicité et non pas avec les lunettes culturelles des autres. Il nous faut avoir nos propres repères, c’est cette condition qui permettra de réévaluer à chaque étape notre niveau de développement.
La néantisation de notre existence doit être appréhendée comme une conversion de nos mentalités, c’est-à-dire un refaçonnement de notre histoire non seulement à partir de notre historicité, mais aussi et surtout à partir de valeurs et de repères propres à l’Afrique. Planifier notre émergence à partir des réalités extérieures n’est certes pas une mauvaise chose, mais faire fi de notre propre réalité historique est la pire des choses à éviter. Puisque le phœnix renaît toujours de ses propres cendres, c’est-à-dire avec une essence, un substrat, la renaissance africaine doit être la grande affaire de notre effort rationnelle à cette nécessité.
Le défi de l’émergence doit s’organiser à partir de cette exigence de la conscience historique. Un examen étriqué, lucide de notre développement constitue avec la réflexion seconde des prolégomènes pour toute Afrique qui voudra sortir de la médiocrité pour aller à l’excellence. Ici les analyses de N’joh- Mouellè, dans De la médiocrité à l’excellence, livrent de grands secrets pour penser véritablement la problématique de l’émergence. Il importe de revenir à l’histoire pour éprouver, examiner les normes autour desquelles s’organise le défi de l’émergence. La réflexion au second degré doit faire émerger de nouveaux contenus ; car la réhabilitation de l’Afrique et son émergence doivent être engagées dans cette voie. C’est à partir de cela seul que politeiaphiles, philanthropes et technophiles ou technocritiques pourront, en second lieu, travailler à l’émergence vraie. Dès lors, comment, à partir de l’exigence de la réflexion seconde et de l’historicité, articuler bâtir-développer et habiter pour donner un sens au projet-émergence africaine ?
2. Bâtir – Développer – Habiter : sens et signification de l’Émergence Africaine
Les problèmes majeurs de notre temps appellent tout citoyen du monde à les interroger afin de les résoudre, tel est le sens d’une initiative citoyenne réfléchie. Saisir sa responsabilité, c’est aussi prendre la mesure et la plénitude des questions essentielles qui fondent la foi de l’humanité en un avenir prometteur. Ce souci nous engage à porter un regard critique sur notre époque où, dans une exigence de progrès et de développement, nos États aspirent à l’Émergence, fût-elle une bride. Penser le développement humain et l’infrastructure dans une co-évolution paraît pertinent dans ces conditions et pose la nécessité de ce rapport philosophiquement.
En fait, nous gagnerons en réalisant que la tâche qui urge plus, c’est d’accomplir la mission qui honorera le mieux l’émergence de notre Afrique : l’unité parfaite entre progrès technologique et une bonne perception des significations humaines du développement. À la vérité, pour bien cerner les enjeux inhérents au projet-émergence africaine, urge une double articulation du concept : Penser l’émergence comme un processus critique et éthique de développement d’infrastructures et penser son caractère moral. Car développer l’homme, c‘est lui donner toutes les conditions nécessaires pour son épanouissement ; c’est- à – dire mettre à sa disposition des ressources lui permettant de bien vivre, certes, mais aussi et surtout l’éduquer dans son milieu. L’éducation morale doit-être au cœur de toute pro-jection vers une émergence qui requiert la réalisation de soi de l’individu. C’est dans ces conditions que la survie de l’Afrique ne sera plus menacée. Cette considération invite à prendre en charge la nécessite d’un nivellement axiologique ou une transformation du genre humain : l’exigence d’une reforme de l’entendement sur le sens et l’essence de l’émergence.
Dans une atmosphère où tout est axé sur les infrastructures matérielles, où les jeunes vautrés dans les voluptés, les passions diverses, perdent le sens et l’essence de l’agir moral, vivent l’inauthentique, c’est-à-dire une sorte de « barbarie morale », car trans-portés par les arts musico-gymniques, gagnés par les vices ; il s’agit de développer un nouveau rapport au concept de développement. Dans le concept de « développement durable », c’est l’homme qui est la valeur des valeurs dans la mesure où, c’est son intérêt qui appelle la réflexion éthique. Le projet-émergence ne devrait-il pas associer la question morale ? Toute tentative de réponse dévoile la grande difficulté à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés, quant à une approche objective de l’homme.
Trouver un plein accomplissement humain pour une société qui aspire à l’Émergence, au progrès technologique, l’aspect moral qui fonde même l’essence de la société ne doit pas être occulté. Car du sérieux de cette approche critique du projet dépendent la valeur et le sens de la conception citoyenne de l’homme. Et la valeur de cette approche réside en ceci : Toute société qui entend bien vivre, bien servir l’homme, toute projection qui vise la satisfaction de l’être-humain, du citoyen, ne peuvent faire abstraction du caractère exigeant de la question morale, l’éducation morale. À ce propos, nous recommanderons une lecture attentive de L’économie est une science morale (1999) de Armatya Sen. Dans cet ouvrage, l’auteur pose l’exigence d’une responsabilité sociale, infléchie à l’exigibilité de l’apport éthique dans la construction d’un monde équilibré et harmonieux. Le caractère et l’importance de cette analyse sont plus que nécessaires, à moins que nous décidions de laisser l’homme dénudé de toute essence morale, infiniment égaré dans la barbarie, l’immoralité, au sein de grandes agglomérations, des artifices.
La problématique actualiste de l’émergence nécessite une reforme morale, une reforme de l’entendement humain, qui exige une co-évolution homme-technologie, afin que l’on puisse bien cerner et appréhender les fins de l’émergence, comme idéal de perfectionnement du corps social. Cela montre pertinemment que le souci d’allier la question morale au concept d’émergence devient une exigence fondamentale, qui permet donc de se prédisposer à une habitation authentique et véritable, qui requiert l’homme, comme être de raison, mais aussi (et surtout) comme « animal politique », selon les mots d’Aristote.
Le projet salvateur d’une émergence invite à la prudence, c’est, à notre humble avis, l’essentiel dans ce présupposé de Progrès et de Développement. Car, comme le souligne Hannah ARENDT (1990, p. 61), « si nous voulons être chez nous sur cette terre, fût-ce au prix d’un accord avec notre siècle, nous devons nous efforcer de prendre part à ce dialogue sans fin avec l’essence de ce monde. » Cela exige que nous menions une réflexion critique sur nos projets et nos actes, particulièrement sur le concept Émergence. Cette co-évolution demeure soutenable, car ni riches ni pauvres ne sauraient vivre dans une société « émergente », exempt de pensée morale. C’est même l’exigence d’une dématérialisation du progrès, afin que nous parvenions à une transfiguration totale de la société, de notre société marquée du sceau de la déficience morale, où les valeurs, les vertus se désagrègent au profit de la barbarie et l’inhumanisation.
L’émergence africaine nécessite une profonde et sérieuse méditation des concepts clés qui donnent au terme « émergence » toute sa valeur et sa justification ontologique. Si dans un langage linguistique le signifié correspond à un signifiant qui le signifie, il convient de trouver le signifié du concept « émergence » avant de chercher les déterminations pratiques qui le signifieraient. Comment intuitionner le concept d’émergence pour lui donner une représentation symbolique et une effectivité ?C’est là le fond du débat.
Si émerger, c’est se déployer, se dégager, manifester un mouvement, connaître une ascension, ce jaillissement doit avoir ses déterminations conscientes et précises. L’émergence, en tant que déploiement et dévoilement de la capacité humaine à créer des changements positifs, à aménager l’espace par un agencement mécanique, doit répondre d’un appel à être ou à un plus-être. L’homme s’est élevé au-dessus du règne animal dès le jour où l’homo faber a commencé à transformer son milieu par la technique. Mais ce changement traduit le souci : le souci d’évoluer, de progresser, d’avancer graduellement. En désignant la chose ainsi, l’on s’aperçoit que l’homme avait le souci du bâtir, du développer. Dès lors, si Gabriel MARCEL (1967, p. 129.) affirme que « l’essence de l’être, c’est d’être en situation », on constate que très tôt l’homo faber a saisi sa situation ; mieux, il a commencé à aménager sa condition d’existence. Par ce fait de vouloir bâtir, il souscrivît à l’émergence, ce projet millénaire. Mais qu’est-ce donc que bâtir une émergence aujourd’hui ?
Bâtir, nous entendons par ce vocable le refus de toute dictature de l’avoir, toute fin de non-recevoir à un enlisement inconscient dans le règne des techniques et la domination de la société de fonction, qui arrachent à la vie concrète sa justification immanente. Bâtir, selon une perspective heideggérienne, c’est aussi avoir le souci de vivre harmonieusement, vivre en harmonique avec la pensée éthique et le souci de l’humain. Autrement dit, si la pensée heideggérienne nous convoque à une éthique de l’habiter; si le penseur exige un constant souci de l’être à travers un souci prononcé pour le dasein, son plus proche voisin, on comprend avec lui que bâtir, c’est l’harmonique, le souci de l’humain. C’est indéniablement vivre dans le présent présentifiant qui rend à l’existence humaine son éclat, sa beauté éthique : Vivre poétiquement, ou encore vivre la paix dans l’unité au divin et aux hommes. Partant de cela, l’émergence doit prendre en compte cette dimension ; elle ne doit pas fonder son essentialité sur le positivisme économique et les seules lois de l’économie et de la politique.
Penser ainsi la problématique de l’émergence africaine, ce sera prendre dangereusement rendez-vous avec le « diable ». Or, Martin HEIDEGGER (1958, p. 193.) éveille notre conscience du réel sur la crise de l’habitat, ou « crise du logement » ou du moins le malaise dans l’habitation humaine, qui doit être la première des idées de cette émergence africaine. Notre capacité à trouver des solutions idoines mettra un terme aux dérélictions. Cette clarification permet de poser une corrélation entre bâtir – Beau et Habiter. Bâtir une émergence actuellement consiste en l’établissement d’un équilibre symbiotique qui consacre l’harmonie dans les relations interhumains et Homme -Nature. La beauté dont il est question vise l’équilibre, l’harmonie dans les interactions, gage d’un monde paisible et agréable.
En outre, cette question de l’émergence doit assimiler la dialectique de l’avoir et être. Le réalisme phénoménologique de notre émergence doit refuser tout enlisement dans le monde de l’avoir, où la dissolution de l’exigence ontologique pourrait nous conduire à un déchoir total, au désespoir. Car si le projet-émergence ne tient pas compte de la dialectique de l’être et l’avoir, nous pourrions aller au déchoir, toute considération faite à la crise du technologique.
L’émergence doit prendre aussi en charge l’Éthique, l’Esthétique et l’Art. Le souci doit être de créer les conditions d’un équilibre dans les rapports interhumains et les relations Homme – Nature. Ici se joue un élément fondamental : le vivre-ensemble. Ce vivre-ensemble doit garantir la paix entre les hommes, mais aussi l’équilibre symbiotique entre l’homme et son milieu. Car la crise de l’habitat, la crise écologique font surgit la question de ” l’éthique environnementale” et celle d’une “éthique de l’habiter “. L’Afrique est un immense réservoir naturel, dotée d’une nature genreuse, elle attire tous les regards. C’est à ce niveau qu’il convient de mettre en relief l’exigence d’une pensée éthique dans l’exploration des ressources naturelles. L’éthique jonassienne (Cf. Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique) pourrait ici jouer un rôle capital. Aussi est-il capital de penser à l’Art, sinon au Beau dans la nature, afin de maintenir l’équilibre. Les crises écologiques et environnementales doivent être prises en compte. Et les africains doivent penser le sérieux de ces questions, à moins qu’on s’inscrive dans une position de dépendance, où l’irresponsabilité rattrape toujours. Dès lors, comment, partant de ces considérations morales et éthiques, caractériser concrètement ce projet-émergence ? Quelles doivent être les tâches les plus explicites de l’émergence sur le plan politique et économique, à proprement dit ?
3. Projet – Émergence et Projet – Espérance : Pour une renaissance Africaine
Après cette randonnée quelque peu abstraite, posons maintenant la problématique d’un réalisme politique et celle de la capacité ou la capabilité humaine à la créativité, à l’innovation, au progrès chez les africains. Face à ce siècle de crises, surtout de crises nucléaires, le projet-émergence africaine exige que l’on ne s’appuie pas sur les seules lois de l’économie et de la politique. Ce projet doit prendre en compte une dimension éthique des politiques, c’est-à-dire une véritable volonté de consécration des dirigeants du vieux continent à faire des projets modèles, à bâtir des gouvernements modèles, habiles, empreintes de sollicitude à l’égard des populations, d’honnêteté exemplaire dans la production et la rétribution ou la répartition des richesses. Ceci doit plus retenir l’attention des bâtisseurs du projet-émergence africaine ; ce sont là les germes, les signes d’une véritable émergence. Et il importe de bien réfléchir, de l’avis de N’joh-Mouellè (1970), à « la signification humaine du développement », car l’émergence africaine ne doit pas suivre le même chemin des indépendances fallacieuses. Bien au contraire, elle doit être perçue comme un travail constant, une sorte de conquête par un long et acharné travail, qui se couronnent par des succès pratiques à travers des constructions et des projets véritablement humanistes.
Aussi est-elle parfaitement juste, à notre humble avis, la décision murie par nos dirigeants politiques, nos gouvernements, et même dans l’esprit de la majorité des africains de croire en ce rêve ; cependant, il nous faut nous rappeler la fameuse indépendance dictée et contrôlée jusqu’ici. La révocation au doute de cette indépendance et, par suite, le renouveau dans la perception des fins de la politique africaine doivent nous éclairer davantage. À cet égard, il nous faut comprendre le fondement de cette émergence quasiment populiste dans les cités africaines. Quels sont ses véritables bâtisseurs ? Quels sont ceux qui fixent ses normes ?
Cette remarque nous permet de poser la question des conditions de possibilités de l’émergence africaine. Car ce continent, dont la grande majorité des pays a une économie qui dépend de l’extérieur (l’Europe, l’Amérique, etc.) peut-il vraiment émerger ? De quelle émergence parlons-nous ? La problématicité de l’émergence africaine est là. Comment des États qui continuent de se nourrir à la mamelle nourricière de l’Europe, peuvent-ils espérer un plein développement ou avoir une économie libre ?
À ce niveau, les analyses de Vladimir LÉNINE, notamment sa réflexion sur Du droit des nations à disposer d’elles-mêmes (Moscou, les Éditions du Progrès), sont fort enrichissantes. Le bien-fondé de cette réflexion de Lénine était de se prononcer sur l’égalité en droits de toutes les nations, pour la reconnaissance de leur droit à décider par elles-mêmes de leur sort, voire de leur devenir. Dans le champ politique, cette problématique reste inchangée ; elle se posera toujours aussi longtemps que les Africains n’auront pas de volonté de puissance et un courage philosophique pour sortir de politiques structurelles et des aides extérieures qui les maintiennent esclaves des politiques inhumaines.La question de l’indépendance économique et politique concrète doit être un pan majeur de ce projet-émergence. Cet humanitaire creux, cette assistance éternelle ne semble pas concourir à une auto-réalisation, une auto-production du progrès ainsi que de l’assumer. Tout ceci concourt à se demander : À quand ce courage philosophique qui donnera à l’Afrique sa Liberté confisquée ?
Mais ce constat est là, implacable. Nos dirigeants sont dans un romantisme politique, incapables de prendre la décision iconoclaste et révolutionnaire pour un véritable sursaut. Il manque aux politiques africaines la volonté de sortir de pactes coloniaux pour développer une économie libre. Nos politiques publiques calquées, ou orientées par les institutions financières internationales, peinent à réaliser une véritable transformation sociale. Le corollaire d’une telle attitude est que la pauvreté gagne les populations, la misère aussi ; nous vivons dans l’inquiétude et l’angoisse au quotidien. Pis, les crises migratoires vers l’Europe, les menaces terroristes nous acculent de toute part. Tout cela rend plausible le besoin de changement, et ce par des politiques courageuses et efficaces. Mais comment cela n’arriverait-il- pas, si, suivant le témoignage de Simone WEIL (1955, p. 41.) :
La génération même pour qui l’attente fiévreuse de l’avenir est la vie tout entière végète, dans le monde entier, avec la conscience qu’elle n’a aucun avenir, qu’il n’y a point de place pour elle dans notre univers […] Nous vivons une époque privée d’avenir.
De la capacité de nos politiques à garantir la sécurité sociale dépendra la preuve indéniable et incontestable de cette projection. Sans ce concret, l’homme africain restera un eternel rêveur qui s’ignore ; c’est-à-dire un être qui aime à se satisfaire des utopies positives, mais qui n’a aucune amélioration de sa condition d’existence. Il deviendra cet utopiste illusionniste qui n’apprend jamais à regarder la lune. Comme les éternels prisonniers de la caverne platonicienne qui prennent leurs illusions pour du concret, pour des réalités, sans la metanoia et un criticisme de notre réalité sociale, l’illusion optique du bonheur nous arrachera la justification immanente de l’existence. Il faudra donc repenser cette économie de la politique africaine de développement. Cet épineux point de cette aspiration ne doit pas être occulté. C’est ici que se pose la question de la paix et de la sécurité en Afrique.
Ce pan devient inconditionnel et exige que les Africains garantissent la quiétude et la sécurité sur tous les plans (alimentaire, sociale, politique, économique, sécuritaire, etc.). Cela demande des mécanismes. Cette problématique de la paix, pour être soldée, demande que les données ontologiques, ou du moins le patrimoine immatériel et matériel jouent un rôle éminemment important dans les politiques de développement, et que l’Afrique ne soit plus le théâtre triste et sans vergogne d’expérimentation de toutes sortes d’expériences et de valeurs[43]. En d’autres termes, il est important que les Africains se servent de leur culture comme un levier de leur projet-émergence. Les données cultures africaines regorgent divers mécanismes et procédés de résolution des crises, des mécanismes de médiation de conflits qui sont largement supérieur à ceux de l’Occident. L’occidentalisation de toutes les sphères de la vie quotidienne n’est pas, et ne sera jamais, pour l’Afrique, l’insigne de l’émergence ; bien au contraire, ce sera même le signe de la dévitalisation, de la dépersonnalisation. Les données sociologiques et historiques africaines doivent servir dans la gestion des affaires des républiques et non comme des compléments ou des suppléments d’âme. Pour ce faire, dans les politiques de l’éducation, ces données méritent une place capitale. Aussi importe-t-il une éthique des technologies.
Dès lors, la question du transfert des compétences en lieu et place d’une tropicalisation ou un transfèrement des technologies est suscitée, d’une part, et, d’autre part, celle de la problématique de la justice sociale à travers une bonne, juste et équitable distribution des ressources. Le développement technologique, à travers des projets de développement d’infrastructures sociales et techniques est certes louable ; cependant, ce changement positif doit être la grande affaire de nos intellectuels et nos ingénieurs et techniciens. Que ce ne soit plus la grande affaire des ingénieurs et des techniciens étrangers qui finissent par se servir de nos techniciens que comme des journaliers ou, au besoin, comme des complémentaires. L’Afrique doit bâtir son émergence avec des ressources intérieures propres, à cette seule condition la réalité de l’émergence sera admise. Sans ce changement de regard, cela rend douteux le projet-émergence même si, dans son principe, le rêve ou l’utopie est un premier et grand pas vers quelque chose de fondamental.
Le projet-émergence doit prendre en compte les réalités inédites et les crises nucléaires de la post-modernité. Les Africains doivent penser à double niveau : Penser l’action pour le présent dans toute sa globalité, d’une part, et, d’autre part, penser le futur à partir du présent et ses conséquences. Un exemple comme celui de l’économie de nombres de pays qui fonde son espérance dans le commerce extérieur, axé sur les matières premières agricoles, ne peut en aucun cas garantir ou assumer, à bon droit, les espérances africaines. Croire en l’émergence de l’Afrique est une chose certes louable, mais la réaliser supposer des fondements solides. Malheureusement, nous sommes incapables de créer la richesse quand bien même la nature nous ait dotés de potentialités. L’Afrique commerce avec l’Europe principalement. Or la nature des rapports entre ces deux entités est semblable à celle d’un homme et sa bonne -à -tout-faire. Ou encore, un maître et son esclave, l’esclave ayant accepté de signer le contrat de ne jamais envisager sa liberté ni de projeter son émancipation, le maître lui ayant imprimé dans le cerveau l’impossibilité de se réaliser pleinement tout seul. À la vérité, telle est la nature de ces relations. Tout est pensé, dicté et orienté par l’extérieur. Sinon que dire de la nature des rapports entre la France et ses colonies d’Afriques ? Près de la moitié des États africains sont à la merci de la mamelle nourricière d’un État (la France) : quel paradoxe ! Quel contraste ! Mais c’est la stricte vérité.
Nous sommes certains que la chute répétée d’une goutte d’eau arrive à percer la roche la plus dure, et qu’à forcer d’espérer, l’on ne finit que pas y arriver ; mais dans ces heures de grandes inquiétudes, face à ce romantisme politique dans l’Afrique actuelle, que l’on ne prenne pas l’aube pour le jour, ni le crépuscule pour la nuit. La différence est nettement établie, la distance aussi. Sans penser les conditions d’une véritable indépendance, l’on restera à la merci des observateurs étrangers qui nous berceront d’illusions : État de droit, avancée notable, croissance forte, etc. À la vérité, ce sera des mécanismes d’annihilation de toute aptitude à la réflexion seconde, c’est-à-dire cette remise en cause de soi, cette élévation au consciencisme véritable. Et si les Africains ne veulent pas connaître une fade et terne reconnaissance extérieure, ces prolégomènes nous paraissent importants. Car les indépendances en Afrique sont comme des leurres, et il ne faudrait plus confondre lueur et leurre, utopie et révolution (au sens de changement positifs).
Somme toute, l’émergence africaine demeure une possibilité humaine, mais qui passe par la conditionnalité d’une révocation au doute de l’indépendance africaine, une révocation au doute de la nature des rapports entre l’Europe et l’Afrique. Elle suppose une sérieuse remise en cause de notre essence, de notre liberté, sinon de notre capacité à opérer des changements positifs en dehors des strates de l’occidentalisation de toutes les sphères de la vie quotidienne. Elle exige notamment une rationalité conséquente. Mieux, le projet-émergence requiert une volonté de puissance nietzschéenne. Urge que les africains opèrent un renouveau dans la perception des fins dernières de la politique. Car, à tout le moins, il ne faudrait pas confondre utopie et générosité ; il ne faudrait pas attendre l’assistance perpétuelle pour poser la corrélation émergence-développement. Les vaines espérances fondées en des politiques structurelles, et l’incapacité des dirigeants africains à penser par eux-mêmes, à voir dans la facticité des choses le sens, ne sont pas des réalités phénoménales. Une véritable réflexion éthique sur l’espérance africaine dans une herméneutique et une phénoménologie des relations entre les États est plus que nécessaire.
Aucun doute que l’espérance marxiste largement partagée par les indépendantistes africains n’a rien apporté, le socialisme ayant été un arôme et non point le plat de résistance en lui-même. L’homme africain, avec toutes les appréhensions et procès qui lui sont faits sur des siècles, peine à atteindre la métamorphose nietzschéenne. Encore au stade du chameau, l’on se demande toujours si les Africains ignorent l’histoire de Prométhée ? Seul l’homme prométhéen brise les chaînes et les interdits, agit et transcende sa réalité banale et première, est l’instigateur du vrai dépassement, du vrai projet-émergence. Or tout se passe comme si l’Afrique n’a plus de Prométhée, ou qu’elle les ait tous réduit au silence. Des figures, avec un engagement peut-être précoce, comme Patrick Lumumba, Thomas Sankara, Sékou Touré, etc., ces hommes transcendantaux au moins pourraient nous convaincre. Sinon dans l’Afrique actuelle, avec ce laxisme, cette absence criarde d’engagement, de motivation, de criticisme, loin s’en faut, trop de mirages. Quel bilan avons-nous faire des nombreuses prospections sur l’Afrique ? Rien ! Au contraire, ce sont des crises interminables, l’irresponsabilité des politiciens et la lâcheté des populations restées au stade d’éternels suiveurs.
Le terreau est encore favorable pour des exploits, notamment la réalisation de la sécurité alimentaire en mettant un terme définitive à l’importation du riz et des aliments chimiques, sources de nombreuses maladies pour nos populations. Aujourd’hui des maladies inédites comme les accidents vasculaires cérébraux (AVC), l’insuffisance rénale et bien d’autres doivent éveiller nos consciences sur les aliments que nous consommons, nous amener au consciencisme sur le sens de notre espérance. L’émergence doit prendre en charge la révocation au doute de notre manière actuelle de saisir les significations humaines de l’accomplissent. L’orientation économique, politique, culturelle doit être bien définie et sue de tous. La réflexion sur l’émergence, un demi-siècle après les indépendances africaines, doit être l’occasion d’un regard lucide sur des visions étriquées, rapides, superficielles d’un avenir dicté par la peur qu’éprouvent les impérialistes de mettre en péril leurs intérêts économiques et financiers, voire une influence considérable dans la gestion des affaires du monde. L’improvisation, le désordre et le refus d’inventer sa propre voie constituent aujourd’hui les éléments qui doivent nous saisir, nous amener à nous révolter contre nous-mêmes et nous conduire à décider de maîtriser notre destin.
Il importe beaucoup que nos dirigeants, par un courage philosophique, parviennent au consciencisme porteur de l’espérance pour cette Afrique cloitrée dans l’improvisation, le désordre politique et social. Que les politiques africaines n’attendent plus après l’extérieur la chance pour réussir le pari de l’émergence africaine. Au contraire, si l’émergence est fondée sur cette attente, elle conduira à un désenchantement ; mieux, elle provoquera la néantisation suprême chez nos populations : le suicide ou la mort tout court. Nous voulons pour preuve les milliers de morts dans les naufrages de la Méditerranée.
La nécessité de la réforme intellectuelle et morale demeure l’une des plus grandes exigences de la promesse d’une Afrique future pleine d’avenir et d’espérance. En un temps de changement historique si décisif où nous croyions devoir aux souvenirs successifs que l’Afrique s’était donnés, il nous faut assez reconnaître le gouffre entre la généreuse proclamation populiste de l’émergence, idéal louable et les paradoxes que nous offre le fonctionnel informel de nos États restés jusqu’ici nécessiteux après un demi-siècle d’indépendance. Au risque de verser dans une simplification, l’on devrait reconnaître assez clairement que, même si la meilleure des croyances est celle qui est capable de porter des projets qui permettaient à l’humanité de progresser le plus sûrement sur la voie du bonheur, de croire en la promesse d’un avenir meilleur, l’Afrique actuelle laisse à désirer. Ce rêve sera partagé lorsque les politiques africaines ne pourront concevoir nos sociétés autrement que sous la forme de collectivités organisées et hiérarchisées qui sauraient faire servir les efforts de la majorité au progrès de la civilisation.
Avec la plupart des gens qui ne croient plus aux promesses politiques dans l’Afrique actuelle, il serait absurde et dupe de ne pas affirmer le caractère instable, dangereux voire pernicieux de la démocratie dans nos sociétés. Immatures, nos populations sont incapables d’assurer une fonction politique qui reste désormais le monopole d’une élite qui les maintient prisonnières de fictions politiques. Pis, la justice sociale qui devrait assurer l’égalité et l’équité reste la plus dangereuse des utopies ; puisque la démocratie en Afrique apparaît comme le plus indescriptible des chaos, au mieux le désolant règne de l’universelle médiocrité. Sur ce point, une phénoménologie de la gouvernementalité et une sociologie du développement nous fourniraient de grandes données. Au demeurant, même si l’on se contente d’accepter la démocratie comme un moindre mal, un travail colossal reste à faire ; c’est tout le sens de l’exigence de la reforme intellectuelle et morale dans une Afrique où les différends peuvent conduire à l’apocalypse.
Il s’en suit que, suivant Elysée KOUASSI (2014, p. 147.) :
Le véritable problème est que la contestation entre les africains eux-mêmes les y éloigne peu à peu de cet idéal, cette renaissance à souhait ou à volonté. C’est cette contestation, qui trahit le développement de l’Afrique, tue ses propres fils qui ambitionnent son idéal, [qui] devra être proscrite pour une Afrique émergente.
Cette reforme intellectuelle et morale demeure un dénominateur important, sans lequel l’alibi ethnique, les partis pris politiques et les intérêts mesquins des uns et des autres feront de ce rêve une vision désincarné du véritable progrès africain.
Conclusion
À bien considérer les choses, dans une herméneutique du sens, ou du moins une phénoménologique de l’espérance, des inquiétudes demeurent. Loin de vouer les africains à l’échec, il est triste de souligner la précocité de ce projet et surtout l’impossibilité de croire aux conditions de son avènement ou son effectivité. Un projet perpétuel, une pro-jection dans l’Histoire, cette marche sur les chemins du progrès et du dé-veloppement ne saurait jaillir de nulle part, sans réflexion sérieuse. L’immaturité dans les politiques africaines, la gestion déséquilibrée des ressources, l’inaptitude des États à rendre manifeste une certaine capacité politique chez leurs peuples, la dépendance totale de l’extérieur, tous ces éléments fomentent la problématicité de la corrélation émergence et reconnaissance. L’émergence africaine est-elle véritablement un réalisme politique des dirigeants africains ? La question demeure inchangée, même à ce stade de l’analyse. Cette projection doit être sous-tendue par une pensée éthique et critique, cette pensée devant faire la membrure de l’émergence, et favoriser le nivellement axiologique. Heureusement que l’espoir est permis, à condition que les prolégomènes d’une telle méditation ne tombent pas dans des terres infertiles, impropices à la culture du progrès et du développement.
Disons que l’émergence doit aboutir nécessairement à une reconnaissance, ce qui jugera de sa réalité et de son effectivité ; cependant il serait faux de croire en cette pro-jection si elle est sous-tendue par les puissants de ce monde, si elle est dictée et orientée par les forces extérieures. Nous voulons pour preuve, la problématicité de l’indépendance africaine après un demi-siècle. Elle pose l’épineuse réflexion sur l’avoir et être, la paix sociale, le bien-être, etc. Elle exige aussi une réflexion intense sur Bâtir- Développer-Émerger. Cette interaction entre ces concepts fondamentaux qui expriment au mieux le sens de l’émergence, doit livrer l’horizon de cette espérance qui fonde la foi des Africains en un avenir prometteur. C’est le lieu, selon les remarques de Fofana MOURAMANE (1997, p. 26.), « d’unir le meilleur de nos forces et nos idées» en vue de lancer le continent dans la course ». Nous sommes certain de ce souhaitable-réalisable, mais nous ne cesserons, comme le fait d’ailleurs Brunchey Stuart (1966, p. 7.), de souligner cependant que « le foyer incandescent dans les domaines plus en plus large n’existe pas encore ».
Une analyse globale de la renaissance africaine est une gageure, nulle ne saurait prétendre couvrir tous ces aspects. (…) En nous engageant sur ce chemin de l’épineuse problématique de la renaissance du continent, (…) notre réflexion se cristallise inévitablement sur le rappel des dommages multiformes du jeu politique qui doivent cesser, l’exigence de trouver un élan de dépassement de soi et de repositionnement moral de la part des dirigeants et intellectuels africains par un Engagement déterminant, afin que le développement de réelles et possibles possibilités qui résument la renaissance africaine voient le jour. (Guy, AMOIKON, et al, 2014, p. 141).
Références bibliographiques
ADORNO Theodor, HORKHEIMER Max, 1974, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard.
AMOIKON Guy, et al, 2014, Réflexions critiques autour de philosophe et contestation en Afrique de Samba DIAKITE, Québec, Différance pérenne.
ARENDT Hannah, 1990, « Compréhension et politique », in La nature du totalitarisme, Paris, Payot & Rivages.
ARMATYA Sen, 1999, L’économie est une science morale, Paris, La découverte.
BADIOU Alain, 2014, La République de Platon. Dialogue en prologue, seize chapitres et un épilogue, Paris, Fayard.
CAPPELLE Philippe, (éd.), 2005, Expérience philosophique et expérience mystique, Paris, Cerf, 2005.
GAZOA Germain, 2006, Les conflits en Afrique noire. Quelles solutions ?, Abidjan, Frat-Mat éditions.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, trad. De l’Allemand par Alain PREAU, Paris, Gallimard.
MARCEL Gabriel, 1967, Le Mystère de l’Être. I. Réflexion et Mystère, Paris, Aubier- Montaigne.
MASSET Pierre, 1997, « Espérance marxiste, espérance chrétienne. Pour une philosophie de l’espérance », p. 1-19, in : http://www.nrt.be/docs/articles/1977/99-3/1097Esp%C3%A9rance+marxiste,+esp%C3%A9rance+chr%C3%A9tienne.+Pour+une+philosophie+de+l’esp%C3%A9rance.pdf.
MOURAMANE Fofana, 1997, Rêver le progrès, Abidjan, CEDA/ NETHER.
N’JOH MOUELLE Ebenezer, (1970) 2011, De la médiocrité à l’excellence, Yaoundé, Éditions Clé.
STUART Brunchey, 1966, Les fondements et le dynamisme d’une économie libre, Paris, Nouveaux Horizons.
WEIL Simonne, (1934) 1955, Oppression et Liberté, « Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale », Paris, Gallimard.
YAHOT Christophe, 1999, « La culture comme force », Quest, Vol. IX/2, Vol. X/1.
SOUS-THÈME IV : ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMERGENCE DE LA FEMME AUTOUR DE LA PHILOSOPHIE HOBBESIENNE
Amenan Madeleine KOUASSI
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
madoamenan@gmail.com
Résumé :
L’émergence de la femme s’entend comme un changement de son statut : de sa situation de femme essentiellement domestique, lorsqu’elle acquiert une responsabilité politique avec des avantages financiers, cela peut être considéré comme une émergence pour elle. Généralement il y a des pesanteurs sociales, traditionnelles qui constituent des obstacles à cette émergence. Nous allons interroger le philosopher hobbesien afin de comprendre ce mécanisme d’émergence de l’être féminin. L’analyse de ce sujet soulève ces questions fondamentales : que recouvre le concept d’émergence de la femme ? Quel est le point de vue hobbesien sur ce sujet ? En quoi la question de l’émergence de la femme[44] chez Thomas Hobbes peut être une problématique à résoudre afin de contribuer aux combats pour l’émancipation de la femme ?
Mots-clés : Condition traditionnelle, Émergence, Émancipation, Pesanteur, Philosopher hobbesien, Responsabilité financière.
Abstract :
The emergence of the woman is understood as a change of her status: from her traditional condition she grants a political, economic responsibility with financial advantages. Generally, there are social, traditional constraints that constitute obstacles to this emergence. We will therefore question the philosophy of Thomas Hobbes in order to understand this mechanism of the emergence of the feminine being in his philosophy. Thus, the analysis of this subject raises these fundamental questions: what does the concept of the emergence of woman cover? What is the Hobbesian point of view on this subject? All these questions refer to this: How can the question of the emergence of women in Thomas Hobbes serve feminism and contribute to the struggle for the emancipation of women?
Keywords : Traditional Condition, Emergence, Emancipation, Gravity, Hobbesian philosopher, Financial Responsibility.
Introduction
Depuis l’Antiquité, l’émergence est problématique pour la femme. Qu’elle soit une femme en milieu rural ou urbain, elle est toujours l’objet d’une discrimination dans la gestion du pouvoir politique. C’est la raison pour laquelle, nous voulons faire une incursion dans la philosophie de Thomas Hobbes qui met un accent particulier sur le statut évolutif de la gente féminine passant de la femme domestique à la femme publique et politique. Notre intérêt pour cet auteur se justifie ainsi par son souci relatif à la promotion de l’égalité des genres dans le domaine politique.
Dès cet instant surgissent ces questions-ci : que recouvre le concept d’émergence de la femme ? Quel est le point de vue hobbesien sur ce sujet ? Quelle est la nature des droits et du pouvoir de la femme chez Hobbes ? Quels sont les implications et les enjeux socio-politiques de la valorisation de la femme chez Hobbes ? Toutes ces interrogations renvoient à celle-ci : En quoi la question de l’émergence de la femme chez Thomas Hobbes peut être une problématique à résoudre ?
Il y a plusieurs facteurs qui suscitent la polémique autour de l’émergence de la femme, entre autres la phallocratie, les stéréotypes qui sous-estimeraient les capacités intellectuelles de la femme et seraient donc des entraves à son émergence. Il serait possible de découvrir dans la philosophie de Hobbes une valorisation des droits politiques de la femme et donc une possibilité de son émergence car l’auteur anglais ne précise pas le sexe du Léviathan. Ce qui voudrait dire que le Léviathan peut être d’un sexe ou de l’autre. Il reconnaît aussi le règne des Reines comme Marie Tudor et Elisabeth 1er de l’Angleterre dans son ouvrage Les éléments de la loi naturelle et politique.
Deux méthodes nous permettront de répondre à notre problématique : l’historique et l’hypothético-déductive. La méthode historique permettra de rappeler l’évolution du statut de la femme donc son émergence progressive. La méthode hypothético-déductive contribuera à la confirmation des différentes hypothèses émises.
1. De l’historicité de l’image de la femme
La philosophie que nous étudions, nous l’avons héritée de la société grecque. De fait, notre ébauche de l’historicité du statut de la femme va prendre ancrage dans un mythe grec, celui de Pandore. Ce mythe nous est raconté par S. Agacinski (2005, p. 16). En effet, Pandore est la première femme façonnée par Héphaïstos, douée de la vie grâce à Athéna et envoyée par Zeus sur la terre et porteuse d’une jarre contenant tous les maux de l’univers : fatigue, maladie, souffrance, mort … Un jour, par curiosité, Épiméthée son mari ouvre le couvercle de la jarre qu’elle devait laisser fermer, et en laissa s’échapper tous les maux qui se répandirent sur l’univers. Mais Pandore referma le couvercle sur l’Espérance qui resta au fond de la jarre. Pandore avait pour mission de séduire les mortels et les conduire à leur perte. C’est pourquoi selon S. Agacinski (2005, p. 16) l’histoire retient que « c’est de Pandore qu’est sortie la race maudite des femmes, terrible fléau installé au milieu des Hommes mortels». Ce mythe grec s’assimile au mythe chrétien de la création ; précisément lorsqu’Ève se laisse séduire par le serpent et fait advenir le péché dans le monde. Ce mythe emmène les misogynes à déduire que la femme est un être infernal qui doit seulement subir les douleurs de l’enfantement et les souffrances du ménage. La femme est à l’origine du mal dans le monde, c’est pourquoi elle ne doit pas avoir des droits, des opportunités qui favoriseraient son épanouissement, son émancipation.
Certains philosophes de l’Antiquité ont aussi cautionné le statut inférieur de la femme. Platon, dans ses œuvres de jeunesse, précisément dans le Timé, soutient en substance que les hommes qui ont mal vécu dans leur première vie, Dieu les punit dans leur seconde vie en les transformant en femme. Ce qui signifie que la femme est un être infernal au point où pour punir l’être de sexe masculin Dieu le transforme en un être de sexe féminin. Chez Aristote, F. Collin et al, (2000, p. 50), encore plus acerbe, « les différences physiques ou psychologiques entre mâles et femelles ne sont pas seulement pensées en termes de supériorité-infériorité, mais définissent la femelle en termes de défectuosité, de manque, voire de monstruosité ». Ce qui signifie pour F. Collin et al, (2000, p. 50) que
le sperme du mâle contient le principe de la forme tandis que celui de la femelle n’a que la matière. S’il est le plus fort, comme c’est la règle, il amène à soi cette matière et génère un enfant qui lui ressemble ; sinon, soit il dépérit, soit il engendre son contraire, c’est-à-dire une femelle, qui ressemble à sa mère. Présentée comme une défectuosité, cette dissemblance qu’est la naissance d’une fille constitue pour Aristote le premier écart de l’humanité parfaite, la première manifestation de monstruosité.
Aristote, F. Collin et al, (2000, p. 48) ajoute : «la femme est aux limites de la cité et de la sauvagerie de l’humain et de la brute ». Elle ne partage pas la position constitutive du citoyen. Cela signifie que la femme, selon Aristote n’est pas digne d’être citoyen. Elle n’est pas capable de produire le sperme qui permet d’engendrer un enfant. Elle est comparable à un être sauvage qui ne peut pas vivre dans une communauté. Pour Aristote, l’homme est un animal politique mais la femme est un animal tout simplement.
Selon le philosophe antique, il n’y a pas de mot pour désigner la citoyenne ou l’Athénienne dans la cité. Il rapproche le destin de la femme de celui de l’esclave et stipule que les femmes sont une menace pour la vie harmonieuse de la cité, elles n’ont même pas leur place dans la société. C’est à juste titre qu’il laisse entendre que le désordre des femmes est pire que celui que sèment les ennemis eux-mêmes. La femme, au même titre que l’esclave, est un être fait pour obéir. Elle est donc la première manifestation de la monstruosité. Le monstre est l’enfant qui ne ressemble pas à son père. Ainsi, s’il n’y avait que de géniteurs mâles, l’humanité serait parfaite. Pour cet auteur, l’incapacité de la femme à produire le sperme explique son infériorité à l’homme. L’homme étant celui qui produit le sperme, qui donne naissance à l’humain est censé être au-dessus de toutes créatures. La perception que l’on a des relations entre l’homme et la femme est que l’homme gouverne le monde, il a le pouvoir et sa domination sur la femme est notoire.
La marginalisation de la femme reste aussi une question cruciale pour les grandes civilisations de l’Antiquité. Les sociétés humaines, notamment la Rome antique n’y échappe pas. En effet, dans la civilisation romaine de l’Antiquité, la femme est toujours marginalisée et stigmatisée. Elle est exclue de la scène politique, économique et culturelle. Elle n’a de droit que dans la domestication. Elle n’est destinée qu’au mariage qui, très souvent, se déroule à un âge très précoce.
De même, pour le droit familial romain, le mari est le maître absolu et seigneur de la femme. C’est cette philosophie patriarcaliste que soutient Robert Filmer dans Patriarcha. Pour lui, Dieu a donné toute autorité à Adam de commander tous les siens, y compris la femme. Celle-ci est donc sa propriété et est à son entière disposition. Il peut la manipuler à sa guise, la punir de la façon qu’il veut sans contrainte. Pour J. S. Mill, (1992, p. 61). « La femme ne peut rien faire que par la permission au moins tacite de son mari. Elle ne peut acquérir de bien que pour lui ; dès l’instant qu’une propriété est à elle, fût-ce par héritage, elle est, ipso facto, à lui ». Par ailleurs, la Rome antique justifiait la restriction des droits de la femme par, entre autres, ‘‘la faiblesse’’ de son sexe, ou ‘‘la stupidité de son sexe’’, son manque de jugement sain et son incapacité à raisonner logiquement comme le souligne, en substance, Emmanuel Levinas (1963, p. 123) dans Difficile liberté. En effet, la femme romaine ne peut se voir confier aucune fonction publique ; elle ne peut non plus agir en son nom propre au tribunal pour signer un contrat ou agir comme témoin puisqu’elle faisait partie du groupe de ces gens à qui on ne pouvait faire confiance dans le jugement à l’instar des mineurs, des criminels et des handicapés psychiques.
Pour le législateur romain, la faiblesse d’esprit de la femme légitime ses incapacités juridiques. La femme romaine antique est une mineure perpétuelle. L’homme avait le droit de vie ou de mort sur elle.
Ce qui sous-entend qu’elle ne peut rien décider d’elle-même. De ce qui précède découle l’idée que la femme, à cette époque, était sous trois types de joug qui la mettaient en état d’incapacité : la puissance paternelle, la tutelle qui en est le substitut et la Manu, c’est-à-dire la dominance maritale. En fait, la femme romaine ne peut exercer aucun des droits essentiels du citoyen romain. Elle est écartée de toutes les fonctions civiques et publiques. Seule l’obligation conjugale la concerne.
Dans le mariage, sa charge la plus importante est de recevoir et de protéger le produit de la procréation, c’est-à-dire les enfants. Les Romains déniaient même à la femme un nom propre à elle ; elle n’était désignée que par le nom de son père féminisé. F. Collin et al, (Op. cit. p. 48), racontent qu’« Il n’y a même pas de mot pour désigner la citoyenne ou l’Athénienne ».
Ainsi, au lieu de lui donner un prénom, soit Hélène, soit Jeanne, l’on préfère l’appeler mademoiselle Dubois, comme se nomme son père. En somme, la société romaine antique a bafoué les droits de la femme. En plus, à l’époque Médiévale, l’image de la femme est aussi passée sous le regard de Saint Tertullien et Saint Augustin qui en donnent leur avis. Le premier, alors qu’il parlait à ses bien-aimées sœurs dans la foi, disait ceci :
Savez-vous que vous êtes chacune une Ève? La sentence de Dieu sur votre sexe subsiste aujourd’hui : la culpabilité doit donc exister nécessairement. Vous êtes la porte du démon: vous avez décacheté l’arbre interdit. Vous avez déserté les premières la loi divine: vous avez persuadé celui que le démon n’a pas été assez courageux pour attaquer de face. Vous avez détruit si facilement l’image de Dieu, l’homme. Par la cause de votre désobéissance, même le Fils de Dieu a dû mourir[45].
Saint Tertullien, à l’instar de Dieu qui prononce sa sentence à l’endroit de la femme lorsqu’elle s’est laissée trompée par le diable, rappelle aux femmes leur faut et évoque les souffrances liées à leur désobéissance. Le second, dans une lettre à un ami, écrit : “Je ne vois pas quelle utilisation peut faire l’homme de la femme, si on exclut la fonction d’élever les enfants. Pour ces auteurs, La fonction adaptée à l’être de la femme est uniquement celle d’une domestique parce qu’elle a désobéit à Dieu et a entrainé l’homme avec elle dans le péché. Les malédictions prononcées par Dieu, comme la soumission à l’homme, la douleur de l’enfantement rythmeront son existence. L’on pourrait déduire que c’est à cet instant que part l’origine de la polémique sur le statut social de la femme. La malédiction prononcée sur sa vie fait d’elle une domestique éternelle.
C’est pourquoi St. Augustin (1866, p. 153), allègue ce qui suit :
Il découle de l’ordre naturel que, parmi les gens les femmes servent leurs maris et leurs enfants, parce que la justesse de cela réside dans le principe selon lequel le plus petit sert le plus grand. Il relève de la justice naturelle que le cerveau le plus faible se mette au service du plus fort. Ceci en conséquence justifie clairement que dans les relations entre les esclaves et leurs maîtres, ce qui excelle dans la raison excelle dans le pouvoir.
St. Augustin poursuit : « que l’homme gouverne la femme plutôt que l’inverse. Ceci est conforme au principe établi par l’apôtre: la tête de la femme, c’est l’homme et femmes, soyez soumises à vos maris» St Augustin (1869, p. 9) Au fait, la femme est tellement infernale à leurs yeux qu’on lui interdit de prêcher dans les temples, et les premières règles de l’Église étaient en accord avec ce fait puisqu’elles stipulent que seuls les hommes doivent être ordonnés prêtres[46].
De ce qui précède, il faut retenir que l’Antiquité a vilipendé la femme pour ses incapacités morales et biologiques, en l’enfermant dans la fonction de procréation. L’époque Médiévale de son côté, a imputé à la femme la misère de l’humanité à cause du péché originel d’Ève. Que pense l’époque moderne de la femme, particulièrement la philosophie de Thomas Hobbes ?
2. La femme dans la philosophie hobbesienne
Thomas Hobbes est un philosophe du XVIIe siècle. Ses écrits s’inspirent des récurrentes guerres civiles et religieuses qui déchirent son pays, l’Angleterre à cette époque. Au regard de toutes ces atrocités, Thomas Hobbes, issu d’un pays bouleversé par la guerre, imagine un dirigeant plus fort, un souverain absolu capable de maintenir la paix. C’est dans ce contexte qu’il conçoit un état de nature, hypothèse de travail, pour montrer comment de cet état, les hommes peuvent, par un contrat, arriver à constituer un État civil régi par des lois. L’état de nature hobbesien est marqué par la solitude des êtres humains et la loi de la jungle. Rappelons que l’état de nature est une hypothèse de travail pour l’auteur en vue d’une élaboration scientifique du politique. De cette donnée hypothétique fondamentalement englobante, il met un point d’honneur à éclairer l’intuition en situant le genre féminin dans les prémisses de sa démarche hypothético-déductive. La méthode hypothético-déductive consiste à partir de définitions générales ou d’hypothèses vers des conclusions particulières. En effet, Thomas Hobbes fait de la femme le détenteur de la puissance parentale à l’état de nature. Toute la question reste à savoir ce que la femme devient sous le contrat social. Pour avoir abordé la question de la femme à l’état de nature en lui attribuant un rôle primordial, Le philosophe de Malmesbury pourrait être considéré comme un féministe. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d’idées politiques, philosophiques et sociales, qui partagent un but commun : définir, établir et atteindre l’égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes.
Pour comprendre le féminisme hobbesien, il faut comprendre sa méthode de travail: hypothético-déductive. Selon J. Bindedou-Yoman (2016, p. 14), « la démarche de Hobbes est toute simple. Il part de la domestication naturelle du genre féminin qu’il pose comme hypothèse de travail à l’état de nature, selon le principe de la méthode hypothético-déductive ».
En effet, T. Hobbes (1982 p. 186) confère un droit domestique à la femme. « En l’état de nature, une femme dès qu’elle est accouchée acquiert le titre de mère et de maîtresse de son enfant ». Selon Hobbes, les besoins quotidiens de l’homme sont la cause de la revendication de ses droits. Ce qui signifie que si la question de l’émancipation, de l’émergence de la femme suscite une polémique aujourd’hui c’est parce que la femme a besoin qu’on reconnaisse ses droits. Une personne qui possède des biens met tout en œuvre pour leur conservation quel que soit son sexe. Pour lui, tous les hommes sont naturellement égaux, c’est-à-dire qu’ils possèdent naturellement les mêmes droits. D’ailleurs, c’est ce qui explique l’opposition de Hobbes à certains auteurs comme Platon, Aristote et Sir Robert Filmer dont les pensées, dans le contexte de la démocratie athénienne, dénient à la femme le droit de citoyen. Chez Robert Filmer, l’homme détient le pouvoir absolu car Dieu le lui a concédé. Pour Hobbes, sur la base de l’égalité naturelle, l’homme et la femme disposent des mêmes pouvoirs c’est pourquoi il ne précise pas le sexe du Léviathan. Voici comment Hobbes exprime cette pensée.
À ce niveau de notre réflexion, il apparaît légitime et nécessaire de bien comprendre la texture du droit naturel dont Hobbes fait l’apologie. L’idée de droit naturel recouvre plusieurs acceptions qui s’opposent souvent. Le droit naturel désigne, d’abord, les règles communes que respectent toutes les communautés humaines, quelles que soient leurs mœurs ou selon la spécificité de leurs droits positifs. C’est aussi la situation dans laquelle se trouvent les humains avant l’État civil. L’état de nature est une situation idéale qui permet de construire logiquement le système du droit positif.
Sous la plume de T. Hobbes (1971, p. 128), le droit naturel est à la fois une liberté et un pouvoir spécifiques à l’être humain vivant dans l’état de nature. Au chapitre XIV du Léviathan, il affirme :
le droit de nature, que les auteurs appellent généralement jus naturale, est la liberté qu’a chacun d’user comme il le veut de son pouvoir propre, pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie, et en conséquence de faire tout ce qu’il considérera, selon son jugement et sa raison propres, comme le moyen le mieux adapté à cette fin.
Dès lors, c’est une liberté qui porte non seulement sur toutes choses, mais également sur le corps d’autrui. Selon T. Hobbes (1982, p. 188), en un mariage où le mari et la femme sont égaux, les enfants appartiennent à la mère « car rien ne s’oppose à ce qu’une mère contracte et dispose de ses droits que bon lui semblera ». En effet, la femme, dans la conception hobbesienne, dispose des droits naturels élémentaires et peut en user à son gré, elle a la possibilité de défendre ses droits avec dévouement. C’est pour cette raison, entre autres, que Hobbes défend le droit de la femme et en fait la promotion. Il va même plus loin dans sa logique en mettant en lumière l’autonomie et la responsabilité de la femme sur l’éducation de son enfant. Il soutient qu’à l’état de nature, l’enfant appartient à la femme en premier, car celle-ci est le berceau de la procréation. C’est elle qui porte l’enfant en son sein. C’est à juste titre que dans Émile ou de l’Éducation, Rousseau dit, en substance, que la femme est avant tout l’élément constitutif le plus important de la famille. C’est la nature elle-même qui l’a prédisposée, et qui lui a accordé ce rôle. Non seulement elle met l’enfant au monde, mais elle doit aussi assurer son éducation. Ce droit de la femme est inaliénable et ne peut être occulté. L’ordre ou le désordre de la société dépend en partie de la femme, car si l’enfant est mal éduqué, la société sera potentiellement exposée à la délinquance, à la violence et elle tendra à sa perdition.
Par contre, lorsque la femme assure bien l’éducation de sa progéniture, tout le monde y gagne puisqu’un enfant bien éduqué est symbole d’un bon citoyen, d’un bon dirigeant et, partant, d’une société en paix et victorieuse. Cette option n’est envisageable que lorsque la femme accepte de porter cette grossesse à son terme. Elle a tout le droit et le pouvoir de vouloir enfanter ou non, c’est-à-dire qu’elle a la possibilité d’interrompre l’embryon ou même d’éviter que surgisse un embryon. C’est par magnanimité qu’elle accepte l’avènement d’un enfant dans le monde.
En plus, la vie de l’homme lui-même dépend de la femme. Celui-ci a besoin de sa compagnie pour être heureux. Il semble dominer la femme mais, en réalité, il ne peut s’épanouir sans elle. Il est, en apparence, le plus fort mais, au fond, il dépend de la femme. La gente féminine sait influencer les hommes et même le sachant, ceux-ci n’ont aucun moyen de s’en défaire. Pour qu’ils soient dans de bonnes dispositions de leurs facultés mentales, il est capital que les femmes leur donnent de l’affect, les estiment dignes. Ils sont tributaires de leurs sentiments, du prix qu’elles mettent à leur mérite. La femme, non seulement préserve la relation entre elle et ses enfants, mais aussi celle qui la lie à son mari, principalement en le mettant en confiance dans son rôle de père. C’est dans ce contexte que J. Croissant (1992, p. 172) écrit : « elle est le cœur de la famille et protège son unité. Autour d’elle tout s’ordonne, s’unifie, s’harmonise, s’épanouit. Tout s’organise, car elle tisse des liens entre tous, envoie les enfants vers le père et le père vers les enfants ». La femme est un maillon important dans le fondement de la communauté. Il est extrêmement important que ses droits soient préservés et respectés. Plus qu’une faiblesse, le respect des droits de la femme est un devoir sociétal pour une vie harmonieuse et épanouie.
En outre, la Déclaration française des droits de l’Homme de 1789 stipule en son article 2 que les droits de l’homme sont naturels et inaliénables. Ce qui signifie que tous les êtres humains sont égaux. Par conséquent, ils ont les mêmes droits qui sont intrinsèques à la nature humaine. Il est incongru de faire une différence entre les droits des femmes, considérées comme des êtres subalternes qui ont des droits restreints et ceux des hommes, les plus forts, qui posséderaient tous les droits possibles. Étant donné que cette déclaration soutient que les droits de l’Homme sont naturels, tous êtres humains doivent en disposer de façon équitable. Partant, la femme, faisant partie de ce grand tout d’être humain, dispose des mêmes droits naturels que l’homme.
Par ailleurs, pour T. Hobbes (2003, p. 256), le rôle concernant l’éducation de l’enfant qu’il attribue à la femme à l’état de nature est valable dans l’État civil, car pour lui, « la domination sur l’enfant appartient originellement au droit de la mère ». En faisant une certaine lecture des œuvres de T. Hobbes (1982, p. 187), philosophe du contrat social et des droits de l’homme, l’on pourrait penser que les femmes sont des êtres domestiques. Voici un extrait qui pourrait le supposer : « J’estime que c’est à elles et non pas à leurs maris, de disposer de leurs enfants par droit de nature ; car la souveraineté les dispense de l’observation des lois civiles ».
Hobbes s’insurge contre Sir Robert Filmer, le père du patriarcalisme, pour défendre la cause de la femme. En effet, « Filmer défend l’idée que la paternité est la source du pouvoir : Adam fut, par décret divin, seigneur et propriétaire exclusif du monde». D. Weber (2003, p. 61). Robert Filmer soutient à travers son ouvrage Patriarcha que l’autorité que Dieu a conférée au premier homme, Adam, s’étend sur toute sa descendance y compris la femme, car elle est aussi sous sa tutelle. Il fonde la puissance naturelle des rois sur le pouvoir qu’Adam a reçu de Dieu sur Ève et sa progéniture.
Avec Filmer, le patriarcat est la simple transposition des relations familiales dans le domaine politique, c’est-à-dire que l’homme, le chef absolu de la famille, l’est aussi sur le terrain politique. Pendant des siècles, la famille, sous l’autorité du père, a fourni le modèle de toutes les relations de pouvoir et d’autorité. L’argumentation patriarcale traditionnelle assimile toutes les relations de pouvoir à la domination du père ou de l’homme. Au XIIè siècle, l’époque de Sir Filmer, c’est par cette analogie qui était prêchée, à l’église, l’obéissance des sujets à l’État. Hobbes s’oppose à cette conception. Il reconnait même le règne de Marie Tudor et d’Elisabeth 1er en tant que Reines d’Angleterre. C’est pourquoi, pour nous, la philosophie de Thomas Hobbes fait la promotion des droits politiques de la femme et contribue à sa valorisation et son émergence. Une incursion à l’époque moderne nous permettra de statuer sur la condition sociale de la femme à cette époque.
3. La femme à l’époque moderne
À l’époque moderne encore, des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau placent la femme dans le foyer. Rousseau la présente comme une personne qui n’a de droit que dans le cadre domestique. Une matrice de procréation, une bonne épouse soumise aux ordres de son mari. Ainsi, écrit-il (1969, p. 539) « plaire aux hommes, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu’on doit leur apprendre dès l’enfance ».
Pour Jean-Jacques Rousseau, en effet, la femme ne sert qu’à rendre l’homme heureux, qu’à prendre soin de lui. Chose plus grave, il va jusqu’à nier toute action politique et publique à la femme. À ce propos, J-J. Rousseau (1969, p. 539) souligne en substance, que la femme n’a pas besoin d’exposer ses idées ou ses points de vue sur les différents problèmes de son temps. Il suffit juste de connaître la position de son mari et de défendre celle-ci officiellement. Par ailleurs, pour cet auteur du siècle des Lumières, la culture est négligeable pour la femme. On doit plutôt la préparer au rôle de la mère qui aménage un foyer. Les métiers qui lui sont destinés sont : la couture et la coiffure.
Il s’établit ici une discrimination entre l’homme et la femme : la femme se voit privée de fonction intellectuelle et même d’éducation culturelle face à l’homme qui est doté de tous les droits et la domine. La pensée de Rousseau sous-entend que la femme est sous-estimée à cette époque. Son corps ne lui appartient pas, étant donné qu’elle est largement soumise à son mari. En d’autres termes, si l’humain est un être chez qui la raison règne sur les passions, cela ne se vérifie pas complètement chez la femme puisque J-J. Rousseau (1969, p. 539) qui prône tant la liberté, soutient que la femme doit vivre selon les convictions et les exigences de son mari. « Par la loi même de la nature les femmes, tant pour elles que pour leurs enfants, sont à la merci des jugements des hommes ». Rousseau bannit ainsi l’indépendance civile, c’est-à-dire l’autonomie qui veut qu’on ne dépende pas de la volonté d’autrui dans son existence. Or, de nos jours, le monde évolue à une vitesse exponentielle de sorte que pour se donner de la valeur et avoir le pouvoir il faut que l’on soit émancipé, autonome. C’est pour cette raison que Rousseau biaise les droits de la femme en la présentant seulement sous cet angle. À l’époque moderne la femme, à l’instar de l’homme doit s’inscrire dans la course du développement technique.
Dans le monde moderne en proie à la technique, où, comme le dirait T. Hobbes (2004, p. 83) : « la valeur ou l’importance d’un homme, c’est comme pour tout objet son prix, c’est-à-dire ce qu’on donnerait pour disposer de son pouvoir. », Rousseau affirme que la culture générale pour la femme est négligeable. En conséquence elle n’a aucune valeur pour Rousseau qui l’exclut des professions intellectuelles qui valorisent l’individu au sein de la société.
L’individu moderne, en effet, est caractérisé par sa propension à acquérir des connaissances et à mettre en valeur tout le potentiel de son esprit pour une maîtrise de la nature, mieux, être « maître et possesseur de la nature » selon R. Descartes (1966, p. 84). Concernant la femme, elle n’est pas libre de se servir de sa raison pour être maître et possesseur de cette nature. La raison chez la femme ne peut dominer ses passions. Elle est donc soumise à la nature et écartée du monde scientifique. De plus, les transformations dans le monde du travail se font parallèlement à celles des techniques. Le travail met en œuvre des techniques mises au point grâce au savoir et à la raison. Il s’agit bien ici encore de maîtriser la nature. Les techniques modernes entrent ainsi en contradiction avec une représentation du féminin comme être soumis à la nature. Enfin, les activités que les femmes exercent dans le cadre domestique sont exclues d’une définition en termes de travail. Elles deviennent des tâches ménagères. Par extension, ce nouvel ordre social construit l’illégitimité des femmes dans le monde du travail.
En définitive, depuis l’Antiquité, les femmes sont stigmatisées, stéréotypées par les hommes. Au-delà de la marginalisation dont elles sont victimes, force est de reconnaître que les femmes elles-mêmes ont leur part de responsabilité dans le sort qui leur est réservé dans la communauté. Car elles manquent de confiance en elles-mêmes, n’osent pas se décider à briguer des postes de dirigeants. Elles se contentent de l’image que la société leur forge, se résignent et sont passives. Tout ceci est aussi à l’origine du faible taux de représentativité des femmes en politique aujourd’hui. C’est pourquoi, il est rare de trouver autant de femmes que d’hommes à des postes de responsabilité politique.
Dans la société contemporaine, nous parlons de valorisation des droits de la femme, car avec la contribution des philosophes comme Hobbes, la femme a déjà acquis nombreux d’entre eux, consolidés plus tard par les combats des féministes à l’instar de Simone de Beauvoir qui a écrit Le deuxième sexe, un ouvrage de 1059 pages sur le féminisme. Dorénavant dans le monde en général et en Afrique en particulier, les femmes accèdent à la magistrature suprême. En Côte d’Ivoire par exemple, les jeunes filles sont scolarisées et accèdent aux postes de décision. La preuve en est que, nous avons six femmes au gouvernement ivoirien et de nombreuses femmes députés. Ce changement notable a conduit aux votes de lois revalorisant les femmes dans la nouvelle constitution ivoirienne en 2016. Parmi celles-ci figurent les articles 35 et 36 qui soutiennent l’égalité et la parité entre l’homme et la femme. Dans cette logique un programme gouvernemental comme le COCOFCI (compendium des compétences féminines en Côte d’Ivoire) a été initié pour contribuer à la promotion des droits de la femme. Nonobstant les progrès significatifs observés, il existe encore des pesanteurs sociales qui empêchent la gent féminine de jouir pleinement de ses droits.
Il faut souligner que la métamorphose des mentalités due à l’instruction occidentale, tant chez les femmes que chez les hommes a permis de comprendre la nécessite de la participation massive des femmes à la vie publique, culturelle, sociale, économique et surtout politique. La présence des femmes dans tous les secteurs d’activité peut buster le développement. Par exemple au niveau économique, lorsque la femme contribue aux charges de la maison, cela peut permettre à l’homme d’économiser. Au plan politique, elle décide de son sort car elle participe aux prises de décision par le vote des lois. Nous pouvons donc affirmer que l’émergence de la femme est en marche en Afrique et surtout en Côte d’Ivoire.
Conclusion
L’émergence de la femme consiste, pour elle à changer de statut social. Cela implique qu’elle se libère de son état de domestique, des pesanteurs sociales et traditionnelles pour mener des actions sur le champ public et politique. Elle doit se donner de la valeur en se hissant dans les hautes institutions de prise de décisions. Ses droits doivent être reconnus et valorisés comme défendus par la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Elle doit mener des activités libérales qui la rendent autonome et épanouie. Pour Hobbes, la femme est un être politique. Le statut de la femme est évolutif, voire émergente dans la philosophie hobbesienne. Elle passe de la domesticité à la femme publique. La valorisation des droits de la femme dans la philosophie hobbesienne aboutit à l’acquisition de certains droits. Cela nous permettra de confirmer notre hypothèse selon laquelle le hobbisme est au service de la valorisation des droits de la femme, par ricochet, son émergence.
En définitive la philosophie de Thomas Hobbes contribue à l’émergence de la femme en ce sens qu’elle valorise ses droits. Les femmes doivent donc être reconnaissantes vis-à-vis de la philosophie de Thomas Hobbes et suivre les changements propices à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, à travers des lois importantes.
Références bibliographiques
AGACINSKI Sylviane, 2005, Métaphysique des sexes, Paris, Seuil.
AUGUSTIN Saint, 1866 Question sur l’Heptateuque, Trad. de M. l’Abbé Pognon, in œuvres complètes, BAR-LE-DUC.
AUGUSTIN Saint, 1869, De la Concupiscence, in Œuvres complètes, Trad. de M. Raulx, BAR-LE-DUC.
BINDEDOU-YOMAN Justine, 2016, Hobbisme et féminisme vers une fluctuation de l’identité féminine, paf.
COLLIN Françoise et Al, 2000, Les Femmes, de Platon à Dérida, Anthologie critique, Paris, Plon.
CROISSANT Jo, 1992, La Femme sacerdotale ou sacerdoce du cœur, Paris, Éditions des béatitudes
D’AQUIN Thomas Saint, 1984, Somme Théologique, Les origines de l’homme, Le Cerf.
DESCARTES René, 1966, Discours de la méthode, Paris, Flammarion.
HOBBES Thomas, 1982, Le Citoyen ou les fondements de la politique, Paris, GF Flammarion.
HOBBES Thomas, 1971, Léviathan ou Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, Trad. de François Tricaud, Paris, SIREY.
HOBBES Thomas, 2004, Léviathan, Trad. de François Tricaud. Paris, Dalloz.
HOBBES Thomas, 2003, Éléments de la loi naturelle et politique, Trad. de Dominique Weber, le livre de poche.
ROUSSEAU Jean Jacques, 1969, Émile ou de l’éducation, Trad. de Pierre Bergelin, Paris, GALLIMARD.
WEBER Dominique, 2003, Léviathan de Thomas Hobbes, Paris, La philothèque,
[1] Voltaire, Candide ou l’optimisme, Paris, Éditions J’ai lu, 2012.
[2] (G.W.F.) Hegel, La raison dans l’histoire, traduction (K.) Papaionnou, Paris, Union Générale d’Éditions, 1979.
[3] (M.) Heidegger, “Pourquoi des poètes” in Chemins qui ne mènent nulle part, traduction (W.) Brokmeier, Paris, Gallimard,1962.
[4] Voir par exemple son grand ouvrage posthume (M.) Heidegger, Apports à la philosophie. De l’avenance, traduction F. Fédier, Paris, Gallimard, 2013.
[5] Voir (M.) Savadogo, Pour une éthique de l’engagement, Presses Universitaires de Namur, 2008.
[6] (M.) Savadogo, Philosophie de l’action collective, Paris, L’Harmattan, 2013.
[7] (M.) Savadogo, Philosophie et existence, Paris, L’Harmattan, 2001.
[8] L’expression est de F. Worms.
[9] S.E.M Quian Jin (1er Conseiller de l’ambassade de Chine en Côte d’Ivoire) dans sa communication à la Conférence internationale sur l’Emergence de l’Afrique qui s’est déroulée du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan, donne les 4 conditions suivantes : « 1. La stabilité comme condition préalable (…) 2. La technologie et l’éducation (…) 3. L’industrialisation (…) 4. Le peuple chinois prône le travail et l’apprentissage » (RSS – Le Magazine officiel de la Réforme du Secteur de la Sécurité, N°5 ̸ Juillet-Août 2015, p. 24)
2Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique [NEPAD], en anglais New Partnership for African Development, plan adopté en octobre 2001 par seize chefs d’État africains avec l’objectif de combler le retard qui sépare l’Afrique des pays développés et de renforcer sa présence et son rôle dans l’économie mondiale. (Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation)
[11]Dagry Macaire, à juste titre, écrit : « La notion de pays émergent ne correspond à aucune définition économique précise, elle correspond plutôt à une notion assez floue qui peut varier d’un auteur à un autre et surtout dans le temps » (www.connectionivoirienne.net)
[12] Contre ceux qui s’ingénieraient à penser que cette autocratie est ontologique, c’est-à-dire imputable à l’être africain, Edem KODJO, l’ancien secrétaire général de l’OUA précise que le système autocratique que nous pouvons constater dans l’Afrique contemporaine est aux antipodes de la gestion traditionnelle du pouvoir politique. Il est plutôt le fait de la traite négrière et surtout des négriers qui utilisèrent cette méthode pour conquérir de petits chefs traditionnels pour leur fournir des esclaves. C’est dans le cadre de ces États que le pouvoir et les systèmes politiques et autocratiques firent leur apparition.
[13] L’idée selon laquelle la politique est l’art de prendre soin de ses concitoyens est clairement exprimée dans Le politique de Platon.
[14] Aussi loin que nous avons cherché, nous n’avons pas trouvé un tel manuel qui, assis sur les traditions philosophiques continentale et analytique, donne des indications claires sur la formation des étudiants et thésards et sur l’apprentissage du métier de philosophe. Les quelques guides à vocation pratique et individuelle qui existent ne permettent pas de combler ce double besoin. C’est le cas du Manuel d’Epictète, rendu par son disciple Arrien de Nicomédie, versions électroniques (ePub, PDF) : Les Echos du Maquis, janvier 2011, 21 pages.
[15] Puisque la dernière actualité montre que la pauvreté est encore la chose du monde la mieux partagée.
[16] Que nous pouvons rendre ici par la personnalité (honnêteté, bonnes mœurs…) du juge traditionnel qui s’implique à fond dans la procédure, là où son collègue ‘’moderne’’ croit ne faire que son travail, sans souci de la corrélation entre la qualité de sa prestation et sa personnalité, en séparant la compétence technique de la moralité : c’est l’anticipation d’une loi comme celle qu’a fini par voter le Parlement français sur la moralisation de la vie publique, visant particulièrement la suppression des emplois familiaux et de la réserve parlementaire, par lesquels les Députés pouvaient embaucher leurs femmes et enfants à l’origine des derniers scandales d’affaires en France.
[17] A ce propos, le lecteur peut consulter Didier Ngalebaye, « Structure et fonction épistémo-éthiques de l’argument persuasif dans le discours de Twere », in Bienvenu Boudimbou (sous la coord.), La parole publique, Brazzaville, Les Editions Hémar, 2016, pp. 103-128.
[18] Nous renvoyons ici le lecteur à notre essai : Didier Ngalebaye, Le projet de philosophie de la rigueur, I, Paris, Publibook, 2016, 358 pages.
[19] « Aie le courage de te servir de ton propre entendement », la devise des Lumières selon Kant.
[20] Les préambules des Déclarations des droits de l’homme de 1789 et de 1948 précisent en ce sens qu’elles ont pour but d’informer les hommes de leurs droits naturels afin qu’ils ne soient plus bafoués ni par autrui, ni par l’État.
[21] Les grandes démocraties que sont les États-Unis, l’Angleterre, la France et l’Allemagne protègent partout les droits de leurs citoyens par les voies diplomatique, judiciaire et même militaire. Ils vont par exemple sortir leurs citoyens des États en conflits armés.
[22] En juillet 2017, l’ONU découvre encore des fosses communes en République démocratique du Congo.
[23] L’Article 3 stipule « le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale ».
[24] Les élections sont quasi-systématiquement contestées dans la partie francophone du continent noir, c’est notamment le cas au Congo-Brazzaville, depuis 2002, au Cameroun, ou encore en Côte – d’Ivoire en 2010.
[25] Le président de la Cours Suprême, le président du Conseil Constitutionnel, les Juges du parquet, le président de la Cours des Comptes sont tous nommés par le Président de la République.
[26] Extrait du Préambule de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 : « Le peuple du Sénégal (…) proclame (…) la volonté du Sénégal d’être un État moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre majorité qui gouverne et opposition démocratique, et un État qui reconnait cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ».
[27] Il est impératif que les députés aient le niveau intellectuel requis pour comprendre les textes qui leur sont soumis et qu’ils comprennent l’enjeu de leur mission. Ceux qui sont proches du pouvoir sont également concernés.
[28] Selon Michael J. GERHARDT, jusqu’à présent, le Congrès a mis en accusation 13 magistrats. Sept ont été condamnés et révoqués de leurs fonctions, quatre ont été acquittés, et deux ont démissionné avant la procédure devant le Sénat (2000, pp. 23-35).
[29] Cette indépendance et impartialité du juge profitable aux citoyens s’est donnée récemment à voir par les décisions judiciaires suspendant l’ordonnance du Président Donald TRUMP interdisant aux ressortissants de certains pays arabes de rentrer sur le territoire américain. Une telle indépendance est inimaginable dans les États africains.
[30] Rebellions, coups d’État, révisions constitutionnelles intéressées ont interrompu les élans du respect de la constitution.
[31] L’accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003 greffé à la constitution ivoirienne de 2002.
[32] La Charte de la transition à Madagascar, août 2009.
[33] Nous avons traité de cette question dans Koffi Eric Inespéré, « opposition politique et droit de révolte chez Kant », Lomé, Échanges, vol. 1, décembre 2O15, pp : 116-137.
[34] Boris cyrulnik, C’est le contexte social qui façonne le sentiment de soi.
[35] Samba Diallo est le personnage principal de l’Aventura ambigüe de Cheikh Amidou KANE.
[36] Dans sa lettre à Jarig Jelles, Spinoza affirme que la différence entre Hobbes et lui est que l’état civil est la continuation de l’état de la nature. Traité politique, lettre 50, p. 283.
[37] Dans le Traité du gouvernement civil, p. 124, la fin de la société civile n’est pas simplement la protection de la sécurité (Hobbes) et de la propriété des biens (Locke), c’est aussi garantir la liberté originaire de l’homme.
[38] Cf. Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 18.
[39] La réflexion seconde transcende la réflexion primaire, focalisée sur les données immédiates. Selon Gabriel Marcel, elle serait une sorte de « chambre froide », un moment de « refaçonnement intérieur ». À ce titre, elle doit favoriser le dépassement, c’est-à-dire une élévation de la conscience à une saisie profonde de la nécessité d’un dynamisme, d’un mouvement spirituel inconditionnel. C’est donc une remise en cause de soi afin de parvenir à une co-naissance ou une re-naissance. Partant de cette exigence, le recueillement permet au sujet de s’ouvrir à l’horizon de la transcendance, ou pour être simple, à la nécessité d’un changement positif et qualitatif.
[40] Dans la philosophie hégélienne, la conscience, dans son parvenir, procède d’un néant d’être avant d’atteindre la conscience de soi et enfin, son effectivité ou l’absolu. C’est à travers ces trois extases que Hegel donne un contenu substantiel au parcours de la conscience phénoménologique. Voir Hegel, « La doctrine de l’être », in Phénoménologie de l’Esprit. Fort de cela, nous pensons que le projet-émergence doit suivre ce parcours.
[41] « Avoir et être : ré-flexion sur le patrimoine matériel et immatériel africain », in Patrimoine culturel africain. Matériau de l’histoire, outil de développement (En cours de parution).
[42] Telle est la vision du monde du mouvement culturel Rastafarisme, qui revendique un devoir de mémoire ou une éthique du devoir de souvenir pour que le sens et la signification fondamentale de l’histoire africaine soit. Cette exigence du Retour, ou encore, ce qui revient au même, ce vouloir d’un enracinement dans notre êtreité africaine, est ici en jeu.
[43] A ce niveau, nous voulons relever le caractère problématique et polémique de valeurs comme l’homosexualité, le mariage pour tous, et bien d’autres en devenir auxquels les africains ne sont pas toujours favorables, mais auxquels les dirigeants acceptent pour des subventions étrangères et l’aide-un poison mortel. Non seulement les valeurs sont en crise, mais les individus aussi.
[44] Être plus spécifiquement d’âge adulte qui dans l’espèce humaine appartient au sexe ou au genre féminin
[45] www.islamfrance.com/femmeislamvsjudeochretien.html, 5 Août 2017 à 14h 42
[46] À l’Église Catholique, seuls les hommes sont ordonnés prêtres et sont habilités à célébrer l’eucharistie. A la limite, les femmes sont constituées en communauté pour les accompagner dans leurs tâches mais ne peuvent pas monter à l’autel pour célébrer l’eucharistie.