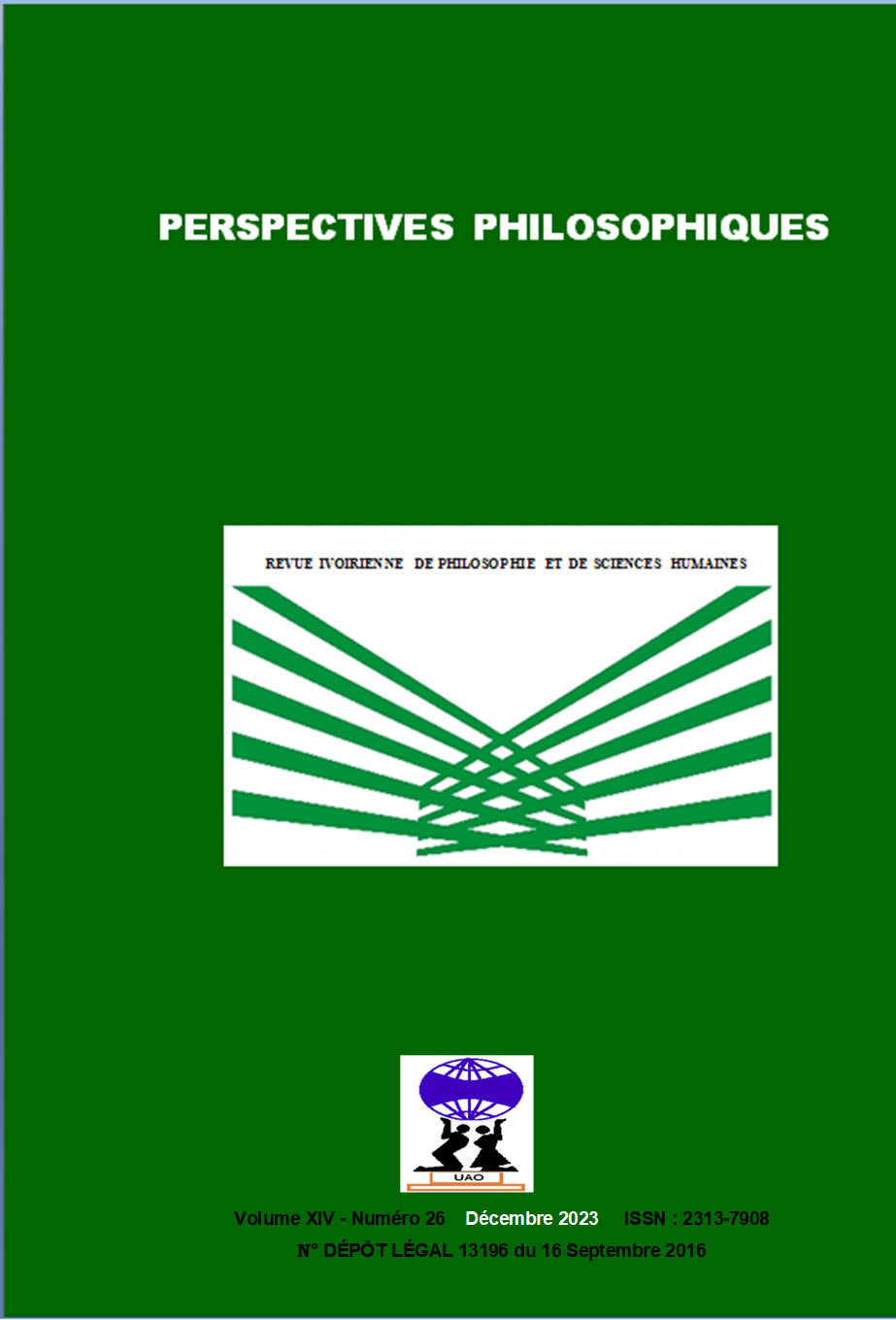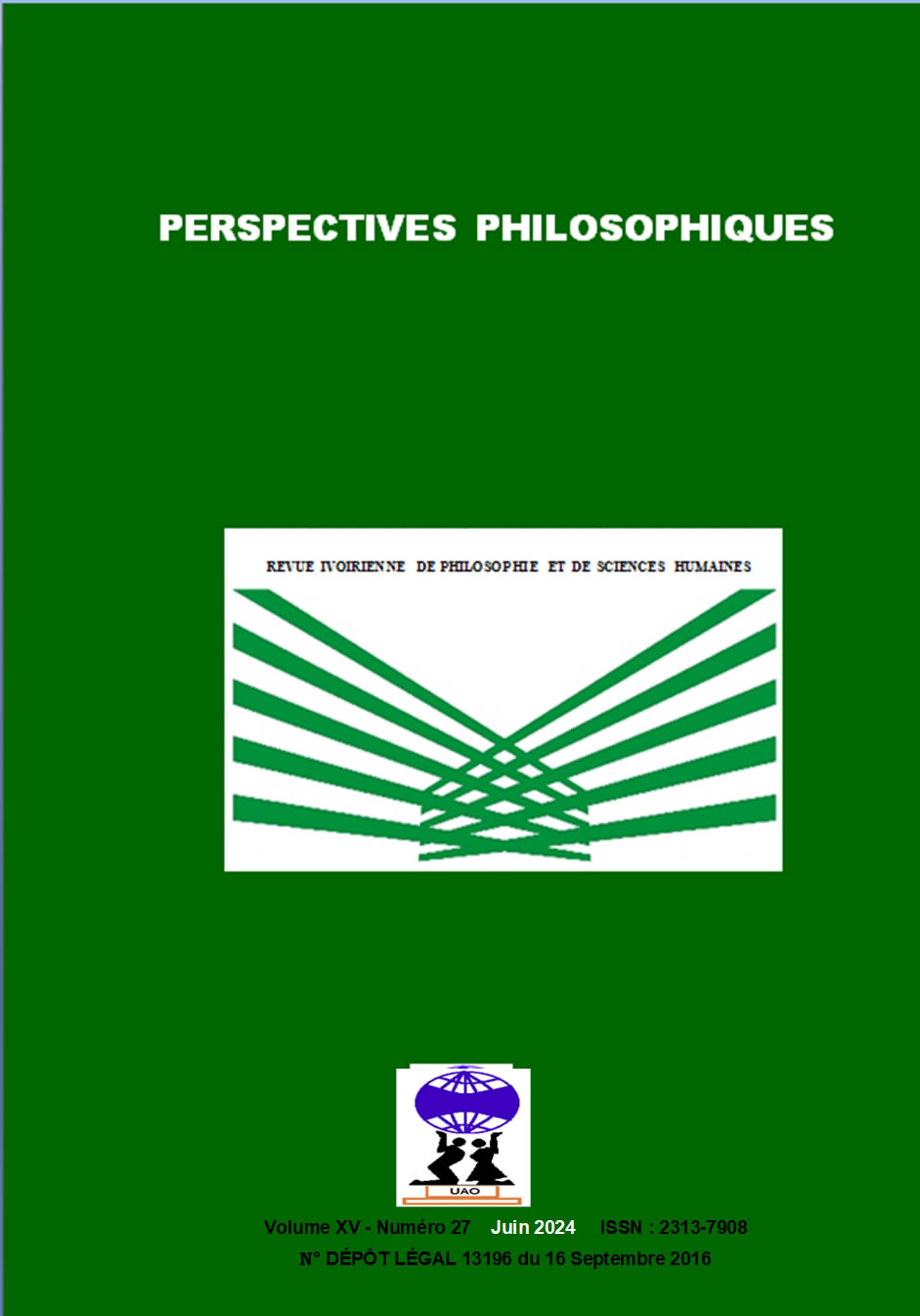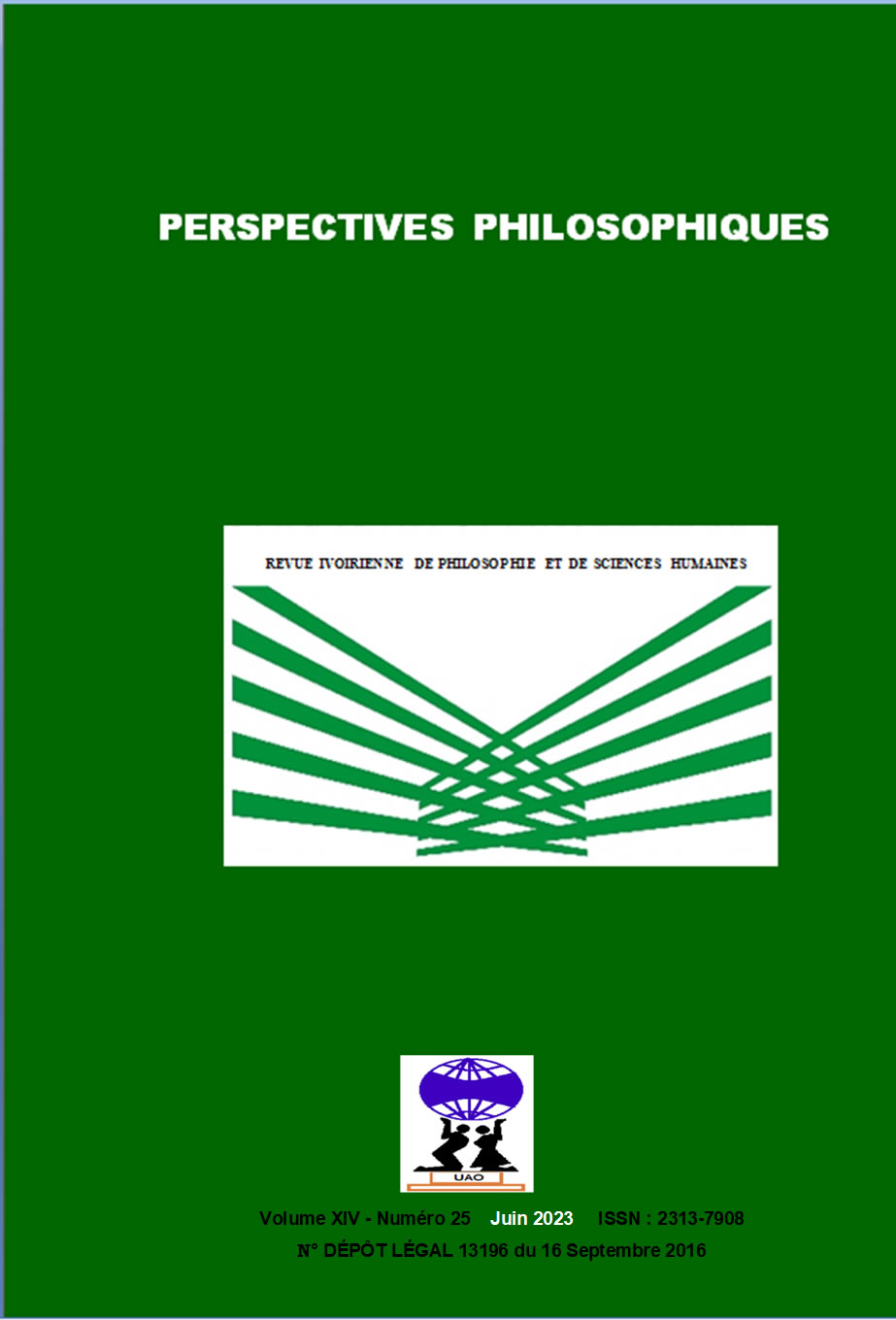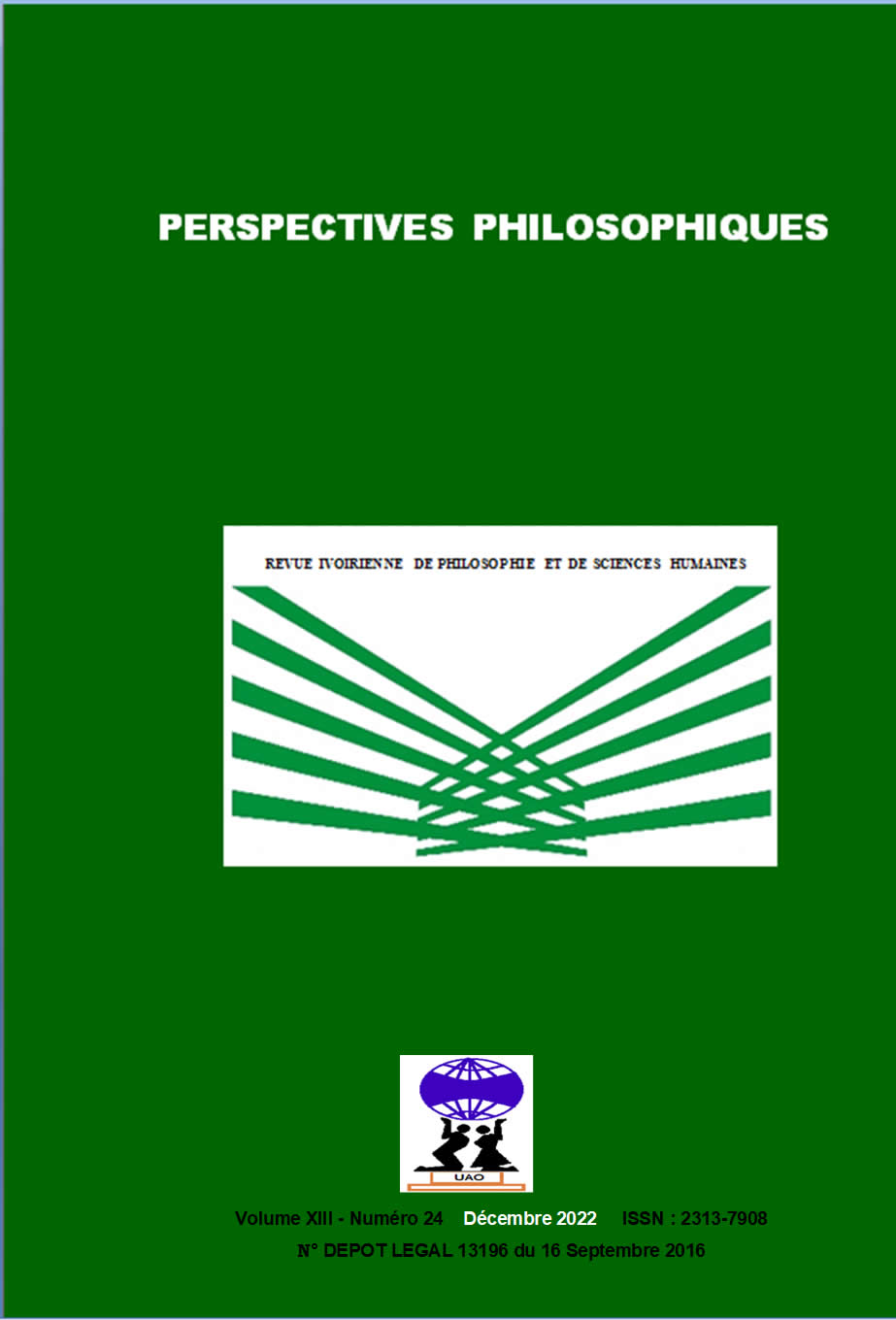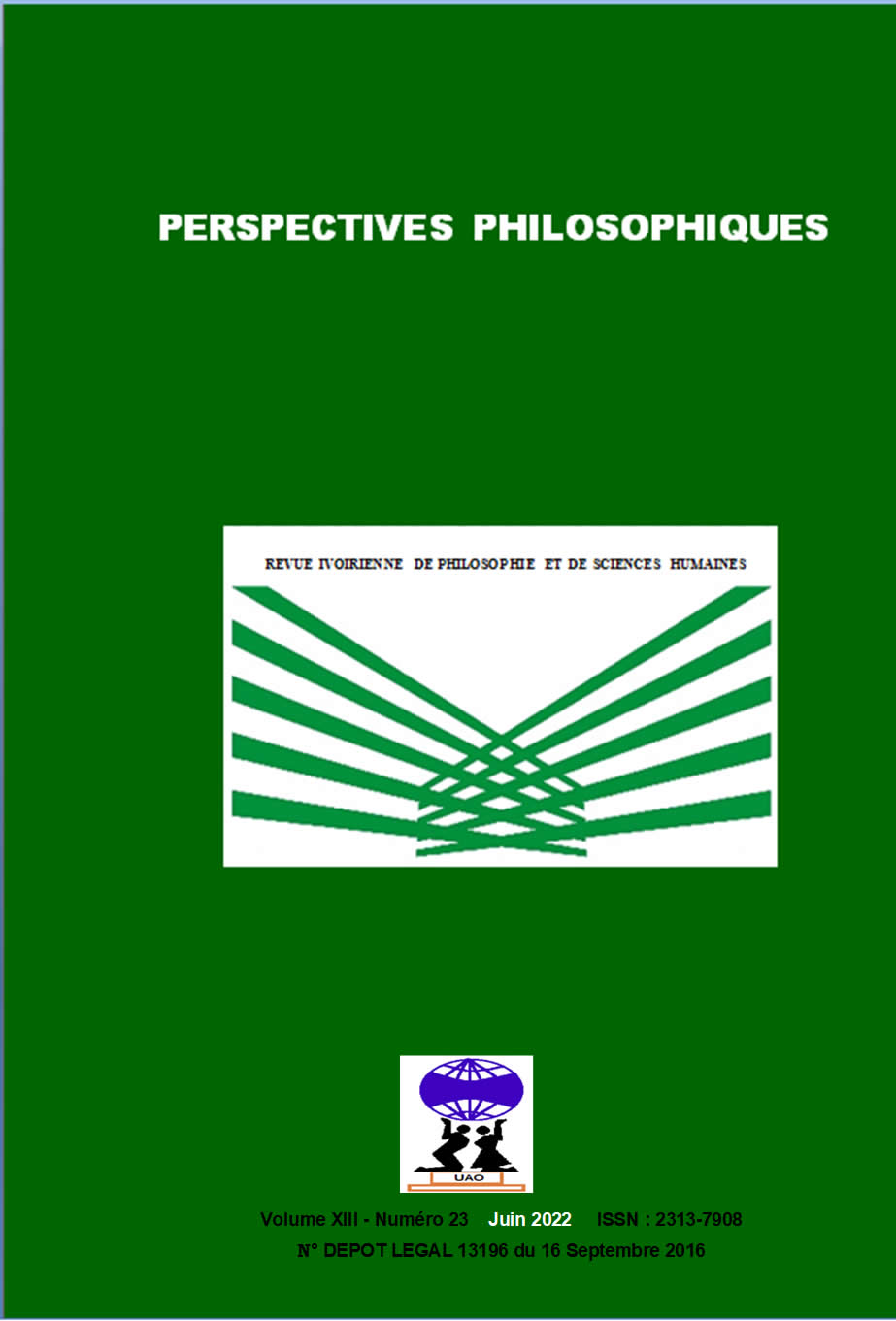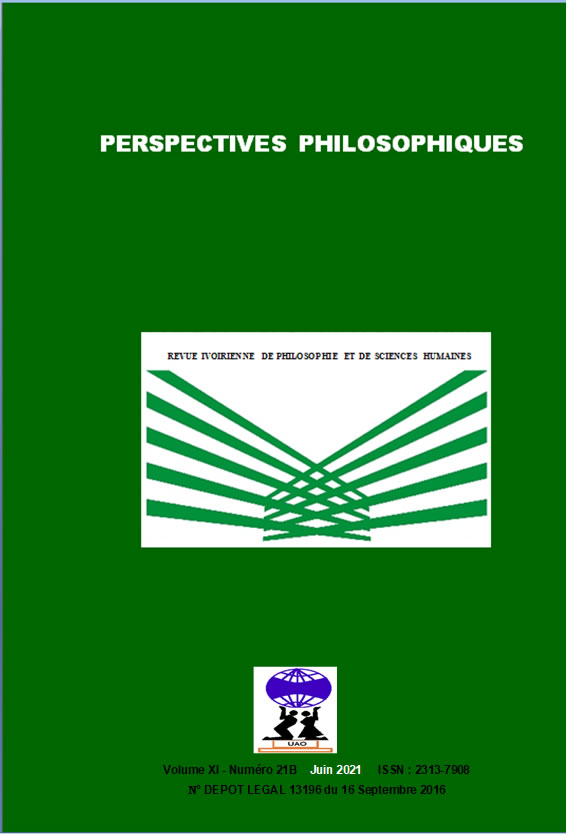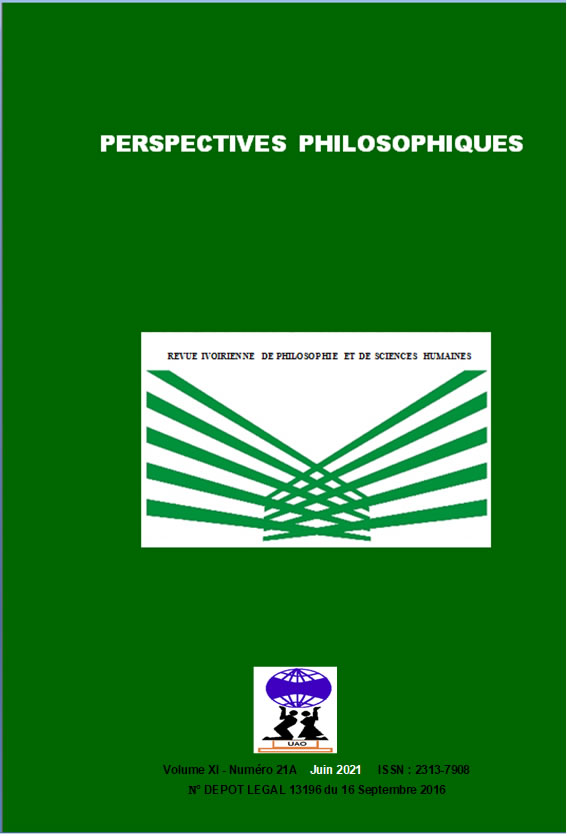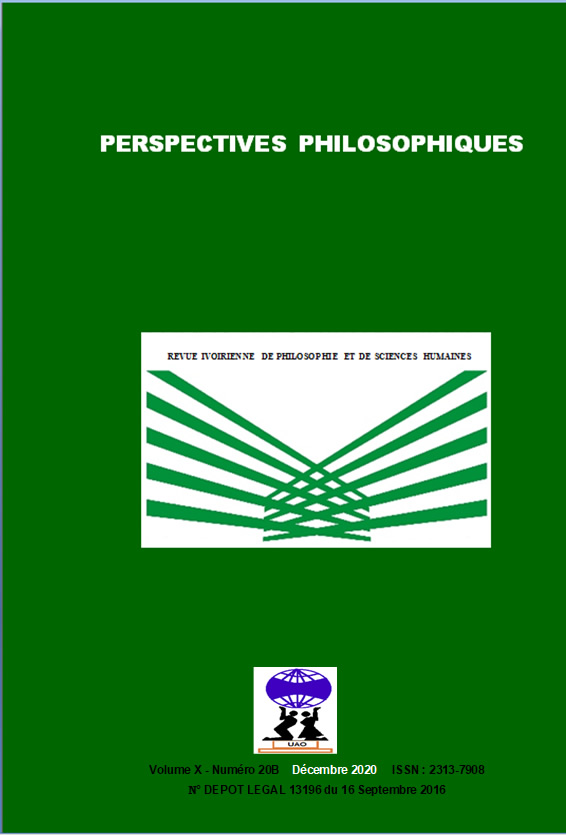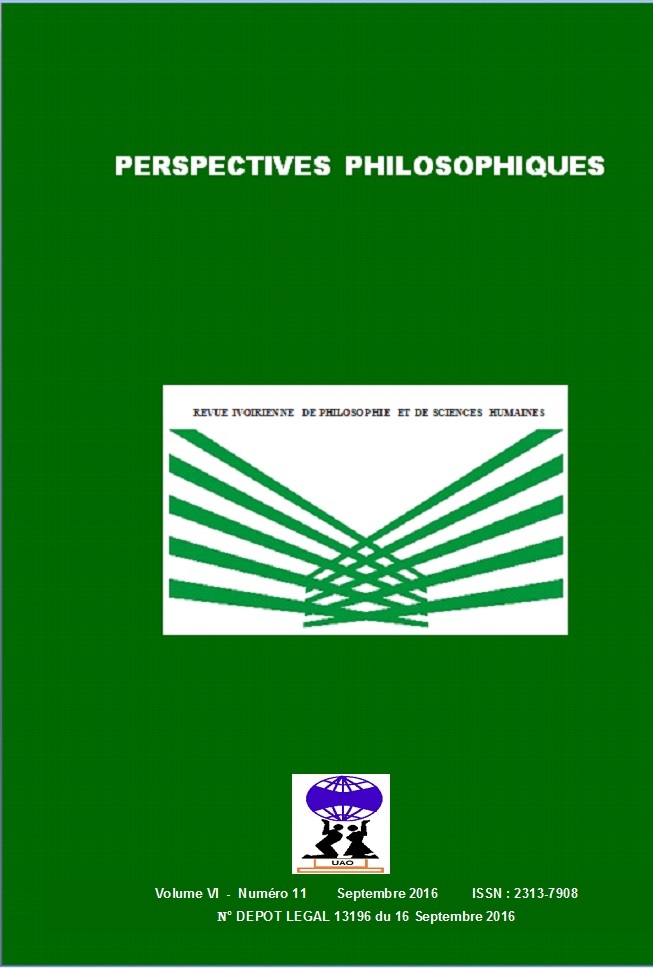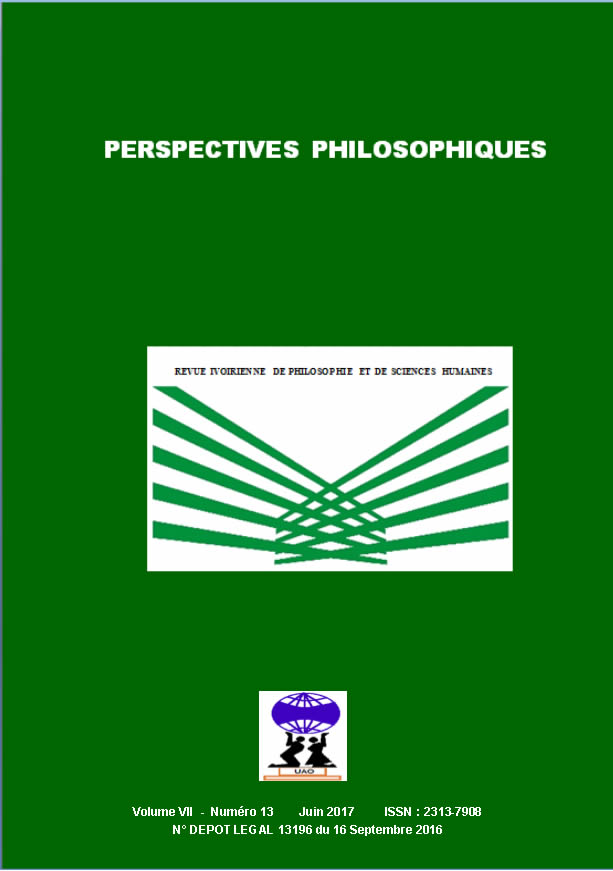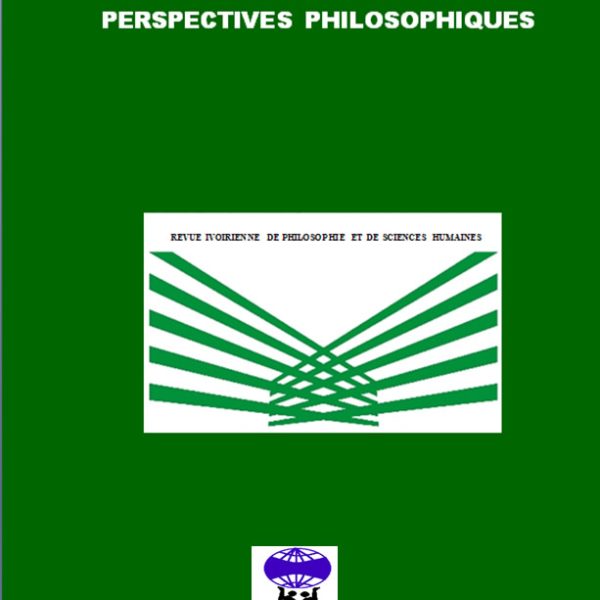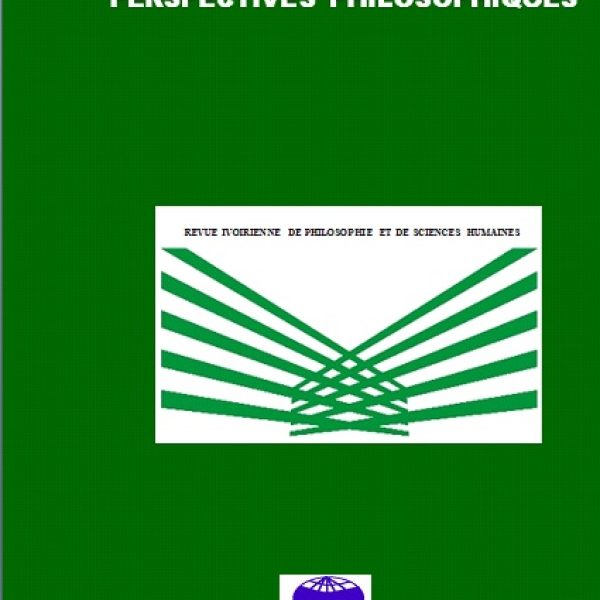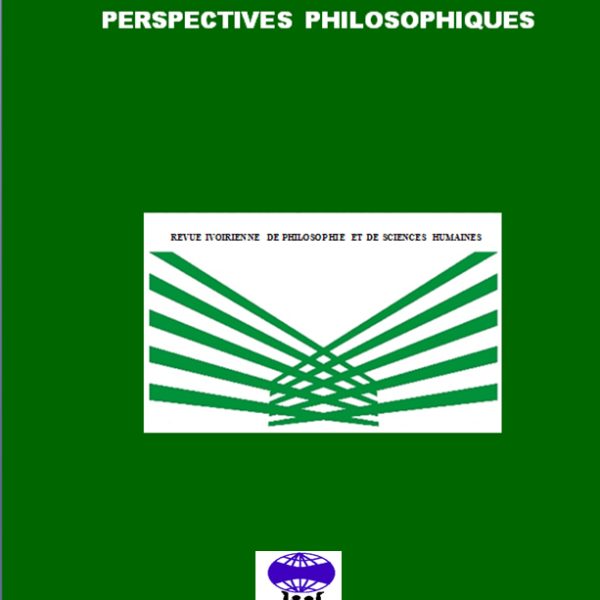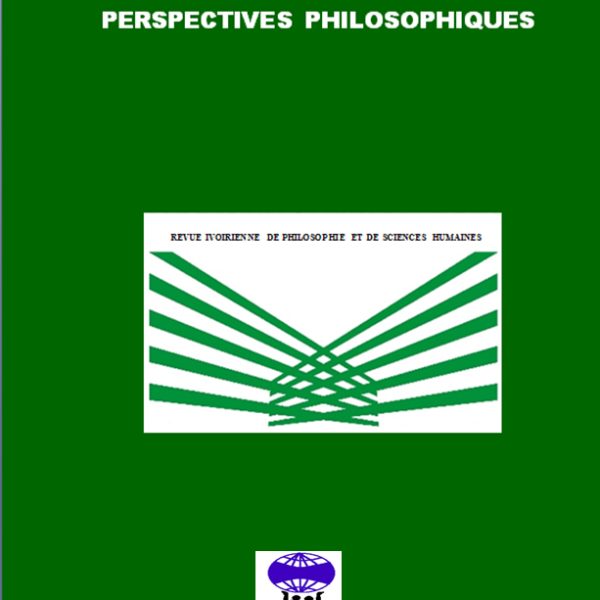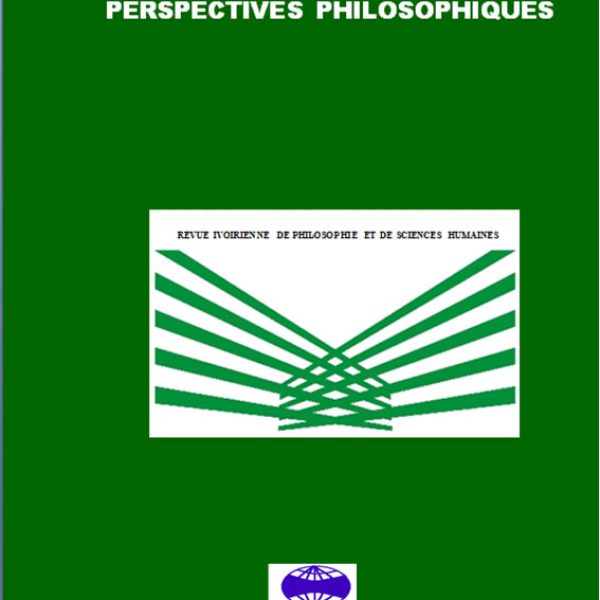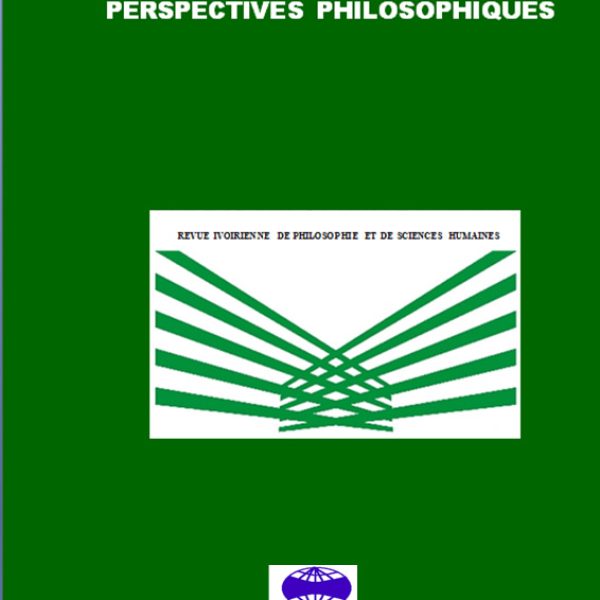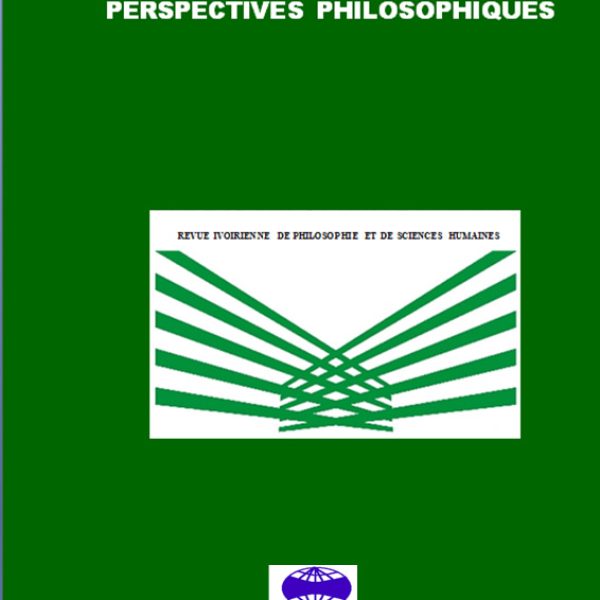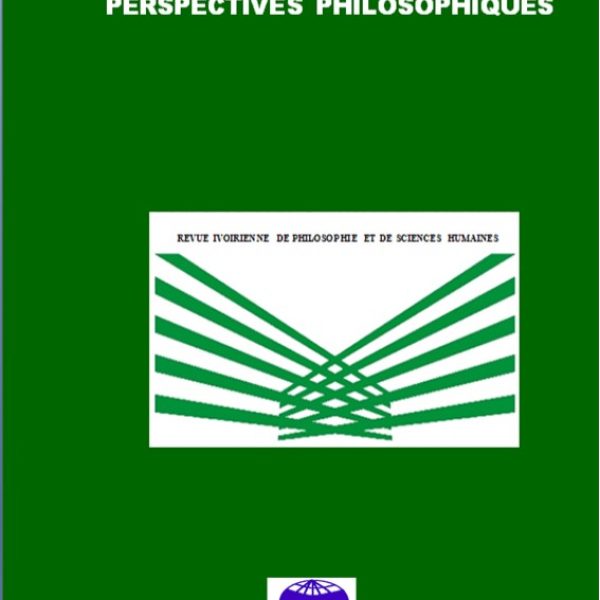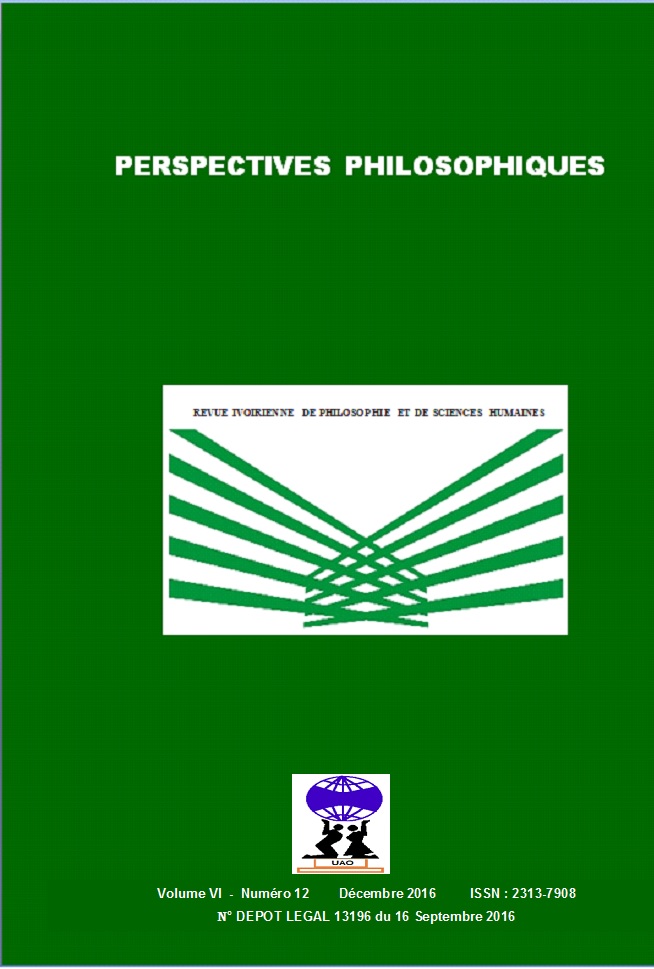
1. L’émergence comme apparaître de l’être, Georges ZONGO…………………………………………………………1
2. Machiavel, thuriféraire de la misogynie ?, Séa Frédéric PLÉHIA…………………………………………17
3. Religion et démocratie chez Leibniz, Mireille Alathé BODO ………………………………………………………………33
4. La philosophie de l’art chez Marcuse : un désengagement engagé, Amara SALIFOU …………………………50
6. La neutralité absolue ivoirienne : une politique contrariée ?, Antoine Sess GNAGNE……………………………88
7. « Amour d’une chaise » et la figure de la métaphore, Pascal Assoa N’GUESSAN……………………………109
8. L’énonciation et la restitution du progressif en français, Ehouman René KOFFI……………………………135
Présentation et Sommaire N°012 > Résumés des articles N°012
| Volume VI – Numéro 12 Décembre 2016 ISSN : 2313-7908N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016 |
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines
Directeur de Publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ
Boîte postale : 01 BP V18 ABIDJAN 01
Tél : (+225) 03 01 08 85
(+225) 03 47 11 75
(+225) 01 83 41 83
E-mail : administration@perspectivesphilosophiques.net
Site internet : http:// perspectivesphilosophiques.net
ISSN : 2313-7908
N° DEPOT LEGAL 13196 du 16 Septembre 2016
ADMINISTRATION DE LA REVUE PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
Directeur de publication : Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités
Rédacteur en chef : Dr. N’dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences
Rédacteur en chef Adjoint : Dr. Assouma BAMBA, Maître de Conférences
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Aka Landry KOMÉNAN, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités, Métaphysique et Éthique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA.
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie ancienne, Université Alassane OUATTARA
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Jean Gobert TANOH, Professeur des Universités, Métaphysique et Théologie, Université Alassane OUATTARA
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Dr. N’Dri Marcel KOUASSI, Maître de Conférences, Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE LECTURE
Prof. Ayénon Ignace YAPI, Professeur des Universités, Histoire et Philosophie des sciences, Université Alassane OUATTARA
Prof. Azoumana OUATTARA, Professeur des Universités, Philosophie politique, Université Alassane OUATTARA
Prof. Catherine COLLOBERT, Professeur des Universités, Philosophie Antique, Université d’Ottawa
Prof. Daniel TANGUAY, Professeur des Universités, Philosophie Politique et Sociale, Université d’Ottawa
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Théorie critique et Philosophie de l’art, Université Alassane OUATTARA
Prof. Henri BAH, Professeur des Universités, Métaphysique et Droits de l’Homme, Université Alassane OUATTARA
Prof. Issiaka-P. Latoundji LALEYE, Professeur des Universités, Épistémologie et Anthropologie, Université Gaston Berger, Sénégal
Prof. Kouassi Edmond YAO, Professeur des Universités, Philosophie politique et sociale, Université Alassane OUATTARA
Prof. Lazare Marcellin POAMÉ, Professeur des Universités, Bioéthique et Éthique des Technologies, Université Alassane OUATTARA
Prof. Mahamadé SAVADOGO, Professeur des universités, Philosophie morale et politique, Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Université de Ouagadougou
Prof. Samba DIAKITÉ, Professeur des Universités, Études africaines, Université Alassane OUATTARA
Prof. Yahot CHRISTOPHE, Professeur des Universités, Métaphysique, Université Alassane OUATTARA
COMITÉ DE RÉDACTION
Dr. Abou SANGARÉ, Maître de Conférence
Dr. Donissongui SORO, Maître de Conférences
Dr Alexis KOFFI KOFFI, Maître-Assistant
Dr. Kouma YOUSSOUF, Maître de Conférences
Dr. Lucien BIAGNÉ, Maître de Conférences
Dr. Nicolas Kolotioloma YEO, Maître-Assistant
Dr. Steven BROU, Maître de Conférences
Secrétaire de rédaction : Dr. Blé Sylvère KOUAHO, Maître de Conférences
Trésorier : Dr. Grégoire TRAORÉ, Maître de Conférences
Responsable de la diffusion : Prof. Antoine KOUAKOU, Professeur des Universités
SOMMAIRE
1. L’émergence comme apparaître de l’être,
Georges ZONGO ………………………………………………………………….…… 1
2. Machiavel, thuriféraire de la misogynie ?,
Séa Frédéric PLÉHIA ………………………………………………………..……… 17
3. Religion et démocratie chez Leibniz,
Mireille Alathé BODO ………………………………………………………….…… 33
4. La philosophie de l’art chez Marcuse : un désengagement engagé, Amara SALIFOU …………………………………………………..……………..……..…50
5. Perception de l’immigration ouest-africaine en milieu rural en Côte d’Ivoire : une menace ou une chance ? ,
Yogblo-Armand GROGUHE …………………………………………….………… 70
6. La neutralité absolue ivoirienne : une politique contrariée ?,
Antoine Sess GNAGNE ………………………………………………..…………… 88
7. « Amour d’une chaise » et la figure de la métaphore,
Pascal Assoa N’GUESSAN ………………………………………………….…… 109
8. L’énonciation et la restitution du progressif en français,
Ehouman René KOFFI …………………………………………………………… 135
9. L’appel de l’altérité dans la construction du vivre-ensemble en Afrique,
Akanis Maxime AKANOKABIA ………………………………………………… 157
LIGNE ÉDITORIALE
L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et inédits.
Le comité de rédaction
L’ÉMERGENCE COMME APPARAÎTRE DE L’ÊTRE
Georges ZONGO
Université Ouaga I Pr Joseph Ki -Zerbo (Burkina Faso)
zongogeorges@yahoo.frr
RÉSUMÉ :
L’émergence est souvent employée pour caractériser l’économie ou la politique d’un pays dont les ressources sont en croissance. Mais cette perception, en elle-même restrictive, est loin d’épuiser le contenu de cette notion qui s’offre à une appréhension plurielle. Émerger suppose, en effet, la manifestation d’un phénomène qui n’était pas perceptible auparavant. Ce qui se manifeste a l’être pour fondement.
Mots clés : Apparaître, Économie, Émergence, Être, Manifestation, Pays, Politique.
ABSTRACT :
Emergence is often used in the economical and political area as the increasing of a country’s resources. But this idea can be a philosophical subject. Emerging means that a new phenomenon appears. This phenomenon appearing lays on the being.
Keywords: To appear, Being, Country, Economy, Emergence, Manifestation, Politics.
INTRODUCTION
Le présent projet de réflexion, suggéré par la question de l’émergence, à partir de sa formulation même, ne se propose pas à être traité sur le plan de la philosophie politique, de façon exclusive. Au contraire, il élargit l’horizon du concept d’émergence pour tenter de l’appréhender sur le terrain de la pensée spéculative. Dans une telle perspective, la notion d’émergence, en tant qu’elle est rapportée à un pays, se présente alors comme une forme déterminée de ce qu’elle se donne à comprendre, le pays lui-même pouvant être considéré comme une certaine apparence de l’être. Cela nous conduit à considérer que ce qui émerge est rendu possible par un fond qui existait d’abord initialement d’une façon latente avant de pouvoir s’extérioriser par la suite, à un moment où les conditions de sa manifestation sont réunies. Dès lors nous pouvons soutenir que toute émergence est émergence de quelque chose de fondamentalement essentiel et qu’elle est, quant à la vérité, une manifestation de l’être. Toutefois les usages actuels de cette notion tendent à la réduire à la question économique et politique. Peut-on s’accorder sur une telle perception et que peut-on envisager comme alternative, en termes de compréhension du concept ? Pour le traitement de ce sujet nous nous proposons de nous interroger d’abord sur le sens et la valeur de l’émergence pour ensuite chercher à comprendre la nature de ce qui émerge en tant qu’il se fonde sur l’être. Cela nous permettra de montrer que l’émergence d’un pays est l’une des formes possibles de sa manifestation.
1. NATURE ET VALEUR DE L’ÉMERGENCE
De nos jours, il est de plus en plus question d’émergence dans les discours politiques, lorsqu’il s’agit de parler de la situation économique de certains pays. Toutefois, l’appréhension de ce concept n’est pas d’emblée donnée. Ernst Cassirer (1972, p.22) faisait justement observer que c’est la raison humaine qui délimite le champ de la connaissance, qui décide de ce qui peut être connu de ce qui ne peut l’être, parce que la source de la connaissance finie « nous est cachée ». Si la conception de ce philosophe est fondée, nous pouvons dire que l’exercice de la raison aura pour but principal de permettre à l’homme d’accéder à la connaissance en s’appliquant à ce qui apparaît, à défaut de pouvoir, dans l’immédiat, remonter à cette source d’abord inapparente. C’est pourquoi, du point de vue philosophique, il importe de circonscrire les contours de la notion d’émergence en faisant apparaître ses différents sens, si l’on veut en parler avec un minimum de précision. Aborder un sujet tel que l’émergence a, en effet, pour but d’examiner et de comprendre ce qu’il veut dire, ses implications et bien sûr sa portée, car si le concept lui-même semble ancien, ses emplois, quant à eux, ont acquis une certaine nouveauté dans les temps actuels. Pour avoir quelques chances de se faire comprendre de l’interlocuteur, si tant est que l’émergence a une importance pour le monde contemporain, et surtout pour les pays africains engagés dans le processus de leur développement, il est indispensable, d’abord et avant tout, de travailler à clarifier la compréhension que nous pouvons en avoir, aussi bien sur le plan individuel que collectif.
Une interrogation portée sur le concept d’émergence nous conduit, dans une approche immédiate visant la saisie du sens, à son étymologie, emergere en latin, qui signifie, ad litteram, ″sortir de l’eau″. Il convient cependant de souligner que le simple fait de sortir de l’eau comme nous enseigne cette radicale latine, ne traduit pas encore, de façon convenable, l’idée d’émerger. En effet, pour expliquer le concept à partir de ce qu’il n’est pas, nous pouvons soutenir que le fait, pour un homme, de sortir de l’eau après y être entré pour se baigner, ne peut pas être considéré comme un fait « émergeant », et de ce point de vue, on ne saurait parler d’émergence d’un baigneur, suite à une séance de nage. Dès lors, nous devons remettre en perspective la question du sens de la notion d’émergence, au-delà de ce que nous enseigne son étymologie. S’il est vrai que l’idée d’émergence est, a priori, liée à une référence à l’eau, ce qu’elle évoque, d’emblée à notre esprit, c’est le fait pour un nageur qui, ayant plongé dans l’eau et après y être resté pendant un moment plus ou moins long, sort doucement et progressivement la tête qui devient de plus en plus perceptible, jusqu’à son apparition totale à l’extérieur. De cette manière, ce à quoi nous renvoie, en premier lieu, dans une compréhension immédiate, la notion d’émerger, est la sortie de la tête hors de l’eau et non le fait de sortir simplement de l’eau. La nuance, ici à prendre en compte, est que, voir apparaître la tête hors de l’eau signifie que le reste du corps y demeure ; ce qui vient dire qu’émerger traduit le déploiement partiel, et non effectif, de quelque chose. Mais cela n’invalide nullement son importance dans la mesure où, une fois la tête hors de l’eau, la respiration devient possible, si bien que l’étouffement susceptible de provoquer la noyade se trouve, du même coup, écartée. Ainsi, émerger, c’est-à-dire « sortir la tête de l’eau » et non simplement « sortir de l’eau » comme le suggère sa signification première, a quelque chose de vital, il est, pour mieux le dire, quelque chose de vital.
Cela est d’autant plus vrai que l’impossibilité de sortir la tête hors de l’eau est mortelle en soi, puisque de là peut survenir l’asphyxie par manque ou par insuffisance d’oxygène. L’émergence indique alors l’apparition, c’est-à-dire plus précisément la monstration (de la tête à la surface de l’eau) qui vient dire la préservation et la persistance de la vie, car il est certain que celui qui est en difficultés, la tête dans l’eau, court le risque de disparaître, c’est-à-dire qu’il s’expose à ne plus pouvoir apparaître comme un vivant existant. Comme le soutient M. Heidegger (1967, p.187), « apparaître est ce qui ouvre l’espace ». En effet, apparaître permet à ce qui apparaît de s’ouvrir à l’espace et de pouvoir ainsi être localisé, situé dans l’horizon du percevoir. Le nageur dont la tête émerge de l’eau peut ainsi se faire secourir en cas de danger, parce qu’on le voit, parce qu’on sait où et dans quelles conditions il se trouve ; cela serait impossible s’il ne pouvait être perçu de l’extérieur.
L’espace est, en effet, l’horizon de la manifestation du Dasein dans la conception de Heidegger. Être veut dire, à proprement parler, avoir une position dans l’espace et dans le temps. Comment, en effet, ce qui apparaît en émergeant à partir de ce qui n’apparaissait pas encore, pourrait-il apparaître s’il n’y avait de l’espace pour le contenir ? Cela revient à dire que l’émergence a un rapport avec l’idée d’espace. Dans un espace donné du monde, quelque chose se montre au dehors comme étant jadis dissimulé ou en gestation, et que l’opportunité des circonstances amène au jour pour être disponible au regard. L’être sort ainsi de soi pour se présenter au monde à travers l’étant, dans la physionomie de l’être-là. Cela revient à dire que c’est par la médiation du Dasein que nous pouvons saisir l’être en ses apparences comme réalité cognoscible. L’apparaître de l’être, en la diversité de ses manifestations extérieures visibles, a pour cadre de référence le monde comme lieu d’existence des étants en tant que modes d’être de l’être. Ainsi, selon M. Heidegger (1967, p.109) « l’essence de l’apparence est l’apparition. Elle est le se-montrer, le se-présenter, l’ad-sister, la pro-jacence ». Un tel ″se-montrer″ et un tel ″se-présenter″ sont rendus possibles par l’horizon à l’intérieur duquel ils se produisent et sans lequel l’apparition de l’apparence n’aurait pas lieu. Pour Heidegger, l’apparaître comporte en soi autant de nécessité que l’être, si bien que les deux doivent être pris dans l’unité. Au fond, pour M. Heidegger (1967, P.110), « l’apparaître n’est pas quelque chose d’accidentel qui parfois rencontre l’être. L’être est comme apparaître ».
Mais dire que l’émergence est liée à l’espace, c’est aussi reconnaître qu’il se rapporte également au temps, de façon essentielle. Émerger dans l’espace c’est aussi prendre position dans le temps. Émerger, c’est se manifester à un moment donné de l’histoire. Cela nous conduit à penser l’émergence comme résultat d’une certaine évolution dans le temps. Avant d’émerger, en effet, ce qui est l’objet d’émergence est en gestation, en préparation de façon active, en attendant le moment opportun pour se laisser voir de l’extérieur. Le phénomène d’émergence est donc d’abord une préparation intérieure, un ″se préparer″ en attendant de se montrer.
On voit, à partir de la conception de l’émergence comme apparaître, qu’elle suppose une réalité première qui est la dissimulation initiale ou, ce qui revient au même, la non-apparence au départ de ce qui apparaît. Ce qui émerge était d’abord caché. C’est justement parce qu’il sort de sa cachette, parce qu’il se libère de ce qui le maintenait hors de la vue que sa survenue se présente comme un moment important. Revoir ce qui s’était retiré du regard et dissiper le doute quant à une éventuelle possibilité de ne plus le revoir, ou de le perdre à jamais de vue, est ce que veut dire l’émergence. En ce sens l’émergence marque la naissance d’un espoir, parce qu’elle signe la reconquête réflexive de ce qu’on souhaitait voir arriver en se réalisant.
Dans la détermination du sens de l’émergence et de sa valeur, nous tombons aussi sur la conception selon laquelle elle signifie la manifestation brusque d’une idée. Or, si l’idée se manifeste chez l’homme, n’est-ce pas parce qu’il est capable de réflexion, n’est-ce pas parce qu’il a d’abord réfléchi ? Si l’on admet l’idée que tout le monde n’est pas savant et qu’il n’existe pas de savant-né, mais que toute science s’acquiert par la médiation d’une recherche préalable, il convient de dire qu’une idée ne peut se montrer soudainement à l’homme qu’après avoir consenti l’effort nécessaire à la pensée, avant toute découverte. L’histoire rapporte qu’Archimède découvrit la loi de la poussée alors qu’il était en train de se baigner, ce qui pourrait nous laisser croire que cette découverte lui est venue à l’esprit de façon subite, comme une révélation indépendante de lui, au moment où il ne s’y attendait pas, comme une apparition à lui donnée par hasard, à un moment il avait interrompu commerce avec ce qui constituait, pour lui, une préoccupation fondamentale, c’est-à-dire à un moment où il n’y réfléchissait pas. Cela expliquerait sa surprise exprimée par l’expression bien connue « Eureka », qui signifie, en Grec, ″j’ai trouvé″. La vérité est que cette loi n’a pas soudainement émergé sans conditions préalables. En effet, l’histoire rapporte aussi qu’il passa beaucoup de temps à chercher à comprendre ce phénomène auparavant, sans succès, et que c’est faute d’obtenir le résultat escompté qu’il avait dû surseoir à sa quête. Cela nous permet alors de soutenir que l’émergence, saisie comme apparaître de l’idée, est précédée par un moment de réflexion, de séjour dans le négatif comme le dirait si bien Hegel. Dans cette perspective, le philosophe de Iéna G. W. F. Hegel (1959, p. 29) avait justement fait observer que « les lois de la nature (…) ne se découvrent que par l’effort de la pensée et ce n’est que la réflexion la plus tardive qui parvient à savoir que ces lois correspondent à l’Idée, ceci est tout juste le contraire du savoir immédiat ». Comme on le voit bien, il n’y a pas de révélation soudaine d’idée lumineuse qui ne soit précédée par une réflexion infructueuse antérieure. Cela nous conduit à la pensée que l’émergence, déterminée comme manifestation subite d’idée, est aussi la révélation d’un travail laborieux sous-jacent, qui en constitue le véritable fondement. Or, le fondement, dans la mesure où il indique l’origine première de tout élan en direction d’un accomplissement attendu, ne repose-t-il pas sur l’être ?
2. L’ÊTRE COMME FONDEMENT DE L’ÉMERGENCE
Émerger a pour signification la sortie du voilement et, par conséquent, la négation de celui-ci. Il désigne, de ce point de vue, l’apparaître, puisque ce qui est dévoilé se prête à la vue et à la compréhension de tous. On peut donc dire que ce qui est dévoilé renvoie à ce qui est manifeste, apparent, et même transparent. Être transparent, en effet, c’est être clair du point de vue du comportement et de l’action, n’avoir rien à dissimuler, c’est-à-dire à voiler. Si émerger veut dire laisser apparaître, ce concept-ci mérite qu’on y réfléchisse. En effet que veut dire apparaître ? En réponse à cette interrogation, on peut dire que c’est révéler extérieurement, montrer par l’apparence. À partir de ce moment, on ne peut échapper à se demander de savoir ce qu’on révèle ou ce qui se montre en apparaissant. Ce qui apparaît, n’est-ce pas l’être ? Nous pouvons dire que ce qui se montre dans l’apparaître, dans la mesure où il extériorise quelque chose, est le signalement de l’être, lequel, étant à l’intérieur ou, mieux, étant à l’intérieur lui-même, ne se laisse pas appréhender à première vue, mais demande, pour être perçu et compris comme tel, la médiation de l’extériorité visible, par laquelle il montre sa présence. L’émergence indique ainsi un moment de l’être, mais l’être existe, avant toute monstration, de façon ontologique. Il convient même de dire que toute monstration est monstration de l’être, non en totalité et en intégralité, mais seulement en partie et temporairement ; et sans l’être, il serait impossible d’envisager l’éventualité d’un se montrer, fût-ce, en tant que monstration partielle.
Heidegger fournit quelques explications entre l’être et l’apparaître, en indiquant la permanence de l’un et l’instabilité de l’autre, ce qui nous conduit, en général, à préférer l’être à l’apparence qui, selon lui, exprime la forme de l’être. En effet, M. Heidegger (1967, p.107) écrit :
Être et apparence, cela veut dire : le réel à la différence de l’irréel et par opposition à lui ; l’authentique opposé à l’inauthentique. Dans cette distinction réside en même temps une appréciation, selon laquelle l’être obtient la préférence (…) Le purement apparent est ce qui émerge parfois, et disparaît de nouveau aussi furtivement et aussi avec peu de persistance, par opposition à l’être conçu comme stable.
Cela nous conduit à penser que l’émergence, au sens de la manifestation, repose sur l’être comme sur le fond qui le soutient et le maintient dans l’existence. Sans l’être en tant que base de l’émergence, toute monstration s’effondre par défaut d’assise. L’émergence, en tant que révélation de l’être, n’est pas la révélation de la totalité qui est absolue. L’absolu, c’est l’être lui-même. Toutefois l’émergence est l’émergence de l’absolu bien que l’absolu se refuse à être saisi en totalité et immédiatement. Pour G.W.F. Hegel (1941, p.25), « ce n’est pas par un coup de pistolet qu’on entre dans l’absolu ». Cela signifie que pour y parvenir, il faut passer par des médiations, surmonter les apparences en ce qu’elles ont de factuel et d’illusoire. En effet, ce qui apparaît ne vaut que dans la mesure où il repose sur l’être en tant que fondement. Schlegel avait, avant Hegel, comme le rapporte C. Berner (2002, p.137) soutenu une idée plus radicale en soutenant que « nous cherchons l’inconditionné mais nous ne trouvons que les choses ». Certes, les choses existantes, en leur variété même, sont des étants particuliers qui, en eux-mêmes, ne sont pas l’absolu, mais seulement ses manifestations, lesquelles montrent que l’absolu est, même s’il n’est pas visible et facile à trouver dans le domaine des réalités sensibles.
Toutefois, les choses peuvent être considérées comme l’émergence de l’absolu, c’est-à-dire la manière de se montrer, son mode d’être. En effet l’absolu est absolu par la médiation de ce qui n’est pas absolu. En ce sens on peut dire que le non-absolu ou, ce qui revient au même, le relatif donne sens à l’absolu. Si nous identifions l’absolu à l’infini comme cela apparaît dans la philosophie hégélienne, on peut dire que la recherche d’une compréhension de l’infini est réalisée par le fini et précisément par le fini humain qui est le foyer de la raison. Le fini est déjà en lui-même, de façon immanente, l’infini émergé. La relation du fini à l’infini est une relation dialectique ; sans l’infini, il serait difficile de penser le fini, mais à rebours, sans le fini pensant, l’infini n’aurait pas sa raison d’être et ne pourrait pas être considéré comme infini. M. Heidegger (1985, p.68) soulignait que « toujours et partout nous pensons l’être, partout où, et chaque fois que, au beau milieu de l’étant, nous nous rapportons à l’étant, nous qui sommes du même coup des étants et nous rapportons ainsi également à nous-mêmes ». Au fond, l’homme est le principal auteur et acteur de l’émergence. C’est par sa pensée, en effet, qu’il émerge lui-même et qu’il rend le concept concevable. Comme le souligne si bien Heidegger, l’homme est le point focal de l’émergence si bien qu’on ne saurait l’ignorer sans remettre en cause toute possibilité d’émergence.
Mais l’homme n’est pas seulement la personne en chair et en os, présente ici et maintenant, il est, à la vérité, l’homme comme concept, c’est-à-dire, l’homme quel qu’il soit et d’où qu’il vienne. C’est donc la valeur de l’homme, en tant qu’il fait l’humanité, qui est ainsi visée comme devant être considéré d’abord et en première instance comme ce qui est à valoriser, et non pas l’ensemble des avoirs qu’il est susceptible d’accumuler. Il n’y a donc pas d’émergence sans homme émergeant, et ce qui importe, c’est son être en tant que pensant. Si l’émergence peut être considérée comme manifestation soudaine de l’idée, celle-ci se rapporte à l’être humain doué de raison et à même d’exercer cette faculté pour examiner et comprendre l’être et l’émergence. G. W. F. Hegel (1989, p. 57) écrivait dans les Principes de la philosophie du droit ceci : « Saisir et comprendre ce qui est, telle est la tâche de la philosophie ; car ce qui est c’est la raison ». Pour Hegel, ce qui apparaît prioritairement, c’est précisément la raison qui, en son universalité même, rend possible toute possible compréhension et en particulier la saisie de l’être. Dès lors nous pouvons affirmer que si l’émergence peut être rapportée à l’homme, c’est la raison elle-même qui émerge dans l’histoire de l’humanité et qui pose l’émergence comme sa propre émergence. En sorte que l’émergence s’affirme comme la manifestation de la raison dans l’histoire à travers les peuples et les pays, chacun se présentant comme sa représentation, en fonction de son évolution et de sa position, dans le temps. En fait, la situation d’émergence est une situation de transition vers une autre situation, différente par rapport à celle précédente Hegel avait indiqué que son temps était celui de la mutation, c’est-à-dire, celui du mouvement qui conduit l’esprit à quitter son état antérieur vers une nouvelle situation qualitativement plus élevée. En effet, G. W. F. Hegel (1941, p. 12) le fait clairement observer en ces termes : « Il n’est pas difficile de voir que notre temps est un temps de gestation et de transition à une nouvelle période ; l’esprit a rompu avec le monde de son être-là et de la représentation qui a duré jusqu’à maintenant ; il est sur le point d’enfouir ce monde dans le passé et il est dans le travail de sa propre transformation. »
À partir de cette conception, nous pouvons dire que l’émergence suppose que l’on quitte un état ancien vers un autre nouveau. En ce sens, elle est une dynamique qui consiste à s’arracher à la situation présente, défavorable à l’existence, et à se mouvoir vers une sphère où les choses auront une valeur supérieure. C’est dans cette direction que le sens de l’émergence nous est rendu lorsqu’il est question de l’émergence d’un pays. Et quelles en sont les implications ?
3. DE L’ÉMERGENCE SAISIE COMME « ÉTAT » D’UN PAYS
Le concept d’émergence, en tant qu’il est employé en rapport avec celui de pays en décrit l’état. Il dit dans quelle situation se trouve le pays en question, comparativement à d’autres. D’une façon plus précise, l’émergence indique l’état d’évolution des conditions économiques d’un État donné. De nos jours, en effet, une distinction est faite entre les pays développés, ceux pauvres et très endettés et entre les deux situations, il y a les pays considérés comme émergeants. Ce que vient révéler l’idée d’un pays se trouvant dans ce contexte, c’est qu’il n’est ni développé ni pauvre, mais qu’il est en passe de “relever la tête”, parce qu’il est en train de sortir de la situation de pauvreté. De ce point de vue, on peut dire que l’émergence exprime une idée très positive puisqu’elle indique la présence du progrès s’effectuant.
L’émergence annonce, si l’évolution se poursuit sans à-coup, des lendemains chantant. En effet, émerger pour un pays donné, n’est-ce pas sortir de l’état de sous-développé dans lequel il était plongé, pour aller vers l’état de pays développé souhaité par tout État caractérisé par la pauvreté et l’endettement chronique, toutes choses qui indiquent la limitation de son indépendance ? Émerger, n’est-ce pas commencer ainsi à s’élever vers le seuil des conditions idéales recherchées, sans y être encore pleinement ? Quoi qu’il en soit, l’émergence révèle que le pays en question est en passe de sortir du lot des pays pauvres. L’émergence suppose, en effet, que le changement qualitatif est possible et même qu’il est en train de s’effectuer in actu. L’émergence, en tant que moment d’évolution d’un pays, indique aussi les apparences extérieures de ce pays ; elle vient dire que le pays est dans un meilleur état comparativement à son état antérieur, autrement dit, il se porte mieux. Se porter mieux veut dire ne plus être malade, même si la pleine santé n’est pas encore établie. L’émergence indique donc le fait d’être mieux, d’être dans une posture acceptable pour un pays considéré comme tel capable de se tenir debout par lui-même et sans aide extérieure.
D’une manière générale, les indices qui indiquent l’émergence, tels qu’ils transparaissent à travers les discours de ceux qui sont spécialistes en matière de détermination des critères d’émergence, et surtout des hommes politiques, sont d’ordre économique. Ils tiennent compte, entre autres, de l’accès des populations à des conditions matérielles de vie plus favorables, ce qui implique l’accès à l’éducation, aux services publics, sans oublier la diminution significative de ceux qui vivent avec moins d’un dollar par jour, surtout pour ce qui concerne les pays africains. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement des spécialistes des questions de développement quelques questions peuvent se poser par rapport à la question de l’émergence. En effet, si l’émergence désigne un certain degré de développement, on peut se demander ce qu’est le développement et si celui-ci peut se limiter à sa détermination exclusivement économique, entendue comme accumulation suffisante de ressources financières. Ensuite, qui en définit les critères et quelle est la pertinence des différents aspects constitutifs de ces critères.
Al Gore (2013, pp. 13-14) identifie six formes d’émergence à prendre en compte si l’on veut œuvrer à la transformation qualitative du monde :
L’émergence d’une économie planétaire (…), l’émergence via un réseau de capteurs intégrés qui couvrent l’ensemble de la planète ,et dont le nombre ne cesse de croître, d’un réseau électronique gigantesque qui permet à des milliards d’individus d’échanger pensées et sentiments et d’avoir accès en temps réel à des données dont le volume prend chaque jour plus d’importance (…), l’émergence d’un nouvel équilibre des pouvoirs politiques, économiques et militaires (…),l’émergence de phénomènes qui se produisent à une vitesse toujours plus grande et insoutenable : la croissance exponentielle de la population qui vit dans des métropoles toujours plus grandes, la consommation effrénée des ressources naturelles (…),l’émergence de techniques scientifiques puissantes et de matériaux révolutionnaires dans le domaine de la biologie, de la biochimie et de la génétique (…) Enfin, l’émergence d’une relation radicalement nouvelle entre la puissance agrégée de la civilisation et les systèmes écologiques les plus fragiles de la planète.
Parmi ces formes d’émergence figure, en bonne position, la question de l’économie. De fait, dans la plupart des discours portant sur cette question, figure toujours, en première ligne, la question de la croissance économique comme critère essentiel et fondamental, susceptible d’impulser le développement des nations. Mais le développement peut-il être envisagé seulement sur le plan exclusif de l’économie, lorsqu’on perd de vue le fait que ce développement émergeant doit servir l’homme et que le bien-être de l’homme est loin de se réduire au « pain qu’il mange » ? Certes on ne saurait méconnaître cette dimension dans la conception et la quête du bonheur de l’homme. Mais Épicure, par exemple, après avoir laissé croire que le bonheur pourrait être assimilé à la satisfaction des passions sensibles, a cependant abouti, de façon contradictoire, qu’« un peu de pain, un peu d’eau, un peu de paille pour dormir suffit à l’homme pour rivaliser de bonheur avec les dieux ». Cela nous conduit à penser que c’est seulement de façon accessoire que l’économie, qui s’occupe des biens matériels et de leur disponibilité pour tous, peut assurer le bien-être recherché par l’homme. C’est pourquoi l’émergence, pour être effective, doit inclure les préoccupations morales de l’homme, c’est-à-dire, au fond, la qualité de la vie qui prend en compte non seulement le confort matériel, mais encore et surtout son épanouissement psychique, c’est–à-dire l’adéquation entre ses attentes, ses avoirs et ses savoirs ; car c’est aussi une forme de pauvreté que de rester dans l’ignorance avec des avoirs suffisants. Le savoir et l’ignorance participent à la détermination de ce qu’est l’homme. Ainsi, émerger pour l’homme dépourvu de savoir, ignorant ses droits et ses devoirs, c’est aussi la possibilité, à lui donnée, de se libérer de cette situation en accédant à la connaissance. C’est pourquoi Joseph Ki–Zerbo avait pensé le développement comme une réalité devant être rapporté au contexte des populations concernées. Pour lui le développement ne doit pas être défini par des critères extérieurs, mais par des critères intérieurs, endogènes qui traduisent les besoins matériels et moraux des populations en situation de développement. C’est dire que, selon lui, l’émergence, considérée comme un moment qui préfigure le développement, doit partir de l’intérieur, sur la base des préoccupations vécues par les populations. Pourtant lorsqu’on parle d’émergence, aujourd’hui, les critères de détermination semblent être exclusivement extérieurs au contexte des populations majoritairement pauvres. Que signifie en effet un indice de croissance supérieur à dix pour une population qui clame, au jour le jour, la douleur de la vie chère ? Qu’apporte l’émergence aux populations africaines, à titre individuel et collectif ? Est-ce un simple discours de politicien, une théorie savante inventée par des économistes pour exprimer l’état de richesse ou de pauvreté des États ? N’y a-t-il pas de contradiction lorsqu’on parle d’émergence, alors que dans les faits et non en théorie, les populations ont du mal à se nourrir, à se soigner, à assurer l’éducation de leurs enfants ? Y a-t-il vraiment émergence lorsque l’être social des hommes ne connaît aucune évolution significative ?
La véritable émergence doit donc prendre en considération ce que l’homme veut vraiment être dans le contexte qui est le sien, c’est-à-dire, ses aspirations profondes, celles dont la réalisation est supposée lui apporter une véritable humanité. L’oubli de l’être de l’homme comme liberté, dignité, altérité est source de différents obstacles susceptibles d’entraver la marche vers le développement intégral en quoi consiste, au fond, l’émergence. L’émergence, entendue comme émergence de l’être de l’homme, peut être envisagée comme émergence du Dasein. Elle prend alors en compte la manière dont le Dasein, en tant que Dasein humain, apparaît dans la banalité quotidienne de son existence. Cela signifie qu’un homme dont la qualité de vie s’est améliorée, ou un homme qui a émergé, si on peut ainsi parler, laisse transparaître les signes du changement qualitatif, non seulement dans ce qu’il a, mais aussi et surtout dans ce qu’il est. Un homme plongé dans les soucis, dans son existence quotidienne, se comporte différemment de celui qui connaît une existence épanouie, c’est-à-dire une existence en marge des nécessités minimales de la vie. Comme le disait Martin Heidegger (1967, p. 108), il y a « une unité cachée de l’être et de l’apparence ». Être pour l’homme, c’est laisser apparaître ce qu’il est : heureux ou malheureux, savant ou ignorant, optimiste ou pessimiste.
Ainsi donc, si un pays émerge, les effets de cette émergence doivent avoir, et ont nécessairement des répercussions sur la vie des hommes qui l’habitent, et cela peut être perçu extérieurement. Il resterait à savoir si l’émergence, telle qu’elle est professée de nos jours par les hommes politiques, s’appuie sur ce que leurs concitoyens sont et ce qu’ils doivent devenir selon une vision ascendante des conditions sociales d’existence, ou si elle a seulement pour objectif de montrer l’apparence d’une certaine gestion politico-économique de l’État sur le plan international ! S’il en est ainsi, la problématique de l’émergence pourrait être simplement un « pis-aller » sans réelle portée pour les peuples des pays concernés, même si elle peut contribuer à donner bonne conscience aux dirigeants des pays concernés. Mais les intérêts des populations ne coïncident pas toujours avec les intérêts de ceux qui les gouvernent. Quand on prend du recul par rapport aux discours officiels, l’émergence peut paraître, dans bien des cas, une théorie politique. Cela n’invalide pas cependant le fait que le concept ait une portée actuelle et qu’il puisse inspirer des réflexions pour en éclairer le sens. D’un tel éclairage, n’apparaît-il pas opportun de questionner radicalement en direction du concept d’Émergence ? Tous les pays, relativement à ce qui précède, ne sont-ils pas engagés dans l’émergence ?
CONCLUSION
Parti de l’approche du concept comme tel, nous avons essayé de montrer en quoi l’émergence repose sur l’être qui en est le fondement. L’émergence est en effet le fait de l’apparition de quelque chose de nouveau qui, depuis longtemps, était en gestation, et qui se révèle à un moment donné de l’histoire. Mais ce qui se manifeste de la sorte, en sa substance même, repose sur quelque chose d’autre que soi, et sans lequel rien ne pourrait se présenter à l’extérieur comme venant de l’intérieur. L’idée d’émergence fait ainsi voir en soi une dynamique, parce qu’elle désigne le mouvement progressif du processus consistant à se hisser d’une étape inférieure à une autre supérieure par la médiation d’une longue et patiente préparation. Nous en sommes arrivés à considérer, à partir du sens de l’idée d’émergence, le discours dominant de notre époque, à savoir que l’émergence situe la position économique d’un pays en progression de ses avoirs. Mais la question essentielle, qui a surgi de cette vision des choses, a été de savoir si on doit considérer seulement l’aspect économique en son essence matérielle, voire matérialiste, dans l’oubli de l’être de l’homme sans lequel il ne saurait y avoir de progrès véritable ! L’homme est une totalité en sa double dimension de corps et d’esprit, si bien que l’oubli de l’être de l’homme, dans la considération de l’émergence, peut conduire à des stagnations voire à des reculs, dans la mesure où le progrès doit avoir l’homme au centre de ses préoccupations ; puisque c’est bien sa cause qu’il doit servir au-delà de la raison économique et du positionnement des politiques sur le plan international. Il est indéniable que le bonheur de l’homme est lié à ses conditions matérielles d’existence, mais il ne saurait cependant se réduire à elles. L’émergence, au fond, c’est l’élévation de l’esprit à la dimension de l’être.
BIBLIOGRAPHIE
CASSIRER Ernst, 1972 Martin Heidegger. Débat sur le kantisme et la philosophie, Paris, Beauchesne.
GORE Al, (2013) Le futur : six logiciel pour changer le monde, trad. Nadine Millanvoye et al., Paris, La Martinière.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1941, La phénoménologie de l’esprit, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1989, Principes de la philosophie du droit, trad. Robert Dérathé, Paris Vrin.
HEIDEGGER Martin, 1985, Concepts fondamentaux, trad. Pascal David, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et temps, trad. François Vézin, éd. Gallimard, 1986.
HEIDEGGER Martin, 1967, Introduction à la métaphysique, trad. Gilbert Kahn, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1985, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, trad. Jean – François Courtine, Paris, Gallimard.
MACHIAVEL, THURIFÉRAIRE DE LA MISOGYNIE ?
Séa Frédéric PLÉHIA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
plehiaseafrederic@ymail.com / sfplehia@gmail.com
RÉSUMÉ :
La pensée féministe impulsée par les laudateurs de la démocratie moderne a eu coutume de présenter Machiavel comme un misogyne conservateur dont il ne serait bon de s’accommoder. Mais pour qui sait lire le Florentin sensatamente[1], son originalité, nonobstant la sévérité du procès des féministes, consiste à ne jamais se montrer complaisant face à la prolifération des pires maux qui empestent la gent féminine ; quoique cela puisse lui coûter en réputation.
Mots-clés : Féminisme, genre, gouvernance, machisme, misogyne, phallocratie, virtù.
ABSTRACT :
The feminist thought driven by the admirers of modern democracy was usually presented as a conservative Machiavelli misogynist which it would be good to live with. But for those who can read the Florentine sensatamente, its originality, notwithstanding the severity of the feminist trial consist to never be complacent about the proliferation of the worst evils that stink the fairer sex, though it may cost him his reputation.
Key words : Feminism, gender, governance, macho, misogynist, male chauvinism – virtù.
INTRODUCTION
Ce qui fait tant le charme attaché à la modernité politique, c’est que son champ d’investigation reste dominé par un certain privilège déféré aux domaines du genre, des Droits alloués aux femmes et aux enfants, et de l’égalité de tous les citoyens.
H. Arendt (1995, p. 111) qui s’inscrit dans cette dynamique en rapport avec l’égalisation des conditions, pense que, ces discussions sur la discrimination positive trouvent leur achoppement autour de la préséance accordée à la féminité d’autant que
l’époque moderne se distingue de façon décisive des époques précédentes, non pas tant par ses aspects politiques que par ses aspects spirituels ou matériels. Le seul fait que l’on ait émancipé les femmes (…) confère un visage radicalement nouveau à toutes les questions politiques.
Cet état de fait a suffi à répertorier des penseurs indexés comme ayant joué un rôle néfaste, s’agissant de la promotion des femmes. Ceci expliquerait que N. Machiavel ait notamment été exhumé des abîmes de l’histoire pour être exhibé comme un antiféministe avéré. Ce préjugé défavorable le concernant apparaît-il justifié ? Si oui, quels seraient les éléments d’analyse de l’œuvre du Florentin qui militeraient en faveur de cette grille de lecture ? Si non, pourquoi cet acharnement immodéré contre celui qu’on aurait pu considérer à bien d’autres égards comme le digne représentant d’une égérie féministe avant l’heure ?
Aussi, pour répondre à cette problématique d’ensemble, tenterons-nous de réinvestir l’histoire de l’Humanité pour dévoiler les esquisses d’image qu’on s’est depuis toujours fait de la femme. C’est sûrement au regard de ces jugements, qu’on serait mieux outillé pour nous prononcer sur la véritable position de Machiavel.
1. JUGEMENTS CONTRADICTOIRES DE L’HISTOIRE SUR LA FEMME
Si le contexte politique de nos jours reste très favorable à l’émancipation sociopolitique de la femme, ceci n’a pas toujours été la règle. Dans la quasi-totalité des cultures, la femme est tantôt dénigrée, tantôt vilipendée pour ce qu’elle représenterait la face immonde de l’être par lequel la calamité a fait une brutale irruption dans le monde. La mythologie grecque inspirée d’Hésiode rapporte, selon E. Hamilton (1995, p. 78) que, pour se venger des hommes qui firent outrage aux dieux, Zeus leur envoya Pandore « qui devrait être une calamité pour l’homme, une créature douce et ravissante ayant l’apparence d’une vierge timide, (…). De cette première naquit l’espèce féminine, quiest néfaste à l’homme et dont la nature est portée au mal ».
À quelques analogies près, on retrouve cette interprétation méprisable de la femme à travers la malédiction que le Yahvé hébraïque va infliger à la femme pour avoir abusé l’homme, à travers l’acte de procréation/châtiment que décrit remarquablement R. Dadoun (1993, p. 11) en ces termes : « Dans le corps de la femme, dans son corps profond, procréateur, dans son corps d’humanité s’inscrit désormais, comme pour l’éternité, la terreur d’être ».
Quand bien même ces approches infamantes héritées de ces vieilles légendes aient fait recette auprès de la tradition romaine, cette dernière s’est efforcée d’édifier de la femme une image fort méliorative. En témoigne que Musonius Rufus, conseiller de l’Empereur Titus, « préconise d’étendre aux femmes les bienfaits de l’enseignement philosophique » (L. Jerphagnon, 2008, p. 323) et de la gouvernance.
Comme tel, nous exposerons d’abord le sombre tableau d’une civilisation humaine très machiste avant de finir par montrer que dans cette grisaille, heureusement d’ailleurs, des traditions religieuses se sont évertuées à accorder à la femme une place de rêve qui contraste beaucoup avec l’élan phallocratique un peu partout perceptible.
1.1. Incursion dans les vestiges d’une civilisation humaine dominée par la misogynie
Reprenant à leur guise les vilains clichés véhiculés par les plus vieilles traditions, les philosophies antiques vont durablement s’installer dans des schèmes qui voient en la femme une créature inapte à la gouvernance politique. Le très respectable Platon (456-a, 1966, p. 210) n’échappe guère à cette tare, lui qui dit qu’elle demeure malhabile pour la gestion des affaires publiques : « (…) la femme et l’homme ont même nature sous le rapport de leur aptitude à garder la cité, réserve faite que la femme est plus faible et l’homme plus fort ».
Tout en ne lui reconnaissant aucune incompétence intrinsèque, Aristote reste tout au moins convaincu que la femme aussi bien que l’homme peuvent exercer toutes les fonctions, sauf qu’elle doit jouer dans l’administration de la cité un rôle subalterne. En inférant ainsi une discrimination de degré et non de nature relative à l’aptitude des femmes à gouverner, il pense, à rebours de Platon, que la nature disposant les talents et les aptitudes physiques selon un ordre rigide, a conçu le mâle fort pour en faire le protecteur de la femelle. Aussi, s’inspirant de la thèse de lavertu de subordination, le Stagirite peut-il énoncer : « L’homme libre commande à l’esclave, [tout comme] l’homme à la femme ». (Aristote, 1260-a, 1990, p. 131). Son infériorité naturelle faisant, elle ne peut en aucune façon prétendre au commandement.
Pire, Épictète pense que pour une véritable harmonie dans le couple, il faut concevoir la femme comme une masse de chair destinée à assouvir la libido[2] du chef de famille. Il en vient même à établir, d’après ce qu’écrit justement P. Brown (1999, p. 54) que, « l’adultère est un vol : enlever la femme de son prochain est aussi indélicat que puiser à table dans la portion de porc servie à son voisin ». Au fond, il faut reconnaître que ces philosophes classiques sont tous tributaires d’une vieille idéologie qui a de tout temps considéré la femme comme la vulgaire gouvernante de maison.
Plus près de nous, Nietzsche va s’inspirer de cette lecture dévalorisante de la femme pour en ébaucher une philosophie toute austère à sa mesure. Avec lui, la différence psychosomatique entre l’homme et la femme étant très marquée, « il faut que l’homme soit éduqué pour la guerre et la femme pour le repos du guerrier ». (F. Nietzsche, 1974, p. 88). Au regard de cette verve typique à lui, l’homme devrait être affecté aux rudes activités, et la femme, lui servir de simple instrument de relaxation comme le bouffon l’est pour l’agrément du roi. Vouloir niveler toute chose, sans s’en tenir à ce que la nature propose comme discrimination, comme loi implacable et irréversible, c’est tenter vainement de vouloir faire advenir les choses contre-nature. Et ce serait là la pire méprise dont la modernité politique se rend depuis lors coupable. Pour J.-H. Koffi (2005, n°36, p. 35), « la grande faute de la société moderne, c’est d’avoir substitué au naturel déploiement de la vie et de la force la recherche artificielle et vaine de la justice pour tous ». Les revendications liées à l’égalité des droits et devoirs des citoyens relèvent d’un charabia inaudible étant donné que des êtres inégalement dotés ne sauraient aspirer aux mêmes prérogatives.
Du fait même de la diversité des genres, il est quasi impossible de vouloir accéder à l’uniformité étant entendu que « la variété, c’est la vie ; l’uniformité, c’est la mort ». (B. Constant, 1997, p. 168). Il faut adhérer aux thèses qui font l’apologie de l’affrontement permanent des sexes d’autant plus que la proie du sexe fort, reste pour longtemps encore le sexe faible. L’homme et la femme ne peuvent jouir du même privilège. À ce titre, il faut, selon le mot de F. Nietzsche (1990, p. 139), « ne jamais égaliser ce qui est inégal » par nature, sinon on ferrait le lit des revendications sociales les plus insensées. Ce qui paraît plus plausible, en regard des dons assignés à chaque être, c’est que « les hommes ne sont égaux ni en droit ni en quoi que ce soit ; ce principe, la nature l’a inscrit en l’humanité, l’ordre des choses et de la vie l’atteste continuellement. Ils ne sauraient donc en toute justice prétendre à des droits égaux ». (J.-H. Koffi, 2005, n°36, p. 35). De cette réflexion menée par Nietzsche (1990, p. 81), il s’ensuit que « l’injustice n’est jamais dans l’inégalité des droits, elle est dans la prétention à des droits égaux ». Ainsi, toute idée de nivellement des hommes opérée par le libéralisme démocratique apparaît-elle contre-nature. Il est dans l’ordre non-corrompu de la nature des choses qu’il se perpétue un abîme profond entre les hommes. Enfin de compte, c’est à son aise que J.-H. Koffi (2005, n°36, p. 40) peut déduire fermement : « Le statut convenant à la femme reste la servitude, volontaire ou non. (…) la femme n’est pas l’égale de l’homme, quoi qu’en dise la modernité » et ses affidés.
S’il appert, au regard du développement qui vient d’être esquissé, que la femme jouit d’une réputation désastreuse pour ce qui est de lui confier les rênes de la Cité, il est tout aussi vrai qu’auprès d’autres traditions, notamment religieuses, elle incarne l’image de la créature par laquelle l’humanité se réconcilie avec les valeurs de bonté et de paix.
1.2. L’exception des traditions religieuses
Longtemps réduites à mener des conditions de vie des plus exsangues, les femmes vont connaître avec le judaïsme un véritable regain d’intérêt. Certes, les traces de la femme maléfique y restent visibles par endroit, mais un effort très important y est entrepris pour changer substantiellement sa condition d’existence ou du moins pour édulcorer son image.
Cette approche fort enrichissante nous est fournie par le Talmud dont Emmanuel Lévinas reste un exégète de première main. À travers la philosophie du visage qu’il développe, il confère à la femme un rôle enviable au sein du tissu familial. « La Maison, c’est la femme, nous dira le Talmud ». (E. Lévinas, 1963, p. 53). Le domicile dont il ébauche la structure architecturale en apparence autour de l’homme, a pour épine dorsale la femme. La compagne de l’homme ne végète plus dans cette société qui ne lui reconnaît qu’un rôle mineur, sa responsabilité s’en trouve désormais décuplée. Le logis, écrit à ce propos J. Madore (2001, p. 95, consulté le 25/03/2016), « (…) n’est un refuge, un havre de paix, que parce qu’il est accueillant. L’accueil du domicile suppose que quelqu’un l’habite. Quelqu’un l’habite avant même que le sujet ne s’y installe ». Tout le mérite qui revient à Lévinas, c’est d’avoir fait une interprétation judicieuse de ces premiers écrits qui affirment clairement que le domicile suppose la présence précieuse de la femme. Par-delà, il y a comme un grave discrédit dont se pare l’habitat où la femme n’est pas présente : la famille bénéficie à coup sûr de son apport appréciable et incommensurable. La véritable harmonie domestique est marquée de son sceau et de son hospitalité légendaire. C’est elle qui veille au scrupule dont la maison se pare et qui en préserve sa dignité. Mieux, elle assure la saine collaboration avec les autres familles. Bref, le charme dont elle reste la dépositaire légitime constitue le véritable creuset du foyer.
Au demeurant, il faut préciser que Lévinas n’imagine pas que, c’est seulement au foyer que les femmes doivent être encastrées, et se contenter d’agir en appoint de leurs époux occupés par les affaires publiques et « (…)qu’elles ne peuvent pas non plus participer à la vie politique de leur pays. (…) La distinction entre les sexes ne peut être qu’accessoire en regard de cette tâche discrète mais primordiale » (J. Madore (2001, p. 97, consulté le 25/03/2016) qu’elles exercent avec brio. S’en tenir à la superficialité du discours lévinassien pour faire de ce moraliste pieux un tenant moderne des thèses machistes, c’est ne pas faire l’effort de saisir la substance de sa pensée qui voudrait au mieux redorer le blason terni de la femme.
Se référant aussi à la tradition biblique, Lévinas rapporte tout aussi que
le monde où se déroulent ces événements (bibliques) n’aurait pas été structuré comme il fut sans la présence secrète, à la limite de l’évanescence, de ces mères, de ces épouses et de ces filles, sans leurs pas silencieux dans les profondeurs et les épaisseurs du réel, dessinant la dimension même de l’intériorité et rendant précisément habitable lemonde. (E. Lévinas, 1963, p. 53)
Les hommes accoutumés au discours viril apparaissent en toile de fond comme les premiers responsables de toutes les déchirures sociales. Pour des passions futiles en effet, ils exposent la vie de tous au danger permanent. Grâce aux femmes, le monde connaît un peu de répit.
Le féminin incarné dans l’hospitalité domiciliaire, confère à la société une certaine bouffée d’oxygène, fut-elle sous les apparences d’un mirage de paix. Alors, par chacun de nous doit être magnifié l’apport indéniable de la femme à la paix dans le monde parce que, tout en se mettant au service d’autrui, la femme contribue à apaiser les relations humaines les plus délétères. A contrario, la virilité masculine égocentrique et futile doit être réfrénée. Pire, en s’enfermant dans les limites de son intériorité, l’autorité du mâle nous livre à l’éternel ennui et à la peur de l’imprévisible qui décuplent notre angoisse existentielle.
En rapport avec ces lectures qui viennent d’être faites, où classer N. Machiavel ? Peut-on prêter foi aux critiques qui l’accusent d’être antiféministe ? Est-il un misogyne attardé ou un précurseur de la pensée pionnière sur le genre ?
2. L’EXÉGÈSE DE L’APPROCHE MACHIAVÉLIENNE DE LA FEMME
Que n’entend-on pas deviser sur Machiavel au sujet d’une certaine aversion qu’il nourrirait à l’égard des femmes ! Lesquels reproches amers peuvent se légitimer si on s’en tient à un certain nombre de ses écrits. À le lire de façon subtile,il se profile chez lui une propension à clouer au pilori avec délectation les tares des femmes. Tantôt imprévisibles, tantôt versatiles, voire libérales et parfois parcimonieuses, il éprouve beaucoup de peine à les comprendre dans leur nature intime.
Les moqueries sociales dont le Florentin est coutumier, dépeignent les femmes sous des procès dont la sévérité peut choquer les consciences prudes. N. Machiavel (2005, p. 213) qui adhère à ces opinions, met ces paroles vexantes dans la bouche de Frère Timoteo : « (…) les femmes ont peu de cervelle. S’il s’en trouve une qui sache dire deux paroles, on la cite comme un prodige ». Ces seuls propos ont suffi à le faire passer pour mauvais juge des femmes.
Paradoxalement, ce même N. Machiavel n’est pas non plus avare en compliments en l’honneur de la femme. Il se découvre même une âme de poète dans Sérénade pour la célébrer : « Salut, ô dame choisie entre toutes les dames, modèle sur cette terre de toutes les beautés ! Unique Phénix, âme parfaite, toi qui renfermes toutes les perfections». (N. Machiavel, 2005, p. 210). Dans cette perspective très accommodante, il réalise à sa mesure, dans Clizia, une peinture plus enviable. Contre les sempiternelles orgies sexuelles des hommes, il dresse le portrait sélect d’une dame, personnage éponyme, à qui les scrupules interdisent de se livrer en pâture aux hommes libidineux.
Ce contraste apparent qui vient d’être exposé dans ce diptyque nous fonde à réinvestir l’ensemble des écrits du Florentin pour bien juger de sa véritable position sur les femmes. Aussi, commencerons-nous dans une première analyse par montrer les faits qui attestent de sa virulence à leur égard pour terminer par révéler que, derrière ses écrits qu’on pourrait qualifier d’antiféministes, se dresse de toute sa stature un philosophe politique qui pense en son for intérieur que la femme n’est pas à négliger d’autant qu’elle jouit aussi d’une réputation exemplaire en matière de gouvernance.
2.1. Machiavel, juge austère de la gent féminine
Au nombre des griefs qui font passer le Florentin pour trop amer avec les femmes, se profile en bonne place sa répulsion pour le mariage en tant qu’institution liberticide dont pâtirait l’homme. Le pensant, ne se prend-il pas pour le digne descendant de ses aïeuls Romains qui affichaient leur préférence pour la pédérastie au motif que l’amour d’une femme finit toujours par “esclavagiser” l’homme ? À en croire l’idéologie domestique dominante de cette époque, se lier d’amitié à une femme, exposerait à toute sorte d’ennuis. Voici ce qu’en dit P. Veyne : « Aussi répétait-on proverbialement que les garçons procurent un plaisir tranquille qui n’ébranle pas l’âme, alors que la passion pour une femme plonge l’homme libre en un esclavage douloureux ». (P. Ariès et G. Duby (dir.), 1999, p. 189).
La liaison féminine serait donc mal vue par les Latins qui supportaient difficilement d’être martyrisés par leurs compagnes. Il est vrai que la règle matrimoniale en vigueur à cette époque était la relation de l’homme à la femme, mais officieusement, le goût pour la pédérastie était partout affiché. Au pire des cas, la tendance exhortait à la fréquentation des maisons closes, en quête de femmes dont la discrétion et la disponibilité étaient acquises sans contrepartie contraignante. « L’amour ? Mieux vaut, (…) aller au bordel pour une heure que de soupirer des jours et des mois pour les beaux yeux d’un unique amour d’où viendront plus de souffrance, finalement, que de paix ». (L. Jerphagnon, 2008, p. 153).
Pour ces raisons susvisées, N. Machiavel (2005, p. 159) peut se lâcher au sujet du mariage : « L’archidiable Belphégor est envoyé dans ce monde par Pluton, avec l’obligation d’y prendre femme. Il arrive, se marie ; mais ne pouvant supporter la hauteur de sa moitié, il aime mieux retourner en enfer que de se rejoindre à elle ». Préférer les supplices de l’enfer aux fantaisies de la femme, c’est la peindre tout en noir, aux couleurs du diable.
Poursuivant toujours dans cette logique machiste, N. Machiavel (1992, p. 176) va énoncer : «La fortune est femme, et il est nécessaire, à qui veut la soumettre, de la battre et la rudoyer. Et l’on voit qu’elle se laisse plutôt vaincre par ceux-là que par ceux qui procèdent avec froideur ». Pour lui, la femme incarne la figure parfaite de la créature masochiste. Tout son être semble dévoué à l’homme qui la brutaliserait sans management. La compagne ainsi caricaturée grossièrement s’apparenterait dans la pensée machiavélienne à un être mineur qui ne peut avoir pour tuteur légal que l’homme, sans lequel d’ailleurs son humanité serait incomplète. Sinon, laisser faire la femme à sa guise, au nom d’un idéal humaniste, c’est exposer le foyer à toute sorte d’imprévisibilité de mauvais aloi. Point n’est donc besoin de vouloir séduire la femme avec qui on doit user de tout moyen, fût-il violent, afin de la rendre vertueuse.
En tenant compte des récriminations qui viennent d’être égrenées, on peut au final déduire avec D. C. N’dri (2013, p. 161) que « Machiavel fustige la nature féminine », tant il s’emploie à passer au crible de la critique acerbe les vices des femmes. En bonne intelligence, on ne saurait leur conférer les mêmes privilèges qu’aux hommes. Il faut s’en tenir à la loi de la ségrégation naturelle qui stipule selon Charles Darwin que la nature ne dote pas tous les êtres des mêmes aptitudes.
En somme, reconnaissons que toute cette littérature malfaisante a contribué à faire passer Machiavel dans l’opinion pour un misogyne invétéré. Mais, pourquoi penser un seul instant que la femme est une créature en sous-responsabilité de l’homme ? N. Machiavel, ayant lui-même pressenti cette gêne, ne va-t-il pas s’ériger en défenseur acharné des femmes ?
2.2. Machiavel, précurseur du féminisme moderne
Si tant est que « le temps vient à bout de tout» (N. Machiavel, 2005, p. 195), alors il ne faut guère prendre ses écrits au pied de la lettre et le calomnier avec des jugements hâtifs. Pour qui prend la peine de faire la froide synthèse de ses réflexions, il devrait pouvoir se convaincre que le procès qu’il fait de la femme est ambivalent. Ne nous méprenons nullement sur son compte parce que, ce ne sont pas toutes les femmes qu’il exècre. Il se dévoue à glorifier en particulier la gent féminine dans ce qu’elle possède de meilleures comme ses honorables représentantes. « Quand bien même toutes les femmes d’Italie seraient des monstres, une sienne parente [madame Lucrezia] était à elle seule capable de rétablir leur réputation ». (N. Machiavel, 2005, p. 191). Le Florentin est bien le défenseur de ces bonnes dames dont l’âme pudibonde contribue au maintien de l’existence la plus saine en société.
Concernant l’exercice de la gouvernance en politique, il place sa confiance tout entière en la femme qui serait tout aussi compétente que l’homme. Et au nombre des gestionnaires de pouvoir dont il encense la virtù[3], il cite en bonne place, Madona Caterina (N. Machiavel, 2005, p. 632), « c’est ainsi qu’on appelait la Comtesse [Catherine Sforza] », qui offrit en garantie ses enfants par pure stratagème politique pour préserver l’inviolabilité de sa citadelle. Pour cette politique futée, mieux vaut garder la forteresse de la cité imprenable plutôt que de préférer sauver sa progéniture. Les Anciens ne lui avaient-ils pas enseigné qu’il faut toujours sacrifier les libertés individuelles sur l’autel du prestige de l’État ? Sans éprouver le moindre remords du choix délibéré qu’elle avait fait « et pour attester qu’elle n’avait cure de ses enfants, elle leur montra ses parties sexuelles, disant qu’elle avait de quoi en faire d’autres ». (N. Machiavel, 2005, p. 632). C’est ainsi qu’elle vainquit et puis exila les conjurés de Forli. Si une femme est ainsi capable de tromper la vigilance d’une multitude d’hommes, alors pourquoi ne pas louer son mérite ?
Très appréciées comme confidentes sûres dans les cercles très restreints et proches du pouvoir, les femmes savent mieux que quiconque mener des actions secrètes très efficaces auprès de leurs compagnons ou de leurs fils de princes régnants. Sur ce chapitre, N. Machiavel ne manque pas de rapporter l’action discrète de Catherine (2005, p. 1034), fille d’Albert de Bohème dont la démarche avisée a fortement contribué à réaliser l’union du peuple pour mettre fin à la tyrannie de Lando.
Fort de ces preuves ci-devant mentionnées, le Secrétaire de Florence juge bien que les femmes sont aussi habiles que les hommes pour la gouvernance. Il rapporte même l’intelligence dont font usage certains fondateurs de peuples. Là, il cite le cas atypique dans l’antiquité de Dame Didon (N. Machiavel, 2005, p. 535) qui se révèle être une exceptionnelle fondatrice de cité. Certes, elle n’avait pas de pouvoir militaire exceptionnel de coercition, mais manipulant la persuasion et la finesse à souhait, elle est parvenue à bâtir une Cité prestigieuse.
Il ne faut pas dire, sans le connaître, que N. Machiavel partage l’opinion selon laquelle les femmes seraient inaptes à la fonction de commandement. Il reste persuadé au contraire qu’elles peuvent y exceller autant que les hommes. Le cataloguer comme l’archétype du misogyne, adepte de la phallocratie, c’est délibérément alimenter une polémique malsaine, fruit elle-même d’un anachronisme mal ficelé qui vise juste à le dénigrer. Autrement, comment accuser un auteur du XVIe siècle pour un délit dont la société cultivée n’a véritablement pris conscience qu’à partir de la seconde moitié du XXe siècle ? La mauvaise foi affichée de ses détracteurs sur le débat du genre, qui date de pas longtemps, suffit à elle seule à ne pas leur accorder crédit.
S’en tenir à la première impression des déclarations de N. Machiavel sur les femmes pour dire de lui qu’il les abhorre, c’est aussi se tromper soi-même et abuser les petits esprits. Si d’après K. Marx (1963, p. 17), les philosophes sont fils de leur temps et de leur société, s’ils « ne sortent pas de terre comme des champignons. [S]’ils sont plutôt les fruits de leur peuple dont les énergies les plus précieuses et les moins visibles s’expriment dans leur philosophie », il faut alors comprendre que N. Machiavel, en parlant ainsi à ras de sol à propos des femmes, se laisse souvent prendre dans les tourbillons des commérages sociaux et des ragots d’époque.
Au final, il faut relativiser les jugements sur N. Machiavel concernant la femme. Resté toujours très critique à l’égard de toute la société sans parti pris, il faut l’appréhender comme un penseur intègre qui a voulu léguer à la postérité un héritage exemplaire. Il n’a rien de haineux contre les bonnes femmes. Son tort peut-être, c’est d’avoir critiqué sans ménagement les femmes de mauvaise vie qu’il exècre.
CONCLUSION
Après coup, ce dont il s’agit de bien juger, c’est que « l’influence des femmes sur l’esprit public est considérable. En bonne politique, le prince est condamné à faire de la galanterie, alors même qu’au fond il ne s’en soucierait pas ». (M. Joly, 1987, p. 414). Voilà donc justifié ce pourquoi elles occupent une place de choix dans la conduite des affaires publiques. Quiconque veut réussir sa gouvernance, doit tenir compte de cette vérité au risque de se voir privé de la meilleure des gloires. On comprend mieux que leur défense ou leur dénonciation en politique ait pris une proportion très sérieuse qui ait souvent poussé N. Machiavel à les invectiver jusque dans leur intime dignité à travers des réquisitoires jugés souvent trop sévères.
« Mais laissons la médisance à qui veut médire » (N. Machiavel, 2005, p. 189) et attachons-nous simplement à dire que le Secrétaire florentin n’est pas l’incarnation du mal qui a passé le clair de son existence à mettre son aisance oratoire et sa virtuosité discursive au service de l’antiféminisme déclaré.
L’exhiber comme un misogyne dénué de scrupule, c’est tenir à son encontre un procès d’intention dont les sources d’alimentation restent des fadaises accumulées ça et là. Pour être crédible à son sujet, il faut plutôt dire que ses propos antiféministes et pro-féministes se tiennent en balance. Il est et demeure le prototype du philosophe politique très critique qui ne transige pas avec la stigmatisation de certaines tares sociales, quoique cela puisse lui coûter en réputation. La meilleure exégèse qu’il convient de proposer de sa démarche, c’est que « la femme et l’homme, en humanité authentique, collaborent comme des responsables ». (E. Lévinas, 1977, p. 137). Toute autre interprétation n’est que pure polémique affabulatrice dont l’intention voilée reste la médisance.
BIBLIOGRAPHIE
ARENDT Hannah, 1995, Qu’est-ce que la politique ?, trad. S. Courtine-Denamy, Paris, Seuil.
ARISTOTE, 1990, Les Politiques, trad. Pierre Pellegrin Paris, G.F.
ARIÈS Philippe et DUBY Georges (dir.), 1999, Histoire de la vie privée. De l’Empire romain à l’an mil, Tome I, Paris, Seuil, « Points histoire ».
BACHELARD Gaston, 1957, La Poétique de l’espace, Paris, P.U.F.
CONSTANT Benjamin, 1997, Écrits politiques, notes Marcel Gauchet, Paris, Gallimard, « Folio essais ».
DADOUN Roger, 1993, La Violence. Essai sur l’« homo violens », Paris, Hatier, « Optiques philosophie ».
GAILLE-NIKODIMOV Marie, 2002, « Machiavel, penseur de l’action politique », GAILLE-NIKODIMOV Marie et MÉNISSIER Thierry (dir.), Lectures de Machiavel, Paris, Ellipses, p. 259-291.
HAMILTON Edith, 1995, La Mythologie, ses dieux, ses héros, ses légendes, trad. Abeth de Beughem, Paris, Marabout, « Savoirs ».
JERPHAGNON Lucien, 2008, Histoire de la Rome antique. Les armes et les mots, Paris, Hachette/Littérature.
JOLY Maurice, 1987, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, Paris, Allia.
KOFFI Jean-Honoré, 2005, « L’Égalitarisme, fin de toute justice ?», Revue ivoirienne de philosophie et de culture, Le Korè, Abidjan, EDUCI, p. 27-42.
LÉVINAS Emmanuel, 1963, Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme, Paris, Albin Michel.
LÉVINAS Emmanuel, 1977, Du sacré au saint. Cinq nouvelles Lectures talmudiques, Paris,Minuit.
MACHIAVEL Nicolas, 2005, Œuvres complètes, intro. Jean Giono, notes Edmond Barincou, Paris, La Pléiade.
MACHIAVEL Nicolas, 1992, Le Prince, trad. Yves Lévy, Paris, G. F.
MADORE Joël, 2001, Éthique et politique chez Lévinas, Thèse de Doctorat, Université d’Ottawa, Canada, Bibliothèque, consulté le 25/03/2016, http://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/9158/1/MQ66085.PDF
MARX Karl, 1963, « La Philosophie et l’esprit du temps », Œuvres choisies I, trad. Norbert Guteman et Henri Lefèbre, Paris, Gallimard, p. 10-32.
NIETZSCHE Friedrich, 1974, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. Georges-Arthur Goldschmidt, Paris, L. G. F.
NIETZSCHE Friedrich, 1990, Crépuscule des idoles, trad. Jean-Claude Hémery, Paris, Gallimard.
NIETZSCHE Friedrich, 1990, L’Antéchrist suivi d’Ecce Homo, trad. Jean-Claude Hémery, Paris, Gallimard.
N’DRI Diby Cyrille, 2013, La Face cachée de Machiavel, postface David Musa Soro,Abidjan, Balafons.
PLATON, 1966, La République, trad. Robert Baccou, Paris, G. F.
RELIGION ET DÉMOCRATIE CHEZ LEIBNIZ
Mireille Alathé BODO
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Bodomireille@gmail.com
Dans le système philosophique leibnizien, les religions occupent une place centrale. Elles sont des facteurs d’unification et de cohésion sociale, surtout en périodes de crises. Pour préserver la paix sociale, nous devons respecter l’opinion de l’autre, car c’est de la diversité que naît la plus belle harmonie.La prolifération de religions est une richesse pour toute société, car les différentes religions, quelle que soit leur nature, cherchent toujours à protéger la liberté humaine. L’Afrique doit donc saisir cette opportunité pour bâtir une nouvelle ère d’entente dans la solidarité et non pas dans la confrontation.
Mots clés : Cohésion sociale, conclave, cosmopolite, laïcité, œcuménisme, prosélytisme.
ABSTRACT :
In Leibniz’s philosophical system, religions are central. They are factors of unification and social cohesion, especially in times of crisis. To preserve social peace, we must respect the opinion of the other, because it is through or from the diversity that comes the most beautiful harmony. The proliferation of religions is an asset for any society, because different religions, whatever still their nature, are always seeking for protecting human being’s freedom. Africa must therefore seize this opportunity to build a new era of understanding in solidarity and not in confrontation.
Key words : Social cohesion, conclave, cosmopolitan, secular, ecumenism, proselytism.
INTRODUCTION
Les démocraties africaines reposent plus sur les filiations ethniques, tribales ou claniques que sur les objectifs moraux. Comme l’exprime (S. Diakité, 2014, p.120), « à vrai dire, l’Afrique politique manque d’éthique. » Cette situation met en mal l’édification d’une véritable démocratie en Afrique. Alors face à cette crise généralisée des États démocratiques africains, le recours aux religions s’avère nécessaire pour redonner de la consistance à nos démocraties en crise. Les religions selon Leibniz, jouent un rôle important dans la société, « car en périodes de crise, elles servent de lumière à l’ardeur des hommes » (G.W. Leibniz, 1969, p.28). C’est pourquoi, la prolifération des religions, loin d’être un obstacle, est un atout pour les États démocratiques africains en crise. Alors partant de ce constat, que dire des religions aujourd’hui ? Peuvent-elles contribuer encore, à la résolution des problèmes que traversent les régimes démocratiques africains ?
1. LES POINTS DE CONVERGENCE ENTRE DÉMOCRATIE ET RELIGIONS
Ladémocratiesedéfinit par la liberté des élections qu’on croit souvent assurer par le pluralisme des partis politiques, la garantie du respect des libertés publiques fondamentales, la limitation du pouvoir central face aux libertés individuelles. Cette conception peut être l’objet de plusieurs critiques, car l’élection ne garantit pas l’exercice du pouvoir par le peuple, si les moyens d’information, de propagande et de pressions économiques sont aux mains de quelques-uns. Aussi le suffrage universel peut-il devenir un élément anti-démocratique lorsque, par exemple, dans la pratique du plébiscite ou du référendum, il vise à faire approuver un homme et non une politique, ou à déterminer le choix du votant par une question imposée. La liberté et l’égalité sont simplement formelles, s’il se trouve que l’appartenance à un milieu social défini détermine pratiquement l’accès à certaines fonctions ou à certaines compétences. Ainsi la liberté, par où se définit la démocratie, n’est pas seulement la reconnaissance à chacun de droits égaux, c’est aussi l’exigence que chacun puisse également exercer ces droits. La démocratie est donc inséparable de la justice sociale. Ainsi l’homme, dans son individualisme, est mis au centre du dispositif démocratique. Dans la démocratie, se joue donc le sort de l’Humanité, dans la mesure où la liberté humaine est politiquement mise en œuvre. Avec la démocratie, le pouvoir politique s’ouvre mieux, s’articule sur la liberté des individus, alors que dans les régimes non-démocratiques, cette liberté élémentaire n’est pas honorée. C’est donc bien la condition concrète de l’homme qui se joue dans la démocratie, ainsi que les possibilités d’un progrès culturel. La démocratie constitue le fond rationnel, la réalité du social. C’est le régime où l’on agit en commun et où l’on accepte le décret de la majorité, mais où l’on ne pense pas en commun. La discussion est le fondement de l’action commune, efficace, parce qu’elle est la conscience de la liberté dans la nécessité de l’action. La démocratie est donc un mode de vie et de gestion, une procédure de résolution des conflits dont elle admet la légitimité et l’irréductibilité. Prétendre supprimer l’existence des conflits conduit au totalitarisme. Le totalitarisme est la déviation de la démocratie. Il se caractérise par la fusion des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Ainsi définie, la démocratie n’est pas un régime parmi d’autres, mais elle apparaît comme l’idéal-type de gouvernement qui veut conserver son être et parvient à penser son effort pour être. Elle est présente en tout régime comme sa vérité secrète, parce qu’elle y est confusément désirée, encore que l’utile propre soit seulement éprouvé et non reconnu par la raison. La démocratie, affirme B. Spinoza (1954, p. 47-48) :
« Est la vraie nature, la réalité, la perfection de la société, comme la raison est celle de l’individu. L’État libre réalise le règne de la loi identifiée au règne de la liberté, de même que l’esprit libre est celui qui n’obéit qu’à sa nature qui est la pensée, autrement dit, en comprenant la loi commune de la nature dont il est une partie. La démocratie, c’est la raison dans l’État, la raison qu’est l’État. »
Or, il se trouve que cette démocratie, véritable espace citoyen de la liberté humaine, où se joue le sort de l’humanité, l’instance religieuse semble inéluctablement aller à sa disparition. Mais comme, le pluralisme politique et le foisonnement religieux sont des phénomènes récents concomitants liés à l’ouverture démocratique, pour la bonne marche des États démocratiques, il est nécessaire de préconiser le retour du fait religieux sur la scène politique. Mais comment ces mouvements religieux incontrôlés peuvent-ils contribuer à la stabilité des États démocratiques en crise ?
À l’époque de Leibniz, l’Allemagne était divisée par la guerre. Porter la paix de la raison dans les controverses de la théologie, était, pour Leibniz, éliminer les divisions en abolissant leur source. La Théodicée est, en ce sens, une action qui résume et réassume l’effort de toute une vie en faveur de l’unification des Églises. C’est l’unification des églises qui a permis de lutter contre les crises sociales. À cet effet, écrit G.W. Leibniz, (1969, p.16) : « Pour lutter contre les crises sociales, il faut mettre la dispersion au service d’une unité, en intégrant les différences sans les abolir. » Dans la conception leibnizienne, les désaccords théologiques entre les confessions chrétiennes n’empêchaient pas la réunification, non pas parce qu’il se souciait peu des points délicats de théologie, mais parce qu’il croyait qu’en regardant les choses de près, on verrait apparaitre un degré de concordance suffisant pour la réunification. Cetteentreprise leibnizienne est celle que nous appelons aujourd’hui l’œcuménisme, qui est une tendance à l’union de toutes les Églises Chrétiennes en une seule. Ce mouvement œcuménique est né en 1948 et présidé par le Pape.
Dès lors, surgie cette question : comment les chefs d’Église sont-ils désignés ? Est-ce par consensus ou par voix de majorité ou par unanimité ? L’élection du Pape, par exemple, se fait par conclave. Qu’est-ce qu’un conclave ? Un conclave est un mot dérivé du Latin « cum et clave », littéralement avec « clé » et qui désigne, en latin classique, une pièce fermée à clef. Dans l’Église Catholique Romaine, c’est le lieu où sont enfermés les Cardinaux rassemblés pour l’élection du Pape. L’élection se fait par consensus, c’est-à-dire que le nombre des cardinaux votant est limité et ne peut excéder 120. Cela sous-entend qu’il y a à la base, un accord des volontés, concernant le nombre des participants. C’est un accord qui se fait sans opposition formelle. La désignation du pape, comme de tout autre guide religieux, se fait par consensus. Ceci nous permet d’éviter de nous enfoncer dans des querelles inutiles souvent occasionnées par la barbarie des hommes qui entraine des révoltes dans les sociétés. Le consensus se distingue de l’unanimité qui met en évidence la volonté manifeste de tous les membres dans l’accord. Le consensus est proche de la majorité, mais ce n’est pas l’unanimité.
2. LES POINTS DE DIVERGENCE ENTRE DÉMOCRATIE ET RELIGIONS
Dans la démocratie, le pouvoir social est celui de l’opinion publique. C’est le scrutin majoritaire. La démocratie repose sur un principe inverse qui est la liberté et l’égalité de chaque citoyen. Ce qui est exclu dans le modèle hiérarchique des religions. La religion quant à elle, est fondée sur la foi en Jésus-Christ, ou les vérités révélées de la bible, communément appelées dogmes. Elle est fondée sur l’opinion commune. Elle est un facteur d’unité. É. Durkheim (2008, p. 3), le confirme en ces termes : « Il n’y a donc pas au fond de religions qui soient fausses. Toutes sont vraies à leur façon. Toutes répondent, quoique de manière très différente, à des conditions données de l’existence humaine. » Loin d’être une source d’erreur, comme on la dénonce souvent, le sentiment religieux est au contraire pour Durkheim à l’origine de l’activité scientifique, plus précisément de la capacité à forger des concepts en dépassant les perceptions sensibles. Les religions ont donc pour première mission de faire naître la paix, et l’histoire montre bien qu’elles peuvent cohabiter pacifiquement, car le mélange des cultures, des langues et des religions est un moyen d’épanouissement pour les individus et permet d’avoir une civilisation particulièrement brillante. La religion, dans la perspective citoyenne, est bien en charge du présent, c’est-à-dire de notre vie actuelle tout autant que la démocratie, mais selon une autre logique. Elle ne se déploie pas sur le mode de la souveraineté, apanage du pouvoir politique, mais sur celui de la symbolique pour donner au parcours existentiel de chacun, l’horizon eschatologique souhaité. Les religions posent la question du bien, du beau et de la vérité. Elles peuvent contribuer à la résolution des problèmes en société, si elles dialoguent entre elles et s’appuient sur la raison. C’est pourquoi, elles doiventabandonner leur mission de prosélytisme, car en toute chose, la modération se fait conciliation, toute voie médiane étant plus rationnelle qu’une voie extrême. Il n’y a que les extrémismes qui soient blâmables dans les théories.
En outre, la société démocratique peut aller vers le meilleur comme vers le pire, vers la liberté ou vers la servitude. (B. Guèye, revue n°129, p. 2-26), écrit : « les élections mal préparées ou manipulées, débouchent sur des violences bloquant le processus démocratique et le dialogue entre les acteurs politiques. » C’est pourquoi l’homme démocratique a besoin de religion qui lui offre un sens à sa vie, car la religion modèle l’ardeur à s’enrichir, notamment en régnant souverainement sur l’âme. Ce que la démocratie n’offre pas. Dans le discours sur la conformité de la foi avec la raison, qu’il a inséré dans la préface de la théodicée et de l’ouvrage lui-même, Leibniz s’est efforcé de démontrer qu’une chose peut être au-dessus de la raison, sans être pour cela contre la raison. Il rattache cette doctrine scolastique à sa distinction de deux espèces de nécessité. Ce qui est contre la raison, dit-il « est contre les vérités absolument certaines et indispensables, c’est-à-dire en définitive, contre le principe de contradiction. Rien ne peut aller en ce sens, contre la raison. » (G. W. Leibniz, 1969, p. 80). Et il en est à cet égard, de la religion comme de la science elle-même.
Mais ce qui est au-dessus de la raison, est contraire seulement à ce qu’on a coutume d’expérimenter ou de comprendre, c’est-à-dire aux faits ordinaires. Mais comme la nécessité physique proprement dite n’est fondée que sur les lois prescrites à la nature par la volonté divine, et qu’elle ne dépend pas immédiatement de l’entendement divin, cette nécessité n’est pas absolue, et Dieu a pu, en vue des fins supérieures, y faire parfois exception. En d’autres termes, le miracle est possible, mais il n’est pas la dérogation à toute espèce de loi. Il est l’introduction d’un ordre supérieur dans l’ordre inferieur, du règne de la grâce dans le règne de la nature. C’est en ce sens que les vérités de la religion sont supérieures à la raison, et ainsi elles la dépassent sans la contrarier. Le but poursuivi par G. W. Leibniz (1969, p. 80), est de montrer que :
« La raison, loin d’être opposée à la doctrine chrétienne, sert de fondement à cette religion, et la fera recevoir à ceux qui pourront venir à l’examen. Mais comme peu de gens en sont capables, le don céleste d’une foi toute nue qui porte au bien suffit pour le général. »
Les différents points de vue religieux constituent donc une richesse pour toute société, car chacun pour sa part, a son rôle à jouer dans la société. Notre existence sur cette terre n’est pas fortuite, parce que « tout ce qui existe a sa raison d’être. » Affirme G.W. Leibniz (1969, p.444). Pour cette raison, nous ne devons pas chercher le principe de l’unité du monde, particulièrement de nos sociétés africaines dans une action directe et réciproque des individus. Sans doute, en chaque individu, les actes résultent d’une spontanéité propre. Mais ces actes ne sont indépendants seulement, qu’en apparence. En réalité, ils dépendent tous de la totalité des actes d’autres individus qui composent l’univers.
Strictement parlant, si on connaissait, sans faille, un seul acte d’un individu, on pourrait reconnaître tous ceux de toutes les autres substances, et non seulement les actes présents, mais ceux, passés, dont ils proviennent, de même que ceux du futurs, qu’ils provoquent. L’unité de nos sociétés africaines ne peut résider qu’en l’accord préétabli entre les perceptions des individus différents. L’univers exprime le plan de Dieu. En lui, s’accordent les points de vue particuliers de toutes les substances. Chaque événement qui arrive, chaque chose, doit pouvoir être expliqué, parce que la volonté créatrice de Dieu agit absolument partout. Mais cela ne va pas sans problèmes, puisque tout ne semble pas parfait dans ce qui arrive. Il y a beaucoup de mal et de souffrance dans le monde. Devons-nous alors croire que Dieu n’est pas un bon démiurge, et que le mal fait partie de son projet créateur ?
Leibniz repousse cette accusation, car pour lui, le mal n’a pas de réalité effective. Ce que nous appelons mal est un certain bien. Aux yeux de Leibniz, le monde pourrait être une vallée de larmes, il vaudrait toujours mieux que le néant. Un homme capable de jouissance et de souffrance vaut mieux qu’une pierre stupide et immobile. La souffrance n’est pas un argument contre l’existence. Ces graves crises que connaissent nos États africains, doivent nous permettre de resserrer les liens, afin de travailler ensemble pour parfaire notre continent, car dans un contexte de crise économique et sociale grave, toutes les religions proposent un appui moral et une offre de guérison. Elles deviennent des lieux de compensation et de ressourcement, pour ceux qui se trouvent déstabilisés par leur difficulté à trouver un statut professionnel ou social. Elles introduisent de nouvelles logiques inter-individuelles de solidarités, non fondées sur la contrainte familiale. Elles sont fondées sur un fonctionnement en associations. Elles constituent des espaces où une nouvelle culture personnelle et relationnelle peut s’épanouir et se formaliser.
Les religions règlent notre conduite en société. Elles sont-là pour servir de lumière, pour assainir la société. Elles ont pour rôle d’accompagner le politique dans le développement de la société. Pour cela, les chefs religieux doivent démontrer concrètement la différence entre l’Évangile authentique et le faux. Ils doivent surtout avoir le courage de dire la vérité aux hommes politiques. Pour le faire, il faut être capable de discernement critique, d’ouverture d’esprit. Bref, il faut garder l’esprit lucide et en éveil. Et cela en prêchant la vérité, rien que la vérité, car pour G. W. Leibniz (1991, p. 296),
« Plus la connaissance est distincte, plus pur et puissant est l’amour qu’elle détermine. Et en même temps, plus nous aimons la perfection divine, plus se produit en nous le plaisir de bien faire, qui est le plus solide appui de la vertu. »
Pour cette raison, nous invitons nos différents chefs religieux à prendre garde pour ne pas se laisser séduire par les hommes politiques. Aujourd’hui, la religion devient de plus en plus un enjeu politique. Les hommes politiques construisent eux-mêmes les conflits religieux car, à dire vrai, aucun conflit n’a une origine exclusivement religieuse. Bien souvent, la religion est un prétexte pour alimenter et justifier une guerre qui a un fondement politique. La religion instrumentalisée est un outil de pouvoir. Dans cette instrumentalisation, il n’y a plus de possibilité de discernement. L’appel à discerner a du mal à se faire entendre. Et là, le risque devient grand, car la religion est elle-même phagocytée par la menace de disparition. (M. Raunet, 2007, débat 103), affirme :
« pour maintenir la paix et le développement en Afrique, il faut comprendre que la lutte contre la pauvreté et l’ignorance, est un combat qui doit être mené au nom de la justice, de la solidarité mais aussi de la raison, car c’est sur un terrain de frustrations et d’ignorance que se développent le fanatisme et donc le terrorisme. »
Ainsi, pour que les mouvements de contestation religieux ne se transforment pas en insurrection meurtrière, le gouvernement doit imposer des restrictions raisonnables pour assurer la sécurité dans une société pluraliste. Il doit façonner et définir la liberté religieuse pour ne pas qu’elle outrepasse ses limites et devienne néfaste pour la société. D’ailleurs, c’est ce qui amène Rousseau à parler de l’instauration de la religion civile qui laisse chacun libre des dogmes qui touchent à l’autre monde, mais qui exaltent des sentiments de sociabilité. Certes, la cohésion sociale n’est jamais définitivement acquise, elle est à construire, mais unis, nous pouvons travailler ensemble pour accompagner les processus de développement de nos sociétés. Relativement à cette idée, (D. Bangoura, revue n°28, 2007, p. 127-136), envisage : « la vigilance avec des regards croisés, car pour elle, les conflits régionaux sont généralement le résultat d’un processus de diffusion d’un conflit interne vers des pays voisins. » Nous devons donc éviter de nous enliser dans des conflits inutiles qui fragilisent la paix et la cohésion sociale. L’appartenance à un culte commun implique une adhésion spirituelle commune à un objet de croyances. Si la religion peut être considérée comme un ensemble de croyances et de pratiques relatives à un monde supranaturel avec lequel les hommes entrent en communication, l’adhésion à un cercle religieux marque le début d’un nouvel apprentissage.
L’orientation spirituelle à laquelle souscrivent des individus d’une collectivité, est un acte de solidarité quasi totale qui unit ses adhérents. La vie fraternelle est une vie sociale et la vie sociale suppose des facultés d’adaptation et d’intégration aux données communes. Au cœur de cette notion de fraternité, affirme F. N. Kouakou (2012, p. 13) : « se trouve la société et à travers elle, la conception de l’homme en tant qu’être humain. La corrélation de la fraternité à son cadre général d’humanité, est un point de réflexion de l’humanisme négro-africain. » La fraternité africaine doit engendrer des hommes nouveaux qui restent profondément unis pour le meilleur et pour le pire, c’est-à-dire pour la vie et aussi pour la mort. À la fraternité, est liée une production idéale et symbolique. Le symbole de l’unité et de l’entente implique un refus de la division, de l’antagonisme et de l’infamie. Dans cette reconnaissance de l’autre, la fraternité africaine apparaît comme un maillon essentiel dans la compréhension de l’anthropologie négro-africaine.
Déjà, au temps de Jésus-Christ et du prophète Mohamed, les hommes connaissaient cette notion de fraternité et de solidarité. Ils allaient vers ceux qui souffraient et leur tendaient la main pour leur donner de l’espoir. Ils ressentaient la souffrance des autres, partageaient avec eux peines et afflictions. Pour avoir une communauté forte, nous devons nous soutenir les uns les autres. L’amour de l’Humanité est la caractéristique des fondateurs de chaque religion. La pratique de la religion consiste dans l’effort pour contribuer au bien-être de tous, c’est-à-dire dans l’amour de nos semblables. Tel est le désir de G. W. Leibniz (1991, p. 297) :
« De l’amour et de la foi, c’est l’amour qui est le principal, à moins que l’on ne considère l’amour comme enveloppé dans la foi véritable et complète. En elle-même, la foi ne peut être nécessaire que comme moyen. Si une erreur de croyance peut nous rendre damnable, ce n’est qu’en tant qu’elle détruit l’amour. »
Aimer selon Leibniz, c’est trouver du plaisir dans le bien, la perfection ou le bonheur d’autrui. C’est faire sien ce bonheur ou cette perfection et l’adopter. Donc aimer, c’est rendre heureux et faire progresser en perfection. La doctrine de l’amour est essentielle au leibnizianisme. Elle assure la communication entre les substances essentiellement séparées les unes des autres, et permet d’espérer un vivre-ensemble qui ne repose pas exclusivement sur l’intérêt égoïste. Par sa doctrine de l’amour qui reprend la distinction augustinienne de l’uti et du frui, Leibniz établit un pont entre intérêt, utilité et désintéressement. Car, nous prenons du plaisir à l’amour, plaisir qui nous permet des actions désintéressées. L’amour suppose quelque chose comme une réciprocité au moins virtuelle. La réciprocité de l’amour permet de comprendre comment chacun, en voulant son propre bien, veut celui de l’autre, étendue par la sagesse à la connaissance vraie de l’universel, et cette réciprocité constitue la forme par excellence de la justice. L’Amour est salvateur, et Leibniz estime qu’on peut être sauvé dans toutes les religions pourvu qu’on aime les perfections divines. L’amour du bien général, du bien public, ou même les actes qui vont dans ce sens en sont une marque suffisante. L’homme bon est celui qui aime tous les autres autant que la raison le permet. L’amour est la source de la vraie piété et de la vraie justice. C’est pourquoi, pour le bon fonctionnement de nos sociétés, surtout pour la cohésion sociale, nous devons nous aimer les uns des autres. L’amour peut nous aider à triompher du mal, parce qu’il ne s’agit pas ici, d’appliquer à la lettre la formule de Saint Augustin : aime et fais ce que tu veux, car de nos jours, la charité sert davantage d’argument de propagande que de principe de vie. Il ne s’agit pas non plus d’appliquer une justice froide et désincarnée fondée sur les notions de Bien et du Mal. Mais il s‘agit de redécouvrir l’importance du lien interhumain par une nouvelle pratique des relations au monde et à autrui. Cette pratique conçue et vécue comme acte d’amour et de raison s’appelle la solidarité. À cet effet, écrit R. Chappuis (1999, p. 67), « cette solidarité mérite d’être appliquée à tous les citoyens du monde pour construire l’édifice de l’humanité. »
Pour Raymond Chappuis, réconcilier les exigences de l’amour avec celles de la raison par une solidarité vécue à tous les niveaux des activités familiales, sociales et professionnelles, c’est apprendre à retrouver le sens de la vie, d’une vie qui porte en son sein sa part d’humanité. La réelle vie démocratique n’est possible, que si les mentalités évoluent vers plus de fraternité, plus de solidarité. Un gouvernement quelle que soit son idéologie, doit s’efforcer de maintenir ce lien affectif qui réunit les citoyens, et de le renforcer par la pratique de la solidarité quand les événements menacent l’intégrité de la nation. L’avenir des nations dépend de l’amélioration et de l’augmentation en nombre des démocraties. Cependant, celles-ci peuvent devenir vulnérables si l’esprit qui les anime se coupe ou s’éloigne des valeurs universelles. Sans une éducation de la citoyenneté fondée sur la pratique d’une solidarité au niveau des hommes, des groupes, des institutions, la démocratie se limiterait alors à l’aménagement des structures, lequel fait appel à une élite qui est souvent tentée de monopoliser le pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Une éducation à la citoyenneté axée sur l’intégration progressive des valeurs de solidarités restitue toute sa richesse à la notion de différence en faisant de celle-ci un objet de plaisir pour chacun, et pour la communauté la force de renouvellement des traditions, des mœurs et des coutumes.L’ouverture sur les autres comme il le dit : « Est une capacité qu’il faut acquérir dès l’enfance. » (R. Chappuis, 1999, p. 74).
Et l’unique façon de grandir pour une personne, une famille, une société, l’unique manière pour faire progresser la vie des peuples, est la culture de la rencontre. Une culture dans laquelle tous ont quelque chose de bon à donner et tous peuvent recevoir quelque chose de bon en échange. L’autre a toujours quelque chose à nous donner, si nous savons nous approcher de lui avec une attitude ouverte et disponible, sans préjugés. Cette attitude ouverte favorise le dialogue et permet la cohabitation entre les cultures et les religions, voire entre les individus de différentes confessions religieuses.
3. LA LAÏCITÉ COMME PRINCIPE DE COHABITATION
La laïcité comme principe d’unification des hommes au sein de l’État, vient du mot grec « Laos » qui désigne l’ensemble du peuple. Il s’agit en effet, de réaliser l’unité du peuple au-delà des différences de croyances. C’est une éthique basée sur la liberté de conscience visant à l’épanouissement de l’homme en tant qu’individu et citoyen. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion ou personne ne peut être contrainte par le droit au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.
Il y a donc une séparation juridique entre les églises et l’État. Pour garantir que la chose publique soit bien l’affaire de tous, l’État revendique sa neutralité en matière spirituelle et religieuse. L’État laïc assure ainsi l’égalité des citoyens face au service public quelles que soient leurs convictions ou croyances. La laïcité est au cœur de notre vivre-ensemble. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L’État laïc, c’est l’État impartial, c’est-à-dire l’État qui ne se réfère à aucune religion, c’est un pouvoir politique libre vis-à-vis des religions, et qui assure à chacune d’elles, mais aussi aux athées, une pleine liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. La laïcité est une valeur commune précisément celle qui permet de rassembler les individus au-delà des croyances et des idées. Elle se fonde sur le respect de la pluralité des options religieuses. Elle contribue à promouvoir une culture commune du respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la considération de tout autre comme semblable doté de la même dignité et des mêmes droits.
Relativement à cette idée, les Églises et les religions ne doivent pas intervenir à tout bout de champ dans les débats politiques, ni s’imposer à tous de manière autoritaire. Leur contribution doit être de l’ordre de la proposition et non d’une parole qui se voudrait hégémonique et normative pour l’ensemble de la société. Le rôle de la laïcité est de protéger la société de toute idéologie. La laïcité est neutre vis-à-vis de la question de Dieu. Elle est la volonté et l’art d’un vivre-ensemble dans la reconnaissance des autres. La spiritualité laïque consiste à inventer ensemble, une société plurielle, où chacun et chacune a sa place et est reconnu dans sa différence, pour faire entendre sa voix originale. Tel est le pacte laïc, celui de tisser, avec nos différences, une citoyenneté solidaire, car il n’y a, en effet, de citoyenneté que lorsqu’un individu ou un groupe, enraciné dans son identité, ses particularités, accepte aussi de prendre en considération le bien commun. La laïcité se construit dans l’acceptation de l’altérité. L’altérité est un concept philosophique signifiant le caractère de ce qui est autre, ou la reconnaissance de l’autre dans sa différence, aussi bien culturelle que religieuse. C’est la condition sine qua non de notre vivre-ensemble et d’une vie harmonieuse. D’ailleurs c’est ce que fait J. Habermas, (1992, p.164), en « distinguant le discours laïc, accessible à tous, du discours religieux, qui repose sur une vérité révélée. » Habermas reconnait la capacité de mobilisation des religions surtout dans le domaine de la solidarité. C’est pourquoi il invite les laïcs à discuter avec elles, bien que beaucoup tendent à les balayer du revers de la main, en les réduisant à un archaïsme.
Mais cette ouverture n’est pas sans prix. En retour, les communautés religieuses doivent faire preuve de tolérance et comprendre, à partir de leurs raisons, que la neutralité de l’État est la condition nécessaire de l’exercice d’une pensée discursive, capable d’apprentissage et de progrès. L’avenir est le lieu de l’espoir. C’est un point-clé de l’argumentation religieuse qui, face aux misères du présent, nourrit l’âme de promesses et de lendemains plus heureux. Le manque de perspectives peut dégénérer en repli ou en refuge. La démocratie a, plus que jamais, besoin d’être laïque, c’est-à-dire capable d’organiser un espace de délibération où chaque composante de la société a sa place. En effet, quand nous regardons l’état du monde, nous constatons que dans les régimes peu ou non-démocratiques, la religion joue un rôle considérable dans la vie des hommes qui y vivent. L’effort à réaliser consistera à penser ensemble, démocratie et religions, et à inventer un schéma qui rende compte de leurs relations, qu’elles soient conflictuelles ou harmonieuses. Comme le rappelle A. Antoine, (2003, p.322), l’enjeu de cette réflexion est important : « La démocratie n’est pas un régime politique parmi d’autres, une simple formule de gouvernement, mais elle est éthique. » La démocratie trouve en elle-même son fondement dans sa référence aux démos, c’est-à-dire au peuple au service duquel elle doit s’exercer. Ici, nous utilisons le terme autonomie pour signifier l’auto-positionnement du pouvoir politique, et non celui plus communément utilisé de séparation, car en déniant au religieux toute fonction d’ordre sociale, le politique se trouve orphelin de valeurs qui sont essentielles à la cohésion sociale, tout comme de l’esthétique qui encadre sa vie culturelle. Et là, la liberté constitutive de l’humain peut dégénérer et devenir un frein pour une authentique fraternité, puisqu’elle n’est pas constamment ressourcée, c’est-à-dire référée à sa source, à son origine : « La société républicaine est incapable de renouveler les valeurs chrétiennes qu’elle a laïcisées, » affirme (J. Julliard, 2003, p. 299).
En effet, il nous faut reconnaitre que la liberté ne se fractionne pas. Elle structure l’homme dans sa totalité. C’est la liberté religieuse qui est l’ultime garant de l’autonomie de la conscience individuelle face aux logiques infernales des idéologies. Pour Spinoza, tout ce qui est, est en Dieu, et rien sans Dieu ne peut ni être, ni être conçu. Relativement à cette idée, nous voyons l’importance de la religion dans la vie sociale. Elle est au fondement de toutes démocraties. Aujourd’hui plus que jamais, les sociétés démocratiques doivent promouvoir l’amour qui brise toute clôture qui renferme les hommes sur eux-mêmes ou sur leur appartenance ethnique. S. Diakité (2014, p. 126), s’interroge en ces termes : « Toute ouverture à l’autre n’est-elle pas une richesse ? » Pour entrer de plain-pied, dans la mouvance de la mondialisation et réaliser le bonheur des sociétaires, E.Y. Kouassi, (2014, p. 142), écrit : « Il faut combattre l’intrusion de fausses valeurs telles que l’indifférence, l’égoïsme petit-bourgeois et le repli sur soi, dans l’espace public africain. »
Afin de mener à bien ce grand mouvement qui porte la civilisation de sa division actuelle au stade universel d’une civilisation mondiale, il nous faudra apprendre à penser universellement, et non plus en termes de personnes, de classes, de nations, de continents privilégiés. Nous ne devons pas torpiller les processus d’intégration africaine, mais au contraire les prendre en compte, ainsi que les médiations. La voie des médiations est une démarche importante, qui reste la condition pour sortir du romantisme et des approches limitées et idéologiques qu’il induit. Concernant l’Afrique, il s’agit de promouvoir, au niveau national, la démocratie en ne perdant pas de vue les droits de l’homme, de même qu’en ne laissant pas de côté les débats sur les résistances, faute de quoi prospéreront, pour longtemps encore, les discours xénophobes, les rebellions, les sécessions, les attaques terroristes, etc. Mais dans l’optique de l’intégration, il s’agit d’inclure l’autre, l’étranger et les faces multiples sous lesquelles ils apparaissent, ici et ailleurs.
À travers la reconnaissance de l’autre, le christianisme doit promouvoir l’idée d’une humanité unifiée et cosmopolite. Dans cette société unifiée, la politique ne pourra faire un pas sans rendre hommage à la morale, car « Bien que la politique soit par-elle-même un art difficile, écrit E. Kant, (1958, p.155), son union à la morale n’est en aucune manière un art, car celle-ci tranche les nœuds que celle-là ne peut délier aussitôt qu’elles ne sont plus d’accord. »
CONCLUSION
Nos traditions religieuses respectives nous appellent à travailler ensemble à la paix. La paix est donc au cœur de nos différentes religions et nos convictions diverses nous font un devoir de travailler ensemble à sa construction. Nos visions multi-religieuses de la paix comprennent un appel adressé à tous les croyants, celui d’accueillir l’autre. Chacune de nos diverses traditions religieuses appelle à une solidarité profonde avec l’autre. Accueillir l’autre signifie accepter les uns et les autres. La gouvernance et la religion ne doivent pas se mélanger. Cependant, la démocratie et les religions ne sont pas incompatibles. D’ailleurs c’est ce que dit G. W. Leibniz (1969, p. 17) : « La persuasion politique, dans la Théodicée, ne se sépare pas de la synthèse théorique. »
La bonne morale et la bonne politique ne sont que l’envers et l’endroit d’une même réalité, les deux faces d’un même effort. Comme l’exprime E. Naert (1964, p. 3) :
« Nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes, mais pour le bien de la société, comme les parties le sont pour le tout et nous ne nous devons considérer que comme des instruments de Dieu, mais des instruments vivants et libres …Si nous y manquons, nous sommes comme des montres et nos vices sont comme des maladies dans la nature. »
Nous devons agir conformément à la nature de Dieu qui est lui-même le bien de toutes les créatures. Nous devons suivre son intention qui nous ordonne de procurer le bien commun, autant qu’il dépend de nous, puisque la charité et la justice ne consistent qu’en cela. Pour ce faire, la démocratie en Afrique doit être soutenue par l’idéal de la bonne gouvernance.
BIBLIOGRAPHIE
AGNÈS Antoine, 2003, L’impensé de la démocratie : Tocqueville, la citoyenneté et la religion, Paris, Fayard.
CHAPPUIS Raymond, 1999, La solidarité, l’éthique des relations humaines, Paris, PUF.
DIAKITÉ Samba, 2014, Politiques africaines et identités, des liaisons dangereuses, Canada, Différance Pérenne.
DURKHEIM Émile, 2008, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF.
HABERMAS Jürgen, 1992, Droit et démocratie, Trad. Rainer Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard.
JULLIARD Jacques, 2003, Le choix de pascal, Paris, DDB.
KANT Emmanuel, 1958, Vers la paix perpétuelle, trad. Darbellay, Paris, P.U.F.
KOUAKOU N’Guessan François, 2012, Fraternité et secret initiatique dans les cultures de tradition africaine, Abidjan, Éditions Balafons.
KOUASSI Yao Edmond, 2014, Colonisations et société civile en Afrique, Paris, l’Harmattan.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1969, Essais de théodicée, trad. Jacques Brunschwig, Paris, Garnier-Flammarion.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1991, La monadologie, Paris, Librairie Générale Française.
NAERT Émilienne, 1964, La pensée politique de Leibniz, Paris, P.U.F.
SPINOZA Baruch, 1954, L’éthique, Paris, Gallimard.
Articles et revues
BANGOURA Dominique, octobre 2007, « les liens entre paix et développement en Afrique : Débat 103, n°28, p.127-136, Dakar.
GUEYE Babacar, 2009, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », pouvoir la démocratie en Afrique, n°129, Paris, Seuil, p. 5-26.
Paris Henri, « La démocratie en Afrique subsaharienne », géopolitique des Afriques subsahariennes, n°25, p. 100.
LA PHILOSOPHIE DE L’ART CHEZ MARCUSE : UN DÉSENGAGEMENT ENGAGÉ
Amara SALIFOU
Université Péléforo Gon COULIBALY (Côte d’Ivoire)
salifouamara@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
À contre courant des positions classiques qui présentent tantôt l’art comme un “miroir de la société” ou comme une œuvre engagée aux côtés de causes sociales, Herbert Marcuse pense plutôt que de telles définitions sont étriquées et dangereuses. L’art doit être pour tous et contre toutes les formes qui enlaidissent la société industrielle établie, la société sous domination technologique, qui sclérose toutes les formes de changement. Mieux, aux côtés de la philosophie, l’art doit aider à faire éclore les possibilités d’épanouissement qu’offre l’existence.
Mots clés : Art, esthétique, société industrielle établie, théorie critique, négatif-désublimation, positif.
ABSTRACT :
In against current of the classical positions which sometimes introduce art as “mirror of the society” or as work hired beside social reasons, Herbert Marcuse thinks rather than such definitions are cramped and dangerous. Art must be for all and against all forms which make look ugly the established industrial society, the society under technological domination, which scleroses all forms of change. Better, beside philosophy, art must help to make hatch the possibilities of development which gives existence.
Keywords: Art, aesthetics, industrial society established, critical theory-negative, desublimation, positive.
INTRODUCTION
Dans l’entendement des philosophes de l’Ecole de Francfort, dont fait partie Herbert Marcuse, « l’art est une réalité ambivalente. Fait social paradoxal parce que se posant dans la société en s’opposant à elle, il n’est pas coupé de la réalité, mais s’efforce de s’inscrire en son sein pour mieux en exprimer les contradictions » (Y. Cusset et S. Haber, 2002, p. 7). L’art ne se désintéresse pas des formes de domination en œuvre dans la société mais s’y oppose comme un négatif qui relève en même temps les perspectives d’épanouissement que cette société refuse de voir. C’est un autre monde qu’affirme l’art comme négatif de ce monde. T. W. Adorno (1974, 2011, p. 9, 11), un des membres de l’Ecole de Francfort affirme à propos que :
« les œuvres d’art se détachent du monde empirique et en engendre un autre possédant son essence propre, opposé au premier(…) L’art acquiert sa spécificité en se séparant de ce par quoi il a pris forme ».
La négation, l’opposition et l’altérité sont consubstantiels à l’œuvre d’art dans le sens, non d’un enfermement mais d’un accompagnement engagé de ce qui demeure sous la critique, à savoir, l’existence quotidienne. Parlant précisément d’Adorno en ce qui concerne sa réflexion sur l’art, H. Marcuse (1979, p. 8) affirme ceci : « Quant à ma dette vis-à-vis de la théorie esthétique de Theodor W. Adorno, il est presque superflu de la signaler ici ». Dans le sens où les pensées d’Adorno, dans les réflexions de Marcuse sur l’art, sont comme des piliers qui soutiennent sa démarche sur l’engagement artistique. Mais en quoi consiste donc l’engagement de l’art chez Herbert Marcuse ?
Quelle est la particularité de la forme et du fond de cet engagement ? L’engagement de l’art dans la philosophie marcusienne est-il purement dénonciateur ou vise-t-il une sphère jusqu’alors non atteinte ?
La réponse est que chez Herbert Marcuse l’engagement de l’art est en même temps désengagement sous la forme du négatif, de la subversion mais aussi engagement en tant qu’ouverture opposée à la société établie. Il s’oppose à cette société qui a réussi, grâce à ses prouesses technologiques, à maintenir un monde de statu quo et de conformisme tout en bloquant l’éclosion des potentialités d’affranchissement contre laquelle se mobilise d’ailleurs le monde établi.
Ainsi, dans le rapport entre la philosophie et l’art, il conviendrait de saisir le désengagement esthétique et la subversion artistique chez Marcuse. Ensuite, il nous faut voir les rapports que l’art entretien avec la société à laquelle il semble appartenir et contre laquelle il semble s’opposer. Enfin, nous verrons la particularité de l’engagement de l’art dans le changement que promeut la théorie critique marcusienne.
Au terme de cette réflexion qui s’appuie sur l’analyse et la critique nous essayerons de percevoir la particularité de la philosophie de l’art chez Herbert Marcuse et les perspectives à dégager pour un monde moins conflictuel et plus épanouissant.
1. DÉSENGAGEMENT ESTHÉTIQUE ET SUBVERSION CHEZ MARCUSE
La perception engageante que la philosophie marcusienne a de l’art ne saurait faire l’économie de deux principes fondamentaux à savoir : la particularité de l’esthétique et le caractère subversif de l’art.
1.1. Art et l’engagement esthétique chez Marcuse
Il semble admis que l’esthétique, le beau, les beaux-arts soient perçus comme des identités inséparables de l’art. Tout art pourrait-on dire vise ainsi le beau. On retrouve en effet, l’esthétique, dans l’œuvre d’art comme le signe qui l’auréole et dont elle ne peut se passer afin de continuer de conserver ces formes d’attirance et cette illumination qui lui sied à propos. L’esthétique marcusienne a cette profondeur que retiennent A. Feenberg et J. David (2002, 2003, Quaderni n°49) lorsqu’ils disent ceci :
« La référence de Marcuse à l’esthétique peut être comprise, non pas seulement comme l’introduction d’un critère de beauté dans des jugements politiques radicaux, mais comme la forme apriori d’un nouveau type d’expérience au sein d’un nouvel ordre social ».
Une façon de dire que la beauté à laquelle fait allusion Marcuse jouit de son autonomie et n’appartient pas à la pesanteur de ce monde de contraintes technico-sociopolitiques, à ses sources d’intérêts et à son expérience du vécu standardisé. A. Comte (1936, p. 66) précise en effet, qu’« il y a une beauté des choses et des êtres, une beauté des manières d’être, et l’activité esthétique commence par la ressentir et l’organiser en la respectant quand elle est naturellement produite. L’activité technique, au contraire, construit à part, détache ses objets, et les applique au monde de façon abstraite ». Ainsi, là où la technique et son mode de standardisation tendent à l’uniformisation et à la désacralisation afin d’instaurer la banalité ; l’esthétique garde encore ses fondamentaux qui s’inscrivent dans les valeurs universelles. L’esthétique revendique sa venue d’un ailleurs qui s’oppose à la radicalité de ce monde de conflit en proposant l’existence d’autres mondes antagoniques. Ces mondes sont ceux qui remettent en cause les formes qui se font passer comme étant les plus belles alors qu’elles ne célèbrent que des catégories inessentielles, factices et marchandes. M. Jimenez (1997, p. 18) fait bien de nous rappeler que « l’esthétique (…) quel que soit son souci de répondre aux urgences du temps présent, ne peut que se remémorer en permanence de son origine philosophique ». On ne saurait faire de la recherche du beau, une affaire de tendance, d’empirisme creux ou de violation de ce qui peut encore avoir une valeur.
C’est bien pour cela que l’esthétique marcusienne célèbre les valeurs à l’exemple de l’union. Il n’est pas engagé dans l’art en opposant des camps dans la société. De ce fait, elle se détache non seulement des clichés antagonistes dans et de la société, et surtout de l’esthétique marxiste.
Si l’esthétique marcusienne a bien en commun avec l’esthétique marxiste, la révolution, les voies pour atteindre ce “saut qualitatif”, ne sont pas les mêmes. « À l’inverse de l’esthétique marxiste orthodoxe, c’est dans l’art lui-même, dans la forme esthétique en tant que telle, que je trouve le potentiel de l’art ». (H. Marcuse, 1979, p. 9).
L’esthétique marxiste oppose l’art du prolétariat à l’art bourgeois avec une préférence pour le premier. Le grand dictionnaire de la philosophie (2003, p. 213)qui cite Georg Lukács et Bertolt Brecht nous rapporte que : « enrôlant l’artiste dans l’action politique, la critique marxiste fait coïncider militantisme et révolution formelle ». La valeur universelle de l’esthétique marxiste finissant ainsi par s’inscrire dans une fonction politique aux côtés, essentiellement d’une classe donnée, celle du prolétariat. H. Marcuse (1979, p. 30) remet en cause une telle position en affirmant que :
« L’universalisation de l’art ne peut se fonder sur l’univers et la conception de l’univers d’une classe particulière, car l’art dirige sa perspective sur un universel concret, l’humanité (…) qui n’est contenu dans aucune classe particulière, pas même le prolétariat, la « classe universelle » de Marx ».
Ce n’est donc pas une esthétique de gauche ou de droite, de bourgeois ou de prolétaires, d’un milieu social donné par rapport à un autre milieu social qui doit être privilégié. Il s’agit d’éviter d’être entraîné dans le monde biaisé du statu quo qui limite le changement dans les luttes sociales actuelles et dont l’aboutissement ne peut que donner une image réchauffée de la même société de domination avec des acteurs qui ont tout simplement changé.
Le but esthétique visé, à l’inverse, c’est celui de s’engager au-delà de cette existence constamment conflictuelle et pénible tout en ne l’ignorant certes pas mais bien en a faisant éclore ses nombreuses possibilités encore ignorées à cause de la position d’affrontement dans laquelle l’on semble s’être résolu, coûte que coûte, à s’engager. « Jouer avec des éléments de la réalité sans les copier comme dans un miroir, sans prendre aucune position, en trouvant son bonheur dans la liberté de ne pas obéir aux ordres, est bien plus dénonciateur que de prendre officiellement le parti de dénoncer » (T. W. Adorno, 1984, p. 433). Le jeu esthétique brise bien évidemment toutes les barrières antagoniques tout en réussissant la prouesse de faire river tous les yeux sur des sujets pour lesquels tout le monde fini par se sentir soucieux. Mieux, il a cette magie de transposer, de transporter tout un chacun vers une réalité que la réalité de la société de domination réussissait grâce à ses artifices, à étouffer. On se retrouve dans un clair-obscur, dans un paradoxe où est un message bien clair est pourtant délivré.
1.2. Le paradoxe artistique
Le paradoxe artistique chez Marcuse renvoie à cette évidence que l’art ne saurait être aux côtés des membres d’une même société tout en s’opposant aux autres membres. Toutefois, l’art n’ignore pas les réalités qui tirent la société vers l’inhumanité. C’est bien à ce niveau qu’il exprime, une fois de plus sa position d’être un négatif contre toutes les distorsions tout en gardant sa forme subversive. Le paradoxe de l’art subversif tient du fait que l’art doit être l’unité du peuple et de l’esprit.
« Marcuse définissait le roman d’art comme l’expression d’une époque où l’unité de l’art et de la vie s’était déchirée, où l’artiste se retrouvait solitaire avec sa « nostalgie métaphysique de l’idée et de sa réalisation » face à l’intense petitesse et pauvreté » des modes de vie dans la réalité » (R. Wiggershaus, 1993, p. 92).
Cette vie n’est plus celle de l’art. Elle n’est pas non plus une vie que l’art ignore. La misère qui y ait entretenue, les violences qui y sont créées, le mensonge érigé en mode d’existence sont une horreur pour le véritable artiste qui rejette ce monde où tout est positivé comme étant l’évolution normale des choses alors que c’est le mode factice dans lequel le système des puissants a pris le temps de nous y maintenir et à fini par nous le faire admettre dans notre majorité. C’est pourquoi, la première action de tout art, c’est d’être négatif à ce mode de vie où la domination est justifiée. « L’art présente une de ces vérités. En tant qu’idéologie, il s’oppose à la société donnée » (H. Marcuse, 1979, p. 28). Il est idéologie, en ce sens qu’il combat cette société qui maintien et entretien l’exploitation des classes, le pillage des ressources, les affrontements, la vie standardisée et toutes ces libertés étouffées de part et d’autre d’une société qui a oublié de prôner la vie mais chante la mort. Son opposition à cette société prouve aussi qu’une autre société est possible. « L’art, de par sa nature, échappe à la pensée ambiante et permet à l’individu de découvrir un univers autre que ce qui lui est présenté. Il est la voie indiquée pour l’autonomie du sujet » (D. L. Fié, 2011, Baobab 8). Ce qui était alors juste présenté à l’individu ressemble bien à une prison d’où on n’en sort jamais. Nous sommes comme dans une situation « d’institutions extractives » (D. Acemoglu et J. Robinson, 2015, p. 426) qui renforcent une gouvernance légitimement illégitime mais qui maintient, grâces à des subterfuges “normaux”, la réalité de la soumission et de l’exploitation. L’art prend en ce moment l’engagement de montrer le monde tel qu’il est mais aussi de montrer tous ces mondes possibles qui sont rendus impossibles.
2. ENGAGEMENT DE L’ART DANS LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ÉTABLIE
L’art, dans la conception marcusienne, a une fonction bien précise. Ce rôle s’inscrit dans le cadre du combat que mènent les forces d’avenir face aux tenants des activités rétrogrades. La cible première de l’art est bien évidemment la société industrielle établie qui a fait du monde une existence de labeur, d’antagonisme et de lutte quotidienne pour la survie comme si le monde ne pouvait être autrement que ce qu’il se donne actuellement à voir.
2.1. L’art est unité et non division
La société industrielle établie a pour particularité, une forte capacité d’évolution technologique, qui au lieu de favoriser l’unité, la libération et l’épanouissement individuel ; renforce plutôt tout un système de contrôle et de domination sur l’ensemble des sociétés, instaurant ainsi une lutte pour l’existence, une domination perpétuelle d’une minorité sur une majorité et créant constamment des parias et des exclus du système. Pourtant,
« les sociétés établies ont des ressources économiques et techniques telles qu’elles peuvent se permettre des conciliations et faire des concessions aux misérables ; elles ont des forces armées assez bien entraînées pour faire face aux situations d’urgence. Cependant la menace est là encore, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières… » (H. Marcuse, 1968, p. 280).
L’art ne peut, conformément à son essence universelle, accepter que tout soit mis en œuvre pour instaurer la division là où tous les ingrédients existent pour garantir l’unité, le bien-être individuel et collectif. L’art n’a pas pour principe d’être une simple copie de ce monde mais d’être plutôt une force contestataire à ce qu’elle représente. Il conserve en priorité cette force dynamique qui nous maintien dans l’espérance et nous élève sans cesse vers des cimes réellement en phase avec le bonheur, avec une vie vraiment harmonieuse. La contribution de l’art pour une société multiforme, ne se manifeste pas à l’image d’une lutte qui doit être menée avec des objectifs bien précis à atteindre en se tenant aux côtés d’une frange de la population.
Si c’était le cas, on détournerait l’art de sa nature d’être ouverte à toutes les sensibilités, de pouvoir inspirer tout un chacun, d’être un lien d’union plutôt que de désunion. Il ne faut donc pas croire qu’on rend service à l’art en faisant de lui quelque chose d’engagé, au sens traditionnel du mot, avec tout un discours élaboré à cet effet. Il est surtout dangereux pour l’art d’être du côté d’un camp contre un autre dans la même société. Ceci n’est pas pour les artistes ou pour les arts, une crainte ou une peur mais un sacerdoce. Celui d’être une réflexion qui valorise les universaux de l’unité, de la fraternité, de l’amour, du bonheur perdu que les intérêts aveugles nous en éloignent et dont l’effet de boomerang ne peut être que forcement catastrophique pour chacun des antagonistes d’hier. Remplacer des anciens riches par des nouveaux riches, c’est toujours perpétuer l’injustice qu’on dénonçait.
C’est pourquoi, « l’art participe directement à la communication du sentiment des individus et donc à la constitution de la « sociabilité » sans supprimer l’individualité du sentiment lui-même… » (F. D. E. Schleiermacher, 2004, p.14). Une façon de dire que l’art n’intervient pas comme un démiurge en ignorant ceux vers qui son discours est pourtant destiné. Il n’est pas non plus catégorisant et exclusif. Il est d’abord et avant tout rassembleur et libérateur. C’est pourquoi le véritable art est celui dans lequel chaque membre de la société, se reconnaît.
Quand toute une administration, toute une industrie est en marche pour s’accaparer l’art, l’orienter, lui assigner des taux d’audience, il faut craindre qu’il soit tout simplement vidé de sa substance réelle. Un exemple typique de cette dénaturation est celle que relève Adorno lorsqu’il fait référence à ce que le jazz, cette musique des esclaves noirs, a fini par devenir, à force d’être chaque fois transformée et modernisée. Il relève en ce sens que :
« les allures sauvages des premiers jazz-bands du Sud, surtout de la Nouvelle-Orléans et de Chicago, se sont assagies avec le progrès de la commercialisation et l’élargissement du public, avant d’être ranimées par des professionnels qui régulièrement retombaient à nouveau dans le commerce, qu’ils appellent swing ou bebop, perdant ainsi de leur mordant » (T. W. Adorno, 1986 : 102).
Le mordant artistique tant recherché ne consiste donc pas à faire coûte que coûte de l’art, une œuvre gigantesque qui s’inscrit obligatoirement dans les rouages du business, de la “star system’’ ou même de s’attendre à ce que l’art mène un certain nombre de luttes sociales. Le monde de l’art est bien différent de celui de la technique, du calculable et de l’immédiat. C’est un monde d’un vaste chantier d’espérance.
2.2. L’art est espérance et non espoir
« C’est seulement à cause de ceux qui sont espoir que l’espoir nous est donné » (H. Marcuse, 1968, p. 281). Ce sont les derniers mots de “L’homme unidimensionnel” que Marcuse emprunte à Walter Benjamin. Ces mots siéent parfaitement à l’art qui chante encore l’espérance là où il ne semble plus avoir d’espoir. C’est l’espérance de toutes ces potentialités dont regorge le monde et qui peuvent être des leviers à la fois économiques, sociaux, sécuritaires, de joie, de loisirs ou de paix afin de combler la totalité que constitue l’individu et la société. Espérer, c’est s’attendre à une satisfaction immédiate qui cache hélas toutes les autres attentes. Être par contre dans l’espérance, c’est réclamer pour notre individualité, la totalité à laquelle aspire l’art.
En réalité et surtout « en vertu de sa forme esthétique l’art jouit d’une large mesure d’autonomie vis-à-vis des rapports sociaux donnés. Par son autonomie, l’art s’oppose à ces rapports et, en même temps, les transcende. L’art subvertit ainsi la conscience dominante, l’expérience ordinaire » (H. Marcuse, 1979, pp. 9-10).
Ce qui signifie que quand l’art parle de ce monde, il n’en parle pas telle qu’il est seulement mais en parle dans un style qui lui est propre et dans lequel un degré d’élévation personnel pourrait nous permettre de saisir ou du moins d’approcher ce qu’il ne dit pas de façon immédiate. Nous sommes, avec l’art, dans le monde du clair-obscur, du réel-irréel, du physique et de la métaphysique. C’est peut-être là, qu’il nous faut rechercher le vrai sens de l’art, son vrai discours dont la cohérence toujours incohérente qui constitue en même temps son levier, sa pâte subversive et créatrice. L’art, s’il ne constitue certainement pas à lui seul, le changement, n’en demeure pas moins une remise en cause de la réalité établie. Ce que transmet l’art n’a rien d’identique avec l’existant mais diffère bien avec ce qui est. Soit par la façon dont il représente le monde. Soit par un autre monde qu’il nous fait découvrir. Ce qui signifie donc que l’art donne obligatoirement du monde un autre visage.
Ce visage du discours artistique n’est jamais neutre. Il suffit de voir comment nous sommes emportés par une musique, un tableau, une photographie, une sculpture, un poème… Toutes ces œuvres parlent d’une façon ou d’une autre du monde dans lequel nous vivons. Elles n’en parlent pas comme si elles étaient une copie représentative de ce monde. Non ! Elles en parlent avec des formes qui leur sont propres. Avec une manière donnée que nous n’avons pas toujours l’habitude de voir. Avec un certain ton qui nous paraît venir d’un ailleurs. Elles parlent de ce monde comme si ce n’était pas de lui qu’elles parlent. Ce qu’elles disent, bouleverse le monde, le fait tressaillir, le perturbe, le fait chanceler.
C’est en effet, un discours nouveau qui est tenu ici. Ce n’est pas un discours démonstratif, explicatif, c’est tout simplement une nouvelle manière de voir les choses. Elles mettent à nue certaines situations, pour rétablir certaines vérités. Les fameux “ vieux souliers aux lacets’’ du peintre Vincent Van Gogh (1853- 1890) sont un message assez fort pour montrer comment l’art est capable d’attirer l’attention sur un sujet que tout le monde feint de ne pas voir afin de ne pas créer le changement qui s’impose. Ces “vieux souliers aux lacets’’ ne sont pas seulement vieux, ils sont sales, crasseux, en piteux état, rafistolés et indiquent tels qu’ils se présentent, la situation sociale de celui qui les porte.
À quel type de société avons-nous affaire pour qu’un individu puisse se retrouver dans un état de dénouement pareil avec des souliers aussi affreux ? Une tentative de réponse pourrait tout de suite nous amener à penser que nous avons certainement affaire à une société exploitante, appauvrissant ou tout simplement peu soucieuse des conditions de vie des individus en son sein. M. Heidegger (1950, p. 27) peut en ce sens nous rappeler que : « la toile de Van Gogh est l’ouverture de ce que le produit, la paire de souliers de paysan, est en vérité ». Cette toile qui dévoile l’être que l’étant de la société tente d’ignorer, d’étouffer.
Quel que soit le cas, cette société est criminelle. Elle nous renvoie dans un état de guerre, animalier et sauvage. C’est contre ce renversement des choses que l’art se dresse. L’art présente la société dans ses faces les plus individuelles, les plus personnelles, pour attirer l’attention sur des cas qui peuvent paraître essentiellement particuliers mais qui traduisent réellement ce que le monde a fait des individus. Ainsi, à partir de ce qui semble être un simple tableau, il se dessine tout un monde que l’art interpelle, qu’il met en cause, qu’il critique.
C’est bien pour cela que la société industrielle, lorsqu’elle ne réussit pas à l’intégrer dans son industrie culturelle, n’a d’autres moyens, que de le tourner en dérision et de traiter tous ces artistes qui refusent de jouer le jeu de l’enfermement ; d’illusionnistes, de rêveurs. Ce qu’on feint d’ignorer c’est qu’en vérité, « l’œuvre d’art transforme l’ordre qui préside à la réalité. Cette transformation est une « illusion », mais une illusion qui confère au contenu représenté un sens et une fonction différente de ceux qu’il a dans l’univers habituel du discours » (H. Marcuse, 1973, p. 108). L’illusion artistique est tout sauf une pure et simple illusion. Ce qui est appelé ici illusion n’est certes rien par rapport au quotidien de ce monde, mais un tout autre monde avec une réelle signification qui, introduite dans ce monde-ci, ne peut que lui donner un sens plus humain, plus universel.
C’est vrai que l’art ne se sert pas ici de coup de boutoirs, de fusils d’assauts, d’armes de destructions massives pour s’imposer, pour traduire ce qu’il ressent mais il se sert de cette force irremplaçable qui est le verbe créateur, de ces styles, de ces manières, de ces formes qui touchent, même les âmes les plus endurcies.
En effet, « l’œuvre d’art possède une identité originale et complexe. Son caractère « anti- institutionnel », sa puissance indisciplinaire et protestataire, lui permettent de s’opposer à la brutalité de la société administrée. Par sa singularité, comme par sa modalité d’existence décalée, elle expose sa différence face à l’ensemble des simples choses (…) » (J. M. Lachaud, 2003, p. 270).
L’on semble des fois ne rien comprendre au discours artistique parce que son langage est tout sauf celui qu’on tient habituellement sur la marche de la société. Ce caractère apparemment étrange constitue sa marque et son pouvoir d’opposition au monde tel qu’il se donne à voir. La vie, celle qui mérite d’être menée est bien loin d’être totalement plate. Elle est plutôt un ensemble de richesses, faite de couleurs, de sons, de lumières, d’extraordinaires beautés, de calme, d’activités fécondes, de joies, de peines qui ne demeurent pas éternelles, de félicité, d’harmonie, d’amour, de partage… Il serait bien difficile de retrouver toutes ces qualités dans la société industrielle établie. Elle qui reste toute engluée dans la raison instrumentale et pour qui ne compte que l’ici-bas. Ce qui est tout le contraire de l’art.
Il ne faut pas l’oublier, l’une de ses principales définitions c’est qu’il est création. Il est la garantie d’un espoir éternel que la masse ne saurait étouffer. L’art est liberté et c’est d’ailleurs ce que ne cesse de protéger la culture en permettant à la pensée, au sentiment, à l’inspiration de constamment traduire cela dans les œuvres.
La culture, précisément, « parle de la dignité de l’Homme, sans se soucier d’une existence réellement plus digne des hommes. La beauté de la culture est avant tout une beauté intérieure et ne peut toucher l’extérieur qu’à partir de l’intérieur ; son domaine est essentiellement celui de l’âme » (H. Marcuse, 1970, p.118). La vie en ce sens mérite respect. Il s’agit de respecter toutes les vies. Pour avoir une telle réaction, il est bien évident qu’il nous faut avoir une bonne dose d’élévation que l’art peut justement nous permettre d’avoir. L’artiste, parce qu’il a justement cessé d’être comparé depuis longtemps à l’artisan, garde encore cette particularité de pouvoir nous faire rêver de mondes meilleurs auxquels chacun de nous a droit. Le monde que promet l’art est sans aucun doute celui d’une félicité telle que chacun peut à nouveau se sentir en train de revivre. On peut dans ce cas reconnaître donc que « la beauté de l’art est (…) compatible avec l’insuffisance du présent, car elle peut y apporter le bonheur » (H. Marcuse, 1970, p.133). Tout cela peut paraître comme une sorte de croyance, de rêve, d’invention, d’imagination pour se réfugier dans un certain monde chimérique.
Si on a de telles pensées, c’est qu’on n’est pas sorti du trou dans lequel nous avons été placés depuis très longtemps. Ce qui veut dire que la machine de l’enfermement continue toujours de bien fonctionner et que nous sommes partis pour n’avoir pour seul repère que la société industrielle établie. Il est évident que se donner beaucoup de mal pour prouver qu’il n’y a pas meilleure société que celle-ci, c’est certainement admettre que d’autres formes de vies meilleures sont possibles. Pour cela, il faut non seulement avoir de l’imagination pour penser une telle réalité tout comme pour construire ces autres mondes. Pour ce combat, l’art n’est pas seul.
3. LA PLACE DE L’ART LA DANS THÉORIE CRITIQUE MARCUSIENNE
3.1. La théorie critique marcusienne
L’outil principal dont se sert Marcuse, avec lui, la plupart des philosophes de l’École de Francfort tels Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, Löwenthal ou Habermas, est la “théorie critique” qui consiste à faire advenir le changement social. En référence à deux membres de l’École de Francfort, à savoir Horkheimer et Habermas, le premier parce que représentant un des membres fondateurs de l’École et le second parce que pouvant être perçu comme étant celui qui représente une autre forme d’appréciation des réflexions de l’École ; nous pouvons dire que la théorie critique se donne à voir avec plus d’engagement et d’objectivité en ce qui concerne les mondes souhaités en opposition à la société industrielle établie.
« Dans les textes fondateurs de l’École de Francfort, Horkheimer définit la critique comme la « propriété essentielle de la théorie dialectique de la société », comme la seule alternative à la pratique dominante d’une science à la fois aveugle sur elle-même, sur son environnement historique et sur ses effets sociaux … » (Y. Cusset et S. Haber, 2002, p. 15).
La science dont la critique est faite ici, concerne à la fois, la raison qui est devenue, depuis les Lumières, de plus en plus obscure et qui se mue en raison instrumentale, ramenant tout au calcul, au profit, à la domination matérielle, à la force. Son pendant est le capitalisme qui ne cesse de conforter ses assises sur l’univers entier, sur les individus et sur la nature. Comme première alternative, M. Horkheimer (1974, p. 38) pense déjà que :
« L’homme peut prendre pour objet la société elle-même. Cette attitude ne vise pas simplement à éliminer certains défauts de la société (…) ; ils lui apparaissent bien plutôt comme liés de façon nécessaire à toute l’organisation de l’édifice sociale. Bien qu’elle soit elle-même un produit de la structure sociale, elle n’a pas pour intention consciente ni pour effet objectif d’améliorer en quoi que ce soit le fonctionnement de cette structure ».
La structure sociale forme en elle-même un tout et doit être appréhendée dans son aspect global. Une vision qui diffère d’ailleurs de la critique ancienne où l’on semble percevoir essentiellement deux entités qui s’opposent.
Habermas s’inscrit lui aussi dans la théorie critique. Sa réflexion ne s’arrête pas à l’analyse, à la dénonciation ou à une certaine proposition de principes à adopter ; mais à la mise en place d’une théorie critique qui épouse à la fois une démarche procédurale et qui en plus, privilégie la communication sur tout sujet donné. On dit à propos de la Théorie Critique habermassienne, qu’elle s’écarte d’une certaine façon de celle soutenue jusqu’alors par la plupart des membres de l’École de Francfort, pour finalement se présenter comme étant une “éthique de la communication’’. Pour revenir à la pensée que J. Habermas (1985, p. 309) a de la théorie critique, il faut savoir qu’il soutient lui-même que :
« la réflexion critique attaque de front l’absolutisme de la philosophie de l’origine et de la théorie pure, la compréhension scientiste que peuvent avoir d’elles-mêmes les sciences, ainsi que la conscience technocratique d’un système politique coupé de ses enracinements pratiques ».
Ce qui signifie que malgré ses bonnes intentions, la philosophie ne saurait à elle seule constituer l’unique source décisionnelle de toute action. Même si la science n’est pas elle aussi la voie royale à retenir.
Chez Marcuse, la Théorie critique, avec comme guide principal, la philosophie, devient véritablement incontournable si l’on veut faire preuve d’une réflexion qui embrasserait la marche du monde dans toutes ses représentations. Au contraire certainement de Habermas, Marcuse ne croit pas que ce soit le moment propice, pendant lequel nous nous trouvons dans une crise de l’orientation du monde due à une trop grande responsabilité accordée à la domination technologique qu’il faille diminuer le poids de la philosophie en l’obligeant à s’adapter à un certain nombre de conciliabules. C’est « (…) un raisonnement extrêmement dangereux de prétendre qu’aujourd’hui on ne peut plus opérer avec des arguments humanitaires » (H. Marcuse, 1968, p. 58).Une telle croyance serait tout à fait paradoxale car l’évidence est qu’autant les terres, les airs et les mers sont liés ; autant l’histoire des individus, la vie des plantes et des animaux, ne sont jamais totalement et entièrement séparées. Il nous faut retenir la corrélation qui lie tout l’univers et ne pas tomber dans l’éparpillement. Le discours artistique a ainsi toute sa place dans la théorie critique.
3.2. Théorie critique et discours artistique
Dans cette quête à l’unité et à la lutte, l’art se présente pour la théorie critique comme un canal extraordinaire qui permet de montrer que la contestation, la fraternité et l’ouverture sont encore possibles. En réalité, « le monde qui fait l’objet de l’intention artistique n’est en aucun cas seulement le monde donné de la réalité quotidienne, mais ce n’est pas non plus un monde de pure fantaisie » (H. Marcuse, 1979, p. 65). L’œuvre artistique ne saurait donc se contenter de représenter le monde tel qu’il se présente, de l’accepter et donc de s’y maintenir. C’est pourquoi sa première action, c’est d’en sortir en même temps. L’art sait que la société existante est loin de garantir toutes les possibilités qui pourraient normalement s’offrir aux individus. C’est pourquoi quand l’art parle de l’existence établie à travers la musique, les tableaux, la sculpture, le roman, l’essai, la danse, le cinéma ou le théâtre ; jamais il ne saurait se contenter de la présenter seulement telle que ce qu’on a fait d’elle mais toujours telle qu’elle peut être ou telle qu’on peut souhaiter qu’elle soit. L’art montre qu’un autre monde ou que plusieurs autres mondes sont encore possibles.
Dans notre habitude de tourner généralement ce qui nous est inconnu en dérision, nous pensons souvent que ce que disent les vrais artistes relève de la démangeaison d’une réflexion quelque peu embrouillée. En fait, c’est certainement nous qui avons tellement été confondu à la société administrée de telle sorte que nous avons perdu toute possibilité de nous élever de la platitude de ce monde. L’art prouve non seulement que la fraternité, l’humanisme, le partage ou la liberté, sont encore possibles mais qu’il ne faut jamais se soumettre à la toute puissance dominatrice, fusse-t-elle, celle d’une société qui semble avoir la main mise sur tout.
Le discours de l’art est avant tout, le cri d’une colère qui affirme qu’il nous faut nous élever au-delà de ce vers quoi nos yeux sont rivés afin d’atteindre la jouissance d’une âme, devant des signes de joie de plus en plus rares, du fait d’une société qui a fini par tout faire rentrer dans le moule glacial de la chosification. En prenant ainsi position, l’art se laisse saisir dans l’un de ses principaux objectifs, « la reconstruction de la société et de la nature de façon à accroître la possibilité humaine d’accéder au bonheur » (H. Marcuse, 1979, p. 67). L’existence des individus, mais aussi la vie de la nature avec ses animaux, plantes, terres, rivières, fleuves ou mers, sont tous considérées avec les mêmes égards par l’art qui nous rappelle ainsi l’interaction, la dynamique entre tous les êtres qui forment l’univers.
Le véritable art s’inscrit donc dans cette logique qui défend La rébellion instinctuelle, l’éveil d’une nouvelle sensibilité, la dénonciation des maux qui tirent la société et la nature vers des modes de vies qui la détruisent plus qu’ils ne l’améliorent. La réparation des injustices à l’endroit des masses, la libération des riches de leur enrichissement illicite qui les met constamment en danger, l’écoute des minorités, des marginalisées, des jeunes, la revendication de leurs droits par les femmes et la prise en compte de leurs visions sur la société, la foi que la naissance d’autres mondes que celui qui nous est servi par la technologie administrative depuis plusieurs siècles ; sont donc toujours possibles. Tout simplement parce qu’avec l’art,
« nous sommes au confluent des forces irrépressibles qui enveloppent l’érotique, l’esthétique et l’éthique dans une conscience en révolte contre toute forme de répression, et que Marcuse appelle, tour à tour, révolte éthico-sexuelle ou esthético-érotique » (A. Nicolas, 1970, p. 163).
Il s’agit de réconcilier la société avec elle-même, en n’en faisant pas essentiellement un monde de labeur, de profit, d’intérêt, alors que le monde a les potentialités technologiques et naturelles qui pourraient favoriser l’avènement d’un monde libéré des contraintes. L’imagination artistique, loin d’être une imagination de vaine utopie fait éclore tous ces instincts qui demandent libération en vue de garantir une société paisible pour tous. C’est le rôle de l’art, mais aussi de « la théorie critique… (qui) doit recueillir les possibilités extrêmes de la liberté » (H. Marcuse, 1968, p. 15). Ainsi au contraire d’une société industrielle établie qui recherche sans cesse le gain ; l’art et la théorique critique recherchent l’épanouissement
Même si nous ne comprenons pas toujours le nouveau discours qui est ici en marche. C’est encore là, un autre rôle de la philosophie critique, que de nous permettre de décrypter le sens de l’évolution actuel de ce monde, à la merci de la technologie. De montrer tout comme l’art et tous ces mouvements de contestation qui essaient de nous le faire comprendre, qu’il y a plus qu’hier, matière à réflexion pour un réel changement. Pour l’avènement, non seulement d’une meilleure façon d’appréhender l’existence, d’une stratégie à adopter pour mener la lutte. Tout comme l’existence de nombreuses possibilités qui nous sont offertes pour mieux vivre.
CONCLUSION
Dans la riche tradition des luttes sociales pour le changement, Herbert Marcuse, en marchant dans les pas d’Adorno, engage l’art dans une particularité contre la société industrielle établie. Celui d’être engagé en n’étant pas engagé auprès d’un groupe constitutif contre un autre de cette même société. Le progrès technologique a aussi réussi à créer une société engourdie où même les forces qui devraient constituer l’expression de sa remise en cause, participent à son maintien dans une désublimation répressive par la satisfaction de besoins qu’elles croient être les leurs alors que ce sont des faux besoins. R. D. Precht (2012, p. 328) peut nous rappeler que : « Le fait est que ce qui nous paraît si commun que nous attribuons aujourd’hui à la nature humaine a été totalement étranger aux hommes durant des millénaires ». La couche matérielle et ses appendices de cupidité, d’intérêts qui ne cessent de grandir dans nos sociétés avec quelques privilégiés nous fait hélas très souvent oublier toutes les souffrances étouffées qu’on refuse d’entendre. Marcuse nous rappelle donc que la société demeure une finalité. Cette unité ne saurait faire l’économie de la force rebelle que constitue l’art. Le combat de l’art est celui de la philosophie, fer de lance du changement, mais aussi, de certaines sources de réflexions et des couches sociales constamment exclues, chez qui l’imaginaire d’une meilleure vie est encore en éveil.
BIBLIOGRAPHIE
ACEMOGLU Daron & ROBINSON James A., 2015, La faillite des nations, les origines de la puissance, de la prospérité et de la pauvreté, traduction de l’anglais (États-Unis) de Philippe Aghion, Genève, Marcus Haller.
ADORNO Theodor, Wiesengrund, 1974, 2011,Théorie esthétique, trad. Marc Jimenez, Paris, Klincksieck.
ADORNO Theodor, Wiesengrund, 1986, Prisme, critique de la culture et société, traduit de l’allemand par Geneviève et Rainer Rochlitz Paris, Payot, 1986.
COMTE Auguste, 1936, Cours de philosophie positive, première leçon, Paris, Larousse, Tome I.
CUSSET Yves et HABER Stéphane, 2002, Le vocabulaire de l’école de Francfort, Paris, Ellipses.
GRAND DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOHIE, 2003, Lukacs et Brecht cité in esthétique, philos, sciences, Paris, Larousse.
HABERMAS Jürgen, 1985, Après Marx, traduction de Jean René Ladmiral et Marc B. de Launay, Paris, Fayard.
HEIDEGGER Martin, 1950, Chemins qui ne mènent nulle part, trad.W. Brokveir, Paris, Gallimard.
HORKHEIMER Max, 1974, Théorie traditionnelle et théorie critique, traduction de C. Maillard et S. Muller, Paris, Gallimard
JIMENEZ Marc, 1997, Qu’est-ce que l’esthétique, Paris, Gallimard.
MARCUSE Herbert, 1968, L’homme unidimensionnel, traduction de Monique Wittig, Paris, Minuit.
MARCUSE Herbert, 1968, La fin de l’utopie, traduction de Liliane Roskopf et Luc Weibel, Paris, Seuil.
MARCUSE Herbert, 1970, Culture et société, traduction de Gérard Billy, Daniel Bresson et Jean-Baptiste Grasset, Paris, Minuit.
MARCUSE Herbert, 1973, Contre-révolution et révolte, traduction de Didier Coste, Paris, Seuil.
MARCUSE Herbert, 1979, La dimension esthétique, traduction Didier Coste, Paris, Seuil.
NICOLAS André, 1970, Marcuse, Paris, Seghers.
PRECHT Richard David, 2012, L’art de ne pas être égoïste, pour une éthique responsable, traduit de l’Allemand par Pierre Deshusses, Paris, Belfond.
SCHLEIERMACHER, F. D. E., 2004, Esthétique. Tous les hommes sont des artistes, traduction de l’Allemand par Christian Bernier, Élisabeth Décultot, Marc de Launay et Denis Thouard, Paris, Cerf.
WIGGERSHAUS Rolf, 1993, L’École de Francfort, traduit de l’Allemand par Lilyane Deroche-Gurcel, Paris, PUF.
Articles cités
ADORNO Theodor Wiesengrund, 1984, « L’art est-il gai ? », in Notes sur la littérature, Champs Flammarion, (l’article a été édité en 1967 dans Süddeutsche Zeitung).
FEENBERG Andrew & DAVID Julia, hiver 2002-2003, Marcuse et l’esthétisation de la technologie in Quaderni, n°49, L’« École de Francfort » aujourd’hui. pp. 81-101.doi :10.3406/quad.2002.1568http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2002_num_49_1_1568 consulté le 20 mai 2016 à 13 heures 30 minutes.
FIÉ Doh Ludovic, 2011, Le paradoxe de l’œuvre d’art : Contribution francfortoise à la critique de la modernité, Abidjan, Revue Baobab : Numéro 8, premier semestre in http://www.revuebaobab.org/content/view/140/33/ consulté 15 juin 2016 à 9 heures 03 minutes.
LACHAUD, Jean-Marc, 2003, De la fonction critique de l’art aujourd’hui in Où en est la théorie critique, Sous la direction d’Emmanuel Renault et Yves Sintomer, Paris, La découverte, p. 269-277.
PERCEPTION DE L’IMMIGRATION OUEST-AFRICAINE EN MILIEU RURAL EN CÔTE D’IVOIRE : UNE MENACE OU UNE CHANCE ?
Yogblo-Armand GROGUHE
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
groguhearmand@gmail.com
RÉSUMÉ :
La Côte d’Ivoire constitue le premier pays d’immigration de l’Afrique de l’Ouest. Cette immigration qui est très majoritairement africaine (99%), provient essentiellement des pays de la CEDEAO et plus particulièrement du Burkina Faso (64,73%), du Mali (18,17%) et de la Guinée (4,52%). Par ailleurs, la part des immigrés en milieu rural en Côte d’Ivoire n’a cessé de croitre depuis 1998 passant de 57% à 58% en 2014(RGPH, 2014). Cependant, il faut faire observer que, certaines controverses et polémiques relatives aux immigrés reviennent de façon récurrente depuis plus de trois décennies, notamment sur les questions de la citoyenneté, des tensions sociales et de la démographie. Dans cette étude, nous nous interrogeons sur l’immigration ouest-africaine telle qu’elle est appréhendée, de façon générale, en Côte d’Ivoire. Son objectif est de montrer les regards portés sur l’immigration ouest-africaine par les populations d’accueil en milieu rural. Ainsi, dans l’imagerie des populations locales, l’immigration est perçue plutôt comme une menace et ce, aux plans de la culture, de l’identité, de la religion, de la santé, de l’économie et de la démographie. Ce n’est qu’aux plans du sport et de l’artisanat que les populations locales voient en l’immigration une chance.
Mots-clés : Immigration, intégration, identité, perception.
ABSTRACT :
Ivory Coast constitutes the first country of immigration of western Africa. This immigration is very mainly African (99%), it comes essentially from countries of the ECOWAS and more particularly from Burkina Faso (64, 73%), of Mali (18, 17%) and Guinea (4, 52%). Besides, the part of the immigrants in rural areas in Ivory Coast did not stop growing since 1998 passing from 57% to 58% in 2014 (RGPH, on 2014). However, it is necessary to make observe that, certain controversies and debates relative to immigrants return in recurring way for more than three decades in particular on the questions of the citizenship, the social tensions and the demography. In this study, we wonder about the West-African immigration such as it is dreaded in a general way. Its objective is to show the visions of West-African immigration by rural host populations. So, in the imaging of local populations, the immigration is rather collected as a threat and it in the plans of the culture, the identity, the religion, the health, the economy and the demography. It is that in the plans of the sport and crafts that the local populations see in the immigration luck.
Key words : Immigration, integration, identity, perception.
INTRODUCTION
L’Afrique de l’Ouest est une grande zone de migration. Les populations d’origines diverses passent d’un pays à un autre et se mettent dans une situation d’étranger qui combine à la fois des traits de proximité et de distanciation, selon un continuum qui couvre une grande diversité de circonstances (A. Babo, 2005, p. 23).
Avec plus de 5millions d’étrangers (RGPH, 2014, p. 150), la Côte d’Ivoire constitue le premier pays d’immigration de l’Afrique de l’Ouest. La forte croissance économique ivoirienne, les restrictions des politiques migratoires dans les pays d’immigration voisins (Ghana ; Nigeria) conjuguée à l’instabilité politique d’autres pays voisins (Liberia, Sierra Leone, Burkina, Mali) ont contribué à faire de la Côte d’ivoire la principale terre d’accueil de la sous-région (R. Blion et S. Bredeloup, 1997, p. 710).
En Côte d’Ivoire, la présence étrangère n’est pas récente puisqu’elle se situe dans le prolongement d’anciens mouvements marchands qui ont eu lieu en Afrique entre le 13ème et le 16ème siècle (F. Akindes, 2003, p.10). Par ailleurs, sa visibilité s’est accrue au fil des années. La Côte d’Ivoire comptait 17% d’étrangers en 1965, 22% en 1975, 25% en 1993, 28% en 1998 et 30% en 2014(RGP 1965, p. 115 ; RGP 1975, p. 130 ; MEF 2007, p.12 ; RGPH 1998, p. 63 ; RGPH 2014, p. 150). Cette immigration qui est très majoritairement Africaine (99%), provient essentiellement des pays de la CEDEAO et plus particulièrement du Burkina Faso (64,73%), du Mali (18,17%) et de la Guinée (4,52%). De plus, la part des étrangers en milieu rural n’a cessé de croitre depuis 1998 passant de 57% à 58% en 2014 (RGPH, 2014, p. 150). Le milieu rural apparait ainsi comme un terrain d’étude particulièrement intéressant en matière d’opinion publique sur l’immigration.
Si la stratégie de développement fondée sur l’économie de plantation a reposé essentiellement sur l’emploi d’une main-d’œuvre importante des ressortissants ouest-africains et a contribué au boom économique de la Côte d’Ivoire(B. Bohoun et O. Kouassy, 1997, p. 14), il n’en demeure pas moins que certaines controverses et polémiques relatives aux immigrés et/ou étrangers reviennent de façon récurrente depuis plus de trois décennies, notamment sur les questions de la citoyenneté, des tensions sociales et de la démographie.
En ce qui concerne la question de la citoyenneté, les revendications des étrangers semblent être en relation avec les différentes crises successives qu’a connues la Côte d’Ivoire. En effet, les accords de Linas Marcoussis[4] ont révélé que la question de l’étranger était une des causes de la guerre. C’est pourquoi, ils ont préconisé en leur point Un, un règlement simple à titre exceptionnel de la situation des étrangers en matière de naturalisation par un acte des pouvoirs publics (M. Bats et T. Pettazzoni, 2003, p. 7).
Au niveau des conflits, on note que dans les zones forestières de l’Ouest et du Sud du pays, des conflits fonciers violents opposent très souvent les autochtones aux étrangers (J. P. Dozon, 1997, p.790). A cela, s’ajoutent les conflits entre cultivateurs autochtones et les éleveurs peulhs dans plusieurs régions de Côte d’Ivoire (I. Koné, 2005, p.68). Et, dans les régions du sud littoral, des litiges halieutiques opposent les populations locales aux pécheurs venus de la boucle du fleuve Niger (I. Koné, 2010, p. 230).
Les relations entre étrangers et populations autochtones ont semblé se détériorer pendant les différentes crises militaro-politiques en Côte d’Ivoire. D’une part, les populations locales reprochent aux ressortissants des pays limitrophes leur participation à la guerre de 2002. Et, d’autre part, les autochtones n’acceptent pas de voir leurs terroirs occupés par les étrangers dans les zones tenues par les rebelles. (Y. A. Groguhé, 2009, p. 63).
Au niveau démographique, on note selon le RGPH (2014, p. 150) que les immigrés et/ou étrangers représentent globalement plus du quart de la population ivoirienne, ce qui semble poser la question d’un seuil quantitatif pouvant altérer les relations entre les autochtones et les étrangers. Dans cette perspective, Y. A. Faure (1982, p.135) fait remarquer depuis 1982, en se fiant aux normes internationales qu’« en Côte d’Ivoire, les fameux seuils de tolérance ont déjà explosé depuis longtemps ».
Le rapport du Conseil Economique et Social Ivoirien (1998, p. 4) ne dit pas autre chose en ce qui concerne les risques que peut représenter un tel seuil des étrangers en Côte d’Ivoire : « Face à l’importance considérable et toujours grandissante du phénomène de l’immigration en Côte d’Ivoire et aux risques encourus par la population aux plans de la sécurité, de l’unité nationale et de la paix sociale ; le conseil économique et social a pris l’initiative d’une réflexion sur le sujet, dans l’espoir d’attirer les autorités sur la réalité de l’immigration dans notre pays ».
Ces constats sont autant d’événements qui semblent être en lien avec le malaise des populations locales sur la question de l’immigration. Cependant, il existe peu d’études réalisées en Côte d’Ivoire depuis une décennie permettant de saisir les opinions et attitudes des populations locales à l’égard de l’immigration ouest-africaine, surtout en milieu rural où selon le RGPH (2014, p. 150) les étrangers sont fortement établis.
Ainsi, dans cette étude, nous nous interrogeons sur l’immigration ouest-africaine telle qu’elle est appréhendée de façon générale en Côte d’Ivoire. A quoi l’immigration Ouest-Africaine, est-elle associée dans l’imaginaire collectif local ? Est-elle positive pour tous ou potentiellement dangereuse ? Cet article vise à montrer les différents regards et perceptions portés sur l’immigration ouest-africaine par les populations d’accueil en milieu rural.
1. MÉTHODE
L’enquête se situe en milieu rural dans trois régions de la Côte d’Ivoire : le District autonome d’Abidjan, la région de la Nawa et le Haut-Sassandra. En effet, selon le RGPH (2014, p. 150), les régions ivoiriennes de forte immigration sont le District autonome d’Abidjan (19,26%), le Haut-Sassandra (8,89%) et la région de la Nawa (7,97%). De plus, ces recensements indiquent que la proportion des étrangers en milieu rural (57%) est plus forte qu’en milieu urbain (43%).
Les données de cette enquête ont été analysées qualitativement. Nous avons retenu, de ce fait, comme unité d’enregistrement, le thème dans l’analyse de contenu des discours des enquêtés. Il s’est agi de recenser les thèmes principaux en rapport avec le thème de l’immigration (comme une chance ou comme une menace).
La technique d’échantillonnage adoptée est celle de la boule de neige. Nous nous sommes servis de nos liens d’amitié dans certaines zones des régions concernées par l’enquête pour recruter de nouveaux sujets.
2. RÉSULTATS
2.1. Immigration ouest-africaine vue comme une chance
L’analyse des données recueillies sur le terrain révèle que l’immigration ouest-africaine représente dans certains domaines d’activités, une chance pour les populations d’accueil. C’est plutôt au niveau de l’économie, de la culture et du sport que les populations locales les ressentent.
2.1.1 Au niveau économique
Les populations locales estiment que l’immigration constitue une chance puisqu’elle peut favoriser une augmentation de la consommation. Ce qui peut être profitable financièrement à tous ceux qui, dans la société d’accueil tiennent des activités commerciales. Pour Z.U (vendeuse de vivriers) :
« L’afflux d’étrangers m’a permis de faire d’énormes marges bénéficiaires. Dans le temps, je ne vendais qu’un carton de tomates par semaine, depuis leur arrivée, j’ai triplé mes ventes. Leur arrivée est plutôt une bonne chose… »
Les populations locales considèrent que l’immigration peut avoir des impacts fiscaux en augmentant les recettes des structures administratives des localités d’accueil. L’arrivée d’étrangers dans les localités d’accueil est perçue comme une chance du fait des opportunités économiques qu’elle induit. Pour certains, c’est au niveau des activités commerciales qu’ils perçoivent cette chance quant pour d’autres, cette arrivée a permis de renflouer les caisses de la chefferie. D’un autre côté, pour A.N (cultivateur), qui dispose de plusieurs hectares de cacao et de café, cette arrivée d’étrangers est un apport de main-d’œuvre dans certains secteurs :
« En tous cas, l’afflux d’étrangers m’a beaucoup aidé. En fait, je n’avais que peu d’employés pour entretenir mes plantations. J’ai recruté 20 employés parmi eux. Non seulement, ils travaillent efficacement mais aussi et surtout j’ai gagné beaucoup d’argent. Je pense que leur présence est une véritable chance… »
L’immigration ouest-africaine apporte, selon les populations locales, une plus-value économique dans divers secteurs d’activités sociales contribuant ainsi à la croissance économique et à l’emploi dans la société d’accueil.
2.1.2. Au plan de la culture
En matière culturelle, les populations d’accueil se montrent positives vis-à-vis de l’immigration. Dans leurs bagages, les immigrés apportent leur force de travail, leur créativité et leur plus-value économique. Ils véhiculent également tout ce qui compose leur patrimoine culturel : leurs coutumes, leurs traditions, leurs chansons, leurs langues et leur gastronomie.
Ils arrivent dans la société d’accueil avec des genres musicaux différents de ceux de la société d’accueil. Non seulement, ces musiques venues d’ailleurs sont plaisantes pour certaines populations, mais aussi et surtout elles apportent des sonorités étrangères que les artistes locaux utilisent pour créer une musicalité originale. K.I (chansonnier) exprime de l’intérêt pour la musique mandingue :
« Il y a une importante communauté malienne dans notre village. Leurs cérémonies de mariage sont souvent accompagnées de danses et de chants. En écoutant ces chants, je me suis laissé pénétrer par le timbre vocal du griot. J’aime tellement la musique mandingue que je collabore en matière musicale avec un griot malien »
Au théâtre, au cinéma, en musique, les populations locales disent apprécier les œuvres d’artistes issus de l’immigration. D’ailleurs, on entend fréquemment les sonorités sur nos radios et télévisions. S.G (mécanicien), exprime son admiration pour deux artistes ivoiriens issus de l’immigration :
« Qui ne connait pas ASALFO, d’origine burkinabé et membre du groupe MAGIC SYSTEM qui nous a fait vibrer au son de son titre ‘’premier gaou’’ ? Que dire du comédien GOHOU, d’origine burkinabé dont le talent artistique n’est plus à prouver ?»
Sur le plan culturel, les immigrés apportent aussi leurs langues. Les populations locales estiment qu’une langue issue de l’immigration a contribué à faciliter les communications entre les diverses communautés dans la société d’accueil : il s’agit de la langue bambara communément connue en Côte d’Ivoire sous le nom de ‘’dioula’’. Ainsi, pour un habitant d’une localité d’accueil, cette langue est un véritable moyen de communication dans le commerce :
« Quand vous vous rendez au marché, vous constaté que le ‘’dioula’’ est la langue la plus utilisée. Pour communiquer dans ces lieux de commerce, il est important de connaitre quelques mots ‘’dioula’’… »
Les populations locales ont découvert des mets confectionnés par les communautés étrangères. R. F (directeur d’école) apprécie les mets togolais :
« Mon ami togolais m’invite souvent à partager le diner chez lui. Réticent au début, j’ai fini par aimer les plats confectionnés par sa femme. Aujourd’hui, je demande souvent à mon épouse d’apprendre à confectionner les plats togolais… »
2.1.3. Au plan du sport
Quand les populations locales perçoivent l’immigration comme une chance, notamment au plan sportif, c’est parce qu’elles se réfèrent aux athlètes ivoiriens issus de l’immigration qui ont contribué, par leurs performances, à redorer l’image de la Côte d’Ivoire dans divers domaines du sport. F. G (infirmier), ne tarit pas d’éloges quand il parle d’athlètes ivoiriens d’origine étrangère qui ont fait les beaux jours du sport ivoirien :
« Au niveau du football, on peut citer ces footballeurs : Ndiaye Aboubacar, d’origine sénégalaise ; Guel tchersoa, d’origine burkinabé, joueur de l’équipe nationale ; Arouna Dindané, d’origine nigérienne, avant-centre de l’équipe nationale ; Boubakar Kanté, d’origine guinéenne, gardien de l’équipe nationale. Parlant de la boxe, nous avons WABI SPIDER de son surnom, d’origine nigériane, champion d’Afrique de boxe des poids légers ; Marie KONATE, d’origine malienne, champion d’Afrique des poids lourds. Tous ces ivoiriens d’origines étrangères ont contribué, somme toute, à l’excellence du sport ivoirien… »
En somme, l’analyse des données de l’enquête révèle que les populations locales insistent sur les bienfaits économique, culturel et artistique de l’immigration. Cependant, pour elles, l’immigration pose problème sur certains plans.
2.2. Immigration ouest-africaine vue comme une menace
L’immigration ouest-africaine est un sujet qui préoccupe les populations ivoiriennes. Quand on leur demande si cette immigration est plutôt une chance ou plutôt une menace pour la Côte d’Ivoire ; les réponses sont variées. Certains, y voient une chance pour le pays d’accueil comme le montre le premier chapitre de notre étude, quand d’autres la considèrent potentiellement dangereuse.
2.2.1. Aux plans de la culture, de l’identité et de la religion
L’analyse des données recueillies au cours de l’enquête de terrain montre que les populations locales se sentent menacées par l’immigration dans leur culture, leur identité et leur religion.
Au plan culturel, les populations locales estiment que l’immigration peut constituer une atteinte aux modèles de valeurs en usage en Côte d’Ivoire. Pour elles, les nouveaux arrivants modifient les valeurs de la société d’accueil par l’introduction de nouvelles croyances. G. A (cultivateur) fait remarquer :
« Les divinités de notre peuple sont différentes de celles des peuples étrangers. Notre espace spirituelle risque d’être perturbé si les étrangers adorent leurs divinités sur nos terres ».
Au niveau identitaire, les populations locales craignent la disparition des identités ivoiriennes. Les populations d’accueil affirment être très attachées aux valeurs qui régissent leurs communautés. Elles perçoivent, dès lors, l’arrivée des communautés étrangères comme susceptible d’entacher les spécificités locales ou nationales. J. R. (notable) ne supporte pas la présence des étrangers dans sa région puisque selon lui :
« Ils font beaucoup d’enfants, ils seront nombreux à un moment donné, et cela peut conduire à un mélange, si éventuellement ils épousent nos sœurs. Ainsi, à cause du mélange, nos filles et nos petits-enfants n’auront plus rien de spécifiquement ivoirien ».
Si pour les populations locales l’immigration ouest-africaine constitue une menace au plan culturelle et identitaire, elles la considèrent davantage comme menaçante pour leur localité au plan religieux. Pour les populations locales, la religion est problématique quand il s’agit de l’islam, religion qu’elles associent à des courants intégristes et fanatiques. P. L (instituteur) nous révèle ceci :
« La plupart des étrangers présents dans notre région sont majoritairement de religion musulmane. Je vous le dis, c’est une religion qui a de forts liens avec le terrorisme et la violence… ».
2.2.2. Au niveau de la qualité de vie et de la santé
Les populations locales voient dans l’arrivée des étrangers une menace sur la qualité de la vie sociale et sur la santé. Elles imputent aux étrangers, la responsabilité de la flambée de l’insécurité et de la ghettoïsation des localités d’accueil :
« Les vols et les cambriolages ont sensiblement pris de l’ampleur depuis l’afflux d’étrangers. Et chaque fois que les policiers mettent la main sur des voleurs, ce sont généralement des étrangers. Allez-y dans les prisons, vous verrez que les étrangers sont les plus nombreux. Ils sont également à l’origine des bidonvilles dans le pays ». (N.F, commerçant).
Selon les populations locales, l’immigration a amplifié le phénomène des conflits fonciers, des conflits entre autochtones agriculteurs et éleveurs peulhs et plusieurs tensions ethniques. Un des chefs d’un village enquêté nous dit ceci :
« Les étrangers sont le plus souvent mêlés dans plusieurs affaires dans le village. Il s’agit des conflits fonciers, les litiges entre agriculteurs et éleveurs, des vols de fèves de cacao, des bagarres, les coupeurs de route. Depuis l’afflux d’étrangers, on assiste à de nouvelles formes de criminalité. »
D’après les populations locales, leur arrivée dans la région suscite des craintes au plan de la santé. Elles dénoncent leurs pratiques traditionnelles liées à l’excision. Les populations sont d’autant plus inquiètes qu’elles refusent que leurs filles épousent des étrangers. P.O (pêcheur) craint l’excision parce que, dit-il, trois jeunes filles issues d’une communauté étrangère sont en mortes :
« Les instruments qu’ils utilisent pour les excisions ne sont pas stérilisés, ce qui a conduit à des infections chez les excisées. C’est ce que nous a révélé un médecin lors du décès de trois jeunes filles étrangères. Nous avons peur pour nos sœurs qui pourraient éventuellement se marier avec des hommes issus de certaines communautés étrangères pratiquant l’excision. »
2.2.3. Au niveau de l’économie et de la démographie
La démographie et l’économie sont citées par les populations d’accueil comme des facteurs qui peuvent faire de l’immigration un problème. En ce qui concerne l’économie, une inquiétude communément répandue parmi les populations locales sur l’immigration ouest -africaine est que les afflux de travailleurs migrants a pour effet de diminuer les salaires des travailleurs locaux. Le nombre grandissant de ces travailleurs exerce une pression sur les salaires puisque, selon les mêmes populations locales, les étrangers constituent une main- d’œuvre bon marché pour les entrepreneurs.
Ce qui n’est pas du goût des populations locales qui affirment que leur présence créé une plus grande compétitivité sur le marché du travail. Pour F.Z (élève en classe de terminale) :
« Les étrangers acceptent généralement les salaires bas. Les entrepreneurs les préfèrent aux jeunes de la localité d’accueil, ce qui fait que nous avons du mal à trouver un emploi. Ces étrangers ne sont pas les bienvenus dans notre région parce qu’ils nous prennent notre travail. »
Les populations déclarent que l’immigration favorise le développement d’une économie souterraine. A.K (instituteur à la retraite) nous explique en quoi consiste cette économie souterraine :
« Les commerçants étrangers falsifient la plupart des produits manufacturés, de sorte que vous achetez toujours les produits non originaux. Ils font ainsi de la concurrence déloyale avec les honnêtes commerçants et engrangent, par voie de conséquence, des bénéfices importants. De même, ils arrivent toujours à contourner les lois et ne paient pas toujours leurs impôts… »
Dans ce contexte, pour les populations locales, les transferts de fonds profitent plus à leur pays d’origine. C’est ce en quoi croit K.J (commerçante de vivriers) :
« Calculez le nombre d’étrangers en Côte d’Ivoire, on peut les estimer entre 2 et 3 millions. Si Chacun envoie dans son pays d’origine ne serait-ce que 100000 f Cfa par an, regardez monsieur la masse d’argent qui sort de notre pays. C’est une véritable entorse pour notre économie. »
Concernant la démographie, les populations locales ont exprimé leur inquiétude suite à l’afflux massif des étrangers dans leur localité. Pour elles, il y a un risque de substitution de population et la création de zones de non droit. V.C (cultivateur) s’inquiète suite au nombre grandissant d’étrangers dans les localités d’accueil :
« Chaque année, ils arrivent en masse dans nos régions. Non seulement, ils font beaucoup d’enfants, mais procèdent très souvent au regroupement familial. A partir de là, on peut s’entendre à ce qu’ils nous phagocytent un jour. »
Plus encore, pour les populations locales, lorsqu’ils sont trop nombreux dans certaines localités, ils ont une tendance au communautarisme, sphère dans laquelle ils érigent souvent leur propre loi et se soumettent très peu aux normes et valeurs de la société d’accueil. O.L (chef d’un village enquêté) nous présente quelques caractéristiques de ces zones de non droit entretenues par les étrangers :
« Ils imposent des règles de vie dans leurs zones d’habitation au détriment des us et coutumes du village d’accueil. Il arrive souvent que nous subissions leurs règles quand nous pénétrons leurs zones. Nous ne pouvons accepter de tels comportements venant de ces populations… ».
De façon générale, les populations des zones enquêtées perçoivent l’immigration ouest-africaine comme un risque pour leurs localités. Il serait intéressant de s’interroger sur les fondements de telles perceptions.
3. DISCUSSION DES RÉSULTATS
En Côte d’Ivoire se dessine dans les localités concernées par notre enquête une double image de l’immigrant ouest-africain. L’une, moins répandue, est positive. Elle évoque l’utilité économique et artistique de l’immigration. L’autre, omniprésente, est négative. Elle décrit les migrants comme des éléments indésirables, amenuisant la cohésion sociale, accroissant la criminalité, menaçant les identités et cultures nationales. L’enquête révèle que les critiques formulées par les populations d’accueil contre les immigrants ouest-africains en termes de menace sont de trois types : criminel, économique et social. Ces préjugés à l’encontre de ceux-ci sont-ils justifiés ?
D’abord, en matière de criminalité, l’idée répandue chez les populations locales selon laquelle les immigrés seraient plus associés à la criminalité doit être battue en brèche. Le thème de criminalité est, en fait, directement lié aux conditions économiques auxquelles sont confrontés les migrants. En générale, les prisons sont principalement peuplées de personnes issues de milieux défavorisés. L’exclusion et les inégalités créent un terrain propice à la délinquance (R. Wilkinson et K. Picket, 2013, p. 313). Or, les personnes d’origine étrangère sont d’avantage soumis au risque de pauvreté (P. Weil, 1998, p. 53 ; L. Muchielli, 2008, p. 101).
Ensuite, l’apport économique des immigrés doit être évalué avec prudence, étant donné la difficulté de le chiffrer. Même si, selon un document du BIT (2004, p. 37), l’influence économique de l’immigration semble plutôt positive.
L’OCDE (2009, p. 15), quant à elle, juge son impact sur les finances publiques limités et estime qu’il serait bénéfique d’améliorer le taux d’emploi des immigrés. Les personnes d’origine étrangère consomment et payent des taxes au sein des pays hôtes. Donc, leur argent est directement réinjecté dans l’économie locale.
Loin de rester passives, certaines deviennent elles-mêmes chefs d’entreprise. De ce fait, elles créent des emplois directs pour elles-mêmes, mais aussi pour d’autres quand elles engagent des employés (M. Burawoy, 1976, p. 1035).
Certaines études font état de ce que les immigrés auraient davantage l’esprit d’entreprise que les autochtones. Les entrepreneurs issus de l’immigration contribuent à la croissance économique et à l’emploi, bien souvent, en donnant un souffle à des secteurs délaissés du commerce et de l’artisanat (H. Boubakri, 1999, p. 34).
Ainsi, l’idée répandue chez les populations selon laquelle les immigrés viennent pour prendre leur travail relève d’une vue de l’esprit, en ce sens que l’incidence des migrants sur le taux du chômage est négligeable (V. Piché, 2009, p. 354). Les crises économiques, et l’incertitude angoissante qui les accompagne font resurgir habituellement des sentiments anti-immigrés chez les populations d’accueil (R. Skeldon, 2008, p. 12).
Dans un autre registre, G. Tapinos (2000, p. 15) fait remarquer que les migrants ne devraient pas être perçus comme une réserve de main-d’œuvre taillable et corvéable à merci.
Si le poids économique pour les pays d’accueil est avéré, il reste aussi important pour le pays d’origine. D’importants montants sont transférés par les migrants vers leur pays de départ à leurs proches. Pour les pays en développement, ces transferts d’argents selon la Banque Mondiale dépassent les investissements directs étrangers et sont trois fois supérieurs à l’aide au développement. En comptabilisant le total des fonds transférés par les migrants, la Banque Mondiale évaluait le total à 582 milliards de dollars en 2009 (OCDE, 2009, p. 180).
Enfin, en matière culturelle, les immigrés véhiculent leur patrimoine culturel. L’apport artistique de l’immigration se ressent au cinéma et au théâtre. Certaines populations locales apprécient les œuvres d’artistes issues de l’immigration. Les immigrés apportent leurs croyances et leurs langues, très souvent considérées comme des obstacles à l’intégration. Sur ce point, la religion est problématique depuis un certain temps, singulièrement lorsqu’il s’agit de l’islam. Il y a parmi les musulmans, comme dans toute croyance, des courants intégristes ou fanatiques. Mais, il ne faut pas faire l’amalgame entre islam et terrorisme. L’islamophobie est dangereuse parce qu’elle suscite les replis identitaires tant chez les victimes que chez les auteurs (I.-M. Stroe, 2015, p. 9).
CONCLUSION
Les migrations font partie de l’histoire humainedepuis le temps des premiers nomades. Pour une raison fort simple : en se déplaçant, les gens recherchent de meilleures conditions de vie. Cette dynamique sera toujours plus forte que toutes les barrières. En outre, elle peut se révéler positive ou négative à bien des égards. A la suite de cette étude, dans le but de déterminer la perception que se font les populations locales à l’égard de l’immigration ouest -africaine, nous sommes arrivés à la conclusion que les populations des zones d’accueil concernées par l’enquête ressentent l’immigration plutôt comme une menace. Cependant, il faut faire observer que cette attitude des populations locales vis-à-vis de l’immigration n’est pas justifiée. Ainsi, il apparait clairement que ces préjugés sur les étrangers devraient être bannis de nos pensées. La migration implique l’accueil. Or, l’hospitalité en tant que ce qui caractérise l’esprit d’ouverture et de générosité des peuples africains doit être vulgarisée.
BIBLIOGRAPHIE
AKINDES Francis., 2003, « Migrations et politiques publiques de l’étranger en Afrique de
L’Ouest », Débats Courrier d’Afrique de l’Ouest, vol. 2, pp. 9-14.
BABO Alfred., 2005, « Citoyenneté et jeu politique en Côte d’Ivoire », Abidjan, Kasa bya Kasa, n° 8, pp. 23- 37.
BATS Mélanie et PETAZZONI Thomas, 2003, la table ronde de Linas Marcoussis du 15 au 27 janvier 2003. T106 ; outils de négociation, Les éditions UTBM (université de technologie de Belfort-Montbéliard), France, p32.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL(BIT) ,2004. Rapport VI-une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée : sixième question à l’ordre du jour, 230 pages.
BLION Reynald, BREDELOUP Sylvie., 1997, « La Côte d’Ivoire dans les stratégies migratoires des Burkinabè et des Sénégalais », in B. Contamin et H. Memel-Fotê, ed. Le modèle ivoirien en question : crises, ajustements, recompositions, Paris : Karthala-ORSTOM, p. 707-738.
BOHOUN Bouabré., KOUASSY Oussou, 1997, « Ouverture sur l’extérieur et performances macroéconomiques en Côte d’Ivoire », in Contamin, B. et Memel-Fotê, H., ed. Le modèle ivoirien en question : crises, ajustements, recompositions, Paris : Karthala-ORSTOM, pp. 11-27.
BOUBAKRI Hal., 1999, « Les entrepreneurs migrants d’Europe : dispositifs communautaires et économie ethnique. Le cas des entrepreneurs tunisiens en France », Cultures et conflits, P 33-34.
BURAWOY Michael, 1976, «The function and reproduction of migrant labour: comparative material from Southern Africa and the United States», American Journal of Sociology, 82(5), p. 1031-1042.
DOZON Jean-Pierre, 1997, « L’étranger et l’allochtone en Côte d’Ivoire », in Contamin, Bernard et Memel-Fotê, Harris, éd, Le modèle ivoirien en question, crises, ajustement, recompositions. Paris, Karthala-ORSTOM, pp.779-798.
FAURE Yāzā-Abū, 1982, État et bourgeoisie en Côte-d’Ivoire, Karthala, Paris, 270p.
GROGUHE Yogblo-Armand, 2009. La problématique de l’intégration sociale des jeunes réfugiés libériens à Abidjan : une approche sous l’angle de la résistance à l’intégration. Thèse de doctorat unique en criminologie. Université de Cocody (Côte d’ivoire). 357 p.
KONE Issiaka, 2005, « Le couple agriculteurs/éleveurs – un tandem confligène. Le cas de la s/p de Dikodougou ». Dakar (Sénégal). Revue Liens de L’ENS, p 65-78.
KONE Issiaka, 2010, « La pêche artisanale dans la région de Dabou (Côte d’Ivoire) »
Revue Annales de l’Université de Lomé, Série Lettres et Sciences Humaines, Tome XXX-1, Les Presses de l’UL, pp. 233-243.
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL(CES), 1998, Immigration en Côte d’Ivoire : le seuil du tolérable est largement dépassé, Rapport publié dans le jour. Abidjan, N° 1251 du jeudi 08 avril 1999.
MINESTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES(MEF), 2007, La Côte d’Ivoire en chiffres, Abidjan, Dialogue production, 222 p.
MUCHIELLI Laurent, 2008, La frénésie sécuritaire, paris, la découverte, 136 p.
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT(OCDE), 2009 Perspectives des migrations internationales-SOPEMI 2009-Thème spécial : Gérer les migrations au-delà de la crise « Résumé en français », Paris, Éd OCDE, 204 p.
PICHE Victor, 2009, « Migrations internationales et droits de la personne : vers un nouveau paradigme ? », in Crépeau F., Nakache D., Atak I. (dir.), Les migrations internationales contemporaines. Une dynamique complexe au cœur de la globalisation, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 350-369.
RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION(RGP), décembre 1975 : résultats définitifs, données nationales, volume 1 + données non publiées, INSD, Ouagadougou, 145 p. + annexes.
RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION(RGP), I985: analyse des résultats définitifs, volume 1, données non publiées, INSD, Ouagadougou, 3 18 p. + annexes.
RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT(RGPH), 1988 : données brutes, Direction de la Statistique, Abidjan, n. p 320 p.
RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITATION(RGPH), 2014, Données brutes, volume 1, données non publiées, Direction de la Statistique, Abidjan. 156p.
SKELDON Ronald, 2008, «International migration as a tool in development policy: a passing phase? », Population and Development Review, 34(1), p. 1-18.
STROE Inout-Mariam, 2015, La criminalisation des migrants en situation irrégulière : un crime sans victime. Rapport commissions des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. Rapport 1, commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, Strasbourg, conseil de l’Europe, 13 p.
TAPINOS George, 2000, « Les enjeux économiques et politiques des migrations clandestines », in OCDE, Combattre l’emploi illégal d’étrangers, Paris, OCDE, p. 13-44.
TERMOTE Marc, 2002, « La mesure de l’impact économique de l’immigration internationale. Problèmes méthodologiques et résultats empiriques », Montréal,Cahiers québécois de démographie, 31(1), p. 35-67.
WEIL Patrick, 1999, Politique française d’immigration, Paris, pouvoirs, n° 47, pp 45-60.
WILKINSON Richard et PICKET Kate, 2013, Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, Paris, Les petits matins, 501 p.
LA NEUTRALITÉ ABSOLUE IVOIRIENNE : UNE POLITIQUE CONTRARIÉE ?
Antoine Sess GNAGNE
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
sessgnagne@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
Devant l’échec apparent du neutralisme et du non-alignement à réaliser la neutralité de l’Afrique face aux deux blocs antagonistes Est-Ouest en lutte pour le contrôle du monde, Félix Houphouët-Boigny avait préconisé en 1970 une politique ivoirienne de neutralité absolue. Inspirée du modèle suisse de neutralité, elle procédait également d’une analyse froide et rigoureuse des problèmes de l’Afrique et du monde. Cependant, elle n’avait pas prospéré plus que ses concurrentes, le neutralisme et le non-alignement, à cause de nombreuses contraintes dont la méfiance entre les pays africains.
Mots clés : Côte d’Ivoire, Houphouët-Boigny, neutralité, neutralisme, non-alignement.
ABSTRACT :
In front of the visible failure of the neutralism and the non-alignment to achieve the neutrality of Africa in front of two striking East-West conflicting blocks for the control of the world, Felix Houphouët-Boigny had recommended in 1970 an Ivorian policy of absolute neutrality. Inspired by the Swiss model of neutrality, it also proceeded of a cold and rigorous analysis of the problems of Africa and the world. However, it had not prospered more than her competitors, the neutralism and the non-alignment, because of the distrust between the African countries.
Key words : Houphouët-Boigny, Ivory Coast, neutrality, neutralism, non-alignment.
INTRODUCTION
La politique ivoirienne de neutralité absolue s’inscrit dans le cadre du débat idéologique entre leaders africains au sujet de l’avenir du continent. Au cœur de ce débat se trouve la question du positionnement de l’Afrique face aux deux blocs antagonistes Est-Ouest en lutte pour le contrôle du monde[5]. Cette polémique, qui avait surgi bien avant les indépendances africaines, s’était surtout amplifiée au cours des années 1960 et 1970. Cette étude tente de lever un coin de voile sur la contribution ivoirienne à ce débat.
En effet, pendant la guerre froide, les pays du tiers-monde s’étaient prononcés majoritairement contre la logique des blocs. Cette posture de non-engagement les avait conduits à adopter soit la neutralité[6], le neutralisme[7], le neutralisme positif[8] ou le non-alignement[9].Jugeant toutes ces approches insuffisantes[10], Félix Houphouët-Boigny avait préconisé, au Ve congrès du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) en 1970, une politique de neutralité absolue[11].
Celle-ci se voulait une forme authentique de neutralité politique, inspirée du modèle suisse de neutralité, et reprenant les idéaux du Rassemblement démocratique africain (RDA)[12]. Contrairement à ses concurrentes, c’était une politique purement africaine, voulue par un Africain pour les Africains dont la finalité était le développement du continent. Elle excluait toute adhésion à toute idéologie contraire au génie propre de l’Afrique au profit d’une coopération économique, scientifique, technique, culturelle et sociale avec toutes les puissances étrangères.
Mais, à peine cette politique était-elle formulée que des voix s’élevaient, en Afrique et dans le monde, pour la combattre farouchement au point de pousser le président ivoirien à une séance publique d’explication[13]. Ces oppositions étaient, en grande partie, le fait de pays progressistes africains[14] et de certains milieux financiers occidentaux[15]. Cependant, en dépit de ces oppositions systématiques, la politique de neutralité ivoirienne avait recueilli l’adhésion de la classe politique ivoirienne et de quelques pays africains amis, membres du Conseil de l’Entente, du Gabon et de la Centrafrique[16].
Dans quelle mesure, une telle politique décriée par les uns et applaudie par les autres pouvait-elle sauvegarder l’indépendance des pays africains face à la logique des blocs des super-grands ? Au surplus, quelles étaient les chances de cette politique de neutralité absolue par rapport au neutralisme et au non-alignement ? De ces préoccupations, découlent les hypothèses suivantes. La politique ivoirienne de neutralité absolue a échoué à préserver l’indépendance des pays africains face aux deux blocs. Comme ses devancières, le neutralisme, le neutralisme positif et le non-alignement, elle souffrait du jeu trouble de son initiateur.
L’objet de cet article est l’analyse de la proposition ivoirienne de neutralité absolue afin d’en évaluer la portée. Cette contribution se fonde principalement sur une exploitation minutieuse des discours du premier président ivoirien et des articles de presse d’époque qui ont été confrontés à des ouvrages sur l’Afrique, la Côte d’Ivoire et le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Sont étudiés successivement le contexte et les facteurs de la neutralité absolue, la mise en œuvre de cette politique et les contraintes.
1. CONTEXTE ET FACTEURS DE LA NEUTRALITÉ ABSOLUE
La politique ivoirienne de neutralité absolue a vu le jour dans un environnement troublé et a été favorisée en grande partie par des facteurs économiques et politiques.
1.1. Le contexte de la neutralité absolue ivoirienne
Au début des années 1970, l’Afrique subissait les effets de la guerre froide. On voyait s’opposer, sur presque toutes les questions africaines[17], les forces conservatrices et progressistes[18]. Ces dernières avaient même fait une percée significative sur le continent depuis les années 1960 avec le recul du colonialisme, l’apparition de régimes ouvertement pro communistes et la prolifération de mouvements de libération se réclamant du marxisme-léninisme[19].
En outre, ces forces progressistes étaient en avant-poste de la lutte contre le colonialisme portugais[20] et le régime d’apartheid en Afrique australe[21]. Dans ce dernier cas, l’Afrique du sud, principal bastion de l’apartheid, attirait les foudres de nombreux pays africains qui n’avaient de cesse de réclamer des sanctions à son encontre et son isolement[22].
Par ailleurs, en 1970 prenait fin la guerre civile nigériane, avec la reddition du colonel Ojukwu. La sécession biafraise, point focal de cette crise, n’avait pas abouti. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait jeté toutes ses forces dans la victoire du Biafra, voyait ainsi tous ses efforts ruinés. Lâché par la France et désapprouvé par la plupart de ses pairs, il était isolé sur la scène africaine[23].
Sur le plan intérieur, la Côte d’Ivoire était secouée par deux tentatives de sécession dans le Sanwi[24] et le Guébié[25]. Au début des années 1970, si le cas Sanwi, après une résurgence en 1969 à la faveur de la sécession du Biafra, tendait à s’essouffler, en revanche la question du Guébié n’était qu’à ses débuts. Ces deux affaires, sans oublier les complots de 1963 et l’intervention de la Côte d’Ivoire au Nigeria, allaient marquer durablement l’opinion nationale. C’est donc dans ce contexte d’agitation politique en Côte d’Ivoire et en Afrique, d’isolement du président ivoirien sur la scène africaine que Houphouët-Boigny avait formulé sa politique de neutralité absolue au Ve congrès du PDCI-RDA en 1970.
1.2. Les facteurs de la neutralité absolue
Le choix de la politique ivoirienne de neutralité totale relevait de considérations économiques et politiques. Economiquement, le statut de neutralité absolue que revendiquait la Côte d’Ivoire était motivé par la quête urgente d’un développement du pays et, partant, de l’Afrique. Car, pour Houphouët-Boigny, il n’y avait pas de développement sans la paix[26].
Or, l’Afrique des décennies 1960 et 1970 était caractérisée par des guerres[27] et surtout par de nombreuses situations conflictuelle[28].Ce qui manifestement compromettait les chances d’un développement du continent. Aussi, pour impulser ce développement économique, était-il important que les pays africains connaissent un climat de paix durable voire permanent. D’où le sens de cet appel à la neutralité absolue lancé par M. Félix Houphouët-Boigny.
Politiquement, il s’agissait, pour le président ivoirien, en tant que leader d’opinion, de prendre toute sa place dans le débat sur le positionnement de l’Afrique par rapport au monde extérieur dans un contexte de division du monde. L’enjeu était la sauvegarde de l’indépendance des pays africains face aux puissances étrangères et à leurs bras séculiers régionaux.
Ce souci commun à tous les Etats du tiers monde n’avait pas permis cependant à ces derniers d’adopter une position commune sur la question. Bien au contraire, de cette préoccupation étaient nées plusieurs formules diplomatiques[29] qui, du point de vue des autorités ivoiriennes, avaient été inopérantes. Il s’agissait donc, en réalité, pour le dirigeant ivoirien, partisan de l’alliance afro-occidentale, de faire une contre-proposition aux théories du neutralisme et du non-alignement jugées trop favorables aux intérêts communistes.
Celle-ci était révélatrice des rivalités idéologiques entre pro-occidentaux et progressistes africains. On pourrait y voir également une volonté des autorités ivoiriennes de faire barrage au communisme sur le continent. Pour celles-ci, il fallait éviter tout risque de contagion des populations et des oppositions intérieures par les idéaux subversifs du communisme en progrès sur le continent et qui pourraient mettre à mal la cohésion à l’intérieur des pays africains et entre ces pays. De fait, les autorités ivoiriennes ne faisaient pas mystère de leur dédain pour le communisme qu’elles considéraient comme la source des problèmes du continent africain[30].
Par ailleurs, cette initiative ivoirienne pourrait s’interpréter d’une part, comme une tentative du président Houphouët-Boigny de réoccuper la scène africaine et de briser l’isolement dont il était victime après l’échec de son intervention au Nigeria et, d’autre part, comme un retour d’ascenseur au régime sud-africain, son allié dans cette aventure[31].
En définitive, le choix de la neutralité absolue par les autorités ivoiriennes confirme bien l’hypothèse de Raymond Aron sur les mobiles qui poussent les nations du tiers monde à rechercher le neutralisme. En effet, selon ce dernier,
le choix d’une certaine sorte de neutralité ou de neutralisme n’est pas fonction du degré ou de la nature du sous-développement : ce sont les circonstances politiques, la psychologie des élites et des peuples qui déterminent la modalité du non-engagement ou de l’engagement en faveur d’un bloc ou d’un autre. (R. Aron, 2004, p. 503)
L’examen du cas ivoirien montre bien que, bien plus que les considérations économiques, c’étaient des raisons politiques, en l’occurrence, l’aversion du communisme, dont le non-alignement et le neutralisme constituaient à ses yeux des formes dérivées, qui avaient fait agir Houphouët-Boigny. Car, avait-il dit, « le non-alignement, je n’y crois pas» (P-H. Siriex, 1986, p. 336).
Le contexte et les facteurs ainsi décrits, comment cette politique s’était-elle traduite sur le terrain ?
2. LA NEUTRALITÉ ABSOLUE À L’ÉPREUVE DES FAITS
L’application de la politique ivoirienne de neutralité absolue s’est déroulée en deux étapes : l’Afrique et le reste du monde.
2.1. La mise en œuvre de la politique ivoirienne de neutralité absolue en Afrique
La principale illustration de la politique ivoirienne de neutralité absolue, au plan africain demeurait, à n’en point douter, la quête inlassable de la paix par les autorités ivoiriennes. « Nous avons fait de la paix notre objectif de tous les jours, le principe premier de notre politique. » (J.N. Loucou, S.P.E. Mbra, 1987, p.144). Cette quête de paix était si fondamentale pour les autorités ivoiriennes qu’elle était apparue à beaucoup d’observateurs comme étant une seconde religion du pays.
En effet, pour les dirigeants ivoiriens, il ne saurait avoir de paix durable en Côte d’Ivoire sans une paix véritable en Afrique voire entre les pays africains. C’est tout le sens du triptyque, – paix à l’intérieur, paix entre les pays africains, paix entre l’Afrique et le reste du monde – Aussi, avaient-elles fait de la paix sur le continent un enjeu essentiel de la diplomatie ivoirienne.
Cette diplomatie de paix s’était montrée très active sur plusieurs fronts ; cependant, nous n’en retiendrons ici que deux aspects. Dans un premier temps, la Côte d’Ivoire avait recherché, avec constance, des relations de bon voisinage avec les autres pays africains. Dans cette optique, elle avait suscité la mise en place de plusieurs organes de coopération sous-régionaux et continentaux. En 1959, elle créait, avec le Dahomey (actuel Bénin), le Niger et la Haute-Volta (actuel Burkina-Faso), l’un des plus anciens groupements régionaux de pays francophones : le Conseil de l’Entente.
Dans les années 1960, la Côte d’Ivoire avait initié la création du « Groupe de Brazzaville[32] » puis du « Groupe de Monrovia [33]».Ce dernier groupe avait rédigé la charte de Lagos dont certains principes avaient été repris par la charte de l’organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963[34].En outre, les autorités ivoiriennes avaient contribué activement à la création de bien d’autres organisations panafricaines : l’Organisation de l’unité africaine (actuelle Union africaine), la Banque africaine de développement (BAD) en 1964, l’Organisation commune africaine et malgache (OCAM) en 1965, la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) en 1972, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 1975 etc[35].
Dans ces différentes organisations, la diplomatie ivoirienne s’était attachée à faire triompher ses idéaux de paix, d’unité progressive, de la non-violence, du respect de la souveraineté de chaque Etat et de son intégrité territoriale, de la non-ingérence, du règlement pacifique des conflits ou de coopération économique. Ainsi, lors de la création de l’OUA en 1963, les principes défendus par le président Félix Houphouët-Boigny (unité progressive, respect des souverainetés nationales, organismes communautaires de coopération économique et technique) avaient prévalu sur ceux de Kwamé Nkrumah (unité immédiate avec un gouvernement continental, une assemblée, une armée etc.)[36]
D’autre part, estimant que « La Côte d’Ivoire est l’amie de tous et l’ennemie de personne » (J.N. Loucou, S.P.E M’bra, 1987, p.144), Abidjan avait multiplié les ouvertures de représentations diplomatiques dans plusieurs capitales africaines : Alger, Luanda, Yaoundé, Bangui, Le Caire, Accra, Conakry, Addis-Abeba, Dakar, Lagos, etc[37]. Ces initiatives étaient destinées vraisemblablement à briser la méfiance entre la Côte d’Ivoire et les autres pays africains et à garantir un climat de paix et de sécurité propice au développement des Etats africains. Elles constituaient également le préalable à toute vraie unité du continent.
Dans un second temps, la diplomatie ivoirienne de paix s’était impliquée dans la résolution de plusieurs conflits sur le continent. En effet, les autorités ivoiriennes avaient condamné la force et la guerre comme moyens de résolution des différends entre les pays africains. Aussi, pour rétablir la paix en cas de trouble ou pour la consolider en cas de menace, avaient-elles préconisé la négociation et la recherche du compromis.
Dans cette perspective, elle avait abrité en 1993, à la demande de l’Organisation des nations unies (ONU), les négociations de paix entre le gouvernement angolais et l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) de Jonas Savimbi. En outre, elle avait accueilli à maintes reprises les protagonistes du conflit tchadien, parrainé les accords de paix de Yamoussoukro sur le Liberia et permis la résolution du conflit entre le Mali et le Burkina Faso en 1986[38]. Par ailleurs, le président ivoirien avait pris des initiatives importantes dans la recherche de solutions de beaucoup d’autres conflits dont la proposition ivoirienne de dialogue avec l’Afrique du Sud destinée à mettre fin à l’apartheid.
2.2. La neutralité absolue à la conquête du monde
Comme en Afrique, la politique ivoirienne de neutralité absolue avait été marquée sur le plan mondial par la recherche de la paix. En effet, au moment d’accéder à la souveraineté internationale, la Côte d’Ivoire avait présenté son indépendance comme une contribution à la cause de la paix. Depuis lors, celle-ci était devenue le leitmotiv qui avait inspiré et orienté toutes les actions de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale[39].
Ainsi, après son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire avait intégré la plupart des organisations mondiales notamment l’ONU et ses principales institutions (UNESCO, HCR, OIT, UNICEF…)[40] Profitant de ces arènes internationales, les autorités ivoiriennes s’étaient attachées à faire triompher la cause de la paix dans la conduite des affaires du monde. Aussi, avaient-elles condamné la guerre dans le monde, dénoncé la course aux armements, l’ingérence extérieure dans les conflits locaux et l’injustice du système international.
Sur tous les grands dossiers internationaux, la Côte d’Ivoire avait marqué sa différence en soutenant la cause de la vérité, de la paix, de la justice et de l’égalité et en jouant la carte de la solidarité comme sur la question du Moyen-Orient[41]. En sus de cette présence remarquée dans les institutions internationales, elle avait travaillé à la constitution d’un vaste réseau diplomatique, étalé aux quatre coins du monde, qui avait contribué efficacement à son insertion dans le concert des nations. En effet, la Côte d’Ivoire était représentée dans plusieurs pays et auprès de nombreuses institutions internationales dans le monde[42].
Ces représentations diplomatiques étaient l’occasion de développer la coopération économique entre pays mais également de promouvoir les idéaux de paix du président ivoirien. Ces efforts de paix avaient valu à la Côte d’Ivoire d’accueillir, du 27 au 31 Août 1973, la 6e Conférence de la Paix Mondiale par le Droit à Abidjan (la première dans une capitale africaine). Cette conférence avait réuni deux mille délégués venus du monde entier et avait décerné au président Houphouët-Boigny le titre de l’« Homme de la paix » en hommage à ses actions de paix[43].
D’autre part,
(…) le président F.H.B, adepte de la diplomatie secrète, grâce à l’étendue et à la diversité de ses relations, de ses réseaux dans le monde, à son prestige international, à sa respectabilité et à son sens de la parole donnée, à son organisation diplomatique, à sa riche expérience et à sa connaissance parfaite des dossiers des affaires internationales, a toujours été consulté en permanence par ses pairs, les responsables des organisations internationales (à vocation mondiale et régionale), des mouvements de libération d’Afrique et d’ailleurs. (J. V. Zinsou, 20 Juillet 2006, p.VI)
Ainsi, le président ivoirien s’était-il impliqué dans la recherche de solutions de plusieurs conflits à travers le monde notamment au Moyen-Orient. En effet, il avait dénoncé la responsabilité des quatre grands dans cette affaire, noué des contacts avec les principaux protagonistes (Golda Meir, Yasser Arafat, Sadate, Bourguiba, Simon Perez…) de cette crise et salué l’accord israëlo-palestinien de 1993 entre Itzhak Rabin (Premier ministre israélien) et Yasser Arafat (Président de l’Organisation de la Palestine, O.L.P.), qui s’étaient vus attribuer le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix[44].
Par ailleurs, le mérite de la Côte d’Ivoire, c’est d’avoir concrétisé le concept de paix et d’avoir milité pour que le dialogue soit reconnu comme un instrument de résolution pacifique des conflits dans le monde. Ce dialogue impliquait que chaque Etat s’abstienne d’imposer ses opinions aux autres par la force et de les contraindre à penser comme lui[45].
Dans cette logique, les autorités ivoiriennes avaient refusé de prendre part à toute opération de combat dans le monde et avaient privilégié la non-violence dans leurs rapports avec les autres. Ces efforts de paix avaient été couronnés en 1989 par l’institution du « Prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix », parrainé par 120 pays, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)[46].
Mais, cette politique de paix s’était heurtée en réalité à de nombreuses contraintes.
3. LES CONTRAINTES DE LA NEUTRALITÉ ABSOLUE
A priori, au regard du contexte politique du moment, cette proposition ivoirienne de neutralité absolue avait quelque chose de surréaliste. En effet, bien que les conditions de sa réalisation eussent été préalablement définies (paix à l’intérieur, paix entre les pays africains, paix entre l’Afrique et le reste du monde), celle-ci s’était heurtée dans la pratique à un environnement politique des plus difficiles. Si les conflits de guerre froide étaient encore rares sur le continent à cette époque, en revanche la prolifération de régimes et de mouvements de libération proches de l’Est, l’opposition entre pays progressistes et pays pro-occidentaux ou la difficile création de l’OUA venaient rappeler que l’Afrique avait bel et bien intégré la division du monde en deux blocs.
Celle-ci avait pour conséquence un climat de méfiance et de tensions qui compliquait davantage la recherche de toute cohésion nationale au sein des pays africains et l’établissement de relations harmonieuses entre ces derniers. Dans ces circonstances, les conditions de réalisation de cette politique de neutralité absolue devenaient avec le temps difficile à atteindre.
En effet, comment pourrait-on réunir ces conditions
(…) dans un monde divisé en deux blocs antagonistes, aux idéologies irréconciliables et dont les leaders, qui sont deux super-grandes puissances, considèrent le maintien de la paix sur la planète, indispensable au progrès de l’humanité, comme la résultante de l’équilibre des forces dans tous les domaines : militaire, économique, scientifique et stratégique ? (A. U. Assouan, 11 mai 1971, p. 4)
Il devient donc clair que si la division du monde en deux blocs antagonistes avait suscité la politique houphouétienne de neutralité absolue, elle contrariait également sa mise en œuvre. D’autre part, l’Afrique était-elle prête à aller à la neutralité ? Il n’en était pas sûr. Théoriquement, les pays africains étaient opposés à la logique des blocs, se murant dans une sorte de non-engagement depuis la conférence de Bandoeng. Ce non-engagement devenait officiel en 1963 au moment de la création de l’OUA par l’adoption du principe de non-alignement inscrit dans la charte de l’organisation panafricaine[47].
Mais, dans les faits, la réalité était tout autre. En effet, les pays africains avaient dérogé dans leur ensemble au respect de ce principe en s’alignant sur l’un ou l’autre des blocs idéologiques et en servant de champs clos aux rivalités des puissances étrangères sur le continent. Cette situation traduisait une absence manifeste de volonté politique de la part des Etats africains amplifiée par l’impuissance de l’OUA à garantir le respect de ses propres principes.
En outre, la neutralité ivoirienne n’était garantie par aucun texte, par aucune puissance étrangère ou par aucune organisation nationale ou supranationale. Pis, elle avait même été rejetée par la plus importante des organisations panafricaines. En effet, la proposition de dialogue avec l’Afrique du Sud, l’un des volets de cette politique, avait été condamnée au sommet de 1971 à Addis-Abeba (Ethiopie), par vingt-huit voix contre six et cinq abstentions[48]. Ce qui était tout le contraire du modèle suisse de neutralité dont elle se réclamait. La neutralité suisse, en effet, était encadrée par un arsenal de textes nationaux et internationaux et garantie par des organisations internationales qui lui assuraient une légitimité internationale[49].
Dans ces conditions, un petit pays pauvre comme la Côte d’Ivoire, bien qu’adossée à la France, avait-il les moyens de faire appliquer une politique de neutralité absolue ? Plus encore, les pays africains, au regard de leur extrême pauvreté et dépendance économique vis-à vis des puissances étrangères, pouvaient-ils s’offrir le luxe d’une telle politique sans subir des représailles ? Comment ces pays pouvaient-ils convaincre les grandes puissances de garantir leur neutralité alors même que celles-ci ne cachaient pas leurs intentions d’occuper l’Afrique ?
Or, l’expérience suisse nous enseigne que la consécration internationale d’une politique de neutralité fait intervenir
(…) un élément essentiel : l’élément extérieur, l’acceptation, le fait pour d’autres pays de reconnaître, d’admettre la neutralité d’un territoire. Si l’élément intérieur est fondamental, car une volonté doit se manifester et chercher à s’imposer – une volonté réelle, obstinée, incarnée dans un gouvernement solide – l’élément extérieur est également nécessaire et là où soit l’un, soit l’autre fait défaut, la neutralité risque de rester fragile. (R.Bridel, 1968, p.36).
Dans le cas de la politique ivoirienne de neutralité absolue, ni l’élément intérieur (du point de vue de l’Afrique) ni l’élément extérieur (du point de vue des puissances étrangères et des organisations internationales) n’étaient suffisamment établis pour prétendre à cette consécration internationale. Par ailleurs, cette politique avait fait l’objet de nombreuses déviations dans sa mise en œuvre. Ainsi, elle s’était muée, en maintes circonstances, en une neutralité bienveillante ou complaisante comme au Nigeria, en Angola ou en Afrique du Sud.
Dans ces différents cas, la politique de neutralité n’avait pas permis à la Côte d’Ivoire de rester hors de ces conflits. En effet, elle avait dérogé à ses principes de paix pour soutenir l’un des belligérants[50]. Enfin, tout en prônant une neutralité stricte, la Côte d’Ivoire se refusait de dénoncer son alliance avec la France et hébergeait sur son sol la base militaire française (le 43e BIMA). De ce point de vue, la politique ivoirienne de neutralité absolue n’était guère différente de ses devancières, le non-alignement et le neutralisme, que le président ivoirien n’avait de cesse de fustiger.
CONCLUSION
À mesure qu’ils accédaient à la souveraineté internationale, les pays africains avaient recherché une meilleure voie vers la neutralité du continent face aux deux blocs antagonistes Est-Ouest en lutte pour le contrôle du monde. Cette quête les avait conduits à expérimenter invariablement les théories du neutralisme et du non-alignement. Ayant constaté l’échec de ces formules, Félix Houphouët-Boigny proposait en 1970 la politique ivoirienne de neutralité absolue sur le modèle de la neutralité suisse.
Portée par des considérations économiques et surtout politiques, elle impliquait pour l’Afrique le rejet des idéologies étrangères et de la logique des blocs au profit d’une coopération sincère, sans condition entre celle-ci et les puissances étrangères. Contrairement au neutralisme et au non-alignement, elle s’inspirait d’une politique éprouvée qui ne laissait guère de place à l’amateurisme et à l’aventurisme des premiers et dont le succès n’était plus à faire.
Bien plus, celle-ci procédait d’une analyse rigoureuse et minutieuse des réalités africaines par les autorités ivoiriennes. Il s’agissait en effet pour ces dernières d’adapter le modèle suisse de neutralité aux conditions africaines ; c’était donc une politique conçue sur mesure pour l’Afrique. De ce point de vue, la proposition ivoirienne de neutralité ne manquait pas d’intérêt et était assurée d’une certaine réussite par rapport aux précédentes expériences africaines. Aussi, pourrait-on penser que la désidéologisation effective du continent aurait sans doute permis d’éloigner le spectre de la guerre froide de l’Afrique.
Car, de toute évidence, c’était le recours aux références marxistes-léninistes par les pays africains qui permit aux Soviétiques et aux Chinois de prendre pied sur le continent et fit basculer l’Afrique dans la guerre froide. Toutefois, les conditions objectives de réalisation de cette neutralité étaient-elles réunies à cette époque ? Rien n’est moins sûr. En effet, si la Suisse avait bénéficié d’un environnement favorable au XVIIIe siècle, il n’en était pas le cas pour la Côte d’Ivoire et l’Afrique au XXe siècle où la compétition entre les deux grands ne laissait aucune place aux neutres.
En définitive, cette proposition ivoirienne n’avait jamais été adoptée par l’Afrique. En revanche, certains de ses aspects, notamment le recours au dialogue dans la résolution des conflits, avaient été expérimentés avec des fortunes diverses ça et là sur le continent. Toutefois, aujourd’hui encore, cette politique garde toutes ses chances de réussite à l’image de l’expérience suisse. En effet, une politique de neutralité vraie, sur le modèle de la Suisse, dans laquelle tous les acteurs accepteraient de jouer le jeu constituerait un gage de paix durable pour notre continent.
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
Sources
Fraternité Matin, 2013, spécial 50 ans OUA/UA, p.24.
Houphouët-Boigny Félix, 1978, Anthologie des discours 1946-1978, Tome III du 28 avril 1971 au 31 décembre 1974, Abidjan, Editions CEDA.
Secrétariat d’Etat chargé des affaires culturelles de la République de Côte d’Ivoire, 1975, Le président Houphouët-Boigny et la nation ivoirienne, Abidjan/Dakar, NEA.
Bibliographie
Ouvrages de référence
Aron Raymond, 2004, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy.
Basttistella Dario, Petiteville Franck, Smouts Marie-Claude, Vennesson Pascal, 2012, Dictionnaire des relations internationales, 3e édition, Paris, Dalloz.
Ouvrage général
Moreau Defarges Philippe, 2003, Relations internationales. 1. Questions régionales, Paris, Editions du Seuil.
Ouvrages spécialisés
Alliali Camille, 2008, Disciple d’Houphouët-Boigny, Abidjan, Juris-Editions.
Baulin Jacques, 1980, La politique africaine d’Houphouët-Boigny, Paris, Editions Eurafor-Press.
Bridel René, 1968, Neutralité : une voie pour le Tiers Monde ?, Montreux, Editions L’âge d’homme.
Loucou Jean-Noël, M’bra Ekanza Simon-Pierre (dir), 1987, Mémorial de la Côte d’Ivoire. Tome 3 : Du nationalisme à la nation, Abidjan, Editions Ami.
Siriex, Paul-Henri, 1975, Félix Houphouët-Boigny l’homme de la paix, Paris, éditions Seghers/ Nouvelles éditions africaines.
Siriex Paul-Henri, 1986, Houphouët-Boigny ou la sagesse africaine, Paris, Nathan, 1986.
Ziké Aiko Marc, 1994, La politique étrangère de la Côte d’Ivoire (1959-1993), Chine, COPRECA-EDITION.
Articles de presse et de revues
Assouan Arsène Usher, 1971, « Dans l’intérêt et pour la dignité de l’Afrique », Fraternité Matin, N°1944, pp.1 ; 4
Assouan Arsène Usher, 1971, « Du dialogue comme méthodologie de la neutralité », Fraternité Matin, N°1939, pp.1 ; 10.
Fraternité matin, 1971, N°1950, p. 10.
Sess Gnagne Antoine, 2015, « La politique étrangère de la Côte d’Ivoire sous Houphouët-Boigny (1960-1993) », Revue d’Histoire, d’Art et d’Archéologie Africain, Godo Godo, N° 2015, pp. 7-18.
Zinsou Jean-Vincent, 2006, « La partition de Félix Houphouët-Boigny et sa politique étrangère », Fraternité Matin, N°12511, cahiers gratuits, n°103, p. VI.
“AMOUR D’UNE CHAISE” ET LA FIGURE DE LA MÉTAPHORE
Pascal Assoa N’GUESSAN
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
pascalassoa@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
“Amour d’une chaise” qui apparaît, à première vue, comme un poème d’amour relatant l’histoire rocambolesque d’un poète follement amoureux d’une chaise, est, en réalité, un texte poétique très engagé. La véritable signification de celui-ci ne peut être perçue en dehors d’une lecture à un niveau figuré. Ainsi, par le moyen de la métaphore, ce poème satirique a pu être présenté comme un texte non engagé, plaisant et rythmé par des itérations. L’étude ayant consisté d’abord à définir la figure microstructurale de la métaphore, a, par la suite, démontré que l’essentiel du message est “camouflé” et ne se révèle qu’aux lecteurs capables de décrypter un discours figuré.
Mots-clés : Système figuré, figure-écart, figure microstructurale de la métaphore, phénomène de réécriture, itérations.
ABSTRACT :
” Love of a chair ” is a very committed poem. At first glance it looks like a love poem telling an incredible story of a poet madly in love with a chair. The true meaning of this poem can be perceived outside a reading of it in a figurative level. The study that first involved defining figure microstructure of metaphor, has subsequently shown that the key message is “camouflaged” and is revealed as players capable of deciphering a figurative speech. Essentially, the study shows that, through metaphor, X. Ebony Christmas could make this very poem committed a pleasant text punctuated by iterations.
Key words : Figurative system, figure-gap, microstructural figure of metaphor, rewriting phenomenon, iterations.
INTRODUCTION
Parlant de l’objet d’étude de la stylistique, Georges Molinié indique que : « … c’est le discours littéraire, la littérature. Plus exactement, c’est le caractère spécifique de littérarité du discours… »[51] Dans La stylistique, Que-sais-je ?, il la définit comme une science qui se préoccupe de : « l’étude des conditions verbales, formelles, de la littérarité »[52]. La stylistique qui a eu un parcours certain dans son histoire a fait du régime de littérarité sa priorité.
La figure qui fait partie des cinq postes d’analyse stylistique[53] est souvent perçue comme un simple ornement du discours ; elle occupe une place importante, voire capitale dans la société. Elle participe de la dynamique de la communication ; on ne saurait en faire l’économie. Son importance s’observe dans les échanges courants, dans la tradition orale, mais aussi et surtout dans les œuvres dites littéraires. La figure par excellence, selon Georges Molinié, est la métaphore.
Déjà-vu est un poème aux longs cours, il est l’unique texte poétique publié par le journaliste-poète Essy Kouamé alias Noël X. EBONY. Dans la première version, publiée du vivant de l’auteur, le poème intitulé “Amour d’une chaise”, le corpus la présente étude, faisait partie d’un supplément de poèmes appelé CHUTES qui a été inséré dans le livre[54].
La nature spécifique de ce poème d’Ebony nous a fondé à y faire une lecture sous l’angle du discours figuré. En outre, la figure de la métaphore qui y est récurrente s’est imposée d’elle-même à cette étude. Le sujet, tel qu’il est formulé, tente de définir le lien entre le corpus d’étude et la métaphore. Il s’agit précisément de montrer comment la métaphore permet-elle de percer la substantifique moelle du message véhiculé dans “Amour d’une chaise”. Le travail consiste, en d’autres termes, à démontrer que le poète s’est servi de la métaphore pour présenter un poème aussi engagé sous l’aspect d’un texte presque parnassien, à l’abri de toute velléité de censure ?
Pour une plus grande clarté de l’analyse consistant à montrer l’importance de la métaphore pour la bonne compréhension de ce poème, il serait intéressant de la faire précéder par un exposé théorique sur ladite figure.
1. À PROPOS DE LA FIGURE DE LA MÉTAPHORE
Avant de parler de la figure de la métaphore en tant que telle, il nous paraît important d’indiquer d’abord ce que renferme la notion de figure dans le domaine de la littérature.
1.1. La figure en littérature
En littérature, la figure est d’emblée perçue comme un écart vis-à-vis de la norme. Elle rappelle surtout la notion d’écart au sens Spitzerien du terme, c’est-à-dire : un rejet de la norme ordinaire.
Ainsi, la plupart des définitions de la figure l’appréhendent comme une négativité des usages habituels. Cette idée se lit, au demeurant, dans les acceptions suivantes : « altération ressentie du degré zéro » (Groupe u. p. 41), « discours déviant » (Kherbrat, 1988, p. 222), « usage inhabituel » (Morel, p. 4).
Il va s’en dire que pour décrypter une figure, l’instance de la réception doit « retrouver » l’usage habituel premier, en réduisant le discours figuré à du non-figuré. La figure, en d’autres termes, est une création pure d’un énonciateur donné qui fait le choix de rompre avec les habitudes classiques d’expression. Dans la logique figurale, le mot n’est pas obligé de désigner ou de refléter ce à quoi il est appelé habituellement à désigner. Par conséquent, le mot figuré est, certaines fois, étranger au contexte de son emploi, si tant est qu’il est fait pour désigner, la plupart du temps, une réalité différente de celle à laquelle il renvoie habituellement.
Le style qui est appréhendé par Buffon comme « …l’homme même »[2], s’identifie le plus souvent par le moyen de la figure.
Aussi, avant de présenter l’approche moliniéenne de la figure, il nous semble important d’indiquer que le développement qui a été fait jusque-là n’est pas sans rappeler la théorie de la figure-écart développée par Pierre Fontanier[55].
Parlant de l’objet figuré, Georges Molinié écrira qu’: «il y a figure quand dans un segment de discours, ou dans un discours entier, quand l’effet de sens produit ne se réduit pas à celui qui est engagé par le simple arrangement lexico-syntaxique…»[56]
Ce postulat moliniéen met d’emblée en relation un degré zéro d’expression et l’interaction entre l’énonciation et la réception. Dans la mesure où I désigne l’information, et E l’expression, il y a un degré zéro d’expression quand E = I. En revanche, dès que l’expression diffère de l’information ( E ≠ I (au-delà ou en deçà)), il y a figure. La figure est une différence, une quantité langagière différentielle entre le contenu informatif ( I ) et les moyens lexico-syntaxiques mis en œuvre dans un énoncé( E ).
Bien que les traités et essais de rhétorique présentent un nombre très important de figures qui servent la plupart du temps des causes différentes, sur la base de points de convergences qu’elles présentent, Georges Molinié les a regroupées en deux grandes catégories ; à savoir : les figures macrostructurales et les figures microstructurales.
Dans la structuration qu’il fait de la figure macrostructurale, on retrouve les propriétés suivantes :
– elles n’apparaissent pas a priori à la réception ;
– elles ne s’imposent pas pour qu’un sens soit immédiatement acceptable ;
– elles ne sont pas isolables sur des segments formels.
Ainsi l’allocution, l’amplification, l’hypotypose et de l‘oppositionsont-elles les figures macrostructurales par excellence.
De même, les propriétés des figures microstructurales se déclinent ainsi :
– elles se signalent de soi ;
– elles sont obligatoires pour l’acceptabilité sémantique ;
– elles sont isolables sur des éléments formels déterminés et fixes.
Molinié précise que cette seconde catégorie de figures comporte trois rubriques ; à savoir : – les figures qui portent sur le matériel sonore (la modification et la répétition, l’anaphore, l’épiphore, l’anadiplose et le polyptote.) ;
– les figures qui tiennent à l’arrangement syntaxique des lexies ;
– les figures qui portent sur le sens des mots : les tropes.
La métaphore, objet de la présente étude, est un trope. Pour cette raison, nous allons mettre un accent particulier sur les tropes qui, du reste, désignent toutes les figures microstructurales portant directement sur le sens des mots. Les deux principaux tropes sont, au demeurant, la métonymie et la métaphore[57].
Aussi, pour une plus grande efficacité de l’analyse, il nous paraît intéressant de présenter quelques-unes des caractéristiques de la métaphore.
1.2. La spécificité de la métaphore
La figure microstructurale de la métaphore intègre la comparaison, même si a priori elle se différencie de la comparaison qui, du reste, n’appartient pas à la famille des tropes.
La métaphore, en effet, même si elle semble s’appuyer, elle aussi, sur un rapprochement entre un comparé et un comparant, se trouve dans un rapport de similitude consistant dans le remplacementde l’un des termes par l’autre. Le mot “normal” est, dans cette logique, remplacé par le mot métaphorique. Ce fonctionnement se signale d’emblée par le nom même de la figure, où « méta » indique un déplacement et « phore » l’idée de « porter » : il s’agit d’un transport, d’un transfert, de la translationdu mot métaphorique dans un contexte correspondant à une structure fondamentale du discours.
La métaphore fait apparaître dans la conscience de l’instance de la réception du message un double phénomène : d’une part, elle entend le mot qu’a finalement choisi le locuteur ; d’autre part, elle a en tête un second mot qui est le mot que laissait attendre le contexte. Il est indispensable de considérer que ce second mot est présent à son esprit : si tel n’était pas le cas, cela signifierait que la métaphore n’est pas comprise. Quand il y a métaphore, deux mots, au lieu d’un, coexistent dans la conscience de l’interlocuteur.
La métaphore, il est bon de le souligner, doit être toujours interprétée au cours de l’analyse. Même si son étude est principalement sémantique, il importe cependant de cerner au départ ses types et ses structures syntaxiques.
Il existe, globalement, trois types de métaphores : la métaphore in praesentia présentant un métaphorisé et un métaphorisant, la métaphore in absentia où il n’y a que le métaphorisé, et la métaphore filée consistant en un prolongement de la métaphore, après l’apparition du métaphorisé.
Syntaxiquement, les catégories lexicales qui servent de supports à la figure de la métaphore permettent également de la sous-catégoriser en : métaphore verbale, quand elle est supportée par un verbe, métaphore adjectivale, quand elle est supportée par un adjectif, métaphore substantive, quand elle est supportée par un substantif et métaphore adverbiale, quand elle est supportée par un adverbe.
Pour étayer l’argument selon lequel la métaphore est la figure utilisée pour “brouiller les pistes d’interprétation” de ce poème, il nous paraît intéressant de montrer comment cette figure asservi ce texte poétique.
2. LA MÉTAPHORE COMME STRATÉGIE DE SÉMANTISATION DANS “AMOUR D’UNE CHAISE”
En partant de l’hypothèse que la métaphore permet de mieux comprendre le sens profond de “Amour d’une chaise”, la démarche consiste à présent en une analyse méthodique du corpus en vue de cerner les manières dont s’opère le processus de métaphorisation avant de procéder, en dernière instance, à une réécriture du poème qui en révélera le sens caché.
2.1. Le processus de métaphorisation dans “Amour d’une chaise”
Une lecture attentive de ce poème montre qu’il y a un emploi récurrent du mot “chaise”. Le grand amour, ou la grande affection que le poète éprouve pour la chaise dont il est question traverse l’ensemble du texte.
Il suffit de considérer le titre du poème et même les premiers vers de celui-ci pour se laisser convaincre par cet amour quelque peu atypique qui anime le locuteur-poète :
« AMOUR D’UNE CHAISE
Je suis amoureux d’une chaise
à première vue cela paraît facile
mais c’est plus compliqué que ça n’en a l’air
aimer une chaise c’est un peu comme aimer la difficulté
mais on ne le fait pas exprès
c’est l’amour qui veut ça. »
L’amour pour cette chaise est évident dans le poème ; il est raconté d’un vers à l’autre. En même temps que le poète exalte cet amour pour la chaise en question, il présente les difficultés liées à cet amour. Le mélange de sentiments se fait jour dans ce poème.
C’est dans cette démarche manichéenne que les vers qui suivent mettent en exergue la mélancolie liée à la désagrégation de cette chaise :
« elle s’écrasa sous moi (v.25)
et se désintégra sans crier gare » (v.26)
« on se souvient toujours des déchirements d’adieu (V.10)»…
« sans elle que serait ma vie » (v.18).
Bien que le mot “chaise” soit ici remplacé par le pronom à la troisième personne “elle”, son omniprésence ne souffre d’aucun doute. Il est même évoqué explicitement douze (12) fois dans le poème. Or, tel qu’il y est employé, le mot “chaise” présente une certaine ambigüité, dans la mesure où, du point de vue du discours utilitaire, on n’a pas l’habitude de traiter ainsi le sentiment qu’un être humain ressent pour une chaise. De même, ce n’est pas courant de qualifier ainsi le sentiment que l’on pourrait éprouver pour une chaise. L’objet de désir rend ainsi “inapproprié” l’emploi de l’amour qui est, ici, fait. Dans le discours utilitaire, et dans les faits, un être normal ne peut pas dépeindre de cette façon l’amour qu’il éprouverait pour une chaise. Il y a assurément un emploi figuré qui mérite un décryptage particulier.
La poétique des genres enseignant qu’en poésie, on use bien souvent d’un langage autre que le langage utilitaire, il nous semble impérieux de rechercher non la signification mais la valeur[58] du mot “chaise”.
Aussi, pour conduire à bien cette démarche, il nous semble intéressant de recourir à l’histoire et à la culture qui nous permettent de savoir que le poète Noël X. EBONY fut un journaliste très engagé, sous le régime du parti unique dirigé par le président Félix Houphouët Boigny ; et qu’à un moment donné de sa vie, pour éviter d’être emprisonné ou éliminé physiquement, il a dû s’exiler au Sénégal où il meurt dans un accident de la circulation à Dakar, dans des conditions jugées bizarres. En hommage à son combat, l’UNJCI[59] lui a dédié le prix du meilleur journaliste de Côte d’Ivoire.
On sait, par conséquent, de Noël. X. Ebony qui n’a publié qu’une seule œuvre littéraire, que sa vie et son œuvre sont marquées par l’engagement et le militantisme. S’il s’est retrouvé au Sénégal, c’est en raison de son grand engagement. Avec cette information qui nous semble capitale, la matière première de l’exploration stylistique de ce poème est déjà disponible. Il s’agit, désormais, de chercher à vérifier si les traces de l’engagement se retrouvent dans ce poème où prédomine le lexème chaise.
La première strophe, composée de six (6) vers, traduit l’amour du locuteur pour une chaise. Il s’agit, ici, de l’amour appelé Eros en grec, c’est-à-dire : l’amour pour les objets matériels ou amour physique se traduisant par un désir appelant un contact. Cet amour Eros diffère de celui dénommé philia renvoyant à l’amitié ou à la relation d’estime mutuelle. L’amour eros diffère, enfin, de l’amour agape qui est l’amour du prochain ; à savoir : l’amour désintéressé.
Tel qu’il est présenté dans ce poème, cet amour semble avoir attiré beaucoup d’ennuis au locuteur-poète qui prend soin de prévenir :
« À première vue cela paraît facile
mais c’est plus compliqué que ça n’en a l’air » (V3).
L’amour qu’éprouve le poète pour cette chaise apparaît comme un amour situé aux antipodes des délices du vrai amour. Au vers 4 du poème, on note la présence d’une comparaison classique portant sur les mots « chaise » (terme comparé) et « difficulté » (terme comparant). Elle s’est faite par le moyen du terme de comparaison « comme ». Cette comparaison est ainsi formulée : « aimer une chaise c’est un peu comme aimer la difficulté ».
À l’analyse, on voit que la présence de la comparaison dans ce vers fonctionnant à l’aune de la métaphore, ne surprend guère, d’autant plus que, d’ordinaire, la métaphore est reconnue pour englober quelque fois la comparaison (cf. I. A PROPOS DE LA FIGURE DE LA METAPHORE).
Du point de vue du sens des mots utilisés, il n’y a aucune ambiguïté, dans la mesure où on comprend aussitôt que l’objet de désir du poète est difficile à acquérir. Cette comparaison fait penser à un poète masochiste, dans la mesure où il n’affectionne que ce qui est hors de sa portée.
Comme s’il voulait rassurer son lectorat, il se lance, très vite, dans la justification de son attitude quelque peu étrange, en précisant avec sincérité :
« mais on ne le fait pas exprès
c’est l’amour qui veut ça ».
Tout porte à croire qu’il ploie sous le poids d’un amour qui échappe au contrôle de la raison. Ainsi, l’amour pour cette chaise est aussitôt relancé au vers 7 du poème : « je suis amoureux d’une chaise ». La récurrence du retour intégral du même vers dans ce poème se confirme davantage. Les refrains utilisés par le poète rapprochent son art de la musique, art qui se soucie de l’harmonie des sons. A l’analyse, on voit que les phénomènes itératifs font partie des éléments qui mettent en exergue la figure de la métaphore dans ce poème. Ils bonifient, pour ainsi dire, l’éclat de cette figure.
La deuxième strophe ne s’éloigne pas de la première. Tout tourne autour de l’amour que le locuteur ressent pour une chaise. Celui-ci s’interroge même sur l’origine de cet amour quelque peu envahissant, mais n’arrive pas à situer cela dans le cours des événements. C’est pour traduire cela qu’il écrit : « je ne sais pas comment ça a commencé ».
Il sait, tout de même, que les conséquences de cet amour ne sont pas joyeuses :
« et on se souvient toujours des déchirements d’adieu».
Il avoue ainsi que l’amour pour cette chaise ne lui vaut que des mésaventures, réalité qu’il traduit par : « des déchirements d’adieu ». L’idée de mouvement, de départ douloureux est sous-entendue ; on la perçoit à travers les lignes. Mais, comme s’il tenait à se lancer un défi personnel, et à s’enliser dans un élogieux développement sur cet amour aux arrière-goûts amers, le poète relance le refrain qu’il a déjà utilisé au vers 1 et 7 : « je suis amoureux d’une chaise ».
Dans le fonctionnement technique de ce refrain, on observe qu’il marque la fin d’un mouvement et relance un autre. Le refrain a, ici, un rôle annonciateur de situations toujours nouvelles, et permet une certaine aération du récit.
La troisième strophe vient, quant à lui, donner les caractéristiques de la chaise dont il est question depuis le début de cette histoire fabuleuse. Aussi curieux que cela puisse paraître, le poète affirme qu’: « elle est une chaise simple, une chaise de tous les jours ».
Le langage ambigu, voire de camouflage est davantage entretenu à dessein, à travers le vers suivant : « elle est simplement la chaise dont je suis amoureux ». Le pronom personnel « la » qui a remplacé l’article indéfini « une » traduit pourtant la volonté du locuteur de vouloir opter pour la précision. Cependant, pour l’heure, il entretient l’ambigüité.
La quatrième strophe renforce l’idée d’un amour passionnel :
« je suis amoureux d’elle
follement amoureux
amoureux au point de ne savoir qu’en dire ».
L’amour dont ne cesse de parler le poète s’apparente à une sorte d’obsession, dans la mesure où il dépasse les limites de la raison. Cet amour avoisine celui que Le Chevalier Desgrieux éprouvait pour Manon Lescaut, tout comme celui que Phèdre éprouvait pour Hippolyte qui, à son tour, aimait passionnément Aricie.
À vrai dire, tomber amoureux d’une chaise anonyme est insolite, voire ridicule. C’est cela qui restitue à la figure de la métaphore, employée de façon récurrente dans ce poème, toute sa puissance.
L’amour du poète pour son objet de désir se traduit par son incapacité à nommer celui-ci : « Elle n’est ni grande ni petite ni droite ni rocking chair ». Il sait, toutefois qu’elle est : « une chaise unique ». En d’autres termes, elle ne saurait être reproduite par aucun ébéniste.
En plus d’être une chaise unique, elle est présentée comme ce qui donne un sens à la vie du locuteur-poète : « sans elle que serait ma vie ». Ce n’est pas de façon fortuite que ce poème est marqué par la modalité assertive. Il en est ainsi, parce que le texte fait l’état des lieux d’un sentiment oscillant entre l’admiration et le regret.
L’antépénultième strophe de ce poème annonce une rupture importante introduite par la conjonction de coordination « or ». Cette rupture est annoncée par : « or un jour ma chaise se couvrit de coussins ». Le poète ne se préoccupe même pas de détails permettant de dater ce jour mémorable. Tout ce qu’il sait, c’est qu’un jour, il s’est passé quelque chose. On remarque le jeu qu’il fait avec les mots, tout comme l’enfant joue avec ses bâtonnets. Dans cette ambiance, une chaise couverte de coussins accueille l’homme non à bras ouverts, mais « à bois ouverts » ; il joue ainsi sur les mots “bois” et “bras”.
Dans la suite du poème, on voit un poète en train, subitement, de caresser la peau d’ébène de la chaise aimée. Il y a une transformation au niveau de la nature de cet objet ; c’est comme si la chaise était devenue un être humain. Cette transformation s’inscrit très bien dans le fonctionnement classique de la figure de la métaphore. En effet, comme le signale le nom même de la figure : « méta » indique un déplacement,« phore » l’idée de « porter » : il s’agit d’un transport, d’un transfert, de la translation du mot métaphorique dans un contexte correspond à une structure fondamentale du discours. La figure porte, ici, sur la peau d’ébène de la chaise aimée : la métaphore in praesentia ainsi exprimée crée un effet d’anthropomorphisation. Or, comme telle, celle-ci doit être interprétée.
Vu que la caractéristique essentielle de cette chaise qui est l’objet de désir du poète, est d’attirer l’ennui, la mélancolie, et vu l’histoire particulière de l’auteur de ce poème, marquée par l’engagement et l’exil jusqu’à sa mort accidentelle (qu’on dit être provoquée), il nous semble juste de penser que la “chaise recherchée” a des chances d’être la patrie perdue par l’exilé. Ainsi quand il écrit : « on se souvient toujours des déchirements d’adieu» (v.11)), il fait allusion aux désastres liés à l’abandon de sa patrie et des siens pour se retrouver en exil. N’est-ce pas cette idée d’exil et du manque de la patrie qui apparaît dans la dernière strophe du poème ?
« depuis lors
je pleure ma chaise (patrie)
et je cours debout à travers le monde
cherchant une chaise (patrie) à aimer où m’asseoir.»
La puissance de transformation de la figure de la métaphore est telle que, par son canal, le poète a réussi à transmuer la patrie en chaise. Le faisant, ce poème n’apparaît pas comme un poème engagé aux yeux de ceux qui n’ont pas été visités par les prouesses du langage figuré. Il ressort de ce qui précède que la figure de la métaphore sert à exprimer, en des termes très peu révoltants, l’attachement à la patrie et les souffrances liées à l’exil dans “Amour d’une chaise”.
La réécriture de ce poème vise à vérifier “l’hypothèse” selon laquelle le mot chaise employé dans ce poème a effectivement la valeur de “patrie”.
2. 2. Le phénomène de réécriture du poème
Il s’agit de réécrire le poème en s’efforçant de remplacer le mot “chaise” par sa nouvelle valeur qui est “patrie”. On obtient alors la version suivante :
« AMOUR D’UNE PATRIE »
Je suis amoureux d’une patrie
à première vue cela paraît facile
mais c’est plus compliqué que ça n’en a l’air
aimer une patrie c’est un peu comme aimer la difficulté
mais on ne le fait pas exprès
c’est l’amour qui veut ça.
Je suis amoureux d’une patrie
je ne sais pas comment ça a commencé
on ne sait jamais comment ça commence
et on se souvient toujours des déchirements d’adieu
ma patrie aimée n’a pour se nommer
que son propre nom
un nom qui vient de l’amour que je lui porte
patrie aimée
elle n’est ni grande ni petite
ni droite ni rocking chair
elle est une patrie unique
sans elle que serait ma vie
or un jour
ma patrie se couvrit de coussins
elle m’accueillit à bois ouverts
je caressai sa peau d’ébène
et elle m’attira
lorsque je m’étendis en elle
elle s’écrasa sous moi
et se désintégra sans crier gare
depuis lors
je pleure ma patrie
et je cours debout à travers le monde
cherchant une patrie à aimer où m’asseoir.»
Le premier constat qui se dégage de la réécriture de ce poème est qu’en remplaçant le mot figuré “chaise” par sa valeur, c’est-à-dire : patrie, le message véhiculé devient plus accessible à un nombre important de récepteurs (lecteurs). Le second constat est que cet état de fait replace ce poème dans la catégorie des poèmes marqués par un grand degré de littérarité, car comme l’écrit Monique Parent :
« …Le texte poétique se reconnaît donc à l’abondance des synonymies, des antithèses, des symétries, des parallélismes. On pourrait dire que le texte poétique est dû à un phénomène de réécriture : l’idée, la part d’information peuvent se ramener à quelques mots ; mais elles sont reprises sous des formes diverses, nombreuses, et très impressionnantes de sorte que ces formes se gravent dans l’esprit, et paraissent intangibles, plus riches et plus précieuses que le sens qu’elles véhiculent. Les phénomènes musicaux du langage (rythme et sonorité) apparaissent comme très importants, et ils sont privilégiés par rapport à la signification… »[60]
Ce poème embrasse, à lui-seul, la quasi-totalité des caractéristiques du poème parfait, selon l’entendement de Monique Parent. Ainsi, la réécriture de celui-ci a pu restituer sa signification camouflée aux lecteurs non aguerris aux arcanes du langage figuré.
Lorsque l’on restitue au mot chaise sa signification voilée qui est patrie, on découvre le très grand attachement du poète Ebony à sa patrie et les souffrances qu’il endurait en tant qu’exilé.
Ainsi, on comprend désormais que lorsqu’il écrit, dans les vers 4, 5 et 6, :
« aimer une chaise c’est un peu comme aimer la difficulté
mais on ne le fait pas exprès
c’est l’amour qui veut ça », il fait allusion à la souffrance endurée du fait de son attachement à sa patrie. Dans ces conditions, l’exil apparaît comme une situation intenable.
La souffrance endurée du fait du mal du pays est si intense qu’il n’hésite pas à se demander à quand remonte ce grand attachement à celui-ci. Il n’est pas exclu le fait qu’il s’en veuille de n’avoir pas vu les choses venir :
« je ne sais pas comment ça a commencé
on ne sait jamais comment ça commence
et on se souvient toujours des déchirements d’adieu » (v.8, 9,10).
Les marques de l’affectivité euphorique de l’émetteur qui sont à l’origine de la souffrance qu’il connaît désormais en tant qu’exilé sont nombreuses ; on note, entre autres : les vers 1 et 7 : « Je suis amoureux », les vers 4, 11, 14 et 30 : « aimer », les vers 6 et 13 : « amour », le vers 22 : « caresser », enfin le vers 28 : « je pleure ma chaise ».
Plus le poète réalise qu’il n’a pas vu venir son attachement pour sa patrie, plus sa douleur est intense. Il a fait, malheureusement, l’amer constat des conséquences néfastes de cet état de fait lorsque, par la force des choses, il a été emmené à vivre loin de celle-ci.
Quand le poète écrit : « elle est une chaise unique sans elle que serait ma vie » (v.17, 18), il entend traduire son désarroi face à son incapacité à s’épanouir loin de sa patrie.
La pénultième strophe du poème qui fait, en quelque sorte, le bilan de cette affection incontrôlée envers la patrie (chaise) plonge, à son tour, le lecteur de ce poème dans un sentiment de peine :
« depuis lors
je pleure ma chaise
et je cours debout à travers le monde
cherchant une chaise à aimer où m’asseoir ». (v.27-30)
Pour le poète exilé, désormais, il n’y a plus d’espérance, ses espoirs sont ruinés ; inconsolable, il cherche vainement ses repères. Le troisième vers de cette strophe rend mieux l’idée de dérèglement total, si tant est que seuls les déportés, les réfugiés et les apatrides peuvent courir debout à travers le monde : «et je cours debout à travers le monde ».
CONCLUSION
L’analyse de “Amour d’une chaise” montre le génie du poète N.X. Ebony qui a pu écrire un texte aussi riche et voilé, en lui donnant un aspect autre. Ce poème n’est pas compris, s’il n’est pas lu en tant que discours figuré. Grâce à la dynamique de la figure microstructurale de la métaphore, le poète a su dénoncer, de façon maquillée, voire subtile, les affres de la dictature, sans exposer son recueil poétique à la censure du pouvoir d’alors.
Ce poème confirme le caractère quelque peu élitiste de la poésie, genre par excellence du “camouflage”, qui tente de procéder à un certain déguisement des mots pour qu’il n’ait a priori pas de déconvenues à la réception du message. A première vue, il apparaît comme un texte évasif et innocent.
La métaphore, englobant dans son élan les nombreuses réitérations, a constitué l’essentiel du régime de littérarité de ce poème. Aussi serait-il intéressant de savoir comment cette belle page qui frise la gaieté l’aurait été, si elle n’avait pas été forgée dans le moule de la métaphore ?
CORPUS
AMOUR D’UNE CHAISE
Je suis amoureux d’une chaise
à première vue cela paraît facile
mais c’est plus compliqué que ça n’en a l’air
aimer une chaise c’est un peu comme aimer la difficulté
mais on ne le fait pas exprès
c’est l’amour qui veut ça.
Je suis amoureux d’une chaise
je ne sais pas comment ça a commencé
on ne sait jamais comment ça commence
et on se souvient toujours des déchirements d’adieu
ma chaise aimée n’a pour se nommer
que son propre nom
un nom qui vient de l’amour que je lui porte
chaise aimée
elle n’est ni grande ni petite
ni droite ni rocking chair
elle est une chaise unique
sans elle que serait ma vie
or un jour
ma chaise se couvrit de coussins
elle m’accueillit à bois ouverts
je caressai sa peau d’ébène
et elle m’attira
lorsque je m’étendis en elle
elle s’écrasa sous moi
et se désintégra sans crier gare
depuis lors
je pleure ma chaise
et je cours debout à travers le monde
cherchant une chaise à aimer où m’asseoir[61].
BIBLIOGRAPHIE
EBONY, Noël X., Déjà-vu, Paris, Ouskokata, 1983.
CALAS, Frédéric, Leçons de stylistique, Paris, Armand Colin, Cursus Lettres, 2011.
COGARD, Karl, Introduction à la stylistique, Paris, Flammarion, 2001.
FROMILHAGUE, Catherine, et SANCIER-CHATEAU, Anne, Introduction à l’analyse stylistique, Paris, Armand Colin, Lettres sup., 2004.
JAKOBSON, Roman, Huit questions de poétique, Paris, Seuil, coll. Point, 1977.
MOLINIE, Georges, La stylistique, Que sais-je ?, Paris, PUF, 2ème édition corrigée, 1991.
MOLINIE, Georges, La stylistique, Paris, PUF, 1993.
NEVEU, Franck, LEMAITRE, Denis, Vers la maîtrise du texte, Paris, 1992.
Articles cités
PARENT, Monique, « La fonction poétique dans deux textes de Saint John PERSE » in Revue de philologie et littérature romane, université de Strasbourg IX, I61971.
« Je n’ai pas dépeint Socrate, [affirme-t-il], m’adressant son récit, comme il le faisait, mais s’adressant à ceux avec qui il disait avoir dialogué. Et c’était, disait-il, avec le géomètre Théodore et avec Théétète. Pour éviter donc que l’écrit ne soit rendu difficile par les formules narratives insérées entre les paroles, à la fois quand Socrate parle de lui-même, disant par exemple : “et je disais”, ou “et, dis-je”, ou quand à l’inverse, parlant de celui qui lui répond, il dit : ” il en convint” ou “il n’en convint pas” – voilà pourquoi, supprimant les formules de ce genre, j’ai rédigé comme si c’était lui-même qui s’entretenait avec eux » (Platon, 2011, 143b-c).
Cette affirmation revêt trois centres d’intérêts montrant bien que le Théétète pourrait être perçu, non comme le produit d’un recadrage méthodologique, mais comme le résultat d’une invention dissimilée. Le premier est l’absence du rédacteur Euclide lors des échanges qu’il se charge de mettre par écrit. En témoigne son propos par lequel il affirme avoir rapporté le récit de Socrate et de « ceux avec qui il disait avoir dialogué. [Et] c’était, disait-il, avec le géomètre Théodore et avec Théétète » (Platon, 2011, 143b). Comme on le voit, Euclide n’était pas témoin oculaire de l’échange de Socrate avec ses interlocuteurs puisqu’il insiste sur le fait que c’est Socrate qui dit avoir échangé avec Théodore et Théétète. Aussi, refuse-t-il de prendre en charge cette information. Il aurait pu affirmer, sans détours, que Socrate a échangé avec Théodore et Théétète. Au lieu de cela, il laisse à Socrate la responsabilité de son affirmation.
Le deuxième centre d’intérêt réside dans la reconnaissance, par Euclide, d’une certaine infidélité dans la restitution du récit de Socrate. Il confesse n’avoir pas dépeint Socrate tel qu’il lui adressait le récit. « Je n’ai pas dépeint Socrate m’adressant son récit, comme il le faisait » (Platon, 2011, 143b), dit-il précisément. Il y a là un écart entre la narration orale de Socrate et la narration écrite d’Euclide qui nous sert de référence. Les écrits d’Euclide ne sont donc pas conformes aux propos que Socrate a tenus, comme il le reconnaît lui-même. Cela conduit à l’idée que ce propos de Socrate nous est parvenu, de manière déformée, à partir d’un compte rendu inexact, construit selon la volonté d’Euclide.
Le troisième centre d’intérêt s’articule autour de la réorganisation euclidienne du récit socratique. Si Euclide nous a retransmis un récit déformé, c’est parce qu’il l’a restructuré et présenté selon ses propres canons rédactionnels. Il a pris sur lui-même la responsabilité d’occulter les formules narratives du récit socratique telles que : « “et je disais”, ou “et, dis-je”, (…) ; ” il en convint” ou “il n’en convint pas” ». En procédant ainsi, il rédigea un dialogue qu’il a lui-même conçu. Et, il nous retransmet le récit comme si c’est Socrate qui s’entretenait avec Théodore et Théétète.
Le point nodal de ces trois centres d’intérêt se résume à l’idée que le Théétète peut être perçu comme une véritable mise en scène. Étant absent lors de l’échange qu’il retransmet par écrit, ayant, en outre, confessé avoir rédigé un récit biaisé, et ayant soutenu avoir réorganisé le dialogue selon ses propres canons rédactionnels, Euclide semble avoir rédigé un dialogue qui n’est que le produit d’une créativité fictive. Le philosophe ivoirien Robert Niamkey-Koffi a bien perçu cette dimension du dialogue platonicien. Il soutient, à juste titre : « En tant que genre littéraire, le dialogue se donne comme un artifice opérant la théâtralisation du fait interlocutoire en produisant la fiction dramatique d’une alternance des positions interdiscursives » (1996, p. 18). C’est dire que le dialogue platonicien est une invention dramatique qui revêt subrepticement l’allure d’un dialogue authentique.
L’idée selon laquelle les écrits de Platon apparaissent comme des fictions dramatiques peut être remise en cause par le fait que l’œuvre de Platon n’est pas uniquement constituée de dialogues racontés. Luc Brisson, dans son Platon pour notre temps, rappelle qu’en plus des dialogues racontés, figurent des dialogues directs et des dialogues exposés dans l’œuvre de Platon (L. Brisson, 2011, XI). L’enjeu de cette classification brissonnienne est que, si certains dialogues racontés, tel que le Théétète, peuvent être taxés de fictifs, les dialogues directs et exposés, quant à eux, échappent à cette critique. Cette approche, bien que pertinente doit être relativisée ; car, pour Platon, la vraie pensée, qu’elle soit consignée dans des dialogues racontés, directs ou exposés n’a aucunement besoin d’interlocuteurs.
L’on se référera au propos suivant de Platon précisant que le dialogue n’a pas besoin d’interlocuteurs : « La pensée est le dialogue de l’âme avec elle-même » (2011, 264a). L’idée sous-tendue par cette déclaration platonicienne est que la pensée, digne de ce nom, est celle que l’âme entretient avec elle-même, sans un interlocuteur autre que le sujet-pensant. De ce point de vue, la pensée, à proprement parler, est le fait, pour un individu, d’entrer en lui-même pour écouter la voix de son être tel. La pensée se produit en l’individu où l’âme dialogue avec elle-même. Un tel dialogue, parce qu’il est intérieur, ne peut qu’être silencieux. Platon parle de « dialogue intérieur que l’âme entretient, en silence, avec elle-même » (2011, 263e). En tant que tel, la présence d’un interlocuteur n’est pas indispensable à sa réalisation. Au contraire, la vraie pensée, dans ce contexte, ne se déploie que dans la négation et le refus de la présence de l’interlocuteur.
En considérant le dialogue intérieur de l’âme comme l’essence même de la pensée, niant ainsi la nécessité de l’interlocuteur pour que le dialogue soit possible, Platon a réalisé des dialogues inauthentiques. Il a utilisé les interlocuteurs de Socrate dans une véritable fiction dramatique. Il convient donc de reconnaître que Socrate n’avait pas d’interlocuteurs, autres que lui-même. Il utilisait les sophistes, de manière formelle, comme des interlocuteurs. Dans le fond, Socrate dialoguait seul, avec lui-même. Il se conformait à l’idée que la vraie pensée n’est pas bruyante et ne provient pas des dialogues extérieurs entretenus avec les autres.
De ce qui précède, il convient de retenir que les dialogues de Platon ne sont, pour ainsi dire, que des mises en scènes fictives à travers lesquelles Socrate traduit un dialogue intérieur de son âme avec elle-même. Monique Dixsaut a raison de déclarer que « Platon a écrit ses dialogues tout seul et qu’ils ne sont pas la transcription d’entretiens actuellement et oralement tenus » (2000, p. 52). Il en résulte que, les sophistes présentés comme les interlocuteurs de Socrate ne sont, en réalité, qu’utilisés par Platon dans une sorte de « configuration paratactique » déguisant son monologisme (R. Niamkey-Koffi, 1996, p. 18). Autrement dit, Platon a mis en œuvre une tactique donnant l’illusion qu’il a convoqué des interlocuteurs pour réaliser ses dialogues.
CONCLUSION
Il est difficile de nier radicalement aux écrits de Platon le statut de dialogue dans la mesure où ils mettent en scène des interlocuteurs, dont des émetteurs et des récepteurs de messages. Cependant, il faut bien reconnaître que ces dialogues comportent bien des insuffisances. L’une de ces insuffisances est le fait que le dialogue platonicien articule une suprématie dictatoriale de Socrate sur ses interlocuteurs et même sur ses lecteurs. Dans l’œuvre de Platon, il n’existe pratiquement pas de moment où Socrate est réfuté ou mis en minorité par ses interlocuteurs. Au contraire, ce sont ses interlocuteurs qui, dans toutes les joutes oratoires, sont battus. Ce qui conduit ainsi, insidieusement, le lecteur à considérer que les interlocuteurs de Socrate ne sont pas à la hauteur des débats.
De plus, dans les dialogues de Platon, l’on remarque que les pensées des interlocuteurs sont rapportées d’une manière singulière, sans respect des normes élémentaires de l’herméneutique. Platon ne procède pas par une reconstruction véritable des différentes articulations de la pensée des sophistes, à partir de leurs principes initiaux. Il ne présente que des aspects polémiques et imprécis de leurs pensées afin de pouvoir les remettre facilement en cause.
Par ailleurs, les dialogues de Platon ne sont pas tous rapportés de manière fidèle. Ils s’apparentent parfois à des récits fictifs à travers lesquels les idées sont attribuées aux locuteurs selon les principes que le rédacteur s’est lui-même fixés. Le Théétète, par exemple, est rédigé par Euclide qui, absent lors du dialogue, l’a reconstruit en se fondant sur ses propres canons rédactionnels.
Tout cela autorise à affirmer que le dialogue de Platon apparaît comme un dialogue inauthentique dans la mesure où il transgresse les principes basiques du vrai dialogue. C’est pourquoi, l’appellation qui convient le mieux aux écrits de Platon est : “le monologue”. À défaut d’adopter officiellement cette expression pour les qualifier, il convient, à tout le moins, de nuancer le substantif “dialogues de Platon”, chaque fois que l’on l’emploie. Les éditeurs, traducteurs et spécialistes de l’œuvre de Platon devraient en tenir compte dans leurs différents propos.
BIBLIOGRAPHIE
BOUVIER David, 2001, « Ulysse et le personnage du lecteur dans La République : Réflexions sur l’importance du mythe d’Er pour la théorie de la mimêsis » in La Philosophie de Platon, tome 1, Paris, L’Harmattan, p. 19-53.
DESCLOS, Marie Laurence, 2000, Structure des dialogues de Platon, Paris, Ellipses.
DIXSAUT Monique, 2000, Platon et la question de la pensée : Études platoniciennes, Vol. I, Paris, Librairie Philosophique Jean Vrin.
DORION Louis-André, 2011, 2de Éd., Socrate, Paris, PUF, Que sais-je ?, n°899.
GADAMER Hans-Georg, 1996, La philosophie herméneutique, trad. Jean Grondin, Paris, PUF.
GOLDSCHMIDT Victor, 1947, Les Dialogues de Platon, Paris, PUF.
GOTTLIEB Anthony, 2000, Socrate, Paris, Seuil.
GRONDIN Jean, 2006, L’herméneutique, Paris, PUF.
HADOT Pierre, 2013, Éloge de Socrate, Paris, Allia.
KOFFI-NIAMKEY Robert, 1996, Les images éclatées de la dialectique, Abidjan, Presses Universitaires de Côte d’Ivoire.
LAFRANCE Yvon, 2001, « Lecture historique ou lecture analytique de Platon » in La Philosophie de Platon, tome 1, Paris, L’Harmattan, p. 375-403.
NIETZSCHE Friedrich, 1974, Crépuscule des idoles, trad. Jean-Claude Hemery, Paris, Gallimard.
PLATON, 2011, Eutyphron, Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, éd. revue, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Hippias majeur, Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, éd. revue, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Lachès, Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, éd. revue, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Le Banquet, Œuvres complètes, Luc Brisson, éd. revue, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Phèdre, Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, éd. revue, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Sophiste, Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, éd. revue, Paris, Flammarion.
PLATON, 2011, Théétète, Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, éd. revue, Paris, Flammarion.
SZLEZAK Thomas, 1996, Le plaisir de lire Platon, trad. Marie Dominique Richard, Paris, Cerf.
ROMILLY Jacqueline De, 2012, Les Grands sophistes de l’Athènes de Périclès, 2nde éd, Paris, Fallois.
ROSSETTI Livio, 2001, Le Dialogue socratique, Paris, Les Belles Lettres.
SCHLEIERMACHER Friedrich Daniel Ernst, 1987, Herméneutique, Paris, Cerf.
WILLIAMS Bernard, 2000, Platon, trad. Ghislain Chaufour, Paris, Seuil.
L’ÉNONCIATION ET LA RESTITUTION DU PROGRESSIF EN FRANÇAIS
Ehouman René KOFFI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
reneehouman@gmail.com
RÉSUMÉ :
Le progressif, s’il est facilement perceptible dans d’autres langues par la présence de marque morphologique, en français, en dehors de la périphrase verbale « être en train de » et de certains adverbes, est difficile à appréhender. Le verbe au présent comme à l’imparfait n’est pas marqué. Il n’y a donc pas de désinence verbale héritée du gérondif qui se présente comme un élément identificatoire de cet aspect. L’énonciation, à travers l’ordre interprétatif, reste alors le seul repère pour appréhender le progressif en français. Cela va de soi parce que pour parler de l’énonciation, disons que ces traces sont, par exemple, les pronoms personnels, les temps grammaticaux, les adverbes. C’est en tenant compte du contexte de production de l’énoncé qu’on arrive à savoir qu’il s’agit d’un progressif en situation.
Mots-clés : Énonciation-progressif-aspect-temps.
ABSTRACT :
The continuous or progressive form, if it can be easily identified in other languages by the presence of morphological sign, in French, a part verbal periphrasis “être en train de” and some adverbs, is difficult to catch. The verb at present as at imperfect is not with a mark. There is not verbal ending inherited from gerundive that appears as a mark of identification of aspect. The enunciation, through the interpretative order, remain so the sole landmark to make sense of the progressive in French. This fact can be understood, because to talk about enunciation, let’s say that it has as traces, for example, personal pronouns, grammatical tenses, adverbs. It is when taking notice of context of production of statement that we can know that it is a progressive in a singular situation.
Key words : Enonciation, continuous, aspect, tense.
INTRODUCTION
Le progressif est une catégorie grammaticale qui, dans les langues comme l’anglais, est facilement repérable. Mais, en français, la difficulté se trouve dans le fait qu’on n’a pas, en réalité, des moyens efficients pour appréhender cette notion. C’est l’ordre interprétatif du discours qui laisse supposer qu’il s’agit du duratif, de l’inchoatif, de l’itératif ou du progressif, pour ne citer que ces seuls aspects. Or dans un texte, les aspects se manifestent et cohabitent quotidiennement pour donner plus de difficultés à la compréhension du texte. La vérité est que « la dimension aspectuelle du verbe est souvent très réduite au bénéfice de sa dimension temporelle, à laquelle elle est étroitement associée en français. »(M. RIEGEL et Al, 2008 : 245). Et comme le font remarquer Delphine DENIS et Anne SANCIER-CHATEAU (1994 :61), « la notion d’aspect, impliquée dans l’examen des catégories du verbe, a longtemps été ignorée des grammaires, faute de recevoir systématiquement en français des marques spécifiques. »
Pour ce qui concerne cette analyse, l’objectif est de chercher à savoir comment se perçoit l’aspect progressif en français. De ce fait, il importe d’indiquer des repères pouvant permettre de comprendre le progressif en français qui met à contribution l’environnement immédiat du texte avec un ensemble d’appareillages linguistiques et grammaticaux se présentant comme des criteria utiles. Dans cette dynamique, l’étude pourrait s’appuyer sur des textes littéraires où des exemples seront proposés mais, pour des questions d’ordre pratique, d’autres exemples pourraient être proposés par nous-même. Dans cette étude où la pragmatique prend toute sa notoriété dans l’énonciation, il sied alors de l’organiser en ces trois points :
– Mise au point théorique sur la notion de progressif ;
– Le progressif et ses réalisations : étude de quelques exemples dans des œuvres littéraires ;
– La question de sémantique et la problématique du progressif en français.
1. MISE AU POINT THÉORIQUE SUR LA NOTION DE PROGRESSIF
Le temps, le mode et l’aspect sont des notions qui se fondent l’un dans l’autre dans le français. Ces trois catégories sont essentielles dans l’appréhension de l’aspect progressif. C’est la raison pour laquelle Jean Dubois peut dire que « Le progressif, lui, non plus n’est uniquement aspectuel, il peut avoir des implications modales. » (J. DUBOIS et alii, 1994 : 242)
1.1. Le mode, l’aspect, le procès et le temps dans l’appréhension du progressif
Dans l’apport d’un éclairage sur le progressif, jetons d’abord un coup d’œil sur le progressif auquel il est inhéremment liée.
1.1.1. Le mode
Caractère d’une forme verbale susceptible d’exprimer l’attitude du sujet parlant vis-à-vis du procès-verbal, c’est-à-dire en un certain sens la manière… dont l’action est présentée par lui, suivant par exemple qu’elle fait l’objet d’un énoncé pur et simple (mode indicatif) ou qu’elle est accompagnée d’une interprétation : modes subjonctif, optatif, impératif, injonctif. Un verbe exprime alors plusieurs modes. La conjugaison exprime deux grands types de mode. Les modes personnels que sont le conditionnel, l’impératif, l’indicatif et le subjonctif et les modes impersonnels qui s’expriment à travers l’infinitif, le participe et le gérondif. Ce point de vue du linguiste Ferdinand Brunot résume suffisamment notre perception de la notion :
Il s’en faut bien que tous les modes aient autant de valeur modale les uns que les autres. Certains d’entre eux, comme le conditionnel, qui est de création française, ont des sens nets, et, s’ils ne paraissent pas partout où ils pourraient se rencontrer, du moins, ils ne sont pas amenés par des nécessités purement formelles et extérieures à la pensée, comme c’est le cas du subjonctif, qui bien souvent n’exprime plus des modalités, mais n’est qu’une forme de subordination. (F. BRUNOT, 1970 : 520)
On finit par comprendre que le mode est la forme particulière sous laquelle se présente un fait, s’accomplit une action. Pour les grammairiens, c’est la forme verbale qui indique l’attitude du sujet parlant vis-à-vis du procès exprimé par le verbe.
1.1. 2. L’aspect
L’aspect est une catégorie grammaticale exprimant la manière dont l’action exprimée par le verbe (ou le nom d’action) est envisagée dans sa durée, son déroulement ou son achèvement. André MARTINET (1996 :140) présente les modalités d’aspect comme « celles qui présentent l’objet ou l’acte dans sa durée, indépendant de cette durée, ou le résultat d’autre chose » Aspect accompli, inaccompli, perfectif, imperfectif, inchoatif. Dans les langues slaves, l’aspect correspond à des formes précises. Il y a des particules qui permettent de marquer l’aspect. Voici comment Gustave Guillaume le présente : « L’aspect est une forme qui, dans le système même du verbe, dénote une opposition transcendant toutes les autres oppositions du système et capable ainsi de s’intégrer à chacun des termes entre lesquels se marquent lesdites oppositions. » (G. GUILLAUME, 1965 : 109)
Ces oppositions sont en réalité de deux ordres. Nous avons une première opposition aspectuelle entre le perfectif et l’imperfectif. Alors que « le perfectif indique que l’action ou la qualité sont apparues à un certain point de la période de l’objet de l’énonciation, l’imperfectif les présente comme se développant dans cette période et la remplissant. » (O. DUCROT et T. TODOROV, 1972 : 391). En français, on peut observer ces deux énoncés qui donnent respectivement (1), énoncé perfectif, (2) énoncé imperfectif.
(1) « L’année dernière, j’ai été malade. »[62]
(2) « L’année dernière, j’étais malade. »
L’énoncé (1) traduit l’aspect d’une action envisagée comme aboutissant à un terme quand le (2) exprime une action envisagée dans son cours, sans considération de son début ni de son terme. Outre ces oppositions, il existe une autre opposition aspectuelle entre l’accompli et l’inaccompli. « On a un aspect inaccompli lorsque la qualité ou l’action, objets de la prédication se réalisent dans la période concernée par l’énonciation. » (O. DUCROT et T. TODOROV, 1972 : 391)
(3) « Hier matin il a dormi. »
Quant à son opposé, c’est- à-dire l’accompli, on dit que « l’aspect est accompli si l’action ou la qualité sont antérieures à la période dont on parle, mais qu’on veut signaler leur trace, leur résultat, dans cette période. » (O. DUCROT et T. TODOROV, 1972 : 391)
(4) « Hier matin il était reposé car il avait dormi. »
Le résultat « il était reposé » est la conséquence de l’action de dormir que l’individu a accomplie. Le résultat de l’action est « visible. »
1.1.3. Le procès
Le procès est le contenu sémantique du prédicat ; ce que le verbe peut affirmer du sujet sont les notions suivantes : existence, devenir et action. « On dit aussi que le verbe exprime un procès, quelque chose se déroule dans le temps. » (M. GREVISSE, 2008 : 1118). Ainsi, c’est la fonction prédicative qui est soulignée. Le prédicat lui-même s’appréhende comme le second terme d’une énonciation où il est possible de distinguer ce dont on parle et ce qu’on en affirme ou nie. Selon la distinction praguoise, il renvoie au rhème, opposé au thème, et se définit comme ce qui, dans un énoncé, est affirmé à propos d’un autre terme. Pour Benveniste, « on sait qu’un seul signe suffit à constituer un prédicat. De même la présence d’un « sujet » auprès d’un prédicat n’est pas indispensable : le terme prédicatif de la proposition se suffit à lui-même puisqu’il est en réalité le déterminant du « sujet ». (BENVENISTE, 1966 : 128) Jean Dubois et René Lagane partent par la définition du verbe pour remonter au procès. Voici comment ils procèdent pour nous présenter le procès : « Le verbe est le constituant essentiel du groupe de verbe ; sa fonction dans la phrase est celle de prédicat. Le verbe indique un procès (action) ou un état. » (J. DUBOIS et R. LAGANE, 2000 : 112) Le procès est donc l’action subie ou faite par le sujet.
(5) « Sept mois que cette fille porte sa grossesse. »
(6) « Depuis dix ans on me bouscule comme un homme sans valeur. »
Dans les énoncés (5) et (6), le verbe « porter » est statif et le verbe « bousculer » est non-statif. Le premier indique un état quand le second exprime une « action » réalisée par le sujet « on ».
1.1.4. Le temps
Le temps est une grandeur immatérielle. Pour définir sa mesure, il est nécessaire de la rapporter à un phénomène matériel. L’échelle matérielle de temps doit se rapporter à un phénomène permanent et stable. (J. LEVY, 1961 :12) Remarquons que le temps se manifeste sous deux aspects : la durée, déroulement continu d’événements successifs et la fréquence, caractérisant les rythmes par l’intervalle de temps (la période) qui sépare deux états identiques successifs du phénomène rythmique. Dans le temps, on parle de temps chronologique et de temps verbal. Temps verbal ou grammatical est ce qui est la conjonction des verbes. Aristote, qui a travaillé sur la catégorie du temps, a constaté que « certaines variations systématiques des formes du verbe pouvaient être mises en corrélation avec ces notions temporelles comme « présent » et « passé ». (LYONS, 1970 : 12)
(7) « Hubert mange des bananes. »
(8) « Hubert mangeait des bananes. »
(9) « Hubert avait mangé des bananes. »
Ici, ces formes verbales différentes appartiennent au même verbe, au même mode et sont à la même personne. La seule différence qui existe entre ces verbes réside au niveau des temps. Lesquels sont respectivement le présent, l’imparfait, et le plus-que parfait. Jean Dubois et René Lagane (2000 : 125) diront alors que « les temps du verbe expriment des rapports de temps de réel, auxquels peuvent s’ajouter, on l’a vu, des valeurs d’aspect. Mais l’action ou l’état indiqués par le verbe peuvent être situés dans le temps par rapport à des points de repère différents. »
1.2. La délimitation de la notion de progressif
La connaissance du fonctionnement progressif passe nécessairement par un éclairage sur la notion. Pour ce faire, le progressif en français doit être rapproché de celui d’autres qui le réalisent par une marque linguistique.
1.2.1. La définition du progressif
Le progressif est un aspect qui « indique qu’une action ou un état est en cours » (J. DUBOIS et R. LAGANE, 2000 : 123) de réalisation. Ainsi, tout laisse croire que si nous avons commencé une action au moment où quelqu’un parle ou rapporte les faits, celle-ci est dans un état de continuité. Elle a commencé, certes à une date (Φ1), mais à la date (Φ2) où l’on tient le discours ou énonce le fait, l’action se poursuit. C’est à une date (Φ3), qui reste totalement ouverte, qu’elle va se réaliser.
Φ1 Φ2 Φ3
Début de l’action action en continuité fin de l’action
En somme, on retient du progressif qu’il exprime une progression, une évolution graduelle et constante dans le temps. A juste titre, John Lyons (1970 : 241) précisera que « La fonction la plus courante de la forme progressive est de marquer la durée.»
1.2.2. Le progressif dans les langues avec une réalisation morphologique
Le progressif est perceptible à travers des marques qui s’expriment à travers les temps de la conjugaison. Les langues comme l’anglais ont leur aspect progressif marqué morphologiquement. La forme progressive ou continue se distincte par un ensemble de critères qui, dès le premier coup d’œil ou la prise de parole, permettent de l’identifier ou de la remarquer.
(10) « I was eating my delicious food. »
(11) « Kramo is speaking with his elder brother. »
Il en est de même pour la langue espagnole où les espagnols l’expriment avec une structure syntaxique composée du verbe « estar » et de la forme gérondivale (ANDO [pour les verbes de la première conjugaison] et IENDO [pour les verbes de la deuxième et troisième conjugaison]. (MATEO, 1993 : 94) Ainsi, les énoncés (10) et (11) donneraient dans cette langue, les énoncés (12) et (13) suivants :
(12) « estuviera comiendo mi deliciosa comida. »
(13) « Kramo est a hablando con su hermano major. »
Dans les langues africaines, c’est soit un morphème soit l’accent tonologique qui permet de reconnaître et d’identifier le progressif. En Baoulé et en malinké par exemple, on aurait :
(14) «Gnin n’ su di mi aliε fεfε. » (Baoulé)
(15) « Kramo ni I gn’ru gbingbin be su kokoyalε. »(Baoulé)
(16) « n’ku be o wati n’ya domli ….domlila. » (Malinké)
(17) « Kramo ni a ya krotchε o ku be kumanan. » (Malinké)
En baoulé et en Malinké, il s’agit respectivement du morphème « sou » et « la ». Dans l’énoncé(15), la structure phrastique en réalité est la suivante :
(15) « Kramo ni a ya krotchε o ku be kumanla. » (Malinké)
C’est la loi de la propagation qui fait qu’on finit par retrouver le son « an » à la fin de cet énoncé. Le son « an » dans « kuman » contamine le « la » qui se mue en « an ».
1.2.3. L’absence de signes morphologiques et la complexité du progressif
Dans la conjugaison en français, il n’existe pas une désinence verbale qui soit caractéristique du progressif. Il n’y a pas, en dehors de la périphrase verbale « être en train de », de morphème identificatoire de cet aspect. Ni désinence verbale, ni morphème ne s’imposent à la consolidation du progressif dans la langue française. Toute la latitude est donnée au texte de construire le sens. Comme le disent Christian Baylon et Paul Fabre (1995 : 126),
Le contexte, l’entourage linguistique d’un mot, permet d’attribuer un sens plutôt qu’un autre. C’est évidemment le cas pour les mots à plusieurs sens (polysémie) et pour les homographes (mots ayant des signifiants et des formes graphiques identiques).
Ainsi, les verbes aux temps conjugués se comportent à la fois comme des polysémiques et des homographes. Le même élément verbal peut exprimer l’itératif, le progressif ; l’habituel, inchoatif, résultatif, etc.
2. LE PROGRESSIF ET SES RÉALISATIONS EN FRANÇAIS
Cette partie du travail, qui se veut plus ou moins pratique, convoquera des exemples tirés d’œuvres littéraires, pour comprendre comment le progressif peut se réaliser dans les textes littéraires d’expression française. Il importe de noter toutefois que d’autres exemples pourraient être proposés par nous-même quand le besoin se fera sentir.
2.1. La difficulté de l’appréhension du progressif dans la langue française
On ne peut saisir facilement le progressif en français. Deux énoncés apparemment proches, en beaucoup de points, peuvent être l’un de l’habituel, l’autre du progressif. Voyons ces deux énoncés :
(18) « Le président de la République gracie un certain nombre de condamnés, lors de son élection. »
(19) « Le président de la République gracie un certain nombre de condamnés et on l’écoute donner les critères de sélection. »
Dans l’énoncé (18), il s’agit de l’aspect habituel. Dans cette république, c’est une tradition pour le président de la république de relâcher et d’accorder la liberté à un certain nombre de prisonniers s’il parvient à la magistrature suprême. Quant à l’énoncé (19), il dénote le progressif. La proposition cordonnée « et on l’écoute donner les critères de sélection » permet de savoir qu’il y a continuité dans l’action. Elle actualise le discours en en faisant une énonciation en cours.
2.2. L’expression du progressif au moyen de la formule « en train de »
La locution prépositive « en train de » ajoutée au verbe « être » pour donner la périphrase verbale « être en train de » indique une action en état, en passe, en voie de, en cours etc. Elle marque l’aspect de durée du verbe. Cet aspect traduit, en ancien français, par le gérondif, toujours en usage en anglais (He is speaking) évoque une suite continue, une évolution dans le temps ou un enchaînement de mouvements successifs.
(20) « Fatou est en train de prendre son bain »
La locution prépositive, à elle seule, permet de signifier l’idée de la continuité. Toutefois, on peut être redondant en apportant des précisions à la structure phrastique par l’adjonction d’une locution adverbiale ou d’une proposition subordonnée.
(20)’ « Fatou est en train de prendre son bain en ce moment.»
(20)’’ « Fatou est en train de prendre son bain au moment où je vous parle. »
Dans l’énoncé (20)’ la continuité est exprimée et renforcée la locution adverbiale et dans le (20)’’, c’est la proposition subordonnée circonstancielle « au moment où je vous parle.
2.3. La valeur du progressif au mode gérondif
En français, le gérondif a la forme verbale en « ant », généralement précédée de la préposition « en » et sert à exprimer des compléments circonstanciels de simultanéité, de manière, de moyen et de cause. Mais il faut ajouter à cela que le gérondif permet également d’exprimer la valeur du progressif.
(21) « Tout en marchant, il prenait des notes. »
(22) « Djè Bi en levant le bras, magnifie le roi qui l’observe. »
Combiné avec « aller » ou « cela », le gérondif qui ne se distingue alors plus du participe présent marque l’action continue, la progression dans le temps. En voici des exemples :
(23) « Comme le nombre d’œufs, grâce à la renommée, la bouche en allait croissant. » (La Fontaine, Fables, 2012 : VIII, 6.)
(24) « Les gérondifs ont une marque, qu’ils prennent devant eux quand ils veulent, qui est en, comme en faisant cela, vous ne sauriez faillir. » (Vaugelas, 1647 : 186)
Dans les énoncés (21), (22), (23), et (24), l’action présentée dans la principale se produit à la faveur et comme au sein de l’autre.
2.4. L’expression du progressif au moyen des adverbes de temps
La notion d’aspect se manifeste par les adverbes de temps, comme le souligne GREVISSE en ces termes : « il y a des adverbes d’aspect» (M. GREVISSE, 2008 : 739), « les adverbes de temps situent les faits par rapport au moment de la parole ou à un autre repère. Les adverbes d’aspect concernent à la fois le temps et la manière. » (M. GREVISSE, 2008 : 965) De même que les adverbes de temps mettent en lumière l’aspect, si « l’aspect est la manière dont s’exprime le déroulement, la progression, l’accomplissement de l’action » (M. GREVISSE, 2008 : 739), il est évident qu’il se signale comme un indice du progressif.
(25) « Il écoute la musique en ce moment »
La locution adverbiale « en ce moment » en actualisant le discours montre que l’action est continue au moment où l’on parle. L’action d’écouter la musique est en cours au moment où l’énonciateur énonce ce fait.
2.5. L’expression du progressif à travers les temps verbaux
Essentiellement, les deux temps verbaux que sont le présent et l’imparfait expriment en français le progressif. Il n’y a pas d’autres temps en dehors d’eux qui soient à mesure de le réaliser. Mais là encore, l’expression de cet aspect, dans les temps, souffre et se noie dans des définitions de base qui ne permettent pas toujours de rendre compte du progressif qu’ils expriment.
2.5.1. Le progressif dans le présent de l’indicatif
De façon normale, le présent évoque un fait qui se produit ou qui est présenté comme se produisant en même temps que l’acte d’énonciation lui-même. Mais comme le font si bien remarquer Delphine DENIS et Anne SANCIER-CHATEAU « la dimension temporelle du présent, comme on le verra est assez floue. » (D. DENIS et A. SANCIER-CHATEAU, 1994 : 236) Ce qu’il appelle le présent actuel est ce présent qui manifeste la progression. Il ne s’agit ni de l’itératif, ni du duratif encore moins le semelfactif ou le résultatif. « C’est la valeur la plus courante du présent : le procès s’intègre au moment de l’énonciation mais le dépasse. On remarque que les verbes imperfectifs impliquent cet élargissement temporel puisqu’ils ne portent pas en eux-mêmes la mention de leur limite. » (D. DENIS et A. SANCIER-CHATEAU : 265) L’action a commencé à un moment précis, mais il est dans une continuité. C’est-à-dire qu’il suit son cours.
(26) « Tu es toute vibrante de ces mots qui continuent de vibrer en toi » (Charles Juliet, Lambeaux, 2001 :29)
(27) « En dehors de ces moments, tu traines ta mélancolie. » (Charles Juliet, Lambeaux, 2001 :91)
Des syntagmes verbaux comme « es toute vibrante de ces mots », « continuent vibrer » et « traines ta mélancolie » rendent d’événements dans un état de continuité. Mais il faut préciser que le progressif n’est pas le seul fait de la voix active. On le retrouve dans des constructions à la voix passive.
(28) « je suis battu sans raison »
2.5.2. Le progressif dans l’imparfait de l’indicatif
Nous retrouvons également le progressif dans le temps imparfait. L’action se trouve dans une continuité et les limites de la réalisation des actions ne sont pas déterminées. « L’imparfait vous fait voir successivement les divers moments de l’action qui, pareille à un panorama vivant, se déroule devant vos yeux, c’est le présent dans le passé. » (ROBERT, 2001 :330) Pour Delphine DENIS et Anne SANCIER-CHATEAU (1994 : 270) l’imparfait présente le procès dans son déroulement, en cours d’accomplissement comme toutes les formes simples ; mais à l’instar du présent, il en donne une image vue de l’intérieur, dans laquelle les limites initiale et finale ne sont pas prises en compte. Cet imparfait, d’un point de vue aspectuelle, comme « le présent dont il est le corrélat pour un repère passé, marque que le procès est « ouvert. » (MAINGUENEAU, 2003 : 72)
(29) « N’Juaba vibrait dans l’attente du neuvième mois de sa grossesse. » (Maurice BANDAMAN, Le Fils de -la -femme-mâle, 2007 : 23)
Il y a des constructions à l’imparfait qui ne rendent pas le progressif. Elles témoignent de faits accomplis et totalement achevés dans le temps dans un bref délai.
(30) « Le soleil glissait avec élégance sur sa pente et s’enfonçait derrière les arbres à l’horizon. Le village de Glahanou venait de saluer la mort de cet autre jour que Dieu a fixé sur le rouleau de la vie. » (Maurice BANDAMAN, Le Fils de -la -femme-mâle, 2207 : 15)
Le verbe « venir » à l’imparfait forme une périphrase verbale avec l’infinitif « saluer » dans la structure « venait de saluer. » Cette périphrase, à valeur de passé, évoque une action qui s’était achevée et dans laquelle on met l’accent sur la limite finale. Outre ce fait, on note que le progressif se réalise aussi avec la forme passive.
(31) « La mère de Kounia était respectée par tous les villageois. »
Dans cette séquence, il est souligné le prolongement de l’action dans le temps. L’imparfait exprime une circonstance durable qui se poursuit dans le temps.
2.6. Le contexte énonciatif et la restitution du progressif en français
2.6.1. La notion de contexte
En parlant de contexte énonciatif, nous ne voulons pas évoquer la situation ou contexte de production d’un énoncé qui pour D. Maingueneau (2003 :11) désigne « les conditions empiriques de production d’un texte. » Il s’agit bien au contraire de l’environnement du signe et les pressions de sens que certains signes du contexte exercent sur lui pour l’amener à signifier autre chose ou compléter le sens qu’il a d’habitude. (R. LAGANE et J. DUBOIS, 2000 :126) Pour lui, « un mot n’a pas de sens il n’a que des usages » (J. DUBOIS citant Wittgenstein, 1994 : 22) Avec le progressif, il est difficile de dire que tel verbe exprime cet aspect. Un ensemble de signes du contexte permettent de dire qu’il s’agit d’un tel aspect ou pas. Observons les phrases suivantes :
(32) « Je lave mes habits. »
(33) « Lucien dansaient sur la route. »
Au premier coup d’œil, il sera difficile de dire que ces verbes expriment tel aspect ou tel autre. Ainsi, la nécessité de tenir compte du cadre énonciatif pour décider de l’aspect est un impératif dans la langue française.
2.6.2. La perception du progressif à partir de l’environnement textuel
Comme le point 2-21 nous l’a permis d’observer, le progressif n’a pas de repères qu’il convient à première vue de reconnaître. L’environnement textuel a son mot à dire comme le font si bien remarquer Christian Baylon et Paul Fabre (1995 : 125) soit en ce point : « Le sens d’un mot est donc complexe : il renvoie à la situation, au contexte, à la référence, au sujet, au système de la langue. » soit en cet autre point : « Le contexte, l’entourage linguistique d’un mot, permet d’attribuer un sens plutôt qu’un autre. » (C. BAYLON et P. FABRE, 1995 : 126) Wittgenstein, allant dans le même sens, parlera pour sa part d’usage. Selon lui, ce sont les usages qui déterminent le sens d’un mot : « Un mot n’a pas de signification, il n’a que des usages. » (WITTGENSTEIN, cité, C. BAYLON et P. FABRE, 1995 : 126) Avec le progressif, il ne s’agit pas de prendre le verbe isolement, mais de considérer tout l’environnement textuel afin de saisir ce qu’il en est fait dans le discours. Les phrases que nous avons citées plus haut lorsqu’elles se retrouvent complétées dans ces formes suivantes apportent un surplus d’informations utiles à la compréhension du discours.
(34) « Je lave mes habits chaque matin. » (Habituel)
(35) « Je lave mes habits actuellement. » (Progressif)
(36) « Lucien dansaient sur la route à cette période. » (Progressif)
(37) « Lucien dansaient sur la route occasionnellement. » (Fréquentatif)
Il n’y a ici que les énoncés (35) et (36) qui expriment le progressif. La phrase (34) rend compte de l’habituel et la phrase (37) nous fait observer l’aspect fréquentatif.
3. LA QUESTION DE SÉMANTIQUE ET LA PROBLÉMATIQUE DU PROGRESSIF EN FRANÇAIS
La sémantique des énoncés et leur analyse est une préoccupation en linguistique. C’est une chose ardue de saisir le sens des énoncés quand l’aspect et le temps n’offrent des criteria de distinctions spécifiques.
3.1. Le progressif et la question de sémantique
Bien que nous ayons donné des criteria linguistiques pour déceler le progressif, il y a lieu de voir qu’avec cet élément grammatical tout l’enjeu est d’ordre sémantique. Il est question du flou qui entoure le volet temporel que celui de l’aspect.
3.1.1. Le verbe et le flou au niveau temporel
Les frontières temporelles et aspectuelles ne sont pas des choses données une fois pour toutes. Des énoncés que les appareils énonciatifs ont délimités peuvent être sujets à de nombreuses interprétations sans que celles-ci ne soient de simples allégations ou des remarques superfétatoires. Pour preuve, les énoncés[63] (5) et (6) que nous avons, ici, peuvent renvoyer à d’autres réalités linguistiques, que d’être simplement des énoncés progressifs au présent de l’indicatif seulement.
(5) « sept mois que N’juaba porte sa grossesse. » (Maurice BANDAMAN, Le fils de -la -femme-mâle, 2007 :15)
(6) « Depuis dix ans on me bouscule comme une vielle marmite. » (Sony Labou Tansi, La parenthèse de sang, 1981 : 83)
Si nous considérons le point de vue temporel, ces phrases peuvent être des événements tout à fait passés qui, dans la narration des événements, sont sujets à l’emploi stylistique du présent. « La forme verbale constitue en fait une variante stylistique de l’imparfait ou du passé simple, avec lesquels elle peut toujours commuter » (D. DENIS et A. SANCIER-CHATEAU, 1994 : 270) :
(5)’ « Sept mois que N’juaba portait sa grossesse. » (Maurice BANDAMAN, Le Fils de -la -femme-mâle, 2007 :15)
(6)’ « Depuis dix ans, on me bousculait comme une vielle marmite. » (Sony Labou Tansi, La parenthèse de sang, 1981 :83)
Cependant, le caractère continu ou progressif du récit est toujours présent dans la perception sémantique de l’énoncé. « Portait » et « bousculait » expriment tous deux des réalités qui ont fonctionné de façon progressive ; et cette continuité est signifiée par le présent de l’indicatif qui, en actualisant les faits, montre que l’énonciateur veut témoigner de leur incidence sur l’actualité.
3.1.2. Le sens du verbe et le flou au niveau de l’aspect
Il n’y a pas que le volet temporel qui souffre d’un manque de confort sémantique. Des énoncés que nous interprétons comme relevant de l’aspect progressif peuvent bien, en dépit de la présence de l’appareil énonciatif, relever d’un autre aspect. Souvent la traduction en anglais permet d’être bien situer sur l’aspect de l’énoncé.
(38) « C’est donc dans le ventre de la terre qu’Awlinba marchait, son fusil sur l’épaule, inconscient du changement d’univers. » (Maurice BANDAMAN, Le fils de -la -femme-mâle, 2007 :17)
L’erreur consisterait malheureusement à voir dans cette phrase un énoncé à l’aspect continuatif. Ce n’est pas le cas. D’ailleurs, le présent de l’indicatif avec le présentatif est aussi un jeu stylistique. La bonne traduction, en anglais, serait donc:
(38)’ « So it was from the bosom of the earth that Awlinba walked, his gun on his shoulder, unaware of the changing of the universe. »
Toutefois, il faut préciser que le présentatif joue un rôle dans le caractère fini du procès qui donne la vision restreinte de l’action.
3.1.3. Le progressif et la préoccupation sémantique
Le flou dans le décryptage de la notion soulève un problème à la fois sémantique qu’énonciatif qui entoure le progressif en français. Même si les éléments énonciatifs se présentent comme un ensemble de critères efficients pour appréhender cet aspect, il n’en demeure pas moins qu’il soit difficile, voire un leurre, de pouvoir affirmer être à mesure, au premier coup d’œil, de le saisir. L’appareil énonciatif aide à coup sûr, quelques fois, à délimiter et à juger du caractère progressif d’un énoncé. Mais ce n’est pas toujours qu’il le permet. Le progressif ne saute pas aux yeux. Souventes fois, pour l’appréhender, cela demande un véritable exercice cognitif et linguistique pour amener à une excellente appréciation. Dans cet exercice de haut niveau intellectuel et grammatical, se trouve la sémantique qui semble être une démarche assez ardue pour tout locuteur. Cela s’entend puisque, généralement, on laisse une place de seconde zone à la sémantique. Cela n’est même pas le fait des simples usagers. La sémantique est négligée par la linguistique moderne au point que John LYONS soulignera que « la plupart des ouvrages dans ces trente dernières années dans le domaine de la linguistique ont consacré très peu de place à la sémantique ou même l’ont passé sous silence. »(J. LYONS, 1970 : 14) De nombreuses années après, cette réalité linguistique n’a pas changé, parce que prétextant de leur manteau de structuraliste, les linguistiques restent porter sur la question de syntaxe. Le progressif qui est plus un problème sémantique que morphologique souffre de ce penchant de marginalisation.
3.2. Les réflexions des linguistes sur le progressif
Il y a un souci général lié à l’aspect qui est le même que rencontre le cas particulier du progressif.
3.2.1. Un souci général à la catégorie aspectuelle
L’aspect, en général, et le progressif, en particulier, relèvent de la partie prédicative d’un énoncé. Les indications prédicatives « sont toujours intérieures au prédicat. Le prédicat comporte en effet, non seulement l’idée d’une certaine qualité ou d’une certaine action, mais l’idée d’un certain mode de manifestation dans le temps de cette action ou de cette qualité, l’indication de la façon dont elles remplissent la période concernée par l’énonciation.» (O. DUCROT et T. TODOROV, 1972 : 390-391) Or l’organisation sémantique d’un énoncé est malheureusement sujet à plusieurs difficultés. Les phrases comportent au moins quatre indications temporelles qu’il faut analyser conjointement. L’aspect se noie dans des imprécisions, faute de marque réelle au niveau du prédicat qui est supposé le porter. Mais si le verbe porte l’aspect, il n’en demeure pas moins qu’il faut tenir compte d’autres aspects de l’énoncé. Toutes ces préoccupations expriment la difficulté d’appréhension du progressif en français. L’absence de matérialisation réelle est la cause de l’emmêlement qui l’entoure.
3.2.2. Le fonctionnement syntaxique au détriment du sens
Le progressif est une catégorie grammaticale, pour s’en rendre compte, peu étudiée. Son péché, peut-être, s’est d’être une affaire exclusivement sémantique, en d’autres termes dérivant potentiellement du sens. On néglige dans un énoncé la question de sens au détriment de la syntaxe. Or le progressif n’est pas une affaire de syntaxe. Au regard de ce qui a été déjà vu et dit plus haut, c’est sans doute la raison pour laquelle on lui consacre peu de travaux. Maurice GREVISSE apporte cette précision sur la méconnaissance de l’aspect. Il pourra, à cet effet, faire remarquer que « la notion d’aspect n’a pris qu’assez récemment une grande place dans les études sur le français. » (M. GREVISSE, 2008 : 740) Ainsi, on peut se rendre compte que le progressif puisqu’il a été négligé en français, c’est dans les langues à marque qu’il a été beaucoup étudié. Pour l’appréhender, on posait la structure de base de sa réalisation. On disait alors que le progressif en anglais avait cette structure = to be + Ing form. Cette erreur souvent faite, de l’étudier en comparaison avec la langue anglaise, a consisté à donner des repères structuraux à cet aspect. Dans notre travail, nous avons certes évoqué quelques criteria, mais nous pensons que l’aspect sémantique reste la proportion la plus large qui explique véritablement cette notion. Et quiconque parle de sémantique doit savoir que le sens est véritablement sens si on doit tenir compte du contexte énonciatif. Christian Baylon et Paul Fabre souligne que « c’est grâce à la syntaxe et à l’environnement des mots que le sens global d’une phrase est produit ou compris. » (C. BAYLON et P. FABRE, 1938 : 139)
CONCLUSION
L’étude sur l’aspect a permis d’aller au cœur de la réflexion linguistique pour s’interroger sur une notion peu étudiée. Dans cette étude, on note que le progressif, en français, peut réaliser dans la tour périphrastique « être en train de » qui marque l’idée de la continuité. On peut également déceler cet aspect dans le mode gérondif, dans des adverbes aspectuels et dans les temps verbaux comme le présent et l’imparfait de l’indicatif. En dehors des appareils énonciatifs évoqués, tout le contexte énonciatif est d’intérêt dans le décodage du discours pour en déterminer le caractère progressif de l’énoncé. Le verbe, à lui seul, ne suffit pas à apporter un éclairage sur cette notion déjà complexe. Et même là encore, la difficulté est toujours d’actualité car l’environnement linguistique d’un énoncé peut être sujet à plusieurs interprétations. Il faut un véritable jeu linguistique et cognitif qui se fait dans les arcanes du prédicat qui est le second terme d’une énonciation où il est possible de distinguer ce dont on parle et ce qu’on en affirme ou nie. Ce qui, dans un énoncé, est affirmé à propos d’un autre terme (sujet ou thème) peut être considéré sous l’angle de son déroulement, entre les deux bornes extrêmes, début et fin sans qu’on ne sache si celles-ci sont réellement prises en compte ou pas. La forme prédicative lorsqu’elle est réduite devient sujette à une ouverture plus large dans l’interprétation. Tout ceci pour dire que le grand problème du progressif réside dans la difficulté de l’interprétation sémantique. Et quand on sait que la sémantique est généralement laissée au second plan, là se trouve toute la difficulté qu’on a à cerner cette catégorie grammaticale.
BIBLIOGRAPHIE
BANDAMAN M., 2007, Le Fils de -la -femme-mâle, Paris, L’Harmattan.
BAYLON C. et FABRE P., 1938, Initiation à la linguistique, Paris, Nathan.
BENVENISTE É., 1966, Problèmes de linguistique générale, tome I, Paris.
BRUNOT F., 1997, La Pensée et la langue, Paris, Editions Masson, 10 tomes.
DENIS D. et SANCIER-CHATEAU A., 1994, Grammaire du français, Paris, Librairie Générale Française.
DUBOIS J. et Al, 1994, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse.
DUBOIS J. et LAGANE R., 2000, La Nouvelle Grammaire du français, Paris, Larousse.
DUCROT O. et TODOROV T., 1972, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Editions du Seuil, collection « Points ».
GREVISSE M., 2008, Le Bon Usage, 13è édition, Paris-Bruxelles, Boeck /Duculot.
GUILLAUME G., 1965, Temps et Verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps, Suivi de L’architectonique du temps dans les langues classiques, Paris, Editions Champion.
JULIET C., 2001, Lambeaux, Paris, Gallimard.
LA FONTAINE J. de, 2012, Fables (livres I et II), Paris, Candide et Cyrano / Grands Classiques.
LABOU S. T, 1981, La Parenthèse de sang, Paris, Hatier.
LEVY J., 1961, « la Troisième Grandeur fondamentale », in Sciences, janv.-févr.
LYONS J., 1970, Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique, Paris, Larousse.
MAINGUENEAU D., 2003, Linguistique pour le texte littéraire, Paris, Nathan.
MARTINET A., 1996, Eléments de linguistique générale, Parsi, Armand Colin.
MATEO R., 1993, Clarisimo, 10è édition, collection Nouvelles Approches, Aix-en-Provence, Martorama.
RIEGEL M., Pellat J.C. et Rioul R., 2006, Grammaire méthodique du français, Paris, Quadrige/ PUF.
ROBERT C.-M., 2002, Grammaire française, Paris, éditions Nathan.
Vaugelas C. F,1647, Remarques sur la langue française, Paris, Librairie de J. BAUDRY.
L’APPEL DE L’ALTÉRITÉ DANS LA CONSTRUCTION DU VIVRE-ENSEMBLE EN AFRIQUE
Akanis Maxime AKANOKABIA
Université Marien NGOUABI de Brazzaville
akanismaxime@gmail.com
RÉSUMÉ :
Ce travail se veut une contribution à la philosophie du vivre ensemble. Il s’agit de penser à nouveau frais, comment à partir de la présence de l’autre, considéré comme un appel, que se donne à voir la construction du vivre ensemble, en insistant sur le fait qu’il ne suffit pas de vivre ensemble, mais il faut surtout bien vivre ensemble selon le bien. Autrement dit, comment construire un espace du vivre ensemble dans une Afrique en proie aux conflits armés, au tribalisme, au régionalisme, à l’ethnicisme ? … La construction d’un espace du bien vivre ensemble dans une Afrique en conflit suppose que l’on réponde à l’appel de l’autre, de celui qui m’est semblable, mais différent de moi, c’est-à-dire qu’il s’agirait de sortir de soi pour aller vers l’autre et se donner à l’autre, tout en se créant soi-même comme un autre et en dialoguant avec l’autre. Le dialogue et la rencontre avec l’altérité ne sont possibles que par le biais de la tolérance, du pardon, … qui ne sont en réalité que l’expression d’une politique qui doit s’enraciner dans la visée éthique de la vie bonne avec et pour les autres dans les institutions justes.
Mots clés : Altérité, vivre ensemble, ethnicisme, Afrique, tribalisme, pardon, tolérance.
ABSTRACT :
This workis a contribution to the philosophy of living together. This is to think of new charges, how from the presence of the other, considered an appealthatgivesherself to see the construction of living together, emphasizingthatitis not enough to live together, but above all live together as well. In otherwords, how to build a space of living together in an Africa beset by armedconflict, tribalism, regionalism, to ethnichatred? … The construction of a space of living together in a conflict in Africaguessweanswer the call of the other, of one whoislike me, but differentfrom me, thatissaythatthiswouldbe out of ourselves to go to the other and give to another, whilecreatingoneself as another and dialoguingwitheachother. Dialogue and encounterwithothernessis possible onlythroughtolerance, forgiveness … which are in reality the expression of a policywhich must berooted in the ethicalaim of the good life with and for others in just institutions.
Key words : Otherness, live together, ethnism, Africa, tribalism, forgiveness, tolerance.
INTRODUCTION
L’homme n’est pas un être solitaire, au contraire, celui-ci vit dans une société au sein de laquelle il entretient sans cesse des relations multiformes avec les autres. Cette dynamique relationnelle entre les sujets est parfois dominée par des moments de conflits et de ruptures, surtout dans nos sociétés africaines en proie au tribalisme à cause du mauvais jeu politique, c’est -à-dire de la mauvaise gestion de l’exercice démocratique. Ces différents moments de conflits mettent souvent en crise les relations inter ethnies, inter tribus, inter religions … Cependant, l’on se demande, comment à partir de la présence de l’autre, pouvons-nous participer à la construction du vivre ensemble. La présence de l’autre comme appel, peut-elle rendre possible la philosophie du vivre ensemble ? Comment, après plusieurs années de guerres civiles, de conflits ethniques, pouvons-nous encore rendre possible le vivre ensemble dans une société africaine où l’ethnie semble prendre le dessus sur l’universel ? L’objet de notre réflexion est de chercher à comprendre comment participer à la politique du vivre ensemble dans une Afrique victime de son propre tribalisme ? Comment participer à la célébration de l’universel dans une Afrique en proie sans cesse aux guerres tribales ? Dans quelle mesure, la tolérance et le pardon constituent-ils des leviers au cœur de la fabrication même du vivre ensemble ? Autrement dit, quelle est la place de la tolérance dans cette dynamique du vivre ensemble ? Que peut-nous apporter la notion de pardon après plusieurs années de guerres civiles ?
1. LE VIVRE ENSEMBLE EN QUESTION
Vivre ensemble est devenu un impératif catégorique, que plus personne ne conteste sans prendre le risque d’être insulté au stigmatisé. Remettre en cause le vivre ensemble, c’est célébrer l’exercice du vécu solitaire, et prétendre mener une existence solitaire relèverait d’une véritable absurdité parce que nous sommes, de plus en plus, ouverts aux autres. Il n’y a pas de toi sans moi et pas de moi sans toi. Cette idée d’égale nécessité du Moi et de l’autre dans la vie sociale est bien systématisée chez Fichte qui l’exprime en ces termes : « Pas de toi, pas de Moi, pas de Moi, pas de Toi. » (Fichte, 1964, p. 83.) L’exploit de Fichte, c’est son opposition radicale au solipsisme, et il y a, dit-il, un appel réciproque entre moi et l’autre, entre ma conscience et la conscience de l’autre. C’est avec le même élan que s’inscrit la dynamique du vivre ensemble en Afrique. Autrement dit, les sociétés africaines sont de plus en plus des sociétés qui glorifient et célèbrent les vertus de l’autre. Le discours politique africain actuel tend vers cette direction puisqu’il incite à la cohabitation, à l’amour des uns et des autres en insistant sur l’idée que l’amour de l’autre et par l’autre est la clé de l’épanouissement d’une société plus cohérente, plus juste, et plus responsable. L’appel de l’autre constitue à cet effet une expérience, un moment d’enrichissement qui permet au Moi de sortir de la bêtise de la solitude naturelle.
Nous sommes des êtres sociaux, et c’est, en cela que nous sommes pourvus du langage. La vraie question en réalité évoquée ici est celle de savoir pourquoi et comment vivre ensemble ? L’autre est là, sur le pas de la porte, dehors, au travail, et devient par conséquent incontournable, on ne peut pas l’éviter parce qu’il est tout simplement là.
Cette question du vivre ensemble n’est rien d’autre que celle de notre rapport aux autres, à l’altérité, c’est-à-dire à notre ouverture au monde. Dans nos sociétés africaines par exemple, le vivre ensemble devient une préoccupation majeure, à tel point que les philosophes, les politiques, les sociologues… ne cessent de s’interroger sur ce qu’il suppose et sur ce qu’il veut dire. Vivre ensemble, est-ce se dissoudre totalement dans un « nous » anonyme et muet ? Comment constituer un nous dissemblant pour vivre ensemble nos singularités unies dans le même « nous » ?
Si l’émergence est devenue la nouvelle aspiration obsessionnelle des pays africains, elle doit devenir le prétexte pour que les pays africains sortent, par la pensée critique du long sommeil dans lequel le monde capitaliste occidental et les élites africaines les a depuis longtemps fichés d’une part, et d’autre part, du tribalisme, du régionalisme, de l’ethnicisme auquel l’Afrique est confrontée, et qui l’empêchent d’accéder à l’universel, considéré, comme l’expression même du vivre ensemble. Le vivre ensemble n’est pas un état de fait, mais une pragmatique, une éthique, une vision du monde, une construction en commun d’une leçon de la vie pour être et vivre ensemble « la vie ». Cette construction de soi pour l’autre sans oublier soi-même, cette mise en commun de soi avec l’autre en vue de vivre ensemble la vie, exige endurance et lucidité car il s’agit de donner de soi-même aux autres et recevoir en retour la part de leur vie pour être plein de vie et être au monde. Par conséquent il faut rendre visible et intelligible la rectitude entre soi-même et l’autre, entre soi-même comme un autre. Il faut montrer la merveilleuse jonction disjonctive entre subjectivité et altérité afin de dégager une vraie hétérogénéité culturelle qui constitue le socle sur lequel reposent nos sociétés africaines. Car nos sociétés ne se sont pas encore données les moyens intellectuels suffisants pour penser et concevoir ce vivre ensemble, c’est-à-dire notre manière d’être au monde, autrement dit, notre façon de nous ouvrir à l’extériorité, c’est-à-dire à l’autre. C’est notre façon à nous de fabriquer notre modernité en chemin vers l’émergence. C’est ici que se donne à voir des notions comme l’hospitalité, la tolérance… qui sont en réalité des concepts au cœur de la fabrication du vivre ensemble en Afrique.
L’hospitalité par exemple, implique la relation interpersonnelle, un lien social. Elle est rencontre, contact, ouverture à l’autre, elle consiste à faire la place, l’espace à autrui, à offrir un chez soi à un individu ou à un groupe qui en est temporairement privé. Elle est un processus d’agrégation et de séparation de l’hôte à la famille, à la communauté. L’homme ne devient homme que par l’expérience de la confrontation aux autres, la présence de l’autre différent de moi élargit notre champ de conscience au-delà des rapports familiaux immédiatement chaleureux et nous oblige à un arrachement douloureux qui est néanmoins nécessaire à la structuration de notre expérience du monde et des autres. Il convient ici, d’accorder une place essentielle à l’amitié, c’est-à-dire à la « philia ». Le problème n’est donc pas celui de la sortie de la conscience vers une autre conscience, mais plutôt de déterminer la nature de la proximité d’autrui avec ce que je vis. Cette proximité demeure l’élément essentiel dans la construction du vivre ensemble, parce qu’elle renvoie à notre responsabilité d’être humain envers des humains, et crée cet entre nous, qui nous fait hommes. Répondre à l’appel de l’autre, dit Levinas, c’est entrer en dialogue avec lui dans sa proximité.
Si le vivre ensemble dans la différence s’impose avec la nécessité de la vie en société, il n’est pas de l’ordre de ce qui est prédéterminé. Il est une quête qui relève de l’ordre d’une construction modeste et exigeante des conditions d’un vivre ensemble. Il doit être porté par une politique qui le régule, lui offre un cadre structuré adapté à chaque société et lui permet de s’épanouir, politique qui doit s’enraciner dans la visée éthique de la « vie bonne » avec et pour les autres dans les institutions justes. Par conséquent, le véritable vivre ensemble n’est possible que s’il se fonde sur l’appel de l’altérité, sur un rapport interhumain par reconnaissance de l’altérité qui a lieu comme une crise de la liberté. Le refus, l’exclusion, le tribalisme, la haine de l’étranger ne peuvent devenir la norme d’une société. On ne fonde pas une société digne de ce nom, appelée à l’émergence sur l’exclusion et la haine, mais sur la bienveillance universelle, qui n’est pas instinct dans l’être, mais appel de l’autre sur lequel il faut bien veiller. La bienveillance, entendue de la sorte, prend naissance avec l’homme, qui est, selon Emmanuel Levinas, un dés-inter-essement, c’est-à-dire une non-indifférence, une forme de passivité vigilante à l’appel de l’appel de l’autre qui précède notre intérêt dans l’être, une mise à nu extrême et une sensibilité pour une autre.
Si à partir de l’hospitalité nos sociétés africaines sont appelées à participer à la construction du vivre ensemble, c’est grâce au fait que le sujet sorte de soi pour aller vers l’autre, puisse se montrer et s’ouvrir à l’autre. Mais que devient l’hospitalité dans une société en proie sans cesse aux conflits armés ? Autrement dit, comment parler du vivre ensemble à partir de la notion d’hospitalité dans nos sociétés de plus en plus ethnicisées ? L’exemple que cite Jean-Luc Aka-Evy (2016) dans sa leçon inaugurale reste convaincant :
« Pour cette leçon inaugurale dépliant le thème du « vivre ensemble » je me suis appuyé sur un certain nombre des faits historiques de notre ville, Brazzaville. Les faits illustrant à mon avis les traits fondamentaux de ce qu’on pourrait appeler l’esprit de poto-poto comme exemple parfait du vivre ensemble ; cet esprit peut constituer l’élément paradigmatique et générique de notre schéma du « vivre ensemble », parce que le vivre ensemble met en exergue les frontières entre confiance et défiance, entre tolérance et intolérance , entre accord et désaccord , entre vérité et diversité , entre Je, Tu, et Nous , entre temps de soi et temps de l’autre , entre subjectivité et altérité… le vivre ensemble n’est rien d’autre que la mise en signe politique de la façon dont une société gère ses propres contradictions, entre homogénéité et hétérogénéité, pour être et vivre ensemble à l’abri de l’hubris, de la démesure et le triomphe des égoïsmes. »
L’exemple que cite le philosophe Jean-Luc Aka-Evy est parlant, parce que le Congo sort de deux guerres civiles, à savoir celle de 1993 et celle de 1997 où la ville de Brazzaville a été sérieusement détruite et divisée en deux. Il y’avait d’un côté les ressortissants de la partie nord du pays, et de l’autre les ressortissants de la partie sud du pays. Mais actuellement, de tous les arrondissements de la ville de Brazzaville, l’arrondissement 3 poto-poto est l’exemple même du vivre ensemble ; d’où l’esprit de « poto-poto », c’est-à-dire le quartier de la diversité, de tout le monde. Que vous soyez étranger ou pas, personne ne le saura. A poto-poto, tout le monde est pareil : pas d’ethnie, pas de tribu, pas d’esprit régionaliste. Il s’agit ici d’un arrondissement qui devient le référentiel dans la construction du vivre ensemble, car,
« le vivre ensemble clôt les obscurantismes et défie les mégalomanies. Il consacre proprement l’harmonie différée entre les êtres et les chers. Il structure la société, la civilisation humaine comme la chose la plus difficile et la plus merveilleuse que l’homme doit inventer et parfaire toute sa vie puisqu’il n’y a pas de modèle parfait pour vivre ensemble. » (Aka-Evy, 2016)
Comment arriver à vivre ensemble après plusieurs années de guerres civiles ? Autrement dit comment participer à la dynamique du vivre ensemble dans nos sociétés en proie au tribalisme ? Comment certaines sociétés à l’image du Cap-Vert, de l’Afrique du sud, et du Rwanda ont-elles fait pour rendre possible le vivre ensemble comme vertu cardinale ?
2. DE LA TOLÉRANCE COMME VALEUR PARTAGÉE
Il serait absurde d’aborder la question du vivre ensemble sans pour autant évoquer la question de la tolérance. Autrement dit, comment participer à la construction du vivre ensemble sans parler de tolérance ? Pourquoi la tolérance dans la construction du vivre ensemble ? Que signifie tolérance et quel sens revêt-elle ?
La tolérance[64] vient du verbe tolérer, qui signifie l’acceptation de la différence, l’acceptation du désaccord,
« Dans une société civile, chaque individu est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu ; s’il croit, il est libre d’adhérer aux opinions et aux dogmes qui lui paraissent les mieux fondés ou les plus agréables à son Dieu, ainsi que de pratiquer la forme de culte extérieur qu’il préfère. »[65]
Comme nous pouvons le constater, l’idée de liberté de croyance, d’adhésion d’opinion posent déjà les fondements du concept de tolérance. Autrement dit la tolérance renvoie au respect mutuel, à la reconnaissance mutuelle. Il s’agit de supporter contre son gré ce que l’on désapprouve, parce que n’ayant aucun pouvoir de l’empêcher. Ce qui signifie en d’autres termes, que même si nous ne partageons pas les mêmes convictions, la même religion, la même ethnie que l’autre, nous sommes obligés de le respecter. Ce n’est pas parce qu’il est d’une ethnie différente que la nôtre, que nous ne l’acceptons pas. La tolérance est bel et bien l’acceptation de la différence. Il s’agit comme le disait Charles Zacharie Bowao d’une reconnaissance mutuelle de la liberté de penser, de croire, d’adhésion tout en respectant le choix de l’autre. Même si nous ne sommes pas d’accord avec autrui, nous sommes quand même tenus de laisser à l’autre le temps d’exprimer librement ses convictions, de pratiquer librement sa foi. Nous acceptons que sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel problème, sur telle ou telle valeur, même si nous ne partageons pas le même point de vue, nous acceptons le désaccord.
Ceci montre bien l’importance de la tolérance et dessine le chemin à suivre pour la fabrication du vivre ensemble ; un vivre ensemble qui n’est rien d’autre que l’expression même de la célébration de l’universel, c’est-à-dire, la mise en avant de l’humain. En célébrant l’universel, les sociétés africaines en quête du vivre ensemble comprendront que l’ethnie, la tribu qui sont des entités culturelles et sociales ne sont en réalité que des accidents, et que ces sociétés africaines doivent demeurées vigilantes pour que le vouloir vivre ensemble l’emporte sur la haine ethnique. Au nom de la tolérance, les sociétés africaines en proie aux conflits ethniques et tribales sortiront de la jungle pour célébrer le vivre ensemble. Il est vrai que la tolérance est une vertu difficile mais il faut que l’on y arrive en favorisant le respect et la reconnaissance, ce qui en réalité exige la réciprocité, c’est-à-dire une exigence adressée à soi et à l’autre. C’est pour cette raison que la tolérance n’est pas une exigence spontanée. Elle exige d’abord et avant tout une éducation surtout dans nos sociétés fragiles. Comme disait Yves Charles Zarka (2004) :
« la tolérance est donc difficile en tant que vertu morale. Elle est en effet porteuse d’une exigence implicite, elle s’adresse aux hommes comme êtres moraux. Autrement dit : l’invocation de la tolérance (soyez tolérants, soyez ouvert les uns aux autres, reconnaissez-vous mutuellement, acceptez vos différences etc.), relève d’un discours moral qui ne peut avoir de signification que pour un être capable d’agir moralement. »
La tolérance comme acceptation de la différence permet à nos sociétés africaines de sortir des considérations claniques, tout en favorisant le vivre ensemble. Nous ne pouvons pas parvenir à cette célébration de l’universel en restant enfermer dans nos tribus, dans nos ethnies, en choisissant nos conjoints, nos partis politiques, en fonction de notre appartenance ethnique et régionale.
Le tribalisme comme système de pensée politique n’est rien d’autre que l’expression de la négation d’autrui, c’est-à-dire le refus à l’ouverture au monde. Les sociétés africaines, en quête du développement, c’est-à-dire en voie vers l’émergence ne peuvent réellement accéder au développement que, si elles mettent la tolérance au cœur de leur système de pensée, car la tolérance renvoie à l’idée d’indulgence et de compréhension. Il s’agit de l’indulgence ou de la compréhension à l’égard de l’opinion d’autrui sur les points de dogme que l’église ne considère pas comme essentiels. Il s’agit en d’autres termes, de l’attitude dont dispose un individu à supporter la présence de l’autre, en dépit de leurs différences de cultures, de religion, d’ethnie ou de tribu. Il ne s’agit surtout pas d’approuver ni de désapprouver les raisons pour lesquelles l’autre vit différemment de moi car ces raisons expriment un rapport à la vérité et à l’erreur qui m’échappe à cause de la finitude de la compréhension humaine. Par conséquent, la vérité devient quelque chose que je ne domine pas, mais que je partage avec autrui. Avec la tolérance, aucune ethnie ou aucune tribu ne peut se dire détentrice de la vérité, car le rapport à la vérité devient un rapport de partage, pour la simple raison que la vérité devient quelque chose que je ne domine pas et que je ne constitue pas, mais quelque chose que je partage avec les autres. À ce sujet, l’analyse la plus fine est celle de John Rawls lorsqu’il déclare, que le vouloir vivre ensemble, dépend de la manière dont les communautés différentes peuvent coexister, alors qu’elles ont des représentations différentes du bien. Mais, comment y parvenir dans une Afrique émiettée en plusieurs ethnies, considérées comme l’arme même du politique africain ? Autrement dit, comment sortir de l’intolérance (source de guerres civiles) dans une société où la fragilité de l’ethnie pose problème ? Comment accéder réellement au vivre ensemble lorsqu’on sait que l’ethnie est souvent à l’origine de la plupart des conflits, des guerres civiles en Afrique ? Pourquoi les politiques africaines n’arrivent-elles pas à sortir de l’instrumentalisation ethnique ? Pourquoi vouloir absolument instrumentaliser son ethnie en la mettant en conflits avec d’autres ? Comme disait Charles Zacharie Bowao (2014. p. 69),
« en tant qu’élites, nous avons une responsabilité d’avenir, celle de promouvoir une dynamique de recomposition de l’espace politique, pour obtenir une reconsidération des populations désabusées par une pratique anachronique du pluralisme démocratique. »
Manifestement, on ne peut pas parler de paix, de justice, de vivre ensemble sans associer la politique ; pour la simple raison qu’elle est d’abord et avant tout la science de la cité, autrement dit, la science qui se donne pour mission, de gérer les affaires de la cité. Ce qui est d’ailleurs curieux, c’est le fait qu’en Afrique, et plus particulièrement dans des pays comme le Congo Brazzaville par exemple, le tribalisme occupe une place essentielle dans l’univers mental de ceux qui ont la responsabilité de gérer les affaires de la République. À titre d’exemple, un ministre qui est nommé se considère d’abord comme le délégué ou le représentant de son ethnie au sein du gouvernement. Il ne travaille qu’avec ses parents, les frères et les sœurs de son ethnie. Au lieu de se sentir investi d’une mission régalienne, ce dernier se considère d’abord comme étant au service de son ethnie, de sa tribu. Comme nous pouvons le constater :
« c’est presque un assujettissement généralisé de l’individu à un ordre sociologique qui rompt avec l’ordre républicain constitutionnellement fixé. Cette servitude s’exacerbe lors des élections où l’on observe hélas impuissamment comment dramatiquement la « tribu » se fait à la fois refuge et foyer électoral par « nos enfants » contre ceux qui viennent d’ailleurs. Et lorsque les « enfants » sont tous dans la même ethnie, c’est la préférence des axes qui prend le dessus. Celui-ci est de l’axe –sud, celui-là de l’axe – nord, ici aussi se trouve préfabriquée, localement, la bipartition politico-géographique du pays en Nord et Sud, sans centre, sans Est et sans Ouest. Dans chaque département et dans chaque district, il y a les gens du Nord et ceux du Sud, comme au niveau national. Puis il y a les originaires et les étrangers. » (Bowao, 2014, p. 69).
L’exemple que prend Charles Zacharie Bowao du Congo Brazzaville, montre à suffisance que la philosophie du vouloir vivre ensemble reste encore un grand problème dans l’espace politique congolais, et, que la question relative à l’ethnie demeure une arme incontournable pour la plupart de ces hommes politiques. Mais comment parler construction du vivre ensemble dans des sociétés fortement tribalisées ?
Ce tribalisme conduit à l’intolérance, et parfois à la dictature de la minorité sur la majorité. Au lieu de parler de pouvoir du peuple, on parlera du pouvoir d’une tribu, car il s’agit de la minorité au pouvoir qui instaure sa dictature, c’est-à-dire, il s’agit d’une tribu qui impose sa loi au nom du fils qui est au pouvoir. Par exemple, une minorité culturelle, religieuse, linguistique, ou autre, qui ne se maintient qu’en imposant sa loi à la totalité ou à une partie de la population qui en fait partie, ou même à certains individus qui la refusent, nous la qualifions de minorité oppressive. Il faut par conséquent, faire de la tolérance un principe au cœur du système politique en Afrique, parce qu’elle écarte les peurs et dissipe les malentendus. Comme disait Yves Charles Zarka (2004, p. 54),
« c’est même à cette condition qu’il sera susceptible de restaurer ou d’instaurer la coexistence dont je parlais tout à l’heure, c’est-à-dire la coexistence des groupes, de communautés, des peuples qui s’identifient différemment, qui se pensent comme étrangers l’un par rapport à l’autre, ne partageant ni des valeurs, ni une histoire, ni des projets. »
La tolérance est au cœur de la construction du vivre ensemble, dans nos sociétés africaines, parce qu’elle reste une valeur partagée autour de laquelle on note la notion de paix, de justice, d’équité et de réconciliation. Mais il n’y a pas de justice, de réconciliation et de paix sans pardon. Autrement dit, quel sens peut-on donner à la notion de pardon dans nos sociétés africaines en quête du vouloir vivre ensemble ? Comment pardonner à l’autre s’il est différent de moi ? À quelles conditions, le pardon peut-il contribuer à la dynamique du mieux vivre ensemble ?
3. PARDONNER POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Nous ne pouvons pas parler du bien vivre ensemble sans évoquer la notion de pardon. Autrement dit la construction du bien vivre ensemble dans nos sociétés africaines en proie aux conflits ethniques, aux guerres civiles… ne peut être rendue possible qu’en incluant le pardon comme valeur essentielle. Cela dit, qu’est-ce que le pardon ? Pourquoi pardonner ? Que peut apporter le pardon dans une Afrique en quête du bien vivre ensemble ?
Il n’est pas du tout aisé de définir ce qu’est le pardon compte tenu de la complexité du concept, et de son entrée dans le jargon philosophique qui en fait l’objet de plusieurs interprétations. Mais, en dépit de sa complexité définitionnelle, nous pouvons dire que le pardon qui vient du verbe pardonner, nous renvoie aux excuses, au repentir à la miséricorde, à l’indulgence, à la réconciliation au rachat, à la paix…. Le concept de pardon est devenu dans le langage courant l’expression d’une formule de politesse lorsqu’on a offensé, dérangé quelqu’un. Toutefois, s’il y a un concept dont on ne peut contester l’origine c’est bien le concept de pardon. Le pardon relève d’abord et avant tout du domaine religieux. Autrement dit, la notion de pardon, la culture européenne la doit essentiellement à son héritage religieux et en particulier au judaïsme, au christianisme et à l’islam. Dans la religion juive par exemple, le pardon est une exigence parce qu’il brise le cercle de la haine et de la violence. Il s’agit par-là d’obtenir le pardon de celui envers qui on a commis une faute ou à qui on a fait mal, car seul celui qui a subi le mal peut accorder son pardon. On peut constater cet état de fait dans cette invite de jésus, qui explicite la portée religieuse du pardon chez les juifs : « Lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. » (La Sainte Bible, Mathieu 5,24)
Tout en exigeant le repentir, le pardon dans la tradition juive exige aussi la réparation pour le mal commis vis-à-vis de l’autre qui a été offensé et blessé. Il s’agit par là d’une instauration d’un climat de justice vis-à-vis de l’autre et vis-à-vis de nous-mêmes. C’est pour cette raison que le verbe « pardonner » est très souvent utilisé dans les rencontres de jésus avec les pécheurs, lors des séances de guérison de malades, dans les paraboles, les discours et les paroles de jésus. Pardonner devient par conséquent, un acte qui concerne les hommes en dialogue entre eux et avec Dieu. C’est d’ailleurs, le sens même, que cette tradition chrétienne donne au concept de pardon, dans la mesure où il redonne la vie par-delà le mal subi et l’acte commis : « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » (Luc 6, 28). Cette tradition religieuse se donne aussi à voir chez les musulmans, qui, d’ailleurs, considèrent appréhendent le pardon comme une attitude d’excellence et de maîtrise de soi, car « celui qui est patient et qui sait pardonner témoigne d’une heureuse maîtrise de soi. » (C42 : 40)
Cependant, depuis quelques décennies, des philosophes s’efforcent d’acclimater la notion de pardon dans l’espace particulier de la philosophie, mais sans jamais l’abstraire de son lieu religieux de naissance.
En effet, la deuxième moitié du XXe siècle, confrontée à la question de l’impardonnable à travers celle de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, parait redonner à la réflexion sur le pardon un intérêt dans la sphère laïque, convoquant ainsi le questionnement philosophique. La question que l’on se pose ici et maintenant, est celle de savoir pourquoi la notion de pardon dans la construction du bien vouloir vivre ensemble. Que peut représenter la notion de pardon dans une Afrique victime de son propre tribalisme ?
Disons, tout d’abord que nos sociétés africaines, comme toutes autres sociétés d’ailleurs, sont toujours confrontées aux problèmes d’injustice, du manquement au droit et des rancœurs qu’il faut savoir gérer pour ne pas compromettre la construction du bien vouloir vivre ensemble qui assure l’épanouissement de tous. C’est ainsi que se pose la question du pardon. Autrement dit, pourquoi pardonner ?
La question du pardon est intimement liée à celle des fautes commises, car nous pardonnons parce qu’il y a des fautes qui ont été commises, et les liens qui existaient avant sont désormais coupés, et méritent d’être raccommodés, refaits par le biais du pardon, qui, assure la réconciliation et permet aux hommes de sortir de ce qu’on appelle la haine éternelle. Il s’agit par-là de créer les conditions de vivre en bonne entente, d’être en harmonie avec soi- même et avec les autres. Il s’agit en d’autres termes de participer à la dynamique de la bonne vie, parce qu’il ne s’agit pas seulement de vivre pour soi, mais aussi de vivre pour l’autre, considéré comme un appel. Comme disait Cyrille Koné (2010, p. 15) :
« le pardon introduit une réversibilité dans la chaine des événements. A l’opposé de la soumission et de l’humiliation, de la rancune qui ne permet d’entrevoir que des représailles ou virtuelles, le pardon laisse la possibilité d’une réversibilité, d’un retour sur l’offense initiale. Le pardon est considéré comme un arrachement a la singularité de la passion. Il favorise l’arrêt de la violence, ce qui permet de refonder l’Etat dans le sens de l’ordre sociopolitique meilleur. »
Le pardon dénoue les liens du passé et favorise l’harmonie sociale, le bien vivre ensemble, même si le passé et son cortège de malheurs ne sauraient être effacés puisque le temps écoulé ne peut par nature être modifié. Il est le moment de la reconnaissance de l’égalité avec autrui, moment où une conscience, dégagée de toute action dans le monde, renonce à son attitude surplombante, arrogante et hypocrite, et cesse de juger ceux qui se compromettent dans l’action. Comme disait Hannah Arendt, la mémoire du mal peut être travaillée, et contre le remord qui emprisonne le coupable dans le passé irréversible, contre la rancune qui enferme la victime dans la même fatalité, surgissent la possibilité du repentir et l’éventualité du pardon qui dénoue les nœuds du passé. Le mal n’est pas aboli, mais sa mémoire ne paralyse plus ceux qui l’ont subi, ni ceux qui l’ont commis. Un nouvel avenir, un nouvel espoir est alors offert à ceux qui se croyaient victimes à jamais de l’irréversibilité du passé. C’est dans ce sens qu’Hannah Arendt renvoie le pardon à son origine religieuse comme condition de l’agir humain. Le pardon qui est exactement la remise de la dette selon l’expression chrétienne, se voit donc reconnaitre un rôle dans les affaires humaines. Le futur peut être à renouveau ouvert, d’autres commencements peuvent être envisagés. Ce qui signifie en d’autres termes, que, le pardon participerait efficacement à l’harmonie sociale, à la bonne entente et à l’effacement des rancœurs dans une Afrique à la recherche d’un développement adéquat, car on ne peut rêver émergence comme cela est devenu un slogan dans la plupart des pays africains, sans pouvoir assurer l’harmonie sociale, le bien vivre ensemble. Il s’agit par le biais du pardon, de montrer qu’après plusieurs années de conflits de guerre tribales dans la plupart de nos pays africains, l’espoir du vivre ensemble peut être possible, parce que le pardon dénoue les conflits, libère les cœurs et permet aux uns et autres d’avoir espoir en un futur meilleur. Comme le réaffirme Hannah Arendt (1983, p. 302) : le « pardon sert à supprimer les actes du passé, dont les fautes sont suspendues comme l’épée de Damoclès au-dessus de chaque génération nouvelle. » C’est dans cette optique que les hommes politiques africains devraient mettre en place de telles initiatives, favorisant les conditions d’un vrai pardon, c’est-à-dire un pardon désintéressé et inconditionnel. Le politique est associé à ce genre d’initiative, parce qu’il reste toujours comme acteur majeur de l’instrumentalisation ethnique. C’est de là que réside la souffrance de la pensée politique africaine, qui, loin d’être au service de la cité, reste essentiellement enfermer dans la célébration de la tribu, de l’ethnie. Mais comment créer les conditions du bien vouloir vivre ensemble, tout en donnant du sens à la notion de pardon ?
Dans les relations humaines, les mots et les expressions utilisés pour dire le pardon ont des sens différents à savoir présenter des excuses, faire part de regrets, reconnaitre des responsabilités, faire acte de repentir, demander pardon, ces différentes expressions n’ont pas le même sens ni la même portée. Et les victimes qui les reçoivent peuvent se sentir à leur écoute, plus ou moins reconnues et réhabilitées dans leur être, et que les conséquences peuvent être très importantes. Qu’une institution, qu’une personne reconnaisse sa responsabilité dans les guerres, dans les crimes et génocides commis, cela peut conduire à réparer le tort qui a été fait. On peut par exemple, citer le cas du geste de l’ancien Secrétaire Général des Nations unies, Kofi Annan, qui, en 1999 a publiquement présenté des excuses pour avoir été passif pendant le génocide rwandais. Aussi, l’on peut noter récemment, en Avril 2014, le geste symbolique du pape François[66] à propos des faits de pédophilie commis par quelques hommes d’Église.
« Je me sens, dit-il, dans l’obligation d’assumer tout le mal commis par quelques prêtres, un petit nombre au regard de tous les prêtres, et de demander personnellement pardon pour les dommages qu’ils ont causés en abusant sexuellement d’enfants. (…) Je crois que les sanctions doivent être très sévères ! On ne joue pas avec les enfants ! »
Dans la même optique, on peut également citer le geste chargé d’histoire entre François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl qui, en 1984, se sont recueillis, mains dans la main, devant l’ossuaire de Douamont, près de Verdun, pour rendre hommage aux millions de morts de la guerre 1914-1918. Ce geste chargé de symboles n’était rien d’autre qu’une manière de demander pardon, tout en scellant en même temps la réconciliation entre les deux peuples. Cette dimension du pardon permet finalement aux uns et aux autres de se refaire, tout en réinitialisant les relations entre les personnes d’une même communauté ou de communautés différentes. Tel a été le cas, de la question politique en Afrique du Sud où Nelson Mandela en mettant sur pied la commission « vérité et réconciliation », a voulu montrer la portée historique de la notion de pardon. Comme l’a su très bien dire le Président de la commission, Monseigneur Desmond Tutu (2000, § 36) :
« Je soutiens qu’il existe une autre forme de justice, une justice reconstructive, qui était le fondement de la jurisprudence africaine traditionnelle. Dans ce contexte-là, le but recherché n’est pas le châtiment ; en accord avec le concept d’Ubuntu, les préoccupations premières sont la réparation des dégâts, le rétablissement de l’équilibre, la restauration des relations interrompues, la réhabilitation de la victime, mais aussi celle du coupable auquel il faut lui offrir la possibilité de réintégrer la communauté à laquelle son délit ou son crime ont porté atteinte. »
CONCLUSION
Ainsi, pour accéder à la célébration de l’Universel, nos sociétés africaines doivent fortement cultiver le pardon et la tolérance, considérés comme des notions essentielles dans la contribution du vivre ensemble. Si certains pays africains comme le Rwanda, l’Afrique du Sud… ont pu se relever et devenir l’incarnation renouvelée du vivre ensemble, c’est parce qu’ils ont su cultiver la paix par le biais de la tolérance et du pardon[67], Considérés, comme un processus de réparation et de réconciliation. Le futur monde de l’Afrique, n’est possible qu’à partir du refus de ce repli identitaire qui crée intolérance et tribalisme. La nouvelle Afrique, est celle qui devrait penser fraternité, il s’agirait en d’autres termes, d’une Afrique qui rassemble ses fils et cultive le vivre-ensemble. Comme l’a très justement souligné, Charles Zacharie Bowao (2007, p. 51),
« ma conviction est que l’avenir de l’identité africaine est dans l’identité de l’avenir, celle du devenir monde de l’humanité, celle de ce temps mondialisé qui sublime l’universalité de la condition humaine. Si non, alors cette identité africaine n’est pas et jamais ne sera. L’avenir de la tolérance en Afrique se jouera de ce côté-là et non dans la célébration romantique du passé. »[68]
BIBLIOGRAPHIE
ARENDT H., 1961 et 1983, Condition de l’homme moderne, Traduit de l’anglais par Georges Fradier, Préface de Paul Ricœur, Calmann-Lévy.
AKA-EVY J.-L., 2016, « Leçon inaugurale sur le vivre ensemble », Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Brazzaville.
BOWAO C. Z., 2007, La Tolérance, Brazzaville, Editions Hemar.
BOWAO C. Z., 2013, Surgissement éthique ou retour à l’humain, Brazzaville, Editions Hemar.
BOWAO C. Z., 2014, L’imposture ethnocentriste. Plaidoyer pour une argumentation éthique du politique, Brazzaville, Editions Hemar.
DEBRAY R., 2009, Le moment fraternité, folio essais, Paris, Gallimard.
DEBRAY R.,2013, Éloge des frontières, Paris, Gallimard.
FICHTE, 1964, Œuvres choisies de philosophie première, trad.fr. Alexis Philonenko, Paris, Vrin.
KONE C., 2010, Le pardon en politique : condition nécessaire à la consolidation démocratique, communication du 30 mars, Ouagadougou, Centre pour la Gouvernance Démocratique Burkina Faso.
LEVINAS E., 1982, Éthique et infini, Fayard/France culture.
LOCKE J., 1992, Lettre sur la tolérance, Paris, GF.
NGOÏE-NGALLA D, 2015, Propos sur l’Afrique, Bajag-Meri, Paris.
OBENGA T., 2007, Appel à la Jeunesse Africaine, Ccinia communication.
RICŒUR P., 2000, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil.
RICŒUR P.,1999, Lecture 1. Autour du politique, Paris, Seuil.
RICŒUR P.,1990, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil.
RICOEUR P. et CHANGEUX J.-P., 1998, Ce qui nous fait penser, la nature et la règle, Odile Jacob.
TUTU D., 2000, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Paris, Albin Michel.
ZARKA C.-Y., 2004, Difficile tolérance, Paris, PUF.
ZARKA C.-Y., 2004, La tolérance : une vertu difficile, Université de Ferrara, 15 Novembre.
Autres textes consultés
La Sainte Bible, traduite d’après les textes originaux Hébreux et Grec par Louis SEGOND, Edition Revue avec Références, Alliance Biblique Universelle.
Journal Le Parisien, du 11 Avril 2014.
[1] Mot italien qu’on pourrait traduire en français par l’expression : “de façon sensée”
[2] Au sens freudien du terme, c’est l’énergie sexuelle qui sous-tend tout désir humain et qui se trouve souvent couronnée de plaisir.
[3] C’est l’ensemble des qualités exceptionnelles de jugement qui permettent au politique ingénieux de prendre les bonnes décisions selon les circonstances propices du moment.
[4] Organisée sur initiative de la présidence française, la table ronde de Linas Marcoussis et la conférence des chefs d’Etats africains ont lieu respectivement du 15 et du 25 au 26 janvier 2003. Elle avait pour mission de dégager un consensus entre les différents partis politiques et les rebelles qui défient le pouvoir Institutionnel du président GBAGBO.
[5] A en croire Félix Houphouët-Boigny, il s’agissait pour les pays africains et asiatiques de déterminer la voie pouvant les conduire à la neutralité dans le contexte de division du monde en deux blocs antagonistes, F. Houphouët-Boigny, 1978, Anthologie des discours 1946-1978. Tome III du 28 avril 1971 au 31 décembre 1974, Abidjan, CEDA, p.1166.
[6] « Notion développée à partir du XVIIe siècle, la neutralité est la politique adoptée par un Etat qui reste à l’écart d’une guerre affectant deux ou plusieurs Etats s’abstenant d’y participer directement, en prenant part aux hostilités, ou indirectement en assistant l’un ou l’autre des belligérants », Dario Basttistella, Franck Petiteville, Marie-Claude Smouts, Pascal Vennesson, 2012, Dictionnaire des relations internationales, 3e éd., Paris, Dalloz, p.381.
[7] Développé par le premier ministre indien, Nehru, le neutralisme positif est une doctrine ou un système politique impliquant le refus d’intégrer l’un des blocs politique et idéologique en lutte pour le contrôle du monde.
[8] Plus actif, le neutralisme positif nassérien préconise une attitude militante consistant à tirer profit de la belligérance entre les deux grands sans pour autant basculer dans l’un ou l’autre bloc.
[9] Le non-alignement désigne l’attitude d’un Etat refusant de s’aligner sur l’un ou l’autre des blocs conduit par les Etats-Unis et l’Urss.
[10] Pour le président ivoirien, le neutralisme positif et le non-alignement étaient incapables de préserver l’indépendance de l’Afrique face aux deux blocs antagonistes qui se disputaient le contrôle du monde. Et pour cause, le premier ne reposait sur aucun fondement concret ; par le passé, aucune expérience similaire n’avait existé dans l’histoire ; pire, les conditions de réalisation de cette politique n’étaient pas établies. De plus, le neutralisme n’avait pas suffi à empêcher les affrontements entre l’Inde et la Chine populaire en 1962 : l’Inde n’avait dû son salut qu’à l’intervention de l’Urss et des Etats-Unis. Quant au non-alignement, il portait en lui une grave contradiction : l’un des principaux tenants de cette ligne, la Chine populaire, était la seconde puissance du communisme. Ce qui rendait peu crédible une telle politique, F. Houphouët-Boigny, 1978, op.cit.pp.1166-1167.
[11]«Et c’est ainsi que nous avons été amenés, au cours du Ve Congrès du P.D.C.I-R.D.A qui s’est tenu à Abidjan du 29 au 31 octobre 1970, à proposer une véritable neutralité, une neutralité qui a fait ses preuves, puisque reposant sur des données réelles et saines : la neutralité telle qu’elle est pratiquée en Suisse. » Idem, p.1168.
[12]Créé en 1946 à Bamako (Mali) par Houphouët-Boigny et ses amis, le Rassemblement démocratique africain (RDA) est un grand rassemblement de plusieurs organisations politiques africaines d’alors. Il était dirigé par le député ivoirien, Houphouët-Boigny, et disposait de sections dans différents pays africains. De fait, la politique ivoirienne de neutralité absolue ne date pas des années 1970 : elle est inspirée « de la politique menée par le président du RDA entre 1945 et 1960. Elle est la continuation de cette vision d’une Afrique libre et égale aux continents les plus développés, rivalisant avec eux dans une compétition pacifique dont le bonheur de l’homme est le but final. », Arsène Assouan Usher, 1971, «Dans l’intérêt et pour la dignité de l’Afrique », Fraternité Matin, n°1944, p.4.
[13]Le 28 avril 1971, au cours d’une conférence de presse sur le dialogue de près de 5h d’horloge, dans les locaux de l’Assemblée nationale à Abidjan, le président Houphouët-Boigny était face à de nombreux journalistes venus des quatre coins du monde, pour défendre sa politique de neutralité et de dialogue.
[14]Il s’agissait principalement de la Tanzanie, de la Zambie, du Congo-Brazzaville, de l’Algérie et de la Guinée. Ces pays avaient récusé violemment la proposition ivoirienne de dialogue avec l’Afrique du Sud, accusant le président Houphouët-Boigny d’être à la solde de puissances étrangères dont le but était de diviser l’Afrique et l’Organisation de l’unité africaine (OUA).Pour ces derniers, cette proposition serait guidée également par des intérêts matériels : le désir de bénéficier des investissements en provenance de l’Afrique du Sud ou d’en tirer des profits personnels, Arsène Assouan Usher, 1971, « Dans l’intérêt et pour la dignité de l’Afrique », Fraternité Matin, n°1944, p.1.
[15]Au nombre des opposants à la politique de neutralité ivoirienne, il faut compter également les lobbies financiers londoniens, représentés par les journaux l’Economist et le Financial times, qui avaient tourné en dérision la proposition ivoirienne de dialogue avec l’Afrique du Sud, Arsène Assouan Usher, « Du dialogue comme méthodologie de la neutralité », Fraternité Matin, 1971, n°1939, p.1.
[16]Dans cette rivalité, le président ivoirien pouvait compter sur le soutien des présidents Bokassa de la Centrafrique, Oumar Bongo du Gabon et de ses pairs des pays membres du conseil de l’Entente (Haute-Volta, Dahomey, Niger, Togo), Fraternité matin, 1971, n°1950, p.10
[17]A cette époque, plusieurs problèmes retenaient l’attention de l’Afrique: il s’agissait, entre autres, du sous- développement, du colonialisme portugais en Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique, des questions de la Rhodésie, de la Namibie, de l’apartheid en Afrique du sud etc.
[18]Avec la guerre froide, apparaissent deux forces majeures qui se disputent le contrôle du continent : les conservateurs et les progressistes. Les premiers regroupent les pays dits modérés (Côte d’Ivoire, Haute-Volta ou actuel Burkina-Faso, Dahomey ou actuel Benin, Congo-Kinshasa ou actuel République démocratique du Congo, Tchad, Centrafrique, Nigeria, Togo, Sénégal, Liberia, Niger, Cameroun etc.) favorables à une coopération avec les anciennes puissances coloniales et l’Occident. Les seconds sont les adeptes du marxisme-léninisme et rassemblent les pays dits progressistes (Ghana, Guinée, Algérie, Tanzanie, Mali, Zambie, Libye, Congo-Brazzaville…), satellites des puissances socialistes dont l’Urss.
[19]Comme régimes, nous avions la Guinée de Sékou Touré, la Somalie de Syad Barré, la Libye de Kadhafi, l’Ethiopie de Mengistu Haïlé Mariam, le Congo-Brazzaville de Marien Ngouabi etc ; comme mouvements pro communistes, il y avait le Parti africain de l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), le Front populaire de libération de l’Erythrée (FPLE)…
[20]Le PAIGC dans les colonies de Guinée-Bissau et de Cap-Vert, le MPLA en Angola et le FRELIMO au Mozambique.
[21]En Afrique australe, l’African National Congres (ANC) en Afrique du Sud, la South west african people organization (SWAPO) en Namibie, la Zimbabwe african national union (ZANU) au Zimbabwe.
[22]Les premières sanctions contre ce pays interviennent en 1977 avec l’embargo total sur les livraisons d’armes décidé par le Conseil de sécurité, Philippe Moreau Defarges, 2003, Relations internationales. 1. Questions régionales, Paris, Editions du Seuil, p.297.
[23]Jacques Baulin, 1980, La politique africaine d’Houphouët-Boigny, Paris, Editions Eurafor-Press, pp. 116-121 ; 205-206.
[24]Après une première tentative de sécession dans les années 1959-1966, le Sanwi, région du sud-est de la Côte d’Ivoire, était entrée à nouveau en sécession en 1969. Prenant prétexte de la reconnaissance du Biafra par la Côte d’Ivoire, les séparatistes conduits par Ehounoud Bilé avaient réclamé à leur tour l’autonomie du Sanwi.Plusieurs d’entre eux étaient arrêtés et emprisonnés, puis libérés en 1973. Cependant, il faut attendre 1981 pour que l’affaire Sanwi soit définitivement réglée, Camille Alliali, 2008, Disciple d’Houphouët-Boigny, Abidjan, Juris-Editions, p.92.
[25]En 1970 éclatait l’affaire du Guébié dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Un membre de cette tribu, Kragbé Gnabé Opadjèlè, qui s’était remarqué par la création d’un parti politique, le Parti nationaliste (PANA), proclamait à Gagnoa la « république d’Eburnie » censée mettre fin aux problèmes fonciers des Bété aggravés par l’arrivée massive de planteurs allochtones. L’armée intervint pour mater la rébellion causant plusieurs morts. Des rebelles étaient arrêtés, jugés et condamnés en 1974 puis amnistiés en 1975, Jean-Noël Loucou, Simon-Pierre Ekanza M’bra(dir.), 1987, Mémorial de la Côte d’Ivoire, Abidjan, Editions Ami, p.141.
[26]Message de nouvel an adressé à la nation le 31 décembre 1967, Secrétariat d’Etat chargé des affaires culturelles de la République de Côte d’Ivoire, 1975, Le président Houphouët-Boigny et la nation ivoirienne, Abidjan/Dakar, NEA, p.201.
[27]La guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), la guerre civile congolaise (1960-1965), la guerre civile tchadienne (1965-1975), la guerre du Biafra (1967-1970), les guerres de décolonisation d’Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, de l’Erythrée, du Sud-Soudan…
[28]Les divergences idéologiques entre leaders africains, les problèmes de l’apartheid en Afrique du sud, la question namibienne, les ingérences libyennes au Tchad à partir de 1969, les coups d’Etat ou tentatives de coup d’Etat (Egypte, Sénégal, Togo, Bénin, Congo, Gabon, Algérie, Zaïre, Centrafrique, Haute-Volta, Ghana,) etc, constituaient autant de facteurs de guerre latente.
[29]Supra, p. 2.
[30]Pour le président ivoirien, le communisme, notamment le communisme chinois, constituait l’élément perturbateur de la paix sur le continent : « Ainsi, pendant que le danger du communisme russe s’estompe, apparaît sur le sol africain le communisme chinois, intransigeant, inhumain, facteur de haine et de division. Avec ses armes redoutables de la subversion et son mépris absolu de la personne humaine, la Chine populaire masque à peine ses visées expansionnistes en Afrique.», Paul-Henri Siriex, 1986, Houphouët-Boigny ou la sagesse africaine, Paris, Nathan, pp. 326-327.
[31]Baulin Jacques, 1980, op.cit, pp.205-206.
[32]Le « Groupe de Brazzaville » est né à la suite de la conférence de Brazzaville (ex-Congo-Brazzaville) du 15 au 19 décembre 1960 et comprend douze pays (Côte d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Madagascar, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, Niger, Dahomey, Haute-Volta, Gabon, République Centrafricaine, Tchad).
[33]Le « Groupe de Monrovia » est né à la conférence de Monrovia (Liberia) de mai 1961 et comprend les pays du « Groupe de Brazzaville », l’Ethiopie, le Liberia, la Libye, le Nigeria, la Sierra-Leone, le Togo, la Tunisie et la Somalie.
[34]Jean-Noël Loucou, Simon-Pierre Ekanza M’bra(dir.), 1987, op.cit, p.148.
[35]Gnagne Antoine Sess, 2015, « La politique étrangère de la Côte d’Ivoire sous Houphouët-Boigny (1960-1993) », Revue d’Histoire, d’Art et d’Archéologie Africain, Godo Godo, N° 2015, p.15.
[36]Jean-Noël Loucou, Simon-Pierre Ekanza M’bra(dir.) (1987), op.cit, p.148.
[37]Marc Aiko Ziké, 1994, La politique étrangère de la Côte d’Ivoire (1959-1993), Chine, Copreca-Edition, p.74.
[38] Marc Aiko Ziké, 1994, op.cit, pp.103-105.
[39] Jean-Vincent Zinsou, 2006, « La partition de Félix Houphouët-Boigny et sa politique étrangère », Fraternité Matin, n°12511, cahiers gratuits, n°103, p.VI.
[40] Marc Aiko Ziké, 1994, op.cit, pp.150-152.
[41] Idem, pp.120-131.
[42] Ibidem, pp.74-76 ; pp.150-152.
[43] Paul-Henri Siriex, 1975, Félix Houphouët-Boigny, l’homme de la paix, Paris, Editions Seghers/Nouvelles éditions africaines, pp.331-332.
[44]Marc Aiko Ziké, 1994, pp.120-122.
[45]Idem, pp.99-100.
[46]Ibidem, pp.105-106.
[47]«Affirmation d’une politique de non-alignement à l’égard de tous les blocs. », article III, 7 de la charte de l’OUA, Fraternité Matin, 2013, spécial 50 ans OUA/UA, p.24.
[48]Paul-Henri Siriex, 1975, op.cit, p.334.
[49]Comme textes, on peut citer la Déclaration du Congrès de Vienne concernant la Suisse (20 mars 1815), la Lettre circulaire de la Diète aux gouvernements des cantons (3 avril 1815), l’Acte d’accession de la Confédération suisse à la Déclaration du Congrès de Vienne (27 mai 1815), l’Acte portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire (20 novembre 1815, Paris), le Traité de Versailles (28 juin 1819), la Déclaration de Londres (13 février 1920), la Résolution du Conseil de la Société des Nations (14 mai 1938), Bridel René, 1968, Neutralité : une voie pour le Tiers Monde ?, Montreux, Editions L’âge d’homme, pp.39-41.
[50]Gnagne Antoine Sess, 2015, op.cit, pp. 13-14.
[51] MOLINIE, Georges, La stylistique, Paris, PUF, 1993, p. 2-3.
[52] MOLINIE, Georges, La stylistique, Que sais-je ?, Paris, PUF, 2ème édition corrigée, 1991, p. 3.
[53] Dans la première partie de Eléments de stylistique française intitulée “LE CHAMP STYLISTIQUE”, Georges Molinié indique qu’il existe cinq postes d’analyse stylistique. En dehors du poste de la figure, il y a les postes du matériel lexico-sémantique, de la caractérisation, de l’organisation phrastique et de l’énonciation.
[54] Sur ce texte additif, Il est mentionné ceci : “SUPPLEMENT UNIQUE A DEJA-VU de N.X Ebony. Ne peut être vendu séparément. N. X. Ebony et les Editions Ouskokata… Dans Déjà-vu suivi de Chutes quelque part, une sorte d’œuvre complète de l’auteur publiée en 2010 par L’Harmattan, ce poème a été pris en compte comme faisant partie des poèmes formant ce texte poétique. On le retrouve aux pages 199 et 200.
[55] Pierre Fontanier, éditeur de Commentaire des tropes de Du Marsais, est le premier théoricien des figures de style, notamment : Manuel classique pour l’étude des tropes (1821) et Les Figures du discours (1827). Il réduit les tropes à la métonymie, à la synecdoque et à la métaphore. Fontanier a ainsi pu décrire une véritable théorie des tropes, sans être pour autant exhaustif dans leur énumération, qui a beaucoup contribué aux classifications modernes. On lui doit la théorie de la figure-écart.
[56] MOLINIE, Georges, La stylistique, Paris, PUF Que sais-je ?, 1ère édition, 1989, p. 118.
[57] Tous les autres tropes ne sont que des variétés respectives de ces deux.
[58] La valeur d’un mot renvoie au sens qu’il acquiert dans son contexte d’emploi.
[59] Le sigle UNJCI signifie : Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire.
[60] PARENT, Monique, « La fonction poétique dans deux textes de Saint John PERSE » in Revue de philologie et littérature romane, université de Strasbourg IX, I61971.
[61] EBONY, Noël X., Déjà – vu, Paris, Ouskokata, 1983.
[62] Les exemples sans références sont de nous-même.
[63] Phrases citées supra
[64] Selon Paul Ricœur, la tolérance, c’est « le fait de tolérer quelque chose, de ne pas interdire ou exiger alors qu’on le pourrait ; liberté qui résulte de cette abstention… Mais abstention de qui ? Qui pourrait ne pas s’abstenir ? Et comment passe-t-on de l’abstention à la liberté qui en résulte ? », Lecture 1, p. 296.
[65] John Locke, Lettre sur la tolérance, Paris, GF, 1992. p. 11.
[66] Journal Le Parisien, du 11 Avril 2014. Nous pouvons aussi citer, l’un des moments marquants de sa visite de cinq jours en Pologne, pendant les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), de juillet 2016, où il a inscrit dans le livre d’or, par rapport à l’horreur de l’Holocauste : « Seigneur, aie pitié de ton peuple, Seigneur pardon pour tant de cruauté. »
[67] Confère Paul Ricœur, dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Editions du Seuil, 2000.
[68] Nous pouvons aussi lire chez Théophile OBENGA : « la quête du destin africain et son accomplissement, à l’échelle humaine, n’est que ce chemin d’unité, de solidarité, de partage, de concertation panafricaine, de grande vision continentale, transcendant lignages, clans, villages, tribus, États-nations, plaies des guerres civiles, précarités sociales, vulnérabilités psychologiques, fragmentations et fragilités politiques au plan mondial, international, planétaire. Dure et longue est par conséquent la tâche. » (Appel à la jeunesse africaine, p. 94.)